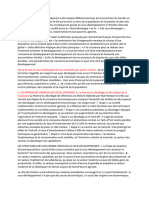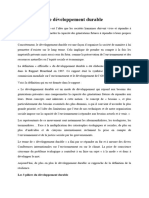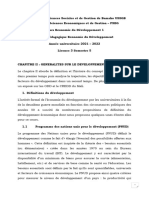Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Développement Economique Et Durable
Le Développement Economique Et Durable
Transféré par
Ilyas MouhajiriTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Développement Economique Et Durable
Le Développement Economique Et Durable
Transféré par
Ilyas MouhajiriDroits d'auteur :
Formats disponibles
Economie générale CPGE ECT
Le développement: finalité de la croissance
I. Relation croissance et développement économique :
1. La croissance doit pouvoir conduire au développement :
La croissance est nécessaire au développement : satisfaire les besoins essentiels et physiologiques (alimentation,
habillement et équipement de la maison) et accéder aux services de base (santé, éducation, transport, distribution
d'eau potable) suppose un minimum de richesse.
La croissance permettra donc d’améliorer les niveaux de vie, d’augmenter l’étendue des choix humains, de
dégager des ressources en faveur de la santé, l’éducation et d’accroître l’indépendance économique nationale en
rendant l’aide étrangère moins nécessaire. Mais elle n’est pas une condition suffisante du développement, au
moins à court terme, si elle n’est pas accompagnée de politiques visant à une réduction directe de la pauvreté.
En effet, la croissance peut aller de pair avec un accroissement des inégalités, une détérioration des conditions
de vie pour les plus pauvres, la misère et la répression politique et sociale. On parlera alors de « croissance sans
développement».
2. Le développement permet à la croissance de se prolonger :
A son tour, le développement favorise la croissance. Selon les théories de la croissance endogène, il permet
l'accumulation du capital humain (formation des individus), l'accroissement des dépenses de recherche-
développement et d'infrastructures... qui seront, à leur tour facteurs de croissance.
Préparé par Mme Rh. SEKKEL 1
Economie générale CPGE ECT
II. Croissance économique et développement durable :
Le Développement durable est mode de développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à pouvoir répondre aux leurs.
Ce développement repose sur plusieurs principes :
o le principe de solidarité, avec les générations futures et avec les populations de la planète;
o le principe de précaution, qui privilégie une approche préventive plutôt que réparatrice;
o le principe de participation de tous les acteurs de la société civile au processus de décision.
1. Les conséquences de la croissance :
La croissance n’est pas toujours facteur de bien-être pour les raisons suivantes :
La mauvaise répartition de la richesse (10% des plus riches accaparent 50% du revenu national).
Les richesses crées peuvent être d’une faible utilité sociale (armement, cigarettes…) contrairement à
l’électricité ou aux soins médicaux qui ont une portée sociale bien plus utile.
Le « paradoxe d’abondance » est un concept où l’individu ne voit pas son bien-être augmenter lors de
son enrichissement car il s’habitue aux biens acquis et donc n’est plus satisfait par ceux-ci.
Le groupe de référence d’un individu forgera ses envies et aspirations aux vues des biens des autres
membres de ce groupe, ce qui le poussera a vouloir toujours mieux et plus. Si chaque individu du
groupe de référence en question agit de la même manière, l’insatisfaction sera permanente.
Aujourd’hui le marketing a une place prépondérante dans notre société. La publicité crée de nouveaux
besoins qui nécessitent donc plus d’argent donc une plus grande quantité de travail par l’individu. Or si
l’individu travaille plus son bien être diminue mais son temps libre également et donc il devra avoir
recours à de nouveaux produits qui constitueront un gain de temps (comme les plats surgelés par
exemple).
La croissance dégrade les ressources naturelles pour les raisons suivantes :
Dans la production, des richesses naturelles peuvent être détruites comme le pétrole, des espèces
peuvent tendre à disparaitre comme le poisson, ou comme à cause de la déforestation. Une partie de ce
capital naturel n’est pas reproductible.
La « Sixième extinction ». La biodiversité est en danger à cause des actions humaines qui exploitent ou
détruisent des espèces animales ou végétales et endommagent gravement les écosystèmes les abritant.
On passe à une période dans laquelle l’homme devient la force géologique dominante et transforme la
terre à son seul profit.
La hausse de la croissance induit une forte production et ainsi une activité industrielle importante. Cette
dernière contamine des courants d’eaux ou encore l’air environnant. A l’échelle planétaire les
conséquences sont multiples : pluies acides, réchauffement de la terre, fonte du pole Nord, trou dans la
couche d’ozone… Des risques cancérigènes pour l’Homme sont également à noter.
2. Les objectifs du développement durable :
La définition du rapport « Notre avenir à tous », dit rapport Brundtland, a été plus ou moins délaissé au profit
d’une explication s’appuyant sur trois piliers : le progrès économique, la justice sociale, et la préservation de
l’environnement.
Préparé par Mme Rh. SEKKEL 2
Economie générale CPGE ECT
Figure 1 : schémas du développement durable
Ces trois aspects doivent pouvoir répondre à l’objectif de construire le développement durable aussi
bien pour les collectivités que pour les entreprises.
3. Les indicateurs du développement durable :
a. L’empreinte écologique :
Un indicateur qui mesure la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation
quotidienne. Elle dépasse de 20% les capacités biologiques de la planète. Elle a doublée en l’espace des 30
dernières années. Celle des pays riches est 6 fois plus importante que celle des pays pauvres.
b. Le PIB Vert
Le PIB Vert consiste à partir du PIB (évalué en unité monétaire) à soustraire tous les dommages écologiques et
sociaux que peut causer la croissance. Inversement, en rajoutant tout ce qui contribue au bien-être de la
population comme les infrastructures, la prise en charge par l’État de biens collectifs (culture, etc.).
c. Les indicateurs du bien-être
Ces indicateurs combinent les dépenses de consommations d’un pays auxquelles on ajoute les contributions
non-monétaire correspondant à la production Domestique. Cependant, on déduit tout ce qui (dans le social)
traduit les inégalités ainsi que tout ce qui touche aux problèmes écologiques.
Préparé par Mme Rh. SEKKEL 3
Economie générale CPGE ECT
III. La préservation de l’environnement est aujourd’hui admise comme l’une des conditions d’une
croissance économique durable :
1- Les théories de la décroissance :
Les théoriciens de la décroissance s’appuient sur différents constats pour appeler à la transformation des
modes de production et de consommation :
Dans son rapport 2007, Un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé, le PNUE souligne
«L’une des plus rudes leçons qu’enseigne le changement climatique, c’est que le modèle économique de la
croissance et la consommation effrénée des nations riches sont écologiquement insoutenables.» paru au début
des années 1970, la théorie de la décroissance a été popularisée, développée et approfondie en France.
Les politiques de développement durable promises par les États comme par les organisations
internationales n’ayant produit que peu d’effets (soit parce que les dispositions adoptées ne sont jamais entrées
en vigueur, soit parce que les politiques décidées manquaient d’ambition au regard des défis à relever), les
partisans de la décroissance appellent à un renversement total du modèle productiviste prévalant dans les
sociétés modernes depuis la Révolution industrielle. La société de consommation, la recherche du profit,
l’exploitation anarchique des ressources naturelles sont autant de réalités avec lesquelles les partisans de la
«simplicité» entendent rompre.
Le développement durable est également dénoncé comme ne remettant pas en question les modèles
économiques prévalant depuis la Révolution industrielle. Les opposants au développement durable lui
reprochent principalement de légitimer un système économique considéré par eux comme inique, en acceptant
simplement d’en minimiser les effets par quelques artifices environnementaux.
Au final, le productivisme et son corollaire, la recherche de profits, ne seraient nullement remis en cause et
même approfondis par ces politiques.
Le rapport publié en 1971 (rapport Meadows ou "Halte à la croissance", traduction française) préconise
une croissance nulle. Selon lui, la persistance de la croissance entraîne un épuisement accéléré des ressources
naturelles, un accroissement de la pollution et un accroissement du fossé entre Nord et Sud. Le rapport veut
attirer l'attention sur les dangers d'une croissance indéfinie, exponentielle : c'est l'époque où les "30 glorieuses"
n'ont pas encore pris fin, deux ans avant le premier choc pétrolier, une période de croissance effrénée et
d'explosion démographique exceptionnelle à l'échelle de l'histoire. Le terme de "croissance zéro" n'est cependant
inventé qu'en 1973, par Alfred Sauvy.
2- Les politiques économiques de l’environnement :
Les politiques environnementales ont pour objectif de faire évoluer les comportements des
consommateurs mais aussi des producteurs. Pour protéger l’environnement, l’État dispose principalement de
trois types d'instruments : la réglementation, la taxation et le système de permis échangeables.
a) La réglementation :
Les instruments réglementaires reposent sur la contrainte. Il s'agit ici d'interdire ou d'autoriser certains
comportements au moyen de règles et des normes. Ces instruments ne laissent aucun choix aux agents à qui ils
sont imposés. En cas de non-respect, ces derniers subissent des sanctions administratives ou judiciaires. Parmi
ces normes on retrouve :
Les normes d'émissions ou de rejet qui définissent des seuils à ne pas dépasser ou à respecter sous peine
sanction. Il y a ici une obligation de résultat. Exemple : Certains produits phytosanitaires ont été
complètement interdits, normes d'émissions de polluants pour les véhicules...
Les normes de procédé imposent l'utilisation de technologies spécifiques pour empêcher la pollution ou
dépolluer. Ce sont des obligations de moyens. Exemples : pot catalytique, recyclage des déchets ...
Les normes de produits qui imposent des caractéristiques et des exigences particulières obligatoires pour un
produit. Exemples : phosphates dans les lessives, teneur en soufre des combustibles, interdiction des gaz
CFC dans les bombes aérosols...
Préparé par Mme Rh. SEKKEL 4
Economie générale CPGE ECT
Les normes de qualité qui précisent les caractéristiques souhaitables du milieu récepteur des pollutions
(niveau de bruit maximum, concentration maximale de nitrates par litre d'eau, ..). Ces normes définissent
davantage des objectifs à atteindre qui servent de base aux politiques pour élaborer des normes d'autre type.
La réglementation est un instrument efficace pour lutter contre les pollutions les plus dangereuses.
Néanmoins elle présente un certain nombre de limites :
Une des difficultés de la norme est de déterminer le niveau de la norme. Comment fixer le niveau ? S'il est
trop ambitieux, l'objectif de réduction des émissions risque de ne pas être atteint. Trop laxiste, la norme
risque de ne pas être utile.
La norme, uniforme, n'est pas toujours l'instrument le plus adapté, en particulier lorsque les sources
d'émission sont trop hétérogènes comme par exemple dans le secteur de l'électricité où différents
combustibles sont utilisés. Il faudrait donc des normes différenciées dans ce cas.
L’uniformité de la norme a des effets négatifs sur les petits producteurs qui peuvent les conduire à la faillite
car le coût économique de mise aux normes peut leur être fatal.
Si la norme est trop sévère alors les pollueurs peuvent chercher à la contourner en fraudant. Si cette norme
n'est pas appliquée au niveau international, les producteurs vont alors délocaliser leur production dans des
pays moins exigeants.
Du point de vue économique, elle nécessite un système de contrôle qui peut s’avérer coûteux et difficile
à faire fonctionner efficacement. C'est pourquoi les économistes préconisent les outils économiques qui
permettent d'atteindre les mêmes résultats mais à moindre coût. De plus, la norme n'incite pas les agents
économiques à faire mieux que ce qui est prescrit, contrairement à certains instruments comme la taxe.
b) La fiscalité environnementale :
Une taxe environnementale vise à inciter les agents économiques à réduire les atteintes à
l’environnement en leur donnant un prix. Chaque producteur va comparer les coûts et les bénéfices d'une
activité polluante. Le coût social est mesuré par le dommage lié aux émissions polluantes. L'objectif de l’État est
de faire supporter par l'activité à l'origine de l'émission de polluants tous les coûts de cette activité y compris le
coût social subi par les autres agents. Chaque pollueur peut comparer le coût de sa dépollution au montant de la
taxe et calculera de production optimale. Le calcul économique le conduira donc nécessairement à réduire le
niveau de sa pollution jusqu’à ce que son coût marginal de dépollution égalise le prix de la taxe.
Ce principe a été mis en avant par A. C. Pigou en 1920 plus connu aujourd’hui sous le nom d’écotaxe
ou de principe du pollueur-payeur. C'est un instrument-prix car l’État atteint son objectif de quantité de
pollution en fixant un prix à l'externalité.
Même si la taxe encourage les agents pollueurs à réduire leurs émissions polluantes et incite à utiliser
des technologies plus respectueuses de l'environnement pour minimiser le paiement de la taxe, cet instrument
n'est pas non plus sans défaut.
En effet, la taxe sera répercutée sur le prix de vente, rendant les produits plus chers, en particulier à
l'export ce qui peut se traduire par une baisse de la compétitivité-prix des entreprises locales qui, pour fuir une
fiscalité jugée trop lourde et préjudiciable, peuvent être tentées de délocaliser leur production vers des pays où
les contraintes fiscales n'existent pas ou sont moins élevées. Dans ce cas, les émissions de carbone ne sont pas
supprimées ; elles sont seulement déplacées.
La taxe est un instrument national qui ne peut répondre aux pollutions transfrontalières. C'est pourquoi,
certains économistes considèrent que seuls des instruments d'envergure internationale comme les permis
d'émission peuvent être efficace pour lutter contre la pollution atmosphérique.
c) Les marchés de droits à polluer :
Un marché de droits à polluer, encore appelé marché de permis négociables, est un instrument
économique de politique environnementale qui vise à limiter le niveau global de rejets polluants en répartissant
les coûts à supporter pour respecter cette contrainte de manière efficace.
Préparé par Mme Rh. SEKKEL 5
Economie générale CPGE ECT
L’idée est que les pouvoirs publics peuvent décider à l’avance d’une quantité de pollution acceptable et
mettre en vente des titres s’apparentant à des droits à polluer. Dans cette perspective, les entreprises
s’échangent, c’est-à-dire se vendent et s’achètent, des permis qui leur donnent droit d’émettre par exemple du
soufre. D’années en années, les pouvoirs publics réduisent le nombre de permis : leur rareté entraîne une hausse
des prix, incitant de plus en plus d’entreprises à moderniser leur installation.
Le marché des quotas d’émission a pour objectif de contrôler les quantités de pollution émises. Il
fonctionne comme tout marché selon le principe d’une libre confrontation entre offre et demande de quotas
d’émission. Chaque pays (protocle de Kyoto) ou chaque entreprise (sur le marché européen) dispose d'un droit à
polluer qu'ils ne doivent pas dépasser sinon ils devront payer des amendes dont le coût est supérieur au droit à
polluer.
Le prix du quota va dépendre de la quantité de quotas accordée par les pouvoirs publics. S'ils distribuent
peu de quotas par rapport aux émissions, les pollueurs sont incités à réduire leurs émissions ou à acheter des
quotas. Par ce prix, les pouvoirs publics montrent l'ambition qu'ils se fixent en matière de politique climatique.
Malgré leur efficacité les marchés de quotas d'émission rencontrent des difficultés.
En période de difficultés économiques, le ralentissement de la production entraîne un excès de permis
d’émission, dont le prix s’effondre. Mais ce n'est pas la seule raison. En effet, dans le marché de quotas de
carbone européen, le nombre de permis distribués a été excessif par rapport à la demande conduisant à une
chute du cours et à des pertes importantes pour les entreprises qui ont investi dans des technologies plus
propres et qui ont subi la concurrence de celles qui n'ont pas dépollué.
La volatilité des prix n’incite pas nécessairement les entreprises à développer des projets d’investissements
coûteux et risqués. Elles n'ont pas de visibilité claire pour investir.
Comme le marché européen n'est pas international, imposer des quotas à des entreprises non européennes
risquent d'aboutir à des mesures de rétorsion comme le montre l'exemple des crédits carbone européens que
devaient acheter les compagnies aériennes. Le transport aérien émet environ 3 % du dioxyde de carbone
rejeté par l'homme dans l'atmosphère. La Chine, les États-Unis, l'Inde ou la Russie avaient menacé l'Europe
de ne pas commander d'Airbus si cette mesure s'appliquait aux compagnies de leur pays. L’Union
Européenne n'a aujourd'hui pas réussi à imposer son mécanisme d’achat de permis d’émissions aux
compagnies non européennes.
Un marché de quotas n’est applicable que pour de grandes installations. Or ces installations ne représentent
qu’un peu plus d’un tiers des émissions totales. Toutes les autres activités émettrices ne sont pas
concernées par le processus d’allocation et quotas, et ne peuvent pas l’être compte tenu de leur taille.
On a tendance à opposer les taxes aux permis d'émission. Loin d'être concurrents, ces instruments
peuvent au contraire se compléter et rendre plus efficace la politique climatique. En effet, les systèmes de quotas
d'émission ont été plutôt privilégiés au niveau européen ou international. Mais ils peuvent être couplés de
manière pertinente avec des mesures prises au niveau national : normes ou taxes. Ces derniers vont venir
renforcer la crédibilité des engagements mondiaux. C’est pourquoi les taxes semblent plus efficaces pour les
sources d’émission diffuses.
Dans la pratique, les pouvoirs publics sont moins confrontés à la difficulté de choisir entre les différents
instruments mais davantage au problème de trouver la bonne combinaison entre ces instruments.
Conclusion
Tout le monde a la possibilité d’agir pour diminuer notre impact sur l’environnement. Le développement
durable exige un changement du système économique et des modes de vie, afin de réduire la consommation
de ressources naturelles à un niveau supportable à long terme pour l’environnement, tout en préservant une
économie visant à une meilleure répartition des richesses à l’échelle planétaire. Il faudrait trouver, dans toutes
les actions humaines, le meilleur équilibre possible entre ces composantes en pensant à l’avenir de chaque
habitant de la planète. Allant dans ce sens, de nombreux pays, collectivités ou individus agissent à leur échelle
pour tenter de mettre sur pied un développement durable.
Préparé par Mme Rh. SEKKEL 6
Vous aimerez peut-être aussi
- LE Développement DURABLEDocument13 pagesLE Développement DURABLETaleb B PandaPas encore d'évaluation
- Éco DVP Durable - 110451Document10 pagesÉco DVP Durable - 110451Lesly TchonangPas encore d'évaluation
- Sujet - 4 PESDocument2 pagesSujet - 4 PESImad Essakhi00Pas encore d'évaluation
- Goe3 2024Document35 pagesGoe3 2024alihassapnaimaPas encore d'évaluation
- FRE3059 W03 T01 Différentes Théories Du DéveloppementDocument79 pagesFRE3059 W03 T01 Différentes Théories Du DéveloppementNguyễn Quỳnh TrangPas encore d'évaluation
- Le Problème Du SousDocument2 pagesLe Problème Du SousAnas AtmaniPas encore d'évaluation
- Le Développement DurableDocument21 pagesLe Développement Durablerbenhima1978Pas encore d'évaluation
- Introduction Generale CorrigeDocument3 pagesIntroduction Generale Corrigesidagmarag14Pas encore d'évaluation
- Developpement DurableDocument4 pagesDeveloppement DurableSaidYouss0% (1)
- Fiche 311 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableDocument7 pagesFiche 311 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Fiche 311 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableDocument7 pagesFiche 311 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Memo 1Document27 pagesMemo 1louisontuabu06Pas encore d'évaluation
- Guide D'installation D'un Gîte RuralDocument104 pagesGuide D'installation D'un Gîte Ruralcissmaroc100% (1)
- Exposé D'economieDocument10 pagesExposé D'economieJunior BenzePas encore d'évaluation
- Fiche 1 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableDocument6 pagesFiche 1 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Le Développement Durable Revu Et CorrigéDocument6 pagesChapitre 5 Le Développement Durable Revu Et CorrigéMaría José Vázquez ParetsPas encore d'évaluation
- Du Développement Au Développement DurableDocument16 pagesDu Développement Au Développement Durablesunasseemithila4Pas encore d'évaluation
- Le Développement DurableDocument10 pagesLe Développement DurableMarouane ElmjabberPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Le Développement Durable Complément La Croissance ZéroDocument5 pagesChapitre 5 Le Développement Durable Complément La Croissance ZéroMaría José Vázquez ParetsPas encore d'évaluation
- Dissertation Croissance Et Le DéveloppementDocument2 pagesDissertation Croissance Et Le DéveloppementMohamed Lamine DembéléPas encore d'évaluation
- Développement DurableDocument4 pagesDéveloppement DurableSalma wahbiPas encore d'évaluation
- GlobalDocument125 pagesGlobalMichkaPas encore d'évaluation
- Texte 3Document3 pagesTexte 3msczdn6kvgPas encore d'évaluation
- Pierre Caye - Durer (2020, Société D'ã©dition Les Belles Lettres) - Libgen - LiDocument295 pagesPierre Caye - Durer (2020, Société D'ã©dition Les Belles Lettres) - Libgen - LiHammadi HabadPas encore d'évaluation
- Grands Problèmes Économiques Contemporains - Correction Des TDDocument16 pagesGrands Problèmes Économiques Contemporains - Correction Des TDEdward Elric100% (1)
- Chapitre I - La Croissance Et Le Développement 2020Document4 pagesChapitre I - La Croissance Et Le Développement 2020Souleymane DiarraPas encore d'évaluation
- Développement Durable Dans Le Monde Et Au MarocDocument21 pagesDéveloppement Durable Dans Le Monde Et Au Marocdaizar71% (7)
- Leçon 17 - Interactions Croissance Économique Et Développement Durable - CoursDocument8 pagesLeçon 17 - Interactions Croissance Économique Et Développement Durable - CoursSébastien ONDO MINKOPas encore d'évaluation
- Chapitre Env Soc Et EconDocument7 pagesChapitre Env Soc Et EconMouna MounaPas encore d'évaluation
- Sujet 22 Corrige-CompletDocument6 pagesSujet 22 Corrige-CompletWilfried DjekoréPas encore d'évaluation
- Club de Rome Eugenisme Decroissance 1972Document5 pagesClub de Rome Eugenisme Decroissance 1972Michael DeverinPas encore d'évaluation
- Thème 2 - Les Relations Entre Croissance Et Développement Économique 2011-2012Document33 pagesThème 2 - Les Relations Entre Croissance Et Développement Économique 2011-2012Mme et Mr Lafon100% (1)
- Le Développement Comme ObjectifDocument3 pagesLe Développement Comme ObjectifsaoussenPas encore d'évaluation
- Présentation2 Développement DurableDocument55 pagesPrésentation2 Développement DurableSimo OugouamouPas encore d'évaluation
- Cours Développement Durable ESTM 2Document241 pagesCours Développement Durable ESTM 2AïchaPas encore d'évaluation
- LA Croissance Économique Et Développement Sont Deux Phénomènes LiésDocument2 pagesLA Croissance Économique Et Développement Sont Deux Phénomènes Liéssidagmarag14Pas encore d'évaluation
- Cours DDDocument21 pagesCours DDjocelyn rakotoPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Le Développement ÉconomiqueDocument6 pagesChapitre 2 Le Développement ÉconomiqueChaimae Bouzagane100% (1)
- Manifeste pour une santé commune: Trois santés en interdépendance : humaine, sociale, naturelleD'EverandManifeste pour une santé commune: Trois santés en interdépendance : humaine, sociale, naturellePas encore d'évaluation
- MAC 2e Chapter18 FrenchDocument32 pagesMAC 2e Chapter18 Frenchfallone zannouPas encore d'évaluation
- WWW - Cours Gratuit - Com Id 6808Document19 pagesWWW - Cours Gratuit - Com Id 6808Sami JaballahPas encore d'évaluation
- Developpement DurableDocument14 pagesDeveloppement DurableAsmaa FelidjPas encore d'évaluation
- Rapport DDDocument23 pagesRapport DDMaroPas encore d'évaluation
- Chap VII - Ethique DD Et Nouvelles Technologies UET122024Document11 pagesChap VII - Ethique DD Et Nouvelles Technologies UET122024Marøcø MãrøcõPas encore d'évaluation
- Entreprise Et Dã©veloppement DurableDocument22 pagesEntreprise Et Dã©veloppement Durablemohamed habib ellah boucennaPas encore d'évaluation
- Conférence Des Nations Unies Sur Le Développement Durable (Rio+20)Document6 pagesConférence Des Nations Unies Sur Le Développement Durable (Rio+20)MUSTAPHA BERAMIPas encore d'évaluation
- Dossier Documentaire Chapitre 3 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec La Préservation de L'environnement ?Document11 pagesDossier Documentaire Chapitre 3 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec La Préservation de L'environnement ?Potala SamaPas encore d'évaluation
- Guide de Diagnostic Participatif - IPD-ACDocument28 pagesGuide de Diagnostic Participatif - IPD-ACCameroon EngineeringPas encore d'évaluation
- La Croissance Économique Se Heurte-T-Elle À Des Limites ÉcologiquesDocument2 pagesLa Croissance Économique Se Heurte-T-Elle À Des Limites ÉcologiquesMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- 2006 - Tes2 - Bac Blanc 1 MarieDocument5 pages2006 - Tes2 - Bac Blanc 1 MarieRihâb AbdiPas encore d'évaluation
- CH IiDocument12 pagesCH IiThianfanga Oumar Sanogo ThianoPas encore d'évaluation
- Le Développement Humain en SociologieDocument5 pagesLe Développement Humain en SociologielcomPas encore d'évaluation
- Economie Du Développemen1 PourquoiDocument6 pagesEconomie Du Développemen1 PourquoiKabeyaPas encore d'évaluation
- Eco Du Développement Industriel Cad Amélioration de La Productivité de TravailDocument11 pagesEco Du Développement Industriel Cad Amélioration de La Productivité de TravailKabeyaPas encore d'évaluation
- Développement DissertationDocument2 pagesDéveloppement DissertationwafaPas encore d'évaluation
- Le Développement Durable - Nécessité Ou UtopieDocument5 pagesLe Développement Durable - Nécessité Ou UtopieOum YoussefPas encore d'évaluation
- Definitions Des Mots Du ThèmeDocument8 pagesDefinitions Des Mots Du ThèmeMohamed MaigaPas encore d'évaluation
- Chap 3 Développement DurableDocument6 pagesChap 3 Développement DurableBouchra ElkhamsiPas encore d'évaluation
- PFE DD Partie ThéoriqueDocument10 pagesPFE DD Partie Théoriqueyacine es-samriPas encore d'évaluation
- Séquence XI.2 - Dossier Élève - La Nécessité D'une Nouvelle Forme de CroissanceDocument9 pagesSéquence XI.2 - Dossier Élève - La Nécessité D'une Nouvelle Forme de CroissanceArtur REBOULPas encore d'évaluation
- Les Accords D'évianDocument32 pagesLes Accords D'évianMalek Aitouazzou100% (1)
- EJCA732 FR-FRDocument1 pageEJCA732 FR-FRAmal HajjiPas encore d'évaluation
- Exfo Spec-Sheet Maxtester-720c v11 FRDocument12 pagesExfo Spec-Sheet Maxtester-720c v11 FRHarveys santosPas encore d'évaluation
- Noche No Te VayasDocument7 pagesNoche No Te VayasUbaldo PPas encore d'évaluation
- Ms Eln Embouazza+MostefaouiDocument84 pagesMs Eln Embouazza+MostefaouiBenjiPas encore d'évaluation
- 2rncap13 S4 2 Courants Faibles Vdi AppDocument26 pages2rncap13 S4 2 Courants Faibles Vdi AppNASR-EDDINE RAHMANIPas encore d'évaluation
- SVT 2nd A - L6 - La Production de La Matiere OrganiqueDocument7 pagesSVT 2nd A - L6 - La Production de La Matiere OrganiquecanadiennesitalaPas encore d'évaluation
- Planning Medecine Du TrvailDocument60 pagesPlanning Medecine Du TrvailAMINE EXmicPas encore d'évaluation
- Rubiks Cube v1.1 A4 BrochureDocument10 pagesRubiks Cube v1.1 A4 BrochurebourkadisPas encore d'évaluation
- Branch Emo DoDocument11 pagesBranch Emo DoanasPas encore d'évaluation
- Katalog Sitrain V20Document23 pagesKatalog Sitrain V20chokamPas encore d'évaluation
- Schemat Boole Comb S1 GMP 2017Document53 pagesSchemat Boole Comb S1 GMP 2017salma.aben.94Pas encore d'évaluation
- Dossier - Student Challenge - 2Document13 pagesDossier - Student Challenge - 2novocaine67Pas encore d'évaluation
- Qad Inn FaradDocument20 pagesQad Inn FaradDmd Yearning100% (1)
- Horaires Ligne 615-2Document2 pagesHoraires Ligne 615-2Bruno FichouPas encore d'évaluation
- Acte D'engagementDocument2 pagesActe D'engagementKarim ZazaPas encore d'évaluation
- Virtualisation Systemes InformationDocument90 pagesVirtualisation Systemes InformationEtsitaSimonPas encore d'évaluation
- Philippe Raynaud - Le Droit Et La Science Politique (Paru Dans Jus Politicum) - Copie PDFDocument9 pagesPhilippe Raynaud - Le Droit Et La Science Politique (Paru Dans Jus Politicum) - Copie PDFkevinbouchardPas encore d'évaluation
- Les Verbes 4. L'imparfait Et Le Plus-Que-ParfaitDocument1 pageLes Verbes 4. L'imparfait Et Le Plus-Que-ParfaitToñi PerezPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument24 pagesRapport de StageOthmane Rajiz100% (1)
- Oxydation Des MatériauxDocument123 pagesOxydation Des Matériauxassiddiqbourihane1Pas encore d'évaluation
- Projet TutoreDocument4 pagesProjet TutoreMed FarahPas encore d'évaluation
- AGRODIVDocument2 pagesAGRODIVSarra BÉCHIRIPas encore d'évaluation
- MaliDocument106 pagesMalidocteurgynecoPas encore d'évaluation
- CalligraphieDocument6 pagesCalligraphiedavid.zitta368Pas encore d'évaluation
- Responsable Communication Marketing Amiens SCDocument2 pagesResponsable Communication Marketing Amiens SCspot08Pas encore d'évaluation
- Phénomènes OVNI, Abductions Et Pédocriminalité Ritualisée - Contrôle Mental (MÀJ) - MK-PolisDocument19 pagesPhénomènes OVNI, Abductions Et Pédocriminalité Ritualisée - Contrôle Mental (MÀJ) - MK-PolisWal WalterPas encore d'évaluation
- JDJ 330 0045 PDFDocument4 pagesJDJ 330 0045 PDFMIHAIPas encore d'évaluation
- Canevas Demande Financement REZZOUGDocument4 pagesCanevas Demande Financement REZZOUGrezzoug78% (18)
- Guide Sortie EcologieDocument3 pagesGuide Sortie EcologieBathie SarrPas encore d'évaluation