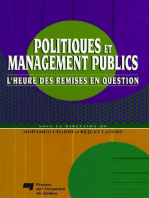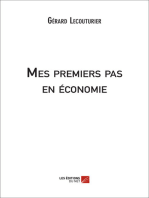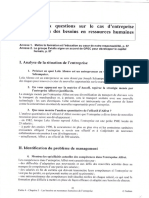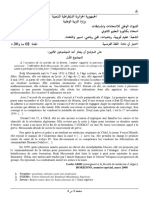Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Strategie Entreprise Selma Bardak 2
Transféré par
cours fsjesCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Strategie Entreprise Selma Bardak 2
Transféré par
cours fsjesDroits d'auteur :
Formats disponibles
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
Prsentation gnrale du cours S St tr ra at t g giie ed de en nt tr re ep pr riisse e
Auditoire :
Ce cours est destin aux tudiants de 3me anne de licence conomie gestion spcialit PME / PMI.
Comptences requises :
Lapprentissage du cours Stratgie dentreprise ncessite des connaissances pralables en management de lentreprise. En Effet, il est indispensable pour les tudiants de cette matire davoir des pr -requis concernant les notions suivantes : lentreprise et son environnement, le processus de gestion : la planification, lorganisation, la direction et le contrle, la prise de dcisions Les principales fonctions de lentreprise.
Objectifs du cours :
Ce cours consiste en une initiation la stratgie de lentreprise. Il a pour objectifs : Maitriser les fondements de la rflexion stratgique. Comprendre lanalyse stratgique Connaitre les principaux outils du diagnostic stratgique Saisir les diffrentes orientations stratgiques
Comptences acquises :
A la suite de cet apprentissage ltudiant doit tre capable de :
comprendre les principaux concepts de la stratgie, connatre les principales coles de pense en stratgie, ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
matriser les concepts de base lis lanalyse stratgique, raliser un diagnostic stratgique, dduire les choix stratgiques possibles dans le cadre dune dmarche structure.
Plan du cours :
Partie I : les fondements de la rflexion stratgique Chapitre I : Gnralits sur la stratgie dentreprise Chapitre II : Les coles de penses en stratgie Partie II : Lanalyse stratgique Chapitre I : La segmentation stratgique Chapitre II : Le diagnostic stratgique Partie II : Les outils du diagnostic stratgique Chapitre I : Le modle LCAG Chapitre II : Le modle de Porter Chapitre III : Les modles de portefeuille dactivit Partie IV : Les orientations stratgiques Chapitre I : Les stratgies concurrentielles Chapitre II : Les stratgies de dveloppement Chapitre III : Les modes de croissance : Croissance interne Vs croissance externe Chapitre IV : Les stratgies dinternationalisation
Dure et mode dvaluation :
Le cours stratgie dentreprise se droule sur un seul semestre raison de deux sances de 1h30 de cours intgr par semaine. Des tudes de cas et des exposs sont prvus tout au long de lapprentissage de ce cours permettent de diminuer laspect thoriqu e de ce cours et donnent la possibilit aux tudiants dappliquer les notions apprises.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
PARTIE
Les fondements de la rflexion stratgique
Objectifs
Maitriser les concepts et les caractristiques de la stratgie dentreprise Assimiler les diffrentes approches stratgiques connaitre les principales coles de pense en stratgie
Sommaire
Ch I La stratgie d'entreprise : Gnralits Ch II Les coles de pense en stratgie
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
Chapitre
La stratgie dentreprise : Gnralits
Objectifs
Dfinir la stratgie et la politique gnrale dentreprise connaitre les composantes de la stratgie dentreprise Comprendre les diffrents niveaux des dcisions stratgiques
Sommaire
I- Stratgie : dfinitions & concepts II- Les composantes de la stratgie III- Les niveaux des dcisions stratgiques
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
I-Stratgie, dfinitions et concepts
La notion de stratgie a vu le jour dans le domaine militaire, elle consiste mobiliser des moyens pour gagner une guerre. Il sagit de l'art de coordonner l'action de forces militaires, politiques, conomiques et morales impliques dans la conduite d'une guerre ou la prparation de la dfense d'une nation ou d'une coalition.
Cette notion a t extrapole lentreprise. En effet, elle dfinit les actions mener pour raliser les objectifs. Cest la direction gnrale de lentreprise qui doit procder au choix des voies et des moyens mettre en uvre afin datteindre les obje ctifs fixs. Ces actions devraient lui permettre de faire face aux entreprises concurrentes.
1-Quelques dfinitions de la stratgie :
On trouve dans la littrature managriale un trs grand nombre de dfinitions diffrentes de la stratgie dentreprise. Dfinition de STRATEGOR Elaborer une stratgie cest choisir les domaines dactivit dans lesquels lentreprise entend tre prsente et allouer les ressources de faon ce quelle sy maintienne et sy dveloppe. Cette dfinition permet didentifier deux niveaux de stratgie : La stratgie de groupe ou corporate strategy : qui consiste dans le choix du ou des domaines dactivit de lentreprise. Lentreprise sengage alors dans un secteur plutt quun autre ; La stratgie concurrentielle ou business strategy : qui consiste dans le choix des actions et des manuvres mettre en place afin davoir un positionnement lui permettant de faire face aux concurrents du secteur. Il sagit donc du choix dallocation de ressources, dinvestissement ou
dsinvestissement qui font la stratgie.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
Dfinition de DESREUMAUX La stratgie est l'ensemble des actions spcifiques devant permettre d'atteindre les buts et objectifs en s'inscrivant dans le cadre de missions et de la politique gnrale de l'entreprise. Elle consiste en 2 choses : prciser les activits spcifiques de l'entreprise, c'est--dire les couples marchs / produits ou les tripls produits / marchs / technologies sur lesquels l'entreprise concentrera ses efforts. Elle consiste donc dfinir le portefeuille d'activit de l'entreprise qu'il convient d'quilibrer en termes de rentabilit, de risque et de perspective de dveloppement, prciser le mode de dveloppement qui sera utilis, c'est--dire, l'expansion en volume, l'extension gographique, l'intgration verticale, la diversification des produits ou au contraire la focalisation sur une activit Les choix stratgiques doivent tre guids par la recherche de synergies entre les activits de l'entreprise. Dfinition de Chandler La dtermination des buts et objectifs long terme dune entreprise et le choix des actions et lallocation des ressources ncessaires pour les atteindre Il sagit donc daprs Chandler dun processus consistant : Fixer des objectifs LT ; Choisir le plan daction adquat permettant datteindre les objectifs fixs ; Allouer les ressources ncessaires afin de concrtiser le plan daction.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
Dfinition de M. Porter Lart de construire des avantages concurrentiels durablement dfendables M. P orter met laccent sur la notion de lavantage concurrentiel. Pour lui, une stratgie doit permettre lentreprise de construire, garder et dvelopper un avantage concurrentiel lui concdant de faire face la concurrence. Ainsi, nous pouvons rsumer la notion de stratgie comme tant les moyens mis en place par lentreprise afin datteindre les objectifs stratgiques fixs par les dirigeants. Et ce pour se crer un positionnement favorable par rapport ses concurrents. I l sagit alors de rpondre trois questions : Quel est mon mtier ? Quel est mon avantage concurrentiel ? Comment se dvelopper ?
2-Quelques vocabulaires de la stratgie :
Mission : Propos fondamental de lorganisation, en rapport avec les valeurs et les attentes des parties prenantes. Il sagit de la raison dtre de lentreprise . Vision ou intention stratgique : Etat futur souhait, laspiration de lorganisation, projection de lavenir. But : Dclaration gnrale dintention. Objectif : Quantification ou intention plus prcise . Comptences distinctives : Ressources procds et aptitudes qui permettent dobtenir un avantage concurrentiel. Contrle : Evaluation de lefficacit de la stratgie et des ralisations, Modification de la stratgie et/ou des ralisations si ncessaire.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
3-Stratgie et politique gnrale de lentreprise :
Toute entreprise est plus ou moins oriente par une politique gnrale explicite ou non par le groupe dirigeant. Elle est le fruit des motivations, de la formation et de la culture des dirigeants. La politique gnrale se dfinie comme l'ensemble des principes directeurs et des grandes rgles et normes qui orientent en permanence l'action. Cette discipline a pour objectif de connatre les dterminants de lentreprise en tant quacteur de la vie conomique, expliquer ses comportements passs et orienter ses comportements futurs. Contrairement aux autres fonctions de lentreprise qui ne concernent quun seul aspect, la politique dentreprise, considre len treprise comme une totalit. Elle utilise des informations provenant des autres fonctions mais se base sur ses propres mthodologies. Elle traduit le libre arbitre des DIRIGEANTS dentreprise. Ainsi, lentreprise est libre dans le choix des objectifs gn raux quelle entend poursuivre et des stratgies quelle dveloppe afin datteindre ces objectifs. La politique gnrale s'impose la stratgie en lui fixant des buts atteindre, des contraintes et des critres respecter et est souvent formalise dans les chartes dentreprises.
4-Objectifs de la stratgie :
La stratgie mise en place par les dirigeants de lentreprise vise rechercher, obtenir et garder une comptence distinctive, ou de savoir-faire diffrentiel, source davantage comptitif et garantir ainsi la comptitivit et la rentabilit de l'entreprise sur le long terme. Cela implique de comprendre lenvironnement afin de modifier lquilibre concurrentiel son avantage.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
Elle englobe la conception et le pilotage dactions dans le but de saisir des opportunits tant internes quexternes.
II-Les composantes de la stratgie :
1-La stratgie dlibre et la stratgie mergente :
Daprs Mintzberg, la stratgie prend forme progressivement dans un flux continu dactions. Certaines de ces actions sont planifies et dlibres, et vont dans le sens des actions futures prvues par les dirigeants : on parle alors de stratgie planifie. Dautres rpondent des vnements non prvus auxquels les firmes ragissent. Elles proviennent suite des changements provenant de lenvironnement et dont la prvision nest pas possible : On parle alors de stratgie mergente.
2-La stratgie dduite et la stratgie construite :
La stratgie dduite (de lenvironnement) : consiste laborer la stratgie en identifiant les opportunits rsultant des forces externes qui sexercent sur lorganisation et en adaptant les ressources dont elle dispose de manire en tirer avantage. I l sagit de rpondre, plus ou moins bien, des besoins existants (ex : Nestl rachte les glaces aux USA car sa consommation est en augmentation) et de comprendre les changements de comportement des consommateurs ou les diffrences quil y a selon les pays afin dadapter sa stratgie (locale) ces lments. La stratgie construite ( partir des ressources et comptences) : consiste sappuyer sur les ressources et les comptences de lorganisation afin de dvelopper un avantage concurrentiel qui permet dexploiter de nouvelles opportunits. Il sagit didentifier les ressources et les comptences qui pourront servir de base la cration de nouvelles opportunits.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
10
III-Les niveaux des dcisions stratgiques :
Les dcisions stratgiques constituent des dcisions qui engageront la firme sur le long terme, ainsi, elles sont souvent irrversibles et impliquent des changements structurels importants. La dcision stratgique diffre selon le niveau hirarchique. En effet, on retrouve trois niveaux de la dcision : On parle de stratgie dentreprise ou corporate strategy, stratgie par domaine dactivit ou business strategy et stratgie fonctionnelle.
1-La stratgie gnrale dentreprise :
Elle concerne le schma et le primtre de lorganisation dans sa globalit et la manire dont elle ajoute de la valeur ses diffrentes activits. A ce niveau, la stratgie permettra la dtermination du domaine dactivit dans lequel lorganisation dsire uvrer. Il sagit de lorientation du portefeuille de couples produit - march de la dtermination de ce que lorganisation doit faire pour mettre en pratique cette orientation.
3- La stratgie par domaine dactivit :
Elle consiste identifier les facteurs cl de succs sur un march particulier. Il sagit de dfinir comment un avantage peut tre obtenu par rapport ses concurrents et de savoir quels nouveaux marchs peuvent tre identifis ou construits. A ce niveau la stratgie permet de dfinir comment lorganisation doit sy prendre pour faire face la comptition au sein du domaine dactivits ou du secteur dans lequel elle opre.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
11
Il peut sagir dun avantage comptitif de cots, dune focalisation ou dune niche de march.
diffrentiation, dune
3-La stratgie fonctionnelle :
Elle consiste assurer la mise en uvre des stratgies globales et des stratgies par domaine dactivits et ce spcifiquement pour chaque fonction de lentreprise. (Marketing, production, distribution, R&D, etc.) A ce niveau, la stratgie vise mettre profit et intgrer les comptences distinctives et les capacits de lorganisation pour chacune des diffrentes fonctions quelle assume.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
12
Chapitre
Les coles de pense en stratgie
Objectifs
Saisir la diffrence entre l'approche dterministe et l'approche volontariste
Connaitre la classification des coles de pense en stratgie selon Mintzberg
Sommaire
I-Les deux grandes approches stratgiques : entre dterminisme et volontarisme II-Les coles stratgiques selon Mintzberg
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
13
I-Les deux grandes approches stratgiques :
Entre dterminisme et volontarisme
Depuis les annes 50, on assiste une volution dans la pense entreprises qui introduit de nouvelles variables. On peut distinguer deux grandes approches (voir figure 1) : lapproche de ladaptation stratgique (base sur le positionnement) et lapproche de lintention stratgique (base sur le mouvement).
Lapproche du positionnement annes 50 Comment crer de la valeur plus que les concurrents ? Lapproche de Lintention annes 80 Comment crer de la valeur ? stratgique
en stratgie.
Lvolution de ces approches provient de lvolution de lenvironnement des
SWOT
Avantage concurrentiel Origine
Approche par les ressources
Transformation permanente Origine
Spcificits du secteur dactivit
Firme = portefeuille de DAS
Spcificits de lentreprise
Firme = portefeuille de resources & competences
- Concilier des avantages concurrentiels multiples et non durables - la stratgie se base sur la capacit la transformation et sur le mouvement
- Sadapter lenvironnement (analyse) - Construire un avantage concurrentiel durable permettant damliorer son positionnement / concurrents
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
14
1-Lapproche de ladaptation stratgique :
Cest lcole classique qui renvoie une priode durant laquelle la stratgie est associe des principes dadaptation et de position. Il sagit du dterminisme stratgique o la stratgie est considre comme une variable contingente lenvironnement. En effet, cette approche considre que la stratgie suppose une adaptation permanente lenvironnement pour acqurir une position dominante sur le secteur et la dfendre. Ainsi, la stratgie ne peut qutre impose par lenvironnement de lentreprise. Elle dbute avec le modle SWOT , qui constitue la base sur laquelle toutes les autres thories se dveloppent. Ce modle considre que la stratgie doit constituer une adquation entre les opportunits et menaces de lenvironnement et les forces et faiblesses de lentreprise. Elle se prolonge par une rflexion sur lavantage concurrentiel et sachve avec M. Porter, dont les travaux reprsentent la rfrence dans le domaine des stratgies de positionnement. En effet, la stratgie devrait permettre de construire et de garder un avantage concurrentiel durable permettant damliorer le positionnement de lentreprise dans son secteur dactivit. Ainsi, la stratgie est considre comme un moyen permettant lentreprise datteindre la position idale (de ses DAS) par rapport ses concurrents dans lindustrie. Il sagit dune position unique et cratrice de valeur. NB : Cette approche sinspire de lconomie industrielle, elle est galement appele lapproche conomique et industrielle .
2-Lapproche de lintention stratgique :
Cette approche met en avant une conception de la stratgie centre plutt sur lintention et le mouvement. Il sagit plutt dune vision volontariste o lentreprise,
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
15
avec ses spcificits (ressources, comptences, connaissances), peut agir sur son environnement. La stratgie vise dans ce cas la transformation permanente du jeu concurrentiel et des capacits de lentreprise. Contrairement lapproche classique, cette approche se base sur les spcificits de lentreprise et non sur le secteur dactivit dans lequel elle se trouve. Elle considre, dune part, que lentreprise doit concilier des avantages con currentiels multiples et non durables. Dautre part, lobjectif cl de la stratgie nest plus ladaptation aux conditions de la concurrence, mais leur transformation et leur renouvellement. Cette approche dbute par le courant de lintension stratgique (lcole base sur les ressources) qui propose une conception radicalement oppose ladaptation stratgique : A partir de ses propres ressources et comptences centrales, une entreprise peut transformer les conditions de lenvironnement en identifiant les ressources et comptences cls, les valuer dans le contexte environnemental de lentreprise, ensuite les dvelopper et valoriser dans le cadre dun apprentissage individuel et collectif.
Une ressource cl : actif spcifique, de valeur, rare, difficilement imitable, non substituable
et difficilement transfrable.
Le courant de lintention stratgique sest dvelopp rcemment pour intgrer le concept de la transformation et du mouvement, et ce, car le problme central devient le renouvellement constant des conditions de la concurrence. En effet, les nouvelles conditions de la concurrence (on parle de lhyper -concurrence) explique cette volution et rend la transformation permanente ncessaire.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
16
II-Les coles stratgiques selon H. Mintzberg
Mintzberg a classifi les approches de gestion stratgique en 10 coles.
1- L'cole de la conception, la crativit ou cole du projet :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus de conception. Elle se base sur la rationalit du dirigeant. Cette cole fonde l laboration de la stratgie sur la notion du diagnostic stratgique. Ainsi, llaboration d'une stratgie co nsiste trouver la meilleure adquation possible entre les forces et faiblesses internes et les menaces et opportunits externes (concept bien connu d'analyse SWOT). Les dirigeants formulent des stratgies claires et simples, dans un schma dlibr de rflexion consciente - ni analyse formaliste, ni flou intuitif - de faon ce qu'elles puissent tre mises en uvre par tous. Il sagit dtablir un ajustement qui tendra vers l'harmonie.
Avantages : Ordre, simplicit. Cette approche convient aux environnements
relativement stables, idalement appuye par un leadership visionnaire fort.
Limites : La simplification peut dformer la ralit. Elle adopte la rationalit parfaite
du dirigeant alors que celui-ci sappuie en ralit sur la rationalit limite.
2-L'cole de la planification :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus formel. Elle reprend pour l'essentiel les hypothses de l'cole du projet, sauf une - qui a son importance : le processus stratgique n'est pas seulement crbral, mais formel, dcomposable en tapes distinctes, dlimit par des check-lists et tay par des techniques (objectifs, budgets, programmes et plans oprationnels). L'quipe de planning stratgique remplace, de fait, les dirigeants qui na plus quune intervention marginale. Ici la
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
17
stratgie est considre comme un processus objectif, organis et planifi dans ses moindres dtails.
Contributions : Donne un sens clair la stratgie, un axe auquel tout le monde peut
se rallier. Permet une bonne rpartition des ressources de l'entreprise, ce qui est un des fondements de la stratgie. Les analystes peuvent pr-visualiser les faits et juger les stratgies labores. Permet aussi un contrle ex-post de la ralisation sur base de ce qui avait t planifi.
Limites : Lenteur du processus de planification, lenteur du processus de mise en
uvre, prise de pouvoir de lquipe de planification, inadapte aux situations dincertitude : peut entraver lmergence de certaines stratgies en les masquant.
3-L'cole du positionnement :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus analytique. Par l'analyse de l'industrie, du secteur et donc de la concurrence, la stratgie va dterminer un positionnement, choisir un endroit o le potentiel de dveloppement est le plus lev. Le positionnement ici est principalement vu en terme de produits / marchs. C'est Michael Porter, qui a donn son lan cette cole en 1980, dans la foule d'autres travaux raliss sur le thme du positionnement stratgique, tant dans le monde universitaire que dans celui du conseil (notamment par le Boston Consulting Group). Pour cette cole, la stratgie se rduit un certain nombre de positions gnriques, choisies par le biais d'une analyse formelle des situations. Cette littrature s'est dveloppe dans toutes les directions, englobant les groupes stratgiques, les chanes de valeur, la thorie des jeux et d'autres encore, mais toujours avec une tendance analytique. Elle place l'activit dans le contexte de son industrie, et regarde comment l'entreprise peut amliorer son positionnement stratgique dans cette industrie.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
18
Avantages : Particulirement utile aux premiers stades du dveloppement de la
stratgie, quand les donnes sont analyses.
Limites : Nglige l'influence de la politique, la culture, les faits sociaux. Elle est plutt
orient vers les grandes socits. Orient chiffres.
4-L'cole entrepreneuriale :
Le courant entrepreneurial axe le processus stratgique sur le dirigeant de l'entreprise, et insiste sur limportance de la prise en compte des mcanismes mentaux : lintuition, le jugement, la sagesse, lexprience, etc. dans le processus de dcision stratgique. Les stratgies Ne sont plus des projets, des plans ou des positionnements prcis, mais des visions floues, ou des perspectives, en gnral exprimes de faon image, au travers de mtaphores. Elle se base sur la vision, c'est--dire la reprsentation de la stratgie qui se cr dans le cerveau du dirigeant et qui constitue la ligne directrice de la stratgie.
Contributions : Une vision claire et un patron visionnaire aident les organisations
naviguer en cohsion dans les eaux troubles. Particulirement dans ses dbuts ou dans les annes trs difficiles pour l'organisation parce que dans ces circonstances, le leadership est fondamental pour que tout le monde rame dans la bonne et mme direction. On dlibre dans les grandes lignes et on est souple et ractif dans la mise en oeuvre.
Limites : La navigation d'un cap prdfini peut aveugler quelqu'un sur des dangers ou
des dveloppements potentiels inattendus. Est-ce que l'on dispose du bon leader, possdant toutes les qualits requises ? Les leaders entrepreneuriaux et visionnaires ont une tendance aller trop loin. tre Prsident est un travail extrmement exigeant dans cette perspective.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
19
5-L'cole cognitive :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus mental. L'intrt portait sur l'origine des stratgies. Si elles se dveloppaient dans l'esprit humain sous formes de schmas de base, de modles ou de cartes, tait-il possible de comprendre le cheminement de ces processus mentaux ? Le courant cognitif sert btir des stratgies sous forme d'interprtations cratives, plutt qu' retracer la ralit de faon plus ou moins objective. Cette cole analyse comment les personnes peroivent les modles et le processus d'information. Elle se concentre sur qu'est-ce qui se produit dans l'esprit du stratge, et comment il ou elle traite l'information.
Contributions : Voit la stratgie comme un processus cognitif dans l'esprit du
stratge. Les Stratgies mergent comme concepts, cartes, schmas et structures de la ralit. Souligne le ct crateur du processus de stratgie.
Limites : Pas trs pratique au del de l'tape conceptuelle. Pas trs pratique pour
concevoir de grandes ides ou stratgies. Actuellement pas trs utile pour guider des processus collectifs de stratgie.
6-L'cole de l'apprentissage :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus mergent. Ce modle de cration stratgique - totalement diffrent de ce ceux des coles prcdentes remonte aux premiers travaux sur l'incrmentation (ou la notion des petits pas plutt que de grandes enjambes) et aux concepts tels que la prise de risque , la stratgie mergente (issue de dcisions individuelles plutt que d'une conception dans une tour d'ivoire). Dans cette optique, les stratgies sont mergentes, les stratges sont partout dans l'entreprise et la formulation et la mise en oeuvre de la stratgie sont inextricablement lies. On introduit le concept d'organisation
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
20
apprenante. Il ny a pas de sparation entre le processus de la formulation de la stratgie et le processus de la mise en uvre. Le monde est trop complexe pour permettre des stratgies d'tre dveloppes d'un seul trait. Comme plans ou visions claires. Par consquent les stratgies doivent merger dans de petites tapes, car une entreprise apprend .
Contributions : Offre une solution pour traiter la complexit et l'imprvisibilit dans
la formation la stratgie.
Limites : Cette cole pourrait mener n'avoir aucune stratgie ou juste faire des
manuvres tactiques (embrouillant tout). Ou la drive stratgique. Pas du tout utile pendant les crises. Pas trs utile en conditions stables. La prise de beaucoup de petites mesures sensibles ne s'ajoute pas ncessairement pour mener jusqu' une stratgie totale saine.
7-L'cole du pouvoir :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus de ngociation. Il s'agit d'un courant de pense qui considre deux pouvoirs : Le pouvoir vocation interne considre que le dveloppement de stratgies au sein d'une entreprise est essentiellement politique et que ce processus est bas sur la ngociation, la persuasion et la confrontation entre les acteurs internes. Le pouvoir vocation externe peroit l'entreprise comme une entit qui utilise son influence sur les autres et sur ses partenaires au sein d'alliances, co-entreprises et autres formes de rseaux pour ngocier des stratgies dites collectives dans son intrt.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
21
La stratgie est alors dveloppe comme un processus de ngociation entre les dtenteurs de la puissance au sein de l'entreprise, et / ou entre l'entreprise et ses partenaires externes.
Contributions : Peut aider s'assurer que tous les aspects d'une question sont
entirement discuts. Peut aider traverser des obstacles au changement ncessaire. Peut aider diminuer des rsistances aprs qu'une dcision soit prise. Particulirement utile pour comprendre des alliances stratgiques, Joint-ventures et pour faire une Analyse de partenaire.
Limites : La politique peut tre sparative, utilise beaucoup d'nergie, cause de
gaspillage et de dformation et est coteuse. Peut mener des aberrations. Peut mener n'avoir aucune stratgie ou faire juste des manuvres tactiques (embrouillant tout). Exagre le rle de la puissance dans la formation de la stratgie.
8-L'cole culturelle :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus collectif. En fait, la culture est un lment central de la stratgie : elle intervient dans le processus dlaboration de la stratgie et constit ue une source de lavantage concurrentiel.car difficilement imitable. Elle essaye d'impliquer les divers groupes et dpartements au sein de l'entreprise. La formation de la Stratgie est regarde comme processus fondamentalement collectif et coopratif. La stratgie qui est dveloppe est une rflexion sur la culture d'entreprise de l'organisation.
Contributions : Souligne le rle crucial que les processus, les convictions et les valeurs
sociales jouent dans la prise de dcisions et dans la formation de la stratgie. Peut galement contribuer grer les processus de fusions et acquisitions.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
22
Limites : Vague, peut alimenter des rsistances au changement et peut tre abus pour
justifier le statu quo (la situation initiale avant le changement).
9-L'cole environnementale :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus ractif : Cest lenvironnement qui oblige lentreprise choisir une stratgie plutt quune autre, ce sont les forces extrieures lentreprise qui constituent le vrifiable acteur de la stratgie. Ainsi, soit lentreprise sadapte lenvironnement soit elle disparait. Cependant, l'cole environnementale mrite que l'on y prte attention pour l'clairage qu'elle apporte sur les exigences lies l'environnement. La stratgie est alors une rponse aux dfis imposs par l'environnement externe. L'environnement nest plus considr un facteur, il est considr comme un acteur.
Contributions : Donne un rle central l'environnement dans la formation la
stratgie.
Limites : Les dimensions de l'environnement sont souvent vagues et agrges. Ceci la
rend moins utile pour la formation la stratgie.
10- L'cole de configuration :
Cette cole voit la formation de la stratgie comme un processus de transformation. L'entreprise est perue comme une configuration (des groupes cohrents de caractristiques et de comportements). La planification, par exemple, dans les entreprises routinires connaissant des conditions de stabilit relative et l'cole entrepreneuriale dans des configurations plus dynamiques de start-up ou de transformation. Toutefois, sil est possible de dcrire les entreprises par de tels tats, alors le changement suppose un mouvement plutt radical, c'est--dire le passage d'un tat un autre.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
23
La formation de la Stratgie est un processus de transformation de l'organisation d'un type de structure de prise de dcisions en un autre.
Contributions : La clef du Management stratgique est la plupart du temps : soutenir
la stabilit, ou au moins un changement stratgique adaptable. Mais priodiquement il y a un besoin de transformation. Et pour tre capable de grer ce processus sans dtruire l'organisation, la voie de la formation de la stratgie doit s'adapter sa propre poque et contexte, alors qu'elle prend une ou plusieurs des 10 formes mentionnes. Par consquent la formation de la stratgie elle-mme a des configurations.
Limites : En ralit, cette cole dcrit la ralit en utilisant des configurations, ce qui
risque de dformer la ralit afin de l'expliquer.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
24
PARTIE
Lanalyse stratgique
Objectifs
Comprendre la ncessit de lanalyse stratgique Assimiler la notion de segmentation stratgique Apprhender la notion de diagnostic stratgique
Sommaire
Ch I La segmentation stratgique Ch II Le diagnostic stratgique
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
Chapitre
25
La segmentation stratgique
Objectifs
Comprendre le concept la segmentation stratgique
Saisir lobjet de la segmentation stratgique ;
Comprendre la diffrence entre la segmentation stratgique et la segmentation
marketing ;
Identifier les notions de dcoupage et de regroupement
Sommaire
I- Le concept de la segmentation stratgique II- Segmentation stratgique VS segmentation marketing III- Segmentation par dcoupage et par regroupement
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
26
I-Le concept de segmentation stratgique
1-Pourquoi la segmentation ?
La notion de domaine d'activit (D.A.) est au cur des concepts de l'analyse stratgique. C'est l'unit d'analyse sur laquelle est fond le raisonnement stratgique. Gnralement, une entreprise se prsente comme un ensemble confus et agrg de produits, fonctions, dpartements, divisions, etc. Face cette situation, la segmentation stratgique se rvle indispensable. En effet, elle permettra didentifier des domaines dactivit homognes. Cela revient regrouper les activits de lentreprise en groupes homognes permettant ainsi une meilleure analyse et une identification plus pertinente des stratgies adquates.
2-Objet de la segmentation stratgique
La segmentation stratgique des diffrentes activits d'une firme a pour objet de dfinir cette unit d'une manire assez prcise pour rendre le raisonnement stratgique plus pertinent. Elle vise fournir au dirigeant une reprsentation du champ concurrentiel l'chelle approprie en ce qu'elle s'appuie sur une analyse des comptences requises pour tre comptitif sur un segment donn. Elle cherche effectuer le dcoupage qui permettra l'allocation des ressources la plus judicieuse.
3-Le rsultat de la segmentation stratgique
Le rsultat de cette segmentation est le segment stratgique ou Domaine dActivit Stratgique DAS (ou Stratgic Business Unit), qui est un domaine d'activit caractris par une combinaison unique de facteurs cls de succs, faisant appel des savoir-faire particuliers sur lesquels l'entreprise peut accumuler de l'exprience, born par des frontires gographiques pertinentes (Strategor, 1997).
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
27
Facteurs cls de succs (FCS): lments sur lesquels se fonde en priorit la concurrence, correspondant aux comptences qu'il est ncessaire de matriser pour tre performant et comptitif. Il y a autant de segments stratgiques que de combinaisons de FCS : chacune tant homogne et significativement distincte des autres. Les produits ou les services qui mettent en jeu les mmes comptences, se caractrisent par la mme combinaison de facteurs cls de succs, et ont des concurrents identiques forment un mme segment stratgique.
II-Segmentation stratgique VS segmentation marketing :
La segmentation stratgique ne doit pas tre confondue avec la segmentation marketing, qui est sensiblement diffrente.
La segmentation marketing concerne un secteur d'activit de l'entreprise et s'appuie
sur le constat qu'un march est rarement homogne, et qu'il se compose d'un ensemble d'acheteurs ayant des besoins, des modes d'achat et des comportements diffrents. Elle permet de tenir compte de ces diffrences afin d'adapter les produits leurs consommateurs et d'optimiser les actions commerciales en fonction des cibles. Elle se concentre donc sur des savoir-faire commerciaux et ignore, pour l'essentiel, les autres facteurs cls de succs de l'activit, comme ceux lis la technologie.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
28
Segmentation marketing
Concerne un secteur d'activit de l'entreprise. Vise diviser les acheteurs en groupes caractriss par les mmes besoins, les mmes habitudes, les mmes comportements d'achat. Permet d'adapter les produits aux consommateurs, de slectionner les cibles privilgies, de dfinir le marketing-mix. Provoque des changements court et moyen terme.
Segmentation stratgique
Concerne les activits de l'entreprise prise dans son ensemble. Vise diviser ces activits en groupes homognes qui relvent de la mme technologie, des mmes marchs, des mmes concurrents. Permet de rvler les opportunits de cration ou d'acquisition de nouvelles activits, et les ncessits de dveloppement ou d'abandon d'activits actuelles. Provoque des changements moyen et long terme.
Permet de rvler des besoins non ou mal satisfaits par les produits ou les services actuels
Remarques :
Nous utiliserons les termes segmentation pour signifier segmentation stratgique, et segment pour voquer un segment stratgique, une unit stratgique homogne (USH) ou un domaine d'activit stratgique (DAS).
Domaine dactivit stratgique : cest lensemble dactivit dune entreprise o les facteurs
cls de succs sont semblables et reposent sur des ressources et savoir-faire communs.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
29
III-Segmentation par dcoupage et regroupement
Les auteurs de Strategor (1997) expliquent que la segmentation stratgique peut tre ralise la fois par un dcoupage par diffrence et par un regroupement par analogie.
1-Segmentation par dcoupage
Entreprise
Segments stratgique
Le dcoupage consiste considrer l'entreprise globalement et tenter d'identifier les diffrents segments stratgiques qui constituent son activit. Le dcoupage est le rsultat d'une analyse des diffrences entre chacune des activits en se fondant sur les critres suivants :
- le type de clientle concerne (critre utilis en segmentation marketing) : ce critre
doit permettre de dterminer rapidement si les activits que lon compare touchent ou non des clientles identiques : industries / grand public, sexe / ge / catgories socioprofessionnelles / style de vie
- la fonction d'usage : ce critre doit permettre de savoir si les produits issus des
activits que lon compare satisfont le mme besoin et sils correspondent aux mmes critres dachat : Besoins / critres d'achat
- les circuits de distribution : le mode de distribution est souvent un critre
dterminant de segmentation et la maitrise des canaux de distribution constitue un
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
30
facteur cl de succs qui peut tre valorisable dans dautres domaines dactivit : Type du rseau de distribution (exemple : grande distribution)
- la concurrence : La prsence de concurrents identique dans diffrents produits est
souvent lorigine de leur regroupement dans un seul DAS : prsence de concurrents identiques dans deux produits
- la technologie : On dcoupe les activits de lentreprise selon la technologie
utilise : le type de techniques industrielles, fabrication l'unit ou en srie, la chane ou en continu
- la structure des cots : Lanalyse de la structure des cots par fonction pour
chaque activit nous permet deffectuer un dcoupage des activits en DAS. Ainsi, il sagit deffectuer une comparaison de la part relative des cots partags et des cots spcifiques. Si part des cots spcifiques pour chaque activit est plus importante que la part des cots partags alors les activits appartiennent des DAS diffrents. Les critres les plus frquemment utilis sont : le type de clients, les besoins satisfaits et la technologie utilise.
2-Segmentation par regroupement :
Segment Stratgique
Produit / Service Le regroupement, quant lui, consiste rassembler les produits / services qui mettent en jeu
les mme comptences , se caractrisent par les mme facteurs cls de succs et ont des concurrents identiques dans des segments stratgiques.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
31
Chapitre
Le Diagnostic stratgique
Objectifs
Dfinir le diagnostic stratgique et ses composantes ; Saisir la dmarche du diagnostic externe de lenvironnement ; Comprendre la dmarche du diagnostic interne de lentreprise
Sommaire
I-Dfinition du diagnostic stratgique II-Le diagnostic externe III- Le diagnostic interne
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
32
I-Dfinition du diagnostic stratgique
Le diagnostic stratgique consiste comprendre la situation actuelle de lorganisation par une analyse de lorganisation et de son environnement. Il sagit dun diagnostic externe de lenvironnement et dune analyse interne de lentreprise. La dmarche du diagnostic stratgique sapparente une photographie de la situation de lentreprise. Il sagit de positionner lentreprise et ses concurrents sur un march donn afin de confirmer ou de modifier les choix stratgiques antrieurs et de projeter ainsi lentreprise dans un futur matris. Il est ralis dans deux directions : l'environnement, en termes dattractivit du secteur (opportunits, menaces), et l'entreprise en termes de potentialits intrinsques (forces et faiblesses). En effet, lentreprise est un systme ouvert qui possde ses propres caractristiques et qui survit et se dveloppe dans un environnement en constante volution, porteur de menaces mais aussi dopportunits. Par ailleurs, elle est amene faire des choix stratgiques adquats afin de garantir sa survie et sa prennit. Le diagnostic stratgique permet alors, au pralable, davoir les informations ncessaires, dune part, concernant les caractristiques du environnement et micro-environnement et, dautre part, caractristiques de lentreprise elle-mme. Ainsi, le diagnostic stratgique interne et externe permettra lentreprise de pouvoir concilier les choix stratgiques dont dpend sa comptitivit long terme et la matrise des turbulences de son environnement dont dpend sa comptitivit immdiate. macroles concernant
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
33
II- Le diagnostic externe :
Selon lapproche dterministe, les changements stratgiques sont souvent le rsultat dune mutation de l'environnement. Par consquent, le diagnostic externe de lenvironnement simpose afin dassoir les dcisions stratgiques. Le diagnostic externe concerne lensemble des lments qui influencent l'entreprise ou sur lesquels elle peut agir. Il sagit didentifier les facteurs de march (forces en prsence) et les facteurs hors march (la rglementation, par exemple). Ainsi, la connaissance de lenvironnement permet de dgager les opportunits possibles et les menaces ventuelles provenant de lenvironnement . Lenvironnement de lentreprise est gnralement divis en deux sous -environnements : Un environnement immdiat (le micro-environnement) et un environnement gnral (le macro-environnement. Il est alors indispensable de raliser un diagnostic du macro environnement et du micro environnement.
1-Lanalyse macro environnement :
Cette analyse permet dvaluer lenvironnement macro de manire dgager les caractristiques susceptibles de modifier les stratgies de lentreprise. Les facteurs de lenvironnement macro peuvent tre classifis en plusieurs catgories ; facteurs politiques, conomiques, socioculturels, technologiques et environnementaux. Ils jouent un rle important dans les opportunits de cration de valeur d'une stratgie. Cependant ils sont habituellement (selon la conception dterministe de lorganisation) en dehors du contrle de l'entreprise et doivent normalement tre considrs en tant que menaces ou opportunits. Il sagit didentifier les influences cls de lenvironnement, cest --dire les facteurs susceptibles daffecter celui-ci de manire durable.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
34
Facteurs politiques : Lois sur les monopoles, lois sur la protection de lenvironnement, politique fiscale, rgulation du commerce extrieur, droit du travail, stabilit gouvernementale, etc. Facteurs conomiques : Cycles conomiques, volution du PNB, taux dintrt, politique montaire, inflation, chmage, revenu disponible, disponibilit et cot de lnergie, etc. Socioculturel : Dmographie, distribution des revenus, mobilit sociale, changements de modes de vie, attitudes par rapport au travail, niveau dducation, etc. Technologique : Dpense publique en R&D, investissements publics et privs sur la technologie, nouvelles dcouvertes, vitesse de transfert technologique, taux dobsolescence, etc. Lanalyse de ces diffrents facteurs nous permet, ainsi, davoir une vision globale sur l e marco-environnement :
Au niveau politique : existe-il une volution de lenvironnement politique ayant des consquences sur le secteur. Au niveau conomique : lanalyse de la conjoncture globale permet de savoir si on volue en priode de croissance ou en dclin. Au niveau socio culturel : analyser lvolution dmographique qui peut avoir une influence sur le niveau de la demande du march. Le vieillissement de la population peut orienter lentre prise vers une production spcifique aux besoins des personnes ges. Au niveau technologique : lvolution technologique peut influencer lactivit de lentreprise au niveau organisationnel mais galement au niveau des processus de conception, dveloppement et production. A lissue de lanalyse, il est possible de dgager de nouveaux segments d'activits et une politique engageant des moyens financiers, humains et matriels pour plusieurs annes.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
35
2-Lanalyse du micro environnement
Lenvironnement immdiat de lentreprise est constitu par plusieurs intervenants ayants des relations directes avec lentreprise. Contrairement lenvironnement gnral, pour qui lentreprise a des moyens limits pour linfluencer, lenvironnement immdiat peut tre influenc par les actions de lentreprise. Il sagit danalyser le comportement des fournisseurs, des clients, des concurrents directs, indirects et potentiels. Ce diagnostic permet lentreprise dlaborer des stratgies adquates afin de : Faire face la concurrence intra-sectorielle provenant des concurrents installs Dvaluer le niveau de protection du secteur contre les entrants potentiels Danalyser le poids des fournisseurs et des clients dans le secteur.
III-Le diagnostic interne :
Le diagnostic interne a pour objectifs danalyser les forces et les faiblesses de lentreprise et celles de ses DAS. Il sagit galement de comparer les forces et les faiblesses de lentreprise par rapports ceux de ses concurrents afin dvaluer la position relative de lentreprise sur son march.
1-Lanalyse de la position concurrentielle de lentreprise :
Cette analyse revient positionner lentreprise par rapport ses concurrents en termes de Facteurs Cls de Succs. Il sagit : Danalyser les facteurs cls de succs (FCS) propre s au DAS analys ; Dvaluer la performance de lentreprise et de chacun de ses concurrents sur les diffrents facteurs cls de succs.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
36
Les facteurs cls de succs sont les lments stratgiques que lentreprise doit matriser afin dassurer sa prennit et sa lgitimit lui permettant de dgager un avantage concurrentiel.)
FCS (sources de lavantage concurrentiel) ce sont des comptences, des ressources des atouts quune entreprise doit ncessairement dtenir pour russir une activit donne. STRATEGOR distingue 5 catgories de FCS :
La position sur le march : sexprime par la part de march (absolue ou relative) et par son volution (en croissance ou en dcroissance) La
position
de
lentreprise
en
matire
de
cot :
les
cots
dapprovisionnement, les cots de production, de commercialisation, etc. Limage et limplantation commerciale , Les comptences techniques et la matrise technologique , La rentabilit et la puissance financire .
2-Le benchmarking :
Le benchmarking consiste analyser les performances de lentreprise sur ses FCS et les comparer avec le meilleur niveau de performance obtenu dans dautres entreprises tous secteurs confondus, afin de dgager un moyen permettant damliorer les performances de lentreprise. Ainsi, il sagit de rechercher quelles sont les meil leures pratiques sur un secteur donn et ce par rapport tous les autres secteurs, dterminer lcart par rapport lentreprise et dfinir un niveau de performance atteindre. Cette pratique demande une grande habilit la recherche dinformation. Les
principales sources dinformations sont : les bases de donnes, les experts de
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
37
lindustrie, les clients et les fournisseurs, les rapports de recherche, livres, magazines, les cabinets de consulting.
3-Lanalyse fonctionnelle :
Lanalyse fonctionnelle consiste passer en revue les principales fonctions de lentreprise pour dterminer les forces et faiblesses et les comparer aux concurrents.
Commercial e: politique marketing : y a-t-il une politique de segmentation du march,
politique de ciblage ? Quel est le positionnement ? Etude du MIX (Prix, Produit, Distribution, Communication). Etude des parts de march et des forces des ventes.
Production : Etude du mode de production, de la capacit de production. Quels sont
les dlais de fabrication, y a-t-il des conomies dchelles ? Quelles est la productivit ?
Approvisionnement : Dlais dapprovisionnement, dlais de paiement accord par le
fournisseur, lien de dpendances entre lentreprise et le fournisseur.
GRH : Niveau de comptences, mode de rmunration, motivation des salaris,
systme de communication interne.
Comptabilit : Etude des Soldes Intermdiaire de Gestion, comptabilit analytique. Financire : Niveau dendettement, mode de financement (autofinancement, ouverture
du capital) et tude de solvabilit de lentreprise ( c..d. la trsorerie, le fonds de roulement et besoin en fonds de roulement)
Recherche et dveloppement : Quels sont les budgets et les ressources consacrs la
recherche ? Masse salariale ? Publication et brevets ? Il sagit danalyser ces fonctions en termes de forces et faiblesses, ressources et comptences.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
38
Les ressources : Il sagit des ressources possdes par lentreprise de manire gnrale. Il
peut sagir des ressources physique (usine, site), des ressources humaines (personnel, ouvriers), ressources financires (fonds disposs par lentreprise), ressources intangibles (marque, brevet, Licence).
Les comptences : Constituent les savoir-faire et routines qui permettent de mener bien
diverses fonctions (exp : la conception, la production, le marketing, etc.)
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
39
PARTIE
Les principaux outils du diagnostic stratgique
Objectifs
Maitriser le modle LCAG comprendre le modle de M. Porter Connaitre les modles danalyse de portefeuille dactivits
Sommaire
Ch I Le modle LCAG / SWOT Ch II Le modle de M. Porter Ch III Les modle danalyse de portefeuille dactivits
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
Chapitre
40
Le modle LCAG
Objectifs
Identifier les principes Comprendre les avantages et limites du modle SWOT identifier les opportunits et menaces de lenvironnement et les forces et
faiblesses de lentreprise Dduire les stratgies adquates suite la confrontation des opportunits et menace aux forces et faiblesses
Sommaire
I- Prsentation et principes du modle LCAG II- Application du modle LCAG III- Les composantes de la matrice SWOT
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
41
I-Prsentation et principe du modle lcag :
Ce modle, connu sous le sigle LCAG du nom de ses 4 dveloppeurs (Learned, Christensen, Andrews et Guth) a t cr en 1965 par ces 4 professeurs de la Harvard Business School. Il est habituellement appel matrice SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forces Faiblesses Opportunits Menaces) Il reprsente toujours un point de rfrence important car il constituait le premier modle daide la formulation stratgique. Il est bas sur deux concepts cls qui sont lide de comptence distinctive , et le concept de stratgie de secteur dactivit . Le modle LCAG offre un raisonnement logique en cinq phases :
-valuation externe,
identification des menaces et des opportunits dans lenvironnement; identification des facteurs cls de succs.
-valuation interne,
identification des forces et faiblesses de lentreprise par rapport la concurrence et par rapport au temps ; identification des comptences distinctives par rapport la concurrence.
-Cration et valuation de toutes les possibilits daction, -claircissement des valeurs de lenvironnement (responsabilit sociale de
lentreprise) et des valeurs managriales (dirigeants),
-Choix des manuvres stratgiques en fonction des ressources et mise en uvre des stratgies.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
42
Ainsi, il permet un diagnostic stratgique interne et externe qui pourra tre approfondi par dautres outils plus prcis tels que le modle de Porter ou les modle matriciels danalyse de portefeuille dactivits.
Le modle LCAG
Analyse de lenvironnement
Identification des opportunits & menaces
Diagnostic de lentreprise
Identification des forces & faiblesses
Valeurs de lenvironnement Responsabilit sociale de la firme
Recensement et valuation des possibilits dactions
Valeurs managriales : Objectifs gnraux des Dirigeants
Formulation de la stratgie : dfinition des activits, objectifs, voies et moyens
Le modle LCAG peut tre utilise comme un outil de diagnostic facile ou comme un outil de base pour identifier des choix stratgiques. Elle prconise, avant d'effectuer des choix stratgiques ou de dfinir des politiques fonctionnelles, de raliser une analyse interne et externe. Ce modle a lavantage dtre attractif en raison de sa logique. Il peut sappliquer une situation simple et en mme temps contribuer schmatiser simplement une situation complexe dans une formulation simple susceptible dtre comprise de t ous dans lorganisation.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
43
II-Application du modle :
Selon le modle LCAG ou de la matrice SWOT, l'entreprise doit dans un premier temps, confronter ses forces et faiblesses aux opportunits et aux menaces de l'environnement. Cette analyse peut tre prsente sous forme de 2 tableaux rcapitulatifs, l'un consacr l'analyse interne des forces et des faiblesses de lentreprise, l'autre consacr l'analyse externe des opportunits et des menaces de lenvironnement.
1-L'analyse de lentreprise (interne) :
Pour identifier ses points forts et faibles, l'entreprise doit raliser une analyse interne. Il convient notamment d'examiner les ressources de l'entreprise, ses activits et ses performances. Les forces : Les forces correspondent aux facteurs qui permettent l'entreprise de mieux russir que ses concurrents. Par exemple, la valeur d'une marque peut reprsenter une force importante pour une entreprise. Les faiblesses : Les faiblesses dsignent les domaines o l'entreprise est susceptible d'afficher des difficults par rapport la concurrence.
2-L'analyse de lenvironnement (externe) :
L'analyse externe vise dtecter les opportunits et les menaces de l'environnement. Elle porte sur l'environnement gnral (environnement dmographique, conomique, institutionnel, naturel, technologique, culturel) et l'univers concurrentiel. Les opportunits : Les opportunits correspondent des tendances favorables qui ouvrent de nouvelles perspectives de dveloppement dont l'entreprise pourrait tirer profit. Par exemple, l'ouverture et le taux de croissance lev du march chinois
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
44
constituent des opportunits de dveloppement intressantes pour les entreprises europennes. Les menaces : Les menaces dsignent des problmes poss par une transformation de l'environnement qui, en l'absence d'une rponse stratgique approprie, peuvent dtriorer la position de l'entreprise. Par exemple le dveloppement des compagnies ariennes de type "low cost" constitue une menace importante pour les compagnies traditionnelles. Celles-ci ont en gnral ragit en lanant leur propre offre "low-cost" sur le march.
3-Finalit : ragir stratgiquement
L'entreprise doit s'appuyer sur l'analyse interne et externe ralise l'aide de la matrice SWOT (LCAG) pour prendre les dcisions stratgiques qui permettent de contrer les menaces et de saisir les ou certaines opportunits. Elle doit dterminer les domaines d'activits stratgiques (DAS-CAS) qu'elle envisage de maintenir, de dvelopper ou d'abandonner. Ensuite sur la base de cette slection, l'entreprise va devoir choisir le mode de ralisation des activits slectionnes : cration d'une filiale, constitution d'une socit commune, acquisition, etc.
4-Limites de lanalyse SWOT
La matrice est une photo, une image isole dun film. Vous voyez quil y a du mouvement, mais pas les images suivantes. Lanalyse SWOT ne montre pas du tout comment atteindre ou obtenir un avantage comparatif, ce nest donc aucunement une fin en soi. La matrice SWOT doit donc tre le point de dpart dune discussion au sein de lentreprise sur la manire dont la stratgie propose pourrait tre mise en uvre, avec une analyse cot/bnfice approprie, pour arriver dgager lavantage concurrentiel.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
45
La dynamique complexe entre les circonstances, les environnements, les menaces, les changements divers, ne peut tre illustre par la matrice SWOT et le risque est donc de se figer dans une analyse trop statique. Enfin, le risque existe de voir lentreprise se focaliser sur un facteur interne ou externe et de ngliger dautres facteurs susceptibles de permettre aujourdhui mais surtout demain un avantage concurrentiel.
III-Les composante de la matrice SWOT
1-Les grands axes de lvaluation interne et externe
Evaluation de lenvironnement de lentreprise
Changements socitaux : changement des gots
du client, volution dmographique.
Evaluation interne de lentreprise
Marketing : qualit du produit, gammes,
diffrenciation, part de march, services
Changements politiques : nouvelles lgislation,
nouvelles priorits en matire dapplication.
R&D : capacit de R&D sur les produits, sur les
processus,
Changements conomiques : taux dintrt,
taux de change, changement dans les revenus individuels
Systme de gestion de linformation :
rapidit et ractivit, qualit de linformation, capacit dexpansion
Changements concurrentiels : adoption de
nouvelles technologies, nouveaux concurrents, variation des prix, nouveaux produits
Equipe de direction : comptences, esprit
dquipe, exprience, coordination de leffort
Oprations : Contrle des matires premires, Changements en matire dapprovisionnement : changement des cots,
changement de loffre, changement du nombre des fournisseurs capacits de production, gestion des stocks, contrle qualit, installation et quipements
Finance : puissance financire, puissance
oprationnelle, ratios de bilan, rapport avec les actionnaires
Changement du march : nouvelle utilisation
du produit, nouveaux marchs, obsolescence des produits
Ressources humaines : systme de gestion,
comptences du personnel, taux de rotation, dveloppement du personnel,
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
46
2-Les Principales variables SWOT
Forces - Strenghts
-Expertise / Brevets - Nouveau produit ou service - Bonne implantation de l'activit - Avantage cot / savoir-faire - Processus et procdures Qualit - Marque ou rputation forte
Faiblesses - weaknesses
Manque d'expertise Produits et service indiffrencis Mauvaise implantation Faible accs aux canaux de distribution Mauvaise qualit des produits / services Mauvaise rputation
Opportunits - Opportunities
March mergeant Fusions, Joint-venture, alliances
Menaces - Threats
Nouveau concurrent sur march Guerre des prix Nouveau produit de substitution Nouvelles rglementations Entraves aux changes Nouvelle imposition sur produit
stratgiques Entre nouveaux segments march Un nouveau march international Rduction de la rglementation Suppression barrires commerciales
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
47
3-Les choix stratgiques selon la confrontation
La confrontation entre lanalyse externe travers les opportunits et les menaces provenant de lenvironnement et lanalyse interne travers lvaluation des forces et des faiblesses de lentreprise permet didentifier quatre possibilits stratgiques. Stratgie dattaque, Stratgie dajustement, Stratgie de dfense, Stratgie de survie.
EXTERNE Opportunits ----------------------INTERNE Points forts
(Strengths) Stratgie d'Attaque Tirer en le Maximum Stratgie de Dfense Stratgie d'Ajustement Rtablisser les points forts Stratgie de Survie Contourner les difficults (Opportunities)
Menaces
(Threats)
Faiblesses
(Weaknesses)
Surveiller troitement la concurrence
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
48
Chapitre
Le modle de M. Porter
Objectifs
Dcrire le modle et ses principes, Comprendre les avantages et les limites du modle des 5 forces de Porter Analyser lenvironnement concurrentiel via le modle des 5 forces de Porter
Comprendre le modle de la chane de valeur
Sommaire
I- Le modle des 5 forces de M. Porter II- Concept de la chaine de valeur
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
49
Michael Porter, professeur et chercheur la Harvard Business School, fait partie des grands matres penser dans le domaine de la stratgie dentreprise. Nous tudierons dans ce chapitre le modle des 5 forces concurrentielles qui permet lanalyse de lenvironnement concurrentiel et la chaine de valeur qui constitue un o util de diagnostic interne de lentreprise
I-Le modle des cinq forces de M. Porter :
Un outil du diagnostic externe
1-Description du Modle des 5 Forces de Michael PORTER:
Le Modle des 5 Forces de Porter est un outil danalyse stratgique et commerciale permettant danalyser linfluence de facteurs extrieurs sur lentreprise ou sur un Domaine dActivit Stratgique. Il permet galement de mieux comprendre la valeur, lattractivit de lentreprise ou du DAS et de son secteur. Porter considre que la concurrence dans un secteur donn est dtermine par 5 forces fondamentales qui influencent la manire dont lentreprise devrait se comporter face la concurrence. Il sagit de :
- Lentre de nouveaux concurrents (new entrants): peut constituer une menace
pour une entreprise installe dans un secteur donn et donc susceptible dintensifier la concurrence : Est-il facile ou difficile pour de nouveaux entrants de venir concurrencer le secteur, quelles sont les barrires lentre ?
- Menace des produits de substitution (substituts): Lexistence ou non de produit
de substitution peut modifier la concurrence dans secteur donn. Il sagit alors de savoir avec quelle facilit un nouveau produit ou service peut-il se substituer aux produits et services existants, particulirement en tant meilleur march, plus performants, dun accs plus ais, ...
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
50
- Pouvoir de ngociation des clients (buyers): Dans certaines conditions, les clients peuvent avoir un pouvoir de ngociation dur lentreprise. Lentreprise doit alors savoir si ses clients sont en position de force pour ngocier. - Pouvoir de ngociation des fournisseurs . (suppliers) Les fournisseurs peuvent galement influencer les conditions de la concurrence en agissant sur les prix, les dlais, etc. Lentreprise doit alors savoir sils sont en position de force pour ngocier ; Existe-t-il beaucoup de fournisseurs potentiels ou pas ? - Rivalit parmi les acteurs existants du march. (existing firms) : La concurrence intra-sectorielle est dpend de lintensit de la rivalit entre les firme s existantes. Il est possible dvaluer lintensit concurrentielle intra-sectorielle en posant les questions suivantes : Existe-t-il une forte concurrence entre les acteurs du march ? Est-ce que l'un des joueurs est en position dominante ou sont-ils tous de force et de tailles gales.
Le Gouvernement : Dans un contexte actuel de rgulation croissante, mais aussi de
fiscalit et de lgislation du travail le gouvernement devient un dterminant de poids et qui impacte sur la concurrence dans un secteur donn : Quelle est limportance des facteurs induits par le Gouvernement ? En termes de rglementation sur le prix, daccs aux marchs, de standards, de normes, de politique fiscale ou sociale, de concurrence ? Le modle des forces de la concurrence de Porter est probablement l'un des outils les plus souvent utiliss en stratgie commerciale.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
51
Schma des 5 forces de la concurrence de M. Porter
2- Analyse des forces de la concurrence:
- La menace des nouveaux entrants :
Dpend de : - Prsence / Absence dans le secteur d'conomies d'chelle influenant la rentabilit. - Besoins en capitaux/investissement. - Cots de remplacement pour le client. - Accs aux canaux de distribution de l'industrie. - Accs la technologie. - Fidlit la marque. Les clients sont-ils fidles ?
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
52
- La probabilit de revanche de joueurs existants dans l'industrie. - Rglementations du gouvernement : p/ex les nouveaux entrants peuvent-ils obtenir des subventions ?
- La menace de produits de remplacement :
Dpend de : - Qualit : un produit de remplacement est-il meilleur ? - La volont des acheteurs de le substituer. - Les prix et performances relatifs aux produits de remplacement. - Les cots de remplacement par les produits de substitution : est-ce facile de changer pour un autre produit ?
- Le pouvoir de ngociation des fournisseurs :
Dpend de : - Concentration des fournisseurs : y a-t-il beaucoup d'acheteurs et peu de fournisseurs dominants ? - Marque : la marque du fournisseur est-elle forte ? - Rentabilit des fournisseurs : est-ce que les fournisseurs sont forcs d'augmenter les prix? - La menace des fournisseurs d'intgrer en aval dans l'industrie (par exemple : fabricants de marque menaant d'tablir leurs propres dbouchs pour les ventes au dtail). - La menace des acheteurs d'intgrer vers l'amont leur approvisionnement. - Rle de la qualit et du service. - L'industrie n'est pas un groupe de clients-cl pour les fournisseurs. - Cots de remplacement : est-il facile pour des fournisseurs d'identifier de nouveaux clients?
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
53
- Le pouvoir de ngociation des acheteurs
Dpend de : - Concentration des acheteurs : y a-t-il quelques acheteurs dominants et beaucoup de vendeurs dans l'industrie ? - Diffrentiation : Est-ce que les produits sont normaliss ? - Rentabilit des acheteurs : Est-ce que les acheteurs sont forcs d'tre durs ? - Rle de la qualit et du service. - Menace d'intgration en amont et vers l'aval dans l'industrie. - Cots de remplacement : Est-il facile pour des acheteurs de remplacer leur fournisseur ?
- L'intensit de la rivalit
Dpend de : - La structure de la concurrence : la rivalit sera plus intense s'il y a un grand nombre de petits ou de concurrents d'gale importance ; la rivalit sera moindre si une industrie a un Leader clairement identifi sur le march. - La structure des cots de l'industrie : les industries avec des cots fixes levs encouragent les concurrents fabriquer pleine capacit de production en cassant les prix si besoin est. - Degr de diffrentiation du produit : les industries dans lesquelles les produits sont des matires premires (par exemple acier, charbon) gnrent typiquement une plus grande rivalit. - Cots de remplacement : la rivalit est rduite quand les acheteurs ont des cots de permutation levs.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
54
- Objectifs stratgiques : si les concurrents poursuivent des stratgies agressives de croissance, la rivalit sera plus intense ; si les concurrents simplement "traient" les bnfices dans une industrie mre, le degr de rivalit est en gnral bas. - Barrires de sortie : quand les barrires de sortie d'une industrie sont leves, les concurrents tendent montrer une plus grande rivalit.
3-Points forts du modle des Cinq Forces de la Concurrence :
Le modle des forces de la concurrence est un outil puissant pour l'analyse de la comptition au niveau d'une mme industrie. Il permet une analyse claire de la concurrence dans un domaine particulier donnant la possibilit lentreprise de prendre les dcisions stratgiques adquates afin de faire face la concurrence. Il fournit les donnes utiles en entre pour raliser une analyse SWOT.
4- Limites du Modle des 5 forces de Porter :
Lutilisation de ce modle peut aboutir une analyse statique de linfluence des 5 forces ce qui limiterait lintrt du travail. Certains auteurs objectent que les environnements qui sont caractriss par des changements rapides, systmiques et radicaux requirent des approches plus souples, plus dynamiques ou mergentes pour la formulation de la stratgie. Dans un contexte de changements rapides, de cycles courts, les rsultats du modle peuvent tre rapidement contests. Certains points forts peuvent devenir obsoltes ou de peu dintrt stratgique, alors que certaines comptences ou ressources anodines peuvent savrer stratgique. Le modle a t conu pour analyser la stratgie commerciale d'une mme activit. Il ne permet pas la prise en compte des synergies et interdpendances du portefeuille d'activits des grandes entreprises.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
55
Parfois il peut tre possible de crer des marchs compltement nouveaux au lieu de choisir parmi ceux existants.
II-La Chaine de valeur de Porter :
un outil du diagnostic interne
1- Prsentation de la chaine de valeur :
La Chane de la Valeur de Michael Porter est un modle qui aide analyser les activits spcifiques par lesquelles les socits peuvent crer de la valeur et dgager un avantage concurrentiel. Elle permet de positionner lensemble des activits dune firme. Les managers peuvent ainsi dcider des efforts que lentreprise doit mettre en uvre pour rduire ses cots et dgager de plus grandes marges. Porter divise les activits de lentreprise en activits principales qui sont directement impliques dans la cration dune valeur pour le client. (ex : la logistique interne, la production, la logistique externe, le marketing et le service aprs vente) et les activits de soutien telles que le dveloppement technologique, les ressources humaines, lapprovisionnement
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
56
Les Activits PRIMAIRES
Logistique interne : Inclut la rception, stockage, gestion des stocks, planification du transport. Oprations : Inclut l'usinage, l'emballage, l'assemblage, l'entretien du matriel, les tests et toutes autres activits de cration de valeur qui transforment les produits d'entre en produit final. Logistique externe : Les activits requises pour mettre le produit fini disposition des clients: entreposage, commande, transport, gestion de la distribution. Marketing et ventes : Les activits lies la mise sur le march des produits, comprenant : choix du canal de distribution, publicit, promotion, ventes, politique de prix, gestion des dtaillants, etc. Services : Les activits qui prservent et augmentent la valeur du produit, comprenant : support la clientle, services de rparation, installation, formation, gestion des pices dtaches, versions de mise jour, etc.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
57
Les Activits de SOUTIEN :
Approvisionnement : Approvisionnement des matires premires, Service Aprs-vente, pices de rechange, immeubles, machines, etc. Dveloppement de technologie : Inclut le dveloppement de technologie pour aider les activits de la chane de valeur. Comme : Recherche et dveloppement , automatisation de processus, conception. Gestion des Ressources Humaines : Les activits lies au recrutement, au dveloppement (formation), la conservation et la politique de rmunration des employs et des dirigeants. Infrastructure de la socit : Inclut la direction gnrale, la gestion de la planification, le financement, la comptabilit, les affaires publiques, la gestion de la qualit, etc.
2-Les dterminants de lavantage concurrentiel bas sur les cots
M. Porter a identifi 10 facteurs permettant dconomiser sur les cots lis aux activits de la chane de valeur : conomies d'chelle Apprentissage Utilisation de capacit Articulations parmi des activits Corrlations parmi des units d'affaires Degr d'intgration verticale Synchronisation d'entre du march Ferme politique de cot ou de diffrentiation Zone gographique Facteurs institutionnels (rglementation, activit des syndicats, impts, etc.).
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
58
Comment crer un avantage de cot bas sur la chane de la valeur ?
Une firme peut crer un avantage de cot en rduisant le cot des diffrentes activits de la chane de la valeur, ou en modifiant la chane de la valeur. Un avantage de cot peut tre cr en rduisant les cots des activits primaires, mais galement en rduisant les cots des activits de soutien. Une fois que la chane de valeur a t dfinie, une analyse du cot peut tre ralise en affectant les cots aux activits de la chane de la valeur. Ainsi, une socit peut dvelopper un avantage de cot soit : En maintenant sous contrle ces facteurs mieux que ses concurrents. Par "Reconfiguration" de la chane de la valeur c'est--dire par des changements structurels comme : un nouveau procd de production, de nouveaux canaux de distribution, ou une approche diffrente des ventes.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
59
Chapitre
Les modles de portefeuille dactivits
(Diagnostic interne)
Objectifs
Dfinir le concept de cycle de vie dun produit / domaine dactivit comprendre les principes de la matrice BCG, Mc Kinsey et A. D. Little
Sommaire
I- Le concept du cycle de vie II- La matrice BCG III-La matrice Mc kInsey IV- La matrice A.D. Little
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
60
I-Le concept de cycle de vie :
Un produit au cours de son existence connat une succession dtapes caractristiques qui rythment sa vie. Comme tout tre vivant, un produit nat, crot, vit et meurt. Il est important dtudier le cycle de vie dun produit dans le cadre de lorientation stratgique. En effet, la phase de cycle de vie dans laquelle se trouve le produit est un lment important dans lanalyse de la position actuelle et future du produit sur son march. Le cycle de vie dun produit ou dun domaine dactivit se dcompose en quatre grandes phases. Chacune delle a ses particularits.
La phase dintroduction (le lancement) : Cest la phase de lintroduction du produit sur le march. Elle est caractrise par : - une faible concurrence, sil sagit dun nouveau produit - une croissance faible - un niveau de profit nul voire ngatif (en raison des cots de lancement)
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
61
- une distribution limite
- La phase de croissance :
Durant cette phase, la demande croit, le produit commence se faire connatre, les ventes augmentent rapidement. Cest une phase de conqute du march. Lentreprise peut commencer raliser des bnfices. La possibilit de bnfices attire les concurrents.
-La phase de maturit :
Durant cette phase, le taux de progression des ventes ralentit. La rentabilit du produit est son maximum (amortissement des investissements de lancement). La concurrence devient trs vive et le march est satur.
-La phase de dclin :
Durant cette phase, les ventes diminuent car apparition de nouveau produits plus adapts aux besoins des consommateurs. La rentabilit du produit devient trs faible et peut mme devenir une charge pour lentreprise.
II-La matrice BCG
1- Principes de la mthode BCG :
La mthode du Boston Consulting Group est la plus ancienne et la plus simple mettre en uvre. Elle permet de situer les produits de lentreprise par rapport ceux de la concurrence dans le but de faciliter la prise de dcision quant la consolidation de la position, le dveloppement, ou le retrait de certains produits. Lobjectif de cette matrice est danalyser lquilibre et la cohrence du portefeuille de produit de lentreprise.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
62
Cette mthode se base sur le cycle de vie du produit ou du domaine dactivit. Elle est reprsente par une matrice qui classe les produits de lentreprise (ou DAS : domaine dactivits stratgiques) en fonction du taux de croissance du segment dactivit et de la part de march relative de lentreprise : - La croissance du march : (Situe en ordonne) A travers laquelle on mesure les besoins de liquidit gnrs par les diffrents produits. La matrice distingue deux catgories de marchs : march forte croissance, et march faible croissance. Ces deux catgories sont spares par le taux moyen de croissance du march. - La part de march relative de lentreprise : (Situe en abscisse) A travers laquelle on mesure la rentabilit dgage par chacun des produits. Elle reprsente la position quoccupe le produit de lentreprise par rapport au plu s important concurrent sur le march. Elle est dfinie par le rapport suivant : PMR = Part de march de lentreprise / Part de march du concurrent principal
2-Prsentation de la matrice BCG :
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
63
Les produits dilemmes (?) : Ce sont des produits en en phase de lancement. Ils prsentent un fort potentiel de dveloppement pour lentreprise mais ce sont des produits coteux qui ncessitent des investissements en communication. Leur rentabilit est possible si lentreprise parvient augmenter sa part de march relative, le produit se transforme alors en un produit vedette. Dans le cas contraire, ce produit volue en poids mort et sera retir du march. Les produits vedettes (toiles) : Ce sont des produits en phase de croissance qui sont prometteur pour lentreprise. Ils gnrent des profits modestes mais seront trs rentables pour lavenir. Les produits vaches lait : Ce sont des produits en pleine phase de maturit. Ils sont peu coteux et gnrent un fort profit assurant lautofinancement des autres produits (vedettes et dilemmes) Les produits poids morts (chiens) : Ce sont des produits en phase de dclin. Ils sont en situation difficile et ne rapportent plus rien lentreprise.
3-Les prescriptions stratgiques de la matrice BCG
La matrice BCG permet dorienter lentreprise sur linvestissement ou le dsinvestissement stratgique effectuer. Rentabiliser les vaches lait : Arrive en phase de maturit, les activits de lentreprise doivent dgager le flux financier le plus important possible. Lentreprise doit alors adopter une gestion rigoureuse et rinvestir dans les activits prometteuses (exp vedettes) Abandonner ou maintenir sans investissement les poids morts : Si lactivit en phase de dclin est encore bnficiaire, la firme peut la conserver condition de ne pas investir. Dans le cas inverse, il faut labandonner en la vendant ou en la laissant mourir.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
64
Maintenir la position dominante pour les vedettes en attendant quelle devienne vache lait avec le vieillissement de lactivit. Doubler la mise, resegmenter ou abandonner pour les dilemmes : Le choix seffectuera selon certains critres tels que : la taille future du march, limportance des investissements raliser, les comptences propres de lentreprise et sa capacit financire, la synergie avec dautres activits, etc.
+ Croissance march
Vedettes
Dilemmes
Vaches lait
Poids morts
PMR
3-Intrt et limites de la matrice BCG
Intrts de la matrice BCG : Le modle BCG permet dvaluer l'quilibre du portefeuille de produits entre les produits : "Etoiles", "Vaches lait", "Dilemmes" et "Poids Mort". Lanalyse des produits en termes de croissance de march et de PMR permet alors lentreprise dquilibrer son portefeuille de produits : supprimer les poids morts, valoriser les produits vedettes et vaches lait et statuer sur les produits dilemmes. La mthode BCG est applicable aux grandes entreprises qui cherchent des effets de volume et d'exprience. Le modle est simple et facile comprendre. Il fournit une base un dirigeant pour dcider et se prparer de futures actions.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
65
- Limites de la Matrice BCG
Elle nglige les effets de synergie entre les Units d'Affaires (Business Units). Une part de march leve n'est pas le seul facteur de succs. La croissance du march n'est pas le seul indicateur de l'attractivit d'un march. Des problmes de collecte des donnes des parts de march et de croissance du march. Il n'y a aucune dfinition claire de ce qui constitue un march . Une part de march leve ne mne pas toujours ncessairement la rentabilit. Le modle utilise seulement deux dimensions : part de march et taux de croissance.- Le modle nglige les petits concurrents qui ont des parts de march croissance rapide.
Ii-Le modle A. D. Little:
1-Principes du modle ADL :
Le modle ADL associe deux critres de nature quantitative : le degr de maturit de lactivit : reposant sur las quatre phases du cycle de vie La position concurrentielle de lentreprise sur le domaine dactivit : tablie partir du degr de matrise des domaines vis--vis des facteurs cl de succs du segment analys. Dans une activit en dmarrage ou en croissance, des investissements lourds sont ncessaires. Seule une position forte ou dominante permet de les autofinancer. Plus la position est marginale, plus le dficit de liquidit et le risque sont importants.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
66
Les activits mres ou vieillissantes crent, en revanche, plus de besoins. Une position forte se traduit par de faibles risques. A linverse, la rentabilit dclinant dans les positions faibles, lautofinancement diminue et le degr de risque augmente.
2- Les prescriptions stratgiques du modle ADL :
Le croisement des deux critres fait apparaitre quatre zones auxquelles correspondent trois options stratgiques : le dveloppement naturel, le dveloppement slectif, la rorientation et labandon.
- Le dveloppement naturel : suppose lengagement de toutes les ressources
ncessaires pour suivre le dveloppement. Il correspond aux activits pour lesquelles lentreprise a une bonne position concurrentielle, mais intgre galement la totalit des segments davenir (en phase de dmarrage) - Le dveloppement slectif : pour les activits position concurrentielle moyenne voire faible ; lobjectif est datteindre une meilleure position concurrentielle et donc une meilleure rentabilit. - La rorientation : pour les activits position concurrentielle assez faible, mais qui sont en phase de fin de maturit, une rorientation vers un nouveau domaine est prfrable pour viter la phase de dclin.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
67
- Labandon : est prfrable pour les activits de peu de rendement et o la position concurrentielle de lentreprise est faible
3-Intrt et limites du modle :
Le modle ADL ne se limite pas comme le modle BCG la comptitivit par des cots ; il est galement plus dynamique puisque, dune part, la position concurrentielle sapprcie en fonction de atouts de lentreprise et non de la seule part de march dtenue un moment donn et que, dautre part, lattrait du segment svalue partir du cycle de vie, ce qui tient compte de son volution. En contre partie, plus qualitatif que le modle BCG, il procure des renseignements moins simples et moins tranchs.
III-Le modle McKinsey :
1-Prsentation de la matrice McKinsey :
Le tableau stratgique de McKinsey est construit partir de deux variables : la position concurrentielle et la valeur du secteur ou attrait du march. La position concurrentielle se diffrencie du modle ADL en ce quelle est mesure par des facteurs cls de succs plus nombreux et pondrs les uns par les autres.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
68
La valeur du secteur ou attrait du march svalue partir de la valeur absolue ou intrinsque (via le taux de croissance du secteur et sa maturit), mais aussi partir de la valeur relative qui correspond lintrt que lactivit reprsente pour lentreprise elle-mme, et dpend dlments tels que lexistence de synergies avec dautres activits de lentreprise, le niveau des barrires lentre ou la matrise dun facteur cl critique (exp scurit des approvisionnements ou des dbouchs).
2-Structure de la matrice et prescriptions stratgiques :
Elle se prsente sous la forme dun tableau double entres et neuf cases en abscisse, la position concurrentielle et, en ordonne, la valeur du secteur ; chacun de ces deux critres tant mesur sur une chelle trois positions : forte, moyenne, faible. La reprsentation des activits dans le tableau est identique celle des deux prcdents modles.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
69
La matrice prsente trois stratgies lmentaires : Investir et se dvelopper : lorsque la valeur de lactivit et la position concurrentielle sont intressantes ; Statu quo : Il sagit de se maintenir en rentabilisant dans les zones de valeur et de position concurrentielle moyenne ; Abandon : Se retirer partiellement ou totalement des zones faibles.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
70
PARTIE
Les orientations stratgiques
Objectifs
Connaitre les stratgies gnriques Identifier les stratgies de dveloppement Comprendre les diffrents modes de croissances Saisir r les stratgies dinternationalisation Identifier les stratgies de coopration
Sommaire
Ch I Les stratgies concurrentielles Ch II les stratgies de dveloppement : spcialisation vs diversification Ch III Les mode de croissance : croissance interne vs croissance externe Ch IV Les stratgies de cooprations
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
Chapitre
71
Les stratgies cooncurrentielles
Objectifs
Connaitre les diffrentes stratgies concurrentielles Comprendre les avantages et les inconvnients de chaque stratgie concurrentielle
Sommaire
I- Stratgie de domination par les cots II- Stratgie de diffrenciation III- Stratgie de focalisation
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
72
Fixer une stratgie revient choisir une mthode parmi dautres permettant dobtenir un avantage concurrentiel sur le march dans un DAS particulier. Afin de faire face la concurrence dans un DAS particulier, Porter identifie 3 stratgies qui peuvent tre peuvent tre adopte : Il sagit de la stratgie de domination par les cots, la stratgie de diffrenciation et la stratgie de focalisation.
I-Stratgie de domination par les cots
L'objectif de l'entreprise est de minimiser ses cots complets. Cet avantage de cot lui permettra de pratiquer une politique de prix adapte l'intensit de la concurrence et la position de l'entreprise. Cette stratgie consiste donc proposer une offre dont la valeur perue est comparable celle des offres des concurrents mais un prix plus faible. Elle sappuie donc sur une domination par les cots. Diffrents mcanismes permettent la domination par les cots : Les conomies dchelles : Lorsque le cot unitaire dun produit diminue suite une augmentation des quantits produites (talement des frais fixes sur un plus grand nombre de produits. Les effets dapprentissage : lorsquau fur et mesure que les quantits cumules dun bien augmentent dans le temps, le savoir-faire commercial ou technique saccroit. Ainsi, laccumulation de lexprience permet dapporter des modifications aux produits afin dliminer les lmen ts superflus qui pserait sur les cots. Les investissements dans linnovation qui permettent une diminution des prix : linnovation permettra de simplifier le processus de production qui peut favoriser la diminution des cots.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
73
Les stratgies de domination par les cots sont des stratgies de volume. L'entreprise recherchera la part de march la plus importante. Cette stratgie est adapte aux domaines d'activit o la diffrenciation des produits est faible et o la concurrence se fait sur les prix. Les risques sont de plusieurs ordres : ncessit d'utiliser des moyens techniques importants, concurrents qui bnficient des effets d'exprience, guerre des prix, apparition de produits de substitution...
Ii-Stratgie de diffrenciation
Cette stratgie consiste pour une entreprise donner son offre une spcificit diffrente de celle de ses concurrents. Selon Porter, se diffrencier pour une firme consiste acqurir par rapport ses concurrents une caractristique unique laquelle les clients attachent une valeur. Elle permet dchapper la comparaison en termes de prix en rendant le produit difficilement comparable en termes de valeur. Les sources de diffrenciation peuvent tre : La qualit Laspect technologique La scurit Lesthtique La notorit de la marque Le service aprs vente Pour russir, la diffrenciation doit tre significative et perue comme telle par le march. Pour mettre l'entreprise l'abri des attaques de ses concurrents elle doit tre dfendable.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
74
Certaines activits comme les automobiles, les produits de mode, de luxe se prtent la diffrenciation alors que d'autres non, comme les produits banaliss. La diffrenciation peut tre soit par le haut, soit par le bas. La diffrenciation pat le haut : loffre se distingue de celle des concurrents par sa valeur suprieure (exp les grande marque de luxe Dior, Chanel etc.) La diffrenciation par le bas : lentreprise fait une offre dont la valeur perue par le march est plus faible mais qui est propos un prix plus bas exp TATI.
III-Stratgie de focalisation ou de niche
Dans ce type de stratgie l'entreprise se concentre sur un segment du march o sa rentabilit sera plus forte que celle de ses concurrents prsents sur l'ensemble des segments. On parle galement de stratgie de niche. La stratgie de focalisation ou de concentration est adapte aux PME, elle n'a pas d'effet de taille. Le risque principal est celui d'une sur segmentation.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
75
Chapitre
Les Stratgies de dveloppement :
Spcialisation vs Diversification
Objectifs
Identifier les diffrentes stratgies de dveloppement Comprendre les avantages et les inconvnients de la spcialisation Connatre les avantages et les inconvnients de la diversification
Sommaire
I- La stratgie de spcialisation II- Stratgie de diversification
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
76
Pour se dvelopper, une entreprise doit faire un choix quant la stratgie quelle devrait adopter. On distingue dans ce cadre la stratgie de spcialisation, la stratgie de diversification et la stratgie dinternationalisation.
I- La stratgie de spcialisation :
Dfinition : Cest la stratgie par laquelle une entreprise limite son activit des
produits fonds sur une technologie unique. Lentreprise concentre tous ses efforts sur un domaine dactivit particulier. Elle cherche atteindre le meilleur niveau de comptence possible et den faire un avantage concurrentiel dcisif.
1-Pourquoi la spcialisation ?
La stratgie de spcialisation est gnralement opte par les entreprises dans une situation particulire de leur dveloppement elle est mise en place pour les raisons suivantes : Lorsque lentreprise dispose de moyens financiers, humains, productifs limits (PME, entreprises rcentes), lobjectif travers une stratgie de spcialisation est dutiliser les comptences acquises dans un dom aine dactivit unique ; Volont de lentreprise de dvelopper un savoir-faire technique et commercial pour faire face aux attaques de la concurrence ; La recherche de scurit dun mtier solide ; La recherche dune taille suffisante dans une optique de croissance (cest un tremplin au dveloppement) ;
2-Les diffrents types de spcialisation :
Afin de se dvelopper en se spcialisant, plusieurs stratgies soffre lentreprise : La pntration de march : Production et distribution intensive afin de renforcer la position de lentreprise et augmenter le chiffre daffaires ;
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
77
Le dveloppement du march : extension du march pour toucher une cible plus large, il sagit dune politique dlargissement de la clientle ou politique dexpansion gographique ; Le dveloppement du produit : politique de produit nouveau, politique de gamme. Lobjectif est la dtermination dune gamme complte (ex secteur automobile) ou au contraire dune gamme restreinte travers une stratgie dcrmage (ex produits de luxe). Elle procure un avantage comptitif certain.
3-Spcialisation et cycle de vie du mtier :
La spcialisation a pour objectif daugmenter les parts de marchs de lentreprise au dtriment de ses concurrents : stratgie offensive ou stratgie dacquisition . Ces stratgies sont adaptes aux 3 premires phases du cycle de vie du mtier : le dmarrage, lexpansion ou la maturit. Lorsque le mtier de lentreprise est en phase de dclin, elle doit chercher des segments encore rentables. Si le mtier de base nest plus rentable et na plus de perspectives dvolution, le dveloppement de lentreprise nest plus possible par une stratgie de spcialisation. Elle devrait adopter une stratgie de diversification (pour aborder un nouveau mtier).
4-Avantages et risques de la stratgie de spcialisation :
La spcialisation permet de gnrer des avantages comparatifs : Atteinte de la taille critique ; C'est--dire la taille minimale quune entreprise doit possder pour sintroduire ou se maintenir sur un march sans subir un handicap concurrentiel notable ; Concentration des forces : baisse des cots de production ce qui permet la cration deffets dexprience grce la maitrise des techniques du mtier ; Ralisation dconomies dchelle ; Cependant, la spcialisation comporte un risque important provenant de la dpendance un seul type de produit ou domaine dactivit.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
78
II-La stratgie de diversification :
Dfinition : Cela consiste ajouter des mtiers nouveaux aux activits actuelles de
lentreprise. Elle cherche multiplier les domaines dactivits sans liens particuliers entre eux. Elle cherche nouveaux. sorienter vers des mtiers ou des secteurs dactivit
1-Les voies de la diversification :
La diversification peut poursuivre plusieurs objectifs : rinvestir des capitaux (diversification de placement) : lorsquune entreprise dgage des profits importants, elle peut en rinvestir une partie dans dautres activits qui lui permettront daugmenter sa rentabilit et ses profits. Elle est rserve aux entreprises riches et bien positionnes sur leur march. conforter
ses
positions (diversification
de
confortement) :
certaines
entreprises prouvent le besoin de conforter leur position sur un march instable notamment dans des activits complmentaires. Adapte aux PME car ne ncessite pas dinvestissements coteux se redployer ou se reconvertir (diversification de redploiement) : vers des secteurs plus porteurs pouvant assurer une reconversion de lentreprise. Les produits leaders perdront de leur importance au profit de nouvelles fabrications. Il sagit de redployer son activit quand les produits sont arrivs maturit (les remplacer). Survivre (diversification de survie) : Il sagit de rechercher rapidement dautres activits pour assurer lavenir de lentreprise. Elle est applique pour les entreprises se trouvant dans une mauvaise position concurrentielle.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
79
2-Les diffrentes formes de diversification :
La diversification peut tre horizontale, verticale ou concentrique. la diversification horizontale : cette forme de diversification consiste couler des produits nouveaux ayant ventuellement un lien technologique entre eux mais ayant surtout un lien commercial puisque la clientle est la mme. la diversification verticale : se caractrise par une intgration des activits en amont ou en aval. Vers lamont, c'est--dire lintgration dune activit situ lamont de la filire dactivit (activits du fournisseur). Vers laval, c'est --dire dvelopper des activits situes laval de la filire d activit (activit du client, exp distributeur ou transporteur) la diversification concentrique : est, quant elle, assez multiforme. Il peut s'agir de fabriquer des produits ou des services semblables pour des clients diffrents. Par exemple Loral fabrique aussi bien des produits pour les professionnels de la coiffure que pour les particuliers. Il peut s'agir galement de fabriquer des produits ou des services nouveaux pour des clients identiques, ou encore des produits diffrents pour des clients diffrents (par exemple, Rhne-Poulenc fabrique des produits pharmaceutiques, des produits textiles, etc....). Il peut s'agir en fin de mthodes de production identiques mais de produits diffrents avec des rseaux de distribution diffrents (par exemple, produits destins aux professionnels et aux particuliers).
3-Les avantages et limites des stratgies de diversification :
Cest une stratgie trs rpandue car elle permet : de rpartir et donc de rduire les risques lis la conjoncture par des compensations entre produits ayant des cycles de vie diffrents. damliorer la rentabilit en sorientant vers de nouveaux marchs ou de nouveaux produits plus porteurs, et en prvenant le risque de dclin de la demande.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
80
Elle peut nanmoins entraner des risques : Position concurrentielle difficile (ractions des concurrents, cots levs) Dispersion des comptences Risque dchec de la nouvelle activit Complexification des problmes financiers, juridiques et organisationnels lis cette volution Rorganisation et modification des struct ures de lentreprise surtout en cas de diversification par croissance externe c'est--dire par lacquisition dune entreprise dans un domaine dactivit diffrents. (greffe dorgane = risque de rejet : consquences importantes) .
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
81
Chapitre
Les modes de croissance :
Croissance interne vs croissance externe
Objectifs
Assimiler le concept de croissance et son intrt pour lentreprise Connaitre les avantages et inconvnients de la croissance interne Comprendre les avantages et inconvnients de la croissance externe Identifier les critres de choix entre la croissance interne et la croissance externe
Sommaire
I- Le concept de croissance II- Les modes de croissance III- Arbitrage entre croissance interne et croissance externe IV- Mode de croissance et stratgies de dveloppement
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
82
I- Concept de la croissance :
1-Dfinition et modes de croissance
La croissance de l'entreprise se caractrise par une augmentation de sa taille mesure par son chiffre d'affaires. Elle peut s'effectuer selon deux modalits : par la croissance interne lorsque l'entreprise se dveloppe par propres moyens de production, par la croissance externe lorsque l'entreprise reprend des capacits de production dj existantes.
2-Intrts de la croissance
La croissance de lentreprise se traduit par une augmentation de s a taille, ce qui lui procure des conomies d'chelle. Ceci permet un avantage de cot pour lentreprise puisque les cots fixes sont tals sur une plus grande production. Elle permet galement daccrot le pouvoir de march de la firme vis--vis de son environnement. Ainsi, elle augmente son pouvoir de ngociation sur ses fournisseurs et de ses clients par un effet de domination.
II-Les modes de croissance
1-La croissance interne
Dfinition :
La stratgie de croissance interne consiste pour l'entreprise s'appuyer principalement sur ses ressources et comptences propres pour assurer son dveloppement.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
83
Elle sobtient donc par le dveloppement des capacits propres de production de l'entreprise, et elle est trs souvent autofinance.
Avantages et limites :
Avantages dveloppement progressif de l'entreprise ; matrise du dveloppement ; utilisation des ressources financires propres; culture d'entreprise consolide.
Limites processus lent; problmes de financement
2-La croissance externe
Dfinition : La croissance externe consiste principalement pour l'entreprise appuyer son dveloppement sur les ressources et comptences d'une autre entreprise par acquisition. Elle se ralise ainsi par des transferts d'actifs existants d'une entreprise vers une autre.
Les modalits de la croissance externe
D'un point de vue juridique, la croissance externe a pour effet de regrouper des patrimoines. Il peut sagir de fusion, fusion-absorption et apport partiel dactif.
La fusion : Opration par laquelle deux socits dcident de runir leur patrimoine
pour nen former quune seule. Il y a transmission du patrimoine la socit nouvelle.
La fusion-absorption : a pour consquence de faire disparatre la socit
absorbe. Ainsi, une seule socit subsiste et reoit titre dapport les actifs de lautre socit.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
84
L'apport partiel d'actifs : se caractrise par l'apport d'une partie du patrimoine une
socit nouvelle ou dj existante. (Stratgie de prise de participation).
Avantages et limites :
Avantages opration rapide; acquisitions rapides de part de march supplmentaires ; accs rapide des technologies ; effets de synergie ; permet la diversification ; pas d'augmentation de l'offre globale regroupes;
Limites Diffrences culturelles entre les entreprises Possibilit de non complmentarit; problmes de financement; cots sociaux en cas de restructuration avec des licenciements.
III-Arbitrage entre croissance interne et croissance externe
Les avantages et inconvnients des deux modes de croissance rendent larbitrage entre croissance interne et croissance externe difficile. Il dpendra de certains facteurs : le temps, lhistoire de lentreprise, la phase du cycle de vie du domaine dactivit et les opportunits.
1-Le facteur temps:
Etant donn le gain de temps que permet la croissance externe, elle devient privilgie lorsque latteinte de la taille critique devient indispensable. Dautre part, elle fournit une rponse rapide une volution de la demande, ce qui permet un avantage comptitive lentreprise.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
85
2-Lhistoire de lentreprise
La tradition de croissance externe plutt quinterne au sein de lentreprise acheteuse rend plus aise lintgration structurelle et culturelle de la firme achete.
3-La phase du cycle de vie du domaine dactivit :
Dans un secteur arriv maturit o le taux de croissance est gnralement faible, il est difficile de gagner des parts de march par ses propres moyens. La croissance externe devient alors plus intressante car permet lacquisition de firmes existantes, ce qui vite laugmentation ventuelle de surcapacit de production.
4-Lopportunit :
Lopportunit dacqurir une entreprise dont le prix dachat est infrieur sa valeur relle ou de sen approprier le savoir-faire. De mme, lopportunit de neutraliser un concurrent ou de contourner des barrires lentre dun secteur donn.
IV-Mode de croissance et stratgies :
Les modes de croissance vont de paire avec les stratgies de dveloppement. En effet, la croissance interne se marie naturellement avec la stratgie de spcialisation, lentreprise se dveloppe de manire progressive et continue dans son domaine dactivit. Quand la croissance externe, elle permet dacqurir rapidement les savoir faire de lentreprise achete, et de favoriser ainsi les oprations de diversification. Cependant, la liaison entre la croissance et les stratgies ne se limite pas aux stratgies de dveloppement car la croissance est un moyen au service de toutes les manuvres stratgiques. (Internationalisation, diffrenciation, coopration, etc.). La croissance peut tre subie ou voulue par lentreprise :
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
86
Elle est subie lorsque lentreprise na pas dautre choix que de croitre pour assurer sa survie ou du moins maintenir ses parts de march. Elle peut, ainsi, faire face laugmentation de la demande par des investissements. En revanche, la croissance relve dune dmarche volont ariste lorsque lentreprise la considre comme finalit et la relie ses objectifs.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
87
Chapitre
Les stratgies dinternationalion
Objectifs
Comprendre les dterminants de linternationalisation Identifier les diffrents niveaux de lengagement des firmes dans le pays daccueil Connaitre les diffrents types de stratgies internationales. Saisir les avantages et les inconvnients des stratgies dinternationalisation
Sommaire
I- Les dterminants de linternationalisation des entreprises ; II- Internationalisation et niveau dengagement III- Les types de stratgies internationales IV- Avantages et limites des stratgies dinternationalisation
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
88
I-Dterminants de Linternationalisation des firmes:
1-Origine et dfinition de linternationalisation des entreprises
La stratgie d'internationalisation est une stratgie d'extension d'une entreprise audel de son march national. Elle concerne essentiellement les grandes entreprises. La stratgie dinternationalisation sinscrit dans un mouvement dintgration conomique mondiale qui, amorce ds le XVIme sicle, sest fortement amplifie depuis 1945.
2-Les facteurs explicatifs de linternationalisation des entreprises :
Les facteurs macro-conomiques : Il sagit essentiellement ; de louverture des frontires douanires et rglementaires lchange international et de lintgration conomique rgionale. Les impratifs politiques constituent un facteur essentiel de linternationalisation des entreprises, Lmergence de nouveaux ples de croissance tel que lAsie du Sud Est constitue un facteur important explicatif de linternationalisation de certaines entreprises. La globalisation financire constitue galement un facteur non ngligeable dans le choix de linternationalisation de certaines entreprises. Les facteurs lis au march et la demande : Lunification et lamlioration des moyens de transport facilitent les stratgies dinternationalisation, notamment travers la rduction des cots et des temps de transports. Les rseaux de communication pour le transport de biens, des personnes et des informations constituent les conditions ncessaires linternationalisation des entreprises.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
89
Lhomognisation de la demande internationale est une condition ncessaire pour une entreprise qui souhaite internationaliser ses activits en adaptant ses units de production des marchs plurinationaux. En effet, la demande internationale apparait la fois comme plus homogne et plus segmente. La recherche de la comptitivit Larrive maturit de certains secteurs poussent les entreprises opter pour des stratgies dinternationalisation afin dchapper laugmentation de la concurrence dans le pays dorigine. La diminution, de plus en plus importante, du cycle de vie de certains produits, notamment dans les secteurs de haute technologie est due la rapide volution technologique. Cette ralit pousse les entreprises a opter pour des stratgies dinternationalisation afin de rentabiliser les gros investissements effectus dans la recherche et dveloppement. Les conomies dchelles permises par les stratgies dinternationalisation constituent un facteur important de linternationalisation des entreprises, leur permettant une diminution des cots unitaires moyens de produ ction via laccroissement du volume. Les facteurs concurrentiels : Lvolution de la concurrence dans certains secteurs reprsente la fois une consquence et une condition de linternationalisation des entreprises. La structure et lintensit de la concurrence influencent directement les stratgies internationales adoptes par les entreprises. Lintensit concurrentielle dun secteur, lchelle nationale, pousse les entreprises installes sinternationaliser afin de diminuer la pression concurrentielle, ce qui dun autre ct augmente la concurrence, lchelle internationale.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
90
II-internationaLisation et niveau dengagement
La profondeur de lengagement de lentreprise sinternationaliser se rvle travers les moyens quelle utilise. Afin de limiter les risques inhrents toute manuvre dinternationalisation, mais aussi afin dacqurir progressivement les savoir faire indispensables son succs, lentreprise procde le plus souvent par tape jusquau stade de la globalisation. Ainsi, lentreprise peut opter pour une stratgie dinternationalisation, soit en exportant sa production (totale ou partielle), soit en procdant une implantation commerciale, soit en implantant des units de production par la cration de filiales, soit en procdant des oprations de fusion-acquisition internationales.
1-Lexportation :
Lentreprise vend tout ou partie de sa production, ralise dans son propre pays, ltranger. Trois types dexportation sont possibles :
Lexportation directe : lentreprise se charge elle-mme de vendre ses
produits ltranger, ce qui suppose une dm arche mercatique approfondie afin de connaitre le ou les marchs destinataires.
Lexportation
indirecte :
lentreprise
recours
aux
services
dintermdiaires spcialiss (exp : courtier, socits de commerce international, importateurs locaux)
Lexportation associe : Lentreprise se regroupe avec dautres
entreprises exportatrices ou utilise les rseaux commerciaux des grands groupes installs ltranger. Cette technique est notamment adapte aux PME .
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
91
2-La distribution lchelle mondiale :
Cest un moyens de plus en plus utilis par les entreprise dsireuses de pntrer les marchs trangers. Il sagit de la signature daccords interentreprises pour la distribution des produits. Les principales formes sont la cession de licence (exp : Christian Dior) et la franchise (exp : McDonalds, Benetton)
3-Limplantation ltranger :
Dans ce cas lentreprise ralise des investissements directs ltranger (IDE) qui prennent gnralement deux formes : -La cration dentreprise : peut se faire soit, par la cration de filiale de commercialisation ou de production totalement contrle par lentreprise, dans ce cas lentreprise devient une Firme Multinationale (FMN), soit, par la cration dun joint venture qui constitue une co-entreprise. - Le rachat dentreprise : peut tre sous la forme dopration de fusion entre deux entreprise, lacquisition ou labsorption dune entreprise ou la prise de participation pans une entreprise installe.
4-Lentreprise mondiale ou globale :
Contrairement la FMN qui adapte sa production aux besoins spcifiques des marchs locaux, lentreprise mondiale standardise sa production et sadresse au march mondial.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
92
III-Les diffrentes stratgies internationales
On peut distinguer deux types dentreprises adoptant des stratgies
dinternationalisation par cration de filiales. :
1-Les Stratgies multidomestiques :
Lentreprise cre des filiales dans diffrents pays et dlocalise compltement sa production. Elle adopte une organisation multidomestique dans laquelle chacune de ces filiales dispose dune forte autonomie et dune capacit de production indpendante. Chaque filiale constitue une rplique identique de la maison mre qui se comporte comme une entreprise part entire car l ensemble des activits de la chaine de valeur sont regroupes dans chaque pays, lexception, gnralement, de la R&D. La firme opte dans, ce cas, pour une approche march par march , c'est--dire quelle applique des stratgies distinctes pour ch acun des marchs trangers et par consquent, sa position concurrentielle stablie donc lintrieur de chaque pays.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
93
2-Les stratgies globales :
Contrairement lentreprise multidomestique, lentreprise globale a une vision mondiale du march, de la concurrence et de la stratgie adopter. Dfinie centralement, lentreprise globale se caractrise par une part de march significative dans les principaux pays, et tend unifier sa gamme de produits sur tous les marchs. Les manuvres stratgiques mises en place sont dfinies dune faon concerte entre les principaux pays, et sa position concurrentielle dans un pays donn dpend de celle occupe dans les autres pays. La stratgie globale saccompagne par une organisation mondiale caractrise par des filiales qui ne sont pas ncessairement indpendantes et les oprations sont lies entre elles sur un plan mondial. Ainsi, il peut y avoir des activits diffrentes dans des pays diffrents. A linverse de lorganisation multidomestique, lorganisation globale gnre dimportants flux dchanges entre les pays ainsi quentre les units de production.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
94
IV- Avantages et limites de LintertionaLisation
1-Avantage de la stratgie dinternationalisation
La conqute de parts de march : Dans un contexte de concurrence internationale, la stratgie dinternationalisation permet de sadresser un march potentiel plus vaste. Diminution des cots : avec les conomies d'chelle, les cots de main d'uvre, les cots de transport, les cots de la matire premire, plus faibles etc. Contournement des barrires douanires (tarifaires et non tarifaires). Recherche de gains fiscaux et de change. Fidlisation de la clientle : Laugmentation de la circulation des per sonnes (voyage, dplacement), poussent les entreprise amliorer la disponibilit de leurs produits dans la plus part des pays.
2-Les limites des stratgies dinternationalisation
Ncessitent des moyens financiers considrables ; Risques financiers considrables ; Risques politiques et conomiques ; Nouvelles pratiques ; Cadres lgaux diffrents ; Cots d'apprentissage ; Instabilit des taux de change.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
95
Chapitre
Les stratgies de coopration
Objectifs
Comprendre la diffrence entre les alliances stratgiques et limpartition Identifier les formes dalliances stratgiques Connaitre les diffrentes modalits de limpartition Saisir les avantages et les inconvnients des stratgies de coopration
Sommaire
I- Les alliances stratgiques ; II- Les stratgies dimpartition ou le partenariat
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
96
Les stratgies de coopration sappuient
le plus souvent sur des contrats de
collaboration entre entreprises concurrentes ou non concurrentes (alliances et partenariats). Ces contrats portent sur lun ou lensemble des stades de la chane de valeur (R&D, production, distribution et commercialisation). On distingue les alliances stratgiques et les stratgies de partenariats (ou dimpartition).
I-Les alliances stratgiques :
1-Dfinition :
Une alliance stratgique est un accord conclu entre deux ou plusieurs entreprises concurrentes qui choisissent de mener bien un projet, un programme ou une activit spcifique en coordonnant les comptences, les moyens et les ressources ncessaires. Elles constituent une rponse aux mutations de lenvironnement : la mondialisation de lconomie acclre par la drglementation, innovation technologiques incessantes, raccourcissement de la dure de vie des produits, demande de plus en plus exigeantes. Elles permettent aux partenaires de rester indpendants et autonomes sur toutes les activits qui chappent au primtre de laccord.
2-Les diffrentes formes dalliance stratgique
On distingue les alliances complmentaires, les Co-intgrations et les pseudoconcentrations.
- Les alliances complmentaires :
Il y a mise en commun de ressources ou comptences spcifiques chaque entreprise, les entreprises ntant plus concurrentes directes. Ces alliances associent des entreprises qui apportent des actifs et des comptences de nature diffrentes. Par exemple, une entreprise dveloppe un produit et la seconde assure la distribution du
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
97
produit grce son rseau de distribution. (Matra/Renault General Mills/Nestl ; Ford/Mazda) Exemple : Lalliance entre Renault et Matra pour concevoir lESPACE : Cette voiture est conue et produite par Matra, le service aprs-vente et la distribution sont faits par Renault.
Les alliances de Co-intgration :
Il sagit de laddition des ressources et comptences sur une ou plusieurs tapes de la chane de valeur pour raliser des conomies dchelles et dpasser le seuil de rentabilit, les entreprises restant concurrentes. En effet, les entreprises ralisent en commun un lment qui sera ensuite intgr dans le produit fini de chacune des entreprises qui resteront concurrentes. Exp : Volkswagen et Renault qui ont produit ensemble une boite-auto que chacune des entreprises a intgr dans son propre produit.
Les alliances pseudo-concentration :
Associe des entreprises qui produisent le mme produit : il y a mise en commun et addition des ressources et des comptences pour la production dun modle unique, la concurrence disparait sur le produit commun, mais elle reste sur les autres produits.
3-Les avantages et les risques des alliances stratgiques :
Intrt des alliances
Maintien ou renforcement de la position stratgique ; Conqute de nouveaux marchs ; Elaboration de nouveaux produits ; Partage de comptences ; Rduction des cots ; Fixation de barrires lentre.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
98
Risque des alliances :
La plupart des risques de lalliance ont pour origine le fait quil sagisse de liens entre entreprises concurrentes, ce qui augmente le risque dinstabilit et de russite de laccord car il combine rivalit et coopration. Il sagit essentiellement de : Risque de perte de confidentialit de certaines informations ; Perte dun facteur cl de succs exclusif ; Msentente entre partenaire sur la rpartition des risques ; Msentente sur le partage des responsabilits en cas dchec, ou des bnfices en cas en cas de succs ; Risque dabsorption du plus faible par le plus fort.
II-Les stratgies d'impartition : le partenariat
1-Dfinition
Limpartition peut se dfinir comme une politique de coopration entre plusieurs partenaires disposant de potentiels complmentaires et dsireux de concrtiser une synergie latente, ralise sous forme de mise en commun de leurs comptences propres. Il sagit dune collaboration entre firmes non concurrentes.
2- Modalits des stratgies dimpartition
Les techniques d'impartition sont de plusieurs ordres ; sous-traitance, franchise, concession, cession de licence. La sous-traitance : Une entreprise (le donneur d'ordres) fait excuter par une autre (le sous-traitant) une partie de sa production. Trois possibilits se prsentent :
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
99
La fourniture spciale : o une entreprise fabrique pour une autre des biens spcifiques tout en concevant la proprit industrielle de sa marque.
La sous-traitance ; o le donneur dordre dfinit les caractristiques du produit et le sous-traitant ne dispose daucune initiative, il excute les ordres du donneur dordre.
La co-traitante ; o les partenaires se partagent la ralisation dun
projet.
La franchise : C'est un contrat par lequel une entreprise (le franchiseur) met la disposition d'une autre (le franchis) son savoir-faire, sa marque, son assistance en contreparties de redevances. La cession de licence : Il s'agit pour une entreprise de cder une autre, moyennant des redevances, le droit dexploiter une technologie, une marque, un modle, etc.
3-Avantages et risques de limpartition :
Intrts de limpartition :
Profiter de cots comptitifs Bnficier des comptences spcifiques des partenaires Recentrage sur son mtier de base Favoriser la flexibilit de lentreprise en faisant supporter aux partenaires les variations de lactivit, les variations qualitatives de la demande, les cots des stocks de scurit, une lgislation sociale contraignante, etc. Rduire le poids des structures en rservant les ressources disponibles aux missions essentielles de lorganisation ; Gagner en ractivit et pouvoir rpondre rapidement aux fluctuations de lenvironnement mais aussi, saisir rapidement les opportunits qui peuvent se prsenter ;
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
100
Concrtiser des synergies (ex : partage du rseau de distribution, des comptences, etc.) Rduire les cots de transaction en instaurant des relations stables et fiables.
Les risques lis aux partenariats :
Lorsque le produit externalis constitue un actif spcifique, la dpendance envers le partenaire devient trs importante et le risque de comportement opportuniste augmente (cheval de Troie, dfaillances, etc.) ce qui engendre des cots dagence selon O. Williamson ; Une impartition trop importante risque de faire perdre lentreprise progressivement son savoir-faire et par consquent la priver davantages stratgiques potentiels.
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
101
Rfrences Bibliographiques
Ouvrages
DESREUMAUX A., Introduction la gestion , Armand colin, 1992. MARCHESNAY M., Management stratgique, Eyrolles, 1993. MARCHESNAY M., Management stratgique, Les Editions de lADREG, 2004 MINTZBERG H. Structure dOrganisation, 2006
et
dynamique
des
organisations,
Editions
MUCCHIELLI J. L. Multinationales et mondialisation, Edition du Seuil, 1998 PONSARD J. P. Stratgie dentreprise et conomie industrielle, McGraw -Hill, 1988 PORTER M. Choix stratgiques et concurrence, Economica 1892 PORTER M. Lavantage concurrentiel, InterEdition 1986 STRATEGOR, Politique Gnrale de lEntreprise , Dunod, Paris, 1997
Notes de cours
Darmon E. Stratgie des entreprises, Facult des Sciences Economiques, Universit de Rennes I WEIL T. Stratgie dentreprise, cole des mines de Paris, 2008
Webographie Stratgies dprise : www.stratgie.gouv.fr www.stratgie.gouv.fr/revue/
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
102
Annexes
Annexe I :
Examen Stratgie dentreprises, ISET Djerba, 2010-2011
Annexe II : Examen Stratgie dentreprises , ISET Djerba, 2011-2012
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
COURS STRATEGIE DENTREPRISE
103
Table des matires
ISET Djerba | Salma Bardak El Younsi
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours Strategie Entreprise Selma BardakDocument103 pagesCours Strategie Entreprise Selma BardakPretty Lina100% (1)
- Analyse stratégique et avantage concurrentielD'EverandAnalyse stratégique et avantage concurrentielÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Le tableau de bord prospectif et les 4 piliers d'une organisation: Quels signaux prendre en compte pour une gestion efficace ?D'EverandLe tableau de bord prospectif et les 4 piliers d'une organisation: Quels signaux prendre en compte pour une gestion efficace ?Pas encore d'évaluation
- Cours de StrategieDocument25 pagesCours de StrategieABRAHAM MOGNEHI100% (5)
- Cours Management Stratégie Partie I (8640)Document49 pagesCours Management Stratégie Partie I (8640)ABDELBASSET QALLALIPas encore d'évaluation
- PME et Stratégie: Les règles économiques à suivre pour bien gérer sa petite entreprise belgeD'EverandPME et Stratégie: Les règles économiques à suivre pour bien gérer sa petite entreprise belgeÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Cours de Stratégie D'entrepriseDocument81 pagesCours de Stratégie D'entreprise237 KOMOL100% (1)
- Stratégie de L'entrepriseDocument43 pagesStratégie de L'entrepriseFaress Rabi100% (3)
- Management StratégiqueDocument16 pagesManagement StratégiqueErjqti Mohmed100% (2)
- Cours Stratégie D'entrepriseDocument12 pagesCours Stratégie D'entreprisepadja_rp75% (4)
- Strategie Et Politique Generale D'entrepriseDocument13 pagesStrategie Et Politique Generale D'entreprisekouakouPas encore d'évaluation
- Études de cas en GRH, en relations industrielles et en managementD'EverandÉtudes de cas en GRH, en relations industrielles et en managementÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Méthodologie de recherche et théories en sciences comptablesD'EverandMéthodologie de recherche et théories en sciences comptablesPas encore d'évaluation
- Cours Politique Et Stratégie de L'entreprise 3 HEC 20120-2021Document134 pagesCours Politique Et Stratégie de L'entreprise 3 HEC 20120-2021Firas TahriPas encore d'évaluation
- Politiques et management publics: L'heure des remises en questionD'EverandPolitiques et management publics: L'heure des remises en questionPas encore d'évaluation
- Changement organisationnel : Théorie et pratiqueD'EverandChangement organisationnel : Théorie et pratiqueÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4)
- Cours Management StrategiqueDocument45 pagesCours Management Strategiquemed aitPas encore d'évaluation
- La Demarche StrategiqueDocument20 pagesLa Demarche Strategiqueahlam nour100% (1)
- La gestion du changement en contextes et milieux organisationnels publicsD'EverandLa gestion du changement en contextes et milieux organisationnels publicsPas encore d'évaluation
- Cours de Management StratégiqueDocument6 pagesCours de Management StratégiqueAbderahmane DjillaliPas encore d'évaluation
- Management StratégiqueDocument28 pagesManagement Stratégiquehammou benzita100% (1)
- Cours Management Strategique PDFDocument88 pagesCours Management Strategique PDFAbdellah Agourram94% (18)
- Management StratégiqueDocument14 pagesManagement StratégiqueNada MrabtiPas encore d'évaluation
- Management Stratégique CoursDocument18 pagesManagement Stratégique CoursGhizlane GhazalPas encore d'évaluation
- Management Et Stratégie Des OrganisationsDocument46 pagesManagement Et Stratégie Des OrganisationsYassine Boutahir100% (1)
- Cours Management Stratégique Allard-PoesipdfDocument158 pagesCours Management Stratégique Allard-PoesipdfOmar Bouasria100% (2)
- Management StrategiqueDocument30 pagesManagement StrategiqueBadra Ali SanogoPas encore d'évaluation
- Management Cours TopDocument287 pagesManagement Cours TopAnont Apie100% (3)
- La Matrice Adl (Arthur Doo Little)Document31 pagesLa Matrice Adl (Arthur Doo Little)EMaroketing86% (14)
- Cours de Management StratégiqueDocument119 pagesCours de Management Stratégiqueyassints88% (8)
- Cours Management Gc3a9nc3a9ral s1Document44 pagesCours Management Gc3a9nc3a9ral s1Davy Ottou0% (1)
- La Matrice BCGDocument1 pageLa Matrice BCGahmedyassineyoussef50% (2)
- Management Des OrganisationsDocument66 pagesManagement Des Organisationshamzagreenois50% (2)
- Management Stratégique Mohamed Ouallal RésuméDocument8 pagesManagement Stratégique Mohamed Ouallal RésumémohamedPas encore d'évaluation
- Stratégie de L'entrepriseDocument45 pagesStratégie de L'entrepriseyassdaoudi81% (21)
- 01 - Management StratégiqueDocument19 pages01 - Management StratégiqueMeringue Galaxicos67% (3)
- La Segmentation StrategiqueDocument4 pagesLa Segmentation Strategiquegilles_evrard100% (6)
- Stratégie D'entrepriseDocument60 pagesStratégie D'entrepriseWenxu Ye67% (3)
- Cours Management StratégiqueDocument3 pagesCours Management Stratégiquee_hasna19870% (1)
- Ethique Des Affaires PDFDocument2 pagesEthique Des Affaires PDFAngelaPas encore d'évaluation
- Cours Méthodologie ENCGDocument85 pagesCours Méthodologie ENCGanass benmoussaPas encore d'évaluation
- La Matrice BCGDocument4 pagesLa Matrice BCGSALMANE ABADANEPas encore d'évaluation
- La Recherche en Sciences de Gestion PDFDocument63 pagesLa Recherche en Sciences de Gestion PDFChaimaa Kharraf67% (3)
- Résumé Management Stratégique S6Document22 pagesRésumé Management Stratégique S6Serm AbourajiPas encore d'évaluation
- Les Grands Principes Du Management PDFDocument26 pagesLes Grands Principes Du Management PDFSid-Ahmed Sido100% (2)
- Analyse PESTEL Méthode Et ExempleDocument8 pagesAnalyse PESTEL Méthode Et ExempleSalma Amallah100% (1)
- Management s2 PDFDocument132 pagesManagement s2 PDFYAHYA NAFAA100% (1)
- Management StrategiqueDocument119 pagesManagement StrategiqueLeila Amîne100% (1)
- Gestion Financière 01Document23 pagesGestion Financière 01Zemerli Amar Charif100% (5)
- Les Ecoles de La Pensee Strategique Master IDocument142 pagesLes Ecoles de La Pensee Strategique Master ICylia Ait AhcenePas encore d'évaluation
- StartégieDocument100 pagesStartégieAbdellatif AmraniPas encore d'évaluation
- Les Outils de Diagnostic StratégiqueDocument21 pagesLes Outils de Diagnostic StratégiqueYoussef Agouirar100% (10)
- Cours Management Des EntreprisesDocument4 pagesCours Management Des EntreprisesRayane RaynouPas encore d'évaluation
- Cours Management Stratégique 2015-2016Document20 pagesCours Management Stratégique 2015-2016Mehdi Ait BatalPas encore d'évaluation
- Candidature GSC 16 17Document1 pageCandidature GSC 16 17cours fsjesPas encore d'évaluation
- Exercices Corrigés de Statistiques Descriptives - 4Document1 pageExercices Corrigés de Statistiques Descriptives - 4cours fsjesPas encore d'évaluation
- Exercices Corrigés de Statistiques Descriptives 2Document2 pagesExercices Corrigés de Statistiques Descriptives 2cours fsjesPas encore d'évaluation
- Management GeneralDocument43 pagesManagement GeneralKarim Boukoulla67% (3)
- Exercices Corrigés de Statistiques Descriptives - 4cDocument1 pageExercices Corrigés de Statistiques Descriptives - 4ccours fsjesPas encore d'évaluation
- Exercices Corriges de Statistiques Descriptives 3cDocument2 pagesExercices Corriges de Statistiques Descriptives 3cAicha EssPas encore d'évaluation
- Exercices Corrigés de Statistiques Descriptives 3Document2 pagesExercices Corrigés de Statistiques Descriptives 3cours fsjesPas encore d'évaluation
- LPRH 2cDocument2 pagesLPRH 2cOliver TwistePas encore d'évaluation
- MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL Compta de SocietéDocument3 pagesMODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL Compta de Societécours fsjes100% (1)
- Marketing 12Document13 pagesMarketing 12cours fsjesPas encore d'évaluation
- Mathématiques Financières Mme BENOMAR PDFDocument21 pagesMathématiques Financières Mme BENOMAR PDFAbdèlàzizPas encore d'évaluation
- Objet de Compta AnalytiqueDocument7 pagesObjet de Compta Analytiquecours fsjes100% (1)
- Exercices Corrigés de Statistiques Descriptives 1cDocument3 pagesExercices Corrigés de Statistiques Descriptives 1ccours fsjesPas encore d'évaluation
- Exercices Corrigés de Statistiques Descriptives 1Document4 pagesExercices Corrigés de Statistiques Descriptives 1cours fsjes0% (1)
- Cours Fiscalité S5Document58 pagesCours Fiscalité S5cours fsjes82% (11)
- Series Corriges Exercices de Comptabilite 2Document5 pagesSeries Corriges Exercices de Comptabilite 2cours fsjes88% (16)
- Cours Compta Des Societe La Societe Anonyme (S.a) Semestre s5Document11 pagesCours Compta Des Societe La Societe Anonyme (S.a) Semestre s5cours fsjes100% (2)
- Exercices Facturation Et ReglementDocument1 pageExercices Facturation Et Reglementcours fsjesPas encore d'évaluation
- Exercice 2 Comptabilité Analytique Avec CorrigéDocument2 pagesExercice 2 Comptabilité Analytique Avec Corrigécours fsjes84% (19)
- Les Effets de CommerceDocument9 pagesLes Effets de Commercecours fsjes100% (1)
- Exercice Comptabilité Analytique Semestre s3 Avec CorrigéDocument2 pagesExercice Comptabilité Analytique Semestre s3 Avec Corrigécours fsjes96% (24)
- Exercice 1 Math CorrigeDocument8 pagesExercice 1 Math Corrigecours fsjes50% (2)
- Examen Droit EntrepriseDocument1 pageExamen Droit EntrepriseTaha CanPas encore d'évaluation
- Exam Rattrapage MathDocument1 pageExam Rattrapage Mathcours fsjesPas encore d'évaluation
- Exam Rattrapage Math CorrigeDocument3 pagesExam Rattrapage Math Corrigecours fsjesPas encore d'évaluation
- Exam Maths Corrige 2009Document2 pagesExam Maths Corrige 2009cours fsjesPas encore d'évaluation
- Exercice 1 MathDocument2 pagesExercice 1 Mathcours fsjesPas encore d'évaluation
- Exam MacroeconomieDocument1 pageExam Macroeconomiecours fsjes100% (3)
- Droit Des EntreprisesDocument39 pagesDroit Des EntreprisesBoujemaa RbiiPas encore d'évaluation
- Management de L'entreprise Performante - Apprendre Par L'actionDocument281 pagesManagement de L'entreprise Performante - Apprendre Par L'actionAyoub Fajraoui100% (3)
- STATISTIQUESDocument136 pagesSTATISTIQUESmoufid24om50% (2)
- Guide Du FormateurDocument184 pagesGuide Du FormateurAzzeddine AfrouniPas encore d'évaluation
- Rapport de La Journee Du Vendredi 27 Novembre 2020Document43 pagesRapport de La Journee Du Vendredi 27 Novembre 2020Bryan NoumiPas encore d'évaluation
- Pfe Fsjse RabatDocument36 pagesPfe Fsjse RabatGhita LaissPas encore d'évaluation
- Mongin Le Desastre de WaterlooDocument4 pagesMongin Le Desastre de WaterlooecrcauPas encore d'évaluation
- Corrigé Cas AlfretsDocument3 pagesCorrigé Cas AlfretsElif KocamanPas encore d'évaluation
- Éléments D'une Théorie Sociologique de La Perception ArtistiqueDocument26 pagesÉléments D'une Théorie Sociologique de La Perception ArtistiqueKarla Schmidt100% (1)
- Scénario PédagogiqueDocument2 pagesScénario Pédagogiquehouda nakkabPas encore d'évaluation
- CVEC: Programme Du Séminaire Du 8 NovembreDocument1 pageCVEC: Programme Du Séminaire Du 8 NovembreLes CrousPas encore d'évaluation
- Recours Gracieux ModéleDocument2 pagesRecours Gracieux Modélehojb100% (1)
- Esgis BrochureDocument16 pagesEsgis BrochureBrunoDunpealsPas encore d'évaluation
- BPJEPS Activite Forme Notice Epreuves UC 4A Et 4B Version15janvier2019Document17 pagesBPJEPS Activite Forme Notice Epreuves UC 4A Et 4B Version15janvier2019Steven WozniakPas encore d'évaluation
- Guide Rapport Stage 5ème Année PDFDocument2 pagesGuide Rapport Stage 5ème Année PDFSayan AminePas encore d'évaluation
- T Tnu9r 2020 1Document1 pageT Tnu9r 2020 1Cheikh Niang100% (1)
- Comment Obtenir Un Pret BancaireDocument47 pagesComment Obtenir Un Pret BancaireelfloiseauPas encore d'évaluation
- Black Beauty AFK Présentation Sommaire PDFDocument7 pagesBlack Beauty AFK Présentation Sommaire PDFArland Narcisse Ella NzehPas encore d'évaluation
- Guide Écriture Sci Bénin 20111020Document64 pagesGuide Écriture Sci Bénin 20111020Kocouvi Agapi HouanouPas encore d'évaluation
- Bac2022 French SciDocument4 pagesBac2022 French SciHina BouzerzourPas encore d'évaluation
- Bibliothèque Numérique de l'UH2C PDFDocument4 pagesBibliothèque Numérique de l'UH2C PDFPaulina Ramírez Del BarrioPas encore d'évaluation