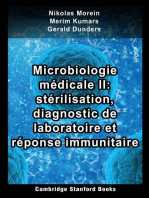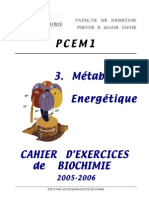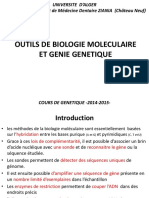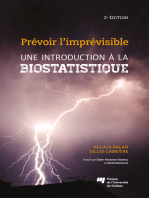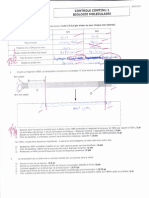Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bmbioch
Bmbioch
Transféré par
Maryem RezguiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bmbioch
Bmbioch
Transféré par
Maryem RezguiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Universit Pierre et Marie Curie
Biologie Molculaire
Objectifs au cours de Biochimie PAES 2009 - 2010
Pr. C. Housset (Chantal.Housset@st-antoine.inserm.fr) Pr. A. Raisonnier (alain.raisonnier@upmc.fr)
Mise jour : 18 novembre 2009 Relecture : Pr. A. Raisonnier
2/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Plan du cours
Plan du cours
3 9 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Plan du cours Objectifs PAES commun DHU Paris-Est Partie I : Chapitre 1 :
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16
La structure des acides nucliques Molcules simples
Phosphates Ribose, dsoxyribose Purine, Pyrimidine Bases puriques Bases pyrimidiques Nuclosides et nuclotides Nomenclature des units nuclotidiques Adnosine Dsoxyguanosine Uridine MonoPhosphate Dsoxythymidine MonoPhosphate Adnosine Tri Phosphate Dsoxycytidine Tri Phosphate Liaisons hydrogne Hybridation A - T Hybridation G - C
Chapitre 2 :
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13
Les acides nucliques
Acide ribonuclique Les extrmits 5 et 3 dun acide nuclique Structure secondaire du RNA Acides ribonucliques Acide dsoxyribonuclique La double hlice (modle rubans) La double hlice (travers) La double hlice (axe) Surenroulement Nuclosome Fibre de chromatine Condensation et hydrolyse des nuclotides Complmentarit des bases 3/207
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
Plan du cours 49 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Partie II : Chapitre 3 :
3.1 3.2 3.3 3.4
Biosynthse des macromolcules DNA Dfinitions
La double hlice Squence dun gne (apoA-II) Gne Expression dun gne
Chapitre 4 :
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31
La transcription
Transcription Promoteur Brins sens et antisens Rgulation de lexpression Cis et trans rgulateurs DNA binding proteins Interaction Protine DNA Rcepteurs nuclaires Rgulation du jene Rgulation de leffort RNA polymrase II Initiation de la transcription Liaison TFIID sur le DNA Rgulation de la RNA polymrase Elongation de la transcription Elongation de la transcription Discontinuit des gnes Exon Exon 1 Fin de la transcription Modifications du transcrit Enzyme coiffante Coiffe dun messager Queue polyA Le transcrit primaire Excision - pissage Formation du lasso Epissages alternatifs Maturation des RNA ribosomiques Stabilit du messager Messager
4/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Plan du cours 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Chapitre 5 :
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26
La traduction
Traduction Expression dun gne Signifiants Codon Code gntique Code gntique Code dgnr Ribosome eucaryote Polyribosome RNA de transfert (trfle) RNA de transfert (ruban) Activation dun acide amin Srine tRNA synthtase Cystine tRNA synthtase Initiation de la traduction Cadre de lecture Elongation de la traduction Incorporation dun acide amin Transfert du peptide Translocation des codons Liaisons riches en nergie Terminaison de la traduction Signal-peptide Polyribosomes lis Carboxylation de lacide glutamique Modifications post-traductionnelles
Chapitre 6 :
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14
La rplication
Rplication Le cycle cellulaire Chromatine et ADN Rplication semi-conservative Synthse et hydrolyse du DNA DNA polymrase DNA polymrase (exonuclase 35) DNA polymrase : fonction ddition Boucle de rplication Fourche de rplication Topoisomrase I Primase DNA ligase Tlomrase
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
5/207
Plan du cours 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 151 152 153 154 155 156 157 158 159 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 173
Chapitre 7 :
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10
La rparation
Rparation Systmes de rparation du DNA Bases endommages Excision de base Msappariements Transmission du msappariement Excision de fragment long Modle Holliday Coupure du double brin Crossing-over
Partie III : Chapitre 8 :
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Les vnements gntiques Substitutions
Substitution Somatique, germinale Faux-sens, non-sens Polymorphisme Xba I de lapoB Marqueur gntique
Chapitre 9 :
9.1 9.2
Mutations
Mutation Mutation Arg3500Gln de lapoB-100
Chapitre 10 : Insertions - dltions
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 Dltion Dcalage du cadre de lecture Dltion Phe 508 de CFTR Dltion de lexon 9 de la lipoprotine-lipase Mutation dun site dpissage Insertion
Chapitre 11 : Transpositions
11.1 11.2 11.3 11.4 Transposition Squence Alu Virus Cycle dun rtrovirus
6/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Plan du cours 174 175 176 177 179 180 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 202 203 204 206 207
11.5 11.6 11.7
Duplication de gne Pseudogne Conversion de gne
Partie IV :
Lvolution
Chapitre 12 : Divergence
12.1 Divergence
Chapitre 13 : Familles de gnes
13.1 13.2 13.3 Famille de gnes Gnes des -globines Famille des -globines
Partie V :
Le DNA au laboratoire
Chapitre 14 : Mthodes dtude
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 Extraction et purification du DNA Synthse dun cDNA Electrophorse de DNA Hae III (enzyme de restriction) EcoR I Polymorphisme de restriction Polymorphisme Msp I de lapoA-II Cartes de restriction Hybridation dune sonde Calcul de la Tm Sonde hybride Sonde spcifique dallle (ASO) Southern blot PCR Didsoxyadnosine triphosphate Raction de squence Squenage dADN Gel de squence
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
7/207
Plan du cours
8/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Objectifs PAES commun DHU Paris-Est
Objectifs PAES commun DHU Paris-Est
Biologie molculaire : tude des acides nucliques
Objectifs Gnraux 1. Sur la base dune bonne connaissance de la structure et des proprits des acides nucliques, ltudiant doit avoir assimil les grands principes de base impliqus dans la transmission et la rparation du matriel gntique, ainsi que lexpression des gnes et sa rgulation. Ltudiant doit tre capable dinterprter des rsultats exprimentaux obtenus par les techniques les plus courantes de biologie molculaire appliques la recherche biomdicale ou lexploration de matriel gntique par les laboratoires de biologie mdicale. Ltudiant doit ainsi avoir acquis les bases ncessaires la comprhension ultrieure des mcanismes molculaires de la physiopathologie ou de laction des mdicaments. Connatre la structure des acides nucliques, savoir reconnatre1 les molcules simples dont ils sont constitus, les classer daprs leurs proprits ou leurs fonctions.
2.
Structure et fonction des acides nucliques
Cette partie ncessite la reconnaissance des structures de lacide phosphorique, du ribose et du dsoxy-ribose, des bases puriques et pyrimidiques. Ltudiant doit savoir reconnatre nimporte quelle base, nucloside, nuclotide ou nucloside polyphosphate. Il doit savoir identifier les liaisons riches en nergie des nuclosides polyphosphates et distinguer les groupements phosphates (, , ) prsents dans ces molcules. Il doit savoir interprter et manipuler les diffrentes reprsentations de la structure primaire du DNA et du RNA, prciser la nature des liaisons impliques dans lenchanement des nuclotides, distinguer une extrmit 5 dune extrmit 3 et manipuler les units de taille (kb, kpb, Mpb...). Sur des schmas qui lui seront prsents, il doit savoir reconnatre les liaisons impliques dans la complmentarit des bases ainsi que les lments structuraux essentiels dune double hlice de DNA, de la chromatine ou des diffrentes espces de RNA. Connaissant la composition en bases de deux DNA de mme taille, il doit savoir prdire les diffrences de temprature de fusion et expliciter les raisons de leur choix.
1. Savoir reconnatre corps chimique : nommer un corps dont on voit la formule dveloppe ; raction : dsigner lenzyme au vu de lquation chimique ; voie mtabolique : dsigner la voie mtabolique au vu de son bilan chimique.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
9/207
Objectifs PAES commun DHU Paris-Est
Mthode dtude des acides nucliques Connatre les mthodes permettant dtudier le DNA des malades (obtention, purification, conservation) y compris dans leur aspect thique. Dcrire lactivit de quelques enzymes qui permettent ltude des acides nucliques et tre capable de montrer leffet de ces enzymes sur un exemple dtaill (squence dacide nuclique). Cet objectif comprend au moins les activits des endonuclases de restriction, les polymrases, les ligases et les topoisomrases. Expliquer le mcanisme de lamplification du DNA par PCR (il ne sagit pas des mthodes ou des techniques, seulement du principe qui est utilis). Expliquer le principe de la PCR et de la RT-PCR Enumrer les principaux constituants du milieu de raction dune PCR Citer un exemple dapplication de la PCR en diagnostic mdical Donner un exemple1 de diagnostic fond sur une variation de longueur de fragments dacides nucliques (RFLP). Enumrer les facteurs qui permettent lhybridation de deux brins dacides nucliques. Savoir interprter2 les rsultats dune technique dhybridation avec une sonde (Southern ou Northern blots, puces DNA) et son application un diagnostic. Expliquer le mcanisme dun squenage dacide nuclique. Donner un exemple de prparation et dutilisation dun DNA complmentaire.
Sans avoir mmoriser les dtails des modes opratoires, ltudiant doit avoir acquis la notion que des mthodes simples permettent dextraire et de purifier, partir de cellules eucaryotes, les diffrentes formes de DNA et de RNA quelles renferment. Il doit avoir acquis la notion des problmes thiques soulevs par la constitution dune banque de DNA gnomique humain. Il doit savoir reconnatre/reprsenter le mode daction des principales enzymes impliques dans la manipulation du DNA : endonuclases, incluant les endonuclases de restriction, ligases, DNA polymrases. Il doit tre capable dinterprter des donnes exprimentales obtenues par les mthodes couplant lectrophorse et hybridation sur filtre (Southern blots). Ayant acquis la notion doligonuclotides de synthse (sans aucun dtail sur les mthodes mises en uvre), de cDNA, de vecteurs plasmidiques ou phagiques, il doit savoir expliquer les grands principes de ltude du DNA gnomique, en matrisant la notion de clonage. Il doit savoir lire un gel de squence et, laide de la table de code gntique, convertir une squence nuclique en squence peptidique, manipulant ainsi les notions de brin sens et non-sens et de cadre de lecture. Sur des squences compares, il doit savoir identifier des mutations, ponctuelles ou tendues, et leurs consquences fonctionnelles (arrt prmatur de la traduction, dcalage du cadre de lecture). La connaissance ainsi acquise du squenage doit lui permettre de matriser les notions de discontinuit des gnes, en distinguant
1. Donner un exemple : choisir, dcrire et expliquer une situation dans laquelle un concept ou un corps dfini joue le rle principal et met en vidence ses proprits essentielles. 2. Savoir interprter un examen : savoir les valeurs usuelles (95 % de la population adulte saine), savoir les circonstances physiopathologiques des variations du paramtre, savoir faire la critique de la valeur dun rsultat en fonction des conditions de son prlvement ou de sa mesure.
10/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Objectifs PAES commun DHU Paris-Est
les exons et les introns, et de modifications post-transcriptionnelles, incluant pose de la coiffe, pissage et polyadnylation. Ltudiant doit savoir interprter des rsultats exprimentaux obtenus par une technique damplification gnique (PCR), quil sagisse danalyse du gnome, dtude dexpression de gne ou de prparation de matriel pour un clonage ultrieur. Transcription et rgulation de lexpression des gnes Dfinir1 les termes : gne, transcription, brin sens, promoteur, exon, intron, coiffe, queue poly-A, excision-pissage. Montrer le mcanisme2 de la transcription dun gne, en distinguant les tapes dinitiation, dlongation et de terminaison. Montrer les mcanismes de la rgulation de la transcription. Donner un exemple de rgulation dun gne eucaryote sous le contrle dune grande voie endocrinienne (exemples : CREB, GlucocorticoidRE). Enumrer et dcrire les principales modifications post-transcriptionnelles : enzyme coiffante, polyadnylation, dition, excision-pissage. Donner un exemple dexpression alternative dun gne eucaryote.
Ltudiant doit tre capable de dfinir un certain nombre de termes indispensables la comprhension de la transcription : brin sens et brin antisens, RNA polymrase, promoteur, initiation de la transcription, longation, terminaison. Il doit savoir dcrire le mcanisme biochimique de la RNA polymrase et mentionner les rles spcifiques des trois types de polymrases impliques dans la transcription chez les eucaryotes. Il doit savoir commenter un schma rsumant de faon intgre la rgulation dun gne dont la transcription est sous le contrle dun messager agissant sur un rcepteur membranaire (exemple de CREB) ou dun messager interagissant avec un rcepteur nuclaire (hormones strodiennes). En ce qui concerne les modifications post-transcriptionnelles, il doit simplement pouvoir dfinir ce quest une coiffe, une polyadnylation ou lpissage (ventuellement alternatif) en identifiant et en explicitant les mcanismes molculaires mis en jeu. Traduction Dfinir les termes : traduction, codon et anticodon, polyribosome, signal-peptide. Montrer le mcanisme de la traduction dun messager, en distinguant les tapes dinitiation, dlongation et de terminaison. Montrer les mcanismes de la rgulation de la traduction. Donner un exemple dantibiotique intervenant sur la rgulation de la traduction des procaryotes. Enumrer et dcrire les principales modifications post-traductionnelles (en complment de ce qui aura t trait dans le thme 2)
Ltudiant doit tre capable de dfinir un certain nombre de caractristiques ou de termes indispensables la comprhension de la traduction : aminoacyl-tRNA synthtase, sens de
1. Dfinir : prciser dans une phrase concise lessence dun objet ou les limites dun concept en excluant toute notion trangre et en comprenant toutes les variations possibles de lobjet ou du concept cern. 2. Montrer le mcanisme (dune raction) ou Dcrire les tapes (dune voie mtabolique) : dfinir les corps chimiques en prsence, crire et quilibrer la (les) raction(s) ; faire le bilan chimique et nergtique.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
11/207
Objectifs PAES commun DHU Paris-Est
la traduction, codon, anticodon, codon dinitiation, code gntique, ribosomes, polyribosomes. Sur un schma synthtique dcrivant le mcanisme de la traduction, il doit tre capable didentifier et dexpliciter les grandes tapes mises en jeu. Il doit avoir la notion que chacune des tapes de la traduction chez les procaryotes peut tre la cible dantibiotiques, mais aucune connaissance spcifique ne peut lui tre demande, sauf des exercices de rflexion o ces donnes lui seraient rappeles. Il doit pouvoir expliquer en termes simples la diffrence entre les protines localisation cytoplasmique et celles qui empruntent la voie de scrtion, en prcisant les notions de peptide-signal et de modifications post-traductionnelles. Rplication et rparation du DNA Dfinir les termes : rplication, rparation. Montrer le mcanisme enzymatique dune fourche de rplication. Dcrire les diffrentes ractions catalyses par les DNA polymrases. Dcrire un exemple de mcanisme de rparation des msappariements. Dcrire la rplication du DNA linaire et le rle dune tlomrase. Dcrire lactivit de la transcriptase inverse et donner un exemple de ses consquences physiopathologiques.
Ltudiant doit pouvoir citer et expliciter les grandes caractristiques de la rplication : semi-conservative, continue/discontinue selon le brin, dbutant une mme origine. Il doit pouvoir citer les principales protines impliques successivement dans la rplication chez les eucaryotes et prciser leur rle : hlicases, protines de liaison au DNA simple brin, topoisomrases, primase, DNA polymrases, ligase. Ltudiant doit savoir illustrer la notion de fidlit de la rplication en explicitant les principaux mcanismes mis en jeu (activit 3-exonuclasique des DNA polymrases, rparation des msappariements). Il doit tre capable de rsoudre le problme pos par la rplication des DNA linaires en expliquant le rle des tlomrases. Il doit savoir dcrire les proprits de la transcriptase inverse sans entrer dans les dtails de la rplication des rtrovirus. Donner un exemple de rparation du DNA ls. En appliquant ses connaissances acquises des principales enzymes agissant sur le DNA, auxquelles seront ajoutes loccasion les glycosylases, ltudiant doit savoir reconnatre sur un schma les interventions successives des enzymes impliques dans la rparation par excision de nuclotides. Recombinaison Sans avoir reproduire le modle de Holliday qui lui aura t prsent, ltudiant doit tre capable de dfinir le processus dchange de segments de DNA homologues sur des schmas simples et de mentionner limplication de la recombinaison dans des phnomnes fondamentaux tels que le crossing-over . Les vnements gntiques Dfinir les termes : variation (= substitution ou mutation silencieuse), mutation (= exprime), dltion/insertion, rptition.
12/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Objectifs PAES commun DHU Paris-Est
Donner des exemples parmi les vnements gntiques suivants qui aboutissent une pathologie : mutation ponctuelle, dltion (avec ou sans dcalage du cadre de lecture), pissage dfectueux, rptitions de triplet. Dfinir les termes : transposition, pseudogne, conversion de gne, famille ou superfamille de gnes. Donner un exemple de lvolution dune famille de gnes.
Grce des exemples de famille de gnes et de leur volution ; ltudiant devra expliciter le rle des vnements gntiques (duplications, conversions de gnes, inactivations de gnes) dans la diversification du patrimoine gntique des espces, et montrer quels avantages slectifs les espces acquirent avec ces changements pour ladaptation leur environnement.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
13/207
Objectifs PAES commun DHU Paris-Est
14/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La structure des acides nucliques
Partie I La structure des acides nucliques
Rappel des objectifs Structure et fonction des acides nucliques Connatre la structure des acides nucliques, savoir reconnatre1 les molcules simples dont ils sont constitus, les classer daprs leurs proprits ou leurs fonctions.
Cette partie ncessite la reconnaissance des structures de lacide phosphorique, du ribose et du dsoxy-ribose, des bases puriques et pyrimidiques. Ltudiant doit savoir reconnatre nimporte quelle base, nucloside, nuclotide ou nucloside polyphosphate. Il doit savoir identifier les liaisons riches en nergie des nuclosides polyphosphates et distinguer les groupements phosphates (, , ) prsents dans ces molcules. Il doit savoir interprter et manipuler les diffrentes reprsentations de la structure primaire du DNA et du RNA, prciser la nature des liaisons impliques dans lenchanement des nuclotides, distinguer une extrmit 5 dune extrmit 3 et manipuler les units de taille (kb, kpb, Mpb...). Sur des schmas qui lui seront prsents, il doit savoir reconnatre les liaisons impliques dans la complmentarit des bases ainsi que les lments structuraux essentiels dune double hlice de DNA, de la chromatine ou des diffrentes espces de RNA. Connaissant la composition en bases de deux DNA de mme taille, il doit savoir prdire les diffrences de temprature de fusion et expliciter les raisons de leur choix. Mthode dtude des acides nucliques Connatre les mthodes permettant dtudier le DNA des malades (obtention, purification, conservation) y compris dans leur aspect thique. Dcrire lactivit de quelques enzymes qui permettent ltude des acides nucliques et tre capable de montrer leffet de ces enzymes sur un exemple dtaill (squence dacide nuclique). Cet objectif comprend au moins les activits des endonuclases de restriction, les polymrases, les ligases et les topoisomrases. Expliquer le mcanisme de lamplification du DNA par PCR (il ne sagit pas des m-
1. Savoir reconnatre corps chimique : nommer un corps dont on voit la formule dveloppe ; raction : dsigner lenzyme au vu de lquation chimique ; voie mtabolique : dsigner la voie mtabolique au vu de son bilan chimique.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
15/207
La structure des acides nucliques
thodes ou des techniques, seulement du principe qui est utilis). Expliquer le principe de la PCR et de la RT-PCR Enumrer les principaux constituants du milieu de raction dune PCR Citer un exemple dapplication de la PCR en diagnostic mdical Donner un exemple1 de diagnostic fond sur une variation de longueur de fragments dacides nucliques (RFLP). Enumrer les facteurs qui permettent lhybridation de deux brins dacides nucliques. Savoir interprter2 les rsultats dune technique dhybridation avec une sonde (Southern ou Northern blots, puces DNA) et son application un diagnostic. Expliquer le mcanisme dun squenage dacide nuclique. Donner un exemple de prparation et dutilisation dun DNA complmentaire.
Sans avoir mmoriser les dtails des modes opratoires, ltudiant doit avoir acquis la notion que des mthodes simples permettent dextraire et de purifier, partir de cellules eucaryotes, les diffrentes formes de DNA et de RNA quelles renferment. Il doit avoir acquis la notion des problmes thiques soulevs par la constitution dune banque de DNA gnomique humain. Il doit savoir reconnatre/reprsenter le mode daction des principales enzymes impliques dans la manipulation du DNA : endonuclases, incluant les endonuclases de restriction, ligases, DNA polymrases. Il doit tre capable dinterprter des donnes exprimentales obtenues par les mthodes couplant lectrophorse et hybridation sur filtre (Southern blots). Ayant acquis la notion doligonuclotides de synthse (sans aucun dtail sur les mthodes mises en uvre), de cDNA, de vecteurs plasmidiques ou phagiques, il doit savoir expliquer les grands principes de ltude du DNA gnomique, en matrisant la notion de clonage. Il doit savoir lire un gel de squence et, laide de la table de code gntique, convertir une squence nuclique en squence peptidique, manipulant ainsi les notions de brin sens et non-sens et de cadre de lecture. Sur des squences compares, il doit savoir identifier des mutations, ponctuelles ou tendues, et leurs consquences fonctionnelles (arrt prmatur de la traduction, dcalage du cadre de lecture). La connaissance ainsi acquise du squenage doit lui permettre de matriser les notions de discontinuit des gnes, en distinguant les exons et les introns, et de modifications post-transcriptionnelles, incluant pose de la coiffe, pissage et polyadnylation. Ltudiant doit savoir interprter des rsultats exprimentaux obtenus par une technique damplification gnique (PCR), quil sagisse danalyse du gnome, dtude dexpression de gne ou de prparation de matriel pour un clonage ultrieur.
1. Donner un exemple : choisir, dcrire et expliquer une situation dans laquelle un concept ou un corps dfini joue le rle principal et met en vidence ses proprits essentielles. 2. Savoir interprter un examen : savoir les valeurs usuelles (95 % de la population adulte saine), savoir les circonstances physiopathologiques des variations du paramtre, savoir faire la critique de la valeur dun rsultat en fonction des conditions de son prlvement ou de sa mesure.
16/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
Chapitre 1 Molcules simples
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
17/207
Molcules simples
1.1 Phosphates
BM 01 Les molcules biologiques qui contiennent linformation gntique sont les acides nucliques. Les acides nucliques sont composs de molcules simples comme lacide phosphorique (PO4H3), des oses 5 carbones (pentoses) et des bases azotes (purines ou pyrimidines). Le phosphate inorganique est un ion stable form partir de lacide phosphorique PO4H3. On lcrit souvent Pi. Des esters de phosphate peuvent se former entre un phosphate et un groupement hydroxyle libre (alcool, nol, phnol...). La condensation dun phosphate et dun autre acide, par exemple un autre phosphate, donne un anhydride. Il y a aussi des anhydrides mixtes avec les acides carboxyliques par exemple. Le pyrophosphate est un ion driv de lacide pyrophosphorique (P2O7H4), qui est lui mme un anhydride dacide phosphorique.
18/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
1.2 Ribose, dsoxyribose
BM 01/1 Le ribose est un pentose de la srie D, dont tous les hydroxyles sont orients droite (reprsentation de Fisher). Dans les acides ribonucliques (RNA), il est cyclis en ribofuranose : anomre spcifiquement. Le dsoxyribose, composant des acides dsoxyribonucliques (DNA) est driv du ribose par une rduction de la fonction alcool secondaire du carbone n2. Le dsoxyribose confre cet acide nuclique une plus grande stabilit propre sa fonction de conservation de linformation gntique.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
19/207
Molcules simples
1.3 Purine, Pyrimidine
BM 02 Les bases azotes des acides nucliques appartiennent deux classes de molcules selon le noyau aromatique qui en constitue le squelette. Le noyau pyrimidine est le plus simple : cest un noyau aromatique six atomes, quatre carbones et deux azotes ; les deux azotes en position mta (n 1 et 3). Le noyau purine est constitu de deux noyaux htrocycliques accols, un de six atomes et lautre de cinq atomes, ayant deux carbones en commun au milieu. Par rapport ces carbones communs, les azotes occupent des positions symtriques (n 1 et 3 gauche, n 7 et 9 droite). Les diffrentes bases rencontres dans les acides nucliques en drivent selon les substituants que portent les atomes de ces noyaux. De nombreux mdicaments appartiennent aussi ces deux classes de bases azotes.
20/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
1.4 Bases puriques
BM 02/1 Les bases azotes sont des molcules aromatiques dont le noyau est soit une purine (bases puriques), soit une pyrimidine (bases pyrimidiques). Les bases puriques sont au nombre de 2 : ladnine et la guanine. Les purines ont un double noyau aromatique comportant gauche un cycle hexagonal de 4 carbones et 2 azotes et droite un cycle pentagonal de 3 carbones (dont 2 communs avec le prcdent) et 2 azotes. Ladnine est constitue dun noyau purine dont le carbone 6 est substitu par une fonction amine. Elle est la seule des bases nucliques dont la formule ne contient pas datome doxygne. La guanine est constitue dun noyau purine dont le carbone 2 est substitu par une fonction amine et le carbone 6 par une fonction ctone.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
21/207
Molcules simples
1.5 Bases pyrimidiques
BM 02/2 Les bases pyrimidiques sont au nombre de 3 : la cytosine, luracile et la thymine. Les pyrimidines ont un noyau aromatique hexagonal de 4 carbones et 2 azotes. La cytosine est constitue dun noyau pyrimidine dont le carbone 4 est substitu par une fonction amine et le carbone 2 par une fonction ctone. Luracile est constitue dun noyau pyrimidine dont les carbones 2 et 4 portent des fonctions ctone. La thymine est aussi constitue dun noyau pyrimidine dont les carbones 2 et 4 portent des fonctions ctone, mais dont le carbone 5 est substitu par un mthyl.
22/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
1.6 Nuclosides et nuclotides
BM 03 Les sucres (ribose ou dsoxyribose) se lient aux bases azotes par des liaisons impliquant un des azotes de la base (azote n1 des pyrimidines ou azote n9 des purines) et le carbone n1 de lose (carbone rducteur ou fonction semi-actalique). Ce sont des liaisons N-osidiques. La liaison dune base azote avec un des sucres donne un nucloside. Un nucloside est donc form dune base et dun sucre lis par une liaison N-osidique. Dans un nucloside, on numrote les atomes de la base par des chiffres : 1, 2, 3, etc... et pour les distinguer, les carbones du sucre sont numrots 1, 2, 3, etc... La liaison dun nucloside avec un phosphate se fait par une estrification de la fonction alcool primaire (carbone n5) du sucre et une des trois fonctions acides du phosphate. Lester obtenu est un nuclotide. Un nuclotide est donc form dune base azote, lie par une liaison osidique avec un sucre, lui-mme li par une liaison ester avec un phosphate. Dans le mtabolisme des acides nucliques interviennent des substrats riches en nergie, les nuclosides triphosphates. Un nucloside triphosphate est un nuclotide dont le phosphate est lui-mme li un ou deux autres phosphates par des liaisons anhydride dacides.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
23/207
Molcules simples
1.7 Nomenclature des units nuclotidiques
BM 03/1 Les bases azotes sont conventionnellement dsignes par une initiale et par une couleur : ladnine par A et la couleur verte, la guanine par G et la couleur jaune, etc... Chaque base peut entrer dans la structure de deux nuclosides, selon que le sucre est un ribose ou un dsoxyribose. Chaque nucloside peut tre li un, deux ou trois phosphates. On les dsigne par des sigles conventionnels : GMP pour guanosine monophosphate, CDP pour cytidine diphosphate, ATP pour adnosine triphosphate, etc... On dsigne par nuclotides les nuclosides monophosphates : AMP ou acide adnylique, dTMP ou acide dsoxythymidylique, etc... Les nuclosides polyphosphates sont des diphosphates : ADP ou GDP... ou encore des triphosphates, les plus riches en nergie : ATP ou GTP ; etc... Les acides nucliques sont forms par une polycondensation de nuclotides AMP, CMP, GMP et UMP pour les acides ribonucliques, dAMP, dCMP, dGMP et dTMP pour les acides dsoxyribonucliques.
24/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
1.8 Adnosine
BM 04 Un nucloside est une molcule compose dun pentose (-D-ribose ou 2-dsoxy--D-ribose) li par une liaison N-osidique une base azote. Les nuclotides sont des esters phosphoriques des nuclosides. Les autres ribonuclosides sont : la guanosine, la cytidine et luridine.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
25/207
Molcules simples
1.9 Dsoxyguanosine
BM 04/5 Un nucloside est une molcule compose dun pentose (-D-ribose ou 2-dsoxy--D-ribose) li par une liaison N-osidique une base azote. Les nuclotides sont des esters phosphoriques des nuclosides. Les autres dsoxyribonuclosides sont : la dsoxyadnosine, la dsoxycytidine et la dsoxythymidine, souvent appele thymidine tout court.
26/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
1.10 Uridine MonoPhosphate
BM 05/3 Un nuclotide est une molcule compose dun nucloside li par une liaison ester un acide phosphorique. Les acides nucliques sont des macromolcules rsultant de la condensation de trs nombreux nuclotides, lis par des liaisons phosphodiester. Luridine mono phosphate (UMP) ou acide uridylique est un exemple de nuclotide. Les autres ribonuclotides sont : lAMP, le GMP et le CMP.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
27/207
Molcules simples
1.11 Dsoxythymidine MonoPhosphate
BM 05/7 Un nuclotide est une molcule compose dun nucloside li par une liaison ester un acide phosphorique. Les acides nucliques sont des macromolcules rsultant de la condensation de trs nombreux nuclotides, lis par des liaisons phosphodiester. Le thymidine monophosphate (dTMP ou TMP) ou acide thymidylique est un exemple de nuclotide. La thymine tant toujours lie un dsoxyribose on nglige souvent de prciser dsoxythymidine monophosphate ou dTMP. Les autres dsoxyribonuclotides sont : le dAMP, le dGMP et le dCMP.
28/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
1.12 Adnosine Tri Phosphate
BM 06 Ladnosine triphosphate est un nuclotide compos. Sa structure comporte une base azote, ladnine, lie par une liaison N-osidique au -D-ribose et trois phosphates. Les fonctions acides des acides phosphoriques distaux sont fortement ionises au pH physiologique. Les liaisons anhydrides unissant les acides phosphoriques sont des liaisons riches en nergie (G 31 kJ/mol). LATP est un des substrats des RNA-polymrases. Le coenzyme ATP/ADP est un coenzyme transporteur dnergie universel. Les enzymes utilisant un nucloside triphosphate comme substrat ou comme coenzyme, ncessitent en mme temps la prsence du cation Magnsium comme cofacteur. Les autres nuclosides triphosphates sont en fonction du sucre ou de la base quils contiennent : le GTP, le CTP, lUTP, le dATP, le dGTP, le dCTP (voir BM 06/6) et le dTTP.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
29/207
Molcules simples
1.13 Dsoxycytidine Tri Phosphate
BM 06/6 Le dsoxycytidine-triphosphate est un nuclotide compos. Sa structure comporte une base azote, la cytosine, lie par une liaison N-osidique au -D-ribose et trois phosphates. Les fonctions acides des acides phosphoriques distaux sont fortement ionises au pH physiologique. Les liaisons anhydrides unissant les acides phosphoriques sont des liaisons riches en nergie (G 31 kJ/mol). Le dCTP est un des substrats des DNA-polymrases. Les enzymes utilisant un nucloside triphosphate comme substrat ou comme coenzyme, ncessitent en mme temps la prsence du cation Magnsium comme cofacteur. Les autres nuclosides triphosphates sont en fonction du sucre ou de la base quils contiennent : lATP (voir BM 06), le GTP, le CTP, lUTP, le dATP, le dGTP et le dTTP.
30/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
1.14 Liaisons hydrogne
BM 07 Une liaison hydrogne est une liaison de faible nergie entre deux atomes attirs lun vers lautre pour des raisons lectrostatiques lun tant riche en lectrons donc nuclophile et lautre nayant que les protons de son noyau donc lectrophile. Ainsi latome dhydrogne, dont lunique lectron est par ncessit dans lorbitale qui unit cet atome au reste de la molcule, ne peut qutre lectrophile et comme tel attir par les atomes ayant des doublets lectroniques libres. Les atomes dazote et surtout doxygne possdent respectivement deux et quatre lectrons de leur couche priphrique qui ne participent pas aux orbitales des liaisons covalentes de la molcule. Ceci leur confre un caractre nuclophile qui leur permet dexercer une attraction sur les atomes lectrophiles voisins, en particulier les atomes dhydrogne : cette attraction constitue une liaison hydrogne. Lorsque les orbitales qui unissent dun ct latome dhydrogne la molcule de gauche et de lautre ct les doublets lectroniques libres avec latome nuclophile sont dans le mme axe, la liaison hydrogne est plus forte.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
31/207
Molcules simples
1.15 Hybridation A - T
BM 07/1 Lorsquun acide nuclique est en solution les molcules forment des liaisons hydrognes associant les nuclotides deux par deux, de sorte quun nuclotide adnine se lie avec un nuclotide thymine (ou uracile dans un RNA) et un nuclotide guanine avec un nuclotide cytosine. On dsigne cette liaison sous le terme dhybridation. Lhybridation adnine-thymine est moins stable (2 liaisons hydrogne, -21 kJ) que celle entre guanine et cytosine.
32/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Molcules simples
1.16 Hybridation G - C
BM 07/2 Lorsquun acide nuclique est en solution les molcules forment des liaisons hydrognes associant les nuclotides deux par deux, de sorte quun nuclotide adnine se lie avec un nuclotide thymine (ou uracile dans un RNA) et un nuclotide guanine avec un nuclotide cytosine. On dsigne cette liaison sous le terme dhybridation. Lhybridation guanine-cytosine est plus stable (3 liaisons hydrogne, -63 kJ) que celle entre adnine et thymine.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
33/207
Molcules simples
34/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Les acides nucliques
Chapitre 2 Les acides nucliques
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
35/207
Les acides nucliques
2.1 Acide ribonuclique
BM 08 Pour former un acide ribonuclique les nuclotides (GMP, AMP, UMP, CMP), sont condenss les uns sur les autres avec des liaisons phosphodiester entre le carbone 3 dun premier nuclotide et le carbone 5 du nuclotide suivant. De sorte que ces liaisons dfinissent un sens la molcule : le dbut tant le nuclotide dont le phosphate en 5 ne serait li aucun autre nuclotide et la fin correspond au nuclotide dont la fonction alcool en 3 nest pas estrifie. Selon leurs fonctions, on distingue plusieurs espces dacides ribonucliques : rRNA = acide ribonuclique ribosomique, qui participe la structure des ribosomes ; tRNA = acide ribonuclique de transfert, transporteur des acides amins activs pour la traduction ; mRNA = acide ribonuclique messager, produit de la transcription dun gne qui porte linformation traduire.
36/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Les acides nucliques
2.2 Les extrmits 5 et 3 dun acide nuclique
BM 08/1 Le premier nuclotide de la chane porte, par une liaison ester sur le carbone 5 de son ribose un phosphate dont les deux autres fonctions acides ne sont pas estrifies. Cest lextrmit 5-phosphate terminale de lacide nuclique, quon dsigne par convention comme le dbut de la squence ou du fragment dacide nuclique. Le dernier nuclotide de la chane porte une fonction alcool sur le carbone 3 de son ribose. Cette fonction alcool nest pas pas estrifie. Cest lextrmit 3-OH terminale de lacide nuclique, quon dsigne par convention comme la fin de la squence ou du fragment dacide nuclique.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
37/207
Les acides nucliques
2.3 Structure secondaire du RNA
BM 09/1 Le RNA diffre du DNA par plusieurs caractres : 1. 2. 3. 4. il est plus court (70 10 000 nuclotides) le squelette de pentoses et de phosphates contient du ribose la place du dsoxyribose parmi les bases azotes luracile (U) remplace la thymine (T) Les RNA sont simple brin mais certaines rgions sont apparies sur une courte distance par leurs bases complmentaires selon un ajustement au hasard (pingles cheveux).
38/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Les acides nucliques
2.4 Acides ribonucliques
BM 10 Il existe de nombreuses molcules dacides ribonucliques dans presque tous les compartiments de la cellule et ayant des fonctions varies. Certains (rRNA) font partie de la structure des ribonucloprotines du ribosome, particule responsable de la synthse des protines. Dautres sont des coenzymes transporteurs dacides amins pour la synthse des protines, ce sont les tRNA. Certains, beaucoup plus rares, participent la structure de ribonucloprotines diverses, responsable de lexcision-pissage des transcrits, de la slection des polyribosomes lis pour ladressage des protines ou encore dautres activits enzymatiques du mtabolisme (ex. : ALA synthtase). Enfin les mRNA sont les produits de la transcription des gnes, grce auxquels les ribosomes reoivent linformation ncessaire la synthse des protines.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
39/207
Les acides nucliques
2.5 Acide dsoxyribonuclique
BM 11 Les molcules dacide dsoxyribonucliques sont formes de deux chanes dont les nuclotides sont hybrids deux deux sur toute la longueur. Les deux chanes sont antiparallles, cest dire que lextrmit 5 de lune est du ct de lextrmit 3 de lautre. Pour que tous les nuclotides puissent shybrider ; il faut que lordre dans lequel ils sont lis ensemble soit complmentaire de la chane oppose. Les bases azotes lies par les liaisons hydrognes sont tournes vers lintrieur, tandis que les riboses et les acides phosphoriques, hydrophiles sont tourns vers lextrieur. La chaleur peut dissocier les deux chanes : cest la fusion du DNA. Cette fusion est rversible : les deux chanes peuvent shybrider nouveau.
40/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Les acides nucliques
2.6 La double hlice (modle rubans)
BM 11/1 La structure secondaire du DNA est telle que les deux brins sont enrouls lun autour de lautre. Chacun des deux brins est orient (53) dans le sens oppos celui de lautre brin (35). On dit quils sont antiparallles. Les bases azotes sont tournes vers lintrieur de la double hlice de faon ce que chacune shybride avec une base de lautre brin (A avec T, C avec G, etc..). On dit que les bases successives de chacun des brins sont complmentaires. La double hlice a un pas de 3,4 nm cest dire quil y a environ 10 paires de nuclotides pour chaque tour dhlice.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
41/207
Les acides nucliques
2.7 La double hlice (travers)
BM 11/2 Une vue perspective de la double hlice montre bien comment les bases azotes sont parallles entre elles, leurs noyaux empils comme des assiettes au centre de la double hlice.
42/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Les acides nucliques
2.8 La double hlice (axe)
BM 11/3 Lorsquon reprsente la double hlice selon son axe, on met en vidence deux particularits. Lensemble des dsoxyriboses et des phosphates se trouve lextrieur de la molcule et les fonctions acides des phosphates sont orientes vers lextrieur. Les bases azotes sont tournes vers lintrieur de la double hlice et unies la base complmentaire par des liaisons hydrogne. Les nuclotides complmentaires ntant pas tout fait diamtralement opposs, laxe de lhlice est vide.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
43/207
Les acides nucliques
2.9 Surenroulement
BM 12 Lors de la transcrition ou de la rplication, lhlice du DNA est ouverte par une topoisomrase (hlicase) qui permet aux enzymes laccs au brin modle. Le fait de sparer les bases complmentaires et les deux brins de la double hlice sur plusieurs dizaines de nuclotides se traduit par un resserrement des tours dhlice de part et dautre de la boucle ainsi ouverte. Ce surenroulement ncessite lintervention dune topoisomrase qui va desserrer les tours dhlice en coupant un brin ou les deux brins du DNA, puis en les faisant tourner lun autour de lautre jusqu revenir 10 nuclotides par tour dhlice. Des protines de stabilisation du DNA simple brin viennent se fixer sur la partie droule pour protger la molcule.
44/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Les acides nucliques
2.10 Nuclosome
BM 12/1 Le DNA a besoin dtre protg par des protines lorsquil nest pas utilis comme modle pour lexpression des gnes ou la rplication. Cette protection se fait par enroulement autour de protines basiques (cationiques) capables de se lier avec le DNA qui est un polyanion. Des octamres dhistones sont au centre de particules quon trouve tous les 200 nuclotides et autour desquels le DNA senroule. La structure voque un collier de perles . Le DNA ainsi li aux histones est protg contre laction des enzymes. Une endonuclase peut digrer le DNA entre les perles et dtacher des particules de 11 nm de diamtre appeles nuclosomes. Chaque nuclosome est constitu dun fragment de DNA de 145 paires de nuclotides et de huit molcules dhistones.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
45/207
Les acides nucliques
2.11 Fibre de chromatine
BM 12/2 Le DNA qui entoure chaque nuclosome et le relie en collier de perles aux nuclosomes suivants, forme la trame dune structure hlicodale qui enroule les colliers de perles sur euxmmes. On dcrit aussi cette structure comme un solnode. Le diamtre de cette hlice est de 30 nm et forme une grande partie de la chromatine dite compacte o le DNA nest pas accessible. Toutefois, des squences reconnues spcifiquement par des protines de liaison au DNA interrompent de place en place cette structure compacte.
46/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Les acides nucliques
2.12 Condensation et hydrolyse des nuclotides
BM 13 La croissance des brins dacides nucliques se fait toujours par leur extrmit 3-OH terminale. La condensation se fait partir dun substrat activ : un des nuclosides triphosphates. La rupture dune liaison riche en nergie fournira lnergie ncessaire la condensation. Le nucloside monophosphate restant sera estrifi par une fonction acide de son phosphate sur la fonction alcool libre du carbone 3 du ribose qui constitue lextrmit de lacide nuclique. Inversement, en ajoutant une molcule deau sur cette liaison ester, on provoquera une raction dhydrolyse qui dtachera le dernier nuclotide et librera le carbone 3 du nuclotide prcdent.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
47/207
Les acides nucliques
2.13 Complmentarit des bases
BM 13/1 Lhybridation des nuclotides complmentaires peut se faire sur toute la longueur dun brin dacide nuclique : par des liaisons hydrogne, on associe systmatiquement les C avec des G et les G avec des C, les A avec des T et les T avec des A. En runissant tous les nuclotides ainsi associs par des liaisons phosphodiester on constitue une squence complmentaire de la squence originale. Ces deux squences sont obligatoirement orientes dans des sens opposs : on dit quelle sont antiparallles. De cette faon, grce des enzymes spcifiques, une squence dacide nuclique dite originale est capable de diriger la synthse dune squence dacide nuclique complmentaire. Dans un second temps, cette squence complmentaire isole, sera elle aussi capable de diriger la synthse de la squence originale dont elle est le complment.
48/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Biosynthse des macromolcules
Partie II Biosynthse des macromolcules
Rappel des objectifs Transcription et rgulation de lexpression des gnes Dfinir1 les termes : gne, transcription, brin sens, promoteur, exon, intron, coiffe, queue poly-A, excision-pissage. Montrer le mcanisme2 de la transcription dun gne, en distinguant les tapes dinitiation, dlongation et de terminaison. Montrer les mcanismes de la rgulation de la transcription. Donner un exemple de rgulation dun gne eucaryote sous le contrle dune grande voie endocrinienne (exemples : CREB, GlucocorticoidRE). Enumrer et dcrire les principales modifications post-transcriptionnelles : enzyme coiffante, polyadnylation, dition, excision-pissage. Donner un exemple dexpression alternative dun gne eucaryote.
Ltudiant doit tre capable de dfinir un certain nombre de termes indispensables la comprhension de la transcription : brin sens et brin antisens, RNA polymrase, promoteur, initiation de la transcription, longation, terminaison. Il doit savoir dcrire le mcanisme biochimique de la RNA polymrase et mentionner les rles spcifiques des trois types de polymrases impliques dans la transcription chez les eucaryotes. Il doit savoir commenter un schma rsumant de faon intgre la rgulation dun gne dont la transcription est sous le contrle dun messager agissant sur un rcepteur membranaire (exemple de CREB) ou dun messager interagissant avec un rcepteur nuclaire (hormones strodiennes). En ce qui concerne les modifications post-transcriptionnelles, il doit simplement pouvoir dfinir ce quest une coiffe, une polyadnylation ou lpissage (ventuellement alternatif) en identifiant et en explicitant les mcanismes molculaires mis en jeu. Traduction Dfinir les termes : traduction, codon et anticodon, polyribosome, signal-peptide.
1. Dfinir : prciser dans une phrase concise lessence dun objet ou les limites dun concept en excluant toute notion trangre et en comprenant toutes les variations possibles de lobjet ou du concept cern. 2. Montrer le mcanisme (dune raction) ou Dcrire les tapes (dune voie mtabolique) : dfinir les corps chimiques en prsence, crire et quilibrer la (les) raction(s) ; faire le bilan chimique et nergtique.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
49/207
Biosynthse des macromolcules
Montrer le mcanisme de la traduction dun messager, en distinguant les tapes dinitiation, dlongation et de terminaison. Montrer les mcanismes de la rgulation de la traduction. Donner un exemple1 dantibiotique intervenant sur la rgulation de la traduction des procaryotes. Enumrer et dcrire les principales modifications post-traductionnelles (en complment de ce qui aura t trait dans le thme 2)
Ltudiant doit tre capable de dfinir un certain nombre de caractristiques ou de termes indispensables la comprhension de la traduction : aminoacyl-tRNA synthtase, sens de la traduction, codon, anticodon, codon dinitiation, code gntique, ribosomes, polyribosomes. Sur un schma synthtique dcrivant le mcanisme de la traduction, il doit tre capable didentifier et dexpliciter les grandes tapes mises en jeu. Il doit avoir la notion que chacune des tapes de la traduction chez les procaryotes peut tre la cible dantibiotiques, mais aucune connaissance spcifique ne peut lui tre demande, sauf des exercices de rflexion o ces donnes lui seraient rappeles. Il doit pouvoir expliquer en termes simples la diffrence entre les protines localisation cytoplasmique et celles qui empruntent la voie de scrtion, en prcisant les notions de peptide-signal et de modifications post-traductionnelles. Rplication et rparation du DNA Dfinir les termes : rplication, rparation. Montrer le mcanisme enzymatique dune fourche de rplication. Dcrire les diffrentes ractions catalyses par les DNA polymrases. Dcrire un exemple de mcanisme de rparation des msappariements. Dcrire la rplication du DNA linaire et le rle dune tlomrase. Dcrire lactivit de la transcriptase inverse et donner un exemple de ses consquences physiopathologiques.
Ltudiant doit pouvoir citer et expliciter les grandes caractristiques de la rplication : semi-conservative, continue/discontinue selon le brin, dbutant une mme origine. Il doit pouvoir citer les principales protines impliques successivement dans la rplication chez les eucaryotes et prciser leur rle : hlicases, protines de liaison au DNA simple brin, topoisomrases, primase, DNA polymrases, ligase. Ltudiant doit savoir illustrer la notion de fidlit de la rplication en explicitant les principaux mcanismes mis en jeu (activit 3-exonuclasique des DNA polymrases, rparation des msappariements). Il doit tre capable de rsoudre le problme pos par la rplication des DNA linaires en expliquant le rle des tlomrases. Il doit savoir dcrire les proprits de la transcriptase inverse sans entrer dans les dtails de la rplication des rtrovirus. Donner un exemple de rparation du DNA ls. En appliquant ses connaissances acquises des principales enzymes agissant sur le DNA,
1. Donner un exemple : choisir, dcrire et expliquer une situation dans laquelle un concept ou un corps dfini joue le rle principal et met en vidence ses proprits essentielles.
50/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Biosynthse des macromolcules
auxquelles seront ajoutes loccasion les glycosylases, ltudiant doit savoir reconnatre sur un schma les interventions successives des enzymes impliques dans la rparation par excision de nuclotides. Recombinaison Sans avoir reproduire le modle de Holliday qui lui aura t prsent, ltudiant doit tre capable de dfinir le processus dchange de segments de DNA homologues sur des schmas simples et de mentionner limplication de la recombinaison dans des phnomnes fondamentaux tels que le crossing-over .
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
51/207
Biosynthse des macromolcules
52/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
DNA Dfinitions
Chapitre 3 DNA Dfinitions
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
53/207
DNA Dfinitions
3.1 La double hlice
BM 21 Lacide dsoxyribonuclique (ADN ou DNA) est constitu de deux chanes de nuclosides monophosphates lis chacun par une liaison ester entre son carbone 3 (alcool secondaire) et le carbone 5 (alcool primaire) du nuclotide suivant. Ces deux chanes de nuclotides sont unies entre elles par des liaisons hydrognes pour former un hybride en forme de double hlice (modle de J.D. Watson et F.H.C. Crick, 1953) dont les deux brins sont : antiparallles : lun est constitu dun enchanement commenant gauche et se poursuivant vers la droite, lautre commenant droite et se poursuivant vers la gauche ; complmentaires : chaque adnine (A) dun des deux brins est lie par deux liaisons hydrogne avec une thymine (T) de lautre brin, et chaque guanine (G) dun brin est lie par trois liaisons hydrogne avec une cytosine (C) de lautre brin.
De sorte que si on dsigne les nuclotides par les lettres A, C, G et T en fonction des bases azotes quils contiennent, on peut lire sur cette figure le texte suivant :
...AGAGTCGTCTCGAGTCA... ...TCTCAGCAGAGCTCAGT...
54/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
DNA Dfinitions
3.2 Squence dun gne (apoA-II)
BM 22 Ecrire la suite les lettres A, C, G et T dans lordre o on rencontre les nuclotides sur lun des brins du DNA de lextrmit 5 lextrmit 3 aboutit un texte indchiffrable (voir limage). Pourtant sur cette diapositive le texte ainsi transcrit contient toute linformation ncessaire pour la synthse dune protine (lapolipoprotine A-II). Cest pourquoi on appelle ce brin de DNA le brin sens . Lautre brin est le brin complmentaire ou brin antisens . Lensemble de linformation gntique transmise par chacun des parents un enfant (gnome haplode) peut scrire ainsi en 3 milliards de lettres (une bibliothque de 7000 livres de 300 pages chacun !) Les protines du noyau savent chercher sur les brins de la double hlice du DNA des suites de lettres (squences) sur lesquelles elles se fixent spcifiquement. Les effets de cette fixation de protines sur le DNA vont permettre lexpression de linformation contenue dans le DNA pour faire vivre un individu.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
55/207
DNA Dfinitions
3.3 Gne
BM 23 Pour permettre la biosynthse dune protine, il doit y avoir dans la structure du DNA dun sujet, une squence de nuclotides qui constitue le gne de cette protine. Dans la squence du gne on distingue des squences en amont (lments rgulateurs, promoteur), un site dinitiation de la transcription, une suite variable dexons et dintrons : exons non-traduits ou traduits, introns comportant ventuellement dautres squences rgulatrices, et enfin la fin de la transcription la fin du dernier exon. Lensemble des mcanismes qui partir de la squence du gne conduisent la production dun acide ribonuclique ou dune protine est dsign sous le terme dexpression de ce gne.
56/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
DNA Dfinitions
3.4 Expression dun gne
BM 23/1 Lexpression dun gne est une suite de synthses chimiques et de ractions aboutissant la production dun acide ribonuclique ou dune protine. Dans un premier temps a lieu la synthse dun acide ribonuclique, dont la squence est complmentaire dun des deux brins du gne donc identique celle de lautre brin : cest la transcription. La squence de lacide ribonuclique est identique celle du brin sens et oriente dans le mme sens. Elle se construit de 5 vers 3 en complmentarit de celle qui est lue sur le brin antisens. Aprs des ractions de maturation le transcrit primaire (RNA) devient RNA messager (mRNA) et sort du noyau vers le cytoplasme. Dans le second temps, le RNA messager est lu par groupe de trois nuclotides (lettres) grce un RNA complmentaire qui porte lacide amin correspondant. La lecture du mRNA se fait de 5 vers 3 et la synthse de la protine se fait en mme temps de lextrmit NH2 terminale vers lextrmit COOH terminale. Aprs des ractions de maturation, la protine mature est prte remplir sa fonction dans la cellule.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
57/207
DNA Dfinitions
58/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
Chapitre 4 La transcription
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
59/207
La transcription
4.1 Transcription
BM 24 Lexpression du gnome aboutit la synthse dans les cellules de macromolcules acides nucliques et protines, dont la structure primaire est dtermine par celle du DNA. Cette expression se fait par deux mcanismes principaux : la structure primaire du DNA sexprime dabord par la synthse dacides ribonucliques dont la structure primaire est parallle celle du DNA. Cest la transcription. la structure transcrite sur certains RNA, dits messagers , sexprime enfin par la synthse de protines dont la structure primaire traduit en acides amins linformation porte par la structure primaire du DNA. Cest la traduction. RNA-polymrase I qui synthtise les RNA cytoplasmiques : RNA ribosomiques (18 S5,8 S- 28 S) RNA-polymrase II qui synthtise les RNA messagers qui contiennent linformation destine la traduction et certains des snRNA RNA-polymrase III qui synthtise les petits RNA (tRNA, rRNA 5 S, snRNA, 7SLRNA).
La transcription est conduite par plusieurs enzymes :
60/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.2 Promoteur
BM 25 La dernire ligne de cette image (en bleu) est la squence du premier exon du gne de lapolipoprotine A-II. Les 900 nuclotides qui prcdent contiennent de nombreuses squences reconnues par des protines nuclaires qui permettent le dbut de la transcription ou la rgulation de cette tape. On distingue en particulier : vers -20 -30 (20 30 nuclotides en amont de lexon 1 en direction de lextrmit 5 du brin sens) une squence TATATA appele bote TATA , qui est spcifiquement reconnue par la protine TFIID, cofacteur de la RNA-polymrase II ; vers -80 une squence GGCCCATCCAT la fois bote CAT ou CAAT et bote GC , sur laquelle viennent se fixer dautres protines de la transcription (CTF et Sp-1) ; de nombreuses autres squences (en jaune) o se fixent des protines rgulatrices de la transcription. Par exemple, une squence TRE (TGACTCA) au dbut de la troisime ligne de cette image, sur laquelle vont se fixer des protines de la famille AP-1 pour activer la transcription.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
61/207
La transcription
4.3 Brins sens et antisens
BM 25/1 Les gnes sont situs sur les deux brins du DNA, de gauche droite ou de droite gauche, indiffremment. Ainsi les gnes des apolipoprotines A-I et C-III qui sont voisins sont orients en sens opposs. Le dbut du message (exon 1) est gauche pour lapoA-I et droite pour lapoC-III. Le message cod doit tre lu en commenant par le dbut donc dans un sens diffrent pour ces deux gnes. Pour servir de modle la transcription doit faire la copie de la squence dun brin de DNA, qualifi de brin sens ; lautre brin en est le complmentaire on le dit antisens . La transcription se fait en synthtisant un RNA complmentaire de la squence du brin antisens, donc identique celle du brin sens. Lors de la formation du complexe dinitiation de la transcription la fixation de TFIID sur la bote TATA se fait en premier et sur les deux brins de faon symtrique. Lors de la fixation des autres protines du complexe (NF-I ou NF-Y sur la bote CAAT) il y a un brin sur lequel la bote TATA est en aval (ct 3) de la bote CAAT, cest le brin sens qui contient le message et un brin sur lequel la bote CAAT est en aval (ct 3) de la bote TATA, cest le brin antisens qui doit servir de modle pour la transcription.
62/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.4 Rgulation de lexpression
BM 26 La rgulation de toute voie mtabolique se fait principalement la premire raction pour ne pas synthtiser dintermdiaires inutiles. Pour lexpression dun gne, la rgulation lieu quatre niveaux : 1. 2. 3. 4. lors de la transcription lors de la maturation du transcrit lors de la traduction lors de lactivation de la protine mature.
Le point de contrle principal est la transcription : la RNA polymrase est lenzyme-cl de lexpression dun gne.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
63/207
La transcription
4.5 Cis et trans rgulateurs
BM 26/1 Les squences de nuclotides du promoteur (facteurs cis-rgulateurs) sont reconnues par une classe de protines spcifiques (facteurs trans-rgulateurs) dont la structure permet une liaison avec le DNA (DNA binding proteins ). Les facteurs trans-rgulateurs ont des effets sur la vitesse de la transcription : activateurs (squences enhancer ) ou inhibiteurs (squences silencer ). Leur liaison avec le DNA dpend le plus souvent de circonstances physiologiques qui induisent ou rpriment lexpression du gne. Il existe des lments essentiels et prsents dans la plupart des gnes : lment principal comme la bote TATA, lments de base comme loctamre reconnu par le facteur OCT-1 prsent dans presque toutes les cellules.
Il existe des lments qui rpondent des facteurs dont la prsence dpend des signaux qui parviennent la cellules, principalement les hormones comme linsuline ou les second messagers comme lAMP cyclique. Il y a encore des lments spcifiques dun type cellulaire permettant lexpression diffrente des gnes dans chaque tissu. Ainsi, le promoteur de la lipoprotine lipase contient la bote TATA, des lments du promoteur de base, des lments de rponse aux hormones et des lments dexpression tissulaire spcifique. Dans le promoteur des gnes il y a souvent 20 ou 30 sites de fixation pour des fac-
64/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
teurs trans-rgulateurs dont beaucoup ont un effet inducteur ou rpresseur sur lexpression du gne.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
65/207
La transcription
4.6 DNA binding proteins
BM 26/2 Les protines qui reconnaissent et se lient au DNA (DNA binding proteins ) sont des enzymes, des protines de structure, des facteurs de transcription et des lments trans-rgulateurs. Dans la structure spatiale de ces protines, on reconnat des domaines propres cette liaison spcifique : Le domaine hlice-boucle-hlice permet le lien spcifique des hlices avec les nuclotides dans le grand sillon sur une longueur de 10 paires de bases environ. Les doigts de Zinc sont des domaines forms dun ion Zn++ ttracoordonn avec deux histidines (H) et deux cystines (C) de la protine. Chaque doigt de Zinc se lie cinq nuclotides dans le grand sillon du DNA. Il y a souvent plusieurs doigts de Zinc la suite dans la mme protine. Certaines protines ont un domaine riche en acides amins basiques (K,R) qui se lie aux phosphates des nuclotides. Ces protines se lient des squences rptes inverses sur le DNA, lorsquelles sont associes en dimres par la liaison hydrophobe de deux domaines riches en leucine (fermeture Eclair leucines).
66/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.7 Interaction Protine DNA
BM 26/21 Les protines rgulatrices (facteurs trans-rgulateurs) ont la capacit de se lier de faon spcifique de courtes squences de DNA et de rguler de faon positive ou ngative la transcription dun gne. Dans la plupart des cas la protine sinsre dans le grand sillon de lhlice et ralise une srie de contacts molculaires avec les paires de bases. La liaison avec le DNA se fait par lintermdiaire de plusieurs types interactions (liaisons hydrogne, liaisons ioniques ou interactions hydrophobes). Ici on a reprsent un point de contact entre un rsidu asparagine dune protine rgulatrice et une adnine dun brin du DNA. Linteraction DNA-protine comporte 10 20 de ces points de contact, impliquant chacun un acide amin.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
67/207
La transcription
4.8 Rcepteurs nuclaires
BM 26/22 Les hormones strodes, thyrodiennes et les rtinodes se lient des protines quon appelle rcepteurs nuclaires. Ces rcepteurs nuclaires forment une famille de protines homologues se liant au DNA. Lensemble hormone-rcepteur constitue un facteur trans-rgulateur. Les squences de DNA quils reconnaissent (lments cis-rgulateurs) sont des rptitions de six nuclotides directes (dans le mme sens) ou inverses, spares par quelques nuclotides.
68/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.9 Rgulation du jene
BM 26/3 Au cours du jene le taux de glucose dans le sang diminue (hypoglycmie). Le cerveau dont le nutriment majeur est le glucose ragit en faisant scrter par lhypophyse une stimuline : la corticotrophine (ou ACTH). Celle-ci provoque la scrtion dune hormone par les surrnales : le cortisol. Le cortisol agit dans le foie en se liant avec une protine spcifique : le rcepteur du cortisol. Cette protine lie lhormone constitue un facteur trans-rgulateur. Le facteur transrgulateur va dans le noyau des hpatocytes se lier au DNA au niveau du promoteur de certains gnes qui ont un lment cis-rgulateur spcifique : le GRE (glucocorticoid responsive element ). La liaison du facteur trans-rgulateur (protine + hormone) sur la squence de llment cisrgulateur (squence AGAACA) va activer la transcription du gne en aval de ce promoteur, do une synthse accrue de messager. Les messagers ainsi produits vont induire la synthse denzymes appartenant la voie de la gluconognse. Laugmentation du taux de ces enzymes dans les hpatocytes va permettre la transformation des acides amins en glucose qui sera scrt dans la circulation et gagnera le cerveau : la glycmie va remonter.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
69/207
La transcription
4.10 Rgulation de leffort
BM 26/4 Les stress provoquent la mise en veil de lorganisme et sa prparation leffort physique qui ncessite lutilisation du glycogne pour la contraction musculaire. Le cerveau active les mdullosurrnales par voie nerveuse pour produire de ladrnaline. Si le taux de glucose dans le sang est bas (hypoglycmie), le pancras scrte du glucagon. Ces deux hormones agissent sur les muscles et sur le foie en activant la synthse de lAMP cyclique. Ce dernier est un activateur de la protine kinase A qui est capable de phosphoryler la CREB (cyclic AMP responsive element binding protein ). La CREB phosphoryle constitue un facteur trans-rgulateur. Le facteur trans-rgulateur (CREB-P) va dans le noyau des cellules se lier au DNA au niveau du promoteur de certains gnes qui ont un lment cis-rgulateur spcifique : le CRE (cyclic AMP responsive element ). La liaison du facteur trans-rgulateur (CREB phosphoryle) sur la squence de llment cisrgulateur (squence TGACGTCA) va activer la transcription du gne en aval de ce promoteur, do une synthse accrue de messager. Les messagers ainsi produits vont induire la synthse denzymes appartenant la voie de la glycognolyse. Laugmentation du taux de ces enzymes dans les muscles va permettre la transformation du glycogne en nergie qui sera utilise pour la contraction musculaire.
70/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.11 RNA polymrase II
BM 27 La RNA polymrase II est lenzyme de la transcription des gnes exprims sous forme de protines. Elle est inhibe spcifiquement par un poison extrait de lAmanite phallode, l-amanitine. Elle est prsente dans tous les noyaux cellulaires. Sa masse molculaire est de 500000 daltons pour 10 sous-units. La transcription quelle catalyse ncessite des ribonuclosides triphosphates comme substrats (ATP, CTP, GTP et UTP), plusieurs cofacteurs protiniques (transcription factors TFIIA TFIIJ). Lnergie de la raction est fournie par lhydrolyse des liaisons riches en nergie des nuclosides triphosphates.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
71/207
La transcription
4.12 Initiation de la transcription
BM 28 Linitiation de la transcription sur un promoteur humain implique plusieurs facteurs de transcription, connus sous les noms de TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, TFIIH et TFIIJ en plus de la RNA polymrase II elle-mme. Au centre de ce mcanisme initial, il y a lassociation de TBP, la sous-unit reconnaissant le DNA du facteur TFIID, avec la bote TATA du promoteur. Ladjonction successive de TFIIB et de RAP30, petite sous-unit de TFIIF, sont ensuite ncessaires pour la fixation de la polymrase et dterminent la fois le brin transcrit et le sens de la transcription. A ce complexe DNA-TFIID-TFIIB-RAP30-polymrase II, sajoutent encore successivement la grand sousunit de TFIIF (RAP74), TFIIE et TFIIH. Alors la transcription peut commencer si les ribonuclosides substrats sont prsents. Le complexe dinitiation de la transcription recouvre une squence denviron 100 nuclotides du brin antisens du DNA. TFIIH provoque louverture et le droulement partiel de la double hlice cet endroit. La transcription commence environ 22 nuclotides de la bote TATA en direction oppose celle des lments GC-CAAT et se poursuit en remontant le brin antisens en direction de son extrmit 5. La formation de ce complexe est active ou inhibe par les facteurs trans-rgulateurs lis aux squences cis-rgulatrices du mme promoteur.
72/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.13 Liaison TFIID sur le DNA
BM 28/1 La fixation du facteur TFII D sur la bote TATA est la premire tape de la constitution du complexe dinitiation de la transcription. La bote TATA est symtrique, cest dire quelle est identique sur les deux brins antiparallles et complmentaires du DNA. La protine TFII D se fixe sur le DNA, en reconnaissant llment TATA et dforme la double hlice de faon importante en se fixant. Cet ensemble va servir de point dancrage pour les autres facteurs dinitiation de la transcription.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
73/207
La transcription
4.14 Rgulation de la RNA polymrase
BM 28/2 Les activateurs ou inhibiteurs de la transcription (facteurs trans-rgulateurs) sont des protines produites par dautres gnes qui interviennent pour activer ou pour inhiber la RNA polymrase II et par suite induire ou rprimer lexpression du gne transcrire. Ces facteurs trans-rgulateurs se lient au DNA (DNA binding proteins ) dans la rgion du gne situe en amont de la partie transcrite. Les sites de fixation de ces facteurs trans-rgulateurs sur le DNA sont des squences spcifiques appeles lments cis-rgulateurs. Le couple lment cis-rgulateur plus facteur trans-rgulateur li entre en contact avec le complexe dinitiation de la RNA polymrase par lintermdiaire dun ensemble de protines appel mdiateur. La RNA polymrase peut donc dmarrer la transcription lorsquelle est active par les facteurs de transcription dont certains sont lis ces lments comme les botes TATA ou CAAT et lorsque par lintermdiaire du mdiateur elle reoit un signal dactivation ou dinhibition. Ce signal dpend de la prsence dun facteur trans-rgulateur li un autre lment du promoteur. La liaison du rgulateur et du mdiateur ncessite un repliement du DNA du promoteur pour permettre la liaison de ces protines.
74/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.15 Elongation de la transcription
BM 29 Chaque nucloside triphosphate est choisi spcifiquement pour tre complmentaire de la base du brin antisens qui va lui faire face. La liaison riche en nergie entre le premier phosphate estrifiant le carbone 5 du ribose et les deux autres phosphates est hydrolyse, librant un pyrophosphate qui sera hydrolys ensuite par une pyrophosphatase. Le phosphate restant est li par une liaison ester au carbone 3 libre du dernier nuclotide du transcrit en cours de synthse. La RNA polymrase construit un RNA hybrid avec le brin antisens du DNA, dont la squence primaire est la copie du brin sens mais compose de ribonuclotides au lieu des dsoxyribonuclotides et duracile la place des thymines. Au cours de cette longation la RNA polymrase II est accompagn dune srie de facteurs dlongation qui modifient la chromatine pour permettre lavance de lenzyme, empchent la formation dobstacles comme des pingles cheveux ou facilitent lavance de la polycondensation.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
75/207
La transcription
4.16 Elongation de la transcription
BM 29/1 La transcription commence au point dinitiation (environ 25 nuclotides avant la bote TATA sur le brin antisens) par lhybridation et la condensation des premiers ribonuclotides du transcrit primaire (futur mRNA). La double hlice est ouverte en une boucle o se place la RNA polymrase II. Le transcrit primaire reste hybrid sur quelques nuclotides avec le brin antisens puis sen dtache pour permettre la double hlice de se reformer aprs le passage de la polymrase. Lextrmit 5 du transcrit primaire libre se condense en diverses structures secondaires (pingles cheveux). Les substrats de la RNA polymrase sont les quatre ribonuclosides triphosphates. La polymrase lit le brin antisens en allant dans le sens 3 5. Elle poursuit la synthse du transcrit primaire en condensant les ribonuclotides jusqu ce quelle rencontre les signaux de terminaison. A la rencontre des signaux de terminaison, la polymrase se dtache du DNA, libre le transcrit primaire et la double hlice se referme.
76/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.17 Discontinuit des gnes
BM 30 Les molcules de DNA de chaque chromosome sont trs longues : jusqu plusieurs centaines de millions de paires de nuclotides et contiennent plusieurs milliers de gnes. Chez lhomme, les gnes sont trs disperss et ne reprsentent que 10 % du DNA gnomique total. Chaque gne comprend des rgions qui contiennent les squences codes qui seront traduites, les exons ; mais aussi, des rgions de rgulation comme le promoteur et des rgions non traduites appeles introns qui sparent les exons. Un gne peut ne contenir quun seul exon et pas dintron, mais il y a des gnes de plus de cent exons. Aprs la transcription le RNA produit de la RNA polymrase ou transcrit primaire contient encore les introns et les exons, mais pas le promoteur. Aprs lexcision des introns et lpissage des exons, le messager ne contient plus que les exons runis en une seule squence codante.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
77/207
La transcription
4.18 Exon
BM 30/1 Les exons sont des fragments de squence primaire dun gne qui seront recopis dans la structure primaire du RNA messager, aprs lpissage. Il existe des exons de longueur trs variable : courts (34 nuclotides pour lexon 1 de lapoAII) longs (7572 nuclotides pour lexon 26 de lapoB). Un exon code le plus souvent pour un domaine fonctionnel de la protine ou une partie dun tel domaine, de sorte que les protines des eucaryotes formes de plusieurs domaines, sont codes par des gnes possdant au moins autant dexons. Au cours de lvolution le gne peut tre modifi par la substitution, linsertion ou la dltion dun exon entier (conversion de gnes) ce qui modifie, apporte ou retire la protine un domaine fonctionnel en entier.
78/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.19 Exon 1
BM 31 Aprs la fixation de la RNA-polymrase sur la bote TATA par lintermdiaire du facteur TFIID, la transcription va commencer 23 nuclotides au del de cette bote. A ce point, la squence du brin sens est 5AGGCACAGA...3, celle du brin antisens est donc 3TCCGTGTCT...5 (complmentaire et antiparallle). En choisissant comme substrats les ribonuclotides complmentaires de ce brin antisens, la RNA-polymrase va composer 5AGGCACAGA...3 qui sera le dbut de la squence du RNA transcrit. Lorsque la polymrase rencontre un A sur le brin antisens, elle incorpore un nuclotide Uracile dans le mRNA : 5...GCUGGCUAG...3. La squence du RNA transcrit recopie donc celle du brin sens du DNA. La transcription se poursuit alors tout au long du brin antisens en incorporant 1329 nuclotides dans le RNA transcrit de lapoA-II.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
79/207
La transcription
4.20 Fin de la transcription
BM 32 La transcription du gne de lapoA-II se poursuit donc durant 1329 nuclotides. Vers la fin du gne des facteurs lis la RNA-polymrase reconnaissent sur le brin antisens une squence 3-TTATTT-5 suivie dans la plupart des gnes dun autre signal 3-ATACAAAC-5 qui librent la RNA polymrase. La transcription sarrte en effet peu aprs le premier signal et la fin du transcrit scrit 5-AAUAAAUGCUGAAUGAAUCC-3OH. La RNA-polymrase ayant libr le DNA et le transcrit primaire qui contient la copie de linformation gntique qui va permettre lexpression du gne sous forme de protine.
80/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.21 Modifications du transcrit
BM 33 Chapeau : une enzyme ajoute un nuclotide Guanine sur les phosphates du Carbone 5 du premier nuclotide du transcrit et transfre des radicaux mthyl sur les premiers nuclotides. Ces modifications font un dbut commun tous les transcrits primaires, prcurseurs des RNA messagers. Queue poly-A : une enzyme coupe le transcrit environ 10 20 nuclotides au del de la squence AAUAAA et synthtise sur le Carbone 3 libre du dernier nuclotide du transcrit restant une longue chane de 500 2000 nuclotides Adnine polycondenss. Edition : Des enzymes peuvent diter (au sens anglais du terme) la structure primaire du transcrit en modifiant certaines bases (exemple : CU par une cytosine dsaminase spcifique dans les apolipoprotines B). Excision - pissage : les parties non codantes de la structure primaire du transcrit sont coupes et les parties codantes rassembles.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
81/207
La transcription
4.22 Enzyme coiffante
BM 33/1 Lorsque llongation du transcrit primaire commence, lextrmit COOH terminale de la polymrase est phosphoryle. Cette phosphorylation permet de librer les protines du complexe dinitiation et de commencer aussitt les modifications sur la partie du RNA qui est dj transcrite. Pour ajouter la coiffe, un complexe multienzymatique exerce trois activits : 1. 2. 3. lhydrolyse du phosphate du nuclotide 5 terminal du transcrit primaire le transfert sur le phosphate restant dun guanylate partir dun GTP la mthylation de ce guanylate sur lazote n7.
Les deux premires activits sont catalyses par une protine de 68 kDa et la mthylation par une autre sous-unit de 57 kDa.
82/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.23 Coiffe dun messager
BM 33/2 Les RNA messagers sont dtruits par des ribonuclases dans le cytoplasme. Leur hydrolyse libre des nuclotides qui seront remploys la synthse de nouveaux acides nucliques. Pour protger les RNA messagers de ce catabolisme, une structure particulire dissimule lextrmit 5 terminale de ces RNA aux exonuclases spcifiques de cette partie du RNA. Cette structure est appele coiffe du messager (cap). Au minimum, il y a fixation dun GMP sur le deuxime phosphate du nucloside triphosphate qui se trouve lextrmit 5 du transcrit. Ce GMP est mthyl sur son azote n7. Si le nuclotide initial comprend une adnine celle-ci peut tre mthyle sur lazote n6. Les riboses des nuclotides initiaux sont quelquefois mthyls sur loxygne de la fonction alcool en 2.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
83/207
La transcription
4.24 Queue polyA
BM 33/3 Des signaux de fin de transcription se retrouvent la fin de la plupart des gnes des Mammifres : TATGTTTC. A la lecture de ces signaux la RNA polymrase II sarrte de transcrire et quitte le DNA en librant le transcrit primaire. Aussitt une endonuclase coupe la fin du transcrit environ une quinzaine de nuclotides aprs un autre signal : AAUAAA dit bote de polyadnylation (ou bote polyA). Sur lextrmit 3OH de cette coupure, une polyA polymrase va condenser un grand nombre de nuclotides, tous adnine. Le transcrit primaire se trouve allong dune queue poly(A) de plus de mille nuclotides. Cette queue polyA est indispensable la maturation et lactivit du RNA messager qui la porte. Elle sera lentement digre par les exonuclases du cytoplasme lorsque le messager sera actif. Lorsquelle sera rduite quelques centaines de nuclotides le messager vieilli sera dtruit totalement pour tre remplac par un messager neuf.
84/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.25 Le transcrit primaire
BM 34 Le transcrit primaire de lapoA-II contenait donc 1329 nuclotides. Il a reu une coiffe (cap), GMP mthyl qui se fixe sur le phosphate de lATP en 5 du transcrit primaire. Il reoit une queue poly-A synthtise en 3 aprs la fin du transcrit. Trois introns vont tre exciss : ils seront reconnus par un site donneur GU en 5 de chaque intron, suivi dune squence riche en purines un site receveur AG en 3 de chaque intron, prcd dune squence riche en pyrimidines.
Aprs cette maturation le transcrit primaire devenu RNA messager sera transport vers le cytoplasme pour la traduction.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
85/207
La transcription
4.26 Excision - pissage
BM 35 Les introns, parties non codantes des gnes des eucaryotes, sont coups (excision) de la structure primaire des RNA au cours de la maturation des messagers. Les exons, parties codantes, sont ensuite lis entre eux bout bout (pissage), pour tablir la squence primaire du RNA messager. Lexcision et lpissage reprsentent donc laction denzymes et de ribozymes qui catalysent la coupure du RNA (endoribonuclase) et la fermeture de la brche (RNA ligase). Lpissage peut tre alternatif, cest dire peut conduire plusieurs structures de RNAm : les RNAm alternatifs ont chacun en propre certains exons ainsi que des exons en commun.
86/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.27 Formation du lasso
BM 36 Lexcision des introns et lpissage des exons est ltape la plus importante de la maturation du transcrit dans le noyau cellulaire. Elle fait appel des facteurs spcifiques : ribonucloprotines contenant des petits RNA (snRNP), ribozymes (RNA ayant des proprits catalytiques), enzymes spcifiques (maturases)... La structure secondaire du transcrit met en contact trois squences de lintron : la squence du dbut de lintron (extrmit 5 ou site donneur), la squence de la fin de lintron (extrmit 3 ou site accepteur) et un nuclotide adnine (A du branchement) environ 40 nuclotides avant le site receveur. Le site donneur commence habituellement par un nuclotide guanine dont le phosphate est dtach de lexon prcdent pour tre transfr sur le carbone 2 de lA du branchement. Le dernier nuclotide du site accepteur, aussi une guanine, est dtach de lexon suivant, dont le premier nuclotide est li par son phosphate 5 au carbone 3 du dernier nuclotide de lexon prcdent. Lintron, libr sous forme de lasso, est dtruit par des nuclases. Le transcrit perd successivement tous ses introns et les exons pisss constituent la squence codante du messager.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
87/207
La transcription
4.28 Epissages alternatifs
BM 36/1 Du fait de la prsence de protines rgulatrices sur le transcrit primaire, lpissage peut quelquefois se faire de faon diffrente dune cellule lautre. Il est possible de garder alternativement soit lexon 3 soit lexon 4 du gne de la troponine T (exemple n2). Si lexon 3 est conserv on obtient l-troponine T et si lexon 4 est conserv on obtient la -troponine T. Cet pissage alternatif est lorigine de nombreuses protines isoformes. Il est aussi possible (exemple n1) de faire dpendre lexpression dun gne de deux promoteurs diffrents, rpondant des rgulations diffrentes. Chacun de ces promoteurs est li un exon 1 ou 1bis qui seront pisss alternativement avec la suite du transcrit. On peut encore (exemple n3) avoir plusieurs exons la fin du gne contenant des codons Stop en phase. Dans ce cas lpissage alternatif donnera des protines de longueurs diffrentes.
88/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.29 Maturation des RNA ribosomiques
BM 36/2 Pour transcrire les RNA des ribosomes, la RNA polymrase I synthtise un transcrit primaire de 13000 nuclotides (nt), et la RNA polymrase III synthtise le petit rRNA 5 S de 120 nt. La maturation du transcrit primaire prcurseur des rRNA se fait par excision de trois fragments : le rRNA 28 S de 4718 nt, le 18 S de 1874 nt et le 5,8 S de 160 nt. Les rRNA 28 S, 5,8 S et 5 S vont sassocier avec 49 protines pour former la grande sous particule. Le rRNA 18 S formera la petite sous-particule avec 33 protines.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
89/207
La transcription
4.30 Stabilit du messager
BM 36/3 Lacide ribonuclique messager est une copie de travail du gne destin diriger la traduction catalyse par les ribosomes. Son extrmit 5-phosphate est protge par la coiffe sans laquelle le RNA est dgrad ds la transcription par des 5 exonuclases. Son extrmit 3-OH est constitue dune longue queue poly(A) qui est lentement digre par des 3 exonuclases. Lorsque cette hydrolyse est avance, le messager est alors inapte la traduction et sera dtruit par les endonuclases. Les messagers qui portent peu de ribosomes (parce que linitiation de la traduction est ralentie ou inhibe) sont dtruits directement par les endonuclases. Certains messagers ont une dure de vie courte : beaucoup de ceux qui interviennent dans les mcanismes post-prandiaux (aprs les repas) ont une dure de vie de lordre de 2 heures et doivent tre entirement resynthtiss chaque repas. Dautres messagers, dans le systme nerveux central par exemple, sont compltement stables durant des annes.
90/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La transcription
4.31 Messager
BM 37 Le RNA messager comprend plusieurs squences : une squence 5 non-codante, qui ne sera pas traduite, qui correspond lexon 1 et une partie de lexon 2 dans le gne de lapoA-II ; un codon AUG qui fixe le tRNA de la mthionine initiale ; des squences de codons pour incorporer les acides amins du signal-peptide (en vert) et du propeptide (souligne) ; la squence des codons dont les acides amins formeront la squence primaire de la protine ; le codon de terminaison (ici, UGA) ; une squence 3 non-traduite qui sachve par la queue poly-A.
Sur la squence 5 non-traduite, va se construire le complexe dinitiation de la traduction o les ribosomes vont sassembler successivement pour commencer la traduction.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
91/207
La transcription
92/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
Chapitre 5 La traduction
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
93/207
La traduction
5.1 Traduction
BM 38 Lexpression du gnome aboutit la synthse dans les cellules de macromolcules acides nucliques et protines, dont la structure primaire est dtermine par celle du DNA. Cette expression se fait par deux mcanismes principaux : la structure primaire du DNA sexprime dabord par la synthse dacides ribonucliques dont la structure primaire est parallle celle du DNA. Cest la transcription. la structure transcrite sur certains RNA, dits messagers , sexprime enfin par la synthse de protines dont la structure primaire traduit en acides amins linformation porte par la structure primaire du DNA. Cest la traduction. soit pour librer des protines cytoplasmiques, soit pour conduire ces protines dans les membranes ou les organites de la cellule (reticulum endoplasmique, appareil de Golgi, membrane plasmique, lysosomes, mitochondries, noyau, etc...), soit pour excrter ces protines travers les membranes vers lextrieur de la cellule.
La traduction est faite dans le cytoplasme des cellules :
94/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.2 Expression dun gne
BM 23/1 Lexpression dun gne est une suite de synthses chimiques et de ractions aboutissant la production dun acide ribonuclique ou dune protine. Dans un premier temps a lieu la synthse dun acide ribonuclique, dont la squence est complmentaire dun des deux brins du gne donc identique celle de lautre brin : cest la transcription. La squence de lacide ribonuclique est identique celle du brin sens et oriente dans le mme sens. Elle se construit de 5 vers 3 en complmentarit de celle qui est lue sur le brin antisens. Aprs des ractions de maturation le transcrit primaire (RNA) devient RNA messager (mRNA) et sort du noyau vers le cytoplasme. Dans le second temps, le RNA messager est lu par groupe de trois nuclotides (lettres) grce un RNA complmentaire qui porte lacide amin correspondant. La lecture du mRNA se fait de 5 vers 3 et la synthse de la protine se fait en mme temps de lextrmit NH2 terminale vers lextrmit COOH terminale. Aprs des ractions de maturation, la protine mature est prte remplir sa fonction dans la cellule.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
95/207
La traduction
5.3 Signifiants
BM 39 Le langage nuclique scrit avec 4 lettres. Le langage protine scrit avec 20 termes correspondant aux 20 acides amins, plus des ponctuations de dbut et de fin de message. Si une lettre nuclique se traduisait par un acide amin, il ne pourrait y avoir que 4 acides amins. En groupant les lettres nucliques en mots de 2 lettres on pourrait avoir 16 mots, mais cela ne permettrait de coder que 16 acides amins. En groupant les lettres nucliques en mots de 3 lettres on peut avoir 64 mots, ce qui permet dexprimer les 20 acides amins et des ponctuations. Le code gntique est donc fond sur des mots de trois lettres : les codons. Il y a plus de codons dans le code gntique que dacides amins et de ponctuations dans les protines, il y aura donc plusieurs codons traduits par le mme acide amin (homonymes). Ces homonymies reprsentent une perte dinformation entre le langage nuclique (64 signifiants) et le langage protique (21 signifiants), cest pour cela quon dit que le code gntique est dgnr.
96/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.4 Codon
BM 39/1 La liaison de lacide ribonuclique de transfert (tRNA) avec lacide ribonuclique messager (mRNA) porteur de linformation, se fait par complmentarit entre 3 nuclotides de chacun de ces deux RNA. Les 3 nuclotides du mRNA constituent un codon et les 3 nuclotides du tRNA un anticodon. Au cours de la traduction lanticodon et le codon se lient de manire antiparallle, et lacide amin port par le tRNA est incorpor la protine en cours de synthse. La squence primaire du mRNA est donc traduite par groupes de 3 nuclotides (codons). Un nuclotide du mRNA au cours de la traduction peut se trouver en position 1, 2 ou 3 dans un codon si le nombre de nuclotides qui le sparent du codon dinitiation AUG est ou nest pas un multiple de 3. Cette position porte le nom de cadre de lecture.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
97/207
La traduction
5.5 Code gntique
BM 40 La squence codante est une suite de codons dont chacun permet dincorporer spcifiquement un acide amin dans la synthse dune protine. Le code gntique est le mme pour tous les tres vivants de la biosphre (universel). Il existe quelques variations (codons propres la biosynthse des protines dans les mitochondries). Le code gntique comporte 61 codons pour signifier les 20 acides amins qui participent la synthse des protines : chaque acide amin peut tre cod par plusieurs codons (de un six) qui diffrent en gnral par leur troisime nuclotide. On dit que le code est dgnr.
98/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.6 Code gntique
BM 40/1 Le code gntique est le fruit dune longue volution et sa disposition nest pas due au hasard. Les correspondances entre les codons et les acides amins ont t slectionnes pour que les changements de bases aient le moins deffet possible sur la protine exprime. Ainsi, tous les codons dont la deuxime lettre est un U correspondent des acides amins hydrophobes, donc ayant des proprits physiques proches. De mme, les acides amins acides correspondent aux codons commenant par GA, de telle sorte que le changement de la troisime base ne fera pas disparatre la charge anionique du radical. Le codon le plus proche des codons Stop est celui du tryptophane. Un changement de chacun ou des deux G engendre un codon Stop et donc un arrt de la traduction. Mais ce codon correspond lacide amin le plus rare des protines habituellement traduites.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
99/207
La traduction
5.7 Code dgnr
BM 40/2 En crivant le code gntique dans lautre sens, de lacide amin vers les codons, on montre que beaucoup dacides amins ont des codons homonymes. Certains ont six codons diffrents, dautres quatre, trois ou deux. Ces codons homonymes ne sont pas employs au hasard parce que les tRNA correspondants nexistent pas dans toutes les cellules aux mmes concentrations. De sorte que certains codons auront moins de chances de sexprimer dans les tissus o le tRNA correspondant est rare. Il existe de nombreux tRNA dont lanticodon ne se lie pas de faon spcifique avec la troisime base du codon. Cette base est donc reconnue moins spcifiquement ou pas du tout, ce qui explique la dgnrescence habituelle de cette troisime lettre.
100/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.8 Ribosome eucaryote
BM 41 Les ribosomes du cytoplasme des cellules eucaryotes sont des complexes multienzymatiques qui associent 82 chanes dacides amins et 4 acides ribonucliques. Ces molcules sont associes entre elles pour former deux particules distinctes : la sous-unit 60S (Large = 2800000 daltons) et la sous-unit 40S (Small = 1400000 daltons) qui peuvent se dissocier facilement. Les acides ribonucliques ribosomiaux et les protines ont des sites de fixation pour la squence du messager, pour les RNA de transfert qui portent lacide amin incorporer (site A) et le peptide en cours de synthse (site P), un site catalytique pour former les liaisons peptidiques, des sites de fixation pour les cofacteurs protiques de linitiation (eIF2, eIF3), de llongation et de la terminaison et des sites de rgulation (protine S6).
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
101/207
La traduction
5.9 Polyribosome
BM 42/1 Sur le mme messager plusieurs ribosomes effectuent la traduction de la mme protine les uns aprs les autres : le tout constitue un polyribosome. Linitiation est un phnomne permanent lextrmit 5 dun RNA messager et les ribosomes se succdent sur le messager raison dun tous les 100 nuclotides environ. Le premier acide amin incorpor constitue lextrmit NH2 terminale de la protine. A lextrmit 3, en arrivant au codon de terminaison, les sous-particules du ribosome se sparent et librent la protine synthtise. Le dernier acide amin incorpor constitue lextrmit COOH terminale de la protine. Les polyribosomes prsentent un aspect diffrent selon la rgulation des diffrentes tapes de la traduction. Plus linitiation est active plus les ribosomes sont nombreux sur le messager. Si llongation est lente, les ribosomes vont mettre plus de temps lire la squence codante. Une activation brutale de la terminaison dissocie tous les ribosomes du messager. De nombreux antibiotiques sont capables dinterfrer avec chacune des tapes de la synthse des protines (streptomycine, cycloheximide, puromycine).
102/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.10 RNA de transfert (trfle)
BM 43 Les RNA de transfert constituent le lien chimique ncessaire entre la structure du codon, reconnu par lanticodon, et lacide amin spcifique port par le tRNA. Cest en quelque sorte le dictionnaire de la traduction. Lanticodon est une squence de trois nuclotides situe lextrmit de la boucle infrieure du tRNA, complmentaire et antiparallle de la squence du codon de lacide amin correspondant. Chaque acide amin est li spcifiquement (code gntique) par une amino-acyl-tRNA-synthtase lextrmit 3 du tRNA dont lanticodon lui correspond (tRNA charg). Les ribosomes lient les tRNA chargs sur le site A de llongation si leur anticodon sapparie avec le codon du messager cet endroit. Llongation transfre alors le peptide sur lacide amin nouveau, lui-mme port par le RNA de transfert.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
103/207
La traduction
5.11 RNA de transfert (ruban)
BM 43/1 Lanalyse cristallographique des RNA de transfert a montr que les extrmits des deux bras, boucle des dihydrouraciles et boucle GTCG, se referment lune sur lautre en changeant des liaisons hydrogne. En sorte que dans ce modle le RNA de transfert affecte une forme en L o seuls le bras de lanticodon et le bras accepteur de lacide amin sont aux extrmits de la molcule.
104/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.12 Activation dun acide amin
BM 44 Les acides amins libres du cytoplasme sont les substrats de la synthse des protines. Pour y participer ils doivent tre activs. Lactivation des acides amins est catalyse par des enzymes spcifiques : les aminoacyltRNA synthtases. Il en existe au moins une pour chacun des 20 acides amins. Ces enzymes ont une double spcificit : elles reconnaissent spcifiquement un acide amin et elles reconnaissent spcifiquement le tRNA non charg correspondant. Laminoacyl-tRNA synthtase hydrolyse un ATP en AMP (liaison riche en nergie) puis active lacide amin en liant sa fonction acide avec la fonction acide du phosphate de lAMP (liaison anhydride mixte riche en nergie). Le pyrophosphate est aussitt dtruit par une pyrophosphatase. Lacide amin ainsi activ est transfr ensuite avec sa liaison riche en nergie sur une des fonctions alcool secondaires du ribose de lAMP 3-terminal du tRNA. Le tRNA charg se lie ensuite au ribosome pour la synthse de la protine.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
105/207
La traduction
5.13 Srine tRNA synthtase
BM 44/1 Les aminoacide-tRNA-synthtases sont les enzymes qui chargent les acides amins libres du cytoplasme sur les RNA de transfert correspondants. Le coenzyme ATP est hydrolys en AMP et en pyrophosphate pour fournir lnergie ncessaire. La liaison ester constitue entre lacide amin et son tRNA est riche en nergie et sera hydrolyse au cours de ltape dlongation de la traduction. Les aminoacide-tRNA-synthtases ont une double spcificit trs troite pour les deux substrats : lacide amin reconnu (ici, la srine) et les tRNA dont les anticodons sont complmentaires des codons correspondant cet acide amin dans le code gntique. Lexactitude de la traduction repose entirement sur cette double spcificit. Les aminoacide-tRNA-synthtases sont en quelque sorte les auteurs du dictionnaire de la traduction. La reconnaissance du tRNA se fait par lanticodon dans certains cas (lenzyme ne tenant pas toujours compte de la premire base de lanticodon, ce qui explique la dgnrescence du code gntique) ou bien encore par dautres squences du tRNA communes aux tRNA synonymes. Certaines aminoacide-tRNA-synthtases sont rgules par phosphorylation.
106/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.14 Cystine tRNA synthtase
BM 44/2 Les aminoacide-tRNA-synthtases sont les enzymes qui chargent les acides amins libres du cytoplasme sur les RNA de transfert correspondants. Le coenzyme ATP est hydrolys en AMP et en pyrophosphate pour fournir lnergie ncessaire. La liaison ester constitue entre lacide amin et son tRNA est riche en nergie et sera hydrolyse au cours de ltape dlongation de la traduction. Les aminoacide-tRNA-synthtases ont une double spcificit trs troite pour les deux substrats : lacide amin reconnu (ici, la cystine) et les tRNA dont les anticodons sont complmentaires des codons correspondant cet acide amin dans le code gntique. Lexactitude de la traduction repose entirement sur cette double spcificit. Les aminoacide-tRNA-synthtases sont en quelque sorte les auteurs du dictionnaire de la traduction. La reconnaissance du tRNA se fait par lanticodon dans certains cas (lenzyme ne tenant pas toujours compte de la premire base de lanticodon, ce qui explique la dgnrescence du code gntique) ou bien encore par dautres squences du tRNA communes aux tRNA synonymes. Certaines aminoacide-tRNA-synthtases sont rgules par phosphorylation.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
107/207
La traduction
5.15 Initiation de la traduction
BM 45 Linitiation de la traduction est ltape limitante de la traduction. Les sous-units des ribosomes sont dissocies dans le cytoplasme. Une cascade dvnements va former un complexe dinitiation. Au repos, le facteur eIF2 (eucaryotic initiation factor 2 ) est porteur dun GDP, coenzyme quil a hydrolys au cours du cycle dune initiation prcdente. En prsence du facteur eIF2B, un nouveau GTP est substitu ce GDP. Le facteur eIF2 ainsi activ, peut alors lier le tRNA charg dune mthionine dont lanticodon est complmentaire du codon dinitiation (AUG) du messager. En prsence du cofacteur eIF4C, la petite sous-unit va fixer le facteur eIF3 et le facteur eIF2 activ qui porte le tRNA charg de la mthionine initiale. Lnergie de la formation de ce complexe a t fournie par lhydrolyse de la liaison riche en nergie du GTP port par le facteur eIF2. La squence 5 non traduite du RNA messager est reconnue par les cofacteurs eIF4A, eIF4B et eIF4F qui sy fixent. Grce lhydrolyse dun ATP pour fournir lnergie, le messager est alors transfr sur la petite sous-unit, en regard du site P, de faon hybrider les nuclotides du codon dinitiation avec ceux de lanticodon de le tRNA de la mthionine initiale. En prsence du dernier cofacteur eIF5, le complexe va se lier une grande sous-unit pour constituer un ribosome fonctionnel. Les cofacteurs dinitiation sont librs et la traduction commence. Le cofacteur eIF2 toujours porteur de son GDP, se libre pour recommencer un nouveau cycle dinitiation.
108/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.16 Cadre de lecture
BM 45/1 Le positionnement du messager par rapport au RNA de transfert de la Mthionine initiale dtermine le cadre de lecture de la traduction du messager. Le RNA de transfert de la mthionine occupe un des deux sites de fixation des tRNA sur le ribosome : site P (ou peptidique, car il contiendra le peptide en cours de synthse). Le codon AUG du messager, en shybridant dans le site P avec lanticodon CAU du RNA de transfert de la mthionine, place le messager de telle sorte que le codon suivant (N1N2N3) apparaisse dans lautre site de fixation : site A (ou acide amin, car il servira la fixation des nouveaux acides amins incorpors). Le nuclotide N1 sera toujours le premier de chaque codon.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
109/207
La traduction
5.17 Elongation de la traduction
BM 47 Les ribosomes initis ont leur site A vacant. Le facteur dlongation eEF1B catalyse lchange du GDP par un GTP sur le facteur eEF1A. Celui-ci, activ, va recevoir un tRNA charg quil viendra fixer sur ce site A, en hydrolysant le GTP en GDP. Ds que le codon du messager au fond du site A a pu se lier complmentairement avec lanticodon du tRNA apport, le facteur eEF1A est libr avec son GDP. Le ribosome catalyse alors le transfert du peptide situ sur le tRNA du site P sur la fonction amine de lacide amin du tRNA du site A. Il utilise pour cela, lnergie de lhydrolyse de la liaison ester riche en nergie entre le peptide et le tRNA du site P. Enfin, grce au facteur eEF2 et lhydrolyse dun autre GTP, le tRNA du site P est libr, le messager, le tRNA restant et le peptide en cours de synthse sont alors dplacs (translocation) du site A vers le site P, sans quil y ait de sparation entre le codon et lanticodon. Le site A est nouveau libre pour recevoir le tRNA de lacide amin suivant.
110/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.18 Incorporation dun acide amin
BM 47/1 Un tRNA charg vient se fixer sur le site A libre. Le codon du messager au fond du site A va se lier complmentairement avec lanticodon du tRNA du nouvel acide amin ce qui va permettre lincorporation de cet acide amin dans le peptide en cours de synthse.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
111/207
La traduction
5.19 Transfert du peptide
BM 47/2 Le ribosome catalyse alors le transfert du peptide situ sur le tRNA du site P sur la fonction amine de lacide amin du tRNA du site A. Il utilise pour cela, lnergie de lhydrolyse de la liaison ester riche en nergie entre le peptide et le tRNA du site P.
112/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.20 Translocation des codons
BM 47/3 Le tRNA libre du site peptidique quitte le ribosome. Le messager, le tRNA restant et le peptide en cours de synthse sont alors dplacs (translocation) du site A vers le site P, sans quil y ait fusion de lhybride entre le codon et lanticodon.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
113/207
La traduction
5.21 Liaisons riches en nergie
BM 47/4 Le bilan nergtique de la traduction dpend du nombre dacides amins de la protine synthtise. Pour chaque acide amin, on utilise dabord un ATP AMP pour la synthse du tRNA charg (aminoacyl-tRNA synthtase). LAMP produit est ractiv en ADP par un autre ATP (nucloside-P2 kinase). Lensemble quivaut la consommation de deux liaisons riches en nergie ATP ADP. Pour lincorporation de ce tRNA charg dans le site acide amin du ribosome, le facteur eEF1B utilise un GTP GDP. Pour la translocation du peptidyl-tRNA du site acide amin au site peptidique, le facteur eEF2 utilise encore un GTP GDP. En tout chaque acide amin incorpor dans la protine cote la cellule quatre liaisons riches en nergie.
114/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.22 Terminaison de la traduction
BM 48 Lorsque le site A se trouve en regard dun codon non-sens annonant la fin de la traduction, le complexe va se dissocier du messager en prsence dun dernier cofacteur eRF. Les deux sous-units du ribosome se dissocient, la protine synthtise est libre, ainsi que le dernier tRNA.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
115/207
La traduction
5.23 Signal-peptide
BM 50 Lorsquune protine est synthtise, sa structure secondaire ou tertiaire se construit au fur et mesure de la traduction et elle est libre dans le cytoplasme. Lorsque cette protine est destine tre incorpore dans les membranes ou les organites de la cellule, la partie codante du RNA messager commence par une squence de quelques acides amins qui sert dadresse pour lincorporation de cette protine dans la membrane. Ces peptides orientent la destine de la protine : incorporation dans les membranes (reticulum endoplasmique, appareil de Golgi, membrane plasmique, lysosomes...), entre dans les mitochondries, excrtion hors de la cellule via lappareil de Golgi, etc... Le signal-peptide est un peptide dadressage situ lextrmit NH2-terminale des protines excrter. Parce que sa fonction est de pntrer dans la membrane du reticulum endoplasmique, sa structure est riche en acides amins hydrophobes (Phe, Leu, Ile, Met, Val).
116/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.24 Polyribosomes lis
BM 51 Les polyribosomes qui se forment sur un messager comportant un signal peptide ont une volution lgrement diffrente. La traduction sarrte peu aprs la synthse du signal-peptide, ds que celui-ci apparat hors de la structure du ribosome et se lie avec la SRP (SRP = Signal Recognition Particle ), qui inhibe llongation. Pour que llongation puisse se poursuivre, il faut que la SRP soit reconnue spcifiquement par un rcepteur de la membrane du reticulum endoplasmique. Ds que cette liaison est tablie, le ribosome est li par la ribophorine, toujours dans la membrane du reticulum, prs dune protine qui ouvre un pore travers cette membrane. Le SRP cart, llongation va reprendre. Le peptide en cours de synthse est alors dirig travers cette membrane pour se dvelopper dans la lumire du reticulum endoplasmique. A la face interne de la membrane une endopeptidase spcifique va couper le signal peptide et la synthse se poursuivra jusqu la terminaison. La protine sera enfin incorpore dans une membrane ou exporte, travers lappareil de Golgi, vers lextrieur de la cellule. Ladressage des protines vers les mitochondries fait appel un autre type de peptide dadressage qui conduit les peptides traverser la membrane mitochondriale.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
117/207
La traduction
5.25 Carboxylation de lacide glutamique
BM 52/1 Lacide carboxyglutamique est un acide amin propre aux protines fixant le calcium : protines des os, protines de la coagulation du sang. Cet acide amin est cr par une modification post-traductionnelle de ces protines. Lenzyme qui effectue la carboxylation a pour coenzyme la vitamine K (ou naphtoquinone), aliment indispensable quon trouve dans les feuilles vertes. Cette vitamine K est un transporteur dhydrogne qui en soxydant, va retirer un hydrogne au carbone n4 dun acide glutamique, et transfrer cet endroit une molcule de gaz carbonique issue dun ion bicarbonate. La vitamine K oxyde doit tre rduite par une diaphorase NADH pour retrouver sa forme initiale avant de participer nouveau cette carboxylation. Les inhibiteurs de la rduction de la vitamine K (antivitamines K) vont empcher la raction de carboxylation, faute de vitamine K rduite, et par consquent empcher la coagulation du sang.
118/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La traduction
5.26 Modifications post-traductionnelles
BM 53 De nombreuses modifications chimiques se produisent aprs lincorporation des acides amins dans la structure primaire de la protine (traduction) ; on les appelle modifications posttraductionnelles. On distingue des modifications cotraductionnelles qui se produisent alors que la traduction se poursuit encore et que le peptide naissant est encore attach au ribosome qui la construit, des modifications post-traductionnelles proprement dites qui ont lieu dans la cellule, dans les organites ou hors de la cellule. On appelle protine mature la forme chimique dfinitive que la protine montrera au moment o elle remplira sa fonction dans lorganisme.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
119/207
La traduction
120/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rplication
Chapitre 6 La rplication
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
121/207
La rplication
6.1 Rplication
BM 54 Au cours de la vie de la cellule (cycle cellulaire, dune division mitotique la suivante), le DNA doit tre ddoubl pour que chaque cellule fille reoive un gnome complet dans son noyau. Cette synthse se produit la phase S (au milieu du cycle cellulaire) grce lactivit de la DNA-polymrase et . Dautres DNA-polymrases participent la rparation du DNA ls (DNA-polymrase ) ou la rplication du DNA mitochondrial (DNA-polymrase ).
122/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rplication
6.2 Le cycle cellulaire
BM 55 La vie de la cellule se droule entre deux mitoses. Chez les Mammifres, cette priode dure en moyenne 30 heures bien quil y ait des cellules dont la vie soit trs courte ou au contraire trs longue. Durant ces trente heures la cellule traverse quatre phases : la phase G1 o le gnome tant diplode, chaque gne est reprsent en deux exemplaires. La chromatine est accessible aux RNA-polymrases qui transcrivent les gnes en messagers, qui seront leur tour traduits. vers la moiti du cycle commence la rplication du DNA : les DNA-polymrases vont mettre environ 8 heures (phase S) pour recopier en double le DNA de chaque chromosome. Durant cette phase la transcription est inhibe. puis la cellule entre en phase G2 o chaque gne est reprsent en quatre exemplaires. La chromatine est nouveau accessible aux RNA-polymrases qui recommencent transcrire. enfin survient la mitose, qui donne naissance deux cellules filles. Chacune recevra une des copies identiques du DNA de chaque chromosome et chaque gne y sera reprsent en deux exemplaires.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
123/207
La rplication
6.3 Chromatine et ADN
BM 55/1 Au cours des phases du cycle cellulaires les chromosomes voluent pour prparer les mitoses. Pendant la phase G1 la chromatine est dcompacte et les gnes peuvent sexprimer. Chaque chromosome ne contient quune chromatide. Pendant la phase S, les bulles de rplication souvrent et la rplication commence. Pendant la phases G2 les deux chromatides issues de la rplication sont lis par leurs centromres : il y a deux chromatides par chromosome. Pendant la mitose le centromre se lie au fuseau achromatique et prpare la sparation. La chromatine est compacte au maximum. Aprs la mitose, la chromatine est dcompacte et les gnes peuvent sexprimer dans chacune des deux cellules filles.
124/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rplication
6.4 Rplication semi-conservative
BM 55/2 Les deux brins du DNA parental au cours de la rplication servent chacun de modle pour la synthse dun nouveau brin. De cette faon les deux brins, au lieu de rester ensemble chaque synthse (rplication conservative), se sparent toujours chaque cycle (rplication semi-conservative) A la premire gnration un brin de chaque double hlice provient de la cellule-mre. A la deuxime gnration il nexiste plus que deux brins de DNA de la cellule-mre pour quatre doubles hlices, etc...
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
125/207
La rplication
6.5 Synthse et hydrolyse du DNA
BM 55/3 La croissance des brins dacides nucliques se fait toujours par leur extrmit 3-OH terminale. La condensation se fait partir dun substrat activ : un des nuclosides triphosphates. La rupture dune liaison riche en nergie fournira lnergie ncessaire la condensation. Le nucloside monophosphate restant sera estrifi par une fonction acide de son phosphate sur la fonction alcool libre du carbone 3 du ribose qui constitue lextrmit de lacide nuclique. Le pyrophosphate rsultant de lhydrolyse des deux derniers phosphates sera lui-mme aussitt dtruit par une pyrophosphatase, de sorte que la condensation des nuclotides sera irrversible. Inversement, en ajoutant une molcule deau sur cette liaison ester, on provoquera une raction dhydrolyse qui dtachera le dernier nuclotide et librera le carbone 3 du nuclotide prcdent.
126/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rplication
6.6 DNA polymrase
BM 56 Les DNA-polymrases sont des enzymes du noyau cellulaire qui agissent en phase S du cycle pour doubler systmatiquement lensemble du gnome diplode. Dautres DNA polymrases interviennent dans la synthse des amorces RNA/DNA, dans la rplication du gnome mitochondrial ou dans la rparation du DNA. Elles ne peuvent dmarrer la condensation des nuclotides que sur la fonction alcool en 3 du ribose du dernier nuclotide dune amorce, nuclotide qui doit tre hybrid avec le nuclotide complmentaire qui sert de modle. Elles utilisent comme substrats des dsoxyribonuclosides triphosphates (dATP, dCTP, dGTP et dTTP) et des amorces de RNA et de DNA synthtises par une primase (RNA polymrase capable de synthtiser un brin de RNA complmentaire dun brin de DNA sur 10 nuclotides) suivie dune DNA polymrase (qui prolonge lamorce de RNA de 20 dsoxyribonuclotides environ). Elles synthtisent le DNA nouveau par fragments qui, aprs excision des amorces, sont lis entre eux par une DNA-ligase. Elles ont aussi une activit exonuclasique, qui leur permet en particulier dhydrolyser le dernier nuclotide en 3 du brin synthtis si celui-ci ne sapparie pas correctement avec le nuclotide complmentaire du brin modle.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
127/207
La rplication
6.7 DNA polymrase (exonuclase 35)
BM 56/1 Les DNA-polymrases sont des enzymes du noyau cellulaire qui agissent en phase S du cycle pour doubler systmatiquement lensemble du gnome diplode. Dautres DNA polymrases interviennent dans la synthse des amorces RNA/DNA, dans la rplication du gnome mitochondrial ou dans la rparation du DNA. Elles ne peuvent dmarrer la condensation des nuclotides que sur la fonction alcool en 3 du ribose du dernier nuclotide dune amorce, nuclotide qui doit tre hybrid avec le nuclotide complmentaire du brin modle. Elles utilisent comme substrats des dsoxyribonuclosides triphosphates (dATP, dCTP, dGTP et dTTP) et des amorces de RNA et de DNA synthtises par une primase (RNA polymrase capable de synthtiser un brin de RNA complmentaire dun brin de DNA sur 10 nuclotides) suivie dune DNA polymrase (qui prolonge lamorce de RNA de 20 dsoxyribonuclotides environ). Elles synthtisent le DNA nouveau par fragments qui, aprs excision des amorces, sont lis entre eux par une DNA-ligase. Elles ont aussi une activit exonuclasique, qui leur permet en particulier dhydrolyser le dernier nuclotide en 3 du brin synthtis si celui-ci ne sapparie pas correctement avec le nuclotide complmentaire du brin modle.
128/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rplication
6.8 DNA polymrase : fonction ddition
BM 56/2 Les DNA polymrases ont la fois une activit de polymrase pour ajouter des nuclotides au nouveau brin de DNA, et une activit de 35 exonuclase pour hydrolyser le dernier nuclotide incorpor. Si le nuclotide incorpor est complmentaire du nuclotide du brin modle et donc que lhybridation des bases se fait normalement, lactivit de polymrase est plus rapide que celle dexonuclase et le nuclotide suivant va tre incorpor. Si le nuclotide incorpor nest pas complmentaire du nuclotide du brin modle et donc quil y a msappariement, lactivit dexonuclase est plus rapide que celle de polymrase et ce nuclotide sera hydrolys.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
129/207
La rplication
6.9 Boucle de rplication
BM 57 Les DNA-polymrases commencent leur synthse en de nombreux points dinitiation. Suite la liaison de protines spcifiques, la double hlice souvre pour permettre le dmarrage. La synthse de DNA commence sur des amorces de RNA/DNA constitues par la primase et la DNA polymrase a. La rplication se poursuit dans une direction : dans ce sens lun des deux brins du DNA (brin direct ) est parcouru par lenzyme dans le sens 3 5 ce qui permet la synthse dun autre brin dans le sens 5 3. Les DNA-ligases assurent ensuite la liaison entre les diffrents fragments du DNA nouveau. La synthse de lautre brin (brin retard ) est plus complexe parce que lenzyme parcourt ce brin de 5 3. La primase et la DNA polymrase synthtisent des amorces de 30 nuclotides en avant de la zone de rplication, et la DNA polymerase construit la suite de petits fragments de DNA dans le sens 5 3 (environ 200 nuclotides ; fragments dOkazaki). Des ribonuclases dtruisent les amorces de RNA/DNA du fragment prcdent et les fragments sont ensuite relis entre eux par la DNA-ligase. Il existe une dizaine disoenzymes de DNA polymrases chez les eucaryotes. La DNA polymrase , associe la primase est responsable de la synthse des amorces. La DNA polymrase est la principale enzyme de la rplication en synthtisant sur le brin direct aussi bien que sur le brin retard. Les autres DNA polymrases interviennent dans la synthse du DNA mitochondrial ou dans les processus de rparation du DNA gnomique.
130/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rplication
6.10 Fourche de rplication
BM 57/1 La rplication commence par la sparation des deux brins du DNA par lhlicase. Chacun des deux brins est stabilis par des protines SSB (single strand bound ). Sur le brin direct, en remontant de 3 vers 5, une DNA polymrase synthtise un brin complmentaire en ajoutant des dsoxyribonuclosides triphosphates lextrmit 3OH libre. Une nouvelle double hlice se forme entre le brin modle direct et le nouveau brin synthtis. Sur le brin retard, une DNA polymrase progresse de 5 vers 3. Pour pouvoir synthtiser un brin complmentaire, il faut que la primase et la DNA polymrase fabriquent des amorces assez rapproches (amorce 3 sur limage) quelques centaines de nuclotides de distance sur le brin modle au fur et mesure que celui-ci est dtach du brin direct. A partir de lextrmit 3OH dune amorce (amorce 2 de limage) la DNA polymrase synthtise un fragment dOkazaki jusqu ce quelle rencontre lextrmit 5-triphosphate de lamorce prcdente (amorce 1 sur limage). Cette dernire est hydrolyse par une nuclase, ce qui permet la DNA polymrase dachever la synthse du fragment dOkazaki que la DNA ligase va lier dfinitivement avec le DNA du fragment prcdent. Une nouvelle double hlice se forme entre le brin modle direct et le nouveau brin synthtis. Toutes ces protines sont associes en une structure du noyau (usine rplication) que traversent les molcules de DNA. Cette usine rplication comprend aussi des enzymes de prparation des substrats : nuclotide kinases, ribonuclotide rductase, etc...
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
131/207
La rplication
6.11 Topoisomrase I
BM 58/1 La rplication ou la transcription du DNA ncessite une fusion partielle de la double hlice et modifie lenroulement des deux brins. Afin de permettre ces ractions, la topoisomrase est capable de modifier lenroulement en hydrolysant un brin du DNA et en le reconstituant aprs avoir fait le tour de lautre brin. Aprs cette opration, la torsion de la double hlice tend se rapprocher de la valeur normale : pas de lhlice = 10 paires de nuclotides par tour. Au cours de la rplication et de la traduction le pas de lhlice diminue en avant des polymrases et lhlicase (une des topoisomrases) travaille alors pour augmenter le pas. Au contraire en arrire des polymrases les topoisomrases ajoutent des tours pour reconstituer la double hlice.
132/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rplication
6.12 Primase
BM 58/2 La DNA polymrase , enzyme principale de la rplication chez les eucaryotes, ncessite de dmarrer son action lextrmit 3OH terminale dun brin de DNA dont le dernier nuclotide soit hybrid avec le brin de DNA servant de modle. Si ce nuclotide nest pas appari, elle lhydrolysera au lieu de pour suivre la synthse. Cest pourquoi elle ne peut pas dmarrer une synthse de DNA sans amorce. Lamorce est cre au dpart par une RNA polymrase particulire (sans rapport avec celles de la transcription) qui peut commencer sur environ 10 nuclotides la synthse dun RNA hybrid avec le DNA modle. Le premier ribonuclotide de cette amorce garde ses 3 phosphates. Au bout de 10 ribonuclotides, une DNA polymrase prend le relai et poursuit la condensation de 20 dsoxyribonuclotides. Lamorce sera donc constitue dun brin mixte comprenant RNA puis DNA sur 30 nuclotides environ. Le dernier dsoxyribonuclotide de lamorce, li avec le brin de DNA qui sert de modle, servira de point dinitiation lactivit de la DNA polymrase .
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
133/207
La rplication
6.13 DNA ligase
BM 58/3 Les DNA ligases sont des enzymes qui sont capables de reconstituer la liaison phosphoester entre le carbone 3-OH et le phosphate-5 de deux nuclotides voisins sur un brin de DNA. Elles interviennent dans la rplication pour lier ensemble les brins de DNA ou les fragments dOkazaki synthtiss par les DNA polymrases. Elles interviennent aussi dans de nombreux processus de rparation du DNA gnomique.
134/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rplication
6.14 Tlomrase
BM 58/4 La synthse du brin retard du DNA ne peut pas se faire lorsque la DNA polymrase atteint lextrmit 3 du brin modle, faute de place pour une amorce complmentaire. Sil ny avait pas de mcanisme particulier, chaque rplication le DNA du chromosome serait raccourci. Le tlomre ou squence du DNA lextrmit des chromosomes humains est une squence 5-TTAGGG-3 rpte quelques centaines de fois avant le 3OH final. La tlomrase est une DNA polymrase qui peut continuer la synthse dun DNA simple brin. Cette enzyme comprend un RNA de 450 nuclotides dont lextrmit 5 terminale est 5CUAACCCUAAC... Cette extrmit sert de modle pour lenzyme en vue de la synthse de quelques units de la rptition TTAGGG. Aprs cette synthse lenzyme glisse le long du brin de DNA et recommence de nouvelles units. Lextrmit 3 du brin modle ainsi allonge peut servir la pose dune amorce nouvelle : lextrmit 3-OH de cette amorce sert alors de point de dpart pour la DNA polymrase pour synthtiser lautre brin.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
135/207
La rplication
136/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rparation
Chapitre 7 La rparation
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
137/207
La rparation
7.1 Rparation
BM 59 La rplication ou la conservation de la structure primaire du DNA peuvent ntre pas parfaites. Lorsque le DNA est endommag ou rpliqu de faon incorrecte, il en rsulte que les nuclotides situs sur les deux brins ne sont plus complmentaires (A-T ou C-G). On dit quil y a msappariement entre les nuclotides. La rparation vise remplacer une base azote, ou un nuclotides ou un fragment dacide nuclique par des nuclotides complmentaires de la squence de lautre brin. La rplication tant semi-conservative, lun des deux brins est identifi en tant que matrice et cest lautre brin qui sera rpar en cas de msappariement. Plusieurs mcanismes de rparation permettent respectivement de remplacer une base, un nuclotide ou un fragment plus ou moins long dun brin de DNA.
138/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rparation
7.2 Systmes de rparation du DNA
BM 59/1 Il existe chez lHomme de nombreux systmes enzymatiques pour rparer le DNA. Ces systmes sont dautant plus complexes que la lsion est importante. De nombreuses enzymes appartiennent spcifiquement ces systmes de rparation, comme la DNA polymrase , par exemple. La rparation dune hydrolyse accidentelle dune liaison phosphodiester sur un brin de DNA fait intervenir la DNA ligase seule si une des extrmits est 5 phosphate. Les bases endommages ou anormales sont enleves du nuclotide qui les porte, puis le sucre et le phosphate sont retirs avant que le brin ne soit reconstitu par la DNA polymrase et la DNA ligase. Les msappariements ne peuvent tre reconnus puisque les bases sont normales. La squence du brin nouvellement synthtise est reconnue puis le nuclotide non complmentaire est remplac. La rparation dun dommage portant sur les deux brins du DNA doit faire appel une squence homologue du gnome et se fait par recombinaison.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
139/207
La rparation
7.3 Bases endommages
BM 60 La nature chimique des bases azotes est essentielle pour le message gntique. De nombreuses modifications de ces bases peuvent entraner des mutations. Des modifications chimiques (nitrites) comme la dsamination des adnines en hypoxanthines. Or, lhypoxanthine est prfrentiellement complmentaire de C plutt que de T. De mme la mthylation des cytosines en 5-mthyl cytosine qui est le complment de A plutt que de G. Des mutations rsultent de liaisons anormales entre les bases de nuclotides voisins, comme les dimres de thymine. La chaleur engendre des ractions dhydrolyse des bases, surtout des purines, aboutissant des sites sans bases ou des sites apuriniques (sans purines) Des agents chimiques de lenvironnement peuvent tre mutagnes. Ainsi il y a des analogues structuraux des bases qui donnent des nuclotides anormaux comme le 5-bromouracile qui shybride prfrentiellement avec les guanines ou la 2-aminopurine qui se lie aux cytosines. Certains agents mutagnes comme la 2-mthyl nitrosamine ragissent avec les bases en ajoutant des radicaux (alkylations) ou en sintercalant entre les bases au sein de la double hlice (bromure dthidium).
140/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rparation
7.4 Excision de base
BM 60/1 Devant une base endommage, la rparation peut tre faite par une simple excision de base suivie du remplacement de la base par un nuclotide normal. Lexcision est faite par une DNA glycosylase qui ouvre la double hlice, puis hydrolyse la liaison N-glycosidique de la base endommage et laisse un nuclotide apurinique (dpourvu de base). La rparation sera faite par une des DNA polymrases de rparation : la DNA polymrase qui hydrolyse le nuclotide apurinique, puis le remplace par le nuclotide attendu sur lextrmit 3OH libre et la brche sera referme par la DNA ligase qui reconstitue la liaison phosphodiester en 3 du nuclotide ajout.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
141/207
La rparation
7.5 Msappariements
BM 61 Certaines bases azotes du DNA existent sous plusieurs formes tautomres rsultant du dplacement inconstant des hydrognes des fonctions amine ou nol. Ces formes sont plus rares que les formes habituelles des bases azotes mais dans un DNA modle en cours de rplication certaines bases peuvent tre momentanment sous une forme tautomre. La forme tautomre de ladnine est limino-adnine, qui ne shybride pas avec la thymine mais avec la cytosine. De mme lnol-thymine shybride mieux avec la guanine au lieu de ladnine et lnol-guanine se lie avec la thymine plutt quavec la cytosine. Ainsi la DNA polymrase va condenser sur le DNA quelle construit des bases azotes diffrentes de celles attendues. Lorsque la base azote du brin modle aura repris sa forme habituelle elle ne pourra plus shybrider avec la base du brin nouveau et il en rsultera des msappariements.
142/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rparation
7.6 Transmission du msappariement
BM 61/1 Un msappariement fait apparatre deux nuclotides non complmentaires la mme position sur les brins du DNA. Chacun des deux brins au cours de la mitose suivante se rpliquera en produisant un nuclotide complmentaire. Le nuclotide anormal engendrera une transition permanente dans une des deux cellules filles. Ici nous avons sur les brins parentaux une paire de nuclotides A=T. A la gnration suivante le brin qui porte le A, par suite dune iminisation, produit un brin complmentaire avec un C la place du T attendu (C=A). Dans lautre cellule la squence est normale (T=A). A partir de l, toutes les cellules dont le DNA a t rpliqu partir du brin porteur de la substitution auront ce niveau une paire CG. La substitution est devenue permanente. Si elle est situe dans un gne, elle peut engendrer une mutation.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
143/207
La rparation
7.7 Excision de fragment long
BM 61/3 Lorsquun fragment de DNA est endommag, la simple excision de base ne suffit plus rparer. En particulier les msappariements qui ne seraient pas rpars par la DNA polymrase au cours de la rplication, sont immdiatement reprs parce que la double hlice ne se forme pas normalement. Une endonuclase coupe alors le brin porteur de la lsion une distance de cinq nuclotides. Puis sous leffet dune topoisomrase (hlicase ou facteur TFIIH) le brin ls est spar du brin sain. A partir de lextrmit 3OH de la brche ainsi cre, une DNA polymrase reconstitue le fragment complmentaire et la dernire liaison sera referme par la DNA ligase.
144/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rparation
7.8 Modle Holliday
BM 62 Louverture dune brche dans un brin de DNA et le droulement de la double hlice permet des fragments de DNA simple brin de shybrider de faon anormale. Lexistence de squences homologues sur lautre chromosome de la mme paire peut conduire ce brin libre shybrider avec la squence complmentaire du chromosome homologue (1). Dans ce cas les brches au bout des deux brins changs peuvent tre refermes par la DNA ligase (2). Une telle structure avec entrecroisement de brins de deux DNA homologues est appele structure Holliday (du nom de son dcouvreur en 1964). Cette structure est mobile et lchange peut se propager par glissement de la structure le long des deux hlices en allant dans le mme sens (3). On peut reprsenter la structure Holliday en sparant les hlices en forme de croix. Cela permet de voir quil y a deux faons de sparer les deux hlices : soit en coupant horizontalement (flche rouge) et on obtient alors un change de fragment de DNA entre les deux chromosomes (4), soit en coupant verticalement (flche jaune) et on aboutit alors un change complet des DNA des deux chromosomes au del du point de croisement (5).
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
145/207
La rparation
7.9 Coupure du double brin
BM 62/1 La rupture totale de la double hlice, coupure des deux brins, ncessite un mcanisme de rparation grce la recombinaison avec un autre brin de DNA (recombinaison homologue). Les deux extrmits double brins sont protges par des protines. Seule une 5exonuclase va digrer les deux brins avec une extrmit 5phosphate libre. Les extrmits simple brins ainsi dgages vont trouver se recombiner avec une squence homologue (squence rpte, duplique ou squence homologue de lautre chromosome). A partir des extrmits 3OH libres de lADN ls (vert sur la figure) la DNA polymerase va resynthtiser des squences grce au modle que constitue les squences homologues du brin intact. Aprs que la DNA ligase ait ferm les brches simples brins, il en rsulte un htroduplex avec deux jonctions Holliday. La coupure des jonctions entre les deux brins libre les deux doubles hlices reconstitues. Comme les squences homologues ne sont pas parfaitement identiques, il reste des msappariements. La rparation de ces msappariements aboutit des doubles hlices normalement hybrides. Toutefois des fragments de ces doubles hlices sont issus du mme modle homologue dans les deux hlices et les squences qui se trouvent dans ces zones sont maintenant identiques : les gnes qui sy rencontrent ventuellement, sils taient htrozygotes, deviennent homozygotes : cest la perte dhtrozygotie.
146/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
La rparation
7.10 Crossing-over
BM 62/2 Les changes entre chromosomes homologues peuvent conduire des changes de fragments ou des changes de brins entiers de DNA. Au cours de la miose en particulier, de tels changes se produisent frquemment entre les chromosomes dorigine paternelle ou maternelle de telle sorte que les gnes des chromosomes des cellules filles (gamtes) sont une recombinaison htrogne de fragments des deux origines. Le rsultat implique un mlange de caractres hrditaires des deux parents qui constituent le patrimoine du nouvel individu, bien que lhomologie des changes garantisse le maintien de chaque gne sur chaque locus avec un allle (homozygote) ou deux (htrozygote).
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
147/207
La rparation
148/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Les vnements gntiques
Partie III Les vnements gntiques
Rappel des objectifs Dfinir1 les termes : variation (= substitution ou mutation silencieuse), mutation (= exprime), dltion/insertion, rptition. Donner des exemples2 parmi les vnements gntiques suivants qui aboutissent une pathologie : mutation ponctuelle, dltion (avec ou sans dcalage du cadre de lecture), pissage dfectueux, rptitions de triplet. Dfinir les termes : transposition, pseudogne, conversion de gne, famille ou superfamille de gnes. Donner un exemple de lvolution dune famille de gnes.
Grce des exemples de famille de gnes et de leur volution ; ltudiant devra expliciter le rle des vnements gntiques (duplications, conversions de gnes, inactivations de gnes) dans la diversification du patrimoine gntique des espces, et montrer quels avantages slectifs les espces acquirent avec ces changements pour ladaptation leur environnement.
1. Dfinir : prciser dans une phrase concise lessence dun objet ou les limites dun concept en excluant toute notion trangre et en comprenant toutes les variations possibles de lobjet ou du concept cern. 2. Donner un exemple : choisir, dcrire et expliquer une situation dans laquelle un concept ou un corps dfini joue le rle principal et met en vidence ses proprits essentielles.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
149/207
Les vnements gntiques
150/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Substitutions
Chapitre 8 Substitutions
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
151/207
Substitutions
8.1 Substitution
BM 63 Au cours de lvolution, la transmission du message gntique de cellule cellule, dindividu individu, despce espce se fait avec des modifications ponctuelles de la structure primaire du DNA, qui sont transmises hrditairement si elles sont compatibles avec la reproduction. Ces modifications sont de trois sortes : substitution, cest dire remplacement dun nuclotide par un autre dltion, cest dire suppression dun ou de plusieurs nuclotides insertion, cest dire addition dun ou de plusieurs nuclotides.
Les substitutions de purine purine ou de pyrimidine pyrimidine (transitions) sont les plus frquentes : A G, C T, G A et T C A C, A T, C A, C G, G C, G T, T A et T G Les autres substitutions sont des transversions :
152/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Substitutions
8.2 Somatique, germinale
BM 63/1 Leffet dune mutation est diffrent selon que cette mutation affecte le DNA dune cellule somatique ou dune cellule de la ligne germinale. Lorsque le DNA dune cellule somatique est modifi et quil en rsulte une mutation, les cellules issues de cette cellule mute forment un clone de cellules mutes qui prsente des caractres diffrents de ceux du tissu dorigine. De tels clones constituent souvent des tumeurs cancreuses. Les mutations somatiques ne sont pas transmises la descendance. Lorsque le DNA dune cellule germinale est modifi et quil en rsulte une mutation, celle-ci sera transmise par les gamtes et apparatra dans la descendance : la mutation est alors hrditaire.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
153/207
Substitutions
8.3 Faux-sens, non-sens
BM 63/2 Une substitution peut aboutir des rsultats trs diffrents aprs la traduction. Cela dpend de sa position par rapport au cadre de lecture. Les transversions font plus de mutations que les transitions. Une substitution dans un codon peut se traduire par le mme acide amin : on dit quelle est synonyme. Il ny aura pas de modification de lacide amin traduit. Une substitution dans un codon peut se traduire par un acide amin diffrent : on dit quelle est faux-sens. Elle sera dautant plus dltre pour les fonctions de la protine que le nouvel acide amin sera diffrent de celui qui aurait du tre traduit. Une substitution dans un codon peut se traduire par un codon de terminaison : on dit quelle est non-sens. La protine traduite sera tronque cet endroit.
154/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Substitutions
8.4 Polymorphisme Xba I de lapoB
BM 64 Le polymorphisme de restriction Xba I de lapolipoprotine B rsulte dune substitution T C, synonyme, qui fait disparatre un site de restriction Xba I (TCTAGA) sur le DNA de certains sujets. Cette substitution nentrane pas de mutation dans lapoB et na donc aucune consquence directe sur la sant des sujets. Toutefois les sujets porteurs du gnotype X2 sur leurs deux gnes dapoB (homozygotes), ont un taux dapoB et des lipides sanguins moins levs que les sujets de gnotype X1, et par consquent un risque plus faible de souffrir dathrome et de maladies cardio-vasculaires. Le lien entre ce polymorphisme et les lipides sanguins est encore inconnu.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
155/207
Substitutions
8.5 Marqueur gntique
BM 64/1 La recherche diagnostique dun tel marqueur : polymorphisme de fragments de restriction, amplification dune squence rptitive, etc... permet de conclure la probabilit de lexistence dun caractre li statistiquement ce marqueur : mutation inconnue ou pathologie dont lorigine gntique nest pas explique. Le diagnostic de la prsence dun marqueur gntique chez un sujet nest habituellement pas une certitude 100 % de la survenue de la pathologie lie ce marqueur : on parle alors de facteur de risque.
156/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mutations
Chapitre 9 Mutations
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
157/207
Mutations
9.1 Mutation
BM 65 Les substitutions de base nucliques dans le DNA conduisent : soit lincorporation dun acide amin diffrent dans la protine (substitution non-synonyme), soit lincorporation du mme acide amin dans la protine (substitution synonyme). Les substitutions synonymes rsultent de la dgnrescence du code gntique.
Lorsquune substitution non-synonyme se produit dans le DNA dun sujet (gnotype) et aboutit lincorporation dun acide amin fonctionnellement diffrent dans la structure primaire dune protine, il en rsulte lapparition dun caractre diffrent (mutation) dans le phnotype de lindividu. Toute autre modification entranant une protine traduite plus longue ou plus courte, ou encore un dcalage de la lecture des codons, se traduit par une squence primaire diffrente et donc la plupart du temps une mutation dans le phnotype de lindividu.
158/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mutations
9.2 Mutation Arg3500Gln de lapoB-100
BM 66 La mutation 3500 de lapolipoprotine B-100 rsulte dune substitution GA non synonyme, qui la traduction code pour le 3500e acide amin de lapoB-100, Glutamine au lieu dArginine. La prsence de cette mutation nentrane pas de modification de sites de restriction et on ne peut pas la dtecter directement par un polymorphisme de longueur des fragments de restriction. La prsence de cette mutation, retrouve en France chez une personne sur 500, est un facteur de risque vis--vis de lathrome et des maladies cardio-vasculaires, parce quelle perturbe la liaison de lapolipoprotine B-100 avec le rcepteur cellulaire des lipoprotines de basse densit (LDL).
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
159/207
Mutations
160/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Insertions - dltions
Chapitre 10 Insertions - dltions
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
161/207
Insertions - dltions
10.1 Dltion
BM 67 Au cours de lvolution, la transmission du message gntique de cellule cellule, dindividu individu, despce espce se fait avec des modifications ponctuelles de la structure primaire du DNA, qui sont transmises hrditairement si elles sont compatibles avec la reproduction. Ces modifications sont de trois sortes : substitution, cest dire remplacement dun nuclotide par un autre dltion, cest dire suppression dun ou de plusieurs nuclotides insertion, cest dire addition dun ou de plusieurs nuclotides.
Les dltions sont dimportance variable selon leur longueur : de 1 ou 2 nuclotides, elles dcalent le cadre de lecture (codons) de 3 nuclotides, elles aboutissent la suppression dun acide amin dans la protine exprime de grande longueur, elles peuvent supprimer lexpression dun ou de plusieurs exons, voire dun gne entier.
162/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Insertions - dltions
10.2 Dcalage du cadre de lecture
BM 67/2 Le cadre de lecture, dtermin une fois pour toute la traduction, est essentiel la synthse exacte dune protine de 77 acides amins (apoA-II). Une dltion *, emportant le premier nuclotide du codon 59 dcale dune lettre le cadre de lecture et aboutit la synthse de cinq acides amins faux, suivis dun codon Stop. La protine produite est inexacte et tronque (63 aa). De mme si on retire les deux premiers nuclotides ** du codon 59 on aboutit encore une protine fausse et tronque (60 aa). Dans les deux cas, on dit quil y a dcalage du cadre de lecture . Si on retirait trois nuclotides, il y aurait un ou deux acides amins inexacts mais le cadre de lecture resterait le mme et la traduction se poursuivrait normalement avec un acide amin de moins (76 aa).
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
163/207
Insertions - dltions
10.3 Dltion Phe 508 de CFTR
BM 67/3 La mutation Phe508 du gne CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator ) rsulte dune dltion qui fait disparatre les nuclotides 1653 1655 du messager (CUU). Le gne CFTR code pour un transporteur danions (chlore) qui rgule les transsudations travers les pithliums et la peau. La dltion nentrane pas de dcalage du cadre de lecture et le changement du troisime nuclotide du codon 507 ne change pas lacide amin (isoleucine) ; mais la seule consquence est labsence de lacide amin 508 (phnylalanine). Cette absence suffit inhiber lactivit du transporteur. La prsence de cette dltion, retrouve en France chez une personne sur 500, est une des causes les plus frquentes de la mucoviscidose (cystic fibrosis ).
164/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Insertions - dltions
10.4 Dltion de lexon 9 de la lipoprotinelipase
BM 68 Une dltion large (dans lexemple reprsent ici 2136 nuclotides) entrane souvent linactivation du gne. Dans le cas prsent la dltion stend depuis lintron 8 jusqu lintron 9 du gne de la lipoprotine lipase, et par consquent supprime la totalit de lexon 9 de ce gne. Il est probable que lexcision pissage de lintron coup ne peut pas se faire avec le site receveur de lintron 9 et donc que la maturation du transcrit nest pas possible. On constate chez un sujet porteur de cette dltion sur ses deux chromosomes 8 (homozygote), une absence dexpression du gne et par consquent, labsence de la lipoprotine lipase en tant que protine, ainsi que de son activit enzymatique dans le plasma sanguin.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
165/207
Insertions - dltions
10.5 Mutation dun site dpissage
BM 69/1 Une substitution peut altrer un site dpissage. Ainsi le site donneur de lintron 3 de lapoAII est-il transform de GT en AT dans une famille de malades, ce qui le rend inactif pour lexcision de cet intron. Il existe au milieu de lexon 3 une squence qui peut servir de site donneur alternatif mais qui est normalement inactive (site donneur cryptique). En labsence du site donneur normal, cest ce site cryptique qui va servir exciser lintron 3. Mais comme ce site cryptique est situ 65 nuclotides en amont du site normal il y aura 22 acides amins de lexon 3 qui ne seront pas traduits. En outre, le nombre de nuclotides perdus ntant pas un multiple de 3 il y aura dcalage du cadre de lecture, ce qui entrane une traduction fausse des 10 premiers acides amins de lexon 4 et la rencontre dun codon Stop prmatur. La protine tronque ne sexprime pas et lapolipoprotine A-II est absente du plasma de ces malades.
166/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Insertions - dltions
10.6 Insertion
BM 70 Au cours de lvolution, la transmission du message gntique de cellule cellule, dindividu individu, despce espce se fait avec des modifications ponctuelles de la structure primaire du DNA, qui sont transmises hrditairement si elles sont compatibles avec la reproduction. Ces modifications sont de trois sortes : substitution, cest dire remplacement dun nuclotide par un autre dltion, cest dire suppression dun ou de plusieurs nuclotides insertion, cest dire addition dun ou de plusieurs nuclotides.
Les insertions sont dimportance variable selon leur longueur : de 1 ou 2 nuclotides, elles dcalent le cadre de lecture (codons) de 3 nuclotides, elles aboutissent laddition dun acide amin dans la protine exprime de grande longueur, elles peuvent modifier compltement la traduction des exons dans les introns ou dans les exons non-traduits, on rencontre souvent de longues insertions de structure variable qui sont sans effet apparent sur lexpression du gne.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
167/207
Insertions - dltions
168/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Transpositions
Chapitre 11 Transpositions
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
169/207
Transpositions
11.1 Transposition
BM 71 Au cours de lvolution des espces, le gnome sagrandit continuellement par suite de duplications de gnes et de transpositions. Les duplications se produisent en tandem, une squence se trouvant rpte deux fois dans le gnome la suite de la duplication. Cette duplication permet chacune des copies de la squence dvoluer pour son propre compte ce qui augmente les chances de produire des caractres nouveaux. Les transpositions rsultent de lincorporation dacides nucliques synthtiss hors du gnome : soit par incorporation du DNA dun virus, soit par transcription rverse dun RNA de la cellule ou dun virus, au moyen dune rverse-transcriptase qui produit un DNA complmentaire (cDNA) et dune transposase qui lincorpore au gnome de la cellule.
170/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Transpositions
11.2 Squence Alu
BM 72 A peu de distance en aval du gne de lapoA-II, on rencontre une squence transpose de la famille Alu. Cest un pseudogne, entour de deux squences rptes (GAAAATGAGGGTACCCT) qui sont caractristiques des squences transposes. Entre ces deux squences on trouve deux squences homologues spares par une courte squence de liaison (TACTAAAAATACAAAAATTA). Plusieurs sites caractrisent encore cette squence Alu : site dinitiation de la RNA-polymrase III, site de restriction de lenzyme Alu I (do le nom de squence Alu), queue poly-A. La squence Alu rsulte dune transposition de la squence du RNA 7 S, RNA de structure de la SRP (Signal Recognition Particle ). Il y a prs dun million de squences Alu de ce type dans le DNA humain, soit une tous les 4 kb. Il en est de mme chez la plupart des Primates et des Rongeurs. Dautres squences transposes sont connues chez lHomme ou dautres Mammifres.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
171/207
Transpositions
11.3 Virus
BM 72/5 Lacide ribonuclique du virus HIV lorsquil pntre dans le sang est reconnu par le rcepteur CD4 des lymphocytes T4. La formation du complexe rcepteur CD4 - virus entrane la fusion de lenveloppe du virus et de la membrane du lymphocyte, et par consquent lentre du virus dans le cytoplasme. Ce noyau contient une enzyme la rverse transcriptase et un RNA viral porteur de linformation gntique. Lenzyme catalyse la rtrotranscription de le RNA viral en DNA et lincorporation de ce DNA (provirus) dans le DNA du lymphocyte. Le provirus engendre de nouvelles particules virales par transcription et traduction et la mort de la cellule par destruction de son DNA. Les particules virales nouvelles sont libres pour transmettre le signal dautres lymphocytes T4. Le nombre de lymphocytes T4 diminue jusqu ce que les dfenses immunitaires du sujet deviennent insuffisantes (SIDA) ce qui entrane le dveloppement dinfections opportunistes et terme la mort du sujet atteint.
172/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Transpositions
11.4 Cycle dun rtrovirus
BM 72/6 La particule du rtrovirus est compose dune enveloppe protinique, entourant une capside galement protinique qui contient le patrimoine gntique du rtrovirus sous forme dun RNA simple brin contenant la transcription du gne de la rverse transcriptase et des gnes des protines des enveloppes. Lors de linfestation dune cellule, seule la capside pntre travers la membrane plasmique puis libre le RNA dans le cytoplasme o il sexprime comme un messager. La rverse transcriptase ainsi synthtise est une enzyme capable de : 1. 2. transcrire ( lenvers) le RNA du virus en DNA complmentaire (hybride RNA:DNA) puis dtruire le RNA pour le remplacer par un deuxime brin de DNA.
Le DNA double-brin se transpose alors dans le DNA nuclaire de la cellule-hte do il peut nouveau tre transcrit en multiples copies de RNA du virus. La traduction de ces RNA aboutit la synthse de protines qui sassemblent autour des RNA pour constituer de nouvelles particules virales en trs grand nombre (amplification du virus). Enfin la cellule-hte meurt en librant les particules virales et le cycle recommence.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
173/207
Transpositions
11.5 Duplication de gne
BM 72/7 De nombreuses situations peuvent conduire la duplication dun fragment de DNA. Ces duplications sont facilites par lexistence de squences rptitives directes (squences identiques dans le mme sens faible distance sur le mme brin de DNA. Dans la bulle de rplication, des squences rptitives directes peuvent conduire un appariement ingal des deux brins de DNA rpliqus et aboutir aprs change des deux brins la rptition dun fragment de DNA. Lorsque lchange de brins se fait dans la mme chromatide aprs la rplication ; la rptition en tandem du mme fragment se retrouve sur un seul des deux brins. Au cours de la miose des changes peuvent encore se produire entre chromatides, comme dans le crossing-over normal, mais en rpartissant de faon ingales les brins la suite dun change de brins au niveau des squences rptitives. Dans ce cas les squences dorigine paternelle et maternelle se retrouvent la suite sur le mme brin de DNA, aboutissant deux gnes presque identiques (appels paralogues). Dans chacun de ces cas, le DNA porteur de rptitions bnficie souvent de deux gnes identiques codant pour la mme protine. Cette disposition confre aux individus qui reoivent ce patrimoine gntique une meilleure rsistance aux mutations qui peuvent survenir sur un gne, donc un avantage slectif en faveur des gnes dupliqus.
174/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Transpositions
11.6 Pseudogne
BM 73 Certains gnes apparus par duplication au cours de lvolution ont subi des vnements gntiques (substitutions, insertions, dltions, etc...) qui empchent la transcription ou la traduction de se faire. A titre dexemple, une duplication du gne de lapolipoprotine C-I a produit un gne apoCI, il y a 40 millions dannes dans le gnome des Primates. Mais, une mutation rcente a transform le dernier acide amin du signal-peptide de la protine exprime par ce gne en codon Stop ! Il en rsulte que mme si la transcription conduit un RNA messager, celui-ci ne peut tre traduit que par un signal-peptide sans protine sa suite.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
175/207
Transpositions
11.7 Conversion de gne
BM 74 Les squences de gnes peuvent tre transformes par change dexons complets par une transposition partir dun autre gne. La transposition dun exon peut ajouter un domaine nouveau dans la structure dune protine ou restaurer un domaine devenu non fonctionnel au cours de lvolution.
176/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Lvolution
Partie IV Lvolution
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
177/207
Lvolution
178/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Divergence
Chapitre 12 Divergence
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
179/207
Divergence
12.1 Divergence
BM 75 Lorsque deux squences primaires dacides nucliques se ressemblent on tente de les aligner au mieux pour obtenir un nombre minimum de diffrences entre les deux squences : substitutions, insertions ou dltions. La divergence entre les deux squences est alors le pourcentage de nuclotides diffrents par rapport au nombre total de nuclotides aligns. La divergence est habituellement trs faible entre les squences dun mme gne lintrieur dune espce (< 1 %). De mme elle reste faible mme pour des espces trs loignes pour des protines ayant une importance mtabolique primordiale. La divergence peut-tre grande, mme dun individu lautre, pour des segments de DNA entre les gnes ou dans les introns sans fonctions gntiques (squences hypervariables).
180/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Familles de gnes
Chapitre 13 Familles de gnes
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
181/207
Familles de gnes
13.1 Famille de gnes
BM 76 Une forme particulire dinsertion a jou un rle majeur dans lvolution des espces deucaryotes : la duplication des gnes. Lorsque la squence dun gne a t rpte deux fois dans le mme DNA et que les deux gnes continuent sexprimer, ils voluent diffremment pour aboutir au bout de nombreux millions dannes exprimer des protines diffrentes, ce qui peut apporter un avantage slectif lespce. Dans les gnes ou dans les protines qui sont issus dun gne ancestral unique, on retrouve toujours une homologie de structure (exons, introns) de squences primaires (DNA, protines) et de fonctions (activits des protines). Ces gnes constituent ensemble une famille de gnes dont on peut reconstruire larbre phylogntique en suivant lvolution du gne ancestral et de ceux qui en sont issus travers le temps et lvolution des espces.
182/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Familles de gnes
13.2 Gnes des -globines
BM 78 Plusieurs gnes existent pour exprimer les chanes dacides amins qui constituent lhmoglobine : -globines sur le chromosome 16 et -globines sur le chromosome 11. Sur ce dernier chromosome il existe cinq gnes exprims successivement au cours du dveloppement de lindividu dans les hmoglobines embryonnaires, ftales et adultes. Lensemble des cinq gnes constitue un groupe de gnes (cluster ). Les cinq gnes sont drivs dans lvolution partir dun gne ancestral unique (chez les Invertbrs) par duplications successives. Le gne -globine est lextrmit 5 du groupe de gnes. Aprs un long intergne, on rencontre les deux gnes des -globines (-Gly et -Ala). Dans lintergne suivant se trouve un pseudogne -globine, qui nest plus exprim. Enfin vers lextrmit 3 se rencontrent successivement les deux gnes exprims chez les adultes -globine et surtout -globine.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
183/207
Familles de gnes
13.3 Famille des -globines
BM 79 Lvolution des gnes des -globines chez les Primates est un bon exemple de lvolution des gnes dupliqus dans un groupe de gnes. A lorigine les Primates reoivent un ensemble de 5 gnes dont 3 sont destins au stade de lhmoglobine embryonnaire et 2 au stade adulte. Un de ces gnes a t inactiv trs tt et donnera le pseudogne -globine chez tous les Primates. Dans toutes les lignes volutives, il se produit des conversions du gne -globine par des squences provenant du gne . Chez les Lmurs, on observe une large dltion qui aboutit la fusion du pseudogne avec le gne . Chez les Tarsiers, le gne est inactiv en pseudogne. Chez tous les petits animaux on assiste une diminution de lactivit des gnes embryonnaires. Chez les Singes au contraire, on voit apparatre lhmoglobine ftale avec une spcialisation du gne dans cette fonction. Chez les Anthropodes enfin, ce gne est encore dupliqu pour donner les gnes -Gly et -Ala des hmoglobines ftales. Au cours de lvolution de ces lignes, lexpression relative des deux gnes de la globine adulte se modifie : les gnes sont exprims galement chez les animaux les plus primitifs, alors que chez lHomme le gne nest plus exprim qu 1 % par rapport au gne .
184/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Le DNA au laboratoire
Partie V Le DNA au laboratoire
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
185/207
Le DNA au laboratoire
186/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
Chapitre 14 Mthodes dtude
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
187/207
Mthodes dtude
14.1 Extraction et purification du DNA
BM 15 Lacide dsoxyribonuclique est extrait partir des lymphocytes dune prise de sang sur EDTA (anticoagulant chlateur du Calcium). On spare les lymphocytes des autres cellules sanguinbes par un gradient de densit, puis on les lave avant de les centrifuger en un culot de lymphocytes. On redissous ce culot dans un tampon et on pratique une extraction par le phnol, qui dissous les lipides et prcipite les protines en laissant les acides nucliques en solution. On reprcipite enfin le DNA par lalcool en prsence de sel. Le DNA prcipite en un nuage cotonneux blanchtre (la mduse ) quon recentrifuge et quon lave avant de redissoudre le DNA purifi dans de leau distille.
188/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
14.2 Synthse dun cDNA
BM 15/1 La manipulation et ltude des RNA est difficile cause de leur grande sensibilit aux ribonuclases qui les dtruisent. Il est ncessaire de recopier la squence en DNA pour quelle soit plus stable et quon puisse lamplifier en fonction des besoins. Le mRNA purifi (chromatographie daffinit sur une colonne doligo-d(T)) est li dans un premier temps avec des oligonuclotides poly(T) qui sattachent la queue poly(A). A partir de lextrmit 3 de cette amorce poly(T) la transcriptase rverse, qui est une DNA polymrase, synthtise un brin de DNA complmentaire du messager de dpart. Une fois cette synthse acheve on dgrade le RNA par une base forte ou par une ribonuclase spcifique. Le brin de DNA fabriqu forme spontanment son extrmit 3 une boucle en pingle cheveux en shybridant sur lui-mme. Lextrmit 3 de cette boucle va servir de site de dmarrage pour la DNA polymrase qui va synthtiser un brin de DNA complmentaire du premier. Une nuclase spcifique du DNA simple brin supprimera la boucle de lextrmit. Le cDNA double brin est prt. On peut ainsi constituer autant de cDNA quil existe de messagers dans une cellule : lensemble de ces cDNA forme une banque de cDNA .
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
189/207
Mthodes dtude
14.3 Electrophorse de DNA
BM 16 Les fragments dun DNA digr par une enzyme de restriction comme Hha I, sont des anions et si on les soumet dans un gel un champ lectrique, ils migrent vers le ple positif (anode) une vitesse dautant plus grande quils sont de taille plus petite. On place dans un des puits de dpt des fragments de DNA de tailles connues pour servir de marqueurs de taille. On ajoute dans les dpts deux colorants : un bien visible sur le gel qui va migrer trs rapidement avant les fragments de DNA pour limiter la distance parcourue au bord de lanode ; un autre, le bromure dthidium qui se fixe spcifiquement au DNA quelle que soit la squence et qui met une fluorescence mauve lorsquon lclaire avec des rayons ultra-violets. On examine le gel sous lumire ultra-violette 254 nm et on photographie les fragments de DNA digr.
190/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
14.4 Hae III (enzyme de restriction)
BM 16/1 Hae III est une enzyme de restriction produite par Haemophilus aegypticus . Le site de liaison lADN est form de quatre paires de nuclotides : 5 GGCC 3 3 CCGG 5 Les sites de restriction sont souvent de type palindrome, cest dire quils sont identiques sur les deux brins de lADN (mais antiparallles sur lautre brin). Lorsque lhydrolyse des liaisons phosphodiester se fait au centre de symtrie du palindrome toutes les paires de nuclotides restent apparies : les fragments qui en rsultent sont dits bouts francs . La mthylation de la cytosine immdiatement en aval du site dhydrolyse inhibe la reconnaissance du site par Hae III. LADN de la bactrie ainsi mthyl nest pas hydrolys alors que lADN parasite qui nest pas mthyl sera hydrolys.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
191/207
Mthodes dtude
14.5 EcoR I
BM 16/11 EcoR I est une enzyme de restriction produite par Escherichia coli , souche R. Le site de liaison lADN est form de six paires de nuclotides : 5 GAATTC 3 3 CTTAAG 5 Les sites de restriction sont souvent de type palindrome, cest dire quils sont identiques sur les deux brins de lADN (mais antiparallles sur lautre brin). Lorsque lhydrolyse des liaisons phosphodiester se fait loin du centre de symtrie du palindrome certaines paires de nuclotides restent non apparies : les fragments qui en rsultent sont dits bouts collants . La mthylation des adnines ou de la cytosine du site dhydrolyse inhibent la reconnaissance du site par EcoR I. LADN de la bactrie ainsi mthyl nest pas hydrolys alors que lADN parasite qui nest pas mthyl sera hydrolys.
192/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
14.6 Polymorphisme de restriction
BM 16/2 Le profil lectrophortique obtenu avec une enzyme de restriction donne montre des diffrences individuelles dans la taille des fragments de restriction (RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism ). Chaque systme alllique de restriction dfinit un locus polymorphe.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
193/207
Mthodes dtude
14.7 Polymorphisme Msp I de lapoA-II
BM 16/3 Le Southern blot permet la dtection des polymorphismes de longueur des fragments de restriction (RFLP ou restriction fragments length polymorphism ). Il existe un polymorphisme dans le gne de lapolipoprotine A-II. Ce polymorphisme altre la squence du site reconnu par lenzyme de restriction Msp I situ en aval du gne, de telle sorte que 19 % des sujets (anglais) ne prsentent pas de site de restriction cet endroit. Lorsquon digre le DNA gnomique de plusieurs individus choisis au hasard on obtient des fragments de taille diffrentes entre chaque point de coupure par lenzyme. Aprs lectrophorse pour sparer ces fragments en fonction de leur taille et transfert sur une membrane, on hybride les fragments sur la membrane avec une sonde complmentaire des exons de lapoAII puis on fait lautoradiograhie de la membrane pour rvler ces fragments. La plupart de ces sujets (81 %) qui possdent trois sites de coupure autour du gne donnent un fragment de 3000 paires de nuclotides (3,0 kb). Dautres sujets, plus rares (19 %) qui ne possdent pas le site de restriction ont un fragment plus grand = 3700 paires de nuclotides (3,7 kb). Le sujet dont le DNA a t dpos dans llectrophorse au n3 est dans ce cas. Il arrive quun sujet porte un allle du type frquent sur un chromosome et lautre allle sur lautre chromosome. Il est alors htrozygote pour le polymorphisme et llectrophorse (n4) on voit les deux fragments rvls par la sonde.
194/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
14.8 Cartes de restriction
BM 16/4 Les marqueurs gntiques peuvent aussi caractriser les DNA responsables des maladies hrditaires grce aux cartes de restriction. Le DNA du malade est digr par de nombreuses enzymes de restriction isolment ou associes entre elles. Les fragments de restriction sont reconnus par une sonde spcifique du gne responsable de la maladie. Il en rsulte un grand nombre de fragments possibles dont les longueurs (en kilobases) sont mesures par lectrophorse cot dun marqueur de masse molculaire. Ainsi, le DNA dun malade atteint dune dyslipoprotinmie et celui dun tmoin sain ont t digrs par BamH I : le sujet sain montre un seul fragment long de 11,65 kb reconnaissable par la sonde du gne de lapoA-I, alors que le DNA du malade en montre deux de 7,5 et 10,25 kb. Le fragment BamH I du sujet tmoin peut encore tre digr par dautres enzymes donnant chaque fois deux fragments (Dde I) ou trois (Hind III) ou quatre (Pst I). Les fragments peuvent tre compars comme les morceaux dun puzzle pour obtenir une carte des emplacements des sites de restriction sur le DNA. La mme carte, chez le sujet malade, montre les mmes sites de restriction aux deux extrmits du fragment BamH I, mais il apparat une insertion de 6 kb au milieu du gne de lapoA-I avec des sites nouveaux : BamH I, EcoR I, Pst I non retrouvs chez le tmoin. Cette insertion est responsable dune absence dexpression de lapoA-I ce qui se traduit par une dyslipoprotinmie.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
195/207
Mthodes dtude
14.9 Hybridation dune sonde
BM 17 Un fragment de DNA double brin affecte normalement une structure secondaire en double hlice. En levant la temprature jusqu la Tm, on disjoint 50 % environ des liaisons hydrogne qui unissent les brins de DNA, ce qui dnature partiellement la double hlice. Lorsque la temprature atteint 95C. toutes les liaisons hydrogne sont rompues et la dnaturation du DNA est complte : DNA simple brin, qualifi de dnatur . Au cours de la dnaturation, le coefficient dextinction du DNA 260 nm augmente (hyperchromicit). En refroidissant brutalement (glace) les structures secondaires ne se reforment pas et le DNA reste dnatur. Si on refroidit doucement, la double hlice se reforme progressivement. Un oligonuclotide (sonde) ajout ce moment peut shybrider avec un fragment complmentaire du DNA, ds que la temprature descend en-dessous de la Tm. Lhybridation dune sonde marque (atomes radioactifs, radicaux fluorescents ou ligands spcifiques) sur un DNA dnatur permet de marquer spcifiquement tous les fragments de ce DNA dont la squence est complmentaire de la sonde.
196/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
14.10 Calcul de la Tm
BM 17/1 Il est possible de mesurer directement la temprature de fusion (Tm) dun DNA double brin en mesurant laugmentation de labsorbance de la solution 260 nm en fonction de la temprature. Toutefois, on se contente la plupart du temps dune estimation partir de la composition de loligonuclotide. Si celui-ci a une longueur gale ou infrieure 20 nt on compte 2C par couple A:T et 4C par couple G:C. A partir de N = 20, on corrige dun multiplicateur proportionnel la longueur au del de ce chiffre : 1 + [(N-20)/20]. Lorsquil existe des msappariements il faut soustraire de la Tm calcule autant de degrs C que le pourcentage de squence non-apparie de loligonuclotide.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
197/207
Mthodes dtude
14.11 Sonde hybride
BM 17/2 Pour pouvoir reconnatre spcifiquement une squence du DNA, on utilise au laboratoire un petit morceau de DNA synthtis (sonde) dont la squence correspond au moins en partie celle dun des brins du DNA. Parce quelle est complmentaire de lautre brin du DNA, la sonde est capable de se fixer spcifiquement sur lautre brin lendroit o se lit la squence complmentaire. En marquant cette sonde par un atome radioactif ou par une molcule fluorescente lis covalentiellement un des nuclotides de la sonde, on peut dtecter la sonde et le morceau de DNA complmentaire qui lui est hybrid.
198/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
14.12 Sonde spcifique dallle (ASO)
BM 17/3 La drpanocytose ou anmie falciforme est une maladie des globules rouges qui sont dforms par une cristallisation anormale de lhmoglobine. Cette cristallisation rsulte dune substitution AT dans le sixime codon. Cette substitution sexprime par une mutation Glu6Val de la chane de la globine. Llectrophorse de lADN du gne HBB, qui code pour la chane des globines est rvle par deux sondes : lune spcifique de la squence normale, lautre de celle de la protine mute (ASO = Allele Specific Oligonucleotide ). Le DNA dun sujet est rvl par la seule sonde normale sil possde deux gnes HBB normaux (homozygote normal), par la seule sonde de la protine mute sil possde deux gnes HBB responsables de la mutation (homozygote mut) et par les deux sondes sil possde un gne normal et un gne de la protine mute (htrozygote). Les sujets homozygotes muts sont atteints danmie falciforme et sujets des crises graves. Les sujets htrozygotes sont porteurs du trait drpanocytaire , ils nont que peu de troubles mais ils transmettent le gne leurs descendants.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
199/207
Mthodes dtude
14.13 Southern blot
BM 17/4 Le Southern blot est une technique mise au point par Edward M. Southern en 1975 pour rechercher des fragments de DNA sur une lectrophorse en les hybridant avec une sonde complmentaire. 1. Aprs avoir digr le DNA par une enzyme de restriction, on obtient un mlange de trs nombreux fragments de restriction. On soumet ces fragments une lectrophorse pour les faire migrer dans un gel de haut en bas en fonction inverse de leur taille. On fait un montage pour faire passer les fragments grce une monte de tampon imprgnant le gel puis une membrane de nylon o le DNA va se fixer par des liaisons stables. La membrane de nylon avec le DNA fix est alors mise incuber dans un sac contenant une solution dune sonde radioactive complmentaire du fragment de DNA quon recherche, une temprature assez basse pour que lhybride se forme mais assez leve pour que cet hybride soit parfaitement complmentaire. On lave la membrane des molcules de la sonde qui ne sont pas fixes leur DNA complmentaire, puis on la met en prsence dun film radiographique vierge dans une enceinte opaque pour que la sonde radioactive fixe sur les fragments de DNA complmentaires impressionne le film. On rvle le film o des taches noires (sur le ngatif) correspondent aux emplacements o ont migr les fragments de DNA complmentaires de la sonde. On compare les distances de migration avec des fragments de DNA radioactifs de tailles connues qui ser-
2. 3.
4.
5.
200/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
vent de marqueurs de taille.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
201/207
Mthodes dtude
14.14 PCR
BM 18 La PCR (polymerase chain reaction ) permet damplifier spcifiquement une rgion de DNA double brin de quelques centaines de paires de bases. Ce DNA doit dabord tre spar en simples brins (dnaturation 95C). On ajoute au DNA de dpart une large quantit damorces (oligonuclotides synthtiques complmentaires des deux extrmits de la rgion amplifier) qui vont shybrider 50-60C environ avec la squence complmentaire sur chacun des brins de DNA, et les quatre dNTP qui serviront de substrats. On soumet le tout lactivit dune DNA polymrase (Taq polymerase ) qui synthtise 72C un brin complmentaire partir du 3OH de lamorce hybride. On obtient quatre brins de DNA. On recommence dnaturer ces 4 brins, puis on les laisse shybrider avec les amorces (toujours en excs) et la polymrase entre en action pour aboutir 8 brins de DNA. On recommence dnaturer ces 8 brins, puis on les laisse shybrider avec les amorces (toujours en excs) et la polymrase entre en action pour aboutir 16 brins de DNA. Et ainsi de suite 35 fois, ce qui aboutit 34359738368 brins de DNA (34 milliards), ce qui reprsente une quantit suffisante pour tudier le fragment de DNA amplifi.
202/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
14.15 Didsoxyadnosine triphosphate
BM 04/9 Le didsoxyadnosine triphosphate (ddATP) est un nucloside triphosphate de synthse. Sa structure est dpourvue de fonction alcool en 3. Analogue structural de nuclotide, le ddA est utilis comme inhibiteur de la rplication (DNA polymrase). Labsence de fonction alcool en 3 empche toute condensation avec le nuclotide suivant. Cette inhibition est principalement utilise pour le squenage des DNA.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
203/207
Mthodes dtude
14.16 Raction de squence
BM 19 Pour lire la squence dun DNA simple brin on hybride une amorce du ct 3 de ce DNA. Puis on effectue avec une DNA polymrase la synthse dun brin complmentaire. La condensation se fait partir dun substrat activ : un des nuclosides triphosphates. La rupture dune liaison riche en nergie fournira lnergie ncessaire la condensation. Le nucloside monophosphate restant sera estrifi par une fonction acide de son phosphate sur la fonction alcool libre du carbone 3 du ribose qui constitue lextrmit de lacide nuclique. Pour cette synthse on apporte comme substrats les quatre dsoxyribonuclosides triphosphates (dATP, dCTP, dGTP et dTTP). En plus une trs petite quantit de didsoxyribonuclosides triphosphates fluorescents (ddATP-JOE, ddCTP-5-FAM, ddGTP-TAMRA et ddTTP-ROX). La polymrase choisira le plus souvent un dsoxyribonucloside normal et la synthse se poursuivra jusqu ce quelle incorpore un didsoxyribonucloside fluorescent. A ce stade le brin en cours de synthse na plus dextrmit 3-OH et la raction de polycondensation ne peut plus se poursuivre. Le didsoxyribonuclotide incorpor en dernier est fluorescent et met sous lexcitation une lumire verte pour JOE (ddAMP), bleue pour 5-FAM (ddCMP), jaune pour TAMRA (ddGMP) et rouge pour ROX (ddTMP). A chaque lettre de la polycondensation un petit nombre de molcules sont ainsi arrtes et marques de la fuorescence correspondant au dernier nuclotide incorpor. En sparant ces molcules par lectrophorse en fonction de leur taille on peut lire les lettres successives qui apparaissent comme des zones sur llectrophorgramme dont la fluorescence
204/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
correspond la base de ce dernier nuclotide.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
205/207
Mthodes dtude
14.17 Squenage dADN
BM 19/1 Pour connatre la squence des DNA, on fait synthtiser un brin du DNA par une enzyme spcifique. Lenzyme commence son travail partir de lextrmit 3 dune sonde hybride qui sert damorce. Elle ajoute des nuclotides complmentaires de ceux du brin de DNA quelle copie. On lui donne pour substrats des dsoxynuclosides triphosphates normaux mlangs avec des didsoxynuclotides dont la fonction alcool secondaire en 3 est rduite ce qui empche la synthse de se poursuivre au del. Les didsoxynuclotides incorpors en dernier sont marqus spcifiquement par des molcules fluorescentes (vert pour didsoxyA, bleu pour didsoxyC, jaune pour didsoxyG et rouge pour didsoxyT) On spare ensuite les fragments synthtiss dans un champ lectrique (lectrophorse : les DNA sont des anions, ils vont donc vers le ple +), en fonction de leur longueur (les plus petits vont plus vite). On lit ensuite les taches successives, identifies par leur couleur, ce qui rvle la squence des fragments synthtiss.
206/207
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
2009 - 2010
Mthodes dtude
14.18 Gel de squence
BM 19/2 En utilisant des amorces spcifiques, on fait synthtiser un brin complmentaire du DNA lire, en prsence dune faible proportion de didsoxyribonuclotides marqus dun radical fluorescent diffrent pour chaque base. La DNA polymrase lorsquelle a incorpor un tel didsoxyribonuclotide ne peut plus continuer la synthse faute dextrmit 3OH libre. Il se forme donc une multitude de brin complmentaires inachevs, chacun termin par un didsoxyribonuclotide fluorescent caractristique de la base de ce dernier nuclotide. En sparant par lectrophorse ces fragments complmentaires on spare dans le gel chacun des fragments, du plus petit au plus grand et on les dtecte au passage par un faisceau laser qui excite la fluorescence et une cellule photolectrique qui lit la lumire mise chacune des longueurs donde des fluorescences caractristiques des quatre bases. Lordinateur reoit donc une srie de mesure dintensit lumineuses en forme de pics correspondant au passage de chacun des fragments : en interprtant la couleur de la fluorescence de chaque pic lordinateur crit la squence du DNA.
2009 - 2010
Biologie Molculaire - Prs C. Housset et A. Raisonnier
207/207
Vous aimerez peut-être aussi
- Microbiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainD'EverandMicrobiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Biochimie 2Document30 pagesBiochimie 2med197850% (2)
- Biologie GéniqueDocument183 pagesBiologie GéniqueÉmna Ghribi100% (1)
- Biologie MoléculaireDocument291 pagesBiologie Moléculairecep100% (6)
- Hormones: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandHormones: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Biologie Cellulaire Et MoleculaireDocument30 pagesBiologie Cellulaire Et Moleculairesoumia lefkir100% (2)
- Membranes cellulaires: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandMembranes cellulaires: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Bio-Informatique Pour La GénomiqueDocument258 pagesBio-Informatique Pour La Génomiquecdm22orangePas encore d'évaluation
- Cours Biologie Moleculaire NehDocument118 pagesCours Biologie Moleculaire NehDjena DiakitePas encore d'évaluation
- VirologieDocument307 pagesVirologieAmina86% (14)
- Resume de CytologieDocument109 pagesResume de CytologieMohamed Mohamed100% (1)
- Mécanique Des FluidesDocument14 pagesMécanique Des FluidesGHERMI .M86% (22)
- Glucides: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandGlucides: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Resumé ENZYMOLOGIEDocument13 pagesResumé ENZYMOLOGIEislamouahabiPas encore d'évaluation
- TP Dosage de L'urée PlasmatiqueDocument10 pagesTP Dosage de L'urée PlasmatiqueGHERMI .M86% (22)
- Notions de Biologie MoléculaireDocument41 pagesNotions de Biologie MoléculaireFaiza H100% (2)
- Tpn°2 - Dosage Des Protéines PlamatiqueDocument10 pagesTpn°2 - Dosage Des Protéines PlamatiqueGHERMI .M100% (2)
- Tpn°2 - Dosage Des Protéines PlamatiqueDocument10 pagesTpn°2 - Dosage Des Protéines PlamatiqueGHERMI .M100% (2)
- Biologie Molecule TD CorrigéDocument3 pagesBiologie Molecule TD CorrigéSchola Janvier94% (32)
- Exercices Biologie Moleculaire PDFDocument2 pagesExercices Biologie Moleculaire PDFMike50% (10)
- Thesaurus Des Interactions MédicamenteusesDocument206 pagesThesaurus Des Interactions MédicamenteusesGHERMI .MPas encore d'évaluation
- Hormones VégétalesDocument21 pagesHormones VégétalesGHERMI .M83% (6)
- Cahier D'exercice2Document15 pagesCahier D'exercice2GHERMI .M100% (11)
- Hematologie Clinique Trimis StudentiDocument121 pagesHematologie Clinique Trimis Studentiwaliddaas100% (1)
- Cahier D'exercice4Document28 pagesCahier D'exercice4GHERMI .M100% (6)
- Biologie CliniqueDocument231 pagesBiologie Cliniquepret30750% (2)
- FeuilletageDocument28 pagesFeuilletagekiki02Pas encore d'évaluation
- Structure Des Glucides & LipidesDocument48 pagesStructure Des Glucides & LipidesGHERMI .M100% (2)
- Microbiologie médicale II: stérilisation, diagnostic de laboratoire et réponse immunitaireD'EverandMicrobiologie médicale II: stérilisation, diagnostic de laboratoire et réponse immunitairePas encore d'évaluation
- Cahier D'exercice3Document12 pagesCahier D'exercice3GHERMI .M80% (15)
- Cahier D'exercice3Document12 pagesCahier D'exercice3GHERMI .M80% (15)
- Les ComprimésDocument7 pagesLes ComprimésGHERMI .M91% (11)
- Cours D ImmunoDocument64 pagesCours D ImmunoMaya Zeen86% (7)
- Sujet Révision de BMGGDocument20 pagesSujet Révision de BMGGikram bt100% (3)
- Biochimie StructuraleDocument169 pagesBiochimie StructuraleGHERMI .M100% (7)
- Séquençage d'ADNDocument27 pagesSéquençage d'ADNFati100% (11)
- Communication CellulaireDocument22 pagesCommunication CellulaireAmïn Fïlalï100% (2)
- Dosage de La CréatinineDocument11 pagesDosage de La CréatinineGHERMI .M90% (30)
- Examen 28 Mai 2010-CorrigéDocument6 pagesExamen 28 Mai 2010-Corrigéikram bt0% (1)
- Biologie Cellulaire Résumé Cours MagistrauxDocument42 pagesBiologie Cellulaire Résumé Cours MagistrauxAdonis Serghini86% (35)
- Immunité InnéeDocument32 pagesImmunité InnéeGHERMI .M100% (2)
- Biochimie Enzymologie ÉlémentaireDocument131 pagesBiochimie Enzymologie ÉlémentaireLahouari FatahPas encore d'évaluation
- TD Corrigé de Biologie MoléculaireDocument3 pagesTD Corrigé de Biologie MoléculaireGeronimo0% (1)
- Séquençage d'ADNDocument16 pagesSéquençage d'ADNhacina83% (18)
- Cahier D'exercice1Document24 pagesCahier D'exercice1GHERMI .M100% (8)
- Cahier D'exercice1Document24 pagesCahier D'exercice1GHERMI .M100% (8)
- Biologie Moleculaire 2Document10 pagesBiologie Moleculaire 2Xzistence100% (3)
- Genetique1an16-Biologie Moleculaire Genie GenetiqueDocument34 pagesGenetique1an16-Biologie Moleculaire Genie Genetiqueikram bt100% (2)
- GenetiqueMoleculaire 1A Polycopie 2007 PDFDocument181 pagesGenetiqueMoleculaire 1A Polycopie 2007 PDFfatiPas encore d'évaluation
- Cahier D'exercice5Document22 pagesCahier D'exercice5GHERMI .M100% (5)
- BG3 ExosDocument22 pagesBG3 Exospersonne12Pas encore d'évaluation
- Controle 1 Et 2 Bio MoléculaireDocument6 pagesControle 1 Et 2 Bio Moléculaire[AE]100% (4)
- Examen L1 Biologie Moléculaire 2005 1Document9 pagesExamen L1 Biologie Moléculaire 2005 1R-winPas encore d'évaluation
- Emd 08Document8 pagesEmd 08lmd2009Pas encore d'évaluation
- Formation Biologie MoléculaireDocument42 pagesFormation Biologie MoléculaireRym BldjPas encore d'évaluation
- Cours 15 Extraction d'ADN, PCR Et Séquençage de l'ADNDocument10 pagesCours 15 Extraction d'ADN, PCR Et Séquençage de l'ADNFarah B. Btoush100% (1)
- Biologie MoleculaireDocument106 pagesBiologie MoleculaireKa TiaPas encore d'évaluation
- Universite_Pierre_et_Marie_Curie-1Document207 pagesUniversite_Pierre_et_Marie_Curie-1farid.ayadPas encore d'évaluation
- Biologie GeniqueDocument183 pagesBiologie Geniqueuma merrakchiPas encore d'évaluation
- Acides Nucleiques 11Document66 pagesAcides Nucleiques 11Zakaria MftPas encore d'évaluation
- AMIAR 2016 ArchivageDocument244 pagesAMIAR 2016 ArchivageJIHED PRIMA PHONESTOREPas encore d'évaluation
- Technique de Bio MolDocument102 pagesTechnique de Bio Moloumouy115Pas encore d'évaluation
- Thèse Alaeddine SafiDocument202 pagesThèse Alaeddine SafiAlaeddine SafiPas encore d'évaluation
- RT PCRDocument16 pagesRT PCRpretty_kelly93Pas encore d'évaluation
- Bases Biologiques Fonction de Reproduction de Oreochromis Niloticus - SenegalDocument186 pagesBases Biologiques Fonction de Reproduction de Oreochromis Niloticus - SenegalConstantin FAKOUNDEPas encore d'évaluation
- Molécules InformationnellesDocument152 pagesMolécules Informationnellestaoufik akabliPas encore d'évaluation
- Tweet: La Synthèse Des ProtéinesDocument59 pagesTweet: La Synthèse Des ProtéinesNadaPas encore d'évaluation
- Rapport GCDocument108 pagesRapport GCazizatheonePas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument16 pagesRapport de Stagepraetf100% (1)
- Dosage Fer Sérique.Document8 pagesDosage Fer Sérique.GHERMI .M100% (1)
- HBDocument8 pagesHBGHERMI .M100% (1)
- BRBDocument7 pagesBRBGHERMI .MPas encore d'évaluation
- Lipides & LipoprotéineDocument106 pagesLipides & LipoprotéineGHERMI .M100% (1)
- Voies D'administrationDocument4 pagesVoies D'administrationGHERMI .M100% (5)
- Molécules Du Complexe Majeur D'histocompatibilitéDocument12 pagesMolécules Du Complexe Majeur D'histocompatibilitéGHERMI .M0% (1)
- Composés AzotésDocument139 pagesComposés AzotésGHERMI .MPas encore d'évaluation
- CancerologyDocument298 pagesCancerologyGHERMI .M67% (3)
- Lipides & LipoprotéineDocument106 pagesLipides & LipoprotéineGHERMI .M100% (1)
- ECB Des Prélev GenitauxDocument4 pagesECB Des Prélev GenitauxGHERMI .M100% (3)
- Les PhagocytesDocument34 pagesLes PhagocytesGHERMI .MPas encore d'évaluation
- Complément 06Document46 pagesComplément 06GHERMI .M100% (1)
- IntroDocument61 pagesIntroGHERMI .MPas encore d'évaluation
- Médicament & GrossesseDocument3 pagesMédicament & GrossesseGHERMI .M100% (1)
- Suivie ThérapeutiqueDocument4 pagesSuivie ThérapeutiqueGHERMI .M100% (1)