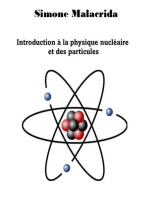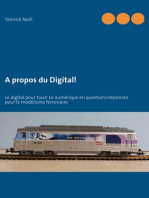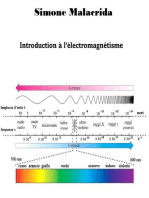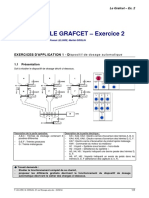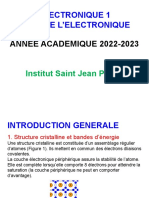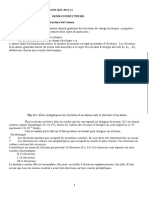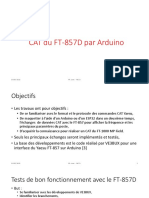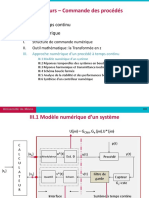Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1 Cours Diode Final Web
1 Cours Diode Final Web
Transféré par
fatibensouCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
1 Cours Diode Final Web
1 Cours Diode Final Web
Transféré par
fatibensouDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
SEMI CONDUCTEURS :
SEMI CONDUCTEURS :
DIODES
DIODES
-
-
TRANSISTRORS MOS
TRANSISTRORS MOS
AOP
AOP
Christian Dupaty Jean Max Dutertre
pour l EMSE
Daprs un diaporama original de Thomas Heiser
Institut d'Electronique du Solide et des Systmes
2
Paramtres
(coefficients)
Ne
Ns
Amplification
en puissance
Amplification et
Filtrage :
Conditionnement
Electronique
ANALOG!"E
Electronique
N"#E$!"E
Arc%itecture analogique & num'rique & analogique
Con(ertisseur
Analogique
Num'rique
Con(ertisseur
Num'rique
Analogique
"nit' de calcul
()*P +
#icrocontr,leur+
FPGA)
3
Instrumentation
Robotique
Communications
Multimdia
Systmes informatiques
Cartes mmoires
Pourquoi quelles applications ?
4
Histoire des semi-conducteurs
1904 invention de la Diode par John FLEMING Premier tube vide.
1904 Triode (Lampe) par L. DE FOREST
Muse
. Cest un amplificateur
d'intensit lectrique.
1919 Basculeur (flip-flop) de W. H. ECCLES et F. W. JORDAN .Il faudra
encore une quinzaine d'annes avant que l'on s'aperoive que ce circuit
pouvait servir de base l'utilisation lectronique de l'algbre de BOOLE.
1937 Additionneur binaire relais par G. STIBITZ
1942 Diodes au germanium Le germanium est un semi-conducteur, c'est
dire que "dop" par des impurets, il conduit dans un sens ou dans l'autre
suivant la nature de cette impuret. Par l'association d'un morceau de
germanium dop positivement (P) et un morceau dop ngativement (N), on
obtient une diode qui ne conduit le courant que dans un seul sens.
Et les transistors
Le transistor effet de champ a t invent en 1925-1928 par J.E. Lilienfeld (bien
avant le transistor bipolaire). Un brevet a t dpos, mais aucune ralisation n'a t
possible avant les annes 60.
1959 : MM. Attala, D. Kahng
et E. Labate fabrique le
premier transistor effet de
champ (FET)
!
Paralllement le premier prototype du transistor bipolaire est
fabriqu en 1947
"n 1#4$ % le &remier transistor bi&olaire
"n 1#$ % le &remier CI '(e)as*Instruments+
$
William Shockley (assis), John
Bardeen, and Walter Brattain,
1948.
William Shockley 1910-
1989
prix Nobel de physique
1956
,
Le premier rcepteur radio
transistors bipolaires
#
"n 1#$1 % le &remier -rocesseur
4004 dINTEL : 15/11/1971
(2250 Transistors Bipolaires,
108 KHz, 4bits)
1.
I/("0 I(1/I2M (u34ila core
2.1. &rocesseur I5M -67"R$ 8 I/("0 9"6/ et I(1/I2M
1.
#
(ransistors M6S
'/:ud tec;nolo<ique = taille de la <rille d>un transistor % 4nm+
11
"lectronique molculaire
Une molcule comme composant
"lectronique sur &lastique
Les technologies mergentes
12
Mais ?a ne se fait &as tout seul@@@
13
Contenu du cours d >lectronique analo<ique 1
1@ Introduction au) semi*conducteurs8 Aonction -/
2@ 0es Biodes
3@ 1&&lications des diodes
4@ 0es (ransistors C effet de c;am&
@ 1m&lificateur o&rationnel
14
*Electronique: composants et systmes d'application8 (;omas 0@ Dloyd8 Bunod8 2...
*Microlectronique8 Eacob Millman8 1rFin Grabel8 "discience International8 1##4
* "0"C(R6/IH2" Dondements et a&&lications B2/6B 2..!
*"0"C(R6/IH2" 1/106GIH2" I10J6I "ducaliFre 1##4
*Comprendre llectronique par la simulation", Serge Dusausay, Ed. Vuibert
*Principes dlectronique", A.P. Malvino, Dunod
*Microelectronics circuits", A.S. Sedra, K.C. Smith, Oxford University Press
*CMOS Analog Circuit Design", P.E. Allen, D.R. Holberg
*Design of Analog CMOS Integrated Circuits", B. Razavi, McGraw Hill
Bibliographie
1
0"S S"MI*C6/B2C("2RS
Introduction aux semi-conducteurs, la jonction PN
I Matriaux semi-conducteurs.
1 Introduction.
Quest ce quun semi-conducteur ?
Ni un conducteur, ni un isolant.
Colonne IVA !i, "e.
#ssociation IIIA-VA #s"a, etc.
17
I Matriaux semi-conducteurs
$ Mod%le des &andes dner'ie.
#tome de silicium le no(au com)orte 1* )rotons nua'e com)ortant 1* e
-
+)artition lectronique 1s
$
$s
$
$)
,
-s
$
-)
$
couc.e de
/alence * e
-
1*
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
1es lectrons /oluent sur des or&ites sta&les corres)ondant
2 des ni/eaux dner'ie discrets 3s)ars les uns des autres4.
5ner'ie
3e64
Ni/eaux dner'ie
lectronique dun
atome isol
18
I Matriaux semi-conducteurs
Principe dexclusion de Pauli deux lectrons ne )eu/ent occu)er le m7me tat
quantique.
5n consquence, si deux atomes identiques sont a))roc.s 2 une distance de lordre
de leur ra(on atomique les ni/eaux dner'ie se ddou&lent.
8ans le cas dun cristal, la multi)lication des ni/eaux cre des bandes dnergie
permise 3quasi-continuum4, s)ares )ar des bandes dnergie interdites 3c.-2-d. ne
contenant )as dtat sta&le )ossi&le )our les e
-
4.
5ner'ie
3e64
Ni/eaux dner'ie
lectronique de $
atomes )roc.es
5ner'ie
3e64
Ni/eaux dner'ie
lectronique dun
cristal
&ande )ermise
&ande interdite
"a)
Bande de valence contient les tats lectroniques des couc.es )ri).riques des
atomes du cristal 3c.-2-d. les e
-
de /alence, * )our le !i4
Bande de conduction &ande )ermise immdiatement su)rieure en ner'ie 2 la
&ande de /alence. 1es e
-
( sont quasi-li&res, ils ont rom)us leur lien a/ec leur atome
dori'ine, ils )ermettent la conduction dun courant.
19
- Com)araison isolants, conducteurs, et semi-conducteurs.
I Matriaux semi-conducteurs
Classi9ication en 9onction de leur rsisti/it :.m;
Isolant < 1=
,
.m
Conducteurs > 1=
-,
.m
!emi-conducteur intermdiaire
!emi-conducteur
5
'
? 1 e6
Isolant
5
'
? qqs e6
Conducteur
5
'
? = e6
|
\
|
=
s
l
R .
5ner'ie
3e64
5
'
conduction conduction
/alence
5ner'ie
3e64
5
'
conduction
/alence
5ner'ie
3e64
conduction
/alence
-==@A
!i "e #s"a
5' 3e64 1,1$ =,,, 1,*-
20
* 1e silicium.
a. !emi-conducteur intrins%que 3cristal )ur4.
I Matriaux semi-conducteurs
Cristal de silicium * e
-
de /alence
!i
association a/ec * atomes /oisins )our o&tenir B e
-
sur la couc.e de /alence 3r%'le
de loctet, la couc.e de /alence est sature4
!i !i !i !i
!i !i !i !i
!i !i !i !i
liaison co/alente
!tructure de la maille cristalline cu&ique 9ace centre
21
I Matriaux semi-conducteurs
Cration de )aires lectrons - trous
sous laction dun a))ort dner'ie t.ermique 3)ar exem)le4
5ner'ie
3e64
5
'
&. conduction
&. /alence
!i !i !i !i
!i !i !i !i
!i !i !i !i
1e &and'a) 5
'
re)rsente lner'ie minimale ncessaire )our rom)re la liaison.
8)lacement des e
-
li&res courant
22
8)lacement des trous de )roc.e en )roc.e courant 3de c.ar'es 04
I Matriaux semi-conducteurs
!i !i !i !i !i !i !i !i !i
!i !i !i !i
8ans un semi-conducteur il existe $ t()es de )orteurs de c.ar'es
C des )orteurs n'ati9s les lectrons de la &ande de conduction,
C et des )orteurs )ositi9s les trous de la &ande de /alence.
1e ).nom%ne de cration de )aires e
-
- trous saccom)a'ne dun ).nom%ne de
recom&inaison 3les e
-
li&res sont ca)turs )ar les trous, ils rede/iennent e
-
de /alence4
8ure de /ie dun )orteur D tem)s s)arant la recom&inaison de la 'nration.
23
1e cristal est lectriquement neutre
i
n p n = =
I Matriaux semi-conducteurs
[ ]
3
2
3
2
exp . .
|
|
\
|
= cm
kT
E
T A n
g
i
Concentration intrins%que de )orteurs 2 lquili&re t.ermod(namique
A cste s)ci9ique au matriau :cm
--
EA
-E$
;
E
g
&and'a) :e6;
k D 1,-B.1=
-$-
FEA
T tem)rature :A;
1oi daction de masse ) , ( .
2
g i
E T n p n =
elle est toujours /ri9ie )our un cristal 2 lquili&re t.ermique 3quil soit intrins%que ou non4.
3 10
10 . 4 , 1
cm n
i
300K, Si :
24
I Matriaux semi-conducteurs
P.nom%ne de trans)ort de c.ar'es
C courant de conduction cr sous laction dun c.am) lectrique,
C courant de di99usion cr )ar un 'radient de concentration de )orteurs.
densit de courant :#Ecm
$
;
V
T
= kT/q = $, m6 2 -==@A, )otentiel t.ermod(namique :6;
n grad V q E n q J
T n n n
+ =
r r
p grad V q E p q J
T p p p
=
r r
n,p
mo&ilit :cm
$
E6.s;
Pour le !i
n
= 1400 cm
2
/V.s,
p
= 500 cm
2
/V.s
25
I Matriaux semi-conducteurs
Intr7t des semi-conducteurs )ossi&ilit de contrGler la quantit de )orteurs de
c.ar'es li&res 3e
-
et trous4 et )ar consquent la rsisti/it.
Comment ? do)a'e, radiations, tem)rature, injection de courant, etc.
&. !emi-conducteur extrins%que de t()e N 3n'ati9 D si'ne des )orteurs de c.ar'e majoritaires4.
H&tenus )ar do)a'e D introduction datomes du 'rou)e V 3c9. classi9ication
)riodique, I e
-
sur la couc.e de /alence4 en lieu et )lace datomes de !i,
'nralement du ).os).ore P ou de larsenic As.
li&ration dun e
-
li&re, les * autres se liant aux atomes de !i /oisins 3atome
donneur4
!i !i !i !i
!i !i #s
0
!i
!i !i !i !i
-
5ner'ie
3e64
&. conduction
&. /alence
5
8
#s
0
cation 9ixe
26
I Matriaux semi-conducteurs
1e cristal 'arde sa neutralit lectrique 'lo&ale 32 c.aque lectron li&re donn )ar
les atomes dim)uret corres)ond un cation 9ixe4.
Porteurs de c.ar'es
C majoritaires e
-
tq n N
D
, concentration du do)a'e,
C minoritaires trous issus de la 'nrations t.ermique de )aires e
-
- trous tq
D i
N n p /
2
27
I Matriaux semi-conducteurs
c. !emi-conducteur extrins%que de t()e P 3)ositi9 D si'ne des )orteurs majoritaires4.
H&tenus )ar do)a'e D introduction datomes du 'rou)e III 3c9. classi9ication
)riodique, - e
-
sur la couc.e de /alence4 en lieu et )lace datomes de !i,
'nralement du &ore B ou du 'allium Ga.
seules trois liaisons co/alentes )eu/ent 7tre cres, la *
%me
reste incom)l%te, un
trou est cr )our c.aque atome de do)a'e. Il /a )ou/oir 7tre com&l )ar un e
-
dune
liaison co/alente )roc.e 3atome acce)teur4.
5ner'ie
3e64
&. conduction
&. /alence
5
#
J
-
anion 9ixe
0
!i !i !i !i
!i !i J !i
J
-
!i !i !i
28
I Matriaux semi-conducteurs
1e cristal 'arde sa neutralit lectrique 'lo&ale 3)our c.aque lectron li&re acce)t
)ar les atomes dim)uret crant un anion 9ixe, un trou est cr4.
Porteurs de c.ar'es
C majoritaires trous tq p N
A
, concentration de do)a'e,
C minoritaires e
-
issus de la 'nrations t.ermique de )aires e
-
- trous tq
A i
N n n /
2
d. P.nom%nes de 'nration et de recom&inaison.
'nration sous le99et da))ort dner'ie t.ermique, ).otonique, dun c.am)
lectrique, de radiations ionisantes, etc.
5ner'ie
3e64
&. conduction
&. /alence
5ner'ie
3e64
&. conduction
&. /alence
h h
I 1a jonction PN.
I Matriaux semi-conducteurs
Kn semi-conducteur seul 3N ou P4 )rsente )eu dintr7t, cest lassociation de
)lusieurs !C do)s qui )ermet de crer les com)osants semi-conducteurs. 1e )lus
sim)le dentre eux est la jonction PN 3ou diode4, il )ermet en outre da))r.ender le
9onctionnement des transistors.
a. Fonction PN non )olarise, 2 lquili&re.
ion 9ixe
trou
mo&ile
)aire e
-
- trou
minoritaire
ion 9ixe
e
-
mo&ile
)aire e
-
- trou
minoritaire
!emi-conducteur P !emi-conducteur N
majoritaire
majoritaire
Que se )asse-t-il si lon met en contact un s.-c. de t()e P a/ec un s.-c. de t()e N )our
raliser une jonction PN ? 3L #ttention L cest sim)lement une /ue de les)rit, ce nest )as ainsi que lon
)roc%de4
30
I Matriaux semi-conducteurs
Considrant la jonction dans son ensem&le, il existe un 'radient de )orteurs de
c.ar'es
cration dun courant de di99usion
C des trous mo&iles du s.-c. P /ers le s.-c. N, au moment de leur entre dans la
Mone N contenant des e
-
majoritaires les trous se recom&inent a/ec les e
-
,
C des e
-
mo&iles du s.-c. N /ers le s.-c. P, au moment de leur entre dans la Mone P
contenant des trous majoritaires les e
-
se recom&inent a/ec les trous.
C.aque trou 3res). e
-
4 majoritaire quittant le s.-c. P 3N4 laisse derri%re lui un anion
3cation4 9ixe et entraNne la))arition dun cation 3anion4 9ixe dans le s.-c. N 3P4 du 9ait
de sa recom&inaison a/ec un e
-
3trou4. Ces ions sont localiss 2 )roximit de la Mone de
contact entre les deux s.-c. 3la Mone de c.ar'e des)ace, OC54, ils sont 2 lori'ine de la
cration dun c.am) lectrique qui so))ose au courant de di99usion. Ce c.am)
lectrique est qui/alent 2 une di99rence de )otentiel a))ele barrire de potentiel
36
=
D =,P 6 )our le silicium, =,- 6 )our le 'ermanium4.
Kn tat dquili&re est atteint, )our lequel
C seuls qqs )orteurs majoritaires ont une ner'ie su99isante )our 9ranc.ir la OC5 et
contri&uer au courant de di99usion I
8
, il est com)ens )ar,
C un courant de saturation inverse, I
s
, cr )ar les )orteurs minoritaires lorsquQils
sont ca)turs )ar le c.am) lectrique de la OC5.
31
I Matriaux semi-conducteurs
Mone neutre
Fonction PN non
)olarise, 2
lquili&re
s.-c P
Mone neutre
s.-c N
Mone de c.ar'e
des)ace
E
5ner'ie
3e64
&. conduction
&. /alence
0
qV
s.-c N
6
=
&arri%re
de )otentiel
tq
OC5 D Mone de d)ltion D Mone dserte
D
I
s
I
|
|
\
|
=
2
0
ln .
i
D A
n
N N
q
kT
V
|
\
|
=
kT
eV
I I
s
0
0
exp .
32
I Matriaux semi-conducteurs
&. Fonction PN )olarise en direct.
P N
V
PN
> 0
+
I
PN
E
5ner'ie
3e64
&. conduction
&. /alence
( )
PN
V V q
0
6
alim
a&aissement de la &arri%re de )otentiel
rduction de la OC5 et du c.am) lectrique
33
I Matriaux semi-conducteurs
Hn ta&lit
(
= 1 .
T
PN
V
V
s PN
e I I
Hn retiendra que le courant tra/erse 9acilement une diode )olarise en direct
36
PN
< 6
=
4
+sistance d(namique dune jonction )olarise en direct
V
alim
= V
alim
+ dV I
PN
= I
PN
+ dI
Hn o&tient
PN
T
I
V
dI
dV
r = =
34
C.ar'e stocRe dans une jonction )olarise en direct
I Matriaux semi-conducteurs
Non )olaris
Polarisation
directe
#/ant de &loquer une jonction PN )olarise en directe il 9aut /acuer ces c.ar'es
en exc%s )ar ra))ort 2 la situation dquili&re courant in/erse transitoire 3c9.
tem)s de recou/rement dans la suite du cours4.
35
I Matriaux semi-conducteurs
E
5ner'ie
3e64
&. conduction
&. /alence
( )
lim 0 a
V V q +
c. Fonction PN )olarise en in/erse.
P N
V
PN
= - V
alim
< 0
+
I
PN
0
6
alim
au'mentation de la &arri%re de )otentiel
lar'issement de la OC5 et intensi9ication du c.am)
lectrique
36
I Matriaux semi-conducteurs
Claqua'e
Sension de claqua'e D tension in/erse limite su))orta&le au-del2 de laquelle a))arait le
).nom%ne da/alanc.e.
!ous le99et dune tension in/erse le/e les )orteurs minoritaires sont acclrs et
acqui%rent su99isamment dner'ie )our arrac.er 2 leur tour dautre e
-
de /alence lors
des c.ocs. Kne raction en c.aine a))arait.
le courant in/erse de/ient tr%s im)ortant 3claqua'e4.
le courant de di99usion 3)orteurs majoritaires4 est quasi-nul.
seul su&siste un courant in/erse tr%s 9ai&le, I
PN
= -I
s
, de )orteurs minoritaires.
37
I Matriaux semi-conducteurs
d. In9luence de la tem)rature.
C !ur I
s
courant dT aux )orteurs minoritaires crs )ar 'nration t.ermique, il au'mente
ra)idement a/ec S@ )our le !i il dou&le tout les P@C.
C !ur V
0
la &arri%re de )otentiel
)our le !i autour de -==@A elle dcroit de $ m6 )our une au'mentation de 1@C.
= / 2
0
mV
dT
dV
38
I Matriaux semi-conducteurs
, 1a diode 2 jonction PN.
P N
A K
anode URUat.ode
V
AK
I
AK
3#
)iff'rentes diodes : *-m.oles
)iode
)iode /ener
)iode *c%ott0-
)iode 1aricap
)iode 'lectro luminescente (LE))
1node K 1 L
Cat;ode K J L
"n inFerse &our la r<ulation
-our les commutations ra&ide
"n MD
Daut il la &rsenter N
4. 4.
4.
)iodes de signal (e2 3N435)
Fai.le intensit' (6usqu78 399 mA)
Fai.le tension in(erse (6usqu78 3991)
*ou(ent trs rapides (trr:39ns)
donc adapt'e 8 la commutation
;o<tier (erre (ou C#*)
L7anneau repre la cat%ode
#arquage le plus sou(ent en clair
41
)iodes de redressement (e2 3N5992)
Forte intensit' (3A)
Forte tension in(erse (6usqu78 39991)
Lente en commutation (trr=399ns)
r'ser('e au2 .asses fr'quences
;o<tier plastique
L7anneau repre la cat%ode
#arquage le plus sou(ent en clair
42
Biodes 0"Bs
C;oisies &our leur couleur8
luminosit et taille
0a tension If d&end de
la couleur 'ner<ie+
0>intensit est &ulse &our accroOtre
l>efficacit lumineuse
5icolores C deu) ou multicolore &ar
combinaisons de courants
Isoles ou assembles
43
)iodes de puissance
2tilises <nralement &our le
redressement de &uissance
Bans les onduleurs &ar e)em&le
ID P1..1
44
Autres diodes
SCHOTTKY pour la commutation rapide en
puissance et la faible chute Vf
TRANSIL pour absorber les courants dues
aux surtensions (protection aux dcharges)
PHOTODIODE polarise en inverse cest un
convertisseur lumire/courant
4
>? Les )iodes
I
d
V
d
>?3 )'finition
n Caractristique courant*
tension d>une diode
id'ale %
I
d
V
d
sous polarisation directe
V
d
.Q!" la diode # court$
circuit
i%e% conducteur parfait!
sous polarisation inverse V
d
&'!
la diode # circuit ou(ert
* Ce ty&e de com&osant est utile &our raliser des fonctions 'lectroniques telles
que le redressement d>une tension8 la mise en forme des si<nau) 'crRta<e8 +@
*0a diode 'mRme idale+ est un com&osant non@lin'aire
*6/ /" S1I( -1S D15RIH2"R 2/" BI6B" IB"10" SSSS
4!
>?> Caract'ristiques d7une diode r'elle 8 .ase de *ilicium
hyp: rgime
statique
tension et courant
indpendants du
temps!
V
d
*2 *1@ *1 *.@ . .@ 1
2.
!.
1..
14.
s
-our V
d
!"# la diode se com&orte comme un .on isolant %
s
) * p+ $ *,+ "
la diode est dite T.loqu'eA
dans ce domaine son com&ortement est a&&ro)imatiFement lin'aire
le courant Tin(erseQ8
s
# au<mente aFec la tem&rature
comportement linaire
-our V
d
$$ %"&'v# le courant au<mente rapidement aFec une (ariation C &eu &rs lin'aire
la diode est dite TpassanteA
mais I
d
n7est pas proportionnel C V
d
'il e)iste une Ttension seuilQU V
o
+
V
o
4$
V
d
*2 *1@ *1 *.@ . .@ 1
2.
!.
1..
14.
d
(
(
|
|
\
|
1
T
d
V m
V
s d
e I I
/one B du coude C % V
d
V.8U V
o
W % au<mentation e2ponentielle du courant
aFec 1m 2 'facteur Td>idalitQ+
V
-
# . / -0e "pour -#1''2 34"5678!" V
-
#34mV
e# *%4 *'
$*9
8oulom:" - la tem&rature en DEel(in
. # 183, 1.
*23
EXJ= constante de 5oltYmann
I
s
# courant in(erse
le com&ortement est fortement non@lin'aire
(ariation aFec la temp'rature
(q : pour Vd$$Vt le terme )*1+ est ne,li,eable
V
o
nfluence de - :
V
d
'C I
d
constant+ diminue de U2mIXZC
diode .loqu'e %
I
d
= I
;
dou.le tous les 1.ZC
diode passante %
diode en ;i!
4,
.one de claqua,e inverse
<rdre de grandeur :
V
ma=
= quelques diYaines de Iolts C qq 1...F
&eut conduire C la destruction &our
une diode non con?ue &our
fonctionner dans cette Yone@
V
ma=
# K -@I@ I L '-ea3 InFerse Iolta<e+
ou K -@R@I L '-ea3 ReFerse Iolta<e+
I
d
V
d
I
ma)
claquage par e>>et
?ener ou +(alanche
V
o
/imites de fonctionnement :
Il faut que V
d
I
d
#@
ma=
/imitation en puissance
V
d
I
d
#@
ma=
4#
>?F )iode dans un circuit et droite de c%arge
>?F?3 Point de fonctionnement
V
al
R
0
I
R
I
d
I
d
8 I
d
8 N
Comment dterminer la tension au) bornes d>une diode insre dans un
circuit et le courant qui la traFerseN
V
d
I
d
et I
d
res&ectent les Lois de Eirc%%off 'conserFation d >ner<ie8 loi des n:uds8
loi des mailles+
I
d
et I
d
sont sur la caract'ristique (1) du com&osant
1u point de fonctionnement de la diode+ 'I
d
8I
d
+ rem&lissent ces deu2 conditions
.
V
al
0A
L
V
al
0 1roite de char,e 2
I
d
I
d
8aractristique IV!
>?F?> )roite de c%arge
0oi de Jirc;off %
L
d al
d
R
V V
I
= L
3 1roite de char,e de la diode dans le circuit
Connaissant I
d
V
d
! on &eut d'terminer grap%iquement le &oint de fonctionnement
procdure (ala:le quelque soit la caractristique IV! du composant B
6n &eut GcalculerA le &oint de fonctionnement en dcriFant la diode &ar un
modle simplifi'?
43 Point de fonctionnement I
C
V
C
H
1
>?5 #od'les *tatiques 8 segments lin'aires
>?5?3? GPremireA appro2imation: )iode B id'ale C
6n n<li<e l>cart entre les caractristiques relle et idale
Ce modle est surtout utilis en electronique numrique
V
al
$"
I
d
V
d
V
al
pente#*0A
i
V
al
! "
I
d
V
d
V
al
V
al
A
i
I
d
V
d
I
d
V
d
&as de tension seuil
conducteur &arfait sous &olarisation directe
I
d
[.% circuit ouFert
diode :loque
0 <
d
V
al d d
V V I = = , 0
V
al
A
i
*c%'mas 'qui(alents :
V
al
A
i
0 , = =
d
i
al
d
V
R
V
I
diode passante
0
d
I
hyp: I
d
8 I
d
constants
2
>?5?> *econde appro2imation
I
d
V
d
I
d
V
d
tension seuil V
o
non nulle
caractristique directe
Ferticale '&as de Trsistance
srieQ+
I
d
[.% circuit ouFert
V
o
V
al
A
i
V
o
schmas quivalents :
diode passante
0
d
I
I
d
V
al
A
i
V
al
!V
o
V
d
V
al
o d
i
o al
d
V V
R
V V
I =
= ,
diode :loque
o d
V V <
al d d
V V I = = , 0
V
al
A
i
*c%'mas 'qui(alents
V
al
$V
o
I
d
V
d
V
al
pente#*0A
i
V
o
* @our une diode en 5i: V
o
9+H@9+I 1
3
>?5?F F
ime
Appro2imation
I
d
V
d
tension seuil V
o
non nulle
rsistance directe (
f
non nulle
I
d
[.% rsistance (
r
finie
V
d
1
V
o
6odlisation
pente # *0A
>
pente # *0A
r
) '
7aractristique relle
*2 *1@ *1 *.@ . .@ 1
Sc;mas quiFalents
I
d
V
d
V
al
pente#*0A
i
V
o
V
al
DV
o
:
V
al
A
i
I
d
V
d
V
al
A
r
diode :loque
V
al
&V
o
:
o d
V V <
V
al
A
i
diode passante
V
o
A
>
schmas quivalents :
o d d
V V I et 0
d f o d
I R V V + =
V
d
I
d
-our une diode en silicium8
V
o
# '"4$.@$I8 A
>
) q%q % *',
A
r
DD M,
4
(emarques :
d
d
f
I
V
R
0e c;oi) du modle d&end de la &rcision requise@
0es effets secondaires 'influence de la tem&rature8 non*linarit de la
caractristique inFerse8 @+ sont &ris en com&te &ar des modles &lus
Folus 'modles utiliss dans les simulateurs de circuit de ty&e S-IC"+@
.model D1N757 D(Is=2.453f Rs=2.9 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=78p
M=.4399
+ Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.762n Nr=2 Bv=9.1 Ibv=.48516 Nbv=.7022
+ Ibvl=1m Nbvl=.13785 Tbv1=604.396u)
* Motorola pid=1N757 case=DO-35
* 89-9-18 gjg
* Vz = 9.1 @ 20mA, Zz = 21 @ 1mA, Zz = 7.25 @ 5mA, Zz = 2.7 @ 20mA
Exemple de modle SPICE : diode 1N757
DIODE PARFAITE
RI
VF
Modle couramment utilis
89emple : Calcul de H du circuit suiFant8 en utilisant la Fime a&&ro)imation &our la diode@
V
al
# 6V
R
0
=
13
P
mA
R R
V V
I
L f
o al
d
33 , 4 =
+
= L
V I R V V
d f o d
66 , 0 et = + =
In>ormations sur la diode:
V
o
# '%4V ;i!
A
>
# *6
A
r
#1M
6V
13
I
o
A
>
I
d
P
I
d
hypothse initiale : diode passante
VV
d
DV
o
" I
d
D'!W
<2B
En utilisant la :ime appro9imation: A
>
# '" A
r
# ! V V mA I
d d
6 , 0 et 4 , 4 = = L
0a 2
ime
a&&ro)@ est souFent suffisante &our une tude qualitati(e du fonctionnement
d>un circuit @
>?5?5 Calcul du &oint de fonctionnement Fia l>utilisation des sc%'mas 'qui(alents %
!
8;8(7785:
1+
V
al
.
1M
Calcul de I
d
et V
d
&our %
a+V
al
# $6V
:! V
al
# 6V
7aractristiques des diodes :
A
>
# 1'8 V
o
#.@!I8 I
s
#' et A
A
infinie
8onseil: sim&lifier le circuit d>abord aFant de Fous lancer dans des
calculs
Val=-5v diode bloque Id=0, Vd =-5v
Val=+5v diode passante Vd=0,6v
Id=(Val-V0)/(50+30)=55mA
$
Eiodes au ;i A
>
# 1'8 V
o
#.@!I8 I
s
#' et A
A
infinie+
3+
2 I
B
1
B
2
R=1..
4+
1I
R=.
)'finir f
)'finir $ en appliquant
l7appro2imation >
($fJ9)
EKE$CCE*
If=(2-2*V0)/(R+2Rf)=5mA
IR=(1-Vf)/(R+Rf/2)=0.4/50=6.15mA
Ie 'I+
t
Icc
aFec (
entre
si<nal sinuso\dal basse frquence 1.MY
d>am&litude Ie
M19
= 1.I tel que le modle statique reste
Falable '&riode du si<nal [ tem&s de r&onse de la diode
&as d>effet Tca&acitifQ +
Etude du si,nal de sortie en >onction de l<amplitude du
si,nal d<entre :
-0,6v
Vcc+ 0,6v
Ie
M19
#
BI6B".
0a courbe R1'2+ re&rsente la tension
au) bornes de la diode8 lorsque la
diode conduit la tension C ses bornes
est ID8 quasiment constante
R1
1k
D1
1N914
R1(1) R1(1) R1(2)
!.
BI6B"1 0a courbe R1'2+ re&rsente la
tension au) bornes de la diode &lus
2F8 lorsque la diode conduit la
tension C ses bornes est ID
R1
1k
D1
1N914
R1(1) R1(1) R1(2)
V1
2V
!1
")em&les d>a&&lication de la diode en 06GIH2"
Ralisation d>un fonction lo<ique aFec R8 B
(moin sonore de la lumire e)terne non teinte dans les automobiles
*la lumire interne s>allume lorsque la &orte est
ouFerte et elle s>teint si la &orte est ferme
* 2ne alarme sonne si la lumire
e)terne est allume et la &orte s>ouFerte
* &as de sonnerie si la lumire e)terne
est allume mais la &orte est ferme
12I BC
0umire
e)trieure
0umire
intrieure
Bonner les deu) &ositions de la &orte et &lacer
un circuit ty&e Biode ] 1larme &our r&ondre
C ce besoin@
-orte
ferme
ouFerte
!2
>?L Comportement d-namique d 7une diode
>?L?3 Prambule : Anal-se statique M d-namique d7un circuit
LF +nalyse dynamique
ne concerne que les composantes (aria.les des tensions et courants 'ou Tsignau2Q
lectriques8 ou encore com&osantes alternatiFes (AC) +
L7anal-se d-namique permet de d'finir la fonction de transfert informationnelle
n>a d>intrRt que s>il y a des sources FariablesS
LF +nalyse statique
se limite au calcul des (aleurs mo-ennes des <randeurs lectriques
'ou composantes continues ()C) 8 ou encore com&osantes statiques+
L7anal-se statique permet de d'finir le point de polarisation
* = 1nalyse com<e du circuit si seules des sources statiques sont &rsentes
=otation : lettres ma6uscules &our les com&osantes continues
lettres minuscules &our les com&osantes (aria.les
!3
llustration : "tude la tension au) bornes d>un com&osant insr dans un circuit@
A
*
A
3
Vt!#VG(t!
V
E
(
e
hypothses:
(
e
# signal sinusoHdal" I (aleur moyenne nulle
V
E
# source statique
Principe de superposition :
* Comme tous les com&osants sont lin'aires8 le &rinci&e de su&er&osition s>a&&lique
la source statique V
E
est C l>ori<ine de V " et (
e
est C l>ori<ine de (
7alcul complet
( ) ( ) [ ] ( ) t v
R R
R
V
R R
R
t v V
R R
R
t V
e E e E
2 1
2
2 1
2
2 1
2
+
+
+
= +
+
=
V
(t!
!4
V
E
A
*
A
3
V
>nalyse statique :
schma statique du circuit
E
V
R R
R
V
2 1
2
+
=
>nalyse dynamique :V
E
# '
( ) ( ) t v
R R
R
t v
e
2 1
2
+
=
(
e
A
*
A
3
?schma dynamique@
(
2ne source de tension statique corres&ond C un Tcourt@circuit d-namiqueQ
0 =
e
v
En statique8 une source de tension (aria.le 8 (aleur mo-enne nulle corres&ond C un
court@circuit
!
>utres e9emples:
(
e
I
o
A
*
A
3
A
1
Vt!#VG(t!
3)
2ne source de courant statique est quiFalent en r'gime d-namique C un circuit
ou(ert? Jpuisque i)t+3"AK
5chma dynamique
(
e
A
*
A
3
A
1
(
( )
( )
3 2 1
3
R R R
t v R
t v
e
+ +
=
5chma statique
I
o
A
*
A
3
A
1
V
o
I
R R R
R R
V
3 2 1
3 1
+ +
=
!!
>)
Vt!
(
g
A
g
V
al
A
*
A
3
8
5chma statique :
al
V
R R
R
V
2 1
2
+
=
C frquence nulle 8 = circuit ouFert
* 8 = com&osant linaire caractris &ar une im&dance
qui d&end de la frquence du si<nal
V
V
al
A
*
A
3
!$
5chma dynamique :
(
(
g
A
g
A
*
A
3
schma qui(alent dynamique
g
g
v
Z R R
R R
v
+
=
1 2
1 2
//
//
jC
R Z
g g
1
avec + =
&our suffisamment leFe % g
g
v
R R R
R R
v
+
=
1 2
1 2
//
//
jC
Z
c
1
=
?
8
g g
R Z
et
1 Ttrs ;autesQ frquences 'C &rciser suiFant le cas+8 le condensateur &eut Rtre
rem&lac &ar un court*circuit@
VCC
R1
10k
R2
10k
R3
100
C1
100u
VE
AMP=1V
FREQ=1000Hz
B1
10V
R1(2)
Ve
POLARISATION et
signal
!#
0e principe de superposition n>est &lus (ala.le en &rsence de com&osants non@
lin'aires N
89trapolations possibles:
le point de fonctionnement reste dans un des domaines de lin'arit' du
com&osant non*linaire
l>amplitude du signal est suffisamment fai.le &our que le com&ortement du
com&osant reste appro2imati(ement lin'aire@
Gmodle lin'aire petits signau2 de la diode
$.
Iariation de fai.le amplitude autour du &oint de fonctionnement statique H %
la caractristique I
d
V
d
! &eut Rtre appro2im'e par la tangente en !
d
Q
d
d
d
v
dV
dI
i
sc%'ma 'qui(alent d-namique
correspondant au point ! :
1
Q
d
d
dV
dI
= Tr'sistance
d-namiqueQ de la
diode
I
d
I
d
I
o
H
Q
d
d
dV
dI
pente :
Q
d
I
Q
d
V
3Li
d
L
2| (L
>?L?> #odle petits signau2 (.asses fr'quences)
* Ce sc;ma ne &eut Rtre utilis !"E &our une analyse d-namique du circuit N
hypothse: Fariation suffisamment lente 'basse frquence+ &our que la
caractristique TstatiqueQ reste Falable@
$1
Notation :
r
>
# # rsistance dynamique pour V
d
C
D '
r
r
# # rsistance dynamique pour V
d
C
& '
1
0
>
d
V
d
d
dV
dI
1
0
<
d
V
d
d
dV
dI
* C temp'rature am.iante %
( )
( ) 1
25
= m
mA I
r
d
f
-our V
d
DD V
o
" r
>
A
>
-our V
d
& ' " r
r
A
r
-our V
d
J'" )V
o
K "
d
T
mV
V
s
T
s
mV
V
s
d
V
d
d
f
I
V
m e I
mV
I e I
dV
d
dV
dI
r
T
d
T
d
d
=
(
(
=
(
(
|
|
\
|
=
1
1
1
.
1
.
* &roc;e de V
o
la caractristique IV! s>carte de la loi e)&onentielle
r
>
ne deFient Aamais in>rieure I A
>
'Foir courbe e)&rimentale+
Id
$2
89emple :
V
d
t!
V
e
(
e
A
a
*.
8
*',M
E
A
:
3.
I
>nalyse statique :
V V mA I
D D
62 , 0 , 2 , 2
2000
6 , 0 5
=
diode: ;i" A
>
# *' " V
o
# '"4V "
-emprature : 1''2
( ) t v
e
= 2 10 sin 1 , 0
3
>nalyse dynamique : , 12
2 , 2
26
=
f
r
a c
R Z << =16
;chma dynamique :
*.
(
e
3.
) *3
(
d
( ) t v
d
2 10 sin 10 2 , 1
3 3
1m&litude des ondulations r'siduelles : 182 mI
MVe!#*2NO" '"*V
.
1
C
Z
c
=
$3
BI6B"3
R1
1k
D1
1N914
R1(1) R1(1)
D1(A)
V1
5V
C1
10uF
R2
2k
$4
>?L?F $'ponse fr'quentielle des diodes
Limitation 8 %aute fr'quence :
-our des raisons p%-siques+ le courant I
d
ne &eut suiFre les Fariations
instantanes de V
d
au delC d>une certaine frquence@
0e temps de r'ponse de la diode d&end :
du sens de (ariation '&assant bloqu8 bloqu &assant+ 'si<nau) de
<rande am&litude+
du point de fonctionnement statique '&our des &etites Fariations+
a&&arition d>un d&;asa<e entre I
d
et V
d
le modle d-namique .asse fr'quence n>est &lus Falable
$
1ariation de 1
d
de fai.le amplitude+ sous polarisation directe (V
d
4
$9)
* une petite (ariation de 1
d
induit une grande (ariation
d
8 c>est *C*dire des
c;ar<es qui traFersent la diode
* 1 ;aute frquence8 des c;ar<es restent Tstoc3esQ dans la diode 'elle n>arriFent
&as C suiFre les Fariations de I
d
+
* U Com&ortement d>un condensateur8 dont la Faleur au<mente aFec I
d
c> physique des dispositi>s semiconducteurs!
<rdre de grandeur : 8
d
) P' nM I *m+" 1''2&
6odle petits si,nau9 haute frquence )V
d
$"+ :
T
I
C
Q
d
d
# capacit de di>>usion
r
c
r
sc
* C basse frquence % r
c
B r
sc
3 r
f
* la s&aration en deu) rsistances tient mieu) com&te des &;nomnes &;ysiques en Aeu@
$!
suite de l>e)em&le &rcdent%
V
d
t!
(
e
A
a
*.
8
*',M
E
A
:
3.
I
I
d
# 3"3m+ 8
di>>
)*''nM
1 quelle frquence la ca&acit dynamique commence*
t*elle C influencer la tension (
d
N
|
|
\
|
th
v
v
log
log >
*3d5
kHz
C r
f
diff th
130
2
1
=
;chma dynamique en tenant compte de 8
di>>
:
*.
(
e
) *3
(
C
diff
r
th
)**
(
th
(
C
diff = K filtre L &asse*bas
';y& sim&lificatrice% r
c
U.+
$$
)iode en B commutation C : Oemps de recou(rement direct et in(erse
o le tem&s de r&onse d&end du courant aFant commutation@
o ordre de <randeur % &s ns
0e temps de r'ponse fini de la diode s>obserFe aussi en K mode impulsionnel L8 lorsque
la diode bascule d>un tat &assant Fers un tat bloqu et Fice*Fersa@
V
d
V
g
A
1
o
V
,
t
$V
A
V
C
temps de rponse
$V
A
V
d
V
o
d
V
C
$V
o
!0A
$V
A
0A
$,
0e simulateur S-IC" tient com&te du
tem&s de recouFrement des diodes
'1/#14 Fs 1/4..4+
BI6B"4
R1
1k
R1(1) R1(2) R1(1)
D1
1N4004
R1
1k
R1(1) R1(2) R1(1)
D1
1N914
$#
>?H !uelques diodes sp'ciales
<rdre de grandeur : V
?
)*$*'' V " I
min
)'"'*$ '"*m+" @
ma=
rgime de >onctionnement
* Biode con?ue &our fonctionner dans la Pone de claquage in(erse8 caractrise &ar
une tension seuil n<atiFe ou K tension /ener L 'I
^
+
>?H?3 )iode /ener
$I
ma=
ma9
: courant ma)@ su&&ort &ar la diode
'&uissance ma)%@
ma=
)V
?
I
ma=
+
$V
O
V
.
: tension ^ener '&ar dfinition% I
^
P.+
$I
min
min
: courant minimal 'en Faleur absolue+ au
delC duquel commence le domaine linaire
T^enerQ
I
d
V
d
n Caract'ristiques
,.
I
d
V
d
$V
O
$I
min
$I
ma=
&ente
*0A
O
sc%'mas 'qui(alents
%-p : 4 domaine ^ener
4
Modle statique :
V
O
V
d
I
d
Q
A
O
Modle dynamique" :asses >rquences"
>ai:les signau= :
z
Q
d
d
z
R
dV
dI
r
(
(
=
1
&our _I
d
L DI
min
,1
>?H?> )iode 'lectroluminescente (ou LE))
Principe : 0a circulation du courant &roFoque la luminescence
Donctionnement sous polarisation directe (1 = 1
o
)
0>intensit lumineuse courant lectriqueI
d
/e marc;e &as aFec le Si
V
o
.@$I S
V
o
d&end de la couleur
,2
Couleur
Longueur donde
(nm)
Tension de seuil (V)
IR >760 Vs<1.63
Rouge 610<<760 1.63<Vs<2.03
Orange 590<<610 2.03<Vs<2.10
Jaune 570<<590 2.10<Vs<2.18
Vert 500<<570 2.18<Vs<2.48
Bleu 450<<500 2.48<Vs<2.76
Violet 400<<450 2.76<Vs<3.1
Ultraviolet <400 Vs>3.1
Blanc xxx Vs=3,5
,3
F?L PROOO)O)E
-olarise en inFerse elle &roduit un courant
&ro&ortionnel C l>ner<ie lumineuse re?ue
'<nralement dans l>infrarou<e+
Ca&teur CCB
,4
F? Applications des )iodes
F?3 Limiteur de crSte (clipping)
Fonction : -rot<er les circuits sensibles 'circuits int<rs8 am&lificateur C <rand <ain+
contre une tension d>entre tro& leFe ou d>une &olarit donne@
I
d
V
d
#V
e
V
g
H
V
o
droite de charge
e g
g
Z R
V
//
/imite d<utilisation : -uissance ma)imale tolre &ar la diode@
7lippin, parallle
V
e
V
g
circuit I
protger
A
g
?
e
diode 00 charge!
7lippin, srie :
V
e
t!
circuit I
protger
?
e
V
g
A
g
,
-rotection &ar diode
%
V
ma=&'
) $ '%QV
V
+
U2.8$I
la conduction de la
diode en<endre un
courant transitoire et
diminue la tension
inductiFe@
]2.I
V
I
]2.I
L
I
V
ouFerture de l>interru&teur
%
V
+
]
risque de dc;ar<e
lectrique C traFers
l>interru&teur ouFert
LFinterrupteur pourrait
Rtre un transistor%%%
=
dt
dI
L V
Protection contre une surtension inductive )e9: ouvertureC fermeture d<un relais+
+
,!
Lors de la rupture de courant
(relche du bouton) la diode
commence conduite lorsque
Vs atteint VCC+0,7v.
Lnergie accumule dans L1
est dissipe dans la
rsistance interne de la diode
durant environ 250uS, il y a
ensuite un phnomne
oscillatoire due la capacit
de la diode (circuit LC //), ce
phnomne apparait lorsque
le point de fonctionnement de
la diode sapproche du coude
(fonctionnement non linaire).
,$
A suivre .
Le transistor effet de champ
Pour prparer la prochaine squence :
Bien connaitre la loi dOhm, les thormes de superposition et de Millman
Intgrer les concepts de grandeurs alternatives et continues, le principe de
polarisation et de variation dune grandeur lectrique autour dun point de
repos.
Revoir les exercices, tre capable dexpliquer les formes et grandeurs des
signaux sur les graphes temporels.
Vous aimerez peut-être aussi
- Exercices d'optique et d'électromagnétismeD'EverandExercices d'optique et d'électromagnétismeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Introduction à la physique nucléaire et des particulesD'EverandIntroduction à la physique nucléaire et des particulesPas encore d'évaluation
- A propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireD'EverandA propos du Digital!: Le digital pour tous! Le numérique en questions/réponses pour le modélisme ferroviaireÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)
- Semi Conducteurs Et Jonction PN GénralitésDocument15 pagesSemi Conducteurs Et Jonction PN GénralitésHamdi100% (1)
- Cours Réseaux ÉlectriquesDocument196 pagesCours Réseaux ÉlectriquesMeriem Chiboub100% (1)
- Grafcet ExercicesDocument15 pagesGrafcet Exercicesياسين بوعيشي57% (7)
- G7-Ex6 Machine-Rainur PDFDocument6 pagesG7-Ex6 Machine-Rainur PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- TD 35 Corrigé - Systèmes Séquentiels - GRAFCET - Structure Particulière - Grafcet Partiel - Compteur PDFDocument4 pagesTD 35 Corrigé - Systèmes Séquentiels - GRAFCET - Structure Particulière - Grafcet Partiel - Compteur PDFKhaled Ouni100% (2)
- Cours de Physique Des Semi Conducteur PDFDocument92 pagesCours de Physique Des Semi Conducteur PDFidannben80% (5)
- Grafcet ExerciceDocument2 pagesGrafcet ExerciceKhaled Ouni33% (3)
- Corrigé TD6 Communications NumériquesDocument19 pagesCorrigé TD6 Communications Numériquesghania boukhelifaPas encore d'évaluation
- Cours IA PDFDocument88 pagesCours IA PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- ElectricitéDocument40 pagesElectricitéEmy AB100% (1)
- Technologie ZigBee / 802.15.4 ProtocolesDocument29 pagesTechnologie ZigBee / 802.15.4 Protocolesمسافر عابرPas encore d'évaluation
- Généralité Sur Les SemiconducteursDocument40 pagesGénéralité Sur Les SemiconducteursMilagro Rosita50% (2)
- Cours Bac S Si - Acquerir L Information - Les CapteursDocument27 pagesCours Bac S Si - Acquerir L Information - Les CapteursKhaled Ouni100% (1)
- DSPDocument123 pagesDSPسعيدة فرحاتPas encore d'évaluation
- Fermions: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandFermions: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Semi ConDocument6 pagesSemi ConSeVILLA8DzPas encore d'évaluation
- TD SCDocument3 pagesTD SCkarim18000100% (2)
- 1 Cours Diode Final WebDocument87 pages1 Cours Diode Final Webmeribout adelPas encore d'évaluation
- Chap1 Conductivité Électrique Des MatériauxDocument36 pagesChap1 Conductivité Électrique Des MatériauxTunENSTAB67% (3)
- SemiDocument117 pagesSemianassPas encore d'évaluation
- La Diode A Jonction Et Le Transistor PDFDocument33 pagesLa Diode A Jonction Et Le Transistor PDFSoumia Lioness Orihimie100% (1)
- Chapit I +II PDFDocument63 pagesChapit I +II PDFGhïž LanëPas encore d'évaluation
- Elec Cours 3Document13 pagesElec Cours 3Fétigué OuattPas encore d'évaluation
- Electrotechnique GénéraleDocument164 pagesElectrotechnique Généraleboukdir hichamPas encore d'évaluation
- Cours EBDocument62 pagesCours EBmehdiPas encore d'évaluation
- chp1 CEF 2023Document78 pageschp1 CEF 2023mohaPas encore d'évaluation
- CE1Document53 pagesCE1Mouad ImzouraPas encore d'évaluation
- 12 Effet HallDocument22 pages12 Effet HallMohamed AIT KASSIPas encore d'évaluation
- 23 Propriétés Electroniques Des Semicond - Rabat - 2023Document86 pages23 Propriétés Electroniques Des Semicond - Rabat - 2023yahiajaber49Pas encore d'évaluation
- Chap1 S-C & Jonction PNDocument7 pagesChap1 S-C & Jonction PNzwawzakiPas encore d'évaluation
- chp1 CEF 2021Document50 pageschp1 CEF 2021Adnane KannanePas encore d'évaluation
- Semi Cond PDFDocument47 pagesSemi Cond PDFAlhadithAssahihPas encore d'évaluation
- Mettre Au Point Des Circuits de RedressementDocument19 pagesMettre Au Point Des Circuits de RedressementLaiLa LouikPas encore d'évaluation
- Chap 7 BisDocument8 pagesChap 7 BisFarid KhouchaPas encore d'évaluation
- Émission ThermoélectroniqueDocument12 pagesÉmission ThermoélectroniqueDocteur Albert TouatiPas encore d'évaluation
- Cours Bases de La Conversion Photovoltaïque: Fssm-Uca 2021/2022Document32 pagesCours Bases de La Conversion Photovoltaïque: Fssm-Uca 2021/2022Hamid InekachPas encore d'évaluation
- Chapitre III Les Semi ConducteursfDocument18 pagesChapitre III Les Semi ConducteursfBadie BkchPas encore d'évaluation
- Cours Et TD Propriètés ElectriquesDocument61 pagesCours Et TD Propriètés ElectriquesWiame NaimPas encore d'évaluation
- CCA1Document5 pagesCCA1Đàm ThếPas encore d'évaluation
- ElnAnalognv PDFDocument80 pagesElnAnalognv PDFZH HamzaPas encore d'évaluation
- Séance - 1 - Int - Chap1 - Electronique1 (Repaired)Document44 pagesSéance - 1 - Int - Chap1 - Electronique1 (Repaired)Ndjidama youssoufaPas encore d'évaluation
- Chapitre-1-Cours Etat Art GEDocument10 pagesChapitre-1-Cours Etat Art GEDaRk SoUlPas encore d'évaluation
- CHP 01 - Les Semi-Conducteurs PDFDocument70 pagesCHP 01 - Les Semi-Conducteurs PDFDouaa BELHADJPas encore d'évaluation
- Cours M1EEA Papier 2013 PDFDocument68 pagesCours M1EEA Papier 2013 PDFlahceneliysaPas encore d'évaluation
- 02 - Structure Atomique - Liaisons Interatomiques - Etats de La Matiere (Mode de Compatibilité)Document44 pages02 - Structure Atomique - Liaisons Interatomiques - Etats de La Matiere (Mode de Compatibilité)Imane NahPas encore d'évaluation
- 2 - Notions de BaseDocument55 pages2 - Notions de BaseQOTEYBA AOUNIPas encore d'évaluation
- Physique Et Technologie Des Composants de PuissanceDocument33 pagesPhysique Et Technologie Des Composants de PuissancetounsimedPas encore d'évaluation
- ElectroniqueAnalogique - 1 Prof EL ABBADIDocument56 pagesElectroniqueAnalogique - 1 Prof EL ABBADIchriaiPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 SMP4 Electronique Print. 2017Document34 pagesChapitre 1 SMP4 Electronique Print. 2017Ayoub BahtatPas encore d'évaluation
- Electricite3 CompletDocument66 pagesElectricite3 CompletayouzyouftnPas encore d'évaluation
- Cours Etat de Lart Du Génie ElectriqueDocument23 pagesCours Etat de Lart Du Génie ElectriqueAdel MomoPas encore d'évaluation
- Support Cours ENA 1GE 2023 - 2024Document71 pagesSupport Cours ENA 1GE 2023 - 2024DiopPas encore d'évaluation
- Télécommunication Optique Chapitre IIIDocument91 pagesTélécommunication Optique Chapitre IIIOThmane CheyadmiPas encore d'évaluation
- Chapitre0 SemiconducteurDocument8 pagesChapitre0 SemiconducteurAbdo KerroumiPas encore d'évaluation
- TP EffetHallDocument21 pagesTP EffetHallMohamed DallagiPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Génie Eletrique - Phy SolideDocument29 pagesChapitre 3 - Génie Eletrique - Phy SolideRahma DardouriPas encore d'évaluation
- Chapitre 06 - Les Semiconducteurs de Puissance, La DiodeDocument39 pagesChapitre 06 - Les Semiconducteurs de Puissance, La DiodeAymen ChaairaPas encore d'évaluation
- Diode (V1)Document26 pagesDiode (V1)mehdiPas encore d'évaluation
- MC EN1 Ch1Document27 pagesMC EN1 Ch1MaryPas encore d'évaluation
- Poly Electronik 1Document76 pagesPoly Electronik 1fatima zahra ettalhyPas encore d'évaluation
- CHAP - II TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 2020L1GInfo&GEI - S1EtuDocument31 pagesCHAP - II TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 2020L1GInfo&GEI - S1EtuNÿ ĀntsøPas encore d'évaluation
- Circuits Analogiques - Cours PDFDocument158 pagesCircuits Analogiques - Cours PDFJanice Rice100% (6)
- Atelier 07 Hmi RTXDocument17 pagesAtelier 07 Hmi RTXKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Cours AcquisitionDocument60 pagesCours AcquisitionKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Poly ADC COURS 1ste 1617 PDFDocument53 pagesPoly ADC COURS 1ste 1617 PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Chapitre 7Document42 pagesChapitre 7Khaled OuniPas encore d'évaluation
- Automate Programmable IndustrielleDocument5 pagesAutomate Programmable IndustrielleKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Bac2002 Distrib Cafe PDFDocument17 pagesBac2002 Distrib Cafe PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Introduction PDFDocument28 pagesIntroduction PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- d000004 Regulflex Ligne Complete PDFDocument32 pagesd000004 Regulflex Ligne Complete PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Grafcet TDDocument11 pagesGrafcet TDKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Traitement SurfaceDocument10 pagesTraitement SurfaceKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Gemma PDFDocument54 pagesGemma PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Le GemmaDocument38 pagesChapitre 5 Le GemmaKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Reseaux Communication Industriels PDFDocument190 pagesReseaux Communication Industriels PDFKhaled Ouni0% (1)
- Analyse Temporelle GrafcetDocument2 pagesAnalyse Temporelle GrafcetKhaled Ouni100% (1)
- Mini Projet DSPDocument12 pagesMini Projet DSPSami FarsiPas encore d'évaluation
- BENAHMED Canevas EvaluationDocument21 pagesBENAHMED Canevas EvaluationKamal ZeghdarPas encore d'évaluation
- Exercices QCM Telecommunication Master1Document2 pagesExercices QCM Telecommunication Master1Ra Bou100% (2)
- Structure Machine 2018 - 2019Document39 pagesStructure Machine 2018 - 2019iKqliPas encore d'évaluation
- Epreuve de Telecommunication: Institut Superieur Bilingue Suzanna (Isbs)Document3 pagesEpreuve de Telecommunication: Institut Superieur Bilingue Suzanna (Isbs)Ghislain Franklin DjomkamPas encore d'évaluation
- Compatibilite Document FinalDocument46 pagesCompatibilite Document FinalSylvain NgahPas encore d'évaluation
- 86 Portail Dossier TechniqueDocument22 pages86 Portail Dossier Techniquemohammed.majdoub69160Pas encore d'évaluation
- Catalouge Tp-Link (PDFDrive) PDFDocument62 pagesCatalouge Tp-Link (PDFDrive) PDFcatrdor2012Pas encore d'évaluation
- CAT Arduino FT 857D V2Document13 pagesCAT Arduino FT 857D V2yoga newPas encore d'évaluation
- Ligne 1 CompletDocument34 pagesLigne 1 CompletAnge Miniminione Sims SimoPas encore d'évaluation
- GET2001PODocument5 pagesGET2001POmouf zerargaPas encore d'évaluation
- 01 Chapitre 1Document42 pages01 Chapitre 1Amin Kech100% (1)
- Cours Transmission Chap1 1BTS RIT IPS 2021 22Document13 pagesCours Transmission Chap1 1BTS RIT IPS 2021 22yoannaffantodji750Pas encore d'évaluation
- Recherche Sur MOD Et DEMOD-SABARI-MBAREK-GECSI1 N°39Document18 pagesRecherche Sur MOD Et DEMOD-SABARI-MBAREK-GECSI1 N°39M'barek SabariPas encore d'évaluation
- Rapport PfaDocument35 pagesRapport PfaSabra SmariPas encore d'évaluation
- Abb Pvi-10.0-12.5-Bcd.00533-FrDocument4 pagesAbb Pvi-10.0-12.5-Bcd.00533-FrsalmaPas encore d'évaluation
- Yale PC Service Tool V4.84 Guide D'installation Et D'utilisationDocument83 pagesYale PC Service Tool V4.84 Guide D'installation Et D'utilisationKristian FonPas encore d'évaluation
- Presonus StudioLive1602 Manuel FRDocument88 pagesPresonus StudioLive1602 Manuel FRMichael Shalys MorellePas encore d'évaluation
- Implementation en VHDL FPGA Dafficheur VDocument357 pagesImplementation en VHDL FPGA Dafficheur Vyoussef hadafPas encore d'évaluation
- Circuit Électronique EnetpDocument10 pagesCircuit Électronique Enetpdiallob83maxiPas encore d'évaluation
- Aide À La Conception de Lignes Microrubans À Onde Lente, Application Aux Coupleurs Et Dispositifs Passifs Non Reciproque These-Luong-Duc-Long-2018Document149 pagesAide À La Conception de Lignes Microrubans À Onde Lente, Application Aux Coupleurs Et Dispositifs Passifs Non Reciproque These-Luong-Duc-Long-2018rouxPas encore d'évaluation
- Commande Numérique Partie2Document83 pagesCommande Numérique Partie2FLASPas encore d'évaluation
- Ouiles Said AdlaneDocument118 pagesOuiles Said Adlanemed medPas encore d'évaluation
- RAPPORT TPDocument7 pagesRAPPORT TPMohamed BoukhalfaPas encore d'évaluation
- TP 5 - Kit Grove - ArduinoDocument5 pagesTP 5 - Kit Grove - ArduinoKhaled Kechaou0% (1)
- CV Ibrahim1Document3 pagesCV Ibrahim1Ibrahim Ngueyon DjoukouePas encore d'évaluation
- Notice Téléviseur 4k Smart Essentiel BDocument29 pagesNotice Téléviseur 4k Smart Essentiel Bfearfox990Pas encore d'évaluation