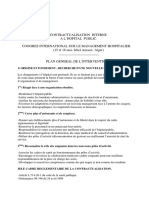Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc Bna
Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc Bna
Transféré par
Ilyas HamdiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc Bna
Controle Interne Finalite de L Audit Interne Etude de Cas Audit Du Cycle de Financement Des Operations de Commerce Exterieur Par Credit Documentaire Credoc Bna
Transféré par
Ilyas HamdiDroits d'auteur :
Formats disponibles
REPUBLIQUE ALGRIENNE DMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE (ESC) DALGER
Mmoire labor pour lobtention du diplme de
Post-Graduation Spcialise (PGS) en Comptabilit et Audit
Thme
Contrle interne : Finalit de lAudit Interne
Etude de cas : Audit du cycle de financement des oprations de
Commerce extrieur par Crdit Documentaire Credoc ; (BNA)
Elabor par Encadr par
Belimane Sarah Benziadi Djamel
Promotion: 2009/2010
REPUBLIQUE ALGRIENNE DMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE (ESC) DALGER
Mmoire labor pour lobtention du diplme de
Post-Graduation Spcialise (PGS) en Comptabilit et Audit
Thme
Contrle interne : Finalit de lAudit Interne
Etude de cas : Audit du cycle de financement des oprations Commerce
extrieur par Crdit Documentaire Credoc ; (BNA)
Elabor par Encadr par
Belimane Sarah Benziadi Djamel
Promotion: 2009/2010
Remerciements
Remerciements
Je remercie dabord le bon Dieu qui ma donn le courage et la
volont dlaborer ce travail.
Cest avec un grand respect que je tiens remercier mon
encadreur M. Benziadi Djamel, pour son aide, ses conseils, et son
orientation tout au long de la prparation de ce travail.
Tous mes vifs remerciements et ma profonde reconnaissance
lensemble du personnel de la BNA, notamment le directeur
M.Djebari, Melle Chikhi, Melle Haneche (Direction daudit interne):
Mme Yahiaoui, Mlle Kessali, M.Adjaoud (DRE Bouzareah 194) ; ainsi
que Mme Sahnoune ; Mme Hassine, Mme Charikhi ; Mme Chouadria,
M.Hadibi, M. Benadla, Mlle Sehamdi ; Mme Zaidi, et Melle Toumi
(Agence Principale 647) qui je tiens tmoigner ma sincre gratitude
pour leur disponibilit qui nont pas cess de prodiguer durant toute la
dure de mon stage.
Enfin, mes remerciements sont adresss tous ceux qui sans avoir
t impliqu directement dans le travail, ont toujours t dun grand
support, et que par leur appui et encouragement ont rendu possible ce
travail.
Merci tous.
Ddicace
Ddicace
ceux qui ont fait de moi ce que je suis aujourdhui, ceux qui je
dois tout, ceux qui ont toujours t l pour moi, ceux qui ont t lart
qui ma projet ce jour, je ddie ce modeste tmoignage de mon
immense gratitude, reconnaissance et ma tendre affection. A mes trs
chers parents.
mes frres, ma sur et toute ma famille petits et grands et tous
qui portent le nom Belimane et Kaouadji.
A la mmoire de ma grand-mre "NANA", et mon oncle que dieu
l'accueillent en son vaste paradis.
A ma trs chre grand-mre (Maternelle) Mani.
mes trs chre amies presque surs le Trinme Imene , Afaf,
Moufida, Sarah, Djazia, Kenza, Mira, Amel qui mont toujours aides
quand jen avais besoin et qui je souhaite toute la russite dans leur
vie.
tous amis (e) et camarades de lEcole Suprieure de Commerce,
plus particulirement mes camarades du groupe PGS 2009/2010, qui
mont soutenus durant cette formation.
toutes les personnes qui ont connu Sarah de prs ou de loin.
Sommaire
Remerciements
Ddicaces
Liste des abrviations
Liste des tableaux
Liste des schmas
Liste des annexes
Introduction gnrale
Partie I : Thorique
CHAPITRE I : LE CONTROLE INTERNE
Introduction du chapitre..
SECTION I : Gnralits sur le Contrle Interne.
I. Dfinitions et cadre rfrentiel du contrle interne
II. Les objectifs du contrle interne....
III. Le champ dapplication du contrle interne
VI. Limites du contrle interne.......
SECTION II : Composantes du contrle interne.......
I. Lenvironnement de contrle.......
II. Evaluation des risques.....
III. Activits de contrle............
IV. Information et communication
V. Pilotage
VI. Lien entre les objectifs et les composantes du contrle interne..
SECTION III : Les acteurs du contrle interne et les tapes de sa mise en uvre
I. Les acteurs du contrle interne
I.1. Les parties internes...
I.2. Les parties externes..
II. Le contrle interne dune activit .
II.1. LES PRALABLES...
II.2. LE CADRE DE CONTRLE
II.3.HIRARCHIE ET COHRENCE DES DISPOSITIFS.
Conclusion du chapitre........
3
4
4
9
11
11
13
14
16
19
21
23
26
27
27
30
30
30
32
38
39
Sommaire
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES
Introduction du chapitre..
SECTION I : Gnralit sur Laudit Interne
I - volution historique de laudit et naissance de la fonction audit interne
II - Dfinition de l'audit interne
III - Le code de dontologie..
IV- Charte et normes daudit interne...
V - Les fonctions voisines de laudit interne
SECTION II : Les outils et la dmarche dune mission daudit interne
I- Les outils de laudit interne.
I -1 Les outils de description...
I -2 Les outils dinterrogation..
I -3 Les outils informatiques
I -4 Outils mthodologiques
I -5 Vrifications, Analyses, et rapprochements divers
II- La conduite dune mission daudit interne.....
II-1- Ordre de mission..
II-2- Les trois phases fondamentales de la mission daudit interne.
1) La phase de prparation..
2) La phase de ralisation
3) La phase de conclusion...
SECTION III : La banque et les risques bancaires
I- La banque
I- 1. Lvolution de la banque et dveloppement du rseau bancaire algrien...
I- 2. Notion de banque.
I- 3. Lactivit bancaire...
I- 4. Quelques Concepts bancaires..
II-Les risques bancaires..
III- Les implications de Balle II sur le contrle et audit internes bancaires...
III- 1- Le risque daudit dans la banque..
III- 2 -Bale II sur laudit et le contrle internes bancaires...
Conclusion du chapitre...
41
42
43
45
46
46
49
49
51
51
51
52
53
53
55
55
60
62
65
65
67
67
69
71
73
73
75
77
Sommaire
Partie II : Pratique
CHAPITRE III : LE CONTROLE INTERNE AU NIVEAU DE LA BNA
Introduction du chapitre..
SECTION I : Historique de la banque nationale dAlgrie
I-Prsentation de la Banque Nationale dAlgrie ..
II- Lagence bancaire...........
II-1-Dfinition.
II-2-Organisation de lagence..
1- Service caisse...
2- Service Crdit (engagement)....
3- Service secrtariat engagement
4- Service tlcompensation.
5- Service Commerce extrieur (Comex).
5.1.La remise documentaire
5.2.Transfert/ rapatriement.
5.3.Devise et change manuel..
5.4.Domiciliation
5.5.Le crdit documentaire (Credoc)..
SECTION II : Dmarche pratique suivre pour la domiciliation et louverture
dun Credoc au niveau de la BNA
I- Domiciliation..
I.1. LOUVERTURE DU DOSSIER DE DOMICILIATION
I.2. LA GESTION DU DOSSIER DE DOMICILIATION
I.3. LAPUREMMENT DE DOMICILIATION.
II- Le crdit documentaire (Credoc)...
II-1-Louverture du Credoc, au niveau de lagence...
II-2- Louverture du Credoc, au niveau de la D.O.D.
II-3- Rglement du Credoc.
III- Autocontrle au niveau de lagence.
SECTION III : Les niveaux de Contrle au sein de la Banque Nationale dAlgrie
I- Gnralits..
II- Le contrle de premier degr au niveau de la DRE
II-1- La DRE : Direction du rseau dexploitation...
1) Dfinition..
2) Organisation..
II-2-Contrle du premier degr des oprations de Comex : cas Credoc...
80
81
85
85
85
86
86
86
86
87
87
87
87
87
88
91
91
94
95
96
96
99
100
102
102
103
103
103
103
110
Sommaire
III- Le contrle du second degr : LAudit Interne...
III-1- Dfinition...
III-2- Missions.
Conclusion du chapitre........
CHAPITRE IV : Laudit du cycle de financement des oprations de commerce
extrieur par crdit documentaire (CREDOC) ; Cas Agence principale Hamiz 647
Introduction du chapitre..
SECTION I : La phase de prparation...
SECTION II : La phase de ralisation
SECTION III : Phase de conclusion
Conclusion du chapitre
Conclusion gnrale..
Bibliographie.
Rsum.
Mots cls.
Annexes.
111
111
112
115
117
118
130
149
157
160
Liste des tableaux :
Tableau n Intitul page
Tableau n01 Comparaison entre laudit interne et laudit externe. 47
Tableau n02 Comparaison entre laudit interne et linspection. 47
Tableau n03 Comparaison entre laudit interne et le contrle de
gestion.
48
Tableau n04 Les incoterms. 91
Tableau n05 Codification de la domiciliation. 93
Tableau n06 QPC 120
Tableau n07 Les points forts et les points faibles. 122
Tableau n08 Fiche de sparation des taches 123
Tableau n09 Identification des zones risques 125
Tableau n10 Le programme de travail 132
Tableau n11 QCI : Domiciliation 137
Tableau n12 QCI : Ouverture de Credoc 140
Tableau n13 FRAP 144
Tableau n14 Synthse des principales recommandations 150
Tableau n15 Plan daction 154
Liste des schmas :
schma n Intitul page
schma n01 Organigramme de la BNA 83/84
schma n02 Organigramme Agence 85
schma n03 Schma de lopration de crdit documentaire 101
schma n04 Organigramme DRE 109
schma n05 Organigramme Direction dAudit Interne 113
schma n06 Organigramme de lAP hamiz 647 119
Liste des annexes :
Annexe n Intitul
Annexe n01 Organigramme de la BNA
Annexe n02 Lorganigramme de lagence
Annexe n03 Demande de la domiciliation
Annexe n04 Attestation Taxe de domiciliation bancaire
Annexe n05 Engagement
Annexe n06 la fiche de contrle CA1112
Annexe n07 Formule 04 (CA 1067)
Annexe n08 Demande Credoc Semar 205 bis
Annexe n09 Chemise Credoc limport chemise :ET7
Annexe n10 Lettre douverture par V8
Annexe n11 Swift
Annexe n12 Organigramme DRE Bouzarah
Annexe n13 Rglement 02-03 de la banque dAlgrie
Annexe n14 Organigramme de la Direction de lAudit Interne
Annexe n15 Lorganigramme de lagence AP hamiz 647
Annexe n16 Questionnaire de prise de connaissance de lentit audite : QPC
Annexe n17 Fiche de sparation des taches
Annexe n18 Programme de travail
Annexe n19 Questionnaire de contrle interne : Domiciliation
Annexe n20 Questionnaire de contrle interne : Ouverture du Credoc
Annexe n21 FRAP
Annexe n22 Apurement de domiciliation
Annexe n23 Diagramme : Ouverture du dossier domiciliation import
Annexe n24 points de surveillance fondamentaux I ; II ; IV
Annexe n25 Schma de lopration de crdit documentaire
Annexe n26 Nouveau modle de demande douverture de Credoc
Annexe n27 Modle de domiciliation propos
Annexe n28 Modle de leve de rserve propos.
Annexe n29 BALE II sur le contrle bancaire (14principes)
Annexe n30 Diagramme de circulation dune mission daudit
Annexe n31
DECLARATION DOUVERTURE DES DOSSIERS DE
DOMICILIATION I ; II ; III
Annexe n 32 Dmarche Ifaci
Liste des abrviations :
Abrviations
COSO Committee Of Sponsoring Organizations of treadway commission
CRBF Comit de la Rglementation Bancaire et Financire
IIA LInstitute of Internal Auditors
IFACI LInstitut Franais de l'Audit et du Contrle Internes
COCO Criteria on Control Committee
OECCA le Conseil de lOrdre des Experts Comptables agre
CNCC la compagnie nationale des commissaires aux comptes
LSF Loi de Scurit Financire
AMF lAutorit des Marchs Financiers
SOX Sarbane Oxley
lIASB Iternational accountant standards Board
lIFAC international Federation of Accountants
Turnbull Institute of chartered accountants
CIA Certified Internal Auditor
DPAI Diplme Professionnel de lAudit Interne
QCI Questionnaire de Contrle Interne
FRAP la feuille de rvlation et danalyse de problme
BAO Billet Ordre
BAD La banque algrienne de dveloppement
CNEP La caisse nationale dpargne et de prvoyance
BEA Banque extrieure dAlgrie
BNCI banque nationale du commerce et de lindustrie de France
CIC crdit industriel et commercial de France
AIB Algerian International Bank
CAD Capital Adequacy Directive
COMEX Commerce extrieur
CREDOC Crdit documentaire
PREG Provision retenue de garantie
TL Transfert libre
Remdoc Remise documentaire
B.A Banque dAlgrie
BNA Banque Nationale dAlgrie
BL Bill of Lading
ATDB Attestation taxe de domiciliation bancaire
RUU Rgles et Usances Uniformes
Introduction
INTRODUCTION GENERALE A
Le dbut des annes quatre-vingt (1980) a t marqu essentiellement par des mutations
stratgiques au niveau des systmes bancaires de par tout le monde, caractrises
principalement par la drglementation, la dsintermdiation, le dcloisonnement des
marchs, le dsencadrement des crdits.
De mme la privatisation de certains tablissement de crdit et leur introduction en bourse
ont chang compltement le statut de lactionnariat qui va prendre de nouvelles couleurs,
pour devenir plus exigeant en matire de rmunration et de rentabilit des fonds propres
moyen et long terme. Paradoxalement, ces volutions qui ont secou le paysage bancaire vont
tre accompagnes par une explosion des risques qui ont pes lourdement sur les
tablissements de crdit, et ont hypothqu lavenir de leur rentabilit.
Devant la diversit de ces risques et face lopacit de lindustrie bancaire et aux
dysfonctionnements mis en vidence par la dernire crise financire, le contrle interne reste
la pierre angulaire de la gouvernance bancaire. Il semble logique que l'autorit de tutelle ait
impos aux tablissements de crdit la mise en place d'un systme de contrle interne, ce qui
est spcifique au secteur bancaire.
Cette obligation apparat pour la premire fois dans le rglement 90-08 du comit de la
rglementation bancaire et financire en date du 25 juillet 1990
(1)
. Ce texte accorde au
systme de contrle interne trois grandes missions. Premirement, ce dernier est charg de
vrifier que les oprations, procdures et l'organisation sont conformes avec les textes et lois
en vigueur. Deuximement, il doit galement vrifier le respect des limites de risques. Enfin,
il s'assure de la qualit de l'information comptable et financire. Ce texte n'impose pas une
organisation prcise du contrle interne mais se contente d'en fixer les principes gnraux.
Par la suite, pour faire face l'apparition des risques multiples et de plus en plus
complexes, la Commission bancaire a dcid de publier un nouveau rglement relatif au
contrle interne. Le texte 97-02, du comit de la rglementation bancaire et financire
(2)
,
renforce les contraintes des tablissements de crdit en matire de contrle interne et impose
une plus grande rigueur de la gestion des risques. De plus, il prcise les rles respectifs de
l'organe excutif et de l'organe dlibrant. Il incite ouvertement l'organe dlibrant la
cration d'un comit d'audit charg d'effectuer un contrle efficace.
La responsabilit de la mise en place d'une structure de contrle interne approprie et
efficace incombe aux gestionnaires d'un organisme. Le responsable de tout organisme public
doit veiller ce qu'une structure de contrle interne approprie soit cre, examine et adapte
pour garder son efficacit. Il est crucial que tous les gestionnaires fassent preuve d'un tat
d'esprit constructif et adoptent une attitude de soutien. Tous les gestionnaires doivent tre
personnellement et professionnellement intgres. Ils doivent maintenir un niveau de
comptence leur permettant de comprendre l'importance d'laborer, de mettre en uvre et de
maintenir des contrles internes efficaces.
1
Mmoire prsent par : Franck DARDENNE, Le Contrle Interne des les tablissements de crdits, DESS BANQUES &
FI NANCES, Uni ver s i t Rne Des car t es , Facul t de Dr oi t , Par i s V, Oct /Nov 2007 ; p10.
2
Ibid, p10.
INTRODUCTION GENERALE B
Un systme de contrle interne efficace est une composante essentielle de la gestion dun
tablissement et constitue le fondement dun fonctionnement sr et prudent dune
organisation bancaire. Pour la Banque des Rglements Internationaux qui en a fix les
principes cls en 1998, un systme de contrle interne efficace est une composante
essentielle de la gestion dun tablissement et constitue le fondement dun fonctionnement sr
et prudent dune organisation bancaire
(1)
. Il ne sagit pas simplement dune procdure ou
dune politique applique un moment donn, mais plutt dun systme qui doit fonctionner
en continu tous les niveaux de la banque sous la responsabilit du conseil dadministration
et de la direction gnrale. Les objectifs sont notamment dtablir une culture de contrle des
risques dans toutes les activits, de se doter des instruments appropris de reconnaissance et
dvaluation des risques et dtablir une organisation interne garantissant une sparation entre
activits de contrle et tches oprationnelles.
Pour en faire, les gestionnaires mettent en place une fonction d'audit indpendante jouant
un rle essentiel dans la structure de contrle interne. Ils devraient fixer des objectifs la
fonction d'audit et ne restreindre en aucune manire la capacit des auditeurs de les raliser.
Pour assurer son indpendance, le chef de cette section d'audit devrait dpendre directement
du gestionnaire qui dirige l'organisme.
LInstitut Franais de l'Audit et du Contrle Internes lIFACI dfinit la fonction daudit
interne comme : une activit indpendante et objective qui donne une organisation une
assurance sur le degr de matrise de ses oprations, lui apporte ses conseils pour les
amliorer, et contribue crer de la valeur ajoute
(2)
.
Ainsi, laudit interne se place comme un outil stratgique du management des
organisations quelles soient petites ou grandes, publiques ou prives. Cest un concept
composite et complexe. Il est entour de beaucoup de confusion, parce quon entend souvent
par laudit le contrle financier, alors que celui-ci peut stendre plusieurs domaines et
spcialits plus larges que ceux du contrle financier tel que laudit de fonctionnement, laudit
stratgique, laudit organisationnel, etc
Donc, cest le rle des responsables de se doter des moyens permettant den dtecter les
carts et les erreurs et den apprcier les projections dans lavenir. Si dans les pays dvelopps
lutilisation des techniques daudit interne bancaire a pu raliser des progrs apprciables,
pour le cas des pays en voie de dveloppement est beaucoup plus loin et ncessite encore plus
defforts dployer dans le domaine.
Objectif de la recherche
Lobjectif de notre travail est dtudier la relation entre laudit interne et le contrle interne
dans le secteur bancaire, Pour ce faire nous prendrons le soin de traiter la problmatique
suivante :
1
Franck DARDENNE ; op-cit ; p11.
2
www.ifaci.com; le 15/09/2011. . D Dfinition approuve le 21 mars 2000 par le Conseil d'Administration de
l'IFACI. Traduction de la dfinition internationale approuve par l'IIA le 29 juin 1999.
INTRODUCTION GENERALE C
La problmatique
Quel est le rle de laudit interne dans lamlioration du dispositif de contrle interne, dans
le secteur bancaire ?
Sous cette problmatique, nous tirons les sous-questions suivantes :
Les sous-questions
1. Comment dfinissent les diffrents rfrentiels le contrle interne ? Quels sont ses
objectifs fondamentaux et les conditions ncessaires leur ralisation ?
2. Quels sont les acteurs du contrle interne ? et comment procde une entit la mise en
place dun dispositif de contrle interne li une activit donne ?
3. De quoi est compose la boite outil de lauditeur interne pour laccomplissement de sa
mission ?
4. Lauditeur interne a- t-il une dmarche unique prcise suivre, afin de pouvoir apprcier
le systme de contrle interne ?
5. Est-ce que la BNA, met en place un systme de suivi du dispositif de contrle interne ?
Pour mener bien notre travail, nous essayerons de rpondre ces questions travers les
hypothses suivantes :
Les hypothses
1. Le contrle interne est une activit qui vise raliser les objectifs dune entit. Ces
objectifs correspondent aux objectifs gnraux que dsire atteindre chaque entit:
augmenter le chiffre daffaire et diminuer les charges et donc augmenter le bnfice.
La ralisation de ces objectifs ncessite lexistence des moyens et ressources.
2. A- Les acteurs du contrle interne sont : personnel, conseil dadministration, les auditeurs
internes.
B- Le processus de mise en place dun systme de contrle interne dune activit donne,
consiste lexistence des moyens, des procdures et dun systme dinformationetc.
3. Lauditeur interne dispose de plusieurs outils pour accomplir sa mission : le questionnaire
du contrle interne, les entretiens, les interviews, les observations.etc.
4. Oui, lauditeur interne a une seule dmarche suivre lors de sa mission.
5. Oui, le contrle interne au niveau de la BNA est suivi par la supervision de contrle
interne (SCI) qui a t cre rcemment.
Le plan de la recherche
Afin de cerner lobjet et le primtre de notre travail, nous avons adopt la dmarche
suivante :
Une premire partie thorique contenant deux chapitres :
Le premier chapitre sera consacr la prsentation du contrle interne, il est subdivis en
trois sections qui traiteront : dabord, Gnralits sur le contrle interne, ensuite, composantes
du contrle interne et enfin, les acteurs du contrle interne et les tapes de sa mise en uvre.
INTRODUCTION GENERALE D
Le second exposera laudit et le contrle internes bancaires. Il sera rparti en trois sections:
Dabord, la premire section traitera, Gnralit sur laudit interne, la deuxime traitera les
outils et la conduite dune mission daudit interne et la dernire section exposera la banque et
les risques bancaires.
La deuxime partie consacre au volet pratique, contient galement deux chapitres :
Dans, le troisime chapitre intitul de : Contrle Interne Bancaire au niveau de la
BNA ; nous commencerons la premire section par la prsentation de lhistorique de la
banque nationale dAlgrie BNA. Ensuite, dans la deuxime section nous allons essayer de
prsenter la dmarche pratique pour louverture de domiciliation et du Credoc. Et enfin, nous
passerons la troisime section qui sera consacre pour les niveaux de contrle au sein de la
BNA.
Le dernier chapitre prsentera le cas pratique de cette tude ; portant sur : Laudit du
cycle de financement des oprations de commerce extrieur par crdit documentaire
(CREDOC) ; au sein de la Banque Nationale dAlgrie (BNA) : Cas Agence principale
Hamiz 647. Ce chapitre est scind en trois sections reprsentant les trois phases
fondamentales dune mission daudit interne: Phase de prparation, phase de ralisation et
enfin phase de conclusion.
Mthodologie de la recherche
Concernant la mthodologie de notre travail il nous est apparu judicieux dutiliser les deux
mthodes suivantes :
Dabord, dans la premire partie thorique, nous avons adopt la mthode descriptive,
base sur des recherches de consultation douvrages divers.
Dans la deuxime partie pratique, nous avons adopt la mthode analytique
(Echantillonnage), partir de donnes et dinformations obtenues lors du stage effectu au
niveau de la banque.
Partie I : Thorique
Chapitre I : Le Contrle
Interne
Chapitre I : Le Contrle Interne 3
Une organisation sapprcie selon trois niveaux : les actions, le contrle et, enfin, laudit.
Cette distinction entre ces trois niveaux est fondamentale pour apprcier limportance du
contrle interne.
Le concept de contrle interne est gnralement assimil dans lentreprise lautorit, la
sanction, la contrainte. Or, dans le dbut des annes 90 aux Etats-Unis sest dveloppe lide
du contrle interne comme tant la matrise des activits de lentreprise. Sa principale
caractristique vient du fait quil couvre lensemble de lorganisation et des fonctions dans
lentreprise. Le contrle interne apparat dautant plus ncessaire que lunivers dans lequel
voluent les banques sest largement complexifi depuis la fin de lencadrement du crdit
avec le renforcement de la concurrence, louverture des frontires, le dveloppement des
technologies, la spcialisation des produits.
Le contrle interne qui tait autrefois dfini comme lensemble des procdures ayant pour
objectif dviter la fraude, dsigne aujourdhui lensemble des procdures qui sauvegarde le
patrimoine de lentreprise et favorise lefficience de la politique de lentreprise. Nous pouvons
dire que le contrle interne est un systme dorganisation et de gestion qui sert raliser les
objectifs de la direction avant dtre un ensemble des procdures qui aident le commissaire
aux comptes lors de ses vrifications.
Nous avons scind ce chapitre en trois sections : la premire traitera gnralits sur le
contrle interne. La deuxime les composantes du contrle interne et enfin, la troisime
section sera consacre pour les acteurs du contrle interne ainsi que les tapes de la mise en
uvre du contrle interne dune activit.
Chapitre I : Le Contrle Interne 4
Section I : Gnralits sur le Contrle Interne
I. Dfinitions et cadre rfrentiel du contrle interne :
I.1.Dfinitions du contrle Interne
Les dfinitions du contrle interne sont multiples et apportent la confusion parmi les
dcideurs, les organes lgislatifs, les autorits de tutelle et le public.
1) La dfinition du contrle interne de B. Fain et V. Faure 1948
Une des plus anciennes est celle de B. Fain et V. Faure : "Le contrle interne consiste en
une organisation rationnelle de la comptabilit et du service comptable visant prvenir, tout
au moins dcouvrir sans retard, les erreurs et les fraudes". Elle date de 1948.
(1)
2) la dfinition du contrle interne de Colins et Valin (1993)
Le contrle interne est mis en place par la Direction dune entreprise pour assurer la
lgitimit de ses activits, la protection des ses actifs, la fiabilit de ses informations et
lutilisation efficace de ses moyens humains et matriels. Il comprend un plan dorganisation
et un ensemble cohrent de moyens, de mthodes et de procdures permettant la matrise du
fonctionnement et de lvolution de lentreprise par rapport son environnement
(2)
Nous, retenons de ce qui prcde que ces dfinitions ne prennent pas en compte la notion
de gestion des risques qui a t prise en compte dans COSO 2. Mais surtout elles ne font pas
distinction entre le contrle interne dune socit en gnral et le contrle interne relatif
llaboration et au traitement de linformation comptable et financire.
I.2. Cadre rfrentiel du contrle interne
1) Les rfrentiels franais
a) Selon le OECCA le Conseil de lOrdre des Experts Comptables agre 1977
La dfinition du contrle interne donne en 1977 par lOECCA: le contrle interne est
lensemble des scurits contribuant la matrise de lentreprise. Il a pour but dun ct
dassurer la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualit de linformation, de lautre
lapplication des instructions de la direction et de favoriser lamlioration des performances. Il
se manifeste par lorganisation, les mthodes et les procdures de chacune des activits de
lentreprise, pour maintenir la prennit de celle-ci .
(3)
1
www.wikipdia.com, le 22/06/2011, mis jour le 12/03/2012.
2
Thse de Doctorat prsent par : SYLVIE TACCOLA-LAPIERRE, Dispositif prudentiel BALE II, Autovaluation et
contrle interne, Universit du sud, Toulon-var, Ecole doctorale n509, Facult des Sciences de gestion,27 Nov
2008, P175.
3
Robert Rebelle, le contrle interne : mettre hors risques lentreprise, Edition Hartman, 1999, p97
Chapitre I : Le Contrle Interne 5
b) Le CNCC la compagnie nationale des commissaires aux comptes 1984
Selon la dfinition retenue par la CNCC : Le contrle interne est constitu par lensemble
des mesures de contrle comptables et autres que la direction dfinit, applique et surveille
sous sa responsabilit, afin dassurer :
(1)
La protection du patrimoine ;
La rgularit et la sincrit des enregistrements comptables et des comptes annuels qui
en rsultent ;
La conduite ordonne et efficace des oprations de lentreprise ;
La conformit des dcisions avec la politique de la direction .
c)Le comit de la rglementation bancaire CRB 1990
Le rglement 90-08 du 25 juillet 1990 du Comit de la Rglementation Bancaire et
Financire (CRBF), impose aux tablissements de crdit de se doter dun systme de contrle
interne et en dfinit les objectifs suivants :
Vrifier que les oprations ralises par ltablissement ainsi que lorganisation et les
procdures internes sont conformes aux dispositions lgislatives et rglementaires en
vigueur, aux normes et usages professionnels et dontologiques et aux orientations de
lorgane excutif ;
Vrifier que les limites fixes en matire de risques, notamment de contrepartie, de
change, de taux dintrt ainsi que dautres risques de march, sont strictement
respectes ;
Veiller la qualit de linformation comptable et financire, en particulier aux conditions
denregistrement, de conservation et disponibilit de cette information.
(2)
d) Le rglement n 97-02 du Comit de la Rglementation Bancaire et Financire
(CRBF)
Le rglement n97-02 du 1/10/1997 est ensuite venu complter ces lments du dispositif
de contrle interne des tablissements de crdit. Il oblige les entreprises assujetties :
Mettre
en uvre les moyens ncessaires pour sassurer du respect des diligences lies lapplication
de ce rglement ;
Sassurer que les systmes mis en place, au sein de ces entreprises, sont cohrents entre
eux afin de permettre un mesure, une surveillance et une matrise des risques encourus au
niveau consolids ;
Vrifier ladoption, au sein de ces entreprises, de procdures adquates pour la production
des informations et renseignements utiles aux fins de lexercice de la surveillance sur une
base consolide.
1
Robert Rabelle, op-cit, p97.
2
Lionel Collins et Grard Valin, Audit et contrle interne, aspects financiers, oprationnels et stratgiques, 4e
dition, Dalloz1992, p 36
Chapitre I : Le Contrle Interne 6
Il faut noter que lensemble des dispositions du rglement n 97-02 modifi sont
compltes et mise jour rgulirement par des arrts ministriels.
(1)
e)La Loi de Scurit Financire LSF2003
En France, la loi n2003-706 du 1er aot 2003 dite Loi de Scurit Financire impose au
prsident du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de rendre compte, dans un
rapport joint au rapport de gestion annuel, des conditions de prparation et d'organisation des
travaux du conseil, ainsi que des procdures de contrle interne mises en place par la
socit.
(2)
f) Le cadre de rfrence de lAMF (lAutorit des Marchs Financiers) 2007
Sur la base de ces textes constituant le socle des dispositions relatives au contrle interne,
(AMF) a publi, en 2006, un cadre de rfrence du contrle interne.
L'AMF recommande l'utilisation de ce cadre de rfrence ainsi que son guide
dapplication.
Elle dfinit le contrle interne comme : un dispositif de la socit, dfini et
mis en uvre sous sa responsabilit, qui vise assurer : la conformit aux lois et rglements
en vigueur, lapplication des instructions et des orientations fixes par la direction gnrale ou
le directoire, le bon fonctionnement des processus internes de la socit, notamment ceux
concourant la sauvegarde des actifs, la fiabilit des informations financires ; le contrle
interne ne peut fournir une garantie absolue que les objectifs de la socit seront atteints
(3)
g) Les recommandations Ble II
Les textes directement lis la problmatique du contrle interne, les accords de Ble et
notamment Ble II viennent apporter un clairage complmentaire.
Ds 1998, le Comit de Ble a dfini les nouvelles dimensions du contrle interne: Le
processus de contrle interne, qui visait traditionnellement rduire la fraude, les
dtournements de fonds et les erreurs, a pris une dimension plus vaste et recouvre lensemble
des risques encourus par les organisations bancaires .
(4)
Le Comit de Ble a propos en 2004 un nouvel ensemble de recommandations, dites
Ble II , au terme duquel a notamment t dfinie une mesure plus pertinente du risque de
crdit, avec, en particulier, la prise en compte de la qualit de lemprunteur.
(5)
2)-Les references Anglo-Saxons
a) Le COSO Committee Of Sponsoring Organizations of treadway commission , 1992
La dfinition du contrle interne qui aujourd'hui fait rfrence est celle du COSO.
1
Ineum Consulting, Etude des mtiers du contrle dans la banque, p6.
2
Ibid, p7.
3
stphanieThiry-Dubuisson, Laudit , dition la dcouverte, paris 2009, p 53
4
SYLVIE TACCOLA-LAPIERRE, op-cit, P192.
5
Ineum Consulting, op-cit, p8.
Chapitre I : Le Contrle Interne 7
Le COSO est lun des rfrentiels les plus rputs en matire de contrle bancaire. Il
dfinit le contrle interne comme un processus mis en uvre par le conseil dadministration,
les dirigeants et le personnel dune organisation destin fournir une assurance raisonnable
quant la ralisation des objectifs suivants : la ralisation et loptimisation des oprations, la
fiabilit des informations financires, la conformit aux lois et aux rglementations en
vigueur.
(1)
b) La loi SOX , ou Sarbane Oxley Act, instaur ds 2002
Cette loi prcise dans son article 404en particulier, lexigence que la Direction Gnrale
engage sa responsabilit sur la mise en place dune structure de contrle interne comptable et
financier et quelle value annuellement lefficacit au regard dun modle de contrle interne
reconnu.
Notons quil sagit dune rponse des scandales financiers qui ont agit des entreprises
amricaines ; lesquelles devaient alors chercher se prmunir et surtout anticiper ce type de
situation. Pour mettre en uvre larticle 404, le COSO a t fortement prconis.
Au-del de leur caractre rglementaire (et obligatoire en France pour le 97-02 et les textes
de Ble II), ces rfrentiels et textes, publis tant par les pays anglo-saxons que la France,
constituent ainsi une sorte de recueil des bonnes pratiques en matire de contrle interne.
(2)
C) Pour lIAASB de lIFAC :(Dfinition proche de celle du COSO)
Le contrle interne est un processus conu et mis en uvre par les personnes charges de
la gouvernance, de la gestion, ainsi que par tous les membres du personnel, destin fournir
une assurance raisonnable de laccomplissement des objectifs de lentit en ce qui concerne la
fiabilit des informations financires, la ralisation et loptimisation des oprations et la
conformit aux lois et rglementations en vigueur.
(3)
d) Le COCO (Criteria on Control Committee) 1995 : Le contrle interne est constitu
des lments dune organisation (y compris les ressources, les systmes, les processus, la
culture, la structure, et les tches) qui collectivement aident les gens raliser les objectifs de
lorganisation .qui font partie des trois catgories suivantes :
efficacit et efficience du fonctionnement ;
fiabilit de linformation interne et externe ;
conformit aux lois, aux rglements et aux politiques internes.
(4)
e) Turnbull (Institute of chartered accountants) 1999 aux royaumes unis
Le Turnbull dfinit le contrle interne comme : Un systme de contrle interne englobe les
politiques, processus, tches, comportements et autres aspects dune entreprise qui, combins:
1
Dov Ogien , Comptabilit et audit bancaires 2e dition / DUNOD, Paris , 2008, p375.
2
Ineum Consulting, op-cit, p8
3
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, Comptabilit et audit Manuel et applications 2e dition, DUNOD
2009, p508.
4
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, ditions eyrolles ; 2010, p138.
Chapitre I : Le Contrle Interne 8
facilitent lefficacit et lefficience des oprations en aidant la socit rpondre de
manire approprie aux risques commerciaux, oprationnels, financiers, de conformit
et tout autre risque, afin datteindre ses objectifs ; ceci inclut la protection des actifs
contre un usage inappropri, la perte et la fraude, et lassurance que le passif est
identifi et gr ;
aident assurer la qualit du reporting externe et interne ce qui ncessite de conserver
les enregistrements appropris et de maintenir des processus qui gnrent un flux
dinformations pertinentes et fiables en provenance de lintrieur et de lextrieur de
lorganisation ;
aident assurer la conformit aux lois et rglements ainsi quaux politiques internes
relatives la conduite des affaires.
3) Autres dfinitions du Contrle interne
a) Le contrle interne est un :
Dispositif permanent cest--dire que le contrle interne nest pas vu comme une
fonction.
Dispositif compos daspects formels et daspects informels cest--dire que le
contrle interne ne se rsume pas laspect formel du contrle (rgles crites,
procdures), mais il comprend aussi le contrle informel ou le contrle social.
(1)
b) Le contrle interne est un :
Un processus intgr
Le contrle interne nest pas un vnement isol ou une circonstance unique, mais un
ensemble dactions qui touchent toutes les activits dune organisation.
Mis en uvre, excut et suivi par les responsables et les autres membres du personnel
Le contrle interne nexiste pas sans les personnes qui le font fonctionner. Il nat des
personnes qui composent lorganisation, au travers de ce quelles font et de ce quelles disent.
Destin traiter les risques
Quelle que soit la mission de lorganisation, sa ralisation entranera pour lorganisation
dtre confronte toutes sortes de risques. Si le contrle interne peut aider traiter ces
risques, lassurance quant la ralisation de la mission et des objectifs gnraux ne pourra
tre que raisonnable.
Destin fournir une assurance raisonnable
Le contrle interne, aussi bien conu et appliqu soit-il, ne peut offrir la direction une
assurance absolue quant la ralisation des objectifs gnraux.
1
Grgory Heem, Convention et contrle interne bancaire, dans Conventions et Sciences de Gestion, sous la
direction de M. Amblard et P. Gensse, De Boeck, version 1 - 12 Oct 2009, p5.
Chapitre I : Le Contrle Interne 9
La notion dassurance raisonnable correspond un degr de confiance satisfaisant pour un
niveau de cots, de bnfices et de risques donn.
Ralisation des objectifs
Le contrle interne est conu en vue de la ralisation dune srie dobjectifs gnraux
distincts mais interdpendants. Ces objectifs gnraux sont raliss par le biais de nombreux
sous-objectifs, fonctions, processus et activits spcifiques.
(1)
Nous retenons de ce qui prcde que :
-Le contrle interne est un dispositif mis en place par la direction dune entit, afin
datteindre ses objectifs et minimiser ses risques ;
-Cest un processus intgr et qui fonctionne en continu.
La multiplicit des dfinitions de la notion de contrle interne est due la varit des
proccupations des diffrents intervenants : cela dpend du mtier, du secteur d'activit, des
crises rencontres,...Il est certain que la vision du commissaire aux comptes est assez
diffrente de celle de l'auditeur interne, du dirigeant ou du consultant en stratgie.
II. Les objectifs du contrle interne
Le contrle interne, contribue garantir raisonnablement que l'organisme remplit les
conditions suivantes :
(2)
o Respecter les lois, rglementations et instructions de la direction ;
o Encourager les oprations ordonnes, conomiques, efficientes et efficaces et
atteindre les rsultats projets ;
o Prserver les ressources de la fraude, du gaspillage, des abus et de la mauvaise
gestion ;
o Fournir des produits et des services de qualit correspondant la mission de
l'organisme ;
o Elaborer et conserver des informations financires et de gestion fiables ainsi qu'en
faire tat fidlement par des rapports priodiques.
Aussi, nous pouvons ainsi classer les objectifs du contrle interne, partir des dfinitions
donnes dans le cadre de rfrence de lAMF, par le CNCC, lIAASB et le COSO en quatre
catgories :
1. Sauvegarde des actifs
Ces actifs peuvent disparatre la suite de vols, fraudes, improductivit, erreurs, ou rsulter
dune mauvaise dcision de gestion ou dune faiblesse de contrle interne. Les processus y
1
Fr.VANSTAPEL,Premier Prsident de la Cour des comptes de Belgique intosai ; Lignes directrices sur les normes
de contrle interne promouvoir dans le secteur public-Comit des normes de contrle interne, pp7-11.
2
Organisation internationale des Institutions suprieures de contrle des finances publiques INTOSAI.
Introduction au contrle interne l'intention des gestionnaires des organismes publics, p1.
Chapitre I : Le Contrle Interne 10
affrents devraient faire lobjet dune attention toute particulire.
(1)
2. Respect des instructions de la direction / Conformit aux lois et rglements
Respect des instructions de la direction
Il est relativement facile dmettre une instruction ; cette facilit et la ncessit de la faire
continuellement dans une entreprise tous les niveaux de responsabilit posent un
important problme de contrle.
Les instructions sont communiques sous diverses formes automatises, crites ou
verbales ; elles peuvent revtir un caractre permanent, temporaire ou ponctuel, et sont
souvent filtres plusieurs fois avant darriver la personne pour laquelle elles doivent avoir
une signification immdiate.
(2)
Conformit aux lois et rglementations
Lentreprise est soumise une varit de lois et rglements qui couvrent plusieurs
domaines, notamment la fiscalit, le droit du travail, le droit des socits, le droit commercial,
la scurit, lenvironnement, etc.
3. efficacit et efficience des oprations
Les oprations effectues par lorganisation doivent tre ordonnes, thiques,
conomiques, efficientes et efficaces. Elles doivent tre cohrentes par rapport sa mission.
Lefficacit concerne la capacit dune organisation atteindre le but quelle sest fix ;
Lefficience est la qualit de lorganisation, ou de chacune de ses parties, qui permet
dtre efficace au moindre cout.
Un bon systme de contrle interne se caractrise par lexistence de :
(3)
Manuels de procdures ou notes de services ;
Organigrammes et descriptions de postes ;
Rapports priodiques dinformation de gestion couvrant lensemble des activits.
4. Fiabilit des informations
Limage de lentreprise se reflte dans les informations quelle donne lextrieur et qui
concernent ses activits et ses performances. Il est ncessaire que tout soit en place pour que
la machine fabriquer des informations fonctionne sans erreur et sans omission.
Et plus prcisment, ces contrles internes doivent permettre la chane desinformations
dtre :
(4)
fiables et vrifiables ;
exhaustives ;
1
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p512.
2
Lionel Collins et Grard Valin ,op-cit, pp 42-43.
3
Ibid, pp 43-44.
4
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; p145.
Chapitre I : Le Contrle Interne 11
pertinentes;
disponibles.
Une entreprise ne peut tre gre, dirige ou maitrise si elle ne possde pas un systme
dinformation comportant les caractristiques suivantes :
(1)
-Enregistrements des oprations la source, dans les dlais les plus brefs ;
-Autorisation des oprations et vrification de linformation sur ces oprations la source ;
-Regroupement des informations par catgories homognes chaque tape de traitement
ou convention ;
-Diffusion de linformation aux personnes censes entreprendre une action ou contrler sa
validit dans les dlais minima ;
-Respect des normes comptables gnralement admises et des rgles internes de
lentreprise pour la prsentation de linformation comptable.
III. Le champ dapplication du contrle interne
Ce que le contrle interne ne recouvre pas est prcis par les CDR AMF, COSO et COCO.
Pour le COCO, le champ de contrle interne inclut certains aspects particuliers de la
gestion que le COSO exclut. Ainsi, si le COCO considre que le contrle interne ne vise pas
prescrire les objectifs tablir et que les dcisions relatives au fait dagir et la faon dagir
sont des aspects de la gestion qui ne font pas partie du contrle, il estime que le contrle
interne peut contribuer assurer que les personnes charges du suivi et de la prise de dcision
disposent dinformations appropries et fiables et permet de suivre les rsultats des actions ou
des dcisions de ne pas agir et de faire un rapport leur gard.
Enfin pour le CDR AMF, le contrle interne ne recouvre pas toutes les initiatives prises par
les organes dirigeants ou le management, par exemple la dfinition de la stratgie de la
socit, la dtermination des objectifs, les dcisions de gestion, le traitement des risques ou le
suivi des performances.
(2)
VI. Limites du contrle interne
Le contrle interne ne peut, lui seul, garantir la ralisation des objectifs gnraux dfinis
plus haut.
La probabilit datteindre les objectifs fixs ne relve pas de la seule volont de la socit.
Il existe en effet des limites inhrentes tout systme de contrle interne. Ces limites rsultent
de nombreux facteurs, notamment des incertitudes du monde extrieur, de lexercice de la
facult de jugement ou de dysfonctionnements pouvant survenir en raison dune dfaillance
humaine ou dune simple erreur.
(3)
1
Lionel Collins et Grard Valin ,op-cit, pp 41-42.
2
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p61.
3
RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE PLACE ETABLI SOUS LEGIDE DE LAMF ; Le dispositif de Contrle
Interne : Cadre de rfrence Pour information : Un guide de mise en uvre du cadre de rfrence sur le
contrle interne adapt aux valeurs moyennes et petites (VaMPs),p 17.
Chapitre I : Le Contrle Interne 12
Les limites qui entravent la ralisation efficace du contrle interne peuvent tre :
1) Le facteur humain
Dans la mesure o le contrle interne repose sur le facteur humain, il est susceptible de
ptir derreurs de conception, de jugement ou dinterprtation, de malentendus, de ngligence,
de la fatigue ou de la distraction, voire de manuvres telles que collusion, abus ou
transgression.
(1)
La mise en place dun systme de contrle interne peut tre interprte comme une remise
en cause de la direction dans le personnel. Sans ignorer lexistence de cas particuliers, il faut
observer :
(2)
que le personnel doit tre clairement inform des objectifs rels du contrle interne ;
que le contrle interne joue en faveur du personnel, car il interdit quil soit suspect ;
que les ventuels obstacles soulevs par le personnel relvent plus de la rsistance au
changement en gnral.
2) Les contraintes financires
Une autre limite tient au fait que la conception dun systme de contrle interne doit tenir
compte de contraintes financires. Les bnfices tirs des contrles doivent, par consquent,
tre valus par rapport leur cot.
(3)
Il est souvent reproch au contrle interne daugmenter les charges de lentreprise par
lembauche du personnel nouveau et la ralisation dinvestissements supplmentaires. Il faut
cependant observer :
(4)
que le contrle interne est un lment de scurit dans lentreprise, dont le cot peut
sanalyser comme celui de lassurance ;
que le contrle interne est avant tout une meilleure rpartition des tches avant leur
multiplication ;
que le contrle interne doit tre la mesure du risque quil doit couvrir. On doit ainsi
souligner que si le risque encouru est faible, la mise en place dune procdure dont le
cot serait suprieur au risque encouru deviendrait une faiblesse dans loptique du
rapport cot/efficacit.
3) Les changements organisationnels et lattitude du management
Les changements organisationnels et lattitude du management peuvent avoir un impact
rel sur lefficacit du contrle interne et sur le personnel qui le met en uvre. Cest pourquoi
il est ncessaire que la direction vrifie et actualise continuellement les contrles,
1
Fr. VANSTAPEL, op-cit, p14.
2
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p522.
3
Fr. VANSTAPEL, op-cit, p14.
4
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p522.
Chapitre I : Le Contrle Interne 13
communique les changements au personnel et montre lexemple en se conformant elle-mme
ces contrles.
(1)
De manire plus gnrale on constate que l'atteinte des objectifs de l'entreprise ne
dpendant pas uniquement des facteurs internes. Si le march s'effondre o si un concurrent
bnfice d'une innovation majeure l'entreprise peut avoir des processus efficaces et
performants mais elle sera en situation de risque vital.
(2)
Il existe dautres limites inhrentes au contrle (erreurs de jugement survenant dans la
prise de dcision, dfaillances attribuables des erreurs humaines, collusion permettant de
faire chec aux activits de contrle, contrle outrepass par la direction).
(3)
Nous retenons de ce qui prcde quun systme de contrle interne, aussi bien conu ne
peut fournir la direction une assurance absolue quant la ralisation des objectifs dune
organisation ou sa prennit, et ce cause des limites et des risques lis toute activit.
SECTION II : Composantes du contrle interne
Les grandes orientations en matire de contrle interne sont dtermines en fonction des
objectifs de la socit. Ces objectifs doivent tre dclins au niveau des diffrentes units de
lentit et clairement communiques aux collaborateurs afin que ces derniers comprennent et
adhrent la politique de lorganisation en matire de risques et de contrle.
Le dispositif de contrle interne comprend cinq composantes troitement lies. Bien que
ces composantes soient applicables toutes les socits, leur mise en uvre peut tre faite de
faon diffrente selon la taille et le secteur dactivit des socits.
(4)
Le contrle interne est dautant plus pertinent quil est fond sur des rgles de conduite et
dintgrit portes par les organes de gouvernance et communiques tous les collaborateurs.
Il ne saurait en effet se rduire un dispositif purement formel en marge duquel pourraient
survenir des manquements graves lthique des affaires.
Le dispositif de contrle interne, qui est adapt aux caractristiques de chaque socit, doit
prvoir:
lenvironnement de contrle (une organisation) ;
lvaluation des risques ;
la diffusion en interne dinformations pertinentes ;
des activits de contrle ;
une surveillance du contrle interne (Pilotage).
1
Pricewaterhouse, IFACI. La pratique du Contrle Interne. Paris, dition d'organisation, 2004.pp14 -27.
2
www.wikpedia.com; le 03/03/2011.
3
Prface de Louis Vaurs, op-cit, pp 59-60.
4
www. amf-france.org ; le 19/09/2011.
Chapitre I : Le Contrle Interne 14
I.Lenvironnement de contrle
Lenvironnement de contrle reflte la culture dune organisation puisquil dtermine le
niveau de sensibilisation de son personnel au besoin de contrle. Il constitue le fondement de
toutes les autres composantes du contrle interne, en fournissant une discipline et une
structure.
(1)
Les facteurs constitutifs de lenvironnement de contrle
Les facteurs ayant un impact sur lenvironnement de contrle comprennent notamment :
(2)
1) Lintgrit tant personnelle que professionnelle et les valeurs thiques des responsables
et du personnel
Lintgrit tant personnelle que professionnelle et les valeurs thiques des responsables et
du personnel dterminent leurs priorits et leurs jugements de valeur, qui se traduisent par un
code de conduite. Ces qualits doivent se concrtiser par une attitude dadhsion lgard du
contrle interne, en tout temps et dans lensemble de lorganisation.
Toute personne active dans lorganisation tant les responsables que le personnel doit
prouver son intgrit personnelle et professionnelle, et de son respect lthique; tous doivent
en permanence observer les codes de conduite en vigueur.
(3)
2) Lengagement un niveau de comptence
Les objectifs du contrle interne sont trs ambitieux, ils seraient donc difficiles de les
raliser sans accroitre les comptences du personnel.
Lengagement un niveau de comptence se dfinit, notamment, au regard du niveau de
connaissance et daptitudes ncessaires pour garantir la fois que les tches sont accomplies
de manire ordonne, thique, conomique, efficiente et efficace, et que les responsabilits
individuelles lies au contrle interne sont bien comprises.
(4)
La formation apportera alors aux salaris les connaissances qui leur manquent. La gestion
du personnel consiste recruter, former, rmunrer les salaris, et enfin leur assurer une
bonne supervision avec une apprciation priodique et une possibilit de promotion. Les
normes et les procdures de recrutement, de formation, de supervision, de rmunration,
dvaluation et de promotion du personnel doivent tre formaliss et appliqus.
(5)
1
Guide dvelopp par lICAEW (lInstitut des Experts Comptables dAngleterre et du Pays de Galle), le dispositif
de contrle interne, publi en 1999, www.amf-france.org, mis jour janvier 2007.
2
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p63.
3
Fr. VANSTAPEL , op-cit, p20.
4
Ibid, p21.
5
Robert Rabelle ,op-cit, p150.
Chapitre I : Le Contrle Interne 15
3) Le style de management
La philosophie et le style de management ont une incidence sur la conduite des affaires de
lentreprise et sur le niveau de risques accept. Le style de management (cest--dire la
philosophie des responsables et leur manire doprer) reflte les lments suivants:
lattitude permanente dadhsion au contrle interne, lindpendance, la comptence et la
volont de montrer lexemple;
un code de conduite dfini par les responsables ainsi quune assistance et des valuations
de performance qui tiennent compte des objectifs du contrle interne et, en particulier, de
celui qui a pour finalit la ralisation doprations thiques.
Si la haute direction croit limportance du contrle interne, les membres de lorganisation
y seront sensibiliss et ragiront en respectant consciencieusement les contrles tablis.
Si, au contraire, le personnel de lorganisation a le sentiment que le contrle nest pas une
proccupation majeure de la haute direction et est soutenu de manire formelle plutt que
relle, il est pratiquement certain que les objectifs de contrle de lorganisation ne seront pas
effectivement atteints.
4) Structure de lorganisation
Au regard du contrle interne, crer une structure, cest dterminer les principaux
domaines de responsabilit, et mettre en uvre une organisation hirarchique qui assure une
bonne communication entre ses lments. La communication ne doit pas tre sens unique :
la direction gnrale doit non seulement apporter aux subordonns linformation ncessaire
lexcution de travaux, mais encore faciliter la remonte de linformation. On engage aussi
une adquation entre les objectifs et la structure.
(1)
Quelle que soit la structure retenue, les activits dune entreprise doivent tre organises de
faon faciliter la mise en uvre des stratgies destines assurer la ralisation dobjectifs
prcis.
(2)
La structure de lorganisation dune entit prvoit les lments suivants:
dlimitation de pouvoirs et domaines de responsabilit;
dlgations de pouvoirs et obligation de rendre compte;
canaux dinformation appropris.
La structure organisationnelle peut inclure un service daudit interne qui doit tre
indpendant du management et faire rapport directement au plus haut niveau dautorit de
lorganisation.
(3)
1
Robert Rabelle ,op-cit, p149.
2
Pricewaterhouse, IFACI, op-cit, p42.
3
Fr. VANSTAPEL, op-cit, p23.
Chapitre I : Le Contrle Interne 16
5) Politiques et pratiques en matire de ressources humaines
La politique de gestion des ressources humaines traduit les exigences de lentreprise en
matire dintgrit, dthique et de comptence. Cette politique englobe le recrutement, la
gestion des carrires, la formation, les valuations individuelles, les conseils aux employs,
les promotions, la rmunration et les actions correctives.
Des systmes de rmunration comptitifs, prvoyant lattribution de primes, permettent de
motiver et daccrotre les performances. Enfin, les mesures disciplinaires permettent de faire
comprendre que tout manquement aux rgles de comportement tablies dans lentit ne sera
pas tolr. Les tudes et la formation doivent prparer le personnel de lentreprise sadapter
aux volutions de lenvironnement.
(1)
II. Evaluation des risques
1) Dfinition des objectifs
La fixation des objectifs constitue une condition pralable lvaluation des risques. Ces
objectifs doivent tre clairs et comprhensibles par les membres de lorganisation. Une
communication de ces objectifs est par consquent ncessaire.
Le management doit se fixer des objectifs avant didentifier les risques susceptibles davoir
un impact sur leur ralisation et prendre les mesures ncessaires.
Ltablissement des objectifs reprsente donc une tape cl de la conduite des affaires.
Bien que ntant pas un lment du contrle interne, cette phase constitue une condition
pralable permettant dassurer le contrle interne. En se fixant des objectifs gnraux, une
entreprise est en mesure didentifier des facteurs cls de russite, cest--dire des vnements
qui doivent se produire ou des conditions qui doivent exister pour que les objectifs puissent
tre atteints.
(2)
2) Lvaluation des risques
En raison de lvolution permanente de lenvironnement ainsi que du contexte
rglementaire, les socits doivent mettre en place des mthodes pour recenser, analyser et
grer les risques dorigine interne ou externe auxquels elles peuvent tre confrontes et qui
rduiraient la probabilit datteinte des objectifs.
(3)
2-1-La notion de risque
Dans le lexique des mots de laudit, lIFACI dfinit le risque comme tant un ensemble
dalas susceptibles davoir des consquences ngatives sur une entit et dont le contrle
interne et laudit ont notamment pour mission dassurer autant que faire se peut la matrise
(4)
1
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p65.
2
Ibid ; p69.
3
RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE PLACE ETABLI SOUS LEGIDE DE LAMF ; op-cit, pp14-15.
4
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; p155.
Chapitre I : Le Contrle Interne 17
Lvaluation des risques est le processus qui consiste identifier et analyser les risques
pertinents susceptibles daffecter la ralisation des objectifs de lorganisation, et dterminer
la rponse y apporter.
Elle implique les lments suivants:
(a) Identification des risques
o lie aux objectifs de lorganisation;
o exhaustive;
o qui prend en compte les risques dus des facteurs externes et internes, la fois au
niveau de lorganisation et celui des activits;
Le processus didentification et danalyse du risque est un lment cl dun systme de
contrle interne efficace. Le management doit, tous les niveaux, identifier minutieusement
les risques et prendre les mesures adquates afin de les limiter. Les performances dune
entreprise peuvent tre menaces par des facteurs internes ou externes. Il est essentiel que tous
les risques soient identifis.
Lidentification des risques doit constituer un processus continu et itratif et est souvent
intgre au processus de planification. Il est souvent utile de partir dune feuille blanche
plutt que de se borner examiner lvolution des risques par rapport la prcdente tude.
(1)
Pour limiter les risques, il vaut mieux que cette procdure didentification soit distincte de
celle consistant valuer leur probabilit de survenance.
(2)
(b) Analyse des risques (valuation)
Il est ncessaire de procder une analyse des risques une fois que ceux-ci ont t
identifis, la fois au niveau de lentreprise et de chaque activit. Les risques identifis
doivent tre valus en fonction essentiellement de deux critres :
(3)
leur probabilit doccurrence ; et
leur impact.
Mesure de la probabilit du risque
Pour les risques o on dispose de frquence doccurrence, il est ais de calculer une
probabilit et de dfinir des seuils, mais il faut aussi pouvoir dterminer une probabilit pour
les risques qui ne se sont jamais encore raliss.
Mesure de limpact du risque
Limpact du risque affectait latteinte des objectifs de lentreprise ou de lentit dans
laquelle celui-ci se matrialisait. De ce fait, il est toujours prfrable de situer lanalyse de
1
Fr. VANSTAPEL, op-cit, p25.
2
Prface de Louis Vaurs, op-cit, pp70-71.
3
Ibid, p73.
Chapitre I : Le Contrle Interne 18
limpact sur lensemble des processus de lentreprise plutt que de se limiter limpact local
au niveau dune chane de production ou dune activit oprationnelle.
(1)
La mthodologie de lanalyse des risques peut varier, surtout parce que de nombreux
risques sont difficiles quantifier (par exemple, risques portant sur la rputation de
lorganisation), tandis que dautres se prtent facilement une analyse chiffre
(particulirement les risques financiers).
Lvaluation des risques reste difficile : on peut les dcrire au mieux comme tant forts,
moyens ou faibles . Elle joue un rle crucial dans la slection des activits de contrle
appropries entreprendre. Mais on peroit bien que le pralable idal est lexistence dune
cartographie.
2-2-La cartographie des risques
Vritable inventaire des risques de lorganisation, la cartographie permet datteindre trois
objectifs :
(2)
inventorier, valuer et classer les risques de lorganisation ;
informer les responsables afin que chacun soit en mesure dy adapter le management de
ses activits ;
permettre la direction gnrale, et avec lassistance du risk manager, dlaborer une
politique de risque qui va simposer tous :
- aux responsables oprationnels dans la mise en place de leur systme de contrle
interne ;
- aux auditeurs internes pour laborer leur plan daudit, cest--dire fixer les priorits.
Il est ncessaire de prendre en considration la fois les risques inhrents et rsiduels pour
dterminer le degr daversion au risque.
Le risque inhrent est celui auquel une organisation est confronte en labsence de
toute action du management susceptible dinfluencer sa probabilit de survenance ou
son impact.
Le risque rsiduel est celui qui reste aprs que le management ait pris des mesures
pour rpondre au risque.
(3)
3) GESTION DES RI SQUES
Une fois limportance et la probabilit de survenance du risque values, le management
doit tudier la faon dont il doit tre gr. Pour cela, il doit faire appel son jugement, en se
basant sur certaines hypothses concernant les risques et sur une analyse raisonnable des cots
quil serait ncessaire dengager pour les rduire.
(4)
1
Jacques Walter et Philippe Noirot ; Contrle interne; Des chiffres porteurs de sens, Afnor ditions,2010 ; p55.
2
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; p157.
3
Fr. VANSTAPEL, op-cit, pp28,29.
4
ibid, op-cit, p30.
Chapitre I : Le Contrle Interne 19
Les mesures de rponse au risque peuvent tre subdivises en quatre catgories :
a. lacceptation
On ne fait rien, cest--dire que lon accepte de courir le risque. Choix opportun sil
correspond la stratgie et aux limites de tolrance dfinies par celle-ci. Mais choix
catastrophique sil nest que le rsultat du hasard ou du manque dinformation.
b. le partage (transfert)
La meilleure rponse certains risques peut consister les transfrer. Ce transfert peut
revtir la forme dune assurance conventionnelle, ce qui revient rmunrer un tiers pour
quil assume le risque autrement, ou par le biais de clauses contractuelles.
c. Lvitement
On fait disparatre le risque en cessant lactivit qui le fait natre.
d. la rduction
On prend les mesures ncessaires pour rduire la probabilit ou limpact. Cest--dire que
lon amliore le contrle interne. Faire intervenir les auditeurs internes, cest choisir cette
solution. On peut observer que le partage est de mme nature. Il peut dailleurs rsulter dune
recommandation de laudit interne.
(1)
Le traitement na pas ncessairement pour objectif dliminer totalement le risque, mais
plutt de le matriser. Les procdures mises en place par une organisation en vue de grer le
risque sont appeles activits de contrle interne.
III. Activits de contrle
Les activits de contrle sont prsentes partout dans lorganisation, tout niveau et dans
toute fonction quil sagisse de contrles orients vers la prvention ou la dtection, de
contrles manuels ou informatiques ou encore de contrles hirarchiques.
(2)
Pour tre efficaces, les activits de contrle doivent :
(3)
tre appropries;
fonctionner de manire cohrente, conformment aux plans, tout au long de la
priode;
respecter un quilibre entre cot et bnfices;
tre exhaustives, raisonnables et directement lies aux objectifs du contrle.
Elles englobent toute une srie dactivits orientes vers la dtection et la prvention, aussi
diverses que:
1. Procdures dautorisation et dapprobation
Lautorisation constitue le principal moyen de garantir que seuls ont lieu des transactions
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; pp160-161.
2
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p520.
3
Coopers, Lybrand. La nouvelle pratique du Contrle Interne. Paris, dition d'organisation, 2002, pp 63-66.
Chapitre I : Le Contrle Interne 20
et des vnements valides, conformes aux intentions de la direction. Les procdures
dautorisation, qui doivent tre documentes et clairement communiques aux responsables et
aux agents, doivent prvoir les conditions et les termes respecter pour que lautorisation soit
accorde.
2. Sparation des tches (autorisation, traitement, enregistrement, analyse)
En vue de rduire les risques derreurs, de gaspillage ou dactes illgaux ainsi que le risque
de ne pas dtecter ces problmes, aucun individu ou quipe ne doit pouvoir contrler toutes
les tapes cls dune transaction ou dun vnement. Il faut au contraire veiller ce que les
fonctions et les responsabilits soient systmatiquement rparties entre plusieurs personnes
afin de garantir lefficacit des contrles et lexistence dun quilibre des pouvoirs. Parmi ces
fonctions cls, on peut retenir lautorisation et lenregistrement des transactions, leur
traitement, ainsi que lanalyse ou le contrle des mmes transactions.
Ne pas disposer suffisamment de personnel peut empcher un organisme de petite taille de
mettre pleinement en uvre cette technique. Dans ces cas, la direction doit tre consciente des
risques et les compenser par la mise en place dautres contrles. La rotation des agents peut
contribuer garantir quaucune personne ne traite tous les aspects importants des transactions
et des vnements pendant une priode inconsidrment longue. En outre, et en vue de rduire
les risques, linstauration dune rotation temporaire des tches peut tre ralise en
encourageant ou mme en exigeant de prendre des congs annuels.
3. Contrle de laccs aux ressources et aux documents
Laccs aux ressources et aux documents doit tre limit aux personnes habilites, qui ont
rpondre de leur garde ou de leur utilisation. La restriction de laccs aux ressources
quelques personnes rduit le risque dutilisation non autorise voire de perte pour
ladministration et contribue mettre en uvre les lignes directrices de la direction.
4. Vrifications
Les transactions et les vnements importants doivent tre vrifis avant et aprs leur
traitement. Par exemple, lorsque des biens sont livrs, le nombre fourni doit tre compar au
nombre command. Par la suite, le nombre de biens facturs est compar au nombre
effectivement reu. Le stock peut aussi tre contrl au moyen de sondages.
5. Rconciliations
Les enregistrements sont compars rgulirement aux documents appropris: par exemple,
les pices comptables relatives aux comptes en banque sont compares aux relevs bancaires
correspondants.
6. Analyses de performance oprationnelle
La performance oprationnelle est analyse rgulirement sur la base dun ensemble de
normes permettant de mesurer lefficacit et lefficience. Sil ressort du suivi des
performances que les ralisations relles ne rencontrent pas les normes ou objectifs fixs, les
Chapitre I : Le Contrle Interne 21
processus et activits tablis pour atteindre les objectifs doivent tre revus pour dterminer
quelles amliorations sont ncessaires.
7. Analyses des oprations, des processus et des activits
Les oprations, les processus et les activits doivent tre priodiquement analyss pour
sassurer quils sont en accord avec les rglementations, politiques, procdures et autres
exigences actuelles. Ce type danalyse des oprations ralises effectivement par une
organisation est distinguer clairement du suivi du contrle interne.
8. Supervision (affectation, analyse et approbation, lignes directrices et formation)
La ralisation des objectifs du contrle interne suppose galement que les superviseurs
soient qualifis. Pour confier un travail un agent, le vrifier et lapprouver, il est ncessaire
de:
communiquer clairement chaque membre du personnel les fonctions, les
responsabilits et les obligations de rendre compte qui lui sont assigns;
vrifier systmatiquement, au degr qui convient, le travail de chaque membre du
personnel;
approuver le travail des moments cls pour sassurer quil se droule comme prvu.
Le fait pour un superviseur de dlguer une partie de ses missions ne lexonre pas de ses
responsabilits et devoirs. Les superviseurs donnent aussi leurs agents les directives et la
formation ncessaires pour rduire au minimum les erreurs.
Cette liste nest pas exhaustive, mais numre les activits de contrle les plus courantes
orientes vers la prvention et la dtection les plus courantes.
Les activits de contrle numrotes :
(1)
de (1) (3) sont orientes vers la prvention,
de (4) (6), elles sont davantage orientes vers la dtection,
tandis que celles vises aux points (7) et (8) visent les deux la fois.
Les actions correctives constituent un complment indispensable aux activits de contrle.
En outre, il doit tre clair que les activits de contrle ne constituent quun lment du
contrle interne et quelles forment un tout avec les quatre autres composantes.
IV. Information et communication
Linformation et la communication sont essentielles la ralisation de lensemble des
objectifs du contrle interne. Les systmes dinformation et de communication permettent au
personnel de recueillir et changer les informations ncessaires la conduite, la gestion et
au contrle des oprations.
(2)
1
Fr. VANSTAPEL, op-cit, pp31-35.
2
Guide dvelopp par lICAEW ,op-cit.
Chapitre I : Le Contrle Interne 22
1. Information
La premire des conditions lobtention dune information susceptible dtre juge fiable
et pertinente rside dans lenregistrement rapide et le classement convenable des transactions
et des vnements.
Linformation pertinente doit tre identifie, recueillie et communique sous une forme et
dans des dlais qui permettent au personnel de procder aux activits de contrle interne dont
il a la charge et dassumer ses autres responsabilits (transmettre la bonne information au bon
moment aux bonnes personnes).
Toute organisation doit disposer de documents crits reprenant les composantes du
processus de contrle interne, notamment ses objectifs et ses activits de contrle. La
documentation du systme de contrle interne doit comprendre lidentification de la structure
et des politiques dune organisation et de ses catgories doprations, ainsi que ses objectifs et
procdures de contrle.
Ces derniers doivent en effet tre enregistrs sans dlai lors de leur survenance afin que
linformation conserve sa pertinence et sa valeur pour la direction dans le cadre des ses
activits de contrle des oprations et de prise de dcision. Ce principe implique aussi la mise
jour rapide de toute documentation pour quelle garde sa pertinence.
Un autre facteur indispensable pour que la direction soit assure de disposer dinformations
fiables rside dans le classement correct des informations relatives aux transactions et
vnements.
Les systmes dinformation produisent des rapports contenant des informations
oprationnelles, financires et non financires, ainsi que des informations lies au respect des
obligations lgales et rglementaires. Toutes sont utiles la gestion et au contrle de
lactivit.
(1)
La qualit des informations se mesure par les rponses aux questions suivantes.
(2)
Les bonnes questions
Contenu : toutes les informations ncessaires y sont-elles ?
Dlai : linformation peut-elle tre obtenue en temps voulu ?
Mise jour : est-ce la dernire information en date disponible ?
Exactitude : linformation est-elle correcte ?
Accessibilit : les parties intresses peuvent-elles obtenir cette information aisment ?
1
Fr. VANSTAPEL, op-cit, pp41-42.
2
Prface de Louis Vaurs , op-cit, p80.
Chapitre I : Le Contrle Interne 23
2. Communication
Une communication efficace doit circuler de manire ascendante, transversale et
descendante dans lorganisation, dans toutes ses composantes et dans lensemble de sa
structure.
A la base de la communication se trouve linformation. Cest pourquoi la communication
doit rpondre aux attentes de groupes et dindividus en leur permettant de sacquitter
efficacement de leurs responsabilits.
La socit devrait disposer de processus assurant la communication dinformations
pertinentes, fiables et diffuses en temps opportun aux acteurs concerns de la socit afin de
leur permettre dexercer leurs responsabilits.
(1)
Lun des canaux de communication essentiels est celui qui relie la direction son
personnel. La direction doit tre tenue au courant de la performance, de lvolution, des
risques et du fonctionnement du contrle interne, ainsi que de tous les autres vnements et
problmes pertinents.
La direction doit assurer lexistence de moyens de communication adquats avec les
interlocuteurs externes et recueillir des informations de ces interlocuteurs, tant donn que la
communication externe peut fournir une information susceptible davoir un impact sur la
ralisation, par lorganisation, de ses objectifs.
En se basant sur les donnes provenant de la communication la fois interne et externe, le
management doit prendre les actions ncessaires et entreprendre temps des oprations de
suivi.
(2)
V. Le pilotage du systme de contrle interne
Lvaluation dun systme de contrle interne constitue un processus en soi. Ceci implique
de comprendre chaque activit de lorganisation et chaque lment de contrle interne
valus. Ce processus suppose lanalyse de la structure du systme de contrle interne et des
rsultats des tests effectus, mene dans le cadre de critres dfinis, afin de pouvoir
dterminer si le systme permet dobtenir une assurance raisonnable de ralisation des
objectifs fixs.
Les valuations du contrle interne varient en tendue et en frquence, en fonction de
limportance relative des risques couverts par les contrles, dune part, et des contrles visant
les rduire, dautre part.
Ce processus prend souvent la forme dune auto-valuation : les personnes responsables
dune unit ou dune fonction particulire dterminent elles mmes lefficacit des contrles
sy appliquant.
1
Prface de Louis Vaurs , op-cit ,pp 81, 82.
2
Fr. VANSTAPEL ,op-cit, pp43-44.
Chapitre I : Le Contrle Interne 24
Les auditeurs internes valuent rgulirement le contrle interne. De mme, le
management peut se servir des travaux effectus par les auditeurs externes dans le cadre de
leur propre valuation de lefficacit du contrle interne.
(1)
Aujourdhui, avec la nouvelle rglementation bancaire, le contrle interne est assur la
fois par les quipes oprationnelles et par des quipes spcialises.
En outre le CRBF 97-02 prcise : La ncessit de disposer dagents ralisant les
contrles, permanent ou priodique de la conformit des oprations ralises .
Plusieurs articles du rglement 97-02 modifi ont structur lorganisation du dispositif de
contrle interne des tablissements bancaires. Parmi les principaux :
Mise en place dun dispositif de contrle permanent et priodique (article 6) : Le contrle
permanent de la conformit est assur par : certains agents, au niveau des services centraux et
locaux, exclusivement ddis cette fonction et dautres agents exerant des activits
oprationnelles.
Le contrle priodique de la conformit est assur au moyen denqutes (missions
daudit), par des agents au niveau central (et le cas chant diffrents de ceux assurant le
contrle permanent) .
(2)
1) Pilotage permanent
Le pilotage ou le suivi permanent du contrle interne sinscrit dans le cadre des activits
dexploitation courantes et rcurrentes dune organisation et comprend des contrles rguliers
effectus par la direction et le personnel dencadrement, ainsi que dautres actions effectues
par le personnel dans le cadre mme des tches quil a accomplir.
Les activits de pilotage permanent portent sur chacune des composantes du contrle
interne et tend empcher que les systmes de contrle interne fonctionnent de manire
contraire aux rgles, lthique ou aux critres dconomie, defficience et defficacit.
(3)
La surveillance permanente est mise en uvre par le management sous le pilotage de la
direction gnrale ou du directoire, cette surveillance prend notamment en compte lanalyse
des principaux incidents constats, le rsultat des contrles raliss ainsi que des travaux
effectus par laudit interne, lorsquil existe. Cette surveillance sappuie notamment sur les
remarques formules par les commissaires aux comptes et par les ventuelles instances
rglementaires de supervision.
Le pilotage permanent est plus efficace que les valuations ponctuelles et les actions
correctives sont potentiellement moins coteuses.
La direction gnrale ou le directoire apprcient les conditions dans lesquelles ils
informent le conseil dadministration ou de surveillance des principaux rsultats des
surveillances et examens ainsi exercs.
(1)
1
Fr. VANSTAPEL ,op-cit, p44.
2
Ineum Consulting, op-cit, p10.
3
Fr. VANSTAPEL, op-cit, pp46-48.
Chapitre I : Le Contrle Interne 25
2) valuations ponctuelles
Les valuations ponctuelles varieront en tendue et en frquence essentiellement en
fonction de lvaluation des risques et de lefficacit des procdures de pilotage permanent.
Les valuations ponctuelles spcifiques portent sur lefficacit du systme de contrle
interne et garantissent que le contrle interne atteint les rsultats attendus sur la base de
mthodes et procdures prdfinies. Les faiblesses du contrle interne doivent tre signales
au niveau appropri de direction.
Les procdures de suivi doivent garantir que les conclusions daudit et les
recommandations qui en rsultent sont mises en uvre de manire approprie et sans retard.
Les valuations ponctuelles tant effectues a posteriori, les oprations courantes de
surveillance permettront souvent une dtection plus rapide des problmes.
(2)
Elles peuvent revtir la forme dauto-valuations, comme lanalyse de la conception du
contrle ou la ralisation de tests portant directement sur le contrle interne. Les valuations
ponctuelles peuvent aussi tre ralises par les auditeurs externes ou internes.
En gnral, la combinaison du suivi permanent et des valuations ponctuelles permettra
dassurer que le systme de contrle interne conserve son efficacit dans le temps.
Toutes les faiblesses dceles dans le cadre du suivi permanent ou la suite dvaluations
ponctuelles doivent tre signales aux personnes habilites prendre les mesures ncessaires.
Le suivi et le pilotage du contrle interne doivent comprendre des politiques et des
procdures garantissant que les conclusions des audits et des autres formes dvaluation sont
mises en uvre de la manire approprie et sans retard.
(3)
La dernire composante du contrle interne (pilotage) est procde de la manire suivante
dans le secteur bancaire :
Trois niveaux de contrle peuvent tre identifis :
- le premier niveau : les personnes qui effectuent des oprations (guichetier dans une
agence ou trader dans une salle de march, par exemple) assurent un premier contrle valid
par leur hirarchie immdiate. Chaque direction oprationnelle est charge didentifier, de
mesurer, et de suivre en permanence les risques inhrents au fonctionnement de son activit.
- le deuxime niveau : des quipes spcialises dans le contrle de terrain et extrieures
aux oprations ou aux actions commerciales effectuent un contrle de deuxime niveau. Elles
sont charges de vrifier que les procdures ont t correctement appliques et dclent les
erreurs ou anomalies. Ce travail est confi des quipes de terrain, des services de back-office
ou de middle office.
1
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p521.
2
Prface de Louis Vaurs - Sous la direction dlisabeth Bertin, op-cit, p84.
3
Fr. VANSTAPEL, op-cit, p47.
Chapitre I : Le Contrle Interne 26
Ces deux premiers niveaux constituent les contrles permanents, leurs champs
dapplication sont trs vastes. Ils comportent les contrles comptables, les vrifications de
caisse et la matrise des risques. La surveillance permanente comporte donc deux volets : la
scurit au quotidien qui concerne lensemble du personnel et ncessite un strict respect des
rgles et procdures et la supervision formalise qui impose la hirarchie de vrifier que les
procdures et rgles sont correctement appliques.
- le troisime niveau : des quipes daudit spcialises et/ou linspection gnrale
effectuent des missions ponctuelles par mtier, territoire ou filiale et mettent des
recommandations devant tre mises en place. Linspection gnrale est hirarchiquement
rattache la direction gnrale, elle est indpendante des mtiers et des fonctions quelle
contrle. Ses domaines dintervention sont illimits, ils comprennent galement laudit des
contrles permanents. Elle doit inspecter a minima tous les quatre ans lensemble des
structures de la banque.
Ce troisime niveau de contrle constitue le contrle priodique, ce dernier, assur ex post
au moyen denqutes, doit inspecter lensemble des activits de la banque et un audit complet
de lensemble du dispositif du contrle interne.
(1)
Les lments et les critres sappliquent au systme de contrle interne dans son ensemble.
Pour une catgorie donne, les cinq critres doivent tre remplis afin de conclure lefficacit
du contrle interne.
VI. Lien entre les objectifs et les composantes du contrle interne
Il existe un lien direct entre les objectifs gnraux, qui reprsentent ce quune organisation
sefforce de raliser, et les composantes du contrle interne, qui reprsentent les instruments
ncessaires leur ralisation.
Si le systme de contrle interne ainsi dfini est pertinent et applicable toutes les
organisations, la manire dont la direction le met en uvre varie largement en fonction de la
nature de lorganisation et dpend dun certain nombre de facteurs qui lui sont spcifiques.
Ces facteurs comprennent, notamment, la structure de lorganisation, le profil de risque,
lenvironnement oprationnel, la taille, la complexit, les activits et le degr de
rglementation. Au vu de la situation spcifique de lorganisation, les responsables opreront
une srie de choix en ce qui concerne la complexit des processus et des mthodologies mises
en uvre pour appliquer les composantes du systme de contrle interne.
1
SYLVIE TACCOLA-LAPIERRE, op-cit, P175.
Chapitre I : Le Contrle Interne 27
SECTION III : LES ACTEURS DU CONTROLE INTERNE, ET LES ETAPES DE SA
MISE EN UVRE
I. Les acteurs du contrle interne
Le contrle interne est avant tout le fait des parties prenantes internes de lorganisation, ce
qui inclut la fois les responsables, les auditeurs internes et les autres membres du personnel.
Toutefois, les actions de parties prenantes externes peuvent aussi avoir une influence sur le
systme de contrle interne.
I.1. Les parties internes
Le contrle interne est laffaire de tous, des organes de gouvernance lensemble des
collaborateurs de la socit.
Le contrle interne relve de la responsabilit de tous les membres du personnel et doit
donc tre mentionn, de faon explicite ou implicite, dans la description de poste de chaque
employ.
En fait tous les salaris de l'entreprise sont responsables du contrle interne. Quels que
soient leur mtier et les tches qui leur sont confis, ils doivent veiller ce que les instructions
qui leur sont donnes sont effectivement appliques.
1) Le conseil dadministration ou de surveillance et le comit daudit
a)Le conseil dadministration ou de surveillance
Il reprsente les actionnaires et il est ce titre directement intress par le niveau de
contrle interne de l'entreprise. Il doit notamment s'assurer que les procdures internes
garantissent la significativit et l'honntet des comptes sociaux. De plus en plus souvent les
constatations faites sont reportes l'Assemble Gnrale des actionnaires.
(1)
La responsabilit civile des membres du conseil d'administration peut tre engage pour
dfaut d'organisation du contrle interne mais galement "pour dfaut de suivi de l'efficacit
de la gestion des risques".
(2)
Le conseil doit mettre en place les politiques de contrle interne et rechercher
rgulirement lassurance que ce systme fonctionne efficacement. De plus, il doit sassurer
que ce systme de contrle interne est efficace pour grer les risques.
b) Le Comit d'audit
Il est compos d'administrateurs indpendants chargs d'initier et de suivre les missions
d'audit. ce titre il a mission de demander le renforcement des procdures de contrle
interne.
Lorsquil existe, le Comit daudit devrait effectuer une surveillance attentive et rgulire
du dispositif de contrle interne. Pour exercer ses responsabilits en toute connaissance de
1
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit,p521 .
2
Ineum Consulting, op-cit, p10.
Chapitre I : Le Contrle Interne 28
cause, le Comit daudit peut entendre le responsable de laudit interne, donner son avis sur
lorganisation de son service et tre inform de son travail. Il doit tre en consquence
destinataire des rapports daudit interne ou dune synthse priodique de ces rapports.
(1)
Le comit daudit, agissant en collaboration ou en complment dune fonction daudit
interne influente, est le mieux plac pour identifier les tentatives de la direction d
outrepasser le systme de contrle interne dune part, et dautre part, pour agir en
consquence. Il est clair que le contrle interne se trouve renforc par son existence
(2)
.
2) La Direction Gnrale ou le Directoire
Cest la direction quincombe la responsabilit globale de la conception, de la mise en
uvre, du bon fonctionnement et de la maintenance du systme de contrle interne, ainsi que
de sa documentation.
(3)
La direction gnrale ou le directoire sont chargs de dfinir, dimpulser et de surveiller le
dispositif le mieux adapt la situation et lactivit de la socit. Dans ce cadre, ils se
tiennent rgulirement informs de ses dysfonctionnements, de ses insuffisances et de ses
difficults dapplication, voire de ses excs, et veillent lengagement des actions correctives
ncessaires.
(4)
3) Laudit interne
Les auditeurs internes fournissent de manire rgulire de linformation sur le
fonctionnement du contrle interne en se concentrant, avec une attention particulire, sur
lvaluation de la conception et des oprations du contrle interne. Ils communiquent de
linformation sur les forces et les faiblesses du contrle interne et formulent des
recommandations en vue de son amlioration. Leur indpendance et leur objectivit doivent
toutefois tre garanties.
Outre son rle de suivi des contrles internes dune organisation, une quipe daudit interne
qualifie peut contribuer lefficience des activits daudit externe en apportant une
assistance directe lauditeur externe. La nature, ltendue ou la dure des procdures daudit
externe pourront ainsi faire lobjet damnagements si lauditeur externe peut sappuyer sur le
travail de lauditeur interne.
(5)
A cet gard, les gestionnaires collaborent de manire constructive avec les auditeurs pour
identifier les risques et crer des contrles correctifs et chargent les auditeurs d'valuer le
contrle interne intervalles rguliers afin d'identifier les dficiences et recommander des
actions correctives.
(6)
1
RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE PLACE ETABLI SOUS LEGIDE DE LAMF ;op-cit, p16.
2
Prface de Louis Vaurs, p89.
3
Organisation internationale des Institutions suprieures de contrle des finances publiques INTOSAI, op-cit,p1.
4
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p521.
5
Fr. VANSTAPEL, op-cit, p52.
6
Organisation internationale des Institutions suprieures de contrle des finances publiques INTOSAI,op-cit, p4.
Chapitre I : Le Contrle Interne 29
Les socits ne disposant pas dune fonction daudit interne doivent revoir rgulirement
leur besoin en la matire. Le conseil doit sassurer de faon annuelle du besoin de cette
fonction. Ce besoin varie en fonction de divers critres (taille, diversit, complexit des
entreprises, nombre demploys...).
(1)
4) Le personnel de la socit
Le contrle interne relve, explicitement ou implicitement, de la responsabilit de chacun.
Tous les membres du personnel jouent un rle dans la ralisation du contrle interne et sont
tenus de communiquer tout problme quils viendraient constater dans la conduite des
oprations, de mme que toute violation du code de conduite ou la politique interne de
lorganisation.
(2)
Chaque collaborateur concern devrait avoir la connaissance et linformation ncessaires
pour tablir, faire fonctionner et surveiller le dispositif de contrle interne, au regard des
objectifs qui lui ont t assigns. Cest le cas des responsables oprationnels en prise directe
avec le dispositif de contrle interne mais aussi des contrleurs internes et des cadres
financiers qui doivent jouer un rle important de pilotage et de contrle.
(3)
a. Les cadres financiers
Pour le COSO, les cadres financiers et leurs quipes jouent un rle de pilotage
particulirement important, puisque leurs activits de contrle sont exerces sur la structure de
lentreprise, non seulement de haut en bas, mais galement de faon transversale travers les
autres units oprationnelles et fonctionnelles. Ainsi, le directeur financier, le directeur des
services comptables, le contrleur de gestion et les autres acteurs de la direction financire,
jouent un rle dterminant dans la faon dont le contrle est exerc par le management.
b. Les autres membres du personnel
Le reste du personnel, quelque soit son niveau, influe galement sur le contrle interne. Ce
sont souvent ceux qui sont placs en premire ligne qui appliquent et supervisent certains
contrles, les analysent et prennent les mesures correctives ncessaires si les contrles sont
mal mis en uvre; par ailleurs, ils sont bien placs pour identifier dans le cours de leurs
activits quotidiennes des problmes qui appellent des rponses qui sont de lordre du
contrle interne.
(4)
Les employs doivent avoir les comptences, la connaissance, linformation et lautorit
ncessaires pour tablir et suivre le systme de contrle interne. Pour cela, ils doivent
connatre et comprendre les objectifs de la socit, le march sur lequel celle-ci volue et les
risques auxquels elle doit faire face.
(5)
1
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p522.
2
Fr. VANSTAPEL,op-cit p53.
3
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit p521.
4
VANSTAPEL, op-cit, p53.
5
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, op-cit, p521.
Chapitre I : Le Contrle Interne 30
I.2. Les parties externes
Le second groupe majeur de partenaires du contrle interne est constitu par des tiers
extrieurs, tels que les auditeurs externes, le pouvoir lgislatif et rglementaire, ainsi que
dautres tiers. Tous peuvent contribuer la ralisation des objectifs de lorganisation ou
fournir des informations utiles la mise en uvre du contrle interne.
Cependant, ils nont aucune responsabilit dans la conception, la mise en uvre, le
fonctionnement adquat, la maintenance ou la documentation du systme de contrle interne
de lorganisation.
(1)
1) Le pouvoir lgislatif et rglementaire
La contribution du pouvoir lgislatif et rglementaire au contrle interne peut contribuer
favoriser une comprhension commune de la dfinition du contrle interne et des objectifs
atteindre. Ils peuvent aussi dicter les politiques auxquelles les acteurs internes et externes
sont tenus de se conformer dans lexercice de leurs rles et responsabilits respectifs en
matire de contrle interne.
(2)
2) Les auditeurs externes
Les missions des parties externes, et plus particulirement celles des auditeurs externes,
comprennent lvaluation du fonctionnement du systme de contrle interne et la transmission
de leurs conclusions au management de lorganisation audite. Lexamen du systme de
contrle interne par les parties externes est toutefois dtermin en fonction de leur mandat.
3) Les autres tiers
Les autres tiers sont en interaction avec lorganisation (usagers, fournisseurs, etc.) et
fournissent des informations quant la ralisation de ses objectifs.
II. Le contrle interne dune activit
Le cadre de contrle nest rien dautre quun regroupement par catgories de tous les
dispositifs de contrle interne possibles. Car si ces derniers sont en nombre infini, les critres
de regroupement sont par contre en nombre fini.
Pour y voir clair dans lensemble des activits de contrle de chacun, trois pralables
doivent prluder la mise en ordre de cette nbuleuse insaisissable.
II. 1.LES PRALABLES
Les pralables la mise en place dun dispositif de contrle interne, quel quil soit, sont :
la dfinition de la mission ;
lidentification des facteurs de russite ;
1
Fr.VANSTAPEL, op-cit, p53.
2
Ibid, op-cit,p55.
Chapitre I : Le Contrle Interne 31
la connaissance des rgles respecter et qui nest que la dclinaison
individuelle des objectifs du contrle interne.
1) La mission
Toute fonction sexerce dans le cadre dune politique et chaque responsable doit dfinir, ou
tout le moins connatre, la politique quil doit conduire :
Chaque politique va donc dfinir quelle est la mission du responsable en prcisant :
quelles actions il doit entreprendre ;
dans quel domaine il va les exercer ;
pour atteindre quelle finalit.
La premire question de lauditeur interne : Quelle est votre mission ?
2) Les facteurs de russite
Ces facteurs de russite sont les lments sans lesquels la mission ne peut tre remplie. Ils
se caractrisent par le fait quils sont entre les mains du responsable qui il appartient de se
les procurer.
Il appartient donc au responsable dexiger que ces facteurs de russite soient runis ds
linstant quil accepte la mission qui lui a t confie. Sinon, il est inutile daller plus loin et
donc de mettre en place un contrle interne, ds lors que lon sait que la politique retenue
nest pas ralisable en ltat.
Les facteurs de russite, exprims en termes de besoins seront matrialiss, sous la
rubrique Moyens . Ils doivent tre parfaitement identifis par le responsable, charge pour
lui de faire modifier le contenu de sa mission sil ne peut les satisfaire.
(1)
3) Les rgles respecter
La mission confie ne peut pas, ne doit pas tre remplie cote que cote et quoi quil
arrive. Il y a des limites quil convient de ne pas dpasser et qui sont de deux ordres :
a. Les rgles dthique : dispositions lgales bien sr, mais galement rgles
dthique de lentreprise.
b. Les frontires techniques : au sens le plus large du terme. Ainsi en est-il de la
capacit de production des machines, ou de lchancier fiscal respecter, ou des
obligations juridiques, ou des limites aux possibilits demprunt, etc.
Ces trois pralables tant dfinis, les dispositifs vont pouvoir tre mis en uvre de faon
ordonne tant entendu que ce qui suit constitue les dispositifs gnraux du contrle interne,
soit autant de ttes de chapitre sous lesquels sordonneront les dispositifs spcifiques propres
chaque activit.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne,op-cit,pp165-167.
Chapitre I : Le Contrle Interne 32
II.2. LE CADRE DE CONTRLE
loccasion de chaque mission daudit, les faiblesses, insuffisances, dysfonctionnements
ou erreurs relevs par lauditeur trouveront toujours leur cause premire dans la dfaillance
dun des dispositifs de contrle interne mis en place par le responsable (ou qui na pas t mis
en place). Ces dispositifs peuvent tre regroups sous les rubriques suivantes :
les objectifs ;
les moyens ;
le systme dinformation ;
lorganisation ;
les procdures ;
la supervision.
1) Les objectifs
La politique et lobjet de la mission ayant t prcis, le premier devoir du responsable est
de dfinir les cibles atteindre, pour remplir la tache assigne.
Ces objectifs doivent naturellement sinsrer dans le cadre des objectifs gnraux du
contrle interne, dj analyss et quil nous suffit de rappeler :
protection du patrimoine ;
fiabilit des informations ;
respect des lois, rglements et contrats ;
efficacit des oprations.
(1)
Ces objectifs doivent avoir les critres suivants :
-Ladquation entre objectifs et mission
-Ils doivent tre dclins lintrieur du service : chaque objectif spcifique se ralise par
la ralisation cumule de sous-objectifs assigns aux responsables oprationnels du service.
En bonne organisation, il doit donc y avoir :
o une construction pyramidale des objectifs dont la totalit concourt la ralisation de
lobjectif gnral ;
o des performances assignes chacun en termes dobjectifs afin que ceux-ci soient
traduits dans la ralit oprationnelle.
-Ils doivent tre mesurables, cest--dire exprims en termes numriques : valeurs
objectives atteindre ou dpasser, ratios, indicateurs dactivit ou de qualit.
- Ils doivent pouvoir tre suivis par le systme dinformation disposition du
management, lequel doit tre construit en fonction de la nature des objectifs assigns
chacun.
- Ils doivent se situer dans le temps.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; 2010 ; pp168-169 .
Chapitre I : Le Contrle Interne 33
- Ils doivent tre ambitieux, ce qui exclut toute confusion avec la norme.
Tout manquement ces principes va constituer une faiblesse du systme de contrle
interne de lactivit considre, tout comme labsence dobjectifs de lentit est une faiblesse
de lorganisation tout entire.
2) Les moyens
Ils permettent la ralisation des objectifs : sont-ils adapts aux objectifs fixs ? Vrifier
ladaptation des moyens cest regarder :
a) Les moyens humains
Sans personnel comptent tout systme de contrle interne est condamn et nombreux sont
les cas dans lesquels les anomalies rencontres ont pour cause une formation insuffisante ou,
ce qui revient au mme, une formation non mise jour. Cette observation concerne trois
activits :
(1)
Le recrutement
La formation professionnelle permanente
Lthique
b) Les moyens financiers
Les budgets dexploitation et dinvestissements sont-ils en ligne avec les objectifs ?
c) Les moyens techniques
Il faut comprendre ce terme en son sens le plus large, cest--dire aussi bien techniques
industrielles, que techniques de gestion et techniques commerciales.
3) Les systmes dinformation et de pilotage
Troisime dispositif de contrle interne, et que lon trouve dans toutes les activits.
Lobservation des systmes dinformation par lauditeur interne doit le conduire examiner
les cinq critres qui vont lui permettre de porter un jugement sur la qualit de ces dispositifs.
a) Ils doivent tre fiables et vrifiables
On pourrait dire fiables parce que vrifiables. En effet, une information nest fiable que
si elle est vrifiable et elle nest vrifiable que si on peut lauthentifier.
b) Ils doivent tre exhaustifs
Un systme de pilotage exhaustif est un systme qui comporte un indicateur par
objectif individuel. Tous les objectifs assigns chaque activit doivent pouvoir tre
mesurs et suivis et le systme dinformation doit y pourvoir.
c) Ils doivent tre disponibles en temps opportun
Il est ncessaire que les informations soient disponibles au moment o lon en a besoin,
ce qui bien videmment nest pas toujours le temps rel.
d) Ils doivent tre mis--jour
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; pp170-171.
Chapitre I : Le Contrle Interne 34
e) Ils doivent tre utiles et pertinents
Ce qui correspond au critre de la qualit : satisfaire les besoins des utilisateurs . La
pertinence ajoute lutilit en ce sens quelle permet de slectionner parmi les indicateurs et
informations utiles , ceux qui rpondent le mieux lobjectif recherch et qui sont donc les
mieux adapts.
Entendu au sens large Les systmes dinformation et de pilotage comportent de
nombreux lments :
(1)
le contrle de gestion et le contrle budgtaire ;
le tableau de bord et ses lments ;
tous les tests et contrles prventifs, dfectifs et correctifs. Rentrent en particulier dans
cette catgorie tous les contrles introduits ou introduire dans les systmes
informatiques, contrles bloquants ou simples messages dalerte ;
toutes les donnes statistiques utiles la gestion.
Et nous mettrons sous cette rubrique le systme de communication, grce auquel chacun va
avoir accs linformation dont il a besoin et rien que cela.
Cest--dire que les systmes dinformation doivent tre allgs de tout ce qui nest pas
utile lapprciation de la ralisation des objectifs.
4) Lorganisation
Une organisation de qualit doit respecter trois principes gnraux, elle se compose de
quatre lments constitutifs :
4.1. Les trois principes respecter
a) Ladaptation
Il ny a pas de modle unique qui pourrait servir de rfrentiel pour tous ; on peut mme
dire quil nexiste pas de panoplie de modles dans laquelle on pourrait puiser. La diversit
des organisations est aussi grande que peut ltre la diversit des entreprises : taille, nature
dactivit, objectifs, environnement, structures juridiques sont autant de variables qui vont
gnrer des organisations diffrentes. Mais le principe essentiel est que lorganisation doit tre
adapte la culture, lenvironnement, lactivit, etc.
Dans cette adaptation que devront raliser les managers, trois cueils sont viter :
Lorganisation anarchique, laquelle on peut assimiler labsence dorganisation : cest
celle dans laquelle les responsabilits ne sont pas dfinies, on ne sait pas qui fait quoi et
lentit vit au jour le jour.
Lorganisation excessive, qui conduit elle aussi la paralysie : ici la cohrence est totale,
mais la minutie de lorganisation, le pointillisme des rgles sont tels que rien ne bouge. Et
cette situation est encore aggrave si des sanctions menacent les contrevenants.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; pp172-175.
Chapitre I : Le Contrle Interne 35
Lorganisation immobile : une organisation adapte, cest aussi une organisation qui
sadapte. Ce principe dadaptation doit se conjuguer avec le second principe : lobjectivit.
b) Lobjectivit
Une organisation objective est une organisation qui nest pas construite en fonction des
hommes.
c) La scurit ou la sparation des tches
Sorganiser, et sorganiser avec le maximum de scurit, cest rpartir les tches de telle
faon que certaines dentre elles, fondamentalement incompatibles, ne puissent tre exerces
par une seule et mme personne.
La fonction de dcision : cest celle de lordonnateur, dtenteur dun budget
dexploitation ou dinvestissement et qui a le pouvoir dengager lentreprise dans les limites
qui lui ont t attribues.
La fonction denregistrement : cest la fonction comptable par laquelle toute opration
fait lobjet dune criture.
La fonction financire : cest lacte de paiement ou de recette qui doit rester autonome.
Cet acte de paiement ou de recette se matrialise de diverses faons : signature ou
encaissement de chques, remise ou encaissement despces, ordres de virement, etc.
La fonction de dtention : les titulaires de la fonction de dtention sont ceux qui
dtiennent et conservent des biens physiques : magasiniers, gestionnaires de stocks. On peut
galement ajouter les caissiers, ceci prs quil ny a pas dincompatibilit entre la dtention
des valeurs et la fonction financire.
La fonction de contrle : le mot contrle est ici entendu au sens de vrification, et qui
ne sexerce que dans les cas o les rgles de lentreprise exigent une autorisation
supplmentaire pour lexercice de lune des fonctions prcdentes.
La confusion de deux au moins de ces fonctions cre des situations risque qui mettent en
pril les actifs de la socit et, dans le meilleur des cas, cre des risques derreurs et de
confusions quil convient dviter.
Dans les cas ou le personnel ou la taille dune entit sont limits, il nexiste gure que trois
faons pour raliser la scurit des taches :
(1)
Faire tourner les tches, en crant une polyvalence au sein des personnes et en
permutant les activits des unes avec les activits des autres. sans modifier les
rattachements hirarchiques,
Faire tourner les personnes : on a alors recours la mutation, qui exige moins de
polyvalence que la formule prcdente car elle sexerce selon un rythme plus lent.
Renforcer la vrification
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; pp177-179.
Chapitre I : Le Contrle Interne 36
Dans le respect de ces trois principes, le dispositif dorganisation se traduit par la mise en
place de quatre lments constitutifs.
4.2. Les quatre lments constitutifs
Ce sont :
o lorganigramme, hirarchique pour savoir qui commande qui ;
o lanalyse de poste pour savoir qui fait quoi ;
o le recueil des pouvoirs et latitudes pour connatre les limites des pouvoirs de
chacun ;
o llment matriel qui organise lenvironnement.
Pour tre bien matris, tout service, toute fonction doit sorganiser autour de ces quatre
points
a)Lorganigramme hirarchique
Cest le premier document que doit se faire communiquer lauditeur ; lorganigramme
hirarchique permet dabord de bien comprendre le fonctionnement de lunit, il peut ensuite
et par simple lecture, signaler des pistes intressantes. Lorganigramme hirarchique doit
comporter la mention de la date laquelle il a t tabli.
b) Lanalyse de poste
Lanalyse de poste (ou description de poste) permet de dtecter des situations anormales.
Ce document est donc un document descriptif qui prcise la nature des tches effectues :
dcision, excution, contrle, coordination, information
Pour que lanalyse de poste joue pleinement son rle, il ne suffit pas quelle existe, encore
faut-il quelle soit :
communique au personnel concern ;
comprise par ce dernier (ce qui veut dire quil doit avoir la formation pour comprendre
et excuter) ;
mise jour en fonction de lvolution de lorganisation ;
archive, donc conserve, par les responsables.
c)Le recueil des pouvoirs et latitudes
Chacun doit connatre avec prcision ce quil doit faire, mais chacun doit savoir galement
dans quelles limites se situent ces dlgations de pouvoir.
On peroit bien que ces dlgations doivent tre :
(1)
crites ;
connues des bnficiaires et de leur hirarchie ;
ventuellement, connues de certains tiers privilgis (banques, administrations)
et surtout : mises jour en fonction des changements, mutations, modifications.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; pp180-181.
Chapitre I : Le Contrle Interne 37
d) Llment matriel
Les lments constitutifs de lorganisation sinsrent et se dveloppent dans un
environnement qui doit tre organis pour leur permettre de fonctionner en assurant la
protection physique des biens et des personnes.
5) Les mthodes et procdures
Les mthodes de travail et procdures de lentreprise doivent tre dfinies et concerner
toutes les activits et tous les processus. Ces documents doivent tre :
crits: Pas de connaissance exclusivement orale ;
Simples et spcifiques : Ce doivent tre des outils de travail auxquels se rfrent les
excutants pour connatre la norme respecter ;
Mis jour rgulirement : Ce qui implique la responsabilit de la hirarchie, charge
de dfinir ses propres mthodes de travail et qui doit donc les mettre jour. Ce nest
jamais une uvre accomplie une fois pour toutes, cest un travail permanent ;
Ports la connaissance des excutants : On peut mme dire porte de main :
outil de travail le recueil des procdures ne doit pas tre conserv sous cl,
disposition de quelques privilgis seuls dtenteurs du savoir.
On peroit bien limportance des procdures dans un dispositif de contrle interne.
6) La supervision
Cest le sixime et dernier dispositif de regroupement des lments du contrle interne
dont les auditeurs examineront la qualit.
On peut dabord dfinir la supervision par ce quelle nest pas :
ce nest pas refaire le travail de ses subordonns ;
ce nest pas tendre des piges pour dceler les erreurs ;
ce nest pas pratiquer en permanence lexamen attentif de ce qui se fait, comme le
surveillant dans la classe.
(1)
Superviser cest :
Dabord un acte dassistance : aider le collaborateur dans les tches nouvelles et
difficiles, lui montrer le chemin, rgler les conflits et ce faisant dtecter ses points
forts et ses points faibles.
Ensuite un acte gratifiant : montrer aux autres que lon sintresse leur travail, que
leurs efforts ou leurs difficults ou leurs performances ne sont pas ignors.
Enfin un acte de vrification : montrer que de temps autre, selon une priodicit
tout fait alatoire, mais certaine, quelquun vient regarder et vrifier comment les
choses se passent.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit , pp182-184.
Chapitre I : Le Contrle Interne 38
toute supervision doit laisser une trace de son passage : visa, note, compte rendu la
trace est ncessaire pour apprcier la qualit du management et se reprer dans la
frquence des actes de supervision ;
la supervision doit tre universelle : toute tche, quelle quelle soit, doit tre
supervise. Seule la frquence de lacte de supervision distingue les tches essentielles
des tches subalternes.
La supervision va de pair avec un bon systme dinformation et de pilotage qui permet au
superviseur de mesurer les progrs raliss dans la poursuite des objectifs.
III.HIRARCHIE ET COHRENCE DES DISPOSITIFS
1) La hirarchie
La liste des dispositifs stablit en fait selon une certaine hirarchie depuis la supervision
en bas de lchelle jusquaux objectifs situs au sommet. On peut sgrger ces dispositifs en
deux familles :
a. Les dispositifs de pilotage
objectifs ;
moyens ;
systmes dinformation.
b. Les dispositifs de contrle
organisation ;
mthodes et procdures ;
supervision.
2) La cohrence
Tous les dispositifs prcdemment analyss sordonnent et se compltent selon une
cohrence qui donne lensemble sa force et sa rigueur.
(1)
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit, pp185-188.
Chapitre I : Le Contrle Interne 39
Conclusion
En conclusion, nous tirons les points cls de contrle interne :
Le contrle interne se dfinit comme un ensemble de moyens aidant une organisation
raliser ses objectifs que lon peut classer en quatre catgories :
efficacit et efficience des oprations ;
fiabilit de linformation interne et externe ;
la protection du patrimoine ;
conformit aux lois, aux rglements et aux politiques internes.
Le champ du contrle interne comporte toutes les activits de gestion, lexception, de
ltablissement des objectifs, de la planification stratgique, de la gestion des risques et
des mesures correctives, des prises de dcision.
Tout systme de contrle interne ne peut fournir quune assurance raisonnable que
lorganisation pourra atteindre ses objectifs. Il existe en effet des limites inhrentes au
contrle interne :
erreurs de jugement dans la prise de dcision ;
dfaillances dues des erreurs humaines ;
contrles outrepasss par la direction.
Par ailleurs, il faut tenir compte de lquilibre cots/avantages dans ltablissement dun
systme de contrle interne.
Le systme de contrle interne doit reposer sur des valeurs thiques traduites dans un code
de conduite ; les politiques et les pratiques en matire de ressources humaines doivent tre
dtermins en fonction de ces valeurs thiques ; les pouvoirs et les responsabilits de
chacun doivent tre clairement dfinis ; les membres de lorganisation doivent possder
les connaissances et les comptences ncessaires laccomplissement de leurs tches.
Il est ncessaire de disposer dune information pertinente, fiable et diffuse au moment
opportun aux personnes qui en ont besoin pour leur permettre dassumer leurs
responsabilits, sachant que les besoins en information ainsi que les systmes
dinformation doivent voluer en fonction des changements de lenvironnement.
Il convient de mettre en avant un processus de surveillance permanente du contrle interne
et de raliser des valuations ponctuelles de son efficacit.
Le contrle interne est laffaire de tous : conseil dadministration et ses comits ; direction
gnrale ; lensemble des managers ; laudit interne ; tout le personnel.
Chapitre II : Laudit et le
contrle internes bancaires
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 41
Contrairement une ide reue, laudit interne nest pas une fonction comptable et
financire ou du moins nest pas que cela. En effet, sa mission consiste analyser les risques,
tous les risques, quils soient oprationnels, financiers ou de conformit, susceptibles
daffecter la ralisation des objectifs fixs par lorganisation, puis sassurer quil existe un
dispositif de contrle interne parfaitement adapt sa situation et, si tel nest pas le cas, faire
toutes les propositions ncessaires pour y pourvoir.
Laudit interne est une fonction en perptuelle volution, au rythme des besoins changeants
des organisations, et sa mutation nest pas acheve. Cette volution peut tre clairement
observe en France, o 77 % des services daudit interne sont rattachs la direction gnrale
ou au prsident du Conseil si lon en croit lenqute effectue par lIFACI en 2005, contre 15
% la direction financire. Elle est beaucoup moins marque dans dautres pays, aux tats-
Unis notamment, o le rattachement la direction financire concerne encore 45 % 50 %
des entreprises.
(1)
La banque, par exemple, en raison essentiellement de ses caractristiques propres, mais
aussi du rglement 97/02 et des contrles stricts exercs par la Commission bancaire, a
dvelopp un audit interne puissant, reconnu et respect, ce qui nest pas encore tout fait le
cas pour laudit interne des secteurs de lindustrie, du commerce et des services.
Nous allons aborder dans ce chapitre trois sections. La premire section sera consacre
pour Gnralits sur lAudit Interne. La deuxime traitera dabord les outils daudit interne
ensuite la conduite dune mission daudit interne et enfin dans la troisime section la banque
et les risques bancaires.
1
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p 6.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 42
Section I : Gnralits sur lAudit Interne
I - volution historique de laudit et naissance de la fonction audit interne
La cration de la fonction daudit interne dans les entreprises sinscrit dans le cadre plus
gnral de lvolution de la notion daudit.
Le mot audit , qui nous vient du latin audire, cest--dire couter , a pour anctre en
France le commissariat aux comptes, institu par la loi du 24 juillet 1867. Le commissaire aux
comptes avait alors pour rle la vrification des comptes. On parla de rvision des comptes
avant de lui prfrer le terme daudit qui a une connotation plus valorisante. Progressivement,
le terme daudit connut un largissement la fois horizontal et vertical en raison de limage
de rigueur quil vhicule, des risques quil parvient identifier, des politiques et des plans
quil doit accompagner, des conomies quil permet de raliser, de linstabilit de
lenvironnement, de la complexit des paramtres de gestion et de contrle quil doit
matriser. Toutes ces vertus associes au mot audit ont fortement contribu son
dveloppement et sa gnralisation.
Laudit peut tre apprhend selon les critres statutaires, gographiques et selon lobjectif
poursuivi.
1) Selon le critre statutaire : on distingue laudit lgal de laudit contractuel. La lgalit
de laudit repose sur le fait que lactivit de lauditeur est exerce dans un cadre lgal
prdfini et obligatoire. En France, il se confond le plus souvent avec le commissariat aux
comptes et aboutit une certification des tats financiers. En revanche, un audit peut tre
souhait ou sollicit par une entreprise en dehors de toute obligation lgale pour rpondre
des besoins spcifiques. On parlera alors daudit contractuel, dans la mesure o les missions
dun tel audit sont dfinies par le client.
2) Selon lobjectif : Laudit peut tre aussi examin en fonction de la nature des objectifs
assigns la mission. Entrent dans ce cadre laudit financier et laudit oprationnel.
Laudit financier apparat comme la forme daudit la plus ancienne et la plus connue
du public. Pour ce dernier, lobjectif principal est la certification du bilan et du
(1)
compte de rsultat, partir de deux notions fondamentales : la rgularit et la sincrit
des comptes annuels.
Laudit oprationnel, plus orient vers les oprations de gestion, lobjectif est
lvaluation des dispositifs organisationnels visant lconomie, lefficience et
lefficacit des choix effectus dans lentreprise tous les niveaux et/ou lvaluation
des rsultats obtenus de ces dispositifs . Cest donc la recherche de lefficacit, de
lefficience, bref de lamlioration des performances de lentit audite qui anime
lauditeur oprationnel.
1
Jacques Renard , Audit interne ce qui fait dbat , Paris, France ; Maxima, 2003, pp17-18.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 43
On parle aussi daudit objectif tendu ou valuation globale. Ce type daudit dsigne la
synthse de laudit financier et de laudit oprationnel. Au-del de sassurer de la conformit
et/ou de la rgularit et de la sincrit des comptes aux lois et rglements en vigueur, de
dterminer lefficacit et lefficience de la gestion de lentit, il sagira aussi de dterminer si
les objectifs stratgiques sont atteints.
3) Selon le critre gographique : On distingue laudit interne de laudit externe. Ce
dernier est beaucoup plus connu sous le nom daudit comptable et financier. Il est exerc par
des experts indpendants de lentit auditer. En revanche, laudit interne est ralis par des
salaris de lentit audite.
(
1
)
Aujourdhui, le regard de laudit interne, regard particulier mais professionnel, est apprci
comme un examen salutaire, lquivalent de la maintenance prventive sur les outils
industriels ou de lassistance dans le diagnostic dune dfaillance repre. Profession cratrice
de valeur ajoute, laudit est un partenaire de la direction gnrale et du management
notamment vis--vis de la maitrise des oprations de lorganisation.
Issue du contrle comptable et financier, la fonction audit interne recouvre de nos jours
une conception beaucoup plus large et plus riche, rpondant aux exigences croissantes de la
gestion de plus en plus complexe des entreprises.
Laudit interne dcle les problmes et formule des recommandations aux directions et aux
audits qui leur apportent une solution. Son rle nest pas de dnoncer ou daccuser, mais
darbitrer les rgles du jeu du groupe et surtout de faire pratiquer les 3R : Rechercher,
Reconnaitre et Remdier aux faiblesses de lorganisation. Il aide anticiper les problmes et
se place dans une dmarche vertueuse damlioration continue.
(2)
II - Dfinition de l'audit interne
Fonction volutive, laudit interne a vu se succder plusieurs dfinitions avant que la
notion ne soit stabilise.
1) Dfinition de lIFACI
LInstitute of Internal Auditors (IIA), dont lune des missions est dlaborer les normes et
les pratiques professionnelles, a donn en 1999 une dfinition de laudit interne, adapte par
lIFACI en ces termes :
L'Audit Interne est une activit indpendante et objective qui donne une organisation
une assurance sur le degr de matrise de ses oprations, lui apporte ses conseils pour les
amliorer, et contribue crer de la valeur ajoute.
1
Jacques Renard , Audit interne ce qui fait dbat, op-cit, p19.
2
Pierre Schick ; Prface de Serge Evraert et jacques vera ; Mmento daudit interne : Mthode de conduite
dune mission ; Dunod, Paris 2007, pp 4-5.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 44
Il aide cette organisation atteindre ses objectifs en valuant par une approche
systmatique et mthodique, ses processus de management des risques, de contrle, et de
gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacit.
(
1
)
Comme indiqu dans sa dfinition officielle, lactivit de laudit interne est cratrice de
valeur ajoute et ses principales missions sont dapporter aux directions gnrales et comits
daudit un clairage sur les risques et les systmes de contrle interne mais galement dtre
au service de lensemble de lorganisation afin dapporter une relle contribution la
gouvernance dentreprise.
(
2
)
Il savre utile de sarrter sur la signification de certains termes cls voqus :
Activit : lusage du terme activit, par opposition fonction, signifie la possibilit pour
une structure daudit interne de recourir des prestataires externes et vaut la reconnaissance
de diffrentes modalits de mise en uvre de ses attributions (missions, auto-
valuations.etc.)
Assurance : laudit interne doit constituer le processus par lequel lorganisation sassure
que les risques auxquels elle doit faire face sont compris et grs de faon approprie. Ceci
ncessite alors plus de diligences exerces par les auditeurs internes.
Conseil : il traduit une orientation client interne . Ceci entraine une large gamme de
services offerts par les structures audit interne, base sur une meilleure exploitation des
comptences dont elles disposent, et une plus grande flexibilit dans laccomplissement des
missions.
Risque : cette notion nest pas limite seulement aux risques financiers, oprationnels et
stratgiques encourus par une organisation, mais intgre galement la non-exploitation des
opportunits offertes. Elle confre laudit interne une dimension proactive (par opposition
ractive) et le situe au cur du management.
(
3
)
Laudit interne doit vivre lentreprise, tre imprgn de sa culture, se sentir concern par
tout ce qui la touche, ses succs comme ses difficults ou ses checs. En consquence,
lexternalisation du service daudit interne, association insolite de termes contradictoires
diraient daucuns, est bannir.
En revanche, le recours ponctuel des ressources et des comptences externes, lorsque la
ncessit sen fait sentir, est recommander.
(4)
1
Institut de laudit interne, Prise de position IFACI/ audit interne/qualit , mai 2004, p4.
2
Pierre Schick ; op-cit, p6.
3
Mmoire prsent par : Mohamed Adel benhayoun sadafi, audit interne levier de performance dans les
organisations publiques, cycle suprieur de gestion, institut suprieur de commerce et dadministration des
entreprises, rabat ; 2001, p09.
4
Jacques Renard , Audit interne ce qui fait dbat , op-cit, p19.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 45
2) Autres dfinitions
a) Laudit interne est un dispositif interne lentreprise qui vise :
- apprcier lexactitude et la sincrit des informations notamment comptables,
- assurer la scurit physique et comptable des oprations,
- garantir lintgrit du patrimoine,
- juger de lefficacit des systmes dinformation.
Outre le fait que laudit interne nest pas un dispositif (mais une fonction) cette
dfinition, au demeurant incomplte, confond les rles de laudit interne ( apprcier
juger ) avec les objectifs du contrle interne ( assurer garantir ).
b) Ralis par un service de lentreprise laudit interne consiste vrifier si les rgles
dictes par la socit elle-mme sont respectes .
Dfinition extrmement restrictive, limite un simple audit de conformit des rgles de
lentreprise.
(
1
)
Dire que laudit interne est une fonction, cest exprimer clairement quil est partie
intgrante de lorganisation, de lentreprise. Changer de mot et dire que cest une activit est
une faon de signifier que lAudit Interne peut sans dommage et sans altration ne plus tre
interne.
Une fonction fait partie de ce qui est ncessaire pour que fonctionne lentreprise,
lorganisation. Dire que lAudit Interne est une fonction, cest galement affirmer quil est un
rouage indispensable la bonne marche de lensemble, cest souligner son importance.
(2)
De tout ce qui prcde on peut dduire que lAudit interne agit dans le souci dapporter une
valeur ajoute lentit, Il doit valuer la conception, la mise en uvre et lefficacit des
objectifs gnraux du contrle interne ; des programmes et des activits de l'organisation.
III - Le code de dontologie
Il prcise aux auditeurs les valeurs respecter dans laccomplissement de leur activit et
sappuie sur quatre principes fondamentaux pertinents pour une pratique tique de laudit
interne.
Lintgrit : la base de confiance et de crdibilit du jugement de lauditeur.
Lobjectivit qui permet dvaluer quitablement tous les lments pertinents examins
relatifs au domaine audit et de ne pas se laisser influencer dans son jugement.
La confidentialit concernant les informations reues et leurs divulgations.
La comptence requise pour la ralisation des travaux daudit.
(
1
)
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit, p06.
2
Jacques Renard , Audit interne ce qui fait dbat,op-cit ; p19.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 46
IV- Charte et normes daudit interne
1) Charte de laudit interne
Pour jouer leur rle et contribuer ainsi lamlioration de la performance dun groupe, les
quipes daudit doivent respecter une thique et informer lensemble des parties prenantes sur
leurs objectifs et leurs mthodes. Lexistence dans chaque socit dune charte daudit interne
le permet.
Cest un document solennel, labor par le responsable de laudit interne, sign par la
direction gnrale et revu par le comit daudit.
La charte doit prciser les missions, objectifs, responsabilits et procdures de travail. Elle
fournit un support de communication de laudit interne vers ses partenaires.
(
2
)
2 2) ) D D f fi in ni it ti io on n d de es s n no or rm me es s i in nt te er rn na at ti io on na al le es s p po ou ur r l la a p pr ra at ti iq qu ue e d de e l l a au ud di it t i in nt te er rn ne e
Laudit interne est exerc dans diffrents environnements juridiques et culturels ainsi que
dans des organisations dont l'objet, la taille, la complexit et la structure sont divers. Il peut
tre en outre exerc par des professionnels de l'audit, internes ou externes l'organisation.
Comme ces diffrences peuvent influencer la pratique de l'audit interne dans chaque
environnement, il est essentiel de se conformer aux Normes internationales pour la pratique
professionnelle de l'audit interne de lIIA (ciaprs les Normes ) pour que les auditeurs
internes et laudit interne s'acquittent de leurs responsabilits.
Les Normes se composent des Normes de Qualification, des Normes de Fonctionnement et
des Normes de Mise en uvre.
( (3 3) )
V -Les fonctions voisines de laudit interne
Pour une meilleure clarification du positionnement de la fonction daudit interne au sein
dune organisation et du rle quil est appel jouer, nous allons prsenter des fonctions
proches en mettant laccent sur les points de divergence existantes entre elles et laudit
interne.
(4)
1) Audit externe
On appelle audit externe laudit comptable et financier, que la mission soit de certifier les
tats financiers ou de donner des conseils dans ce domaine.
1
Pierre Schick ; op-cit, pp 09-10 .
2
Ibid, pp28-29.
3
IFACI, the institute of internal auditors, Normes daudit interne, publication oct 2008-rvision janvier 2011,
pp1-2.
4
Pierre Schick ; op-cit, p28.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 47
Tableau n01 : Comparaison entre laudit interne et laudit externe.
Audit interne Audit externe (CAC)
Mandat De la direction gnrale,
pour les responsables de
lentreprise.
Du conseil dadministration
pour les tiers qui requirent
des comptes certifis.
Missions Lies aux proccupations de
la direction gnrale :
dclenchement sur dcision.
Tous les types daudit et tous
les sujets.
Lies la certification des
comptes : mise en uvre
annuelle. Audit de rgularit
uniquement, dans le domaine
comptable.
Conclusions Constatations approfondies
ds quexiste un potentiel de
dysfonctionnements, pour
identifier les causes et dfinir
les actions quil ya lieu de
mener.
Obligation de rsultats.
Constatations succinctes :
examen des circuits cls et
des montants suprieurs un
seuil de signification pour
dresser des constats de
carence et informer
(rsoudre).
Obligation de moyens.
Source : Pierre Schick ; Prface de Serge Evraert et jacques vera ; pp 09-10
2) Linspection
Tableau n02 : Comparaison entre laudit interne et linspection.
Audit interne Inspection
Efficacit / Rgularit Contrle le respect des rgles
et leur pertinence, caractre
suffisant..
Contrle le respect des rgles
sans les interprter ni les
remettre en cause.
Mthodes et objectifs Remonte aux causes pour
laborer des recommandations
dont le but est dviter la
rapparition du problme.
Sen tient aux faits et identifie
les actions ncessaires pour les
rparer et remettre en ordre.
Evaluation Considre que le chef ou le
responsable est toujours
responsable et donc critique
les systmes et non les
hommes : value le
fonctionnement des systmes.
Dtermine les responsabilits et
fait ventuellement sanctionner
les responsables.
Evalue le comportement des
hommes, parfois leurs
comptences et qualits.
Service / Police Privilgie le conseil et donc la
coopration avec les audits.
Privilgie le contrle et donc
lindpendance des contrleurs.
Slection/ Slectivit Rpond aux proccupations
du management soucieux de
renforcer sa maitrise, sur
mandat de la direction
gnrale.
Investigations approfondies et
contrles trs exhaustifs,
ventuellement sous sa propre
initiative.
Source : Pierre Schick ; Prface de Serge Evraert et jacques vera ; p54.
3) Contrle de gestion (Management Control)
Est le processus par lequel les dirigeants de lentreprise sassurent que lorganisation met
en uvre des stratgies de manire efficace et efficiente. Il fournit au sommet stratgique de
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 48
lorganisation toutes les informations utiles pour apprcier le niveau de maitrise des activits
par rapport aux finalits, lexcution des missions, le dploiement de la stratgie et latteinte
des objectifs oprationnels de lorganisation.
(
1
)
La distinction avec laudit interne est la plus ncessaire car ces deux fonctions
interviennent dans le mme domaine, la gestion de lentreprise et son amlioration, en
fonctionnels (analystes, conseillers) et non oprationnels (responsables, dcideurs), et en
toute indpendance (rattachement haut niveau) elles se distinguent par leurs modes
opratoires
Tableau n03 : Comparaison entre laudit interne et le contrle de gestion.
Audit interne
Comment fonctionne ce qui existe,
comment lamliorer ?
Contrle de gestion
Ou voulons-nous aller, par ou passer ?
Photo priodique dtaille. Cinma continu et global.
Va des problmes rencontrs en pratique
leurs causes et consquences.
Va des indicateurs gnraux aux paramtres
particuliers.
Contrle lapplication des directives, la
fiabilit des informations et ladquation des
mthodes : les processus, les conditions
dobtention des rsultats.
Audite la fonction contrle de gestion.
Planifie et suit les oprations et leurs rsultats.
Conoit et met en place le systme dinformation
pour ce faire.
Analyse le budget du service daudit interne.
Dcouvre les moyens organisationnels pour
atteindre les objectifs.
Elabore les objectifs en sappuyant sur des
hypothses explicites.
La mission daudit interne et celle du contrle de gestion se compltent et spaulent
mutuellement :
- Le contrle de gestion peut demander un arrt sur image ; un zoom, une vue dtaille et
sure laudit interne.
- Laudit interne peut sappuyer sur la connaissance du contrle de gestion pour laborer
un plan daudit.
Source : Pierre Schick ;Prface de Serge Evraert et jacques vera ,pp59-60.
4) La Gestion des risques (Risk Management) :
Cest une fonction dingnierie des risques visant les identifier, les valuer et les
hirarchiser au regard du cout des mesures adoptes compar sa frquence doccurrence et
la gravit de ses consquences, dfinir des stratgies de gestion insres dans le dispositif de
contrle interne et piloter les alas rsiduels.
La fonction dintresse aux risques purs (alatoires ou accidentels sans esprance de gain)
portant sur les biens, les personnes, lenvironnement et les processus, et ce loppos de
laudit interne axe sur les risques de dysfonctionnements lis des transgressions de rgles,
des dsordres et des inefficacits.
(2)
1
Mohamed Adel benhayoun sadafi, op-cit, p29.
2
Ibid, op-cit, p29.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 49
Laudit interne est une fonction qui prsente de grandes spcificits et ne peut tre
compare aucune autre. Elle dispose en fait des caractristiques dune profession norme
lchelle internationale : mme dfinition, mmes standards professionnels, mme code de
dontologie; un examen mondialement reconnu, le CIA (Certified Internal Auditor), auquel
est venu sajouter pour les pays francophones le DPAI (Diplme Professionnel de lAudit
Interne) ; une valuation rgulire enfin de son bon fonctionnement par des organismes
indpendants.
Section II : les outils et la dmarche dune mission daudit interne
I- Les outils de laudit interne
I -1-Les outils de description
1)-LObservation physique
Lauditeur interne nest pas quelquun qui reste dans son bureau : il saisit toutes les
occasions pour aller sur le terrain et pratiquer lobservation physique.
Lobservation physique par lauditeur est un outil dapplication universelle car tout est
observable. Une mission daudit qui se bornerait faire des interviews, pourrait tre
considre comme une enqute dopinion, ce ne serait pas une mission daudit interne.
Lobservation lmentaire des biens, cest linventaire. Mais il ny a pas que
lobservation quantitative des biens, il y a aussi lobservation qualitative.
a)Lobservation des documents
b) Observation des comportements Il existe deux grandes catgories dobservation :
lobservation directe et lobservation indirecte.
Lobservation directe est celle qui permet le constat immdiat du phnomne : les
employs ne prsentent pas leur carte lentre des bureaux. Cest cette observation
mme qui va figurer sur la FRAP, elle aura t constate directement par lauditeur.
Lobservation indirecte, au contraire, fait appel un tiers qui va observer pour le compte
de lauditeur et va lui communiquer le rsultat de son observation. Cest le cas bien connu
des circularisations des dettes et crances.
2)-La narration
Il existe deux sortes de narration, toutes les deux utilises en audit interne : la narration par
laudit et la narration par lauditeur. La premire est orale, la seconde est crite.
La narration par laudit est la plus riche, cest elle qui apporte le plus denseignements ; la
narration par lauditeur nest quune mise en ordre des ides et des connaissances.
(1)
1
Khelassi Reda ; Laudit interne Audit oprationnel- : Techniques, Mthodologie, Contrle interne ; ditions
Houma ; Alger 2007, pp351-353.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 50
La narration, et surtout si elle est structure et logique, va tre de lecture facile pour un
tiers. La communicabilit de linformation est, en effet, un des avantages essentiels de ce
mode dexpression qui nest pas un outil de premire description puisquil nest que la mise
en ordre de renseignements obtenus par ailleurs.
3)-Lorganigramme fonctionnel
Lorganigramme fonctionnel, va tre construit par lauditeur, si celui-ci le juge ncessaire,
pour y voir plus clair. Lauditeur le dessine partir dinformations recueillies par
observations, interviews, narrations
Le dessin dun organigramme fonctionnel permet denrichir les connaissances obtenues
partir de laddition : organigramme hirarchique + analyses de poste. Cest, en gnral, le
document qui permet de passer de lun lautre car il rvle la totalit des fonctions existantes
et permet donc daller voir, si on trouve leur traduction, dans les analyses de poste.
4)-La grille danalyse des taches
Elle va vritablement relier lorganigramme fonctionnel lorganigramme hirarchique et
justifier les analyses de postes. Tous ces documents refltant une situation une date donne,
il en est de mme de la grille danalyse des tches, qui est la photographie un instant T de la
rpartition du travail. Sa lecture va permettre de dceler sans erreur possible les manquements
la sparation des tches et donc dy porter remde. Elle permet galement de faire le premier
pas dans lanalyse des charges de travail de chacun.
5)-Le diagramme de circulation
(1)
Si la grille danalyse des tches est statique, le diagramme de circulation est dynamique :
lun est la photographie, lautre le cinma. Le diagramme de circulation, ou flow chart,
permet de reprsenter la circulation des documents entre les diffrentes fonctions et centres de
responsabilit, dindiquer leur origine et leur destination et donc de donner une vision
complte du cheminement des informations et de leurs supports.
(2)
6)-La piste daudit
La piste daudit est dfinie comme un ensemble de procdures internes permanentes. Ce
fut lorigine et cest encore un outil de contrle comptable, applicable dsormais aux
comptabilits informatises. Des dispositions rglementaires et professionnelles ont rendu
cette technique dapplication obligatoire.
Il sagit de remonter lenvers les oprations qui ont conduit la dtermination du rsultat
pour en retrouver lorigine (chemin de piste). Lexigence dtre en mesure de raliser ce
cheminement tout moment implique que :
1
Khelassi Reda ; op-cit, pp355-357.
2
Jacques Renard , Audit interne ce qui fait dbat,op-cit ;p172.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 51
les documents justificatifs soient dats et conservs chronologiquement (on imagine la
complexit dans les chanes de traitement informatique) ;
des rgles de sauvegarde informatique soient dfinies ;
les traces informatiques soient utilisables.
Ainsi conue la piste daudit apparat plus comme un dispositif de contrle interne que
comme un outil au service de lauditeur.
III-2- Les outils dinterrogation
1)-Les sondages statistiques (Echantillonnage)
Le sondage statistique est une mthode qui permet, partir dun chantillon prlev de
faon alatoire, dans une population de rfrence, dextrapoler la population, les
observations faites sur lchantillon.
(1)
2)-Les interviews
Cette technique consiste sentretenir avec le personnel afin den apprendre plus sur
lenvironnement interne de lentreprise. Linterview contribue prparer le terrain. Elle vise
lobtention dinformations prcises qui permettront de se faire une opinion sur les
observations et hypothses mises priori.
(2)
De surcrot, linterview daudit interne ne saurait tre confondue avec des techniques
dapparence similaire : ce nest ni une conversation, ni un interrogatoire.
Linterview daudit se droule normalement en quatre tapes :
a) Prparation de linterview ;
b) Dbut de linterview ;
c) Le droulement de linterview ;
d) La conclusion de linterview.
III -3 - Les outils informatiques
Ils sont de plus en plus nombreux et sont dautant plus difficiles inventorier que la
plupart des services daudit interne crent leurs propres outils, plutt que dadopter des
logiciels peu adapts la fonction.
III - 4 - Outils mthodologiques
Ils permettent lauditeur interne de concevoir son tableau de risques, dtablir et de suivre
le droulement de son QCI, de formaliser les FRAP, etc. Dautres logiciels permettent
ltablissement de cartographies des risques.
1
Khelassi Reda ;op-cit, p367.
2
Ibid, p335.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 52
1)-les questionnaires (check-list)
Le contrle interne ncessite la recherche de toutes les informations valables concernant
lactivit audite. Afin de runir ces lments, lauditeur dispose dune batterie de questions
pour atteindre le but quil sest fix, cest le questionnaire.
Le questionnaire de base utilis dans les travaux daudit est structur autour de cinq
questions :
Quoi ? question oriente sur le travail ;
Qui ? question oriente sur lexcutant ;
Ou ? question oriente sur le lieu dexcution ;
Quand ?question oriente sur lordre dexcution et le moment dexcution ;
Comment ? question oriente sur la mthode de travail.
La forme et le contenu du questionnaire sont rvlateurs de lapproche suivie :
(1)
Approche visant luniversalit de la couverture : questionnaire ferm ;
Approche ad hoc : questionnaire ouvert.
2)- la feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP
La feuille de rvlation et danalyse de problme (FRAP) est un document de synthse qui
sintgre dans la mthodologie gnrale danalyse du contrle interne. Elle permet de rsumer
la nature du problme, de formaliser la nature du risque du secteur dactivit audit, den
apprcier la cause, puis les consquences et de proposer succinctement des recommandations.
Elle doit comporter une indication des rsultats de discussion avec les audits.
Par son caractre normatif, ce type de document facilite la consolidation des lments
rptitifs, llment des manuels daudit, des rfrentiels et des logiciels daudit.
3)- les rapports
Le rapport est le produit principal de laudit. Cest loutil de communication des rsultats,
des opinions, des rserves et de lacceptation (ou contestation) des audits. Sa forme et son
contenu doivent sajuster la culture de lorganisation.
(2)
III- 5- Vrifications, Analyses, et rapprochements divers
Ce ne sont pas des outils proprement parler mais plutt des procds et qui sont utiliss
par lauditeur au cours du travail sur le terrain.
Ces procds sont galement largement utiliss par :
tous les responsables chargs de la vrification au premier degr ;
les auditeurs externes.
1
Khelassi Reda ,op-cit, p343.
2
Ibid; pp36-38 .
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 53
Les auditeurs internes ny ont recours que pour sassurer de la validit des oprations
effectues : toute erreur donne lieu une recherche causale.
1)-Les vrifications
Elles sont extrmement diverses : les plus nombreuses sont les vrifications arithmtiques.
On peut assimiler aux vrifications arithmtiques lutilisation des ratios, largement utiliss en
audit comptable. Lauditeur externe qui a sa disposition des points de comparaison, est
mieux arm dans ce domaine que lauditeur interne.
Ajoutons cette rubrique, la vrification de lexistence de documents et la recherche
dindices, tous lments que nous retrouverons en parlant de lobservation.
2)-Les analyses
Les analyses de donnes permettent dutiliser les potentialits du Systme dInformation
pour aider les auditeurs dans la conduite de leurs travaux. Ces analyses permettent de rvler
des dysfonctionnements mais ne permettent pas den connatre les causes. Il faut, pour ce
faire, aller au-del : entretiens, observations, vrifications, etc.
3)-Les rapprochements
Les rapprochements constituent pour lauditeur interne une technique de validation : on
confirme lidentit dune information ds linstant quelle provient de deux sources.
4)-La confirmation par des tiers
Les auditeurs externes utilisent largement la confirmation par des tiers dans la mesure o
elle constitue une preuve de la certification quils fournissent. Les auditeurs internes
lutilisent, moins largement et moins systmatiquement, comme moyen de validation des
constats et observations. Cette confirmation peut tre sollicite auprs de tous les tiers avec
lesquels lorganisation est en relation.
(
1
)
II-Conduite dune mission daudit interne
II-1-Ordre de mission
1) Dfinition
Une mission daudit se prpare. Mais auparavant, lauditeur doit avoir reu lordre ou le
mandat deffectuer la mission. Le document qui fait dclencher la mission daudit sintitule
un ordre de mission pour lauditeur interne ou une lettre de mission pour lauditeur externe. Il
sagit gnralement dun document dinformation court (une page) qui indique le prescripteur,
le destinataire et lobjet de la mission, les objectifs gnraux, le lieu et primtre de la
mission, la date du dbut et de la fin de la mission.
(2)
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit, p348.
2
Prface de Louis Vaurs, op-cit,p 39 .
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 54
Lordre de mission formalise le mandat donn par la direction gnrale laudit interne. Il
a deux fonctions essentielles :
o une fonction de mandat ;
o une fonction dinformation.
Pour que ces fonctions soient remplies, lordre de mission doit comporter un certain
nombre de mentions essentielles.
2) Contenu
On peut distinguer les mentions obligatoires et les mentions facultatives.
Les mentions obligatoires incluent au premier chef la dsignation prcise du mandant et
sa signature. De mme, on indique trs prcisment les noms des destinataires et en
premier lieu celui du mandataire, cest--dire le responsable de laudit interne. Mais
lessentiel du document est constitu par lobjet de la mission clairement dfini, ce texte
pouvant tre rdig suivant certaines latitudes.
Les mentions facultatives ainsi nommes parce que sil est indispensable de prsenter au
minimum un texte court, le texte long, par contre, nest pas obligatoire.
(1)
L'ordre de mission rpond trois principes essentiels :
- le service d'audit ne peut pas se saisir lui-mme de ses missions. La dcision de raliser
une mission d'audit dans telle ou telle entit ne lui appartient pas. Toutefois, le service d'audit
peut, si ncessaire, proposer de raliser une mission au Comit d'audit ou au Secrtaire
gnral qui prendra la dcision.
- l'ordre de mission doit maner d'une autorit comptente : Secrtaire gnral, Comit
d'audit, cabinet ministriel.
- l'ordre de mission permet de diffuser l'information tous les responsables concerns. Il
est adress non seulement au service d'audit mais aussi tous ceux qui vont tre concerns par
la mission d'audit (Direction de l'entit audite,).
(2)
3) Missions prvues dans le programme d'audit
Le programme d'audit constitue par lui-mme un ordre de mission collectif.
Le service d'audit ne doit donc pas attendre recevoir d'ordre de mission spcifique pour
dbuter une mission qui est prvue dans le programme d'audit. Dans ce cas, le SGABF
(Service gnral d'audit budgtaire et financier) rdige de sa propre initiative un ordre de
mission selon un modle prtabli et le soumet la signature du Secrtaire gnral (en tant
que Prsident du Comit d'audit).
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-citpp 218-219.
2
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB) et financier du Ministre de la Communaut franaise certifi
ISO 9001:2000 (ISO 9001 Pro Cert), www.audit.cfwb.be, 18-04-08, modification le 15-09-10.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 55
5) Missions spcifiques
Les missions d'audit spcifiques sont des missions non prvues dans le programme d'audit
et qui manent d'un cabinet ministriel, du Secrtaire gnral ou de la Direction d'une entit
ou du ministre.
Lorsque la demande mane d'un cabinet ministriel ou de la Direction d'une entit, les
auditeurs la formalisent sous forme d'ordre de mission dans un document crit (modle
prtabli) et le soumettent la signature du Secrtaire gnral (en tant que Prsident du
Comit d'audit).
(1)
II-2-Les trois phases fondamentales de la mission daudit interne
Le chiffre trois nest pas le nombre dor de laudit interne, il correspond trs exactement
la situation gographique de lauditeur au cours de son intervention :
dans la premire partie de sa mission, lauditeur est essentiellement dans son bureau et
dans son service. Ses dplacements sont courts et brefs ; la limite ils peuvent ne pas exister ;
dans la deuxime partie, au contraire, lauditeur est la plupart du temps sur le terrain,
donc absent du service ; les retours au bureau sont rares, parfois inexistants ;
dans la troisime partie, retour la sdentarit galement ponctue comme dans la
premire phase de quelques dplacements possibles, brefs et rapides. Et cette sdentarit
peut galement signifier travail domicile.
On dispose donc dun critre gographique prcis qui, lui seul, permet didentifier les
trois moments singuliers dune mission daudit interne. Ces trois moments sont
traditionnellement dsigns :
phase de prparation : dtude, de planification;
phase de ralisation : vrification;
phase de conclusion : de restitution des rsultats.
Examinons plus en dtail ces trois moments mthodologiques de la mission daudit interne.
(2)
Trois acteurs interviennent dans la mission :
lauditeur : celui qui conduit la mission daudit ;
laudit : celui qui fait lobjet de laudit ;
le prescripteur daudit : celui qui donne lordre lauditeur de raliser la mission
daudit.
(3)
1) La phase de prparation : Ltape de familiarisation
La phase de prparation ouvre la mission daudit, exige des auditeurs dune capacit
importante de lecture, dattention et dapprentissage. Elle sollicite laptitude apprendre et
1
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB), op-cit.
2
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit, pp 214-215.
3
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p38.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 56
comprendre, elle exige galement une bonne connaissance de lentreprise car il faut savoir o
trouver la bonne information et qui la demander. Cest au cours de cette phase que lauditeur
doit faire preuve de qualits de synthse et dimagination. Elle peut se dfinir comme la
priode au cours de laquelle vont tre raliss tous les travaux prparatoires avant de passer
laction.
(1)
Cette tape dite de familiarisation ne saurait tre omise ; elle constitue le plus souvent,
en termes de dure, la partie la plus importante de la mission.
a) Rencontre avec la direction de lentit audite
Aprs rception de l'ordre de mission et avant de commencer tout travail dans l'entit
auditer, le Service d'audit organise une rencontre avec la Direction de l'entit audite afin de
dterminer diffrents points :
objectifs de la mission
faisabilit de la mission d'audit (ressources suffisantes, dlais,...)
tendue de la mission : l'(es) entit(s) concerne(s) ou les processus concerns
nature de la mission d'audit (ressources humaines, ressources technologiques,
organisation, communication,...)
dlais de la mission
auditeurs responsables de la mission
description du droulement de la mission
organisation ou non d'une runion d'ouverture avec l'ensemble du personnel
rapport d'audit : destinataires du rapport, rapport intermdiaire,...
plan d'action
b) Compte rendu de la runion avec la direction de lentit audite
Suite la rencontre avec la Direction de l'entit audite, le Service d'audit rdige un
compte rendu de cette runion.
Le compte rendu de la runion est envoy aux personnes prsentes la runion ; lesquelles
disposent d'un dlai pour communiquer au service d'audit leurs ventuelles modifications
et/ou commentaires.
Le service d'audit introduit les modifications et transmet le compte rendu final par note
interne aux mmes personnes.
c) Runion douverture
La runion d'ouverture a pour but d'tablir les premiers contacts avec l'ensemble des
personnes impliques par l'audit avant de dbuter les travaux.
La runion d'ouverture est facultative : les auditeurs et la Direction de l'entit audite
dcident de l'organisation d'une runion d'ouverture. Pour les missions qui exigeraient la
prsence de beaucoup de personnes, il peut tre plus ais de transmettre une note explicative.
Toutefois, quand c'est possible, l'organisation d'une runion d'ouverture est toujours
prfrable.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; pp 213-214.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 57
Personnes prsentes cette prsentation :
le responsable du service d'audit ou son dlgu
les auditeurs chargs de la mission
la Direction de ou des entit(s) audite(s)
l'ensemble du personnel de ou des entit(s) audite(s) ou les responsables des
processus audits
Support de la prsentation :
Il s'agit d'une prsentation orale faite par les auditeurs, avec support Power Point.
Contenu de la prsentation :
Prsentation succincte du Service d'audit : place au sein du MCF, missions, normes
respectes,...)
Contexte et objectifs de la mission :
Contexte = le pourquoi de la mission (excution du programme d'audit,
demande spcifique en raisons de problmes aigus,...)
Objectifs = le but de la mission
Etendue de la mission : entit(s) concerne(s) ou processus concern(s)
Droulement de la mission
Prsentation de la mthodologie
Rapport
Evaluation
Plan d'action et suivi de la mission
Planning
Contacts
Aprs la prsentation, les auditeurs rpondent aux questions des audits.
(1)
Lauditeur interne va procder exactement selon la dmarche :
prise de connaissance du domaine auditer dite familiarisation ;
identification des risques ;
dfinition des objectifs.
d) La prise de connaissance : rcolte dinformations
Cette tape est une des plus importantes d'une mission d'audit. Il ny a pas de mthode
daudit qui ne commence par la connaissance des processus ou des activits que lon doit
auditer.
Cette prise de connaissance ne doit pas se faire au hasard, en glanant dans le dsordre les
informations ncessaires. Elle doit tre avant tout organise.
Lauditeur va donc planifier sa prise de connaissance en ayant soin de prvoir le ou les
moyens les plus appropris pour acqurir le savoir ncessaire la ralisation de sa mission
(interviews, documents, sminaires)
1
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB), op-cit.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 58
Ds que cette prise de connaissance a t mene bien, lauditeur dispose dj
dinformations srieuses sur les risques majeurs, le fonctionnement des interfaces et les
priorits du management.
(1)
La dure de la prise de connaissance varie en fonction de diffrents lments : complexit
du sujet, profil de l'auditeur, existence d'audits antrieurs,...
Les auditeurs utilisent diffrents outils (moyens) pour acqurir des connaissances :
(2)
Examen des rsultats de l'analyse de risques ;
Les entretiens avec les responsables de plus haut niveau dans l'activit audite ;
L'analyse de documents de base.
Les flow-charts (diagramme de circulation)
Les grilles d'analyse de tches
L'examen des rapports d'ventuels audits antrieurs, des rapports de la Cour
des Comptes et de l'Inspection des Finances permet d'identifier les risques
prsents
L'auditeur peut galement faire des rapprochements sur diverses
statistiques.
En dfinitive, lauditeur doit disposer des documents, dinformations et dlments
suffisants et pertinents pour acqurir une meilleure connaissance de lenvironnement, du
domaine et des risques susceptibles de menacer latteinte des objectifs de la socit.
La prise de connaissance ne se rsume pas la collecte des donnes et leur tude.
Lauditeur rencontre aussi les personnes concernes par la mission daudit et leur pose les
bonnes questions. Il procde par interview selon lordre hirarchique de la socit.
(3)
e) Lidentification et lvaluation des risques
Cette tape nest que la mise en uvre de la norme 2210.A1 : En planifiant la mission,
lauditeur interne doit relever et valuer les risques lis lactivit soumise laudit .
On dit aussi identification des zones risques , soulignant par l quil sagit beaucoup
plus didentifier les endroits o les risques les plus dommageables sont susceptibles de se
produire, que danalyser les risques eux-mmes.
Cette phase didentification va conditionner la suite de la mission : elle va permettre
lauditeur de construire son rfrentiel et, dans le mme temps, de concevoir son programme
et de llaborer de faon module , en fonction non seulement des menaces mais galement
de ce qui a pu tre mis en place pour y faire face. Cest compter de cet instant que lauditeur
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; p226.
2
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB), op-cit.
3
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p41.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 59
interne en charge dune mission va croiser la notion de risque qui ne cessera de
laccompagner tout au long de sa dmarche.
(1)
Toutes les informations ainsi recueillies, exploites ou analyses sont classes dans un
dossier permanent. Elles permettent lauditeur de raliser une valuation prliminaire des
forces et faiblesses apparentes. Do llaboration par lauditeur dun tableau des risques.
(2)
Le tableau des risques permet de cerner les objectifs daudit retenus, quil conviendra de
vrifier ultrieurement sur le terrain.
Les auditeurs privilgient une cotation selon une chelle de type : risque
faible/moyen/lev. On comprend que la dmarche de lauditeur interne soit fonde sur
lapproche par les risques.
f) La dfinition des objectifs ou llaboration du rfrentiel : rapport dorientation
Du tableau des risques dcoule le rapport dorientation. Il sagit dun document
destination des audits dans lequel lauditeur synthtise les conclusions quil a pu faire sur les
zones de risques, les difficults envisages, rappelle les objectifs gnraux et spcifiques,
propose les services et les divisions qui seront audits, dfinit la nature et ltendue des
travaux raliser.
(3)
On lappelle aussi, avec des variantes dans la forme, le plan de mission ou encore
Termes de rfrence ; Mais quelles que soient la forme et son appellation, ( ce
programme de travail doit tre formalis ), il sagit toujours dun document dont les
caractristiques et le contenu se retrouvent dans tous les cas de figure.
(4)
Le rapport d'orientation est une sorte de contrat de prestations de service entre les audits
et le service d'audit ; un compromis entre les attentes (de la Direction, du demandeur et des
audits) et les capacits en temps et comptences des auditeurs.
Le rapport d'orientation fera l'objet d'une validation par l'entit audite, et ce, afin de
canaliser leur adhsion positive et active au travail du service d'audit.
(5)
Ce document va devenir le rfrentiel de lauditeur, le document auquel il doit se rfrer.
Le rfrentiel de contrle interne permet l'auditeur de dterminer les objectifs d'audit,
lesquels se retrouveront dans le programme de travail.
La dmarche doit permettre l'auditeur d'organiser sa mission en identifiant les points qu'il
devra approfondir et a contrario ceux sur lesquels il pourra passer rapidement voire mme
faire l'impasse.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; p240.
2
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p41.
3
Ibid, pp40-41.
4
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; p240.
5
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB), op-cit.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 60
Cette tape n'est pas ncessaire si le sujet de la mission est simple ou si les risques sont
dj identifis dans l'ordre de mission.
Contenu :
Le rfrentiel de contrle interne devra tre un inventaire le plus complet possible et tendre
l'exhaustivit :
des objectifs d'un processus audit
des risques associs ces objectifs
des consquences associes ces risques
des dispositifs de contrle interne
On utilise un rfrentiel diffrent par processus.
(1)
2) La phase de ralisation
La phase de ralisation fait beaucoup plus appel aux capacits dobservation, de dialogue
et de communication. Se faire accepter est le premier impratif de lauditeur, se faire dsirer
est le critre dune intgration russie. Cest ce stade que lon fait le plus appel aux
capacits danalyse et au sens de la dduction.
a) Le programme de travail
Le programme de travail constitue la base de la phase de ralisation. Il s'agit d'un
document interne au service dans lequel on procde la dtermination, la rpartition et la
planification des tches qui permettront aux auditeurs d'atteindre les objectifs du rapport
d'orientation.
Le programme de travail reprend 2 points essentiels :
- les travaux d'audit accomplir pour atteindre les objectifs d'audit ;
- les techniques, outils dont il faut envisager l'utilisation : diagramme de circulation,
sondage statistique, entretien,...
b) Le questionnaire de contrle interne (Q.C.I)
Le QCI est le guide de l'auditeur pour raliser son programme de travail et il doit donc
permettre de raliser l'observation la plus complte possible. L'objectif est d'valuer le
dispositif de contrle interne pour chaque opration " risques ".
(2)
c)Le travail sur terrain
Durant cette phase il s'agit pour l'auditeur de rpondre aux questions du QCI. Les outils
mettre en uvre sont dtermins dans le QCI mais il se peut que lors de la phase de terrain un
outil s'avre inappropri et qu'il faille en choisir un autre.
Les outils vont des observations aux diffrentes sortes de tests : analyse de documents,
rconciliation des donnes, entretiens,...
1
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB), op-cit.
2
Ibid.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 61
L'auditeur ne peut jamais baser ses constats sur des hypothses ou intuitions, il doit avoir
des preuves de ce qu'il avance.
Il existe 4 critres de qualit de la preuve : pour qu'un constat soit considr comme prouv
et valable, la preuve doit tre :
PERTINENTE = en relation avec les objectifs d'audit
SUFFISANTE = fonctionnelle, approprie et probante, prsentant assez d'information
CONCLUANTE = fiable, elle doit permettre d'aboutir une conclusion aussi prcise que
possible et certitude de la qualit de la source
UTILE = rpondant aux objectifs de l'organisation
Les preuves peuvent tre classes en 4 catgories :
La preuve physique : c'est ce que l'on voit, constate = observation.
La preuve testimoniale : tmoignages. C'est une preuve trs fragile qui doit toujours
tre recoupe et valide par d'autres preuves.
La preuve documentaire : pices comptables, procdures crites, comptes-rendus,
notes,faire attention la qualit du document et l'analyse qu'on en fait.
La preuve analytique : rsulte de calculs, rapprochements, dductions et
comparaisons diverses. Les alas ici se cumulent : ceux lis aux documents,
tmoignages partir desquels on va raliser l'analyse ainsi que les erreurs de calculs et
de dductions de l'auditeur lui-mme.
d) La FRAP= Feuille de Rvlation et d'Analyse de Problme
Durant la phase de terrain, pour chaque dysfonctionnement constat, l'auditeur rdige une
FRAP.
L'auditeur rempli une FRAP chaque fois qu'une observation rvle un problme. En fait,
l'auditeur se sert de la FRAP pour mener bien son raisonnement.
Les FRAP serviront de base pour la rdaction du rapport.
(1)
e) La validation des constats et des conclusions
Lauditeur doit systmatiquement valider ses constats ou ses conclusions en les prsentant
la connaissance du responsable afin de recueillir sa raction sur les lments de preuve
recueillis. Chaque FRAP est supervise par le chef de mission qui lapprcie, situe sa place et
son degr dimportance par rapport la mission. Les validations individuelles et successives
sont suivies de validations gnrales en fin de mission (la runion de clture). Tous les
documents utiliss par lauditeur interne durant la phase de ralisation, appels papiers de
travail, sont rfrencs. Lensemble des FRAP aprs reclassement constitue l ossature du
rapport daudit.
(2)
f) Le compte rendu final :
Le compte rendu final est la prsentation orale, par le(s) responsable(s) de la mission au
principal responsable de l'entit audite, des observations les plus importantes. Le but est
1
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB), op-cit.
2
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p43.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 62
d'informer rapidement et en premier le responsable de l'entit audite du rsultat des travaux
d'audit et des conclusions dgages.
Cette prsentation est effectue la fin du travail de terrain et avant la rdaction du projet
de rapport. Il s'agit d'une sorte de " pr-validation " gnrale.
g) Lapprciation du contrle interne
Trois lments cls sont prendre en compte pour l'valuation du CI :
les travaux d'audit ont-ils mis en vidence des anomalies ou des faiblesses significatives ?
en cas de rponse positive, des corrections ou amliorations ont-elles t apportes aprs
constatation des anomalies ou faiblesses ?
ces anomalies ou faiblesses et leurs consquences sont-elles vraisemblablement gnralises
et entranent-elles de ce fait un degr inacceptable de risque ?
(1)
3) La phase de conclusion
La phase de conclusion exige galement et avant tout une grande facult de synthse et
une aptitude certaine la rdaction, encore que le dialogue ne soit pas absent de cette dernire
priode. Lauditeur va cette fois laborer et prsenter son produit aprs avoir rassembl les
lments de sa rcolte.
a) La runion de validation et de clture
Cette runion prsente plusieurs objectifs :
prsenter et valider les constats ;
expliquer les recommandations ;
fixer les modalits pratiques relatives au plan d'action et au suivi de la mission.
Tous les lments dcouverts lors de l'audit doivent tre prsents et valids par l'audit.
Le rapport final ne doit pas contenir d'lments qui n'auraient pas t prsents l'audit. Tout
doit tre compris et les audits doivent reconnatre les constats comme exacts.
Personnes prsentes
le choix des participants de l'entit audite : logiquement, on retrouvera lors de la runion de
clture les personnes ayant particip la runion de dbut de mission.
la reprsentation du Service d'audit : la prsence ou non du responsable de l'Audit, son rle
dans la runion peuvent jouer lors de la prsentation afin de marquer l'entit audite sur
l'importance de l'Audit.
Droulement de la runion de clture et de validation :
L'ordre du jour de cette runion est l'examen du projet de rapport qui a t remis chaque
participant, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la runion.
1
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB), op-cit.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 63
Prsentation du projet par les auditeurs
L'auditeur prsente les points essentiels qui seront voqus et illustrera ceux-ci par des
constats prcis.
L'auditeur commencera si ncessaire par une brve explication des processus en place.
Ensuite, il abordera les points forts ou satisfaisants qui n'ont pas fait l'objet de FRAP et
finira par les dysfonctionnements en fonction de leur importance.
Observations des audits
Dans le souci d'une participation des audits au processus d'audit, un droit de rponse
de ceux-ci sur le projet de rapport est rendu possible. Celui-ci peut tre informel et
oral lors de la runion de clture. Il peut galement tre crit et formel.
Lors de la runion, deux types de contestations peuvent se prsenter l'auditeur :
contestations relatives aux constats : deux situations possibles: soit l'auditeur fournit un
lment de preuve et la contestation s'teint, soit il n'est pas en mesure de fournir cet lment
et il est prfrable d'abandonner le point litigieux.
contestations relatives aux recommandations : comme il s'agit d'un Projet, l'audit peut
ventuellement suggrer autre chose. L'audit reste le spcialiste du sujet audit. Sa
proposition peut englober des aspects oublis ou non vus par l'auditeur. Dans ce cas,
l'auditeur peut modifier voire annuler le contenu de son texte sur un point si l'audit le
convainc. Cela ne doit pas l'empcher de maintenir son texte s'il n'est pas convaincu.
N'oublions pas que l'audit a toujours le droit de refuser une recommandation lors de sa
rponse crite. En effet, l'audit pourra encore ragir aux recommandations lors de ses
commentaires crits et/ou lors de l'laboration de son plan d'action.
Modalits relatives au plan d'action et au suivi
Les auditeurs prciseront, lors de cette runion, la date de remise des commentaires crits
(si ncessaire) sur les constats et les recommandations et les modalits relatives au plan
d'action (date de remise, insertion ou non dans le rapport, nom du responsable).
La runion de validation doit faire l'objet d'un compte rendu intgrant toutes les remarques
sur les constats et les recommandations. Ce compte rendu est envoy pour approbation
l'audit.
b) Le rapport daudit final
Le rapport d'audit final ne peut tre rdig que lorsque les audits ont remis leurs
commentaires crits, si prvus lors de la runion de validation.
Toute mission daudit sachve par la rdaction dun rapport. Cest pourquoi au cours de
cette phase, il convient dobtenir ladhsion des membres de lquipe dauditeurs et des
audits impliqus dans la mission lors de la runion de clture.
Cest au responsable quincombe la charge de communiquer les rsultats de laudit.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 64
Ce rapport fait apparatre les mentions suivantes :
une page de garde comprenant le titre complet de la mission, la date, les auditeurs
ayant particip la mission ;
lordre de mission, qui doit tre plac en tte du rapport ;
le sommaire ;
une note de synthse de deux trois pages permettant aux destinataires principaux du
rapport davoir lessentiel des conclusions du travail daudit, date et signe par le chef
de mission ;
le rapport proprement dit ;
les annexes.
Toutefois, il ny a pas dunanimit sur la forme du rapport daudit dans les entreprises.
Pour certains auditeurs internes, le rapport doit donc tre rdig, comme un rapport doit
ltre selon la tradition .
(1)
Principes gnraux du rapport d'audit
le rapport doit tre complet, constructif, objectif et clair. La signature du rapport par le
responsable donne l'exemple de responsabilit. Mme en cas de conclusions positives, un
rapport doit tre rdig.
le rapport ne doit contenir que des lments qui ont t prsents aux responsables audits.
C'est cette fin que la runion de validation et de clture est organise.
le rapport doit tre structur pour des lecteurs diffrents. C'est pourquoi, il comprend un
expos gnral et une synthse. L'expos gnral doit tre complet et technique et apporter
toutes les informations utiles aux responsables audits et aux responsables des actions
entreprendre. La synthse s'adresse des personnes qui doivent tre informes et
sensibilises mais qui n'ont pas rsoudre les dysfonctionnements relevs.
le rapport doit tre objectif, clair, concis, utile et le plus convaincant possible.
le rapport doit tre revu par au moins une personne du Service d'audit qui n'a pas particip
sa rdaction.
Le rapport d'audit a deux objectifs distincts :
il s'agit d'un document d'information pour la hirarchie ;
il s'agit d'un outil de travail pour les audits. C'est partir du Rapport que l'audit
prend les mesures correctrices.
c) Plan daction
Le service d'audit n'ayant ni l'autorit ni la responsabilit de mettre en place dans les entits
audites les recommandations qu'il a faites, il est demand la Direction de ces entits
d'laborer des plans d'action visant mettre en uvre les recommandations, c'est --dire de
prendre des mesures pour grer les risques.
1
Prface de Louis Vaurs, op-cit, p45.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 65
Le service d'audit transmet une note d'information sur la manire d'laborer les plans
d'action.
Le plan d'action doit tre valid par le service d'audit. Ce dernier doit mettre des
observations s'il estime le plan d'action partiellement ou totalement insuffisant. Le
responsable du service audit y apporte alors les modifications ncessaires.
(1)
Section III : La banque et les risques bancaires
I - La banque
I 1. Lvolution de la banque et dveloppement du rseau bancaire algrien
La notion de banque est trs ancienne. Elle date du quatrime sicle avant J-C. cest en
Grce que les premires oprations sapparentant celles des banques modernes, ont t
traites (change de monnaie, garde de dpts, octroi de prts).
Favorise par les changes commerciaux localiss essentiellement dans le bassin
mditerranen, lactivit bancaire se dveloppa un peu plus tard dans lempire ROMAN, et en
Egypte. La guerre des croisades donna une impulsion nouvelle, aux changes commerciaux
entre lorient et loccident, et la cration des premires banques europennes notamment
allemandes, hollandaises, italiennes et anglaises.
Les grandes dcouvertes maritimes des 15 sicles (routes des indes, et les Amriques)
dplacrent vers lAtlantique, le trafic international dont les banques anglaises et hollandaises
furent les grands bnficiaires. En France, les premires banques prives ont fait leur
apparition au 18
me
sicle mais avec beaucoup moins de succs. Plusieurs banques se sont
succdes et ont succomb sous la lourdeur des risques quelles ne parvenaient pas encore
maitriser.
Ce nest quau 19me sicle que le rseau bancaire franais se faonna avec la cration
des grandes banques et tablissement financiers actuels. La banque de France fut cre la
premire en date du 15 janvier 1800. Les autres banques et tablissements financiers
constiturent progressivement le rseau bancaire national franais et international.
En Algrie le rseau bancaire tait constitu la veille de lindpendance (juillet 1962)
par des succursales et agences de banques franaises principalement. Ne pouvant tre agres
par la Banque dAlgrie exercer leur activit bancaire en tant quagences et succursales de
banques trangres, elles ont accept de cder leur patrimoine immobilier aux banques
algriennes nouvellement cres en 1966. Ainsi compter du 1
er
janvier 1967, le rseau
bancaire en Algrie se trouva totalement constitu par les banques publiques suivantes :
La banque centrale dAlgrie : institut dmission et banque de rescompte ;
La banque algrienne de dveloppement BAD Banque dinvestissement qui sest
substitu la caisse algrienne de dveloppement CAD ;
1
Le service gnral d'audit budgtaire ( SGAB), op-cit.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 66
La caisse nationale dpargne et de prvoyance CNEP ;
Trois banques en loccurrence (BEA, BNA, CPA) qui ont hrit des infrastructures et
des fonds de commerces des banques trangres :
La BEA a hrit le rseau du crdit lyonnais, de la socit gnrale, de la
BFCE, de la Worms et Cie, de la banque des pays bas ;
La BNA a hrit le rseau de la banque nationale du commerce et de
lindustrie de France BNCI , du comptoir descompte de Paris, du
crdit industriel et commercial de France CIC , du crdit de France
CFF , du crdit agricole de France CA .
Sur la base des nouvelles rformes conomiques provoques par les vnements
historiques doctobre 1988, et visant linstauration dune conomie de march en Algrie, une
panoplie de textes a t labore et publie, notamment la loi sur la monnaie et le crdit et les
nouveaux codes : code de commerce et dinvestissement, favorisant la cration et
lexploitation de banques prives en Algrie capitaux algriens et/ou trangers.
Ainsi la premire banque daffaire sous la forme dtablissement financier, aux capitaux
privs algriens est ne en 1993 sous la dnomination d union banque dont le sige est
fix Alger. Elle a t suivi par la cration de Mouna Bank sigeant Oran et par Algerian
International Bank AIB sigeant Alger.
Paralllement dautres banques commerciales vocation universelle et capitaux
algriens, ont t cres et agres par la Banque dAlgrie BA . il sagit de la BCIA
Banque Algrienne pour le commerce et lindustrie sigeant Alger, la Banque Khalifa
sigeant Alger, la CAB sigeant Alger, ARCO Bank sigeant Alger.. Etc.
Les premires Banques trangres qui ont manifest leurs intrts pour le march
algrien et qui ont obtenu leur agrment auprs de la banque dAlgrie sont : la CITI Bank
Amricaine, la Socit Gnrale de France, et la banque nationale de Paris et le Crdit
Lyonnais de France suivies dautres banques capitaux privs arabes (Saoudiens, Qataris,
jordaniens notamment : Rayane Bank, Arabe Bank Corporation, housing Bank, Golf
Banketc).
Compte tenu de la diversit des structures des tablissements de crdit et de la multiplicit
de lactivit bancaire, il est assez difficile de proposer une dfinition la fois simple et
complte de la banque.
Selon lordonnance n 03-11 du 26 Aot 2003 relative la Monnaie et au Crdit : la
Banque est une socit par action qui est seule habilite effectuer titre de profession
habituelle toutes les oprations dcrites aux articles 66 68 de ladite ordonnance, notamment:
la rception de fonds du public, les oprations de crdit ainsi que la mise la disposition de la
clientle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci .
La mission dune banque ne se rsume pas uniquement remplir les missions
prcdemment cites, en effet et en ce qui concerne celle de loctroi de crdits, il faut se
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 67
rendre compte que cette tche nest pas aussi simple. Les dfinitions mmes du Crdit
dmontrent quel point il est ardu datteindre lobjectif de scurisation des banques.
I 2. Notion de banque
Sont considres comme Banques, les entreprises ou tablissements qui font profession
habituelle de recevoir du public, sous forme de dpts ou autrement, des fonds quils
emploient pour leur propre compte, en oprations descompte, en oprations de crdit ou en
oprations financires.
Une autre dfinition plus pragmatique considre que :
La banque est un intermdiaire financier qui redistribue sous forme de crdits les fonds
quil collecte auprs des agents conomiques en vue de raliser un profit . Donc lactivit
principale dune banque est base principalement sur la collecte de ressources et la
distribution de crdits.
I 3. Lactivit bancaire
De manire gnrale, lactivit des banques consiste sendetter pour prter. Ils
transforment les caractristiques intrinsques des actifs quils acquirent tant au niveau des
chances quau niveau des risques.
Lorsque lintermdiation bancaire est privilgie et que les agents ont recours au crdit
pour se financer, on parle dconomie dendettement . Lorsque la finance directe est
privilgie et que les agents ont davantage recours au march financier, il y a
dsintermdiation financire et on parle dconomie de march financier .
1) Lintermdiation bancaire
Le principe de lintermdiation bancaire sexerce la fois dans le temps et dans lespace de
faon habituelle :
dans le temps : cest la fourniture de moyens de financement (crdits) leurs clients,
un moment o ceux-ci en sont dpourvus. Il y a alors cration montaire soit
totalement soit partiellement ;
dans lespace : cest le transfert de moyens de paiement (chques, virements, cartes de
crdit) dune place commerciale une autre.
Pour les changes qui mettent en relation des agents non financiers de taille modeste, les
cots de recherche dun prteur potentiel par un emprunteur potentiel aux meilleures
conditions possibles seront invitablement prohibitifs. La banque se trouve au centre de
lactivit financire et dtient une relle comptence dans le traitement de linformation sur la
solvabilit des emprunteurs. Elle assume de plus le risque de dfaut et le gre en dveloppant
la mthode de division des risques.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 68
Par ailleurs, les dures des besoins de financement ne concident pas ncessaires avec la
dure de placement des agents excdentaires. La banque assumera donc le risque de liquidit,
par exemple en empruntant court terme et en prtant long terme.
(1)
Lactivit traditionnelle des banques consiste :
collecter lpargne des dtenteurs de capitaux ;
accorder des crdits aux agents conomiques dficitaires ;
grer les dpts et offrir des services financiers.
Les revenus de la banque sont constitus par les carts de taux (spreads) entre dpts
collects et prts accords et par la rmunration des services quelles accordent.
Ces revenus doivent lui permettre de couvrir :
ses frais de fonctionnement ;
les risques (dfaut, liquidit) ;
et un rsultat positif en tant quentreprise commerciale.
On distingue quatre (4) grandes activits dintermdiation :
la distribution de crdits : crdits aux entreprises (quipement, trsorerie) ; crdits aux
particuliers (habitat, trsorerie) ;
la collecte des dpts : les dpts vue, les comptes terme ; les dpts rgime
spcial;
les prts et emprunts de liquidits sur le march interbancaire ;
les services spcialiss associs lintermdiation bancaire :
les engagements de financement (crdit bail) et de garanties (caution),
les oprations daffacturage,
les engagements sur instruments financiers termes, destins couvrir les
risques de prix lis aux activits dintermdiation.
2) Lintermdiation de march
Elle consiste raliser des oprations spculatives ou darbitrage sur les marchs financiers
ou de raliser des montages financiers avec pour objectif de raliser des plus-values.
On distingue 3 grands types dintermdiation de march :
a) Le trading
Oprations spculatives sur les titres, les changes ou les taux ainsi que les instruments
qui leur sont drivs.
Oprations darbitrage sur les mmes supports.
1
Dov Ogien ,op-cit, p10.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 69
b) Le market-making
La banque intervient sur les marchs en tant quanimateur de march. Elle affiche des
cours lachat et la vente dinstruments financiers. Elle exerce une activit de march en
assumant les risques.
(1)
c) Le portage
La procdure de prise ferme lors dune introduction dactions en Bourse ou lors dune
mission demprunt obligataire par un syndicat bancaire peut conduire la banque conserver
les titres si elle narrive pas les placer dans le public. Dans ces cas de figure, la banque
assume le portage de ces titres.
(2)
I 4 Quelques concepts bancaires
1) Le chque
Le chque est un crit par lequel une personne dnomme le tireur donne lordre une
personne dnomme le tir de payer une certaine somme au titulaire ou un tiers, appel le
bnficiaire concurrence des fonds dposs chez le tir.Cest un instrument de paiement
vue, et non pas un instrument de crdit.
Le chque donc fait intervenir 3 personnes :
Le tireur : cest lui qui tablit et signe le chque ; il doit tre capable ;
Le tir : cest lui qui dtient les fonds et paye ; la banque .
Le bnficiaire : cest lui reoit le paiement. Le chque peut tre stipul payable une
personne dnomme, ou au porteur.
2) Les effets de commerce
a)La lettre de change
La lettre de change ou traite est un crit par lequel une personne appel tireur (fournisseur),
invite une autre personne appele tir (client) payer une certaine somme, une date
dtermine (date dchance), une troisime personne appele bnficiaire(le tireur ou son
banquier).
Donc la lettre de change met en prsence trois personnes : le tir ; le tireur ; et le
bnficiaire. Elle est toujours un acte de commerce, quelle que soit la qualit de ses
signataires ou quel que soit le motif de sa cration.
b) Le billet ordre : BAO
Le billet ordre est un crit par lequel une personne appele souscripteur(le dbiteur :
client) reconnait sa dette et sengage payer une tierce personne appele bnficiaire(le
crancier : fournisseur) une certaine somme une priode dtermine.
1
Dov Ogien ,op-cit, p11.
2
Ibid, p11.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 70
3) Le compte
On peut dfinir le compte comme un tat comptable sur lequel est inscrit lensemble des
oprations effectues entre la banque et son client. Dont, les remises, versements, virement
reus.., sont inscrits au crdit ; et les retraits, par diffrents moyens, sont inscrits au dbit
(chques mis, prlvement espces, virements,..).
La diffrence entre le total des sommes portes au crdit et le total des sommes portes au
dbit est appele : le solde du compte.
Les oprations sont enregistres au moyen de pices comptables et le client est inform de
certaines oprations par des avis de dbit ou de crdit.
Lensemble des oprations est repris sur un relev ou extrait de compte.
Il existe deux types de comptes :
Les comptes vue ;
Les comptes terme.
4) La notion de crdit
Le crdit est une expression de confiance , dorigine Grecque. Le mot crdit dcoule du
mot grec Crdr cest--dire Croire autrement dit faire confiance .
Le crdit cest du temps et/ou de largent que la banque prte. Cest une confiance qui
sacquiert par une promesse
La banque :
prte le temps en attendant largent, (crdit par signature) ;
Elle prte largent en attendant un temps (crdit par caisse).
Il ne peut y avoir de crdit en labsence de ces trois facteurs.
En effet, faire crdit quelquun : cest lui faire confiance. Faire crdit de quelque chose,
cest prter la chose contre promesse dtre rendue au terme convenu. Le degr de probabilit
de la promesse constitue le risque quil faudra tudier pralablement lemprunt de la chose.
La confiance est en effet llment dterminant de toutes les manifestations de crdit qui
naissent loccasion des nombreux actes de la vie courante. Partant de ce postulat, qui est la
base de la cration des banques et de leur dveloppement, on peut donc affirmer que : lart du
banquier consiste acheter et vendre la confiance sa clientle, donc faire confiance et
inspirer la confiance de ses dposants.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 71
La notion de confiance est lie troitement la notion de risque.
II-Les risques bancaires
1) Dfinition
Le risque fait partie intgrante du mtier de banquier. En acceptant les dpts des clients,
sans les conserver dans son coffre pour lui rendre sa demande ou une date dtermine, le
banquier prend un risque. Et mme dans ce cas dcole, son coffre peut tre factur et il peut
tre mis dans lincapacit de remplir ses obligations. Le risque est donc li une pratique de
lactivit dans un monde incertain.
A partir de ce constat, et puisquil nest pas envisageable de laisser ces dpts dans un
coffre, toute lactivit de la banque va comporter un risque. Il ne sagit pas de lviter mais de
lassumer et den tirer un bnfice.
La prise de risque peut sanalyser comme un service offert par la banque ses clients et qui
doit tre factur sa juste valeur.
Pendant longtemps, cette prise de risque, fondement du mtier na pas t formalise. Elle
relevait dune valuation personnelle tire de lexprience acquise au fur et mesure de la
pratique de lactivit. La prise de risque donnait lieu au prlvement dune marge sur les
clients et les oprations concernes. Tant que le risque ne se concrtisait pas, la marge tait
gangue.
(1)
2) La prise de risque
La prise de risque est une dcision deffectuer une opration avec un client ou sur un
march financier. Elle stablit sur une assiette et dans un environnement conomique et
financier incertain.
(2)
3) Les types de risques
Risque de liquidit
Risque de transformation
Risque de taux
a) Le risque de liquidit
Selon le rglement 97-02, le risque de liquidit est le risque pour ltablissement de ne pas
pouvoir faire face ses engagements ou de ne pas pouvoir dnouer ou compenser une position
en raison de la situation du march.
La concrtisation du risque de liquidit peut entrainer la concrtisation dautres risques
(Le risque de march, Le risque de taux)
(1)
1
Franois Desmitch, Pratique de lactivit bancaire, Dunod, paris, 2007, pp250-251,
2
Ibid, p258.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 72
b) Le risque de transformation
Ce risque nest actuellement plus identifi comme tel : il nest pas retenu dans le rglement
97-02, ni dans la nouvelle rglementation Bale II. Il perdure cependant dans le coefficient de
ressources longues sur les emplois longs.
Ce coefficient oblige la banque financer ses emplois long terme par des ressources
court terme. Il est en effet risqu de couvrir des emplois 20 ans par des ressources courtes,
dont il faudra assurer la rotation plusieurs fois pendant la dure de vie du prt.
c) Le risque de taux
Le risque de taux est identifi dans le rglement 97-02 sous le nom de risque de taux
dintrt global : cest le risque encouru en cas de variation des taux dintrt du fait de
lensemble des oprations de bilan et de hors bilan, lexception, le cas chant, des
oprations soumises aux risques de march.
(2)
4) Les risques majeurs
Les autres risques sont considrs comme majeurs : sils se concrtisent, ils engendrent des
pertes de fonds propres et mettent en cause la solvabilit de la banque.
Il sagit :
(3)
du risque de march ;
du risque de change ;
du risque de crdit ;
du risque oprationnel.
a)Le risque de march
Le risque de march est identifi dans le CAD (Capital Adequacy Directive), et repris dans
le rglement 95-02 modifi par le rglement 99-02 concernant la surveillance des risques de
march. Le rglement 97-02 retient la dfinition du rglement 95-02.
Globalement, il sagit du risque de raliser des moins-values ou des pertes la revente des
titres dtenus. Plusieurs raisons peuvent tre lorigine de cet effet :
-la baisse gnrale des cours des titres ;
-lilliquidit du march des titres vendre : il ny a pas suffisamment dacheteurs ;
-lobligation de vendre rapidement les titres mme un cours infrieur.
(4)
1
Franois Desmitch, op-cit p258.
2
Dov Ogien , op-cit ; p417
3
Ibid, p417.
4
Franois Desmitch, op-cit, p271
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 73
b) Le risque de change
Il sagit dun sous-ensemble du risque de march. Il se dfinit comme une perte possible de
la valeur des actifs, suite une variation dfavorable du cours des devises.
c)Le risque oprationnel
Le Comit de Ble dfinit le risque oprationnel comme le risque de pertes rsultant de
linadaptation ou de la dfaillance de procdures internes, de personnes et de systmes ou
rsultant dvnements extrieurs . La dfinition part des effets (les pertes) pour remonter
aux causes (inadaptation, dfaillance ou vnements extrieurs).
Donc, le risque oprationnel porte sur lensemble des processus de gestion de la banque. Il
implique les vnements suivants :
(1)
fraudes internes ;
fraudes externes ;
pratiques contraires aux lois ;
dommages aux biens ;
interruption dactivit;
dfaillances des processus ;
comptabilit dfectueuse ;
etc.
d) Le risque de crdit
Cest le risque de perte en cas de dfaillance de lemprunteur. Pour les crdits, il sagit du
risque dimpay ou risque de dfaut.
Le dfaut est constat selon lun des trois critres suivants :
-existence de doutes sur la capacit de lemprunteur rembourser ses engagements ;
-constitution de provisions spcifiques, abondons de crances, restructuration ;
-existence dimpays constats.
III- Les implications de Bale II sur le contrle et laudit internes bancaires
III- 1- Le risque daudit dans la banque
Les spcificits bancaires prendre en compte dans lapproche daudit dune banque sont :
la multiplicit des transactions et des contreparties ;
la complexit de certaines oprations ;
linformatisation ncessairement importante pour lexcution des tches ;
la multiplicit des implantations gographiques ;
lexistence de dispositions lgislatives rglementaires et professionnelles nombreuses
(Conditions daccs la profession, grant les habilitations, rgles relatives lorganisation
1
Franois Desmitch , op-cit, pp273-274
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 74
des tablissements et leur bon fonctionnement, rgles relatives la protection de la clientle,
normes comptables et la transparence des situations financires des tablissements de crdit,
normes prudentielles pour la stabilit du systme et la scurit de la clientle, normes
montaires).
La rglementation bancaire, plus que les normes industrielles et commerciales, privilgie
lapproche par le contrle interne compte tenu des spcificits du mtier et des erreurs du
pass, certaines banques nayant pas dtect temps les facteurs de vulnrabilit en raison des
dysfonctionnements de contrle interne.
Le contrle interne bancaire contribue la fois la solidit des systmes et donc la
prvention des difficults et garantit la fiabilit de la communication financire.
La mise en place de procdures, de contrle de conformit de lorganisation, des
oprations, de linformation financire produite et des systmes dinformation, adaptes et
correctement appliques permet de scuriser les oprations traites par la banque et les tiers
en relation.
Ces rgles minima de bonne gestion bancaire sont dictes par le rglement CRBF 97-02
sur le contrle interne des tablissements de crdit. Les tablissements de crdit prsentent
donc des particularits dont il rsulte une attnuation ou au contraire un renforcement du
risque daudit.
(1)
1) Diminution du risque daudit
Existence dune fonction de contrle interne rglemente sur laquelle les travaux
daudit pourront sappuyer ;
existence de contrles externes permanents et approfondis exercs par la Commission
bancaire.
Existence de procdures usuelles de confirmations systmatiques entre tablissements de
crdit et denvoi dextraits de compte aux tiers.
Existence de principes comptables particuliers dicts par des autorits bancaires
comptentes, en charge den vrifier par ailleurs la correcte application.
2) Augmentation du risque daudit
Dcentralisation de la fonction comptable, notamment dans les banques commerciales,
qui disposent en gnral de succursales et dagences disperses gographiquement.
Ce type de structure implique une grande dcentralisation des pouvoirs et des fonctions
comptables et de contrle.
Importance des engagements, souvent souscrits sans transfert de fonds, ce qui rend
problmatique la dtection dune absence ventuelle denregistrement.
Importance des actifs grs pour le compte de tiers, qui relvent de la responsabilit des
tablissements de crdit mais ne figurent ni au bilan, ni au hors-bilan publi.
Foisonnement des produits nouveaux, souvent complexes, proposs la clientle.
1
Dov Ogien , op-cit, pp443-444.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 75
Rptitivit des transactions et automatisation des traitements, qui confrent un rle
primordial la fiabilit des systmes dinformation.
(1)
III 2 -Bale II sur laudit et le contrle internes bancaires
Les dispositions de Ble II donnent la fonction daudit interne des banques la possibilit
de confirmer et de renforcer son rle et son autorit en dlivrant une assurance quant la
validit des systmes didentification, de mesure et de matrise des risques. Cette facult reste
toutefois subordonne sa capacit de se doter de comptences techniques dans des domaines
jusquici peu explors.
En juillet 1988, le Comit de Ble sur le contrle bancaire publiait le rapport intitul
Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres, communment
dnomm Accord de Ble. Ce texte tait destin raliser une convergence internationale des
rglementations de contrle bancaire rgissant le niveau des fonds propres des banques
vocation internationale. Ce document instituait le dispositif pour la mesure du niveau des
fonds propres et la norme minimale atteindre 8% ds la fin de lanne 1992 au regard du
risque de crdit, que les autorits de contrle nationales reprsentes au sein du Comit
entendaient faire appliquer dans leurs pays respectifs.
Aprs avoir amend le texte en 1996 pour prendre en compte le risque de march, cest
partir du mois de juin 1999 que le Comit a mis des propositions visant rviser lAccord de
1988 afin de renforcer la solidit et la stabilit du systme bancaire international, tout en
cherchant viter la cration de distorsions de concurrence entre banques activit
internationale. A lissue de plusieurs annes de travaux en son sein et de consultations avec la
profession bancaire, le Comit de Ble a publi, le 26 juin 2004, le dispositif rvis.
(2)
Ce nouveau dispositif appel Accord Ble II ou Ratio Mac Donough du nom du
prsident du Comit de 1998 2003, M. William J. Mac Donough, Prsident de la Federal
Reserve Bank of New York. La rforme vise uniformiser linformation financire pour
garantir la solidit du systme bancaire international.
(3)
La rforme vise non seulement lier plus troitement les normes de fonds propres au
risque effectif mais aussi renforcer le contrle et uniformiser linformation financire avec
pour objectif de fond la garantie de la solidit du systme bancaire international.
Les pondrations adoptes dorigine ne refltaient plus le niveau de risque rel : un crdit
une entreprise prsentant un risque de dfaut lev requiert la mme charge en capital quun
crdit une entreprise de qualit. La consquence est de favoriser loctroi de crdits aux
clients risqus dont la marge est plus forte afin daugmenter la rentabilit du capital.
1
Dov Ogien, op-cit, p445
2
Denis Lauretou, Xavier-Yves Zanota, Les implications de Ble II pour laudit interne, p 437.
3
Dov Ogien, op-cit, p391.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 76
Les objectifs de la refonte de laccord de Ble sont :
la prise en compte lensemble des risques auxquels les banques peuvent tre exposes
dont les techniques bancaires de rduction des risques, quil sagisse de la
collatralisation (garanties relles et personnelles), des drivs de crdit, ou de la
titrisation ;
le renforcement de la surveillance prudentielle et une plus grande transparence
financire ;
la convergence entre lexigence en fonds propres rglementaires et lexigence de capital
conomique propre chaque tablissement.
Le Comit de Ble2 a ainsi publi en septembre 1997, un document intitul Principes
fondamentaux pour un contrle interne efficace et en septembre 1998 un autre document
intitul Framework for Internal Control Systems in Organisations . Ces travaux rejoignent
les rflexions menes au niveau europen dans le cadre du Sous-Comit de Surveillance
Bancaire de lInstitut Montaire Europen, qui a publi en 1997 un rapport intitul Les
systmes de contrle interne des tablissements de crdit .
Lune des ides directrices des rflexions menes par le comit de Ble, le Sous Comit de
Surveillance Bancaire et la Commission Bancaire est que le contrle interne nest pas une
simple procdure ou une politique applique un certain moment, ni mme simplement une
fonction daudit, mais un systme qui fonctionne en continu tous les niveaux de
ltablissement.
(1)
Les auditeurs internes examinent et contribuent lefficacit continue du systme de
contrle interne via leurs valuations et recommandations et de ce fait jouent un rle
important dans lefficacit du contrle interne. Ils nassument toutefois pas la responsabilit
de base, qui revient la direction, de la conception, la mise en uvre, le maintien et la
documentation du contrle interne.
(2)
Le contrle interne (CI) concerne la banque dans toutes ses activits. Il sapplique aux
biens, aux individus et aux informations, quelles que soient les circonstances ou lpoque de
lanne. Toutefois, on ne peut contrler que ce qui est organis. Lensemble des activits de la
banque doit, au pralable, tre structur : dfinition des niveaux de contrle, organisation
rigoureuse de la fonction.
1
Grgory Heem , op-cit, p7.
2
Fr. VANSTAPEL, op-cit, p50.
CHAPITRE II : LAUDIT ET LE CONTROLE INTERNES BANCAIRES 77
Conclusion
Le Nouvel Accord de Ble constitue un dispositif prudentiel destin mieux apprhender
les risques bancaires et principalement le risque de crdit ou de contrepartie et les exigences.
La gestion des risques, ainsi que laudit et le contrle internes, doivent rellement tre
apprhends comme un processus continu dont lapplication doit tre garantie en permanence.
Ce processus doit assurer lidentification des dficiences et la prise de mesures de correction
adquates.
Il ne peut sagir dune apprciation fige des risques un instant donn. Ds lors,
lefficacit du dispositif devient une relle source davantage concurrentiel pour un
tablissement. En sus de la vision purement contrle , la combinaison de ces dispositifs
fournit un outil de pilotage ayant vocation amliorer les pratiques et pas seulement
sanctionner. Les tablissements ayant pris conscience de lopportunit qui leur est offerte
auront une longueur davance.
Partie II : Pratique
Chapitre III : Le Contrle
Interne au niveau de la BNA
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 80
Lvolution des tablissements de crdit au cours des dernires annes, lanalyse des
difficults, voire des dfaillances pour certains, souligne limportance du contrle interne
dans les banques. Ces volutions dmontrent que le contrle interne doit se concevoir dans
une dmarche prventive qui permette dassurer que les tablissements de crdits exercent
leur activit de manire saine et sre.
Le rglement 2002-03 de la banque dAlgrie fait obligation aux banques algriennes de se
doter dun systme de contrle interne.
Ce qui implique la mise en place dun systme de contrle interne efficace et efficient la
banque nationale dAlgrie (BNA), devant lui assurer la sauvegarde de son patrimoine, de sa
prennit et en mesure dapporter des solutions aux anomalies constats dans les agences et
dmettre galement les suggestions ncessaires de nature viter leurs renouvellement et
damliorer la gestion de lorganisme.
L'audit interne est un acteur majeur du dispositif de matrise des risques, et du contrle
interne. Il apporte sa contribution l'ensemble des activits, fonctions ou processus de la
banque.
Au cours de ce chapitre, intitul de : Contrle Interne bancaire au niveau de la BNA
nous allons aborder les points suivants :
Nous commencerons dans la premire section par lhistorique de la banque nationale
dAlgrie BNA. Ensuite, dans la deuxime section nous allons essayer de prsenter la
dmarche pratique pour louverture de domiciliation et du Credoc. Et enfin, nous passerons
la troisime section qui sera consacre pour les niveaux de contrle au sein de la BNA.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 81
Section I : Historique de la banque nationale dAlgrie
I-Prsentation de la Banque Nationale dAlgrie
1) Cration de la banque BNA
La Banque nationale d'Algrie(BNA), premire banque commerciale nationale cre le
13 juin 1966, suite la rorganisation du systme bancaire entame en 1966 avec la
nationalisation des banques trangres. Elle a t cre par lordonnance n 66-178 du 13 juin
1966.
Le secteur bancaire sest largi par la suite avec la cration dautres banques et de ce fait,
le financement de lagriculture et qui tait lune des activits exerces par la BNA, a t
confie en Mars 1982 une institution bancaire spcialise (BADR) et qui a pris le volet du
financement et de la promotion du monde rural.
Par la suite, et partir de 1988, deux textes majeurs affrents aux rformes conomiques et
prparant la transition vers lconomie de march ont eu les implications contestables sur
lorganisation et les missions de la BNA, en loccurrence :
-la loi n88.01 du 12 janvier 1988 portant orientation des entreprises publiques conomiques.
-la loi n90.10 du 14 avril 1990 relative la monnaie et le crdit dfinissant la banque comme
tant : une personne morale qui effectue titre de profession habituelle, et principalement
des oprations portant sur la rception des fonds du public, des oprations de crdit ainsi que
la mise disposition de la clientle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci .
Suite auxquelles, la BNA a obtenu son agrment le 05/09/1995, et de ce fait elle est la
premire banque du pays bnficiaire de ce statut.
La BNA est une personne morale qui effectue titre de profession habituelle les oprations
de banque dfinies dans larticle 66 de la lordonnance N 03-11 du 26 aout 2003.
2) Capital social
Au mois de juin 2009, le capital de la BNA a t augment. Il a t port de
14 600 milliards de dinars 41 600 milliards de dinars par lmission de 27 000 nouvelles
actions de 01 million de dinars chacune, souscrites et dtenues par le Trsor Public.
3) Rseau BNA
Aujourdhui le rseau de la BNA est compos de plus de 200 agences rparties sur le
territoire national et dautres sont programmes dans le cadre de densification et de
dveloppement de son rseau dexploitation.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 82
Le rseau de la BNA est encadr par 17 directions rgionales appeles direction du rseau
dexploitation (D.R.E). Chaque D.R.E a un pouvoir hirarchique sur un nombre des agences.
Les agences de la BNA sont catgorises comme suit :
Agences principales.
Agences de catgories A, B, C.
Agences sur site implantes dans les locaux des grandes entreprises publiques.
4) Sige social
Son sige social est 08, Boulevard Ernesto Che-Guevara 16000- Alger- Algrie.
5) Missions
La BNA exerce toutes les activits dune banque de dpts, elle assure notamment le
service financier des groupements professionnels des entreprises. Elle traite toutes les
oprations de banque, de change et de crdit dans le cadre de la lgislation et de la
rglementation des banques.
Lordonnance N 66-178 du 13 juin 1966 crant la BNA charge cette dernire des missions
suivantes :
En tant que banque commerciale : elle traite toutes les oprations de banque, recueille des
dpts et consent des crdits court terme ou crdits dexploitation, finance les oprations du
commerce extrieur
En tant que banque dinvestissement : elle collabore avec les autres institutions financires
pour les crdits moyen et long terme.
En tant que socit nationale : elle sert dinstrument de planification financire, charge
dexcuter et de mettre en uvre la politique du gouvernement en matire de crdit.
Comme toute autre banque commerciale, La BNA a pour objectif le financement de
lconomie .Elle doit maximiser sa rentabilit en collectant des ressources financires auprs
des agents conomiques pour une redistribution sous forme de crdits au profit du
dveloppement de lconomie .Cest le rle dintermdiation financire
6) Lorganigramme de la banque
Lorganigramme de la banque se prsente comme suit :
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 83
Schma n01 :Lorganigramme de la banque :
(1)
1
Www.bna.dz
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 84
Annexe n01 : Organigramme de la BNA
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 85
II- Lagence bancaire
II-1-Dfinition
Lagence constitue la cellule de base de linstitution et le noyau de laction bancaire et
cest ce niveau que se traitent lensemble des oprations bancaires avec la clientle.
Elle est charge de mener toute action qui favorise laccroissement des ressources de la
banque et le dveloppement du portefeuille de la clientle.
II-2-Organisation de lagence
Les agences sont classes en fonction de leur importance commerciale selon le degr de
leurs performances et limportance de leurs chiffres daffaires.
A la BNA, il ya 4 catgorie dagences :
Agence principale (AP) ;
Agence 1re catgorie (type A) ;
Agence 2me catgorie (type B) ;
Agence 3me catgorie (type C) ;
Chaque agence est structure en services :
Service caisse ;
Service crdit ;
Service secrtariat engagement ;
Service porte feuille (tlcompensation) ;
Service Comex.
Schma n02 :Lorganigramme de lagence :
(1)
Source : www.bna.dz
1
Annexe 02 : Lorganigramme de lagence
Directeur Adjoint
Secrtaire
Commerce
extrieure (Comex)
Secrtariat
engagement
Caisse
Directeur
dAgence
tl
compensation
Engagement
(Crdits)
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 86
1- Service caisse
Les oprations de caisse constituent la base de lensemble des oprations bancaires.
On entend par service de caisse, lensemble des services matriels que doit offrir la banque
son client pour lui permettre une utilisation la plus souple possible des fonds dposs sur un
compte en banque.
Le service caisse traite les oprations de mouvements de fonds reus ou octroy la
clientle tels que : versement, virement, retrait....
2-Service Crdit (engagement)
Lactivit principale de la banque consiste prter les ressources collectes dans les
meilleures conditions de couts et de scurit. Selon le type de clientle et lactivit peut
recouvrir des formes trs diverses et ce pour des dures trs variables.
La banque :
prte le temps en attendant largent, (crdit par signature) ;
Elle prte largent en attendant un temps (crdit par caisse).
Le service des engagements soccupe principalement des tudes et analyses des dossiers de
crdits, et le suivi des conditions doctroi de crdits.
3- Service secrtariat engagement
La clientle constitue la partie essentielle du fonds de commerce de la banque. En effet, la
connaissance approfondie de cette clientle, ses caractristiques, sa nature juridique et son
fonctionnement comptable et financier en est le premier lment.
Pour faire face aux diffrents besoins des clients, et afin de faciliter leur gestion
commerciale, le banquier procde avant tout l'ouverture de comptes, qui constitue l'tape
pralable est importante avant toute nouvelle relation entre le client et sa banque.
Pour en faire, au niveau de chaque agence bancaire on trouve le service secrtariat
engagement qui est un organe de gestion et dexcution.
Le secrtariat engagement est complmentaire au compartiment crdits dans lorganisation
actuelle de lagence.
4- Service tlcompensation
Le service est charg de la remise des chques, descompte des effets de commerce, mis
par la banque ou reus des confrres.
La tl compensation est un systme centralis, avec un accs unique par participant, qui se
traduit par la suppression des chambres de compensation rgionales, elle ncessite la
centralisation des remises et ordre de toutes les agences d'une banque sur un site central de la
banque.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 87
5- Service Commerce extrieur (Comex)
Le service Comex est charg de raliser, de grer et de superviser toutes les oprations qui
matrialisent les relations du banquier avec sa clientle et /ou avec ses correspondants
essentiellement dans le cadre du commerce extrieur.
Le service Comex au niveau de lagence est charg des oprations de commerce extrieur,
il est subdivis en 5 sections :
Section remise documentaire ;
Section transfert/rapatriement ;
Section devise et change manuel ;
Section domiciliation ;
Section crdit documentaire.
5-1) La remise documentaire
La remise (encaissement) documentaire est lopration par laquelle une banque appele
banque remettante sur instruction de son client exportateur (tireur) se charge de
lencaissement dun montant de la transaction auprs de limportateur (tir) par
lintermdiaire dune banque appele banque charge de lencaissement, contre remise de
documents.
5-2) Transfert/ rapatriement
Le transfert est lordre par lequel un client donne instruction la banque de transfrer une
somme dtermine, son compte, ou au compte dun tiers, tenu sur les livres dune banque
trangre.
5-3) Devise et change manuel
Cette section est charge de louverture, la gestion et le suivi des comptes devises vue ou
terme, ainsi que lexcution des oprations de versement et de retraits de billets de banque
trangres ralises par les titulaires de comptes devises.
Elle est charge galement du traitement des oprations de change manuel (achat/vente de
devises).
5-4) Domiciliation
La domiciliation est pralable toute opration de commerce extrieur. En effet, cest
lopration qui prcde louverture du Credoc. Elle est rgie par le rglement n 91-12 du 14
08 1991.
a) Dfinition
Cest une procdure administrative qui consiste enregistrer et excuter les oprations
dimportation et dexportation. Elle consiste donner un numro la transaction
commerciale, pour permettre son suivi physique.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 88
Etant donn quon na pas rencontr de dossiers de domiciliation lexport au niveau du
lieu de stage, il ya lieu daxer sur la domiciliation des importations.
b) Types de domiciliation
Dlai normal (DI) : lopration dimportation se ralisera dans un dlai de six
(6) mois, compter de la date de domiciliation.
Dlai long (DIP) : Au-del de six mois- concerne les investissements.
5-5) Crdit Documentaire
a) Dfinition
Le crdit documentaire couramment nomm Credoc , est tout fait adapt aux
transactions entre un importateur et un exportateur -ou prestataire de services- qui souhaitent
obtenir des assurances quant au respect des obligations de chacun et au bon droulement de
lopration.
Le Credoc import est une opration par laquelle une banque, sur demande dun
importateur, intervient en vue de garantir le rglement dun exportateur tranger, avec un
engagement de le payer ( vue, directement ou indirectement), contre la remise des documents
requis jugs conformes aux conditions du crdit documentaire. Cest un crdit par signature.
b) Les intervenants
Donneur dordre : acheteur ;
Le bnficiaire ;
La banque mettrice (banque de lacheteur) ;
La banque notificatrice - confirmante (banque du vendeur).
c) Avantages
Le Credoc apporte des garanties concrtes :
A lacheteur, qui paiera seulement dans le cas o le vendeur peut justifier du fait quil
a satisfait ses obligations (prestation accomplie, marchandises expdies dans les
dlais, termes du Credoc respects : quantit, montant)
Au vendeur, qui aura obtenu un engagement de rglement manant dune banque,
vitant ainsi le risque de dfaillance de lacheteur.
Le crdit documentaire peut galement tre assorti de dlais de rglement :
Limportateur bnficie alors dune certaine souplesse dans la gestion de sa
trsorerie.
Lexportateur pourra facilement mobiliser sa crance puisquil dtient un
engagement bancaire de paiement.
d) Les formes
Rvocable : peut tre annul sans accord du bnficiaire sauf sil a connu un dbut de
ralisation ;
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 89
Irrvocable : engagement de la banque mettrice, ne peut tre annul ou modifi sans
accord des parties engages ;
Irrvocable et confirm : engagement des banques, ne peut tre annul ou modifi
sans accord des parties engages.
e) Documents
Lacheteur, importateur, doit indiquer dans ses instructions dmission de crdit
documentaire, les documents dont il aura besoin pour raliser son importation.
Certains documents sont indispensables :
- La facture commerciale ;
- Le document de transport (sauf sil sagit de prestations de services) ;
- Le certificat dassurance (si lassurance est couverte par le vendeur) ;
Dautres documents peuvent tre rclams en fonction de la marchandise importe ou de la
prestation fournie, du pays de provenance et/ou des exigences douanires limportation .Les
documents devront tre mis en conformit avec les termes et conditions du crdit
documentaire, mais aussi avec les articles des RUU 600 sy rfrent.
La facture commerciale: commercial invoice. (art14etart18des RUU 600)
La facture doit tre tablie par le bnficiaire du crdit documentaire au nom du donneur
dordre.
La dsignation des marchandises porte sur la facture doit tre strictement conforme celle
indique dans le crdit documentaire, alors que sur les autres documents elle peut tre reprise
en termes gnraux.
Les documents de transport selon le mode de transport (art 1927)
En fonction du mode de transport prvu dans le crdit documentaire, le document de
transport requis sera diffrent.
Les RUU 600 ont consacr un article pour chacun des documents de transport qui peuvent
tre rclams, savoir :
Le connaissement maritime : Ocan Bill of Lading : BL
Ce titre de transport, par lequel le capitaine reconnait avoir mis bord les marchandises et
sengage les acheminer au port de destination dsign, est tabli en plusieurs exemplaires
dont :
- Un pour le capitaine (connaissement chef) ;
- Un pour larmateur ;
- Et les autres pour le vendeur.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 90
Le document de transport par route (art 24) :CMR
Il sagit de la lettre de voiture internationale type C.M.R (convention relative au contrat de
transport international de marchandises par route). Cest un formulaire prvu par la
convention internationale pour le transport de marchandises par route.
Le document multimodal : (art19)
Cest le document qui devra tre prsent si le crdit documentaire exige un document de
transport couvrant au moins deux modes de transport diffrents (transport multimodal).
Le document de transport arien :(Air transport doc art23)
LTA : Ce document prouve la prise en charge de la marchandise pour expdition de
laroport de dpart laroport de destination indique sur le document.
Les autres documents dexpdition
Ces diffrents documents peuvent tre exigs selon le type de marchandises ou de
prestation fournie du pays dorigine et de destination et/ou des exigences douanires
limportation.
Certificat dorigine ;
Certificat / note de poids
Liste de colisage ;
Certificat de qualit ;
Certificat dexpertise et danalyse :
Certificat sanitaire ;
Certificat dinspection.
f) Les incoterms 2000: (International Commercial Terms)
Les incoterms sont des termes du commerce international dapplication universelle dfinis
par la chambre de commerce internationale (CCI) en langue anglaise avec traduction franaise
internationalement et officiellement reconnue.
(1)
Caractristiques
Sappliquent aux contrats de vente (la livraison)
- Transfert de frais (charges) ;
- Transfert de risques ;
- Transfert de proprit.
Les principaux incoterms et leur dfinition :Les conditions de vente doivent
imprativement tre adaptes aux moyens de transports utiliss : FER-MER-AIR-
ROUTE-MIXTE
1
Ces incoterms de lan 2000, ont t modifis par la nouvelle version de lan 2010.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 91
Le but
Leur but est de permettre aux parties signataires dun contrat de limiter les malentendus,
litiges, ou procs dus une mconnaissance des pratiques commerciales en vigueur dans les
diffrents pays.
Tableau n 04 : les incoterms : QUATRE CATEGORIES : 13 termes
La
famille
Sigle Nom anglais Mode de transport Obligations
Termes
en E
EXW Ex -Works Tous modes Obligations minimales
du vendeur
Termes
en F
FAS
FCA
FOB
-Free alongside ship
-Free-Carrier
-Free On Board
-Exclusivement maritime
-Tous modes
-Exclusivement maritime
Le vendeur nassume ni
les risques, ni les frais de
transport principal
Termes
en C
CFR
CIF
CPT
CIP
-Cost and freight
-Cost insurance freight
-Carriage paid to
-Carriage insurance paid
-Exclusivement maritime
-Exclusivement maritime
-Tous modes
-Tous modes
Le vendeur assume les
frais de transport
principal, mais pas les
risques
Termes
en D
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
Delivered at frontier
Delivered ex ship
Delivered ex quay
Delivered duty unpaid
Delivered duty paid
-Terrestre
-Exclusivement maritime
-Exclusivement maritime
-Tous modes
-Tous modes
Le vendeur assume les
risques et les frais de
transport principal
Source : Akli Rafik ; Les oprations de commerce extrieur, Document interne BNA.
g) Risques du Credoc :
Pour limportateur : non-conformit des marchandises ;
Pour lexportateur : risque de non remboursement si irrvocable seulement.
Section II : Dmarche pratique suivre pour la domiciliation et louverture dun
Credoc au niveau de la BNA :
I- Domiciliation :
La domiciliation se droule en trois (3) tapes :
Ouverture du dossier de domiciliation ;
Gestion du dossier ;
Apurement de domiciliation.
I-1-LOUVERTURE DU DOSSIER DE DOMICILIATION
1) Rception de la demande douverture
Elle seffectue sur prsentation dune demande douverture ; dun contrat ; et dune
facture pro-forma. Donc, Le prpos aux oprations de domiciliation reoit du client :
une demande douverture de domiciliation import comportant les renseignements
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 92
suivants :
(1)
- la date dtablissement de la demande ;
- le nom ou la raison sociale de limportateur;
- son numro de compte auprs de lagence;
- la nature du contrat commercial (facture, contrat ou autres);
- les indications relatives aux marchandises importer:
o nature des produits,
o montant en devises et contre valeur en dinars;
o nom du fournisseur ou vendeur;
o tarifs douaniers;
o origine des produits.
- les conditions de paiement tel que le montant total en devises (des fournitures/ des
prestations).
La demande douverture de domiciliation doit tre dment remplie, cachete et signe par
le client ou son mandataire.
un contrat commercial (contrat en bonne et du forme, une facture pro-forma, un bon ou
une lettre de commande ferme, etc...).
Attestation Taxe de domiciliation bancaire
(2)
en cas de revente en tat, si non un
engagement en cas de production.
(3)
2) Vrifications de conformit
Le prpos aux oprations de domiciliation vrifie soigneusement les clauses de la
demande suscites et sassure de la conformit des documents et des oprations avec la
rglementation en vigueur.
A ce titre, il sassure que :
- le client nest pas frapp dune mesure dinterdiction limportation,
- la marchandise nest pas frappe dune mesure dinterdiction limportation.
Il vrifie les clauses du contrat commercial selon le cas de figure qui se prsente:
- numro de la facture ou rfrence du bon de commande,
- nom et adresse du vendeur (exportateur);
- nom et adresse de lacheteur (importateur);
- adresse dexpdition ou de destination (pays de lacheteur);
- nature et dtail de la marchandise ainsi que le dtail du montant et du prix (avec
prcision de la nature du contrat: FOB / C&F....);
- modalits de paiement: comment doit soprer le rglement de la marchandise
importe.
Dans le cas o la vrification fait apparatre que le client nest pas habilit la
domiciliation, le prpos rejette la demande du client.
1
Annexe n03 : Demande de la domiciliation
2
Annexe n04 : Attestation Taxe de domiciliation bancaire
3
Annexe 05 : engagement
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 93
Dans le cas contraire (opration conforme), le prpos procde la matrialisation de la
domiciliation.
3) Matrialisation de la domiciliation
a)Saisir lopration de Domiciliation sur Delta V8
Menu--- Etranger------ Domiciliation---prises en charges des domiciliations ----- :
Cration
Remplir les cases :
matricule client= NIF ;
Rf Autorit : CDI n ;
Di pour les Credoc dlai normal <6mois ;
DIP pour les Credoc spciaux > 6mois ;
Termes de vente : FOB, CFR : incoterms
-------Confirmation--- DER : lopration passe par drogation.
b) Attribution du numro dordre chronologique et apposition du cachet de domiciliation
Le prpos aux oprations de domiciliation attribue un numro dordre chronologique de
domiciliation.
Par la suite, il procde lapposition du cachet de domiciliation sur le contrat commercial
prsent par le client et le renseigne selon une codification.
Ce cachet comporte la codification de la domiciliation qui est compose de 21 chiffres
rcapituls en huit (08) cases distinctes et se dcompose dans lordre suivant :
Tableau 05 : Codification de la domiciliation
A :2 B :2 C :2 D :4 E :1 F :2 G :4 H :3
xx
wilaya
xx
code de
lagrment
agence
xx
code de lagrment
guichet de
domiciliation
xxxx
anne
X
trimestre
xx
nature
de
contrat
xxxx
N
dordre
chrono-
logique
xxx
monnaie
Source : Akli Rafik ; Les oprations de commerce extrieur, Document interne BNA.
c)Validation de la domiciliation
Le directeur valide lopration de la domiciliation aprs vrification de la conformit des
documents :
Menu-- Etranger-- domiciliation--- Validation de la domiciliation
--Domiciliation importation.
- Niveau 1.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 94
Les oprations de domiciliation apparaissent en attente : AT jusqu :
F1 : validation par le charg dtudes :----- F10-ESC-OUI.
Pour vrifier : Consultation de lvnement : 815---F1
F2 : validation de la domiciliation par le directeur dagence.
AT-----F 1--------F2 : domiciliation valide. Opration : 815.
I-2- LA GESTION DU DOSSIER DE DOMICILIATION
Entre la date douverture et lapurement, la banque domiciliataire procde au suivi et
intervient en cas de besoin auprs de son client pour complment dinformation. Elle veille
la rgularit des paiements; elle est tenue de constituer un dossier complet (original du contrat
commercial dument apur, Facture dfinitive domicilie, Document douanier D10 exemplaire
banque, Formule 04 cessions devises).
1) Enregistrement du dossier domicili
Le prpos aux oprations de domiciliation enregistre lacte de domiciliation sur le
rpertoire des dossiers dimportations domicilis et porte les indications suivantes :
la date douverture,
le numro de domiciliation;
le code de la devise;
le montant de limportation (montant port sur le contrat) ;
le nom de limportateur.
Il remet limportateur un exemplaire du contrat commercial dment domicili.
2) Etablissement de la fiche de contrle
Le prpos aux oprations de domiciliation tablit la fiche de contrle rglementaire selon
le cas :
Modle CA.1112
(1)
pour la domiciliation dimportation dlai normal DI
Modle CA.1113 pour la domiciliation dimportation dlai spcial DIP
Il remplit ladite fiche comme suit :
le nom du fournisseur ( indiquer dans la case rfrences diverses concernant
limportateur ) ;
les modalits de paiement concernant le dossier ouvert et lchancier probable
du rglement de limportation (dans la case observations gnrales ).
La fiche de contrle remplie soigneusement, doit faire apparatre les renseignements aussi
complet que possible, afin de rpondre aux soucis de linstitut dmission (Banque dAlgrie)
1
Annexe n 06 : la fiche de contrle CA1112
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 95
et dobserver la ralisation physique de lopration, au regard des dispositions de la
rglementation des changes.
Le dossier de domiciliation est ensuite remis au chef de service et au directeur dagence
pour validation.
3) Perception de la commission douverture
Le prpos aux oprations de domiciliation peroit la commission douverture inhrente
la domiciliation et ce, conformment aux conditions de banque en vigueur.
Les frais seront prlevs automatiquement, comme suit :
Dt : Client 1755,00DA
Ct : Commission 707.304 1500,00DA.
Ct : TVA 64/37 255,00DA.
I-3- LAPUREMMENT DE DOMICILIATION
Consiste pour le sige domiciliataire sassurer de la conformit et de la rgularit de
lopration import et de sa ralisation suivant la rglementation en vigueur jusqu sa
ralisation financire.
Lapurement seffectue en deux (2) tapes :
1) Linventaire
Aux termes de la priode de contrle des dossiers de domiciliation, lagence domiciliataire
procdera lapurement au vu des documents suivants
(1)
:
o La facture dfinitive, dument domicilie ;
o Document douanier exemplaire (D10) ;
o Exemplaire formule (4) (CA1067)
o Copie du message Swift.
Au terme de cet inventaire deux cas peuvent se prsenter :
a) Cas dossier complet
La banque domiciliataire procdera immdiatement ltablissement du bilan, et donnera
sa dcision finale quant au classement du dossier de lagence.
b) Cas dossier incomplet
Lagence procdera au rappel du client sur la rgularisation de son dossier.
1
Annexe n 07 : Formule 04 (CA 1067)
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 96
2) Ltablissement du bilan
Il sagit de vrifier que la valeur nette transfre (VNT) est en conformit avec la valeur
domicilie et ddouane (VD).
Trois cas peuvent se prsenter :
VNT=VD ; il se traduit par lapurement du dossier (le dossier sera garder au niveau de
lagence et informer la banque dAlgrie B.A) ;
VNT> VD ; excdent de rglement, (les dossiers sont dclars et transmis la B.A)
VNT<VD ; insuffisance de rglement (les dossiers sont dclars et transmis la B.A)
3) Les statistiques de fin du mois
Mensuellement ,et dans les deux semaines qui suivent le mois de rfrence, les banques et
les tablissements financiers sont tenus conformment larticle 2 de linstruction Banque
dAlgrie N03-07 du 31 Mai 2007 de transmettre la Banque dAlgrie les dclarations
douverture et dapurement des dossiers de domiciliation des oprations dimportation des
biens et services ainsi que les dclarations des dossiers non apurs.
4) La conservation des dossiers
Les dossiers de domiciliation dclars doivent tre conservs au niveau de lagence pour
tout contrle de la Banque dAlgrie pendant une priode de 5 ans.
II- Le crdit documentaire (Credoc)
II-1-Louverture du Credoc, au niveau de lagence
1) Conditions
- Le client doit avoir un compte commercial ;
- Le client doit tre solvable.
- Il faut pralablement renseigner une ligne de Credoc et une autorisation plafonne
avant de saisir un dossier. Cette intervention ressort exclusivement des pouvoirs du
directeur dagence ou de son adjoint.
- Le dossier de Credoc ne doit tre saisi dans le systme quaprs domiciliation de la
facture ou du contrat y relatif.
2) Documents requis
- Demande douverture Credoc (modle SEMAR 205-BIS)
(1)
avec les 19 clauses
conformment aux des rgles et usances uniformes et la rglementation de change
1
ANNEXE N08 : Demande Credoc Semar 205 bis
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 97
en vigueur. Elle doit tre dument remplie, cachete et sign par le client. Elle ne doit
comporter ni ratures ni surcharges.(en 3 exemplaires) ;
- Facture pro-forma ou contrat commercial (en 3 exemplaires) Domicili;
- Attestation Taxe de domiciliation bancaire : en cas de revente en ltat ;
- Un engagement en cas de revente avec modification ;
3) Rception et vrification des documents
-le prpos aux Credoc reoit la demande douverture du Credoc sur le formulaire
(Semar205bis), et les autres documents suscits.
-le prpos doit vrifier la conformit des documents prsents par le client par rapport aux
rgles et usances uniformes et la rglementation en vigueur.
-Le chef de service Comex vrifie que le dossier est conforme techniquement et la
rglementation des changes en vigueur et des rgles et usances rgissant les crdits
documentaires.
4) Enregistrement du dossier
- Il procde lenregistrement du Credoc sur le registre pour le suivi ;
5) Matrialisation de louverture de Credoc
a)Saisie de louverture du Credoc sur le systme
-le prpos procde la saisie des informations sur le systme Delta V8.
-Lors de la saisie de louverture du Credoc, le systme contrle automatiquement :
La fiche client ( exple : cas dinterdiction au commerce extrieur) ;
Lexistence de la provision dans le compte client.
La ligne dautorisation Credoc et/ou lautorisation plafonne.
Si lune des conditions prcites nest pas respecte, le systme signale un dsaccord
bloquant.
-Le prpos confirme la fin de la saisie du dossier la transaction par drogation (DER), et
confirme ldition correcte par oui .
-une fiche de Credoc est dite sur laquelle sont reprises toutes les informations du Credoc y
compris le numro chronologique attribu par le systme.
b) Etablissement de la chemise : Credoc limport (ET7)
-Il remplit la chemise rouge ET7 (Credoc limport)
(1),
sur laquelle sont reportes les
renseignements essentiels du Credoc, tel que le numro du dossier attribu par le systme.
1
Annexe n09 : Credoc limport chemise : ET7.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 98
6) Validation
Conformment lexistant, trois signatures doivent intervenir dans le dossier quon appelle
validation multiple dans Delta. Il sagit de la :
Validation 1 : confi au chef de service. Dossier en tat F1.
Validation 2 : confi au charg dtudes (charg du dossier), dossier en tat F2.
Validation 3 : confi au directeur dagence. Dossier en tat F3 (Validation commerciale).
-Le chef de service reprend le dossier, vrifie la saisie de lutilisateur par rapport aux
documents prsents par le client, si la saisie prsente une ou des anomalies, il procde aux
rectifications ncessaires suivant lopration Modification service , et procde la
validation technique du dossier en F1, et remet le dossier au charg dtudes pour la
validation la validation en F2.
-Celui-ci prsente le dossier au directeur dagence ou son adjoint intrimaire pour la troisime
validation du dossier en F3.
-Cette dernire validation provoque automatiquement une rservation des fonds sur le compte
du client pour les Credoc ouverts avec une marge de provision.
-Cette rservation de fonds se traduira automatiquement en PREG aprs validation finale de
lopration en agence de centralisation J+2.
-Le document SEMAR 205bis devra tre sign par le directeur et son adjoint, et retourn au
prpos pour la ventilation suivante :
Une copie comme accus de rception ;
Une copie achemine la DRE ;
Deux copies sont classes dans le dossier client ET7 au mme titre que la facture
proforma ou le contrat commercial ainsi que tout autre document.
Au terme des validations, le systme gnre la rservation des fonds. Le prpos pourra
consulter lvnement rservation de fons laide de la transaction Consultation des
vnements .
----validation Credoc------Credoc Import
F1 : Niveau 1 Charg dtudes: F10-------------ESC.
F2 : directeur adjoint.
F3 : directeur.
F1---------------F2-------------------F3
Consultation des vnements :
830: Credoc IC.
870: Credoc : IRR.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 99
7) Classement des documents
Le prpos classe les documents suivants dans le dossier client :
Facture proforma ou contrat commercial ;
Formulaire SEMAR 205bis ;
Autres documents.
8) Envoi la D.O.D : (Direction des Oprations Documentaires)
o La facture pro-forma domicilie ;
o Demande douverture Credoc SEMAR ;
o Lettre douverture par V8
(1)
.
9) Gnration des critures de Credoc
Ecritures dengagement ;
Commission douverture ;
Constitution de la PREG.
-Lintgration des critures comptables au niveau de lagence est effectue J+2 aprs
traitement de fin de journe.
II-2- Louverture du Credoc, au niveau de la D.O.D
-Validation de la domiciliation aprs 4 ou 5 jours.
-Constitution de la provision : Ristourne : frais douverture Credoc.
Dt : client
Ct : PREG 0364..
Ct : Commission douverture 3000,00DA
Ct : Commission Swift 2000,00DA
Ct : Commission dengagement (selon le montant).
-Forage du Credoc.
-Le prpos reoit deux exemplaires de lavis du client :
Un exemplaire classer dans le dossier ;
Un exemplaire remettre au client.
-Emission dun Swift douverture pour permettre au fournisseur de confirmer louverture de
Credoc.
-Edition des pices comptables internationales : PREG D.O.D.
1
Annexe n10 : Lettre douverture par V8.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 100
II-3- Rglement du Credoc
1) Cas de Rception des documents par le client : PLI Cartable
Un Pli cartable : est un pli renfermant lensemble des documents permettant limportateur
de ddouaner rapidement ses marchandises.
Lors de la rception des documents originaux par pli cartable, le client fournit :
- La facture dfinitive pour la domicilier.
- Le B/L original mis au nom de la banque. Il sera endoss au nom du client : avec
la mention remettre au client + la date et le cachet au verso.
- Une demande de la mainleve de la rserve , dont une copie sera conserve
dans le dossier et lautre sera accuse et remise au client.
- Copies des factures domicilies seront classes dans le dossier pour les statistiques
de la fin du mois.
Le client signe la chemise rouge ET7, aprs rception des documents domicilis, et met
son cachet.
Le banquier envoie par lettre demande de la leve de rserve la D.O.D, pour payer
lexportateur.
2) Cas de rception des documents de lexportateur au niveau de la DOD
-Vrification des documents, sils sont conformes.
-Restitution de la provision : Extourne : Avis de crdit
Dt : PREG 00364.
Ct : client.
-Rglement : paiement du fournisseur : Avis de dbit
Dt : client : Montant rglement + commission rglement Credoc + commission rglement
B.A + Frais cbles.
-Emission du deuxime Swift : SWIFT de rglement
(1)
.
3) Edition des pices comptables internationales
Pour ldition des pices comptables internationales :
Menu---- Exploitation informatique---- traitement de fin de journe
---- lancement des ditions de fin de journe--- bordereaux-Oui ESC
MC10 : Avis de crdit : Ristourne.
MC10 : Avis de dbit : Rglement.
-Classer les 2 MC10 dans le dossier et le barr avec la mention S : sold.
4) Classement des dossiers
Credoc ouvert : Credoc encours.
Credoc dj rgl : Credoc solds.
1
Annexe n11 : Swift.
Marchandises.
(1)
Ordre
De documents documents rglement
Paiement (5) (2) (7)
(4) documents
(3)
Transfert(6)
C
h
a
p
i
t
r
e
I
I
I
:
L
e
c
o
n
t
r
l
e
i
n
t
e
r
n
e
b
a
n
c
a
i
r
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
a
B
N
A
1
0
1
S
c
h
m
a
d
e
l
o
p
r
a
t
i
o
n
d
e
C
r
e
d
o
c
:
s
c
h
m
a
n
0
3
Importateur
donneur
dordre
Exportateur
bnficiaire
Banque
mettrice
(Banque de
limportateur)
Banque
notificatrice
(Banque de
lexportateur)
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 102
III-Le contrle au niveau de lagence : (Auto-contrle)
Lagence tablit les tats de reporting (contrle au niveau de lagence). Les responsables
hirarchiques au niveau de lagence vrifient leur conformit avec les instructions de gestion
et de contrle en vigueur.
Sur la base dudit reporting reus au niveau des DRE, la Direction daudit interne et tablit
trimestriellement une fiche dapprciation et de synthse par laquelle elle fera part de ses
actions et propositions la supervision du contrle interne (SCI).
(1)
Section III : Les niveaux de Contrle au sein de la Banque Nationale dAlgrie
I- Gnralits
Le rglement 2002-03 de la banque dAlgrie fait obligation aux banques de se doter dun
systme de contrle interne.
Larticle 6 prvoit, notamment, quelles doivent organiser leurs systmes de contrle de
faon pouvoir :
Assurer un contrle rgulier avec un ensemble de moyens mis en uvre en
permanence dans les units oprationnelles pour garantir la rgularit, la scurit et la
validation des oprations lies la surveillance des risques de toute nature associs
aux oprations ;
Vrifier, selon une priodicit adapte, la rgularit et la conformit des oprations, le
respect des procdures et lefficacit des dispositifs prvus dans lalina prcdent, en
particulier, leur adquation la nature de lensemble des risques associs aux
oprations .
A la banque nationale dAlgrie, la terminologie retenue pour distinguer ces deux types de
contrles est la suivante :
les contrles rguliers avec un ensemble de moyens mis en uvre en permanence
sont dfinis comme les CONTROLES DE PREMIER DEGRE ; il sagit de
lensemble des contrles dcids et placs sous la responsabilit directe des
hirarchies oprationnelles qui en vrifiant la bonne excution et lutilisation ; ces
contrles, dcids, mis effectivement en uvre, rviss ou actualiss en permanence
peuvent tre manuels ou automatiss (intgrs aux systmes), raliss posteriori ou
priori ;
les vrifications, selon une priodicit adapte de la rgularit et de la conformit
des oprations sont dfinies comme les CONTROLE DE SECOND DEGRE .
La nature de ces deux grandes familles de missions est dfinie ci-aprs.
1
Circulaire n1926 du 28/01/2007, Reporting de contrle de premier degr au niveau de lagence.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 103
II - Le contrle de premier degr au niveau de la DRE
Compte tenu des spcificits de lactivit bancaire, lensemble des risques affrents
lensemble des activits de la banque (y compris les risques oprationnels) doit tre recens,
puis valu, surveill et supervis par les hirarchies oprationnelles.
Cest partir de ce recensement, de limportance que les hirarchies oprationnelles
attribuent chacun des risques (sous validation de lexcutif, notamment parce que certains
risques sont transverses), que les contrles de premier degr doivent tre dtermines.
Ils doivent tre permanents (le plus souvent possible intgrs aux systmes informatiques
notamment) et rguliers, raliss dans et par lensemble des units de la banque pour garantir
la rgularit et la scurit des oprations qui leurs sont confies.
Ils doivent tre exercs par des collaborateurs suffisamment qualifis, en nombre et
disposant de moyens ncessaire et adapts la taille et aux activits de la banque.
La qualit de ces contrles, leur ralit, leur analyse doivent tre surveilles et portes la
connaissance des hirarchies oprationnelles.les anomalies les plus graves ou rcurrentes
mises en lumire loccasion de ces contrles doivent donner lieu des actions correctrices
linitiative de ces mmes hirarchies.
Ces contrles de premier degr sont assurs au niveau de la DRE.
II-1) La DRE : Direction du rseau dexploitation
1) Dfinition
Soccupe dune manire gnrale du suivi du droulement des oprations effectues au
niveau des agences qui lui sont rattaches et les et les diffrents dpartements de la DRE.
2) Organisation
2-1) DGAB : dpartement charg de la gestion du budget administratif.
Ce dpartement a pour mission essentielle la gestion des moyens humains et matriels de la
DRE ainsi que les budgets y affrents.
2-2) DPAC : dpartement charg de la promotion et lanimation commerciale :
La mission du DPAC et daugmenter la production et la rentabilit de la banque,
notamment par un accroissement des dpts, contre partie des crdits et par la promotion des
produits et services mis la disposition de la clientle, cest la vritable plaque tournante
des informations de la DRE.
2-3) Dpartement crdit
Charg de ltude et le suivi des dossiers de crdits octroys la clientle tant publique que
prive de la DRE. Il a pour mission principale de surveiller et contrler la conformit et la
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 104
bonne excution de lensemble des oprations de crdits excutes au niveau des agences
rattaches la DRE.
2-4) Dpartement contrle : Contrle du premier degr
Ce dpartement fut cre suite la circulaire n1789 et ce, en remplaant la cellule de
contrle prvue auparavant. Il est charg du contrle du premier degr au sein de chaque
DRE, et il agit sous lautorit directe du directeur.
a) Organisation et attribution
Le dpartement de contrle est organis en deux cellules :
Une cellule sdentaire : charge du contrle distance, compose de deux (2) contrleurs
au moins ;
Une cellule itinrante : charge des interventions et missions sur place et de llaboration
des rapports de contrle, compose de deux (2) brigades de deux (2) contrleurs chacune,
au moins.
La nouvelle organisation vise :
Une assistance accrue des services de la DRE et des siges qui lui sont rattachs ;
Une meilleure prvention contre les oprations irrgulires ou tout risque li aux
oprations bancaires ;
Un contrle complmentaire par rapport celui ralis par linspection gnrale ;
Une clrit dans la prise des mesures appropries.
b) Missions
Dans le cadre de ses missions et interventions, ce dpartement doit sassurer que :
Les instructions et procdures sont bien comprises et appliques ;
La gestion est saine, rgulire et efficace ;
Les rgles de bonne organisation et lutilisation judicieuse des moyens mis la
disposition des services de la DRE, et des siges qui lui sont rattachs sont observes ;
Les prestations rendues soient de qualit ;
Les contrles hirarchiques et fonctionnels sont correctement et rgulirement
accomplis ;
Les observations et constatations releves par les organes de contrle (interne et
externe) soient rellement prises en charge et rgularises.
c) Champ dintervention
Le dpartement contrle de la DRE excute le programme dintervention tel qutabli par
le DRE ou les missions spciales qui lui sont confies par le DRE au niveau :
Des siges rattachs la DRE ;
Des services de la DRE, en cas de ncessit.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 105
Toutefois, les contrleurs ne doivent, en aucun cas :
Assurer lintrim des services et des siges ds leur affectation au contrle ;
Contrler les services et siges dont ils avaient la charge avant leur affectation au
contrle.
d) Nature et priodicit des interventions
Les missions du contrle de premier degr sont excutes :
A distance ;
Sur place.
Le contrle distance
Le contrle distance vise :
-Lexploitation des tats priodiques transmis par les structures de la banque tels que:
Les statistiques de la direction de la comptabilit ;
Les tats de comptes de chques dbiteurs ;
Relev des comptes des existences CT100 (mensuel) ;
Etats des suivis de risque (mensuel, semestriel, et annuel) ;
Etat quotidien dmission de chques de banque (traitement mensuel) ;
Points de surveillance de commerce extrieur (mensuel) ;
Etat de reporting du contrle de 1
er
degr (quotidien, mensuel, trimestriel, semestriel et
annuel).
-La collecte, le traitement et la communication des informations ncessaires
lengagement des missions sur place et la prparation de ces missions avant leur
dclenchement ;
-La saisie, ldition des rapports de contrle et leur transmission aux structures concernes
notamment la DER, linspection de contrle et dintervention ou dinspection rgionale
comptente ;
-Lexploitation et le suivi deffets des rapports labors par les organes de contrle interne ou
externes ;
-La tenue et la mise jour du recueil des circulaires et sa diffusion aux services de la DRE et
aux siges qui lui sont rattachs ;
-La tenue et la mise jour du fichier de contrle du premier degr et linspection gnrale des
siges et services de la DRE ;
-Laspect scurit sous toutes ses formes ;
-Llaboration du rapport dactivit du dpartement.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 106
Le contrle sur place
Le contrle sur place est bas sur des :
Missions ponctuelles ;
Missions de suivi ;
Missions spciales.
Les missions ponctuelles
Les missions ponctuelles consistent en un traitement intgral dun (1) ou de trois (3)
thmes au plus.
Les thmes traiter et les objectifs viss sont dtermins dans la partie (thmes de mission
ponctuelle)
Les missions ponctuelles doivent :
Etre limites dans le temps, leur dure ne doit, en aucun cas, dpasser quinze (15)
jours ;
Faire lobjet dun rapport et dune rponse du sige ou du service visit.
La rponse doit parvenir la DRE dans les dix (10) jours qui suivent la notification du
rapport. Ce dlai ne peut, en aucun cas, dpasser les quinze (15) jours, sauf justification et
aprs accord du DRE.
Les missions de suivi
Les missions de suivi traitent de :
Lapplication des mesures arrtes aprs contrle effectu par linspection, le contrle
du premier degr ou tout organe de contrle externe ;
La mise en uvre du plan de redressement prioritaire arrt lors des runions de
clture ;
Elles sont dune dure ne devant, en aucun cas, excder cinq (05) jours, elles sont
sanctionnes par un rapport indiquant, pour chaque sige ou service contrl :
Les mesures dcides et non appliques ainsi que les difficults ou causes nayant pas
permis leur application ;
Les solutions ou toutes autres recommandations et suggestions de nature rsorber
les insuffisances et amliorer la gestion du sige ou service.
En tout tat de cause, tout sige devra faire lobjet dun minimum de deux visites, au
moins, par exercice. On entend par visite, lexcution dune mission ponctuelle.
Les missions spciales
Le caractre spcial des missions dcoule de :
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 107
La nature de lopration contrler non prvue au programme prvisionnel annuel ;
Lurgence prendre en charge la ou les situation (s) induite (s) par cette opration.
En cas de difficults rencontres dans le traitement de lopration et/ou de ses
dveloppements et ramifications, il pourra tre fait appel, sur rapport spcial circonstanci et
motiv, linspection de contrle et dintervention ou linspection rgionale comptente.
Les missions spciales traitent :
Erreurs de caisse ;
Oprations irrgulires ;
Etablissements frauduleux des documents de banque ou de leur disparition, perte ou
vol ;
Rclamation de la clientle ;
Situation particulires signales.
Elles sont dune dure rduite au maximum, toute mission spciale est sanctionne par un
rapport devant :
Prciser les conditions dans lesquelles a t excute lopration ou les motivations de
la rclamation ;
Dlimiter, si possible, les responsabilits ;
Prciser les causes ayant favoris lopration et proposer les solutions ou mettre des
recommandations et suggestions de nature viter son renouvellement.
e) Les rapports
Quelle que soit sa nature, toute mission est sanctionne par un rapport. Le rapport est tabli
sur imprim officiel de la banque de contexture similaire celle utilise par linspection
gnrale.
Il doit prciser dans une page de garde :
o Le sige ou le service contrl ;
o La nature et lobjet de la mission ;
o Les noms, prnoms et grades des contrleurs ;
o La priode dintervention ou de mission ;
o La priode contrle qui ne doit, en aucun cas, tre infrieure trois (3) mois et
suprieure six (6) mois.
Les contrleurs doivent satteler :
Eviter la reproduction des termes des correspondances ( remplacer par une synthse
avec indication de sa rfrence), de situations dtailles ( remplacer par une
vrification de la conformit entre situation thorique et situation relle) ;
Rechercher lorigine de tout cart ou discordance comptable ;
Evaluer le prjudice ventuel ;
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 108
Recueillir les propositions et faire des recommandations ou suggestions de nature
amliorer la gestion ou contrecarrer le renouvellement des oprations irrgulires,
anomalies ou autres insuffisances.
Les rapports de missions ponctuelles donnent lieu, en attendant les rponses du service ou
du sige contrl, ltablissement dune synthse devant indiquer :
Le service ou le sige contrl ;
Les principales observations et constatations releves ;
Les principales suggestions et recommandations mises.
Cette synthse est transmise pour exploitation et prise de mesures, ventuellement, au plus
tard, dix (10) jours aprs la fin de la mission, :
Linspection de contrle et dintervention ou linspection rgionale comptente ;
La DRE.
Tout rapport de mission est transmis par le DRE, :
La DER, qui est charge de :
Assurer son exploitation ;
Lui rserver les suites qui simposent en saisissant ventuellement les
directions concernes par les solutions, recommandations et suggestions
proposes ;
Linspection de contrle et dintervention ou linspection rgionale comptente pour
exploitation et suivi.
(1)
1
Circulaire BNA n 1789 du 09/09/1999 ; contrle de premier degr.
Source : Documents internes BNA
DIRECTION DU RESEAU D'EXPLOITATION
DGAB DPT CREDIT
DEPT
CONTROLE
DPAC
SECRETARIAT
C
h
a
p
i
t
r
e
I
I
I
:
L
e
c
o
n
t
r
l
e
i
n
t
e
r
n
e
b
a
n
c
a
i
r
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
a
B
N
A
1
0
9
S
c
h
m
a
n
0
4
:
O
r
g
a
n
i
g
r
a
m
m
e
d
e
l
a
D
R
E
(
1
)
1
A
n
n
e
x
e
n
1
2
:
O
r
g
a
n
i
g
r
a
m
m
e
D
R
E
B
o
u
z
a
r
a
h
.
AP CHE
GUEVARA -599-
AP TELEMLY
-602-
AP
BOUZAREAH -
627-
AP ZIROUT
YOUCEF -620-
AP LIBERTE -
605-
Agence PORT-
SAID -628-
Agence BAB
EL OUED -629-
Agence
BOLOGHINE -
608-
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 110
II- 2) Contrle du premier degr des oprations de Comex : cas Credoc
Dans le cadre de lapplication des dispositions du rglement banque dAlgrie n02-03 du
14/11/2002
(1)
, portant sur le contrle interne des banques et des tablissements financiers,
notamment celles relatives au systme de contrles des oprations et des procdures internes,
un nouveau palier de contrle des oprations de commerce extrieur est institu.
Le contrle doit porter sur la rgularit et la conformit des oprations de crdits
documentaires raliss par les agences sur les plans, engagements, constitution de provision et
perception des commissions et ce, conformment aux dispositions de la circulaire n1789 du
19/09/1999.
Afin de permettre au dpartement contrle deffectuer le suivi et le contrle appropris des
oprations de Comex (Credoc), les agences doivent transmettre les documents repris ci-aprs :
Lagence joint lappui de la copie de la demande de crdit documentaire modle Se-Mar
205bis (feuille5), adress actuellement la DRE de rattachement, les documents suivants :
Une copie de la facture pro-forma ou du contrat dument domicili ;
Une copie de bordereaux MC10, pour la constitution de la provision et la perception
des commissions (feuillet 3) ;
Une copie du Swift adress la D.O.D (Direction des oprations diverses) ;
Lagence est tenue de renseigner et de transmettre mensuellement sa DRE de
rattachement un tat de surveillance des oprations de Comex conformment au modle I
joint en annexe.
(2)
Le dpartement contrle de la DRE doit confirmer mensuellement les contrles oprs en
renseignant les tats de reporting points de surveillance fondamentaux prvus pour chaque
nature doprations dans le tableau modle II
(3)
, ainsi que la fiche daction modle IV
(4)
.
Les tats cits ci-dessus dument renseigns et revtus des signatures du DRE et du chef de
DPT contrle doivent tre adresss mensuellement aux structures ci-aprs :
La direction de lencadrement du rseau pour exploitation DER ;
La direction de la gestion des risques (DGR) pour exploitation et analyse du risque ;
La direction de laudit interne (DAI) pour exploitation ;
Linspection rgionale (IR) pour exploitation ;
Linspection rgionale (IG) pour centralisation et analyse ;
La supervision du contrle interne (SCI) pour consolidation et commentaires sur les
rsultats du contrle.
La SCI doit aprs consolidation, communiquer ses commentaires monsieur le PDG et au
comit daudit.
(1)
1
Annexe n 13 : rglement 02-03 de la banque dAlgrie.
2
Tableau n 06: points de surveillance fondamentaux Modle I.
3
Tableau n07 : points de surveillance fondamentaux Modle II
4
Tableau n08 : points de surveillance fondamentaux Modle IV
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 111
NB : Au niveau de la DRE Bouzareah (194) ; on na pas pu participer a des missions sur
place, car la cellule itinrante (qui intervient sur place) nexiste pas cause dinsuffisance
deffectifs.
Sur la base des tats (reporting) reus des DRE, la Direction de lAudit Interne analyse les
dysfonctionnements et les risques ; et labore la fiche dapprciation et de prise en charge
quelle transmet la SCI avant le 30 du mois suivant de la priode considre.
(2)
III- Le contrle du second degr : LAudit Interne
III-1- Dfinition
Les contrles de second degr exercs un rythme priodique par une entit
hirarchiquement indpendante des units dont elle a en charge dvaluer la qualit des
systmes de contrle interne, et la bonne maitrise de lensemble des risques lis leur
activit.
La ou les structures doivent disposer de moyens suffisants pour assurer un cycle complet
dinvestigations :
Sur lensemble des activits de la banque ;
Sur le nombre dexercices ncessaires ;
Sur la base et dans le respect dun programme dinterventions valid par lexcutif.
Il sagit donc de faire du contrle des contrles de premier degr, mais aussi et surtout, par
lvaluation de la pertinence et de lefficacit de lensemble des moyens et des dispositifs
prvus, de donner au responsable dunit une assurance raisonnable sur la qualit des
dispositifs de contrle interne et la maitrise des risques lis son activit.
Ce contrle du second degr est assur par la structure daudit interne, indpendante et lie
directement la direction gnrale, selon un programme annuel valide par la direction
gnrale de la BNA.
Laudit interne participe la surveillance permanente du dispositif de contrle interne et
fournit une valuation indpendante de son adquation et de sa conformit avec les
procdures et la politique dcide par la banque. Dans lexercice de cette mission, la fonction
daudit interne aide la direction gnrale et le conseil dadministration, qui tient lieu de comit
daudit, assumer effectivement et efficacement leurs responsabilits en matire de dispositif
de contrle.
La direction de laudit interne de la BNA au sien de laquelle nous avons effectu notre
stage pratique a t cre en 2006 par la circulaire N1992 du 28/12/2006.
1
Circulaire BNA n 1960 du 09/09/2008 ; Contrle Interne : Contrle des oprations de commerce extrieur.
2
Circulaire BNA n1925 du 28/01/2007 ; contrle interne : les indicateurs de suivi des risques.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 112
III-2- Missions
La direction de lAudit Interne a pour missions principales :
-Lidentification des risques inhrents aux activits de lentit audite au sein de la banque ;
-Lvaluation, pour une approche systmatique et mthodique de la qualit du systme de
contrle interne et les processus de management des risques ;
-La recommandation de solutions appropries pour une valeur ajoute reconnue destines
optimiser le systme de contrle interne ;
-Le suivi du plan daction et la prise en charge effective des recommandations ;
-La communication lorgane excutif et au comit dAudit du rsultat de ses missions.
1) La nature des missions
Les missions ralises par laudit interne sont dites :
a) De rgularit ou de conformit : lorsquil sagit de mesurer un cart entre les
rfrentiels (les procdures internes, les obligations rglementaires) et les pratiques de
lunit audite ;
b) Defficacit : il sagit dvaluer la pertinence dune procdure ou dun procss interne.
Les missions de rgularit et de conformit dans une unit peuvent tre
Globale : elles portent sur lensemble des risques dcoulant de lensemble des
activits dployes par lunit audite ;
Partielles : elles sont limites lvaluation des risques dcoulant dune partie des
activits dployes par lunit audite ; ce type de mission doit tre justifi,
notamment par la cartographie des risques ou par limpossibilit de mobiliser les
moyens humains suffisants (notamment en matire de comptence) dans les quipes
de laudit interne. Ces insuffisances doivent tre portes lattention de la direction
gnrale qui pourra dcider de faire appel des comptences externes (ce type de
situation est probable dans lvaluation de la maitrise et la gestion des risques dunits
spcifiques, telles linformatique, le contrle de gestion, les activits de march) ;
De suivi : ces missions ont pour objet de valider la ralit, la qualit et les effets dune
action correctrice engage et dclare termine par une unit audite la suite dune
recommandation de niveau lev accepte par elle.
2) Relations
Le champ dactivit de la Direction de lAudit Interne (DAI) couvre lensemble des
structures de la banque avec lesquelles elle entretient des relations fonctionnelles et de
coopration et plus particulirement avec :
Le Comit dAudit ;
La Supervision du Contrle interne ;
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 113
La Direction de la Gestion des Risques ;
LInspection Gnrale.
Elle entretient galement des relations avec les diffrents partenaires externes et les
commissaires aux comptes.
3) Les informations ncessaires pour laccomplissement de la mission daudit
Les organigrammes, ltat des effectifs rels (DPRD) ;
Les dfinitions de mission, de poste (Direction centrale hirarchique) ;
Les pouvoirs, les dlgations, les habilitations, (DG, ou DI) ;
Les tableaux de bord (activit, production) ;
Les rapports dactivit ;
La dernire cartographie des risques (SCI) ;
Les reporting de suivi des indicateurs de risques (SCI) ;
Le dernier rapport de linspection gnrale ou de laudit interne Etc.
(1)
4) Organisation
La direction de lAudit Interne est organise en trois (03) cellules. Chaque cellule,
compose dauditeurs et dauditeurs juniors, est pilote par un auditeur senior.
Schma n05 : Organigramme de la Direction de lAudit Interne :
(2)
Source : Circulaire BNA n1922 du 28/12/2006 ; Attribution et organisation de la direction
daudit interne.
1
Circulaire BNA n DOSI/ 150/ 06 du 24/12/2006 ; Charte de lAudit interne.
2
Annexe n14 : Organigramme de la Direction de lAudit Interne.
Directeur de
lAudit Interne
Assistant
Administratif
Assistante de
Direction
Cellule III :
Auditeur senior
Auditeurs
Auditeurs juniors
Cellule II :
Auditeur senior
Auditeurs
Auditeurs juniors
Cellule I :
Auditeur senior
Auditeurs
Auditeurs
juniors
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 114
5) La dmarche daudit interne
Puisque lAudit Interne est une fonction volutive, la Direction dAudit Interne (DAI 118)
au niveau de La Banque Nationale dAlgrie, suit tout ce qui est dactualit. En effet, elle
ralise ses missions daudit selon la nouvelle dmarche de lIFACI 2010/2011.
Cette dmarche se rsume dans les trois phases suivantes :
a) Phase de planification
Aprs rception de lordre de mission, lquipe daudit et sous la responsabilit du chef de
mission ou du directeur de la DAI, doit planifier la mission en vue dtablir le programme de
travail, selon les tapes suivantes :
Prcision des objectifs ou du primtre de la mission ;
Analyse de processus et leurs objectifs ;
Identification et valuation des risques ;
Evaluation du dispositif de contrle interne ;
Rfrentiel de contrle interne ;
Validation du rfrentiel de contrle interne ;
Slection des objectifs daudit ;
Elaboration du programme de travail, ce dernier sera valider ensuite par le chef de mission
ou le directeur daudit.
b) Phase de ralisation
La runion douverture ;
La collecte dinformations ;
Questionnaires de contrle interne ;
Les fiches dobservation (problme / constats/ causes/ consquence/ recommandations)
c) Phase de conclusion
La runion de clture ;
Validation des constats ;
Le pr-rapport ;
Synthse du rapport ;
La synthse des principales recommandations ;
Le prambule ;
Objectifs de la mission ;
Limites de la mission ;
Les aspects (constats/ recommandations) ;
Le plan daction ;
Le suivi des recommandations.
Chapitre III : Le contrle interne bancaire au niveau de la BNA 115
Conclusion
Nos banques algriennes qui sont accuses aujourdhui par un retard considrable en
matire de prvention contre les diffrents risques, doivent amliorer leurs techniques et
adapter des nouvelles politiques afin de poursuivre le dveloppement mondial et ce en
prconisant un systme de contrle interne efficace.
Le contrle interne au sein de la Banque Nationale dAlgrie se trouve tous les
niveaux :
Agence (Auto-Contrle) ;
DRE (Contrle de premier degr)
Audit Interne (contrle du second degr).
Le personnel de la banque doit, en effet, tre sensibilis de limportance de ce processus
dans la ralisation des objectifs, et la maitrise des risques inhrents lactivit bancaire.
Pour en faire la Banque (BNA), procde la mise jour puis la diffusion et la
communication de toute instruction nouvelle ayant un impact sur le bon fonctionnement du
dispositif de contrle, et ce au niveau de la DPO (Direction de la prvision et lorganisation).
Cela ne suffit pas, la banque doit complter la communication par la formation continue
de son personnel en les informant de toute actualit ou changements conomiques nationaux
et internationaux.
Chapitre IV : Audit du cycle de financement
des oprations de commerce extrieur (Comex)
par Crdit Documentaire (Credoc): Cas Agence
Principale 647 BNA
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 117
La banque exerce ses activits de commerce extrieur, dans un contexte international
incertain et affront des risques multiples. En effet, elles doivent faire face ces risques
(risques de pays, de non-remboursement et de change).
Pour se prmunir contre le risque de non-paiement de lacheteur tranger, lexportateur
peut recourir la technique du crdit documentaire qui nest pas ncessairement une
opration de crdit, mais avant tout un mode de rglement particulier au commerce
international .
Mcanisme complexe codifi par la chambre de commerce internationale (CCI), le crdit
documentaire donne lexportateur la certitude dtre pay lchance contractuelle pour
autant quil remette la banque les divers documents prvus dans louverture de crdit
documentaire son profit.
Afin de mettre en application lensemble des concepts thoriques voqus dans les
diffrents chapitres de notre travail, nous avons consacr ce chapitre ltude dun cas
pratique portant sur : Laudit du cycle de financement des oprations de commerce extrieur
par crdit documentaire (CREDOC) ; au sein de la Banque Nationale dAlgrie (BNA) : Cas
Agence principale Hamiz 647. Ce chapitre est scind en trois sections reprsentant les trois
phases fondamentales dune mission daudit interne: Phase de prparation, phase de
ralisation et enfin phase de conclusion.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 118
Suite notre entretien avec le personnel de la Direction dAudit Interne (DAI) au niveau
de la banque ; il sest avr que la mission daudit du cycle de financement des oprations de
Comex par Credoc na jamais t effectue par lquipe daudit. Pour cela nous avons pris le
soin, de choisir ce cycle comme tude de cas, afin dapporter une valeur ajoute pour la
banque et pour la direction elle-mme.
Nous allons dcomposer notre mission daudit en trois phases :
Phase de prparation ;
Phase de ralisation ;
Phase de conclusion.
Section I : La phase de prparation (planification)
Avant dentamer la mission daudit ; nous allons planifier et prparer la mission travers
llaboration dun programme daudit (plan de travail), en effectuant les tapes suivantes :
1) Ordre de mission (lettre de mission)
La lettre de mission est un pralable toute mission daudit interne ; elle indique
gnralement les lments suivants :
Lobjet ou le sujet de la mission ;
Les objectifs de la mission ;
Les entits concernes ;
La date du dbut de la mission ;
La dure de la mission ;
Le responsable et les membres de la mission.
2) Runion de prsentation
La premire prise de contact au tout dbut de la mission (souvent simple communication
tlphonique ou simple visite pour les missions courtes) se nomme runion de prsentation ou
runion de dbut de mission.
3) Objectif de la mission : primtre daudit
Lobjectif de notre mission se rsume dans laudit du cycle de financement des oprations
de commerce extrieur par crdit documentaire ; donc notre primtre de travail se limite aux
points suivants :
La domiciliation ;
Lapurement de la domiciliation ;
Louverture du crdit documentaire
Le rglement du Credoc.
4) Outils de travail
Les outils qui seront utiliss lors de la mission sont les suivants :
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 119
Observation ;
Questionnaire de prise de connaissance ;
Organigramme ;
Grille danalyse des taches ;
Rapprochement ;
Vrification ;
QCI ;
Interview ;
Confirmation.
Autres..
5) Prise de connaissance gnrale de lentit et du domaine audits
a) prsentation de lagence
Lagence Hamiz 647, est une agence principale(AP) attache la DRE 187 Alger-Est I;
lentit audite objet de notre audit a t cre le 14/02/1989 ; et a t enregistr au CNRC
dAlger centre le 17/03/1989, dont son numro de registre de commerce est : 84B178.
Elle se situe sur la route nationale n05-(Haouch El Bey) entre Rouba et elhamiz. Elle est
constitue dun immeuble compos de deux tages : (Rez de chausse + premier tage) sur
une surface de 186 m
2
et dun poste de surveillance dune surface de 22 m
2
.
Lentit comme toute agence de la BNA est structure des mmes services suscits (dans la
premire section). Elle dispose dun portefeuille client important.
b) Lorganigramme de lagence AP hamiz 647 :
(1)
Schma n06
Source : Elabor par nos soins.
1
Annexe n15: Lorganigramme de lagence AP hamiz 647
Directrice
Secrtariat
Directrice
Adjointe
Tl
compensation :
Chef de section.
Service Caisse :
-4Chefs de Section ;
-1 employe de
banque ;
-Caissier.
Engagement :
1 Charg
dtudes.
Commerce
Extrieur :
2 Chargs
dtudes.
Secrtariat
Engagement :
Chef de Service.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 120
6) Prise de connaissance du domaine audit : Le commerce extrieur au niveau de la
BNA
Les agences de la BNA interviennent dans le processus du traitement des oprations du
commerce extrieur pour louverture des domiciliations des dossiers, leur suivi, leur
apurement et galement pour louverture des dossiers crdit documentaire.
Elles exercent un autocontrle en vrifiant la conformit de lensemble des documents et
des oprations traites ses niveaux par rapport la rglementation, aux conditions de
banque et aux procdures internes.
La direction des Oprations Documentaires (DOD) procde au complment du traitement
des dossiers Credoc reus de lagence ; assure leur ralisation ; leur rglement ainsi que leur
modification ou annulation.
Elle exerce un contrle de la conformit et de lefficacit des oprations traites aux
niveaux des agences mais galement un autocontrle.
a)Questionnaire de prise de connaissance du domaine et de lentit audits : QPC
La prise de connaissance du domaine ou de lactivit auditer ne doit pas se faire dans le
dsordre, lauditeur ne pouvant prendre le risque domissions essentielles. Pour laider dans
cette dmarche dapprentissage il va donc utiliser un questionnaire, cest le questionnaire de
prise de connaissance (QPC) rcapitulant les questions importantes dont la rponse doit tre
connue si on veut avoi r une bonne comprhensi on du domai ne audi t er.
( 1)
Tableau n 06: Questionnaire de prise de connaissance du domaine et de lentit
audits : QPC
(2)
QUESTIONS Oui Non Observation
Lagence
Lagence est-elle bien situe
gographiquement par rapport aux
clients ?
x -Lagence se situe sur un axe routier, dont
la circulation de vhicules nest pas
grande.
-Lexistence dun parking.
Lagence est-elle bien situe
gographiquement par rapport aux
employs ?
x Aa cause de labsence de moyens de
transport (Bus priv ou / bus du personnel)
-Lagence est situe dans une zone isole.
-Manque de restauration.
Est-ce que lagence est propritaire ou
non ?
x
Est-ce que le lieu est scurise ?
(existence de camra de
surveillance ?)
x -Manque dagents de scurit (deux agents
ne sont pas suffisants pour assurer la
scurit du lieu et de lagence ;
-Les bureaux ne sont pas ferms cls ;
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; p227 ; 2010.
2
Annexe n16: Questionnaire de prise de connaissance de lentit audite : QPC
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 121
-Les documents sont classs dans des
armoires ouvertes (sans porte)
Est-ce que les livres lgaux sont bien
tenus ?
x
Le climat social de lentit est
conflictuel ou pas ?
x
La relation entre le client et lagence
est-elle bonne ?
x
Existe-t-il un organigramme de
lagence ?
x
Est-ce quil ya une fiche danalyse de
poste ?
x
Le systme de pointage ? est-il
respect ?
x
La rputation de lagence est-elle
bonne ?
x
Est-ce que les employs sont
polyvalents ?
x
Le degr dintgration dinformatique
est lev ou pas?
x
Est-ce que lagence est bien quipe ?
(Matriel nouveau ou vtuste ?)
x -Matriels informatiques vtustes ;
-Manque de moyens de rchauffage.
Le service Comex
Est-ce que les conditions de travail
dans le service sont bonnes ?
x
Est-ce que le nombre deffectifs dans
le service est suffisant ou pas ?
x Vu le volume des oprations traites, le
nombre deffectifs nest pas suffisant.
Est-ce que le personnel du service est
soumis des formations continues?
x
Existe-t-il un manuel de procdures ou
pas ?
x Les procdures de contrle interne sont
connues et appliques, mais il nexiste
pas un manuel utilis comme rfrence.
La politique douverture dun crdit
documentaire est-elle clairement
dfinie?
x
La dure de traitement des oprations
de la clientle est-elle toujours
respecte ?
x Ce qui favorise la bonne rputation de
lagence.
Est-ce que les documents de demande
de CREDOC, de domiciliation ainsi
que de la leve de rserve sont
formaliss ?
x La demande de la leve de rserve nest
pas formalise.
Existe-il une forme de Credoc la plus
utilise ?
x Il existe deux formes de Credoc les plus
utilises : lirrvocable et lirrvocable
et confirm.
Source : labor par nos soins.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 122
b) Les forces et les faiblesses
travers le questionnaire de prise de connaissance nous avons relevs les points forts et
les points faibles suivants :
Tableau n07 : les points forts et les points faibles
Points forts Points faibles
-Les conditions de banque existent et sont
connues des clients ;
-Des sances de sensibilisation du personnel
sur les relations avec la clientle sont
frquemment organises ;
-Les livres lgaux sont cts et paraphs par
le greffe du tribunal ;
-Le charg dtude est une personne
comptente, titulaire dun diplme
universitaire ;
-Formation continue ;
-La politique douverture dun crdit
documentaire est-elle clairement dfinie.
-La forme de CREDOC la plus utilise est le
Credoc Irrvocable ou Irrvocable et
confirm ;
-Un nouveau modle de la demande de
Credoc a t cr rcemment pour remplacer
lancien.
-Les conditions de travail dans le service ne motive pas
raliser les objectifs tracs.
-Insuffisance d'effectifs au service Comex ;
- La dure de traitement des oprations de la clientle
nest pas toujours respecte; et ce lorsque le volume des
dossiers au niveau de la DOD est grand. En cas de non-
respect pour cas de force majeur, aucune notification
nest faite l'avance au client ;
- Le client n'est pas toujours avis l'avance de la non-
excution ou d'une modification de sa demande ;
-Absence d'un manuel de procdures ;
-Dans la BNA, il existe une seule structure (D.O.D) qui
traite les oprations de Credoc, de 200 agences.
-La demande de domiciliation dimportation est
formalise ; mais le modle nest pas bien conu ;
-la demande de la leve de rserve nest pas formalise.
-La demande de Credoc est formalise ; mais le modle
nest pas bien conu ;
-Les moyens fournis ne sont pas suffisants pour le
travail; ce qui constitue un risque de non ralisation des
objectifs tracs.
Source : labor par nos soins.
c) La grille de sparation des taches
Le critre de sparation des taches constitue un des principes fondamentaux du contrle
interne (Activit de contrle). Cest un lment important pour la dtection des fonctions
incompatibles, suivantes :
excution ;
autorisation ;
enregistrement ;
contrle (vrification).
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 123
Tableau n 08 : Fiche de sparation des taches
(1)
Source : labor par nos soins.
1
Annexe n17 : Fiche de sparation des taches
La tache Le
charg
dtudes
Le
chef
de
service
Le
directeur
adjoint
La
directrice
La
DOD
DPT
contrle
DRE
Nature de
lopration
Rception des
documents
X EXECUTION
Vrification des
documents
X
x
CONTROLE
Domiciliation
dimportation
X ENREGISTREMENT
Ouverture de
Credoc
X ENREGISTREMENT
vrification de
lopration
X CONTROLE
Rectification de
lopration en
cas derreur
X CONTROLE
Validation de
lopration
X X X AUTORISATION
Perception des
commissions
douverture
X ENREGISTREMENT
Constitution de
la PREG
X ENREGISTREMENT
Contrle des
ouvertures de
Credoc
X CONTROLE
Statistiques de
fin du mois
X ENREGISTREMENT
Suivi des
domiciliations
X CONTROLE
Restitution de la
PREG
X ENREGISTREMENT
Paiement du
fournisseur par
le dbit du
compte client
X ENREGISTREMENT
Rception des
documents de
lexportateur
X EXECUTION
Enregistrement
de lopration
dans un
Registre
X ENREGISTREMENT
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 124
Commentaires
-Nous constatons que le charg dtudes cumule plusieurs taches : dtention/ contrle/ et
enregistrement ; mais ceci ne constitue pas un risque significatif puisquil est contrl par son
chef de service, par le directeur et par le DPT contrle au niveau de la DRE.
-Nous avons galement relev une autre anomalie concernant les oprations de devise et
change manuel qui sont effectus par un autre banquier ; Ce dernier, utilise le visa (sur
systme Delta V8) du charg dtude (service Comex) ce qui constitue un risque pour lagent
en cas derreur ;
7) Dtermination du rfrentiel de contrle interne
-Circulaire n1839 du 20/03/2002 (Credoc) ;
-Note n 2048.105.230 du 28.07.2002 (domiciliation)
-Rgles et usances uniformes 600.
-Rglement de la banque dAlgrie 07-01;
-Larticle 2 de linstruction Banque dAlgrie N03-07 du 31 Mai 2007
- Le rglement n 91-12 du 14 08 1991 (relatif la domiciliation des importations)
8) Identification des zones risques
Toute banque qui traite des oprations de commerce extrieur est confronte un nombre
important des risques notamment :
Risque crdit : engagement de la banque mettrice payer le fournisseur.
Risque oprationnel : de patrimoine, informatique et comptable, fraude
Risque de change : il est relatif la variation des taux de change Ce risque est support
par le client.
Risque rglementaire (de non-conformit) : sanctions de la Banque dAlgrie surtout
le retrait dagrment.
Altration de la qualit de service et de limage de la banque.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 125
Tableau n 09: Identification des zones risques
Objectifs daudit interne Objectifs du contrle interne Risques
significatifs
Domiciliation
-la demande de
domiciliation import
comporte tous les
renseignements
ncessaires
La demande douverture de domiciliation import
comportant les renseignements suivants :
-la date dtablissement de la demande ;
-le nom ou la raison sociale de limportateur;
-son numro de compte auprs de lagence;
-la nature du contrat commercial (facture, contrat
ou autres);
-les indications relatives aux marchandises
importer:
nature des produits,
montant en devises et contre valeur en
dinars;
nom du fournisseur ou vendeur;
tarifs douaniers;
origine des produits.
Risque de non
conformit
-Le prpos aux oprations
de domiciliation vrifie les
documents accompagns
de la demande suscite et
sassure de leur conformit
avec la rglementation en
vigueur
Vrification de la conformit des documents
suivants, la rglementation en vigueur :
- La demande douverture de domiciliation
doit tre dment remplie, cachete et signe
par le client ou son mandataire.
- un contrat commercial (contrat en bonne et d
forme, une facture proforma, un bon ou une
lettre de commande ferme, etc...).
-Attestation Taxe de domiciliation bancaire en
cas de revente en tat, si non un engagement en
cas de production.
Risque derreur/
risque de non-
conformit.
-Attribution du numro
dordre chronologique et
apposition le cachet de
domiciliation sur le contrat
commercial prsent par le
client.
Attribution du numro dordre chronologique et
apposition du cachet de domiciliation :
-Le prpos aux oprations de domiciliation
attribue un numro dordre chronologique de
domiciliation.
-Par la suite, il procde lapposition du cachet
de domiciliation sur le contrat commercial
prsent par le client et le renseigne selon une
codification.
Risque
oprationnel
- le cachet de domiciliation
est protg.
Le cachet de domiciliation doit tre protg. Risque de perte
-Le dlai de transmission
des documents la DOD
pour louverture de
domiciliation est respect.
Le dlai de transmission des documents la
DOD pour louverture de domiciliation doit tre
respect.
Risque pays /
risque de contre-
partie
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 126
Apurement de la domiciliation
-Lagence domiciliataire
procdera lapurement
des dossiers, aux termes de
la priode de contrle des
dossiers de domiciliation
Aux termes de la priode de contrle des
dossiers de domiciliation, lagence domiciliataire
procdera lapurement au vu des documents
suivant :
La facture dfinitive, dument domicilie ;
Document douanier exemplaire(D10) ;
Exemplaire formule (4) (CA1067) ?
Risque de la
banque dAlgrie
Etablissement des
statistiques de fin du
mois ; et suivi des dossiers
apurs, en excdent ou en
insuffisance de rglement.
Mensuellement ,et dans les deux semaines qui
suivent le mois de rfrence, les banques et les
tablissements financiers sont tenus
conformment larticle 2 de linstruction
Banque dAlgrie N03-07 du 31 Mai 2007 de
transmettre la Banque dAlgrie les
dclarations douverture et dapurement des
dossiers de domiciliation des oprations
dimportation des biens et services ainsi que les
dclarations des dossiers non apurs.
Risque
oprationnel
-larchivage des dossiers
au niveau de lagence.
les dossiers doivent tre archivs au niveau de
lagence pendant une dure de 5ans.
Risque perte (non
protection)
Ouverture de Credoc
- la domiciliation du
dossier, avant louverture
du Credoc. Art 298 du
rglement BA 07-01.
La domiciliation est pralable toute opration
douverture de Credoc.
Risque de non
conformit
-Le manuel de procdures
douverture de Credoc
existe et accessible.
-Il existe un manuel de procdure douverture de
Credoc, qui doit tre accessible.
Risque de
mauvaise
interprtation
-la politique douverture
dun Credoc est conforme
la rglementation en
vigueur et aux RUU600 ;
- la politique douverture dun Credoc seffectue
par loctroi dune demande douverture de
Credoc (Semar 205bis) ; cette demande doit tre
signe et cachete par le client et ne doit
comporter ni surcharges, ni ratures.
Risque de non
conformit
-les conditions ncessaires
pour bnficier du Credoc,
sont runies ;
-les conditions ncessaires pour bnficier du
Credoc sont :
*le client doit tre solvable ;
*le client doit disposer au pralable dun
compte courant.
Risque de non
conformit
-le client qui a bnfici du
CREDOC nest pas frapp
dune mesure
dinterdiction
limportation.
- le client qui a bnfici du CREDOC nest pas
frapp dune mesure dinterdiction
limportation ; par la consultation de la DER.
Risque de pays
-lexistence dun dossier
complet et conforme aux
normes ;
-lexistence dun dossier du client comprenant
les documents suivant :
*la facture proforma dument domicilie ;
*la demande douverture de Credoc ;
*la chemise ET7 ;
Risque de non
conformit
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 127
*autres documents.
-la conformit du
document Semar aux RUU
600 et la rglementation
en vigueur.
-la conformit du document Semar aux RUU 600
et la rglementation en vigueur :
*le prpos aux oprations de Credoc doit
vrifier les 19 clauses de la demande sils sont
conformes ;
*Il doit galement vrifier lexistence de la
mention je dgage la BNA de tous risques de
change
*Risque derreur
*Risque de change.
-le numro de
domiciliation appos sur le
contrat commercial
correspond celui du
dossier.
-le numro de domiciliation appos sur le contrat
commercial doit correspondre celui du dossier.
Risque derreur
-les dures de traitement
des dossiers, de
domiciliation et
douverture de CREDOC
sont respectes.
les dures de traitement des dossiers, de
domiciliation et douverture de CREDOC
doivent tre respectes ;
Risque
oprationnel
-Le Credoc est valid par
les 3 personnes habilites ;
-Le Credoc est valid par les 3 personnes
habilites :
*F1 : le chef de service ;
*F2 : le directeur adjoint ;
*F3 : le directeur.
Risque de
collusion
-les dates de valeur du
prlvement des
commissions sont exactes.
-les dates de valeur pour le prlvement des
commissions doivent correspondre la mme
date de la saisie du Credoc sur le systme.
Risque derreur
-le systme Delta gnre
les critures de :
*perception des
commissions ;
*constitution de la
PREG...
- le systme Delta gnre automatiquement les
critures suivantes J+2 :
* perception des commissions douverture ;
* constitution de la PREG ;
* critures dengagement.
Risque derreur
(informatique)
-lexistence dune
procdure dterminant que
lopration est rellement
effectue ;
lexistence dune procdure dterminant que
lopration est rellement effectue sur le
systme : consultation des vnements
Risque derreur
-les dlais de transmission
des statistiques de fin du
mois au DPT contrle sont
respectes ;
- les dlais de transmission des statistiques de fin
du mois au DPT contrle sont fixs avant les
10jours du mois qui suit la date douverture.
Risque dimage de
la banque.
-le suivi est effectu par
une personne ou un service
jusqu la fin de
lopration ;
- le suivi est effectu par :
*le charg dtudes ;
* la DOD ;
*le DPT contrle au niveau de la DRE jusqu
la fin de lopration.
Risque de collusion
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 128
-les dossiers des clients qui
bnficient des lignes de
crdits sont mis jour
priodiquement;
les dossiers des clients qui bnficient des lignes
de crdits sont mis jour priodiquement;
Risque
oprationnel
-La protection des dossiers
clients est assur;
-La protection des dossiers clients doit tre
assure.
Risque de perte
Rglement du Credoc :
-lexistence dune
coordination entre la DOD
et lagence lors de la
constitution et la
restitution de la PREG ;
-lexistence dune coordination entre la DOD et
lagence lors de la constitution et la restitution de
la PREG :
*Lagence transmet les copies du dossier la
DOD pour la constitution de la PREG ;
*La DOD ds rception des documents avise
lagence ;
*lagence transmet la leve de rserve la
DOD ;
*La DOD procde la restitution de la PREG
et au paiement du fournisseur.
Risque
oprationnel
- lexistence dun
document justificatif
confirmant le paiement de
lexportateur et la fin de
lopration.
lexistence dun document justificatif confirmant
le paiement de lexportateur et la fin de
lopration, appel Swift.
Risque de
contrepartie
-Les tats de suivi
permettent didentifier les
Credoc dont la date de
validit est expire.
- les tats de suivi permettent didentifier les
Credoc :
*encours ;
*solds ;
* chus.
Risque dimage de
la banque
Source : labor par nos soins.
9) Dfinition des objectifs de la mission dans le rapport dorientation
Le rapport dorientation dfinit les objectifs de la mission sous deux rubriques :
objectifs gnraux ;
objectifs spcifiques ;
a) Objectifs gnraux
Ce sont les objectifs permanents du contrle interne dont laudit doit sassurer quils sont
pris en compte et appliqus de faon efficace et pertinente.
(1)
-Fiabilit des informations ;
-Efficacit des oprations ;
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; p241 ; 2010.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 129
-Respect des lois et rglementations en vigueur ;
-Protection du patrimoine.
b) Objectifs spcifiques la mission
Ils prcisent de faon concrte les diffrents dispositifs de contrle qui vont tre tests par
les auditeurs, qui tous contribuent la ralisation des objectifs gnraux et qui tous se
rapportent aux zones risques antrieurement identifies.
(1)
Domiciliation
-La demande de domiciliation import comporte tous les renseignements ncessaires.
-Le prpos aux oprations de domiciliation vrifie les clauses de la demande suscites et
sassure de la conformit des documents avec la rglementation en vigueur.
-Apposition du cachet de domiciliation sur le contrat commercial prsent par le client
-Le cachet de domiciliation est protg.
-Le dlai de transmission des documents la DOD pour louverture de domiciliation est
respect.
-Lagence domiciliataire procdera lapurement au vu de certains documents reus.
-Etablissement des statistiques de fin du mois et suivi des dossiers apurs, en excdent ou en
insuffisance de rglement.
-Larchivage des dossiers au niveau de lagence.
Credoc
-Le manuel de procdures douverture de Credoc existe et accessible.
-La politique douverture dun Credoc est conforme la rglementation en vigueur et aux
RUU600 ;
-Le client qui a bnfici du CREDOC nest pas frapp dune mesure dinterdiction
limportation.
-Les conditions ncessaires pour bnficier du Credoc, sont runies ;
-Lexistence dun dossier complet et conforme aux normes ;
-Les dures de traitement des dossiers, de domiciliation et douverture de CREDOC sont
respectes.
-La conformit du document Semar aux RUU 600 et la rglementation en vigueur.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; p242 ; 2010.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 130
-Le numro de domiciliation appos sur le contrat commercial correspond celui du dossier.
-Le Credoc est valid par les 3 personnes habilites ;
-Le systme Delta gnre les critures de :
*perception des commissions ;
*constitution de la PREG...
-Les dates de valeur pour le prlvement des commissions sont exactes.
-Lexistence dune procdure dterminant que lopration est rellement effectue ;
-Les dlais de transmission des statistiques de fin du mois au DPT contrle sont respectes ;
-Les dossiers des clients qui bnficient des lignes de crdits sont mis jour priodiquement;
-Lexistence dun document justificatif confirmant le paiement de lexportateur et la fin de
lopration.
-Le suivi est effectu par une personne ou un service jusqu la fin de lopration ;
-Lexistence dune coordination entre la DOD et lagence lors de la constitution et la
restitution de la PREG ;
-Les tats de suivi permettent didentifier les Credoc dont la date de validit est expire.
-La protection des dossiers clients est assure;
Section II : La phase de ralisation
1) Programme daudit
On lappelle aussi Programme de vrification ou encore planning de ralisation ;
quelle que soit sa dnomination, il sagit du document interne au service et dans lequel on va
procder la dtermination et la rpartition des tches.
Ce programme daudit est tabli par lquipe en charge de la mission, sous la supervision
du chef de mission et en gnral au cours dun bref retour dans les bureaux du service.
(1)
a)Domiciliation
-Vrifier que la demande de domiciliation import comporte tous les renseignements
ncessaires ;
-Sassurer que le prpos aux oprations de domiciliation vrifie les clauses de la demande
suscites et sassure de la conformit des documents avec la rglementation en vigueur ;
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; p252 ; 2010.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 131
-Vrifier lattribution du numro dordre chronologique et apposition le cachet de
domiciliation sur le contrat commercial prsent par le client ;
-Sassurer que le cachet de domiciliation est protg ;
-Sassurer que le dlai de transmission des documents la DOD pour louverture de
domiciliation est respect ;
-Apprcier si lagence domiciliataire procdera lapurement au vu de certains documents
reus ;
-Sassurer de ltablissement des statistiques de fin du mois et suivi des dossiers apurs, en
excdent ou en insuffisance de rglement ;
-Vrifier larchivage des dossiers au niveau de lagence.
b) Credoc
-Sassurer de la domiciliation du dossier, avant louverture du Credoc. Art 29 du rglement
BA 07-01 ;
-Sassurer que le manuel de procdures douverture de Credoc existe, accessible et mis jour;
-Sassurer que la politique douverture dun Credoc est conforme la rglementation en
vigueur et aux RUU600 ; Art 46 du rglement 07-01 de la BA ;
-Vrifier la conformit du document Semar aux RUU 600 et la rglementation en vigueur ;
-Contrler si le client qui a bnfici du CREDOC nest pas frapp dune mesure
dinterdiction limportation ;
-Sassurer que les conditions ncessaires pour bnficier du Credoc, sont runies ;
-Contrler lexistence dun dossier complet et conforme aux normes ;
-Apprcier si les dures de traitement des dossiers, douverture de CREDOC sont respectes ;
-Sassurer que le numro de domiciliation appos sur le contrat commercial correspond
celui du dossier ;
-Sassurer que le Credoc est valid par les 3 personnes habilites ;
-Vrifier que le systme Delta gnre les critures de :
perception des commissions ;
constitution de la PREG...
-Estimer si les dates de valeur pour le prlvement des commissions sont exactes ;
-Vrifier lexistence dune procdure dterminant que lopration est rellement effectue ;
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 132
-Sassurer que les dlais de transmission des statistiques de fin du mois au DPT contrle sont
respectes ; larticle 2 de linstruction Banque dAlgrie N03-07 du 31 Mai 2007 ;
-Sassurer que les dossiers des clients qui bnficient des lignes de crdits sont mis jour
priodiquement ;
-Vrifier lexistence dun document justificatif confirmant le paiement de lexportateur et la
fin de lopration ;
-Apprcier si le suivi est effectu par une personne ou un service jusqu la fin de
lopration ;
-Estimer lexistence dune coordination entre la DOD et lagence lors de la constitution et la
restitution de la PREG ;
-Vrifier si les tats de suivi permettent didentifier les Credoc dont la date de validit est
expire ;
-Evaluer le degr de protection des dossiers clients.
Le tableau suivant rsume le plan de travail qui sera valid par le directeur daudit interne:
(1)
Tableau n10 : le programme de travail
Objectifs daudit interne Objectifs du contrle interne Risques Outils
Respect des lois et rglementation :
D
o
m
i
c
i
l
i
a
t
i
o
n
Vrifier que la demande de
domiciliation import comporte
tous les renseignements
ncessaires.
La demande douverture de
domiciliation import comportant les
renseignements suivants :
-la date dtablissement de la demande
-le nom ou la raison sociale de
limportateur;
-son numro de compte auprs de
lagence;
-la nature du contrat commercial
(facture, contrat ou autres);
-les indications relatives aux
marchandises importer:
nature des produits,
montant en devises et contre
valeur en dinars;
nom du fournisseur ou
vendeur;
tarifs douaniers;
origine des produits.
Risque de
non
conformit
Observation/
vrification /
QCI
1
Annexe n18: le programme de travail
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 133
Sassurer que le prpos aux
oprations de domiciliation
vrifie les documents
accompagns de la demande
suscite et sassure de leur
conformit avec la
rglementation en vigueur
Vrification de la conformit des
documents, la rglementation en
vigueur :
La demande douverture de
domiciliation doit tre dment
remplie, cachete et signe par le
client ou son mandataire.
un contrat commercial (contrat en
bonne et d forme, une facture
proforma, un bon ou une lettre de
commande ferme, etc...).
Attestation Taxe de domiciliation
bancaire en cas de revente en tat,
si non un engagement en cas de
production.
Risque
derreur/
risque de
non-
conformit.
QCI/
vrification
-vrifier lattribution du numro
dordre chronologique et
apposition le cachet de
domiciliation sur le contrat
commercial prsent par le
client.
Attribution du numro dordre
chronologique et apposition du cachet
de domiciliation :
Le prpos aux oprations de
domiciliation attribue un numro
dordre chronologique de
domiciliation.
Par la suite, il procde
lapposition du cachet de
domiciliation sur le contrat
commercial prsent par le client
et le renseigne selon une
codification.
Risque
oprationnel
Observation
/vrification
C
r
e
d
o
c
Sassurer de la domiciliation du
dossier, avant louverture du
Credoc.
-La domiciliation est pralable toute
opration douverture de Credoc. Art
29 du rglement BA 07-01.
Risque de
non
conformit
QCI
-Sassurer que la politique
douverture dun Credoc est
conforme la rglementation en
vigueur et aux RUU600 ;
- la politique douverture dun Credoc
seffectue par loctroi dune demande
douverture de Credoc (Semar
205bis) ; cette demande doit tre
signe et cachete par le client et ne
doit comporter ni surcharges, ni
ratures. Art 46 du rglement 07-01 de
la BA.
Risque de
non
conformit
QCI
-sassurer que les conditions
ncessaires pour bnficier du
Credoc, sont runies ;
-Les conditions ncessaires pour
bnficier du Credoc sont :
*le client doit tre solvable ;
*le client doit disposer au pralable
dun compte courant.
Risque de
non
conformit
Vrification/
confirmation
-contrler lexistence dun
dossier complet et conforme aux
normes ;
-lexistence dun dossier du client
comprenant les documents suivant :
*la facture proforma dument
domicilie ;
*la demande douverture de Credoc ;
*la chemise ET7 ;
Risque de
non
conformit
observation
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 134
*autres documents.
-vrifier la conformit du
document Semar aux RUU 600
et la rglementation en
vigueur.
-la conformit du document Semar aux
RUU 600 et la rglementation en
vigueur :
*le prpos aux oprations de Credoc
doit vrifier les 19 clauses de la
demande sils sont conformes ;
*Il doit galement vrifier lexistence
de la mention je dgage la BNA de
tous risques de change
*Risque
derreur
*Risque de
change.
OCI/
vrification
Fiabilit des informations :
D
o
m
i
c
i
l
i
a
t
i
o
n
/
C
r
e
d
o
c
-Le manuel de procdures
douverture de Credoc existe et
accessible.
-Il existe un manuel de procdure
douverture de Credoc, qui doit tre
accessible.
Risque de
mauvaise
interprtatio
n
Observation/
QCI
-vrifier si le client qui a
bnfici du CREDOC nest pas
frapp dune mesure
dinterdiction limportation.
- le client qui a bnfici du CREDOC
nest pas frapp dune mesure
dinterdiction limportation ; par la
consultation de la DER.
Risque de
pays
Confirmation
/ QCI
-Sassurer que le numro de
domiciliation appos sur le
contrat commercial correspond
celui du dossier.
-le numro de domiciliation appos sur
le contrat commercial correspond
celui du dossier.
Risque
derreur
Vrification
-Tester que le systme Delta
gnre les critures de :
*perception des commissions ;
*constitution de la PREG...
-Le systme Delta gnre
automatiquement les critures
suivantes J+2 :
* perception des commissions
douverture ;
* constitution de la PREG ;
* critures dengagement.
Risque
derreur
(informati-
que)
Rapproche-
ment
-Estimer si les dates de valeur
pour le prlvement des
commissions sont exactes.
-Les dates de valeur pour le
prlvement des commissions doivent
correspondre la mme date de la
saisie du Credoc sur le systme.
Risque
derreur
Rapproche-
ment
-vrifier si les dlais de
transmission des statistiques de
fin du mois au DPT contrle
sont respectes ;
-Les dlais de transmission des
statistiques de fin du mois au DPT
contrle sont fixs avant les 10jours
du mois qui suit la date douverture.
Risque
dimage de
la banque.
QCI/
Observation,
vrification
-Vrifier lexistence dun
document justificatif confirmant
le paiement de lexportateur et
la fin de lopration.
-Lexistence dun document justificatif
confirmant le paiement de
lexportateur et la fin de lopration,
appel swift.
Risque de
contrepartie
QCI
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 135
Efficacit des oprations :
D
o
m
i
c
i
l
i
a
t
i
o
n
-Sassurer que le dlai de
transmission des documents la
DOD pour louverture de
domiciliation est respect
Le dlai de transmission des
documents la DOD pour louverture
de domiciliation doit tre respect.
Risque
pays /
risque de
contre-
partie
narration
-Apprcier si lagence
domiciliataire procdera
lapurement au vu de certains
documents reus
Aux termes de la priode de contrle
des dossiers de domiciliation, lagence
domiciliataire procdera lapurement
au vu des documents suivant :
La facture dfinitive, dument
domicilie ;
Document douanier
exemplaire(D10) ;
Exemplaire formule (4)
(CA1067)
Risque de la
banque
dAlgrie
QCI
-Sassurer de ltablissement des
statistiques de fin du mois et
suivi des dossiers apurs, en
excdent ou en insuffisance de
rglement.
Mensuellement ,et dans les deux
semaines qui suivent le mois de
rfrence, les banques et les
tablissements financiers sont tenus
conformment larticle 2 de
linstruction Banque dAlgrie N03-
07 du 31 Mai 2007 de transmettre la
Banque dAlgrie les dclarations
douverture et dapurement des
dossiers de domiciliation des
oprations dimportation des biens et
services ainsi que les dclarations des
dossiers non apurs.
Risque
oprationnel
Rapproche-
ment/
vrification
C
r
e
d
o
c
-Vrifier que les dures de
traitement des dossiers,
douverture de CREDOC sont
respectes.
les dures de traitement des dossiers,
de domiciliation et douverture de
CREDOC doivent tre respectes ;
Risque
oprationnel
QCI
- sassurer que le Credoc est
valid par les 3 personnes
habilites ;
-le Credoc est valid par les 3
personnes habilites :
*F1 : le chef de service ;
*F2 : le directeur adjoint ;
*F3 : le directeur.
Risque de
collusion
Vrification
-Contrler lexistence dune
procdure dterminant que
lopration est rellement
effectue ;
lexistence dune procdure
dterminant que lopration est
rellement effectue sur le systme :
consultation des vnements
Risque
derreur
Rapproche-
ment
-Vrifier que les dossiers des
clients qui bnficient des lignes
de crdits sont mis jour
priodiquement;
les dossiers des clients qui bnficient
des lignes de crdits doivent tre mis
jour priodiquement;
Risque
oprationnel
QCI
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 136
-Vrifier quil ya un suivi
effectu par une personne ou un
service jusqu la fin de
lopration ;
- le suivi est effectu par :
*le charg dtudes ;
* la DOD ;
*le DPT contrle au niveau de la
DRE jusqu la fin de lopration.
Risque de
collusion
QCI
-Vrifier lexistence dune
coordination entre la DOD et
lagence lors de la constitution et
la restitution de la PREG ;
-lexistence dune coordination entre
la DOD et lagence lors de la
constitution et la restitution de la
PREG :
*Lagence transmet les copies du
dossier la DOD pour la constitution
de la PREG ;
* la DOD ds rception des
documents avise lagence ;
*lagence transmet la leve de
rserve la DOD ;
*La DOD procde la restitution de
la PREG et au paiement du
fournisseur.
Risque
oprationnel
Interview
-Estimer si les tats de suivi
permettent didentifier les
Credoc dont la date de validit
est expir.
- les tats de suivi permettent
didentifier les Credoc :
*encours ;
*solds ;
* chus.
Risque
dimage de
la banque
observation
Protection du patrimoine :
D
o
m
i
c
i
l
i
a
t
i
o
n
-Vrifier si le cachet de
domiciliation est bien protg.
le cachet de domiciliation doit tre
protg.
Risque de
perte
Observation
-sassurer que les dossiers sont
archivs au niveau de lagence
pendant 5ans.
les dossiers doivent tre archivs au
niveau de lagence pendant une dure
de 5ans.
Risque
perte (non
protection)
QCI
C
r
e
d
o
c
-Evaluer le degr de protection
des dossiers clients ;
-La protection des dossiers clients
doit tre assure.
Risque de
perte
Observation
Source : Elabor par nos soins.
2) La runion douverture
Lauditeur interne va, cette fois-ci sortir de son bureau , pour des travaux qui vont le
maintenir durablement au sein de lunit audite. Tout commence par une runion qui ouvre
la phase de ralisation, nomme : runion douverture (dorientation, ou de dbut des
oprations).
3) La mthode de travail
Nous allons aborder notre mission, en utilisant la mthode de sondage alatoire simple:
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 137
La population : Les dossiers de crdit documentaire et de domiciliation. Cette population est
compose des dossiers solds et des dossiers encours dans le service Comex de lagence ;
Lchantillon : Nous allons choisir un chantillon de taille n=120 ; compos de 60 dossiers
de domiciliation et les 60 dossiers de Credoc correspondants, des annes 2010 ; 2011 et 2012.
Les (Soixante) 60 dossiers de domiciliation de notre chantillon sont reprsents de la
manire suivante :
20 dossiers de lanne 2010.
35dossiers 2011.
08 dossiers 2012.
Le mme nombre est maintenu pour les dossiers des Credocs correspondants.
4) Le questionnaire de contrle Interne
Il sagit dvaluer le dispositif de contrle interne au travers de questions concernant une
organisation ou une fonction prcise, il ne saurait y avoir de questionnaires de contrle interne
gnraux, ils sont ncessairement spcifiques.
(1)
a)Questionnaire de contrle interne : Domiciliation
Tableau n 11 : Questionnaire de contrle interne : Domiciliation
(2)
Questions : Oui Non Observation
OUVERTURE DU DOSSIER DE DOMICILIATION
Rception de la demande douverture
Est-ce que la demande de domiciliation import comporte
tous les renseignements ncessaires ?
x
Si, oui est-elle cachete et signe par le client ou son
mandataire ?
x
Est-ce que le client prsente en plus de la demande de
domiciliation un contrat commercial ?
x
Vrifications de conformit
Est-ce que le prpos aux oprations de domiciliation vrifie
les documents accompagns de la demande suscite et
sassure de leur conformit avec la rglementation en
vigueur?
x
Est-ce quil procde la vrification des deux points
suivants :
-le client nest pas frapp dune mesure dinterdiction
limportation,
x
Par consultation de la
DER ; lors de
louverture de compte
client.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; p256 ; 2010.
2
Annexe n19 : Questionnaire de contrle interne : Domiciliation.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 138
-la marchandise nest pas frappe dune mesure
dinterdiction limportation. ?
Procde-t-il la vrification des clauses du contrat
commercial selon le cas de figure qui se prsente:
- numro de la facture ou rfrence du bon de
commande,
- nom et adresse du vendeur (exportateur);
- nom et adresse de lacheteur (importateur);
- adresse dexpdition ou de destination (pays de
lacheteur);
- nature et dtail de la marchandise ainsi que le
dtail du montant et du prix (avec prcision de la
nature du contrat: FOB / C&F....);
- modalits de paiement: comment doit soprer le
rglement de la marchandise importe ?
x
Dans ce cas lors de la
saisie des informations
pour la domiciliation
sur le systme; il
constate que le contrat
ne comporte pas les
mentions ncessaires ;
dans ce cas il sera
oblig de contacter le
client pour fournir un
nouveau contrat
commercial.
Dans le cas o la vrification fait apparatre que le client
nest pas habilit la domiciliation, le prpos rejette-t-il la
demande du client ?
x
Matrialisation de la domiciliation
Dans le cas ou lopration est conforme, le prpos procde-
t-il immdiatement la matrialisation de la domiciliation ?
x
Est-ce que le prpos saisit lopration de domiciliation sur
Delta V8 conformment aux instructions de la banque ?
x
Est-ce-que la confirmation de lopration passe par
drogation(DER) du directeur ou de son adjoint intrimaire
sur Delta V8 ?
x
Est-ce-que le prpos aux oprations de domiciliation
attribue un numro selon un ordre chronologique de
domiciliation ?
x
Est-ce quil appose le cachet de domiciliation sur le contrat
commercial prsent par le client ? et le renseigne selon une
codification ?
x
Mais la codification
apparait sur le contrat
remis au client aprs
apposition du cachet de
domiciliation.
Est-ce que le cachet de domiciliation est bien protg ?
x
Dans un tiroir, non ferm
cl.
Validation de la domiciliation :
Est-ce que le directeur valide lopration de la
domiciliation aprs vrification de la conformit des
documents ?
x
En raison de la
confiance faite au
charg dtudes.
Le prpos aux oprations de domiciliation sassure-t-il de la
validation de lopration ?
x
Par la consultation sur
le systme.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 139
LA GESTION DU DOSSIER DE DOMICILIATION:
Enregistrement du dossier domicili
Le prpos aux oprations de domiciliation enregistre-t-il
lacte de domiciliation sur le rpertoire des dossiers
dimportations domicilis immdiatement ? ou bien, il attend
jusqu ce quil yait un cumul de dossiers ?
x
Le prpos est jour
dans lenregistrement
des dossiers sur le
rpertoire des
domiciliations.
Lexemplaire du contrat commercial dment domicili est-il
remet ensuite au client ?
x
Etablissement de la fiche de contrle
Est-ce que le prpos aux oprations de domiciliation tablit
la fiche de contrle rglementaire, selon le cas DI ou DIP ?
x
Est-ce quil remplit ladite fiche soigneusement ? et fait
apparatre les renseignements aussi complet que possible (le
nom du fournisseur ; les modalits de paiement) ?
x
Perception de la commission douverture
Est-ce quil peroit la commission douverture ? et met le
bordereau de perception de commission (MC10) ?
x
Le systme gnre
lcriture comptable
automatiquement, aprs
la saisie du dossier.
Est-ce que les dates de valeur pour le prlvement des
commissions sont exactes ?
x
Est-ce quil vrifie sur le systme Delta V8 que les
commissions ont t rellement prleves ? et que le compte
du client a t dbit du montant ?
x
Et ce avec loption
Consultation des
vnements sur le
systme Delta V8.
Envoi la D.O.D : (Direction des Oprations
Documentaires)
Est-ce quil respecte le dlai de transmission des documents
la DOD pour louverture de domiciliation ?
x
LAPUREMMENT DE DOMICILIATION:
Premire tape : linventaire
Aux termes de la priode de contrle des dossiers de
domiciliation, est-ce que lagence domiciliataire procdera
lapurement au vu des documents suivant :
o La facture dfinitive, dument domicilie ;
o Document douanier exemplaire (D10) ;
o Exemplaire formule (4) (CA1067) ?
x
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 140
Dans le cas dun dossier complet ; est-ce que la banque
domiciliataire procdera immdiatement ltablissement du
bilan ? et donnera sa dcision finale quant au classement du
dossier de lagence ?
Dans le cas dun dossier incomplet, lagence procdera-t-elle
au rappel du client sur la rgularisation de son dossier ? ou
prendra dautres dispositions ?
x
La banque transmet une
rclamation aux Douanes
pour rcuprer le D10 ; et
la DMFE pour rcuprer
la Formule (4).
Deuxime tape : ltablissement du bilan
Est-ce que le prpos aux oprations de domiciliation vrifie
que la valeur nette transfre (VNT) est conforme la valeur
domicilie et ddouane (VD) ?
x
Est-ce quil tablit les statistiques de fin du mois ? et
effectue un suivi des dossiers apurs, en excdent ou en
insuffisance de rglement ?
x
Est-ce que la banque prendra les mesures ncessaires en cas
dapparition dexcdent ou dinsuffisance de rglement ?
x
Existe-t-il un service de contrle ? examine- t-il les dossiers
de domiciliation ?
x
Oui le dpartement
Contrle au niveau de
la DRE.
Si oui, est ce que le dlai de lenvoi des statistiques ce
service est respect ?
x
Source : Elabor par nos soins.
b) Questionnaire de contrle interne : Ouverture du Credoc
Tableau n 12 : Questionnaire de contrle interne : Ouverture du Credoc
(1)
Questions :
Oui Non Observation
LOuverture de Credoc
Le client pourra-t-il bnfici dune ligne de crdit ?
(Credoc marg X%)
x
Oui et le dossier
dautorisation de la ligne de
crdit est tenu au niveau de
service engagement.
Est-ce que le directeur dagence ou de son adjoint
renseignent pralablement une ligne de Credoc et une
autorisation plafonne avant de saisir un dossier ?
x
Les dossiers des clients qui bnficient des lignes de
crdits sont-ils-mis jour priodiquement ?
x
Existe t-il un manuel de procdures, pour les oprations
de Comex, notamment celles de louverture de Credoc ?
x
Est-ce que les dossiers sont bien organiss ? classs ? et
protgs ?
x
Les dossiers ne sont pas
bien classs, et mal
organiss, ce qui nous a
1
Annexe n20 : Questionnaire de contrle interne : Ouverture du Credoc.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 141
pos problme lors du
contrle.
Conditions :
Est-ce- que les conditions de solvabilit et de possession
dun compte sont respectes ?
x
Est-ce que la facture ou le contrat sont domicilis avant la
saisie du dossier de Credoc sur le systme?
x
Car le systme ncessite la
saisie du numro de
domiciliation lors de
louverture de Credoc.
Documents requis :
Est-ce que la demande douverture Credoc (modle
SEMAR 205-BIS) est remplie selon les termes du contrat
commercial ? cachete et sign par le client ?
x
Vrification notamment de
la mention : nous
dgageons la BNA de tous
risques de change .
Est-ce quelle ne comporte ni ratures ni surcharges ?
x
Est-elle fournit en 4 exemplaires ?
x
Trois (3) sont classes dans
le dossier du client et la
quatrime sera accuse et
remise au client.
Est-ce que la facture pro-forma ou contrat commercial (en
3 exemplaires) et les autres documents sont fournis ?
x
Rception et vrification des documents :
Est-ce que le prpos aux Credoc est celui qui reoit la
demande douverture du Credoc (Semar205bis), et les
autres documents suscits ?
x
Est-ce quil vrifie la conformit des documents prsents
par le client par rapport aux rgles et usances uniformes
et la rglementation en vigueur ?
x
Le chef de service Comex procde-t-il la
vrification du dossier, sil est conforme techniquement et
la rglementation des changes en vigueur et des rgles
et usances rgissant les crdits documentaires ?
x
Enregistrement du dossier
Est-ce que le prpos procde lenregistrement
chronologique du Credoc sur le registre pour le suivi ?
x
Les dates ne sont pas
conformes ainsi, les
montants en devises sont
enregistrs dans la case de
dinars, et dautres
informations non compltes.
Matrialisation de louverture de Credoc :
Etablissement de lET7 :
Est-ce quil ouvre une chemise ET7 (Credoc limport)
pour chaque dossier, sur laquelle sont reports les
renseignements essentiels du Credoc ?
x
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 142
Saisie de louverture du Credoc sur le systme :
Est-ce-quil procde la saisie des informations sur le
systme Delta V8, sans avoir contrl lexistence de la
provision, et la situation du client ?
x
Lorsque une des conditions douverture de Credoc nest
pas respecte ; Existe-t-il une procdure sur le systme
informatique qui signale le problme ?
x
Si, oui en cas dexistence dune faille dans le systme,
est-ce que la banque prconise dautres mesures pour
dceler lanomalie ?
x
Validation :
Est-ce que le Credoc est valid par les trois (3) personnes
habilites ? (F1, F2, F3)
x
Si la saisie prsente une ou des anomalies, est-ce il peut y
avoir une rectification ? et quelle la personne responsable
de cette rectification ?
x
La rectification est faite par
lagent qui a saisit
lopration.
Est-ce que le directeur vrifie le dossier la troisime
validation du dossier en F3 ?
x
Risque de falsification des
informations ; ou documents
non conformes.
Aprs signature du document SEMAR 205bis par le
directeur et son adjoint, le prpos procde-t-il a sa
ventilation ?
x
Existe-t-il une procdure pour vrifier que lopration est
rellement effectue ?
x
Classement des documents :
Est-ce que le prpos classe les documents dans le dossier
client ?
x
Dlgation :
Existe-t-il des dlgations accordes par la Direction en
matire dautorisation de Credoc?
x
Suivi des risques
Les tats de suivi permettent-ils didentifier les Credoc
dont la date de validit est expire ?
x
Si cest un dossier chu, il
faut aviser le client.
La constitution de la PREG est-elle effectue par une
personne (ou un service) diffrente de celle qui autorise le
Credoc ?
x
La constitution de la PREG
est effectue au niveau de la
DOD, et lautorisation est
faite par la directrice
dagence.
Avant la constitution de la PREG, le contrle sur
lexistence dun dossier et sa conformit aux normes est-
il effectu ?
x
Car lagence transmet par
courrier les copies des
documents la DOD, aprs
la saisie du dossier.
Gnration des critures de Credoc :
Ecritures dengagement ;
Commission douverture ;
Constitution de la PREG.
x
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 143
Est-ce que la date de valeur de la perception des
commissions est exacte ?
x
Rglement du CREDOC :
La restitution de la PREG est-elle faite ds de rception
des documents de lexportateur ?
x
Elle pourra tre faite aussi
par pli-cartable pour les
clients fidles, qui met une
leve de rserve pour
rglement du fournisseur.
Le paiement de lexportateur est-il effectu par le dbit du
compte client conformment aux rgles prvues dans le
contrat ?
x
Est-ce que lexportateur pourrait avoir une pice
justificative lui confirmant son paiement et la fin de
lopration ?
x
Par lmission du message
swift de rglement
Est les statistiques sont tablies chaque fin du mois ?
x
Existe-t-il un service de contrle ? examine- t-il les
dossiers de Credoc sur le fonds et la forme ?
x
Dpartement contrle au
niveau de la DRE
Si oui, est ce que le dlai de lenvoi des statistiques ce
service est respect ?
x
.
Source : Elabor par nos soins.
c) Les vrifications
La vrification des documents travers les outils prcdemment cits, nous a permis de
relever les anomalies suivantes :
Les dossiers de 2011 et de 2012 sont conformes ; mais pour les 20 dossiers de 2010, qui
reprsente le tiers (1/3) de notre chantillon, beaucoup danomalies ont t releves ; titre
dexemple:
Domiciliation
-Manque de demande de domiciliation ;
-Copie de D10 ; et le dossier a t apur (absence de loriginal du D10) ;
-Manque des pices comptables de perception des commissions ;
-Absence de lattestation de la taxe de domiciliation bancaire ;
Credoc
-Absence du cachet et la signature du client sur lET7 constitue un risque, car le client pourra
prouver la non rception des documents ;
-Les chemises ET 7 ne sont pas bien remplie (date ; n Domiciliation.) ;
-Le registre des Credocs nest pas bien tenu ; lenregistrement est chronologique ; mais les
dates ne sont pas conformes ; ainsi les montants en devise sont enregistrs dans la case de
dinars ;
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 144
-Dans certains dossiers :
Manque de documents mentionn dans le SEMAR (Certificat de qualit ; de
conformit);
Manque pices comptable (Extourne de la PREG, Ristourne.) ;
Chaque dysfonctionnement, chaque anomalie va donner lieu ltablissement dune FRAP.
5) La FRAP
On la nomme aussi Feuille de fait ou Feuille danalyse ou encore FECI ( Feuille
dvaluation du Contrle Interne )
Chaque FRAP est un document divis en cinq parties : problme, constat, causes,
consquences, recommandations (modle ci-aprs).
La FRAP est remplie par lauditeur chaque fois quil rencontre un dysfonctionnement,
une erreur, une malversation, une insuffisance bref, chaque fois quune observation rvle
un problme, une difficult.
(1)
Tableau n13 : La Feuille de rvlation et danalyse de problme:FRAP n01
(2)
Papiers de travail FRAP n01
Problme :
- Les moyens fournis ne sont pas adquats aux objectifs fixs ;
Constats :
- Les oprations de change manuel sont confies un agent hors service Comex.
Causes :
- Le nombre deffectifs dans le service est insuffisant vu le volume des oprations ;
- Les employs ne sont pas polyvalents.
- Lagent qui effectue les oprations du change manuel, utilise le visa (sur systme Delta
V8) du charg dtude (service Comex)
Consquences :
- Risque derreur.
- Risque de non atteinte des objectifs fixs.
Solution propose :
- Recruter plus de personnel dans le service commex.
Etablie par : approuve par : valide avec :
Le : le : le :
Source : labor par nos soins.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit; p268 ; 2010.
2
Annexe n21 : FRAP
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 145
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n02
Papiers de travail FRAP n02
Problme :
- Lagence ne dispose pas dun organigramme dfinissant clairement les responsabilits et
son respect effectif ;
Constats :
- Dans le cas o la saisie prsente une anomalie, la rectification est faite par celui qui a
saisi lopration ;
Causes :
Le contrle estinsuffisant ; et les responsabilits ne sont pas bien dfinies.
Consquences :
Risque de cumul de tache ;
Risque derreur ;
Risque oprationnel.
Solution propose :
-Le chef de service doit controler, et procder la rectification ;
-Elaborer un organigramme dfinissant clairement les responsabilits.
Source : labor par nos soins.
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n03
Papiers de travail FRAP n03
Problme :
Absence dun manuel de procdures de la domiciliation dans le service ;
Constats :
Les procdures sont dfinies oralement ;
Causes :
Manque de coordination entre lagence et la D.P.O( Direction de Prvisions et Organisation)
Consquences :
Risque de mauvaise interprtation.
Solution propose :
Les procdures devraient etre crites ;
Doter le service comex dun manuel de procdures.
Source : labor par nos soins.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 146
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n04
Papiers de travail FRAP n04
Problme :
La protection du patrimoine nest pas assure.
Constats :
Cachet domiciliation est mal protg
Causes :
-Manque de responsabilit ;
-Absence de moyens de protection ( coffre,)
Consquences :
-Risque de perte ;
-Risque de la banque dalgrie ;
-Risque de retrait dagrment.
Solution propose :
Protger le cachet dans un coffre, sous la supervision et la responsabilit du chef de service et
du directeur adjoint.
Source : labor par nos soins.
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n05
Papiers de travail FRAP n05
Problme :
-La troisime validation nest pas conforme aux normes.
Constats :
La directrice valide les oprations de Credoc et de domiciliation sans avoir contrl les
documents.
Causes :
La confiance qui est faite par la directrice son personnel, lincite valider lopration sans
avoir controler les documents.
Consquences :
Risque de non-conformit ;
Risque de collusion entre lemploy et le client.
Solution propose :
Vrification des documents avant toute validation.
Source : labor par nos soins.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 147
La Feuille de rvlation et danalyse de problme:FRAP n06
Papiers de travail FRAP n06
Problme :
Dossier incomplet.
Constats :
- Absence de lattestation de la taxe de domiciliation bancaire ;
- Manque des pices comptables de perception des commissions ;
- Manque de demande de domiciliation ;
Causes :
Suivi insuffisant des dossiers.
Consquences :
Risque de non-conformit.
Solution propose :
-Contacter :
le client ;
la direction des impots ;
la DOD, pour completer le dossier.
-Les pices comptables non gnrs par le systme doivent etre crites la main par le
prpos.
Source : labor par nos soins.
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n07
Papiers de travail FRAP n07
Problme :
- Absence des documents qui doivent etre reus de la DOD dans le dossier ; tels que : le BL,
la liste de colisage
Constats :
Comparaison avec le swift douverture de credoc.
Causes :
-Le prpos qui soccupait du service tait en cong, donc il a t remplac par un autre
agent qui ne maitrisait pas bien le domaine comex.
-Absence de suivi
Consquences :
Risque de non-conformit des documents.
Solution propose :
-Faire tourner le personnel, pour assurer un niveau lev de polyvalence.
-Renforcer le contrle hirarchique.
Source : labor par nos soins.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 148
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n08
Papiers de travail FRAP n08
Problme :
-Le manuel des procdures na pas t mis jour.
Constats :
La circulaire se date de lan 2002 .
Causes :
elle na pas t adapte au nouveau systme informatique Delta V8 qui a remplac la V4, en
2009.
Consquences :
Risque de non-conformit
Solution propose :
Procder la mise jour du manuel de Credoc de la BNA.
Source : labor par nos soins.
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n09
Papiers de travail FRAP n09
Problme :
- Le registre des Credocs nest pas bien tenu
Constats :
lenregistrement est chronologique ; mais les dates ne sont pas conformes ; ainsi les montants
en devise sont enregistrs dans la case de dinars ;
Causes :
-Lenregistrement nest pas jour, le prpos attend jusqu ce quil yait un cumul de
dossier pour lenregistrement,
-Absence de suivi par le chef de service.
Consquences :
-Risque derreur.
Solution propose :
Lenregistrement doit etre jour et vrifi par le chef de service et si possible, le registre doit
etre sign par le directeur adjoint chaque fin de semaine .
Source : labor par nos soins.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 149
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n10
Papiers de travail FRAP n10
Problme :
-La chemise ET 7 nest pas bien remplie et suivi.
Constats :
-Absence du cachet et de la signature du client sur lET7 (pour les dossiers de 2010).
Causes :
-Contrle insuffisant ;
Consquences :
Risque litigieux avec le client : ce dernier pourra prouver la non rception des documents ;
Solution propose :
Contacter les clients pour rgler la situation .(apposition du cahet et leur signature)
Source : labor par nos soins.
Section III : La phase de conclusion
Nous retournons notre domicilie avec lensemble des FRAP et des papiers de travail.
Pour permettre la validation gnrale, nous allons rdiger un document : cest le projet de
rapport daudit. Puis aura lieu la runion de clture et validation, do sort le rapport daudit
en son tat final et auquel il faut assurer un suivi.
1) La runion de clture
La runion finale dont il sera question au dbut de la phase trois(3) sous la dnomination
runion de clture se nomme galement :
Runion finale sur le site,
ou runion de validation gnrale.
(1)
2) Validation des constats (risques significatifs)
Cette tape sert valider lensemble des FRAP avec le service audit (Commerce
extrieur).
3) Le pr-rapport
Le rapport doit inclure les objectifs et le champ de la mission, ainsi que les conclusions,
recommandations et plans dactions.
1
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, op-cit ; p245 ; 2010.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 150
3-1) La synthse du rapport
A travers notre mission mene du 13/02/2012 au 16/02/2012, au niveau de lagence
principale Hamiz 647, plusieurs anomalies, dysfonctionnements, points faibles et points forts
ont t relevs. Cette mission est sanctionne par llaboration de ce rapport, qui a pour
objectif principal: lvaluation du dispositif de contrle interne des oprations de commerce
extrieur, plus spcifiquement les procdures de domiciliation, dapurement, douverture et de
rglement de Credoc.
3-2) La synthse des principales recommandations (recommandations/ dlai/ structure
concerne)
Tableau n 14: synthse des principales recommandations
Recommandations Structure concerne Date limite de
ralisation
Organisation :
Recruter plus de personnel au niveau de ce service,
vu le volume des oprations traites ;
Service comex 6mois
Faire tourner le personnel, pour assurer un niveau
lev de polyvalence ;
Agence 1anne
Renforcer le contrle hirarchique ; Agence Immdiatement
Les moyens ne sont pas adapts aux objectifs fixs,
donc cest au directeur dagence de ngocier les
moyens pour raliser les objectifs ;
Agence / service
comex
1 anne
Elaborer un organigramme dfinissant clairement les
responsabilits ;
Agence Immdiatement
Domiciliation/ Credoc :
Le cachet de domiciliation doit tre bien protg dans
un tiroir ferm cl ou dans le coffre de la banque ;
Service comex Immdiatement
Crer de nouvelles structures qui traitent les
oprations de Credoc : D.O.D Est ; D.O.D Ouest ;
D.O.D Centre ; et D.O.D Sud ;
La DG
_
Doter le service Comex dun manuel de procdures :
Les procdures devraient tre crites ;
La DRE / lagence. 1 mois
Procder la mise jour et ladaptation du manuel de
Credoc de la BNA au nouveau systme informatique
Delta V8.
La DPO 6 mois
Complter les dossiers de Credoc.
Service comex/ DOD 2 mois
Vrification des documents avant toute validation.
Agence Immdiatement
Le chef de service doit contrler, et procder la
rectification ;
Service comex Immdiatement
Source : Elabor par nos soins.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 151
3-3) Le prambule
Nous avons men cette mission dans le cadre dactivit du commerce extrieur porte sur
le thme: laudit du cycle de financement des oprations de Commerce extrieur par crdit
documentaire . Lors de cette mission nous avons abord les points suivants :
Domiciliation dimport ;
Apurement de domiciliation ;
Ouverture de Credoc ;
Rglement de Credoc.
Le fruit de cette mission est concrtis par llaboration de ce rapport qui rsume
lensemble des dysfonctionnements, et des forces relevs au niveau du service Comex de
lagence principale hamiz 647.
a)Objectifs de la mission
- Apprcier si les moyens fournis sont adquats aux objectifs fixs ;
- Connaitre la faon dont le service Comex est organis ;
- Vrifier que les objectifs gnraux de contrle interne sont raliss :
La rglementation en matire de domiciliation, douverture et de rglement de
Credoc est respecte;
La protection du patrimoine est assure ;
La fiabilit des informations et leur communication ;
Efficacit des oprations de domiciliation et de Credoc.
- Evaluer les procdures de contrle interne spcifiques la domiciliation, louverture et le
rglement de Credoc ;
- Apprcier le degr de maitrise du nouveau systme informatique Delta V8, au niveau du
service Comex : pour les oprations de domiciliation et de Credoc ;
- Evaluer si le contrle hirarchique est assur. Ainsi, la supervision et la dlgation des
pouvoirs sont accordes au personnel du service Comex.
b) Limites de la mission : (champ de la mission)
Notre mission sest limite aux oprations de commerce extrieur, suivantes :
Domiciliation dimportation ;
Apurement de domiciliation ;
Ouverture de Credoc ;
Rglement de Credoc.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 152
c) Les aspects : (Constats / recommandations)
Les constats :
Nous allons dcouper les constats relevs en deux parties :
Partie 1 : points forts ;
Partie 2 : points faibles.
Partie 1 : Les points forts
Lorganisation
- Le personnel est soumis des formations continues ;
- Lagence a une bonne rputation et un portefeuille clients important ;
- Le systme de pointage est respect ;
La domiciliation
- Enregistrement chronologique des dossiers sur le registre des domiciliations ;
Apurement de la domiciliation
- Rclamation, faite aux douanes en cas de non rception du D10 modle banque ; et
dclaration la banque dAlgrie ;
- Le suivi permanent des dossiers : en excdent, apurs, en insuffisance de rglement ou
chus ;
Louverture de Credoc
- Vrification de la mention : je dgage la BNA de tous risques de change ;
- Deuxime vrification faite par la DOD avant louverture du CREDOC, aprs rception
des copies des documents auprs de lagence ;
- Cration dun nouveau modle de la demande douverture de Credoc.
Le rglement du Credoc
- Paiement du fournisseur ds rception des documents ;
- Paiement du fournisseur aprs rception de la leve de rserve fournie par le client, aprs
rception des documents par pli cartable ;
- Emission du Swift de rglement transmis la banque de lexportateur, pour confirmer son
paiement et la fin de lopration.
Partie 2 : Les points faibles
Lorganisation
- Les moyens fournis ne sont pas adquats aux objectifs fixs ;
- Lagence ne dispose pas dun organigramme dfinissant clairement les responsabilits et
son respect effectif ;
- Le nombre deffectifs dans le service nest pas suffisant vu le volume des oprations ;
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 153
- Les employs ne sont pas polyvalents ;
- Les oprations de change manuel sont confies un agent hors service Comex ;
- Dans la BNA, il existe une seule structure (D.O.D) qui traite les oprations de Credoc, de
200 agences.
La domiciliation
- Absence dun manuel de procdures de la domiciliation dans le service ;
- Le cachet de domiciliation est mal protg ;
- Validation des oprations de domiciliation par la directrice sans avoir vrifier la
conformit des documents ;
- Dossier incomplet :
Absence de lattestation de la taxe de domiciliation bancaire ;
Absence de la demande de domiciliation ;
Manque des pices comptables de perception des commissions ;
- Le modle de la demande douverture de domiciliation nest pas bien conu.
Lapurement de la domiciliation
- Dossier apur sans avoir reu le D10 modle banque ; (fausse dclaration retrait
dagrment) ;
Louverture de Credoc
- Le prpos nest pas jour dans lenregistrement des Credoc sur le registre, Il attend
jusqu ce quil yait un cumul de dossiers. Les dates ne sont pas conformes et les
informations sont incompltes ;
- Dans le cas o la saisie prsente une anomalie, la rectification est faite par celui qui a saisi
lopration ;
- Validation du Credoc par la directrice sans avoir vrifier la conformit des documents ;
- Absence du cachet et la signature du client sur la chemise ET7 ;
- Manque de pices comptables dans les dossiers des clients (perception des commissions,
constitution, ) ;
Le rglement du Credoc
- La demande de la leve de rserve nest pas formalise ;
- Manque de pices comptables : (extourne, rglement du fournisseur)
- Manque de documents mentionns dans le Swift : tels que : la liste de colisage ;
Les recommandations
Les conclusions et les recommandations de laudit interne peuvent servir de base pour
lidentification et la correction des anomalies et dfaillances du systme de contrle ainsi que
lvaluation des risques lis aux objectifs de lorganisation.
(1)
1
Mmoire prsent par : Makram yaich ; Le pilotage du systme de contrle interne : dmarche, outils et rle
de lexpert-comptable ; diplme dexpertise comptable ; universit de Sfax ; 11/11/2010,p143.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 154
Dans le meilleur des cas, la recommandation est labore en collaboration avec l'entit qui
aura la charge de la mettre en uvre et fera l'objet d'un plan d'action ds la parution du
rapport.
Organisation
Recruter plus de personnel au niveau de ce service, vu le volume des oprations traites ;
Faire tourner le personnel, pour assurer un niveau lev de polyvalence ;
Renforcer le contrle hirarchique ;
Les moyens ne sont pas adapts aux objectifs fixs, donc cest au directeur dagence de
ngocier les moyens pour raliser les objectifs ;
Elaborer un organigramme dfinissant clairement les responsabilits ;
Crer demande de la leve de rserve modle BNA, pour faciliter la tche aux clients.
Domiciliation/ Credoc
Le cachet de domiciliation doit tre bien protg dans un tiroir ferm cl ou dans le
coffre de la banque ;
Crer de nouvelles structures qui traitent les oprations de Credoc : D.O.D Est ; D.O.D
Ouest ; D.O.D Centre ; et D.O.D Sud ;
Lenregistrement quotidien des dossiers sur le registre, et sa vrification par le chef de
service et si possible, sa signature par le directeur adjoint chaque fin de semaine.
Procder la mise jour et ladaptation du manuel de Credoc de la BNA au nouveau
systme informatique Delta V8.
Les pices comptables non gnres par le systme doivent tre crites la main par le
prpos.
Complter les dossiers de Credoc.
Vrification des documents avant toute validation.
Doter le service Comex dun manuel de procdures : Les procdures devraient tre
crites ;
Le chef de service doit contrler, et procder la rectification ;
4) Plan daction
Cest un simple formulaire, dessin par laudit interne, et qui permet laudit dindiquer pour
chaque recommandation, qui fera quoi et quand . Pour rpondre ces objectifs le papier joint en
fin de rapport comporte, en face de chaque recommandation lindication de la personne responsable de
la mise en uvre et le dlai dans lequel celle-ci sera entreprise et mene bonne fin.
Tableau n 15: Le plan daction
Recommandations Structure concerne Dlai de
ralisation
Organisation :
Accorder plus dimportance aux ressources humaines Agence 2 ans
Utiliser des systmes de motivation du personnel, Agence / DG 2 ans
Recruter plus de personnel au niveau de ce service,
vu le volume des oprations traites ;
Service comex 6mois
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 155
Faire tourner le personnel, pour assurer un niveau
lev de polyvalence ;
Agence 1anne
Renforcer le contrle hirarchique ; Agence Immdiatement
Dlguer des taches aux personnes comptentes et les
superviser.
Agence 3 mois
Les moyens ne sont pas adapts aux objectifs fixs,
donc cest au directeur dagence de ngocier les
moyens pour raliser les objectifs ;
Agence / service
comex
1 anne
Doter le service Comex des moyens ncessaires pour
laccomplissement de leurs travaux ;
Agence Immdiatement
Elaborer un organigramme dfinissant clairement les
responsabilits ;
Agence Immdiatement
Etablir une fiche danalyse de poste. Agence 1 mois
Crer demande de la leve de rserve modle BNA,
pour faciliter la tche aux clients.
Service comex 3 mois
Domiciliation/ Credoc :
Le cachet de domiciliation doit tre bien protg dans
un tiroir ferm cl ou dans le coffre de la banque ;
Service comex Immdiatement
Ce cachet doit tre protg sous la responsabilit du
directeur adjoint ;
Immdiatement
Crer de nouvelles structures qui traitent les
oprations de Credoc : D.O.D Est ; D.O.D Ouest ;
D.O.D Centre ; et D.O.D Sud ;
La DG
_
Doter le service Comex dun manuel de procdures :
Les procdures devraient tre crites ;
La DRE / lagence. 1 mois
Avoir plus de coordination entre la DRE et lagence,
en matire de nouvelles dispositions ou procdures
concernant les oprations de domiciliation et de
Credoc.
Service comex/ DRE Immdiatement
Lenregistrement quotidien des dossiers sur le
registre, et sa vrification par le chef de service et si
possible, sa signature par le directeur adjoint chaque
fin de semaine.
Le service comex Immdiatement
Procder la mise jour et ladaptation du manuel de
Credoc de la BNA au nouveau systme informatique
Delta V8.
La DPO 6 mois
Les pices comptables non gnrs par le systme
doivent tre crites la main par le prpos.
Service comex Immdiatement
Complter les dossiers de Credoc. Service comex/ DOD 2 mois
Prendre les mesures de contact ncessaires pour
complter les dossiers incomplets (Impts ;
Douanes ; clients ; DOD)
Service Comex /DOD 3 mois
Vrification des documents avant toute validation. Agence Immdiatement
Le chef de service doit contrler, et procder la
rectification en cas derreur ;
Service comex Immdiatement
Respecter le principe de sparation des taches. Service comex immdiatement
Source : labor par nos soins.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 156
5) Conclusion
Le service Comex est bien organis, vu lautocontrle effectu par lagent lui-mme (le
charg dtude), et le directeur adjoint ainsi que la supervision de la directrice dagence ;
Les oprations se droulent dans les normes et sont conformes aux RUU ;
Les instructions de contrle interne de la BNA sont bien respectes exception faite de
quelques points prcdemment identifis (points faibles) ;
6) Suivi des recommandations
Selon l'organisation, l'Audit Interne ou le Contrle Interne ont la charge de s'assurer que les
recommandations se traduisent par des plans d'action suivis par les entits concernes.
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 157
Conclusion
Laudit interne est une fonction dapprciation et dvaluation dont la tche essentielle est,
notamment, la validation du contrle interne.
A travers notre cas pratique, nous avons relev certains manquements et faiblesses du
dispositif du contrle interne mis en place pour le traitement des oprations du commerce
extrieur (Domiciliation et Credoc), et nous avons attir lattention des responsables travers
ltablissement des constats sur les risques pouvant affecter latteinte des objectifs du contrle
avant que ces derniers prennent de lampleur.
Ces dysfonctionnements se rsument essentiellement dans les points suivants :
- Le nombre deffectifs dans le service nest pas suffisant vu le volume des oprations ;
- Les oprations de change manuel sont confies un agent hors service Comex ;
- Dans la BNA, il existe une seule structure (D.O.D) qui traite les oprations de Credoc, de
200 agences.
- Absence dun manuel de procdures de la domiciliation dans le service ;
- Le cachet de domiciliation est mal protg ;
- Dossier incomplet :
Absence de lattestation de la taxe de domiciliation bancaire ;
Absence de la demande de domiciliation ;
Manque des pices comptables de perception des commissions ;
- Le modle de la demande douverture de domiciliation nest pas bien conu.
- Dossier apur sans avoir reu le D10 modle banque ; (fausse dclaration retrait
dagrment) ;
- Le prpos nest pas jour dans lenregistrement des Credoc sur le registre, Il attend
jusqu ce quil yait un cumul de dossiers. Les dates ne sont pas conformes et les
informations sont incompltes ;
- Dans le cas o la saisie prsente une anomalie, la rectification est faite par celui qui a saisi
lopration (Cumul de taches);
- Validation du Credoc par la directrice sans avoir vrifier la conformit des documents ;
- Manque de pices comptables dans les dossiers des clients (perception des commissions,
constitution, ) ;
- La demande de la leve de rserve nest pas formalise ;
- Manque de documents mentionns dans le Swift : tels que : la liste de colisage ; BLetc.
Pour grer ces dysfonctionnements et viter leur rapparition, nous suggrons aux
responsables ce qui suit :
Crer demande de la leve de rserve modle BNA, pour faciliter la tche aux clients.
Le cachet de domiciliation doit tre bien protg dans un tiroir ferm cl ou dans un
coffre de lagence ;
Crer de nouvelles structures qui traitent les oprations de Credoc : D.O.D Est ; D.O.D
Ouest ; D.O.D Centre ; et D.O.D Sud ;
Chapitre IV: Audit du cycle de financement des oprations de Comex par Credoc 158
Lenregistrement quotidien des dossiers sur le registre, et sa vrification par le chef de
service et si possible, sa signature par le directeur adjoint chaque fin de semaine.
Procder la mise jour et ladaptation du manuel de Credoc de la BNA au nouveau
systme informatique Delta V8.
Les pices comptables non gnres par le systme doivent tre crites la main par le
prpos.
Complter les dossiers de Credoc.
Vrification des documents avant toute validation.
Doter le service Comex dun manuel de procdures : Les procdures devraient tre
crites ;
Le chef de service doit contrler, et procder la rectification ;
Conclusion
CONCLUSIO GENERALE 160
Un systme de contrle interne efficace est une composante essentielle de la gestion dun
tablissement et constitue le fondement dun fonctionnement sr et prudent dune
organisation bancaire. Il concerne la banque dans toutes ses activits et sapplique aux biens,
aux individus et aux informations, quelles que soient les circonstances ou lpoque de lanne.
Toutefois, on ne peut contrler que ce qui est organis. En consquence, lensemble des
activits de la banque doit, au pralable, tre structur : dfinition des niveaux de contrle,
organisation rigoureuse de la fonction.
La mise en uvre du dispositif de contrle dans le secteur bancaire est clairement oriente
vers la gestion des risques, le dveloppement des dispositifs et d'une culture de contrle, et la
recherche d'efficacit et de performance.
Afin de veiller du bon fonctionnement de systme de contrle interne au niveau dune
organisation, il est recommand aux responsables de mettre en place une structure de
surveillance et de suivi de ce systme appele : Audit Interne.
Cest une activit dont la finalit est dvaluer damliorer et d'aider l'organisation
atteindre ses objectifs. C'est galement une fonction indpendante et impartiale l'intrieur de
l'organisation, gnralement rattache la direction gnrale et au service de l'ensemble des
membres de l'organisation.
En effet, l'auditeur interne, est le garant du bon fonctionnement des systmes de contrle
interne prsents au sein de l'entreprise. Son rle est de veiller ce que l'ensemble des risques
soient matriss par les oprationnels.
Dans ce mmoire qui est le fruit de notre passage au sein de diffrentes structures de la
Banque Nationale dAlgrie, nous avons essay de rpondre aux questions prcdemment
noncs dans lintroduction, en affirmant ou infirmant les hypothses proposes.
En ce qui concerne la vrification des hypothses proposes nous constatons que :
1. La dfinition du contrle interne qui aujourd'hui fait rfrence est celle du COSO, qui le
dfinit comme un processus mis en uvre par le conseil dadministration, les dirigeants et
le personnel dune organisation destin fournir une assurance raisonnable quant la
ralisation des objectifs suivants : la ralisation et loptimisation des oprations, la fiabilit
des informations financires, la conformit aux lois et aux rglementations en vigueur.
La ralisation de ces objectifs ncessite lexistence des instruments appels composantes
du contrle interne. Ces composantes sont :
Lenvironnement de contrle ;
Evaluation des risques ;
Activits de contrle ;
Information et communication ;
Pilotage.
Ce qui infirme notre premire hypothse.
CONCLUSIO GENERALE 161
2. A- Le contrle interne est laffaire de tous. Quelles soient des parties internes (personnel,
conseil dadministration.) ou externes (les auditeurs externes..) lentit. Ces deux
parties constituent lensemble des acteurs du contrle interne.
B- Le processus de mise en place dun systme de contrle interne dune activit donne,
ncessite la dfinition de la mission ; lidentification des facteurs de russite ; la connaissance
des rgles respecter . Ces trois points constituent les pralables de toute dmarche de
mise en place dudit dispositif.
Aprs avoir identifi ces pralables il appartient aux responsables de prciser le cadre de
contrle, qui est compos dun certains nombre de dispositifs. Ces dispositifs peuvent tre
regroups sous les rubriques suivantes :
Les dispositifs de pilotage
Objectifs ;
Moyens ;
Systmes dinformation.
Les dispositifs de contrle
Organisation ;
Mthodes et procdures ;
Supervision.
Et donc notre deuxime hypothse est renforce par cette rponse.
3. Lauditeur interne dispose de plusieurs outils pour accomplir sa mission, ces outils
peuvent tre classs de la manire suivante :
Outils de description :
Lobservation ;
La narration ;
Lorganigramme fonctionnel ;
La grille danalyse des taches ;
Le diagramme de circulation ;
La piste daudit.
Outils dinterrogation :
Les sondages statistiques ;
Les interviews.
Outils informatiques : logiciels
Outils mthodologiques :
Les questionnaires (check-list)
La FRAP ;
Les rapports.
Les vrifications, analyses et rapprochements divers : (confirmation par des tiers).
Nous arrivons donc, par cette rponse affirmer notre troisime hypothse.
CONCLUSIO GENERALE 162
4. Il existe plusieurs dmarche pour accomplir la mission daudit interne (Dmarche IFACI,
celle de Jacques Renardetc). mais chaque mission se dclenche par la rception dun
ordre de mission et se conclue par llaboration dun rapport daudit interne.
La mission daudit interne est rpartie en trois phases. Dabord la phase de prparation
(planification) ; ensuite la phase de ralisation et enfin la phase de conclusion.
La phase de prparation (planification) est celle la plus importante, dont lauditeur interne
doit consacrer plus de temps et dimportance avant dallers sur terrain.
Donc, En rpondant la quatrime question, nous infirmons lhypothse correspondante.
5. La Banque Nationale dAlgrie (BNA) accorde beaucoup dimportance au systme de
contrle interne, notamment aprs lobligation faite par la banque dAlgrie (Rglement
02-03 de la BA), aux banques de se doter dun systme de contrle interne. Ce dernier est
suivi tous les niveaux de la banque: Agence ; DRE ; Direction dAudit Interne comme
suit :
Le contrle effectu par lemploy au niveau de lagence quotidiennement sous la
supervision de son directeur est appel : Auto-contrle.
Le contrle effectu au niveau de la DRE (Direction du Rseau dExploitation),
constitue un contrle permanent, appel Contrle du premier degr.
Le contrle effectu par la structure dAudit Interne sous de la responsabilit de la
direction gnrale et le comit daudit, constitue un contrle ponctuel ou intermittent,
appel contrle du second degr.
De plus la BNA a cre rcemment, une nouvelle structure responsable du suivi du
systme de contrle interne et de la consolidation des reporting reus des diffrents niveaux
de contrle ; appele : Supervision de Contrle Interne (SCI).
Par cela, nous affirmons notre dernire hypothse.
Difficults de la recherche
Tout au long de la dure de recherche plusieurs difficults nous ont rencontr, telles que :
Linsuffisance du temps consacr pour llaboration de ce travail ;
Refus daffectation certaines structures de la banque ayant une relation avec le thme de
la recherche (SCI).
Recommandations
Puisque nous avons pris le soin de traiter le contrle et laudit internes au sein de la BNA,
nous recommandons aux diffrents responsables de la banque ce qui suit :
Le nombre de personnel, doit tre adquat au volume des oprations traites ;
Faire tourner le personnel, pour assurer un niveau lev de polyvalence ;
Renforcer le contrle hirarchique ;
Les moyens doivent tre adapts aux objectifs fixs, donc cest aux responsables de
ngocier les moyens pour raliser les objectifs ;
Chaque structure doit avoir un organigramme dfinissant clairement les responsabilits ;
CONCLUSIO GENERALE 163
Assurer la protection du patrimoine ;
Procder la mise jour et ladaptation des manuels de la BNA au nouveau systme
informatique Delta V8;
Vrification des documents avant toute validation ;
Procder la formation continue ;
La Direction dAudit Interne (DAI) doit accorder plus dimportance aux reportings de
premier degr ;
Assurer une coordination entre les structures du contrle de premier de degr et celles du
second degr ;
Recruter des effectifs comptents en audit interne, pour viter lexternalisation de la
fonction, et minimiser les charges correspondantes ;
Procder la formation continue ;
Avoir plus de coordination entre la DAI et la SCI (Supervision de Contrle Interne).
Perspectives de la recherche
Ce travail comporte certainement quelques insuffisances en raison des difficults
prcdemment cites. Certaines questions ambiges restent en suspens et mritent dtre
tudier. Parmi lesquels nous pourrons citer :
Le contrle interne outil de scurisation des oprations bancaires ;
Le pilotage de systme de contrle interne ;
Le contrle interne au centre de lactivit bancaire ;
Utilit de la cartographie des risques pour lauditeur interne.
Enfin, nous souhaitons que notre travail soit dune grande utilit pour tous ceux qui auront
le consulter.
Bibliographie
Bibliographie
Ouvrages
Coopers, Lybrand. La nouvelle pratique du Contrle Interne. Paris, dition d'organisation,
2002.
Dov Ogien , Comptabilit et audit bancaires 2e dition / DUNOD, Paris, 2008.
Franois Desmitch, Pratique de lactivit bancaire, Dunod, paris, 2007.
Jacques Renard , Audit interne ce qui fait dbat , Paris, , France: Maxima, 2003.
Jacques Renard ; Thorie et pratique de laudit interne, ditions eyrolles ; 2010.
Jacques Walter et Philippe Noirot ; Contrle interne - Des chiffres porteurs de sens, Afnor
editions, 2010.
Lionel Collins et Grard Valin , Audit et contrle interne, aspects financiers, oprationnels
et stratgiques, 4e dition , Dalloz1992.
Louis Vaurs - Sous la direction dlisabeth Bertin, Audit interne : enjeux et pratiques
linternational, Edition eyrolles 2007.
Ouvrage de lIFACI, la conduite dune mission daudit interne 2me dition, centre de
librairie et dditions techniques (CLET), Paris 1995.
Pierre Schick ; Prface de Serge Evraert et jacques vera ; Mmento daudit interne :
Mthode de conduite dune mission ; Dunod, Paris 2007.
Pricewaterhouse, IFACI. La pratique du Contrle Interne. Paris, dition
d'organisation,2004.
Reda Khelassi ; Laudit interne Audit oprationnel :Techniques , Mthodologie, Contrle
interne ; ditions Houma ; Alger 2007.
Robert OBERT - Marie-Pierre MAIRESSE, Comptabilit et audit Manuel et applications,
2eme dition ,DUNOD 2009.
Robert Rabelle , Le contrle interne : mettre hors risques lentreprise, Edition Hartman
1999.
Stphanie Thiry-Dubuisson, Laudit, dition la dcouverte, paris 2009.
Thses
Franck DARDENNE, Le Contrle Interne des les tablissements de crdits,
UNIVERSITE RENE DESCARTES, FACULTE DE DROIT, Pari s V, DESS
"BANQUES & FINANCES", Oct /Nov 2007.
Bibliographie
Makram yaich ; Le pilotage du systme de contrle interne : dmarche, outils et rle de
lexpert-comptable ; Mmoire pour lobtention du diplme dexpertise comptable ;
universit de Sfax ; 11/11/2010.
Mohamed Adel benhayoun sadafi,audit interne levier de performance dans les
organisations publiques ; mmoire prsent pour lobtention du diplme du cycle
suprieur de gestion, institut suprieur de commerce et dadministration des entreprises,
rabat ; 2001.
SYLVIE TACCOLA-LAPIERRE, Dispositif prudentiel BALE II, Autovaluation et
contrle interne, Universit du sud, Toulon-var, Ecole doctorale n509, Facult des
Sciences de gestion,27 Nov 2008.
Guides pratiques
Anita Campion -AMELIORER LE CONTROLE INTERNE Guide pratique lusage des
institutions de microfinance 2000
Denis Lauretou, Xavier-Yves Zanota, Les implications de Ble II pour laudit interne.
Fr. VANSTAPEL Premier Prsident de la Cour des comptes de Belgique intosai ; Lignes
directrices sur les normes de contrle interne promouvoir dans le secteur public -
Comit des normes de contrle interne.
Grgory Heem , Convention et contrle interne bancaire, dans Conventions et Sciences
de Gestion, sous la direction de M. Amblard et P. Gensse, De Boeck, version 1 - 12 Oct
2009.
Guide dvelopp par lICAEW (lInstitut des Experts Comptables dAngleterre et du Pays
de Galle) 1999.
IFACI, the institute of internal auditors, Normes daudit interne, publication oct 2008-
rvision janvier 2011.
Ineum Consulting, Etude des mtiers du contrle dans la banque.
Institut de laudit interne, Prise de position IFACI/ audit interne/qualit , mai 2004.
La pratique du contrle interne- COSO Report, Ouvrage traduit en franais par lIFACI
(Institut Franais de lAudit et du Contrles Internes) et PwC (Price waterhouseCoopers)
en 1994.
Le service gnral d'audit budgtaire et financier du Ministre de la Communaut
franaise certifi ISO 9001:2000 (ISO 9001 Pro Cert)
Bibliographie
Organisation internationale des Institutions suprieures de contrle des finances publiques
INTOSAI. Introduction au contrle interne l'intention des gestionnaires des organismes
publics.
Rafik Akli ; Les oprations de commerce extrieur, Document interne BNA.
RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE PLACE ETABLI SOUS LEGIDE DE
LAMF ; Le dispositif de Contrle Interne : Cadre de rfrence Pour information : Un
guide de mise en oeuvre du cadre de rfrence sur le contrle interne adapt aux valeurs
moyennes et petites (VaMPs).
Lois
Balle II sur le contrle Interne Bancaire ;
Circulaire BNA n1922 du 28/12/2006 ; Attribution et organisation de la direction daudit
interne ;
Circulaire BNA n 1960 du 09/09/2008 ; Contrle Interne : Contrle des oprations de
commerce extrieur ;
Circulaire BNA n 1789 du 09/09/1999 ; contrle de premier degr ;
Circulaire BNA n DOSI/ 150/ 06 du 24/12/2006 ; Charte de lAudit interne ;
Circulaire BNA n1925 du 28/01/2007 ; contrle interne : les indicateurs de suivi des
risques ;
Circulaire BNA n1926 du 28/01/2007, Reporting de contrle de premier degr au niveau
de lagence ;
Canevas type de Mission classique ; Inspection Gnrale 140 BNA , Janvier 2010 ;
Rglement 02-03 de la Banque dAlgrie ;
Sites internet
www.wikpdia.com
www.ifaci.com 'IFACI (Institut Franais de l'Audit et du Contrle Internes).
www.amf-france.org
www.bna.dz
www.Droit-Afrique.com
www.audit.cfwb.be
Rsum
Le rsum
A travers notre mmoire, nous avons vu limportance dun systme de contrle interne
efficace pour la matrise des activits et des risques bancaires, qui doit tre mis en place tous
les niveaux tant oprationnel quorganisationnel.
Laudit interne est partie intgrante du systme de contrle interne et ses interventions
organises et mthodiques en rfrence aux normes universelles en la matire lui permettent
de contribuer de faon permanente lamlioration du dispositif du contrle interne et sa
promotion au niveau de toutes les fonctions de la banque.
Les banques, doivent disposer dun systme de gestion des risques efficace afin de
prserver leur solidit financire, de continuer crotre et de se montrer dignes de la
confiance de leurs clients.
Cest dans cet ordre dides que nous avons opt pour lapplication de cet Audit Interne
un pan important de lactivit bancaire, savoir le commerce international, le crdit
documentaire en particulier ; sous la problmatique prcdemment nonce :
Quel est le rle de laudit interne dans lamlioration du dispositif de contrle
interne, dans le secteur bancaire ?
Mots cls
Les mots cls
-Contrle interne ;
-Audit interne ;
-Pilotage ;
-Coso ;
-Domiciliation ;
-Crdit Documentaire ;
-Balle II ;
-Les risques bancaires.
Annexes
Annexe n01 : Organigramme de la BNA
1/2
2/2
Annexe 02 : Lorganigramme de lagence :
Source : labor par nos soins.
Directeur
dAgence
Directeur Adjoint Secrtaire
Caisse tl
compensatio
Secrtariat
engagement
Engagement
(Crdits)
Commerce
extrieure
(Comex)
Annexe n03 : Demande de domiciliation
DEMANDE DOUVERTURE DOSSIER DOMICILIATION
Donneur dordre BANQUE NATIONALE DALGERIE
SARL
Agence . . . /
Conformment la rglementation des changes, nous vous prions douvrir un dossier
de domiciliation relatif limportation dsigne ci-aprs :
Contrat commercial (1) FACTURE .Rfrence : N
Fournisseur : montant :
Contre valeur en Dinars au cours provisoire de soit DA.
Se rapportant aux marchandises T.D. Numro
Indiqu ci-contre :
Provenance .origine
Dsignation du titre dimportationR.C. N du ..
Il est bien entendu que nous vous dgageons de toutes responsabilits quant la
position douanire de ces marchandises, vis--vis de la rglementation des changes en
vigueur.
Nous certifions sur lhonneur que nous ne possdons dans les pays trangers aucun
moyen de paiement nous permettant deffectuer sur place le rglement de cette
importation et sommes daccord pour que cette opration se dnoue sur le plan
financier suivant les normes en vigueur et dgageons la BANQUE NATIONALE
DALGERIE des risques de change ventuels pouvant en dcouler.
Nous nous engageons enfin dores et dj vous remettre aussitt aprs
ddouanement le justificatif douanier de cette opration.
SIGNATURE AUTORISEE
(1) prciser sil sagit dune
facture ou dun march.
A dtailler sil y a lieu.
Annexe n04 : Attestation Taxe de domiciliation Bancaire
Annexe n05: Engagement
-oOo- E N G A G E M E N T -oOo-
Je soussign M..
Reprsentant lgal de la Socit :
- Raison Sociale :
- Activit :
- Adresse :
- NIS :
- Fournisseur :
- Montant :
- TARIF DOUANIER :
Mengage au nom de la Socit destiner les produits,
soit ,
imports exclusivement au besoin de lexploitation de
lentreprise et de ce fait, je minterdis revendre les
produits en question en ltat.
En outre, jatteste que les quantits importes
correspondent aux capacits de production et aux moyens
humains, matriels et de stockage de la Socit.
Fait-Le .
Cachet & signature.
Annexe 06 : CA1112 :
Annexe n 07 : Formule 04 (CA 1067)
ANNEXE N08 : Demande Credoc Semar 205 bis
DEMANDE D'OUVERTURE DE CREDIT DOCUMENTAIRE
Alger le: / /
Sige
DONNEUR D'ORDRE BANQUE NATIONALE D'ALGERIE
1- . .. 2- Agence :
Rfrence du donneur d'ordre
3- Nous Vous prions d'ouvrir un Crdit documentaire REVOCABLE
4- transmettre par lettre / lettre avec pravis par cable IRREVOCABLE
5- MONTANT (en chiffre et en lettre) .. IRREVOCABLE et CONFIRME
Maximum / Environ (1)
6- Faveur: Transfrable/Non transfrable
7- Utilisation Vue ou contre acceptation de traite ..(1)
8- POUR PRESENTATION: Paiement ngociation acceptation (1)
9- AUPRES DE:
10- CONTRE REMISE DES DOCUMENTS CIDESSOUS: (1)
- Jeu Complet de connaissement "Clean on Board" tabli l'ordre de la Banque
Nationale d'Algrie Notify Ordonnateur stipulant fret
- L.T.A tabli l'adresse de la Banque Nationale d'Algrie pour compte
Ordonnateur Stipulant frt
- Facture Commerciale en exemplaires
-
-
-
11- CONCERNANT (marchandises)
Conforme Facture Pro forma du
(Mention devant figurer sur facture dfinitive)
12- VALABLE JUSQU'AU
13- AVISER FIL BENEFICIAIRE
14- SANS AJOUTER / EN AJOUTANT (1) VOTRE CONFIRMATION
15- EXPEDITION / EMBARQUEMENT JUSQU'AU PARTIELS AUTORISE/ INTERDITS
16- TRANSBORDEMENTS: - AUTORISES SUR
- INTERDITS
17- A DESTINATION DE ASSURANCE COUVERTE PAR L'ORDONNATEUR
18- TITRE D'IMPORTATION N
19- ACHAT DE DEVISE
Tous les frais rclams par la banque mettrice (BNA) sont la charge de l'ordonnateur. Tous ceux rclams
par la banque notificative sont la charge de fournisseurs.
- JE DEGAGE LA BNA DE TOUS RISQUES DE CHANGE.
De convention expresse, les documents sont affects par nous titre de gage
et de nantissement la bonne fin des avances qui rsulteront de votre paiement
ou de votre acceptation, ainsi qu'au remboursement de toute somme dont nous
serions dbiteurs envers vous pour quelque cause que se soit.
Signature du donneur d'ordre
Nous nous engageons, si l'assurance est soigne par nous, vous remettre un
Avenant sur votre demande.
Cette ouverture de crdit est soumise aux rgles et Usances Uniformes relatives
Aux crdit documentaires sous rserves de l'application des rgles et Usances
Propres aux pays qui n'auraient pas adopts les rgles et Usances Uniformes
Approuvs par la chambre de commerce internationale.
Annexe n09 : Credoc limport ET7
Annexe n 10 : Lettre douverture par V8
BANQUE NATIONALE DALGERIE
D.R.E :
Agence :
FAX :
----------------------------------------- .. le :
OUVERTURE PAR V8
D.O.D 101
Service Credoc
Objet : demande ouverture de CREDOC N CDI(100% marg)
EUR. F/.
DOM/..DU
O/SARL..
NIF :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous vous transmettons, ci-joint une demande douverture de CREDIT
DOCUMENTAIRE de notre relation SARL.
Nous vous en souhaitons bonne rception.
Cordialement.
Le charg dtudes la directrice adjointe la directrice
Annexe n11 : Swift
1/3
2/3
3/3
Source : Document interne BNA.
DIRECTION DU RESEAU D'EXPLOITATION
DGAB DPT CREDIT
DEPT
CONTROLE
DPAC
SECRETARIAT
A
n
n
e
x
e
n
1
2
:
O
r
g
a
n
i
g
r
a
m
m
e
D
R
E
B
o
u
z
a
r
a
h
.
AP CHE
GUEVARA -599-
AP TELEMLY
-602-
AP
BOUZAREAH -
627-
AP ZIROUT
YOUCEF -620-
AP
LIBERTE -
605-
Agence PORT-
SAID -628-
Agence BAB
EL OUED -629-
Agence
BOLOGHINE -
608-
Annexe 13 : rglement 02-03 de la Banque dAlgrie.
Algrie
Contrle interne des banques
et tablissements financiers
Rglement de la Banque dAlgrie n2002-03 du 14 novembre 2002
Le Gouverneur de la Banque dAlgrie,
Vu la loi n90-10 du 14 avril 1990 relative la
monnaie et au crdit modifie et complte par
lOrdonnance n01-01 du 4 Dhou El Hidja
1421correspondant au 27 Fvrier 2001, notamment
ses articles 43 bis et 44 alinas g et i ;
Vu lordonnance n75-35 du 29 avril 1975
portant Plan comptable national ;
Vu le Dcret Prsidentiel du 10 Rabie El Aouel
1422 correspondant au 02 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et Vice- Gouverneurs de
la Banque dAlgrie ;
Vu le Dcret Prsidentiel du 10 Rabie El Aouel
1422 correspondant au 02 juin 2001 portant
nomination des Membres du Conseil
dAdministration de la Banque dAlgrie ;
Vu le Dcret Prsidentiel du 10 Rabie El Aouel
1422 correspondant au 02 juin 2001 portant
nomination des Membres du Conseil de la
Monnaie et du Crdit ;
Vu le rglement n92-05 du 22 mars 1992 modifi
et complt concernant les conditions que
doivent remplir les fondateurs, les dirigeants et
reprsentants des banques et tablissements
financiers ;
Vu le rglement n92-08 du 17 novembre 1992
portant plan de comptes et rgles comptables
applicables aux banques et tablissements financiers ;
Vu le rglement n92-09 du 17 novembre 1992
relatif ltablissement, et la publication des
comptes individuels annuels des banques et
tablissements financiers ;
Vu le rglement n94-12 du 2 juin 1994 relatif
aux principes de gestion et dtablissement de
normes dans le secteur financier ;
Vu le rglement n94-18 du 25 dcembre 1994
portant comptabilisation des oprations en devises ;
Vu le rglement n95-04 du 20 avril 1995 modifiant
et compltant le rglement n91-09 du
14 Aot 1991 fixant les rgles prudentielles de
gestion des banques et des tablissements financiers
;
Vu le rglement n95-07 du 23 dcembre 1995
modifiant et remplaant le rglement n92-04
du 22 mars 1992 relatif au contrle des changes
;
Vu le rglement n95-08 du 23 dcembre 1995
relatif au march des changes ;
Vu le rglement n97-01 du 8 janvier 1997
portant comptabilisation des oprations sur titres
;
Vu les dlibrations du Conseil de la Monnaie
et du Crdit du 28 Octobre 2002
Promulgue le rglement dont la teneur suit :
Art.1.- Le prsent rglement a pour objet de dfinir
le contenu du contrle interne que les banques et
tablissements financiers doivent mettre en place,
en particulier, les systmes de mesure et danalyse
des risques et les systmes de leur surveillance et
matrise.
Art.2.- Au sens du prsent rglement, on entend
par :
Risque de crdit : risque encouru en cas de
dfaillance dune contrepartie ou des contreparties
considres comme un mme bnficiaire
au sens de larticle 2 du rglement n95-
04 modifiant et compltant le rglement n91-
09 du 14 Aot 1991 fixant les rgles prudentielles
de gestion des banques et tablissements
financiers.
Risque de taux dintrt global : risque encouru
en cas de variation des taux dintrt du fait
de lensemble des oprations de bilan et de
hors bilan, lexception, le cas chant, des
oprations soumises aux risques de march.
Risque de rglement : risque encouru, notamment,
dans les oprations de change, au cours
de la priode qui spare le moment o
linstruction de paiement dun instrument financier
vendu ne peut plus tre annule unilatralement
et la rception dfinitive de
linstrument achet.
Risque de march : il sagit de risque de taux,
de risque de variation de prix de titres de proprit,
de risque de rglement-contrepartie et
de risque de change.
Risque oprationnel : risque rsultant
dinsuffisances de conception, dorganisation
et de mise en oeuvre des procdures
denregistrement dans le systme comptable et
plus gnralement dans les systmes
dinformation de lensemble des vnements
relatifs aux oprations de la banque ou
ltablissement financier concern.
Risque juridique : risque de tout litige avec une
contrepartie rsultant de toute imprcision, lacune
ou insuffisance dune quelconque nature
susceptible dtre imputable la banque ou
ltablissement financier au titre de ses oprations.
Organe excutif : Les personnes vises
larticle 135 de la Loi relative la monnaie et
au crdit charges de la dtermination effective
de lorientation de lactivit des banques et
tablissements financiers rgulirement agres.
Organe dlibrant : Le conseil dadministration
ou le Conseil de Surveillance.
Comit daudit : Comit qui peut tre cr par
lorgane dlibrant pour lassister dans
lexercice de ses missions. Lorgane dlibrant
dfinit la composition, les modalits de son
fonctionnement et les conditions dans lesquelles
les commissaires aux comptes ainsi que
toute personne appartenant la banque ou
tablissement
financier concern sont associs
ces travaux. Lorgane dlibrant dfinit les
missions dudit Comit daudit. Celles-ci doivent,
cependant, permettre :
- de vrifier la clart des informations fournies
et de porter une apprciation sur les
mthodes comptables adoptes par la banque
ou tablissement financier concern,
- de porter une apprciation sur la qualit du
contrle interne, en particulier, la cohrence
des systmes de mesure, de surveillance
et de matrise des risques.
Art.3.- Le contrle interne que les banques et
tablissements
financiers doivent mettre en place
comprend, notamment :
un systme de contrle des oprations et des
procdures internes ;
une organisation comptable et du traitement de
linformation ;
des systmes de mesure des risques et des rsultats;
des systmes de surveillance et de matrise des
risques ;
un systme de documentation et dinformation.
Art.4.- Le contrle interne, que les banques et
tablissements
financiers doivent mettre en place en
adaptant lensemble des dispositifs prvus par le
prsent rglement, doit tre en adquation avec la
nature et le volume de leurs activits, leur taille et
leurs implantations et avec les risques de diffrentes
natures auxquels ils sont exposs.
I. Le systme de contrle des oprations
et les procdures internes
Art.5.- Le systme de contrle des oprations et
des procdures internes a pour objet, notamment,
dans les conditions optimales de scurit, de fiabilit
et dexhaustivit, de :
vrifier la conformit des oprations aux dispositions
lgislatives et rglementaires, aux
normes et usages professionnels et dontologiques
et aux orientations de lorgane dlibrant
;
vrifier le strict respect des procdures de dcision
de prises de risques de toute nature et des
normes de gestion fixes par lorgane excutif,
en particulier sil sagit de normes de gestion
sous forme de limites ;
vrifier la qualit de linformation comptable
et financire, quelle soit destine lorgane
excutif et lorgane dlibrant, transmise la
Banque dAlgrie, transmise la Commission
Bancaire ou destine tre publie ;
vrifier les conditions dvaluation,
denregistrement, de conservation et de disponibilit
de linformation comptable et financire,
en particulier, en garantissant la piste
daudit dans le cas des oprations informatises
;
vrifier la qualit des systmes dinformation
et de communication.
Art.6.- Les banques et tablissements financiers
doivent organiser leurs systmes de contrle de
faon pouvoir :
assurer un contrle rgulier avec un ensemble
de moyens mis en oeuvre en permanence dans
les units oprationnelles pour garantir la rgularit,
la scurit et la validation des oprations
ralises et le respect des autres instructions ou
orientations lies la surveillance des risques
de toute nature associes aux oprations ;
vrifier, selon une priodicit adapte, la rgularit
et la conformit des oprations, le respect
des procdures et lefficacit des dispositifs
prvus dans lalina prcdent, en particulier,
leur adquation la nature de lensemble des
risques associs aux oprations.
Art.7.- Lorganisation des banques et tablissements
financiers doit assurer la stricte indpendance
entre les units charges de lengagement
des oprations et les units charges de leur
validation,
en particulier comptable et de leur rglement
ainsi que du suivi des instructions ou des orientations
lies la surveillance des risques.
Art.8.- Lindpendance entre les units charges de
lengagement des oprations et les units charges de
leur validation peut tre organise, soit, par un
rattachement hirarchique diffrent de ces units
jusqu un niveau suffisamment lev ou par une
organisation qui garantit la sparation claire des
fonctions, soit par des procdures, en particulier
informatiques, conues dans ce but et dont les
banques et tablissements financiers sont en mesure
de justifier ladquation.
Art.9.- Les dispositifs viss larticle 6 du prsent
rglement qui vrifient, notamment, la rgularit et la
conformit des oprations, doivent fonctionner de
manire indpendante par rapport lensemble des
structures lgard desquelles ils exercent leurs
missions.
Art.10.- Les banques et tablissements financiers
doivent dsigner un responsable charg de veiller la
cohrence et lefficacit du contrle interne et qui
rend compte de lexercice de sa mission
lorgane excutif et, le cas chant, au comit
daudit. Lorgane dlibrant est tenu inform par
lorgane excutif de la dsignation de ce responsable
et des comptes rendus de ses travaux.
Lorsque la taille de la banque ou de ltablissement
financier ne justifie pas la dsignation dune personne
spcialement charge de veiller la cohrence et
lefficacit du contrle interne, lorgane excutif,
sous le contrle de lorgane dlibrant, doit assurer la
coordination de tous les dispositifs qui sont lis
lexercice de cette mission.
Art.11.- Les banques et tablissements financiers
doivent sassurer que le nombre et la qualification
des personnes qui participent au fonctionnement du
systme de contrle des oprations et des procdures
internes ainsi que les moyens mis leur disposition
en particulier les outils de suivi et les mthodes
danalyse de risques, sont adapts aux activits,
la taille et aux implantations de la banque ou de
ltablissement financier concern.
Art.12.- Les moyens affects la vrification de la
rgularit et de la conformit des oprations, du
respect des procdures et du respect des autres
instructions
ou orientations lies la surveillance des
risques de toute nature associs aux oprations,
doivent tre suffisants pour mener le cycle complet
dinvestigations relatives lensemble des activits
sur le nombre dexercices ncessaire. Un programme
des missions de contrle doit tre tabli,
au moins une fois par an, en intgrant les objectifs
annuels en matire de contrle fixs par lorgane
excutif et lorgane dlibrant.
Art.13.- Les banques et tablissements financiers
doivent sassurer que le systme de contrle des
oprations et des procdures internes soit intgr
dans lorganisation, les mthodes et les procdures
de chacune de leurs activits et que les vrifications
telles que prvues larticle 6, alina deux cidessus
sappliquent la banque ou ltablissement
financier dans son ensemble, y compris ses succursales
et agences.
Art.14.- Les systmes de mesure des risques et de
dtermination des limites doivent tre rexamins
rgulirement afin de vrifier leur performance au
regard de lvolution de lactivit, de
lenvironnement, des marchs ou des techniques
danalyse.
Art.15.- Lorsque la banque ou ltablissement
financier
dcide de raliser des oprations portant sur
de nouveaux produits pour la banque ou
ltablissement financier ou pour le march, le systme
de contrle doit permettre de sassurer :
que lanalyse spcifique des risques a t effectue
au pralable et quelle a t conduite de
manire rigoureuse,
que ladquation des procdures de mesure de
limite et de contrle des risques encourus est
effective,
que, le cas chant, les adaptations ncessaires
aux procdures en place ont t engages.
II. Lorganisation comptable et le
traitement
de linformation
Art.16.- Les banques et tablissements financiers
doivent respecter les dispositions gnrales du Plan
comptable national et les dispositions du rglement
n92-08 portant plan de comptes bancaire et rgles
comptables applicables aux banques et tablissements
financiers, en tenant compte des prcisions
ci-aprs :
1) Pour linformation comprise dans les comptes du
bilan, du hors bilan et de rsultats publis et pour les
informations de lannexe issues de la comptabilit,
lorganisation mise en place doit garantir
lexistence de lensemble des procdures, appel
piste daudit, qui permet :
de reconstituer dans lordre chronologique les
oprations ;
de justifier toute information par une pice
dorigine partir de laquelle il doit tre possible
de remonter, par un cheminement ininterrompu,
au document de synthse et rciproquement ;
dexpliquer lvolution des soldes dun arrt
lautre par la conservation des mouvements
ayant affect les postes comptables.
En particulier, les soldes des comptes qui figurent
dans le plan de comptes doivent se raccorder, par
voie directe ou par regroupement, aux postes et
sous-postes du bilan, du hors bilan et du compte de
rsultats et aux informations issues de la comptabilit
contenues dans lannexe. Le solde dun compte peut
tre raccord par clatement condition de pouvoir
justifier le respect des rgles de scurit et de
contrle adquat et que la banque ou ltablissement
financier concern dcrive la mthode utilise.
2) Pour les informations comptables qui figurent
dans les documents destins la Banque dAlgrie
ou la Commission bancaire et pour celles qui sont
ncessaires au calcul des normes de gestion, elles
doivent respecter lordre chronologique des
oprations et pouvoir tre justifies par des pices
dorigine.
Chaque montant figurant dans les situations, dans
les tableaux annexes, dans les dclarations
concernant les normes de gestion et dans les autres
documents remis la Banque dAlgrie ou la
Commission bancaire, doit tre contrlable,
notamment, partir du dtail des lments qui le
composent.
Lorsque la Banque dAlgrie ou la Commission
bancaire autorise que des informations leurs soient
fournies sous forme statistique, elles doivent tre
vrifiables.
Art.17.- Les banques et tablissements financiers
sassurent de lexhaustivit, de la qualit et de la
fiabilit des informations et des mthodes
dvaluation et de comptabilisation, notamment :
par un contrle priodique qui doit tre exerc
sur ladquation des mthodes et des paramtres
retenus pour lvaluation des oprations
dans les systmes de gestion,
par un contrle priodique qui doit tre exerc
pour sassurer de la pertinence des schmas
comptables au regard des objectifs gnraux de
scurit et de prudence, ainsi que de leur
conformit aux rgles de comptabilisation en
vigueur,
pour les oprations qui font encourir des risques
de march, par un rapprochement qui doit
tre effectu, au moins mensuellement, entre
les rsultats calculs pour la gestion oprationnelle
et les rsultats comptabiliss en respectant
les rgles dvaluation en vigueur. Les
carts constats doivent pouvoir tre identifis
et analyss.
Art.18.- Les banques et tablissements financiers
dterminent le niveau de scurit informatique jug
souhaitable par rapport aux exigences de leurs mtiers.
Ils sassurent que leurs systmes
dinformation intgrent en permanence ce minimum
de scurit retenu.
Art.19.- Le contrle des systmes dinformation
doit, notamment, permettre :
de sassurer que le niveau de scurit des systmes
dinformation est priodiquement valu
et que, le cas chant, les corrections y affrentes
sont effectues,
de sassurer que des procdures de secours
informatique sont disponibles afin dassurer la
continuit de lexploitation en cas de difficults
dans le fonctionnement des systmes informatiques.
Le contrle des systmes informatiques stend la
conservation des informations et la documentation
relative aux analyses, la programmation et
lexcution des traitements.
Art.20.- Les banques et tablissements financiers
sont tenus de conserver lensemble des fichiers
ncessaires la justification des documents du dernier
arrt remis la Banque dAlgrie et la
Commission bancaire au moins jusqu la date de
larrt suivant.
Art.21.- Les avoirs dtenus par la banque ou
ltablissement financier pour le compte des tiers
ne figurant pas dans les comptes individuels annuels
doivent faire lobjet dune comptabilit ou
dun suivi matire retraant les existants, les en-
tres et les sorties. Une rpartition est effectue, si
elle est significative, entre les lments dtenus
titre de simple dpositaire et ceux qui garantissent,
soit un crdit accord, soit un engagement pris
des fins spcifiques ou en vertu dune convention
gnrale et permanente en faveur du dposant.
III. Les systmes de mesure
des risques et des rsultats
Art.22.- Les banques et tablissements financiers
doivent mettre en place des systmes de mesure et
danalyse des risques, en les adaptant la nature et
au volume de leurs oprations, afin dapprhender
les risques de diffrentes natures auxquels ces
oprations
les exposent, notamment les risques de crdit,
de march, de taux dintrt, de liquidit et de
rglement.
A. La slection et la mesure des risques de crdit
Art.23.- Les banques et tablissements financiers
doivent disposer dune procdure de slection des
risques de crdit et dun systme de mesure de ces
risques. Ces systmes doivent leur permettre :
didentifier de manire centralise leur risques
de bilan et de hors bilan lgard dune
contrepartie ou dune contrepartie-groupe telle
que dfinie dans larticle 2 du rglement n95-
04 du 20 avril 1995 sus-vis,
dapprhender diffrentes catgories de niveaux
de risque partir dinformations qualitatives
et quantitatives conformment larticle
n7 du rglement n91-09du 14 aot 1991 susvis,
de procder la rpartition globale de leurs
engagements au profit de lensemble des
contreparties par niveau de risque encouru, par
secteur juridique et conomique et par zone
gographique.
a) Systme de slection des risques de crdit
Art.24.- Lapprciation du risque de crdit doit
notamment tenir compte des lments portant sur la
situation financire du bnficiaire, sur sa capacit de
remboursement et, le cas chant, sur des garanties
reues. En particulier, pour les entreprises,
lapprciation doit intgrer lanalyse de leur
environnement, les caractristiques des associs ou
actionnaires et des dirigeants. Elle doit tenir compte
aussi des documents comptables les plus rcents.
Les banques et tablissements financiers doivent
constituer des dossiers de crdit destins recevoir
lensemble des informations de nature qualitative et
quantitative sur une contrepartie et les informations
concernant les contreparties-groupe. Ces dossiers
sont complter au moins trimestriellement pour
les contreparties dont les crances sont impayes
ou douteuses et pour celles dont les volumes des
crances sont significatifs.
Art.25.- La slection des oprations de crdit doit
intgrer galement le critre de leur rentabilit.
Lanalyse prvisionnelle des charges et produits,
directs et indirects, doit tre la plus exhaustive
possible
pour chaque crdit et porter, notamment, sur
les cots oprationnels et de financement et sur les
cots de rmunration des fonds propres. Lanalyse
doit intgrer galement les charges correspondant
lestimation du risque de non-paiement par le
bnficiaire
au cours de lopration de crdit.
Art.26.- Lorgane excutif effectue, au moins
semestriellement,
une analyse a posteriori de la rentabilit
des oprations de crdit.
Art.27 :Les procdures de dcision doctroi de prts
ou dengagement par signature, surtout quand elles
sont organises par la fixation de dlgations, doivent
tre clairement formalises et tre adaptes
aux caractristiques de la banque et ltablissement
financier relativement sa taille, son organisation
et la nature de son activit.
Art.28.- Lorsque la nature et limportance des
oprations
de crdit le rendent ncessaire, les banques
et tablissements financiers sassurent que les
dcisions
de prts ou dengagements par signature sont
prises par au moins deux personnes et que les dossiers
de crdit font lobjet dune analyse par une
unit spcialise, indpendante des entits
oprationnelles.
b) Systme de mesure des risques de crdit
Art.29.- Les banques et tablissements financiers
doivent mettre en place un systme de mesure des
risques de crdit qui doit permettre didentifier, de
mesurer et dagrger les risques qui ressortent de
lensemble des oprations pour lesquelles la banque
ou ltablissement financier encourt le risque de
dfaillance dune contrepartie ou dune contrepartie-
groupe.
Art.30.- Les banques et tablissements financiers
doivent procder, au moins trimestriellement,
lanalyse de lvolution de la qualit de leurs
engagements
(bilan et hors bilan). Cette analyse doit
permettre de reclasser les oprations de crdit, de
comptabiliser les crances classes et de prvoir les
provisionnements y affrents en tenant compte des
garanties prises et en sassurant que leur valuation
est rcente, indpendante et prudente.
B. Systme de mesure des risques de march
Art.31.- Les banques et tablissements financiers
doivent, dans lattente de la promulgation des textes
portant sur le mode dvaluation, la mesure et la
couverture des risques de march, mettre en place
des systmes de suivi de leurs oprations effectues
sur les marchs pour leur propre compte. Ils doivent,
en particulier :
enregistrer quotidiennement les oprations de
change conformment aux dispositions du rglement
n95-08 relatif au march des changes
sus-viss ainsi que les oprations portant sur
leur portefeuille de ngociation et calculer
leurs rsultats,
mesurer leur exposition au risque de change
par devise et pour lensemble des devises.
C. Systme de mesure du risque de taux
dintrt
Art.32.- Les banques et tablissements financiers
doivent, dans lattente de la promulgation des textes
portant sur la mesure et la couverture des risques
de taux dintrt, satteler mettre en place un
systme dinformation interne permettant
dapprhender le risque de taux dintrt, dassurer
son suivi et de prvoir les correctifs en cas
dexposition juge significative ce type de risques.
D. Le systme de mesure du risque de rglement
Art.33.- Les banques et tablissements financiers
doivent mettre en place un systme de mesure de
leur exposition au risque de rglement, plus
particulirement au risque de rglement dans les
oprations de change. Ils veillent apprhender les
diffrentes phases du processus de rglement.
IV. Les systmes de surveillance et de
matrise des risques
Art.34.- Les banques et tablissements financiers
doivent mettre en place des systmes de surveillance
et de matrise des risques de crdit, de taux
dintrt, de taux de change, de liquidit et de
rglement
faisant apparatre les limites internes et les
conditions dans lesquelles ces limites sont respectes.
Ils doivent aussi se doter de moyens adapts
la matrise des risques oprationnels et juridiques.
Art.35.- Les systmes de surveillance et de matrise
des risques de crdit, de taux de change et de
liquidit doivent comporter un dispositif de limites
globales internes. Ces limites sont revues autant
que ncessaire, au moins une fois par an par
lorgane excutif et, le cas chant, par lorgane
dlibrant, en tenant compte, des fonds propres de
la banque ou de ltablissement financier concern.
Les limites oprationnelles qui peuvent tre fixes
au niveau de diffrentes entits organiques internes
(directions, agences, succursales,), doivent tre
en cohrence avec les limites globales. La
dtermination
des diffrentes limites, globales et oprationnelles,
doit tre effectue de faon homogne
par rapport aux systmes de mesure des risques en
place.
Les systmes de surveillance et de matrise des
risques de taux dintrt et de rglement doivent, au
dpart, comporter des systmes de suivi pour
apprhender
correctement ces risques de faon passer,
par la suite, des systmes de limites au moins
oprationnelles dans le cas de difficult de fixation
de limites globales.
Art.36.- Les banques et tablissements financiers,
mandats, sur leur demande, par la Banque
dAlgrie pour exercer, par dlgation de pouvoir,
le contrle des changes, doivent se doter dun systme
de contrle interne permettant de sassurer en
permanence du suivi des oprations de commerce
extrieur.
Le dispositif mettre en place, conformment au
rglement n95-07 sus-vis, doit permettre :
de sassurer de la traabilit et de lapurement
rgulier et temps des dossiers de domiciliation
ouverts ;
de veiller au dnouement des oprations avant
remise des comptes rendus ;
de sassurer de la stricte adquation entre les
flux financiers et les flux des biens et des services
entre lAlgrie et le reste du monde.
Art.37.- Les banques et tablissements financiers
doivent veiller la bonne tenue du fichier et de
lchancier de la dette extrieure de leur clientle
et de celle contracts pour leur propre compte.
Art.38.- Les banques et tablissements financiers
doivent se doter de dispositifs, suivant des procdures
formalises, permettant :
de sassurer en permanence du respect des
procdures
et des limites fixes,
de procder lanalyse des causes du nonrespect
ventuel des procdures et des limites,
dinformer les entits ou les personnes dsignes
cet effet de lampleur des dpassements
et des actions correctrices proposes ou
entreprises.
Dans le cas ou les limites sont reparties par entits
organiques internes, et o ces limites risquent
dtre atteintes, les procdures formalises doivent
permettre aux entits concernes den rfrer au
niveau hirarchique appropri.
Art.39.- Pour les besoins de la surveillance de leurs
oprations et dinformation de lorgane excutif, de
lorgane dlibrant et, le cas chant, du comit
daudit, les banques et tablissements financiers
doivent laborer des tats de synthse appropris.
V. Le systme dinformation
et de documentation
Art.40.- Lorgane dlibrant de la banque ou de
ltablissement financier procde au moins deux
fois par an lexamen de lactivit et des rsultats
du contrle interne sur la base des informations qui
lui sont transmises par lorgane excutif et par le
responsable vis larticle 10 et, le cas chant, par
le comit daudit.
Dans le cas de lexistence dun comit daudit, cet
examen peut tre fait une fois par an.
Art.41.- Lorgane excutif informe rgulirement
lorgane dlibrant et, le cas chant, le comit
daudit, sur les lments essentiels et sur les
enseignements
principaux qui peuvent se dgager de la
mesure des risques auxquels la banque ou
ltablissement financier est expos. Cette
information
porte, notamment, sur la rpartition des engagements
par ensembles de contreparties et sur la
rentabilit des oprations de crdit comme indiqu
dans larticle 25 du prsent rglement.
Art.42.- Dans le cas o lorgane dlibrant nest
pas associ la fixation des limites, lorgane excutif
doit linformer et informer, le cas chant, le
comit daudit, des dcisions prises en la matire.
Lorgane excutif doit informer lorgane dlibrant,
au moins une fois par an, des conditions dans
lesquelles
les limites fixes sont respectes.
Art.43.- Les banques et tablissements financiers
laborent les manuels de procdures affrents
leurs diffrentes activits. Ces manuels doivent
dcrire, au minimum, les modalits
denregistrement, de traitement et de restitution des
informations, les schmas comptables et les
procdures
dengagement des oprations.
Ils tablissent galement une documentation prcisant
les moyens destins assurer le bon fonctionnement
du contrle interne, notamment :
les diffrents niveaux de responsabilit,
les attributions dvolues et les moyens affects
au fonctionnement des dispositifs de contrle
interne,
les rgles assurant lindpendance de ces dispositifs,
les procdures relatives la scurit des systmes
dinformation et de communication,
une description des systmes de mesure des
risques,
une description des systmes de surveillance et
de matrise des risques.
Cette documentation doit tre mise, leur demande,
la disposition de lorgane excutif, de
lorgane dlibrant, des commissaires aux compte,
des inspecteurs de la Banque dAlgrie et le cas
chant du comit daudit.
Art.44.- Les rapports tablis la suite des contrles
effectus au titre de la vrification de la rgularit
et de la conformit des oprations, du respect des
procdures et de lefficacit des dispositifs
garantissant
la rgularit, la scurit et la validation des
oprations ralises, sont communiqus lorgane
excutif et, sa demande, lorgane dlibrant et,
le cas chant, au comit daudit.
Art.45.- Les banques et tablissements financiers
laborent, au moins une fois par an, un rapport sur
les conditions dans lesquelles le contrle interne est
assur. Ce rapport comprend, notamment :
un inventaire des enqutes ralises et des
principaux enseignements tirs, en particulier,
les principales insuffisances releves et les mesures
correctives prises,
une description des modifications significatives
ralises dans le domaine de contrle interne
au cours de la priode en revue,
une description des conditions dapplication
des procdures mises en place pour les nouvelles
activits,
Source : www.Droit-Afrique.com
la prsentation des principales actions envisages
dans le domaine du contrle interne.
Art.46.- Les banques et tablissements financiers
laborent, au moins une fois par an, un rapport sur
la mesure et la surveillance des risques auxquels ils
sont exposs. Ce rapport comprend, notamment, les
lments essentiels et les principaux enseignements
qui peuvent se dgager de la mesure des risques
auxquels ils sont exposs, la slection des risques
de crdit ainsi que lanalyse de la rentabilit des
oprations de crdit.
Art.47.- Les deux rapports annuels prvus dans les
articles 45 et 46 ci-dessus sont communiqus
lorgane dlibrant et, le cas chant, au comit
daudit. Ils sont adresss la Commission bancaire
et mis la disposition des commissaires aux comptes.
Art.48.- Le prsent Rglement sera publi au Journal
Officiel de la Rpublique Algrienne Dmocratique
et Populaire.
Annexe n 14 : Organigramme de la Direction de lAudit Interne :
Source : Charte daudit interne (BNA)
Directeur de
lAudit Interne
Assistant
Administratif
Assistante de
Direction
Cellule III :
Auditeur senior
Auditeurs
Auditeurs juniors
Cellule II :
Auditeur senior
Auditeurs
Auditeurs juniors
Cellule I :
Auditeur senior
Auditeurs
Auditeurs
juniors
Annexe n 15 : Lorganigramme de lagence AP hamiz 647 :
Source : labor par nos soins.
Directrice
Secrtariat
Directrice
Adjointe
Secrtariat
Engagement :
Chef de Service.
Commerce
Extrieur :
2 Chargs
dtudes.
Engagement :
1Charg
dtudes.
Service Caisse :
-4Chefs de Section ;
-1 employe de
banque ;
-Caissier.
Tl
compensation :
Chef de section.
Annexe n16:Questionnaire de prise de connaissance de lentit audite : QPC
QUESTIONS Oui Non Observation
Lagence
Lagence est-elle bien situe
gographiquement ?
Est-ce que lagence est propritaire ou
non ?
Est-ce que le lieu est scurise ? (existence
de camra de surveillance ?)
Est-ce que les livres lgaux sont bien
tenus ?
Le climat social de lentit est conflictuel
ou pas ?
La relation entre le client et lagence est-
elle bonne ?
Existe-t-il un organigramme de lagence ?
Est-ce quil ya une fiche danalyse de
poste ?
Le systme de pointage ? est-il respect ?
La rputation de lagence est-elle bonne ?
Est-ce que les employs sont polyvalents ?
Le degr dintgration dinformatique est
lev ou pas?
Est-ce que lagence est bien quipe ?
(Matriel nouveau ou vtuste ?)
Le service Comex
Est-ce que le nombre deffectifs dans le
service est suffisant ou pas ?
Est-ce que le personnel du service est
soumis des formations continues?
Existe-t-il un manuel de procdures ou
pas ?
Est-ce-que la politique douverture de
domiciliation est clairement dfinie ?
La politique douverture dun crdit
documentaire est-elle aussi clairement
dfinie?
La dure de traitement des oprations de la
clientle est-elle toujours respecte ?
Est-ce que les documents de demande de
CREDOC, de domiciliation ainsi que de la
leve de rserve sont formaliss ?
Existe-il une forme de Credoc la plus
utilise ?
Source : labor par nos soins.
Annexe n 17: Fiche de sparation des taches :
La tache Le
charg
dtudes
Le
chef
de
service
Le
directeur
adjoint
La
directrice
La
DOD
DPT
contrle
DRE
Nature de
lopration
Rception des
documents
DETENTION
Vrification
des documents
CONTROLE
Domiciliation
dimportation
ENREGISTREMENT
Ouverture de
Credoc
ENREGISTREMENT
Autorisation de
lopration
AUTORISATION
Validation de
lopration
AUTORISATION
Perception des
commissions
douverture
ENREGISTREMENT
Constitution de
la PREG
ENREGISTREMENT
Contrle des
ouvertures de
Credoc
CONTROLE
Statistiques de
fin du mois
ENREGISTREMENT
Suivi des
domiciliations
CONTROLE
Restitution de
la PREG
ENREGISTREMENT
Paiement du
fournisseur par
le dbit du
compte client
ENREGISTREMENT
Rception des
documents de
lexportateur
DETENTION
Enregistrement
de lopration
dans un
Registre
ENREGISTREMENT
Annexe n18 : le programme de travail.
Objectifs daudit interne Objectifs du contrle interne Risques Outils
Respect des lois et rglementation :
D
o
m
i
c
i
l
i
a
t
i
o
n
Vrifier que la demande de
domiciliation import comporte
tous les renseignements
ncessaires.
La demande douverture de
domiciliation import comportant les
renseignements suivants :
-la date dtablissement de la demande
-le nom ou la raison sociale de
limportateur;
-son numro de compte auprs de
lagence;
-la nature du contrat commercial
(facture, contrat ou autres);
-les indications relatives aux
marchandises importer:
nature des produits,
montant en devises et contre
valeur en dinars;
nom du fournisseur ou
vendeur;
tarifs douaniers;
origine des produits.
Risque de
non
conformit
Observation/
vrification /
QCI
Sassurer que le prpos aux
oprations de domiciliation
vrifie les documents
accompagns de la demande
suscite et sassure de leur
conformit avec la
rglementation en vigueur
Vrification de la conformit des
documents, la rglementation en
vigueur :
La demande douverture de
domiciliation doit tre dment
remplie, cachete et signe par le
client ou son mandataire.
un contrat commercial (contrat en
bonne et d forme, une facture
proforma, un bon ou une lettre de
commande ferme, etc...).
Attestation Taxe de domiciliation
bancaire en cas de revente en tat,
si non un engagement en cas de
production.
Risque
derreur/
risque de
non-
conformit.
QCI/
vrification
-vrifier lattribution du numro
dordre chronologique et
apposition le cachet de
domiciliation sur le contrat
commercial prsent par le
client.
Attribution du numro dordre
chronologique et apposition du cachet
de domiciliation :
Le prpos aux oprations de
domiciliation attribue un numro
dordre chronologique de
domiciliation.
Risque
oprationnel
Observation
/vrification
Par la suite, il procde
lapposition du cachet de
domiciliation sur le contrat
commercial prsent par le client
et le renseigne selon une
codification.
C
r
e
d
o
c
Sassurer de la domiciliation du
dossier, avant louverture du
Credoc.
-La domiciliation est pralable toute
opration douverture de Credoc. Art
29 du rglement BA 07-01.
Risque de
non
conformit
QCI
-Sassurer que la politique
douverture dun Credoc est
conforme la rglementation en
vigueur et aux RUU600 ;
- la politique douverture dun Credoc
seffectue par loctroi dune demande
douverture de Credoc (Semar
205bis) ; cette demande doit tre
signe et cachete par le client et ne
doit comporter ni surcharges, ni
ratures. Art 46 du rglement 07-01 de
la BA.
Risque de
non
conformit
QCI
-sassurer que les conditions
ncessaires pour bnficier du
Credoc, sont runies ;
-Les conditions ncessaires pour
bnficier du Credoc sont :
*le client doit tre solvable ;
*le client doit disposer au pralable
dun compte courant.
Risque de
non
conformit
Vrification/
confirmation
-contrler lexistence dun
dossier complet et conforme aux
normes ;
-lexistence dun dossier du client
comprenant les documents suivant :
*la facture proforma dument
domicilie ;
*la demande douverture de Credoc ;
*la chemise ET7 ;
*autres documents.
Risque de
non
conformit
observation
-vrifier la conformit du
document Semar aux RUU 600
et la rglementation en
vigueur.
-la conformit du document Semar aux
RUU 600 et la rglementation en
vigueur :
*le prpos aux oprations de Credoc
doit vrifier les 19 clauses de la
demande sils sont conformes ;
*Il doit galement vrifier lexistence
de la mention je dgage la BNA de
tous risques de change
*Risque
derreur
*Risque de
change.
OCI/
vrification
Fiabilit des informations :
D
o
m
i
c
i
l
i
a
t
i
o
n
/
C
r
e
d
o
c
-Le manuel de procdures
douverture de Credoc existe et
accessible.
-Il existe un manuel de procdure
douverture de Credoc, qui doit tre
accessible.
Risque de
mauvaise
interprtatio
n
Observation/
QCI
-vrifier si le client qui a
bnfici du CREDOC nest pas
frapp dune mesure
dinterdiction limportation.
- le client qui a bnfici du CREDOC
nest pas frapp dune mesure
dinterdiction limportation ; par la
consultation de la DER.
Risque de
pays
Confirmation
/ QCI
-Sassurer que le numro de
domiciliation appos sur le
contrat commercial correspond
celui du dossier.
-le numro de domiciliation appos sur
le contrat commercial correspond
celui du dossier.
Risque
derreur
Vrification
-Tester que le systme Delta
gnre les critures de :
*perception des commissions ;
*constitution de la PREG...
-Le systme Delta gnre
automatiquement les critures
suivantes J+2 :
* perception des commissions
douverture ;
* constitution de la PREG ;
* critures dengagement.
Risque
derreur
(informati-
que)
Rapproche-
ment
-Estimer si les dates de valeur
pour le prlvement des
commissions sont exactes.
-Les dates de valeur pour le
prlvement des commissions doivent
correspondre la mme date de la
saisie du Credoc sur le systme.
Risque
derreur
Rapproche-
ment
-vrifier si les dlais de
transmission des statistiques de
fin du mois au DPT contrle
sont respectes ;
-Les dlais de transmission des
statistiques de fin du mois au DPT
contrle sont fixs avant les 10jours
du mois qui suit la date douverture.
Risque
dimage de
la banque.
QCI/
Observation,
vrification
-Vrifier lexistence dun
document justificatif confirmant
le paiement de lexportateur et
la fin de lopration.
-Lexistence dun document justificatif
confirmant le paiement de
lexportateur et la fin de lopration,
appel swift.
Risque de
contrepartie
QCI
Efficacit des oprations :
D
o
m
i
c
i
l
i
a
t
i
o
n
-Sassurer que le dlai de
transmission des documents la
DOD pour louverture de
domiciliation est respect
Le dlai de transmission des
documents la DOD pour louverture
de domiciliation doit tre respect.
Risque
pays /
risque de
contre-
partie
narration
-Apprcier si lagence
domiciliataire procdera
lapurement au vu de certains
documents reus
Aux termes de la priode de contrle
des dossiers de domiciliation, lagence
domiciliataire procdera lapurement
au vu des documents suivant :
La facture dfinitive, dument
domicilie ;
Document douanier
exemplaire(D10) ;
Exemplaire formule (4)
(CA1067)
Risque de la
banque
dAlgrie
QCI
-Sassurer de ltablissement des
statistiques de fin du mois et
suivi des dossiers apurs, en
excdent ou en insuffisance de
rglement.
Mensuellement ,et dans les deux
semaines qui suivent le mois de
rfrence, les banques et les
tablissements financiers sont tenus
conformment larticle 2 de
linstruction Banque dAlgrie N03-
Risque
oprationnel
Rapproche-
ment/
vrification
07 du 31 Mai 2007 de transmettre la
Banque dAlgrie les dclarations
douverture et dapurement des
dossiers de domiciliation des
oprations dimportation des biens et
services ainsi que les dclarations des
dossiers non apurs.
C
r
e
d
o
c
-Vrifier que les dures de
traitement des dossiers,
douverture de CREDOC sont
respectes.
les dures de traitement des dossiers,
de domiciliation et douverture de
CREDOC doivent tre respectes ;
Risque
oprationnel
QCI
- sassurer que le Credoc est
valid par les 3 personnes
habilites ;
-le Credoc est valid par les 3
personnes habilites :
*F1 : le chef de service ;
*F2 : le directeur adjoint ;
*F3 : le directeur.
Risque de
collusion
Vrification
-Contrler lexistence dune
procdure dterminant que
lopration est rellement
effectue ;
lexistence dune procdure
dterminant que lopration est
rellement effectue sur le systme :
consultation des vnements
Risque
derreur
Rapproche-
ment
-Vrifier que les dossiers des
clients qui bnficient des lignes
de crdits sont mis jour
priodiquement;
les dossiers des clients qui bnficient
des lignes de crdits sont mis jour
priodiquement;
Risque
oprationnel
QCI
-Vrifier quil ya un suivi
effectu par une personne ou un
service jusqu la fin de
lopration ;
- le suivi est effectu par :
*le charg dtudes ;
* la DOD ;
*le DPT contrle au niveau de la
DRE jusqu la fin de lopration.
Risque de
collusion
QCI
-Vrifier lexistence dune
coordination entre la DOD et
lagence lors de la constitution et
la restitution de la PREG ;
-lexistence dune coordination entre
la DOD et lagence lors de la
constitution et la restitution de la
PREG :
*Lagence transmet les copies du
dossier la DOD pour la constitution
de la PREG ;
* la DOD ds rception des
documents avise lagence ;
*lagence transmet la leve de
rserve la DOD ;
*La DOD procde la restitution de
la PREG et au paiement du
fournisseur.
Risque
oprationnel
Interview
-Estimer si les tats de suivi
permettent didentifier les
Credoc dont la date de validit
est expir.
- les tats de suivi permettent
didentifier les Credoc :
*encours ;
*solds ;
* chus.
Risque
dimage de
la banque
observation
Protection du patrimoine :
D
o
m
i
c
i
l
i
a
t
i
o
n
-Vrifier si le cachet de
domiciliation est bien protg.
le cachet de domiciliation doit tre
protg.
Risque de
perte
Observation
-sassurer que les dossiers sont
archivs au niveau de lagence
pendant 5ans.
les dossiers doivent tre archivs au
niveau de lagence pendant une dure
de 5ans.
Risque
perte (non
protection)
QCI
C
r
e
d
o
c
-Evaluer le degr de protection
des dossiers clients ;
-La protection des dossiers clients
doit tre assure.
Risque de
perte
Observation
Source : Elabor par nos soins
Annexe n19: Questionnaire de contrle interne : Domiciliation
Questions : Oui Non Observation
a. OUVERTURE DU DOSSIER DE DOMICILIATION
a.1. Rception de la demande douverture
Est-ce la demande de domiciliation import est
formalise ?
Est-ce que la demande de domiciliation import
comporte tous les renseignements ncessaires ?
Si, oui est-elle cachete et signe par le client ou
son mandataire ?
Est-ce que le client prsente en plus de la
demande de domiciliation un contrat
commercial ?
a.2. Vrifications de conformit
Est-ce que le prpos aux oprations de
domiciliation vrifie les clauses de la demande
suscites et sassure de la conformit des
documents avec la rglementation en vigueur ?
Est-ce quil procde la vrification des deux
points suivants :
-le client nest pas frapp dune mesure
dinterdiction limportation,
-la marchandise nest pas frappe dune mesure
dinterdiction limportation. ?
Procde-t-il la vrification des clauses du
contrat commercial selon le cas de figure qui se
prsente:
- numro de la facture ou rfrence du
bon de commande,
- nom et adresse du vendeur
(exportateur);
- nom et adresse de lacheteur
(importateur);
- adresse dexpdition ou de destination
(pays de lacheteur);
- nature et dtail de la marchandise ainsi
que le dtail du montant et du prix (avec
prcision de la nature du contrat: FOB /
C&F....);
- modalits de paiement: comment doit
soprer le rglement de la marchandise
importe ?
Dans le cas o la vrification fait apparatre que le
client nest pas habilit la domiciliation, le
prpos rejette-t-il la demande du client ?
a.3. Matrialisation de la domiciliation
Dans le cas ou lopration est conforme, le
prpos procde-t-il immdiatement la
matrialisation de la domiciliation ?
Saisir lopration de Domiciliation sur Delta V8
Est-ce que le prpos saisit lopration de
domiciliation sur Delta V8 conformment aux
instructions de la banque ?
Menu--- Etranger------ Domiciliation---
prises en charges des domiciliations ----- :
Cration
Remplir les cases :
matricule client= NIF ;
Rf Autorit : CDI n ;
Di pour les Credoc dlai
normal <6mois ;
DIP pour les Credoc
spciaux > 6mois ;
Termes de vente : FOB,
CFR : incoterms
Est-ce-que la confirmation de lopration passe
par drogation(DER) du directeur ou de son
adjoint sur Delta V8 ?
a.3.2. Attribution du numro dordre
chronologique et apposition du cachet de
domiciliation
Est-ce-que le prpos aux oprations de
domiciliation attribue un numro selon un ordre
chronologique de domiciliation ?
Est-ce quil appose le cachet de domiciliation sur
le contrat commercial prsent par le client ? et le
renseigne selon une codification ?
Est-ce que le cachet de domiciliation est bien
protg ?
a.3.3. Validation de la domiciliation :
Est-ce que le directeur valide lopration de la
domiciliation aprs vrification de la conformit
des documents ?
Le prpos aux oprations de domiciliation
sassure-t-il de la validation de lopration ?
b. LA GESTION DU DOSSIER DE DOMICILIATION:
b.1 Enregistrement du dossier domicili
Le prpos aux oprations de domiciliation
enregistre-t-il lacte de domiciliation sur le
rpertoire des dossiers dimportations domicilis
immdiatement ? ou bien, il attend jusqu ce
quil yait un cumul de dossiers ?
Lexemplaire du contrat commercial dment
domicili est-il remet ensuite au client ?
b.2 Etablissement de la fiche de contrle
Est-ce que le prpos aux oprations de
domiciliation tablit la fiche de contrle
rglementaire, selon le cas DI ou DIP ?
Est-ce quil remplit ladite fiche soigneusement ?
et fait apparatre les renseignements aussi complet
que possible (le nom du fournisseur ; les
modalits de paiement) ?
b. 3 Perception de la commission douverture
Est-ce quil peroit la commission douverture ?
et met le bordereau de perception de commission
(MC10) ?
Est-ce que les dates de valeur pour le prlvement
des commissions sont exactes ?
Est-ce quil vrifie sur le systme Delta V8 que
les commissions ont t rellement prleves ? et
que le compte du client a t dbit du montant ?
b.4. Envoi la D.O.D : (Direction des
Oprations Documentaires)
Est-ce quil respecte le dlai de transmission des
documents la DOD pour louverture de
domiciliation ?
c. LAPUREMMENT DE DOMICILIATION:
Premire tape : linventaire
Aux termes de la priode de contrle des dossiers
de domiciliation, est-ce que lagence
domiciliataire procdera lapurement au vu des
documents suivant :
o La facture dfinitive, dument domicilie ;
o Document douanier exemplaire (D3) ;
o Exemplaire formule (4) (CA1067) ?
Dans le cas dun dossier complet est-ce que la
banque domiciliataire procdera immdiatement
Source : labor par nos soins.
ltablissement du bilan ? et donnera sa dcision
finale quant au classement du dossier de
lagence ?
Dans le cas dun dossier incomplet, lagence
procdera-t-elle au rappel du client sur la
rgularisation de son dossier ? ou prendra dautres
dispositions ?
Deuxime tape : ltablissement du bilan
Est-ce que le prpos aux oprations de
domiciliation vrifie que la valeur nette transfre
(VNT) est conforme la valeur domicilie et
ddouane (VD) ?
Est-ce quil tablit les statistiques de fin du mois ?
et effectue un suivi des dossiers apurs, en
excdent ou en insuffisance de rglement ?
Est-ce que la banque prendra les mesures
ncessaires en cas dapparition dexcdent ou
dinsuffisance de rglement ?
Existe-t-il un service de contrle ? examine- t-il
les dossiers de domiciliation ?
Si oui, est ce que le dlai de lenvoi des
statistiques ce service est respect ?
Annexe n20: Questionnaire de contrle interne : Ouverture du Credoc
Questions : Oui Non Observation
Politique gnrale
Le client pourra-t-il bnfici dune ligne de crdit ?
(Credoc marg X%)
Est-ce que le directeur dagence ou de son adjoint
renseignent pralablement une ligne de Credoc et une
autorisation plafonne avant de saisir un dossier ?
Les dossiers des clients qui bnficient des lignes de
crdits sont ils-mis jour priodiquement ?
Existe t-il un manuel de procdures, pour les
oprations de Comex, notamment celles de louverture
de Credoc ?
Est-ce que les dossiers sont bien organiss ? classs ? et
protgs ?
Conditions :
Est-ce- que les conditions de solvabilit et de possession
dun compte sont respectes ?
Est-ce que la facture ou le contrat sont domicilis avant
la saisie du dossier de Credoc sur le systme?
Documents requis :
Est-ce que la demande douverture Credoc (modle
SEMAR 205-BIS) est remplie selon les termes du
contrat commercial ? cachete et sign par le client ?
Est-ce quelle ne comporte ni ratures ni surcharges ?
Est-elle fournit en 4 exemplaires ?
La facture pro-forma ou contrat commercial (en 3
exemplaires) et les autres documents sont fournis ?
1-Rception et vrification des documents :
Est-ce le prpos aux Credoc est celui qui reoit la
demande douverture du Credoc sur le formulaire
(Semar205bis), et les autres documents suscits ?
Est-ce quil vrifie la conformit des documents
prsents par le client par rapport aux rgles et usances
uniformes et la rglementation en vigueur ?
Le chef de service Comex procde-t-il la
vrification du dossier, sil est conforme techniquement
et la rglementation des changes en vigueur et des
rgles et usances rgissant les crdits documentaires ?
Enregistrement du dossier
Est-ce que le prpos procde lenregistrement
chronologique du Credoc sur le registre pour le suivi ?
2-Matrialisation de louverture de Credoc :
Etablissement de lET7 :
Est-ce quil ouvre une chemise ET7 (Credoc limport)
pour chaque dossier, sur laquelle sont reportes les
renseignements essentiels du Credoc ?
Saisie de louverture du Credoc sur le systme :
Est-ce-quil procde la saisie des informations sur le
systme Delta V8, sans avoir contrl lexistence de la
provision, et la situation du client ?
Lorsque une des conditions douverture de Credoc nest
pas respecte ; Existe-t-il une procdure sur le systme
informatique qui signale le problme ?
Si, oui en cas dexistence dune faille dans le systme,
est-ce que la banque prconise dautres mesures pour
dceler lanomalie ?
3-Validation :
Est-ce que le Credoc est valid par les trois (3)
personnes habilites ? (F1, F2, F3)
Si la saisie prsente une ou des anomalies, est-ce il peut
y avoir une rectification ? et quelle la personne
responsable de cette rectification ?
Est-ce que le directeur vrifie le dossier la troisime
validation du dossier en F3 ?
Aprs signature du document SEMAR 205bis par le
directeur et son adjoint, le prpos procde-t-il a sa
ventilation ?
A) Consultation des vnements :
Existe-t-il une procdure pour vrifier que lopration
est rellement effectue ?
Classement des documents :
Est-ce que le prpos classe les documents dans le
dossier client ?
Dlgation :
Existe-t-il des dlgations accordes par la Direction en
matire dautorisation de Credoc?
Un systme de dlgation pour autoriser les drogations
aux conditions gnrales est-il clairement dfini ?
Suivi des risques
Les procdures prvoient-elles un suivi des
dpassements ?
Existe-t-il un outil de suivi des dpassements ?
Le suivi des engagements permet-il dobtenir une
situation client et ce tout moment ?
Les chargs de dossiers peuvent-ils consulter tout
moment les comptes ouverts au nom de la socit et
analyser lvolution de ces comptes par rapport aux
limites prtablies ?
Les tats de suivi permettent-ils didentifier les Credoc
dont la date de validit est expire ?
La constitution de la PREG est-elle effectue par une
personne (ou un service) diffrente de celle qui autorise
le Credoc ?
Avant la constitution de la PREG, le contrle sur
lexistence dun dossier et sa conformit aux normes
est-il effectu ?
4-Gnration des critures de Credoc :
Ecritures dengagement ;
Commission douverture ;
Constitution de la PREG.
Est-ce que la date de valeur de la perception des
commissions est exacte ?
La restitution de la PREG est elle faite ds de rception
des documents de lexportateur ?
Le paiement de lexportateur est-il effectu par le dbit
du compte client conformment aux rgles prvues dans
le contrat ?
Est-ce que lexportateur pourrait avoir une pice
justificative lui confirmant son paiement et la fin de
lopration ?
Etablissement des statistiques de fin du mois ?
Existe-t-il un service de contrle ? examine- t-il les
dossiers de Credoc sur le fonds et la forme ?
Si oui, est ce que le dlai de lenvoi des statistiques ce
service est respect ?
.
Source : labor par nos soins.
Annexe n21 : FRAP
La Feuille de rvlation et danalyse de problme : FRAP n
Papiers de travail FRAP n
Problme :
Constats :
Causes :
Consquences :
Solution propose :
Etablie par : approuve par : valide avec :
Le : le : le :
Annexe n 22 : Diagramme dapurement de dossier de Domiciliation bancaire.
Client
Prpos aux oprations de domiciliation BA
Adminis
trat
Douane
DM
FE
Avis pour
rgularisation
Lettre
dannulation
procdure
domiciliation
Avis pour
rgularisation
Avis pour
rgularisation
1 2
2.1. Linventaire du dossier de domiciliation
dossier incomplet dossier
complet
2.1. Linventaire du dossier de domiciliation
dossier incomplet dossier
complet
Dossier
domiciliation
Lett
re
Dossier
domiciliation
2.2. Ltablissement du bilan
Dossier en Dossier en
Dossier
excdent de insuffisance de
apur
rglement rglement
fich
e de
contrl
e
fiche de
contrle
complte
Dossier
domiciliation
apur
CA
1124
CA
1067
Doc.
doua
nier
Dossier
inutilis
Annexe n 22 : Diagramme dapurement de dossier de Domiciliation bancaire.
Client
Prpos aux oprations de domiciliation DEJC BA
1 2
oui
non
non
oui
Dossier
transmis
VNT-VD 30000
DA
VNT-VD 30000
DA
CA
1121 CA
1115
CA
1120
Dossier
domiciliation MAJ et
class
CA
1115
CA
1117
Annexe n23 : Ouverture du dossier domiciliation import.
Schma descriptif de traitement
client Prpos aux oprations de domiciliation Banque dAlgrie
Rejet
Exemplaire remis au
client
Non oui
Contrat
commercial
Deman
de
Rception de la demande douverture
Contrat
commercial
Deman
de
Vrification de
conformit
Confor
me
Deman
de
CA
1110
Contrat
commercial
-Matrialisation de la domiciliation
-Attribution du num dordre
chronologique du cachet de domiciliation
Contrat
commercial
domicili
CA
1110
Enregistrement du dossier
domicili
Contrat
commercial
domicili
CA 1110
mise jour
Sui
te
CA 1112 : fiche de contrle DI
CA 1113 : fiche de contrle DIP
Note n 2048 :105.230 du 28/07/2002.
Copie client
Etablissement de la fiche de contrle
DI DIP
CA
1112
CA
1127
CA11
13
CA 1127
Dossier
Domiciliation
Perception de
la commission
CA
121
Ca
50
Journe
comptable
Dossier Domiciliation
Annexe n24: points de surveillance fondamentaux I
BANQUE NATIONALE DALGERIE ..le
08, BOULEVARD ERNESTO CHE GUEVARA, ALGER Annexe I la circulaire N1960 du 09/09/2008
Agence (indice) :
DRE :
Points de surveillance fondamentaux
Oprations du commerce extrieur
Mois de rfrence :
Mode de
paiement
N
dossier
Client
ordonnateur
Solde
compte
avant
constitution
PREG
Date de
constitution
PREG
Montant
constitution
PREG
Marge Ticket dautorisation
Autorisation Echance
NB : A joindre les factures domicilies avec les documents prvus
Par la note N35/PDG/2000 du 26/11/2000. Le Directeur dAgence
(Nom, Prnom, Cachet et Signature)
Annexe n24: points de surveillance fondamentaux II
BANQUE NATIONALE DALGERIE ..le
08, BOULEVARD ERNESTO CHE GUEVARA, ALGER Annexe II la circulaire N1960 du 09/09/2008
Emetteur Dpartement Contrle
DRE :
Points de surveillance fondamentaux
CREDOCS
Mois de :..
Agence (indice) :.
Vrification effectuer (*)
N
dossier
Credoc
Date
douverture
Date de
rception
la DRE
Date de
contrle et
Nom du
contrleur
Conformit du Credoc
aux rgles et usances
(RUU600) et la
rglementation des
changes
Constitution de
la PREG
globale ou
partielle selon
autorisation
Date de
constit-
ution
PREG
Perception
des
commissions
Dgagements de la
BNA par le client du
risque de change
Observations et
commentaires
(*) vrifications raliser ds rception
Des documents prvus par la
Note n35/PDG/2000/ du 26/11/2000
Le chef de dpartement contrle le Directeur du Rseau dExploitation
(Nom, Prnom et Signature) (Nom, Prnom, Cachet et Signature)
Destinataires :
*Supervision du Contrle Interne
*Inspection Gnrale
*Inspection Rgionale
*Direction de lAudit Interne
*Direction de la Gestion des Risques
*Direction de lEncadrement du Rseau
Annexe n24: points de surveillance fondamentaux IV.
BANQUE NATIONALE DALGERIE
..le
08, BOULEVARD ERNESTO CHE GUEVARA, ALGER
Annexe IV la circulaire N1960 du
09/09/2008
Points de surveillance fondamentaux
CREDOCS, REMDOCS et Transferts Libres.
FICHE DACTION
I- Emetteur : DRE de.
II- Destinataire :
1. Supervision du Contrle Interne
2. Inspection Gnrale
3. Inspection Rgionale
4. Direction de lAudit Interne
5. Direction de la Gestion des Risques
6. Direction de lEncadrement du Rseau
III- Constats :
IV- Mesures et Actions entreprises :
V- Rsultats obtenus :
Le chef de dpartement contrle le Directeur du Rseau
dExploitation
(Nom, Prnom et Signature) (Nom, Prnom, Cachet et
Signature)
Marchandises.
(1)
Ordre
De documents documents rglement
Paiement (5) (2) (7)
(4)
documents(3)
Transfert(6)
Source : labor par nos soins. A
n
n
e
x
e
n
2
5
:
S
c
h
m
a
d
e
l
o
p
r
a
t
i
o
n
d
e
c
r
d
i
t
d
o
c
u
m
e
n
t
a
i
r
e
Importateur
donneur
dordre
Exportateur
bnficiaire
Banque
mettrice
(Banque de
limportateur)
Banque
notificatrice
(Banque de
lexportateur)
Annexe n26 : Nouveau modle de la demande douverture de Credoc
Banque Nationale dAlgrie ..le ...
Annexe n 27 : Modle propos : Demande de domiciliation dimportation
Nom et Prnom/
Raison Sociale :.........................
Adresse/Sige
Social :..................................
Qualit :(Grant/agent.autoris)
NIF :NIS :N
RC................
Nde.compte :
Nous vous prions de bien vouloir procder louverture dun dossier de domiciliation pour lopration
dimportation de : (produit/service...) ; Dune quantit de :.et
dont le prix unitaire est de :.; Conformment au document commercial (contrat/ facture pro forma
ou dfinitive) N : .du : (date)..
Et nous vous engageons sur lhonneur effectuer toutes les oprations et formalits bancaires prvues par la
rglementation du commerce extrieur et des changes en vigueur.
Nous vous autorisons dbiter notre compte courant, repris du montant de lopration, ainsi que de toutes
commissions et frais y affrents.
Information du fournisseur :
Nom du
fournisseur :..............
Adresse du
fournisseur :.................
Banque du
fournisseur :IBAN :Swift.........................
Lieu.dembarquement :..........
Lieu.de.dbarquement :...........
Nature de lopration :
Investissement revente en ltat transformation services
Tarif.Douanier :............
Documents joints :
Attestation Taxe de la domiciliation bancaire N..
Facture pro forma.
Autres :
Mode de paiement :
Transfert libre
Remise Documentaire
Crdit Documentaire
Conditions de rglement :
Avue :
Diffr de paiement (Date)..
Nous dgageons LA Banque Nationale dAlgrie de tout risque de change ventuel.
Date, cachet et signature :
Cadre rserv la banque :
Jour de rception :/../.. Observation :
Date de contrle :/../..
Dossier :
Apur
En excdent de rglement
En insuffisance de rglement
Annul
Annexe n28 : Modle de leve de rserve propos.
SARL
. Le...
A Madame la Directrice
Agence :
OBJET : leve de rserves CDI..
USD / EUR Exportateur :
==============================//
Madame,
Jai lhonneur de venir par la prsente vous demander de bien vouloir lever
toutes les rserves quant au rglement du CREDOC cit en marge.
Veuillez agrer, Madame, lexpression de ma haute considration.
Annexe 29 : Bale II sur le contrle Interne :
Bale II
Les problmes rencontrs dans les cas rcents de pertes bancaires importantes entrent dans ces cinq catgories. Le fonctionnement
efficace de ces lments est capital pour la ralisation des objectifs oprationnels, d'information et de conformit d'une banque.
A. Surveillance par la direction et culture de contrle
1. Conseil d'administration
Principe 1: Le conseil d'administration devrait tre charg d'approuver les stratgies et politiques, d'apprcier les risques encourus par la
banque, de fixer des niveaux Acceptables en regard de ces risques en s'assurant que la direction gnrale prend les dispositions ncessaires
pour identifier, surveiller et contrler ces risques, d'approuver la structure organisationnelle et de s'assurer que la direction gnrale surveille
l'efficacit du systme de contrle interne.
Le conseil d'administration a une mission de gouvernance, d'orientation et de surveillance vis--vis de la direction gnrale. Il est charg
de fixer les grandes stratgies et les principales politiques de l'organisation et d'approuver sa structure organisationnelle globale. Il lui
incombe en dernier ressort de veiller la mise en place et l'application d'un systme adquat de contrle interne. Pour tre efficaces, ses
membres doivent tre objectifs, comptents et scrupuleux et connatre les activits de la banque ainsi que les risques qu'elle encourt. Un
conseil d'administration fort et actif, surtout lorsqu'il est associ des canaux de communication faisant bien remonter l'information et des
organes financiers, juridiques et d'audit interne efficients, est souvent le mieux en mesure de rsoudre les problmes qui pourraient amoindrir
l'efficacit du systme de contrle interne.
Le conseil d'administration devrait inclure dans ses activits 1) des discussions rgulires avec la direction sur l'efficacit du systme de
contrle interne, 2) un examen, dans les dlais les plus brefs, des valuations sur les contrles internes effectues par la direction et les
auditeurs internes et externes, 3) des actions rptes pour s'assurer que la direction a pris en compte de manire approprie les
recommandations et proccupations exprimes par les auditeurs et autorits de contrle au sujet des carences du contrle interne.
Une option utilise par les banques de nombreux pays consiste instaurer un comit d'audit indpendant pour assister le conseil dans
l'exercice de ses responsabilits. Cela permet d'examiner dans le dtail des informations et rapports sans devoir mobiliser tous les
administrateurs et d'apporter toute l'attention ncessaire certaines questions particulires. Le comit d'audit est gnralement responsable du
suivi du processus de communication financire et du systme de contrle interne. Dans le cadre de cette responsabilit, il est attentif aux
oprations du dpartement d'audit interne de la banque, auquel il sert de contact direct; il engage galement les auditeurs externes et en est
l'interlocuteur privilgi. Dans les pays optant pour un comit d'audit, celui-ci devrait tre entirement compos d'administrateurs extrieurs
(c'est--dire de membres du conseil qui ne sont employs ni par la banque ni par l'un de ses tablissements affilis) possdant une
comptence en matire de
communication financire et de contrle interne. Il convient de noter que la constitution d'un comit d'audit ne devrait en aucun cas
dcharger le conseil plnier de ses tches, lui seul tant juridiquement mandat prendre des dcisions.
Direction gnrale
Principe 2: La direction gnrale devrait tre charge de mettre en oeuvre les stratgies approuves par le conseil, de dfinir des
politiques de contrle interne appropries et de surveiller l'efficacit du systme de contrle interne.
Il incombe la direction gnrale de mettre en oeuvre les directives approuves par le conseil d'administration, en appliquant notamment
les stratgies et politiques de la banque et en instaurant un systme de contrle interne efficace. Pour l'laboration des politiques et
procdures de contrle interne plus spcifiques, les membres de la direction gnrale dlguent habituellement leur responsabilit aux
personnes charges des activits ou fonctions d'une unit particulire. Il est donc important que la direction gnrale s'assure que ces
personnes tablissent et conduisent les politiques et procdures appropries.
Le respect de la conformit un systme de contrle interne passe en grande partie par une structure organisationnelle parfaitement
transparente et connue de l'ensemble du personnel, montrant clairement les niveaux de responsabilit et d'autorit en matire de notification
et permettant une communication adquate dans l'ensemble de l'organisation. La rpartition des tches et responsabilits devrait garantir
l'absence de ruptures dans la chane hirarchique et l'exercice d'un degr de contrle efficace par la direction tous les niveaux de la banque
et dans toutes ses activits.
Il importe que la direction gnrale prenne des mesures pour garantir que les activits sont conduites par du personnel qualifi possdant
l'exprience et les capacits techniques requises. Le personnel devrait bnficier d'une rmunration approprie ainsi que d' une remise
niveau priodique de sa formation et de ses comptences. La direction gnrale devrait instaurer des politiques de rmunration et de
promotion rcompensant les comportements adquats et rduisant au maximum les incitations, pour les agents, ignorer ou contourner les
mcanismes de contrle interne.
Culture de contrle
Principe 3: Le conseil d'administration et la direction gnrale sont chargs de promouvoir des critres levs d'thique et d'intgrit et
d'instaurer, au sein de l'organisation bancaire, une culture qui souligne et dmontre, tous les niveaux du personnel, l'importance des
contrles internes. Tous les niveaux du personnel de l'organisation doivent comprendre leur rle dans le contrle interne et s'impliquer
activement dans ce processus.
L'un des lments essentiels d'un systme de contrle interne efficace rside dans une culture de contrle forte. Il incombe au conseil
d'administration et la direction gnrale de souligner, dans les termes utiliss et les actions entreprises, l'importance du contrle interne;
cela passe notamment par les valeurs thiques mises en avant par la direction dans son comportement professionnel, tant l'intrieur qu'
l'extrieur de l'organisation. Les termes, actes et attitudes de ces deux instances affectent l'intgrit, l'thique et les autres aspects de la culture
de contrle d'un tablissement.
des degrs divers, le contrle interne relve de la responsabilit de chacun. Presque tous les employs produisent des informations
utilises dans le systme de contrle interne ou effectuent d'autres actions indispensables l'exercice du contrle. Un lment cl d'un
systme de contrle interne fort est la conscience, pour chaque employ, de la ncessit d'assumer ses tches de manire effi cace et de
notifier au niveau de direction appropri tout problme rencontr dans le cadre des oprations, toute infraction au code de conduite ainsi
que toute violation des politiques tablies ou action illgale constate. L'idal, cet effet, est que les procdures oprationnelles soient
clairement prcises par crit et mises la disposition de l'ensemble du personnel concern. Il est essentiel que tous les agents de la banque
comprennent l'importance du contrle interne et s'impliquent activement dans ce processus.
En renforant les valeurs thiques, les organisations bancaires devraient viter des politiques et pratiques pouvant engendrer par mgarde
des incitations ou des tentations effectuer des activits inappropries: importance exagre donne aux objectifs de performance ou autres
rsultats oprationnels, particulirement court terme; gratifications leves lies aux performances; sparation inefficace des tches ou
d'autres fonctions de contrle pouvant conduire mal utiliser les ressources ou dissimuler des performances mdiocres; sanctions minimes
ou excessives en cas de comportement incorrect.
Si l'existence d'une forte culture de contrle interne ne garantit pas une organisation d'atteindre ses objectifs, son absence augmente les
risques d'erreurs non dceles ou d'irrgularits.
B. valuation des risques
Dans la perspective du contrle interne, l'valuation des risques devrait dceler et apprcier les facteurs internes et externes pouvant
compromettre la ralisation des objectifs oprationnels, d'information et de conformit d'une organisation bancaire. Cette analyse devrait
prendre en compte des risques tels que le risque de crdit, le risque de march, le risque de liquidit et le risque oprationnel (lequel inclut le
risque de fraude, de dtournement d'actifs et d'informations financires douteuses). Il existe une diffrence notable entre l'valuation des
risques dans le contexte du processus de contrle interne et le concept plus large de gestion des risques dans l'activit globale d'une
banque. Dans une organisation bancaire, cette gestion des risques consiste tablir des objectifs organisationnels et autres (en matire de
rentabilit, par exemple) et dterminer, mesurer et fixer les plafonds d'engagement que la banque acceptera pour les atteindre. L'objet du
contrle interne est alors de s'assurer que les objectifs et politiques sont communiqus et appliqus, que le respect des plafonds est soumis
surveillance et que les dviations sont corriges dans le sens des politiques de la direction. Par consquent, le concept de gestion des risques
s'tend, mais ne se limite pas, l'valuation des risques et la fixation d'objectifs oprationnels tels qu'ils sont dfinis aux fins du contrle
interne.
Principe 4: La direction gnrale devrait s'assurer qu'il est procd l'identification et l'valuation des facteurs internes et externes qui
pourraient compromettre la ralisation des objectifs de la banque. Cette valuation devrait couvrir l'ensemble des divers risques encourus par
l'tablissement (par exemple, risque de crdit, risque-pays et risque de transfert, risque de march, risque de taux d'intrt, risque de liquidit,
risque oprationnel, risque juridique et risque de rputation).
Une valuation efficace des risques recense et analyse les facteurs internes (nature des activits de la banque, qualit du personnel,
modifications organisationnelles et mouvements d'effectifs) et externes (volution des conditions conomiques, changements au sein de la
profession et progrs technologique) pouvant compromettre la ralisation des objectifs de la banque. Cette valuation devrait tre effectue
au niveau de chaque dpartement oprationnel ainsi que pour l'ensemble des activits et filiales de l'organisation bancaire consolide et peut
s'oprer par diverses mthodes. Pour tre efficace, elle doit porter la fois sur les risques mesurables (risque de crdit, risque de march et
risque de liquidit) et non mesurables (risque oprationnel, risque juridique et risque de rputation).
Le processus d'valuation des risques ncessite galement de dterminer ceux qui sont contrlables par la banque et ceux qui ne le sont
pas. Pour les premiers, la banque doit tablir si elle accepte ces risques ou si elle prfre les limiter au moyen de procdures de contrle. Pour
ceux qui ne peuvent pas tre contrls, la banque doit dcider soit de les accepter, soit de se dsengager, soit encore de rduire le niveau de
l'activit concerne.
Principe 5: La direction gnrale devrait s'assurer que les risques affectant la ralisation des stratgies et objectifs de la banque font
l'objet d'une valuation permanente. Un rexamen des contrles internes peut s'avrer ncessaire pour prendre en compte de manire
approprie tout risque nouveau ou jusque-l non contrl.
Pour que l'valuation des risques et, par consquent, le systme de contrle interne demeurent efficaces, la direction gnrale doit
considrer en permanence les risques pouvant entraver la ralisation des objectifs de la banque et ragir aux modifications des circonstances
et des conditions d'activit. Il peut s'avrer ncessaire de revoir les contrles internes, afin de bien prendre en compte des risques nouveaux
ou jusque-l non contrls. Par exemple, avec l'innovation financire, une banque doit valuer les nouveaux instruments financiers et
oprations de march et examiner les risques qu'ils font encourir. Souvent, la meilleure faon de comprendre ces risques est de voir comment
divers scnarios (conomiques ou autres) affectent les flux de trsorerie et le rendement des transactions et instruments financiers. Un
examen attentif de l'ventail des problmes possibles, allant des malentendus avec la clientle aux dfaillances oprationnel les, soulignera
certains aspects importants en matire de contrle.
C. Activits de contrle
Principe 6: Les activits de contrle devraient faire partie intgrante des oprations quotidiennes de la banque. La direction gnrale
doit mettre en place une structure de contrle approprie pour garantir des contrles internes efficaces, en dfinissant les activits de
contrle chaque niveau oprationnel. Ces activits devraient inclure les lments suivants: examens effectus au niveau suprieur; contrles
d'activit appropris pour les diffrents dpartements ou units; contrles physiques; vrification priodique du respect des plafonds
d'engagement; systme d'approbation et d'autorisation; systme de vrification et de contrle par rapprochement. La direction gnrale doit
s'assurer rgulirement que tous les domaines de la banque se conforment aux politiques et procdures tablies.
Les activits de contrle sont conues et mises en oeuvre pour faire face aux risques dcels par la banque par le biais du processus
d'valuation des risques dcrit prcdemment. Ces activits comportent trois tapes: 1) l'tablissement des politiques; 2) la performance des
procdures au regard de ces politiques; 3) la vrification du respect de la conformit aux politiques. Les activits de contrle se situent tous
les niveaux du personnel de la banque, y compris la direction gnrale et les personnels directement en contact avec le march. Voici
diffrents exemples d'activits de contrle.
Examens effectus au niveau suprieur Le conseil d'administration et la direction gnrale demandent souvent des prsentations et
comptes rendus de rsultats qui leur permettent d'valuer les progrs raliss par la banque vers ses objectifs. Par exemple, la direction
gnrale peut vouloir consulter des rapports indiquant les rsultats financiers effectifs en cours d'exercice par rapport au budget. Les
questions de la direction gnrale qui en rsultent et les rponses fournies par les niveaux hirarchiques infrieurs constituent une activit de
contrle qui peut mettre en vidence des problmes, tels que carences du contrle, erreurs dans la communication financire interne ou
fraudes.
Contrles d'activit La direction, au niveau d'un dpartement ou d'une unit, reoit et examine des comptes rendus normaux ou
exceptionnels sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Les examens fonctionnels sont plus frquents que ceux effectus au
niveau suprieur et sont habituellement plus dtaills. Par exemple, le responsable du secteur des prts commerciaux consulte des rapports
hebdomadaires sur les dfauts de paiement, les paiements reus et les revenus d'intrts produits par le portefeuille, tandis que le responsable
du crdit au sein de la direction gnrale a connaissance de documents similaires une fois par mois et sous une forme plus condense
couvrant toutes les catgories de prts.
Comme pour les examens au niveau suprieur, les questions qui rsultent de l'analyse des rapports et les rponses qu'elles amnent
reprsentent l'activit de contrle.
Contrles physiques Les contrles physiques portent en gnral sur les limitations d'accs aux actifs physiques, dont les titres et autres
actifs financiers.
Les activits de contrle incluent les restrictions physiques, la double conservation et les inventaires priodiques.
Conformit aux plafonds d'engagement L'tablissement de limites prudentes sur les engagements constitue un lment majeur de la
gestion des risques. Par exemple, la conformit aux limites fixes pour les emprunteurs et les autres contreparties rduit la concentration du
risque de crdit de la banque et permet de diversifier son profil de risque. Par consquent, un aspect important des contrles internes rside
dans la vrification, intervalles rguliers, du respect de telles limites.
Approbation et autorisation La ncessit de solliciter une approbation et une autorisation pour les transactions dpassant certaines
limites garantit qu'un niveau de direction appropri a connaissance de la transaction ou de la situation, ce qui aide tablir les
responsabilits.
Vrification et concordance La vrification des caractristiques dtailles des transactions ainsi que des diverses activits et des
rsultats fournis par les modles de gestion des risques utiliss par la banque constitue une activit de contrle importante. La concordance
priodique, par exemple entre les flux de trsorerie et les rapports et tats financiers, peut mettre en vidence des activits et enregistrements
comptables exigeant d'tre amends. Par consquent, les conclusions de ces contrles devraient tre notifies rgulirement aux niveaux de
direction appropris.
Les activits de contrle ont leur efficacit optimale lorsque la direction et l'ensemble du personnel les considrent comme faisant
intrinsquement partie, et non comme un complment, des oprations quotidiennes de la banque. Lorsque les contrles sont vus comme un
complment des oprations de chaque jour, ils sont souvent jugs moins importants et peuvent ne pas tre raliss dans des situations o des
agents s'estiment presss par le temps pour effectuer leurs activits. En outre, les contrles qui sont vritablement intgrs aux oprations
quotidiennes permettent de ragir rapidement des modifications des conditions et vitent des cots inutiles. Dans le cadre de l'action visant
instaurer la culture de contrle approprie au sein d'une banque, la direction gnrale devrait s'assurer que les activits de contrle
adquates font vritablement partie des fonctions quotidiennes de l'ensemble du personnel concern.
La direction gnrale ne doit pas se contenter de dfinir des politiques et procdures appropries pour les diverses activits et units de la
banque. Elle doit s'assurer priodiquement que tous les domaines de la banque oprent en conformit avec ces politiques et procdures et
faire en sorte galement que les politiques et procdures existantes demeurent adquates. Cette fonction entre habituellement dans les
attributions du dpartement d'audit interne.
Principe 7: La direction gnrale devrait s'assurer qu'il existe une sparation approprie des tches et que des responsabilits
conflictuelles ne sont pas confies des membres du personnel. Les secteurs prsentant des conflits d'intrts potentiels devraient tre
identifis, circonscrits aussi troitement que possible et surveills avec attention.
Dans les cas de pertes bancaires importantes dues un contrle interne insuffisant, les autorits prudentielles constatent en gnral que
l'une des causes principales rside dans l'absence de sparation adquate des tches. Le fait de confier la mme personne des responsabilits
conflictuelles (par exemple, celles des fonctions de march et de postmarch d'une unit de ngociation) lui donne la possibilit d'avoir accs
des actifs de valeur et de manipuler des donnes financires en vue d'un profit personnel ou de dissimuler des pertes.
C'est pourquoi, au sein d'une banque, certaines tches devraient tre rparties entre plusieurs individus, afin de rduire le risque de
manipulation de donnes financires ou de dtournement d'actifs.
La sparation des tches ne concerne pas seulement des situations o la mme personne contrle la fois la salle des marchs et le
postmarch. En l'absence de contrles appropris, de srieux problmes peuvent galement se poser lorsqu'un individu est charg:
de l'approbation du dcaissement de fonds et de leur dcaissement effectif;
des comptes clientle et des comptes propres;
des transactions au titre du portefeuille bancaire et du portefeuille de ngociation;
de la fourniture informelle d'informations des clients sur leurs positions et de la relation commerciale avec ces mmes clients;
de l'valuation du caractre adquat des dossiers de crdit et de la surveillance des emprunteurs aprs l'octroi des crdits;
de tout autre domaine o des conflits d'intrts notables apparaissent et ne sont pas attnus par d'autres facteurs.
Les domaines de conflits potentiels devraient tre identifis, circonscrits aussi troitement que possible et surveills avec attention. Des
examens priodiques des responsabilits et fonctions des personnes dtenant les postes cls devraient tre galement effectus pour s'assurer
que ces responsables ne sont pas en mesure de dissimuler des agissements inappropris.
D. I nformation et communication
Principe 8: La direction gnrale devrait s'assurer de l'existence de donnes internes adquates et exhaustives d'ordre financier,
oprationnel ou ayant trait au respect de la conformit ainsi que d'informations de march extrieures sur des vnements et conditions
intressant la prise de dcision. Ces donnes et informations devraient tre fiables, rcentes, accessibles et prsentes sous une forme
cohrente.
Une information adquate et une communication efficace sont deux lments essentiels au bon fonctionnement d'un systme de contrle
interne. S'agissant des banques, pour que l'information soit utile, elle doit tre pertinente, fiable, rcente, accessible et prsente sous une
forme cohrente. Il peut s'agir de donnes internes d'ordre financier, oprationnel ou ayant trait au respect de la conformit ainsi que
d'informations de march extrieures sur des vnements et conditions intressant la prise de dcision. L'information interne fait partie d'un
processus d'enregistrement qui devrait comporter des procdures dfinies pour la conservation des supports d'enregistrement.
Principe 9: La direction gnrale devrait instituer des voies de communication efficaces pour garantir que l'ensemble du personnel est
parfaitement inform des politiques et procdures affectant ses tches et responsabilits et que les autres informations importantes
parviennent leurs destinataires.
En l'absence d'une communication efficace, l'information est inutile. La direction gnrale d'une banque doit instaurer des voies
effectives de communication, afin que les informations ncessaires parviennent leurs destinataires. Ces informations portent la fois sur les
politiques et procdures oprationnelles de l'tablissement ainsi que sur les rsultats d'exploitation rels.
La structure organisationnelle de la banque devrait faciliter la libre circulation horizontale et verticale de l'information dans toute
l'organisation. Une telle structure garantit que les informations remontent et permet au conseil d'administration et la direction gnrale de
connatre les risques encourus dans le cadre de l'activit et les rsultats d'exploitation.
L'information qui redescend travers l'organisation garantit que les objectifs, les stratgies, et aussi les attentes, de la banque ainsi que
les politiques et procdures tablies sont communiqus au niveau de direction infrieur et au personnel charg des oprations. Cette
communication est essentielle pour obtenir un effort commun de tous les employs vers les objectifs de la banque. Enfin, la communication
horizontale dans l'organisation est ncessaire pour que l'information parvenant une unit ou un dpartement puisse tre connue des autres
units ou dpartements concerns.
Principe 10: La direction gnrale doit s'assurer de l'existence de systmes d'information appropris couvrant toutes les activits de la
banque. Ces systmes, notamment ceux qui contiennent et utilisent des donnes informatises, doivent tre srs et faire l'objet de tests
priodiques.
Un lment essentiel des oprations d'une banque rside dans la mise en place et la maintenance de systmes d'information de la
direction couvrant toute la gamme des activits. Cette information est habituellement fournie sous forme la fois lectronique et non
lectronique. Les banques doivent tre tout particulirement informes des exigences organisationnelles et de contrle interne lies au
traitement lectronique de l'information.
Les systmes lectroniques et l'utilisation de l'informatique prsentent des risques qui doivent tre efficacement contrls par les
banques, afin d'viter des dysfonctionnements et des pertes potentielles. Les contrles sur les systmes et la technologie informatiques
devraient tre la fois gnraux et spcifiques aux applications. Les contrles gnraux portent sur le systme informatique (c'est--dire
ordinateur central et terminaux d'utilisateur) et en assurent un fonctionnement correct en continu. Ils incluent notamment des procdures de
sauvegarde et de reprise, des politiques de dveloppement et d'acquisition de logiciels, des procdures de maintenance et des contrles de
scurit d'accs. Les contrles lis aux applications sont des tapes informatises au sein des applications logicielles et d'autres procdures
manuelles qui examinent le traitement des oprations. Ils comprennent, entre autres, les questions de rconciliations et de concordances. En
l'absence de contrles adquats sur les systmes et la technologie informatiques, y compris ceux qui sont en cours de dveloppement, les
banques pourraient subir des pertes de donnes et de programmes rsultant de dispositions inappropries en matire de scurit physique et
lectronique, de dfaillances des quipements ou systmes et de procdures inadaptes de sauvegarde et de reprise. Au niveau de la direction,
la prise de dcision pourrait tre fausse par des informations non fiables ou errones fournies par des systmes mal conus et
insuffisamment contrls. Le traitement de l'information pourrait tre entrav, voire totalement stopp, s'il n'est pas possible, en cas de
dfaillance prolonge de l'quipement, de recourir des installations de secours compatibles. Dans des situations extrmes, de tels problmes
pourraient causer de srieuses difficults aux banques et mme compromettre leur capacit d'effectuer leurs activits essentielles.
E. Activits de surveillance
Principe 11: La direction gnrale devrait surveiller en permanence l'efficacit globale des contrles internes de la banque pour
favoriser la ralisation des objectifs fixs. La surveillance des principaux risques devrait faire partie des oprations quotidiennes de la banque
et comporter, au besoin, des valuations spcifiques.
L'activit bancaire est un secteur dynamique, o tout volue rapidement. Les banques doivent en permanence surveiller et valuer leurs
systmes de contrle interne en fonction des modifications des conditions internes et externes et les renforcer, au besoin, pour en garantir
l'efficacit.
Surveiller l'efficacit des contrles internes devrait faire partie des oprations quotidiennes de la banque mais commande galement de
procder des valuations priodiques spcifiques de l'ensemble du processus de contrle interne. La frquence de la surveillance des
diffrentes activits devrait tre fonction des risques encourus ainsi que du rythme et de la nature des changements affectant l'environnement
oprationnel. Un processus de surveillance en continu peut permettre de dcouvrir et de corriger rapidement les dficiences du systme de
contrle interne; il atteint son efficacit maximale lorsque le systme de contrle interne est intgr l'environnement oprationnel et donne
lieu des rapports rguliers qui font l'objet d'un examen. Dans le cadre de la surveillance en continu figurent, par exemple, l'examen et
l'approbation des enregistrements courants ainsi que la consultation et l'approbation par la direction des rapports sur des faits exceptionnels.
En revanche, les valuations spcifiques ne dtectent gnralement les problmes qu'aprs coup; elles permettent cependant une
organisation d'avoir un aperu rcent et global de l'efficacit du systme de contrle interne et de celle, en particulier, de ses activits de
surveillance. Ces valuations du systme de contrle interne prennent souvent la forme d'autovaluations, lorsque les personnes charges
d'une fonction prcise dterminent le degr d'efficacit des contrles pour leurs activits. Les documents et rsultats concernant les
valuations sont ensuite soumis l'attention de la direction gnrale. Les examens effectus tous les niveaux devraient tre tays par une
documentation adquate et communiqus dans les meilleurs dlais l'chelon de direction appropri.
Principe 12: Un audit interne efficace et exhaustif du systme de contrle interne devrait tre effectu par un personnel bien form et
comptent. La fonction d'audit interne, en tant qu'lment de la surveillance du systme de contrle interne, devrait rendre compte
directement au conseil d'administration, ou son comit d'audit, ainsi qu' la direction gnrale.
La fonction d'audit interne constitue un lment majeur de la surveillance en continu du systme de contrle interne, parce qu'elle fournit
une valuation indpendante du caractre adquat des contrles instaurs et du respect de la conformit ces derniers. En rendant compte
directement au conseil d'administration ou son comit d'audit ainsi qu' la direction gnrale, les auditeurs internes procurent des
informations objectives sur les diffrentes activits. En raison de l'importance de cette fonction, l'audit interne doit tre assur par un
personnel comptent et bien form ayant une parfaite comprhension de son rle et de ses responsabilits. La frquence et l'ampleur des
examens et tests des contrles internes effectus au sein d'une banque par les auditeurs internes devraient correspondre la nature et la
complexit des activits de l'organisation et aux risques associs. Dans tous les cas, il est capital que la fonction d'audit interne soit
indpendante du fonctionnement de la banque au quotidien et qu'elle ait accs toutes les activits conduites par l'organisation bancaire.
Il est important que la fonction d'audit interne rende compte directement au plus haut niveau de l'organisation bancaire, habituellement le
conseil d'administration ou son comit d'audit, et la direction gnrale. Cela permet la gouvernance d'entreprise de s'exercer correctement,
le conseil bnficiant d'informations qui ne sont altres en aucune faon par les niveaux de direction couverts par ces comptes rendus. Le
conseil devrait galement renforcer l'indpendance des auditeurs internes, en faisant en sorte que des questions ayant trait, par exemple,
leur rmunration ou aux affectations budgtaires les concernant soient traites par le conseil ou par les niveaux de direction suprieurs
plutt que par des responsables qui sont affects par les travaux des auditeurs internes.
Principe 13: Les carences dtectes dans les contrles internes devraient tre notifies dans les meilleurs dlais au niveau de direction
appropri et faire l'objet d'un traitement rapide. Les dficiences importantes devraient tre signales la direction gnrale et au conseil
d'administration.
Les dficiences des contrles internes, ou les politiques ou procdures inefficaces, devraient tre signales ds leur dtection la ou aux
personnes appropries, les problmes graves tant ports l'attention de la direction gnrale et du conseil d'administration. Lorsque ces
insuffisances ont t notifies, il est important que la direction y remdie dans les meilleurs dlais. Les auditeurs internes devraient en
effectuer le suivi et informer immdiatement la direction gnrale ou le conseil de toute insuffisance non corrige. Pour faire en sorte que
toutes les dficiences soient traites au plus tt, la direction devrait prvoir un systme pour suivre les faiblesses du contrle interne ainsi que
les actions destines y remdier.
1
1
CADRE D'VALUATION DES SYSTMES DE CONTRLE INTERNE Comit de Ble sur le contrle bancaire Ble
Janvier 1998
Annexe n30 : Diagramme de circulation dune mission daudit
Annexe n31: DECLARATION DOUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION I
BANQUE NATIONALE DALGERIE ..le
08, BOULEVARD ERNESTO CHE GUEVARA, ALGER ANNEXE I
DECLARATION DOUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION A LIMPORT ET A LEXPORT DES BIENS ET SERVICES
OUVERTS DURANT LE MOIS DE ./..
DRE : AGENCE :
CODE
AGENCE/
N CC
CODE
FISCAL DE
LOPERAT
EUR
N
DOMICILIATI
ON
DATE
DOUVERTU
RE
TARIF
DOUANIER
OU
NATURE
DE
SERVICES
MONTANT
DE
LOPERATI
ON EN
DEVIDE
FOURNISSEUR OU
CLIENT
PAYS
DORIGINE
OU DE
DESTINATI
ON
CHARGE
DES
RISQUES
CODE
MODE DE
REGLEM
ENT
Annexe n31: DECLARATION DOUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION II
BANQUE NATIONALE DALGERIE ..le
08, BOULEVARD ERNESTO CHE GUEVARA, ALGER ANNEXE II
DECLARATION DOUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION A LIMPORT ET A LEXPORT DES BIENS ET SERVICES
APURES DURANT LE MOIS DE ./..
DRE : AGENCE :
CODE AGENCE/
N CC
DATE
DOUVERTURE
N
DOMICILIATION
DATE
DAPUREMENT
MONTANT OU
VALEUR DU
CONTRAT/
FACTURE EN
DEVISE
MONNAIE MONTANT
TOTAL
Annexe n31: DECLARATION DOUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION III
BANQUE NATIONALE DALGERIE ..le
08, BOULEVARD ERNESTO CHE GUEVARA, ALGER ANNEXE III
DECLARATION DOUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION A LIMPORT ET A LEXPORT DES BIENS ET SERVICES NON
APURES EN EXCEDENT DE REGLEMENT POUR LES IMPORTATIONS OU INSUFFISANCE DE RAPATRIEMENT POUR LES
EXPORTATIONS DURANT LE MOIS DE ./..
DRE : AGENCE :
CODE
AGENCE/ N CC
DATE
DOUVERTURE
N
DOMICILIATION
MONTANT OU
VALEUR DU
CONTRAT/
FACTURE EN
DEVISE
MONTANT TOTAL OBSERVATIONS
EXCEDENT
DE
REGLEMENT
INSUFFISANCE
DE
RAPATRIEMENT
Annexe n 32: Les trois phases fondamentales de la mission daudit interne.
Source : Louvrage de lIFACI, la conduite dune mission daudit interne 2me
dition, centre de librairie et dditions techniques (CLET), Paris 1995.
Vous aimerez peut-être aussi
- Manuel Du Conducteur de Culte 2015-2016Document12 pagesManuel Du Conducteur de Culte 2015-2016Cécé Charles Kolié82% (17)
- Audit Des Stés de BourseDocument38 pagesAudit Des Stés de Bourseqsx qxsq100% (2)
- Manuel de Poche Du Le Controle FinancierDocument12 pagesManuel de Poche Du Le Controle FinancierIssam Eddine FahfouhPas encore d'évaluation
- Le Modele Britannique de La GouvernanceDocument26 pagesLe Modele Britannique de La Gouvernanceimannit0% (1)
- Sémiotique Figurative Et Sémiotique Plastique PDFDocument28 pagesSémiotique Figurative Et Sémiotique Plastique PDFvelhobiano67% (3)
- Traité d'économétrie financière: Modélisation financièreD'EverandTraité d'économétrie financière: Modélisation financièrePas encore d'évaluation
- Etudes Fichier163Document137 pagesEtudes Fichier163Rhana DiabagatéPas encore d'évaluation
- Imen JaidaineDocument88 pagesImen JaidaineHanenHanenPas encore d'évaluation
- Guide FO Le Temps PartielDocument10 pagesGuide FO Le Temps PartielEchalierPas encore d'évaluation
- Binder 1Document142 pagesBinder 1Lounes LeroulPas encore d'évaluation
- L'importance Et Le Déroulement de L'information Financière Au Sein D'un Établissement HôtelierDocument62 pagesL'importance Et Le Déroulement de L'information Financière Au Sein D'un Établissement HôtelierGhassenPas encore d'évaluation
- Audit Financier Et Controle InterneDocument12 pagesAudit Financier Et Controle InterneMellouk KhalidPas encore d'évaluation
- PNADM827Document391 pagesPNADM827abjadiPas encore d'évaluation
- Interdependance Entre Audit Interne Et Audit Externe Et Leurs Impacts Sur La Qualite Du Reporting Financier Dans Le Contexte TunisienDocument309 pagesInterdependance Entre Audit Interne Et Audit Externe Et Leurs Impacts Sur La Qualite Du Reporting Financier Dans Le Contexte TunisienFatima Lakssoumi100% (2)
- Impact de La Lite Clients Pour Le Controle de Gestion BancaireDocument73 pagesImpact de La Lite Clients Pour Le Controle de Gestion Bancairedonafifi0% (1)
- Guide Cartographie Risques Juin 2015Document58 pagesGuide Cartographie Risques Juin 2015Jean Paul ESSONO NGUEMAPas encore d'évaluation
- Fiscalité Des Monnaies VirtuellesDocument78 pagesFiscalité Des Monnaies VirtuellesArnaud PahudPas encore d'évaluation
- Memoire de Master en Gpe Eteki - EloundouDocument77 pagesMemoire de Master en Gpe Eteki - EloundouEmmanuel TchoudjoPas encore d'évaluation
- La Performance Locale.Document713 pagesLa Performance Locale.youssef_MTPas encore d'évaluation
- Memoire - Imelda - VFDocument74 pagesMemoire - Imelda - VFMONDJO IMELDAPas encore d'évaluation
- Le Système Fiscal Marocain Et Le Nouveau Modèle de Développement - Analyse Et Propositions - VFDocument20 pagesLe Système Fiscal Marocain Et Le Nouveau Modèle de Développement - Analyse Et Propositions - VFSalma FaitourPas encore d'évaluation
- RevueDocument11 pagesRevueSara AmsidderPas encore d'évaluation
- Les Techniques BudgétairesDocument53 pagesLes Techniques Budgétairesbederinadml0% (1)
- Maldie Questions Theoriques D'analyse Financiere 52 PDFDocument10 pagesMaldie Questions Theoriques D'analyse Financiere 52 PDFGael KasongaPas encore d'évaluation
- Controle Interne Et Gestion Des RisquesDocument5 pagesControle Interne Et Gestion Des Risquesstyve vorren100% (1)
- Les Accords de Bretton WoodsDocument10 pagesLes Accords de Bretton WoodsAhmednah MohamedouPas encore d'évaluation
- Contraintes À LDocument3 pagesContraintes À Louma yaPas encore d'évaluation
- Proposition D'intégration en Cabinet D'expertise Comptable D'une Gamme de Missions de Conseil Social Auprès Du DirigeantDocument170 pagesProposition D'intégration en Cabinet D'expertise Comptable D'une Gamme de Missions de Conseil Social Auprès Du DirigeantAssante di Panzillo Emmanuelle100% (1)
- Support Module 6 Contrôle Interne & Passation Des MarchésDocument16 pagesSupport Module 6 Contrôle Interne & Passation Des MarchésJacques GAGNONPas encore d'évaluation
- Méthodologie Générale: Prise de Connaissance de L'entrepriseDocument27 pagesMéthodologie Générale: Prise de Connaissance de L'entrepriseAhmed AhmedPas encore d'évaluation
- Gouvernance de L'entreprise Et Cadre Légal de L'audit Dans La Zone Euro Méditerranéenne - Une Comparaison Entre La France Et Les Pays de La Méditerranée ArabeDocument34 pagesGouvernance de L'entreprise Et Cadre Légal de L'audit Dans La Zone Euro Méditerranéenne - Une Comparaison Entre La France Et Les Pays de La Méditerranée ArabeWahib LahnitiPas encore d'évaluation
- Ifrs 6Document9 pagesIfrs 6MIKOU KIMOU100% (1)
- Rapport Sénat Evasion FiscaleDocument809 pagesRapport Sénat Evasion FiscaleFabrice Borel-MathurinPas encore d'évaluation
- Infos Utiles Pour Postuler Au DoctoratDocument8 pagesInfos Utiles Pour Postuler Au DoctoratElMoatassimTasbihePas encore d'évaluation
- Rapport CIDocument5 pagesRapport CIkarimaelPas encore d'évaluation
- Les Critères de La Bonne GouvernanceDocument18 pagesLes Critères de La Bonne GouvernanceMohammed JabranePas encore d'évaluation
- ,NNDocument12 pages,NNloubnaPas encore d'évaluation
- Analyse Des Couts Des Programmes Et Des Actions de Politique PubliqueDocument25 pagesAnalyse Des Couts Des Programmes Et Des Actions de Politique PubliqueAli SYLLAPas encore d'évaluation
- Apports Et Principes D'un Tableau de Bord Cabinet D'expertiseDocument49 pagesApports Et Principes D'un Tableau de Bord Cabinet D'expertiseImane Emy100% (1)
- 660-Article Text-2494-1-10-20210106Document21 pages660-Article Text-2494-1-10-20210106Ouma100% (1)
- Projet de Gouvernance Locale Au MarocDocument348 pagesProjet de Gouvernance Locale Au MarocPapis Wesh100% (1)
- 133-Texte de L'article-330-1-10-20201113Document18 pages133-Texte de L'article-330-1-10-20201113TAOUFIK ESSAIHPas encore d'évaluation
- Methodologie Enquete Questionnaire With Cover Page v2Document57 pagesMethodologie Enquete Questionnaire With Cover Page v2zaki zaki100% (2)
- Rapport Stage DESS ACGDocument41 pagesRapport Stage DESS ACGRadoaune ElhibaouiPas encore d'évaluation
- FrenchDocument194 pagesFrenchelimbi ndoumbe emmanuelPas encore d'évaluation
- Plaquette DU GFCDocument9 pagesPlaquette DU GFCOUISSAL EL HILALIPas encore d'évaluation
- Le Contrôle FinancierDocument43 pagesLe Contrôle FinancierAfaf Ismaili100% (1)
- Le Controle Interne Et La Responsabilite Du Dirigeant Dans L'associationDocument57 pagesLe Controle Interne Et La Responsabilite Du Dirigeant Dans L'associationCamy SoPas encore d'évaluation
- MemoireDocument29 pagesMemoireBakayoko Aboubakar100% (1)
- Mémoire Finale Lynda Faiza YflhDocument149 pagesMémoire Finale Lynda Faiza YflhAli BlmPas encore d'évaluation
- Memoire IMAS Amessinou KossiDocument86 pagesMemoire IMAS Amessinou Kossicalipsooujda100% (1)
- PFE FinalDocument139 pagesPFE FinalChaïmaâ El GhorriPas encore d'évaluation
- Convergence Des Normes D'audit Dans Le Secteur PublicDocument20 pagesConvergence Des Normes D'audit Dans Le Secteur PublicInternational Consortium on Governmental Financial ManagementPas encore d'évaluation
- Le Marketing Et L'environnementDocument42 pagesLe Marketing Et L'environnementYoucef BenjillaliPas encore d'évaluation
- Audit Légal - PR - Kaoutar El Menzhi PDFDocument189 pagesAudit Légal - PR - Kaoutar El Menzhi PDFanasPas encore d'évaluation
- L'auditeur Interne Et Les Algorithmes d'IADocument11 pagesL'auditeur Interne Et Les Algorithmes d'IAzogo felixPas encore d'évaluation
- FINANCES PUBLIQUES CONTROL, EVALUATION ET Et AUDIT DE BUDGETDocument29 pagesFINANCES PUBLIQUES CONTROL, EVALUATION ET Et AUDIT DE BUDGEToussamaPas encore d'évaluation
- Ifrs - Encg PDFDocument20 pagesIfrs - Encg PDFSaid Rudani100% (2)
- Les Documents de Synthèse de L'entrepriseDocument50 pagesLes Documents de Synthèse de L'entrepriseBassirou ToéPas encore d'évaluation
- Performance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsD'EverandPerformance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsPas encore d'évaluation
- 51775-Que Devrait Comprendre Un BudgetDocument3 pages51775-Que Devrait Comprendre Un BudgetmadjidaknPas encore d'évaluation
- Essai D'Analyse Des Contrats de Travail À Durée Indéterminée de La Radio Et La Télévision Publiques AlgériennesDocument17 pagesEssai D'Analyse Des Contrats de Travail À Durée Indéterminée de La Radio Et La Télévision Publiques AlgériennesmadjidaknPas encore d'évaluation
- 02 PropositionsDocument32 pages02 PropositionsmadjidaknPas encore d'évaluation
- 12Document2 pages12madjidaknPas encore d'évaluation
- Nouveau Manuel de Procedure DMPDocument192 pagesNouveau Manuel de Procedure DMPmadjidaknPas encore d'évaluation
- Outil Comptable Corrige 211113-2Document467 pagesOutil Comptable Corrige 211113-2madjidaknPas encore d'évaluation
- Cahier Charges Audit InterneDocument4 pagesCahier Charges Audit Internemadjidakn100% (2)
- Méthodes de Recherche en Management by ImihiDocument618 pagesMéthodes de Recherche en Management by ImihiSalma Nouni100% (3)
- Macadabre OdtDocument2 pagesMacadabre Odtjean reuhPas encore d'évaluation
- 2021 03 Metro Sujet1 ExoB BoissonHydratation 5pts CorrectionDocument6 pages2021 03 Metro Sujet1 ExoB BoissonHydratation 5pts CorrectionYoram JdlPas encore d'évaluation
- Bodies York Rite Structure GlufmmmoscDocument6 pagesBodies York Rite Structure GlufmmmoscMatthieu LUBOYAPas encore d'évaluation
- Programmation Linéaire en Nombres Entiers Pour L'ordonnancement Modulo Sous Contraintes de Ressources.Document75 pagesProgrammation Linéaire en Nombres Entiers Pour L'ordonnancement Modulo Sous Contraintes de Ressources.Med GasPas encore d'évaluation
- 3 - DéglutitionDocument17 pages3 - DéglutitionouazzanyPas encore d'évaluation
- M2 - Mémoire - SR ModifDocument121 pagesM2 - Mémoire - SR ModifSandra RebolledoPas encore d'évaluation
- JNGG 2012 519 PDFDocument8 pagesJNGG 2012 519 PDFFaci AliPas encore d'évaluation
- DS Elec n1Document4 pagesDS Elec n1Zac RajayiPas encore d'évaluation
- BIOLOGIE1TD3groupes3 4 5et6L1Geo21Document4 pagesBIOLOGIE1TD3groupes3 4 5et6L1Geo21aqua FishPas encore d'évaluation
- Sujet Certification Octobre 2015 Validé 2Document5 pagesSujet Certification Octobre 2015 Validé 2fatoutraore2345Pas encore d'évaluation
- Fiche MethodeDocument3 pagesFiche MethodeLoundou ortegaPas encore d'évaluation
- La Bénédiction Du Sel Et de L'eauDocument2 pagesLa Bénédiction Du Sel Et de L'eauThamai100% (1)
- Emeka Et Le Vieil Homme - Nwanne Felix-EmeribeDocument14 pagesEmeka Et Le Vieil Homme - Nwanne Felix-EmeribeSara CANO CARRATALÁPas encore d'évaluation
- Le Colonel Si Sadek Est Mort Le Matin DZDocument3 pagesLe Colonel Si Sadek Est Mort Le Matin DZxeres007Pas encore d'évaluation
- Les Yowlè - Recherche GoogleDocument1 pageLes Yowlè - Recherche Googlekouameulysse0Pas encore d'évaluation
- TD Dualité 2021Document2 pagesTD Dualité 2021AYMANE JAMAL100% (1)
- Spasmocalm 80mgDocument4 pagesSpasmocalm 80mgSmile ForeverPas encore d'évaluation
- Cours Droit Des Stes CommercialesDocument82 pagesCours Droit Des Stes CommercialesMohamed Moudine100% (1)
- 1 Rapport de SSTDocument3 pages1 Rapport de SSTAbdellahPas encore d'évaluation
- La Trame Se Soigner Par Lénergie Du Monde (French Edition) (Patrick Burensteinas) (Z-Library)Document96 pagesLa Trame Se Soigner Par Lénergie Du Monde (French Edition) (Patrick Burensteinas) (Z-Library)Rahman100% (1)
- Correction SERIE EXERCICES TP3Document5 pagesCorrection SERIE EXERCICES TP3Khlifi AyoubPas encore d'évaluation
- Enon SuitesDocument26 pagesEnon SuitesLOUNDOU orthegaPas encore d'évaluation
- Management HospitalierDocument4 pagesManagement HospitalierAli Lemrabet0% (1)
- Plaquette Des EnseignementsDocument17 pagesPlaquette Des Enseignementsabdul.rahmanprivate.box2022Pas encore d'évaluation
- (Aristote) de La G?n?ration Des AnimauxDocument461 pages(Aristote) de La G?n?ration Des AnimauxFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- Rendu Approche Documentaire BRUN Tom CARNIAUX FabienDocument8 pagesRendu Approche Documentaire BRUN Tom CARNIAUX FabienFafabi ibafaFPas encore d'évaluation
- Reflexion Sur Le Style Néo Mauresque en AlgérieDocument53 pagesReflexion Sur Le Style Néo Mauresque en AlgérieMARWA BOUPas encore d'évaluation