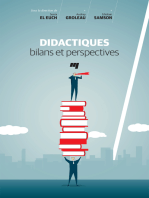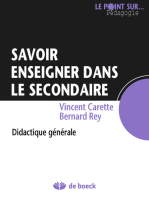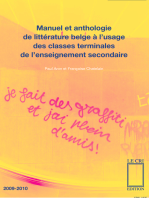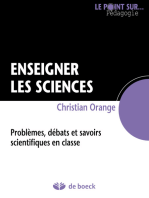Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
JP Cuq Concepts Didactiques
JP Cuq Concepts Didactiques
Transféré par
Mayssa RjaibiaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
JP Cuq Concepts Didactiques
JP Cuq Concepts Didactiques
Transféré par
Mayssa RjaibiaDroits d'auteur :
Formats disponibles
71
het instrueren van de student niet meer gebruik maken van het Spaans lijkt ons evenwel
een gemiste kans. Niettemin schenkt As es 1 de cursist genoeg autonomie, kennis en
vaardigheid om van hem een competente taalgebruiker te maken.
Pilar Molina Gmez
Jean-Pierre CUQ, Isabelle GRUCA, Cours de didactique du franais langue
trangre et seconde, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2002,
454 p., 30.
Enfin un cours de didactique du franais langue trangre et secon-
de et qui fait le poids !
Ds sa parution en mai 2002, le Cours de didactique du franais langue trangre et seconde
(CDFLES) de Cuq et Gruca fut salu comme une sorte de dcathlon de la pense, une
somme que nul ne pourra plus contourner par la revue Le Franais dans le Monde
(FDM), qui enchana : Il fallait un courage de marchal dempire et une conviction
cheville pour entreprendre un aussi gigantesque travail
1
.
Comme le public attendait visiblement ce type douvrage avec impatience, le succs
commercial ne se fit pas attendre et aprs quelques mois seulement il fallut dj proc-
der une rimpression. Certes, ce nest pas le tout premier cours ou manuel de didacti-
que du FLES.
2
Seulement, les ouvrages existants constituent des tentatives, depuis
longtemps dpasses, qui plissent ct de la synthse magistrale que viennent de
publier nos collgues franais.
Les auteurs
Les auteurs sont tous deux des didacticiens chevronns. Jean-Pierre Cuq, qui nous
devions dj e.a. un classique bien connu Le franais langue seconde (Cuq, 1991) et une
remarquable Introduction la didactique de la grammaire en FLE (Cuq, 1996), est actuelle-
ment professeur de didactique du FLE lUniversit de Provence et Prsident de
lAssociation pour la Diffusion du franais langue trangre (ASDIFLE).
Isabelle Gruca, de son ct, enseigne galement la didactique du FLE luniversit
internationale dt de Nice-Sophia Antinopolis, dont elle est la directrice. Elle a fait un
doctorat sur un sujet minemment didactique Les textes littraires dans lenseignement du
FLE - tude de didactique compare (Gruca, 1993). Comme didacticiens expriments, les
deux auteurs sont donc particulirement bien placs pour apprhender le champ avec le
recul ncessaire, de faon panoramique.
1
Cours de didactique du franais langue trangre et seconde de Cuq et Gruca, (2002), compte rendu
dans le Franais dans le Monde, 323, sept.-octobre, 84 et descriptif dans Point Commun, 18, 36. Pour ce qui
est de la didactique du franais langue seconde, en revanche, il existe des ouvrages assez rcents (Cuq,
1991 et Vigner, 2000). Les notions de langue trangre et langue seconde seront clarifies ci-dessous.
2
Songeons e.a. aux livres sur la didactique du FLE de Decoo (1982) pour le domaine nerlandophone et
louvrage de Rivers (1975) pour le domaine anglo-saxon.
72
Public-cible et justification
Louvrage sadresse aux tudiants, aux jeunes chercheurs et aux enseignants en forma-
tion continue. Voici comment les auteurs justifient leur publication : Aprs bientt
vingt annes dexistence des formations universitaires en franais langue trangre et de
leur extraordinaire succs auprs des tudiants, il nous a paru utile de mettre leur
disposition un ouvrage qui donne un aperu gnral des connaissances actuelles dans ce
domaine, et qui soit pour eux une sorte de manuel dans lequel ils puissent trouver
lessentiel des rfrences utiles leur formation (p. 8).
Articulation
Le CDFLES adopte une structure quelque peu arborescente et comprend trois parties,
allant du plus gnral, du plus abstrait, du plus thorique, du niveau mta ou macro au
plus concret, au plus pratique, au niveau micro.
Dans la premire partie, Le niveau mtadidactique, les auteurs essaient de crer un cadre
de rfrence, de structurer et de dlimiter le champ du franais langue trangre et
seconde par rapport ses disciplines de rfrence et la didactique des langues trang-
res et secondes en gnral. Ils passent en revue les principaux acteurs institutionnels,
dcrivent les diverses situations dapprentissage et denseignement, la classe et ses ac-
teurs : les apprenants et les enseignants, tout en clarifiant les concepts-clefs relevant du
champ de la didactique du FLES, comme la didactologie des langues et des cultures.
Cette dnomination a t lance par R. Galisson qui voulait associer ainsi de faon plus
troite le binme indissociable langue-culture.
Le niveau mthodologique constitue la deuxime partie. Elle comprend une prsentation
des quatre comptences fondamentales ; elle dcrit quelques concepts mthodologiques
de base et quelques outils de rfrence incontournables, comme le franais fondamen-
tal, un niveau-seuil, le cadre europen commun de rfrence, le portfolio europen des
langues ; elle consacre ensuite presque tout un chapitre lvaluation, au problme des
certifications, des chelles de niveaux et des tests. Les mthodologies et mthodes tra-
ditionnelles et non conventionnelles sont dcrites, sans oublier le franais sur objectifs
spcifiques (FOS) qui fait lobjet de tout un paragraphe.
Le niveau technique, celui de la pdagogie, des approches et des dmarches didactiques
concrtes, est trait dans la troisime partie ; elle prsente les diffrents domaines de
connaissance : la grammaire, la traduction, le lexique. Le deuxime chapitre est rserv
la littrature et aux documents authentiques, alors que le dernier examine les pratiques
dintervention en classe (typologie dactivits et dexercices) et les supports technolo-
giques (du tableau jusquau multimdia).
Clart et richesse des informations
Un Cours de didactique se doit de recourir un discours didactique, cest--dire vulgarisa-
teur, clair et comprhensible. Ce qui frappe demble en effet, cest ce souci de clart
qui se manifeste dans larchitecture gnrale de louvrage, dans lagencement judicieux
des paragraphes et alinas, mais galement dans le style et dans la prcision des dfini-
tions. Cette prcision, on la retrouve mme dans la dfinition de concepts qui parais-
sent simples et transparents premire vue comme FLE, apprendre une langue
trangre, langue seconde et langue maternelle :
Le franais est une langue trangre pour tous ceux qui, ne le reconnaissant pas
73
comme langue maternelle, entrent dans un processus plus ou moins volontaire dappro-
priation et pour tous ceux qui, quils le reconnaissent ou non comme langue maternelle,
en font lobjet dun enseignement des parleurs non natifs (C&G, 93).
Apprendre une langue trangre ne signifie plus simplement acqurir un savoir
linguistique, mais savoir sen servir pour agir dans cette langue et savoir oprer un
choix entre diffrentes expressions possibles lies aux structures grammaticales et au
vocabulaire qui sont subordonns lacte que lon dsire accomplir et aux paramtres
qui en commandent la ralisation (C&G 197).
La collocation langue seconde a en fait deux acceptions. Cuq reprend la dfinition la
plus stricte de son livre de 1991. Il dsigne le franais parl notamment dans les
rgions du monde (e.a. lAfrique), o cette langue, tout en ntant pas la langue mater-
nelle de la majorit de la population, nest pas une langue trangre comme les autres,
que ce soit pour des raisons statutaires ou sociales . Le franais y est donc une langue
de scolarisation. En Belgique, en revanche, on utilise gnralement langue seconde
dans un sens plus large, issu de la sociolinguistique anglo-saxonne , cest--dire tout
systme acquis chronologiquement aprs la langue premire (C&G, 95)
3
.
On peut donc appeler langue maternelle une langue qui, acquise lors de sa premire
socialisation et ventuellement renforce par un apprentissage scolaire, dfinit prioritai-
rement pour un individu son appartenance un groupe humain et laquelle il se rfre
plus ou moins consciemment lors de tout apprentissage linguistique (C&G 93).
Chaque chapitre est assorti dune bibliographie succincte rcente (Pour en savoir plus),
alors quune Bibliographie gnrale clt le volume. Le lecteur apprciera aussi particulire-
ment les prcieuses Annexes avec le Matriel didactique de franais langue trangre et le
Tableau des mthodes de franais sur objectifs spcifiques (FOS) publies en France, clairement
structures avec chaque fois une fiche signaltique de louvrage en question, le public-
cible, etc.
Ides innovantes, prises de position tranches
Le CDFLES comprend toute une srie de notions ou dides nouvelles qui viennent
enrichir le champ de la didactique FLES et dont quelques-unes mritent dtre signales
titre dexemple. La notion de posture dapprentissage, par exemple, est introduite
par Cuq et Gruca, lopposition culture cultive et culture anthropologique, en
revanche, est une distinction emprunte Bourdieu.
Le concept de posture dapprentissage recouvre de faon large ce quon appelle en psy-
chologie la motivation, ou ensemble des phnomnes dont dpend la stimulation agir
pour atteindre un objectif dtermin (C&G, 138).
La culture est certes la littrature, la musique, la peinture, etc., tout ce quon runit
depuis Bourdieu sous lappellation de culture cultive, mais aussi toutes les faons de vivre
et de se conduire, quon runit sous le nom de culture anthropologique. En ce sens, pour
Louis Porcher une culture est un ensemble de pratiques communes, de manires de
voir, de penser et de faire qui contribuent dfinir les appartenances des individus,
3
Remarquons quen Flandre le franais a longtemps revtu un statut de langue seconde. Ctait la langue
de scolarisation, de ladministration, de larme pour les Flamands jusqu la deuxime guerre mondiale
environ. Voil pourquoi on dit souvent que le franais devient de plus en plus une langue trangre en
Flandre .
74
cest--dire les hritages partags dont ceux-ci sont les produits et qui constituent une
partie de leur identit. (C&G, 83). Cette conception de la culture qui doit faire partie
de la comptence (inter)culturelle de lapprenant se substitue donc progressivement
lancienne notion de civilisation.
Selon C&G (86), la classe doit prendre en charge non seulement la partie de la culture
cultive propre la langue tudie, mais aussi fournir les lments de la culture anthro-
pologique quon a dit ncessaires son appropriation correcte .
Dautres concepts-clefs, qui mriteraient dtre mentionns dans ce compte rendu sont,
par exemple, la coconstruction du savoir (128),
4
la progression multidimension-
nelle (187)
5
, linscurit linguistique et culturelle (138)
6
, la comptence dvalua-
tion (149)
7
, la lexiculture (370)
8
, etc.
En ce qui concerne lenseignement du lexique, on se rjouit de constater que les con-
ceptions psycholinguistiques soient mentionnes aussi bien que les aspects mthodolo-
giques, et que lon cite les conclusions de Bogaards (1994, 92) comme autant dencou-
ragements linterventionnisme :
- les tches difficiles mnent des traces mmorielles mieux tablies que les tches faci-
les ; par consquent, si on apprend par raisonnement, on apprend mieux que par rpti-
tion ;
- plus la description ou la trace est riche, dtaille et prcise, plus elle a de chances
dtre retrouve, rutilise et, par ce fait mme renforce ;
- les tches significatives, celles o lapprenant est impliqu personnellement, provo-
quent un apprentissage bien plus efficace ;
- le contenu significatif est un facteur de premire importance dans tout apprentissage
verbal.
Saluons enfin ladmirable synthse que constitue Une approche possible du texte littraire ou
un parcours tapes (380-385), qui se termine par un ardent plaidoyer pour le texte litt-
raire : Lieu de croisement des langues et des cultures, lespace littraire est galement
un espace de plaisir et de libert qui invite lpanchement de laffectivit, de la sensi-
4
Par consquent nous dirons quen classe de langue comme dans les autres situations denseignement/
apprentissage, le travail de didactisation consiste pour le matre compresser ses savoirs pour en faire
des informations opratoires, qui, traites par lapprenant au moyen doutils thoriques, deviendront
pour lui des savoirs authentiques, si elles se manifestent par des savoir-faire. Cest cette opration que
nous appelons coconstructions des savoirs .
5
La progression est lexemple type dun concept qui a failli disparatre (). On peut dire pour schma-
tiser, quon est pass dune conception linaire, une conception en spirale, et, aujourdhui une
conception polycentre, plus complexe, voire, selon Danielle Bailly, multidimensionnelle . Cf. galement
lexcellent ouvrage de Borg (2001) ce sujet.
6
En ce qui concerne les professeurs non natifs, leur connaissance de la langue et de la culture fran-
aises est donc variable, et beaucoup partagent avec leurs lves une certaine inscurit linguistique et cultu-
relle .
7
Il existe, selon nous, une cinquime comptence, transversale aux quatre autres : cest la comptence
dvaluation. En effet, toute communication implique valuation. Quand on parle, quand on crit, laudi-
toire ou les lecteurs valuent notre production. Quand on lit ou quand on coute, on value la produc-
tion des autres. Accent, dbit, particularits de la syntaxe et du vocabulaire, tout dvoile lorigine provin-
ciale ou trangre, lappartenance sociale, les intentions La comptence valuative est donc, au mme titre
que les quatre comptences classiques, une composante fondamentale de la communication .
8
Cette option pdagogique dentrer dans la culture par les mots afin de solidariser et dintgrer langue
et culture dans un mme enseignement/apprentissage a t formalise par Robert Galisson .
75
bilit, et au dploiement de limaginaire. Lapprenant, au centre de cette approche, peut
engager toute sa personnalit et son vcu dans la construction du sens, condition quil
soit guid et quon lui donne les moyens dtablir une connivence avec lobjet texte et
de se construire dans la culture dont il apprend la langue trangre (C&G, 387).
Un autre mrite du CDFLES que nous aimerions souligner est quaucun problme
didactique plus ou moins dlicat nest esquiv, que ce soit lemploi du mtalangage dans
la classe de langue, lenseignement prcoce des langues vivantes ou le problme de la
correction en classe.
Conclusions et suggestions
Ds lintroduction (C&G, 7), les auteurs nous prviennent : Compte tenu de lobjectif
de ce livre, il ne saurait bien entendu tre question dexhaustivit, et sans doute des lec-
teurs avertis pourront-ils nous reprocher juste raison davoir nglig tel ou tel apport
jug par dautres important . Faire une synthse dun champ aussi vaste en quelque 450
pages, constitue un dfi de taille que les auteurs ont relev avec panache. Peut-on ds
lors parler de lacunes ? Non, tout au plus dabsences plus ou moins regrettables, parfois
de choix sujets caution. Signalons-en tout de mme quelques-uns, forcment subjec-
tifs.
Les stratgies dapprentissage et de communication (compensatoire) sont peu reprsen-
tes, la prsence des TICE est fort discrte. Limpact des prsupposs des apprenants
sur leurs processus dapprentissage nest pas pass sous silence, mais peu dvelopp.
Lapprentissage coopratif et autodirig ainsi que lenseignement bas sur les tches
(task based learning) mriteraient sans doute de figurer dans les mthodologies non con-
ventionnelles, davantage mme que la suggestopdie. La version dun niveau-seuil pour
publics scolaires aurait pu tre mentionne. Constat rjouissant, la littrature anglo-
saxonne nest pas ignore, loin de l, mais on aurait pu sattendre ctoyer galement
certaines figures de proue de la didactique des langues trangres et du domaine du
Second Language Acquisition, comme M. Lewis, M. Long, D. Nunan, P. Skehan ou P. Ur.
La conjonction de coordination et dans le titre Cours de didactique du franais langue tran-
gre et seconde pourrait faire croire que les deux publics FLE et FLS sont cibls de faon
plus ou moins gale. Or, cest surtout du FLE quil sagit. Pour le FLS il faut consulter
Cuq (1991) ou Vigner (2000).
On pourrait stonner de constater que les domaines de connaissance, comme la gram-
maire, le lexique, la littrature, soient relgus au niveau technique, alors que les com-
ptences langagires relvent du niveau mthodologique. Ne sagit-il pas dune discrimi-
nation peu justifie ? Personnellement nous aurions prfr limiter le niveau technique
au dernier chapitre du livre, consacr aux outils de la classe.
Le revers de la mdaille dun CDFLES universaliste, qui sadresse un public trs large
de professeurs de franais, enseignant partout dans le monde, cest quil est impossible
de rendre compte des contextes instructionnels locaux, si importants et parfois si diff-
rents avec leurs propres ressources, contraintes, programmes dtudes, etc. Il tait vi-
demment impossible pour les auteurs den tenir compte, ce qui nest dailleurs pas telle-
ment grave. Chaque professeur peut facilement adapter les principes du CDFLES sa
situation particulire partir de son exprience. Les auteurs lui fournissent le cadre de
rfrence, les outils et les concepts ncessaires pour ce faire.
76
On rve dj dune seconde dition du CDFLES qui soit assortie dun index et dun
lexique avec la dfinition de tous les concepts-clefs.
9
Afin dautonomiser et de respon-
sabiliser lutilisateur et dadopter une approche interactive, on pourrait ajouter des
sujets de rflexion et de discussion, comme cest dj la tradition dans le monde anglo-
saxon,
10
offrir des pistes dexploitation plus concrtes (typologie dactivits, grille dva-
luation des ressources didactiques, etc.). Bref, tout un programme !
Nous sommes convaincu que ce joyau didactique rendra dminents services de nom-
breux professeurs, tudiants dans leur formation initiale, formateurs et formateurs de
formateurs, didactologues/didacticiens, conseillers pdagogiques, attach(e)s linguisti-
ques, inspecteurs, auteurs de manuels, etc. On ne peut que savoir gr aux auteurs
davoir mis un outil si prcieux la disposition des lecteurs.
Jean Binon
Institut interfacultaire des langues vivantes
Agrgation en langues romanes
Universit Catholique de Leuven (Belgique)
BIBLIOGRAPHIE
BOGAARDS P., (1994), Le vocabulaire dans l'apprentissage des langues trangres, Collection
Langues et Apprentissage des Langues, Paris, Hatier-Didier
BORG S., (2001), La notion de progression, Paris, Hatier-Didier
COSTE R., GALISSON R., (1976), Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette,
Collection F
CUQ J. P., (1996), Introduction la didactique de la grammaire en FLE, Paris, Didier-Hatier
(CDFLES) : CUQ J. P., GRUCA I., (2002), Cours de didactique du franais langue trangre et
seconde, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble
CUQ, J. P., (1991), Le franais langue seconde, Paris, Hachette
DECOO W.,(1982), Didactiek van het Frans als vreemde taal, Lier Van In
GRUCA I., (1993), Les textes littraires dans lenseignement du FLE - tude de didac-
tique compare, thse de doctorat, Universit Stendhal-Grenoble 3
RIVERS W., (1975) A practical guide to the teaching of French, New York, Oxford Univer-
sity Press
ROBERT J. P., (2002), Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Paris, Ophrys
TREVILLE M. C., & DUQUETTE L., (1996), Enseigner le vocabulaire en classe, Paris,
Hachette
VIGNER G., (2000): Enseigner le franais comme langue seconde. Paris , CLE International
9
Nous croyons savoir que J. P. Cuq prpare avec toute une quipe un dictionnaire de didactique FLES
qui devrait sortir sous peu. Le CDFLES aura donc bientt son Lexique. La publication de ce diction-
naire rjouira dautant plus les lecteurs, quon na plus dit douvrages de ce genre depuis Coste et
Galisson, (1976), sauf le Dictionnaire pratique de didactique du FLE de Robert (2002), de taille fort modeste
et de qualit douteuse, il est vrai (176 p.).
10
Par exemple Trville et Duquette (1996).
Vous aimerez peut-être aussi
- Chapitre 11 - La Méthode SGAVDocument20 pagesChapitre 11 - La Méthode SGAVDaniela SantosPas encore d'évaluation
- Démarche de La Conception Dun Cours de FosDocument6 pagesDémarche de La Conception Dun Cours de FosAssia RafaPas encore d'évaluation
- Mouvements LitterairesDocument2 pagesMouvements LitterairesCaiusGracchus90% (10)
- Acquisition D'une Langue ÉtrangereDocument23 pagesAcquisition D'une Langue Étrangeremiguel angel meza ruedaPas encore d'évaluation
- Les dimensions linguistiques de toutes les matières scolaires: Guide pour l'élaboration des curriculums et pour la formation des enseignantsD'EverandLes dimensions linguistiques de toutes les matières scolaires: Guide pour l'élaboration des curriculums et pour la formation des enseignantsPas encore d'évaluation
- DA SILVA SANTOS - Headson - Rogers - Anthropologie Culturelle Et Enseignement Des Langues ÉtrangèresDocument6 pagesDA SILVA SANTOS - Headson - Rogers - Anthropologie Culturelle Et Enseignement Des Langues ÉtrangèresHeadson SantosPas encore d'évaluation
- Fiches Pédagogiques Des Cours de M2 Du Master de FLEDocument11 pagesFiches Pédagogiques Des Cours de M2 Du Master de FLETewodrosPas encore d'évaluation
- 50 Exercices Pour PRDocument9 pages50 Exercices Pour PRealainfl56% (9)
- Textarbeit La Tonalite Du TexteDocument3 pagesTextarbeit La Tonalite Du TexteealainflPas encore d'évaluation
- Plan de Cours SIO-2102Document13 pagesPlan de Cours SIO-2102Jorge D. NontolPas encore d'évaluation
- Eribon Didier - Michel FoucaultDocument68 pagesEribon Didier - Michel FoucaultNicolás Idigoras89% (9)
- Livret Colloque Diltec Juin-2012 108pDocument108 pagesLivret Colloque Diltec Juin-2012 108pSony PsPas encore d'évaluation
- RA51 - Didactiques de L Écrit-9-33Document25 pagesRA51 - Didactiques de L Écrit-9-33Natalia Massei100% (1)
- PUREN 2004c Unité Didactique EntréesDocument10 pagesPUREN 2004c Unité Didactique EntréesjorgePas encore d'évaluation
- 4 - L'approche CommunicativeDocument65 pages4 - L'approche CommunicativeMerve Acer100% (1)
- Voies multiples de la didactique du français: Entretiens avec Suzanne-G. Chartrand, Jean-Louis Chiss et Claude GermainD'EverandVoies multiples de la didactique du français: Entretiens avec Suzanne-G. Chartrand, Jean-Louis Chiss et Claude GermainPas encore d'évaluation
- Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelleD'EverandGuide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et interculturellePas encore d'évaluation
- Littératie : vers une maîtrise des compétences dans divers environnementsD'EverandLittératie : vers une maîtrise des compétences dans divers environnementsPas encore d'évaluation
- Savoir enseigner dans le secondaire: Didactique généraleD'EverandSavoir enseigner dans le secondaire: Didactique généralePas encore d'évaluation
- Manuel et anthologie de littérature belge à l’usage des classes terminales de l’enseignement secondaire: Manuel scolaireD'EverandManuel et anthologie de littérature belge à l’usage des classes terminales de l’enseignement secondaire: Manuel scolairePas encore d'évaluation
- Orthographe et populations exceptionnelles: perspectives didactiquesD'EverandOrthographe et populations exceptionnelles: perspectives didactiquesPas encore d'évaluation
- Manuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littéraireD'EverandManuel et anthologie de littérature belge à l'usage des classes terminales de l'enseignement secondaire: Anthologie littérairePas encore d'évaluation
- Enseigner les sciences: Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classeD'EverandEnseigner les sciences: Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classePas encore d'évaluation
- Bajrić - Proces 5+Document16 pagesBajrić - Proces 5+MarijaDomovićPas encore d'évaluation
- Module1 1 PDFDocument46 pagesModule1 1 PDFMadalina ZahariaPas encore d'évaluation
- Cours 2 Khaled Hegazi Les MethodologiesDocument29 pagesCours 2 Khaled Hegazi Les Methodologiesmohamed100% (1)
- Le Cadre Europeen Evolutions Visibles deDocument422 pagesLe Cadre Europeen Evolutions Visibles deSmiljaPas encore d'évaluation
- Méthodologie Audiovisuelle EXERCICEDocument3 pagesMéthodologie Audiovisuelle EXERCICEAmjad Bani MaterPas encore d'évaluation
- PerspectiveationnelleBagnoliRuel PDFDocument16 pagesPerspectiveationnelleBagnoliRuel PDFpac81Pas encore d'évaluation
- MLF25Document151 pagesMLF25Il Principio CarinoPas encore d'évaluation
- Analyse Des Interferences PhonologiquesDocument24 pagesAnalyse Des Interferences PhonologiquesRitedje BouPas encore d'évaluation
- La Langue Et L'intégration Des ImmigrantsDocument25 pagesLa Langue Et L'intégration Des ImmigrantsRui Da VeigaPas encore d'évaluation
- La Méthode SGAVDocument17 pagesLa Méthode SGAVNvseem BtPas encore d'évaluation
- Résumé Pratique Du CECRDocument7 pagesRésumé Pratique Du CECRChiara SilvestroPas encore d'évaluation
- Introduction À La Sociodidactique: July 2022Document4 pagesIntroduction À La Sociodidactique: July 2022Firdaous HrfPas encore d'évaluation
- 3 Methodologie DirecteDocument2 pages3 Methodologie DirecteAnonymous vgCbHfEpPas encore d'évaluation
- Theorie 1Document9 pagesTheorie 1Güve RjîñPas encore d'évaluation
- Franc m3 2015Document130 pagesFranc m3 2015Anonymous h1vAgLWwjzPas encore d'évaluation
- TEME DIPLOME - Méthodes Et Méthodologies Pour L'enseignement Des Languesétrangères (L'exemple Du Français Langue Étrangère)Document38 pagesTEME DIPLOME - Méthodes Et Méthodologies Pour L'enseignement Des Languesétrangères (L'exemple Du Français Langue Étrangère)Teme Diplome100% (2)
- 07 - Ivan La Metode Structuro Global Audio VisuelleDocument5 pages07 - Ivan La Metode Structuro Global Audio VisuelledcolomesPas encore d'évaluation
- Histoire de La Didactique de Langues ÉtrangèresDocument45 pagesHistoire de La Didactique de Langues ÉtrangèresNashmy Rodríguez100% (1)
- Module Sur L'utilisation de La Vidéo en Classe de Français Langue Étrangère (Jean-Michel Ducrot) PDFDocument6 pagesModule Sur L'utilisation de La Vidéo en Classe de Français Langue Étrangère (Jean-Michel Ducrot) PDFErwan MorelPas encore d'évaluation
- Caslaru L Interlangue Des Apprenants Roumains de FleDocument262 pagesCaslaru L Interlangue Des Apprenants Roumains de FlerevedepierrePas encore d'évaluation
- 10 Jan Goes EntreDocument7 pages10 Jan Goes EntreTabitha SandersPas encore d'évaluation
- Dossier Français FLEDocument18 pagesDossier Français FLEtarisiaPas encore d'évaluation
- Berger Christelle m2r Fle 2013Document161 pagesBerger Christelle m2r Fle 2013Tabitha SandersPas encore d'évaluation
- Porcher - L'Enseignement de La CivilisationDocument9 pagesPorcher - L'Enseignement de La CivilisationludaninaPas encore d'évaluation
- 1ere Partie Cours Alternance Des Langues, Interactions Et Didactique Du PlurilinguismeDocument8 pages1ere Partie Cours Alternance Des Langues, Interactions Et Didactique Du PlurilinguismeLou-salomé Ferret RenevierPas encore d'évaluation
- FOS Francais Sur Objectifs Specifiques: SommaireDocument8 pagesFOS Francais Sur Objectifs Specifiques: SommaireRosana SosaPas encore d'évaluation
- Le Rôle Des Activités Ludiques en Grammaire DuDocument101 pagesLe Rôle Des Activités Ludiques en Grammaire DuGeanina CondreaPas encore d'évaluation
- Bibliographie de L'oralDocument2 pagesBibliographie de L'oraleugeniePas encore d'évaluation
- Vers Une Analyse Des ManuelsDocument7 pagesVers Une Analyse Des Manuelsdelbarco2Pas encore d'évaluation
- Referat Document VideoDocument4 pagesReferat Document Videoanon_231134432Pas encore d'évaluation
- La Linguistique Appliquée MLMDDocument9 pagesLa Linguistique Appliquée MLMDmanal.darifPas encore d'évaluation
- L Oral Dans La Classed e FleDocument23 pagesL Oral Dans La Classed e FleScoala Gimnaziala CalugareniPas encore d'évaluation
- BeaccoDocument7 pagesBeaccoEka KutateladzePas encore d'évaluation
- La Didactique de L'écrit, Une Question de Savoir Faire: Ghribi Sara Doctorant U-UDL - Sidi Bel Abbes (Algerie) RésuméDocument9 pagesLa Didactique de L'écrit, Une Question de Savoir Faire: Ghribi Sara Doctorant U-UDL - Sidi Bel Abbes (Algerie) RésuméelmatadorPas encore d'évaluation
- Actes Du Troisieme Colloque Internationa PDFDocument469 pagesActes Du Troisieme Colloque Internationa PDFmyaa2010Pas encore d'évaluation
- Tableau D Approches DidactiquesDocument3 pagesTableau D Approches DidactiquesmichoXPas encore d'évaluation
- Fiche FLEDocument5 pagesFiche FLEDanaé BoucheronPas encore d'évaluation
- Pédagogie Du Texte LittéraireDocument13 pagesPédagogie Du Texte LittérairejilalibenPas encore d'évaluation
- Master 2 FLE DEVOIRDocument7 pagesMaster 2 FLE DEVOIRValentina SanclerPas encore d'évaluation
- PUREN 2008e AC PA Culturel CoculturelDocument16 pagesPUREN 2008e AC PA Culturel CoculturelCassiPas encore d'évaluation
- Demarche Pedagogique de La Bande Dessinnee Dans La Classe de Franais LangueDocument131 pagesDemarche Pedagogique de La Bande Dessinnee Dans La Classe de Franais LangueM CPas encore d'évaluation
- Article Ekorong Sike HomoerotismeDocument15 pagesArticle Ekorong Sike HomoerotismeealainflPas encore d'évaluation
- Gendering TraumaDocument11 pagesGendering TraumaealainflPas encore d'évaluation
- Corps Inorganique Eko4Document11 pagesCorps Inorganique Eko4ealainflPas encore d'évaluation
- Corps Tech Eko 8Document7 pagesCorps Tech Eko 8ealainflPas encore d'évaluation
- Sciences de L'educationDocument4 pagesSciences de L'educationealainfl100% (1)
- Corps Tech Eko 7Document6 pagesCorps Tech Eko 7ealainflPas encore d'évaluation
- EcouteDocument10 pagesEcouteealainflPas encore d'évaluation
- Maternel Eko2Document11 pagesMaternel Eko2ealainflPas encore d'évaluation
- Conditions Postmodernes de La Litt AfriDocument19 pagesConditions Postmodernes de La Litt Afriealainfl100% (1)
- DadaDocument10 pagesDadaealainflPas encore d'évaluation
- Introduction Au Theatre Contemporain-3Document61 pagesIntroduction Au Theatre Contemporain-3ealainflPas encore d'évaluation
- Lart de La These - Avant - ProposDocument19 pagesLart de La These - Avant - ProposSalima TaherPas encore d'évaluation
- Narratologie Et SémantiqueDocument10 pagesNarratologie Et SémantiqueealainflPas encore d'évaluation
- Etude de L'oeuvre Integrale 1Document9 pagesEtude de L'oeuvre Integrale 1ealainflPas encore d'évaluation
- Art Poetique VerlaineDocument3 pagesArt Poetique VerlaineealainflPas encore d'évaluation
- CamfranglaisDocument8 pagesCamfranglaisealainflPas encore d'évaluation
- Annexe 07 - Argumentaire SanteDocument226 pagesAnnexe 07 - Argumentaire SanteKeith KelewouPas encore d'évaluation
- TD N°3 AutomatiqueDocument7 pagesTD N°3 AutomatiqueFadelPas encore d'évaluation
- Carte Arduino UnoDocument23 pagesCarte Arduino UnoSimou Zomi100% (1)
- ... Il Était Une Fois À Molenbeek-Saint-JeanDocument567 pages... Il Était Une Fois À Molenbeek-Saint-JeanAbd-Errahman E.Pas encore d'évaluation
- Pourquoi Pas L'allemand en LV2Document72 pagesPourquoi Pas L'allemand en LV2collegevictorhugodegisorsPas encore d'évaluation
- Cours - Construire Une Frise ChronologiqueDocument5 pagesCours - Construire Une Frise ChronologiqueWon SeoPas encore d'évaluation
- TP Sur GLPIDocument6 pagesTP Sur GLPIdebisoPas encore d'évaluation
- TP CAO DAO CATIA Vanne PDFDocument15 pagesTP CAO DAO CATIA Vanne PDFTimo ShmittPas encore d'évaluation
- Rapport de PFEDocument102 pagesRapport de PFEbojojooooPas encore d'évaluation
- Comptabilite GeneraleDocument7 pagesComptabilite Generaleعبدالوهاب بنعبداللهPas encore d'évaluation
- Revue Conscience Soufie N1 WebDocument28 pagesRevue Conscience Soufie N1 WebdonkonkeePas encore d'évaluation
- CTRL PropositionfDocument2 pagesCTRL PropositionfboulaichPas encore d'évaluation
- Rediger Un Compte Rendu de TPDocument2 pagesRediger Un Compte Rendu de TPsabahsousou100% (2)
- ANTI-DOULEUR-9-4400-Traitement Tendinopathie RotulienneDocument3 pagesANTI-DOULEUR-9-4400-Traitement Tendinopathie RotulienneDDN1967Pas encore d'évaluation
- Environnement Et Organisation-Des-EntreprisesDocument47 pagesEnvironnement Et Organisation-Des-EntreprisesfouadPas encore d'évaluation
- Dalf c1 Grille PeDocument2 pagesDalf c1 Grille PePatrice ArmelPas encore d'évaluation
- Catalogue GARGAT Basse DefDocument36 pagesCatalogue GARGAT Basse DefJudith Sitbon100% (1)
- Fiche 24 - Les Dispositifs de L'aide Sociale À L'enfanceDocument4 pagesFiche 24 - Les Dispositifs de L'aide Sociale À L'enfancejohn ferdsonPas encore d'évaluation
- 490DCADFd01Document71 pages490DCADFd01Marouane El KiassePas encore d'évaluation
- Geologie de Lingenieur Et Geotechnique M1 - Deliberation - 2022 - 2023 18 PDFDocument4 pagesGeologie de Lingenieur Et Geotechnique M1 - Deliberation - 2022 - 2023 18 PDFZinn DinnePas encore d'évaluation
- 1.decimaux 6emeDocument6 pages1.decimaux 6emeMifTàri ÉdisonPas encore d'évaluation
- Rodier - Qualité de L'eauDocument31 pagesRodier - Qualité de L'eaubaba abouPas encore d'évaluation
- Exam Corrigés QCMDocument14 pagesExam Corrigés QCMpjq9nrbjwjPas encore d'évaluation
- WORKBOOKDocument11 pagesWORKBOOKNoah BrabantPas encore d'évaluation
- GriseyDocument34 pagesGriseyNazario AugustoPas encore d'évaluation