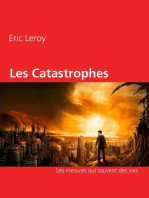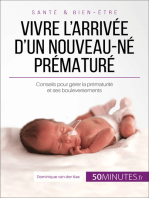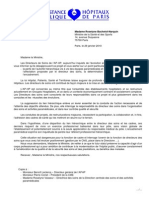Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Administateur de Garde Hospitalier
Transféré par
MuhetoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Administateur de Garde Hospitalier
Transféré par
MuhetoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
1
MEMENTO DE
LADMINISTRATEUR DE GARDE
Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient
Vous pouvez retrouver ce document actualis en ligne ladresse suivante : http://daj.ap-hop-paris.fr
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
2
SOMMAIRE
Avant propos
I. Lorganisation de la garde administrative
Gnralits
Les grands principes de la garde administrative lhpital
Le cadre juridique de la garde administrative
A lchelon central de lAP-HP : la garde Direction gnrale et la garde Sige
(DAG)
Les gardes mdicales
La garde paramdicale
La garde technique
La garde du Service central des ambulances (SCA)
La garde informatique : lastreinte informatique sur le site de Bessires
La communication avec les mdias pendant la garde
Lorganisation de crise
La cellule centrale de crise
La gestion de la communication en situation de crise (potentielle ou avre)
Lorganisation pratique de la garde administrative lhpital
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
3
II. Fiches de situations
LADMISSION
1 - Ladmission en urgence
2 - Ladmission dun mineur
3 - Ladmission du majeur protg
4 - Ladmission dune personne en situation de prcarit
5 - Ladmission dun patient non ressortissant de lUnion Europenne
6 - Ladmission dune personnalit
7 - Ladmission dun militaire
8 Ladmission dun patient en tat dbrit
9 - Ladmission dun bless par arme
10 Ladmission des patients dtenus / prvenus / gards vue
11 Ladmission dun patient porteur de drogue ou dune arme
12 Ladmission dun toxicomane
13 - Ladmission confidentielle et sous le rgime de lanonymat
14- Ladmission dun patient sans identit
15 - Ladmission dun patient non voyant
16 - Laccouchement sous X
17 - Ladmission dun nouveau-n avec sa mre en maternit
18 La demande dIVG
19 - Ladmission pour troubles mentaux
20 Lhospitalisation libre
21 Lhospitalisation sur demande dun tiers
22 Lhospitalisation doffice
23 Ladmission psychiatrique des mineurs
24 Ladmission psychiatrique des dtenus
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
4
25 Les droits des patients hospitaliss sans leur consentement
26 Face un bless, une urgence ou un accident proximit de lhpital
27 Le dpt de biens
28 - Lusurpation didentit
LE SEJOUR HOSPITALIER
29 - Le consentement aux actes mdicaux
30 Le consentement des majeurs protgs
31 - Le consentement du patient mineur
32 - Le refus de soins
33 La communication du dossier mdical
34 La personne de confiance
35 Le secret mdical et professionnel
36 La demande du dossier mdical sur rquisition ou perquisition
37 Laudition de patients majeurs
38 Laudition dun patient mineur
39 La fouille de la chambre dun patient
LA SORTIE
40 Les sorties linsu du service : les fugues
41 Les sorties contre avis mdical
42 Les sorties disciplinaires
43 La sortie du mineur
44 Les sorties en cours de sjour
45 Le refus de sortie du patient
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
5
LE DECES
46 Les formalits de dcs
47 Le dcs par mort violente ou suspecte
48 En cas de suicide
49 Le dcs prinatal
50 Le dpt du corps en chambre mortuaire
51 Les transports de corps
52 - Les prlvements but thrapeutique : le don dorganes ou de tissus
53 - Les autopsies mdicales et les prlvements vise scientifique
54 Les prlvements sur les personnes dcdes en dehors de lhpital
55- Le don de corps la science
QUESTIONS DIVERSES
56 Les pratiques religieuses lhpital
57 Les visites
58 Laccs des journalistes dans les locaux hospitaliers
59 Les troubles dans lenceinte de lhpital
60 Loccupation illicite dun site de lAP-HP
61 Danger grave et imminent - CHSCT locaux
62 Lalerte la bombe
63 Les objets suspects trouvs au sein de lhpital
64 La circulation et le stationnement dans lenceinte de lhpital
65 - La gestion des lits disponibles
66 Les dommages matriels causs aux agents
67 En cas de grve ou dabsence injustifie
68 Les frais de transport sanitaire
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
6
69 Le dpt de plainte
70 La protection fonctionnelle des agents victimes de violences lhpital
71 - Les situations de maltraitance
72 Les risques sanitaires et leur signalement
73 Lafflux de victimes, les circonstances exceptionnelles et les Plans blancs
74 La scurit incendie
76 Le plan national canicule
77 Les inondations
78 Les agents de scurit
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
7
Avant propos
La notion de garde est lie une notion de base de notre organisation administrative : le principe de
continuit du service public. Elle est aussi fonde sur la ncessit de faire face en toutes circonstances aux
urgences relevant du fonctionnement du service public hospitalier.
La garde de direction doit rpondre la ncessit de la permanence des services et de la fonction de direction
au sein de l'hpital. Cette permanence, le directeur de l'hpital ne peut bien videmment pas lassumer seul. Il
est en revanche tenu de l'organiser, en fonction des caractristiques de chaque hpital, de la manire la plus
efficace et la plus adapte. Il doit pour cela dsigner des administrateurs de garde .
Le prsent document a t conu pour les administrateurs de garde des hpitaux, groupes hospitaliers et
services gnraux de lAssistance publique hpitaux de Paris.
Il sagit dun document qui doit permettre aux administrateurs de garde, et plus largement aux quipes de
direction, de disposer de faon claire et synthtique de points de repre sur les modalits de droulement des
gardes administratives au sein de lAP-HP. Il prcise les procdures devant tre suivies en cas de dcisions
prendre dans lurgence et les diffrentes composantes de lorganisation interne de lAP-HP, au-del mme de
lhpital ou du service gnral, dans les priodes de nuit, week-end ou de ftes, et le cas chant dans les
circonstances exceptionnelles et priodes de crise. Les modalits des gardes centrales (Direction
gnrale, Sige) sont ainsi prsentes dans leurs grandes lignes.
Il sagit dun canevas et dun support qui doit en tant que de besoin tre complt en fonction des
particularits des sites hospitaliers ou de service gnral.
Il a vocation bien entendu tre modifi et complt rgulirement, au gr des volutions des organisations et
des dispositions rglementaires.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
8
I. Lorganisation de la garde administrative
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
9
Gnralits
Les grands principes de la garde administrative l'hpital
La garde administrative a pour mission de rpondre l'urgence, d'assurer la permanence de l'administration
et la continuit du fonctionnement des services. La garde de direction peut donc tre dfinie comme la
procdure qui permet aux personnels hospitaliers expressment habilits par le directeur de lhpital dy
assurer dune part la continuit de la direction administrative et, dautre part, les missions de police
administrative .
La continuit du fonctionnement des services, c'est le fonctionnement courant de lhpital, mais galement
la gestion de l'vnement imprvu ou exceptionnel (dfection du personnel, dfaillance matrielle, afflux
massif de victimes l'hpital, dlits et crimes, ...) qui ncessite un renforcement des moyens, une coordination
de l'organisation et, dune manire gnrale, des dcisions immdiates. Ce peut tre aussi la gestion de
l'imprvisible (situation qui ne peut pas tre prvue de faon prcise, comme la survenance d'une
catastrophe runissant les conditions de la force majeure), mme si cet imprvisible nest pas propre aux
situations nocturnes, de week-end, etc. ;
La permanence de l'administration signifie que mme en circonstance deffectif rduit, lhpital doit garantir
la meilleure prise en charge du patient, y compris dans sa dimension "administrative" et, notamment, une
organisation simple des formalits. Dans ce cadre, l'administrateur de garde n'est videmment pas tenu
dintervenir de manire systmatique. En revanche, il le fera pour les dcisions importantes (ex : indices de
mort violente ou suspecte pour lesquels l'autorit judiciaire doit tre prvenue, ou encore afflux massif de
victimes, vrifications administratives pralables un prlvement dorgane) ou s'il est saisi par un service
d'un problme dlicat qui ncessite dtre rsolu avec une attention particulire.
La prise en charge de l'urgence signifie que lhpital doit demeurer en position dapporter une rponse
immdiate en cas de risques encourus par un patient pour sa sant, sa scurit ou son confort. Mais des
risques peuvent galement tre encourus, le cas chant, par des personnels hospitaliers ou des visiteurs. Le
patrimoine de l'hpital lui-mme peut tre menac.
L'administrateur de garde peut tre principalement amen intervenir dans trois domaines :
En sa qualit de reprsentant du directeur de l'hpital, chef d'tablissement , l'administrateur de
garde intervient dans les matires que celui-ci n'a pas dlgues d'autres agents : mesures de "police"
intrieure, mesures prendre en cas de fugue d'un patient, dcisions relatives des soins sous contrainte en
psychiatrie, relations avec la police et la justice
Dans une hypothse d'vnement imprvu ou/et urgent, son intervention peut tre ncessaire pour
lorganisation des services, compte tenu de l'importance dun risque, des moyens devant tre mis en
uvre et de la ncessit de la mise en uvre coordonne des mesures prendre ;
L'administrateur de garde peut tre amen, en tant que de besoin, conseiller ou arbitrer sur tel ou tel
sujet du domaine juridique, administratif ou technique.
Son rle consiste prendre les initiatives et les dcisions qui simposent, chaque fois quelles sont
ncessaires. Il lui serait reproch dtre demeur inactif en cas de situation de ncessit.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
10
Dune manire gnrale, relvent de la garde de direction les incidents qui nont pas pu tre traits par les
services de lhpital en fonctionnement, ou concernant lhpital titre gnral, ainsi que les dcisions
urgentes, exigeant une rponse immdiate, celles qui ne peuvent attendre. Lurgence tant parfois difficile
cerner, le champ prcis de la garde nest pas fig. Il sapprcie avec discernement, au regard de la ncessit
ou non de reporter des mesures et dcisions prendre.
Attention !
Pendant les heures ouvrables de service, la comptence dcisionnelle est en principe celle du directeur
(ou dfaut, de ses adjoints, dans leurs champs de comptence respectifs). L'administrateur de garde
devient toutefois comptent, mme en cours de journe ordinaire , en cas d'absence momentane du
directeur comptent (ou de ses adjoints).
En dehors des heures ouvrables de service, la comptence de l'administrateur de garde peut ne pas tre
immdiate, mais de second recours. Ainsi, lors d'un incident technique, l'agent technique de garde sera alert
le premier par le service concern, quitte ce quil informe immdiatement ladministrateur de garde en cas
de difficult manifestement srieuse. De mme, le personnel soignant et le personnel administratif doivent
tre en mesure de rpondre la majeure partie des questions poses, quitte en rfrer en second recours,
en cas de doute ou de situation risque, l'administrateur de garde.
Lexercice de la garde administrative peut concerner de multiples situations, des plus banales aux plus
complexes, qui sont gnres par lactivit hospitalire ou son environnement.
Par une note en date du 20 janvier 2005, adresse lensemble des directeurs chefs dtablissement, la
Direction gnrale a prcis plus particulirement le mode de prise en charge des situations sensibles.
Cinq types de risques principaux sont notamment identifis dans ce cadre :
les risques lis aux activits mdicales et de soins (infections nosocomiales, erreur de diagnostic et de
traitement, dfaut de surveillance) ;
les risques professionnels (accidents du travail, agressions, conflits sociaux) ;
les risques industriels et environnementaux (accidents, incendie, panne lectrique) ;
les risques informatiques et de tlcommunication (panne informatique, atteinte la confidentialit) ;
les risques concernant limage de lAP-HP (prise en charge de personnalits, visites de personnages
publics, soins aux personnes incarcres)
Le cadre juridique de la garde administrative
Lexercice de la fonction de direction
L'obligation d'assurer la garde de direction dcoule des fonctions exerces par le directeur de lhpital
et de leur continuit ncessaire. Il lui revient, en qualit de chef d'tablissement, den fixer l'organisation.
Cette obligation dcoule au sein de lAP-HP des fonctions du directeur gnral, telles quelles sont
nonces par l'article L. 6143-7 du code de la sant publique et qui sont en partie dlgues aux
directeurs des hpitaux de lAP-HP pour le fonctionnement courant des hpitaux : le directeur gnral
"reprsente ltablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile (). Il est charg de
l'excution des dcisions du conseil d'administration et met en uvre la politique dfinie par ce dernier (). Il
est comptent pour rgler les affaires de l'tablissement autres que celles qui (relvent du conseil
dadministration). Il assure la gestion et la conduite gnrale de l'tablissement (). A cet effet, il exerce
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
11
son autorit sur l'ensemble du personnel dans le respect des rgles dontologiques ou professionnelles qui
s'imposent aux professions de sant, des responsabilits qui sont les leurs dans l'administration des soins et
de l'indpendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art .
Dans ce cadre, le directeur de chaque hpital ou groupe hospitalier assure la conduite de lhpital ou du
groupe hospitalier dont il est charg sous lautorit du directeur gnral et, le cas chant, dans les
matires qui lui sont dlgues, sous lautorit du directeur excutif du groupement hospitalier
universitaire (GHU) dont il dpend, conformment leurs directives respectives (art. R. 6147-22, C.
sant publ.).
Une autre source juridique de la garde de direction est nonce dans un texte ancien, le dcret du 17 avril
1943, qui impose au directeur une prsence constante par ncessit absolue de service, prsence qui
s'tend ipso facto l'ensemble du personnel de direction en cas dabsence, programme ou non, du directeur.
Cette ncessit absolue de servi ce j usti fie l ' i ntervention di recte du di recteur de l hpital pour
organiser la garde administrative.
On notera quil n'y a pas de corrlation parfaite entre l'obligation d'assurer la garde de direction et
l'attribution d'un logement de fonction, mme si la concession du logement facilite videmment l'exercice de la
garde : en effet, l'agent de direction non log par l'tablissement n'a pas le droit de se soustraire de ce seul
fait l'obligation de garde. Il peut seulement prtendre, en l'absence d'une telle concession, rmunration.
Un fondement juridique de la garde, dorigine jurisprudentielle, dcoule par ailleurs des obligations de tout
chef de service (au sens de responsable administratif dun service, dun tablissement, en droit public) :
en vertu de la jurisprudence constante faisant suite l'arrt Jamart (Conseil dEtat, 7 fvrier 1936), mme
dans le cas o l'autorit administrative ne tient d'aucune disposition lgislative un pouvoir rglementaire,
il lui appartient de prendre les mesures ncessaires au bon fonctionnement de l'administration place
sous son autorit. Ce pouvoir tire sa lgitimit de la ncessit d'un fonctionnement rgulier des
services publics et repose sur l'ide que toute autorit doit naturellement disposer des moyens ncessaires
l'accomplissement de sa mission. Responsable de la bonne marche du service dont il a la charge, le
directeur de lhpital doit en toute logique fixer les modalits d'organisation de l'administration de garde.
Enfin, le rglement intrieur type des hpitaux et groupes hospitaliers de lAP-HP prvoit, en son article
6 ( Garde administrative ), que Pour rpondre la ncessit de la prsence permanente, sur place,
dune autorit responsable, le directeur organise avec les membres de son quipe de direction et, le cas
chant, dautres cadres de direction et collaborateurs auxquels il a donn dlgation de sa signature, un
service de garde administrative .
Garde administrative et dlgation de signature
Pour que la garde administrative soit assure, le directeur de lhpital doit sappuyer sur son quipe de
direction et plus gnralement sur les cadres de ltablissement quil estime en mesure de le reprsenter et
de bnficier ce titre dune dlgation de sa signature.
Le code de la sant publique prvoit en effet que dans le cadre des dlgations de comptences que peut
leur dlguer le directeur gnral, les directeurs dhpitaux, de groupes hospitaliers et de services gnraux
et les directeurs excutifs de groupements hospitaliers universitaires peuvent, sous leur responsabilit,
dlguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorit lorsquils appartiennent un
corps ou exercent un emploi relevant de la catgorie A ou, dfaut, de la catgorie B, ainsi quaux praticiens
responsables de ple dactivit (art. R. 6147-23, C. sant publ.)
Peut ainsi participer effectivement la garde de direction tout membre du personnel hospitalier
susceptible de recevoir une dlgation de signature du directeur de lhpital.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
12
Sont concerns :
les membres du corps des directeurs d'hpital (leur statut D. n 2005-921 du 2 aot 2005 - prvoit
que lorsquils ne sont pas chefs dtablissement, ils sont chargs sous lautorit du chef de
ltablissement de prparer et de mettre en uvre ses dcisions, dans le cadre des dlgations que le
chef dtablissement leur a accordes, ainsi que les dlibrations du conseil dadministration),
les attachs d'administration hospitalire,
les adjoints des cadres hospitaliers,
les directeurs des soins,
les ingnieurs,
les cadres de sant.
En pratique, il est recommand de ne faire participer aux gardes administratives que les personnels
disposant d'une certaine exprience.
Les personnels de lAP-HP mis disposition ou dtachs auprs dorganismes tiers (y compris auprs du
ministre de la Sant) sont placs sous lautorit hirarchique de ceux-ci et ne peuvent donc tre destinataires
dune dlgation de signature ou de comptence du Directeur gnral de lAP-HP. Ils ne peuvent exercer la
fonction dadministrateur de garde au sein de lAP-HP pour tout le temps de leur mise disposition ou de leur
dtachement.
Les administrateurs de garde ne peuvent assurer la garde dans un hpital ou groupe hospitalier de lAP-HP
que sils disposent dune dlgation de signature du directeur de lhpital ou du groupe hospitalier concern.
Le tableau de garde
Les administrateurs de garde une fois dsigns, il revient au directeur de lhpital dtablir un tableau de
garde.
Ce document est essentiel : il indique les jours et plages horaires pendant lesquels les administrateurs de
garde assurent la garde.
Ce tableau de garde doit tre formalis en un document crit, dat et sign du directeur, car il faudra le cas
chant tre en mesure de le prsenter sous une forme incontestable.
Un exemplaire doit tre conserv par le directeur et un autre exemplaire remis chaque administrateur de
garde, dans un dlai permettant ladministrateur intress den tre inform et davoir pris ses dispositions.
Il doit prciser la nature de la garde pour laquelle ladministrateur de garde a t dsign et la priode prcise
de cette garde. Il doit notamment prciser, sans aucune ambigut, si ladministrateur doit ou non assurer la
garde, en tant que de besoin, pendant la journe, en semaine.
Administrateurs en premier, administrateurs en second
En raison de la taille des hpitaux et groupes hospitaliers, la garde peut tre organise en deux niveaux et
tre assure conjointement par un administrateur en premier , membre de lquipe de direction, et un
administrateur en second, agent de catgorie A ou B.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
13
La rpartition des tches doit tre dfinie par le directeur de lhpital, notamment pour la gestion des premiers
recours et des affaires courantes. En tout tat de cause, il revient ladministrateur en premier dassurer
personnellement la reprsentation du directeur de lhpital dans toutes les circonstances qui doivent tre
gres dans une dlgation de premier niveau.
Chef dtablissement / administrateurs de garde
Au cours de la garde administrative, le directeur dhpital n'est jamais dessaisi de ses comptences. Le
cadre juridique tant celui de la dlgation de signature, rien n'empche le directeur, tout moment, de
prendre une dcision dans une matire faisant l'objet de la dlgation.
L'administrateur de garde n'est donc pas investi de l'ensemble des pouvoirs du directeur de lhpital : son
action se cantonne l'urgence et, conscutivement, aux mesures strictement ncessaires au bon
fonctionnement du service.
Les incidents survenant loccasion dune garde et ncessitant dy trouver rapidement remde peuvent tre
trs divers : recrutement de personnel intrimaire, renforcement des effectifs d'un service de soins, appel aux
forces de l'ordre ou au juge des rfrs pour l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public ... L'urgence
justifiant lintervention de ladministrateur de garde exclut par elle-mme tous les cas dans lesquels la solution
peut attendre et l'administrateur de garde n'a pas lieu en principe dintervenir dans le domaine de
l'organisation gnrale de l'hpital, qui relve du seul chef d'tablissement.
Enfin, l'administrateur de garde demeure soumis aux prrogatives et l'autorit hirarchique du directeur -
chef d'tablissement : les mesures qu'aura prises l'administrateur de garde seront contrles a posteriori par
le chef d'tablissement en sa qualit de suprieur hirarchique. L'intervention du chef d'tablissement au
cours mme de la garde, pour imposer la conduite tenir, fait que le permanent sera contraint d'excuter
l'ordre reu, sauf si celui-ci est manifestement illgal (hypothse, voque ici pour ordre , du "devoir de
dsobissance" : v. arrt Conseil dEtat, 10 novembre 1944, Langneur).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
14
A lchelon central de lAP-HP :
La garde Direction gnrale (DG) et la garde Sige (DAG)
A lchelon central de ltablissement AP-HP, deux gardes sont organises qui fonctionnent 7 jours sur 7 :
la garde Direction Gnrale
la garde Sige (Direction des Affaires gnrales)
Ces deux gardes sont confies des responsables du Sige, appartenant en principe au corps des
personnels de direction de la fonction publique hospitalire.
Les gardes sorganisent de la manire suivante :
la garde de fin de semaine commence le vendredi 19 h. 00 et sachve le lundi 8 h. 30.
la garde de semaine commence le lundi soir 19 h. 00 et sachve le vendredi 8 h. 30.
la garde de jour fri commence la veille 19 h. 00 et sachve le lendemain 8 h. 30.
Avant chaque prise de garde, il est souhaitable de sinformer des affaires en cours, auprs du Cabinet du
Directeur gnral (poste 3271 3272) et de la cellule de veille (poste 4630).
Dans tous les cas, la garde seffectue jusqu ce que la relve soit assure. La vrification de cette relve est
effectue par le standard du Sige.
Missions de ladministrateur de garde
Il revient lAdministrateur de garde Direction gnrale , pour lensemble des hpitaux de lAP-HP :
dassurer la gestion des vnements sensibles,
dassurer la gestion initiale des situations de crise,
de mettre en place la cellule de crise.
Il revient lAdministrateur de garde Sige :
dassurer la gestion des vnements indsirables des 20 sites grs par la DAG,
dassurer la mise en place du Centre oprationnel de gestion de crise ( CO Victoria ),
daider lAdministrateur de garde Direction gnrale , en tant que de besoin.
En relation avec le CERVEAU , les administrateurs de garde Direction gnrale et Sige
reoivent un bulletin quotidien spcial 18 h 00 les informant des tendances de la journe et de la capacit
en lits ;
doivent, pour tout vnement li lactivit des urgences pour lequel ils ont t contacts pendant leur
garde, adresser le matin 9 h. 30 les informations relatives cet vnement, de prfrence par ml veille-
regionale.urgences@sap.aphp.fr .
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
15
Les Administrateurs de garde Direction gnrale et Sige sont tenus pendant leur garde :
davoir en permanence lalphapage ouvert en mode sonnerie sur eux,
de passer leurs communications par le standard, afin den assurer la traabilit,
de tenir le standard inform, autant que possible.
Ils doivent rpercuter pendant leur garde, 24 heures sur 24, les vnements sensibles porteurs dune
charge critique auprs du cabinet du directeur gnral ou du secrtaire gnral, et notamment :
les vnements graves perturbant lorganisation de lactivit dun site hospitalier,
les vnements fort potentiel mdiatique,
les hospitalisations/dcs dune personnalit
tout autre lment jug pertinent.
Tous les vnements ne doivent pas tre signals. Un vnement doit tre valu en tenant compte des
lments porteurs de crise . En tout tat de cause, il convient dviter que le signalement de lvnement,
lorsquil est issu de lactivit et du fonctionnement de lAP-HP, ne provienne de lextrieur. Et le signalement
simpose en cas de doute.
Ils doivent en cas dvnement critique, et notamment lors de dclenchement des plans blancs, bleus,
zonaux ainsi que des plans gouvernementaux de dfense civile (plans pirate ) :
dclencher la pr-alerte Plan blanc,
se rendre imprativement au Sige.
En cas de demande de la presse, ils doivent :
recueillir les coordonnes de leur interlocuteur et lobjet de son appel,
saisir la personne dastreinte de la Direction de la Communication/Sige et prendre ses consignes.
Les administrateurs de garde Direction gnrale et Sige doivent passer en dbut de garde :
A la cellule du CERVEAU (Victoria, 1
er
tage, n 140) 16 h. 30 ou sur rendez-vous pour recueillir les
informations et les consignes pour la ralisation du bulletin quotidien assur conjointement le week-end par
les administrateurs de garde Direction gnrale et Sige .
Au cabinet de la Direction gnrale (Victoria 2
me
tage, n 272-273) pour :
- prendre les consignes (AdG Direction gnrale et AdG Sige )
- rcuprer la mallette de garde (AdG Direction gnrale )
Au standard tlphonique (Victoria, escalier B 3
me
tage gauche) pour :
- rcuprer lalphapage et le tlphone portable (AdG Direction gnrale )
- rcuprer le tlphone portable (AdG Sige)
Au secrtariat du DAG (Saint-Martin, 1
er
tage, n 141A) pour rcuprer la mallette de garde et lalphapage
(AdG Sige ).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
16
Les gardes mdicales
Elles se justifient par la ncessit dassurer la continuit des soins, dans lensemble de lhpital ou dans
certaines spcialits mdicales. Elles sont mises en place, le plus souvent, dans un contexte de mutualisation
des moyens lchelon de lhpital, du GHU ou de lAP-HP dans son ensemble, pour les priodes en principe
de faible activit mdicale que sont les nuits, les week-ends et les jours fris.
SAMU
Numro de tlphone unique par dpartement : 15
24 heures sur 24, un mdecin spcialis rpond aux appels d'urgence concernant toutes dtresses
mdicales. Il possde les informations et les moyens ncessaires pour donner des conseils mdicaux et
dclencher les secours de la faon la plus efficace (quipes mdicales de SMUR, mdecins libraux ...). Il
facilite l'orientation des blesss ou des malades vers le service de ranimation le plus proche ou tout autre
service, aprs contact pralable avec les mdecins de garde de ces services. Le SAMU assure la
coordination des moyens de secours avec la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris, la Croix Rouge, la
Protection civile...
Liste des SAMU en Ile-de-France
SAMU 75 (Paris) 01 45 67 50 50 AP-HP Necker
SAMU 77 (Seine et Marne) 01 64 71 66 88 CH de Melun
SAMU 78 (Yvelines) 01 30 84 96 00 CH de Versailles
SAMU 91 (Essonne) 01 60 90 15 15 CH Sud Francilien (Evry-Corbeil)
SAMU 92 (Hauts de Seine) 01 47 10 70 10 AP-HP Raymond-Poincar
SAMU 93 (Seine Saint-Denis) 01 48 96 44 44 AP-HP Avicenne
SAMU 94 (Val de Marne) 01 45 17 95 00 AP-HP Henri Mondor
SAMU 95 (Val dOise) 01 30 75 42 15 CH de Pontoise
*** ***
Les Services dUrgences (SU) et les SMUR
Urgences Adultes
Hpitaux de l'AP-HP
Groupe hospitalier BICHAT-CLAUDE BERNARD SU
75 - PARIS 18
me
Tl. : 01 40 25 80 80
Groupe hospitalier COCHIN SAINT VINCENT DE PAUL SU
75 - PARIS 14
me
Tl. : 01 58 41 41 41
Hpital EUROPEEN-GEORGES POMPIDOU SU
75 - PARIS 15
me
Tl. : 01 56 09 20 00
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
17
HTEL-DIEU SU et SMUR
75 - Paris 4
me
Tl. : 01 42 34 82 34
Groupe hospitalier LARIBOISIERE-FERNAND WIDAL SU et SMUR
75 - PARIS 10
me
Tl. : 01 49 95 65 65
Groupe hospitalier PITIE-SALPETRIERE SU et SMUR
75 - PARIS 13
me
Tl. : 01 42 16 00 00
Hpital St ANTOINE SU et SMUR
75 - PARIS 12
me
Tl. : 01 49 28 20 00
Hpital St LOUIS SU
75 - PARIS 10
me
Tl. : 01 42 49 49 49
Hpital TENON SU
75 - PARIS 20
me
Tl. : 01 56 01 70 00
Hpital BEAUJON SU et SMUR
92 CLICHY
Tl. : 01 40 87 50 00
Hpital AMBROISE PARE SU
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT
Tl. : 01 49 09 50 00
Hpital ANTOINE BECLERE SU
92 CLAMART
Tl. : 01 45 37 44 44
Hpital LOUIS MOURIER SU
92 COLOMBES
Tl. : 01 47 60 61 62
Hpital AVICENNE SU et SMUR adultes
93 BOBIGNY
Tl. : 01 48 95 55 55
Hpital JEAN VERDIER SU
93 - BONDY
Tl. : 01 48 02 66 66
Hpital de BICETRE SU
94 - LE KREMLIN-BICETRE
Tl. : 01 45 21 21 21
Groupe hospitalier HENRI MONDOR ALBERT CHENEVIER SU et SMUR
94 CRETEIL
Tl. : 01 49 81 21 11
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
18
Autres hpitaux Paris et en Petite Couronne (tablissements publics de sant, hpitaux privs
participant au service public hospitalier et cliniques prives)
Paris
15me / Hpital Lopold-Bellan - 01.40.48.68.68 SU (PSPH)
14me / Hpital Saint-Joseph - 01.44.12.33.33 SU (PSPH)
20me / Hpital de la Croix-Saint-Simon - 01.44.64.16.00 SU (PSPH)
92 - Hauts de Seine
Hpital priv d'Antony - 01.46.74.37.28 SU (PL)
Centre Hospitalier Courbevoie/Neuilly - 01.40.88.60.00 SU (EPS)
Hpital Foch (Suresnes) - 01.46.25.20.00 SU (PSPH)
Centre hospitalier Jean-Rostand (Svres) - 01.41.14.75.15 SU (EPS)
CASH de Nanterre - 01.47.69.65.65 SU (EPS)
Hpital Notre-Dame du Perptuel Secours (Levallois) - 01.47.59.58.58 SU (PSPH)
Centre hospitalier de Saint-Cloud - 01.49.11.60.42 SU (EPS)
Centre hospitalier dpartemental Stell Rueil - 01.41.29.90.00 SU (EPS)
93 - Seine-Saint-Denis
Hpital Europen de Paris - la Roseraie (Aubervilliers) - 01.48.39.41.71 SU (PL)
Hpitaux de Saint-Denis - 01.48.69.12.99 SU et SMUR (EPS)
Hpital Robert-Ballenger (Aulnay - Villepinte) - 01.49.36.71.23 SU et SMUR (EPS)
Hpital priv de l'Est parisien - Clinique d'Aulnay - 01.48.19.33.33 SU (PL)
Centre Hospitalier intercommunal Le Raincy- Montfermeil - 01.41.70.80.00 SU et SMUR (EPS)
Clinique du Vert-Galant (Tremblay-en-France) - 01.49.63.50.50 SU (PL)
94 - Val de Marne
Centre hospitalier intercommunal de Crteil - 01.45.17.56.60 SU (EPS)
Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges - 01.43.86.20.00 SU et SMUR (EPS)
Polyclinique chirurgicale (Champigny-sur-Marne) - 01.49.83.66.00 SU (PL)
Hpital Sainte-Camille - Bry-sur-Marne - 01.49.83.10.10 SU (PSPH)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
19
Urgences Enfants
Tous les sites d'urgence sont en mesure d'accueillir les enfants. Toutefois Paris, il vaut mieux s'adresser
directement l'un des 4 hpitaux spcialiss pour enfants de l'AP-HP. Ils reoivent toutes les urgences de
mdecine ou de chirurgie :
Groupe hospitalier ARMAND TROUSSEAU La ROCHE GUYON SU
75 - PARIS 12
me
Tl. : 01 44 73 74 75
Hpital ROBERT DEBRE SU et SMUR pdiatrique
75 - PARIS 19
me
Tl. : 01 40 03 20 00
Hpital NECKER-ENFANTS MALADES SU et SMUR pdiatrique
75 - PARIS 15
me
Tl. : 01 44 49 40 00
Hpital St VINCENT DE PAUL SU
75 - PARIS 14
me
Tl. : 01 40 48 81 11
Hpitaux d'adultes ayant des services de pdiatrie ou de chirurgie infantile accueillant galement les
enfants en urgence
AMBROISE-PARE (92 - Boulogne) pdiatrie SU
Tl : 01 49 09 57 00
ANTOINE-BECLERE (92 - Clamart) pdiatrie SU
et SMUR pdiatrique
Tl : 01 45 37 44 44
BICETRE (94 - Le Kremlin-Bictre) pdiatrie et chirurgie SU
Tl : 01 45 21 21 21
JEAN-VERDIER (93 - Bondy) pdiatrie SU
Tl : 01 48 02 64 55
LOUIS-MOURIER (92 - Colombes) pdiatrie
Tl : 01 47 60 61 62
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
20
Urgences spcialises
Centre anti-poisons
Assistance tlphonique tous les jours, 24 heures sur 24 au 01 40 05 48 48.
(pas daccueil du public)
Hpital Fernand-Widal (Groupe hospitalier Lariboisire-Fernand-Widal)
200, rue du Faubourg Saint-Denis
Paris 10
me
Les maternits
L'AP-HP a 15 maternits dans les hpitaux suivants : Antoine-Bclre, Beaujon, Bichat-Claude Bernard,
Cochin (Port-Royal), Jean-Rostand, Jean-Verdier, Lariboisire, Louis-Mourier, Necker-Enfants Malades, Piti-
Salptrire, Robert-Debr, Armand-Trousseau, Saint-Antoine, Saint-Vincent de Paul et Tenon. Il est conseill
aux femmes enceintes de s'inscrire ds le dbut de leur grossesse dans l'une de ces maternits. Les femmes
enceintes peuvent, en cas d'urgence, s'adresser :
soit l'hpital le plus proche de leur domicile
soit l'hpital de proximit immdiate au moment de l'urgence.
Accueil en ophtalmologie
Les matines des jours ouvrables, aux consultations et services d'ophtalmologie des hpitaux de l'AP-HP
suivants : Ambroise-Par, Avicenne, Bictre, Bichat-Claude Bernard, Beaujon, Cochin, Htel-Dieu, Louis-
Mourier, Lariboisire (galement l'aprs-midi de 13h 30 17h 30), Necker-Enfants Malades (enfants), Piti-
Salptrire, Robert-Debr (enfants), Saint-Antoine, Saint-Louis, Tenon, Armand-Trousseau (enfants) et Saint-
Vincent de Paul (enfants) tous les jours (matine et aprs-midi, sauf la journe du mercredi et l'aprs-midi du
vendredi). Les aprs-midi, nuits, dimanches et jours fris :
lHtel-Dieu de Paris
2, rue d'Arcole
75004 Paris
Tl : 01.42.34.80.36 ou 01.42.34.82.34
Accueil en O.R.L.
Les matines des jours ouvrables, aux consultations et services d'O.R.L. des hpitaux de l'AP-HP suivants :
Armand-Trousseau (enfants), Avicenne, Beaujon, Bictre, Bichat, Cochin, HEGP, Lariboisire, Louis-Mourier,
Necker-Enfants-Malades, Piti-Salptrire, Robert-Debr (enfants), Saint-Louis, Saint-Antoine, Saint-Vincent
de Paul (enfants) et Tenon.
Les aprs-midi, nuits, dimanches et jours fris :
- pour les adultes, l'hpital Lariboisire, 01.49.95.65.65
- pour les enfants, l'hpital Necker, 01.44.49.40.00
Accueil en stomatologie
Les matines des jours ouvrables et aprs-midi jusqu' 17h 30, aux consultations et services de stomatologie
des hpitaux suivants : Bictre, Cochin, Necker-Enfants Malades, Piti-Salptrire, Htel-Dieu, Saint-Louis,
Saint-Antoine, Tenon, Saint-Vincent de Paul (enfants du lundi matin au vendredi midi), Robert Debr (enfants)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
21
et Armand Trousseau (enfants). Les soirs (aprs 17h 30), nuits, samedis, dimanches et jours fris, accueil
au :
Groupe hospitalier Piti-Salptrire - service des urgences mdicales
Pavillon Gaston-Cordier
83, boulevard de l'Hpital
75013 Paris
Tl : 01.42.17.72.47
Accueil en odontologie
Les services dodontologie de lAP-HP (Albert-Chenevier, Charles-Foix, Piti-Salptrire, Garancire,
Bretonneau) peuvent recevoir des patients en urgence aux heures ouvrables.
Le service dodontologie du groupe hospitalier Piti-Salptrire accueille galement les patients dans le cadre
du PASS bucco-dentaire pendant les heures ouvrables.
Les aprs-midi partir de 18 heures, les nuits, les samedis, dimanches et jours fris, une garde
dodontologie est assure au groupe hospitalier Piti-Salptrire (service des urgences).
SOS Mains (rimplantation)
Tous les jours, 24 heures sur 24, avec accs par rgulation SAMU, :
l'hpital Saint-Antoine
184, rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
lHpital Europen Georges Pompidou
20, rue Leblanc
75015 Paris
l'hpital Robert Debr - urgences mains enfants
48, boulevard Srurier
75019 Paris
Psychiatrie
Tous les jours, 24 heures sur 24, aux urgences des hpitaux de l'AP-HP : Avicenne, Beaujon, Bictre, Bichat,
Cochin, HEGP, Henri Mondor, Htel-Dieu, Lariboisire, Louis-Mourier, Piti-Salptrire, Saint-Antoine, Tenon.
Les jours ouvrables, de 8h30 19h30 Corentin-Celton.
Psychiatrie infantile
Tous les jours, 24 heures sur 24 :
l'hpital Armand Trousseau
(du lundi au vendredi de 9h00 18h00)
l'hpital de Bictre
(tous les jours 24h/24)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
22
le groupe hospitalier Piti-Salptrire
47, boulevard de l'hpital
75013 Paris
Accueil par des pdopsychiatres tous les jours jusqu' 18h30. Aprs 18h30, l'accueil des enfants est assur
par des psychiatres pour adultes
l'hpital Robert Debr
(du lundi au vendredi de 9h 18h. En dehors de ces horaires, l'accueil est assur la Piti-Salptrire, pour
les enfants, et Lariboisire, pour les adolescents).
Dermatologie
Les mdecins, exclusivement, peuvent s'adresser 24 heures sur 24 l'hpital Henri Mondor.
Urgences neuro-chirurgicales
(accs par rgulation SAMU)
5 hpitaux de l'AP-HP (Beaujon, Bictre, Henri-Mondor, Lariboisire, Piti-Salptrire) assurent tour de rle
une garde gnrale quotidienne (avec l'hpital Sainte-Anne) pour les urgences en neurochirurgie adultes.
La liste de garde est disponible sur le site Intranet de la DPM (http://intranet.aphp.fr/sections/dpm/)
L'hpital Necker-Enfants Malades assure une garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les urgences en
neurochirurgie enfants.
Urgences neuro-vasculaires
(accs par rgulation SAMU)
Tous les jours, 24 heures sur 24 :
Groupe hospitalier Lariboisire-Fernand-Widal
Hpital Tenon
Groupe hospitalier Piti-Salptrire
Groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard
Groupe hospitalier Henri-Mondor-Albert-Chenevier
Consultations mdico-judiciaires (UMJ)
Dpt de plainte auprs dun service de police ou de gendarmerie. Dlivrance par les UMJ de certificats
mdicaux constatant les atteintes corporelles, tous les jours, 24 heures sur 24, :
l'Htel-Dieu
place du Parvis Notre-Dame
Paris 4
me
l'hpital Jean-Verdier
avenue du 14 juillet
93 Bondy
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
23
l'hpital Raymond Poincar
104, bd Raymond Poincar
92 Garches
Cet hpital accueille galement les victimes pour les dpartements des Yvelines (78) et des Hauts-de-Seine
(92) sur demande de la police uniquement.
Se munir d'une rquisition auprs d'un commissariat de police.
La garde paramdicale
Il revient au directeur de lhpital de dfinir avec le coordonnateur gnral des soins les modalits de cette
garde, quand elle est ncessaire.
Elle peut prendre la forme de la dsignation dun cadre de sant coordonnateur pour la garde. Les fonctions
peuvent tre varies et complmentaires de celles de ladministrateur de garde : redploiement interne du
personnel soignant en cas dabsence de personnel, recours un agent extrieur, recherche dun lit disponible
pour le patient au sein de lhpital, contribution aux demandes dinformation du patient, de sa famille et du
personnel de lhpital (notamment le personnel nouvellement affect et le personnel intrimaire).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
24
La garde technique
La mise en place dune garde technique simpose en raison de la complexit croissante des installations et
des quipements, et de leur ncessaire fonctionnement continu.
Au sein de l AP-HP, la garde technique est organise trois niveaux successifs et complmentaires :
- au niveau local : chaque hpital ou groupe hospitalier dispose dune permanence technique et dune garde
locale, cette dernire tant assure en dehors des heures ouvrables. Cette permanence fonctionne 24 heures
sur 24, tous les jours de lanne. Assure par des techniciens, elle comporte diffrentes composantes :
lectricit, plomberie, dpannages gnraux et mise en scurit. Il sagit donc dune garde de comptence
trs large, mais qui ninclut pas la composante informatique .
- un niveau intermdiaire : en 2000, une garde des ingnieurs a t officiellement formalise pour
lensemble de lAP-HP. Elle fonctionne sur la base dun regroupement des hpitaux et groupes hospitaliers en
huit zones. 48 ingnieurs participent au tour de garde.
- au niveau central : la garde SMS (Scurit, Maintenance et Services) fonctionne 24 heures sur 24, toute
lanne. Elle est organise sur la base dastreintes domicile, avec des techniciens qui peuvent se dplacer
sur lensemble des sites. Son champ dintervention comprend :
le secours lectrique (par exemple, les groupes lectrognes mobiles),
le froid ,
la plomberie,
le chauffage,
llectricit,
le transport (dpannage automobile),
le transport titre trs exceptionnel de personnel AP-HP et de matriels AP-HP,
les quipements de restauration.
(on notera que pour le chauffage et llectricit, SMS intervient principalement en renfort du niveau local).
SMS
14, rue du Port-aux-Lions
94227 Charenton-le-Pont Cedex
Tl. : 01.45.13.67.93
En cas de panne technique, la procdure suivante doit tre suivie :
identifier le dysfonctionnement au niveau local et solliciter lintervention du technicien ;
ds lors que le problme ne peut tre rsolu au niveau local, contacter le standard du Sige (composer le
01.40.27.30.00) ;
le standard orientera alors soit vers lingnieur de zone de garde, soit vers le technicien SMS ;
en cas de problme plus grave, appeler ladministrateur de garde du Sige (galement via le standard) : il
pourra ventuellement mettre en uvre le dispositif CO-Victoria (centre oprationnel de crise) et activer,
le cas chant, la cellule centrale et les cellules locales de crise.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
25
La garde du Service central des ambulances (SCA)
Le Service Central des Ambulances de lAP-HP (SCA) assure une permanence 24 heures sur 24, tous les
jours de lanne.
Un numro de tlphone unique (01.45.13.67.93) permet de joindre ladministrateur de cette garde.
Demandes concernant les SMUR :
remorquage et dpannage des Units Mobiles Hospitalires
absence dambulanciers la prise de service
mise disposition du vhicule de transport sanitaire pour patient surcharge pondrale.
Gestion des demandes de transports sanitaires
pour toutes questions relatives aux demandes de transports sanitaires, il existe un numro de
tlphone unique : 01.45.13.67.93
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
26
La garde informatique : lastreinte informatique sur le
site de Bessires
La Direction du Systme dinformation (DSI - site de production de Bessires) organise une astreinte
informatique dont son rle est dassurer aux utilisateurs, autant que possible, une continuit de service.
Conditions dappel :
Le service d'astreinte est assur :
- du lundi au vendredi de 19 h. 00 7 h. 00,
- du vendredi 19 h. 00 au lundi 7 h. 00,
- les week-ends et jours fris (jour et nuit).
Le personnel dastreinte intervient pour remdier dans les meilleurs dlais aux dysfonctionnements de
nature technique en fonction du niveau de priorit et du caractre critique des incidents signals.
Le problme informatique rencontr doit tre de nature technique. Lquipe dastreinte nest en effet pas
en mesure actuellement de rpondre des problmes relatifs lutilisation ou au fonctionnement des logiciels.
Le problme rencontr doit entraner une rupture de service intermittente ou permanente. Les
dysfonctionnements nentranant pas de rupture de service sont exclus du primtre de lastreinte.
Enfin, le problme rencontr doit avoir un caractre d'urgence. Il ne doit pas tre possible de le traiter
dans le cadre d'une gestion courante des incidents.
Le personnel dastreinte est seul apte juger de la situation et dcider des actions techniques
entreprendre, si ncessaire en liaison avec le RSIO du site concern et l'administrateur de garde.
La prise dappel :
(Actuellement)
Tous les appels pour lastreinte informatique doivent passer par ladministrateur de garde ou le standard
tlphonique (selon lhpital), seuls autoriss appeler le service dastreinte informatique. Il est prvu
quultrieurement, ladministrateur de garde/standard tlphonique sera joint par le Point dEntre Unique sur
lHpital (PEUH).
(Ultrieurement)
Lutilisateur ayant rencontr le problme appelle le Point dEntre Unique sur lHpital (PEUH).
Le PEUH consulte la liste des applications couvertes par les astreintes de Bessires : ACTIPIDOS ,
CCAM, GILDA, GIP, MEDIWEB, PHEDRA, RADOS, SANDRA, SGL.GLIMS, WINREST, SRD, STARE.
Si lapplication est couverte par les astreintes, le PEUH doit se rfrer lapplication en question.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
27
Aprs la qualification de lappel par le PEUH, celui-ci peut tre amen contacter lastreinte informatique.
Pour cela, il doit runir au pralable les informations suivantes :
- lapplication concerne par lappel,
- le nom du service,
- le nom de lutilisateur ayant rencontr le problme son numro de tlphone
- la description du problme.
Puis, il doit se prsenter et faire connatre son numro de tlphone.
Le PEUH dclenche lappel auprs de lastreinte informatique au 01.40. 25.38.40, puis communique les
informations ci-dessus.
Dispositions gnrales
Pour toutes les applications, les contrles suivants doivent tre raliss, tant prcis quaucun appel nest
recevable par ce dispositif pour des problmes fonctionnels ou pour des incidents matriels sur un poste.
Accs lapplication :
Si un poste ne fonctionne pas, il faut essayer sur un autre poste.
Si lutilisateur peut travailler, mais a un message gnant et non bloquant, il faut reporter lappel la DSI aux
heures ouvres dans la semaine.
Si tous les postes des utilisateurs ne fonctionnent pas, il faut faire appel lastreinte.
Editions :
Il faut faire appel lastreinte en cas de problme gnral ddition sur toutes les applications.
Il en est de mme :
Si aucune application hberge sur Bessires ne fonctionne
Dans le cas o lapplication fonctionne normalement, sauf sur une fonction spcifique (qui est
probablement lie une autre application), que cette fonction est bloquante et que lensemble des
utilisateurs rencontrent la mme difficult.
Dispositions particulires
Il faut se reporter lapplication concerne directement par le problme.
ACTIPIDOS :
Problme dimpression :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour des problmes ddition. La rsolution de ces problmes doit tre
reporte aux heures ouvres de la semaine.
Problme dintgration de messages (rception de messages) :
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
28
Il faut faire appel lastreinte dans les cas suivants :
Si tous les nouveaux patients ne sont pas intgrs dans lapplication,
Si toutes les dispensations des mdicaments ne sont pas intgres dans lapplication.
CCAM SAG :
Problme dimpression :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour des problmes ddition. La rsolution de ces problmes doit tre
reporte aux heures ouvres de la semaine.
Problme dintgration de messages (rception de messages) :
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour des problmes de rception de messages. La rsolution de ces
problmes doit tre reporte aux heures ouvres de la semaine.
EDITIONS - SERVEUR DIMPRESSION :
Le serveur dimpression est utilis par plusieurs applications pour leurs ditions.
En cas de problme gnralis des ditions sur les applications sous astreinte de Bessires, le serveur
dimpression est probablement en cause. Il faut alors faire appel lastreinte.
GILDA :
Problme dimpression :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Il faut faire appel lastreinte si le problme ddition est gnral tous les utilisateurs.
Problme dintgration (rception de messages) :
Il faut faire appel lastreinte si tous les nouveaux patients ne sont pas intgrs dans lapplication.
GIP :
En gnral, les appels ne sont pas dclenchs directement pour GIP. La cause du problme peut provenir
dune autre application et ce problme est signal par celle-ci.
MEDIAH :
MediaH est le pivot dchange/communication entre les applications.
En cas de problme gnralis de non-rception de messages par toutes les applications, le serveur MediaH
est probablement en cause. Il faut dans ce cas faire appel lastreinte.
Il faut de mme faire appel lastreinte si les applications (SGL, URQUAL, SANDRA) restantes sur lhpital ne
reoivent plus de messages.
MEDIWEB :
Problme dimpression :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour des problmes dimpression. La rsolution de ces problmes doit
tre reporte aux heures ouvres de la semaine.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
29
Problme dintgration de messages (rception de messages) :
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour des problmes de rception de messages. La rsolution de ces
problmes doit tre reporte aux heures ouvres de la semaine.
PHEDRA :
Problme dimpression :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour des problmes dimpression. La rsolution de ces problmes doit
tre reporte aux heures ouvres de la semaine.
Problme dintgration de messages (rception de messages) :
Il peut tre fait appel lastreinte dans les cas suivants :
Si tous les nouveaux patients ne sont pas intgrs dans lapplication,
Si toutes les prescriptions des mdicaments et autres activits de soins ne sont pas intgres dans
lapplication.
RADOS :
Lapplication WorkList (EsyLink) nest pas couverte par lastreinte de Bessires et il ne peut tre fait appel
lastreinte pour cette application.
Problme dimpression :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour des problmes dimpression. La rsolution de ces problmes doit
tre reporte aux heures ouvres de la semaine.
Problme dintgration de message (rception de messages) :
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour des problmes de rception didentit de nouveaux patients.
Lutilisateur peut toujours saisir lidentit directement dans Rados et ces identits seront corriges dans les
heures ouvres de la semaine. Lappel doit tre uniquement dclench pendant ces horaires.
SANDRA :
Problme dimpression :
Les rsultats peuvent tre consults par accs lapplication. En consquence, si les ditions ne
fonctionnent pas, il faut reporter la rsolution du problme aux heures ouvres dans la semaine.
Problme dintgration de messages (rception de messages) :
Il faut faire appel lastreinte si aucun rsultat nest reu dans lapplication.
Il ne faut pas faire appel lastreinte si les identits de nouveaux patients ne sont pas intgres dans
lapplication.
SGL/GLIMS :
Il ne faut pas faire appel lastreinte pour les laboratoires dexplorations fonctionnelles.
La rsolution de ces problmes doit tre reporte aux heures ouvres de la semaine.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
30
Problme dimpression :
Edition des tiquettes :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Il faut faire appel lastreinte si le problme ddition est gnral tous les utilisateurs.
Pour les autres types dimpression, la rsolution des problmes doit tre reporte aux heures ouvres de la
semaine.
Problme dintgration (rception de messages) :
Il faut faire appel lastreinte si toutes les identits de nouveaux patients ne sont pas rcupres.
SRD RESTAURATION :
Problme dimpression :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Aucun appel ne doit tre dclench pour des problmes dimpression. La rsolution de ces problmes doit
tre reporte aux heures ouvres de la semaine.
Problme dintgration (rception de messages) :
Il doit tre fait appel lastreinte si toutes les identits de nouveaux patients ne sont pas intgres dans
lapplication.
STARE :
Problme dimpression :
Pour les ditions, il ne doit pas tre fait appel lastreinte.
Problme dintgration (rception de messages) :
Il faut faire appel lastreinte si tous les rsultats ne sont pas intgrs dans Stare.
Il faut faire appel lastreinte si toutes les identits de nouveaux patients ne sont pas intgres dans
lapplication.
WINREST RESTAURATION :
Problme dimpression :
Si ldition ne marche pas sur une imprimante, essayer dditer sur une autre imprimante.
Lastreinte ne doit pas tre sollicite pour des problmes dimpression. La rsolution de ces problmes doit
tre reporte aux heures ouvres de la semaine.
Problme dintgration (rception de messages) :
Il faut faire appel lastreinte si les identits de nouveaux patients ne sont pas intgres dans lapplication.
Jours ouvrs/jours ouvrables :
En droit du travail :
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, lexception du dimanche et des diffrents jours
fris chms.
Les jours ouvrs sont les jours effectivement travaills de la semaine, cest--dire, en gnral, du lundi au
vendredi inclus.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
31
La communication avec les mdias pendant la garde
Lorganisation de la garde Communication/presse
Des astreintes sont organises en dehors des heures ouvres du Service la semaine et le week-end.
La personne dastreinte est joignable par le standard.
Le cas chant, les informations peuvent tre adresses sur une messagerie ddie :
service.presse@sap.aphp.fr
Procdure dalerte et de saisie
Ladministrateur de garde Direction gnrale informe et saisit la personne dastreinte de communication :
de tout vnement susceptible dintresser les mdias (hospitalisation dune personnalit, vnements
indsirables,),
de toute demande de presse dactualit (reportages dactualit, interview dun mdecin).
Le standard recevant un appel de journaliste ladresse directement la personne dastreinte pour la presse.
Procdure de traitement
La personne dastreinte pour la communication se met en contact avec ladministrateur de garde de lhpital
pour tout vnement susceptible dintresser les mdias (hospitalisation dune personnalit,
vnements indsirables,) afin dobtenir, si besoin, des informations complmentaires et dfinir la
conduite tenir (bulletin de sant, lments de langage,),
pour toute demande de presse dactualit (reportage dactualit, interview dun mdecin,) afin
dobtenir les accords ncessaires.
v. fiche n58 : accs des journalistes dans les locaux hospitaliers .
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
32
Lorganisation de crise
Lorganisation du systme de gestion de crise au sein de lAP-HP sinscrit dans un processus permanent
comportant trois degrs : la veille, laction et la gestion de crise.
La veille
Cette veille, permanente, se traduit principalement par le fonctionnement de la Cellule rgionale de veille et
daction sur les urgences ( CERVEAU ), organise conjointement par lARHIF et lAP-HP. Sa mission est
le suivi de lactivit dun chantillon de services durgences volontaires dIle-de-France.
Cette cellule est situe au Sige et fonctionne avec des personnels ddis. Elle travaille avec un rseau
dtablissements sentinelles, dispose dindicateurs dalerte et produit un court bulletin dinformation quotidien.
Ce dispositif de veille spcifique est plac sous la responsabilit fonctionnelle de la Mission
Urgence/Rgion de la DPM. Il est articul avec les autres relais de veille rgionale (centre oprationnel de
la zone de dfense - COZ) ou nationale (InVS).
Laction
Lorsquil est constat que les hpitaux atteignent un tat de nette tension dans la gestion du flux des
urgences, en particulier pour assurer lhospitalisation en aval, le dispositif de veille se hausse en position
daction.
Celle-ci se traduit par :
la mise en place dun relev exhaustif des donnes quotidiennes relatives aux urgences et la ranimation
dans tous les hpitaux accueillant des urgences,
une runion quotidienne de la cellule action du Sige afin danalyser les donnes recueillies et, le cas
chant, intervenir par exception pour faciliter les transferts, provoquer ventuellement des dprogrammations
limites, mobiliser plus largement les moyens en aval des urgences.
Chaque hpital doit alors faire en sorte de disposer de capacits supplmentaires en lits en aval des urgences
dans le cadre dune organisation prtablie.
LAP-HP se met systmatiquement en position action chaque anne pendant les priodes du 1
er
juillet au
31 aot et du 1
er
dcembre au 15 janvier. Elle se place en outre dans cette position chaque fois que la
situation lexige au vu des informations produites par le dispositif de veille.
La gestion de crise
La crise peut avoir de multiples causes et prendre diverses formes. Elle se traduit principalement par la
difficult majeure pour lAP-HP, ou certains de ses hpitaux, dassurer leur mission. La situation de crise exige
que ltablissement soit mme de prendre des dispositions exceptionnelles visant une concentration de tous
les efforts, sur lobjet et les effets de la crise, en diffrant des actions non immdiatement ou non absolument
indispensables.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
33
La mise en uvre du dispositif de gestion de crise
Elle rsulte dune dcision de la Direction gnrale (Directeur gnral, Secrtaire gnral, Directeur de
Cabinet).
Elle peut tre prcde dune phase de mise en alerte linitiative des mmes autorits ou de ladministrateur
de garde.
Elle se traduit concrtement par lactivation immdiate du Centre oprationnel de gestion de crise du Sige (le
CO-Victoria) et la runion dune Cellule centrale de crise .
Elle conduit, dans certaines conditions pr-identifies, la mise en uvre de plans particuliers pr-tablis.
2.2. Les plans de crise pr-tablis
Ils sont divers et on peut en distinguer deux grandes familles :
le plan blanc proprement dit, contenant une srie de mesures gnriques visant le passage en position de
gestion de crise du Sige, des SAMU, des hpitaux et des services gnraux,
des plans spcifiques, lis la nature de lvnement (plans de la famille PIRATE, plans intempries, plan
de scurit des points dimportance vitale, etc.)
Le Plan blanc (v. galement la fiche n 72 : Lafflux de victimes, les circonstances exceptionnelles et les
plans blancs )
Il correspond au dispositif de gestion de crise dont sont dots les tablissements de sant (loi relative la
politique de sant publique du 9 aot 2004).
Il na vocation tre dclench que lorsque les consquences sanitaires dun vnement exceptionnel ne
peuvent tre normalement prises en charge dans le cadre du fonctionnement ordinaire de lhpital.
Au niveau de ltablissement, aprs son dclenchement par le directeur gnral, il conduit lactivation
coordonne de plusieurs niveaux oprationnels :
la Direction gnrale (centre oprationnel et cellule centrale de crise)
les SAMU (rgulations 75-zone, 92, 93, 94)
les hpitaux (cellules locales de crise)
les services gnraux (cellules locales de crise)
Au niveau des hpitaux, il repose sur la mise en uvre dune srie de mesures principales :
1. le dclenchement et la leve du plan
2. lactivation de la cellule de crise locale
3. la scurisation priphrique et le contrle des accs
4. lorganisation de la circulation et du stationnement
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
34
5. la mobilisation des personnels
6. la mobilisation des matriels
7. laugmentation des capacits dhospitalisation
8. laccueil et lorientation des victimes
9. la traabilit des patients hospitaliss
10. linformation des familles et des proches
11. la communication interne et externe
Le plan blanc sapplique demble aux hpitaux daccueil des urgences.
Il peut cependant tre dclench et faire lobjet dune mise en uvre particulire dans les hpitaux dactivit
griatrique.
2.3. Les plans spcifiques lis la nature de lvnement
Plan VIGIPIRATE
Plans de lutte contre des risques et menaces particuliers
- nuclaires et radiologiques (Piratome)
- biologiques (Biotox, variole, pandmie grippale)
- chimiques (Piratox)
- intempries (canicule, plan bleu, grands froids, inondations)
- systmes dinformation (Piranet)
Plan de scurit des points dimportance vitale de lhpital
Plan dvacuation de lhpital
Plan de confinement de lhpital
Ces plans prvoient un ensemble de procdures appliquer, de dispositifs mettre en place et de ressources
mobiliser qui pourraient aussi sappliquer en cas daccident NRBC dorigine non terroriste.
** ** **
Les administrateurs de garde disposent dinformations sur la gestion de crise sur les sites suivants :
Intranet : http://intranet.ap-hop-paris.fr/sections/enjeux_et_projets/administration/rubrique1/
le rpertoire partag : K:\crise
Capri : http://capri.aphp.fr login: cellule mot de passe : veille
Cyberurgences : http://cyber-urgences.aphp.fr login : urgencesmot de passe : urgences
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
35
La Cellule centrale de crise
La Cellule centrale de crise (CCC) est llment coordonnateur du dispositif gnral de crise, qui comprend
notamment les cellules locales de crise des hpitaux et des services gnraux.
La Cellule centrale de crise est lentit dcisionnaire et oprationnelle centrale. Elle est place sous lautorit
du Directeur gnral. Elle est active au moment de la crise.
Activation
La mise en place de la Cellule centrale de crise est active par une dcision relevant de lautorit de la
Direction gnrale.
Cette dcision fait suite :
soit une alerte significative du SAMU,
soit la survenue dun vnement grave port la connaissance de ladministrateur de garde de la
Direction gnrale,
soit une alerte directement transmise par les services de lEtat (tutelles).
La mise en place de la Cellule centrale de crise est notifie par un message (fax et ml) aux hpitaux
concerns.
La mobilisation des personnes faisant partie de la Cellule initiale de crise et lactivation du centre oprationnel
de gestion de crise (CO-Victoria) sont assures par le Directeur des Affaires gnrales du Sige ou par
ladministrateur de garde du Sige. Les coordonnes de ladministrateur de garde du Sige sont connues du
standard du Sige.
De mme, les coordonnes du technicien de garde du Sige, qui a accs tous les locaux concerns et qui a
pour mission dinstaller la salle de crise, sont conserves au standard du Sige.
Arrt
Larrt de la Cellule centrale de crise est dcid par la Direction gnrale.
Il est notifi par un message envoy tous les hpitaux. Ce message prcise les dispositions prises pour la
priode post-crise.
Par ailleurs, une sance de dbriefing est organise afin de tirer toutes les conclusions concernant la crise et
son traitement (voir Rapport sur la crise ci-dessous).
Missions de la Cellule centrale de crise
Organisation
1. La Direction gnrale nomme un Directeur de crise qui il appartient de prendre toutes les mesures
adquates concernant la gestion de la crise. Il est, en labsence du Directeur gnral, le dcideur ultime.
A dfaut, cette mission incombe ladministrateur de garde.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
36
2. La Cellule centrale de crise dcide de la mobilisation des personnes non prvues dans la composition de la
cellule.
3. Elle organise les permanences pour toute la dure de la crise.
4. Elle organise ventuellement le suivi post-crise.
Relations avec les hpitaux et les services gnraux
1. La Cellule centrale de crise sassure de la bonne rception de lalerte dans les hpitaux en demandant un
accus de rception par fax ou ml.
2. Elle sassure de la mise en place des cellules locales de crise (CLC) et du caractre oprationnel de leurs
moyens de communication (tlphones, tlcopieurs, mls).
Cette vrification doit seffectuer par des demandes daccuss de rception sur les tlcopieurs et les
adresses mls indiqus par les hpitaux et les services gnraux, et par des appels tlphoniques aux sites.
Cette tche est confie au secrtariat de la Cellule centrale de crise, qui dispose dune liste des coordonnes
des CLC.
3. Elle centralise toutes les donnes de la crise fournies par les hpitaux, les SAMU et les services gnraux,
et les sollicite ventuellement pour leur demander des informations.
4. Elle diffuse auprs des sites concerns les informations utiles et les dcisions quelle a prises. La diffusion
des dcisions seffectue en double par ml et fax. La diffusion des dcisions se fait par fax et si possible par
ml (pour les documents non lectroniques, envoi uniquement par fax).
5. Elle coordonne les moyens et les ressources des services gnraux et des hpitaux.
6. Elle est seule habilite donner des consignes aux hpitaux.
Relations avec les autorits
La Cellule centrale de crise assure les relations avec les autorits : Prfecture de police de Paris (prfecture
de zone de dfense), Ministre de la sant, Agences de scurit sanitaire, DRASS, DDASS
Elle diffuse auprs des hpitaux les informations et les consignes donnes par les autorits.
Elle communique aux autorits les informations en sa possession concernant les victimes, la publication de la
liste officielle des victimes tant du ressort des autorits administratives comptentes.
Les directeurs des hpitaux ont la responsabilit de la scurit de leurs sites et doivent faire appel directement
aux autorits de police sils lestiment ncessaire.
Relations directes avec le public
Le Ple des Recherche Patients ( RIP - DAJDP), rattach dans ces circonstances la Cellule centrale de
crise, est la structure charge dinformer les demandeurs :
sur la prsence des patients ou leur passage aux urgences,
sur leur prsence dans les services dhospitalisation.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
37
Dans un contexte de crise, le RIP est habilit donner aux familles ou proches ces informations, sans
accord pralable de la personne hospitalise.
En aucun cas, le RIP ne donne des informations mdicales sur ltat de sant des victimes, ni sur leur
dcs ventuel. Ces informations ne peuvent tre donnes que par les personnels soignants des hpitaux
concerns.
En ce qui concerne les personnalits, la communication de ces informations relve de la Direction de la
Communication aprs avis du Directeur de crise.
Les hpitaux transmettent en temps rel la Cellule centrale de crise, par lintermdiaire du systme
informatis de traabilit VICTIMES , les informations concernant les patients. Ce site actualis, accessible
au RIP , permet celui-ci de renseigner en temps rel les demandeurs.
Toute autre demande dinformation (liste de victimes, statistiques sur le nombre de personnes admises, etc.)
est gre par la Direction de la Communication aprs avis du Directeur de crise.
Installation du centre oprationnel de gestion de crise (CO-Victoria)
Elle est organise par le Directeur des Affaires gnrales ou ladministrateur de garde du Sige.
Ceux-ci doivent mobiliser les moyens permettant dinstaller et de rendre oprationnel, dans les plus brefs
dlais, lensemble des quipements et des liaisons de la salle de crise.
Numros de la Cellule centrale de crise communiqus aux hpitaux :
01 40 27 46 00 : tlphone de rception des appels
01 40 27 46 01 : tlphone de rception des appels
01 40 27 46 02 : tlcopieur de rception des messages
Ladresse ml de la Cellule centrale de crise, laquelle les hpitaux doivent adresser leurs messages,
est communique au moment du dclenchement des oprations de gestion de crise.
La logistique du Centre oprationnel Victoria est assure pendant la journe par deux secrtaires charges de
recevoir les mls, les appels tlphoniques et de diffuser les messages. La nuit et le week-end, cette fonction
est assure par ladministrateur de garde du Sige. Les cls du local doivent tre retires au standard du
Sige.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
38
La gestion de la communication en situation de crise
(potentielle ou avre)
La gestion de linformation en situation de crise est souvent aussi importante que la gestion de la
crise elle-mme.
Si un vnement indsirable grave constitue toujours une situation sensible, il nest pas appel devenir
systmatiquement une crise mdiatique. Lorganisation mise en place par lAP-HP sinscrit dans une
dmarche prventive de la crise mdiatique : apprcier avec discernement le risque de crise potentielle
induit par chaque vnement indsirable grave, en intgrant la gestion des mdias comme lment de
pilotage stratgique, ceci ds lamont de lalerte.
Il est souvent possible dempcher ou de limiter la survenue dune crise conscutive un vnement
indsirable grave en procdant de faon rigoureuse et diligente.
Lalerte immdiate de la Direction de la Communication via ladministrateur de garde de la Direction
gnrale en constitue un lment.
Sont concerns notamment :
les vnements risque de contentieux (agression dun agent, accident mdical grave,)
les situations risque social (conflits du travail, situations de danger grave et imminent,)
les situations anormales du fait de leur nature ou de leur frquence (accidents et dysfonctionnements
graves, dcs anormaux, infections inhabituellement rcurrentes, incidents rptition,)
ou tout autre sujet ou vnement concernant les activits de lAP-HP.
En situation de crise rsultant dun vnement sur un site hospitalier, le point de dpart est a priori
linformation de la Direction gnrale (Cabinet du Directeur gnral ou administrateur de garde Direction
gnrale ) par le directeur de lhpital (ou ladministrateur de garde de lhpital).
La Direction gnrale ou ladministrateur de garde de la Direction gnrale :
informe alors de la situation ds que ncessaire et mobilise la Direction de la Communication, la DAJDP et
tout autre direction fonctionnelle ou service susceptible dtre impliqu dans la gestion de la situation,
dsigne le chef de file qui sera en appui du directeur de chaque hpital concern. Ce chef de file assurera
linterface Direction gnrale / hpital pendant toute la dure de la situation sensible.
Si le besoin de communiquer apparat, la Direction de la Communication se rapproche du chef de file. Elle
dfinit, en lien avec le directeur de chaque hpital concern (ou avec ladministrateur de garde de lhpital), le
niveau de cette communication : niveau central ou niveau local. Elle informe la Direction gnrale et le
directeur de chaque hpital concern du droulement et de leffet de la gestion de la communication.
La gestion de la communication locale est privilgie dans un premier temps. En effet, lexprience
montre que lintervention du Sige induit ou accentue la perception de crise par les mdias.
La Direction gnrale doit tre informe de la situation suffisamment en amont. Elle doit galement
tre informe du contenu de linformation susceptible dtre diffuse.
Le directeur de lhpital (ou ladministrateur de garde de lhpital) a la responsabilit de la coordination de la
communication interne ou externe locale, en liaison avec la Direction gnrale qui valide les messages.
Afin de bien matriser les situations, la prparation et la mise en cohrence du discours et des donnes,
notamment quantitatives, il est ncessaire de dsigner au sein de lhpital au moins deux personnes
rfrentes des mdias, pour la prise de parole au nom de lInstitution :
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
39
le directeur
le prsident du CCM
Dautres personnes rfrentes peuvent galement tre dsignes pour les assister, parmi lesquelles
le prsident du CLIN (ou de la sous-commission du CCM qui en tient lieu)
le mdecin mdiateur
le charg de communication
le ou les responsables de ple ou de service concerns.
Dans le cadre de la stratgie de communication de crise mise en place par la Direction de la
Communication :
la Direction de la Communication (service de presse) centralise et gre lensemble des demandes
dinformation manant de la presse. Elle est seule habilite communiquer un bilan hospitalier pour ce qui
concerne lAP-HP. Elle diffuse priodiquement, cet effet, un communiqu de presse comportant la date,
lheure, le bilan quantitatif global des personnes hospitalises dans les hpitaux de lAP-HP (par hpital et
ventuellement par degr de gravit). Les indications complmentaires ne peuvent concerner ventuellement
que lge et le sexe des victimes, mais en aucun cas leur identit. Par ailleurs, ce communiqu ne comporte
aucune indication mdicale.
en dehors des communiqus prpars par la Direction de la Communication, un porte-parole de crise
peut tre dsign par le coordonnateur de crise pour assurer la communication auprs de la presse
pendant tout ou partie de la dure de la crise.
de manire gnrale, en situation de crise avre, il convient de matriser la rsonance, autant que
possible. Un risque sous-jacent la communication de crise est la discordance dinformation : prises de parole
intempestives, contradictoires, mal cordonnes, qui sont susceptibles de nourrir la crise mdiatique en jetant
la confusion. La ncessit de parler dune seule voix dans un contexte soumis de fortes pressions
mdiatiques et pour garantir une diffusion dinformations vrifies, cohrentes et dont les sources sont fiables,
justifie une gestion centralise de la gestion des relations avec les mdias et la constitution chaque fois que
ncessaire de la Cellule de communication de crise .
Quelques principes essentiels en cas de crise
Ractivit : alerter immdiatement la Direction gnrale en cas de situation potentielle ou avre de crise
Cohrence : parler dune seule voix en interne et en externe
Intgrit : vrifier la fiabilit des sources et des informations
Transparence matrise : privilgier une communication offensive et claire
Concertation : ne jamais communiquer chaud, ni sans change pralable
Solidarit : tenir compte de la charge motionnelle, des victimes et du personnel
Humilit : lvolution dun scnario nest jamais prvisible
Suivi : assurer la sortie de crise et les suites, tant auprs des personnels que des mdias
Les personnes rfrentes des mdias
Ces personnes sont les seules habilites communiquer par oral ou par crit avec les mdias.
Tout contact avec les mdias doit faire lobjet dune concertation pralable entre les intresss (directeur de
lhpital, prsident de CCM, responsables de service concerns) pour :
laborer ensemble le contenu du message
communiquer des lments srs et vrifis, qui ne pourront pas tre dmentis, contredits ou sujets
polmique
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
40
Toute demande de commentaire doit tre adresse au numro o les personnes habilites communiquer
sont joignables et ont t prvenues.
Aucune rponse ne doit tre donne directement et chaud aux demandes, mais :
- il faut faire prciser la nature de la demande, la nature du support et le nom du correspondant
- il doit tre indiqu quil sera rpondu dans les dlais les plus brefs et si possible dans lheure.
Une grande vigilance doit tre observe sur les autorisations de reportage dans un contexte o doivent tre
prservs le secret mdical et le droit limage des patients et des soignants (voir sur ce point la fiche n58 :
Laccs des journalistes dans les locaux hospitaliers ).
Lappui de la Direction de la Communication aux hpitaux
Une hot line est active en situation de crise par la Direction de la Communication.
Cette assistance se traduit par
une aide lvaluation de lopportunit de communiquer au regard de la situation.
un conseil sur les relais mdias
une aide la formulation des messages en fonction des types de presse
un conseil sur le dispositif mettre en place et sur sa graduation :
- communiqus de presse
- entretiens et/ou interviews individuels
- encadrement et autorisations de reportages
- confrences et/ou points de presse
une veille mdias (monitoring) sur le traitement rdactionnel et audiovisuel de la situation
la mise en place de mdia-trainings de crise.
Centre oprationnel de crise et communication : la Cellule centrale de communication
de crise
Une Cellule centrale de communication de crise est directement relie la Cellule centrale de crise.
Sa mission est dassurer la gestion des mdias pendant la crise, en liaison directe avec la Direction gnrale,
savoir :
llaboration des messages
linterface avec les porte-parole, les rfrents mdicaux et administratifs
relations avec la presse
organisation des rencontres, interviews et reportages
veille mdias.
Communication de crise et Plan blanc
La gestion de ce type de crise est centralise.
Elle sintgre dans un dispositif dpartemental ou rgional.
En cas de crise NRBC (nuclaire, radiologique, biologique, chimique), le niveau rfrent pour lAP-HP est
la zone de dfense. La Cellule de communication de crise de lAP-HP coordonne son action avec celle de
la Prfecture de police et avec celle de la Prfecture de zone de dfense (COZ).
Afin de parler dune seule voix dans un contexte trs encadr, soumis de fortes pressions mdiatiques et
pour garantir une diffusion dinformations vrifies, cohrentes et dont les sources sont autorises , la
gestion des relations avec les mdias est entirement centralise au niveau de la Cellule de communication
de crise.
En cas de dclenchement dun plan gouvernemental de dfense civile (plans de la famille Pirate ), lAP-HP,
mme interpelle par les mdias, ne peut prendre aucune initiative de communication. Cette rgle sapplique
tant au plan institutionnel que local ou a fortiori individuel.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
41
En cas d Alerte Plan blanc :
Ladministrateur de garde Direction gnrale doit saisir le permanent de la Direction de la Communication
(passer par le standard Victoria : 01 40 27 30 00).
Il doit linformer des faits (premiers lments dinformation disponibles).
Le coordinateur communication (Directrice de la communication ou son collaborateur) appel par le
permanent de la Direction de la Communication, rejoint la Cellule centrale de crise pour une premire
valuation de la situation.
En cas de dclenchement du Plan blanc :
La Cellule centrale de crise est active. Le coordonnateur communication dclenche la procdure
communication de crise et mobilise :
lquipe de supplance (un binme est en principe constitu, mais le dispositif est variable suivant lampleur
de la crise)
les porte-parole (rfrents mdicaux et administratifs).
Le champ de la communication Plan blanc
Quelle que soit la pression lgitimement exerce par les mdias au nom du droit linformation, la prise de
parole de la Direction gnrale se limite dans ces circonstances, en principe, aux domaines suivants :
Bilan des victimes : leur nombre, leur orientation, leur prise en charge. Dans le respect de la vie prive et
du secret, aucune information caractre nominatif nest communique.
Informations mdicales relatives aux consquences des produits mis en cause (tableaux cliniques, modes
de prise en charge et traitements requis)
Informations sur les risques de contamination et les recommandations sanitaires visant les
personnels et le public (en fonction du type de risque)
Nature des stocks stratgiques de mdicaments, vaccins ou quipements disponibles dans les hpitaux
(dans la limite des rserves de confidentialit).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
42
MINISTERES ARHIF PREFECTURE de POLICE
DIRECTIONS
FONCTIONNELLES LA VEILLE HPITAUX
DU SIEGE
CABINET DG
PRISE EN CHARGE DE LENSEMBLE
DES EVENEMENTS SURVENANT
CHAQUE JOUR
CERVEAU
ENGAGER LA PROCEDURE DE
GESTION DES EVENEMENTS
SENSIBLES
LES TRAITER
LES TRAITER
ENGAGEMENT DE LA
PROCEDURE DE GESTION
DE CRISE
si ncessaire
si ncessaire
CELLULES DE
VEILLE
CONJONCTURELLES
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
43
Lorganisation pratique de la garde administrative
lhpital
Certains instruments sont a priori indispensables au bon droulement de la garde :
une valise de garde, dont le contenu peut varier selon lhpital. Elle peut comprendre notamment :
- le mmento de ladministrateur de garde,
- les plans dtaills des btiments de l'hpital,
- un trousseau de cls permettant d'ouvrir l'ensemble des btiments et services de l'hpital (en pratique, il
peut galement s'agir de la cl de l'armoire cls ou d'un passe),
- un tlphone mobile avec un nombre suffisant de batteries de secours;
- un annuaire tlphonique de l'hpital, du Sige, et comportant les numros des administrations
sanitaires, du Parquet, des services de secours, de la prfecture.,
- le rglement intrieur de lhpital,
- un registre de rapport de garde.
le registre de rapport de garde est un document important permettant au sein de chaque hpital :
- linformation du directeur de lhpital (ou en cas dabsence, du membre du personnel de direction qui le
remplace),
- de garder trace des incidents survenus et traits lors de la garde et des initiatives prises pour les rsoudre.
Ce registre doit tre rdig et sign la fin de chaque garde par ladministrateur qui la assure.
Il doit indiquer clairement et objectivement le type dvnement, dincident ou de situation qui a pos problme
(contexte prcis, heure et lieu), les mesures prises et les rponses apportes, les suites ventuelles
donner, les personnes contactes (Sige de lAP-HP, Parquet, ARH,.).
Il sagit dun document essentiel, qui peut toujours, sagissant dun document administratif communicable au
sens de la loi du 17 juillet 1978, servir dlment de preuve permettant dtablir que lhpital a assum ses
missions dans des conditions normales.
Il doit tre conserv au moins dix ans.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
44
II. Fiches de situations
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
45
1 - Ladmission en urgence
Pour aller lessentiel
Lorsquun patient doit tre admis en urgence, il faut :
assurer les soins de premiers secours et ventuellement organiser le transfert vers un tablissement
plus adapt
procder aux formalits de dpt
prvenir la famille si ncessaire
Principe
Ladmission dun patient bless ou malade rclamant des soins urgents est prononce par le directeur (ou
son reprsentant, ladministrateur de garde) qui doit veiller ce que les soins urgents soient dlivrs.
Lorsque lhpital ne dispose pas des moyens ou comptences pour assurer la prise en charge du patient, il
doit provoquer les premiers secours et prendre toutes les mesures utiles et ncessaires pour diriger le
patient vers un autre tablissement.
Conditions
Aucun motif ne peut tre invoqu pour faire obstacle cette admission, requise par lurgence (tant prcis
que la notion durgence, nulle part dfinie, doit tre apprcie au cas par cas).
Dans ces circonstances, lhpital ne peut exiger, pralablement aux soins, la prsentation dune carte
didentit ou dune attestation de prise en charge des frais mdicaux et dhospitalisation par un organisme
dassurance ou de scurit sociale.
Le patient ou un de ses proches sera invit, quand la situation le permettra, rgulariser sa situation
administrative et financire auprs de la direction de lhpital.
Recommandations
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit :
prvenir la famille du patient dans les meilleurs dlais, sauf opposition expresse de sa part,
procder ou faire procder aux formalits de dpt lorsque le patient nest pas en mesure de le faire lui-
mme
v. fiche n 27 : Le dpt de biens
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
46
informer, le cas chant, le mdecin dsign par le patient (a priori le mdecin traitant) de la date et de
lheure de ladmission et du service afin quil puisse donner tous les renseignements possibles et utiles sur le
patient,
faire signer au patient, le cas chant, une attestation (information sur les risques encourus) lorsque
celui-ci refuse les soins ou lhospitalisation et dresser un procs-verbal en cas de refus de signature.
v. fiche n 32 : Le refus de soins
Rfrences
Articles R. 1112-13 R. 1112-16 du code de la sant publique
Article L. 1113-3 et R. 1113-5 du code de la sant publique
Article 69 du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
47
2- Ladmission dun mineur
Pour aller lessentiel
En principe, un patient mineur ne peut consentir seul lacte mdical
Bien distinguer les actes usuels des actes non usuels
Dtecter les situations drogatoires (urgence mdicale, IVG, demande de soins confidentiels.)
Rappels sur lautorit parentale
Larticle 371-1 du code civil caractrise la rgle de lautorit parentale. Il indique que l'autorit parentale
est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalit l'intrt de l'enfant. Elle appartient aux pre et mre
jusqu' la majorit ou l'mancipation de l'enfant pour le protger dans sa scurit, sa sant et sa moralit,
pour assurer son ducation et permettre son dveloppement, dans le respect d sa personne. Les parents
associent l'enfant aux dcisions qui le concernent, selon son ge et son degr de maturit .
Larticle 372 du mme code pose la rgle de lexercice conjoint de lautorit parentale et nonce que les
pre et mre exercent en commun l'autorit parentale . Nanmoins, chacun des parents est rput agir
avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorit parentale relativement la personne de
l'enfant.
Toutefois, dans certaines situations et outre les cas de dcs de lun des parents, lautorit parentale nest pas
exerce en commun. Il sagit des situations suivantes :
lorsque la filiation est tablie l'gard de l'un des parents plus d'un an aprs la naissance d'un enfant dont
la filiation est dj tablie l'gard de l'autre : dans ce cas, le parent pour lequel la filiation tait
antrieurement tablie est seul investi de l'exercice de l'autorit parentale (l'autorit parentale pourra
nanmoins tre exerce ultrieurement en commun en cas de dclaration conjointe des pre et mre
devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur dcision du juge aux affaires familiales).
lorsque la filiation est judiciairement dclare l'gard dun seul parent de l'enfant,
en cas de dlgation de lautorit parentale, volontaire ou non (article 377 du code civil),
en cas de retrait total ou partiel de lautorit parentale concernant un des parents (articles 378 et s. du code
civil).
Principe : ladmission la demande du reprsentant lgal
L'admission d'un mineur est prononce par le directeur de lhpital (ou ladministrateur de garde), sauf
ncessit ou urgence, la demande :
d'une personne exerant l'autorit parentale
ou le cas chant de l'autorit judiciaire.
Lorsquaucune personne exerant l'autorit parentale ne peut tre jointe en temps utile, l'admission peut tre
demande par le service dpartemental de l'aide sociale l'enfance (ASE).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
48
Ladmission la demande de lautorit judiciaire ou du service dpartemental de lAide sociale
lenfance
L'admission d'un mineur, que l'autorit judiciaire, statuant en matire d'assistance ducative ou en application
des textes qui rgissent l'enfance dlinquante, a plac dans un tablissement d'ducation ou confi un
particulier, est prononce la demande du directeur de l'tablissement ou celle de la personne auquel le
mineur a t confi (et qui en a la garde).
Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service dpartemental de l'aide sociale l'enfance (ASE), l'admission
est prononce la demande de ce service, sauf si le mineur lui a t confi par une personne exerant
l'autorit parentale.
Lautorisation doprer
Une autorisation crite doprer le mineur et de pratiquer les actes ventuels lis lopration doit tre
demande au moment de ladmission pour tous les cas o lautorisation ne pourrait en cas de besoin tre
obtenue bref dlai du pre, de la mre ou du tuteur lgal en raison de leur loignement ou pour toute autre
cause.
Attention !
Lorsquil existe un dsaccord entre les parents sur la dcision dhospitalisation et hors les cas durgence
imposant lintervention pour sauvegarder la sant du mineur, il leur revient de saisir le juge des enfants ou le
juge aux affaires familiales.
La doctrine retient quune mre mineure est malgr sa minorit titulaire de lautorit parentale sur son
enfant.
Exceptions : ladmission la demande du mineur
Dans certaines circonstances, ladmission du mineur peut tre prononce sans laccord des titulaires de
lautorit parentale.
Il sagit des cas suivants :
le mineur mancip,
Rappel sur lmancipation
le mineur est mancip de plein droit par le mariage,
le mineur non mari et ayant atteint lge de 16 ans rvolus peut tre mancip par dcision du juge des
tutelles, la demande des pre et mre ou de lun deux.
le mineur dont les liens familiaux sont rompus et qui bnficie personnellement ce titre de la CMU,
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
49
en cas durgence : dans ce cas, les formalits dadmission passent aprs lobligation de soins, sous rserve
de rgulariser la situation le plus rapidement possible,
lorsque le traitement ou lintervention simpose pour sauvegarder la sant du mineur et lorsque celui-ci
soppose expressment la consultation du ou des titulaires de lautorit parentale et souhaite garder le
secret sur son tat de sant,
la mineure qui souhaite subir une IVG (v. fiche n18 : la demande dIVG ),
lorsque des parents refusent un traitement ou refusent de faire pratiquer une intervention sur leur enfant et
que ce refus risque dentraner des consquences graves pour la sant du mineur (dans ce cas, la loi prvoit
que le mdecin dlivre les soins indispensables ).
Rappel : ge de la majorit lgale dans divers pays
En application de l'article 3 du code civil, l'ge de la majorit est fix par la loi nationale du ressortissant.
C'est ainsi que pour les pays dans lesquels l'ge de la majorit se situe au del de 18 ans, le consentement
des titulaires de l'autorit parentale aux soins de leur enfant mineur peut tre obligatoire au-del de cet ge.
Age de la majorit lgale dans divers pays trangers
Algrie 21 ans
Allemagne 18 ans
Autriche 19 ans
Belgique 18 ans
Brsil 21 ans
Burkina Faso 20 ans
Cameroun 21 ans
Rpublique centrafricaine 18 ans
Cote d'Ivoire 21 ans
Congo 18 ans
Espagne 18 ans
Etats-Unis variable
Gabon 18 ans
Grce 18 ans
Inde 18 ans
Irlande 18 ans
Italie 18 ans
Japon 20 ans
Liban 18 ans
Libye 18 ans
Luxembourg 18 ans
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
50
Madagascar 18 ans
Mali 18 ans
Maroc 21 ans
Mauritanie 21 ans
Monaco 21 ans
Nigeria 18 ans
Pakistan 18 ans
Pays-Bas 18 ans
Pologne 18 ans
Portugal 18 ans
Sngal 18 ans
Sri Lanka 18 ans
Sude 18 ans
Suisse 18 ans
Tchad 18 ans
Turquie 18 ans
Tunisie 20 ans
v. fiche n 31 : Le consentement du patient mineur
Rfrences
Articles L. 1111-5, L. 3211-10, L. 3211-1, L. 3213-1, L. 3211-12 et L. 3213-9 du code de la sant publique,
Articles R. 1112-34 et R. 1112-36 du code de la sant publique,
Articles 371 et s. du code civil,
Circulaire n 83-24 du 1
er
aot 1983 relative lhospitalisation des enfants,
Articles 76 du rglement intrieur type AP-HP.
Voir Guide AP-HP : Lenfant, ladolescent lhpital (2002)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
51
3 - Ladmission du majeur protg
Pour aller lessentiel
Pour ladmission des majeurs protgs :
les rgles du droit commun sappliquent aux patients sous sauvegarde de justice et sous curatelle:
ladmission relve en principe de leur dcision,
ladmission dun majeur sous tutelle ne peut tre prononce qu la demande de son reprsentant lgal
(le tuteur),
Dfinitions
Majeur protg : personne majeure dont les facults mentales et/ou corporelles sont altres par une
maladie, une infirmit ou un affaiblissement d lge. Cette altration, mdicalement tablie, place la
personne dans limpossibilit de pourvoir seule ses intrts.
Le majeur sous sauvegarde de justice
Il sagit dune mesure de protection juridique temporaire, mise en uvre pralablement un rgime de
protection plus durable ou pour un majeur atteint dune altration provisoire de ses facults. La personne
conserve le plein exercice de ses droits. En matire de soins, elle conserve la mme capacit juridique que
nimporte quel patient. Son admission, son sjour et sa sortie relvent des rgles du droit commun.
Le majeur sous curatelle
Le majeur, sans tre hors dtat dagir lui-mme a besoin dtre conseill ou contrl dans les actes de la vie
civile. Son admission, son sjour et sa sortie relvent des rgles du droit commun.
Le majeur sous tutelle
La tutelle est mise en place lorsque la personne nest plus mme dexprimer sa volont et a donc besoin
dtre reprsente dune manire continue dans les actes de la vie civile. Il sagit dune mesure de
reprsentation par laquelle le tuteur dsign agit en lieu et place du majeur. Certes, la loi prvoit que le
consentement (aux soins) doit tre systmatiquement recherch sil est apte exprimer sa volont et
participer la dcision, mais dune manire gnrale, le majeur sous tutelle ne peut consentir seul ni
son admission, ni aux soins : le tuteur le reprsente et seul son consentement est requis.
v. fiche n 27 : Le dpt de biens
Rfrences
Articles 448 490-3, 491 491-6, 492 515 du code civil,
Articles 91 et 92 du rglement intrieur de lAP-HP
voir Guide AP-HP, Personnes vulnrables et domaine mdical Quels sont leurs droits ? (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
52
4 - Ladmission dune personne en situation de
prcarit
Pour aller lessentiel
En cas durgence, les premiers soins doivent tre dispenss et ladmission prononce.
Les formalits seront accomplies ultrieurement, le cas chant dans le cadre de la permanence daccs
aux soins de sant (PASS).
La Couverture Maladie Universelle (CMU)
Ce dispositif garantit tous une prise en charge des soins par un rgime dassurance maladie et, aux
personnes dont les revenus sont les plus faibles, le droit une protection complmentaire et la dispense
davance de frais.
La CMU de base permet laccs lassurance maladie pour toutes les personnes rsidant en France en
situation rgulire depuis plus de trois mois et qui nont pas droit lassurance maladie un autre titre,
La CMU complmentaire accorde aux personnes les plus dmunies le droit une complmentaire
sant gratuite (prise en charge du forfait journalier et du ticket modrateur sans avance de frais).
Lors de ladmission, la personne doit fournir lhpital les documents ncessaires la prise en charge de
ses frais dhospitalisation, except en cas durgence o son admission peut tre prononce par le directeur
(ou ladministrateur de garde) sans que ces formalits naient pralablement t remplies.
La Permanence dAccs aux Soins de Sant (PASS)
Les PASS sont des cellules de prise en charge mdico-sociale, destines faciliter laccs des personnes
dmunies au systme hospitalier ainsi quaux rseaux institutionnels ou associatifs de soins, daccueil et
daccompagnement social. Ces permanences ont galement pour fonction daccompagner les personnes en
difficult dans les dmarches ncessaires la reconnaissance de leurs droits sociaux. Tous les
tablissements publics de sant ayant une activit de court sjour sont tenus par la loi de mettre en place un
tel dispositif, dans une configuration propre aux ncessits locales.
Les PASS nont a priori pas vocation prendre en charge des assurs sociaux, sauf exception : absence de
couverture complmentaire, personnes assures sans le savoir ou ne prsentant pas les documents en
attestant, personnes ayant besoin dune assistance psychologique et sociale spcifique.
La loi prvoit que les tablissements publics de sant, dans des conditions prvues en principe par convention
avec lEtat, peuvent tre amens dlivrer gratuitement des traitements aux personnes en situation de
prcarit (article L. 6112-6 du code de la sant publique). Le fait que les mdicaments dont ils ont besoin ne
soient pas rembourss par lassurance maladie nest pas une restriction prvue par la loi.
Pour des plus amples informations vous pouvez vous reporter la brochure AP-HP Les permanences
daccs aux soins de sant PASS ractualise en 2004 (3me dition)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
53
Priode de grand froid et organisation de rondes
1. A la suite du dcs dune personne sans domicile fixe proximit dun hpital parisien, un communiqu
ministriel du 21 novembre 1998 a prcis que lhpital doit veiller la bonne prise en charge des
personnes qui se prsentent ses portes () et qu ce titre, le personnel hospitalier doit tre
sensibilis exercer une particulire vigilance partout o cest ncessaire, au sein et aux abords des
tablissements hospitaliers, notamment par lorganisation de rondes rgulires .
2. Une circulaire DGAS/1 A du 18 octobre 2004 relative au dispositif daccueil, dhbergement et dinsertion
plan hiver 2004-2005 a ultrieurement mis en place un dispositif daccueil et dhbergement consolid des
personnes en difficult prvoyant la collaboration, entre autres intervenants, des tablissements de sant.
Ce dispositif prvoit notamment un recensement par les agences rgionales dhospitalisation des locaux
susceptibles dtre mobiliss au sein des hpitaux publics dans le cadre du plan Hiver . De plus, la
Ministre dlgue la lutte contre la prcarit et lexclusion a alors rappel que lattention des directeurs
dtablissements de sant est appele sur la prsence dans lenceinte de lhpital de personnes sans abri et
de leur signalement au 115 (gr Paris par le SAMU social).
LAP-HP est tenue de participer galement ces actions au travers du SAMU : la mme circulaire nonce en
effet que si les personnes refusent dtre mises labri alors quelles semblent en danger, il appartiendra
aux agents entrs leur contact duser, dans un premier temps, de toute leur persuasion et, en cas dchec,
de prvenir le SAMU qui mobilisera les moyens appropris afin dvaluer la situation mdicale de la personne
et apprciera la ncessit de la faire hospitaliser (avec ou sans consentement). Lobligation dassistance
personne en danger sera apprcie par les acteurs de terrain en lien avec le mdecin rgulateur du SAMU .
Rfrences
Loi n 99-641 portant cration dune couverture maladie universelle,
Loi n 98-657 du 29 juillet 1998 relative la lutte contre les exclusions,
Article L. 6112-6 du code de la sant publique,
Article 68 du rglement intrieur de lAP-HP,
Communiqu ministriel du 21 novembre 1998 (organisation de rondes rgulires aux abords des hpitaux en
priode de grand froid),
Circulaire DGAS/1 A n 2004-511 du 18 octobre 2004 relative au dispositif daccueil, dhbergement et dinsertion
Plan hiver 2004-2005.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
54
5 Ladmission dun patient non ressortissant de
lUnion Europenne
Pour aller lessentiel
Distinguer ladmission programme, qui impose des formalits pralables, de ladmission en situation
durgence, qui doit tre effectue le cas chant en suspendant la ralisation des formalits
administratives.
Les patients trangers rsidant rgulirement en France sont en principe couverts par lAssurance
maladie, ds quils peuvent justifier de leur identit et dune rsidence stable et rgulire.
Ladmission programme
Ladmission doit tre prcde de dmarches au plan mdical et au plan administratif.
Sur le plan mdical, le patient doit adresser au directeur de lhpital, par lintermdiaire dun mdecin :
une lettre de demande davis mdical en vue dune hospitalisation prcisant le nom du service sollicit,
un rsum du dossier mdical sous pli confidentiel.
Aprs tude du dossier, lhpital adressera au patient un avis mdical accompagn dun devis contresign
par la direction de lhpital indiquant la dure prvisionnelle du sjour et le montant prvisionnel des frais de
soins.
Ladmission est subordonne la confirmation de la prise en charge des soins soit par un organisme tiers
payeurs soit par le patient lui-mme.
Sil sagit dun malade payant ou dun malade relevant dun organisme dont les prises en charge ne sont pas
acceptes par lAP-HP, une provision dun montant gal au devis doit tre verse lhpital par
lintermdiaire du Payeur de lAmbassade de France du pays concern (article R. 6145-4 C. sant publ.).
Lobligation de contracter une assurance prive :
Tout tranger dsireux dentrer en France (ressortissants des pays non membres de lunion europenne), quil
soit soumis ou non une obligation dobtention de visa, a lobligation de contracter une assurance prive
(depuis la loi du 26 novembre 2003 relative la matrise de limmigration, au sjour en France et la
nationalit dite loi Misefen ) couvrant ses ventuelles dpenses mdicales et hospitalires, hauteur de
30 000 euros minimum (v. art. 3-2 du dcret n 2004-1237 du 17 novembre 2004).
Patients trangers rsidant rgulirement en France :
Ces personnes, ds lors quelles peuvent justifier de leur identit et dune rsidence stable et rgulire (art. L.
161-2-1, C. Scurit soc.), ainsi que leurs ayants droit sont en principe couverts par lAssurance maladie.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
55
Ladmission en urgence
Ladmission dun malade en situation durgence mdicalement constate est de droit, quelles que soient les
conditions de prise en charge administrative du malade.
Il convient toutefois, ds lors que la ralisation de ces formalits est possible compte tenu de ltat de
sant du patient, et sans retarder la mise en uvre des soins :
de recueillir les renseignements et de photocopier les documents concernant le malade en vue de
lmission des titres de recettes,
de prciser au malade le montant des frais engags,
dinformer lhbergeant que des actions en recouvrement peuvent tre engages son encontre si aucun
rglement nintervient,
de demander le versement dune provision compte tenu de la dure prvisible du sjour,
de faire signer un engagement de paiement et de demander un relev didentit bancaire.
Les trangers en situation irrgulire
Pour les trangers en situation irrgulire, une dure de rsidence en France dau moins 3 mois est
ncessaire pour bnficier de lAide Mdicale dEtat (art. 97 de la loi de finances pour 2003 du 30 dcembre
2003). Toutefois, un dispositif de prise en charge des soins urgents a t prvu pour les personnes en
situation irrgulire, durant les 3 premiers mois de rsidence en France : il concerne les soins urgents dont
labsence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire une altration grave et durable de ltat de
sant de la personne ou dun enfant natre (article L. 254-1 du code de laction sociale et des familles).
Rfrences
Site internet du CLEISS (Centre des Liaisons Europennes et Internationales de Scurit Sociale) : http://www.cleiss.fr
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
56
6 - Ladmission dune personnalit
Pour aller lessentiel
prvenir les autorits comptentes de la prsence dune personnalit au sein de lhpital et uniquement
avec laccord de celle-ci,
organiser les visites (famille, amis, journalistes et photographes) avec laccord de lintress.
Les personnels doivent signaler au directeur (ou ladministrateur de garde) toute consultation ou
hospitalisation dune personnalit. Il importe en effet dassurer la protection de la personne contre toute
indiscrtion ou perturbation de son sjour.
Lintress doit tre interrog (si son tat le permet), afin de connatre :
sil demande que son admission reste confidentielle,
sil souhaite recevoir certaines personnes quil aura choisies,
sil accepte la visite de journalistes et/ou photographes.
Dans ce dernier cas, le directeur (ou ladministrateur de garde) devra dlivrer pralablement une autorisation
crite pour toute demande de visite.
Selon la personnalit, et avec laccord de celle-ci, le directeur (ou ladministrateur de garde) pourra prvenir la
Direction Gnrale, lautorit sanitaire (DDASS), le prfet ou lARH de sa prsence au sein de lhpital.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) peut selon le cas tre amen mettre en place, en lien avec les
forces de lordre, un systme de scurit et de protection de la personnalit, aux abords de sa chambre et
du btiment dans lequel elle est prise en charge.
v. fiche n 13 : Ladmission confidentielle et sous le rgime de lanonymat
v. fiche n 58 : Laccs des journalistes dans les locaux hospitaliers
Adresses et numros utiles :
DDASS :
Prfet :
Agence Rgionale de lHospitalisation (ARH) :
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
57
7 Ladmission dun militaire
Pour aller lessentiel.
Lhospitalisation dun militaire doit tre signale lautorit militaire ou la gendarmerie
Rgle gnrale
En principe, les militaires de carrire, malades ou blesss, ne sont pas hospitaliss au sein des hpitaux
civils, et sont pris en charge par le Service de sant des Armes.
Ceci ninterdit bien entendu pas leur admission dans un hpital civil lorsquelle est ncessaire.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) qui prononce ladmission dun militaire effectue en cas durgence,
doit signaler cette admission lautorit militaire ou, dfaut, la gendarmerie.
Adresses et numros utiles :
Autorits militaires :
Service de sant des armes : BP 125 00459 Armes tl. : 01 41 93 36 10
Hpitaux militaires :
Hpital dinstruction des armes du Val-de-Grce
74, boulevard de Port-Royal BP 1
00446 Armes
75005 PARIS
Tl. : 01 40 51 40 00
Hpital dinstruction des armes Percy
101, avenue Henri-Barbusse
92141 CLAMART cedex
Tl. : 01 41 46 60 00
Hpital dinstruction des armes Bgin
69, avenue de Paris
00498 Armes
94160 SAINT MANDE
Tl. : 01 43 98 50 00
Rfrences
Articles R. 1112-29 du code de la sant publique,
Articles 88 et 89 du rglement intrieur de lAP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
58
8 Ladmission dun patient en tat dbrit
Pour aller lessentiel
dlivrer les soins urgents lorsquils sont ncessaires,
appeler la police (ou la gendarmerie) si le patient prsente un danger pour lui et/ou pour les autres,
faire signer une attestation en cas de refus dhospitalisation,
consigner les dmarches entreprises dans le rapport de garde.
Principe
Aucun acte mdical ne peut tre pratiqu sans le consentement libre et clair du patient. Si celui-ci refuse les
soins, il peut quitter tout moment et librement lhpital.
Amnagements et recommandations
Une personne en tat dbrit nest pas totalement en possession de ses moyens. Tout doit tre mis en
uvre pour la convaincre de rester. Si ncessaire, les premiers soins doivent tre dlivrs.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) peut, au cas par cas, et selon lapprciation porte par le mdecin
sur ltat du patient :
faire appel aux forces de police lorsque le patient prsente un danger pour lui-mme ou pour autrui ; le
patient sera alors en principe conduit au poste le plus proche par la police et plac en chambre de sret
jusqu ce quil retrouve ses esprits,
laisser sortir le patient si le mdecin estime quil ny a pas de danger.
Refus dhospitalisation
En cas de refus dhospitalisation, de soins ou de sortie contre avis mdical, il convient de faire signer, lorsque
cela est possible, une attestation au patient linformant des risques quil encourt. A dfaut de signature, la
dmarche tendant convaincre le patient doit tre mentionne son dossier.
v. fiche n 32 : Le refus de soins
Rtention de la personne contre sa volont
En thorie, une telle rtention est possible, sur le fondement de larticle 122-7 du code pnal et certaines
conditions, apprcies par les mdecins :
un danger actuel ou imminent,
un danger pour le patient lui-mme, autrui ou un bien,
les mesures prises doivent tre strictement proportionnes la gravit de la menace
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
59
Art. 122-7 du code pnal :
N'est pas pnalement responsable la personne qui, face un danger actuel ou imminent qui menace elle-
mme, autrui ou un bien, accomplit un acte ncessaire la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y
a disproportion entre les moyens employs et la gravit de la menace .
Cas du patient en tat dbrit qui souhaite quitter lhpital et
utiliser son vhicule
Le mdecin qui constate ltat dbrit manifeste du patient ne peut le contraindre rester au sein de lhpital
et doit respecter sa libert daller et venir.
Pour autant, le personnel hospitalier ne peut demeurer inactif. Selon les circonstances, lhpital pourra faire
appel aux forces de police, informer les membres de la famille du patient de la situation afin quune personne
se dplace pour le conduire chez lui, le retenir au sein de lhpital (cf. ci dessus : rtention de la personne
contre sa volont et lart. 122-7 du code pnal) ou prendre une autre initiative approprie
Cas du patient amen par la police
Sont concerns ici les patients en tat divresse (ou les patients souffrant de troubles du comportement autres
que livresse) amens par les autorits de police.
Lorsque, en dehors de toute rquisition, les services de police ou de gendarmerie amnent lhpital un
patient en tat apparent divresse, celui-ci doit faire lobjet dun bilan mdical exact de son tat.
Si son tat ne ncessite pas une hospitalisation, un certificat de non admission doit tre dlivr aux autorits
de police ou de gendarmerie par le mdecin qui a examin le malade. Il doit tre remis aux officiers de police
judiciaire ou aux gendarmes qui lont amen.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
60
Modle type de certificat de non admission
Hpital.- Service des urgences
Je soussign(e)..
certifie avoir examin ce jour, ..heures.
M./Mme/Melle.
g(e) de
demeurant
..
prsent(e) par :
- les fonctionnaires du commissariat de police de .
- les militaires de la brigade de gendarmerie de
Ltat de sant du patient au moment de lexamen :
mautorise*
ne mautorise pas*
remettre ce patient aux autorits de police (ou de gendarmerie).
Le patient refuse lexamen*
.., le..
(* rayer la mention inutile)
Rfrences
Article L. 1111-4 du code de la sant publique,
Article L. 3341-1 du code de la sant publique,
Article 122-7 du code pnal,
Articles 93 et suivants du rglement intrieur de lAP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
61
9 Ladmission dun bless par arme
Pour aller lessentiel.
Les professionnels de sant sont tenus au respect du secret professionnel : il ne doit pas y avoir de
dclaration systmatique aux services de police
Les projectiles doivent tre soigneusement conservs
Le compte-rendu opratoire rdig doit mentionner avec prcision la localisation des projectiles et la nature
des lsions constates
Principe
L'article 40 du Code de procdure pnale prvoit que "(...) toute autorit constitue, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un dlit est tenu
d'en donner avis sans dlai au procureur de la Rpublique et de transmettre ce magistrat tous les
renseignements, procs-verbaux et actes qui y sont relatifs".
Pour autant, sont exemptes de cette obligation les personnes astreintes au secret professionnel, dont les
professionnels de sant (art. 226-13, C. pnal et L. 1110-4, C. sant publ.).
Recommandations
Aucune recommandation univoque ne peut tre faite. Il revient au directeur de lhpital (ou ladministrateur
de garde) dapprcier, autant que possible avec lquipe mdicale et soignante, la situation et les
circonstances, puis de prendre avec discernement et en conscience les dcisions qui lui paraissent simposer.
Il ne peut notamment y avoir de dclaration systmatique aux services de police de ladmission des
blesss par arme feu ou arme blanche.
Lorsque les praticiens hospitaliers extraient un projectile du corps dun patient (balles, lames de couteaux,),
ils doivent prendre les mesures conservatoires appropries permettant les examens utiles aux autorits
judiciaires si elles taient saisies.
Un compte-rendu opratoire particulier doit alors tre rdig. Il doit indiquer :
la localisation des projectiles,
la nature des lsions constates.
Les vtements de ces blesss, ventuellement utiles aux enquteurs, peuvent tre conservs en ltat
quelques jours (circulaire du 21 juillet 1947).
Rfrences
Articles 226-13, 226-14 et 434-1 du code pnal,
Article 72 du rglement intrieur de lAP-HP
Loi n2003-239 du 18 mars 2003 pour la scurit intrieure, article 85
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
62
10 Ladmission des patients dtenus / prvenus /
gards vue
Pour aller lessentiel.
Les dtenus ncessitant des soins hospitaliers doivent en principe tre transfrs dans un hpital spcialis. Ils ne
doivent donc tre admis dans un hpital de lAP-HP qu titre exceptionnel :
lorsque leur tat de sant ncessite des soins particuliers ou ne pouvant tre raliss au sein dun
tablissement pnitentiaire,
(et pour les prvenus) pour des raisons tenant limpossibilit de les loigner des juridictions devant lesquelles
ils doivent comparatre.
Admission
Ces malades ou blesss doivent tre hospitaliss au sein de lhpital, dans des locaux spcialement
amnags cet effet. Lhpital peut toutefois assurer leur hospitalisation dans dautres locaux en cas
durgence ou de ncessit de soins spcialiss.
Hors les cas durgence, ladmission dun dtenu se fait la demande de ladministration pnitentiaire sur
autorisation du Ministre de la Justice (magistrat saisi du dossier) et aprs avis dun mdecin intervenant dans
le centre pnitentiaire.
En cas durgence, il doit tre procd lhospitalisation du dtenu avant rception de ces accords (du
Ministre de la Justice et du mdecin intervenant dans le centre pnitentiaire).
Surveillance et responsabilit
Les mesures de surveillance et de garde des dtenus incombent exclusivement aux personnels de
ladministration pnitentiaire et sexercent sous leur responsabilit.
En aucun cas, le service de scurit intrieur de lhpital ne doit tre amen y participer.
Lorsque, pour des raisons strictes de scurit, le chef descorte (police ou gendarmerie) estime quune
consultation doit tre annule ou reporte, la dcision est prise sous la seule responsabilit de lhpital
pnitentiaire. Elle ncessite une lettre crite de son directeur (et/ou du mdecin pnitentiaire) et une
information du directeur de lhpital. Elle simpose au mdecin hospitalier.
La responsabilit de lhpital ne saurait donc tre engage dans ce cas prcis. En revanche, et ds lors que le
dtenu est pris en charge (consultation ou hospitalisation), linsuffisance des soins prodigus est susceptible
dengager la responsabilit de lhpital, cette carence pouvant constituer une faute dans lorganisation et le
fonctionnement du service.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
63
Relations avec lextrieur (visites, courrier)
Les personnes prives de libert hospitalises sont considres comme continuant subir leur peine (pour
les prvenus, comme tant placs en dtention provisoire) : les rgles de lorganisation pnitentiaire
continuent de sappliquer.
Pour le courrier, ladministration pnitentiaire conserve le pouvoir douvrir, de retenir une correspondance et
de rclamer lhpital des lettres qui auraient t adresses au dtenu.
Attention !
Tout incident grave doit tre signal au Prfet, au Procureur de la Rpublique, au directeur rgional des
services pnitentiaires et au Ministre de la justice (pour un prvenu, au magistrat en charge du dossier ; pour
un condamn, au juge de lapplication des peines).
Organisation dune consultation mdicale - Recommandations
Dans la mesure du possible, prparer la consultation, en concertation avec les services pnitentiaires,
Les rgles relatives au consentement sappliquent aux dtenus,
v. fiche n 29 : Le consentement aux actes mdicaux
Eviter dannuler des rendez-vous la dernire minute,
Limiter le temps de prsence du dtenu au sein de lhpital,
Organiser des conditions daccueil discrtes et adaptes,
Le cas chant, laisser ladministration pnitentiaire dcider du port de menottes et/ou dentraves, celle-ci
ne devant pas gner le bon droulement des soins,
Respecter les niveaux de scurit dcids par ladministration pnitentiaire (I, II ou III selon le danger
potentiel du dtenu : v. dfinitions ci-aprs). Dans tous les cas, le chef descorte doit veiller prendre les
mesures de scurit qui simposent, celles-ci ne devant pas entraver la confidentialit de la consultation,
Faire en sorte que le chef descorte puisse contrler le local et assurer la surveillance de tous les accs.
Lors dune consultation, certaines dcisions peuvent tre contestes par le mdecin (par exemple, lutilisation
de moyen de contrainte). Dans ce cas, un formulaire type pralablement renseign par le chef dtablissement
pnitentiaire doit en principe lui tre remis par le chef descorte afin de porter sa connaissance les motifs
justifiant le recours de telles mesures de scurit. A titre exceptionnel, et en fonction des lments
complmentaires ports la connaissance du chef de ltablissement pnitentiaire (de lun de ses adjoints ou
du chef de service pnitentiaire ayant reu dlgation cet effet), le dispositif mis en place pourra tre
modifi.
Attention !
Les femmes enceintes dtenues ne doivent pas tre menottes au cours de leur accouchement, dans la salle
de travail et pendant le travail. La surveillance ne doit pas sexercer lintrieur de la salle, mais lextrieur.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
64
Personnes gardes vue
Ladmission des personnes gardes vue est prononce dans les mmes conditions que celles des patients
relevant du droit commun. Leur surveillance est assure par lautorit de police ou de gendarmerie qui a
prononc la garde vue, sous le contrle du Procureur de la Rpublique ou du Juge dinstruction.
Sagissant du menottage, les rgles applicables aux patients dtenus sont transposables aux patients gards
vue. Quel que soit le niveau de surveillance retenu par les OPJ, ceux-ci doivent veiller ce que les mesures
de scurit prises nentravent pas la confidentialit de lentretien mdical. Cest pourquoi une concertation
avec les mdecins est essentielle. Ceux-ci devront toutefois se conformer la dcision retenue par les OPJ.
Lorsque, dans le cadre dune procdure pnale, les officiers de police judiciaire (OPJ) demandent la
ralisation dexamens particuliers, une rquisition est utile. En revanche, lorsque le patient gard vue est
amen aux urgences et que son tat de sant exige des soins immdiats, son admission est prononce dans
les mmes conditions que celles des patients relevant du droit commun.
Rfrences
Articles R. 1112-30 R. 1112-33 du code de la sant publique,
Articles D. 391 D. 399 du code de procdure pnale,
Circulaire du 18 novembre 2004 relative lorganisation des escortes pnitentiaires des dtenus faisant lobjet dune
consultation mdicale
Articles 93 et suivants du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
65
Dfinitions utiles
(source : site du Ministre de la justice - www.justice.gouv.fr)
Administration pnitentiaire
Direction et services relevant du ministre de la Justice. L'administration pnitentiaire prend en
charge les personnes condamnes pnalement par dcision de justice. Elle participe
l'excution des dcisions pnales et au maintien de la scurit publique. Elle met en uvre
des actions de rinsertion sociale des personnes.
Centre de dtention
Prison, tablissement pnitentiaire accueillant les personnes majeures condamnes qui
prsentent les perspectives de rinsertion les meilleures. Leur rgime de dtention est orient
principalement vers la resocialisation des dtenus.
Centre pnitentiaire
tablissement pnitentiaire qui comprend au moins deux quartiers rgime de dtention
diffrents : maison d'arrt, centre de dtention et/ou maison centrale.
Centre de semi-libert
tablissement pnitentiaire qui reoit des condamns admis au rgime de semi-libert.
Comparution
Comparution personnelle
Convocation d'une juridiction (ou d'un juge) ordonnant une personne de se prsenter
personnellement devant elle.
Comparution immdiate
Procdure par laquelle un prvenu est traduit immdiatement aprs l'infraction devant le
tribunal correctionnel pour tre jug le jour mme. Cette procdure n'est prvue par la loi
que si l'auteur (identifi) est majeur, et en cas de dlit puni de 1 7 ans d'emprisonnement
(flagrant dlit), ou de 2 7 ans (aprs enqute prliminaire).
Condamn
Personne dclare coupable d'avoir commis une infraction par une dcision dfinitive.
Dtention provisoire
Mesure exceptionnellement ordonne par le juge des liberts et de la dtention saisi par le
juge d'instruction de placer en prison avant son jugement une personne mise en examen
pour crime ou dlit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement (loi du 15 juin 2000). La
dtention provisoire doit tre strictement motive selon les conditions prvues par la loi.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
66
Dtenu
Personne incarcre dans un tablissement pnitentiaire.
tablissement pnitentiaire
Prison. Il existe plusieurs types d'tablissements pnitentiaires selon le rgime de dtention et
les catgories de condamnations : les centres de dtention, les centres pnitentiaires, les
centres de semi-libert, les maisons d'arrt, les maisons centrales.
Garde vue
Pour les ncessits d'une enqute, un officier de police judiciaire peut retenir une personne
dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie pendant 24 heures maximum, si elle
est suspecte d'avoir commis une infraction. Le procureur de la Rpublique doit en tre
inform. Il peut autoriser la prolongation de la garde vue pour un nouveau dlai de 24 heures
maximum.
La garde vue est strictement rglemente par la loi et son excution est surveille par les
magistrats du Parquet. La personne garde vue dispose de droits comme le droit de se
taire, le droit de faire prvenir sa famille ou de s'entretenir avec un avocat au dbut de la garde
vue (loi du 15 juin 2000). Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupfiants), la
garde vue peut durer au total 4 jours.
Incarcration
Emprisonnement.
Juge de l'application des peines
Il intervient aprs un jugement pnal pendant l'excution des peines quelles qu'elles soient et mme
aprs la sortie de prison, en cas de peines d'emprisonnement
Maison d'arrt
tablissement pnitentiaire qui reoit les prvenus et les condamns dont la dure de peine
restant purger est infrieure 1 an, ou les condamns en attente d'affectation dans un
tablissement pour peine (centre de dtention ou maison centrale). Certaines maisons
d'arrt disposent d'un quartier spcifique pour recevoir des mineurs, spar des adultes.
Maison centrale
tablissement qui reoit les condamns les plus difficiles. Leur rgime de dtention est ax
essentiellement sur la scurit.
Niveau de surveillance
Niveau de surveillance I : la consultation mdicale peut seffectuer hors la prsence du
personnel pnitentiaire avec ou sans moyen de contrainte
Niveau de surveillance II : la consultation se droule sous la surveillance constante du
personnel pnitentiaire mais sans moyen de contrainte
Niveau de surveillance III : la consultation se droule sous la surveillance constante du
personnel pnitentiaire avec moyen de contrainte
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
67
Prvenu
Personne (en libert ou dtenue dans un tablissement pnitentiaire) poursuivie pour
contravention ou dlit, et qui n'a pas encore t juge ou dont la condamnation n'est pas
dfinitive.
Prison (tablissement pnitentiaire)
Voir centre de dtention, centre pnitentiaire, centre de semi-libert, maison d'arrt,
maison centrale.
Procureur de la Rpublique
Magistrat, chef du Parquet (ou ministre public) auprs d'un tribunal de grande instance (ou
d'un tribunal de premire instance ou d'un tribunal suprieur d'appel pour les DOM TOM).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
68
11 Ladmission dun patient porteur de drogue ou
dune arme
Pour aller lessentiel
un patient ne doit pas introduire de drogue ou darmes dans lhpital et a fortiori, conserver darme sur lui
lors de la consultation ou lors de son hospitalisation,
toute arme doit tre confisque et remise avec prcautions (protection des traces et empreintes) au chef de
la scurit. Plus prcisment :
- les armes blanches doivent tre confisques et faire lobjet dun dpt auprs du chef de la scurit,
- les armes feu doivent tre confisques, enregistres et munies dun numro et dune description sur le
cahier dinventaire des admissions, puis ventuellement dposes au commissariat, sans donner lidentit du
patient (ventuellement, prvenir le commissariat que lon va transporter une arme feu),
Se munir de gants et manipuler le moins possible larme. La surveiller en attendant sa prise en charge par
une personne habilite,
ne pas jeter la drogue recueillie sur un patient,
noter les dmarches effectues dans le rapport de garde.
Le rglement intrieur type de lAP-HP prvoit que sauf besoins de service ou autorisations spciales (), il
est interdit dintroduire lhpital animaux, alcool, armes, explosifs, produits incendiaires, toxiques, dangereux
ou prohibs par la loi. Les objets et produits dangereux ou prohibs par la loi doivent tre dposs auprs de
ladministration hospitalire. Les objets prohibs par la loi ainsi dposs sont remis aux autorits de police,
contre rcpiss (art. 25)
Le patient porteur de drogue
Applications
Le secret professionnel couvrant toutes les informations venues la connaissance dun professionnel de
sant (et nonobstant les dispositions de lart. 40 du code de procdure pnale, v. fiche n9 : ladmission dun
bless par arme ), il nest pas possible de dnoncer la personne auprs des services de police.
Ladministrateur de garde doit :
tre inform de la situation dans les meilleurs dlais,
faire procder la confiscation des produits en vertu de ses pouvoirs de police interne, et les conserver au
coffre de lhpital,
informer par crit le commissariat de police ou le procureur sur les circonstances de la dcouverte et lui
remettre la drogue sans rvler lidentit du patient (au cas o il est dcid de transporter les produits au
commissariat, il est recommand den prvenir le commissariat au pralable).
.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
69
Le patient dtenteur darme
Les rgles sont identiques celle de la dtention de drogue, sous rserve des dispositions de larticle 226-14
du code pnal (v. ci-dessous).
Vous devez :
tre inform de la situation dans les plus brefs dlais,
faire procder la confiscation de larme et la consigner au coffre de lhpital,
informer par crit le commissariat de police ou le procureur sur les circonstances de la dcouverte et lui
remettre larme sans rvler lidentit du patient (au cas o il est dcid de transporter larme au
commissariat, il est recommand den prvenir le commissariat au pralable),
restituer larme au moment de la sortie lorsque le patient est dment autoris dtenir une arme (titulaire
dun permis de port darme).
.
Prcision : une circulaire du 31 mai 1928 fixe les principes gnraux applicables en cas de dcouverte
dune arme sur un patient. Elle indique que les armes et objets dangereux ne doivent pas tre laisss en leur
possession : en ce qui concerne les armes de toute sorte, revolvers chargs ou non, armes blanches (cest
dire arme munie dune lame, perforante et ou tranchante qui nemploie pas la force dune explosion, mais celle
dun homme ou dun mcanisme quelconque), elles doivent tre immdiatement confisques pour tre
remises la police munies dun numro dordre et dune brve description qui seront mentionnes
linventaire tenu par le service des admissions.
Lintress pourra le cas chant, la rclamer au commissariat
Attention !
Ne viole pas le secret mdical le professionnel de sant qui informe, dans le respect de sa conscience
professionnelle, le Prfet et Paris, le Prfet de police, du caractre dangereux pour lui mme ou pour autrui
des personnes qui le consultent et dont il sait quelles dtiennent une arme ou quelles ont manifest lintention
den acqurir une (art. 226-14 du code pnal).
Rfrences
Dcret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif lapplication du dcret du 18 avril 1939 fixant le rgime des matriels de
guerre, armes et munitions
Article 25 du rglement intrieur de lAP-HP
Article 226-14 du code pnal
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
70
12 Ladmission dun toxicomane
Pour aller lessentiel
En cas dinterruption dun traitement impos, informer immdiatement lautorit sanitaire (la DDASS).
Ladmission peut tre volontaire ou rsulter dune injonction
Le traitement volontaire
Dans cette hypothse, le patient toxicomane se prsente spontanment dans un hpital afin dy tre trait.
Le patient peut dans ce cas, sa demande, bnficier de lanonymat au moment de ladmission. Cet
anonymat ne pourra tre lev que pour des causes ne relevant pas de lusage illicite de stupfiants.
Le traitement sur injonction de lautorit sanitaire
Dans cette hypothse, le patient toxicomane a t signal lautorit sanitaire (la DDASS) soit sur certificat
dun mdecin, soit sur le rapport dune assistante sociale.
Lautorit sanitaire a enjoint au patient de se prsenter dans un tablissement agr (de son choix ou
dsign doffice), car une cure de dsintoxication savre ncessaire (aprs enqute sur la vie prive,
familiale, sociale et professionnelle de la personne).
Le patient doit apporter la preuve du suivi de son traitement lautorit sanitaire, par des certificats mdicaux
notamment.
Le traitement sur injonction du procureur de la Rpublique
Dans cette hypothse, la personne a fait un usage illicite de stupfiants et le procureur la enjointe de suivre
une cure de dsintoxication ou de se placer sous surveillance mdicale.
Lautorit sanitaire est alors informe de cette injonction de soin et contrle le droulement de la cure par le
biais de certificats mdicaux que doit lui faire parvenir le toxicomane.
Lautorit sanitaire doit informer rgulirement le Parquet.
En cas dinterruption du traitement, le directeur (ou ladministrateur de garde) ou le mdecin responsable du
traitement doivent informer immdiatement lautorit sanitaire qui prviendra le Parquet.
Rfrences
Articles L. 3412-1 L. 3412-3 du code de la sant publique
Article L. 3411-2 du code de la sant publique
Articles L. 3413-1 L. 3413-3 et L. 3423-1 du code de la sant publique
Article L. 3414-1 du code de la sant publique
Articles R. 1112-38 et R. 1112-39 du code de la sant publique
Article 99 du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
71
13 Ladmission confidentielle et sous le rgime de
lanonymat
Pour aller lessentiel
Si tout patient doit en principe dcliner son identit au moment de son admission, il peut demander que son
hospitalisation soit maintenue secrte, mme si ce caractre confidentiel ne concerne que les tiers et non les
services hospitaliers.
En dehors de cette hypothse, la personne hospitalise peut demander un vritable anonymat dans deux
situations :
laccouchement sous X ,
le patient toxicomane volontaire pour se soigner.
Ladmission confidentielle
Rgle gnrale :
Le patient peut demander que sa prsence au sein dun service hospitalier ne soit pas divulgue des tiers.
Dans ce cas, son identit est connue uniquement :
des services hospitaliers,
des organismes dassurance maladie.
Le rglement intrieur de lAP-HP nonce que les patients peuvent demander quaucune indication ne soit
donne par tlphone ou dune autre manire sur leur prsence au sein de lhpital ou sur leur tat de
sant.() Pour les patients demandant le bnfice du secret de lhospitalisation, un dossier dadmission est
constitu normalement. Toutefois, une mention relative ladmission sous secret est porte sur leur dossier et
les services concerns (standard, unit de soins, htesses daccueil) en sont aviss .
Cette demande du patient doit entraner une application particulirement attentive du secret professionnel au
sein des services hospitaliers.
Exception :
Ces dispositions ne sappliquent pas aux patients mineurs vis--vis des titulaires de lautorit parentale, hors
les cas o ceux-ci souhaitent garder le secret sur son tat de sant et recevoir des soins sans que les
titulaires de lautorit parentale en soient informs (article L. 1111-5, C. sant publ.).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
72
Ladmission sous le rgime de lanonymat
Dfinition :
Lanonymat nest possible que dans deux cas expressment prvus par les textes :
laccouchement sous X (v. fiche n 16)
ladmission dun toxicomane (v. fiche n 12)
Attention !
Dans les deux cas, la demande danonymat ninterdit en rien aux intresss de solliciter des mdecins qui les
ont pris en charge un certificat nominatif mentionnant les dates, la dure et lobjet de leur sjour ou de leur
traitement
Rfrences :
Ladmission confidentielle :
Article R. 1112-45 du code de la sant publique
Article 111 du rglement intrieur type de lAP-HP
Lanonymat :
Article L. 222-6 du code de laction sociale et des familles
Articles R. 1112-28 et R. 1112-38 du code de la sant publique
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
73
14- Ladmission dun patient sans identit
Pour aller lessentiel
Si tout patient doit en principe dcliner son identit au moment de son admission, il est des situations o
lidentit du patient est inconnue, soit parce quil est dans lincapacit de fournir son identit, soit parce quil
est dcd sans avoir pu tre identifi.
La procdure de signalement ne concerne pas les personnes qui souhaitent garder leur anonymat :
l'admission anonyme des toxicomanes venant spontanment suivre un traitement (v. fiche n 12) ou
l'accouchement dans le secret (v. fiche n 16)
Une circulaire ministrielle du 13 mai 2005 est venue prciser les conditions de mise en uvre dun
signalement systmatique.
Un patient vivant sans identit
Lhpital est tenu de signaler au service de police ou lunit de gendarmerie territorialement
comptent toute personne non identifie.
Cette procdure de signalement est applicable aux personnes se trouvant dans limpossibilit de fournir leur
identit et dont la disparition prsente un caractre inquitant ou suspect .
Ce caractre inquitant ou suspect est apprci au regard des circonstances, de lge ou de ltat de la
personne non identifie.
Les dlais de signalement
Ds la reconnaissance du caractre inquitant ou suspect de la disparition, lhpital a lobligation de procder
au signalement et ce, dans les meilleurs dlais, que la personne ait t accueillie au service des urgences ou
pour une consultation externe.
Les modalits du signalement
Le chef de service concern ou la personne dsigne par lui cet effet doit complter une fiche de
signalement de manire la plus prcise et lisible possible. La prsence dun reprsentant de lordre nest pas
requise.
Lhpital doit, par la suite, envoyer la fiche dment renseigne au service de police ou lunit de
gendarmerie territorialement comptente. Un double de ce document doit galement tre adress lOffice
central charg des disparitions inquitantes de personnes (dont ladresse est la suivante : 101-103 rue des
Trois-Fontanots, 92000 Nanterre).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
74
En outre, il est galement obligatoire dinformer la personne non identifie du signalement dont elle fait
lobjet, condition quelle soit en mesure de le comprendre. Dans le cas contraire et si cette personne ne
recouvre ses facults de comprhension quaprs lenvoi de la fiche de signalement, elle devra alors en tre
informe sans dlai.
Les formalits accomplir en cas didentification aprs signalement
Dans lhypothse o la personne est identifie aprs que le signalement ait t effectu, lhpital doit informer,
de manire systmatique, les services de police de cette identification.
Il faut toutefois prendre en compte les circonstances suivantes :
Lorsque la personne identifie est capable dexprimer sa volont :
- si la personne identifie est majeure, il convient de lui demander si elle consent ou non faire connatre son
identit aux services de police,
- si la personne est mineure ou majeure sous tutelle, ce consentement doit tre demand et recueilli auprs
des titulaires de lautorit parentale (pour le mineur) ou du tuteur (pour le majeur sous tutelle).
Lhpital doit galement informer ces personnes que ces services de police peuvent requrir, auprs des
organismes publics ou des tablissements privs dtenant des fichiers nominatifs, la communication
dinformations permettant de localiser une personne faisant lobjet de recherches et ce sans que puisse leur
tre oppose lobligation au secret.
De plus, la personne identifie doit tre informe quelle a la possibilit de demander aux services de police la
protection des informations la concernant vis--vis des personnes qui la recherchent.
Lorsque la personne, identifie par une tierce personne, est dans lincapacit dexprimer sa volont :
- si la personne est majeure, lhpital doit prvenir la police de lidentification de la personne sans toutefois
fournir lidentit de celle-ci (sauf demande expresse de la police). En outre, la tierce personne qui a identifie
cette personne na pas tre informe.
- si la personne identifie est mineure ou majeure sous tutelle, les titulaires de lautorit parentale ou le tuteur
doivent tre informs du signalement. Il faut galement recueillir leur consentement afin de savoir sils
acceptent ou non de faire connatre lidentit de la personne aux services de police.
Ils doivent enfin tre informs de la possibilit pour les services de police dobtenir communication de tout
renseignement permettant de localiser la personne faisant lobjet de recherches. En outre, aucune tierce
personne na lieu dtre informe de ce signalement hormis les titulaires de lautorit parentale ou le tuteur.
Un patient dcd non identifi
Dans lhypothse o un patient est dcd sans avoir pu tre identifi, il est dabord indispensable de
procder la dclaration de dcs dans les dlais ordinaires.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
75
Un certificat de dcs doit alors tre rempli avec la mention patient non identifi . Ce certificat doit
tre accompagn dun rapport dtaill donnant des indications dcrivant la personne (ge approximatif,
taille, couleur des cheveux, description du corps et des vtements,), ainsi que les circonstances ou les
particularits qui ont entour le dcs et qui sont susceptibles de faciliter ultrieurement lidentification.
Lhpital a galement lobligation de prvenir lautorit judiciaire (lofficier de police judiciaire, lunit de
gendarmerie territorialement comptente ou le Parquet) qui procdera aux recherches et au signalement
ncessaires.
Lofficier dtat civil de la mairie rdigera lacte de dcs. Aucun prlvement dorganes, de quelque nature
que ce soit, ne pourra tre pratiqu sur la personne non identifie. Il en est de mme pour tout autre
prlvement (de tissu , de sang,), mme si la conservation dun chantillon dADN pourrait tre utile a
posteriori pour lidentification du patient : une telle dcision ne pourrait rsulter que dune dcision de justice.
Les objets ou les vtements ports par le patient doivent galement tre soigneusement conservs et laisss
la disposition de la justice.
Enfin, et conformment la circulaire du 13 mai 2005, le chef de service concern, ou la personne dsigne
par lui cet effet, devra complter une fiche type de renseignements de faon trs prcise et lisible. La
prsence dun reprsentant des forces de lordre nest pas requise.
Lhpital adressera cette fiche dment renseigne au service de police ou lunit de gendarmerie
territorialement comptente. Un double de ce document doit galement tre adress lOffice central charg
des disparitions inquitantes de personnes.
Si la personne est identifie ultrieurement, lhpital doit informer systmatiquement les services de police de
cette identification.
Rfrences :
Circulaire DHOS/SDE/E1 n 2005-226 du 13 mai 2005 relative aux modalits de signalement aux services
de police ou de gendarmerie des personnes hospitalises non identifies ou dcdes en milieu hospitalier
dans lanonymat
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
76
15 Ladmission dun patient non voyant
Pour aller lessentiel
les chiens daveugles peuvent pntrer dans les lieux ouverts au public,
le chien doit tre confi une tierce personne pendant la consultation,
en cas dhospitalisation du patient, une association spcialise peut tre sollicite afin de garder le chien
Principe
Laccs des animaux de compagnie est interdit dans lenceinte de lhpital, except pour les chiens
daveugles.
Applications
La personne non-voyante vient en consultation externe :
Le chien peut pntrer dans les lieux ouverts au public (hall daccueil, etc. ), mais il ne doit pas tre en
contact direct avec les malades, ni tre introduit dans les boxes de consultation.
Durant le temps des soins, il doit tre confi une tierce personne.
La personne non-voyante doit tre hospitalise :
Le chien doit tre remis un proche du patient. A dfaut du parent ou de proche, le chien peut tre confi la
garde dun chenil avec laccord du patient, qui doit en assurer la charge financire.
Accueil dun chien guide durant lhospitalisation de son matre
Par exemple :
Lcole des chiens guides :
105, avenue St Maurice
Bois de Vincennes 75012 PARIS
Tl : 01 43 65 64 67
Fax : 01 43 74 61 18
Si le chien a t form par lcole, il sera pris en charge doffice.
Sinon, il faudra contacter le directeur du centre qui dcidera au cas par cas.
Liste des gardes danimaux : (prciser le cas chant les services de garde disposition des personnes en difficult)
Rfrences
Circulaire du 16 juillet 1984 (BO Sant 84/33) relative laccs des chiens daveugles dans les tablissements publics
de sant,
Article R. 1112-48 du code de la sant publique,
Loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 portant diverses mesures dordre social,
Article 158 du rglement intrieur de lAP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
77
16 - Laccouchement sous X
Pour aller lessentiel
informer les services du Conseil gnral de ladmission de toute femme qui souhaite accoucher
sous X
informer la patiente des consquences juridiques dun accouchement sous couvert de lanonymat
conserver dans les meilleures conditions possibles le dossier mdical
Principes
Ladmission sous X doit en principe tre effectue dans un centre maternel du dpartement ou dans un
centre avec lequel le dpartement a pass une convention, et la femme enceinte doit tre oriente vers ce
type de structure lorsquelle existe.
Lorsquil ny a pas de lits disponibles dans une structure de ce type, ou sil y a urgence, ladmission doit tre
prononce.
Anonymat de ladmission
Lors de laccouchement, la mre peut demander que le secret de son admission et de son identit soit
prserv .
Pour une patiente mineure, le sjour est pris en charge par le dpartement (service de laide sociale
lenfance du dpartement dimplantation de lhpital).
Larticle R. 1112-28 du code de la sant publique ajoute que si pour sauvegarder le secret de la grossesse
ou de la naissance lintresse demande le bnfice du secret de ladmission, dans les conditions prvues par
larticle L. 226-6 du code de laction sociale et des familles, aucune pice didentit nest exige et aucune
enqute nest entreprise. () Le directeur informe de cette admission le directeur dpartemental des
affaires sanitaires et sociales .
La loi n 2002-93 du 22 janvier 2002 relative laccs aux origines des personnes adoptes et pupilles de
lEtat a transfr cette comptence au Conseil gnral.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit informer les services du conseil gnral comptent en
la matire de ladmission de toute femme qui souhaite accoucher sous X.
Lanonymat demand par la femme est absolu : son identit nest pas connue du service hospitalier. Il peut
tre rtroactif : il doit tre tenu compte de la dcision de la femme prise tardivement, alors que les
consultations prnatales ont t effectues de faon nominative. Il revient dans ce cas lhpital de rtablir
lanonymat, y compris en dtruisant les identifications portes sur les documents administratifs et mdicaux.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
78
Accs aux origines et obligation dinformation de la femme enceinte
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la prservation du secret de son admission et de son
identit par un tablissement de sant doit tre informe :
des consquences juridiques de cette demande,
de limportance pour toute personne de connatre ses origines.
Elle doit donc tre invite laisser, si elle laccepte :
des renseignements sur sa sant et celle du pre,
les origines de lenfant et les circonstances de la naissance,
ainsi que, sous pli ferm, son identit.
Ces formalits doivent en principe tre accomplies par des personnes dsignes par le prsident du Conseil
gnral et charges dassurer les relations avec le Conseil national pour laccs aux origines personnelles
(CNAOP). A dfaut, en labsence des reprsentants du conseil gnral, ces formalits doivent tre accomplies
par lhpital et ladministrateur de garde doit y veiller.
Obligations de lhpital
Lhpital est tenu :
dinformer la patiente des consquences juridiques dun accouchement sous couvert de lanonymat.
de prvenir les personnes dsignes par le prsident du Conseil gnral afin dorganiser
laccompagnement psychologique et social de la femme et de recueillir toute information quelle souhaiterait
transmettre son enfant.
Si ces personnes ne peuvent intervenir, le recueil de ces informations et la communication des droits
reconnus sont de la comptence du directeur de lhpital.
de former et dinformer leur personnel soignant (infirmires, mdecins, aides-soignants),
de conserver dans les meilleures conditions possibles le dossier mdical concern puisquune femme
ayant accouch dans lanonymat peut, tout moment, fournir des informations complmentaires la
concernant et qui pourront tre transmises son enfant :
La femme qui demande, lors de son accouchement, la prservation du secret de son admission et de son
identit par un tablissement de sant () est galement informe quelle peut tout moment donner
son identit sous pli ferm ou complter les renseignements quelle a donn au moment de la
naissance (prnoms donns lenfant, et le cas chant, mention du fait quils lont t par la mre, sexe
de lenfant, date, lieu et heure de naissance doivent tre indiqus lextrieur de ce pli).
de transmettre un certain nombre dinformations laisses par la femme ayant accouch dans lanonymat
au Conseil national pour laccs aux origines personnelles.
Les tablissements de sant communiquent au conseil national, sur sa demande, copie des lments
relatifs lidentit des personnes mentionnes aux alinas qui prcdent ainsi que tout renseignement ne
portant pas atteinte au secret de cette identit, et concernant la sant des pre et mre de naissance, les
origines de lenfant et les raisons et circonstances de sa remise au service de laide sociale lenfance ou
un organisme autoris et habilit pour ladoption .
Le secret mdical continue de simposer. Lhpital est tenu de porter une attention particulire aux
informations transmises.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
79
Le devenir de lenfant n sous X
Plusieurs possibilits sont ouvertes. Lenfant sera, selon le cas :
remis au service dpartemental de laide sociale lenfance (ASE) quand il quittera lhpital,
remis au pre lorsque celui-ci aura fait tablir sa paternit,
remis la mre lorsque celle-ci aura dcid de revenir sur son choix et de garder son enfant (sauf
impossibilit : adoption, dcision judiciaire contraire).
Dans la perspective dun ventuel dcs de la mre :
Il peut tre propos (et non impos) la femme de remettre une enveloppe cachete au directeur (ou
ladministrateur de garde) contenant son identit et qui ne sera ouverte quen cas de dcs. Cette enveloppe
lui sera remise en ltat lors de la sortie.
En cas de refus et si la femme venait dcder, le dcs devra tre dclar selon les procdures applicables
aux personnes non identifies (v. fiche n 14).
v. fiche n13 : Ladmission confidentielle et sous le rgime de lanonymat
Coordonnes utiles
Service dpartemental de lAide sociale lEnfance (ASE)
CNAOP
14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
Tl. : 01 40 56 72 17
Fax : 01 40 56 59 08
Conseil gnral
Direction de lAction Sociale, de lEnfance et de la Sant
Sous Direction des Actions Familiales et Educatives
Bureau des Adoptions
94-96, quai de la Rpe, 75570 PARIS CEDEX 12 - Tl. : 01 43 47 75 38
Rfrences
Articles 55 et 326 du code civil,
Articles L. 147-1 L. 147-11 et L. 222-6 du code de laction sociale et des familles,
Articles R. 147-21 et suivants du code de laction sociale et des familles,
Article R. 1112-28 du code de la sant publique,
Dcret n 2002-781 du 3 mai 2002.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
80
17 Ladmission dun nouveau-n avec sa mre en
maternit
Pour aller lessentiel.
La mre et lenfant bnficient dun droit ladmission spcifique dans les jours prcdant et suivant
laccouchement.
Le directeur de lhpital (ou ladministrateur de garde) ne peut, sil existe des lits vacants dans le
service de maternit, refuser ladmission dune patiente dans le mois qui prcde la date prsume de
son accouchement ou dans le mois qui suit son accouchement, ni celle de son enfant nouveau-n.
Ladmission de la patiente et le cas chant de son enfant simpose lhpital, mme dfaut de prescription
mdicale, ceci rsultant du dispositif rglementaire de protection maternelle et infantile.
Toutefois, dfaut de prescription mdicale, les frais de sjour sont en principe la charge directe de
lintresse partir du 12
me
jour suivant laccouchement. Ces consquences financires doivent tre
clairement prcises la mre.
Rfrences
Article R.1112-27 du code de la sant publique
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
81
18 La demande dIVG
Pour aller lessentiel
Une femme enceinte que son tat place dans une situation de dtresse peut demander un mdecin
linterruption de sa grossesse avant la fin de la douzime semaine de grossesse.
Toute IVG doit faire lobjet dune dclaration tablie par le mdecin et adresse par lhpital au mdecin
inspecteur rgional de sant publique. Cette dclaration ne doit pas mentionner lidentit de la femme.
Les conditions spcifiques daccs des femmes trangres lIVG qui existaient antrieurement ont t
supprimes : la ralisation dune IVG sur une femme trangre nest soumise aucune condition de dure
et de rgularit du sjour en France.
La loi permet dans des conditions prcises lIVG dune mineure sans linformation des parents.
En cas dintrusion dans les locaux hospitaliers de personnes opposantes lIVG :
prvenir le chef de la scurit
appeler immdiatement les forces de police (ou de gendarmerie) pour faire vacuer les locaux
tenter de recueillir des lments de preuve (tracts, tmoignages) dmontrant que laccs lhpital a t
perturb, que des pressions et menaces ont t exerces sur le personnel et les patientes.
en fonction de la gravit de la situation, dposer une plainte.
Conditions gnrales
Le dlai lgal (art. L. 2212-1, C. sant publ.)
Une femme enceinte que son tat place dans une situation de dtresse peut demander un mdecin
linterruption de sa grossesse avant la fin de la douzime semaine de grossesse.
Les modalits de lintervention (art. L. 2212-2, C. sant publ.)
Linterruption volontaire dune grossesse ne peut tre pratique que par un mdecin.
Lors de la premire visite (art. L. 2212-3, C. sant publ.) :
Le mdecin doit informer la femme :
des mthodes mdicales et chirurgicales dinterruption de grossesse,
des risques,
des effets secondaires potentiels.
Le dossier guide
Le mdecin doit remettre la femme un dossier guide mis jour au moins une fois par an comprenant :
le rappel des dispositions du code de la sant publique,
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
82
la liste et ladresse des organismes comptents (conseil conjugal, centre de planification ou dducation
familiale, service social ou autre organisme agr),
la liste des tablissements pratiquant des IVG.
La consultation pralable lIVG (art. L. 2212-4, C. sant publ.)
Il sagit dune consultation avec une personne qualifie dans un tablissement dinformation, de consultation
ou de conseil familial, un centre de planification ou dducation familiale, un service social ou un organisme
agr.
Cette consultation doit tre systmatiquement propose et consiste en un entretien particulier (assistance et
conseils appropris).
Le dlai de rflexion (art. L. 2212-5, C. sant publ.)
La femme doit confirmer sa demande aprs un dlai de rflexion dune semaine aprs la premire demande,
sauf si le dlai de 12 semaines risque dtre dpass.
La consultation post IVG (art. L. 2212-7, C. sant publ.)
Elle doit tre systmatiquement propose la femme majeure.
La clause de conscience (article L. 2212-8, C. sant publ. )
Un mdecin nest jamais tenu de pratiquer une IVG, mais il doit informer, sans dlai, la femme de son refus
et lui communiquer immdiatement le nom de praticiens susceptibles de raliser lintervention.
Le cas de la femme mineure non mancipe
(art. L. 2212-7, C. sant publ.) :
la consultations avant lIVG est obligatoire et la consultation aprs lIVG est obligatoirement propose,
le consentement de lun des titulaires de lautorit parentale ou du reprsentant lgal est en principe requis
(et joint la demande de la jeune femme),
si la mineure veut garder le secret, le mdecin doit sefforcer dobtenir son consentement ce que ces
personnes soient consultes,
si elle refuse ou si le consentement na pu tre obtenu, lIVG est nanmoins effectue et la mineure se fait
alors accompagner de la personne majeure de son choix. Dans ce cas, il convient dtre attentif aux
conditions dans lesquelles la mineure a choisi la personne majeure qui va laccompagner (contraintes,
pressions), et de bien indiquer cet accompagnant quil na aucun pouvoir de dcision et ne dispose
daucun des attributs de lautorit parentale,
la prise en charge des IVG est anonyme et gratuite,
une anesthsie, quelle soit gnrale ou locale, se dfinit comme un acte de soins directement li lIVG.
Lacte mdical principal (IVG) tant dcid de faon autonome par la mineure, lacte mdical ncessaire la
ralisation de lIVG est galement consenti par la mineure seule,
Evoquant le cas dune complication grave, lIGAS (Inspection gnrale des affaires sociales), dans son
rapport dactivit du Groupe national dappui la mise en uvre de la loi du 4 juillet 2001 relative lIVG et
la contraception , a jug que dans ce cas, les mdecins sont ncessairement amens prvenir la
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
83
famille et quil leur revient dapprcier lattitude avoir dans les cas particulirement graves o un tel
vnement se produit (page 13 du rapport).
Le cas de la majeure protge
Si la personne majeure est sous sauvegarde de justice ou de curatelle : il nexiste aucune disposition
spcifique qui rglementerait lIVG de la femme majeure protge. Cette personne consent donc seule une
IVG (application du droit commun).
Si la personne est sous tutelle : aucune disposition spcifique nest prvue. Le droit commun sapplique : le
mdecin doit sassurer que la femme concerne est dtermine faire pratiquer une IVG. Si son tuteur devait
sopposer cette dcision, il appartiendrait au mdecin consult de saisir le juge des tutelles.
***
Lentrave lIVG (art. L. 2223-2, C. sant publ.)
Le fait dempcher ou de tenter dempcher une IVG est puni dune peine damende et/ou demprisonnement.
Il consiste :
soit perturber laccs aux tablissements, la libre circulation des personnes lintrieur des
tablissements ou les conditions de travail des personnels mdicaux et non mdicaux,
soit exercer des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte dintimidation lgard
des personnels mdicaux et non mdicaux, de la femme ou de son entourage.
Rfrences
Articles L. 2211-1 L. 2223-2 du code de la sant publique,
Articles R. 2212-1 R. 2222-3 du code de la sant publique,
Articles D. 132-1 D. 132-5 du code de la scurit sociale,
Circulaire n 2001-467 du 28 septembre 2001,
Circulaire n 2001-338 du 13 juillet 2001,
Article 87 du rglement intrieur type de lAP-HP.
Guide AP-HP Lenfant, ladolescent lhpital (2002)
Guide AP-HP Personnes vulnrables et domaine mdical Quels sont leurs droits ? , 2007.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
84
19 Ladmission pour troubles mentaux
Pour aller lessentiel
En hospitalisation libre , le patient conserve les mmes droits que dans le cadre dune hospitalisation
ordinaire,
Bien distinguer lhospitalisation doffice (HO) et lhospitalisation la demande dun tiers (HDT),
Mentionner fidlement les diffrents moments de ladmission ou du transfert dans le rapport de garde.
Lhospitalisation dune personne atteinte de troubles mentaux est en principe libre. Toutefois, dans un souci
de protection de la personne et le cas chant de son entourage et de lordre public, la loi prvoit trois
modalits dhospitalisation sous contrainte, sil devient ncessaire de soigner cette personne alors quelle
sy oppose :
lhospitalisation la demande dun tiers (HDT),
lhospitalisation doffice (HO),
lhospitalisation du dtenu atteint de troubles mentaux.
Lhospitalisation sous contrainte pour troubles mentaux ne peut tre effectue que dans des tablissements
spcifiquement habilits par les autorits sanitaires (art. L. 3222-1, C. sant publ.).
Quelques tablissements de sant habilits en Ile-de-France soigner sans leur consentement des
personnes atteintes de troubles mentaux
Hpital Esquirol Saint-Maurice
Hpital de Perray - Vaucluse Sainte-Genevive-des-bois
Hpital Sainte-Anne Paris (14
me
)
Hpital Maison-Blanche Paris / Neuilly-sur-Marne
Hpital LEau vive Soisy-sur-Seine
Centre Thophile-Roussel Montesson
Etablissement public de sant de Ville-Evrard Neuilly-sur-Marne
Centre hospitalier spcialis Ren Prvos Moisselles
Hpital Simone-Veil Eaubonne
Hpital Albert-Chenevier Crteil (AP-HP)
Hpital Louis-Mourier Colombes (AP-HP)
Hpital Corentin-Celton Issy les Moulineaux (AP-HP)
Rfrences
Articles L. 3211-1 L. 3223-3 du code de la sant publique
Guide AP-HP Soins sous contrainte en psychiatrie (2004)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
85
20 - Lhospitalisation libre
Rgle gnrale
Un patient hospitalis pour troubles mentaux dispose a priori des mmes droits que ceux reconnus aux
malades hospitaliss pour une autre cause mdicale.
Ainsi :
il a le droit de circuler librement au sein de lhpital (du moins dans les lieux ouverts la circulation
gnrale),
il ne doit pas tre retenu dans un service ferm cl ou dans une chambre verrouille,
il a le droit de choisir lhpital o il sera soign (principe du libre choix), y compris lextrieur de son
secteur psychiatrique de rfrence.
Transformation de lhospitalisation libre en hospitalisation sous contrainte :
Si ltat de sant du patient le justifie et quil remplit les conditions dune hospitalisation la demande dun
tiers ou dune hospitalisation doffice, le directeur de lhpital (ou ladministrateur de garde) doit prendre, dans
les 48 heures, les mesures ncessaires son transfert dans un tablissement habilit soigner des
personnes sous contrainte.
En cas durgence, le malade peut tre isol, pour des raisons de scurit, mais uniquement sur dcision
mdicale. Cet isolement doit tre strictement limit dans le temps et proportionn aux ncessits de
lurgence.
Rfrences
Articles L. 3211-2 et L. 3222-2 du code de la sant publique
Guide AP-HP Soins sous contrainte en psychiatrie (2004)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
86
21 - Lhospitalisation sur demande dun tiers (HDT)
Pour aller lessentiel
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut tre hospitalise sans son consentement sur demande
dun tiers que :
si ses troubles rendent impossible son consentement ;
son tat impose des soins immdiats assortis dune surveillance constante en milieu hospitalier (art.
L.3212-1, C. sant publ.).
Ce mode dhospitalisation ncessite donc forcment lintervention dun tiers.
Procdure
La demande dhospitalisation sur demande dun tiers (HDT) doit :
tre manuscrite,
tre signe
contenir un certain nombre de renseignements sur le demandeur de lhospitalisation et sur la personne
faisant lobjet de la demande (nom, prnoms, ge, adresse, profession, nature des relations existantes entre
le demandeur et la personne concerne).
Si le demandeur ne sait pas lire et crire, la demande peut tre reue oralement par le maire, le commissaire
de police ou le directeur de lhpital.
La demande dHDT doit tre accompagne de deux certificats mdicaux :
circonstancis et dats de moins de quinze jours ;
tablis par deux mdecins (non parents ou allis, au quatrime degr inclusivement, ni entre eux, ni des
directeurs dtablissements, ni du demandeur de lhospitalisation, ni de la personne concerne), dont lun au
moins nexerce pas dans lhpital accueillant le malade.
Ces certificats doivent attester que les conditions ncessaires lHDT (troubles rendant impossible le
consentement de la personne et un tat imposant des soins immdiats assortis dune surveillance constante
en milieu hospitalier) sont remplies.
Le mdecin qui tablit le second certificat nest pas li par les constatations du premier mdecin.
Avant de prononcer ladmission dune personne en HDT, le directeur de lhpital
daccueil (hpital habilit soigner sous contrainte) doit :
vrifier lidentit du demandeur,
vrifier que lensemble des pices ncessaires est bien runi (demande dadmission, pices justifiant de
lidentit, certificats mdicaux).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
87
Si la demande dHDT dun majeur protg est formule par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir un
extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Le bulletin dentre doit mentionner que toutes les pices ont t produites.
A titre exceptionnel et en cas de danger imminent pour la sant de la personne, une
procdure durgence peut tre mise en uvre.
Dans ce cas particulier, le directeur de lhpital daccueil (ou ladministrateur de garde) , c'est--dire dun
hpital habilit hospitaliser sous contrainte:
doit vrifier avant de prononcer ladmission que la demande a t tablie conformment aux rgles et
sassurer de lidentit du patient et de la personne qui a demand ladmission ;
peut prononcer ladmission du malade au vu dun seul certificat mdical.
Qualit du tiers demandeur
La demande dadmission doit tre ncessairement prsente par un tiers.
Celui-ci peut tre :
un membre de la famille du malade,
ou une personne susceptible dagir dans lintrt de celui-ci.
Toutefois, la loi ne permet pas la prise en compte dune demande du personnel soignant exerant dans
lhpital daccueil (art. L. 3212-1, C. sant publ.).
Deux dcisions importantes.
Dans un arrt du 30 dcembre 1999 (CAA Nantes, 30 dcembre 1999, CHS de Pontorson), la Cour
administrative dappel de Nantes a confirm une annulation de la mesure dhospitalisation en nonant que
bien que lemploye (en lespce, un secrtaire de lhpital) ne fasse pas partie du personnel soignant, elle
ntait pas au nombre des tiers autoriss demander ce type dhospitalisation .
La circonstance que seule lexclusion des personnels soignants soit explicite dans le code de la sant
publique nimplique pas que le personnel administratif de lhpital puisse intervenir, ds lors quil na pas de
lien familial ou de lien personnel avec lhospitalis permettant de le regarder comme agissant dans son
intrt .
Pour le Conseil dEtat (3 dcembre 2003, CHS de Caen), la dcision d'hospitalisation sans son
consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut tre prise sur demande d'un tiers que si
celui-ci, dfaut de pouvoir faire tat d'un lien de parent avec le malade, est en mesure de justifier de
l'existence de relations antrieures la demande lui donnant qualit pour agir dans l'intrt de celui-ci .
En pratique, il est admis que lassistante sociale de lhpital daccueil puisse signer une telle demande
dadmission, lorsquelle avait suivi antrieurement le patient et le connaissait ainsi personnellement.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
88
En labsence de tiers demandeur : recommandations
Principe : Lauteur dune demande dhospitalisation sous contrainte doit avoir un lien personnel avec
lhospitalis permettant de le regarder comme agissant dans son intrt.
Le demandeur, signataire dune hospitalisation la demande dun tiers, doit indiquer :
son degr de parent avec la personne hospitaliser,
ou, dfaut la nature des relations existant entre le patient et lui mme.
Labsence de tiers connu, le refus des membres de lentourage du patient de prendre une dcision dHDT qui
parat pourtant ncessaire, ainsi que labsence des critres requis pour une hospitalisation doffice sont
rgulirement lorigine de situations dlicates.
A dfaut de dispositions appropries et compte tenu de lassistance qui, de faon manifeste, doit parfois tre
apporte au patient, il est recommand de procder ainsi :
1. Avant de signer la demande dHDT, ladministrateur de garde doit sefforcer de prendre contact, par tous
moyens, avec les membres de la famille du patient, ses proches ou une personne qui connat le patient
et susceptible dagir pour sa protection. Il doit au besoin ritrer cette dmarche (cas de parents
indiffrents ou opposs lhospitalisation) et dlivrer une information complte sur la situation du patient.
Le cas chant, ladministrateur de garde doit noter au sein du formulaire type de demande dhospitalisation
la demande dun tiers quaucun membre de la famille du patient na pu tre contact ou que lun de ses
membres, contact par ses soins, a refus de se dplacer.
2. Ladministrateur de garde doit motiver la demande dHDT. Pour ce faire, il doit avoir vu personnellement
le patient et constater que son tat mdical justifie une admission au sein dun service psychiatrique.
En effet, le juge administratif exige dsormais que la demande dHDT fasse lobjet dune motivation srieuse
(rencontre avec le patient, constatations personnelles de son tat.).
3. Toutes les dmarches effectues (dates et signes) par ladministrateur de garde (prise de contact avec
les membres de la famille du patient, information de ces derniers, entretien personnel avec le malade)
doivent imprativement figurer dans le dossier mdical du patient.
4. Il peut alors signer la demande dHDT.
Il doit tre soulign que ces recommandations trouvent leurs limites dans un ventuel refus de lhpital
daccueil (= habilit lhospitalisation sous contrainte de patients) de prononcer ladmission.
Rfrences
Articles L. 3212-1 L. 3212-12 du code de la sant publique
Guide AP-HP Soins sous contrainte en psychiatrie (2004)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
89
Droulement de lHDT
La loi prvoit une procdure de suivi et de surveillance pendant lhospitalisation et jusqu la sortie du
patient.
1. Dans les 24 heures qui suivent ladmission du malade, un nouveau certificat mdical doit tre tabli par un
psychiatre de lhpital daccueil. Celui-ci doit alors confirmer ou infirmer la ncessit de maintenir
lhospitalisation du malade. Dans ce mme dlai, le directeur de lhpital doit adresser le certificat
accompagn des pices de procdure relatives ladmission du patient au Prfet et la Commission
dpartementale des hospitalisations psychiatriques.
2. Dans les trois jours suivant lhospitalisation, le Prfet doit notifier les noms, prnoms, profession et
domicile, du patient et du demandeur lhospitalisation au Procureur de la Rpublique.
Droits des patients
Eu gard au caractre attentatoire pour la libert de la personne, la loi prvoit galement des garanties
pendant lhospitalisation du patient.
Ainsi, dans les trois jours prcdents lexpiration des premiers quinze jours, le malade doit nouveau tre
examin par un psychiatre de lhpital daccueil. Celui-ci doit tablir un certificat mdical circonstanci et
indiquer notamment si les conditions de lhospitalisation sont toujours runies. Si tel est le cas, lhospitalisation
peut tre maintenue pour un mois. Un rexamen mensuel est alors pratiqu selon les mmes modalits.
Fin de lhospitalisation la demande dun tiers
Lhospitalisation la demande dun tiers prend fin lorsquun psychiatre de lhpital tablit un certificat
mdical constatant que les conditions de lhospitalisation ne sont plus runies, soit au cours des diffrentes
visites prvues, soit tout moment.
Labsence de certificat priodique peut galement entraner la fin de lhospitalisation.
Lhospitalisation prend galement fin lorsque la leve de lhospitalisation est requise par le curateur, le
conjoint ou dfaut par les ascendants (cf. liste tablie larticle L. 3212-9 du code de la sant publique).
Dans les 24 heures suivant la sortie du patient, le directeur de lhpital doit informer le prfet, la
Commission des hospitalisations psychiatriques et le Procureur de la Rpublique.
Si le mdecin hospitalier constate que ltat du malade ncessite des soins en raison de troubles
mentaux qui compromettent la sret des personnes ou portent atteinte, de faon grave, lordre
public, le prfet doit en tre inform. Il peut alors ordonner immdiatement un sursis provisoire de la leve de
lhospitalisation la demande dun tiers et, le cas chant, une hospitalisation doffice (article L. 3212-9 du
code de la sant publique : le sursis provisoire cessera de produire ses effets au bout de quinze jours si
aucune mesure dhospitalisation doffice na t prononce).
Tenue dun registre
Lhpital daccueil, habilit pour les hospitalisations sous contrainte de patients souffrant de troubles mentaux,
doit tenir un registre sur lequel sont mentionns dans les 24 heures :
les noms, prnoms, profession, ge et domicile des personnes hospitalises,
les dates des hospitalisations,
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
90
les noms, prnoms, profession, ge et domicile des personnes ayant demand les hospitalisations,
les certificats mdicaux joints la demande dadmission,
le cas chant, les mentions des dcisions de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice,
les certificats que le directeur de lhpital doit adresser aux autorits administratives,
les dates, dures et modalits des sorties dessai,
les leves dhospitalisation,
les dcs.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
91
Hpital :
Hospitalisation sur demande dun tiers
Premier certificat mdical
Je soussign(e),
Nom, prnom : .., docteur en mdecine,
fonction / adresse professionnelle :
certifie avoir examin ce jour :
M. (Mme, Melle) .
n(e) le :
domicili (e) : .
Son tat mental ce jour (description) :
impose des soins immdiats assortis dune surveillance constante en milieu hospitalier
rend impossible son consentement une hospitalisation
ncessite une hospitalisation selon les termes de larticle L. 3212-1 du Code de la sant publique.
Je certifie ntre ni parent ou alli, au quatrime degr inclusivement, ni avec la personne ayant demand
lhospitalisation, ni avec la personne dont lhospitalisation est demande.
Fait ., le..
Signature
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
92
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
93
Hpital :
Demande dhospitalisation par un tiers
(cette demande doit tre crite la main)
Je, soussign(e),
n(e) le : ..
demeurant : ..
et exerant la profession de :
demande en ma qualit de : ..
(selon le cas : lien de parent avec lintress, nature de la relation avec lintress)
Conformment aux dispositions de larticle L. 3212-1 du Code de la sant publique,
lhospitalisation de M. (Mme, Melle) .
n(e) le : ..
demeurant : ..
et exerant la profession de :
afin quil y reoive les soins que semblent justifier son tat de sant actuel.
Fait , le..
Signature
Indication de la pice didentit du demandeur
(numro et date denregistrement, autorit ayant dlivr la pice didentit)
Indication de la pice didentit de la personne vise par la demande
(numro et date denregistrement, autorit ayan dlivr la pice didentit)
Nom et qualit de lagent auquel ce document a t remis : ..
(lagent veillera le remettre sans dlai la direction de lhpital)
date :
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
94
Hpital :
Hospitalisation sur demande dun tiers
Certificat mdical en cas de pril imminent
Je soussign(e),
nom, prnom : .., docteur en mdecine,
fonction : ..
exerant dans le service suivant : ...
Certifie avoir examin ce jour :
M. (Mme, Melle) .
n(e) le : .
domicili(e) : ...
Son tat mental ce jour (description) : .
prsente un pril imminent pour sa sant
impose des soins immdiats assortis dune surveillance constante en milieu hospitalier
rend impossible son consentement une hospitalisation
ncessite une hospitalisation selon les termes de larticle L. 3212-3 du Code de la sant publique
Je certifie ntre ni parent ou alli, au quatrime de gr inclusivement , ni avec la personne ayant demand
lhospitalisation, ni avec la personne dont lhospitalisation est demande.
Fait ., le .......
Signature
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
95
22 - Lhospitalisation doffice (HO)
Pour aller lessentiel
Sont seules susceptibles de faire lobjet dune hospitalisation doffice () les personnes dont les troubles
mentaux ncessitent des soins et compromettent la sret des personnes ou portent atteinte, de faon grave,
lordre public .
Lhospitalisation doffice procde dun arrt prfectoral ou, dfaut, en cas durgence, dun arrt du maire
(ou Paris, du Prfet de police).
Un patient hospitalis la demande dun tiers peut prsenter un tat mental ncessitant des soins et
compromettant la sret des personnes ou portant atteinte, de faon grave, lordre public. Ce patient peut
alors faire lobjet dune hospitalisation doffice (art. L. 3213-6, C. sant publ.).
Dans cette hypothse, le prfet peut prendre un arrt dhospitalisation doffice.
Lhospitalisation doffice peut rsulter dun signalement effectu par lhpital aux autorits de police qui
dclencheront la procdure.
Conditions de forme de la demande dhospitalisation
La dcision dhospitaliser doffice la personne est prise sur la base dun arrt motiv du Prfet de police
( Paris) ou du Prfet de dpartement (hors Paris), au vu dun certificat mdical circonstanci.
Larrt doit noncer prcisment les circonstances rendant lhospitalisation ncessaire. Une motivation
insuffisante peut entraner leur annulation par le juge administratif
Le certificat ne doit pas maner dun psychiatre exerant dans lhpital daccueil.
Le directeur de ltablissement daccueil (ou ladministrateur de garde) est tenu de transmettre au prfet et la
Commission dpartementale des hospitalisations psychiatriques, dans les 24 heures suivant ladmission
du patient, un certificat mdical tabli par un psychiatre de lhpital.
Le prfet doit informer, dans les 24 heures, le procureur de la Rpublique, le maire et la famille de la personne
hospitalise, de lhospitalisation doffice.
Si le Prfet ne se prononce pas dans ce dlai, les mesures provisoires deviennent caduques dans les 48
heures.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
96
Droulement de lhospitalisation doffice :
La loi prvoit une procdure de surveillance pendant lhospitalisation et jusqu la sortie du patient.
Dans les quinze jours, puis un mois aprs ladmission, un psychiatre de lhpital doit examiner le patient.
Celui-ci doit tablir un certificat mdical circonstanci confirmant ou infirmant la dcision dhospitalisation. Par
la suite le malade devra tre examin au moins tous les mois.
Le directeur de lhpital doit alors transmettre le certificat au prfet et la Commission dpartementale des
hospitalisations psychiatriques.
Dans les trois jours prcdant lexpiration du premier mois dhospitalisation, le prfet peut prononcer,
aprs avis motiv dun psychiatre, le maintien de lhospitalisation pour trois mois. Au-del et si les troubles
mentaux persistent, il peut maintenir lhospitalisation pour des priodes de six mois maximum, renouvelables
selon les mmes modalits.
Fin de lhospitalisation doffice :
Lhospitalisation doffice prend fin lorsquun psychiatre de lhpital tablit un certificat mdical constatant
que les conditions de lhospitalisation ne sont plus runies ou linscrit sur le registre. Dans ce cas, le directeur
est tenu davertir le prfet dans les 24 heures, ce dernier devant statuer sans dlai.
De mme, si lissue des dlais prvus pour le renouvellement de lhospitalisation doffice, le prfet ne prend
aucune dcision, la mesure devient caduque.
Le prfet peut galement mettre fin tout moment lhospitalisation doffice soit aprs avis dun psychiatre,
soit sur proposition de la Commission dpartementale des hospitalisations psychiatriques.
Rfrences
Articles L. 3213-1 L. 3213-10 du code de la sant publique
Guide AP-HP Soins sous contrainte en psychiatrie (2004)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
97
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
98
Hpital :
Certificat mdical en vue dune mesure dhospitalisation doffice
(au titre de larticle L. 3213-1 du Code de la sant publique)
Je soussign(e),
nom, prnom : .. docteur en mdecine,
fonction : ...
exerant dans le service suivant :
certifie avoir examin ce jour :
M. (Mme, Melle) ..
n(e) le : ..
domicili(e) :
et atteste que les troubles mentaux dont il (elle) souffre (description) :
ncessitent des soins
et
compromettent la sret des personnes
(ou/et)
portent atteinte de faon grave lordre public
Fait ., le ...
Signature
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
99
Hpital :
Avis mdical attestant le danger imminent
(au titre de larticle L. 3213-2 du Code de la sant publique)
Je soussign(e),
nom, prnom : .. docteur en mdecine,
fonction : ...
exerant dans le service suivant :
certifie avoir examin ce jour :
M. (Mme, Melle) ..
n(e) le : ..
domicili(e) :
et atteste quen raison de son tat mental, M. (Mme, Melle) ...
constitue un danger imminent pour la sret des personnes.
Fait ., le
Signature
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
100
23 - Ladmission psychiatrique des mineurs
Principes
Lhospitalisation la demande dun tiers ne se justifie pas pour un mineur : il appartient aux titulaires de
lautorit parentale de demander lhospitalisation du mineur en cas de ncessit, comme pour toute
hospitalisation.
Lhospitalisation doffice est possible pour un mineur, mais est en principe exceptionnelle.
Le juge des enfants peut dcider de placer un mineur dans un tablissement de soins spcialis. Cette
dcision est ordonne aprs avis mdical circonstanci dun mdecin extrieur lhpital, et pour une dure
maximale de 15 jours. Elle peut tre reconduite, aprs avis mdical conforme dun psychiatre de lhpital
daccueil, pour une dure dun mois renouvelable.
Rfrences
Articles L. 3211-10 du code de la sant publique,
Articles 375-3 et 375-9 du code civil.
Guide AP-HP Lenfant, ladolescent lhpital (2002)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
101
24 - Ladmission psychiatrique des dtenus
Principes
Lhospitalisation, avec ou sans son consentement, dune personne dtenue atteinte de troubles mentaux
doit en principe tre ralise dans un tablissement de sant, au sein dune unit spcialement amnage.
En cas dhospitalisation sans consentement, le dtenu doit ncessiter des soins immdiats assortis dune
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son
consentement et constituant un danger pour lui-mme ou pour autrui.
La dcision appartient au Prfet de police Paris ou au prfet du dpartement dans lequel se trouve lhpital
pnitentiaire daffectation du dtenu. La dcision prend la forme dun arrt motiv, au vu dun certificat
mdical circonstanci qui ne peut maner de lhpital daccueil. Dans les 24 heures suivant ladmission, le
directeur (ou ladministrateur de garde) de lhpital daccueil doit transmettre au prfet et la commission
dpartementale des hospitalisations psychiatriques un certificat mdical tabli par un psychiatre de lhpital.
Rfrences
Articles L. 3214-1 L. 3214-5 du code de la sant publique
Articles D. 394 et D. 398 du code de procdure pnale
Guide AP-HP Soins sous contrainte en psychiatrie (2004)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
102
25 Les droits des patients hospitaliss sans leur
consentement
Pour aller lessentiel
Lorsquune personne atteinte de troubles mentaux est hospitalise sans son consentement (), les
restrictions lexercice de ses liberts individuelles doivent tre limites celles ncessites par son tat de
sant et la mise en uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignit de la personne hospitalise
doit tre respecte et sa rinsertion recherche (art. L. 3211-3, C. sant publ.)
Malgr le caractre contraint de lhospitalisation et des soins, que le patient hospitalis doffice ou sur
demande dun tiers refuse, lexercice de ses liberts individuelles demeure la rgle et les restrictions qui y sont
apportes le sont par exception.
La personne hospitalise doit tre informe ds son admission et tout au long de son hospitalisation, sa
demande, de ses droits et obligations.
La loi numre un certain nombre de droits dont ces patients disposent en tout tat de
cause :
droit de communiquer avec les autorits mentionnes larticle L. 3222-4 du code de la sant publique
(le prfet, le juge du tribunal dinstance, le prsident du tribunal de grande instance, le maire, le procureur de
la Rpublique)
droit de saisir la commission dpartementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP)
droit de prendre conseil auprs dun mdecin ou dun avocat de leur choix
droit dmettre ou de recevoir des courriers
droit de consulter le rglement intrieur et de recevoir les explications qui sy rapportent
droit dexercer leur droit de vote
droit de se livrer aux activits religieuses ou philosophiques de leur choix.
Ces droits peuvent tre exercs leur demande par les parents ou les personnes susceptibles dagir dans
lintrt du malade ( lexception des droits relatifs aux correspondances, aux votes et aux activits religieuses
ou philosophiques).
droit daccs aux informations mdicales
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
103
La loi prvoit de manire gnrale que toute personne a accs lensemble des informations concernant
sa sant dtenues par des professionnels et tablissements de sant (). Elle peut accder ces
informations directement ou par lintermdiaire dun praticien quelle dsigne et en obtenir
communication (art. L. 1111-7, C. sant publ.).
Les personnes hospitalises sans leur consentement pour troubles mentaux peuvent en consquence avoir
accs leur dossier mdical.
Toutefois, titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre dune
hospitalisation sur demande dun tiers ou dune hospitalisation doffice, peut tre subordonne la prsence
dun mdecin dsign par le demandeur en cas de risques dune gravit particulire .
En cas de refus du demandeur, il revient la Commission dpartementale des hospitalisations psychiatriques
de rendre un avis, celui-ci simposant au dtenteur des informations et au demandeur.
Les sorties
Il existe deux types de sorties : les sorties dessai et les sorties accompagnes de courte dure.
Les sorties doivent faire lobjet dune attention particulire en tenant compte de ltat de sant des patients.
Rfrences
Articles L. 3211-1 L. 3223-3 du code de la sant publique
Guide AP-HP Soins sous contrainte en psychiatrie (2004)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
104
26 Face un bless, une urgence
ou un accident proximit de lhpital
Pour aller lessentiel
Lorsque sur la voie publique, une personne blesse est signale proximit de lhpital, les personnels de
lhpital, quel que soit leur grade ou leur fonction, sont tenus de lui porter secours.
Deux types de mesures doivent alors tre mis en uvre :
lalerte des services chargs de laide mdicale urgente (SAMU, SMUR, centre de secours)
lenvoi dune quipe mdicale sur les lieux, afin de dispenser les premiers soins et dapprcier la gravit de la
situation
Consigne gnrale
En cas durgence ou daccident signal proximit immdiate de lhpital (on entend par proximit le fait de
pouvoir aisment approcher pied la personne en difficult), les personnels de lhpital, quel que soit leur grade ou
leur fonction, ainsi que, le cas chant, les agents de scurit employs par une socit prive si leur contrat le
prvoit, sont tenus de porter secours aux malades ou aux blesss en pril sur la voie publique.
En rgle gnrale, ds que lurgence est signale, ladministrateur de garde doit tre inform et deux types de
mesures doivent tre mises en uvre simultanment :
lalerte des services chargs de laide mdicale urgente (SAMU, SMURou centre de secours) ;
lenvoi sur les lieux dune quipe charge de donner les premiers soins, dapprcier la gravit de la situation, de
prendre toutes les mesures de protection ncessaires avant larrive des services comptents et de transmettre
ces derniers le bilan et les besoins constats.
En priode hivernale, lorganisation de rondes rgulires au sein et aux abords de lhpital est prconise afin de
reprer les personnes sans abri en difficult et dorganiser leur prise en charge (v. fiche n 4 : ladmission dune
personne en situation de prcarit ).
Champ de comptence des agents de scurit
Principe
Les possibilits dintervention des personnels de scurit sur les personnes sont limites. Ils ne peuvent
intervenir que dans certaines situations prvues par :
larticle 223-6 du code pnal relatif lobligation dassistance aux personnes en pril.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
105
Cet article nonce que toute personne qui sabstiendrait volontairement de porter assistance (soit par une
action personnelle, soit en provoquant un secours) une personne en pril encourrait une peine de prison et
une amende. Sont concernes les interventions qui ne reprsentent aucun risque pour elle ou pour des tiers.
larticle 73 du code de procdure pnale relatif aux crimes et dlits flagrants.
Cet article dispose que toute personne a qualit pour apprhender lauteur dun crime ou dun dlit flagrant,
cest--dire une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, et de le conduire devant
un officier de police judiciaire.
les articles 122-5, 122-6, 122-7 du code pnal relatifs la lgitime dfense et ltat de ncessit.
En ce qui concerne la lgitime dfense (par ex. concernant une personne victime dune agression en train de
se produire), une personne qui accomplirait, face une atteinte injustifie envers elle-mme ou autrui, un acte
command par la ncessit de la lgitime dfense delle-mme ou dautrui, ne serait pas pnalement
responsable. Toutefois, aucune disproportion ne doit exister entre les moyens de dfense employs et la
gravit de latteinte.
Quant ltat de ncessit, il concerne la personne qui, face un danger actuel ou imminent qui menace
elle-mme, autrui ou un bien, accomplirait un acte ncessaire la sauvegarde de la personne ou du bien.
Dans ce cas, elle ne serait pas pnalement responsable. Toutefois, il doit y avoir proportion entre les moyens
employs et la gravit de la menace.
Numros utiles :
Chef de la scurit de lhpital :
SAMU, SMUR, pompiers :
Rfrences
Article 223-6 du code pnal,
Article R. 4127-9 du code de la sant publique,
Circulaire n 335 du 31 mars 1988 relative lintervention des personnels en cas durgence ou daccident survenant
proximit immdiate dun tablissement de soins public ou priv,
Article 68 du rglement intrieur type de lAP-HP,
Communiqu ministriel du 21 novembre 1998 (organisation de rondes rgulires aux abords des hpitaux en priode
de grand froid),
Circulaire DGAS/1 A n 2004-511 du 18 octobre 2004 relative au dispositif daccueil, dhbergement et dinsertion
Plan hiver 2004-2005.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
106
27 Le dpt de biens
Pour aller lessentiel
Les objets dtenus par un patient doivent tre remis au rgisseur de lhpital ou un agent habilit par le
directeur pour tre le dpositaire de ces objets.
Ils doivent tre inscrits sur le registre des dpts aprs inventaire.
Conditions du dpt
Le patient doit avoir t admis dans lhpital. Le dpt de biens est donc exclu pour les patients en
consultation externe.
Moment du dpt
En principe, il se fait au moment de ladmission. Mais rien ne soppose ce quil ait lieu en cours
dhospitalisation.
Obligation dinformation
Le patient doit tre inform des dispositions relatives au dpt, au rgime de responsabilit, qui sappliquent
aux biens abandonns ou non rclams.
Cette information, dlivre au patient ou son reprsentant lgal, doit tre orale et crite. Il doit leur tre remis
un document rappelant ces rgles, sign puis conserv dans le dossier administratif du patient.
Caractre facultatif du dpt
Quelle que soit la valeur des biens, le dpt est toujours facultatif : le patient (ou son reprsentant lgal) doit
tre invit dposer ses biens.
Modalits de dpt
objets dposables : choses mobilires dont la nature justifie leur dtention par le patient.
Il est possible de refuser le dpt de biens dont la dtention au cours du sjour hospitalier ne se justifie pas.
personnes qui reoivent les dpts :
Les sommes dargent, titres et valeurs mobilires, moyens de rglement et objets de valeur doivent tre
dposs entre les mains du rgisseur dsign cet effet.
Les autres objets peuvent tre remis un agent dsign par le directeur.
procdure :
1) dresser un inventaire contradictoire, avec la liste des objets dposs et des objets gards par le patient,
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
107
Attention !
La dsignation des objets doit tre faite sur la base dlments visuels et ne doit pas comporter dapprciation
par lagent.
Ex : ne pas indiquer bague en diamant , mais bague avec une pierre qui brille . Ne pas indiquer
montre en or , mais montre en mtal jaune .
2) remettre un exemplaire de cet inventaire au patient (ou son reprsentant lgal) et inclure lautre dans son
dossier administratif,
3) complter le registre spcial de lhpital sur lequel les dpts sont inscrits au fur et mesure de leur
ralisation avec, le cas chant, mention des objets conservs par le dposant.
lhypothse du dpt feint : Vous pouvez consentir ce quun patient conserve avec lui des biens de
faible valeur ayant fait lobjet dun dpt.
La mention de la conservation du bien par le patient doit tre indique sur le registre.
Procdure suivre lorsque le patient se trouve dans lincapacit deffectuer lui-mme le dpt
(soins urgents - patient hors dtat dexprimer sa volont mineur ou majeur sous tutelle non accompagn)
Dans ces circonstances, il revient en principe un agent de lhpital de procder aux formalits la place de
la personne.
Un inventaire de tous les objets (pas seulement les objets de valeur ou les objets dont la dtention est
justifie) doit tre dress par le responsable du service des admissions ou par un agent ayant reu dlgation,
en prsence dune personne ayant accompagn le patient admis, le cas chant, ou dun second agent de
lhpital.
Le patient sera inform du dpt ds que possible, afin quil retire les objets qui en principe ne relvent pas du
dpt. Linventaire initial et le reu lui sont remis (ou son reprsentant lgal). Le patient doit faire connatre
les biens quil souhaite retirer du dpt. Linventaire est alors rectifi.
Responsabilits de lhpital
Principe :
sagissant des objets dposs, lhpital est responsable de plein droit de leur vol, perte ou dtrioration,
sagissant des objets non dposs, lhpital nest responsable quen cas de faute, la charge de la preuve
incombant au dposant.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
108
Attention !
Si le directeur (ou ladministrateur de garde) avait donn son accord pour que le patient conserve avec lui des
objets dposables ( dpt feint ), lhpital redevient responsable de plein droit condition quil ne sagisse
pas de sommes dargent, titres ou valeurs mobilires, moyens de rglement ou objets de valeur.
Limites :
Dans les deux cas, lhpital nest pas responsable :
si la perte ou la dtrioration rsulte de la nature ou dun vice de la chose,
si le dommage a t rendu ncessaire pour lexcution dun acte mdical ou de soins.
Rfrences
Articles L. 1113-1, L. 1113-3 et L. 1113-8 du code de la sant publique,
Articles R. 1113-1 R. 1113-5 du code de la sant publique,
Article 137 du rglement intrieur type de lAP-HP,
Circulaire du 27 mai 1994 relative la gestion des dpts effectus par des personnes admises dans les
tablissements de sant et les tablissements sociaux ou mdico-sociaux hbergeant des personnes ges ou des
adultes handicaps.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
109
28 Lusurpation didentit
Pour aller lessentiel
Lhpital doit porter plainte auprs du commissariat de police pour faux et usage de faux et aviser de
cette plainte lorganisme de scurit sociale concern.
La Direction des affaires juridiques et des droits du patient doit galement tre tenue informe.
Dfinition
Il nest pas rare que des patients procdent une usurpation didentit :
pour sattribuer le nom dun tiers, disparatre lissue de lhospitalisation et ne pas payer leurs frais de
sjour ;
pour utiliser le nom et la couverture sociale dun proche et bnficier, indment, de la prise en charge des
soins par la Scurit sociale.
Lusurpation didentit peut tre sanctionne pnalement en tant que faux et usage de faux de trois ans
demprisonnement et de 45 000 euros damende. Larticle 441-1 du code pnal dispose en effet que :
Constitue un faux toute altration frauduleuse de la vrit, de nature causer un prjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit, dans un crit ou tout autre support dexpression de la pense qui a pour objet ou
qui peut avoir pour effet dtablir la preuve dun droit ou dun fait ayant des consquences juridiques () .
Procdure suivre
Dans un premier temps, lhpital doit porter plainte auprs du commissariat de police pour faux et usage de
faux .
Puis, il doit aviser immdiatement de cette plainte le ou les organismes de scurit sociale dont lindividu
se dclare tort le bnficiaire.
La caisse de scurit sociale pourra, son tour, porter plainte pour escroquerie et agir conjointement avec
lAP-HP.
Enfin, une fois la plainte dpose, la Direction des affaires juridiques et des droits du patient (Bureau des
personnes vulnrables, des libralits et des frais de sjour) doit tre saisie.
Il doit lui tre communiqu :
toutes les pices du dossier,
les coordonnes du dpt de plainte.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
110
Coordonnes utiles :
DAJDP (bureau des personnes vulnrables, des libralits et des frais de sjour)
Tel : 01 40 27 34 83
Fax : 01 40 27 38 27
CPAM
Commissariat de police du [] arrondissement
Rfrences
Article 441-1 du code pnal
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
111
29 Le consentement aux actes mdicaux
Pour aller lessentiel
Le patient ne peut tre lobjet de soins ou dexamens de diagnostic que sil a donn son
consentement libre et clair. Ce consentement doit tre recherch dans tous les cas.
Les modalits dexpression du consentement sont renforces dans certaines situations, et notamment pour :
le don et utilisation des produits et lments du corps humain,
les recherches biomdicales,
lexamen des caractristiques gntiques dun patient.
Le principe gnral
Il est nonc par larticle L. 1111-4 du code de la sant publique :
Toute personne prend, avec le professionnel de sant et compte tenu des informations et des
prconisations qu'il lui fournit, les dcisions concernant sa sant.
Le mdecin doit respecter la volont de la personne aprs l'avoir informe des consquences de ses choix.
Si la volont de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le mdecin doit
tout mettre en uvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel un autre
membre du corps mdical. Dans tous les cas, le malade doit ritrer sa dcision aprs un dlai raisonnable.
Celle-ci est inscrite dans son dossier mdical. Le mdecin sauvegarde la dignit du mourant et assure la
qualit de sa fin de vie en dispensant les soins viss l'article L. 1110-10.
Aucun acte mdical ni aucun traitement ne peut tre pratiqu sans le consentement libre et clair de la
personne et ce consentement peut tre retir tout moment.()
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement
pralable. Les tudiants qui reoivent cet enseignement doivent tre au pralable informs de la ncessit de
respecter les droits des malades noncs au prsent titre.
Les dispositions du prsent article s'appliquent sans prjudice des dispositions particulires relatives au
consentement de la personne pour certaines catgories de soins ou d'interventions .
Le patient a la possibilit de refuser les soins qui lui sont proposs aprs avoir reu une information
complte sur les consquences mdicales de son refus.
Forme du consentement
Il nexiste pas de formalisme en matire de recueil du consentement, lexception de certaines activits
mdicales, pour lesquelles le recueil du consentement crit du patient est ncessaire :
Pour les actes de recherche biomdicale, le consentement du patient doit tre recueilli par crit ou
attest par un tiers, hors le cas de lurgence mdicale ;
Pour le don et lutilisation des produits du corps humain, le consentement pralable du donneur majeur
doit tre recueilli pour le prlvement in vivo dlments du corps humain et la collecte de ses produits. Ce
consentement est rvocable tout moment,
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
112
Pour lexamen des caractristiques gntiques du patient, la loi prvoit que Le consentement exprs de
la personne doit tre recueilli par crit pralablement la ralisation de lexamen, aprs quelle a t dument
informe de sa nature et de sa finalit. Le consentement mentionne la finalit de lexamen (art. 16-10, C.
civ.),
Pour la collecte de sang humain, () le prlvement ne peut tre fait quavec le consentement du
donneur par un mdecin ou sous sa direction et sa responsabilit () (art. L. 1221-3, C. sant publ.),
Pour le prlvement dorganes et quand la personne tait majeure, la loi prvoit la recherche obligatoire
dun ventuel refus de prlvement d'organe exprim par la personne de son vivant. Toute personne
refusant des prlvements sur son corps post mortem a la possibilit de le faire mentionner sur le registre
national automatis des refus prvu cet effet et tenu par lAgence de la biomdecine, ou de le faire connatre
par tout autre moyen.
Exceptions au principe du consentement
Larticle L. 1111-4 du code de la sant publique prvoit que :
Lorsque la personne est hors d'tat d'exprimer sa volont, aucune intervention ou investigation ne peut tre
ralise, sauf urgence ou impossibilit, sans que la personne de confiance prvue l'article L. 1111-6, ou la
famille, ou dfaut, un de ses proches ait t consult.
Lorsque la personne est hors d'tat d'exprimer sa volont, la limitation ou l'arrt de traitement susceptible de
mettre sa vie en danger ne peut tre ralis sans avoir respect la procdure collgiale dfinie par le code de
dontologie mdicale et sans que la personne de confiance prvue l'article L. 1111-6 ou la famille ou,
dfaut, un de ses proches et, le cas chant, les directives anticipes de la personne, aient t consults. La
dcision motive de limitation ou d'arrt de traitement est inscrite dans le dossier mdical .
Il peut tre drog la rgle du consentement pralable dans deux cas :
- la situation durgence mdicale
- la situation dans laquelle le patient est hors dtat dexprimer son consentement
Dans ces deux cas, lquipe mdicale a la facult de prendre dans lintrt du patient la dcision mdicale
quelle juge ncessaire. Elle devra informer le patient des dcisions relatives aux soins lorsquil sera
nouveau apte les comprendre.
Dispositions spcifiques aux mineurs et aux majeurs protgs
Larticle L. 1111-4 du code de la sant publique prvoit que : Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit tre systmatiquement recherch s'il est apte exprimer sa volont et participer la dcision.
Dans le cas o le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorit parentale ou par le tuteur risque
d'entraner des consquences graves pour la sant du mineur ou du majeur sous tutelle, le mdecin dlivre
les soins indispensables .
v. fiches n 30 et 31 : le consentement des majeurs protgs et le consentement du patient mineur
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
113
30 - Le consentement des majeurs protgs
Pour aller lessentiel
Les droits des majeurs sous tutelle (en matire de droit linformation mdicale : sur son tat de sant,
les investigations, les traitements, les risques, etc.) sont exercs par le tuteur. (..). Les intresss ont le droit
de recevoir eux-mmes une information et de participer la prise de dcision les concernant, dune manire
adapte leurs facults de discernement (art. L. 1111-2, C. sant publ.).
Par ailleurs, Le consentement du majeur sous tutelle doit tre systmatiquement recherch sil est apte
exprimer sa volont et participer la dcision (art. L. 1111-4, C. sant publ.).
Le mdecin a la possibilit de dlivrer les soins indispensables lorsque le refus du reprsentant lgal
risque dentraner des consquences graves pour la sant de lincapable (art. L. 1111-4, C. sant publ.).
Les principes
Ils sont fixs par les articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la sant publique :
Les droits des majeurs sous tutelle (en matire de droit linformation mdicale : sur son tat de sant, les
investigations, les traitements, les risques, etc.) sont exercs par le tuteur. (Le tuteur reoit linformation). Les
intresss ont le droit de recevoir eux-mmes une information et de participer la prise de dcision les
concernant, dune manire adapte leurs facults de discernement .
Par ailleurs, Le consentement du majeur sous tutelle doit tre systmatiquement recherch sil est apte
exprimer sa volont et participer la dcision (article L. 1111-4, C. sant publ.).
Des dispositions lgales spcifiques
Les prlvements
Le prlvement dorganes
Aucun prlvement dorganes, en vue dun don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant
lobjet dune mesure de protection lgale () (art. L. 1231-2, C. sant publ.).
Les prlvements de tissus, cellules et produits du corps humain sur une personne vivante majeure
protge (art. L. 1241-2 et L. 1241-4, C. sant publ.) sont en principe interdits.
Une exception consiste en ce qu en labsence dautre solution thrapeutique, un prlvement de cellules
hmatopotiques issues de la moelle osseuse peut tre fait sur une personne vivante majeure faisant lobjet
dune mesure de protection lgale au bnfice de son frre ou de sa sur .
Si la personne protge fait lobjet dune mesure de tutelle, ce prlvement est subordonn une dcision
du juge des tutelles comptent qui se prononce aprs avoir recueilli lavis de la personne concerne lorsque
cela est possible, du tuteur et du comit dexperts mentionn larticle L. 1231-3 (C. sant publ.) ;
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
114
Si la personne protge fait lobjet dune mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des
tutelles comptent estime, aprs lavoir entendue, que la personne protge a la facult de consentir au
prlvement, celui-ci est subordonn une autorisation du comit dexperts (), aprs recueil du
consentement de lintress dans les conditions prvues larticle L. 1241-3 (le consentement est exprim
devant le prsident du Tribunal de grande instance ou le magistrat dsign par lui, qui sassure au pralable
que le consentement est libre et clair. En cas durgence vitale, le consentement recueilli par tout moyen par
le procureur de la Rpublique).
Hors les cas o la personne protge a la facult de consentir au prlvement, celui-ci ne peut tre pratiqu
quaprs que le juge des tutelles se soit prononc favorablement aprs avoir recueilli lavis du tuteur et du
comit dexperts mentionn larticle L. 1231-3.
De tels prlvements peuvent galement tre effectus sur une personne protge au bnfice de son cousin
germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nice, sous de
strictes conditions (art. L. 1241-4, C. sant publ.).
Attention ! Le refus de la personne protge fait obstacle au prlvement (art. L. 1241-4, C. sant publ.)
Les prlvements post mortem et lautopsie :
Le principe : Si la personne dcde tait un majeur sous tutelle, le prlvement (effectu des fins
thrapeutiques ou scientifiques) ne peut avoir lieu qu la condition que le tuteur y consente par crit (art. L.
1232-2, C sant publ.).
Rfrences
Article L. 1111-4 du code de la sant publique,
Article 122 du rglement intrieur de lAP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
115
31 Le consentement du patient mineur
Pour aller lessentiel
Lobtention du consentement du ou des titulaires de lautorit parentale est obligatoire pour toute
intervention mdicale ou chirurgicale sur le mineur. Le consentement du mineur doit tre recherch, chaque
fois que possible, afin quil participe la prise de dcision mdicale.
Dans certaines situations prvues par la loi, des soins peuvent tre dlivrs la demande du mineur sans
le consentement parental.
Le principe gnral : le consentement des titulaires de lautorit
parentale
La loi prvoit que Les droits des mineurs () sont exercs () par les titulaires de lautorit parentale ().
Ceux-ci reoivent linformation prvue () sous rserve des dispositions de larticle L. 1111-5. Les intresss
ont le droit de recevoir eux-mmes une information et de participer la prise de dcision les concernant,
dune manire adapte leur degr de maturit () (article L. 1111-2 C. sant publ.).
Le refus de soins des titulaires de lautorit parentale
La loi prcise aussi que Dans le cas de refus dun traitement par la personne titulaire de lautorit parentale
ou par le tuteur risque dentraner des consquences graves pour la sant du mineur (ou du majeur sous
tutelle), le mdecin dlivre les soins indispensables (article L. 1111-4 C. sant publ.).
Le consentement du ou des titulaires de lautorit parentale
En principe, toutes les dcisions relatives la sant de lenfant doivent tre prises par les deux parents,
quelle que soit leur situation juridique (maris, pacss, en union libre, spars ou divorcs).
Aucun crit nest exig pour formaliser leur consentement, lautorisation crite ntant requise que pour les
interventions chirurgicales ou les actes mdicaux de gravit comparable.
Lorsquun seul parent est prsent, la loi retient une prsomption de consentement des deux parents :
lgard des tiers de bonne foi (ici : lhpital, le mdecin,), chacun des parents est rput agir avec
laccord de lautre, quand il fait seul un acte usuel de lautorit parentale relativement la personne de
lenfant (art. 372 du code civil).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
116
Actes usuels / actes non usuels
et forme du consentement
En matire mdicale, on considre gnralement que les actes usuels sont les actes mdicaux sans
gravit, notamment les soins obligatoires (comme certaines vaccinations), les soins courants (blessures
superficielles, infections bnignes, soins dentaires courants...), les soins habituels (maladies infantiles
ordinaires) ou ceux induits par la poursuite du traitement d'une maladie rcurrente (usuel ne voulant pas
ncessairement dire bnin).
Dans ce cas, lautorisation de soins peut ntre demande qu l'un des parents.
Une mme autorisation initiale peut par ailleurs valoir pour lensemble des actes de soins usuels
intervenant dans le traitement.
Lhpital pourra vrifier que cette autorisation gnrale est bien signe par lun des titulaires de
lautorit parentale, par tous moyens (le livret de famille constituant un moyen de vrification possible).
En revanche, lorsque le mineur ncessite lintervention dun acte non usuel dans le cadre ou non dun
traitement dj engag (ncessit dune intervention chirurgicale, dun traitement lourd ou comportant des
effets secondaires importants, ou tout acte mdical invasif et pratiqu sous anesthsie et de gravit
comparable, tels les radiologies interventionnelles ou endoscopies), une autorisation crite, explicite
(visant lacte ou lintervention) et signe des deux parents est ncessaire.
Le mineur peut tre soumis lautorit parentale dun seul de ses parents, cest--dire dans les cas o sa
filiation na t tablie qu lgard un seul parent, o lorsquun des parents est dcd ou se trouve priv de
lautorit parentale titre temporaire ou dfinitif. Ce parent dtenant seul lautorit parentale, son seul
consentement sera requis pour les actes non usuels et plus graves.
Lorsque le mineur est plac sous tutelle, le consentement est donn par le tuteur pour les actes bnins, et
par le conseil de famille pour les actes les plus graves.
Il rsulte de ce qui prcde que le mineur, dont l'avis doit tre recueilli avant tout traitement important, ne
peut en principe (sauf urgence) se prsenter de son propre chef, sans consentement des parents connu de
lhpital, dans un service hospitalier en vue d'y bnficier d'une consultation ou de soins.
En cas de soins " bnins "
Dans de nombreux cas, cette situation ne prsente pas de difficult, les soins tant programms en accord
avec les parents et lautorisation a t donne de faon explicite..
A dfaut, pour les soins non urgents, le personnel hospitalier doit sassurer par tout moyen, notamment par
tlphone, que les titulaires de lautorit parentale sont informs de linitiative du mineur deffectuer la
consultation et ne sy sont pas opposs.
Cette possibilit doit tre limite aux cas o il ne peut tre procd autrement : en principe, le patient mineur
ne peut bnficier de soins que s'il est muni d'une autorisation crite d'un titulaire de l'autorit parentale par
laquelle ce dernier indique quil est inform de la nature des soins devant tre pratiqus, et autorise que ceux-
ci soient prodigus en son absence.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
117
Une exception : l'urgence mdicale
Si la consultation rvle une situation durgence (situation rendant ncessaire une intervention mdicale
immdiate), l'autorisation pralable du (ou des) titulaire(s) de l'autorit parentale n'est pas requise.
Les actes mdicaux indispensables doivent tre raliss, quel que puisse tre le point de vue ultrieur des
parents ( en cas durgence, si les parents ou le reprsentant lgal du mineur ne peuvent tre joints, le
mdecin doit donner les soins ncessaires ).
Paralllement lexcution de ces soins, il convient cependant de tout mettre en uvre pour tenter de joindre
les titulaires de lautorit parentale afin de les informer de la situation : toutes mesures utiles doivent tre
prises pour que la famille des malades ou blesss hospitaliss en urgence soit prvenue . Le mdecin
appel dispenser des soins au mineur doit sefforcer dobtenir le consentement du reprsentant lgal.
Par ailleurs, lquipe mdicale doit conserver toutes les indications utiles pouvant rapporter la preuve des
moyens mis en uvre pour tenter de joindre les parents.
Enfin, le procureur de la Rpublique doit tre avis en cas dimpossibilit de joindre la famille et lorsque la
sant ou lintgrit corporelle du mineur risque dtre compromise par limpossibilit de recueillir le
consentement du reprsentant du mineur (art. R.1112-35, C. sant publ.).
Les prlvements
Le prlvement dorgane
Aucun prlvement dorganes, en vue dun don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ()
(art. L. 1231-2, C. sant publ.).
Les prlvements de tissus ou de cellules et la collecte de produits du corps humain
Le principe est qu Aucun prlvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps
humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure () (art. L. 1241-2 C. sant
publ.).
Une exception concerne les prlvements de cellules hmatopotiques issues de la moelle osseuse : Par
drogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thrapeutique, un prlvement
de cellules hmatopotiques issues de la moelle osseuse peut tre fait sur un mineur au bnfice de son
frre ou de sa sur.
Lorsqu'un tel prlvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thrapeutique, le prlvement de
cellules hmatopotiques issues de la moelle osseuse peut, titre exceptionnel, tre fait sur un mineur au
bnfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de
sa nice.
Dans tous les cas, ce prlvement ne peut tre pratiqu que sous rserve du consentement de chacun des
titulaires de l'autorit parentale ou du reprsentant lgal du mineur informs des risques encourus par le
mineur et des consquences ventuelles du prlvement par le praticien qui a pos l'indication de greffe ou
par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprim devant le prsident du tribunal de grande
instance ou le magistrat dsign par lui, qui s'assure au pralable que le consentement est libre et clair. En
cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la Rpublique. Le
consentement est rvocable sans forme et tout moment.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
118
L'autorisation d'effectuer le prlvement est accorde par le comit d'experts mentionn l'article L. 1231-3
qui s'assure au pralable que tous les moyens ont t mis en uvre pour trouver un donneur majeur
compatible pour le receveur et que le mineur a t inform du prlvement envisag en vue d'exprimer sa
volont, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prlvement (art. L. 1241-3, C. sant
publ.).
Les drogations au consentement parental : le consentement du
seul mineur aux actes mdicaux
Des dispositions lgales spcifiques autorisent dans certains cas particuliers, et dans ces seules situations, de
dlivrer des soins des mineurs sans l'autorisation pralable des titulaires de lautorit parentale.
Elles confrent au mineur la possibilit dune prise en charge confidentielle par lhpital, en application du
principe du respect de la vie prive et de lintimit du patient, pos par larticle L.1110-4 du code de la sant
publique (on notera que selon le Conseil National de lOrdre des Mdecins, le mineur doit bnficier au mme
titre que le majeur dun droit individuel lintimit dans le cadre de sa relation thrapeutique). Le mineur peut
ainsi revendiquer un droit particulier au secret :
Pour toutes les consultations lies la prescription, la dlivrance ou l'administration de mdicaments,
produits ou objets contraceptifs, qui peuvent tre dlivrs titre gratuit par les centres de planification ou
dducation familiale aux mineures qui dsirent garder le secret (art. L. 2311-4, C. sant publ.).
Pour les consultations lies une grossesse dont la mineure dsire garder le secret, puisque la mineure
est autorise garder le secret de son accouchement au mme titre quune femme adulte (art. 341-1 du code
civil : accouchement sous X ), ou dune interruption volontaire de grossesse (art. L. 2212-4, C. sant
publ. ; v. fiche n18 : la demande d IVG ).
Pour le dpistage de linfection du VIH, anonyme et gratuit (art. L.3121-2, C. sant publ.).
En cas de demande de secret exprime par le mineur (art. L. 1111-5, C. sant publ.) :
Par drogation larticle 371-2 du code civil, le mdecin peut se dispenser dobtenir le consentement du ou
des titulaires de lautorit parentale sur les dcisions mdicales prendre lorsque le traitement ou
lintervention simpose pour sauvegarder la sant dune personne mineure, dans le cas o cette dernire
soppose expressment la consultation du ou des titulaires de lautorit parentale afin de garder le secret sur
son tat de sant. Toutefois, le mdecin doit dans un premier temps sefforcer dobtenir le consentement du
mineur cette consultation. Dans le cas o le mineur maintient son opposition, le mdecin peut mettre en
uvre le traitement ou lintervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner dune personne majeure de
son choix .
Dans ce cas :
- le mdecin peut accepter dengager les soins dans le secret vis--vis des parents, mais il ny est pas
tenu ;
- le mdecin est tenu dengager au pralable un dialogue avec la personne mineure afin de tenter de la
persuader de consulter ses reprsentants lgaux. Toutefois, si le mineur persiste dans son refus de les
informer, les actes mdicaux envisags peuvent alors tre accomplis.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
119
Cependant, afin de prserver les intrts du mineur et de lui assurer une aide, le mineur a lobligation de
dsigner une personne majeure rfrente qui laccompagnera au cours de son hospitalisation.
Le mineur bnficiaire de la couverture maladie universelle (CMU) (art. L. 1111-5, C. sant publ.)
Lorsquune personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bnficie titre personnel du
remboursement des prestations en nature de lassurance maladie et maternit et de la couverture
complmentaire mise en place par la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant cration dune couverture
maladie universelle, son seul consentement est requis .
Les personnes mineures ayant atteint l'ge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont
rompus, peuvent bnficier titre personnel, leur demande, sur dcision de l'autorit administrative, de la
protection complmentaire dans les conditions dfinies l'article L. 861-3 () (loi n 99-641 du 27 juillet
1999).
Rfrences
Article L 1111-5 du code de la sant publique
Article 121 du rglement intrieur de lAP-HP
Dcret n 2000-842 du 30 aot 2000 relatif aux centres de planification ou dducation familiale
Guide AP-HP Lenfant, ladolescent lhpital (2002)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
120
32 Le refus de soins
Pour aller lessentiel
Lorsque la vie du patient nest pas en danger, il convient de se rfrer la fiche n41 les sorties contre
avis mdical ,
Dans certaines circonstances, une quipe mdicale peut tre confronte un refus du patient (ou des ses
parents ou encore de son tuteur) de se soigner, alors mme que des soins paraissent manifestement
ncessaires,
Il convient de distinguer plusieurs cas diffrents : celui de la personne majeure, celui du mineur, du majeur
sous tutelle ou celui de la personne en fin de vie,
La volont de la personne doit tre respecte. Dans des circonstances strictes et cumulatives, le mdecin
peut toutefois passer outre le refus de soins.
Le cas de la personne majeure
Larticle L. 1111-4 du code de la sant publique dispose que : Toute personne prend, avec le professionnel
de sant et compte tenu des informations et des prconisations quil lui fournit, les dcisions concernant sa
sant.
Le mdecin doit respecter la volont de la personne aprs lavoir informe des consquences de ses choix.
Si la volont de la personne de refuser ou dinterrompre un traitement met sa vie en danger, le mdecin doit
tout mettre en uvre pour la convaincre daccepter les soins indispensables. Aucun acte ni aucun
traitement ne peut tre pratiqu sans le consentement libre et clair de la personne et ce consentement
peut tre retir tout moment () .
Lorsque la vie du patient nest pas en danger, il convient de se rfrer la fiche n41 les sorties contre avis
mdical
Le fait que le patient refusant des soins en vienne se placer ainsi, le cas chant, en danger, mrite en
revanche la plus grande attention.
Recommandations face un refus de soins lorsquil met en jeu le pronostic vital :
Si la facult de passer outre le refus de soins et de ce fait de porter atteinte aux droits fondamentaux du
patient est reconnue, elle est subordonne de strictes et cumulatives conditions :
le mdecin doit tout mettre en uvre pour sefforcer de convaincre le patient daccepter les soins
indispensables ;
lacte mdical est accompli dans le but de sauver le patient ;
le patient doit se trouver dans une situation extrme mettant en jeu le pronostic vital ;
lacte mdical constitue un acte indispensable et proportionn ltat de sant du patient (absence
dalternatives thrapeutiques)(Conseil dEtat, Ordonnance du 16 aot 2002).
Ce type de situations doit tre gr avec la plus grande rigueur.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
121
Cas de la personne mineure ou majeure sous tutelle
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit tre recherch de manire systmatique sil est
apte exprimer sa volont et participer toute prise de dcision concernant sa sant.
Sagissant du refus dun traitement effectu sur un mineur ou un majeur sous tutelle, larticle L. 1111-4 du
code de la sant publique dispose que :
Dans le cas o le refus dun traitement par la personne titulaire de lautorit parentale ou le tuteur risque
dentraner des consquences graves pour la sant du mineur ou du majeur sous tutelle, le mdecin dlivre
les soins indispensables .
Recommandations
Dans ce cas prcis, il nest donc pas ncessaire de saisir le Parquet ou le Juge des enfants.
Lquipe mdicale doit sefforcer de convaincre le ou les titulaires de lautorit parentale ou le tuteur de lutilit
des soins proposs ainsi que de labsence dalternatives thrapeutiques dans le traitement propos. La
dcision mdicale lemporte.
Cas de la personne en fin de vie
Larticle L. 1111-10 du code de la sant publique nonce que lorsquune personne, en phase avance ou
terminale dune affection grave et incurable, quelle quen soit la cause, dcide de limiter ou darrter tout
traitement, le mdecin respecte sa volont aprs lavoir informe des consquences de son choix . Dans ce
cas, des soins palliatifs doivent en principe tre organiss, en accord avec le patient.
Dans le cas o la personne est hors dtat dexprimer sa volont, le mdecin doit rechercher si elle a rdig
des directives anticipes (elles indiquent les souhaits de la personne relatifs sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou larrt de traitement. Elles sont rvocables tout moment). Il doit galement
demander lavis de la personne de confiance, si le patient en a dsign une (cet avis prvaut alors sur tout
autre avis non mdical, lexclusion des directives anticipes).
Rfrences
Article L. 1111-4 du code de la sant publique,
Article 120 du rglement intrieur de lAP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
122
33 La communication du dossier mdical
Pour aller lessentiel
Les patients (ou le cas chant, les titulaires de lautorit parentale, ou les ayants droit en cas de dcs) ont
accs l'ensemble des informations concernant leur sant dtenues par lhpital. Ils peuvent y accder,
suivant leur choix directement ou par l'intermdiaire d'un praticien qu'ils dsignent, et en obtenir
communication.
Composition du dossier mdical
Le dossier mdical est constitu a minima des pices suivantes :
les informations formalises recueillies lors des consultations externes dispenses dans lhpital,
lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du sjour
hospitalier :
Lettre du mdecin l'origine de la consultation ou de l'admission, motifs d'hospitalisation, recherche
d'antcdents et de facteurs de risques, conclusions de l'valuation clinique initiale, informations relatives la
prise en charge en cours d'hospitalisation (tat clinique, soins reus, examens para-cliniques, etc.), dossier
d'anesthsie, compte rendu opratoire, consentement crit du patient pour les situations o ce consentement
est requis sous cette forme par voie lgale ou rglementaire, mention des actes transfusionnels pratiqus,
copie de la fiche d'incident transfusionnel le cas chant, dossier de soins infirmiers, correspondances
changes entre professionnels de sant
les informations formalises tablies la fin du sjour :
Compte rendu d'hospitalisation, lettre de sortie, prescription et modalits de sortie, fiche de liaison infirmire
Attention ! Les informations recueillies auprs de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thrapeutique ou concernant des tiers ne sont pas communicables au patient.
Procdures pour laccs aux documents
Deux modalits d'accs au dossier mdical sont prvues, au choix du patient :
l'accs direct de la personne aux informations mdicales contenues dans son dossier. Conformment la
loi, lhpital doit cependant proposer au demandeur un accompagnement mdical (cest--dire la prsence
dun mdecin).
l'accs par l'intermdiaire d'un mdecin.
La loi prvoit que la prsence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut
tre recommande par le mdecin les ayant tablies ou en tant dpositaire, pour des motifs tenant aux
risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir la personne concerne ". Dans cette
hypothse, les informations seront communiques ds que le demandeur aura exprim son acceptation ou
son refus de suivre cette recommandation.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
123
Un dlai de rflexion pralable de 48 heures doit tre respect (pas de remise directe et immdiate). Les
informations doivent tre ensuite communiques au patient dans les 8 jours compter de la date de
rception de sa demande. Le dlai de 48 heures est port deux mois pour des informations mdicales
datant de plus de cinq ans (la priode de cinq ans a pour point de dpart la date laquelle l'information
mdicale a t constitue) ou lorsque la commission dpartementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie.
Pour obtenir communication de son dossier mdical, le patient doit formuler sa demande au directeur de
lhpital ou la personne que lhpital a le cas chant dsigne cet effet.
Le destinataire de cette demande doit, avant toute communication, s'assurer de l'identit du demandeur ou
s'informer de la qualit de mdecin de la personne dsigne comme intermdiaire.
Deux modes de transmission du dossier mdical sont prvus :
une consultation des informations sur place, gratuite, avec remise le cas chant de copies de
documents ;
l'envoi de copies des documents. Seuls les frais de photocopies seront facturs au demandeur, ainsi que
les frais de port si le patient sollicite un envoi de son dossier mdical. Dans tous les cas (sauf le cas chant
pour certains clichs), lhpital conserve les documents originaux.
Pour les clichs dimagerie, une reproduction peut tre dlivre aux patients qui le demandent, sans
redevance supplmentaire.
Attention !
En cas de ncessit, des clichs originaux peuvent tre transmis :
- Pour les clichs raliss dans le cadre des consultations externes, ils sont remis soit au patient, soit au
mdecin prescripteur ;
- Dans les autres cas :
faire alors signer au patient ou son reprsentant un rcpiss prcisant quil devient le seul dpositaire de
ces documents,
lorsque la remise se fait par courrier, rdiger un courrier daccompagnement (recommand avec accus de
rception), dat et sign, listant les documents ainsi remis,
conserver une copie du rcpiss et du courrier daccompagnement dans le dossier mdical du patient.
Lorsque le demandeur n'a pas exprim clairement le mode de communication choisi, lhpital doit informer le
demandeur des diffrentes modalits de communication ouvertes par la rglementation et lui indiquer celle
utilise dfaut de choix de sa part. Si le demandeur, au terme du dlai de huit jours ou celui de deux mois,
ne s'est toujours pas exprim quant aux modalits de communication, les professionnels de sant doivent
mettre sa disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient prcdemment indique.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
124
Cas particuliers de consultation du dossier mdical
Les personnes hospitalises sans leur consentement pour troubles mentaux
La consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou
d'une hospitalisation d'office, peut tre subordonne la prsence d'un mdecin dsign par le demandeur.
Cette procdure ne peut tre lgalement impose au patient que :
titre exceptionnel,
en cas de risques dune gravit particulire.
En cas de refus du demandeur de dsigner un mdecin, il revient lhpital des informations ou l'intress
de saisir la Commission dpartementale des hospitalisations psychiatriques. Cette commission rend
alors un avis qui s'impose lhpital comme au demandeur.
Les patients mineurs
Le droit daccs aux informations mdicales est exerc par le ou les titulaires de lautorit parentale.
Toutefois, si le mineur en fait la demande, laccs aux informations relatives sa sant et ses soins a lieu
par lintermdiaire dun mdecin, dsign par le ou les titulaire(s) de lautorit parentale.
Par drogation au principe ci-dessus nonc, le mineur peut sopposer ce que ses reprsentants lgaux
aient accs au dossier mdical le concernant, et ce conformment aux dispositions dictes par larticle L.
1111-5 du code de la sant publique (v. fiche n31 : le consentement du patient mineur ).
Le dossier mdical d'un patient dcd
Le dcs du patient nouvre pas un droit absolu aux survivants accder au dossier mdical, ni plus
gnralement aux informations concernant la sant des patients.
L'article L.1110-4 du code de la sant publique nonce cependant que " le secret mdical ne fait pas obstacle
ce que les informations concernant une personne dcde soient dlivres ses ayants droit "
Il prcise que sauf volont contraire du dfunt exprime de son vivant, l'accs son dossier mdical de
ses ayants droit n'est possible que lorsque ces informations sont ncessaires afin de :
connatre les causes de la mort,
dfendre la mmoire du dfunt,
faire valoir leurs droits.
Ainsi, l'ayant droit du patient dcd doit prciser lors de sa demande le motif pour lequel il a besoin
d'avoir connaissance de ces informations. Seules les informations ncessaires la ralisation de
lobjectif poursuivi par layant droit lui sont communicables.
Il convient donc, dans cette situation, de procder au tri pralable des pices constitutives du dossier pour ne
transmettre que celles qui concernent lobjectif poursuivi.
Tout refus oppos layant droit doit tre motiv. Toutefois, ce refus ne fait pas obstacle la dlivrance d'un
certificat mdical, ds lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret mdical.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
125
Cas particulier : communication des informations mdicales un mandataire
Le Conseil dEtat (arrt du 26 septembre 2005) a prcis quun patient, lorsquil souhaite accder des
informations mdicales le concernant, peut recourir un mandataire. Cette possibilit de communication un
mandataire nest pas ouverte aux ayants droit (avis CADA du 8 mars 2007)
Il convient alors :
de vrifier lidentit du mandataire (copie de sa pice didentit)
dobtenir un mandat exprs du patient.
Le mandat doit tre formul par crit et de faon ce que la volont du patient apparaisse sans ambigit.
Exemple :
Je soussign(e) (nom, prnoms, adresse), mandate M. nom, prnoms, adresse pour recevoir copie de
mon dossier mdical/de (tels lments) de mon dossier mdical, date et signature .
Le mandataire peut tre toute personne dsigne par le patient.
Ces dispositions sappliquent sans modifier les rgles par lesquelles le patient doit lui-mme justifier de son
identit.
La notion dayant droit
La notion dayant droit dun patient dcd concerne les personnes suivantes :
le conjoint survivant,
les hritiers (ceux qui succdent au dfunt en vertu de la loi)
ou les lgataires (ceux qui succdent au dfunt par leffet dun testament).
En vertu des dispositions de larticle 731 du Code civil, les frres et surs ont la qualit dhritiers du dfunt.
Le partenaire dun PACS et le concubin ne sont pas considrs en droit franais comme des hritiers : ils
sont, de ce fait, considrs comme des tiers la succession du dfunt. Nanmoins, ces personnes pourront
avoir accs au dossier mdical du dfunt condition que celui-ci les ait expressment, et de son vivant,
institus lgataires par leffet dun testament.
En tout tat de cause, toute personne qui veut se prvaloir dun droit daccs au dossier mdical dune
personne dcde doit rapporter la preuve, par tout moyen, de sa qualit dayant droit, en produisant si
ncessaire un acte de notorit, tabli par un notaire ou un magistrat, prouvant par crit lexistence dune
situation juridique ou faisant tat de dclarations de plusieurs personnes attestant de faits notoirement
connus.
Rfrences
Article L. 1111-7 du code de la sant publique,
Article R. 1112-2 du code de la sant publique,
Articles 106 et 107 du rglement intrieur de lAP-HP.
Guide AP-HP, Recommandations pour la communication du dossier mdical (2002)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
126
Demande de communication de documents mdicaux
( adresser au mdecin chef du service concern ou au directeur de lhpital)
Je soussign(e), M./Mme/Melle (nom, prnom; pour les femmes maries, prcisez le nom de jeune fille)
N(e) le Tl. Domicili(e)
Le cas chant : pre, mre, reprsentant lgal de (nom, prnom du patient)
................................................................................................................................................................
N(e) le....................................................................................................................................................
demande obtenir communication des documents suivants :
le compte rendu de lhospitalisation du ..............................................................................................
............................................................................................................................................................ au
................................................................................................................................................................
les pices essentielles du dossier mdical
autres documents .......................................................................................................................
tabli(s) par lhpital
mon nom...........................................................................................................................................
ou au nom de.......................................................................................................................................
(mon fils, ma fille, la personne dont je suis le reprsentant lgal ou layant droit)
selon les modalits suivantes :
remise sur place lhpital
(prendre rendez-vous avec le service en prcisant si vous souhaitez la prsence dun mdecin en particulier)
envoi postal M., Mme, Melle (nom, prnom, adresse) ......................................................................
................................................................................................................................................................
envoi postal au Docteur (nom, prnom, adresse) ................................................................................
................................................................................................................................................................
motif de la demande (pour le dossier dun patient dcd)
................................................................................................................................................................
Date........................................... Signature
Renseignements facilitant la recherche du dossier
(dates de lhospitalisation, service dhospitalisation, n didentification)
................................................................................................................................................................
Pour un envoi postal, merci de joindre une photocopie de votre pice didentit et sil y a lieu, tout document
attestant de votre qualit de reprsentant lgal ou dayant droit du patient.
Les frais de copie et denvoi donnent lieu facturation.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
127
34 La personne de confiance
Pour aller lessentiel.
Lors dune hospitalisation, toute personne majeure doit tre en mesure aprs information du personnel
mdical de dsigner une personne de confiance. Celle-ci peut tre un parent, un proche ou le mdecin
traitant.
La personne de confiance peut intervenir dans trois situations :
les soins courants (articles L. 1110-4, L. 1111-4 et L. 1111-6, C. sant publ.)
la recherche biomdicale (article L. 1122-1-2, C. sant publ.).
les soins dlivrs aux patients en fin de vie (articles L. 1111-10, C. sant publ.)
Dsignation
Lidentit de la personne de confiance doit figurer au dossier du patient ainsi que ses coordonnes pour
la joindre le plus facilement possible. Les demandes particulires du patient relatives cette personne de
confiance doivent galement figurer dans le dossier mdical.
La dsignation de la personne de confiance est valable pour la dure de lhospitalisation, moins que le
malade nen dispose autrement. De mme, le patient peut tout moment mettre un terme cette dsignation
auprs du personnel hospitalier ou dsigner une autre personne. Toute modification figurera dans son dossier
mdical.
La dsignation dune personne de confiance na pas pour effet de restreindre linformation qui doit tre
donne aux proches, et notamment la personne prvenir que le patient est appel dsigner ds son
admission, pour le cas daggravation de son tat de sant ou pour toute autre ncessit.
La personne de confiance peut tre le mdecin traitant (libral ou hospitalier). En revanche, il est prfrable
que le mdecin dsign comme personne de confiance ne soit pas le mdecin qui dlivre les soins.
Rle
La personne de confiance ne reprsente pas le malade. En effet, la loi ne la pas investie dun pouvoir de
dcision. Son avis doit tre recueilli. Si le patient le souhaite, la personne de confiance laccompagne dans
ses dmarches et assiste aux entretiens mdicaux afin de laider dans ses dcisions.
Personne de confiance et secret mdical
Le personnel hospitalier ne doit pas divulguer des informations qui lui ont t confies par le patient et que
celui-ci souhaite demeurer confidentielles la personne de confiance
Ainsi, la personne de confiance na pas accs au dossier mdical du patient.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret mdical ne soppose pas ce que la personne
de confiance reoive, au mme titre que les membres de lentourage proche du patient et sauf
opposition de celui-ci, les informations ncessaires pour le soutenir et laccompagner.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
128
La personne de confiance doit agir dans lintrt du patient. Son assistance doit ainsi tre proportionne
aux besoins du patient et favoriser le bon droulement de lentretien mdical, qui demeure en principe
individuel.
Personne de confiance et tutelle
Le rle de la personne de confiance prend fin ds lors que le patient est plac sous le rgime de la tutelle. Le
juge des tutelles peut cependant en dcider autrement et confirmer la mission de la personne de confiance. A
contrario, il peut rvoquer la dsignation de la personne de confiance.
Une personne sous curatelle, sous sauvegarde de justice ou une personne fragile a la possibilit de
dsigner une personne de confiance.
Personne de confiance et recherches biomdicales
Dans le cas de recherches biomdicales mettre en uvre dans des situations durgence ne permettant pas
de recueillir le consentement pralable du patient, le consentement des membres de sa famille ou celui de
la personne de confiance est sollicit (art. L. 1122-1-2, C. sant publ.).
Il sagit du seul cas o la personne de confiance peut consentir pour le patient et nest pas seulement
consulte.
Personne de confiance et patient en fin de vie
Lorsquune personne, en phase avance ou terminale dune affection grave et incurable, a dsign une
personne de confiance, lavis de cette dernire, sauf urgence ou impossibilit, prvaut sur tout autre avis
non mdical, lexclusion des directives anticipes, dans les dcisions dinvestigation, dintervention ou de
traitement prises par le mdecin (art. L. 1111-12, C. sant publ.)
Rfrences
Articles L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1111-6, L. 1111-10 et s., L. 1122-1-2 du code de la sant publique
Article 109 du rglement intrieur de lAP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
129
Hpital:
Formulaire de dsignation dune personne de confiance
(art. L. 1111-6 du code de la sant publique)
Je soussign(e) (nom, prnom, adresse) ............................................................................................
............................................................................................................................................................
dsigne M., Mme, Melle ........................................................................................................................
(nom, prnom, adresse, tl., fax, e-mail)
...........................................................................................................................................................
lien avec le patient (parent, proche, mdecin traitant)
...........................................................................................................................................................
pour massister en cas de besoin en qualit de personne de confiance
pour la dure de mon hospitalisation
pour la dure de mon hospitalisation et ultrieurement
Jai bien not que M., Mme, Melle ........................................................................................................
pourra maccompagner, ma demande, dans mes dmarches lhpital et pourra assister aux
entretiens mdicaux, ceci afin de maider dans mes dcisions.
pourra tre consult(e) par lquipe hospitalire au cas o je ne serais pas en tat dexprimer ma
volont concernant les soins ou de recevoir linformation ncessaire pour le faire. Dans ces
circonstances, sauf cas durgence ou impossibilit de le (la) joindre, aucune intervention ou investigation
importante ne pourra tre ralise sans cette consultation pralable.
pourra dcider de mon inclusion dans un protocole de recherche biomdicale, si je ne suis pas en
mesure dexprimer ma volont
ne recevra pas dinformations que je juge confidentielles et que jaurais indiques au mdecin
sera informe par mes soins de cette dsignation et que je devrai massurer de son accord.
Fait .......................................................................
Le .......................................................................
Signature
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
130
35 Le secret mdical et professionnel
Pour aller lessentiel
Le secret professionnel simpose tout professionnel de sant et toute personne intervenant de par ses
activits professionnelles ou bnvoles au sein de lhpital.
Le secret est un principe fondamental dont on ne peut droger que dans les cas de rvlation strictement
prvus par la loi.
Les principes
(art. L. 1110-4, C. sant publ.)
Sauf drogations prvues par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne
venues la connaissance du professionnel de sant, cest dire ce qui lui a t confi, mais aussi ce quil a
vu, entendu ou compris . Le secret mdical doit galement tre maintenu l'gard des proches du patient.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret mdical ne s'oppose pas ce que la famille, les
proches de la personne malade ou la personne de confiance reoivent les informations ncessaires destines
leur permettre d'apporter un soutien direct celle-ci, sauf opposition de sa part.
En cas de dcs du patient, certaines informations peuvent toutefois tre transmises ses ayants droit dans
la mesure o elles leur sont ncessaires pour leur permettre de connatre les causes de la mort, de dfendre
la mmoire du dfunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volont contraire exprime par la personne avant son
dcs.
Obligations des mdecins et du personnel soignant
Tout mdecin a l'obligation professionnelle de maintenir le secret mdical sur les informations mdicales et
personnelles quil a recueillies auprs du patient.
Est punie " d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ", toute " rvlation d'une information
caractre secret par une personne qui en est dpositaire soit par tat ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire " (art. 226-13 du code pnal).
Nanmoins, la loi franaise autorise les mdecins droger au secret mdical dans certains cas. L'article
226-14 du Code pnal nonce ainsi que " l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas o la loi impose ou
autorise la rvlation du secret ".
Attention : Les tablissements de sant garants du secret mdical doivent assurer un contrle strict relatif
l'identit du destinataire (exemple : compagnies d'assurance, demandeur d'informations mdicales
nominatives).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
131
Article 226-14 du code pnal
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas o la loi impose ou autorise la rvlation du secret. En
outre, il n'est pas applicable :
1 A celui qui informe les autorits judiciaires, mdicales ou administratives de privations ou de svices, y
compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont t infliges
un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protger en raison de son ge ou de son
incapacit physique ou psychique ;
2 Au mdecin qui, avec l'accord de la victime, porte la connaissance du procureur de la Rpublique les
svices ou privations qu'il a constats, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et
qui lui permettent de prsumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont t
commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protger en
raison de son ge ou de son incapacit physique ou psychique, son accord n'est pas ncessaire ;
3 Aux professionnels de la sant ou de l'action sociale qui informent le prfet et, Paris, le prfet de police
du caractre dangereux pour elles-mmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent
qu'elles dtiennent une arme ou qu'elles ont manifest leur intention d'en acqurir une.
Le signalement aux autorits comptentes effectu dans les conditions prvues au prsent article ne peut
faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire .
Les applications lhpital
Dans certaines situations, la loi prvoit que le secret puisse tre partag :
Partage du secret mdical au sein d'une quipe mdicale
La loi prvoit que :
Deux ou plusieurs professionnels de sant peuvent (), sauf opposition de la personne dment avertie,
changer des informations relatives une mme personne prise en charge, afin dassurer la continuit des
soins ou de dterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible ,
et que par ailleurs,
Lorsque la personne est prise en charge par une quipe de soins dans un tablissement de sant, les
informations la concernant sont rputes confies par le malade lensemble de lquipe (art. L. 1110-4, C.
sant publ.).
Protection du secret mdical lors de transmission d'informations mdicales par voie lectronique
entre professionnels de sant
La transmission d'informations mdicales est autorise par voie lectronique entre professionnels de sant
ayant pris en charge le mme patient.
Ce partage d'informations permet ainsi la continuit des soins dans de meilleures conditions. LOrdre des
mdecins a mis une srie de recommandations dont il est indispensable de tenir compte, tant pour lmission
du message qu sa rception (v. Bull. de lOrdre des mdecins, avril 1996 ; lart. 73 du Code de dontologie
mdicale oblige de manire gnrale le mdecin protger contre toute indiscrtion les documents mdicaux
concernant les personnes soignes ; art. R. 4127-73, C. sant publ.).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
132
Communication d'informations mdicales des professionnels de la sant du fait de leurs missions
Dans le strict cadre de leurs missions, les mdecins-conseils de l'assurance maladie, les mdecins experts de
la Haute Autorit de Sant (HAS) ainsi que les mdecins de l'Inspection gnrale des affaires sociales sont
autoriss accder aux donnes mdicales contenues dans les dossiers mdicaux de tout patient.
Le secret mdical est ainsi tendu des mdecins diffrents de ceux qui prennent en charge le malade.
Rfrences
Article L.1110-4 du code de la sant publique,
Articles 226-13 et 14 du code pnal,
Article 4 du Code de dontologie mdicale,
Article 111 du rglement intrieur de lAP-HP
v. fiche n33 : la communication du dossier mdical
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
133
36 La demande du dossier mdical sur rquisition ou
perquisition
Il rsulte de la loi du 9 mars 2004 (dite loi Perben II ) que dans le cadre dune procdure pnale, il ne peut
tre donn suite la sollicitation dun dossier mdical ou dune partie de celui-ci que dans deux hypothses :
soit la rquisition,
soit la perquisition saisie .
Dans ces deux situations, il convient dassurer, dans le respect des activits de chacun, une coopration
efficace et rationnelle entre les autorits judiciaires, les forces de police ou de gendarmerie dune part, et les
hpitaux, les praticiens de lAP-HP, dautre part.
Attention : La loi Perben II na pas eu pour objet de modifier les dispositions du Code de la sant publique
relatives la communication du dossier mdical ds lors quil est demand par le patient (art. L.1111-7, C.
sant publ., v. fiche n33 : la communication du dossier mdical ).
Rappel des procdures concernes :
1. Lenqute prliminaire : articles 76 et 77-1-1 du code de procdure pnale
Cette enqute est effectue par le Procureur de la Rpublique, ou sur son autorisation, par un OPJ
2. Lenqute de flagrance : articles 56 59 et 60-1 du code de procdure pnale
Cette enqute est effectue sous la direction dun officier de police judiciaire (OPJ)
3. Linstruction : articles 81, 94, 96 et 99-3 du code de procdure pnale
Cette enqute est effectue sous la direction dun juge dinstruction ou par un OPJ sur commission rogatoire
dlivre par ce juge.
La sollicitation du dossier mdical par rquisition
Dfinition
La rquisition est lacte par lequel lautorit judiciaire et/ou les forces de police ou de gendarmerie sollicite un
mdecin ou un tablissement de sant aux fins de se faire remettre par exemple tout ou partie dun dossier
mdical.
Formalisme
Les dispositions lgales nimposent aucun formalisme particulier aux rquisitions. Si le plus souvent celles-ci
feront lobjet dun document crit remis ou adress la personne concerne, rien ninterdit quun enquteur
procde des rquisitions orales. Cependant, dans toute la mesure du possible, il convient de demander au
service de police la dlivrance dun document crit.
Lorsque la rquisition concerne des documents mdicaux, la remise des documents ne peut intervenir
quavec laccord du mdecin. Cette acceptation ne lui fait pas commettre linfraction de violation du secret
professionnel.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
134
Si le mdecin refuse de rpondre la rquisition, il ne commet pas linfraction de sabstenir de rpondre dans
les meilleurs dlais aux rquisitions.
Le praticien a donc le droit en conscience daccepter ou de refuser de rpondre des rquisitions judiciaires.
Nanmoins, un refus oppos par le mdecin lexpose une perquisition qui aura lieu sans son consentement.
Le Procureur de la Rpublique peut galement ouvrir une information en saisissant un juge dinstruction. Cette
procdure est lourde et enlve au Procureur de la Rpublique les suites de lenqute.
Rle de lhpital
ladministrateur de garde, sil en a la possibilit, doit demander la carte professionnelle de la personne qui
sollicite le dossier mdical.
le mdecin requis doit en informer la direction de lhpital dans les meilleurs dlais.
Une copie des pices ou du dossier mdical dans son entier doit tre systmatiquement effectue et
conserve au sein du service dorigine.
Cette copie servira notamment en cas de sollicitation par le patient des informations mdicales le concernant.
Elle est galement essentielle la dfense des intrts de lAP-HP et des praticiens, pour le cas dune mise
en cause pnale ultrieure.
Dlivrance du dossier mdical au cours dune perquisition
saisie
Dfinitions
La perquisition est un droit donn lautorit judiciaire (et/ou aux forces de police ou de gendarmerie) de
rechercher au sein de lhpital les lments de preuve de la commission dune infraction et notamment, le
dossier mdical.
La saisie est un acte par lequel lautorit judiciaire (et/ou les forces de police ou de gendarmerie) place sous
main de justice des objets (dont le dossier mdical) trouvs au cours de la perquisition, en dresse inventaire et
y appose un scell.
Le plus souvent, ce type dinvestigations a lieu dans le cadre dune instruction.
Rappel : la perquisition est effectue sous la direction dun magistrat, ou dun juge dinstruction ou, sur
commission rogatoire dlivre par ce dernier par un officier de police judiciaire (OPJ).
Un procs verbal est dress par lOPJ. Il nest pas dlivr copie de ce document.
Conditions de la perquisition et de la saisie
Quatre conditions sont prvues :
Les perquisitions dans le cabinet dun mdecin () sont effectues par un magistrat et en prsence de la
personne responsable de lordre ou de lorganisation professionnelle laquelle appartient lintress ou de
son reprsentant (article 56-3 du code de procdure pnale).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
135
la prsence dun magistrat :
Le magistrat doit en principe tre personnellement prsent et se dplaant lhpital. Mais il peut galement
dlguer ses pouvoirs un OPJ par le biais dune commission rogatoire. Dans ce cas, lOPJ reprsente le
magistrat et dispose de lensemble de ses prrogatives.
la prsence dun reprsentant de lordre national des mdecins :
Cette prsence est ncessaire pour assurer le respect du secret mdical, et viter la consultation de
documents mdicaux concernant des patients non concerns par la procdure.
la prsence du mdecin concern (art. 57 et 96 du code de procdure pnale) :
En principe, le praticien hospitalier ou le chef de service ou le responsable de ple concern doit tre prsent
lors de la perquisition.
A titre subsidiaire et en cas dabsence du mdecin dpositaire du dossier mdical sollicit, la perquisition et la
saisie ne peuvent avoir lieu que si deux personnes dsignes en qualit de tmoins sont prsentes.
Laccord du mdecin concern par lopration
Dans le cadre de lenqute prliminaire, la perquisition saisie ne peut avoir lieu quavec lassentiment du
mdecin concern (sauf dcision du juge des liberts et de la dtention).
Dans les autres procdures (enqute de flagrance et instruction), cet assentiment nest pas requis.
Rle de lhpital
Ladministrateur de garde, sil en a la possibilit, doit demander la carte professionnelle de la personne qui
sollicite le dossier mdical.
le mdecin concern doit informer la direction de lhpital de la perquisition-saisie dans les meilleurs dlais ;
la direction de lhpital concern est tenue dinformer la DAJDP par tlcopie confirme par courrier (fax :
01.40.27.38.27).
Une copie des pices ou du dossier mdical dans son entier doit tre systmatiquement effectue et
conserve au sein du service dorigine.
Cette copie servira notamment en cas de sollicitation par le patient des informations mdicales le concernant.
Elle est galement essentielle la dfense des intrts de lAP-HP et des praticiens en cas de mise en cause
pnale ventuelle.
Larticle 96 du code de procdure pnale prvoit la prsence de deux tmoins. Il est recommand que ce soit
un reprsentant de ladministration hospitalire et un mdecin du service concern.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
136
Rquisitions. Cas particuliers
La rquisition porte frquemment sur le point de savoir si telle personne a t hospitalise dans
ltablissement telle date :
Il sagit dun renseignement purement administratif qui peut tre donn aux services demandeurs.
Sauf urgence, il est souhaitable dentrer en contact immdiatement avec la Direction des affaires juridiques et
des droits du patient - DAJDP - (tl. : 01 40 27 34 14).
La rquisition vise obtenir une liste gnrale et indtermine de personnes hospitalises une
date dtermine :
Ces renseignements peuvent tre donns aux services requrants. Cependant, la gnralit des termes
(termes trop vagues) de la demande comme les lments identifiants requis (ge, couleur de peau,
donnes morphologiques, nature de la pathologie) peuvent conduire faire prciser la rquisition ou, en
cas de motif lgitime tabli, sy opposer.
Dans toute la mesure du possible, il est souhaitable de prendre contact avec la DAJDP.
A partir dune affection donne, la rquisition vise obtenir lidentit dune personne hospitalise :
Cest certainement l lhypothse la plus dlicate.
Il est conseill de varier la rponse selon que la personne recherche est la victime ou lauteur prsum de
linfraction. Si elle est victime, il est prfrable de rpondre, car cela va dans le sens de ses intrts. Si elle
est encore prsente dans lhpital et si cela est possible, son accord sera au pralable sollicit.
La gravit de linfraction commise, sur laquelle il convient dinterroger les fonctionnaires de police peut tre
un autre lment dapprciation, sans oublier que la loi prvoit la dnonciation des crimes et des dlits
certaines conditions. Et sans oublier que larticle 175 du rglement intrieur type de lAP-HP relatif la mort
suspecte dispose que en cas de signes ou dindices de mort violente ou suspecte dun patient hospitalis,
le directeur de lhpital (du groupe hospitalier), prvenu par le mdecin responsable de la structure mdicale
concerne, doit aviser immdiatement lautorit judiciaire .
La rquisition porte sur un renseignement dordre mdical, telle la description des blessures dune
personne hospitalise :
Suivant la nature de lenqute, la rponse apporter varie (voir ci-dessus).
Rfrences
Articles 56 59, 60-1, 76, 77-1-1, 81, 94, 96, 99-3 du code de procdure pnale
Article 72 du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
137
37 Laudition de patients majeurs
Pour aller lessentiel
Les officiers ou agents de police judiciaire sur dlgation ne peuvent se voir opposer de refus l'audition
d'une personne hospitalise, hormis pour des raisons mdicales lies l'tat de sant du patient.
Le directeur de l'hpital (ou ladministrateur de garde) doit tre inform de toute audition. Les enquteurs
sont galement tenus de produire une pice justificative l'appui de leur dmarche et dinformer les mdecins
du service d'une telle audition.
Trois situations peuvent se prsenter :
1. Dans le cadre d'une enqute prliminaire (art. 75 et suivants du code de procdure pnale) :
Lorsque les officiers de police judiciaire souhaitent procder l'audition d'un patient au stade de l'enqute
prliminaire, ils doivent s'assurer auprs de l'administration de l'accord de celui-ci. La direction de l'hpital n'a
pas donner son autorisation. Seule la volont du patient ou l'avis du chef de service sur un tat de sant
incompatible avec l'audition permettent ou non la police judiciaire de procder l'audition.
2. Dans le cadre d'un flagrant dlit (art. 53 et suivants du code de procdure pnale) :
L'audition des patients n'est soumise aucune autorisation ni accord pralable.
S'il est de rgle que le directeur d'hpital (ou ladministrateur de garde) soit prvenu par la police de
l'accomplissement de ces actes au sein de lhpital, il ne peut cependant s'y opposer, ni d'ailleurs le chef du
service o est hospitalis le patient, sauf dans le cas d'un tat de sant incompatible avec laudition.
3. Dans le cadre d'une commission rogatoire (articles 81 et 151 155 du code de procdure pnale)
Les officiers de police judiciaire peuvent sans aucun obstacle, entendre les personnels hospitaliers et les
patients et procder au sein de l'hpital des perquisitions ou saisir des pices de dossiers mdicaux.
Il est possible pour l'administration ou pour le mdecin de demander lecture et de relever les rfrences de la
commission rogatoire :
nom du juge,
numro de la commission rogatoire,
nom de la personne contre laquelle l'information est diligente.
Les OPJ peuvent solliciter avant l'audition d'une personne hospitalise, l'avis du mdecin prsent dans le
service sans que cette demande constitue pour eux une obligation lgale.
Rfrences
articles 53 et suivants, 62 et suivants, 81 et 151 155 du code de procdure pnale,
articles 4 et 5 du dcret n 93-221 du 16 fvrier 1993 relatif aux rgles professionnelles des infirmires,
circulaire du 2 juin 1998 relative l'intervention des services de police dans un tablissement public de sant.
article 93 du rglement intrieur type de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
138
Lexique
Enqute prliminaire
Article 75 et suivants du code de procdure pnale
Enqute caractrise par labsence de pouvoir coercitif des forces de police. Le tmoin est libre de rpondre
ou non ces questions. Toute entre de la police judiciaire dans les locaux de lhpital en vue de lexcution
dune rquisition judiciaire est soumise laccord pralable, soit du directeur de lhpital (ou de
ladministrateur de garde), soit de la personne concerne par la demande dinformations.
Enqute de flagrance
Articles 53 et suivants du code de procdure pnale
L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Enqute caractrise
par les pouvoirs de coercition des officiers de police judiciaire. Les tmoins doivent dposer, nul obstacle ne
pouvant tre mis aux perquisitions et aux saisies.
Commission rogatoire
Articles 81, 151 155 du code de procdure pnale
Le juge d'instruction procde tous les actes utiles la manifestation de la vrit. Ne pouvant accomplir seul
ces actes, le juge d'instruction dlivre des commissions rogatoires aux officiers de police judiciaire afin de
leur permettre de procder ces actes.
Les officiers de police judiciaire agissant sur dlgation du magistrat instructeur disposent de pouvoirs
coercitifs. Ils peuvent ainsi se transporter en tout lieu, procder toutes auditions.
Audition
Fait pour un magistrat dentendre les personnes impliques dans une procdure judicaire : adversaires,
tmoins, experts, etc.
Tmoin
Personne qui expose la justice des faits dont elle a connaissance. Le tmoin doit se rendre aux
convocations qui lui sont adresses, et rpondre sans ambigut, ni omission volontaire aux questions
poses par le juge. Il doit indiquer si les faits ou les propos qu'il relate sont intervenus en sa prsence.
Dans le cas contraire, il doit prciser les conditions et les circonstances dans lesquelles il a
connaissance de faits. En cas de dposition mensongre, il s'expose des poursuites pnales pour
faux tmoignage.
Tmoin assist
Personne vise par une plainte, mise en cause ou poursuivie par le Parquet sur rquisitoire,
convoque et entendue par le juge d'instruction contre laquelle il existe de simples indices qui
rendent vraisemblable qu'elle a commis un crime ou un dlit, sans qu'elle soit mise en examen. Elle
a droit d'tre assiste par un avocat qui a accs au dossier de la procdure, et peut demander tre
confronte avec la ou les personnes qui la mettent en cause. Le tmoin assist ne peut tre plac
sous contrle judiciaire ou en dtention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou
de mise en accusation devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
139
Le juge d'instruction
Il est saisi des affaires pnales les plus complexes (crimes et dlits). Il dirige alors l'action de la police
judiciaire. Il peut dcider de mettre une personne en examen et sous contrle judiciaire. Il rassemble
les lments qu'il juge utiles la manifestation de la vrit, dirige les interrogatoires, confrontations et
auditions, et constitue le dossier qui sera soumis le cas chant au tribunal correctionnel ou la cour
d'assises
Mise en examen
Dcision du juge d'instruction de faire porter ses investigations sur une personne contre laquelle il
existe des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme
auteur ou comme complice, la ralisation d'un crime ou d'un dlit. A dfaut, la personne est
entendue comme tmoin assist.
La personne "mise en examen" a le droit un avocat qui peut prendre connaissance du dossier
constitu par le juge.
Elle peut galement demander au juge de procder tout acte lui paraissant ncessaire la
manifestation de la vrit : auditions, confrontations Le juge peut dcider une mesure de
contrle judiciaire ou saisir le juge des liberts et de la dtention s'il envisage une dtention
provisoire.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
140
38 Laudition dun patient mineur
Pour aller lessentiel.
Quel que soit le cadre juridique de laudition dune personne mineure au sein de lhpital, le personnel
mdical (chef de service ou autre mdecin) doit proposer de manire systmatique la prsence des titulaires
de lautorit parentale, sans toutefois imposer cette prsence.
Principes
Les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents de police judiciaire agissant sur dlgation, ne peuvent
en principe se voir opposer de refus laudition dune personne hospitalise et ce, quel que soit son
ge, sauf sil existe une contre indication mdicale nautorisant pas les officiers de police judiciaire
intervenir.
Le directeur de lhpital (ou ladministrateur de garde) doit tre inform de laudition envisage par les forces
de police. Les officiers de police judiciaire sont par consquent tenus de prsenter une pice justificative et
dinformer le mdecin responsable du service, ou dfaut, les mdecins du service concern dune telle
audition.
Applications
Diffrentes situations peuvent ainsi se prsenter :
Dans le cadre dune enqute prliminaire (art. 75 et suivants du code de procdure pnale), lorsque les
officiers de police judiciaire souhaitent procder laudition dun patient mineur, ils doivent au pralable
sassurer auprs de ladministration de lhpital de laccord de celui-ci.
Lorsque le mineur a donn son accord, il est alors entendu en qualit de tmoin. Il doit, autant que possible,
tre accompagn dun titulaire de lautorit parentale.
Dans le cadre dune enqute de flagrance (art. 53 et suivants du code de procdure pnale), le
mineur peut tre entendu sans que le directeur de lhpital de sant puisse sy opposer, lexception dun
tat de sant incompatible avec son audition.
Dans le cadre dune commission rogatoire (art. 81 du code de procdure pnale).
Avant toute audition, les OPJ peuvent solliciter lavis du mdecin prsent dans le service hospitalier sans que
cette demande constitue pour autant une obligation lgale. En principe, le patient est entendu, sans
aucun obstacle.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
141
39 La fouille de la chambre dun patient
Pour aller lessentiel
La chambre dhpital est considre comme un endroit privatif dans lequel on naccde quavec le
consentement du patient qui loccupe.
Ce principe ne peut faire obstacle ce quune inspection et une fouille de la chambre puisse tre effectue
pour les ncessits du service.
Principe
La chambre dhpital se dfinit aujourdhui, sur le fondement de plusieurs textes nationaux (notamment les
dispositions du code civil sur le respect de la vie prive) et europens, comme un lieu privatif.
Depuis 1986, elle est considre comme un lieu ayant qualit de domicile priv par la jurisprudence pnale
(arrt Chantal Nobel, Cour dappel de Paris, 17 mars 1986).
Larticle 8 de la Convention Europenne des Droits de lHomme reconnat que toute personne a droit au
respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de sa correspondance .
Larticle 136 du rglement intrieur type de lAP-HP nonce le respect de la personne et son intimit en ces
termes : les personnels et les visiteurs extrieurs doivent frapper avant dentrer dans la chambre du malade
et ny pntrer, dans toute la mesure du possible, quaprs y avoir t invits par lintress .
Par consquent, une intrusion dans la chambre dun patient ou une fouille de ses effets personnels contre sa
volont constitue en principe une infraction.
Le fait, par une personne dpositaire de l'autorit publique ou charge d'une mission de service public,
agissant dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de
tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gr de celui-ci hors les cas prvus par la loi est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (art. 432-8 du code pnal).
Exception
Larticle 33 du rglement intrieur souligne quen raison de circonstances exceptionnelles, le directeur (de
lhpital) peut (ainsi) faire procder, avec laccord et en prsence des intresss, louverture des vestiaires,
armoires individuelles... . En cas de pril grave et imminent pour le groupe hospitalier, pour son personnel
ou pour un ou plusieurs de ses usagers, le directeur peut en outre et mme dfaut de consentement des
intresss, faire procder en urgence linspection de certains locaux ... .
A lappui de ces textes, une intrusion dans la chambre dun patient pour effectuer une fouille peut
donc tre justifie par un danger rel encouru par le patient lui-mme.
Exemple : Lorsque le pronostic vital dun patient est en jeu, le personnel soignant peut fouiller sa
chambre la recherche dun quelconque indice qui permettrait dtablir un diagnostic prcis et pratiquer les
premiers soins.
Toutefois, laccord du patient est le plus souvent recommand. Le cas chant, une information prcise doit
lui tre transmise dans les meilleurs dlais.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
142
Rfrences
Article 9 du code civil,
Article 432-8 du code pnal
Articles 33 et 136 du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
143
40 Les sorties linsu du service : les fugues
Pour aller lessentiel
La fugue dun patient peut constituer une situation grave : la sortie du patient linsu du service est
susceptible de le mettre en situation de danger. Elle ncessite une prise en charge associant rapidit,
ractivit, transparence et tact.
La gestion de ces situations doit tre organise au sein de lhpital par une procdure prtablie.
La fugue doit faire intervenir selon le cas de nombreuses personnes : le personnel hospitalier, le
directeur, le personnel de scurit, les forces de police et la famille du fugueur.
La fugue dun patient est susceptible dengager la responsabilit de lhpital, et le cas chant de ses
agents.
Principes
Les personnes hospitalises bnficient comme toute autre personne (et sauf si elles sont mineures,
majeures sous tutelle, relevant dune hospitalisation psychiatrique sous contrainte, garde vue, prvenues
ou dtenues) de la libert individuelle daller et venir.
Dans un certain nombre de cas, la dcision du patient de sortir de lhpital prsente toutefois un danger quil
ne mesure pas forcment. Lhpital est tenu dans ces situations de le protger contre les consquences
possibles de cette dcision.
Les dispositions concernant les sorties linsu du service (ou fugues ) concernent principalement les
personnes qui ont t admises administrativement.
Lorsque la sortie dun patient linsu du service ( fugue ) est constate, lobjectif premier est bien entendu
de retrouver le patient pour assurer quil ne mette en danger ni sa sant, ni sa vie, ni encore celle dautrui.
Elle peut faire intervenir de nombreuses personnes : le personnel hospitalier, le directeur, le personnel de
scurit, les forces de police, la famille du fugueur
Le rle du service :
La premire dmarche de lquipe hospitalire doit tre dorganiser des recherches au sein du service, du
btiment, puis de lhpital dans son ensemble et de son environnement immdiat si les recherches demeurent
infructueuses.
Paralllement, le responsable du service doit tablir un rapport crit, relatant les circonstances de la
disparition du patient, les risques quil encourt du fait de cette sortie prmature. Ce rapport doit rendre
compte des diffrentes diligences qui ont t prises pour retrouver la personne sortie linsu du service.
Linformation du directeur :
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit tre systmatiquement tre averti de la fugue dun patient.
Le cas chant, sil le juge ncessaire, il lui appartient de prendre contact avec les autorits de police.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
144
Le personnel de scurit :
Le personnel de scurit doit tre tenu inform de la sortie du patient linsu du service et tre invit
participer aux recherches.
Linformation de la famille :
Si le directeur doit tre inform de lincident, il appartient en revanche au service (personnel soignant
infirmire ou aide-soignante) de prvenir la famille.
Linformation la famille est un lment primordial qui facilite les rapports et ventuellement de permettre des
recherches plus fructueuses.
Linformation consiste expliquer les circonstances de la disparition et, par un dialogue avec lentourage du
patient, tenter de comprendre o le patient a pu se rendre et favoriser ainsi les recherches. Il importe que
les recherches soient menes en transparence avec la famille et dans un rapport de collaboration, souvent
ncessaire dans ce type de situations.
Les autorits de police :
Linformation de la police est souvent indispensable, du moins lorsque la sortie prsente un danger manifeste,
pour le patient comme pour lordre public.
Lorsque le patient est majeur, la police prendra note de cette disparition par le biais dune main courante et
pourra se rendre sur place pour procder certaines investigations.
Lorsque le fugueur est un mineur, la procdure sera un peu diffrente : les autorits de police doivent en effet
mettre en uvre une procdure particulire. Lidentit du mineur disparu est notamment inscrite sur un
registre particulier et un avis de recherche est lanc, diffus auprs des autres services de police.
Les relations avec le Ple des Recherches Patients la DAJDP :
Il est ncessaire que lhpital fasse parvenir ce service situ au Sige un fax au n 01 40 27 19 87 pour
linformer de la fugue.
Responsabilit
La fugue dun patient est susceptible dentraner de graves consquences pour lhpital : sa responsabilit
administrative, voire pnale, peut tre engage de ce fait.
La responsabilit de ltablissement peut le cas chant tre mise en cause sur le fondement de la faute dans
lorganisation et le fonctionnement du service.
Lexistence dun dfaut de surveillance pourra tre invoque.
Le juge prendra en considration ltat du patient, la vigilance montre par lhpital et les mesures prventives
qui avaient t prises le cas chant.
La responsabilit pnale des agents pourrait par ailleurs tre retenue dans les cas de sorties linsu du
service sur le fondement de la non assistance personne en danger. Cette infraction pourrait notamment tre
reconnue dans lhypothse o le personnel se serait abstenu de mettre en uvre les mesures permettant de
secourir le patient. On notera cependant qu lheure actuelle, il ny a jamais eu de mise en cause de cet ordre
au sein des hpitaux de lAP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
145
La responsabilit disciplinaire des agents peut tre recherche par lAP-HP en cas de ngligence, imprudence
et non respect des procdures tablies par lhpital, notamment en labsence :
de rdaction dun procs verbal de sortie linsu du service,
de signalement au suprieur hirarchique,
et, plus gnralement, de prise dinitiative.
Hpital :
Structure mdicale :
PROCES VERBAL DE SORTIE A LINSU DU SERVICE
Je soussign(e), (prnom et nom de lagent)
atteste avoir constat le (jour) (heure) ...
La sortie de (nom du patient) . linsu du service.
Circonstances de la sortie : (lments permettant de lexpliquer ou de comprendre les motivations du
patient, date prsume de la sortie, lments permettant de faciliter une enqute ultrieure, descriptif
physique et vestimentaire du patient,)
Mesures prises : (appels tlphoniques, signalement, information des agents de scurit, recherche
au sein de lhpital,)
Fait .le..
Signature..
Ce procs verbal doit tre conserv au sein du dossier mdical du patient.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
146
Numros utiles :
Chef de la scurit de lhpital :
Procureur de la Rpublique :
Commissariat de police du .arrondissement :
Gendarmerie de..
Cas particuliers
Patient hospitalis sous contrainte pour troubles mentaux (hospitalisation doffice ou sur demande dun
tiers)
Ladministrateur de garde doit :
ordonner des recherches dans et aux abords immdiats de lhpital en donnant le signalement du patient,
pour une hospitalisation doffice (HO), informer le prfet, le cas chant par lintermdiaire de la DDASS,
informer sans dlai la famille du patient,
informer le Procureur de la Rpublique ou les forces de police en donnant le signalement du patient,
rdiger un procs-verbal de sortie linsu du service.
Numros utiles :
DDASS :
Prfet :
Rfrences
Articles R. 1112-56 et s. du code de la sant publique
Article 162 du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
147
41 Les sorties contre avis mdical
Pour aller lessentiel
A l'exception des patients mineurs et majeurs sous tutelle, des personnes hospitalises sous contrainte pour
troubles mentaux, des patients gards vue et des patients prvenus ou dtenus, les patients peuvent, sur leur
demande, quitter tout moment lhpital.
Toutefois, si le praticien hospitalier responsable de la structure mdicale estime que cette sortie est prmature et
prsente un danger pour leur sant, cette sortie doit tre effectue dans le respect des procdures suivantes :
- le patient doit signer une dcharge mentionnant sa volont de sortir contre avis mdical et sa connaissance des
risques ventuels ainsi encourus,
- en cas de refus de signer cette dcharge, un procs-verbal doit tre tabli et sign par deux tmoins. Il doit attester
de la bonne foi et de la qualit des explications des soignants,
- les modalits de la sortie doivent tre mentionnes dans le dossier mdical.
Recommandations
Le chef de service, sil estime que la sortie est prmature et prsente un danger pour le patient, doit
remplir une attestation, avant la sortie, tablissant que le patient a t inform des consquences de sa
dcision,
En cas de refus du patient de signer cette attestation, le directeur (ou ladministrateur de garde) ou tout
autre membre du personnel hospitalier doit dresser un procs-verbal de refus de soins, sign par deux
personnes et qui doit tre joint au dossier mdical,
un exemplaire de lattestation doit tre remis au patient, un autre adress son mdecin traitant, et un
dernier conserv dans le dossier mdical.
en cas de refus de soins exprim par le patient, la sortie est prononce par le directeur (ou ladministrateur
de garde).
Cas particuliers
Patient mineur
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit :
lorsque la sortie est demande par les titulaires de lautorit parentale et lorsque cette dcision risque
dentraner des consquences graves pour la sant du mineur, saisir le Procureur de la Rpublique afin de
faire ordonner toute mesure visant assurer la protection du mineur,
lorsque le mineur est mancip (ou lorsque les liens avec sa famille sont rompus et quil bnficie de la
CMU ce titre), appliquer les rgles susmentionnes (attestation + procs-verbal de refus de signature),
lorsque le mineur est pris en charge dans le cadre des dispositions de larticle L. 1111-5 du code de la sant
publique (secret gard vis--vis des titulaires de lautorit parentale, v. fiche n31 : le consentement du
patient mineur ), rappeler que le majeur accompagnant ne peut aucun cas signer lattestation ou une
dcharge pour la sortie du mineur. Dans ce cas, il est conseill par ailleurs de saisir lautorit judiciaire
(Procureur de la Rpublique ou son substitut), en expliquant le contexte bien particulier et viter que les
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
148
titulaires de lautorit parentale soient inutilement informs de la prise en charge du mineur au sein de
lhpital.
Patient majeur sous tutelle
Ladministrateur de garde doit, lorsque la demande du tuteur risque dentraner des consquences graves
pour la sant du majeur sous tutelle, saisir le juge des tutelles ou le Procureur de la Rpublique (ou son
substitut).
Adresse et n de tlphone du Procureur de la Rpublique :
Rfrences
Article L. 1111-4 du code de la sant publique,
Articles R. 1112-16, R. 1112-43 et R. 1112-62 du code de la sant publique
Article 161 du rglement intrieur de lAP-HP
Fiche n 32 Le refus de soins
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
149
Exemple dune attestation et dun PV de sortie contre avis mdical
Sortie contre avis mdical
ATTESTATION
Je soussign(e) M., Mme, Melle
..
demande ma sortie immdiate de
lhpital...
Jai t clairement inform(e) de lavis mdical contraire du mdecin chef de service cette sortie, ce
dernier lestimant prmature et prsentant un danger pour ma sant.
Fait .le..
Signature..
Une copie de cette attestation doit tre remise au patient, une autre transmise son mdecin traitant et loriginal doit tre
conserv au sein du dossier mdical du patient.
Sortie contre avis mdical
PROCES VERBAL
( conserver au dossier mdical)
Nous soussign(e)s, (prnoms et noms des agents), attestons que M., Mme,
Melle...........
.
a demand quitter lhpital le ..heures.
Il lui a t indiqu en notre prsence lavis mdical dfavorable du mdecin chef de service cette
sortie immdiate, ce dernier lestimant prmature et prsentant un danger pour sa sant.
(Indiquer ici les risques mdicaux encourus)
Fait , le.
Signatures des deux agents
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
150
42 Les sorties disciplinaires
Pour aller lessentiel
La sortie dun patient dment averti peut, hors les cas o son tat de sant linterdirait, tre prononce par
le directeur, aprs avis mdical, par mesure disciplinaire fonde sur le constat de dsordres persistants dont il
est la cause ou plus gnralement du manquement grave aux dispositions du rglement intrieur.
Dans ces circonstances, une proposition alternative de soins, le cas chant dans un autre hpital, doit en
principe tre faite au patient, afin dassurer la continuit des soins.
Recommandations
On procdera ainsi :
adresser des avertissements successifs au patient,
sassurer quil ny a pas de contre-indication mdicale,
prononcer la sortie pour motif disciplinaire uniquement en dernier recours,
remettre au patient un courrier prcisant les motifs disciplinaires de la sortie et en garder une copie au
dossier mdical,
faire intervenir le service de scurit si besoin,
faire intervenir les forces de police lorsque cela savre ncessaire (menaces pour la scurit des biens et
des personnes).
Lexprience montre que lintervention personnelle de ladministrateur de garde dans lunit de soins est
souvent dterminante pour grer ce type de situations, en lien avec lquipe hospitalire.
Numros utiles :
Chef de la scurit de lhpital :
Commissariat de police du .arrondissement :
Gendarmerie de..
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
151
43 La sortie du mineur
Pour aller lessentiel
Sauf dans les cas de drogation prvus par la loi, les titulaires de lautorit parentale doivent toujours tre
pralablement informs de la sortie prochaine du mineur.
Principes et recommandations
Il revient aux titulaires de lautorit parentale, ds ladmission le cas chant, dinformer la direction de l'hpital
que le mineur, selon le cas :
peut quitter seul lhpital,
doit lui tre confi,
ou peut tre confi une tierce personne.
Ces indications doivent tre mentionnes au dossier mdical.
Dans les deux derniers cas, une pice d'identit de la personne accompagnant le mineur ou un extrait de la
dcision de justice prcisant la personne laquelle est confi l'enfant doit tre exig.
La sortie des mineurs non accompagns exige une vigilance particulire de lquipe mdicale.
Il importe de veiller ce que seuls les enfants jugs capables de repartir par leurs propres moyens y soient
autoriss : la dcharge signe par les titulaires de l'autorit parentale ne dispense en aucune faon le
mdecin de contrler cette aptitude au regard du traitement dispens.
Le cas chant, le mineur devra tre retenu et les titulaires de l'autorit parentale contacts afin de venir
chercher le mineur.
Des drogations prvues aux articles L.1111-5 et L. 2212-7 du code de la sant publique ont pour
consquence lhospitalisation dun mineur sans lautorisation du ou des titulaires de lautorit parentale :
La sortie du mineur, dans ces situations spcifiques (IVG ou acte mdical pour lequel le mineur sest
expressment oppos la consultation du ou des titulaires de lautorit parentale afin de garder le secret sur
son tat de sant), se fera par consquent sans autorisation pralable des titulaires de lautorit parentale.
Les mineurs sont toutefois tenus de dsigner une personne majeure de leur choix. Celle-ci doit pouvoir
apporter aide et assistance au mineur dans toutes ses dmarches au cours de son hospitalisation. Bien que
non obligatoire, il parat important et ncessaire que le majeur rfrent puisse tre prsent lors de la sortie du
mineur hospitalis.
Rfrences
Articles R. 1112-57 et R. 1112-64 du code de la sant publique,
Articles 80 et 83 du rglement intrieur de lAP-HP,
voir Guide AP-HP, Lenfant, ladolescent lhpital (2002)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
152
44 Les sorties en cours de sjour
Pour aller lessentiel
Des autorisations de sortie peuvent tre dlivres :
soit titre provisoire pour la sortie administrative dun patient hospitalis,
soit dans le cadre de sorties organises par lhpital (sorties thrapeutiques ).
Sorties la demande du patient ou de sa famille
Concernant la rglementation des autorisations de sortie, il convient de se rfrer aux articles R.1112-56 et
suivants du code de la sant publique :
Les hospitaliss peuvent, compte tenu de la longueur de leur sjour et de leur tat de sant, bnficier
titre exceptionnel, de permission de sortie dune dure maximale de quarante-huit heures. Ces permissions de
sorties sont donnes, sur avis favorable du mdecin chef de service, par le directeur ..
La direction de lhpital doit tre dment informe au pralable et ainsi donner son autorisation, qui peut
tre dlivre soit titre gnral pour un sjour de longue dure (par ex. : Jautorise cette activit tous les
mercredis selon les modalits suivantes ), soit au cas par cas.
Sorties thrapeutiques
Les sorties thrapeutiques relvent de la prise en charge hospitalire : elles sont organises et effectues
sous la responsabilit de lhpital, et ceci mme dans le cas o des personnes bnvoles ou des parents
de patients y apportent leur contribution.
En application de ces dispositions, avant toute sortie organise par le directeur de lhpital, lavis mdical du
mdecin chef de service doit tre recueilli pour les patients hospitaliss concerns.
Lhpital est tenu dans ces circonstances une obligation de scurit. Sa responsabilit sera engage en
cas de dommage li un dfaut de surveillance, notamment par une insuffisance de personnel pour assurer
la scurit de lactivit.
Cependant, en cas de faute caractrise de la victime dans la survenance du dommage, lAP-HP peut voir sa
responsabilit attnue ou bien tre exonre de toute responsabilit.
En pratique, le service est tenu de mettre en place une surveillance adapte aux patients autoriss sortir. Il
sagit donc pour lquipe charge dorganiser ces sorties de dterminer les conditions optimales de
surveillance en fonction notamment de lventuelle vulnrabilit des patients, de leur degr dautonomie, du
niveau de formation du personnel soignant, etc.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
153
Cas des patients mineurs et majeurs sous tutelle
Pour ces sorties, lautorisation pralable dun titulaire de lautorit parentale ou du tuteur est requise
(Article R.1112-57 C. sant publ. : () les mineurs ne peuvent tre, pour les sorties en cours
dhospitalisation, confis quaux personnes exerant lautorit parentale ou aux tierces personnes
expressment autorises par elles ).
Cette autorisation peut tre sollicite au cas par cas, ou, si lactivit est rgulire, avoir un caractre gnral.
Elle doit permettre de vrifier que le patient est couvert par une assurance individuelle, garantissant sa
responsabilit civile personnelle (pour les dommages quil peut causer), dans le cadre par exemple dune
police multi-risques.
Rfrences
Articles R.1112-56 et suivants du code de la sant publique,
Article 139 du rglement intrieur de lAP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
154
45 Le refus de sortie du patient
Pour aller lessentiel
La sortie est une dcision administrative, prise par le directeur de lhpital sur avis mdical.
Lavis mdical doit indiquer que le patient ne justifie plus de prise en charge mdicale lhpital dans la
discipline donne, ce qui entrane la dcision de sortie. Sauf cas particulier, le patient est tenu de sy
conformer.
Les situations de refus de sortie ou de refus de transfert doivent tre gres avec souci du dialogue, mais
galement avec fermet.
Un patient ne peut demander la suspension (forcment provisoire) de son transfert avec une autre structure
que sur le fondement de son libre choix : Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son
tablissement de sant est un principe fondamental de la lgislation sanitaire (art. L. 1110-8, C. sant publ.),
et si manifestement na t trouve aucune solution de transfert acceptable.
Dans ces situations et pour mettre fin toute situation abusive, il convient, selon la situation, de
rappeler au patient que la prise en charge dans une structure mdicale sachve ds quelle nest plus
justifie mdicalement (art. R. 1112-58, C. sant publ.) ;
une requalification du sjour du patient est possible : requalification en sjour de pure convenance
personnelle, qui na pas lieu dtre pris en charge par lassurance maladie ; signalement de cette situation au
contrle mdical de lassurance maladie et facturation des frais de sjour dans leur intgralit au patient..
Dans le cas dun transfert, il doit, sauf impossibilit, tre propos au patient un tablissement de transfert
objectivement acceptable pour viter une situation anormale et forcment conflictuelle.
Dans tous les cas, les solutions judiciaires ou policires ne peuvent tre que tout fait exceptionnelles
(demande par voie de justice lexpulsion du patient refusant sa sortie et devenu en quelque sorte occupant
sans titre du domaine public).
Rfrences :
Article L. 1110-8 du code de la sant publique
Article R. 1112-58 du code de la sant publique
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
155
46 Les formalits de dcs
Pour aller lessentiel
laggravation de ltat du patient justifie de prvenir la famille, le cas chant par un avis daggravation .
le dcs doit tre mdicalement constat. Le certificat de dcs doit ensuite tre apport pour dclaration
la mairie dans les 24 heures. Le dimanche et les jours fris ne sont pas pris en compte dans ce dlai.
Avis daggravation
Lorsque le dcs parat imminent, la famille et les proches doivent en tre informs dans les meilleurs
dlais et par tous moyens par un agent habilit de lhpital.
Le patient peut tre transport son domicile si lui-mme ou sa famille en expriment le dsir (transport
rsidence sans mise en bire, v. fiche n 51 : les transports de corps ). Sinon, il doit tre transport dans
une chambre individuelle de lunit de soins.
Avant le dcs, la famille et ses proches peuvent rester auprs de lui et lassister dans ses derniers instants.
Ils peuvent prendre leurs repas au sein de lhpital et y demeurer en dehors des heures de visite. La mise
disposition par lhpital dun lit daccompagnant ne donne pas lieu facturation. En revanche, les repas fournis par
lhpital sont la charge des personnes qui en bnficient.
Constat et information sur le dcs
Les dcs doivent tre constats conformment aux dispositions du code civil, par un mdecin de lhpital. Dans
tous les cas, ce constat doit tre tabli sur un certificat de dcs selon les formes requises au plan national.
Lorsque le dcs a t mdicalement constat, la famille et les proches doivent en tre informs dans les
meilleurs dlais et par tous moyens par un agent habilit de lhpital.
Attention !
Les internes, praticiens en formation, ne peuvent pas en principe signer les certificats de dcs (tant quils ne
sont pas docteurs en mdecine).
Toutefois, s'il arrive, l'hpital, que cette tche leur soit confie un interne, c'est avec l'autorisation et sous
la responsabilit du mdecin chef de service dont ils relvent.
La notification du dcs est faite :
pour les trangers dont la famille ne rside pas en France, au consulat le plus proche ;
pour les militaires, lautorit militaire comptente ;
pour les mineurs relevant dun service dpartemental daide sociale lenfance (ASE), au prsident du conseil
gnral en charge de ce service ;
pour les mineurs relevant des dispositions relatives la protection de lenfance et de ladolescence en danger, au
directeur de lhpital dont relve le mineur ou la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel ou
laquelle a t confi le mineur ;
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
156
pour les personnes places sous sauvegarde de justice la famille et, le cas chant, au mandataire spcial ;
pour les personnes places sous tutelle ou curatelle, au tuteur ou au curateur ;
pour les personnes non identifies, aux services de police.
Ds que le dcs est constat, le personnel infirmier de lunit de soins doit :
procder la toilette du patient dcd avec toutes les prcautions convenables;
dresser linventaire de tous les objets, vtements, bijoux, sommes dargent, papiers, clefs, etc., que possdait le
patient dcd,
rdiger un bulletin didentit du corps;
apposer sur le corps un bracelet didentification.
Le mdecin qui a constat le dcs doit remplir :
une fiche didentification destine la direction de lhpital et comportant la date et lheure du dcs, la
signature et la qualit du signataire ainsi que la mention le dcs parat rel et constant ,
un certificat de dcs dans les formes rglementaires, qui doit tre transmis la mairie.
Lagent du bureau de ltat civil de lhpital doit annoter, pour sa part :
le registre des dcs de lhpital (groupe hospitalier),
le registre de suivi des corps,
la mairie du lieu du dcs (dans les 24 heures), le registre denregistrement des dcs de la commune.
La dclaration du dcs
La dclaration du dcs, par transmission du certificat de dcs, doit tre effectue dans un dlai de 24 heures auprs
de lofficier dtat civil de la commune o le dcs a eu lieu. Le dimanche et les jours fris ne sont pas pris en compte
dans ce dlai.
Cas du patient non identifi (v. aussi fiche n14 : ladmission du patient sans identit )
Dans ces situations, il doit tre procd dans les dlais ordinaires la dclaration de dcs. Le certificat de
dcs doit tre rempli avec la mention patient non identifi . Ce certificat doit tre accompagn dun
rapport donnant des indications dcrivant la personne (ge approximatif, poids, taille, couleur de cheveux,
description du corps et des vtements.), ainsi que les circonstances ou les particularits qui ont entour son
dcs et qui sont susceptibles de faciliter ultrieurement son identification.
Lhpital doit conserver les documents quil a en sa possession et les joindre au certificat de dcs.
Les objets ou vtements ports par le patient doivent tre conservs et laisss la disposition de la police.
Lhpital est galement tenu de prvenir lautorit judiciaire (en pratique : le commissariat de police) qui
procdera aux recherches et au signalement ncessaires.
Il est possible dindiquer un obstacle mdico-lgal lors de la rdaction du certificat mdical.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
157
Rfrences
Article 80 du code civil,
Articles R. 1112-71 et R. 1112-72 du code de la sant publique,
Articles 172 et suivants du rglement intrieur de lAP-HP.
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
158
47 Le dcs par mort violente ou suspecte
Pour aller lessentiel
Lorsque lexamen du corps de la personne dcde semble rvler des signes de mort violente ou
suspecte, le mdecin est tenu de cocher la case obstacle mdico-lgal du certificat de dcs. La direction
de lhpital doit paralllement aviser sans dlai le commissariat de police (ou le Procureur de la Rpublique)
de lventualit dun problme mdico-lgal.
Principes
En cas de signes ou dindices de mort violente ou suspecte dun patient, ladministrateur de garde doit en
informer lautorit judiciaire (commissariat de police, Procureur de la Rpublique).
Dans ces circonstances, linhumation du corps ne pourra avoir lieu quaprs enqute mdico-lgale
linitiative des autorits judiciaires (investigations mene par un officier de police judiciaire, expertise mdico-
lgale mene par un mdecin lgiste,).
Le certificat de dcs doit mentionner quil existe un obstacle mdico-lgal qui suspendra les
oprations funraires jusqu la dcision de leve de cette suspension par les autorits judiciaires.
Ladministrateur de garde doit donc tre inform par les services concerns de lhpital, dans les meilleurs
dlais, et doit saisir le procureur de la Rpublique. Il doit veiller galement ce que le corps soit plac sous
surveillance jusqu larrive des forces de police. Il convient de prserver les lieux du dcs lorsque celui-ci
sest droul lhpital.
Rfrences
Article R.1112-73 du code de la sant publique,
Article 81 du code civil,
Article 40 du code de procdure pnale,
Article 175 du rglement intrieur de lAP-HP
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
159
48 En cas de suicide
Recommandations
En cas de suicide dun patient, il convient de :
constater le dcs du patient,
saisir lautorit judiciaire (le commissariat de police), qui procdera une enqute,
ne pas toucher ou dplacer le corps,
prserver les lieux du suicide,
organiser linformation de la famille du patient, en lien avec le chef de service,
faire tablir par le mdecin un rapport dtaill sur ltat de sant du patient, les conditions de sa prise en
charge (mesures particulires de surveillance notamment), les circonstances prcises du suicide (lieu, heure,
position du corps, moyens utiliss, tmoins ventuels), et les premiers gestes de secours ventuellement
effectus.
Le corps ne peut faire lobjet dans limmdiat dune autorisation de transport avant mise en bire.
Attention !
Dans certains cas (dtenus, patients atteints de troubles mentaux, mineur), la responsabilit de lhpital
pourra tre retenue, notamment si les mesures de surveillance qui simposaient au regard de la situation du
patient navaient pas t mises en uvre.
Ceci justifie une grande prcision dans la rdaction du rapport qui doit tre tabli par lhpital.
Conduite tenir devant les intentions et actes caractre suicidaire
dun patient
La menace exprime par un patient dactes suicidaires, ou la mise en uvre de tels actes, ncessite la mise
en uvre de sa protection et de soins. Ainsi :
Si un patient prsente des intentions suicidaires, lquipe hospitalire ne peut demeurer inactive ;
Un examen mdical ou le cas chant une consultation en psychiatrie doit lui tre propose, autant que
possible, afin quil reoive une prise en charge adapte ;
Si le patient persiste dans son attitude suicidaire et refuse les offres de soins proposes, une hospitalisation
doffice (v. fiche n 22 : lhospitalisation doffice ) peut dans certains cas tre envisage pour le protger
contre ses actes.
En effet, au terme de larticle L. 3213-1 du code de la sant publique, sont susceptibles de faire lobjet dune
hospitalisation doffice () les personnes dont les troubles mentaux ncessitent des soins et compromettent
la sret des personnes ou portent atteinte, de faon grave, lordre public .
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
160
Il est considr par la jurisprudence que lhospitalisation doffice peut tre prononce au motif que le patient
est susceptible de se porter atteinte lui-mme.
Tout est cas despce (il faut faire la part des attitudes de dtresse et de provocation) et les initiatives prises
doivent ltre autant que possible de faon proportionne au danger rellement encouru par le patient, de son
fait.
Rfrences
Circulaire n 1029 du 11 mai 1978 relative aux accidents ou incidents survenus dans les tablissements sanitaires et
sociaux
Voir fiche n 47 : Le dcs par mort violente ou suspecte
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
161
49 Le dcs prinatal
Pour aller lessentiel
Bien distinguer, car des dispositions diffrentes sappliquent selon le cas en matire dtat civil et dobsques :
les enfants ns vivants et viables
les enfants ns vivants, mais non viables et les enfants morts-ns compter de 22 semaines
damnorrhe ou pesant plus de 500 gr.
les enfants ns morts avant 22 semaines damnorrhe ou pesant moins de 500 gr.
La mort prinatale recouvre diffrentes situations :
soit lenfant dcde aprs la dclaration de sa naissance ltat civil.
Lenfant a un acte de naissance et un acte de dcs.
Le dcs doit tre dclar lofficier de ltat civil de la mairie du lieu du dcs, dans un dlai de 24 heures
selon les rgles de droit commun.
Le dcs doit tre mentionn sur le registre de lhpital et sur celui de ltat civil.
Linhumation ou la crmation du corps est obligatoire et seffectue la charge de la famille, selon les
prescriptions fixes par la lgislation funraire.
soit lenfant, dcd avant sa dclaration de naissance ltat civil, est n vivant et viable.
Un acte de naissance et un acte de dcs peuvent tre tablis par lofficier dtat civil, sur production dun
certificat mdical indiquant que lenfant est n vivant et viable et prcisant les jours et heures de sa naissance
et de son dcs.
Le dcs est mentionn sur le registre de lhpital et sur celui de ltat civil.
Linhumation ou la crmation du corps est obligatoire, selon les mmes modalits que dans le cas prcdent.
soit lenfant est n vivant, mais non viable ou lenfant est mort-n aprs un terme de vingt-deux
semaines damnorrhe ou en ayant un poids dau moins cinq cents grammes
Un acte denfant sans vie est dress. Cet acte est galement tabli lorsque fait dfaut, dans lhypothse
prcdente, le certificat mdical attestant que lenfant est n vivant et viable.
Lacte denfant sans vie est inscrit sa date sur les registres de dcs et il nonce les jour, heure et lieu de
laccouchement, les prnoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des pre et
mre, et sil y a lieu, ceux du dclarant. Il ne prjuge pas de savoir si lenfant a vcu ou non ; tout intress
peut saisir le tribunal de grande instance leffet de statuer sur la question.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
162
Lindication denfant sans vie peut, la demande des parents, tre appose par lofficier de ltat civil qui a
tabli lacte sur le livret de famille quils dtiennent.
La famille peut faire procder, sa charge, linhumation ou la crmation du corps. Sinon, en cas
dabsence de prise en charge par la famille, le corps est soit inhum si lhpital, en accord avec les communes
concernes, a pris des dispositions spcifiques en ce sens, soit incinr dans un crmatorium la charge de
lhpital selon les dispositions applicables llimination des dchets dactivit de soins et assimils et aux
pices anatomiques.
soit lenfant (= le ftus) est n mort un terme infrieur vingt-deux semaines damnorrhe ou
pse moins de cinq cents grammes
Aucun acte dtat civil nest dress pour lenfant.
Cet enfant nest pas inscrit sur le registre des dcs de lhpital.
Le corps fait en principe lobjet dune crmation la charge de lhpital. Nanmoins, certaines communes
acceptent daccueillir ces corps dans leurs cimetires.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit :
- identifier prcisment lhypothse de mort prinatale concerne ;
- dfinir en consquence le rgime juridique applicable ;
- veiller linformation de la famille sur les diffrentes possibilits de prise en charge du corps.
Dans tous les cas, lorsque, dans un dlai de dix jours au maximum suivant le dcs, le corps na pas t rclam par
la famille, lhpital doit faire procder son inhumation ou sa crmation.
Quelle que soit la dcision prise par la famille en matire de prise en charge du corps, le personnel hospitalier doit
veiller proposer, sans imposer, un accompagnement facilitant le travail de deuil.
Recommandations
En cas de problmes ou de difficults, solliciter une rencontre et/ou un entretien avec les parents afin de les
informer sur les dmarches administratives accomplir et leurs consquences.
Lorsque lenfant n vivant et viable est dcd avant sa dclaration de naissance, rappeler au mdecin la
ncessit de faire figurer ces deux mentions sur le certificat mdical.
Rfrences
Articles 78 et suivants du code civil
Articles L. 2223-19 et s. et R. 2213-2 et s. du code gnral des collectivits territoriales
Article R. 1112-70 et s. du code de la sant publique
Articles 171 et 181du rglement intrieur de lAP-HP
Circulaire DGS n 50 du 22 juillet 1993 relative la dclaration des nouveau-ns dcds ltat civil
Circulaire DHOS/E4/DGS/DACS/DGCL n 2001-576 du 30 novembre 2001 relative lenregistrement ltat civil et
la prise en charge des corps des enfants dcds avant la dclaration de naissance.
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
163
50 Le dpt du corps en chambre mortuaire
Pour aller lessentiel
Les corps doivent tre dposs la chambre mortuaire au plus tard dans les 10 heures qui suivent le
dcs.
Il convient de bien distinguer les notions de chambre mortuaire (local hospitalier o sont dposs les corps
des personnes dcdes) et de chambre funraire (local dun oprateur funraire extrieur lhpital o
sont dposs les corps des personnes dcdes, lhpital ou ailleurs).
Principes
Le corps dun patient dcd doit tre dpos la chambre mortuaire (lorsque lhpital est tenu den disposer)
dans un dlai maximum de 10 heures compter du dcs et pour une dure maximale de 10 jours.
Aprs ralisation de linventaire des biens, le corps doit tre dpos, avant tout transfert, la chambre mortuaire (sauf
cas de transport immdiat rsidence, sans mise en bire). Il ne peut tre alors transfr hors de lhpital que dans
les conditions relatives la mise en bire (transport avant et aprs mise en bire) et avec les autorisations prvues
par la loi.
Au cas o les circonstances le permettent, la famille peut demeurer auprs du dfunt dans la chambre mortuaire.
Dans toute la mesure du possible, cet accs doit tre organis dans un lieu spcialement prpar cet effet et
conforme aux exigences de discrtion et de recueillement.
Avant toute prsentation, les agents de lhpital doivent prendre en compte, dans toute la mesure du possible, et,
aprs sen tre enquis auprs des familles, les souhaits que leurs membres expriment sur les pratiques religieuses
quils dsirent pour la prsentation du corps ou la mise en bire.
Le dpt et le sjour la chambre mortuaire de lhpital du corps dune personne qui y est dcde sont gratuits
(disposition propre lAP-HP).
Le fonctionnement de la chambre mortuaire est organis par un rglement intrieur spcifique qui doit tre affich
dans ses locaux, la vue du public.
Rfrences
Articles L. 2223-39 du code gnral des collectivits territoriales,
Articles R. 2223-89 R. 2223-98 du code gnral des collectivits territoriales,
Circulaire n99-18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des tablissements publics de sant,
Article 176 du rglement intrieur de lAP-HP
Guide AP-HP Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
164
Rglement intrieur type des chambres mortuaires de lAP-HP
( remplacer par le rglement intrieur local de la chambre mortuaire de lhpital)
Article 1 : Le prsent rglement intrieur nonce les rgles de fonctionnement de la chambre mortuaire de lhpital (du groupe
hospitalier)
Il simpose lensemble des personnels de lAssistance publique hpitaux de Paris, aux familles et proches des personnes
dcdes ainsi qu tous les tiers qui, pour une raison professionnelle ou pour tout autre motif, sont autoriss pntrer dans les
locaux de la chambre mortuaire.
Article 2 : La chambre mortuaire est un quipement du service public hospitalier.
Elle est destine au dpt des corps des personnes dcdes au sein de lhpital (du groupe hospitalier)..(le cas
chant, pour les hpitaux concerns : ainsi quau dpt des corps des enfants pouvant tre dclars sans vie ltat civil). Elle
doit permettre la prsentation des corps aux familles et leur laisser le temps ncessaire lorganisation des obsques.
Les personnes ayant qualit pour pourvoir aux funrailles disposent dun dlai de dix jours pour rclamer le corps de la
personne dcde dans lhpital (le groupe hospitalier).
(Le cas chant, pour les hpitaux et groupes hospitaliers concerns : la mre ou le pre dispose, compter de
laccouchement, du mme dlai pour rclamer le corps de lenfant pouvant tre dclar sans vie ltat civil).
Dans le cas o le corps du dfunt (le cas chant pour les hpitaux et groupes hospitaliers concerns : ou de lenfant
pouvant tre dclar sans vie ltat civil) est rclam, il est remis sans dlai aux personnes ayant qualit pour
pourvoir aux funrailles.
En cas dabsence de rclamation du corps dans le dlai de dix jours, lhpital (le groupe hospitalier) dispose de deux
jours francs :
- pour faire procder linhumation du dfunt dans des conditions financires compatibles avec lavoir laiss par ce
dernier. En labsence de ressources suffisantes, la prise en charge des obsques sera sollicite auprs de la
commune. Sil sagit dun militaire, linhumation du corps seffectue en accord avec lautorit militaire comptente ;
- (le cas chant, pour les hpitaux et groupes hospitaliers concerns) pour prendre les mesures en vue de procder,
sa charge, la crmation du corps de lenfant pouvant tre dclar sans vie ltat civil ou, lorsquune convention avec
la commune le prvoit, en vue de son inhumation par celle-ci.
Article 3 : Les corps des patients dcds au sein de lhpital (du groupe hospitalier) .......doivent dans tous les cas tre
transports soit dans la chambre mortuaire de lhpital (du groupe hospitalier) ......, soit titre exceptionnel dans la chambre
mortuaire dun autre hpital de lAP-HP.
(Le cas chant, pour les hpitaux concerns : il en est de mme pour les corps des enfants pouvant tre dclars sans vie
ltat civil). Ladmission dans la chambre mortuaire est effectue aprs signature du certificat de dcs par un mdecin dun
service de soins
Article 4 : Les corps des patients dcds au sein de lhpital (du groupe hospitalier) (le cas chant, pour les hpitaux
concerns : et les corps des enfants pouvant tre dclars sans vie ltat civil) doivent tre transports la chambre mortuaire
pourvus dun bracelet et dune fiche didentification.
(Dans les hpitaux lis par convention un hpital ne disposant pas de chambre mortuaire : Des corps de patients dcds (le
cas chant, pour les hpitaux concerns : ou denfants dclars sans vie ltat civil) au sein de lhpital (ou du groupe
hospitalier) (prciser le nom de lhpital ou du groupe hospitalier) peuvent tre dposs la chambre mortuaire, pourvus des
mmes documents didentification.
Le transport de ces corps la chambre mortuaire doit avoir t autoris au pralable par le maire de la commune de dcs ;
Paris, par le prfet de police).
Un certificat mdical tabli par le mdecin du service o le dfunt tait soign doit tre remis au mdecin chef du service
danatomie pathologique ou la personne quil habilite au sein de son service.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
165
Ce certificat prcise si le dcs a t caus par une maladie contagieuse ou sil pose un problme mdico-lgal. Il indique
galement si ltat du corps permet un transport de corps rsidence et sil est ou non porteur dune prothse faisant obstacle
une ventuelle incinration.
Les soins de conservation du corps prvus par les articles R. 2213-2 du code gnral des collectivits territoriales ne
peuvent tre raliss dans la chambre mortuaire sans une autorisation dlivre par le maire de la commune (pour les
hpitaux situs Paris, par le Prfet de police).
Les corps de personnes dcdes lextrieur de lhpital (du groupe hospitalier) peuvent tre dposs au sein de la
chambre mortuaire, titre exceptionnel et uniquement sur rquisition des autorits administratives ou de police.
Article 5 : Des prlvements fins scientifiques (et notamment des autopsies) peuvent tre raliss dans la chambre mortuaire,
dans les conditions prvues par les articles L. 1232-1 L. 1232-6 du code de la sant publique.
Ces prlvements sont pratiqus, la demande crite et motive dun mdecin dune unit de soins, sur le fondement dun
formulaire de demande. Ces prlvements sont raliss sous la responsabilit du chef du service danatomie pathologique de
lhpital (du groupe hospitalier)
Ce dernier en assure le contrle ainsi que la bonne excution par les mdecins de son service qui en ont la charge, assists le
cas chant des agents de la chambre mortuaire quil dsigne.
Aucun prlvement des fins thrapeutiques ne peut tre effectu dans la salle de prparation des corps de la chambre
mortuaire.
(le cas chant, pour les hpitaux et groupes hospitaliers concerns) Lorsque des prlvements sont raliss sur le
corps dun enfant pouvant tre dclar sans vie ltat civil, les dlais de dix jours et de deux jours francs viss
larticle 2 du prsent rglement sont prorogs de la dure ncessaire la ralisation de ces prlvements sans quils
puissent excder quatre semaines compter de laccouchement.
Article 6 : Des prlvements des fins scientifiques (et notamment des autopsies) peuvent tre effectus au sein de la chambre
mortuaire sur des personnes dcdes en dehors de lhpital (du groupe hospitalier)Ces prlvements peuvent tre effectus
la demande du prfet ou la demande dune personne qui a qualit pour pourvoir aux funrailles.
Le transport des corps, effectu avant mise en bire, doit dans ce cas avoir t autoris par le maire de la commune du lieu de
dcs ( Paris, par le prfet de police).
Les corps admis au sein de la chambre mortuaire dans ces conditions peuvent faire lobjet, la demande de toute personne qui
a qualit pour pourvoir aux funrailles, dun transport de corps avant mise en bire, soit vers une chambre funraire, soit vers la
rsidence du dfunt ou dun membre de sa famille. Ce transport de corps est subordonn lautorisation du directeur de lhpital
(du groupe hospitalier), aprs avis du mdecin ayant ralis les prlvements.
Ledit mdecin ne peut sopposer au transport de corps que pour lun des motifs suivants :
obstacle mdico-lgal,
corps atteint dune maladie contagieuse vise par larticle R. 2213-9 du code gnral des collectivits territoriales,
tat du corps ne permettant pas le transport.
Article 7 : Les agents de la chambre mortuaire sont chargs, sous lautorit du directeur de lhpital (du groupe hospitalier), des
activits mortuaires de lhpital et assurent ce titre laccueil des familles et la prsentation des corps, qui doivent tre effectus
avec toute lattention et la dignit requises.
Ils sont placs, pour lensemble des activits mdico-techniques de la chambre mortuaire, sous lautorit directe du chef de
service danatomie pathologique (prciser, au cas o lhpital ne dispose pas de service danatomie pathologique, le service de
rattachement : de lhpital) ou, le cas chant, du mdecin dlgu par ce dernier pour ces activits.
Article 8 (article concernant uniquement les hpitaux disposant de plusieurs agents de chambre mortuaire) : Un coordonnateur
de la chambre mortuaire est dsign par le directeur de lhpital, (du groupe hospitalier) aprs avis du chef du service danatomie
pathologique (prciser, au cas o lhpital ne dispose pas de service danatomie pathologique, le service de rattachement : de
lhpital), pour tre charg du fonctionnement courant des activits ralises au sein de la chambre mortuaire.
Cet agent est responsable, sous lautorit du directeur de lhpital (du groupe hospitalier), des modalits de laccueil des familles
et de la prsentation des corps. Il est charg de lencadrement des agents de la chambre mortuaire et est plac, pour la
ralisation de lensemble des activits mdico-techniques ralises dans la chambre mortuaire, sous lautorit directe du chef de
service danatomie pathologique ou le cas chant du mdecin dlgu par ce dernier pour ces activits.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
166
Article 9 : Sous rserve des dispositions des articles 10 et 11 du prsent rglement intrieur, aucune personne ne peut accder
la chambre mortuaire sans en avoir reu lautorisation expresse par le directeur de lhpital (du groupe hospitalier), de son
reprsentant dment habilit, ou du chef du service danatomie pathologique.
Laccs de la chambre mortuaire peut tre interdit toute personne dont la prsence ne serait pas motive par des ncessits
de service ou prvue par lapplication des dispositions lgales et rglementaires relatives lhygine, la scurit et les conditions
de travail, ou dont le comportement pourrait troubler lordre, la dcence ou la srnit des lieux.
Article 10 : Les familles ont accs la chambre mortuaire o se trouve leur dfunt, dans les conditions suivantes : ( complter :
jours douverture, horaires, rgles respecter afin de garantir un fonctionnement satisfaisant du service, conditions daccs en
dehors des heures douverture).
Avant toute prsentation, les agents de la chambre mortuaire prennent en compte, dans toute la mesure du possible, aprs sen
tre enquis auprs des familles, les souhaits que leurs membres expriment sagissant des rites qui doivent entourer la
prsentation du corps ou la mise en bire.
En cas dobstacle mdico-lgal, la prsentation des corps aux familles ne peut avoir lieu quen labsence dopposition de lautorit
judiciaire.
Article 11 : Les personnels des rgies, entreprises, associations et de leurs tablissements habilits ont accs la chambre
mortuaire, pour le dpt et le retrait des corps, la pratique des soins de conservation et la toilette mortuaire, lorsquils sont
mandats par une personne ayant qualit pour pourvoir aux funrailles, dans les conditions suivantes : ( complter le cas
chant) .....................................................................................................................................................................
Les responsables des dites rgies, entreprises, associations et de leurs tablissements organisent conjointement avec lagent
vis larticle 8 ci-dessus les modalits de leurs activits au sein de la chambre mortuaire, en tenant compte des ncessits et
contraintes du service.
Article 12 : La liste des rgies, entreprises, associations ou de leurs tablissements habilits doit tre affiche dans les locaux
daccueil de la chambre mortuaire.
Elle est tablie par le reprsentant de ltat dans le dpartement o est situe la chambre mortuaire. Elle est mise jour chaque
anne.
La liste doit comprendre le nom, ladresse complte et le numro de tlphone des oprateurs funraires habilits conformment
larticle L 2223-23 du code gnral des collectivits territoriales et installs dans la commune (ou selon le cas :
larrondissement ou le dpartement).
- (- dans la commune o se trouve la chambre mortuaire si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ;
- dans le cas contraire, la liste comprend les oprateurs funraires installs dans larrondissement si celui-ci
- compte 100 000 habitants ou plus ;
- dans le dpartement si larrondissement compte moins de 100 000 habitants.)
La liste des chambres funraires tablie par le prfet de dpartement doit galement tre affiche dans la chambre mortuaire,
dans les conditions prvues par larticle R. 2223-32 du code gnral des collectivits territoriales.
Article 13 : Aucun document de nature commerciale ne doit tre visible au sein de la chambre mortuaire, sous rserve des
dispositions de larticle 12.
Les agents de la chambre mortuaire ne peuvent en aucun cas recevoir, raison de leurs fonctions, de rmunration ou de
gratification de la part des familles, des oprateurs funraires, des fleuristes, des thanatopracteurs et dune manire gnrale de
tiers lAssistance Publique Hpitaux de Paris.
Article 14 : Le chef du service danatomie pathologique sassure, en liaison avec le directeur de lhpital (du groupe hospitalier),
que toutes les prcautions dhygine et de scurit sont respectes dans la ralisation des prlvements.
Il prend notamment toutes les mesures ncessaires (selon le cas, obligation demploi de gants, ventuellement rsistants la
coupure, de lunettes de protections, de matriel jetable, ) pour assurer le respect au sein de la chambre mortuaire des
prcautions visant minimiser les risques de contamination par des maladies transmissibles.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
167
Article 15 : Le prsent rglement doit tre affich la vue du public dans les locaux de la chambre mortuaire destins laccueil
du public.
Il est dpos, dat et sign, ds son adoption, auprs du reprsentant de ltat dans le dpartement o est implante la chambre
mortuaire.
Fait , le
Le Directeur de lhpital (du groupe hospitalier)
Vu, le Chef du service danatomie pathologique
(le cas chant : de lhpital ou du groupe hospitalier)
(le cas chant, si lactivit mdico-technique est assure dans le cadre dune antenne dun service danatomie pathologique dun autre
hpital ou groupe hospitalier de lAP-HP) :
Vu, le Directeur de lhpital ou du groupe hospitalier
Le dpt du corps dun patient dcd au sein dun autre tablissement.
Elle est possible aux conditions suivantes :
en cas d'impossibilit pour l'hpital o est dcd le patient de conserver le corps (notamment en cas dabsence
de chambre mortuaire),
si lhpital dorigine fait son affaire (frais et responsabilit) du transport, de la reprise des corps, de la prise en
charge funraire...,
le cas chant, sur rquisition des autorits administratives ou judiciaires.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
168
51 Les transports de corps
Pour aller lessentiel.
Les transports de corps sont soumis une rglementation stricte et un rgime dautorisation.
Le maire de la commune du dcs (ou le Prfet de police Paris) peut autoriser le transport sans mise en
bire rsidence ou vers une chambre funraire, sil nexiste pas dopposition de lhpital (accord crit du
mdecin et du directeur) et que le transport rpond une demande dune personne ayant qualit pour pourvoir
aux funrailles.
Ce transport ne peut avoir lieu sil existe un problme mdico-lgal ou si le patient tait atteint dune maladie
contagieuse y faisant obstacle.
Laccord du directeur est toutefois suffisant lorsque le transport du corps en chambre mortuaire ncessite de
sortir de lenceinte de ltablissement. Laccord du chef de service est cependant ncessaire, les formalits
dtat civil devant avoir t effectues et le transport ralis dans un vhicule habilit.
Le transport de corps sans mise en bire ( visage dcouvert ) vers le domicile ou une chambre funraire
doit tre ralis dans un dlai de 24 heures compter du dcs. Ce dlai peut tre prolong jusqu 48 heures
si le corps a subi des soins de conservation.
Au-del de ce dlai, le transport ne peut avoir lieu quaprs fermeture du cercueil et donc quaprs mise en
bire.
Le transport de corps avant mise en bire
Rappel : Les corps doivent tre dposs la chambre mortuaire au plus tard dans les 10 heures qui suivent
le dcs.
Lorsque la chambre mortuaire se situe sur un autre site, mais dans la mme commune, le transport sans mise
en bire seffectue aprs accord du directeur dhpital (ou de ladministrateur de garde). Le maire de la
commune de destination ainsi que le responsable de la chambre mortuaire de lhpital de transfert
doivent par ailleurs obtenir copie de cet accord sans dlai.
Le chef de service de lhpital o a eu lieu le dcs doit donner son accord pralable (absence dobstacle
mdico-lgal, de maladie contagieuse, tat du corps satisfaisant) et les formalits de dclaration de dcs
doivent avoir t effectues.
Le transport avant mise en bire doit tre ralis dans les 24 heures qui suivent le dcs et dans les 48
heures si le corps a subi des soins de conservation.
Lorsque le Maire refuse de donner son accord, le corps est conserv en chambre mortuaire et ne pourra tre
transport quaprs mise en bire.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
169
Ce transport doit tre autoris par le Maire de la commune du lieu de dpt du corps.
Cette autorisation est subordonne :
la demande de toute personne qui a qualit pour pourvoir aux funrailles et justifie de son tat civil et de
son domicile ;
la reconnaissance pralable du corps par cette personne ;
l'accord crit du directeur (ou de ladministrateur de garde) ;
l'accord crit du mdecin chef de service ou de son reprsentant ;
l'accomplissement pralable des formalits du code civil relatives aux dclarations de dcs.
Lorsque le mdecin refuse le transport du corps, il doit motiver son refus : existence dun obstacle mdico-
lgal, tat du corps impropre au transport, maladie contagieuse relevant de larrt du 20 juillet 1998.
Le transport de corps au domicile du dfunt ou la rsidence dun membre de sa famille
Demand par une personne ayant qualit pour pourvoir aux funrailles, il est effectu partir de lhpital vers
le domicile du dfunt ou la rsidence dun membre de sa famille.
Le transport de corps en chambre funraire
Il doit intervenir au plus tard dans les 24 heures suivant le dcs et dans les 48 heures si le corps a subi des
soins de conservation.
Une demande dadmission en chambre funraire, comportant les nom, prnom, ge et domicile du dfunt, doit
tre effectue par crit :
soit par toute personne ayant qualit pour pourvoir aux funrailles et justifiant de son tat civil et de son
domicile,
soit par le directeur (ou ladministrateur de garde) de lhpital dans le cas o lhpital ne dispose pas de
chambre mortuaire ou a t dans limpossibilit de joindre, dans un dlai de 10 heures, une personne ayant
qualit pour pourvoir aux funrailles.
Ladmission en chambre funraire est soumise la production dun certificat mdical attestant exclusivement
que le dcs na pas t caus par une maladie contagieuse cite dans larrt du 20 juillet 1998 (v. encadr).
Les frais de transport et de sjour durant les trois premiers jours qui suivent ladmission sont la charge de
lhpital lorsque le transfert en chambre funraire a t opr la demande du directeur.
Les malades infectieuses vises par larrt du 20 juillet 1998
Cet arrt prvoit la liste des maladies infectieuses qui soppose au transport de corps sans mise en bire :
orthopoxviroses
cholra
peste
charbon
fivres hmorragiques virales
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
170
Le transport de corps aprs mise en bire
Avant son inhumation ou sa crmation, le corps d'une personne dcde doit obligatoirement tre mis en
bire.
Lautorisation de fermeture du cercueil doit avoir t dlivre par lofficier dtat civil de la commune du dcs.
Une mise en bire immdiate peut tre prescrite par lofficier dtat civil sur avis du mdecin et aprs
constatation officielle du dcs lorsque celui ci est survenu la suite dune maladie contagieuse ou
pidmique ou en cas de dcomposition rapide du corps.
Si la commune de destination se situe sur le territoire mtropolitain ou dans un DOM, lautorisation de
transport est donne par le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. Dans le cas contraire (en
dehors du territoire mtropolitain ou en dehors dun DOM), lautorisation est donne par le prfet du
dpartement o a eu lieu la fermeture du cercueil.
Rfrences
Articles R. 2213-7 R. 2213-12 du code gnral des collectivits territoriales,
Articles R. 2223-67 R. 2223-98 du code gnral des collectivits territoriales,
Circulaire du 4 novembre 2002 relative au transport de corps avant mise en bire,
Articles 177, 178 et 179 du rglement intrieur de lAP-HP
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
171
52 - Les prlvements but thrapeutique : le don
dorganes ou de tissus
Pour aller lessentiel :
Un prlvement dorganes ou de tissus pour don ne peut tre pratiqu que si la personne na pas fait
connatre de son vivant, son refus dun tel prlvement
Si le mdecin na pas directement connaissance de la volont du dfunt, il doit sefforcer de recueillir auprs
des proches lopposition au don dorganes ventuellement exprime de son vivant par le dfunt, par tout
moyen, et il doit les informer de la finalit des prlvements envisags.
Le registre national des refus doit tre systmatiquement consult.
Dfinition :
Les prlvements dorganes ou de tissus sur le corps dune personne dcde ont une vise thrapeutique
lorsquils sont effectus en vue dune implantation ultrieure sur une autre personne dans le cadre dun
traitement.
Conditions :
1. Le prlvement ne peut tre effectu sans vrification de labsence de refus exprim par le patient
de son vivant
Lorsque le prlvement est demand sur un majeur
Le principe est celui de la prsomption de consentement : le prlvement peut tre effectu ds lors que la
personne concerne n'a pas fait connatre, de son vivant, son refus de prlvement.
Le refus du patient, lorsquil a t doit tre strictement respect.
Il peut tre exprim de plusieurs manires :
- par lindication du refus sur le Registre National automatis des Refus de Prlvement tenu par
lAgence de la biomdecine.
La demande de consultation de ce registre est obligatoire et doit tre crite, signe, date par le directeur de
lhpital, ladministrateur de garde ou la personne habilite cet effet. Elle doit tre conserve ;
- dfaut de refus exprim sur le Registre ou sur un autre support, le mdecin doit recueillir le tmoignage
des proches ;
- par tout autre moyen : senqurir de lexistence de documents crits du malade, de propos tenus au
personnel de lhpital.
Lorsque le prlvement est demand sur un mineur ou un majeur sous tutelle :
Le consentement doit tre explicite.
Le prlvement est possible en cas daccord crit du ou des titulaires de lautorit parentale ou du tuteur.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
172
2. Ils ne peuvent tre pratiqus que dans des tablissements de sant autoriss cet effet par le directeur de
lagence rgionale de lhospitalisation aprs avis de lAgence de la biomdecine.
Lautorisation dlivre pour 5 ans et renouvelable doit prciser le type dorganes, tissus ou cellules que
ltablissement peut prlever.
3. Il nexiste pas de liste rglementaire limitative des organes, tissus et cellules pouvant tre prlevs sur
personne dcde sauf lorsquil sagit dun prlvement cur arrt (lorsque la personne prsente un
arrt cardiaque et respiratoire persistant)
4. Un procs-verbal rglementaire du constat de la mort doit tre sign concomitamment au certificat de
dcs par :
- un mdecin pour un prlvement cur non battant ou cur arrt,
- deux mdecins pour un prlvement cur battant
5. Les mdecins qui tablissent le constat de la mort et ceux qui effectuent le prlvement doivent faire lobjet
dunits fonctionnelles ou de services distincts Rien ne soppose ce que les oprations de prlvement
et de greffe se ralisent au sein dun mme hpital. Nanmoins, les quipes doivent tre distinctes.
6. Le mdecin doit informer les proches de la finalit des prlvements envisags
7. Le corps devra tre restaur aprs prlvement.
8. Les proches doivent tre informs de leur droit connatre les prlvements effectus
Conduite tenir :
Le mdecin prleveur, en liaison directe avec la coordination hospitalire
devra faire la demande crite, signe et date
sassurer de la non opposition de la personne (dans lhypothse ou la famille ne peut tre jointe, le mdecin
du donneur et le coordonnateur hospitalier doivent dfinir une procdure crite permettant de recueillir le nom,
le lien de parent, le n de tlphone de la personne contacte, les heures et le nombre dappels)
faire contresigner le formulaire de demande par le mdecin de service et par le mdecin prleveur
informer les proches de la finalit des prlvements envisags.
Le directeur de lhpital ou ladministrateur de garde
La demande de consultation du registre doit tre crite, signe, date par le directeur de lhpital ou la
personne habilite et adresse par tlcopie au RNR au numro suivant : 01 49 98 06 38 La rponse du RNR
est galement crite et retourne par tlcopie.
(La direction de lhpital doit donc veiller tenir strictement jour la liste des personnes habilites, en lien
avec lAgence de la biomdecine)
Les mdecins qui procdent aux prlvements doivent tablir un compte rendu dtaill.
La prise en charge des frais lis aux prlvements
les frais de transport du patient d'un tablissement de sant vers un autre tablissement de sant, sont la
charge de ce dernier tablissement ;
l'tablissement de sant qui effectue les prlvements prend sa charge les frais entrans par le constat
du dcs du donneur et l'assistance mdicale du corps avant le prlvement ;
les frais de transport du corps d'une personne dcde vers un tablissement de sant, en vue d'effectuer
des prlvements de tissus des fins thrapeutiques, sont la charge de cet tablissement ;
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
173
dans tous les cas, l'tablissement qui a procd au prlvement assure les frais de conservation et de
restauration du corps aprs l'acte de prlvement.
INTERROGATION DU REGISTRE NATIONAL DES REFUS
(circulaire DGS/DH/EFG du 31 juillet 1998)
En vue de prlvements
but thrapeutique (organes, tissus)
but scientifique (recherche)
afin de rechercher les causes de la mort (autopsie mdicale)
A envoyer au : 01 49 98 06 38
Tlphone : 01 49 46 50 77
TABLISSEMENT DE SANT
Nom : Ville : Dpartement :
n FINESS :
Administrateur de la demande (dment habilit par le directeur de l'tablissement de sant)
Nom :
Prnom :
Fonction :
Tlphone :
Numro de tlcopie pour adresser la rponse :
(Rponse dans un dlai de 30 minutes pour un but thrapeutique, d'une heure, les jours ouvrables, pour les
autres types de prlvements)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
174
Personne sur laquelle le prlvement est envisag
Nom patronymique :
Nom d'usage :
Premier prnom :
Autres prnoms (dans l'ordre de l'tat civil) :
Sexe : masculin fminin
Date de naissance :
Ville de naissance : ou pays de naissance :
Renseignements tablis partir d'une pice officielle d'identit :
oui non
(obligatoire pour but scientifique et autopsie )
Date et heure du dcs (selon le procs-verbal du constat de mort prvu par l'article R. 1232-3 du code de la
sant publique) :
Demande tablie , le :
Signature :
Ce formulaire de demande et la rponse correspondante doivent tre archivs dans le dossier mdical de la
personne dcde et au bureau de l'tat civil de l'tablissement de sant.
Rfrences
Art. L. 1232-1 L. 1232-5, L. 1233-1 L. 1233-3, R. 1232-1 1232-13, L. 1241-1 L. 1241-2-1 du code de la sant
publique
Arrt du 27 fvrier 1997 portant homologation des rgles de bonnes pratiques relatives au prlvement dorganes
finalit thrapeutique sur personne dcde
Arrt du 1
er
avril 1997 portant homologation des rgles de bonnes pratiques relatives au prlvement des tissus et
au recueil des rsidus opratoires issus du corps humain des fins thrapeutiques
site de lAgence de la biomdecine : www.agence-biomedecine.fr
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
175
53 - Les autopsies mdicales et les prlvements
vise scientifique
Pour aller lessentiel :
Indpendamment du cas des autopsies mdico-lgales (effectues la demande de lautorit judiciaire),
des prlvements et autopsies diagnostiques ou vise scientifique peuvent tre effectus sur un patient
dcd.
Dans ce cas, comme dans celui des prlvements vise thrapeutique pour don (voir fiche n52 : les
prlvements but thrapeutique : le don dorganes ou de tissus ), il doit tre vrifi au pralable que le
patient navait pas exprim de son vivant le refus dun tel prlvement.
Le Registre national des refus doit tre systmatiquement consult.
Dfinition :
Il sagit de prlvements qui sont pratiqus en dehors du cadre de mesures denqute ou dinstruction
diligentes lors dune procdure judiciaire :
soit dans le but dobtenir un diagnostic sur les causes du dcs (prlvements but diagnostique et
autopsies mdicales ),
soit dans le cadre de recherches mdicales (prlvements but scientifique).
Conditions :
le prlvement ne peut tre effectu sans vrification de labsence de refus exprim par le patient de
son vivant. Le consentement du dfunt est prsum, sauf pour les mineurs et les majeurs sous tutelle, pour
lesquels il faut une autorisation crite du ou des titulaires de lautorit parentale ou du tuteur.
En cas de ncessit imprieuse pour la sant publique et en labsence dautres procds permettant dobtenir
une certitude diagnostique sur les causes de la mort, lautopsie peut tre pratique sans le consentement de
la personne dcde.
il ne peut tre effectu quaprs qua t tabli un procs verbal rglementaire du constat de la mort
spcifique, indpendant du certificat de dcs
les mdecins qui tablissent le constat de la mort, et ceux qui effectuent le prlvement doivent faire partie
dunits fonctionnelles ou de services distincts.
le mdecin doit informer les proches de la finalit des prlvements envisags
le corps devra tre restaur aprs prlvement.
les proches doivent tre informs de leur droit connatre les prlvements effectus
sagissant des prlvements but scientifique : ils doivent tre pratiqus dans le cadre de protocoles
transmis pralablement lAgence de la biomdecine. Les mdecins qui procdent aux prlvements doivent
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
176
tablir un compte rendu dtaill de leur intervention et de leurs constatations sur ltat du corps et des
organes prlevs.
Conduite tenir :
Le mdecin hospitalier doit :
- faire une demande crite, signe et date,
- sassurer de la non-opposition de la personne, le cas chant par le tmoignage de la famille,
- faire contresigner le formulaire de demande par le directeur de lhpital, ladministrateur de garde ou son
reprsentant. Ce document sera conserv au dossier du malade (un double est remis au chef du service
danatomie pathologique),
Le prlvement nest pas soumis un rgime dautorisation administrative, il peut donc tre librement exerc
par les tablissements de sant, ds lors quils respectent les rgles de protection des personnes
(consentement, anonymat) dhygine et de scurit du travail et, sagissant des prlvements vise
scientifique, quils relvent dun protocole dclar lAgence de la biomdecine.
Rfrences
Art. L. 1211-2, L. 1232-1 L. 1232-5, L. 1241-5 du code de la sant publique
site de lAgence de la biomdecine : www.agence-biomedecine.fr
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
177
54 - Les prlvements sur les personnes dcdes en
dehors de lhpital
Pour aller lessentiel
Des prlvements vise diagnostique peuvent dans certains cas tre effectus lhpital, alors mme que
le dcs a eu lieu en dehors de lhpital :
la demande du prfet : en cas de mort suspecte
la demande dune personne de lentourage du patient, charge de pourvoir aux funrailles
Les situations :
en cas de mort suspecte, le Prfet peut sur lavis conforme crit et motiv de deux mdecins prescrire
toutes les constatations et les prlvements ncessaires en vue de rechercher la cause du dcs.
la ralisation dun prlvement ou dune autopsie peut tre effectue la demande dune personne qui a
la qualit pour pourvoir aux funrailles (cette situation concerne principalement les hypothses de mort
inattendue du nourrisson, les personnes dcdes de maladies rares ou complexes ou toute autre personne
souhaitant connatre les causes du dcs)
Conduite tenir dans le cas de prlvement la demande de la famille :
Ces prlvements peuvent tre effectus dans un autre hpital que celui o le dcs a eu lieu.
Ce transfert dun hpital vers un autre hpital ne peut tre effectu sans le consentement de la personne
qui a qualit pour pourvoir aux funrailles (c'est--dire de la personne dsigne de son vivant par le dfunt
ou le membre de lentourage qui se charge des obsques).
Le transport du corps vers lhpital est subordonn lautorisation du maire ou, Paris, du prfet de
police.
Les conditions de lautorisation du maire (ou du Prfet de police Paris) :
la production dun extrait du certificat mdical attestant que le dcs :
labsence de problme mdico-lgal
le dcs ne doit pas avoir t caus par lune des maladies contagieuses numres par larrt du
20 juillet 1998 (v. fiche n 51 : les transports de corps ).
Possibilit dun nouveau transport
Dans cette hypothse, lissue des prlvements, un nouveau transport de corps peut tre effectu la
demande de la personne qui a qualit pour pourvoir aux funrailles soit :
vers une chambre funraire
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
178
vers la rsidence du dfunt
vers la rsidence dun membre de sa famille
Conditions requises en vue dun nouveau transport
accord crit du directeur de lhpital (ou administrateur de garde) aprs avis du mdecin ayant ralis les
prlvements en vue de rechercher les causes de la mort.
Dlais
Les oprations de transport doivent tre acheves dans un dlai maximum de 24 heures compter du dcs.
Ce dlai est port 48 heures si des soins de conservation ont t raliss lissue des prlvements.
Prise en charge financire
Les frais de transport aller et retour du lieu de dcs lhpital et les frais de prlvement sont la charge
de lhpital dans lequel il a t procd aux prlvements.
Il convient de souligner quen principe, le corps doit tre repris par lhpital demandeur lissue des
demandes dinvestigations.
Rfrences
Art. R. 2213-14 et R. 2213-19 du code gnral des collectivits territoriales
Recommandations de la Haute autorit de sant, Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de
deux ans)(2007)
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
179
55 Le don de corps la science
Pour aller lessentiel
Pour pouvoir tre accept, le don du corps ( la science ) doit avoir t formul personnellement du
vivant du dfunt
les dons du corps de personnes mineures ou sous tutelle ne sont pas accepts
le don du corps ne doit pas tre confondu avec le don dorganes, qui a une vise thrapeutique
(implantation sur une autre personne).
Le don du corps est le fait de donner son corps aprs sa mort la mdecine pour aider la recherche ou
l'enseignement mdical.
Ce don sexprime sous la forme dun acte de donation qui peut tre effectu par toutes les personnes
majeures ntant pas sous tutelle. Il doit tre rdig entirement de sa main par le donateur sur papier libre,
dat, sign et adress par courrier au Centre du don des Corps dune Facult de Mdecine ou l'Ecole de
Chirurgie de lAP-HP.
En retour, ces services adresseront lintress un formulaire de don. Une carte de donateur lui sera
expdie rception de ce formulaire quil devra complter, signer et porter sur lui. A tout moment, la
personne ayant souhait donner son corps peut revenir sur sa dcision en dtruisant sa carte de donateur et
en informant lEcole de Chirurgie ou la Facult de mdecine par crit.
Le corps est achemin l'tablissement lgataire (Ecole de chirurgie ou Facult de mdecine) dans les 24
heures suivant le dcs, ou dans les 48 heures si le dcs est survenu dans un tablissement de sant
disposant d'quipements permettant la conservation des corps. Il est ensuite embaum par une quipe de
professionnels spcialise dans les soins de conservation, puis plac dans un lieu ddi au dpt des corps
jusqu' ce qu'il puisse tre utile aux travaux anatomiques.
En fonction des besoins lis aux programmes de l'cole, les corps sont alors mis la disposition de travaux
d'enseignement ou de recherche.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
180
56 Les pratiques religieuses lhpital
Pour aller lessentiel
Le service public est lac.
Les patients doivent pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les prceptes de leur religion. Ce droit
sexerce dans le respect de la libert des autres malades.
Toute personne est tenue au sein de lhpital au respect du principe de neutralit du service public dans
ses actes comme dans ses paroles.
Sur lintervention des ministres du culte, v. fiche n 57 : les visites .
Si les patients doivent pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les prceptes de leur religion. Ce droit
sexerce dans le respect de la libert des autres malades, ces dispositions doivent saccorder avec les
exigences dune bonne dispensation des soins telle quelle est dfinie par lquipe mdicale.
Il convient de veiller ce que lexpression des convictions religieuses ne porte pas atteinte :
la qualit des soins et aux rgles dhygine (le malade doit accepter la tenue vestimentaire qui lui est
impose compte tenu des soins qui lui sont donns)
la tranquillit des autres personnes hospitalises et de leurs proches
au fonctionnement rgulier du service.
En vertu du pouvoir de police quil exerce au sein de lhpital, il appartient au directeur (ou ladministrateur
de garde) de faire respecter strictement ces diverses dispositions qui constituent des garanties essentielles
pour les patients.
Ces principes poss par la jurisprudence sappliquent de mme faon tous les fonctionnaires et agents
publics (contractuels, internes, ), lexception des ministres des diffrents cultes.
Le directeur de lhpital doit les faire respecter strictement en sanctionnant tout manquement en ce domaine.
En pratique :
1. Le port dun signe dappartenance religieuse
Le personnel mdical et non mdical tout comme le personnel administratif ou les tudiants sont
tenus de respecter les principes de neutralit et de lacit.
Cette obligation doit sappliquer aussi bien au sein des coles de formation de lAP-HP quau sein des
hpitaux et groupes hospitaliers et dans tous leurs services (mdicaux, administratifs, techniques.).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
181
Larticle 149 du rglement intrieur de lAP-HP nonce que : toute personne est tenue au sein de lhpital
(du groupe hospitalier) au respect du principe de neutralit du service public dans ses actes comme dans ses
paroles. () Le service public est lac. Il en rsulte notamment que les signes dappartenance religieuse,
quelle quen soit la nature, ne sont pas tolrs au sein de lhpital (du groupe hospitalier), quils soient
arbors, individuellement ou collectivement, par les patients, leurs familles, les personnels ou toute autre
personne, ds lors que ces signes constituent un acte de pression, de provocation, de proslytisme ou de
propagande, ou quils perturbent le droulement des activits hospitalires et, dune manire gnrale, lordre
et le fonctionnement normal du service public .
2. Le libre choix du praticien et notamment le refus dune patiente dtre prise en charge par un
soignant de sexe masculin
Larticle 41 du rglement intrieur de lAP-HP nonce que le droit du patient au libre choix de son praticien
et de son tablissement de sant est un principe fondamental de la lgislation sanitaire. Ce droit sexerce au
sein de la spcialit mdicale dont le patient relve, dans les limites imposes par les situations durgence et
par les disponibilits en lits et en personnel de lhpital (du groupe hospitalier).
Les patients ne peuvent, raison de leurs convictions, rcuser un agent ou dautres usagers, ni exiger une
adaptation du fonctionnement de lhpital .
Si une patiente refuse dtre prise en charge par un professionnel de sexe masculin, et si lon considre
que ce refus est motiv par des considrations dordre religieux, il faut rappeler que lhpital ne peut pas offrir
et/ou garantir en urgence une quipe fminine pour l'accouchement ou tout autre vnement qui n'est pas
programmable.
Dans ces circonstances, il convient dinformer les patientes, lors des consultations pralables
laccouchement, que les prestations de soins seront effectues indiffremment par l'quipe de garde qui peut
tre compose d'hommes et de femmes et que le respect de cette organisation est une condition de la prise
en charge par le service.
Rfrences
Circulaire DHOS/G/2005/57 du 2 fvrier 2005 relative la lacit dans les tablissements de sant,
Articles 41, 140 et 149 du rglement intrieur de lAP-HP.
Guide AP-HP, Le dcs lhpital (2007)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
182
57 Les visites
La famille, les amis, les proches
Pour aller lessentiel
Lorganisation des visites (de la famille, des proches,..) relve de la comptence du directeur de lhpital.
Elle fait lobjet de dispositions arrtes par le directeur sur avis des responsables des structures mdicales concernes. Le
directeur doit en dfinir les horaires et les modalits, en prcisant notamment le nombre maximum de visiteurs admis dans
une chambre. En dehors des horaires prvus, des autorisations peuvent tre dlivres nominativement, pour des motifs
exceptionnels, avec laccord du responsable de la structure mdicale concerne.
Un droit de visite largi est prvu pour les patients mineurs.
Les principes
Le droit de visite est un droit important des patients et de leurs familles et un lment essentiel pour
l humanisation des hpitaux.
Il doit tre favoris autant que possible, dans la mesure o il ne porte pas atteinte de faon gnante au
fonctionnement des services, au repos des patients et lorganisation des soins.
Linterdiction de visite doit le cas chant tre dcide, lorsquelle est ncessaire, avec prcaution et
discernement, et, sauf cas exceptionnel, jamais pour une dure illimite.
Visites dans les services de pdiatrie
La mre, le pre ou toute autre personne qui soccupe habituellement de lenfant doit pouvoir accder au
service de pdiatrie quelle que soit lheure et rester auprs de son enfant aussi longtemps que ce dernier le
souhaite, y compris la nuit.
La prsence de ces personnes ne doit en aucun cas les exposer, ni exposer lenfant un risque sanitaire, en
particulier des maladies contagieuses. Dans ce cas, il est souhaitable quun membre de lquipe mdicale
explique ces personnes les raisons empchant leur visite et leur donne la possibilit de prendre des
nouvelles de lenfant en lui tlphonant.
Les restrictions
Le droit aux visites peut tre restreint :
pour des motifs lis ltat de sant des patients. Ces restrictions, par lesquelles les visites sont susceptibles dtre
interdites ou limites en nombre et en dure, peuvent notamment concerner laccs aux services hospitaliers de
visiteurs mineurs gs de moins de 15 ans et laccs des visiteurs des patients hospitaliss dans certaines units
mdicales ;
pour les patients placs sous la surveillance de la police.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
183
Les horaires des visites doivent tre affichs lentre des units de soins concerns.
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des patients, ni gner le fonctionnement des units de soins et plus
gnralement de lhpital (du groupe hospitalier). Le personnel soignant peut demander aux visiteurs de se retirer des
chambres des patients pendant lexcution des soins et examens.
Les patients peuvent demander lhpital de ne pas permettre les visites aux personnes quils dsignent.
Les visiteurs doivent garder une tenue correcte, viter de provoquer tout bruit intempestif, notamment par leur
conversation ou en faisant fonctionner des appareils sonores. Ils doivent respecter strictement linterdiction de fumer.
Il est interdit aux visiteurs dintroduire dans les chambres des patients :
des mdicaments, sauf accord exprs du mdecin en charge du patient,
dans tous les cas, des boissons alcoolises ou des produits toxiques, de quelque nature quils soient,
des denres ou des boissons, mme non alcoolises, incompatibles avec le rgime alimentaire du patient.
Lorsque ces obligations ne sont pas respectes, le personnel hospitalier peut interrompre immdiatement la visite et
le directeur (ou ladministrateur de garde) peut dcider lexpulsion du visiteur.
Les stagiaires extrieurs
Les stages organiss pour les tudiants et professionnels au sein de lhpital doivent faire lobjet dune convention entre
lhpital et lorganisme dont dpend le stagiaire.
Les stagiaires sont tenus de respecter les dispositions du rglement intrieur type de lAP-HP sous la conduite de la
personne responsable de leur stage.
Les bnvoles
Lhpital doit faciliter lintervention des associations de bnvoles qui peuvent apporter un soutien au patient
et sa famille, la demande ou avec laccord de ceux-ci, ou dvelopper des activits leur intention, dans le
respect des rgles de fonctionnement de l'hpital et des activits mdicales et paramdicales.
Les associations qui proposent, de faon bnvole, des activits au bnfice des patients au sein de lhpital doivent,
pralablement leurs interventions, avoir conclu avec lhpital une convention qui dtermine les modalits de
cette intervention.
Le directeur de lhpital doit se faire remettre la liste nominative des personnes qui interviendront au sein de lhpital.
Les bnvoles doivent pouvoir tre identifis tout instant (port dun badge indiquant leur nom et qualit par
exemple).
Le responsable de la structure mdicale concerne peut sopposer des visites ou des activits de ces associations
pour des raisons mdicales ou pour des raisons lies lorganisation de la structure mdicale.
Les personnes bnvoles ne peuvent dispenser aucun soin caractre mdical ou paramdical.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
184
Les ministres du culte
Les hospitaliss doivent tre en mesure de participer lexercice de leur culte. Tout patient doit pouvoir
solliciter librement le ministre du culte de son choix. Celui-ci pourra alors se rendre dans la chambre du patient,
avec son accord ou le recevoir dans le local destin cet effet.
Lhpital doit mettre la disposition des patients une liste des diffrents ministres du culte avec leur nom,
confession, horaires de disponibilit, numros de tlphone Cette liste doit tre visible et disponible dans
chaque unit de soins.
Un local doit galement tre mis disposition et doit pouvoir servir de lieu de culte et/ou de prire et de
recueillement aux patients, quelle que soit leur confession.
Ces dispositions ne permettent pas les visites spontanes des ministres du culte dans les chambres des
patients, ni la remise de liste de patients tris selon leur confession aux ministres du culte concerns.
Les ftes religieuses
Lautorisation du directeur (ou de ladministrateur de garde) doit tre pralablement requise pour lorganisation
dune fte ou dune clbration religieuse. Celle-ci doit le cas chant se drouler dans un espace strictement
rserv et sans tre impose de quelque faon que ce soit aux patients.
Liste des ministres du culte intervenants au sein de lhpital :
Les accompagnants privs
Lautorisation de disposer dun accompagnant priv doit tre demande par crit par le patient ou sa famille.
Elle est subordonne laccord conjoint du mdecin responsable de lunit de soins et du directeur de lhpital, qui
peuvent tout moment rapporter cette dcision.
La personne autorise se tenir en permanence auprs du patient ne doit effectuer aucun soin mdical ou
paramdical.
Les frais ventuels occasionns par cette garde ne sont pas rembourss par la Scurit sociale. Cette prcision doit
tre donne au demandeur avant toute autorisation.
Les dmarcheurs, photographes, agents daffaires et enquteurs
Laccs au sein de lhpital (du groupe hospitalier) des dmarcheurs, photographes, agents daffaires et enquteurs est
interdit, sauf autorisation spcifique.
Sils pntrent, sans autorisation crite du directeur, dans les chambres et les locaux hospitaliers dans lintention dy
exercer leur activit, ils doivent tre immdiatement exclus.
V. fiche n58 : Laccs des journalistes dans les locaux hospitaliers
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
185
Les notaires
Les patients peuvent demander au notaire de leur choix de venir recueillir leur chevet leurs dernires
volonts. Dans ce cas, toutes les dispositions doivent tre prises au sein de lhpital afin de faciliter
laccomplissement de ces formalits.
Les agents hospitaliers peuvent tre sollicits pour servir de tmoins. Dans cette hypothse, lautorisation
pralable du directeur (ou de ladministrateur de garde) est ncessaire.
Les mdecins sont libres daccepter ou de refuser dtablir un certificat mdical la demande dun notaire.
Rfrences :
Article R. 1112-46 et R. 1112-47 du code de la sant publique
Circulaire DH/EO 3 n98-688 du 23 novembre 1998 relative au rgime de visite des enfants hospitaliss en pdiatrie
Circulaire n83-24 du 1
er
aot 1983 relative lhospitalisation des enfants
Lettre-circulaire n1034/DH/9C du 14 octobre 1983 relative lintervention des notaires dans les tablissements publics
hospitaliers
Articles 142 148 du rglement intrieur type de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
186
58 Laccs des journalistes dans les locaux
hospitaliers
Pour aller lessentiel
Laccs de journalistes au sein de lhpital est soumis une autorisation pralable.
Les journalistes ne doivent pas troubler le repos des patients, ni gner le fonctionnement du service.
Applications
Les journalistes et les photographes nont pas accs auprs des malades, sauf accord de ceux-ci et
autorisation donne par la Direction de la Communication de lAP-HP (aprs avis du directeur de lhpital et
du responsable de la structure mdicale concerne). Les journalistes qui souhaitent raliser des reportages
dans un tablissement doivent ainsi obtenir au pralable une autorisation de tournage.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit donc :
sassurer de laccord du patient,
vrifier auprs du mdecin traitant que la prsence dun tiers nest pas contraire ltat de sant du malade.
Attention !
Pour toute prolongation ou report de tournage, une nouvelle autorisation doit tre dlivre
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit donc demander au journaliste de lui produire lautorisation
accorde (ou en obtenir une copie). Il peut demander lannulation du tournage et lautorisation devient alors
caduque. Il peut faire interrompre le tournage tout moment, notamment en cas de ncessit pour la scurit
des patients, sur demande du chef de service.
Lautorisation doit mentionner de faon expresse :
le ou les services concerns par le tournage,
les jours et heures de tournage,
lutilisation prvue des images.
Dans le cas des patients mineurs, une autorisation spciale et expresse doit tre donne par les titulaires de
lautorit parentale.
Dans le cas des majeurs sous tutelle, lautorisation doit tre donne par le tuteur.
Dans le cas des patients juridiquement capables, mais ne manifestant pas une lucidit totale, la prudence
simpose.
En cas de doute, le directeur (ou ladministrateur de garde) doit prendre les mesures ncessaires pour
interdire le tournage et toute utilisation de limage du patient.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
187
Enfin de faon plus gnrale, si l'hpital est tenu d'assurer le respect de la vie prive de ses patients, de leurs
familles et des personnels en protgeant leur droit l'image, l'hpital et les professionnels qui y exercent
ont pour leur part le devoir d'observer un certain nombre d'obligations de discrtion professionnelle pour tout
ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions. Cette rserve est un lment de la neutralit du service public.
En effet, si la libert d'opinion est parfaitement reconnue aux fonctionnaires et agents publics hospitaliers, elle
comporte des limites, qui ont respectivement pour objet d'interdire, pour les agents en fonctions, des
dclarations ou attitudes exagrment critiques l'gard du service public ou de se livrer une propagande
politique ou religieuse partisane.
Il en rsulte par ailleurs que chaque fois qu'un agent de l'hpital souhaite exprimer librement un point de vue
personnel ou syndical, aucune ambigit ne doit exister sur le fait que cette expression s'effectue ce titre :
une autorisation dlivre ne peut laisser entendre que l'agent s'exprime au nom de l'AP-HP, ni tre libelle de
telle sorte que puisse tre engage la responsabilit de l'AP-HP.
Sur tous les aspects relatifs la communication et aux relations avec les mdias, notamment en
situation de crise, voir page 29 du prsent mmento.
Autorisations et numros utiles
La demande dautorisation doit tre formule par crit et de manire expresse, par fax sur papier en-tte de
la socit, par courrier ou par mail la Direction de la communication de lAP-HP (3 avenue Victoria, 75004
Paris) auprs du :
Service de Presse
Tl : 01 40 27 37 22
Fax : 01 40 27 57 01
E-mail : service.presse@sap.aphp.fr
Extranet : www.aphp.fr (rubrique Actualits, onglet Salle de Presse)
Rfrences
Article 9 du code civil,
Article L. 1111-4 du code de la sant publique,
Article R. 1112-47 du code de la sant publique,
Articles 223-2, 226-1 et 226-13 du code pnal,
Charte de la personne hospitalise (circulaire du 2 mars 2006),
Article 146 du rglement intrieur type AP-HP.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
188
59 Les troubles dans lenceinte de lhpital
Pour aller lessentiel
Le directeur de lhpital (ou ladministrateur de garde qui le reprsente) assure la gestion et la conduite
gnrale de lhpital quil dirige et y dispose du pouvoir de police. Il doit donc intervenir en cas de troubles
constats au sein de lhpital occasionns par les patients ou les visiteurs, ou plus gnralement, pour toutes
les infractions constates quels que soient leurs auteurs.
Les troubles causs par un patient
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit :
appliquer le rglement intrieur de lhpital et prendre les mesures disciplinaires appropries aux
circonstances (du simple avertissement la dcision de sortie disciplinaire du patient). Laide des forces de
police peut tre ventuellement demande. En cas de dommages, une indemnisation peut tre rclame,
v. fiche n 42 : Les sorties disciplinaires
complter la mesure disciplinaire par une demande ventuelle dindemnisation du prjudice subi,
notamment en cas de dtrioration des biens de lhpital,
alerter le commissaire de police ou le Procureur de la Rpublique si les troubles causs sont constitutifs de
dlits ou de crimes
Les troubles causs par des visiteurs
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gner le fonctionnement des services. Lorsque
ceci nest pas respect, lexpulsion du visiteur et linterdiction de visite peuvent tre dcides par le directeur
(ou ladministrateur de garde). Laide des forces de police peut tre ventuellement demande. En cas de
dommages, une indemnisation peut tre rclame.
Infractions commises dans lhpital
La rgle gnrale est quil appartient au directeur (ou ladministrateur de garde) de prendre toutes mesures
utiles et veiller quelles soient correctement mises en uvre.
En cas de crime ou dlit flagrant, la loi autorise toute personne apprhender lauteur des faits et le
conduire devant lofficier de police judiciaire le plus proche.
Article 73 du code de procdure pnale :
Dans les cas de crime flagrant ou de dlit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a
qualit pour en apprhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche .
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
189
Obligation dinformation.
Tout vnement susceptible dtre qualifi de crime ou dlit doit tre dnonc la justice (art 40 du code de
procdure pnale : Le procureur de la Rpublique reoit les plaintes et les dnonciations et apprcie la suite
leur donner Toute autorit constitue, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans lexercice de ses
fonctions, acquiert la connaissance dun crime ou dun dlit est tenu den donner avis sans dlai au procureur
de la Rpublique et de transmettre ce magistrat tous les renseignements, procs-verbaux et actes qui y sont
relatifs. )
Dans la pratique, le chef de scurit ou ladministrateur de garde appelle pour intervention la police ou la
gendarmerie, qui sont tenues dinformer le Parquet des infractions dont elles sont saisies.
Gel des lieux
Les lieux doivent imprativement demeurer dans ltat o ils taient au moment de linfraction, de manire
ce que la police judiciaire (police technique et scientifique) puisse y retrouver dventuelles traces et indices.
Eviter les attroupements : loigner les curieux et ne garder proximit que les personnes susceptibles
dapporter un tmoignage
En cas de vol, le directeur (ou ladministrateur de garde) doit faire diligenter une enqute interne et demander
un rapport sur les circonstances et limportance du vol commis. Il doit faire un tat des objets vols et prvenir
les services de police afin quils procdent aux enqutes dusage.
Le dpt de plainte auprs du procureur de la Rpublique est personnel et appartient la victime de
linfraction : patient ou reprsentant lgal, visiteur, agent ou administrateur de garde si linfraction a t
commise au dtriment de lhpital.
V. fiche n27 : le dpt de biens (sur les rgles de la responsabilit)
En cas dactes de violence, le directeur (ou ladministrateur de garde) doit saisir le commissariat de police.
Seuls les incidents mineurs peuvent chapper cette rgle. Un rapport circonstanci doit tre demand au
service concern et une plainte doit tre dpose (le cas chant par la ou les victimes).
Dans tous les cas, le directeur (ou ladministrateur de garde) doit rdiger un rapport de garde dtaill
le plus rapidement possible.
Rfrences
Articles 15-3, 40 et 73 du code de procdure pnale,
Article L. 6143-7 du code de la sant publique,
Articles R. 1112-47, R. 1112-49 et R. 1112-50 du code de la sant publique,
Articles 26 et 135 du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
190
60 Loccupation illicite dun site de lAP-HP
En cas doccupation illicite dun site relevant du domaine public ou priv de lAP-HP (locaux relevant du Sige,
dun hpital ou dun service gnral), il revient ladministrateur de garde du Directeur gnral de suivre la
procdure suivante :
Informer la Direction gnrale (le Directeur gnral, le Secrtaire gnral ou le Directeur de cabinet), seul
habilite donner lautorisation de faire intervenir les forces de police ;
Prvenir le responsable de la Direction de la Communication/Service de presse de lAP-HP qui assure la
garde ;
Ds lors que le Directeur gnral a donn son accord, tablir un ordre de rquisition en indiquant la date, le
site concern et lheure de loccupation ;
Faxer cet ordre de rquisition la permanence du cabinet du Prfet de police et, ventuellement, lEtat-
major de la Direction de lOrdre public et de la Circulation (tl. : 01 53 71 28 92 / fax : 01 53 71 67 46).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
191
61 Danger grave et imminent (CHSCT)
Pour aller lessentiel
Certains CHSCT locaux ont parfois pris linitiative dinscrire, de faon systmatique, des situations
dinsuffisance de personnel, dans telle ou telle unit ou service, sur le registre de consignation des dangers
graves et imminents.
Quelle que soit lapprciation porte par lhpital sur la lgitimit dune telle inscription, la direction de
lhpital doit mettre systmatiquement en uvre la procdure lgale prvue aux articles L..4132-2 et suivants
du Code du travail (enqute sur place, saisine immdiate du CHSCT local en cas de dsaccord, information
de lInspection du travail).
1 Le danger grave et imminent constat par les reprsentants du personnel au CHSCT concerne lapplication
de la lgislation du travail. IL doit concerner la sant physique et/ou mentale des salaris de lhpital
concern et non celle des patients.
2 Il ne peut tre compltement exclu que linsuffisance de personnel au sein dun hpital pourrait caractriser
un danger l'gard des personnels (cas de non-respect grave des dispositions lgales relatives la dure du
travail : non respect des repos entre deux journes de travail, fort dpassement du contingent dheures
supplmentaires ou encore dpassement massif de la dure maximale de travail hebdomadaire...).
La notion de danger grave et imminent nest pas dfinie par le Code du travail.
Selon une dclaration du ministre du Travail :
Il y a danger grave et imminent lorsquon est en prsence dune menace de nature provoquer une atteinte
srieuse lintgrit physique dun travailleur ; il importe peu que le dommage se ralise en un instant ou
progressivement, du moment quil puisse tre envisag dans un dlai proche.
Il a t par ailleurs t prcis, sagissant de lapprciation du caractre grave et imminent du danger, que :
Cette apprciation ne peut se faire quau cas par cas, sous le contrle du juge, sachant quon peut dfinir
comme :
- grave, tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entranant la mort ou paraissant
devoir entraner une incapacit permanente ou temporaire prolonge ;
- imminent, tout danger susceptible de se raliser brutalement dans un dlai rapproch .
Toutefois, lvaluation de la gravit et de limminence du danger est laisse lapprciation souveraine des
juges qui, en cas de constat dune situation particulirement critique pourraient raisonnablement estimer que
le manque de personnel constitue un danger grave et imminent pour les salaris.
3 Le Directeur de lhpital est en principe strictement tenu de mettre en uvre la procdure lgale
applicable en cas dexercice par le CHSCT de son droit dalerte lorsquil ce dernier estime qu'il y a danger
grave et imminent.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
192
A la suite dun avis de danger grave et imminent mis par un reprsentant du personnel au CHSCT et
consign sur le registre spcial mis en place cet effet, la loi prvoit en effet que lemployeur doit procder
sur-le-champ une enqute avec le membre du CHSCT qui lui a signal le danger et prendre les mesures
ncessaires pour y remdier.
Les articles L.4132-3 et L.4132-4 du Code du travail prvoient que :
- En cas de divergence sur la ralit du danger ou la faon de le faire cesser, notamment par arrt du
travail, de la machine ou de l'installation, le CHSCT est runi d'urgence, dans un dlai n'excdant pas vingt-
quatre heures. L'employeur informe immdiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prvention
de la caisse rgionale d'assurance maladie, qui peuvent assister la runion du CHSCT .
- A dfaut d'accord entre l'employeur et la majorit du CHSCT sur les mesures prendre et leurs conditions
d'excution, l'inspecteur du travail est saisi immdiatement par l'employeur. L'inspecteur du travail met en
uvre soit l'une des procdures de mise en demeure prvues l'article L.4721-1, soit la procdure de rfr
prvue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 .
En application de ces textes, lemployeur donc lobligation, quelle que soit son opinion sur la ralit du
danger grave et imminent, de mettre en uvre la procdure lgale prvue ci-dessus.
La mconnaissance de cette procdure lgale serait constitutive du dlit dentrave. Larticle L.4742-1 du
Code du travail prcise, en effet, que :
Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit la constitution, soit la libre dsignation des
membres, soit au fonctionnement rgulier du CHSCT, notamment par la mconnaissance des dispositions du
livre IV de la deuxime partie relatives la protection des reprsentants du personnel ce comit, est puni
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 .
4 La prudence recommande de mettre systmatiquement en uvre la procdure lgale lors de tout
signalement dun danger grave et imminent par un CHSCT local, en contestant, au cours de la runion du
CHSCT local, la ralit de ce danger.
La mise en uvre de la procdure lgale jusqu son terme (saisine de linspection du travail) permettra le cas
chant davoir une position de linspecteur du travail, qui pourra tre oppose au CHSCT pour une
situation ultrieure comparable, afin de tenter de mettre un terme la pratique de ce dernier consistant
traiter systmatiquement comme danger grave et imminent un manque de personnel.
Rfrences
articles L.4132-2 et suivants du Code du travail
article L.4742-1 du Code du travail
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
193
62- Lalerte la bombe
Le standard de lhpital doit disposer dune fiche remplir en cas dappel dalerte la bombe. Cette fiche doit
comporter a minima les indications suivantes :
date et heure de lappel,
paroles prononces,
caractristiques de la voix : accent, voix calme, nerve,
lments dambiance : bruits de fond,
autres prcisions : localisation, dlai..,
personnes prvenir : administrateur de garde, directeur de cabinet, chef de scurit, police.
Ladministrateur de garde doit sassurer que le standard a rpercut lalerte auprs des diffrentes personnes
prvenir cites ci-dessus.
Ladministrateur de garde doit coordonner lensemble des moyens :
Si une localisation de lexplosif est indique :
prescrire une ronde de scurit, avec instruction de napprocher en aucun cas dun ventuel objet suspect
repr,
dterminer un primtre de scurit dune cinquantaine de mtres,
vacuer le service si ncessaire.
Si lemplacement de lexplosif est inconnu :
attendre larrive des autorits de police.
La dcision dvacuer ltablissement ou une partie de ltablissement appartient au directeur (ou
ladministrateur de garde) en liaison avec le service de police. Elle repose beaucoup sur lapprciation de la
fiabilit de lappel et de lvaluation de la menace (dexprience, la grande majorit de ces alertes relvent de
mauvaises plaisanteries ou de vengeances.)
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
194
63 Les objets suspects trouvs au sein de lhpital
Le cas particulier du plan Vigipirate
Une procdure particulire est prvue en cas de dcouverte dobjets suspects au sein dun lieu appel
recevoir du public, tel quun tablissement de sant, dans le cadre du plan Vigipirate .
La circulaire DHOS du 30 octobre 2001 relative lapplication dans les tablissements de sant du plan
Vigipirate donne des consignes mettre en uvre face la dcouverte de plis ou colis contenant des
substances suspectes ou lors de la dcouverte dobjets abandonns.
Cette circulaire prvoit notamment dlaborer une fiche rflexe consigne en cas de dcouverte dobjet ou
colis suspect qui doit tre connue des chefs de service, des cadres du service et des quipes de scurit.
Les mesures prendre sont de manire gnrale celles applicables aux tablissements recevant du public :
limitation du nombre des accs voiture et pitons,
consignes de vigilance aux agents de scurit : dceler les comportements suspects, assurer un contrle
visuel des vhicules ou des bagages (la fouille nest pas autorise)
augmenter la frquence des rondes de prvention,
dbarrasser les couloirs et autres espaces publics des encombrants : cartons, containers..,
loigner les poubelles extrieures des accs et des btiments,
rappeler rgulirement au personnel hospitalier son rle en matire de surveillance et de dtection des
comportements anormaux.
En cas de dcouverte de vhicule ou dobjet suspect
ne pas approcher ou manipuler le vhicule ou lobjet suspect.
tablir un primtre de scurit
prvenir la police
rechercher dans lenvironnement immdiat toutes informations utiles sur labandon du vhicule ou de
lobjet : comportement insolite, situation inhabituelle, personne suspecte
Rfrences
Circulaire DHOS/E 4 n2001-525 du 30 octobre 2001 relative lapplication dans les tablissements de sant du plan
Vigipirate et des consignes face la dcouverte de plis ou colis contenant des substances suspectes
Circulaire DHOS/E 4 n 2002-356 du 19 juin 2002 relative l'application dans les tablissements de sant du plan
Vigipirate et des consignes face la dcouverte de plis ou colis contenant des substances suspectes
Circulaire DHOS/Cellule/GRD n 2004-362 du 27 juillet 2004 relative aux actions conduire par les tablissements de
sant dans le cadre de l'application du plan Vigipirate
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
195
64 - La circulation et le stationnement dans lenceinte
de lhpital
Pour aller lessentiel.
En cas datteinte la scurit ou lordre public, et notamment lorsque le fonctionnement du service public
hospitalier est compromis, la police doit tre appele pour faire enlever un vhicule (ex : stationnement devant
lentre des urgences, sur une bouche dincendie.),
En cas durgence et de pril grave et imminent pour les intrts dont lhpital a la charge, le directeur (ou
ladministrateur de garde) peut faire dplacer le vhicule gnant par ses propres moyens,
Dans ce cas, les mesures employes doivent tre strictement ncessaires pour faire cesser la situation de
pril.
Qualification juridique des voies internes de lhpital
Les voies de desserte et les parcs automobiles situs dans lenceinte des hpitaux constituent des
dpendances du domaine public des tablissements publics de sant lorsquils sont affects au service
public et spcialement amnags cette fin.
Cependant, ces voies de desserte, ouvertes uniquement au personnel et aux usagers du service public
hospitalier, ne sont pas des voies ouvertes la circulation publique (sauf exception, voir article 38 du
rglement intrieur type de lAP-HP).
En consquence, les dispositions du Code de la route relatives aux rgles dusage des voies ouvertes la
circulation publique ne sont pas applicables.
En outre, la comptence des autorits charges de la police est carte au profit de celle du directeur de
lhpital, responsable du bon ordre et de la discipline au sein de son tablissement. Lautorit de police ne
retrouve sa comptence que dans des hypothses trs exceptionnelles des voies affectes lusage de tous
et qui se retrouvent donc ouvertes la circulation publique (cette situation ne semble pas se prsenter
actuellement au sein des hpitaux de lAP-HP).
Autorits comptentes
Principe :
Il appartient au directeur de lhpital dorganiser le service public dont il a la charge et donc de rglementer
lusage du domaine public.
Il lui revient ce titre dassurer la police de la circulation et du stationnement dans lenceinte de lhpital.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
196
Consquences :
Le directeur de lhpital doit faire connatre au personnel et aux usagers, par tous moyens appropris, les
dispositions du rglement intrieur, ainsi que les mesures prises pour son application et en assurer la
surveillance,
Il doit galement, dans le cadre du plan gnral de circulation soumis pralablement aux instances
reprsentatives de lhpital, rglementer laccs, la circulation, larrt et le stationnement des diverses
catgories de vhicules afin dassurer le bon fonctionnement du service public.
Enfin, la responsabilit de lhpital pourrait tre engage non seulement sur le fondement du risque
loccasion dun dommage de travaux publics, mais aussi sur celui de la faute de service loccasion dun
retard dans la dispense de soins mdicaux appropris, conscutifs des difficults daccs au service
mdical comptent ou dune carence prendre et faire respecter les prescriptions ncessaires.
Les mesures dexcution forces
Dfinition : il sagit en gnral du dplacement dun vhicule irrgulirement stationn sur le domaine public
hospitalier.
Trois hypothses peuvent tre envisages :
soit le vhicule constitue une entrave grave mettant en pril imminent le fonctionnement du service : celui-ci
ne peut tre rtabli que par une mesure de dplacement immdiat du vhicule, ordonne par le directeur et
qui peut tre effectu par le personnel de lhpital (notamment le service de scurit) de lhpital ou par toute
socit de service habilite le faire,
soit le vhicule ne constitue quune gne ne mettant pas en pril le fonctionnement du service : la seule
possibilit est de recourir la procdure de rfr devant le tribunal administratif aprs avoir identifi le
propritaire du vhicule. Ce nest quau vu de lordonnance rendue par le juge quune mesure dexcution
force pourra intervenir,
soit le vhicule est stationn de faon prolonge, mme rgulirement : dans ce cas, larticle 3 de la loi n
70-1320 du 31 dcembre 1970 relative la mise en fourrire, lalination et la destruction des vhicules
terrestres prvoit que peuvent, la demande du matre des lieux et sous sa responsabilit, tre mis en
fourrire, alins et ventuellement livrs la destruction, les vhicules laisss sans droit dans les lieux
publics ou privs o ne sapplique pas le Code de la route .
Cette procdure ncessite obligatoirement une mise en demeure pralable du propritaire du vhicule, puis le
recours lofficier de police judiciaire qui fera procder lenlvement.
La dlivrance et le retrait des autorisations daccs au domaine public
hospitalier
Le directeur de lhpital dispose de prrogatives en matire de dlivrance et de retrait des autorisations
daccs au domaine public hospitalier.
Il peut ce titre :
limiter laccs du domaine public au nombre de vhicules correspondant au nombre de places de
stationnement disponibles au sein de lhpital,
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
197
retirer ou suspendre les autorisations daccs accordes aux personnels en cas dinfraction aux rgles
de circulation et de stationnement,
interdire temporairement ou dfinitivement laccs du vhicule dun usager qui ne respecterait pas les
rgles de circulation et de stationnement dans lenceinte de lhpital.
Rfrences
Articles 38 et suivants du rglement intrieur type de lAP-HP
Circulaire n 2719 du 17 novembre 1977 du Ministre de la Sant relative la circulation et au stationnement des
vhicules automobiles lintrieur des tablissements dhospitalisation publics
Guide DAJDP fvrier 2007 Les prjudices des usagers circulant dans les hpitaux (personnes et vhicules) .
N de tlphone du Responsable de la scurit au Sige de lAP-HP :
Monsieur Grard BROWNE
3, avenue Victoria
Paris 4me
01 40 27 32 68
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
198
65 - La gestion des lits disponibles
Pour aller lessentiel
Les tablissements publics de sant sont tenus daccueillir, de jour comme de nuit, toutes les personnes
dont ltat requiert leur service ou, dfaut, dassurer leur admission dans un autre tablissement pouvant
assurer une prise en charge adapte ltat de sant du patient.
Ladmission dun patient est prononce par le directeur (ou ladministrateur de garde) sur avis mdical
Les principes
Ladmission dun patient est prononce par le directeur (ou ladministrateur de garde) sur avis mdical.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) est tenu de recueillir lavis dun mdecin, mais il nest pas oblig de
le suivre. Ceci indiqu, toute dcision dadmission contre avis mdical doit tre prise avec le discernement
appropri, sentourant des avis mdicaux ncessaires, et pouvoir tre justifie par des motifs prcis.
En cas de refus de prononcer une admission, alors que le patient remplit les conditions requises et que les
disponibilits en lits le permettent, ladmission peut par ailleurs tre prononce par le directeur de lagence
rgionale de lhospitalisation (ARH).
Ladmission en surnombre
En cas de manque de places, le directeur (ou ladministrateur de garde) peut et si la situation lexige doit
prononcer une admission en surnombre, ds lors que lhpital est en mesure de prendre en charge
efficacement le patient. En cas durgence, le manque de places disponibles ne fait pas obstacle ladmission
du patient.
Cette dcision doit cependant tre prise avec le discernement appropri et doit pouvoir tre justifie
ultrieurement par les circonstances.
Cette admission peut consister en ladmission du patient dans une unit de spcialit distincte de celle dont il
relve mdicalement. Elle peut tre provisoire et ne durer que le temps de prendre toutes les mesures pour
organiser le transfert du patient, vers une autre structure..
Dans ce cas, le directeur (ou ladministrateur de garde) doit :
prononcer ladmission, mme en labsence de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les
frais de sjour seraient rembourss lhpital (arrt CAA Paris, 9 juin 1998, Mme B.),
veiller la dlivrance des premiers secours,
tenter dorganiser le transfert du patient vers un autre tablissement, condition que ltat de sant du
patient le permette.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
199
Le transfert
Si le mdecin concern constate que ltat de sant dun patient ou dun bless requiert des soins relevant
dune discipline ou dune technique non pratique au sein de lhpital ou ncessitant des moyens dont
lhpital ne dispose pas, le directeur (ou ladministrateur de garde) doit prendre toutes les mesures
ncessaires pour que le patient ou le bless soit dirig au plus tt vers un tablissement susceptible
dassurer les soins requis.
Sauf urgence, ladmission dans ce nouvel tablissement est dcide aprs entente entre le mdecin du
premier tablissement et le mdecin de lhpital daccueil, au vu dun certificat mdical attestant de la
ncessit du transfert dans un hpital plus adapt.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit :
veiller ce que le patient ait t correctement inform (notamment sur laspect financier et sur les
conditions du transfert) pralablement son transfert, provisoire ou dfinitif dans un autre tablissement,
notifier le transfert du patient la personne prvenir, dsigne par le patient au moment de ladmission
et/ou la famille.
Cas particulier des incubateurs
Si tous les incubateurs de lhpital sont occups, toutes les dispositions doivent tre prises pour le transport
durgence de lenfant prmatur vers lhpital le plus proche disposant dincubateurs.
Rfrences
Article L. 6112-2 du code de la sant publique,
Articles R. 1112-11 R. 1112-14 du code de la sant publique,
Articles 43 et suivants du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
200
66 Les dommages matriels causs aux agents
Pour aller lessentiel
Les dommages subis au cours de lexercice des fonctions doivent tre distingus des autres dommages,
mme sils sont subis galement dans lenceinte de lhpital pendant les heures de service.
Lindemnisation par lAP-HP suppose une responsabilit pour faute de ladministration.
Les hpitaux sont souvent saisis de demandes de ddommagement de la part de leurs agents, victimes au
sein de lhpital, au cours de leur service et tout au moins dans lenceinte de lhpital, de prjudices matriels
dont ils entendent obtenir rparation.
Se pose alors la question de la responsabilit ventuelle de lhpital et, le cas chant, des modalits
dindemnisation des agents.
Certains dommages subis par les personnels hospitaliers dans lenceinte de lhpital sont susceptibles dtre
indemniss et dautres ne le sont pas.
Les dommages matriels causs aux agents
Deux catgories de dommages peuvent tre recenses :
les dommages subis au cours de lexercice des fonctions
les dommages subis dans lenceinte de lhpital pendant les heures de service.
Les dommages subis au cours de lexercice des fonctions
Le cas des bris de lunettes
Ex. : Un membre du personnel soignant, amen dispenser des soins un patient, est victime de ce dernier
dun coup violent assn de faon volontaire ou involontaire (ex. : patient agit, en phase de rveil), causant
la dtrioration de la paire de lunettes.
Lagent victime doit informer son cadre de lincident aux fins dtablir limputabilit de laccident durant le
service et permettre, le cas chant, une prise en charge lie au remplacement des lunettes.
De mme, la dtrioration dun bijou peut constituer un dommage matriel indemnisable. Une grande
rserve simpose toutefois dans une telle hypothse : il ne doit pas tre procd lindemnisation
systmatique de bijoux perdus, dtriors ou mme vols et dont le port, notamment lors dactes mdicaux,
savrerait incompatible avec les conditions dexercice normal des soins.
Une alliance, voire une chane, peuvent tre abmes dans des circonstances semblables celles dune paire
de lunettes et donner lieu rparation. Ce type dindemnisation doit toutefois tre restrictivement entendu.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
201
Le critre essentiel de qualification retenir dans ces circonstances est le lien de causalit entre le
dommage et lexercice des fonctions.
Dommages subis dans lenceinte de lhpital pendant les heures de service
Il peut sagir par exemple dun vol commis dans lenceinte de lhpital
Ex : vols deffets personnels rangs dans les vestiaires ou dans les bureaux des agents
Il peut sagir galement de dgradations causes aux vhicules personnels des agents gars dans le
parking de lhpital.
Lindemnisation de ce type de dommage diffre quelque peu de la prcdente dans la mesure o le lien avec
lexercice des fonctions est moins vident.
Elle implique, toutefois, de la part de la victime du dommage non seulement une dmarche dclarative
semblable celle exige en matire daccident imputable au service, mais surtout la rdaction dune requte
destine prouver une faute de lhpital.
La prise en charge de ces dommages, si elle est envisageable, repose sur une application plus stricte du
rgime de droit commun de la responsabilit de ladministration.
Prise en charge de ce type de dommages
Quelle que soit la nature du dommage subi, le rgime dindemnisation reste le mme : le rgime de
responsabilit pour faute de ladministration.
Seul diffre le degr de reconnaissance de limputabilit au service de laccident ou du dommage.
La faute doit tre prouve. La charge de la preuve incombe lagent sestimant victime du prjudice.
La charge de cette preuve se trouvera dune certaine faon facilite dans les hypothses de dommages subis
au cours de lexercice des fonctions, dans la mesure o une faute dans lorganisation ou le fonctionnement du
service peut tre plus aisment rvle et un accident de service ventuellement reconnu.
Il ny a donc pas lieu dune prise en charge systmatique des dommages de ce type par les hpitaux, lAP-HP
ne devant absolument pas tre assimile une compagnie dassurances : les agents se mprennent parfois
sur ltendue du champ de responsabilit de ltablissement de sant et sur les termes de leur propre police
dassurance quils sabstiennent de mettre en uvre.
Il est important que :
chaque demande de prise en charge soit tudie au cas par cas et, si elle est rejete, le cas chant, le
soit par une dcision motive,
si le principe de lindemnisation est retenu, dans le cas dun accident de service (ex. : bris de lunettes) ou
dune faute prouve de lhpital (ex. : vols deffets personnels en raison de labsence de mise disposition
dun vestiaire personnel fermant clefs), le montant de celle-ci soit rigoureusement calcul.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
202
Les documents justificatifs
Il est ncessaire de demander des factures nominatives, des devis dtaills de rparation, toutes pices
attestant dune prise en charge par des organismes tiers (Scurit Sociale, mutuelle, assurances..), et tout
document utile la quantification du dommage, ces pices permettant de chiffrer prcisment la part
dindemnisation restant le cas chant la charge de lhpital.
Rfrences
Article 30 du rglement intrieur de lAP-HP
Guide AP-HP/DAJDP fvrier 2007 Les prjudices des usagers circulant dans les hpitaux (personnes et
vhicules) .
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
203
67 - En cas de grve ou dabsence injustifie
Pour aller lessentiel
Le droit de grve sexerce dans le cadre des lois qui le rglementent :
obligation de pravis de 5 jours francs, qui ninclut ni le jour du dpt du pravis, ni le jour de
dclenchement de la grve,
en cas de grve gnralise lensemble du personnel, le pravis doit tre adress au Ministre de la sant,
en cas de grve localise, il doit tre adress au directeur de lhpital.
Grve de personnels - Principe
Dfinition : toute cessation concerte et collective du travail de tout ou partie du personnel, en vue de faire
pression sur ladministration hospitalire et obtenir satisfaction de revendications.
Le droit de grve est un principe valeur constitutionnelle.
Limitations de lexercice du droit de grve
En vertu de larticle R. 6147-22 du code de la sant publique, lensemble des directeurs des sites en fonction
lAP-HP sont habilits instaurer un service minimum.
Concernant le pouvoir du directeur dhpital en matire dorganisation du service mdical, larticle
L. 6143-7 du code de la sant publique dispose que le directeur exerce son autorit sur l'ensemble du
personnel dans le respect des rgles dontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de
sant, des responsabilits qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indpendance
professionnelle du praticien dans l'exercice de son art .
En outre, larticle L. 6146-4 du code de la sant publique prvoit que le praticien responsable d'un ple
d'activit clinique ou mdico-technique () organise avec les quipes mdicales, soignantes et
d'encadrement du ple, sur lesquelles il a autorit fonctionnelle, le fonctionnement technique du ple, dans le
respect de la dontologie de chaque praticien et des missions et responsabilits de structure prvues par le
projet de ple.
Ainsi, afin dassurer la continuit du service public, la scurit physique des personnes, la continuit des soins
et des prestations htelires aux hospitaliss et la conservation des installations et du matriel, le directeur
(ou ladministrateur de garde) doit mettre en place un service minimum. Il dispose du pouvoir dassigner les
personnels grvistes. Lautorit prfectorale peut galement faire usage de son pouvoir gnral de
rquisition.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
204
Organisation du service minimum
Il nexiste aucune norme lgislative ou rglementaire quant lorganisation du service minimum en milieu
hospitalier.
Lorganisation du service minimum relve du seul pouvoir du directeur de lhpital. Le moment choisi pour
dclencher le service minimum doit tre concert avec les responsables des structures mdicales
concernes. Ce moment peut donc correspondre au jour et lheure choisis pour le dclenchement de
la grve. Les modalits dorganisation du service minimum peuvent voluer en fonction du mouvement de
grve et de sa dure annonce ou prvisible.
Sagissant de la dtermination du nombre dagents ncessaires lexcution du service minimum, seuls les
agents dont la prsence est strictement ncessaire doivent tre contraints de demeurer en fonction.
Dune manire gnrale, les critres retenus doivent tenir compte de la nature, de la densit en personnel, de
lactivit du service considr ainsi que de la qualit statutaire des agents. La recherche de solutions
ngocies doit tre privilgie.
Dsignation / assignation
En cas de grve du personnel mdical, le directeur de lhpital dispose seul du pouvoir pour assigner les
personnels grvistes.
Dfinition : la dsignation est lacte par lequel le directeur de lhpital dsigne les agents dont la prsence est
juge indispensable pour assurer le fonctionnement du service public hospitalier en cas de grve.
Procdure : aucune disposition lgislative ou rglementaire nimpose la consultation avec les reprsentants
syndicaux. Cette consultation est toutefois recommande.
Toute cessation concerte du travail doit tre prcde dun pravis. Ce pravis constitue une tape
prliminaire essentielle lexercice du droit de grve dans la fonction publique hospitalire et doit tre
dpos 5 jours avant le dclenchement effectif de la grve. Il est ncessaire de demander aux internes de
se dclarer grvistes.
A lAP-HP, le Directeur Gnral et par dlgation le Directeur du Personnel et des Relations Sociales sont les
destinataires des pravis de grve dposs lchelon central. Nanmoins, les directeurs des hpitaux et des
services gnraux ont galement comptence pour rceptionner les pravis qui leur sont adresss. Ils
doivent, dans cette hypothse, en informer le Directeur Gnral et par dlgation le Directeur du Personnel et
des Relations Sociales. De manire gnral, il est important que lAP-HP accuse rception du pravis en
faisant connatre sil est ou non recevable compte tenu des conditions de validit fixes par la loi, notamment
le motif et le dlai.
Durant la priode de pravis, le directeur de lhpital doit tablir une liste nominative des praticiens non
grvistes et grvistes astreints au service minimal. Il doit galement constituer un tableau de garde
porter la connaissance des intresss.
Lassignation doit tre nominative et remise en mains propres ou par lettre recommande avec accus de
rception. Elle doit comporter la date de son application.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
205
La rquisition
Dfinition : la rquisition est lacte qui impose, en cas de grve, lensemble du personnel faisant partie dun
service, considr comme indispensable pour les besoins des usagers, dassurer ses fonctions.
Une dcision rcente :
Le 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rendu, en audience de rfr libert, une
ordonnance suspendant une dcision du 9 octobre 2007 dun directeur dhpital de lAP-HP qui rquisitionnait
une interne pour assurer une garde le jeudi 11 au soir. Le considrant de principe rappelle que sil appartient
au directeur dun centre hospitalier de prendre les mesures ncessites par le fonctionnement des services qui
ne peuvent en aucun cas tre interrompus, en particulier, le maintien en service pendant la journe de grve
dun effectif suffisant pour assurer en particulier la scurit physique, la continuit des soins (), il ne peut,
toutefois, prendre de telles mesures que si elles sont imposes par lurgence et proportionnes aux ncessits
de lordre public au nombre desquelles figurent les impratifs de sant publique ;
Considrant quil ressort des pices du dossier que ladministration a, en dbut du mois doctobre, dress la
liste de garde des internes chargs de la garde dintrieur au SAU , pour chacune des journes du mois avec
mention ventuelle de la qualit de grviste ou de non grviste de linterne concern, Mademoiselle V ayant
t dsigne pour assurer une garde le 11 octobre et note comme grviste ; que le Professeur R
travaillant dans le service de a attest navoir pas t sollicit pour assurer une garde le 11 octobre 2007 ;
quainsi, en rquisitionnant une interne grviste, dont il savait au moins ds le 1
er
octobre quelle ltait, sans
avoir recherch au pralable si dautres praticiens hospitaliers non grvistes pouvaient assurer la garde du 11
octobre 2007, le directeur gnral de lAssistance Publique- Hpitaux de Paris a entach la dcision litigieuse
dune illgalit manifeste qui porte une atteinte grave la libert fondamentale que constitue le droit de grve ;
quil y a lieu, par suite, dordonner la suspension de la dcision litigieuse () .
Il convient donc, au vu de cette dcision de demander au pralable aux praticiens seniors de
prendre les gardes, dans le cadre dun service minimum dfini par les chefs de ples et les chefs de
service ou dunit, avant toute rquisition des internes grvistes. Compte tenu de cette dcision, il est
impratif que les responsables rpondent aux directeurs par crit (mail ou note).
Attention, les dlais du rfr-libert sont trs court (24 h., voire moins) : la DAJDP doit tre immdiatement
avise de la mise en uvre de cette procdure.
Absences de dernire minute Absences injustifies
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit :
veiller au remplacement du personnel absent dans les meilleurs dlais,
tablir un rapport sur les circonstances de labsence du personnel,
adresser un courrier nominatif recommand avec accus de rception (LR/AR) aux membres du personnel
concerns les mettant en demeure de justifier leur absence et linvitant reprendre leur poste.
Attention : ces pices peuvent tre ventuellement utilises dans le cadre dune procdure disciplinaire ou de
licenciement contre le ou les agents concerns. Elles doivent donc tre tablies avec prcision.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
206
Refus de se dplacer pour une garde
Le directeur (ou ladministrateur de garde) doit :
rappeler au professionnel de sant ses obligations, ainsi que les sanctions et responsabilits encourues en
cas de refus de se dplacer (responsabilit pour faute personnelle dtachable du service),
rdiger un rapport circonstanci et dtaill, sur les conditions dans lesquelles le professionnel a refus de
se dplacer.
Lensemble de ces pices pourra le cas chant tre utilis dans le cadre dune procdure disciplinaire ou
contentieuse pour dgager la responsabilit de lhpital. Un refus de se dplacer en cas de garde constitue un
refus dobissance un ordre rgulirement donn pour le service et constitue ce titre une faute
disciplinaire.
Liste des socits dintrim et numros de tlphone :
Rfrences
Articles L. 521-2 et suivants du code du travail
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
207
68 - Les frais de transport sanitaire
Pour aller lessentiel
Lassurance maladie ne prend en charge les frais de transport des patients par ambulance que dans cinq
situations strictement dfinies.
Les rgles de facturation sont diffrentes selon que le transport est primaire ou secondaire.
La prise en charge des frais de transport par ambulance ou vhicule
sanitaire lger (VSL)
Lassurance maladie ne prend en charge les frais de transport par ambulance que dans cinq situations (art.
R. 322-10 du code de la scurit sociale).
Les transports lis une hospitalisation : entre et sortie de lhpital (hospitalisation complte, partielle
et ambulatoire, sous rserve dentente pralable si la distance aller est suprieure 150 kms ou il sagit de
transports en srie), transfert dfinitif vers un autre hpital ;
Les transports pour des soins directement en rapport avec une affection de longue dure (article L.
324-1 du code de la scurit sociale) ou des soins continus suprieurs six mois (transports pour
chimiothrapie, dialyse, radiothrapie) ;
Les transports par ambulance lorsque ltat du malade justifie un transport allong ou une surveillance
constante ;
Les transports de longue distance : lieu distant de plus de 150 kms, sous rserve dentente pralable ;
Les transports en srie : lorsque le nombre de transports prescrits au titre dun mme traitement est au
moins gal quatre au cours dune priode de deux mois et pour une distance aller suprieures 50 km.
Il appartient au mdecin qui prescrit un transport dapprcier avec vigilance le mode de transport le mieux
adapt ltat du patient et dtablir par crit une prescription mdicale de transport.
Les transports inter-hospitaliers sont la charge de ltablissement demandeur, prescripteur du transport,
sauf pour les transferts dfinitifs raliss par des ambulances prives et rembourss directement par la
Scurit sociale.
Dans le cas o un patient hospitalis est convoqu par ltablissement dorigine pour une consultation ou un
traitement faisant suite une hospitalisation dans ses services, cest cet tablissement dorigine, prescripteur
de la consultation ou du traitement, qui est tenu de prendre en charge les frais de transport.
Le transport sanitaire peut-tre primaire ou secondaire
Cette distinction est essentielle puisquelle dtermine les rgles de facturation applicables en la matire.
1. Un transport est primaire lorsquil est effectu en vue de ladmission dun malade dans un tablissement
ou en vue de sa sortie dfinitive.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
208
Ces transports sont pris en charge directement par la scurit sociale sagissant des assurs sociaux.
2. un transport est secondaire lorsquil est effectu pour transfrer un malade dun hpital un autre. Ce
transfert peut-tre :
provisoire : le malade est transfr dans un tablissement plus spcialis, pour soins ou diagnostic, avec
retour dans ltablissement dorigine dans un dlai maximum de 48 heures ;
Les frais de transport sont dans ce cas la charge de ltablissement dorigine. Cette rgle sapplique dans
tous les cas, quil sagisse de transferts effectus par une ambulance de lAP-HP ou par une ambulance
prive titulaire ou non dun march avec les hpitaux.
dfinitif : le malade quitte, mme provisoirement, le premier tablissement pour une dure suprieure 48
heures. Le malade est considr comme sortant du premier hpital et le second sjour hospitalier donne lieu
admission.
Si le transfert est effectu par une ambulance de lAP-HP, les frais sont la charge de lhpital demandeur de
lAP-HP et ne doivent pas donner lieu facturation lgard des organismes dassurance maladie.
Si le transfert est effectu par une ambulance prive, les frais de transport sont la charge de la caisse
dassurance maladie dont relve lassur.
Toutefois, les frais de transport relvent galement de lAP-HP (hpital demandeur) si le transfert est effectu
par une ambulance prive titulaire dun march prvoyant ce type de prise en charge.
Rfrences :
article L. 324-1 du code de la scurit sociale
article R. 322-10 du code de la scurit sociale
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
209
69 Le dpt de plainte
Pour aller lessentiel
La main courante consiste uniquement faire noter les faits rapports dans le registre tenu par le
commissariat ou la gendarmerie.
Contrairement la plainte, elle ne sera pas transmise au Procureur de la Rpublique et ne pourra donc pas
dclencher de poursuites.
La victime peut dposer plainte dans n'importe quel commissariat.
Il n'y a pas de dlai pour dposer une plainte (en dehors du dlai de prescription de l'infraction).
Toute plainte dpose doit tre recueillie par les officiers de police judiciaire (OPJ).
Principe
La plainte est lacte par lequel une personne physique ou morale, majeure, incapable majeure ou mme
mineure, porte la connaissance des autorits de police ou de justice la commission dun crime, dun dlit,
voire dune contravention dont elle sestime la victime, ou dont elle estime que la personne dont elle est
civilement responsable en a t la victime.
Un hpital ne peut se substituer son agent et dposer plainte en ses lieu et place en application du principe
nul ne plaide par procureur . Ainsi, la plainte dun hpital ne peut-elle constituer une plainte de substitution,
mais bien une plainte autonome au titre du propre prjudice de ltablissement, qui devra alors tre chiffr
(plainte avec constitution de partie civile).
De mme, le fait quun agent refuse de dposer plainte ne constitue pas un obstacle au dpt de plainte par
lhpital toujours au titre de son prjudice propre.
Ceci indiqu, laccompagnement de lagent victime dune infraction, par le chef de scurit, le chef du
personnel, voire le directeur des ressources humaines, dans ses dmarches auprs des autorits judiciaires
peut attester du soutien de ltablissement lgard de son agent.
Pour qu'il y ait infraction, trois conditions doivent tre runies :
il faut que l'infraction ait caus un prjudice, c'est dire qu'elle ait constitu une atteinte aux biens, au
corps, l'honneur d'une personne ;
la victime doit prouver la ralit de l'infraction et du prjudice subi par tout moyen. Il est ncessaire
d'apporter tous les lments justificatifs qui permettront d'apprcier la ralit des faits reprochs. Parmi les
lments de preuve figurent par exemple le certificat mdical, l'arrt de travail occasionn par le dommage
subi, les tmoignages, des photographies... S'il s'agit au contraire d'un dommage matriel, il faudra conserver
toutes les factures correspondant la rparation des objets endommags ou vols (portire de voiture
facture, vitre brise...)
le type d'infraction concerne doit tre punie par la loi.
La plainte peut tre dpose contre l'auteur nommment dsign ou, s'il n'est pas connu ou identifi, contre
X .
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
210
La victime dispose d'un dlai au del duquel elle perd ses droits saisir la justice pnale. On parle du dlai
de prescription. Il s'agit du dlai pendant lequel les infractions peuvent tre poursuivies et sanctionnes. Le
dlai de prescription varie en fonction de la nature de l'infraction :
un an pour les contraventions,
trois ans pour les dlits (vol, coups et blessures par exemple),
dix ans pour les crimes (meurtre par exemple).
A l'expiration du dlai, la victime ne pourra demander rparation que devant les juridictions civiles, dans le
dlai de 10 ans
Les modalits du dpt de plainte
1. La plainte simple :
La victime peut porter plainte :
soit au commissariat de police ou la gendarmerie la plus proche du lieu de l'infraction. La dposition
est recueillie oralement et atteste par un procs verbal de rception de plainte. L'intress reoit en retour un
rcpiss indiquant la date et la nature de l'infraction. La plainte est obligatoirement transmise au
procureur de la Rpublique.
soit directement auprs du Parquet du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction en adressant
une simple lettre au procureur. La lettre doit prciser l'tat civil complet, le rcit dtaill des faits, la date et
le lieu de l'infraction, l'estimation du prjudice et les lments de preuve.
Une fois la plainte dpose en bonne et due forme, la victime doit tre patiente, car la loi ne fixe pas de dlai
imparti au procureur de la Rpublique pour se prononcer. Sans nouvelle du suivi de la plainte au bout de
quelques mois, la victime peut se renseigner au bureau d'ordre du parquet pour savoir quelle suite a t
donne au dossier.
Le suivi :
En cas de dpt de plainte simple, le parquet peut dcider :
du classement de la plainte et de ne pas poursuivre. La dcision du procureur est discrtionnaire. Il peut
dcider du classement, car la plainte n'est pas considre comme prsentant des lments de gravit ou ne
constitue pas une infraction, ou encore que l'auteur est inconnu et a toutes les chances de le rester.
de dcider de l'ouverture d'une information. Le procureur demande alors la dsignation d'un juge
d'instruction afin de recueillir tous les lments utiles la manifestation de la vrit.
de faire usage de la mdiation pnale avec l'accord des parties. La mdiation pnale rpare le dommage
caus tout en contribuant la rinsertion sociale de l'auteur.
2. La plainte avec constitution de partie civile :
La plainte avec constitution de partie civile n'est possible qu'en cas de crime ou dlit. Il s'agit d'une plainte sur
papier libre, date, signe, motive, adresse "Monsieur le juge d'instruction" du TGI.
La victime y exprime sa volont de se constituer partie civile, cest--dire de demander en plus de la
condamnation pnale, le versement de dommages et intrts.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
211
La constitution de partie civile peut se faire en cours de procdure si la victime a dpos une plainte simple et
a souhait demander ultrieurement des dommages et intrts.
Le suivi :
En cas de dpt de plainte avec constitution de partie civile, le classement sans suite n'est pas possible. Le
juge d'instruction ouvre obligatoirement une information. A l'issue de l'enqute, il peut renvoyer l'affaire
devant la juridiction de jugement ou rendre une ordonnance de non lieu.
Attention :
Les arrts de dlgation de comptence au sein de lAP-HP prvoient que les directeurs des hpitaux,
groupes hospitaliers et services gnraux, bnficiaires de cette dlgation dans le domaine des affaires
juridiques et des droits du patient ont dlgation (et peuvent dlguer leur signature en cette matire aux
administrateurs de garde) pour les dcisions et les actes se rattachant au dpt de plainte lencontre de
toute personne, lexception de personnels relevant de leur autorit et du rgisseur davances et de recettes
de leur hpital, coupable dune infraction pnale constitutive dun prjudice matriel dun montant infrieur
4 500 euros, commise au dtriment de lhpital, groupe hospitalier ou service gnral.
Au-del de ce seuil de 4 500 euros, la comptence revient au directeur des affaires juridiques et des droits du
patient.
La plainte doit tre distingue du signalement des crimes et des dlits que peuvent constater les personnels
de lhpital dans lexercice de leurs fonctions. Ce signalement, obligatoire au titre de larticle 40 du code de
procdure pnale (sous rserve le cas chant des prcautions qui peuvent tre lies au secret
professionnel), doit tre effectu en principe par ladministrateur de garde ds lors quil prend connaissance
des faits.
Lorsque les faits sont sensibles, il est recommand de prendre contact avec ladministrateur de garde de la
Direction gnrale ou avec la DAJDP pour dcider de qui procdera linformation des autorits judiciaires,
entre le reprsentant de lhpital ou celui de la Direction gnrale.
Pour mmoire, larticle 40 du code de procdure pnale prvoit notamment que Toute autorit constitue,
tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime
ou d'un dlit est tenu d'en donner avis sans dlai au procureur de la Rpublique et de transmettre ce
magistrat tous les renseignements, procs-verbaux et actes qui y sont relatifs .
Rfrences
Articles 15-3 et s. du code de procdure pnale,
article 30 du rglement intrieur type de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
212
70 La protection des agents victimes de violences
lhpital
Pour aller lessentiel.
Ladministration hospitalire est tenue de protger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait
ou injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes loccasion de leurs fonctions et de rparer, le cas
chant, le prjudice qui en est rsult (art. 11 de la loi du 13 juillet 1983, Statut gnral des fonctionnaires).
Principe et procdure
La mise en uvre de l'assistance juridique dfinie l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 implique, pour
l'agent et l'hpital, de respecter diffrentes obligations.
Tout agent victime d'une agression au cours de l'exercice de ses fonctions doit, sans dlai, dposer plainte
soit personnellement, soit accompagn du chef de scurit de l'hpital ou d'un cadre au commissariat le
plus proche du lieu de l'agression.
Afin de se protger contre dventuelles reprsailles de lauteur de linfraction, la victime aura tout intrt, lors
de son dpt de plainte, indiquer ladresse de lhpital et non son adresse personnelle.
Une inscription " en main courante", la diffrence d'une plainte, n'entrainera pas de dclenchement de la
procdure pnale. Elle permettra uniquement de consigner des faits dans un registre de police (v. fiche n
67).
L'agent doit en outre, informer la direction de l'hpital. Celle-ci doit alors en informer la Direction des Affaires
Juridiques et des Droits du Patient (DAJDP), qui est charge, outre sa mission de conseil en la matire, des
modalits de mise en uvre de l'assistance juridique. La DAJDP la tiendra informe des plaintes dposes
par les agents de l'AP-HP, ainsi que de celles dposes au nom des hpitaux. Surtout, ceci permettra
doptimiser la coordination avec les directions hospitalires locales dans l'application de la protection
fonctionnelle.
La saisine de la DAJDP se concrtise par la transmission d'un dossier comprenant un certain nombre de
documents :
la copie de la plainte de l'agent
la copie de celle dpose par l'hpital, le cas chant
un rapport relatant l'ensemble de la situation
si possible, des tmoignages
tout document utile la dfense des intrts de l'agent et de l'AP-HP
la demande d'assistance juridique de l'agent victime de l'agression (demande manuscrite rdige par
l'agent et sollicitant la protection fonctionnelle de l'article 11 ).
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
213
La constitution d'un tel dossier permettra dapprcier le rattachement de l'atteinte subie par l'agent l'exercice
de ses fonctions.
Dans l'hypothse o le Procureur dcidera de donner suite la plainte, il fixera une date d'audience et la
notifiera sous forme d'un avis victime au domicile du plaignant. Ds notification de cette date d'audience,
le directeur de l'hpital saisi par son agent, doit immdiatement en informer la DAJDP et transmettre la
demande d'assistance juridique de l'agent.
L'assistance d'un avocat n'est pas une procdure automatique s'excutant sur simple demande de l'hpital au
bnfice de l'un de ses agents. En effet, cette assistance n'est envisageable qu' la condition que l'agent
victime en ait expressment et personnellement formul la demande auprs de lAP-HP.
Ds rception des lments constitutifs du dossier, la DAJDP dsignera un avocat charg de la dfense des
intrts de l'agent et le cas chant de l'AP-HP.
L'agent conserve toutefois la facult de dsigner son propre avocat, sous rserve de l'information pralable de
la DAJDP.
En tout tat de cause, l'avocat ainsi mandat par la DAJDP se constituera partie civile au nom et pour l'agent
victime de l'agression, dans le but d'obtenir rparation des prjudices subis et recouvrer, le cas chant, le
montant de l'indemnisation fix par le juge pnal, auprs du ou des agresseurs.
Les moyens juridiques la disposition de l'AP-HP face aux situations de violence :
L'hpital peut subir un prjudice "par ricochet" lorsqu'un de ses agents est victime d'un acte de violence.
Cette situation lui permet de s'impliquer dans le processus juridictionnel, le plus souvent aux cts de son
agent. A l'instar de son agent, l'AP-HP peut donc tre amene dposer plainte.
LAP-HP ne peut se substituer son agent et dposer une plainte en ses lieu et place, en application du
principe selon lequel nul ne plaide par procureur .
La plainte de l'hpital ne peut donc constituer une plainte de substitution mais bien une plainte autonome.
Toutefois, et ds lors qu'un prjudice caus l'hpital est identifiable, mme mineur, rien ne s'oppose ce
qu'il soit dpos une plainte par l'AP-HP afin " d'accompagner" la plainte de l'agent.
Le fait que l'agent se refuse dposer plainte ne constitue pas un obstacle au dpt de plainte par l'hpital
au titre de son propre prjudice.
En tout tat de cause, le dpt de plainte par l'hpital n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus ncessaire
aux poursuites pnales.
Rfrences
Article 11 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983
Article 30 du rglement intrieur de lAP-HP
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
214
71 Les situations de maltraitance
Pour aller lessentiel
Face une personne en danger ou victime de mauvais traitements, la loi impose de faon gnrale de ne
pas se taire et, face certaines situations, dagir.
On entend par maltraitance toute violence physique, tout abus sexuel, toute cruaut mentale, toute
ngligence lourde ayant des consquences prjudiciables sur ltat de sant et, pour un enfant, sur son
dveloppement physique et psychique.
Les situations les plus souvent rencontres sont les violences conjugales, les agressions sexuelles intra-
familiales, le harclement moral ou sexuel en milieu professionnel, la maltraitance dun mineur ou dune
personne ge.
Cette procdure sapplique aux situations suivantes :
suspicion de maltraitance interne lAP-HP, signales par la personne elle-mme ou repres par des
personnes externes linstitution ou par un professionnel de linstitution,
suspicion de maltraitance externe (domicile, institutions hors AP-HP.) repres loccasion dune venue
lAP-HP.
Lauteur du signalement et ses modalits
Lvaluation attentive de la situation est un pralable tout signalement. Elle requiert, chaque fois que cela
est possible, la mise en commun, multidisciplinaire, dinformations provenant des diffrentes approches
(mdecins, psychologue, assistante sociale pour les mineurs, etc.).
Tous ces lments doivent tre consigns dans le dossier mdical et social de la victime.
En principe, le signalement seffectue par crit et est accompagn dun certificat mdical des constatations.
Dans la pratique, il peut tre donn par tout moyen, y compris par appel tlphonique. Dans ce cas, il doit
tre conserv trace de lauteur du signalement et la date de lappel.
Larticle 226-14 du code pnal tablit une drogation au secret mdical. Il prvoit que tout professionnel qui
porte la connaissance des autorits administratives, mdicales ou judiciaires un cas de maltraitance
nencourt aucune sanction pnale pour violation du secret professionnel.
Cette disposition autorise la dnonciation des violences, mais daucune manire celle de leur auteur
prsum, que celui ci en ait fait laveu au mdecin ou que ce dernier lait dduit des ses observations.
Le mdecin nest tenu que de signaler les faits constats, cest dire seulement les constations mdicales
quil a t amen faire.
De mme, tout professionnel qui informe les autorits comptentes dans les conditions prvues cet article
nencourt aucune sanction professionnelle.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
215
Dans un cas flagrant de maltraitance, le mdecin ne doit pas hsiter alerter les autorits administratives
(mdecin inspecteur de la sant, mdecin chef de PMI, assistantes sociales des secteurs ou tablissements)
et les autorits judiciaires (procureur de la Rpublique, substitut)
Cependant, larticle 44 du code de dontologie est nuanc : il permet au mdecin dagir avec prudence et
circonspection et de faire un signalement aux autorits administratives et judiciaires en fonction du risque pour
protger au mieux la personne en fonction de plusieurs facteurs (sans oublier, quil pourra ultrieurement avoir
se justifier) :
un signalement aux autorits sur de simples prsomptions peut dstabiliser une famille ;
une surveillance troite et un accompagnement du milieu familial en quipe pluridisciplinaire
(enseignants, ducateurs, travailleurs sociaux) peut tre suffisante ; mais le mdecin a limprieux devoir
dintervenir. Le silence ou labsence dintervention sont rprhensibles notamment lorsque le mdecin a
acquis la certitude des svices ou mauvais traitements (art 223-6 du code pnal).
La maltraitance du mineur de moins de 15 ans :
Le signalement peut tre administratif et adress au prsident du Conseil gnral, lattention de la Cellule
de recueil et de traitement des informations proccupantes (organe cr par la loi n 2007-293 du 5 mars
2007 rformant la protection de lenfance). Selon les circonstances, ce dernier chargera les services du
secteur social polyvalent, le service de PMI ou le service de laide sociale lenfance de procder une
valuation pour estimer ltat de danger et prciser les besoins de lenfant et de sa famille.
Le signalement peut tre judiciaire lorsque la protection du mineur apparat urgente (mauvais traitements
avrs, rvlation dabus sexuel). Il est adress au substitut du procureur de la Rpublique en charge des
mineurs (au TGI du lieu de rsidence habituel du mineur) qui dcidera :
de lopportunit dune enqute complmentaire confie un service de police ou de
gendarmerie ;
de la poursuite du ou des prsums auteurs de violences en transmettant le dossier un juge
dinstruction ;
de la saisine du juge des enfants au titre de lassistance ducative
En urgence, le substitut des mineurs peut intervenir pour prendre toute mesure conservatoire et dcider le
placement du mineur.
Sauf exception (cas dabus sexuel), la famille doit tre tenue informe.
En outre, aux termes de lart. L. 226-4-II du Code de laction sociale et des famille, tout professionnel qui
avise directement, du fait de la gravit de la situation, le procureur de la Rpublique de la situation dun
mineur en danger adresse une copie de cette transmission au prsident du conseil gnral. [] .
La maltraitance du mineur de plus de 15 ans et de ladulte:
Lautorisation de la victime doit tre obtenue pralablement au signalement, sauf si celle ci nest pas en
mesure de se protger en raison de son ge, dune maladie, dune infirmit, dune dficience physique ou
psychique ou dun tat de grossesse.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
216
Le signalement est judiciaire et se fait auprs du procureur de la Rpublique sur le fondement de larticle 40
du Code de procdure pnale.
La maltraitance des personnes ges et des personnes majeures handicapes
A lAP-HP, une dmarche en cohrence avec la politique nationale et rgionale de prvention et de lutte
contre la maltraitance des personnes ges est engage. Aussi, la maltraitance sinscrit parmi les
vnements indsirables qui doivent tre signals et consigns par crit sur la fiche de signalement
d vnement indsirable .
Aprs avoir inform la victime et son entourage, le mdecin doit sefforcer dobtenir le consentement de la
personne concerne pour toute information ou signalement :
2 hypothses :
linformation auprs des autorits administratives comptentes (secteur social polyvalent, CCAS,) : le
consentement de la personne vulnrable nest pas requis
le signalement judiciaire auprs du procureur de la Rpublique : en principe, le consentement de la
personne vulnrable doit tre recueilli.
A titre exceptionnel, le mdecin (extrme vulnrabilit, pril imminent pour la victime) peut dans lintrt du
patient, informer et/ou signaler sans le consentement pralable.
Rfrences
Article 226-14 du Code pnal et article 40 du Code de procdure pnale
Articles 43 et 44 du Code de dontologie mdicale
Loi n 2007-293 du 5 mars 2007 rformant la protection de l'enfance
Circulaire DGAS/SD2 n 2002-280 du 3 mai 2002 relative la prvention et la lutte contre la
maltraitance envers les adultes vulnrables, et notamment les personnes ges
Arrt du 16 novembre 2002 portant cration du Comit national de vigilance contre la maltraitance des
personnes ges
Guide AP-HP Lenfant, ladolescent lhpital (2002)
Document AP-HP La maltraitance des personnes ges et des personnes majeures handicapes
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
217
72 Les risques sanitaires et leur signalement
Pour aller lessentiel.
Lhpital est expos de nombreux risques sanitaires, dont certains font lobjet dune vigilance
spcifique et, en cas dincident, dune procdure de signalement obligatoire.
Cest tout lobjet dune part du dispositif relatif aux maladies dclaration obligatoire (MDO) et
dautre part des systmes de biovigilance, dhmovigilance, de matriovigilance, de
pharmacovigilance, de ractovigilance, de toxicovigilance, ainsi que de signalement dinfection
nosocomiale.
La survenance de ce type de risque doit tre signale selon des formes spcifiques, et en principe
sans dlai, aux instances internes (correspondant vigilance local, CLIN,), aux autorits sanitaires
(DDASS,) ou aux agences sanitaires (AFSSAPS, INVS,) concernes.
N de tlphone de la Coordination des Vigilances et des Risques sanitaires de lAP-HP :
Dr. Marie-Laure PIBAROT
Tl. : 01.40.27.18.41 Fax : 01.40.27.19.09
En cas durgence aux heures non ouvrables, contacter le standard du sige : 01.40.27.30.00
Les maladies dclaration obligatoire (MDO)
Obligation et modalits du signalement :
Qui doit dclarer ?
Tout mdecin ou biologiste suspectant ou diagnostiquant une des maladies dclaration obligatoire (MDO).
Liste des 30 maladies dclaration obligatoire :
botulisme, brucellose, charbon, chikungunya, cholra, dengue, diphtrie, fivres hmorragiques africaines,
fivre jaune, fivre typhode et fivres paratyphodes, hpatite aigu A, infection aigu symptomatique par le
virus de lhpatite B, infection par le VIH quel quen soit le stade, infection invasive mningocoque,
lgionellose, listriose, orthopoxviroses dont la variole, paludisme autochtone, paludisme dimportation dans
les dpartements doutre-mer, peste, poliomylite, rage, rougeole, saturnisme de lenfant mineur, suspicion de
maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encphalopathies subaigus spongiformes transmissibles humaines,
ttanos, toxi-infection alimentaire collective, tuberculose, tularmie, typhus exanthmatique.
Destinataire, dlai et forme du signalement :
La dclaration doit tre effectue auprs du mdecin inspecteur de sant publique de la DDASS, sans dlai,
par tlphone ou fax (aux heures non ouvrables, lastreinte est assure par la Prfecture du dpartement).
Elle doit tre notifie, aprs confirmation du diagnostic, au moyen dune fiche spcifique tlchargeable sur le
site de lINVS : http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/mdo/liste_mdo.htm
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
218
Rfrences
Articles L. 13113-1, R. 3113-1 R. 3113-5, D. 3113-6 et D. 3113-7 du Code de la sant publique
La biovigilance
Obligation et modalits du signalement :
Qui doit dclarer ?
Tout mdecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, biologiste, sage-femme, infirmire ou infirmier, quel que soit
son mode dexercice.
Produits concerns :
Les produits du corps humains utiliss des fins thrapeutiques ; les produits, autres que les mdicaments,
qui en drivent ; les dispositifs mdicaux les incorporant ; les produits thrapeutiques annexes (sont exclus les
gamtes et les produits sanguins labiles).
Les vnements devant tre dclars :
La survenance chez un patient, un donneur vivant ou un receveur dun incident ou dun effet indsirable li
un produit concern.
On entend par :
- effet indsirable : la raction nocive survenant chez un patient, un donneur vivant ou un receveur, lie ou
susceptible d'tre lie un produit ou une activit de biovigilance (la nature de ces activits est prcise aux
articles R. 1211-29 et R. 1211-30 du code de la sant publique : voir le site Legifrance)
- incident : l'incident li aux activits mentionnes au 1 de l'article R. 1211-30 du code de la sant
publique (voir sur le site Legifrance), d un accident ou une erreur, susceptible d'entraner un effet
indsirable chez le patient, le donneur vivant ou le receveur.
Les destinataires, le dlai et la forme du signalement :
La dclaration doit tre faite auprs du correspondant local de biovigilance. En son absence ou en cas
durgence, elle doit tre effectue auprs de lAFSSAPS, avec information lAgence de la biomdecine, sans
dlai et selon le modle fix par lAFSSAPS et tlchargeable ladresse suivante :
http://afssaps.sante.fr/htm/10/bv/indbiovi.htm (rubrique signalements et dclarations).
Rfrences
Articles L. 1211-7 et R. 1211-29 R. 1211-48 du Code de la sant publique
Dfinition de lincident et de leffet indsirable, voir art. R. 1211-31 du Code de la sant publique
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
219
Lhmovigilance
Obligation et modalits du signalement :
Qui doit dclarer ?
Tout professionnel de sant qui constate ou a connaissance d'un effet indsirable survenu chez un receveur
de produits sanguins labiles doit le signaler sans dlai au correspondant d'hmovigilance de l'hpital dans
lequel a t administr le produit. A dfaut de pouvoir le joindre, il doit le signaler au correspondant
d'hmovigilance d'un tablissement de transfusion sanguine, qui transmettra cette information au
correspondant d'hmovigilance comptent.
Le correspondant d'hmovigilance de l'hpital dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause doit
procder aux investigations et examens appropris dans le service concern. Il doit informer le correspondant
de l'tablissement de transfusion sanguine rfrent et rdiger, en concertation avec lui, une fiche de
dclaration d'effet indsirable survenu chez un receveur. Une copie de cette fiche doit tre verse au dossier
mdical du receveur.
Si des effets indsirables susceptibles d'tre dus un produit sanguin labile sont apparus chez un patient
auquel ont galement t administrs des mdicaments drivs du sang ou des produits biologiques relevant
d'une autre vigilance, une copie de la fiche de dclaration d'effet indsirable survenu chez ce patient doit tre
communique au correspondant de la vigilance concerne.
Les produits concerns :
Les produits sanguins labiles (PSL)
Les vnements devant tre dclars :
Lhmovigilance comporte pour tout produit sanguin labile :
1 le signalement et la dclaration de tout incident grave
2 le signalement et la dclaration de tout effet indsirable survenu chez un donneur de sang
3 le signalement et la dclaration de tout effet indsirable survenu chez un receveur de produit sanguin
labile
On entend par :
1 effet indsirable : la raction nocive survenue chez les donneurs et lie ou susceptible d'tre lie aux
prlvements de sang ou survenue chez les receveurs et lie ou susceptible d'tre lie
l'administration d'un produit sanguin labile ;
2 effet indsirable grave : l'effet indsirable entranant la mort ou mettant la vie en danger, entranant
une invalidit ou une incapacit, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ou tout autre tat
morbide ;
3 incident : l'incident li aux prlvements de sang, la qualification biologique du don, la
prparation, la conservation, la distribution, la dlivrance ou l'utilisation de produits sanguins
labiles, d un accident ou une erreur, susceptible d'affecter la scurit ou la qualit de ce produit
et d'entraner des effets indsirables ;
4 incident grave : l'incident susceptible d'entraner des effets indsirables graves.
Les destinataire, le dlai et la forme du signalement :
LAgence franaise de scurit sanitaire des produits de sant (AFSSAPS) et le correspondant rgional
dhmovigilance (CRH) doivent tre destinataires simultanment des fiches de dclaration dincident grave et
des fiches de dclaration deffet indsirable survenu chez un donneur ou un receveur. LEtablissement
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
220
franais du sang (EFS) et le Centre de transfusion des armes (CTSA) doivent chacun tre destinataires des
fiches de dclaration les concernant.
Rfrences
Articles L. 1221-13 et R. 1221-22 R. 1221-52 du Code de la sant publique
La matriovigilance
Obligation et modalits du signalement
Qui doit dclarer ?
Toute personne, fabricant, utilisateur, ou tiers ayant connaissance dun incident ou risque dincident grave.
Les produits concerns :
Les dispositifs mdicaux, soit tout instrument, appareil, quipement, matire, produit, l'exception des
produits d'origine humaine, ou autre article utilis seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels
intervenant dans son fonctionnement, destin par le fabricant tre utilis chez l'homme des fins mdicales
et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni
par mtabolisme, mais dont la fonction peut tre assiste par de tels moyens.
Les vnements devant tre dclars :
Tout incident ou risque dincident grave (ayant entran ou susceptible dentraner la mort ou la dgradation
grave de ltat de sant dun patient, dun utilisateur ou dun tiers) ou vnement indsirable mettant en cause
un dispositif mdical.
Les destinataires, le dlai et la forme du signalement :
Le correspondant local de matriovigilance doit tre destinataire du signalement. En son absence ou en cas
durgence, il convient dinformer lAFSSAPS, avec information du fabricant. Le signalement doit tre effectu
sans dlai pour les incidents ou risques dincident grave, et de manire trimestrielle pour les vnements
indsirables. Il doit tre effectu selon le formulaire Cerfa n 10246*02 tabli par lAFSSAPS, tlchargeable
ladresse : http://www.sante.gouv.fr/cerfa/dispo_med/amaterio20.pdf, par fax ou courrier lectronique, en y
joignant, le cas chant, un questionnaire-type complt ou tout document jug utile lvaluation de
lincident.
Rfrences
Articles L. 5212-1 L. 5212-3 et R. 5212-1 R. 5212-35 du Code de la sant publique
La pharmacovigilance
Obligation et modalits du signalement :
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
221
Qui doit dclarer ?
Le mdecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme, tant ou non prescripteur, le pharmacien, qui a dlivr le
produit, ou tout autre professionnel de sant.
Les produits concerns :
Tous les mdicaments, y compris les mdicaments drivs du sang, les prparations magistrales, les vaccins,
les allergnes, les toxines, les srums, les mdicaments radiopharmaceutiques, les prparations
homopathiques, les produits contraceptifs, les insecticides et les acaricides usage humains, les gaz
mdicaux et les autres mdicaments dorigine humaine.
Les vnements devant tre dclars :
Tout effet indsirable grave ou inattendu susceptible dtre d un mdicament ou produit concern.
On entend par :
- "effet indsirable grave" : un effet indsirable ltal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entranant
une invalidit ou une incapacit importante ou durable, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou
se manifestant par une anomalie ou une malformation congnitale ;
- "effet indsirable inattendu" : un effet indsirable dont la nature, la svrit ou l'volution ne correspondent
pas aux informations contenues dans le rsum des caractristiques du produit.
Les destinataires, les dlais et la forme du signalement :
Le signalement doit tre effectu auprs du centre rgional de pharmacovigilance (CRPV) comptent. La liste
de ces centres rgionaux est consultable ladresse suivante : http://agmed.sante.gouv.fr/htm/2/2200c.htm.
Le signalement doit tre effectu immdiatement aprs le constat ou la connaissance de la survenance du
risque. Une fiche est tlchargeable ladresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/cerfa/efindes/abvitot.pdf
Rfrences
Articles L. 5121-20 et R. 5121-150 R. 5121-201 du Code de la sant publique
La ractovigilance
Obligation et modalits du signalement :
Qui doit dclarer ?
Tous les professionnels de sant utilisateurs.
Les produits concerns :
L'ensemble des dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro aprs leur mise sur le march ainsi que les
dispositifs mdicaux de diagnostic in vitro fabriqus par un tablissement dispensant des soins, pour son
propre usage et utiliss exclusivement au sein de ce mme tablissement, sur leur lieu de fabrication ou dans
des locaux situs proximit immdiate.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
222
Les vnements devant tre dclars :
Toute dfaillance ou altration susceptible d'entraner des effets nfastes pour la sant des personnes.
Les destinataires, les dlais et la forme du signalement :
Le signalement doit tre effectu auprs du correspondant local de ractovigilance. En son absence ou en
cas d'urgence, il doit tre effectu auprs de lAFSSAPS. Il doit tre ralis sans dlai et selon le modle fix
par lAFSSAPS et tlchargeable ladresse suivante : http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/3/reacto.pdf
Rfrences
Articles L. 5222-1 L. 5222-4 et R. 5222-1 R. 5222-19 du Code de la sant publique
La toxicovigilance
Obligation et modalits du signalement :
Qui doit dclarer ?
Tous les professionnels de sant.
Les produits concerns :
Les produits ou substances naturels ou de synthse ou les situations de pollution, l'exception de celles
relevant de systmes nationaux particuliers de vigilance, notamment celui de pharmacovigilance.
Les vnements devant tre dclars :
Les cas d'intoxications aigus ou chroniques aux produits cits ci-dessus, dont les effets toxiques sont
potentiels ou avrs.
Les destinataires, les dlais et la forme du signalement :
Les correspondants dpartementaux des centres antipoison (v. les coordonnes sur le site internet suivant :
http://www.centres-antipoison.net ) ; pas de dlai rglementaire fix ; pas de fiche spcifique de signalement.
Rfrences
Articles R. 1341-11 R. 1341-22 du Code de la sant publique
Linfectiovigilance (infections nosocomiales)
Obligation et modalits du signalement :
Qui doit dclarer ?
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
223
Le professionnel de sant dsign par le directeur de ltablissement, aprs avis du CLIN, pour transmettre
sans dlai les signalements par crit la DDASS et au CCLIN.
Les vnements devant tre dclars :
1. Les infections nosocomiales ayant un caractre rare ou particulier du fait :
- de lagent pathogne en cause (nature, caractristiques ou profil de rsistance),
- de la localisation de linfection,
- de lutilisation dun dispositif mdical,
- de procdures ou pratiques pouvant exposer ou avoir expos dautres personnes au mme risque
infectieux, lors dun acte invasif.
2. Les dcs lis une infection nosocomiale.
3. Les infections nosocomiales suspectes dtre causes par un germe prsent dans leau ou dans lair
environnant.
4. Les maladies devant faire lobjet dune dclaration obligatoire et dont lorigine nosocomiale peut tre
suspecte.
Les destinataires, les dlais et la forme du signalement :
Le signalement doit tre effectu auprs de la DDASS, du CCLIN, de lquipe dhygine du Sige de lAP-HP,
sans dlai, sur une fiche de signalement des infections nosocomiales, tablie selon le modle disponible sur
le site du CCLIN Paris Nord : http://www.cclinparisnord.org/ACTU_DIVERS/fiche2003.pdf
Rfrences
Articles L. 6111-1 et R. 6111-1 R. 6111-26 du Code de la sant publique
Circulaire DHOS/E2 DGS/SD5C n 2001/383 du 30 juillet 2001 relative au signalement des infections
nosocomiales et linformation des patients en matire dinfection nosocomiale dans les tablissements de
sant.
Circulaire DHOS/E2 DGS/SD5C n 21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections
nosocomiales et linformation des patients dans les tablissements de sant.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
224
73 Lafflux de victimes, les circonstances
exceptionnelles et les plans blancs
Pour aller lessentiel
Ladministrateur de garde doit pouvoir disposer immdiatement de :
la liste des personnes rfrents pour lhpital en cas de dclenchement du Plan blanc,
la localisation du Plan blanc au sein de lhpital.
Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur doit prendre toutes les mesures justifies par la nature des
vnements et proportionnes la gravit de la situation.
Le comit local dhygine, de scurit et des conditions de travail (CHSCT local) doit en tre inform pour les matires
relevant de sa comptence.
Le directeur (ou ladministrateur de garde) peut faire procder dans ces circonstances, avec laccord et en
prsence des intresss, louverture des vestiaires, armoires individuelles, vhicules, ou des
investigations dans les chambres dhospitalisation.
Il peut, dans les mmes conditions, faire interdire laccs de lhpital toute personne qui se refuserait se
prter aux mesures gnrales ventuelles quil a dcides. Sont notamment concernes louverture des sacs,
bagages ou paquets, vhicules, ou la justification par les personnes du motif de leur accs sur le site de
lhpital.
En cas de pril grave et imminent pour lhpital, pour son personnel ou pour un ou plusieurs de ses usagers, le
directeur (ou ladministrateur de garde) peut en outre et mme dfaut de consentement des intresss, faire
procder en urgence linspection de certains locaux et lexamen de certains mobiliers ou vhicules. Il peut aussi
dcider dun primtre de scurit ou dune vacuation.
En situation de catastrophe ou lors du dclenchement de plans durgence, le directeur (ou ladministrateur de garde)
doit prendre toutes les mesures indispensables lexcution de la mission de service public de lhpital, notamment
quant laccueil, laccs, la circulation ou le stationnement.
Plan blanc des hpitaux
Gnralits
(v. aussi, au dbut du mmento, Lorganisation de la garde administrative Lorganisation de crise )
La mise en uvre de la cellule de crise de lhpital ncessite lexistence dun lieu ddi la gestion de crise,
organis pour tre oprationnel dans un dlais infrieur une heure et demie.
Ce local doit rassembler les terminaux des systmes dinformation rservs au temps de crise (tlphone,
tlcopie, messagerie lectronique). Il doit tre situ au calme, hors de la chane des soins et protg du
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
225
public et des journalistes. Les membres de la cellule de crise et leur supplants doivent tre rpertoris,
joignables 24h/24 et entrans la gestion de crise.
Plans blancs largis
Ces plans sont des dispositifs de niveau dpartemental, la disposition des prfets, leur permettant de
coordonner lengagement gographique des ressources, notamment en matire doffre de soins.
Si l'afflux de patients ou de victimes o la situation sanitaire le justifient, le prfet de dpartement peut
procder aux rquisitions ncessaires de tous biens et services, et notamment requrir le service de tout
professionnel de sant, quel que soit son mode d'exercice, et de tout tablissement de sant ou tablissement
mdico-social. Il doit dans ce cas informer sans dlai le directeur de l'agence rgionale de l'hospitalisation
(ARH), le service d'aide mdicale urgente (SAMU) et les services d'urgences territorialement comptents,
ainsi que les reprsentants des collectivits territoriales concernes du dclenchement de ce plan.
Ces rquisitions peuvent tre individuelles ou collectives. Elles doivent tre prononces par un arrt
motiv fixant la nature des prestations requises, la dure de la mesure de rquisition, ainsi que les modalits
de son application. Le prfet de dpartement peut faire excuter d'office les mesures prescrites par cet arrt.
Rfrences
Articles L. 3110-7 L. 3110-10 du code de la sant publique,
Loi du 9 aot 2004 relative la politique de sant publique,
Article 67 du rglement intrieur de lAP-HP.
Les mesures fondamentales du Plan blanc des hpitaux
modalits de dclenchement et de leve du plan
activation de la cellule de crise locale
scurisation priphrique et contrle des accs
organisation de la circulation et du stationnement
mobilisation des personnels
mobilisation des matriels
augmentation des capacits dhospitalisation
accueil et orientation des victimes
traabilit des patients hospitaliss
information des familles et des proches
communication interne et externe
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
226
Dispositif PLAN BLANC de lhpital :
Coordonnes utiles :
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
227
74 La scurit incendie
Insrer ici les consignes locales obligatoires de lhpital :
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
228
75 Le plan national canicule
Ce plan repose sur trois niveaux dalerte, en fonction de llvation de la temprature atmosphrique.
le niveau 1 veille saisonnire : il correspond une situation de veille pendant la priode du 1
er
juin au
1
er
octobre ;
le niveau 2 mise en garde et action : il correspond un niveau dalerte active en fonction des
prvisions de Mto France, de dpassement pendant trois jours conscutifs des seuils biomtorologiques
qui sont pour lIle-de-France : 31C la journe et 21C la nuit ;
le niveau 3 mobilisation maximale : canicule avec impact sanitaire, tendue.
La dcision de passage au niveau 2 ou 3 est prise par les autorits prfectorales.
Le Plan national canicule se dcline localement par un Plan de gestion dune canicule dpartemental (PGCD).
Ce plan labor par le prfet de dpartement comprend quatre volets : a) lorganisation des services publics,
b) les personnes ges et personnes handicapes, c) la sant publique et d) les tablissements de sant et
professionnels de sant.
Le quatrime volet concerne les hpitaux accueillant des personnes ges et consiste mettre en place un
Plan bleu qui fixe le mode gnral dorganisation de lhpital pour faire face la survenue dune canicule.
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
229
76 Les inondations
Insrer ici les consignes locales obligatoires de lhpital:
Version septembre 2008
Tous les textes cits dans le mmento sont directement accessibles sur le site de la DAJDP : http://daj.ap-hop-paris.fr/
230
77 Les agents de scurit
Insrer ici les consignes locales concernant les agents de scurit telles quelles rsultent des
contrats passs avec les socits prives de gardiennage :
Vous aimerez peut-être aussi
- Raisonnement et argumentation infirmiers: Essai de logique et rhétorique des sciences infirmièresD'EverandRaisonnement et argumentation infirmiers: Essai de logique et rhétorique des sciences infirmièresPas encore d'évaluation
- Hygiene Et Transport MédicalDocument41 pagesHygiene Et Transport Médicalelmosawida100% (1)
- Santé Hopitale General MsilaDocument116 pagesSanté Hopitale General MsilasiliaPas encore d'évaluation
- GNR Formateur EgeDocument246 pagesGNR Formateur EgeurletdespartanPas encore d'évaluation
- Gestion de Risque Radiotherapie IgrDocument24 pagesGestion de Risque Radiotherapie IgrlouisgdvallePas encore d'évaluation
- L’assurance R.C. auto: Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989D'EverandL’assurance R.C. auto: Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989Pas encore d'évaluation
- DICOM Guide BlocsOpératoiresDocument47 pagesDICOM Guide BlocsOpératoiresiadh ksiraPas encore d'évaluation
- AvpppppDocument55 pagesAvpppppipmedPas encore d'évaluation
- Cours Sis2 - Partie 2 - msp2 - Ucac 2018 deDocument132 pagesCours Sis2 - Partie 2 - msp2 - Ucac 2018 deMathias Gouané Leyambé DamaPas encore d'évaluation
- Chef D Équipe Sapeur-Pompier VolontaireDocument20 pagesChef D Équipe Sapeur-Pompier Volontaireomar benounaPas encore d'évaluation
- Renforcement Du Système de Gestion de Stocks Et Amélioration de La Logistique Hospitalière Analyse Par L'approche SystémiqueDocument230 pagesRenforcement Du Système de Gestion de Stocks Et Amélioration de La Logistique Hospitalière Analyse Par L'approche SystémiqueIslam El OusroutiPas encore d'évaluation
- Bloc Operatoire ConceptionDocument39 pagesBloc Operatoire ConceptionGaelor NdoumaPas encore d'évaluation
- Prevention Routiere AssuranceDocument16 pagesPrevention Routiere AssuranceSlimane ZadoudPas encore d'évaluation
- CoursDocument25 pagesCoursvicente ondo nguema medja100% (1)
- Bureau EntreesDocument75 pagesBureau EntreesRekia Al SidPas encore d'évaluation
- Secourisme en Milieu de Travail PDFDocument253 pagesSecourisme en Milieu de Travail PDFVE NOMPas encore d'évaluation
- Organisation Du Systeme de Soins Sa Regulation Les Indicateurs Parcours de SoinsDocument6 pagesOrganisation Du Systeme de Soins Sa Regulation Les Indicateurs Parcours de SoinsLouisGrasso100% (1)
- Techniques Chirurgicales Pr. Tshimbila Kabangu Jean-marie-VianneyDocument130 pagesTechniques Chirurgicales Pr. Tshimbila Kabangu Jean-marie-VianneyFARTIN JustinPas encore d'évaluation
- Normes Zs Actualisees Juillet 2012xDocument75 pagesNormes Zs Actualisees Juillet 2012xFrancisPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'études: Etat de Lieu Du Système D'information Hospitalier (SIH) de L'hôpital Général PeltierDocument69 pagesMémoire de Fin D'études: Etat de Lieu Du Système D'information Hospitalier (SIH) de L'hôpital Général PeltierTauriel MirkwoodPas encore d'évaluation
- De L'importance Du Vase D'expansion Dans Le Solaire ThermiqueDocument10 pagesDe L'importance Du Vase D'expansion Dans Le Solaire Thermiqueeric_leysens9093Pas encore d'évaluation
- Plan ORSECDocument5 pagesPlan ORSECLaurent DavidPas encore d'évaluation
- 03P63Document67 pages03P63Midouri DjafferPas encore d'évaluation
- Samu StrasbourgDocument61 pagesSamu StrasbourgFrancois GregoirePas encore d'évaluation
- FT 03. Chaîne de SecoursDocument1 pageFT 03. Chaîne de SecoursSocieté EpsPas encore d'évaluation
- Carnet de StagedelinfirmierpolyvalentDocument58 pagesCarnet de StagedelinfirmierpolyvalentNorth StarPas encore d'évaluation
- 2018 Ibo Dmi F RabarinDocument74 pages2018 Ibo Dmi F RabarinFeriel FerielPas encore d'évaluation
- Mouhib ADocument66 pagesMouhib Ahh100% (1)
- L'Hygiène Hospitalière Au Niveau de Service de Chirurgie (Homme Femme)Document77 pagesL'Hygiène Hospitalière Au Niveau de Service de Chirurgie (Homme Femme)Alaâ BoukhalfaPas encore d'évaluation
- Contrôle Secourisme 2Document1 pageContrôle Secourisme 2Serraji Max100% (1)
- RemerciementsDocument58 pagesRemerciementsbhtukg ghigihPas encore d'évaluation
- Audit en HospitalDocument33 pagesAudit en HospitalAhmad LanePas encore d'évaluation
- Radiologie IRMDocument1 pageRadiologie IRMopaze45Pas encore d'évaluation
- 2016 10 28 Protocole de Soins Infirmiers Et FichesDocument146 pages2016 10 28 Protocole de Soins Infirmiers Et FichesLina BernoussiPas encore d'évaluation
- Eea Rapport FINAL 2019Document38 pagesEea Rapport FINAL 2019Mariam SajidPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 1er Année Bts Systémes Et Reseaux InformatiqueDocument22 pagesRapport de Stage 1er Année Bts Systémes Et Reseaux InformatiqueHajar KhraisPas encore d'évaluation
- Fiche Navette ÉOSDocument1 pageFiche Navette ÉOSAdrien ThéveleinPas encore d'évaluation
- 2e V Canevas Plan Action Régional SE V FDocument31 pages2e V Canevas Plan Action Régional SE V FDina RimaPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage A Lhopital Central de YaoundeDocument4 pagesRapport de Stage A Lhopital Central de YaoundePaule MbellegPas encore d'évaluation
- Memoire Ons Hassine ISISDocument73 pagesMemoire Ons Hassine ISISÑàdá EzZïńàPas encore d'évaluation
- Memoire DARSEBA AminaDocument47 pagesMemoire DARSEBA AminaسميةPas encore d'évaluation
- Plan 5 Mars 2013 PDFDocument13 pagesPlan 5 Mars 2013 PDFabdo massoudiPas encore d'évaluation
- Gestion Préopératoire Du Risque InfectieuxDocument116 pagesGestion Préopératoire Du Risque Infectieuxionescu_paul2002Pas encore d'évaluation
- Fassi Fihri Ahmed MEnv 2016Document122 pagesFassi Fihri Ahmed MEnv 2016Hafid ErrabiyPas encore d'évaluation
- Cours Bloc Operatoire Texte PDFDocument44 pagesCours Bloc Operatoire Texte PDFSą HąrPas encore d'évaluation
- Carnet de Stage de La Sage Femme: August 2016Document57 pagesCarnet de Stage de La Sage Femme: August 2016ۥٰۥٰۥٰ ۥٰۥٰۥٰPas encore d'évaluation
- Exam SecourismeDocument2 pagesExam SecourismeAlexi100% (1)
- Le Pneumothorax Tuberculeux TDocument100 pagesLe Pneumothorax Tuberculeux Tzaamouche0% (1)
- Rapport Projet Santé Ndiago FinalDocument40 pagesRapport Projet Santé Ndiago FinalSos Pairs EducateurPas encore d'évaluation
- RISUM DahbiDocument34 pagesRISUM DahbiSAID SAHLAOUIPas encore d'évaluation
- Aide Mémoire JuridiqueDocument30 pagesAide Mémoire JuridiqueBertrand CharletPas encore d'évaluation
- Generalites Sur La Pec Des FracturesDocument56 pagesGeneralites Sur La Pec Des Fracturesndemba stevePas encore d'évaluation
- Equipements Biomedicaux de BaseDocument78 pagesEquipements Biomedicaux de BaseMohamed EL-BOUCHTIPas encore d'évaluation
- Prévention Des Infections HospitalièresDocument9 pagesPrévention Des Infections HospitalièresmecherguiPas encore d'évaluation
- Organisation Du Système de SanteDocument21 pagesOrganisation Du Système de SanteDr Jean Berchmans NDARUSANZEPas encore d'évaluation
- Anesthésie de Patient À Estomac Plein DR NABI 1Document3 pagesAnesthésie de Patient À Estomac Plein DR NABI 1Sabīne KoudPas encore d'évaluation
- Guide Preparer Et Rediger Un Memoire de RechercheDocument14 pagesGuide Preparer Et Rediger Un Memoire de RechercheMohammed TahtouhPas encore d'évaluation
- Stagiaire Associe A L'apDocument2 pagesStagiaire Associe A L'apsaintdoulPas encore d'évaluation
- Rapport 2016 053R CHAR FlashDocument42 pagesRapport 2016 053R CHAR FlashGUYAWEBPas encore d'évaluation
- Annexe 1B - Accord de CoopérationDocument1 pageAnnexe 1B - Accord de CoopérationReda BzikhaPas encore d'évaluation
- Hopi 2Document24 pagesHopi 2Le Quotidien du MédecinPas encore d'évaluation
- Combat 20 Mars 2001Document16 pagesCombat 20 Mars 2001douziemePas encore d'évaluation
- 0-Rapport de StageDocument47 pages0-Rapport de StageWassim Djennane100% (3)
- Guide Programmation Chambre Dhopital APHPDocument59 pagesGuide Programmation Chambre Dhopital APHPAbigail AbbyPas encore d'évaluation
- Liste Intégrale Des Signataires Tribune Nice 2017Document2 pagesListe Intégrale Des Signataires Tribune Nice 2017Le MondePas encore d'évaluation
- CV Moro Sep 2013Document123 pagesCV Moro Sep 2013pSIsecretarioPas encore d'évaluation
- BROCHURE Tarifs Formation Continue 21-22Document21 pagesBROCHURE Tarifs Formation Continue 21-22rachidaPas encore d'évaluation
- 1166 Em31102013Document21 pages1166 Em31102013elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- 1er Metro ParisDocument23 pages1er Metro Parisjulien_dupontcalboPas encore d'évaluation
- 6 6978 2e87dfda PDFDocument30 pages6 6978 2e87dfda PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- 726 05 RnsaDocument17 pages726 05 RnsaIsmail Boukli HacenePas encore d'évaluation
- Permanence Des Soins Des Etablissements de Santé (Schéma Régional IDF)Document94 pagesPermanence Des Soins Des Etablissements de Santé (Schéma Régional IDF)Khatidja KassamPas encore d'évaluation
- Administateur de Garde HospitalierDocument230 pagesAdministateur de Garde HospitalierMuhetoPas encore d'évaluation
- Jacques Tenon, Memoires Sur Les Hôpitaux de Paris (1788)Document574 pagesJacques Tenon, Memoires Sur Les Hôpitaux de Paris (1788)andrecastanhocorreiaPas encore d'évaluation
- 2 Audit CDC Descartes NantesDocument59 pages2 Audit CDC Descartes NantesCellule investigation de Radio France100% (1)
- CIP ACL Les Cahiers 23 Fiche FournisseurDocument5 pagesCIP ACL Les Cahiers 23 Fiche Fournisseurkawtar bourkanPas encore d'évaluation
- Mémoire "Manager Le Développement Durable Dans Les Hôpitaux Publics"Document220 pagesMémoire "Manager Le Développement Durable Dans Les Hôpitaux Publics"Marine Tondelier100% (2)
- Bibdoc 2008-2 - Eté 2008 (Documentation Santé)Document7 pagesBibdoc 2008-2 - Eté 2008 (Documentation Santé)Association des Diplômés de l'Ecole des Bibliothécaires DocumentalistesPas encore d'évaluation
- Le Monde2Document30 pagesLe Monde2obudancamanak8025Pas encore d'évaluation
- Lettre - Ministre - Janvier DS 01 2010Document2 pagesLettre - Ministre - Janvier DS 01 2010ufmict-cgtPas encore d'évaluation
- Les Abréviations en MédecineDocument70 pagesLes Abréviations en MédecineMina HappinessPas encore d'évaluation
- Trivalle, Christophe - Gérontologie Préventive. Eléments de Prévention Du Vieillissement Pathologique (2016, Elsevier Masson) PDFDocument696 pagesTrivalle, Christophe - Gérontologie Préventive. Eléments de Prévention Du Vieillissement Pathologique (2016, Elsevier Masson) PDFFethi ChourouPas encore d'évaluation
- M-Lemagazine PDFDocument116 pagesM-Lemagazine PDFde merdPas encore d'évaluation
- Rapport Igas AP-HMDocument147 pagesRapport Igas AP-HMJ.P.Pas encore d'évaluation
- Journal MEDIAPART Du Vendredi 17 Avril 2020Document92 pagesJournal MEDIAPART Du Vendredi 17 Avril 2020Юнес БеджуPas encore d'évaluation
- CuprinsDocument14 pagesCuprinsAniela VizitiuPas encore d'évaluation
- Manifeste Association Jean-Louis MégnienDocument7 pagesManifeste Association Jean-Louis MégnienLe Quotidien du MédecinPas encore d'évaluation