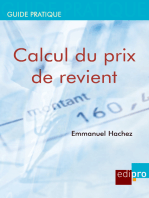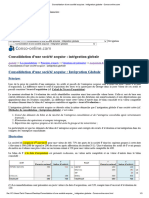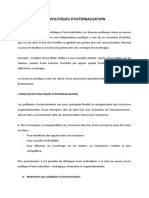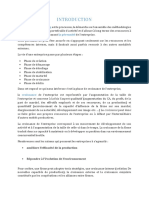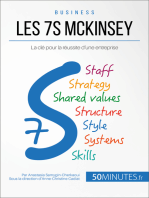Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Consolidation D'une Sous-Filiale PDF
Consolidation D'une Sous-Filiale PDF
Transféré par
salladdinaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Consolidation D'une Sous-Filiale PDF
Consolidation D'une Sous-Filiale PDF
Transféré par
salladdinaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références
Comptabilité
Consolidation d’une sous-filiale :
difficultés techniques et concepts
innovants
Partie 1 : Les principes
Une sous-filiale, ou filiale d’une filiale, résulte d’une participation “indirecte“
de la société-mère. Pour la consolidation de ce type de participation,
Par Pierre SCHEVIN,
plusieurs problèmes spécifiques se posent : détermination des pourcentages
Professeur à l’Université
de contrôle et d’intérêt du point de vue du groupe, mais aussi choix et mise de Strasbourg,
en œuvre du processus de consolidation. Ecole de management,
Diplômé d’expertise comptable
En effet, il apparaît que deux démarches sont possibles : consoli- différentes selon le stade auquel on procède à l’élimination des
dation par paliers ou consolidation directe (Règlement CRC 99-02 titres de la sous-filiale. Après avoir montré comment s’applique
§ 111), la première constituant la référence pour les données-clés chacun des processus, nous verrons quels sont leurs avantages
à obtenir. L’objet de l’article est de montrer comment s’effectue et inconvénients.
concrètement le recours à chacune de ces deux méthodes, en envi-
sageant les problèmes techniques et en dégageant les concepts Présentation du cas
utilisés. Dans la première partie de l’article, nous partirons d’abord
d’un cas simplifié, c’est-à-dire un groupe composé de la maison- Prenons le cas d’un groupe constitué de la maison-mère M, qui
mère, d’une filiale et d’une sous-filiale et au niveau duquel la mai- détient 90 % du capital de F (filiale de M), F détenant 70 % du
son-mère n’a qu’une participation indirecte dans la sous-filiale. capital dans SF (filiale de F, et sous-filiale de M).
L’exposé de chacune des démarches donnera lieu également à Les bilans sont les suivants :
une étude critique.
Bilan de M
Dans une 2e partie, à paraître dans un prochain numéro de la RFC,
nous procéderons à l’examen de cas plus complexes : existence Actif Passif
d’une participation directe et d’une participation indirecte de la Immobilisations 1 400 Capital 400
maison-mère dans la sous-filiale d’une part, combinaison d’une corporelles
situation de contrôle de la filiale et d’une influence notable dans Titres F 192 Réserves 380
la sous-filiale d’autre part. A partir de l’étude de ces cas, nous Autres actifs 408 Résultat 120
mettrons en évidence le recours, explicite ou implicite, à des Dettes 1 100
concepts nouveaux, et nous montrerons aussi quelle est l’utilité Total 2 000 Total 2 000
de l’indication d’une méthode de référence.
Bilan de F
1re partie : Les principes
Actif Passif
La consolidation d’un groupe comportant à la fois des filiales et Immobilisations 720 Capital 200
des sous-filiales peut s’effectuer d’abord selon la méthode par corporelles
paliers. La démarche est ascendante : la sous-filiale est d’abord Titres SF 180 Réserves 300
intégrée dans la filiale, le sous-groupe obtenu étant ensuite conso- Autres actifs 300 Résultat 100
lidé par la maison-mère. Par ailleurs, la méthode directe peut être Dettes 600
appliquée, et nous allons voir qu’elle peut prendre deux formes Total 1 200 Total 1 200
Bilan de SF
Actif Passif
Résumé de l’article
Immobilisations 600 Capital 200
corporelles
L’étude menée montre que l’application des deux processus Autres actifs 200 Réserves 240
(direct et par paliers) aboutit habituellement à une identité
Résultat 60
au niveau des chiffres-clés issus de la consolidation. La
Dettes 300
méthode par paliers présente des avantages en matière de
décentralisation des tâches et de fourniture d’informations Total 800 Total 800
au niveau des sous-groupes. La méthode directe est plus
rapide et permet de mettre en évidence la contribution de 1. Méthode par paliers
chaque unité du groupe, quel que soit son niveau, dans les
montants consolidés. Toutefois, cette méthode peut prendre 1.1 Mise en œuvre
deux formes, l’approche “financière“ donnant des résultats Le processus de consolidation par paliers consiste à effectuer
plus pertinents que l’approche “arithmétique“. tout d’abord une consolidation de SF dans F et ensuite à intégrer
le sous-ensemble “F + SF“ dans M.
28 // N°435 Septembre 2010 // Revue Française de Comptabilité
Comptabilité
n 1er palier : Sous-consolidation au niveau de F La méthode “indirecte“ permet d’obtenir des informations “seg-
Compte tenu du pourcentage de participation de F dans SF mentées“ à l’intérieur du groupe, particulièrement utiles aux action-
(70 %), on procède à une intégration globale. On obtient : naires d’une filiale ayant elle-même des filiales, et cotée en Bourse.
• Réserves consolidées = Réserves de F + % d’intérêt de F x La fourniture d’informations par paliers est intéressante également
(Capital de SF + Réserves de SF) dans le cadre du contrôle de gestion, notamment lorsqu’un sous-
- valeur des titres SF détenus par F ensemble correspond à un secteur d’activité ou à une zone géogra-
= 300 + 70 % (200 + 240) - 180 = 428 phique. Elle permet de connaître l’apport de chaque sous-groupe
• Résultat consolidé = Résultat de F + % d’intérêt de F x résultat dans le potentiel et le résultat du groupe.
de SF En 3e lieu, la consolidation par paliers est avantageuse dans une
= 100 + 70 % x 60 = 142 optique de décentralisation. En effet, ce processus facilite l’orga-
• Intérêts minoritaires = (1 - % d’intérêt de F) (Capital SF + nisation et la répartition des tâches incombant au service central
Réserves SF + Résultat SF) de consolidation. Les opérations de consolidation peuvent être
= 30 % (200 + 240 + 60) = 150 effectuées, en partie tout au moins, à des niveaux “locaux“. En
outre, l’établissement d’états financiers consolidés à des niveaux
Bilan consolidé du groupe “F + SF“ intermédiaires permet et facilite la décentralisation des prises de
Actif Passif décision économique et financière. Par suite, le choix de la tech-
Immobilisations 1 320 Capital 200
nique de consolidation par paliers peut apparaître « lié à la nature
corporelles des relations entre la société-mère et les entités consolidées, dans
720 + 600 le cadre de l’organisation générale du groupe » 3.
Autres actifs 500 Réserves consolidées 428 Cependant, cette technique n’est pas majoritairement utilisée
300 + 200 300 + 128 par les groupes. Elle présente des inconvénients sur le plan de
Résultat consolidé 142 la longueur des opérations et du coût. D’autre part, il est difficile
100 + 42 d’appliquer la technique des paliers si le groupe ne peut pas être
Intérêts minoritaires 150 décomposé en plusieurs sous-groupes, indépendants du point
132 + 18
de vue des participations financières. En effet, si la société-mère
Dettes 900 détient directement des titres dans la sous-filiale, la consolida-
600 + 300
tion devient relativement complexe et les sources d’erreurs se
Total 1 820 Total 1 820
multiplient.
n 2e palier : Consolidation au niveau de M 2. Méthode directe
M détenant 90 % du capital de F, on procède à une intégration
globale du sous-groupe “F + SF“. 2.1 Mise en œuvre
• Réserves consolidées = Réserves de M + % de M dans F x Elle consiste à consolider, sans détour, toutes les sociétés retenues
(Capital sous-groupe + Réserves sous-groupe) - valeur des titres dans le périmètre de consolidation, quel que soit le lien, direct ou
F détenus par M = 380 + 90 % (200 + 428) - 192 = 753,2 indirect, avec la société-mère. Les capitaux propres et résultats
• Résultat consolidé = Résultat de M + % de M dans F x Résultat de chaque société consolidée sont répartis directement entre les
sous-groupe = 120 + 90 % x 142 = 247,8 intérêts du groupe et les intérêts minoritaires. La mise en œuvre
• Intérêts minoritaires au niveau de F = (1 - Part de M) (Capital de ce processus nécessite un traitement particulier des titres SF
sous-groupe + Réserves sous-groupe + Résultat sous-groupe) détenus par la filiale, de façon à éviter un “double emploi“ au niveau
= 10 % (200 + 428 + 142) = 77 des comptes consolidés. En effet, sans précaution, la participa-
• Intérêts minoritaires au niveau du groupe M = Intérêts minori- tion de F dans SF sera comptée deux fois : une première fois au
taires au niveau du sous-groupe + Intérêts minoritaires au niveau
de F = 150 + 77 = 227
Bilan consolidé du groupe M
1. CNC, Méthodologie relative aux comptes consolidés,
Actif Passif arrêté du 9-12-1986, intégrée au PCG Titre II, chapitre 4.
Immobilisations 2 720 Capital 400 2. CRC, Règlement 99-02, § 111.
corporelles
1 400 + 1 320 3. Lavoyer J.-C., Richard J., Manuel de consolidation, La Villeguérin
Autres actifs 908 Réserves 753,2 éditions, p. 145.
408 + 500 380 + 373,2
moment de la répartition des capitaux propres de la sous-filiale,
Résultat 247,8
120 + 127,8
Intérêts minoritaires 227
77 + 150
Abstract
Dettes 2 000
1 100 + 900
Total 3 628 Total 3 628 The study that is carried out shows that the application of
both processes (direct and in stages) usually results in an
identity at the level of the key figures stemming from the
1.2 Etude critique consolidation. The method in stages has some advantages as
On peut souligner tout d’abord que le Conseil national de la compta- regards the decentralization of tasks and the supply of infor-
bilité donne la primauté au processus par paliers. Cette préférence, mation at the level of the subgroups. The direct method is
déjà formulée dans l’ancien Plan comptable 1, est reprise par la quicker and enables one to bring to the fore the contribution
nouvelle réglementation relative aux comptes consolidés de façon of each unit of the group, whatever its level may be, in the
précise : « Les capitaux propres consolidés, les écarts d’acquisition consolidated amounts. However, this method can take two
et d’évaluation, les intérêts minoritaires et le résultat déterminés dans forms, the “financial“ approach giving more relevant results
le cadre d’une consolidation directe doivent être les mêmes que ceux than the “arithmetic“ approach.
qui seraient obtenus si la consolidation était réalisée par paliers » 2.
Revue Française de Comptabilité // N°435 Septembre 2010 // 29
Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références
Comptabilité
et une seconde fois lors de la répartition des capitaux propres de à la réalité économique : le double emploi ne résulte pas de la
la filiale. Pour éviter un “double emploi“, deux démarches sont consolidation directe de F, mais de celle de SF. De plus, elle
concevables, selon la place donnée à l’élimination des titres de la reprend la logique de la consolidation par paliers (qui constitue
sous-filiale dans le processus de consolidation. la méthode de référence). Enfin, elle présente l’avantage de
faire ressortir, dans les calculs de répartition, la ventilation du
n Méthode arithmétique financement des titres de SF entre le groupe et les minoritaires.
Une première solution consiste à retirer les titres SF au niveau de
la société détentrice de la participation. Ces titres sont éliminés Consolidation de la filiale F
avant la répartition de la situation nette de F entre le groupe et • Montant de la situation nette de F à répartir : 200 + 300 = 500
les minoritaires (élimination dite “en amont“), cette situation nette - Part du groupe : 90 % x 500 = 450
se trouvant ainsi diminuée. C’est la méthode la plus simple, mais - Part des minoritaires : 10 % x 500 = 50
sa pertinence d’un point de vue économique est discutable. Elle - Impact sur les réserves consolidées :
réduit le montant à répartir et minore notamment l’impact de F Part du groupe - valeur des titres F détenus par M = 450 - 192
sur les réserves consolidées du groupe. = 258
• Répartition du résultat de F :
Consolidation de la filiale F - Part de M : 90 % x 100 = 90
Elle s’effectue selon la méthode de l’intégration globale, compte - Part des minoritaires : 10 % x 100 = 10
tenu du pourcentage de contrôle de M dans F (90 %).
• Montant de la situation nette de F à répartir = Capital de F + Consolidation de la sous-filiale SF
Réserves de F - Titres SF détenus par F = 200 + 300 - 180 = 320 • Répartition de la situation nette de SF
- Intérêts du groupe : 90 % x 320 = 288 L’élimination des titres de la sous-filiale détenus par F intervient
- Intérêts des minoritaires : 10 % x 320 = 32 lors de la répartition de la situation nette de SF entre le groupe
- Impact sur les réserves consolidées = Intérêts du groupe - Valeur (63 %) et les minoritaires (37 %). Elle fait intervenir une nouvelle
des titres F détenus par M distinction : part brute/part nette.
= 288 - 192 = 96 - Part “brute“ du groupe : 63 % (200 + 240)= 277,2
• Répartition du résultat de F : - Valeur des titres SF financés par M : 180 x 90 % = 162
- Part du groupe : 90 % x 100 = 90 - Part “nette“ du groupe, ou impact sur les réserves consolidées :
- Part des minoritaires : 10 % x 100 = 10 277,2 - 162 = 115,2
La part des minoritaires dans la situation nette de SF se calcule
Consolidation de la sous-filiale SF également en deux étapes :
Le pourcentage de contrôle de M dans SF (70 %) découle de - Part “brute“ des minoritaires : 37 % (200 + 240) = 162,8
l’examen de la chaîne de contrôle, qui fait apparaître une conti- - Valeur des titres SF financés par les minoritaires : 180 x 10 % = 18
nuité. Le niveau de ce pourcentage entraîne également l’appli- - Part “nette“ des minoritaires : 162,8 - 18 = 144,8
cation de la méthode de l’intégration globale. Le pourcentage • Répartition du résultat de SF :
d’intérêt de M dans SF s’obtient par multiplication des pourcen- - Part de M : 63 % x 60 = 37,8
tages successifs (M dans F, et F dans SF). - Part des minoritaires : 37 % x 60 = 22,2
• Situation nette de SF à répartir : 200 + 240 = 440
Bilan consolidé du groupe M
- Intérêt de M : 90% x 70% = 63 %
- Impact de SF sur les réserves consolidées : 63 % x 440 = 277,2 Actif Passif
- Intérêts des minoritaires dans SF : 37 % x 440 = 162,8 Immobilisations 2 720 Capital 400
• Répartition du résultat de SF : corporelles
1 400 + 720 + 600
- Part de M = 63 % x 60 = 37,8
- Part des minoritaires = 37 % x 60 = 22,2 Autres actifs 908 Réserves consolidées 753,2
408 + 300 + 200 Réserves de M 380
Impact de F 258
Bilan consolidé du groupe M Impact de SF 115,2
Actif Passif Résultat consolidé 247,8
Résultat de M 120
Immobilisations 2 720 Capital 400 Impact de F 90
corporelles Impact de SF 37,8
1 400 + 720 + 600
Intérêts minoritaires 227
Autres actifs 908 Réserves consolidées 753,2 Dans F : 50 + 10 = 60
408 + 300 + 200 Réserves de M 380 Dans SF : 144,8 + 22,2 = 167
Impact de F 96
Impact de SF 277,2 Dettes 2 000
1 100 + 600 + 300
Résultat consolidé 247,8
Réserves de M 120 Total 3 628 Total 3 628
Impact de F 90
Impact de SF 37,8
Le bilan consolidé obtenu par la méthode “en aval“ est identique
Intérêts minoritaires 227
Dans F 32 + 10 = 42 à celui découlant de la méthode “en amont“, mais la ventilation
Dans SF 162,8 + 22,2 = 185 des réserves consolidées et des intérêts minoritaires selon la
Dettes 2 000 provenance (filiale ou sous-filiale) n’est pas la même.
1 100 + 600 + 300
Total 3 628 Total 3 628 2.2 Etude critique
Cette technique de consolidation présente plusieurs avantages :
n Méthode financière • mise en œuvre immédiate de l’optique globale du groupe, en
La seconde solution revient à enlever le montant de la partici- tant qu’entité, et traitement identique des filiales et des sous-
pation (entraînant le “double emploi“) au niveau de la société filiales, les premières n’étant qu’un relais dans le lien de parenté 4,
dans laquelle elle est détenue, c’est-à-dire SF. L’élimination
des titres de la sous-filiale s’effectue après la répartition de la
situation nette de F (méthode dite “en aval“). La méthode est 4. CENCA, Les groupes industriels français face à la pratique
plus complexe que la précédente, mais elle correspond mieux de la consolidation, éditions SEF, p. 154.
30 // N°435 Septembre 2010 // Revue Française de Comptabilité
Comptabilité
• rapidité d’obtention de l’information financière consolidée au Enfin, l’existence de deux démarches possibles pour l’élimination
niveau du groupe, des titres de la sous-filiale peut poser des problèmes d’interpré-
• coût plus faible que dans le cas de l’application de la méthode tation, notamment au niveau du calcul des réserves consolidées.
par paliers, qui nécessite l’établissement d’états financiers inter- La méthode “en amont“ est plus commode à appliquer que la
médiaires, méthode “en aval“, mais elle peut fausser l’analyse. En particulier,
• possibilité d’une centralisation du contrôle des opérations, le calcul de l’impact sur les réserves consolidées de la filiale F est
• moyen permettant de passer d’une structure de groupe, même sous-estimé, et peut même faire ressortir une différence négative,
complexe, à une structure à un seul niveau, alors qu’il n’en est rien.
• indication de la contribution individuelle de chaque unité aux
montants des différents postes figurant au bilan consolidé, cette Conclusion
information étant utile à la fois aux dirigeants et aux auditeurs.
L’étude précédente montre que les différentes méthodes appli-
Ces avantages expliquent l’importance, en pratique, de l’utili- cables aboutissent à des résultats “globalement“ identiques, et
sation de ce processus, mais celui-ci présente également des qu’il n’y a pas d’écart entre la méthode par paliers (citée comme
inconvénients. référence par le CRC) et la méthode directe. Cependant, la décom-
Une première critique que l’on peut adresser à cette technique position des chiffres-clés (réserves consolidées, résultat conso-
est de présenter un caractère artificiel. En effet, la consolida- lidé, intérêts minoritaires) est affectée par la méthode utilisée. La
tion directe repose implicitement sur une participation directe méthode par paliers donne une répartition par “sous-groupe“ alors
de la consolidante dans la consolidée, alors que la réalité est que la méthode directe permet de faire ressortir l’impact de chaque
différente. unité du groupe. Mais l’intérêt de cet apport de la méthode directe
D’autre part, il est nécessaire de calculer l’intérêt financier net doit être nuancé, en raison de l’existence de deux méthodes per-
de la société-mère dans chaque société. Ce calcul peut dans mettant d’éviter le double emploi découlant des titres de la sous-
certains cas s’avérer complexe. On est amené dans la méthode filiale détenus par la filiale. La méthode “arithmétique“ minore la
la plus pertinente (dite “en aval“) à utiliser deux types de pour- mesure de la part de la filiale, alors que la méthode “financière“
centages d’intérêt pour déterminer l’impact de la sous-filiale sur est complexe et présente des difficultés dans la mise en œuvre
les réserves consolidées : le % d’intérêt de M dans la sous-filiale des pourcentages d’intérêt.
(90 % x 70 % = 63 %) et le pourcentage d’intérêt de M dans
la filiale qui détient les titres de la sous-filiale (90 %), d’où des
risques de confusion 5.
En troisième lieu, la méthode directe présente l’inconvénient de ne Bibliographie
pas permettre d’analyses internes (secteurs, régions) au groupe.
En outre, cette méthode ne donne pas d’états financiers pour CNC, Méthodologie relative aux comptes consolidés, arrêté du 9 décembre1986.
un sous-groupe, alors que ceux-ci sont indispensables dans le CRC, Règlement 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et
cas où la filiale-mère est cotée en Bourse, ou encore lorsqu’un entreprises publiques.
banquier les exige. Lavoyer J.C., Richard J., Manuel de consolidation, La Villeguérin éditions, 1997.
Lefebvre F., Comptes consolidés, Règles françaises, 2009.
Montier J., Grassi O., Techniques de consolidation, Economica, 2006.
5. E. Ropert, G. Gélard, J.Y. Eglem, Nouvelle pratique des comptes Ropert E., Gélard G., Eglem J., Nouvelle pratique des comptes consolidés, Gualino,
consolidés, Vuibert, p. 51. 2000.
Tableau récapitulatif : montants des chiffres-clés issus de la consolidation
Postes du bilan consolidé Consolidation par étapes Consolidation directe : méthode Consolidation directe : méthode
arithmétique (“en amont“) financière (“en aval“)
Réserves consolidées 753,2 753,2 753,2
Réserves de M 380 380 380
Impact de F+SF 373,2
Impact de F 96 258
Impact de SF 277,2 115,2
Résultat consolidé 247,8 247,8 247,8
Résultat de M 120 120 120
Impact de F+SF 127,8
Impact de F 90 90
Impact de SF 37,8 37,8
Intérêts minoritaires 227 227 227
Niveau F 77 42 60
Niveau SF 150 185 167
Nouveau
Congés payés : guide pratique
Règles d’acquisition des congés payés (avec l’incidence des absences maladie, maternité), décompte (en par-
ticulier pour les salariés à temps partiel), paiement (par exemple les incidences des primes diverses sur le calcul
de l’indemnité) : un ouvrage essentiel dans la bibliothèque d’un cabinet
www.experts-comptables.fr/boutique
15,00 €
Revue Française de Comptabilité // N°435 Septembre 2010 // 31
Vous aimerez peut-être aussi
- VAISSELLE DE LIMOGES Exemple Fiche SP ComplétéeDocument3 pagesVAISSELLE DE LIMOGES Exemple Fiche SP Complétéebapti.1804Pas encore d'évaluation
- Etude de Cas IntégrationDocument1 pageEtude de Cas IntégrationSoùFian AitPas encore d'évaluation
- IAS 16 Immobilisations CorporellesDocument11 pagesIAS 16 Immobilisations CorporellesBBNGM67% (3)
- Cours Comptabilité Des Groupes 2017Document58 pagesCours Comptabilité Des Groupes 2017MAAATIPas encore d'évaluation
- FusionDocument8 pagesFusionOumaima MazariPas encore d'évaluation
- Le Cout de Revient D Un Bulletin de PaieDocument16 pagesLe Cout de Revient D Un Bulletin de PaieadpfrancePas encore d'évaluation
- Scission Et Apport Partiel D'actifsDocument22 pagesScission Et Apport Partiel D'actifsOussama Belhaj100% (1)
- Calcul du prix de revient: Rentabiliser les coûts de production et de distribution pour les chefs d'entreprises belgesD'EverandCalcul du prix de revient: Rentabiliser les coûts de production et de distribution pour les chefs d'entreprises belgesPas encore d'évaluation
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Valorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesD'EverandValorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Analyse de Risque Dans La Démarche de Commissaire Aux ComptesDocument94 pagesAnalyse de Risque Dans La Démarche de Commissaire Aux Comptesouijdane el100% (2)
- 435 28-31Document4 pages435 28-31Ahmed AkaichiPas encore d'évaluation
- Lactionnariat Salarie Dans Les Entreprises FamiliDocument30 pagesLactionnariat Salarie Dans Les Entreprises FamilikakadoPas encore d'évaluation
- Slides Sur La Technique de La Consolidation Des ComptesDocument36 pagesSlides Sur La Technique de La Consolidation Des ComptesYannickEkaniPas encore d'évaluation
- Les Operation de Restrcturation DDocument2 pagesLes Operation de Restrcturation DAssma ZarwalPas encore d'évaluation
- La Consolidation Des Comptes Cadre Général Et Difficultés TechniquesDocument21 pagesLa Consolidation Des Comptes Cadre Général Et Difficultés TechniquesAMHIL MohamedPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document50 pagesChapitre 3zebiPas encore d'évaluation
- Module 1 Cours Fusion Et Operations AssimileesDocument92 pagesModule 1 Cours Fusion Et Operations AssimileesAdama BerthePas encore d'évaluation
- Limpact Des Operations de Fusions AcquisDocument30 pagesLimpact Des Operations de Fusions Acquisjxc2wc5z7pPas encore d'évaluation
- Corrigé - UE4 - 2021 - Epreuve Blanche de SeptembreDocument30 pagesCorrigé - UE4 - 2021 - Epreuve Blanche de SeptembreCarolePas encore d'évaluation
- Apports PartielsDocument2 pagesApports PartielssadkosadohPas encore d'évaluation
- Méthodo Conso IG IP MEEDocument8 pagesMéthodo Conso IG IP MEEqsx qxsqPas encore d'évaluation
- AP Et SCISSIONDocument12 pagesAP Et SCISSIONfouadPas encore d'évaluation
- Ce Et IgDocument29 pagesCe Et IgAsmaâ BouâmPas encore d'évaluation
- Fusion Master Cca - Cours 1 VdefDocument9 pagesFusion Master Cca - Cours 1 Vdef6ffvkqzm7xPas encore d'évaluation
- Approche Fonctionnelle de LE FCours ADF - S3Document5 pagesApproche Fonctionnelle de LE FCours ADF - S3Aymen NasdyPas encore d'évaluation
- 2014 FCS Mard Marsat RouxDocument42 pages2014 FCS Mard Marsat RouxTsiory Fitiavana RabePas encore d'évaluation
- Fiche LookDocument2 pagesFiche LookElodie ChhayPas encore d'évaluation
- Cours FUSIONS DES ELSES 2Document34 pagesCours FUSIONS DES ELSES 2aldrige abagaPas encore d'évaluation
- Politique D'externalisationDocument12 pagesPolitique D'externalisationBALOGOUN RomainPas encore d'évaluation
- DCG 06 Recroix Pascale2 - UnlockedDocument69 pagesDCG 06 Recroix Pascale2 - Unlockedsalim aggounPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Consolidation Directe Et Par PaliersDocument29 pagesChapitre 5 Consolidation Directe Et Par PaliersTafika RabetsimamangaPas encore d'évaluation
- Consolidation Des Comptes Kaoutar BOUSHIB Périmètre 3 4 5 CasDocument14 pagesConsolidation Des Comptes Kaoutar BOUSHIB Périmètre 3 4 5 Caszineb el khaouliPas encore d'évaluation
- Consolidation Des Comptes Kaoutar BOUSHIB Périmètre 2 CasDocument10 pagesConsolidation Des Comptes Kaoutar BOUSHIB Périmètre 2 Caszineb el khaouliPas encore d'évaluation
- COMPTABILITé de Groupe Kheder NajetDocument39 pagesCOMPTABILITé de Groupe Kheder NajetNajet KhederPas encore d'évaluation
- Consolidation Des Comptes Kaoutar BOUSHIB +Document7 pagesConsolidation Des Comptes Kaoutar BOUSHIB +zineb el khaouliPas encore d'évaluation
- Module 3 Methodes de Consolidation 060115Document144 pagesModule 3 Methodes de Consolidation 060115YAMAJAKO AUGUSTEPas encore d'évaluation
- Support Compt GROUPE 2021-22Document56 pagesSupport Compt GROUPE 2021-22ASMAE ZAROUALPas encore d'évaluation
- Projet Professionnel TITI AnisDocument3 pagesProjet Professionnel TITI AnisAnis NissouPas encore d'évaluation
- Chapitre2 Imprimable-1Document9 pagesChapitre2 Imprimable-1hamdiPas encore d'évaluation
- Cours Consolidation Des Comptes SND 2020 PrepadescoDocument239 pagesCours Consolidation Des Comptes SND 2020 PrepadescosidyPas encore d'évaluation
- FA - RésuméDocument5 pagesFA - RésuméHala RhPas encore d'évaluation
- Couts CachésDocument14 pagesCouts CachésAdam ChnaniPas encore d'évaluation
- Finance Internationale Et IFRSDocument85 pagesFinance Internationale Et IFRSSalma ElmorsliPas encore d'évaluation
- Consolidation Des ComptesDocument86 pagesConsolidation Des ComptesAsmae BOUMAHDI100% (2)
- Exposé M2PB FINANCEDocument10 pagesExposé M2PB FINANCEMira TiamelaPas encore d'évaluation
- Operation de RestructurationDocument4 pagesOperation de Restructurationyanis aziz nasrounPas encore d'évaluation
- Consolidation IFAGEDocument65 pagesConsolidation IFAGECheikh NgomPas encore d'évaluation
- Cours 2 - Consolidation-Normes IFRSDocument17 pagesCours 2 - Consolidation-Normes IFRSikram awlad100% (1)
- Restructuration Du PassifDocument30 pagesRestructuration Du PassifAnas Tsouli100% (5)
- Cours Management Des OrganisationsDocument98 pagesCours Management Des OrganisationsHanan ErgPas encore d'évaluation
- Seance 4Document7 pagesSeance 4Moctar BahPas encore d'évaluation
- HEM FES 2017 - LES COMPTES CONSOLIDES - COURS - CH 1et2 - AMDocument32 pagesHEM FES 2017 - LES COMPTES CONSOLIDES - COURS - CH 1et2 - AMimaneyakPas encore d'évaluation
- Cycle Paie PersonnelDocument86 pagesCycle Paie Personnelmed7days89% (19)
- Présentation de La Consolidation Des ComptesDocument9 pagesPrésentation de La Consolidation Des ComptesAsli YilmazPas encore d'évaluation
- Module 3 Methodes de Consolidation Actualise 100114Document129 pagesModule 3 Methodes de Consolidation Actualise 100114Sidy TallPas encore d'évaluation
- Analyse Financiere Sectorielle FlambantDocument15 pagesAnalyse Financiere Sectorielle Flambantmalvert91Pas encore d'évaluation
- Synthese Theme 7Document2 pagesSynthese Theme 7strong girlPas encore d'évaluation
- Decret Audit CamerounDocument16 pagesDecret Audit CamerounMakongo Janyce Tecla Makongo Janyce TeclaPas encore d'évaluation
- L'analyse Financière de L'entreprise 17,42Document59 pagesL'analyse Financière de L'entreprise 17,42MemoMBA100% (4)
- La consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesD'EverandLa consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Les 7S McKinsey: La clé pour la réussite d'une entrepriseD'EverandLes 7S McKinsey: La clé pour la réussite d'une entrepriseÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Vocabulaire Des SensationsDocument3 pagesVocabulaire Des Sensationslina angel100% (1)
- Les Adjectifs Possesifs Et Les Adjectif DémonstratifsDocument3 pagesLes Adjectifs Possesifs Et Les Adjectif Démonstratifslina angelPas encore d'évaluation
- TVA-Application Et Série D'exercicesDocument5 pagesTVA-Application Et Série D'exerciceslina angelPas encore d'évaluation
- فرض 3 في مادة اللغة الفرنسية للسنة الثالثة اعداديDocument2 pagesفرض 3 في مادة اللغة الفرنسية للسنة الثالثة اعداديlina angelPas encore d'évaluation
- فرض 3 في مادة اللغة الفرنسية للسنة الثالثة اعداديDocument2 pagesفرض 3 في مادة اللغة الفرنسية للسنة الثالثة اعداديlina angelPas encore d'évaluation
- Cours Audit Bancaire FinaleDocument65 pagesCours Audit Bancaire FinaleAmayed ChafikPas encore d'évaluation
- Sage 100 Comptabilite Manuel Pedagogique PDFDocument290 pagesSage 100 Comptabilite Manuel Pedagogique PDFDavila AlomgbaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1: Généralités Sur L'auditDocument4 pagesChapitre 1: Généralités Sur L'auditMed BerrahalePas encore d'évaluation
- Marge À L'avancementDocument18 pagesMarge À L'avancementXavier Chabou100% (1)
- Sifac Formation Comptabilite AnalytiqueDocument60 pagesSifac Formation Comptabilite AnalytiqueMohamedRiahiPas encore d'évaluation
- Coût Marginal: Exercice 026Document2 pagesCoût Marginal: Exercice 026Marc Justin NgassamPas encore d'évaluation
- Gest Dess225Document39 pagesGest Dess225Mohamed KonatéPas encore d'évaluation
- 537cc92ce2ac7 (1) - CopieDocument68 pages537cc92ce2ac7 (1) - CopieTaha AammiPas encore d'évaluation
- Comptabilite PubliqueDocument134 pagesComptabilite PubliqueAnisPas encore d'évaluation
- Chapitre LE PLAN COMPTABLEDocument3 pagesChapitre LE PLAN COMPTABLEIvan ApedoPas encore d'évaluation
- Examen IFRS 1 SDocument3 pagesExamen IFRS 1 Slara iplikje100% (2)
- Procedure Cycle Paie PersonnelDocument7 pagesProcedure Cycle Paie PersonnelDounyazed Mostefaoui100% (1)
- CFE11Document9 pagesCFE11Uss EefPas encore d'évaluation
- Vocabulario Contabilidad en Cuatro IdiomasDocument25 pagesVocabulario Contabilidad en Cuatro IdiomasHola SpaniolaPas encore d'évaluation
- Programme Travail Cycle StocksDocument5 pagesProgramme Travail Cycle StocksMerouane AllalouPas encore d'évaluation
- Deliberation S6 L3 FISCDocument4 pagesDeliberation S6 L3 FISChafs83534Pas encore d'évaluation
- Consolidation Des ComptesDocument39 pagesConsolidation Des Comptesmoulay_znati100% (4)
- Direction de La Recherche Et de L'ingénierie de Formation: Corrige Fourni A Titre IndicatifDocument6 pagesDirection de La Recherche Et de L'ingénierie de Formation: Corrige Fourni A Titre IndicatifSalimPas encore d'évaluation
- Cours Danalyse Financière l3Document23 pagesCours Danalyse Financière l3Âmenî Bën SërïPas encore d'évaluation
- Analyse 1Document57 pagesAnalyse 1ulucsluxxbhlsaPas encore d'évaluation
- Analyse Et Diagnostique FinanciersDocument5 pagesAnalyse Et Diagnostique FinanciersJuan ZiridePas encore d'évaluation
- Conversion Suivi de TrésorerieDocument40 pagesConversion Suivi de TrésorerieAZEDDINE ARIFPas encore d'évaluation
- Exe ConsoDocument4 pagesExe ConsofouadPas encore d'évaluation
- Exo GraceDocument4 pagesExo GraceLudovic BouadiPas encore d'évaluation
- Présentation Des États Financiers Selon Système Comptable Financier PDFDocument86 pagesPrésentation Des États Financiers Selon Système Comptable Financier PDFAsma ZebbichePas encore d'évaluation
- CR - Sig - CafDocument16 pagesCR - Sig - CafIlyes BalePas encore d'évaluation
- Dossier Final Eval Frs Evaluation Des FournisseursDocument84 pagesDossier Final Eval Frs Evaluation Des FournisseurssapmaryPas encore d'évaluation