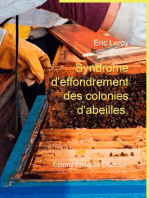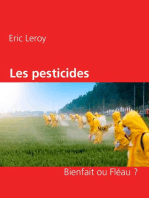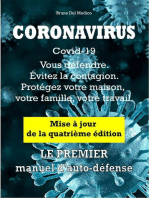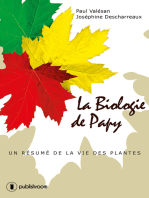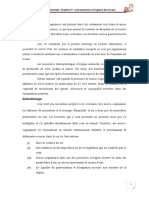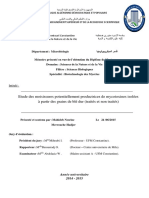Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Chapitre2 PDF
Chapitre2 PDF
Transféré par
Tasnim Tas NimTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre2 PDF
Chapitre2 PDF
Transféré par
Tasnim Tas NimDroits d'auteur :
Formats disponibles
2MBIOMA Module : ALIT Chapitre 2 : Mycotoxines
Définition des mycotoxines
Le terme mycotoxine vient du grec «mycos» qui signifie champignon et du latin «toxicum»
qui signifie poison. Il désigne des métabolites secondaires sécrétés par des moisissures
appartenant principalement aux genres Aspergillus, Penicillium et Fusarium. Ces
mycotoxines présentent des origines chimiques très diverses correspondant à la différence de
leurs voies de biosynthèse.
Conditions de toxinogénèse
La production de mycotoxines est directement liée à la croissance fongique. Par conséquent,
les facteurs capables d’influencer la croissance fongique vont aussi jouer un rôle sur la
toxinogénèse. De manière générale, les conditions environnementales nécessaires à la
production de mycotoxines sont plus étroites que celles permettant la croissance fongique et
sont, le plus souvent, proches des conditions optimales de développement de l’espèce
considérée.
1. Activité d’eau (aw)
Il s’agit d’un paramètre dont l’influence est déterminante sur le développement des
moisissures ainsi que sur la production de mycotoxines. Dans un premier temps ce paramètre
influence la germination des spores ; puis dans un second temps, le développement mycélien
2. pH
Le pH du milieu est un facteur important dans la croissance des moisissures et la production
des mycotoxines. La plupart des moisissures croissent dans des pH acides et peuvent tolérer
des valeurs de pH très basses. Comme pour l’aw, la gamme de pH permettant la toxinogénèse
est plus restreinte que celle permettant la croissance fongique
3. Température
En général, la température optimale de toxinogénèse est voisine de la température optimale de
croissance. Pour d’autres toxines, telles que la zéaralénone élaborée par F. roseum, la
température optimale de toxinogénèse est généralement inférieure à celle de la croissance,
respectivement de 15°C et 25°C environ. Parfois l’apparition de mycotoxines dans les
conditions naturelles est favorisée par des températures relativement basses, au voisinage de
la température minimale de croissance
Dr NAHAL BOUDERBA N Page 1
2MBIOMA Module : ALIT Chapitre 2 : Mycotoxines
4. Présence d’oxygène
Généralement la production des mycotoxines est plus sensible à la variation de composition
de l’air que la croissance fongique. Une concentration en oxygène inférieure à 1% et des
concentrations élevées de CO2 empêchent l’élaboration de mycotoxines
5. Influence du substrat
Les mycotoxines sont produites par de nombreuses moisissures dotées génétiquement d’un
pouvoir toxinogène. Cependant la nature du substrat peut influencer l’expression du pouvoir
de sécrétion des toxines. Il est important de noter que des différences dans cette expression,
peuvent être observées au sein d'une même espèce et expliquer les différences de pouvoir
toxinogène observées entre les souches.
6 Interactions microbiennes
La présence simultanée de plusieurs espèces de microorganismes dans le même milieu
entraîne une diminution de la production de mycotoxines par chacun des microorganismes
producteurs. Ainsi, la quantité d’aflatoxine B1 produite est réduite quand une souche
d’Aspergillus flavus est introduite dans une culture en même temps qu’une souche
d’Aspergillus parasiticus, et ce, même si la souche d’Aspergillus parasiticus est une souche
non toxinogène
Principaux mycotoxines
On trouvera dans le tableau 1 les moisissures et les mycotoxines actuellement considérées
comme ayant une importance à l’échelle mondiale.
Sont considérées comme “importantes” les mycotoxines qui ont montré qu’elles pouvaient
avoir des effets sensibles sur la santé humaine et la productivité animale dans divers pays.
Dr NAHAL BOUDERBA N Page 2
2MBIOMA Module : ALIT Chapitre 2 : Mycotoxines
Tableau 1 - Moisissures et mycotoxines d’importance mondiale
Espèce de moisissure Mycotoxines engendrées
Aspergillus parasiticus Aflatoxines B1, B2, G1, G2
Aspergillus flavus Aflatoxines B1, B2
Fusarium sporotrichioides Toxine T-2
Fusarium graminearum Déoxynivalénol (ou nivalénol)
Zéaralénone
Fusarium moniliforme (F. verticillioides) Fumonisine B1
Penicillium verrucosum Ochratoxine A
Aspergillus ochraceus Ochratoxine A
1. Aflatoxines
Les Aflatoxines ont été les premières mycotoxines identifiées par les chercheurs, et ce sont
aujourd’hui les plus connues.
Les aflatoxines B1, B2, G1 et G2 sont susceptibles d’être produites par certaines souches
d’espèces appartenant au genre Aspergillus telles que A. flavus pouvant produire les
aflatoxines B1 et B2, A. parasiticus et A. nomius pouvant produire en plus les aflatoxines G1 et
G2
Les aflatoxines sont à l’origine de nombreuses pathologies comme le cancer du foie,
l’hépatite chronique, la jaunisse et la cirrhose. Si les mycotoxines se révèlent toxiques
lorsqu’elles sont ingérées en grande quantité, une longue exposition à de très faibles doses
d’aflatoxines peut également être source de risque pour la santé. De même, certaines
aflatoxines peuvent être à l’origine de mutations génétiques dans les cellules humaines et
animales
2. Ochratoxine A
L’ochratoxine A est une mycotoxine d’importance mondiale produite par des champignons
microscopiques qui sont des contaminants courants des produits alimentaires. Cette
mycotoxine est produite par différentes espèces de Penicillium (P. verrucosum, P.
Dr NAHAL BOUDERBA N Page 3
2MBIOMA Module : ALIT Chapitre 2 : Mycotoxines
viridicatum…) et d’Aspergillus (A. ochraceus…). Elle fait partie de la famille des
ochratoxines qui compte une dizaine de molécules connues. Les champignons A. ochraceus
produisent l’OTA à une température optimale de 28°C alors que P. viridicatum par exemple,
produit la mycotoxine entre 4 et 30°C.
Il a été démontré que l’OTA est néphrotoxique, carcinogène, immunotoxique, génotoxique et
tératogène pour toutes les espèces animales testées. Elle a été également classée carcinogène
du groupe 2B (peut provoquer le cancer). L’OTA a de nombreux effets délétères sur différents
types d’organes d’animaux domestiques. Le rein est l’organe cible de l’OTA. Cependant,
d’autres organes sont aussi atteints tels que le foie.
3.Trichothécènes
On sait étonnamment peu de chose des effets de l’humidité et de la température sur le
comportement des moisissures du genre Fusarium, et, entre autres, sur la production de
mycotoxines.
Dans le cas de F. graminearum, les limites de température dans lesquelles la croissance est
possible n’ont pas été rapportées, mais la température optimale a été estimée entre 24 et 26°C.
Le facteur d’humidité minimal est de 0,9, et la limite supérieure dépasserait 0,99. On ne
dispose d’aucune information sur l’effet de l’humidité et de la température sur la production
de déoxynivalénol, de nivalénol et de zéaralénone
4. Zéaralénone
La zéaralénone est une mycotoxine oestrogène que l’on trouve en faibles quantités,
principalement dans le maïs, en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Elle peut être
présente en grandes quantités dans les pays en développement, particulièrement lorsque le
maïs est cultivé dans des conditions plus tempérées, par exemple en altitude.
La zéaralénone, coproduite avec le déoxynivalénol par F. graminearum, est associée, avec le
DON, à des épisodes aigus de mycotoxicoses chez l’homme.
5. Fumonisines
Les fumonisines sont un groupe de mycotoxines récemment caractérisées produites par F.
moniliforme, une moisissure présente dans le monde entier et fréquemment retrouvée sur le
Dr NAHAL BOUDERBA N Page 4
2MBIOMA Module : ALIT Chapitre 2 : Mycotoxines
maïs (CIRC, 1993d). La fumonisine B1 a été observée dans le maïs et les produits en
contenant dans diverses régions agroclimatiques comprenant les États-Unis, le Canada,
l’Uruguay, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Autriche, l’Italie et la France. Ces toxines sont
observées principalement en présence de maïs cultivé sous un climat chaud et sec.
6. Patuline
La patuline est un antibiotique produit par plusieurs moisissures. Elle apparaît dans les
pommes pourries contaminées par Penicillium expansum et, peut donc être présente dans le
jus de pomme et autres produits à base de pommes.
Détection des mycotoxines
Les effets toxiques des mycotoxines s'exercent même en quantités extrêmement faibles dans
les denrées. Leur identification et leur évaluation quantitative font appel à des méthodes
perfectionnées d'échantillonnage, de préparation des échantillons, d'extraction et d'analyse.
Dans des conditions pratiques de stockage, le but doit être de suiveiller l'apparition des
champignons. Si aucun champignon n'est détecté, la contamination par les mycotoxines est
peu probable. La présence de champignons révèle un risque de production de mycotoxines; il
faut alors envisager la destruction du lot contaminé. Bien qu'il existe des moyens pour
décontaminer des denrées polluées, ils sont relativement onéreux et leur efficacité fait encore
l'objet de débats.
Des méthodes simples, rapides et efficaces d'analyse des mycotoxines, pouvant être mises en
oeuvre par des opérateurs peu qualifiés, sont nécessaires et des progrès ont déjà été réalisés en
vue de leur développement.
Le FGIS Service Fédéral Américain d'inspection des Grains, a évalué huit tests mis sur le
marché pour la détection rapide de l'aflatoxine du maïs Les kits approuvés par le FOIS
comprennent un test ELISA rapide, une cartouche d'affinité immunitaire, un test ELISA en
phase solide et des méthodes sélectives absorbantes en mini-colonnes.
Dans les laboratoires la technique de détection par HPLC reste la meilleur et la plus
performante mais l’inconvénient de cette technique c’est qu’elle est couteuse.
Il reste nécessaire de mettre au point des méthodes d'analyse efficaces, peu coûteuses et
pouvant être utilisées dans les laboratoires des pays en développement.
Dr NAHAL BOUDERBA N Page 5
2MBIOMA Module : ALIT Chapitre 2 : Mycotoxines
Plusieurs gouvernements ont mis en place des limites réglementaires des teneurs en
mycotoxines dans les denrées mises sur le marché ou importées. En ce qui concerne
l'aflatoxine, les recommandations varient de 400 à 500 µq/kg (parties par billion). Les limites
réglementaires pour la fumonisine sont en cours d'examen. Pour toutes les mycotoxines, il est
probable que l'amélioration des méthodes d'analyse et des connaissances des toxines
entraînera une baisse des limites maximales tolérées.
Dr NAHAL BOUDERBA N Page 6
Vous aimerez peut-être aussi
- Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles.: Colony Collapse DisorderD'EverandSyndrome d'effondrement des colonies d'abeilles.: Colony Collapse DisorderPas encore d'évaluation
- Microbiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainD'EverandMicrobiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Les MycotoxinesDocument7 pagesLes MycotoxinesInga Jurju100% (1)
- Mycotoxins FRDocument2 pagesMycotoxins FRgouthonomonlolaPas encore d'évaluation
- Les Mycotoxines ESSAIADocument55 pagesLes Mycotoxines ESSAIAamina imene100% (1)
- Les MycotoxinesDocument37 pagesLes MycotoxinesAnass DraPas encore d'évaluation
- Polycope 2022 CorrigéDocument45 pagesPolycope 2022 CorrigéAbdelmoghit EL HAILOTIPas encore d'évaluation
- Bourais TL2006Document6 pagesBourais TL2006abdelillah hatimPas encore d'évaluation
- Les Mycotoxines: Un Danger de Santé Public: January 2016Document20 pagesLes Mycotoxines: Un Danger de Santé Public: January 2016Ingrid MarchauxPas encore d'évaluation
- Toxicologie Des Mycotoxines - Dangers Et Risques en Alimentation Humaine Et Animale 2005 PDFDocument10 pagesToxicologie Des Mycotoxines - Dangers Et Risques en Alimentation Humaine Et Animale 2005 PDFlsandlasnPas encore d'évaluation
- Les Mycotoxines: Un Danger de Santé Public: January 2016Document20 pagesLes Mycotoxines: Un Danger de Santé Public: January 2016anassyounes2003Pas encore d'évaluation
- Présentation Mycotox M2 QSADocument69 pagesPrésentation Mycotox M2 QSAOuiam OuiamPas encore d'évaluation
- ISAGES M1 Polycopie de Cours Microbiologie AlimentaireDocument79 pagesISAGES M1 Polycopie de Cours Microbiologie AlimentairedadeahmedjamesPas encore d'évaluation
- Toxicology of Mycotoxins, Hazards and Risks in Human and Animal FoodDocument10 pagesToxicology of Mycotoxins, Hazards and Risks in Human and Animal FoodMLAN HesnaPas encore d'évaluation
- Hygiène Et Sécurité Sanitaire Des Aliments ERA SUD AGROTRANSFORMATIONDocument40 pagesHygiène Et Sécurité Sanitaire Des Aliments ERA SUD AGROTRANSFORMATIONGedion DouaPas encore d'évaluation
- 7 MycotoxineDocument11 pages7 Mycotoxinehamadi-fatimaPas encore d'évaluation
- Aflatoxine NutiritionDocument9 pagesAflatoxine NutiritionSawsen MhamdiPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 4 5 Ecologie MicrobienneDocument22 pagesChapitre 3 4 5 Ecologie Microbienneislam.brm1332Pas encore d'évaluation
- PhytopathologieDocument20 pagesPhytopathologieNouara AmokranePas encore d'évaluation
- AflatoxinesDocument36 pagesAflatoxinesamrouche13100% (3)
- Chapitre 2Document9 pagesChapitre 2Nsoa Patrick emmanuelPas encore d'évaluation
- Microbio BinômeDocument40 pagesMicrobio BinômeAdam Magagi garbaPas encore d'évaluation
- Copie de Cours MasterDocument471 pagesCopie de Cours Masterbiodeug67% (3)
- Les Maladies MicrobiennesDocument134 pagesLes Maladies MicrobiennesAmina100% (17)
- M1 Protection Des Végétaux 19-20 Cours Phytopathologie Master SNVDocument28 pagesM1 Protection Des Végétaux 19-20 Cours Phytopathologie Master SNVMohamed Mohamed Bellache100% (1)
- Micro Organismes Et AlimentsDocument8 pagesMicro Organismes Et AlimentsMįSs BęãüTÿPas encore d'évaluation
- Exposé MicrobioDocument24 pagesExposé MicrobioAdam Magagi garbaPas encore d'évaluation
- 1174522Document40 pages1174522lobnaPas encore d'évaluation
- Processus InfectieuxDocument229 pagesProcessus InfectieuxMassouh AssouiPas encore d'évaluation
- 2018 - Rakotonirainy - La Biocontamination Des Documents GraphiquesDocument8 pages2018 - Rakotonirainy - La Biocontamination Des Documents GraphiquesFatima zahra NaciriPas encore d'évaluation
- Resume Mycotoxines 3Document6 pagesResume Mycotoxines 3BBichon FrizePas encore d'évaluation
- Cours Mycotoxines 倀udiants 2020-2021Document185 pagesCours Mycotoxines 倀udiants 2020-2021Zineb BahlawiPas encore d'évaluation
- 2019 Cours Phytopathologie Chap 1 Et IntroDocument9 pages2019 Cours Phytopathologie Chap 1 Et IntroKaoutar LamsilaPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document11 pagesChapitre 3Nsoa Patrick emmanuelPas encore d'évaluation
- MYCOBACTERIES CorrigéDocument62 pagesMYCOBACTERIES CorrigésafemindPas encore d'évaluation
- BacterioDocument6 pagesBacterioAmir JaballahPas encore d'évaluation
- Le Monde Microbien - GBDocument29 pagesLe Monde Microbien - GBzoungrana idrissaPas encore d'évaluation
- Parasitologie VégétaleDocument26 pagesParasitologie VégétaleFaiza FifiPas encore d'évaluation
- Jean Louis CUQ Microbiologie de Nos Aliments 2016Document150 pagesJean Louis CUQ Microbiologie de Nos Aliments 2016asamboa lionelPas encore d'évaluation
- Les Maladies Fongiques de La VigneDocument9 pagesLes Maladies Fongiques de La VigneAminos AminosPas encore d'évaluation
- Bactéries Anaérobies À Gram NégatifDocument8 pagesBactéries Anaérobies À Gram Négatifsfendri17Pas encore d'évaluation
- Bactéries Anaérobies GénéralitésDocument9 pagesBactéries Anaérobies Généralitéssfendri17Pas encore d'évaluation
- Profil Microbien Des Aliments Et AltérationsDocument29 pagesProfil Microbien Des Aliments Et AltérationsAhlamPas encore d'évaluation
- Salmonella SPDocument12 pagesSalmonella SPLina Had JerPas encore d'évaluation
- Alertes Aux MycotoxinesDocument20 pagesAlertes Aux MycotoxinesMLAN HesnaPas encore d'évaluation
- Cours Lutte BiologiqueDocument55 pagesCours Lutte BiologiqueFərrøųdjã MędjbërPas encore d'évaluation
- L'Importance Des Micro Organ Is Me Dans Les AlimentsDocument4 pagesL'Importance Des Micro Organ Is Me Dans Les AlimentsاخيراPas encore d'évaluation
- PénicillineDocument15 pagesPénicillinecampus librairiePas encore d'évaluation
- Travail6an-Risques Biologiques2020chachourDocument9 pagesTravail6an-Risques Biologiques2020chachourFarah B. BtoushPas encore d'évaluation
- 40 Cont ADocument21 pages40 Cont AZouhir BenPas encore d'évaluation
- Seance 3Document3 pagesSeance 3Komi Achille AffognonPas encore d'évaluation
- Les MicrobesDocument6 pagesLes Microbeshatimous2010Pas encore d'évaluation
- Cours Phytopath ORIGDocument465 pagesCours Phytopath ORIGHicham Ait BouhouPas encore d'évaluation
- Les maladies de l'abeille: Éviter, Détecter, Identifier, SoignerD'EverandLes maladies de l'abeille: Éviter, Détecter, Identifier, SoignerÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- OGM : Intérêts industriels et enjeux politiques: Essai scientifiqueD'EverandOGM : Intérêts industriels et enjeux politiques: Essai scientifiquePas encore d'évaluation
- Coronavirus Covid-19. Vous défendre. Évitez la contagion. Protégez votre maison, votre famille, votre travail. Mise à jour de la quatrième édition.D'EverandCoronavirus Covid-19. Vous défendre. Évitez la contagion. Protégez votre maison, votre famille, votre travail. Mise à jour de la quatrième édition.Pas encore d'évaluation
- 2 2 B Digestion MacromoleculesDocument4 pages2 2 B Digestion MacromoleculesTasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- Chapitre III Microbiote IntestinaleDocument13 pagesChapitre III Microbiote IntestinaleTasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- Chapitre IV Contamination Des Locaux PDFDocument7 pagesChapitre IV Contamination Des Locaux PDFTasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- Chapitre I de Geol LA TERREDocument5 pagesChapitre I de Geol LA TERRETasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- Corrigé de EMD Microbiologie 2014Document4 pagesCorrigé de EMD Microbiologie 2014Tasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- Alpha Amylase 2Document10 pagesAlpha Amylase 2Tasnim Tas Nim100% (1)
- Acide SucciniqueDocument6 pagesAcide SucciniqueTasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- 00-Les ChampignonsDocument101 pages00-Les ChampignonsTasnim Tas Nim100% (2)
- Acide CitriqueDocument3 pagesAcide CitriqueTasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- MA Heust DelphineDocument187 pagesMA Heust DelphineLina SafaPas encore d'évaluation
- Bourais TL2006Document6 pagesBourais TL2006abdelillah hatimPas encore d'évaluation
- Chapitre2 PDFDocument6 pagesChapitre2 PDFTasnim Tas NimPas encore d'évaluation
- HACCP COUSCOUS FinalDocument35 pagesHACCP COUSCOUS FinalSuma MulimPas encore d'évaluation
- Module 02 Hygienne Et Securite AlimentairevfDocument55 pagesModule 02 Hygienne Et Securite AlimentairevfKhaledBranatPas encore d'évaluation
- EXPOSEDocument13 pagesEXPOSERokhaya DiopPas encore d'évaluation
- G-025v2Fr 20151015 PDFDocument287 pagesG-025v2Fr 20151015 PDFTAMMA HOUSSAM ELDDINPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 4 5 Ecologie MicrobienneDocument22 pagesChapitre 3 4 5 Ecologie Microbienneislam.brm1332Pas encore d'évaluation
- Cours Mycotoxines 倀udiants 2020-2021Document185 pagesCours Mycotoxines 倀udiants 2020-2021Zineb BahlawiPas encore d'évaluation
- Hygiène Et Sécurité Sanitaire Des Aliments ERA SUD AGROTRANSFORMATIONDocument40 pagesHygiène Et Sécurité Sanitaire Des Aliments ERA SUD AGROTRANSFORMATIONGedion DouaPas encore d'évaluation
- Etude Fao: Alimentation Et Nutrition: ISSN 1014-290Document304 pagesEtude Fao: Alimentation Et Nutrition: ISSN 1014-290Abdelali EnnouariPas encore d'évaluation
- Fiche Technique Alimentation Animale 201608Document12 pagesFiche Technique Alimentation Animale 201608benPas encore d'évaluation
- RCCP Ra Mycotoxines2009Document308 pagesRCCP Ra Mycotoxines2009Inga JurjuPas encore d'évaluation
- CXS 193f-1Document49 pagesCXS 193f-1Imelda KamsuPas encore d'évaluation
- Copie de Cours MasterDocument471 pagesCopie de Cours Masterbiodeug67% (3)
- Chapitre 3: Modifications Entraînant Un Risque de PathogénicitéDocument23 pagesChapitre 3: Modifications Entraînant Un Risque de PathogénicitéOuiam OuiamPas encore d'évaluation
- Stockage Des Céréales - Wikipédia PDFDocument39 pagesStockage Des Céréales - Wikipédia PDFfabrice mellantPas encore d'évaluation
- Article Sciencelib Isolement Des Souches D Actinomycetes Productrices de Substances Antifongiques-5Document14 pagesArticle Sciencelib Isolement Des Souches D Actinomycetes Productrices de Substances Antifongiques-5Said SaiPas encore d'évaluation
- Objectifs Des Enseignements de Mycologie LynonDocument2 pagesObjectifs Des Enseignements de Mycologie LynonMariam AhmPas encore d'évaluation
- Plan - HACCP - Xls - Filename - UTF-8''Plan HACCPDocument4 pagesPlan - HACCP - Xls - Filename - UTF-8''Plan HACCPAmine Simo JacksonPas encore d'évaluation
- Dawajine Infos N°26 PDFDocument76 pagesDawajine Infos N°26 PDFDIEGO MARADONAPas encore d'évaluation
- Les Mycotoxines ToxDocument17 pagesLes Mycotoxines ToxDiana Paierele0% (1)
- El Aziz, HDocument127 pagesEl Aziz, HROKNI yahyaPas encore d'évaluation
- Guide de Bonnes Pratiques D'hygiène Et D'application Des Principes HACCP en MeunerieDocument21 pagesGuide de Bonnes Pratiques D'hygiène Et D'application Des Principes HACCP en MeuneriesanjeeneePas encore d'évaluation
- 1 (4) - CopieDocument13 pages1 (4) - Copiesalama2011Pas encore d'évaluation
- PFE ESIAT Etude de L'effet de L'irradiation Sur La Conservation de Pin D'alep Et Sur Les MycotoxinesDocument133 pagesPFE ESIAT Etude de L'effet de L'irradiation Sur La Conservation de Pin D'alep Et Sur Les MycotoxinesDominique Serge AmbassaPas encore d'évaluation
- Laouid NeftiaDocument95 pagesLaouid Neftiaryma bouldjedjPas encore d'évaluation
- TD3 Toxicologie Analytique-ConvertiDocument22 pagesTD3 Toxicologie Analytique-ConvertiSelma HassuonPas encore d'évaluation
- Etude Des Moisissures Potentiellement Productrices de Mycotoxines Isolées À Partir Des Grains de Blé Dur (Traités Et Non Traités)Document107 pagesEtude Des Moisissures Potentiellement Productrices de Mycotoxines Isolées À Partir Des Grains de Blé Dur (Traités Et Non Traités)Othmane MebroukiPas encore d'évaluation
- Risques BiologiquesDocument53 pagesRisques BiologiquesManna Karim OUEDRAOGOPas encore d'évaluation