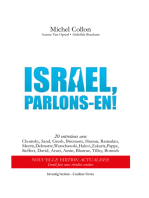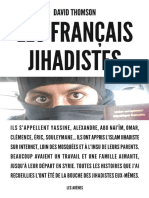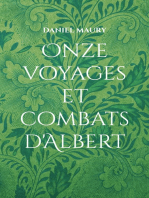Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ENTRETIEN - Elaine Mokhtefi
Transféré par
moussaouiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
ENTRETIEN - Elaine Mokhtefi
Transféré par
moussaouiDroits d'auteur :
Formats disponibles
«
Alger vibrait, jour et nuit, d’une exaltation extraordinaire »
Nina Simone, Archie Shepp et Miriam Makeba s’y produisirent. Les
révolutionnaires du continent et du monde entier s’y donnèrent
rendez-vous. Il y a 50 ans, le Festival panafricain faisait converger à
Alger tous les espoirs soulevés par la décolonisation. Retour sur cette
parenthèse enchantée avec l’Américaine Elaine Mokhtefi, qui fut l’une
des chevilles ouvrières de l’évènement.
« Les catholiques vont au Vatican, les musulmans à La Mecque et les
révolutionnaires à Alger », affirma un jour Amilcar Cabral, héros tombé
trop tôt de la lutte d’indépendance du Cap-Vert et de la Guinée Bissau.
Alors que tout un peuple clame son désir de se libérer pour reconquérir une
indépendance confisquée, l’Américaine Elaine Mokhtefi se souvient de ces
années rouges, quand la Ville blanche offrait asile et soutien aux
combattants de la liberté, des Sud Africains de l’ANC aux activistes du
Black Panthers Party (BPP), des antifranquistes aux Vietnamiens en
guerre. Cette militante internationaliste, qui épousa la cause de l’Algérie
indépendante, côtoya Frantz Fanon et croisa les grandes figures de la
révolution africaine. Elle fut, à l’été 1969, l’une des chevilles ouvrières du
Festival panafricain ; elle accompagnait alors Eldridge Cleaver et ses
camarades dans leur exil algérien. De cette épopée, elle livre, dans « Alger,
capitale de la révolution » (La Fabrique), un récit savoureux, exaltant, mais
lucide sur la nature autoritaire du régime qui prenait corps, alors, dans l’ex-
colonie française. Rencontre.
C’est en France que vous avez d’abord pris fait et cause pour le peuple
algérien. Dans quelles circonstances ?
Elaine Mokhtefi. J’arrivais des Etats-Unis lorsque j’ai assisté à Paris, au
défilé syndical du 1er mai 1952. Reléguées à l’arrière du cortège officiel,
des milliers d’hommes suivaient, par rangées de dix ou douze. C’était très
impressionnant. J’ai compris plus tard qu’il s’agissait de militants du
MTLD. Quelques jours plus tard, en Algérie, à Orléansville (Chlef
aujourd’hui, NDLR), la police tirait sur la foule venue pour un meeting du
chef de cette organisation, Messali Hadj, faisant deux morts et des
centaines de blessés. Ce leader indépendantiste était arrêté, pour être placé,
en France, en résidence surveillée. Tout ceci m’a frappée. Ces évènements
troublaient mon image de la France : je me suis dis que quelque chose
n’allait pas.
Vous êtes issue d’une famille de la classe ouvrière américaine, de
confession juive. Ces origines vous portaient-elles spontanément du côté
des opprimés ?
Elaine Mokhtefi. Je dois plutôt cette empathie à ma propre expérience : la
classe ouvrière américaine ne penchait pas forcément à gauche. Très tôt,
j’ai éprouvé la discrimination raciste, parce que j’appartenais à une famille
juive. A l’époque, l’antisémitisme était très fort, très prononcé, il
s’exprimait ouvertement. Il se manifeste aujourd’hui, aux Etats-Unis, de
façon, disons… plus discrète. Et puis je suis d’un milieu assez modeste.
Dans mon entourage, dans le village où j’ai grandi, personne n’allait à
l’université. Nos enseignants eux-mêmes n’avaient pas fait d’études
supérieures, au-delà des deux ans d’école normale. Il n’y avait pas
d’exemple, il fallait se débrouiller soi-même. J’ai appris très tôt à prendre
des coups, à me débrouiller toute seule. Je crois que tout cela m’a rendue,
plus tard, sensible au racisme, à la discrimination. En France, j’ai été
horrifiée par les conditions de vies des Algériens dans les bidonvilles. Cela
me faisait pensait au sort réservé aux Noirs du sud des Etats-Unis. C’était
le même genre d’habitations de bric et de broc. Toutes ces images me sont
restées. Je les avais en tête, elles m’ont influencée, elles sont remontées à
la surface lorsque, plus tard, j’ai rencontré des militants politiques.
Lorsque vous arrivez en Europe, l’usage de l’anglais n’y est pas si répandu.
Cette compétence linguistique vous porte vers l’interprétariat. Vous êtes
très vite enrôlée dans des organisations internationalistes et vos missions
vous conduisent à Accra, au Ghana, où vous faites des rencontres
décisives, celle de Frantz Fanon en particulier. Quel souvenir gardez-vous
de lui ?
Elaine Mokhtefi. J’étais sur le campus d’Accra, quand j’ai vu arriver quatre
hommes : trois d’entre eux était vêtus de costume de laine et portaient des
cravates. Le quatrième, lui, était visiblement plus décontracté, en pantalon
de coton et chemisette. C’était Fanon. Ces quatre Algériens étaient là pour
examiner la possibilité d’ouvrir un front du sud dans la guerre d’Algérie.
Ils étaient allés jusqu’à la frontière malienne, avant de revenir à Accra où
Fanon, représentant permanent du GPRA en Afrique, disposait d’un siège.
De mon côté, j’étais l’organisatrice d’une conférence internationale de
jeunesse. Fanon est venu assister à cette conférence avec ses camarades.
Elle a duré trois semaines : il venait tous les jours, nous défendions
l’adoption de résolutions anticolonialistes, anti-impérialistes. C’était un
petit bonhomme, mais on le sentait mu par une grande foi politique. Son
corps était tendu par la volonté, il réfléchissait continuellement à la
politique. Il parlait beaucoup politique, il écartait le plus souvent les sujets
qui l’en éloignaient. Mais il savait, aussi, se montrer plein d’humour : il
nous faisait rire. Il aimait beaucoup la musique, se passionnait pour le
football. Il nous racontait de nombreuses études de cas tirées de son
expérience de médecin chef à l’hôpital de Blida, avant son expulsion
d’Algérie.
Ce travail auprès des colonisés, comme psychiatre, deviendra le creuset
d’une solide pensée d’émancipation. Son livre « Les Damnés de la terre »
est très vite devenu, à l’époque, une bible des révolutionnaires. Dans quelle
mesure Fanon influença-t-il les militants Africains-Américains ?
Elaine Mokhtefi. C’était une lecture obligatoire pour tous les militants du
Black Panthers Party. Ses cofondateurs, Huey Newton et Bobby Seale, y
voyaient « une philosophie de la violence exemplaire ». C’était un peu leur
bible, oui : ce texte était discuté collectivement. C’était le livre qui
apprenait aux opprimés à se libérer, à devenir actifs, militants.
Une décennie après avoir quitté les Etats-Unis, vous vous définissez
comme anti-impérialiste, anticolonialiste, socialiste. Vous dites aussi de la
guerre d’Algérie qu’elle détermine la fracture politique fondamentale de
l’époque. C’est ce qui vous pousse à revenir à New York. Là, vous vous
mettez au service du bureau algérien, qui ouvre un nouveau front,
diplomatique celui-là. Comment fonctionnait cette ambassade officieuse
qui, dites vous, abattait plus de travail que la représentation française à
l’ONU ?
Elaine Mokhtefi. Nous étions quatre, seulement, à travailler au bureau
algérien de New York, quand la France disposait d’une délégation de 93
personnes, sans compter l’ambassade de Washington. Ce bureau avait été
fondé en 1955 par M’hamed Yazid et Hocine Aït Ahmed pour
internationaliser la question algérienne. Tous les ans, une délégation
conduite par Krim Belkacem arrivait de Tunis, une résolution en faveur de
l’indépendance de l’Algérie était introduite à l’ONU. On y rappelait la
torture, l’injustice. Il était très difficile de convaincre des délégations de
voter en faveur de ces résolutions : la France avait une influence énorme
sur les anciennes colonies qu’elle avait « lâchées » pour garder l’Algérie.
Les pays européens et les Etats-Unis appuyaient Paris eux aussi. On faisait
ce qu’on pouvait, on écrivait des brochures, on préparait des discours, on
rencontrait des journalistes…
En fait, c’est déjà là, dans ce bureau algérien de New York, que se nouent
des solidarités internationalistes, panafricaines, avec des représentants
d’autres peuples colonisés…
Elaine Mokhtefi. Les Algériens étaient très conscients de leur faiblesse
militaire. Ils n’allaient pas vaincre la quatrième puissance mondiale avec
des couteaux de scouts et des vieux fusils, c’était une évidence. Ils ont vite
compris que la bataille se jouait aussi dans l’arène diplomatique. Tandis
que les maquis, à l’intérieur, s’étendaient, les contacts étaient pris avec
d’autres organisations de libération, africaines, surtout. Cette ouverture
vers l’international, qui était fut décisive dans la lutte algérienne, a perduré
après l’indépendance : les organisations de libération du monde entier,
d’Afrique, d’Amérique latine, les mouvements antifascistes espagnols et
portugais… tous ont ouvert des bureaux à Alger. Leurs militants y étaient
reçus, soutenus, formés.
A l’indépendance, vous vous étiez, dites-vous, « algérianisée hors
d’Algérie ». Lorsque vous arrivez à Alger, bien après le coup d’état contre
le GPRA et la prise de pouvoir de l’armée des frontières, vous passez de
services en services, avant d’être affectée à l’agence de presse officielle.
Vous observez déjà de sérieux dysfonctionnements, des rivalités, des
failles politiques. Vous êtes d’ailleurs assez cruelle avec Ahmed Ben Bella,
décrit dans votre livre comme un homme velléitaire. Le ver était-il déjà
dans le fruit, en 1962 ?
Elaine Mokhtefi. Oui, toutes ces faiblesses étaient déjà manifestes. Il ne
faut pas oublier que la pratique de la torture se perpétuait dans la jeune
Algérie indépendante… Nous étions jeunes, optimistes, idéalistes, sans
doute trop peu cyniques : nous pensions, à l’époque, que les choses
pouvaient évoluer, que ce pouvoir militaire ne serait pas éternel. Il y avait
d’un côté l’armée, la police, les services. Et de l’autre, beaucoup de
progressistes, algériens ou étrangers, venus du monde entier. Nous sentions
que nous avions de la force, que les choses pouvaient changer.
Lors du coup d’état de 1965, lorsque Houari Boumediene dépose Ahmed
Ben Bella, vous rejoignez les protestataires. Le régime durcit la répression.
Bachir Hadj Ali et Mohammed Harbi, figures du combat d’indépendance,
sont torturés, emprisonnés, comme bien d’autres militants de gauche.
Diriez-vous que le pouvoir de Houari Boumediene a instrumentalisé cet
affichage internationaliste pour en faire une vitrine et faire oublier son
caractère autoritaire ?
Elaine Mokhtefi. Oui, je le pense. C’était une semi dictature. Houari
Boumediene et les hommes qui l’entouraient étaient conscients de l’enjeu
que représentait cette façade internationaliste. Beaucoup de critiques
s’exprimaient à l’époque, des gens quittaient le pays parce qu’ils refusaient
de vivre sous un régime militaire.
Comment Eldridge Cleaver et les militants du Black Panthers Party ont-ils
atterri à Alger ?
Elaine Mokhtefi. Accusé de tentative de meurtre, Eldridge Cleaver a pris
contact avec la délégation cubaine à l’ONU, pour rejoindre La Havane. Il
est parti clandestinement, en bateau. Cinq mois plus tard, alors que sa
présence sur l’île avait été révélée dans la presse, les autorités ont jugé trop
difficile de prolonger son séjour. Les Cubains l’ont convaincu qu’il serait
bien en Algérie, ils lui ont donné des documents de voyage et l’ont mis
dans un avion. Mais personne ne l’attendait à Alger. Il m’a alors contactée
par l’entremise d’un représentant de la ZAPU, l’organisation de libération
du Zimbabwe, qui disposait d’un bureau à Alger. Je suis allée le voir, il
était avec son épouse, Kathleen, enceinte. J’ai aussitôt contacté la le
commandant Slimane Hoffman, qui dirigeait au sein du FLN la section
chargée des mouvements de libération. Je lui ai expliqué la situation de
Cleaver. Il m’a dit : « Mais qu’il reste ! », en suggérant l’organisation
d’une conférence de presse. Il a pris cette décision sans en référer à qui que
ce soit, parce que c’était normal. Et Cleaver est resté.
A la même époque, vous êtes très impliquée dans la préparation du Festival
panafricain d’Alger, qui a lieu du 21 juillet au 1er août 1969. En quoi cet
évènement représente-il, pour reprendre votre expression, un « éclair dans
le ciel d’Afrique » ?
Elaine Mokhtefi. Alger vibrait, jour et nuit, d’une exaltation extraordinaire,
pendant toute la durée de cet évènement. C’était un moment magique :
trente et un pays africains et six mouvements de libération avaient envoyé
des délégations. Le Moyen Orient, le Vietnam, Cuba étaient aussi
représentés ; la diaspora noire au Brésil et aux Etats-Unis était là. Le
festival a réuni 60000 spectateurs, des femmes voilées, avec leurs enfants,
assistaient aux spectacles jusqu’à 3 ou 4 heures du matin sur les places
publiques d’Alger. C’était exceptionnel. Le jazzman américain Archie
Shepp, un musicien exceptionnel, un grand intellectuel, clamait : « Nous
sommes revenus ! Nous sommes noirs et nous sommes revenus ! ».
Eldridge Cleaver répétait : « L’Amérique blanche a tenté de faire croire au
Noirs américains qu’ils n’avaient pas de passé en Afrique ». Mais tous
étaient parfaitement conscients de leurs origines… L’atmosphère était très
joyeuse, les délégations se promenaient dans la rue. A chaque carrefour, il
y avait des sortes d’estrades où les délégations se présentaient. Les théâtres
ne désemplissaient pas, les fantasias se succédaient… A la fin, il y a eu ce
feu d’artifice grandiose illuminant la ville. Je me souviens de deux
semaines de pur bonheur !
Les Blacks Panthers ne passaient pas inaperçus… Comment se
comportaient-ils, dans cet environnement que vous décrivez comme
« ombrageux et conservateur » ?
Elaine Mokhtefi. Les Panthers n’avaient aucune conscience de ce qu’était
alors la société algérienne. Ils se promenaient en ville avec leurs afros,
leurs blues jeans, s’attablaient aux terrasses des cafés… Ils vivaient ! Ils
vivaient comme s’ils étaient aux Etats-Unis. On les remarquait. Pendant le
Festival panafricain, leur bureau était rempli nuit et jour d’Algériens
séduits par ces grands messieurs plein de charme. Ils ne parlaient pas un
mot de français ni d’arabe, mais ils arrivaient à se faire comprendre, ils
distribuaient de la littérature, des photos, des affiches.
Au-delà de la défense de leur propre cause, les Panthers s’impliquaient-ils
aussi dans les solidarités internationalistes qui se tissaient alors à Alger ?
Elaine Mokhtefi. Oui, bien sûr ! Dès son arrivée, Cleaver a rencontré le
représentant du Viêt-Cong. Les Panthers étaient les gardes du corps attitrés
d’Oliver Tambo, le président de l’ANC, lors de ses visites à Alger. Ils ont
noué, aussi, des relations avec les Palestiniens du Fatah. Il fallait beaucoup
de courage, pour assumer, comme Américains, de telles rencontres.
Une question plus personnelle, sur Cleaver lui-même : vous ne taisez rien
de la brutalité du personnage, de son machisme. Vous évoquez même le
crime qu’il commet en abattant l’un de ses camarades. Pourquoi suscitait-il
quand même chez vous tant d’admiration ?
Elaine Mokhtefi. Il était un dirigeant noir américain, c’était important pour
moi. Oui, il avait de terribles défauts mais il avait aussi de grandes
qualités : il était très intelligent, c’était un orateur exceptionnel, il avait une
belle plume, il représentait avec talent le peuple noir américain. Lui et moi,
on s’entendait, nous étions des camarades. J’étais un peu comme sa
confidente, il me racontait ce qu’il taisait en présence d’autres. Je suis
l’une des rares personnes à qui il a confié, par exemple, qu’il travaillait
avec la bande à Baader. Il avait des côtés admirables et des côtés
détestables. Il pouvait arranger la vérité très facilement, ce qui me
déplaisait terriblement. Mais c’était ainsi !
Comment cette section internationale du BPP se situait-elle sur l’échiquier
de la guerre froide ?
Elaine Mokhtefi. Ils étaient du côté de la révolution, des révolutionnaires.
Leur solidarité avec les mouvements de libération, avec les mouvements de
gauche à travers le monde était totale. Ils sont allés au Vietnam où ils ont
rencontré le général Giap. Là, Eldridge Cleaver s’est adressé, sur les ondes
de la radio nord-vietnamienne, aux soldats américains déployés au sud,
pour les appeler à saboter les opérations…
Huey Newton est libéré le 5 août 1971. Il est accueilli par des milliers de
personnes à sa sortie de prison, avec ce slogan : « Le ciel pour seule
limite ». Mais c’est aussi le début de la crise qui conduira à l’éclatement du
Black Panthers Party. Le travail de sape du FBI, avec son programme de
contre insurrection explique-t-il seul la crise ? Existait-il, déjà, des
fractures politiques entre Newton et Cleaver ?
Elaine Mokhtefi. Oui, il y avait des fractures politiques, pas entre deux
hommes, mais entre deux factions du parti. Beaucoup de gens ont
commencé à se méfier de Huey Newton quand il est sorti de prison. Il est
vite tombé dans la drogue, dans le pouvoir personnel, il essayait de
contrôler toutes les activités : tout devait passer par lui. Il était difficile,
depuis Alger, de prendre la mesure de cette crise. Lorsque la scission est
intervenue, Huey Newton était déjà très isolé. Je pense que le FBI a joué
un rôle central dans la destruction du parti. Ils ont attaqué physiquement les
bureaux des Panthers dans différentes villes. Ils ont assassiné des militants.
Ils ont monté des complots, avec des fausses lettres, de fausses
informations pour semer la division. Mais les Panthers aussi ont leur part
de responsabilité. La rivalité entre Cleaver et Newton, devenue publique, a
précipité la désagrégation du parti.
Entretien réalisé par Rosa Moussaoui
Vous aimerez peut-être aussi
- The Isis PapersDocument130 pagesThe Isis PapersEdden Ahaut Fred Akichi88% (8)
- Israël, parlons-en!: 20 entretiens avec Chomsky, Sand, Gresh, Bricmont, Hassan, Ramadan, Morris, Delmotte, Warschawski, Halevi, Zakaria, Pappe, Sieffert, David, Aruri, Amin, Blanrue, Tilley, BotmehD'EverandIsraël, parlons-en!: 20 entretiens avec Chomsky, Sand, Gresh, Bricmont, Hassan, Ramadan, Morris, Delmotte, Warschawski, Halevi, Zakaria, Pappe, Sieffert, David, Aruri, Amin, Blanrue, Tilley, BotmehPas encore d'évaluation
- Exemple de Sujets Examen Taxi VTCDocument11 pagesExemple de Sujets Examen Taxi VTCsam lemaire100% (2)
- Presto Vivace & Reprise - Full ScoreDocument3 pagesPresto Vivace & Reprise - Full ScoreMarcello Cirelli67% (3)
- Interview de Josie Fanon Veuve de FrantzDocument9 pagesInterview de Josie Fanon Veuve de FrantzLouis MehmesPas encore d'évaluation
- Alain Soral - Chroniques D'avant-Guerre PDFDocument295 pagesAlain Soral - Chroniques D'avant-Guerre PDFJames100% (2)
- Les Francais Jihadistes - David ThomsonDocument530 pagesLes Francais Jihadistes - David ThomsonKrisLegeay100% (1)
- Frantz-Fanon - L'homme-De-La-RuptureDocument13 pagesFrantz-Fanon - L'homme-De-La-RuptureIkhlas ChachouaPas encore d'évaluation
- 30 - Florilège de La Françafrique PDFDocument12 pages30 - Florilège de La Françafrique PDFJulio Cesar PiñerosPas encore d'évaluation
- La QuestionDocument28 pagesLa QuestionsidePas encore d'évaluation
- Qui Est Charlie - Sociologie - Emmanuel ToddDocument652 pagesQui Est Charlie - Sociologie - Emmanuel ToddViolette Victoire100% (1)
- 942 8mars2013Document24 pages942 8mars2013elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Hommage À Robert DavaziesDocument3 pagesHommage À Robert Davaziesjmlb0123Pas encore d'évaluation
- Debat Goldnadel Soral Guysen 2004Document5 pagesDebat Goldnadel Soral Guysen 2004Clém DupPas encore d'évaluation
- Textes Supports 3ASDocument6 pagesTextes Supports 3ASAddiPas encore d'évaluation
- F XVL A Franc AfriqueDocument356 pagesF XVL A Franc AfriquePapa Moustapha DialloPas encore d'évaluation
- 1 - La NégritudeDocument10 pages1 - La Négritudegorguy100% (7)
- Libération Du Lundi 4 Mai 2015Document32 pagesLibération Du Lundi 4 Mai 2015Bruno DiasPas encore d'évaluation
- Voltaire AntijuifDocument111 pagesVoltaire Antijuifverdi18157174Pas encore d'évaluation
- Dissertation FR Sujets CorrigésDocument55 pagesDissertation FR Sujets CorrigésEmmanuel Prosper100% (3)
- La Nouvelle Droite, Ses Pompes Et Ses Œuvres: D'Europe Action (1963) À La NRH (2002)Document56 pagesLa Nouvelle Droite, Ses Pompes Et Ses Œuvres: D'Europe Action (1963) À La NRH (2002)derfghPas encore d'évaluation
- Texte de Frantz FanonDocument1 pageTexte de Frantz FanonEnseignante De Français100% (1)
- Voile Ou FoulardDocument7 pagesVoile Ou FoulardismaelPas encore d'évaluation
- La_perspective_afro_asiatique_dans_le_moDocument5 pagesLa_perspective_afro_asiatique_dans_le_moobart.africaPas encore d'évaluation
- Frantz Fanon aux Etats Unis Suivi de commentaires par Josie Fanon, son épouseD'EverandFrantz Fanon aux Etats Unis Suivi de commentaires par Josie Fanon, son épousePas encore d'évaluation
- Marie Monique Robin Escadrons de La Mort PDFDocument231 pagesMarie Monique Robin Escadrons de La Mort PDFKouadio yao armandPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Lewis MumfordDocument11 pagesEntretien Avec Lewis MumforduPas encore d'évaluation
- Fanon Discours A Alger NBP TronqueesDocument17 pagesFanon Discours A Alger NBP TronqueesPapa Moustapha DialloPas encore d'évaluation
- Litterature Africaine ResumeDocument77 pagesLitterature Africaine ResumeFlore KonatéPas encore d'évaluation
- n10 - 2 CR Mokeddem KhedidjaDocument6 pagesn10 - 2 CR Mokeddem KhedidjaGuelPas encore d'évaluation
- B. Senghor - de La Negritude A La FrancophonieDocument7 pagesB. Senghor - de La Negritude A La FrancophonieLinPas encore d'évaluation
- (Ziegler, Jean) L'empire de La Honte PDFDocument322 pages(Ziegler, Jean) L'empire de La Honte PDFTomas Alfredo Flores LizanaPas encore d'évaluation
- Urbain Gohier Protocoles Des Sages D Israel D Apres La Vieille France 1925Document148 pagesUrbain Gohier Protocoles Des Sages D Israel D Apres La Vieille France 1925Sharklo KipetrovitchiPas encore d'évaluation
- Contre L'ordre Du Monde Les RebellesDocument685 pagesContre L'ordre Du Monde Les Rebellesouedrisaac727Pas encore d'évaluation
- Dantec - Je Suis Sioniste, Et Je Le DisDocument3 pagesDantec - Je Suis Sioniste, Et Je Le DisyukiyurikiPas encore d'évaluation
- Lannée Du Coq (Guy Sorman (Sorman, Guy) )Document265 pagesLannée Du Coq (Guy Sorman (Sorman, Guy) )alex1.bonapartePas encore d'évaluation
- Nationalisme Et Panafricanisme Par DiengDocument9 pagesNationalisme Et Panafricanisme Par DiengEmmanuel FoyetPas encore d'évaluation
- 100 Mots Pour Se Comprendre. Contre Le Racisme Et L'antisémitismeDocument160 pages100 Mots Pour Se Comprendre. Contre Le Racisme Et L'antisémitismeActuaLitté100% (1)
- Femen Et La Culture Porno Paternaliste PDFDocument7 pagesFemen Et La Culture Porno Paternaliste PDFAnonymous eAKJKKPas encore d'évaluation
- LH Charlie OptimiseDocument39 pagesLH Charlie OptimiseNataša PopovićPas encore d'évaluation
- CultureDocument7 pagesCultureWissam MoujahidPas encore d'évaluation
- Droits de Vote Des Femmes - Verifica 18-05-22Document8 pagesDroits de Vote Des Femmes - Verifica 18-05-22Lucia BrascaPas encore d'évaluation
- Chesnay Philippe - Pinochet, L'autre VéritéDocument252 pagesChesnay Philippe - Pinochet, L'autre VéritéBessarion JGHENTI100% (1)
- La Litterature Negro AfricaineDocument8 pagesLa Litterature Negro AfricaineRodrick MabialaPas encore d'évaluation
- anti-apartheid-analyseDocument13 pagesanti-apartheid-analyseMouchid DegboPas encore d'évaluation
- Les Évolués Au Congo BelgeDocument45 pagesLes Évolués Au Congo BelgeGabin Damien De TchidjePas encore d'évaluation
- TP Le Panafricanisme Et La NegritudeDocument1 pageTP Le Panafricanisme Et La NegritudeefraPas encore d'évaluation
- Les aventures extraordinaires d'un Juif révolutionnaire: « Sans l’espérance, on ne trouvera pas l’inespéré » (Héraclite)D'EverandLes aventures extraordinaires d'un Juif révolutionnaire: « Sans l’espérance, on ne trouvera pas l’inespéré » (Héraclite)Pas encore d'évaluation
- DocumentDocument4 pagesDocumentgarciaxemma1505Pas encore d'évaluation
- Manville Version LongueDocument7 pagesManville Version LonguemoussaouiPas encore d'évaluation
- On Fanon - Algerie Se DevoileDocument16 pagesOn Fanon - Algerie Se DevoileBrigitte Thanina JakobPas encore d'évaluation
- compo 3 asDocument4 pagescompo 3 asDerradji Ahmed Hassan HassanPas encore d'évaluation
- Dommerge Polacco de Menasce Roger - La Fin Du Judéo-CartésianismeDocument5 pagesDommerge Polacco de Menasce Roger - La Fin Du Judéo-CartésianismeNunussePas encore d'évaluation
- Julius Evola - Le Petit Livre NoirDocument40 pagesJulius Evola - Le Petit Livre NoirSeptentri0n100% (2)
- EMC Devoir 1 2Document2 pagesEMC Devoir 1 2tdfy2krjryPas encore d'évaluation
- Reconnaitre Le FascismeDocument20 pagesReconnaitre Le FascismedaedrilPas encore d'évaluation
- La Palestine assassinée: Un nettoyage ethnique voulu par le sionisme dès le XIXe siècleD'EverandLa Palestine assassinée: Un nettoyage ethnique voulu par le sionisme dès le XIXe sièclePas encore d'évaluation
- Quand l'Afrique s'éveille entre le marteau et l'enclume: RomanD'EverandQuand l'Afrique s'éveille entre le marteau et l'enclume: RomanPas encore d'évaluation
- Sociétés de Projet Externalisation Et ESSD La Défense Contrainte de Recourir Au Secteur PrivéDocument6 pagesSociétés de Projet Externalisation Et ESSD La Défense Contrainte de Recourir Au Secteur PrivémoussaouiPas encore d'évaluation
- QUAI OUEST Dossier de Diffusion 2018Document36 pagesQUAI OUEST Dossier de Diffusion 2018moussaouiPas encore d'évaluation
- Dossier Artistique Tempête QUAI OUESTDocument7 pagesDossier Artistique Tempête QUAI OUESTmoussaouiPas encore d'évaluation
- Dossier Dramaturgique QUAI OUEST Janv 2017Document12 pagesDossier Dramaturgique QUAI OUEST Janv 2017moussaouiPas encore d'évaluation
- 2022 04 Strategie Polaire de La France A Horizon 2030Document112 pages2022 04 Strategie Polaire de La France A Horizon 2030moussaouiPas encore d'évaluation
- 604 Mozart GroupDocument8 pages604 Mozart GroupmoussaouiPas encore d'évaluation
- EUWhoiswho COM FRDocument194 pagesEUWhoiswho COM FRmoussaouiPas encore d'évaluation
- BACCHANTES - DP DefDocument22 pagesBACCHANTES - DP DefmoussaouiPas encore d'évaluation
- DP Lanuitdesrois-V4Document14 pagesDP Lanuitdesrois-V4moussaouiPas encore d'évaluation
- 1906-12-15-Behanzin L'illustration AlgérienneDocument2 pages1906-12-15-Behanzin L'illustration AlgériennemoussaouiPas encore d'évaluation
- BEHANZIN - Funerailles - Albert Londres - Le - Petit - Parisien - Journal - (... ) - bpt6k607352jDocument10 pagesBEHANZIN - Funerailles - Albert Londres - Le - Petit - Parisien - Journal - (... ) - bpt6k607352jmoussaouiPas encore d'évaluation
- Approvisionnement de La France en Carburants-FinaleDocument9 pagesApprovisionnement de La France en Carburants-FinalemoussaouiPas encore d'évaluation
- La Guerre Au Dahomey 1888-1893 (... ) Aublet Edouard-Edmond Bpt6k65696532Document204 pagesLa Guerre Au Dahomey 1888-1893 (... ) Aublet Edouard-Edmond Bpt6k65696532moussaouiPas encore d'évaluation
- DULCIE ChronologieDocument9 pagesDULCIE ChronologiemoussaouiPas encore d'évaluation
- CP - RATP - en 2022, Le Groupe RATP Poursuit Ses Recrutements en France Et À L'internationalDocument3 pagesCP - RATP - en 2022, Le Groupe RATP Poursuit Ses Recrutements en France Et À L'internationalmoussaouiPas encore d'évaluation
- Dares - La France Vit-Elle Une Grande DémissionDocument5 pagesDares - La France Vit-Elle Une Grande DémissionmoussaouiPas encore d'évaluation
- Commission MC Carthy Audition ALVAH BessieDocument3 pagesCommission MC Carthy Audition ALVAH BessiemoussaouiPas encore d'évaluation
- Sankara Entretien À L'humanité 23 Janvier 1984Document6 pagesSankara Entretien À L'humanité 23 Janvier 1984moussaouiPas encore d'évaluation
- Gdeim Izik 10 AnsDocument3 pagesGdeim Izik 10 AnsmoussaouiPas encore d'évaluation
- Commission MC Carthy Audition de Dalton Trumbo TraduiteDocument10 pagesCommission MC Carthy Audition de Dalton Trumbo TraduitemoussaouiPas encore d'évaluation
- Mike DavisDocument3 pagesMike DavismoussaouiPas encore d'évaluation
- Commission MC Carthy - TESTIMONY OF BERTHOLD BRECHTDocument17 pagesCommission MC Carthy - TESTIMONY OF BERTHOLD BRECHTmoussaouiPas encore d'évaluation
- Lead Sankara 30 AnsDocument7 pagesLead Sankara 30 AnsmoussaouiPas encore d'évaluation
- Pierre Audin, Retour Au Pays NatalDocument5 pagesPierre Audin, Retour Au Pays NatalmoussaouiPas encore d'évaluation
- Manville Version LongueDocument7 pagesManville Version LonguemoussaouiPas encore d'évaluation
- Titres Et TravauxDocument59 pagesTitres Et Travauxgerard1993Pas encore d'évaluation
- La Révolution Et L'empire Une Nouvelle Conception de La NationDocument5 pagesLa Révolution Et L'empire Une Nouvelle Conception de La NationsfaligotdelPas encore d'évaluation
- Cours Contrat D'assurance Université Internationale de Rabat Actuariat 2018-2019Document37 pagesCours Contrat D'assurance Université Internationale de Rabat Actuariat 2018-2019Youssef JabirPas encore d'évaluation
- Newsletter Gicam Mars 2020 FR PDFDocument4 pagesNewsletter Gicam Mars 2020 FR PDFRostand NPas encore d'évaluation
- Dossier PROJET (3) - CopieDocument73 pagesDossier PROJET (3) - Copieclara84ferrePas encore d'évaluation
- Algerie TelecomDocument39 pagesAlgerie TelecommouazizPas encore d'évaluation
- Chapitre II: Management de La Diversité CulturelleDocument96 pagesChapitre II: Management de La Diversité CulturelleDEBBAGH KHALIDPas encore d'évaluation
- Rapport Sur Le Projet de Loi Du Pays Relative Aux Conditions Dencadrement Des Prix de Certains Produits Ou Services EtDocument30 pagesRapport Sur Le Projet de Loi Du Pays Relative Aux Conditions Dencadrement Des Prix de Certains Produits Ou Services EtCharlieRénéPas encore d'évaluation
- Quanno Tramonta 'O Sole1Document4 pagesQuanno Tramonta 'O Sole1Gregory GeigerPas encore d'évaluation
- R. v. Dinel - Information 22-11404139 - Form 2 Response - Defendant R.D. - 19-NOV-2023 (X)Document7 pagesR. v. Dinel - Information 22-11404139 - Form 2 Response - Defendant R.D. - 19-NOV-2023 (X)Brian DoodyPas encore d'évaluation
- Cerfa 13410-09Document8 pagesCerfa 13410-09vjoulain4Pas encore d'évaluation
- S4 Finance Publique El BoubkariDocument31 pagesS4 Finance Publique El BoubkariMohamed MohamedPas encore d'évaluation
- Droit Pénal Des AffairesDocument18 pagesDroit Pénal Des AffairesLeboffePas encore d'évaluation
- L Esprit D Entreprise Chez Les JeunesDocument25 pagesL Esprit D Entreprise Chez Les JeunesAubin DiffoPas encore d'évaluation
- Le Discours PublicDocument10 pagesLe Discours PublicTania GPas encore d'évaluation
- SaritaDocument1 pageSaritaHarley Sarah QuinPas encore d'évaluation
- Chap. 16 - ApplicationsDocument6 pagesChap. 16 - ApplicationsNoemy JanotPas encore d'évaluation
- SESAME - Synthèse Par William Declerck - 2016Document16 pagesSESAME - Synthèse Par William Declerck - 2016Randy BuzisaPas encore d'évaluation
- Evaluation Patrimoniale - ANCCDocument43 pagesEvaluation Patrimoniale - ANCCZineb EloumaryPas encore d'évaluation
- Droit Des Affaires AlgerieDocument5 pagesDroit Des Affaires AlgerieMedPas encore d'évaluation
- Raport de Stage D'initiation S6Document23 pagesRaport de Stage D'initiation S6ANASS BACHRIPas encore d'évaluation
- 2 Eme Partie Responsabilité Civile D'avocatDocument3 pages2 Eme Partie Responsabilité Civile D'avocatBouchra KtamiPas encore d'évaluation
- Madagascar. Code Du TravailDocument34 pagesMadagascar. Code Du TravailRoddy LawRazakarisonPas encore d'évaluation
- Histoire de La Bourse 1Document43 pagesHistoire de La Bourse 1Mohamed Karim LarouiPas encore d'évaluation
- État de Ma Demande D'admissionDocument2 pagesÉtat de Ma Demande D'admissionLinda KoundziPas encore d'évaluation
- Droit Administratif General by Jean-Claude RicciDocument323 pagesDroit Administratif General by Jean-Claude Riccivangabriel100% (1)
- Rapport de Licence - KOUA Cynthia ColombeDocument44 pagesRapport de Licence - KOUA Cynthia ColombeCynthia Colombe Koua100% (1)
- Texte ArgumentatifDocument1 pageTexte ArgumentatifBianca-PopescuPas encore d'évaluation