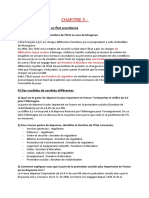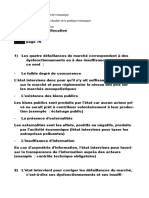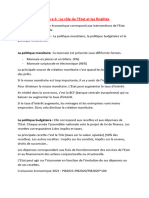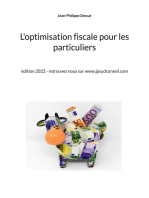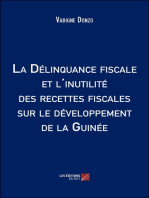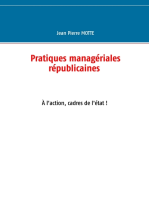Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
T2C6 Dynamique Répartition Des Revenus
T2C6 Dynamique Répartition Des Revenus
Transféré par
TrophinTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
T2C6 Dynamique Répartition Des Revenus
T2C6 Dynamique Répartition Des Revenus
Transféré par
TrophinDroits d'auteur :
Formats disponibles
6 La dynamique de la répartition des
revenus
SYNTHÈSE
La valeur ajoutée est créée conjointement par différentes catégories d’agents économiques. Il est donc logique que
chacune de ces catégories en reçoive une part proportionnellement à sa propre contribution. Ce partage de la valeur
ajoutée est conflictuel puisque chaque catégorie d’agents cherche à augmenter ses revenus en captant la plus grande
part possible de la valeur ajoutée (1). À la suite de cette répartition, les agents disposent de revenus primaires dont
les origines sont diverses et qui ont évolué dans le temps (2). Ces revenus primaires peuvent être répartis de
manière inégale. C’est pourquoi une redistribution des revenus permet de constituer le revenu disponible des agents
économiques et de réduire les inégalités (3).
1. Le partage de la valeur ajoutée et ses évolutions
La valeur ajoutée doit être partagée entre les agents économiques qui ont contribué à sa création. De manière
générale, c’est le facteur travail qui capte la majeure partie de la valeur ajoutée (environ les deux tiers), le facteur
capital en reçoit environ un tiers et l’État une partie très modeste (3 % environ).
Cette répartition de la valeur ajoutée a évolué dans le temps, en fonction de facteurs divers qui avantagent ou non
les différentes catégories d’agents économiques. Les gains de productivité, par exemple, selon qu’ils affectent
davantage le facteur travail ou le facteur capital, vont modifier le partage de la valeur ajoutée. Aussi, dans la
mesure où ce partage est conflictuel, le pouvoir de négociation de chaque catégorie de bénéficiaires, principalement
les actionnaires pour le facteur capital et les salariés pour le facteur travail, va influencer lui aussi le partage de la
valeur ajoutée. Enfin, le poids relatif de chaque facteur dans la création de valeur, et en particulier l’importance du
stock de capital, va naturellement jouer un rôle dans la répartition de la valeur ajoutée. Ainsi, lorsque le progrès
technique est important et/ou que le coût du capital est faible, les entreprises sont incitées à accumuler du capital
dont la part dans la création de valeur ajoutée devient plus importante, ce qui favorisera l’augmentation de sa part
dans le partage de cette valeur.
2. Les sources des revenus primaires des ménages
Les revenus primaires des ménages sont composés de trois éléments :
- les revenus du travail, qui proviennent de l’activité des travailleurs (salaires, traitements, primes, avantages
en nature) ;
- les revenus du patrimoine, qui sont issus du patrimoine (placements financiers, loyers) ;
- les revenus mixtes, qui rémunèrent à la fois le travail d’un entrepreneur et le patrimoine personnel qu’il a
mobilisé dans l’activité de l’entreprise. Cette catégorie de revenus rémunère donc à la fois le travail et le
patrimoine, c’est la raison pour laquelle on l’appelle « revenus mixtes ». Cette catégorie de revenus
concerne les entrepreneurs individuels (artisans, commerçants, professions libérales).
Depuis 1950, les revenus de travail constituent la partie la plus importante des revenus primaires, leur part étant
même en augmentation régulière (52 % en 1950 et 70 % en 2018). Cette augmentation s’explique en partie par la
réduction simultanée de la part des revenus mixtes (42 % en 1950 et 9 % en 2018). En effet, depuis les années
1950, le salariat a augmenté au détriment d’autres formes d’activités, principalement l’entreprenariat individuel.
En parallèle, on observe depuis 1950 une augmentation régulière de la part des revenus du capital dans les revenus
primaires. Ainsi, les intérêts et dividendes représentent 7 % des revenus primaires en 2018 contre 3 % en 1950.
Pour ce qui concerne les loyers reçus, leur part était de 15 % des revenus primaires en 2018 contre 5 fois moins
(3 %) en 1950. On peut imaginer que la part des revenus primaires issue des revenus du capital pourrait continuer à
augmenter dans les prochaines décennies avec l’essor de l’économie du partage, qui consiste à louer les biens qui
sont peu ou plus utilisés par un agent économique.
Thème 2 – Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ? 1
3. Le processus de redistribution
La répartition de la valeur ajoutée entre les agents économiques leur permet de bénéficier de revenus primaires dont
les origines sont variées. D’un point de vue global, la répartition des revenus primaires entre les agents
économiques peut être assez inégale.
En France, le rapport entre le revenu moyen des 10 % les plus aisés et le revenu moyen des 10 % les plus modestes
était, par exemple, supérieur à 21 en 2015 (les plus aisés sont environ 21 fois plus riches que les plus modestes).
Ces inégalités peuvent justifier une redistribution des revenus. Celle-ci consiste à verser à certains agents
économiques, en fonction de leurs revenus primaires, des revenus de transfert pour améliorer leur niveau de
revenus. Ces revenus de transfert peuvent prendre la forme de prestations sociales comme les pensions de retraite,
les indemnités de chômage ou des allocations comme les allocations familiales. La redistribution suppose
également que certains agents économiques soient soumis à des prélèvements obligatoires qui réduiront leurs
revenus et permettront de financer la redistribution. Ces prélèvements obligatoires prennent la forme de cotisations
sociales et d’impôts comme l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée (CSG) ou la taxe d’habitation.
Lorsque l’on ajoute aux revenus primaires des agents les revenus de transfert et que l’on déduit les prélèvements
obligatoires, on obtient le revenu disponible des agents.
En France, les prélèvements obligatoires représentent en 2018 près de 45 % du PIB. Le poids des prélèvements
obligatoires dans le PIB n’a cessé de progresser depuis 1960 où il ne représentait que 30 % du PIB. En
comparaison des autres pays, ce poids est important. La France figure parmi les pays dont le poids de prélèvements
obligatoires (en %) du PIB est le plus important, avec d’autres pays européens comme le Danemark ou la Belgique.
Dans la plupart des autres pays, ce poids est moins important, parfois inférieur à 20 % comme dans le cas du
Mexique (16,2 %). La moyenne des pays de l’OCDE est située à 34,2 % en 2017, la France se situant donc bien au-
delà de cette moyenne.
La contrepartie de ces prélèvements obligatoires importants est que la redistribution des revenus en France s’avère
très efficace. Alors que les Français les plus aisés sont 21,1 fois plus riches que les plus modestes avant la
redistribution des revenus, ils ne sont plus que 5,7 fois plus riches après la redistribution. Cette dernière a donc
réduit les inégalités par 4 environ.
2 Chapitre 6 – La dynamique de la répartition des revenus
Vous aimerez peut-être aussi
- Fact Barre Yamaha DartyDocument1 pageFact Barre Yamaha Dartymadura.screen8Pas encore d'évaluation
- Aalhyse FinancièreDocument25 pagesAalhyse FinancièreEl housseinou kanePas encore d'évaluation
- Modèle de BarroDocument10 pagesModèle de BarroIbrahima DialloPas encore d'évaluation
- La Theorie de La Gestion Des StocksDocument20 pagesLa Theorie de La Gestion Des StocksDassi Lionel100% (3)
- Chap 6 La Répartition Des Revenus SynthèseDocument2 pagesChap 6 La Répartition Des Revenus SynthèsebarakaPas encore d'évaluation
- Cas - Présentoirs de Montréal 14Document17 pagesCas - Présentoirs de Montréal 14ALOPas encore d'évaluation
- Chap6 La Repartition Des RevenusDocument3 pagesChap6 La Repartition Des Revenusdiouf MohoulagnaPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 La Dynamique de La Répartition Des Revenus Synthèse 2Document1 pageChapitre 6 La Dynamique de La Répartition Des Revenus Synthèse 2Sosa 92Pas encore d'évaluation
- Réparation Du RevenuDocument5 pagesRéparation Du RevenuSamuel KouassiPas encore d'évaluation
- A Quoi Servent Les ImpôtsDocument8 pagesA Quoi Servent Les ImpôtsNadia ElhartiPas encore d'évaluation
- Chapitre 8 RépartitionDocument10 pagesChapitre 8 Répartitionsoumia.zemmahiPas encore d'évaluation
- Corrigé de La Partie 3 de L'Epreuve Composée N°1 Novembre 2015 Comment Évolue Le Partage de La Valeur AjoutéeDocument7 pagesCorrigé de La Partie 3 de L'Epreuve Composée N°1 Novembre 2015 Comment Évolue Le Partage de La Valeur AjoutéeMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Correction Devoir Comptabilité NationaleDocument5 pagesCorrection Devoir Comptabilité NationaleMme et Mr Lafon100% (1)
- 2 030Document27 pages2 030mohajbakayokoPas encore d'évaluation
- Fiscalité, Inégalité Et RedistributionDocument10 pagesFiscalité, Inégalité Et RedistributionMarie NdyPas encore d'évaluation
- Revenu - WikipédiaDocument25 pagesRevenu - WikipédiagbodjaaaPas encore d'évaluation
- Répartition Cours TazaDocument13 pagesRépartition Cours TazaBennaceur ThamiPas encore d'évaluation
- ESH Ch1Document12 pagesESH Ch1Salim HaciniPas encore d'évaluation
- The-Me n-2Document19 pagesThe-Me n-2luisreal2850Pas encore d'évaluation
- Correction EC3 III. Limites de L'action Publique en Faveur de La Justice SocialeDocument5 pagesCorrection EC3 III. Limites de L'action Publique en Faveur de La Justice SocialeFlorine MICHARDPas encore d'évaluation
- Fiche 2 Du Chapitre Démocratie Et Égalité: Analyse Des Inégalités 2010 2011Document10 pagesFiche 2 Du Chapitre Démocratie Et Égalité: Analyse Des Inégalités 2010 2011Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Synthèse Chapitre 6Document1 pageSynthèse Chapitre 6Bradley RimbertPas encore d'évaluation
- TD Le Partage de La Valeur Ajoutée 2009-2010Document8 pagesTD Le Partage de La Valeur Ajoutée 2009-2010Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Ellipses 150 Mots Et Expressions Pour Comprendre LeconomieDocument97 pagesEllipses 150 Mots Et Expressions Pour Comprendre LeconomieDONATELLOPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 5 - ExercicesDocument6 pagesCHAPITRE 5 - ExercicesNitusa RNPas encore d'évaluation
- THEM2 Q1 Etat-Regul Doss-Etud RessourcesDocument3 pagesTHEM2 Q1 Etat-Regul Doss-Etud Ressourcesyrina.mariusPas encore d'évaluation
- 4.2 La Creation de Richesse Par L Entreprise Le Partage de La Valeur AjouteeDocument7 pages4.2 La Creation de Richesse Par L Entreprise Le Partage de La Valeur AjouteeWilly tsatyPas encore d'évaluation
- Fiche Chapitre 4 La ProductionDocument7 pagesFiche Chapitre 4 La ProductionEtienne MougeotPas encore d'évaluation
- Cours Fiscalité IRPP - ISDocument74 pagesCours Fiscalité IRPP - ISFahima CharefPas encore d'évaluation
- Redistribution CorDocument3 pagesRedistribution Corsalma esmaelPas encore d'évaluation
- Fiche Chapitre 12 Le Budget de LetatDocument7 pagesFiche Chapitre 12 Le Budget de LetatDemba KanoutePas encore d'évaluation
- Chap 4Document8 pagesChap 4GautierPas encore d'évaluation
- Politique BudgetaireDocument2 pagesPolitique BudgetaireMartin LBT100% (1)
- E 1ES 04 Comment Les Agents EconomiquesDocument3 pagesE 1ES 04 Comment Les Agents EconomiquesjoshPas encore d'évaluation
- Croissance Économique Et Partage Des Fruits de La CroissanceDocument6 pagesCroissance Économique Et Partage Des Fruits de La CroissanceGontrand LenoirPas encore d'évaluation
- Politique Fiscale, RedistributionDocument23 pagesPolitique Fiscale, RedistributionKHALLAL DRISSEPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document5 pagesChapitre 1b60032595Pas encore d'évaluation
- Synthese 05Document2 pagesSynthese 05JusDePatataPas encore d'évaluation
- Économie TD AESDocument6 pagesÉconomie TD AESaPas encore d'évaluation
- L'état Dépense-T-Il TropDocument7 pagesL'état Dépense-T-Il Troplina josephePas encore d'évaluation
- Droit Fiscal 2Document9 pagesDroit Fiscal 2ntambwePas encore d'évaluation
- Cejm Thème 3Document21 pagesCejm Thème 3bayanomonnetPas encore d'évaluation
- Synthèse Chapitre 4EDocument4 pagesSynthèse Chapitre 4EfrancisokaiPas encore d'évaluation
- FISCALITEDocument18 pagesFISCALITEmrabdelilahPas encore d'évaluation
- Politique Budgétaire - WikipédiaDocument8 pagesPolitique Budgétaire - Wikipédiaabderrahmane ait maaitPas encore d'évaluation
- DM3 Pol ÉcoDocument2 pagesDM3 Pol ÉcotaratiniPas encore d'évaluation
- TD Sur La RedistributionDocument2 pagesTD Sur La Redistributionmokademamina100% (1)
- Chapitre 6 Économie (Rôle de L'état Et Finalités)Document4 pagesChapitre 6 Économie (Rôle de L'état Et Finalités)leogoncccPas encore d'évaluation
- Chapitre 10 ÉlèvesDocument8 pagesChapitre 10 ÉlèvesAlex 39Pas encore d'évaluation
- Exercice "Les Principales Politiques Économiques Et Leurs Outils"Document11 pagesExercice "Les Principales Politiques Économiques Et Leurs Outils"mailys.c23Pas encore d'évaluation
- Exercices Chapitre 1Document5 pagesExercices Chapitre 1mailys.c23Pas encore d'évaluation
- Derniers Articles: Modèle de Demande de Rattachement Au Foyer Fiscal de Ses Parents (23/04/2021)Document2 pagesDerniers Articles: Modèle de Demande de Rattachement Au Foyer Fiscal de Ses Parents (23/04/2021)pfe1Pas encore d'évaluation
- TD Redistribution 2010Document4 pagesTD Redistribution 2010mokademaminaPas encore d'évaluation
- Chap 1. Macroéconomie (1 Année LG)Document18 pagesChap 1. Macroéconomie (1 Année LG)Rä Høuba100% (1)
- La Politique BudgétaireDocument42 pagesLa Politique BudgétaireSaaidi KhalidPas encore d'évaluation
- Chapitre 4-1 - Répartition Et Distribution Des RevenusDocument13 pagesChapitre 4-1 - Répartition Et Distribution Des RevenusSou HìLaPas encore d'évaluation
- Politique BudgétaireDocument5 pagesPolitique BudgétaireAZPas encore d'évaluation
- HTNFA2019002Document20 pagesHTNFA2019002Hedi HedefPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Les Revenus Des MénagesDocument6 pagesChapitre 4 Les Revenus Des MénagesAlzenorPas encore d'évaluation
- FiscalitéDocument9 pagesFiscalitéKonan Armel KobenanPas encore d'évaluation
- DCG 4 Droit Fiscal 2018 2019 12e Ed Manuel - Chapitre1Document18 pagesDCG 4 Droit Fiscal 2018 2019 12e Ed Manuel - Chapitre1Fatoumata Sadjo Diallo100% (1)
- L'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comD'EverandL'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comPas encore d'évaluation
- La Délinquance fiscale et l'inutilité des recettes fiscales sur le développement de la GuinéeD'EverandLa Délinquance fiscale et l'inutilité des recettes fiscales sur le développement de la GuinéeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Pratiques managériales républicaines: À l'action, cadres de l'état !D'EverandPratiques managériales républicaines: À l'action, cadres de l'état !Pas encore d'évaluation
- Présentation Sur Le ReengineeringDocument22 pagesPrésentation Sur Le ReengineeringDOUDOU-38Pas encore d'évaluation
- Examen de Fin de Formation TCE 2018 v2 CorrectionDocument7 pagesExamen de Fin de Formation TCE 2018 v2 CorrectionboudouinePas encore d'évaluation
- Contenu Des Rapports - Sgo - de Contrôle Interne - 19 04 2022Document28 pagesContenu Des Rapports - Sgo - de Contrôle Interne - 19 04 2022crepinPas encore d'évaluation
- La Politique Monétaire Et Le Marché de Change VFDocument45 pagesLa Politique Monétaire Et Le Marché de Change VFkarimael100% (1)
- Accord de Majorité Cocof 2009-2014Document44 pagesAccord de Majorité Cocof 2009-2014mohamed_nayttaib1788Pas encore d'évaluation
- Fondements de L'économie-PolitiqueDocument541 pagesFondements de L'économie-PolitiqueMah Moh100% (2)
- Délocalisation Des Entreprises P.bernardDocument349 pagesDélocalisation Des Entreprises P.bernardchawki trabelsiPas encore d'évaluation
- Environnement Micro Et Macro de NestléDocument2 pagesEnvironnement Micro Et Macro de NestléScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Ch07 QuestionsDocument4 pagesCh07 QuestionsMoustiquePas encore d'évaluation
- QCMDocument6 pagesQCMhassankch0% (1)
- RAC 2017 - Rapport Provisoire Draft2Document93 pagesRAC 2017 - Rapport Provisoire Draft2CheikhPas encore d'évaluation
- Partie 1 - Notion D'investissementDocument11 pagesPartie 1 - Notion D'investissementArthur RamillonPas encore d'évaluation
- Financement de L' É ConomieDocument61 pagesFinancement de L' É ConomieFeraoun Feraoun Mohand100% (1)
- TDR de L'assistant Technique de La DG de l'ADRDocument6 pagesTDR de L'assistant Technique de La DG de l'ADRdieyecheikh2014Pas encore d'évaluation
- Droit Des Sociétés 2017Document83 pagesDroit Des Sociétés 2017alexPas encore d'évaluation
- Sujet Et Corrige Bts Comptabilite Et Gestion Des Organisations E4Document24 pagesSujet Et Corrige Bts Comptabilite Et Gestion Des Organisations E4ÂbdėÑóùr Lê RóìPas encore d'évaluation
- Bilan CanadaDocument1 pageBilan Canadaanas karimiPas encore d'évaluation
- Chapitre II Les Structures Organisationnelles - 230426 - 133614Document21 pagesChapitre II Les Structures Organisationnelles - 230426 - 133614soulimanPas encore d'évaluation
- Thème1 Chapitre1 Géographie SecondeDocument35 pagesThème1 Chapitre1 Géographie SecondeAndy SantkinPas encore d'évaluation
- Vendor Request Form FR (Collect Info For NVA)Document2 pagesVendor Request Form FR (Collect Info For NVA)bernardmenezPas encore d'évaluation
- AuditDocument2 pagesAuditAbdel Motaleb AL-SaadyPas encore d'évaluation
- Les Lois MarocDocument2 pagesLes Lois MarocImane HoubbanePas encore d'évaluation
- Mémoire PDFDocument138 pagesMémoire PDFeliaskenza06Pas encore d'évaluation
- Les Taux de Change Et Leurs DeterminantsDocument2 pagesLes Taux de Change Et Leurs DeterminantsiliasPas encore d'évaluation
- CNSST - Normes Du Travail, QCDocument28 pagesCNSST - Normes Du Travail, QCJack TemplarPas encore d'évaluation
- Strategie D'entrepriseDocument50 pagesStrategie D'entrepriselp visaPas encore d'évaluation