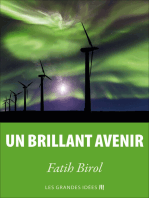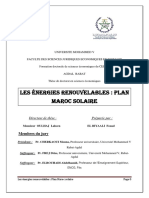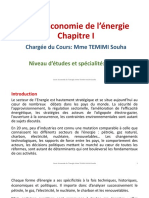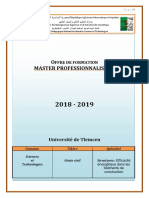Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Economie de L'energie Chap II
Cours Economie de L'energie Chap II
Transféré par
Souha TemimiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Economie de L'energie Chap II
Cours Economie de L'energie Chap II
Transféré par
Souha TemimiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Economie de l’énergie
Chapitre II
Chargée du Cours: Mme TEMIMI Souha
Niveau d’études et spécialité: L3 APE
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 1
Chapitre II
MICROECONOMIE ET MARCHE DE L’ENERGIE
• L'objet de ce chapitre est de proposer les grandes lignes d'une analyse d'ensemble des
marchés de l'énergie, en mettant en évidence leurs principales caractéristiques
économiques, leurs points communs et leurs différences.
• On s'interrogera également sur l’origine et la pérennité des différentes formes de
marché dans les domaines de l'énergie, ainsi que sur leur conformité ou non avec
certaines hypothèses fondamentales de la théorie microéconomique, et sur les
conséquences des réponses apportées pour la définition de quelques éléments de
principe de la politique énergétique
• Référence bibliographique principale: Jean-Pierre HANSEN, Jacques PERCEBOIS
Energie. Economie et politiques, De Boeck, 2010
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 2
Marché et concurrence : pratiques et limites
Dans une économie complexe comme l’est l'économie réelle, la question
fondamentale qui se pose est: est-ce que la coordination des activités parviendra,
selon les choix posés, à rendre efficace le fonctionnement de ses agents, sachant
que le système ne dispose que de ressources limitées pour satisfaire des besoins
a priori illimités? (Ce qui est la définition même de la science économique).
Sous certaines hypothèses fortes, les agents (entreprises et ménages) ont une
taille très réduite de sorte qu’ils ne peuvent agir sur les conditions de
fonctionnement du marché, les différents biens étant homogènes, l'information
étant parfaite et chaque acteur pouvant, à tout moment, entrer ou sortir du
marché, le marché résout le problème de la coordination de manière très efficace.
L'allocation des produits qui en résulte est alors dite «efficiente», dans le sens où
aucune autre ne paraitrait plus favorable aux acteurs.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 3
On sait aujourd’hui que le marché (de concurrence parfaite) ne peut pas tout,
quand l'une de ses hypothèses contraignantes n'est plus respectée. On dit qu'il y a
défaillance du marché et des pans entiers de la science économique les recensent
et les analysent.
Dans certains cas, les acteurs interfèrent entre eux sans passer par le marché et, les
décisions de l'un peuvent affecter la satisfaction d'un autre sans que le marché ne
repère ni, a fortiori, ne fasse payer ces interactions. Il s’agit des «externalités»
(favorables ou défavorables). C’est évidemment un domaine vaste et important en
économie de l'énergie et en économie de l'environnement.
Pour traiter ces questions d'effets externes, la théorie économique propose
«d’internaliser» les coûts concernés et ainsi de conduire à des calculs d’équilibre
différents mais toujours cohérents.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 4
D’autre part, la définition d'un marché suppose de préciser au minimum trois
éléments :
- la nature du bien: indique la qualité qui le différencie d'autres biens semblables
(ex: Les qualités différentes de pétroles, de charbons ou de gaz sont des
déterminants de la structure des marchés respectifs)
- la localisation de l'échange: est une indication des coûts de transport de
certains marchés énergétiques (charbon, gaz) voire même leur segmentation
technologique (gaz gazeux ou gaz liquéfié)
- La disponibilité dans le temps: la valeur du bien pouvant évoluer
significativement à cause de sa stockabilité plus ou moins possible ou coûteuse
Or, outre ces déterminants communs à tous les marchés (nature, lieu, temps), les
marchés énergétiques partagent, à des degrés divers, certains attributs spécifiques
que l’on doit spécifier.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 5
Caractéristiques générales du marché de l’énergie:
• Tout d'abord, les énergies revêtent dans leur nature une double dimension: biens
stratégiques, d'une part, biens de grande proximité voire de service public, d'autre part.
II n'est dès lors pas étonnant que les différents pouvoirs publics (Etats, groupes d'Etats,
Régions, Collectivités locales..) aient voulu contrôler ou surveiller l'accès, le
développement et le fonctionnement de leurs marchés.
• Ensuite, les industries de l'énergie se caractérisent par des coûts fixes très élevés: elles
sont «intensives en capital» et la programmation de ces investissements lourds se fait
sur un temps très long (20 à 60 ans) en comparaison avec la plupart des autres secteurs
industriels, et avec l'horizon des marchés financiers.
• Par ailleurs, compte tenu de leur épuisabilité, de leurs localisations spatiales, de
différences pérennes de qualité ou de certaines différences de coût (production,
transport...), les activités de l'énergie sont celles qui génèrent le plus de rentes
d'origines, de natures, et d'importances diverses.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 6
• Enfin, des motifs divers (concentration géographique de plusieurs ressources,
technologies, dispositions légales...) conduisent certains acteurs à disposer d'un
pouvoir de marché, dans l’un ou l’autre des maillons de la chaîne énergétique
(producteurs, transporteurs, distributeurs,...). Ce qui a conduit à la formation de
structures de marchés très différentes et évolutives (pétrole, p. ex.) qui vont de
la concurrence (quasi) parfaite au monopole, en passant par diverses structures
oligopolistiques (Cournot, Bertrand, Stackelberg, firme dominante de
Forchheimer, etc.
Les caractéristiques évoquées ci-dessus conduisent à un constat: le jeu (et l'enjeu)
sur les marchés de l'énergie sera une sorte de partage de la rente, jeu dont les
pouvoirs publics peuvent modifier la donne par la mise en place de techniques
instrumentales de régulation dans le but de se rapprocher des conditions
optimales d'efficacité économique.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 7
Indications quantitatives
Le tableau suivant décrit quelques-uns des éléments qui peuvent caractériser un
marché énergétique et son mode de fonctionnement.
On peut en tirer les quelques constats suivants :
• si le pétrole apparaît comme un marché globalisé mondialement, il n'en va pas
de même du charbon ni du gaz et encore moins de l'uranium; l'électricité - pour
des raisons physiques reste limitée à des marchés nationaux ou régionaux.
• les coûts de transport: le gaz et le charbon ayant en commun d'être plus chers à
transporter que le pétrole.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 8
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 9
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 10
• les parts de la production qui sont commercialisées mondialement sont
également différentes, notamment compte tenu des coûts de transport, mais
aussi du degré de concentration géographique des ressources, ce dernier facteur
éclairant également le pouvoir de marché potentiel dont peuvent bénéficier
certains acteurs.
• les prix des énergies ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Par exemple, le
prix du pétrole apparaît comme « directeur » de la plupart des tarifications du
gaz naturel, l'électricité, étant influencée par les prix des autres énergies,
primaires, ainsi que par le prix des émissions de CO2, lui-même influencé par le
différentiel entre les prix du gaz et du charbon, notamment.
• le stockage, sa disponibilité et son coût jouent un rôle fondamental dans
l'analyse économique des secteurs de l'énergie. Il peut fortement influencer des
caractéristiques techniques essentielles des marchés, comme le prix de court
terme ou la volatilité, par exemple (pétrole, gaz, électricité).
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 11
Les relations inter temporelles entre les différentes formes de prix
A court terme, les énergies primaires sont en principe déterminés par une
comparaison offre-demande, l'offre étant elle-même représentée par le coût
marginal de production. Deux éléments viennent cependant nuancer ce principe
classique (H. Geman, 2005) :
• Le comportement des agents (échanges financiers) ou les contraintes
techniques (échanges physiques) sont parfois plus importantes que les
fondamentaux économiques: si les prix de court terme varient généralement
autour des coûts marginaux, ils peuvent très fortement s'en écarter pour un jour
ou une période donnés. On parle alors de volatilité des prix;
• La disponibilité des stocks « lisse » en principe les fluctuations de court terme,
mais le jeu des acteurs sur le niveau des stocks, en fonction d'impératifs
commerciaux ou spéculatifs, peut entraîner parfois des mouvements erratiques
des courbes d'offre et de demande, et donc des prix.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 12
A long terme, le prix est en principe déterminé par le coût de l'unité productive
fonctionnant à pleine charge du fournisseur marginal, qui comprend la prime de
risque représentative de l'attraction et du maintien de capitaux dans les unités
ultérieures (renouvellement).
La comparaison offre-demande de moyen terme conduit à des prix plus stables et
à une volatilité moindre.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 13
Offre et demande en élasticité de court Offre et demande en élasticité de moyen
terme avec effet de jeu de stock sur la terme
volatilité des prix
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 14
Sur le marché de l’énergie, comme sur les marchés financiers et ceux des
commodities, il est important de savoir comment les prix sont reliés au cours du
temps.
Les calculs d’investissement, les conditions contractuelles d’achat-vente, les
prises de position visant à « couvrir » ( càd à sécuriser) les paramètres
économiques ayant prévalu dans la décision ou dans les activités de marché ou de
spéculation, toutes ces démarches nécessitent au moins une idée des relations qui
peuvent exister entre un prix à l’instant t ( le prix spot) et le prix à l’instant T > t (
que l’on appelle « forward » ou « future », selon les produits échangeables).
Cette matière très complexe est du ressort du vaste domaine de la gestion des
risques. Nous en donnerons, plus loin, quelques principes de base utiles illustrés
par des exemples de marchés de l’énergie.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 15
Les stocks
• les stocks jouent un rôle essentiel dans la détermination de la volatilité des
prix des marchés énergétiques
• Les plus grands auteurs, comme Keynes (1930) ou Kaldor (1934), ont
consacré de nombreux et importants travaux à la théorie des stocks,
notamment en s’interrogeant sur les raisons qui conduisent des agents à
conserver des biens en stock, et ceci dans le but d'expliquer les différences
entre prix actuels/instantanés (« spots ») et prix à terme (« futures »).
• L'identification et la justification de l'avantage pur que représente la
détention d'un stock («convenience yield ») ont été notamment étudiées.
Ce concept se révélera très important dans l'analyse des caractéristiques
techniques des différents marchés énergétiques.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 16
La concentration
C’est une stratégie ancienne qui s'explique par les éléments suivants :
- les économies d'échelle sont importantes (infrastructures de transport,
optimaux de production) dans le secteur minier lato sensu (c à d dans ses
grandes lignes);
- les rentes différentielles de qualité conduisent chaque opérateur à tenter
de se constituer un portefeuille de biens d'origines et (donc) de qualités
différentes, par acquisitions, fusions ou constitutions de partenariats;
- la taille confère aussi un avantage (jeux stratégiques) aux grands
opérateurs, dans les domaines où la demande varie fortement.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 17
L'intégration verticale
C’est une autre composante stratégique que l'on rencontre dans le secteur des
commodities, le plus souvent sous une forme partielle: producteurs en nombre limité
élargissant leurs activités en descendant vers l'aval de manière ciblée et concurrencés sur
ces marchés par des entreprises plus petites mais beaucoup plus nombreuses.
Ce mouvement d'intégration vers l'aval est limité, compte tenu notamment de la diversité
des marchés et des produits finis qu'il faudrait intégrer dans la stratégie des producteurs.
Les joueurs d'aval («smelters» pour les minerais, «midstreamers» pour l'énergie)
conservent donc un rôle essentiel en rapprochant offres d'amont et demandes finales.
Le mouvement inverse, celui de la remontée vers l'amont des acteurs d'aval pour sécuriser
et stabiliser leurs conditions d'approvisionnement est également observé, mais là aussi de
manière limitée et ciblée (acquisition d'activités d'exploration-production par les grands
vendeurs de gaz, acquisition de mines par les smelters de zinc, etc.).
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 18
Rente et Rareté
Comme nous l'avons indiqué précédemment, les marchés de l'énergie se
caractérisent par l'existence de différentes formes de rentes, trouvant elles-mêmes
leurs origines dans la rareté, naturelle ou créée artificiellement par des
producteurs, groupes de producteurs, Etats, etc…ayant su acquérir un pouvoir de
marché et qui affectent spécifiquement ces marchés.
Le concept de «rente» n'est pas toujours bien connu et mérite donc de l’analyser,
notamment pour en définir la nature, la portée et même la licéité, au regard
notamment de certains aspects de la politique énergétique.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 19
Pour certains facteurs primaires
«disponibles» dont l'offre est fixée (ou
presque) et ne varie pas (ou peu) avec le
prix, le prix de ce type de facteur est
affecté d'une rente, et tout déplacement
de la courbe de demande se traduit par
une variation de la rente.
La rente trouve donc toujours son
origine dans la rareté d'un facteur de
production, rareté pouvant revêtir
différentes formes qui généreront autant
de types de rentes.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 20
En concurrence parfaite, certains producteurs peuvent disposer de ressources rares
(terres, sites, technologies...) que d'autres n'ont pas. Dans ce cas, et en fonction de la
position de la courbe de demande, un nombre plus ou moins grand d'entreprises
continuent de se trouver, même à long terme, en position privilégiée et réalisent un
profit supérieur au profit économique normal (qui est égal à zéro). Dans ce cas, les
possesseurs de la ressource rare, éventuellement distincts des producteurs, détiennent un
avantage important. Le niveau de cet avantage constitue une rente.
• Les implantations géographiques et donc les coûts de transport sont aussi très
importants. La théorie de la concurrence parfaite admet que l'existence de localisations
privilégiées, naturelles ou créées délibérément, peut donner lieu à la persistance de
rentes à long terme.
• L’invention, le développement et la maitrise des techniques d’extraction ou de
liquéfaction ( du Gaz, par ex) sont la source de rentes technologiques
• Les caractéristiques commerciales liées aux qualités des ressources (la proportion plus
ou moins grande d’un pétrole brut en produits « légers » ( essence, kérosène,….) qui se
valorisent mieux sur les marchés sont la source de rente de qualité.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 21
Les trois grandes catégories de rentes
La notion de rente est omniprésente tout au long des filières énergétiques. La
théorie économique en distingue trois catégories qui regroupent les différentes
formes précédemment citées.
- La rente différentielle
- La rente absolue ou d'épuisabilité
- La rente de monopole
Une rente se définit en économie comme un surprofit qu’un acteur pourra dégager
par rapport à ses concurrents.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 22
La rente différentielle ou rente de RICARDO
Dans son ouvrage célèbre « des principes de l’économie politique et de l’impôt »,
David Ricardo (1817) a élucidé cette question, de la plus haute importance pour la
compréhension des mécanismes des effets de la rareté sur la répartition des
revenus. L’idée principale est que les terres les plus fertiles sont les premières à
être mises en culture (de blé) , mais qu’à mesure que s’accroît la pression de la
demande, du fait notamment de l’augmentation de la population, des terres moins
fertiles doivent être exploitées.
Parce que ces nouvelles terres sont moins productives que les premières, le coût
de production unitaire est plus élevé, donc le prix de vente requis pour la
réalisation de la production sur ces nouvelles terres est plus élevé. Mais le prix de
marché étant unique, les propriétaires des terres les plus fertiles bénéficient d’une
rente «différentielle », la rente sur la terre marginale – la moins fertile, donc la
dernière mise en culture – étant nulle.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 23
Ce raisonnement en termes de différence de rendements des ressources agricoles
et naturelles est, à l’évidence, d’une grande utilité pour comprendre la
rémunération relative des propriétaires fonciers de terres agricoles, y compris dans
le monde contemporain et à l’échelle de la planète.
Mais il permet également d’expliquer les mécanismes qui, face à une demande
croissante d’énergies fossiles, incitent à rechercher et à mettre en exploitation
des gisements dont la production est plus coûteuse, engendrant ainsi des rentes
différentielles croissantes pour les détenteurs des ressources les plus aisément
exploitables.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 24
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 25
Considérons une économie de concurrence parfaite où il y a une parfaite mobilité
de capitaux entre secteurs de l'économie et dans laquelle le profit moyen est donc
uniforme entre les secteurs. Le stock de terre est limité et mis en culture par ordre
de fertilités (productivités) décroissantes.
La figure suivante résume les principales données de l'analyse. Des quantités
identiques de travail et de capital (moyens d'exploitation) affectées à la terre 2
produiront moins de blé que si elles étaient apportées à la terre 1. Le coût de
production de 2 sera supérieur à celui de 1. II en va de même de 3 par rapport à 2,
etc.
Les «prix » nécessaires pour mettre en exploitation successivement chacune de ces
terres seront ceux qui assureront à chaque producteur la couverture de ses coûts.
On aura: P1< P2 <Ps
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 26
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 27
Si une quantité q0 correspond à la demande D, sa satisfaction ne nécessitera pas
toutes les terres de type 3 : certaines d'entre elles resteront libres et le prix
d'équilibre du marché P0 correspondant à q0, sera p3, celui qui assure à la terre
marginale (la terre 3) la couverture de l'ensemble de ses coûts. En effet,
- si P0 < P3, aucun producteur n'exploiterait la terre 3 et le déficit d'offre
augmenterait le prix du marché;
- si P0 > P3 il y aurait une augmentation du nombre de producteurs sur le reste de
la terre 3 toujours disponible => EO et une baisse du prix de marché.
Les différences entre P0 = P3 et P1, P2 sont appelées rentes différentielles.
Il faut noter que si la demande D(t) augmentait au cours du temps, il faudrait
mettre les terres 4 en exploitation, à un prix p4 > P3, et le prix de marché serait p4,
ce qui générerait une rente différentielle pour la terre 3 et l'augmenterait pour les
terres 1 et 2.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 28
La rente absolue ou d'épuisabilité (rente de Hotelling)
• La rente d'épuisabilité de Hotelling est un modèle économique qui décrit le
comportement d'une entreprise qui exploite une ressource naturelle épuisable.
Le modèle est basé sur l'hypothèse que les ressources naturelles sont finies et
que leur extraction engendre des coûts croissants. Par conséquent, l'entreprise
doit décider du moment optimal pour extraire la ressource en maximisant la
valeur actuelle nette de ses bénéfices futurs.
• Dans ce modèle, l'entreprise est confrontée à un dilemme : si elle extrait trop tôt,
elle perd des bénéfices futurs en ne prenant pas en compte la rareté de la
ressource, mais si elle extrait trop tard, elle perd des bénéfices immédiats car le
coût d'extraction devient de plus en plus élevé.
• Le modèle de Hotelling prédit que le prix de la ressource augmentera au fil du
temps en raison de sa rareté croissante, ce qui incite l'entreprise à retarder
l'extraction et à augmenter les prix pour maximiser ses profits. La rente
d'épuisabilité est donc la différence entre le coût de production et le prix de
vente de la ressource.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 29
Les Hypothèses du modèle de base
• Les propriétaires des gisements sont distincts des exploitants.
• La concurrence est pure et parfaite tant entre les exploitants qu'entre les
propriétaires de gisements qui cherchent à valoriser au mieux leur droit à la
propriété sur cette ressource naturelle.
• Il existe un substitut abondant au minerai. Son coût de production est ps.
• Le stock de minerai, dont le coût d'extraction ce < ps, est fini (épuisabilité)
• La ressource apparaît pour le propriétaire de la mine comme un stock de
𝒅𝑺
biens qui diminue au fur et à mesure de son extraction ( = −𝒒(𝒕))
𝒅𝒕
• On connaît la demande future de minerai, et donc on connaît la date T où le
stock de minerai sera épuisé (hypothèse évidemment très forte).
• Pour le propriétaire de la mine, il doit être équivalent à chaque instant t<T de
donner à exploiter son gisement au un prix p(t) ou de différer cette mise en
exploitation moyennant la perspective d’un prix supérieur.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 30
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 31
La résolution du programme d’optimisation précédent (en utilisant le Hamiltonien)
nous donne:
𝒑 𝒕 = 𝑪′ 𝒕 + 𝝀(𝒕)𝒆𝒓𝒕
Avec 𝝀(𝒕): les variables de coût du hamiltonien (ces variables peuvent être interprétées comme des
multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes du problème d’optimisation)
Ce qui implique que le prix d’une ressource épuisable est composé de deux
éléments, le coût d’extraction (y compris le coût d’usage), et le taux de croissance
de la valeur de la ressource.
On constate que, même en situation de CPP, le prix diffère du coût marginal et
qu’il y a persistance de rente, ici de rareté absolue.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 32
• Selon le modèle de Hotelling, le prix de la ressource naturelle épuisable
augmente au fil du temps, car l'offre diminue et que la demande reste constante
et le taux d’augmentation du prix de la ressource est égal au taux d’intérêt c à d
que le prix de la ressource augmente au même rythme que les intérêts qui
pourraient être gagnés si la ressource était économisée.
• L'arbitrage inter-temporel de la rente de Hotelling est un processus de décision
qui permet de déterminer la quantité optimale de ressource à extraire et le
moment optimal pour le faire, tout en équilibrant les bénéfices présents et futurs
de l'entreprise. En d'autres termes, l'entreprise doit trouver un équilibre entre
extraire suffisamment de la ressource pour réaliser des bénéfices immédiats,
mais en même temps, ne pas trop en extraire pour préserver la valeur future de
la ressource, ce qui permettra de générer des bénéfices pour les générations
futures.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 33
𝝀
ce
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 34
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 35
• Si l'on considère deux périodes, le possesseur de la ressource peut : soit vendre
tout de suite pour obtenir une somme 𝝀𝒕 , qu'il place pour obtenir à la période
suivante (𝟏 + 𝒓)𝝀𝒕 ; soit vendre à la seconde période au prix 𝝀𝒕+𝟏 .
• Ainsi, par arbitrage, on a que 𝝀𝒕+𝟏 = (𝟏 + 𝒓)𝝀𝒕 , donc que la rente 𝝀 croît avec le
taux d'intérêt r.
Supposons que la rente initiale soit 𝝀𝟎 . L'arbitrage du possesseur de la ressource
est alors le suivant :
- soit il vend tout𝒓𝒕de suite à une valeur 𝝀𝟎 , place son argent, et obtient ainsi après
un temps t: (𝝀𝟎 𝒆 );
- soit il attend pour vendre.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 36
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 37
• Pour résumer, Hotelling, en reprenant les outils et les éléments de la
théorie microéconomique du producteur , détermine la valeur d’un stock de
ressource épuisable, l’évolution de cette valeur, le rythme d’extraction de la
ressource et en déduit une règle selon laquelle il existe, du point de vue de
l’exploitant, un rythme optimal d’évolution du prix d’une ressource naturelle et
un sentier optimal d’épuisement de cette ressource.
• Cependant, ce modèle ne tient pas compte de la concurrence et de la possibilité
pour d'autres entreprises d'entrer sur le marché, ce qui peut faire baisser le prix
de la ressource. Il ne prend pas non plus en compte les coûts environnementaux
liés à l'extraction de la ressource.
• Malgré ces limitations, le modèle de Hotelling est toujours utilisé pour analyser
les marchés de ressources naturelles épuisables tels que le pétrole, le gaz et les
métaux rares.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 38
• Dans le secteur minier, le partage de rentes n’est pas seulement d'origine
«naturelle» . Ce sont les structures de marchés (concurrence parfaite,
monopole, oligopole) qui entretiennent l’existence même de ces rentes.
• Un bon exemple, sur lequel nous reviendrons, en est les effets des découvertes
de pétrole à très bas coût de production au Moyen-Orient. Ces découvertes
auraient pu a priori faire sortir la plupart des producteurs américains du marché
international. Mais les compagnies pétrolières, qui constituaient un oligopole («
Les Sept Soeurs ») ont préféré s'entendre pour contrôler la production au Moyen-
Orient et donc maintenir sur ces gisements d'importantes rentes différentielles
qu'elles pouvaient alors s'approprier presque entièrement, compte tenu des
rapports existant entre ces compagnies et les Etats, théoriquement propriétaires
des gisements.
• Il nous faut donc examiner la formation des prix dans des structures
monopolistiques ou oligopolistiques.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 39
Extension du modèle de Hotelling aux autres structures de marché:
Le cas du Monopole
- L’entreprise contrôle à la fois son taux d’extraction et le prix du marché. En
revanche, elle n’est pas maître des quantités achetées à ce prix.
- Prix et quantité ne peuvent être déterminés indépendamment l’un de l’autre car
le monopole doit servir la demande
- La recette marginale est décroissante du prix.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 40
On rappelle que la maximisation du profit du monopole s'obtient en égalant recette marginale
et coût marginal Cm avec
où 𝜀 est l'élasticité-prix de la demande.
Dès lors,
Et puisque 𝜀 < 0 𝑒𝑡 𝑝 > 𝐶𝑚, il y aura pouvoir de marché: le monopole fixe son prix au-delà
du coût marginal, mais d'un montant qui dépend de l'inverse de l'élasticité.
Il faut noter que la structure de marché monopolistique ne postule pas nécessairement un
comportement prédatoire à stigmatiser. Dans certains cas, l'organisation en monopole est la
seule susceptible de réaliser l'allocation optimale des ressources.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 41
En effet, dans certaines conditions, le monopole est la seule structure permettant de
minimiser les coûts et donc d'assurer l'efficacité du système productif.
Il en va ainsi, par exemple, si le coût marginal de long terme 𝐶𝑚𝐿𝑇 est constamment inférieur
au coût moyen de long terme 𝐶𝑀𝐿𝑇 (fig. suivante).
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 42
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 43
On a donc:
Hotelling montre qu’en situation de monopole, le prix d’équilibre diffère du prix
de la concurrence par la prise en compte complémentaire d’une rente de
monopole.
Le monopoleur a donc intérêt à fixer au départ un prix plus élevé et d’accroitre
ensuite ce prix à un rythme inférieur aux taux d’actualisation ( voir fig suivante)
En ce sens, la situation du monopole « préserve » la ressource puisque, à prix plus
élevé, la demande sera plus faible.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 44
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 45
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 46
Le cas de l’oligopole:
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 47
• La rente de l’oligopole résulte aussi du pouvoir de ses acteurs à influencer le
marché et à imposer un prix élevé. Le cartel de l’OPEP ou le monopoleur
Gazprom ont été en mesure d’influencer les prix et de capter une partie des
rentes.
• Les contrats pétroliers ont ainsi été conçus pour régler le partage de la rente
entre les parties prenantes : le gouvernement des pays producteurs et les
investisseurs qui financent l’exploitation et la mise en production. Les contrats de
concession, et de partage de production sont les plus courants avec une
différence au niveau de la part de production revenant légalement et
physiquement à chaque partie.
• Les gouvernements des pays qui détiennent la ressource cherchent aussi à avoir
accès aux revenus issus de l’exploitation des gisements par les compagnies
privées. Ils peuvent collecter des revenus du secteur énergétique à travers des
instruments fiscaux et non fiscaux tels que les redevances, le bonus sur signature,
les impôts sur les revenus, les revenus indirects via des droits de douanes…
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 48
Limites pratiques et théoriques de la rente d’épuisabilité
Une ressource en terre est un actif qui doit être valorisé comme les autres actifs de
la même classe de risque. Tout le problème est : quelle est sa valeur aujourd'hui?
- La rente d'épuisabilité, même si elle existe et croît en théorie au taux
d‘actualisation, est dans la réalité très faible quand on est très loin de la date
d'épuisement. Par conséquent, elle risque d’influencer de manière négligeable
l'évolution des prix.
- La validité des hypothèses d'information parfaite (ou probabilisable) des acteurs
et en particulier des propriétaires des ressources en terre est une autre limite. En
effet, ceux-ci sont censés surveiller le prix de marché de la ressource et vérifier
qu'il croît bien au taux d‘actualisation qui représente le taux d’opportunité des
profits qu’ils pourraient gagner en investissant dans d’autres secteurs plutôt que
dans la ressource. Or, les propriétaires de ressources rares peuvent être
confrontés à de nombreux défis et obstacles qui peuvent affecter leur capacités à
surveiller et contrôler les prix ( ex fluctuations du tx de change, progrès
technologique, concurrence internationales,…)
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 49
- Dans la réalité, on a le plus souvent à faire à des oligopoles qui décident de
contrôler collectivement l'offre de ressources à condition que chacun y trouve
sont intérêt. Si dans l'oligopole, les taux d'actualisation sont différents (par exemple
parce que les contraintes qui pèsent sur les Etats détenteurs de réserves ou la
durée de vie de celles-ci sont très différentes), la stratégie jugée optimale pour l'un
ne le sera plus pour un autre. C'est ce qu'on observe dans l'histoire récente de
l'OPEP ou certains Etats (l'Arabie et les Emirats) ont toujours prôné une stratégie de
prix modérés pour soutenir la demande à long terme, alors que d'autres
préféreraient une stratégie de prix élevés pour engranger rapidement des rentes
importantes.
L'oligopole risque fort de se défaire, confronté à de telles divergences. Même si ce
n'est pas le cas, la politique de prix sera le résultat d'un compromis et son niveau
ne résulte plus de la seule logique d'optimisation économique, mais de bien
d'autres facteurs, qui seront variables dans le temps.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 50
Application: Cartel et « free riding » dans le pétrole
Les producteurs de pétrole peuvent avoir intérêt à s’entendre pour fixer des quotas
de production qui, en réduisant l’offre, conduisent à des prix d’équilibre plus
élevés. Mais la tentation est ensuite forte pour chacun de dépasser son quota, pour
récupérer un profit plus élevé.
Si chacun se comporte comme un « passager clandestin », on est alors conduit à
un prix d’équilibre plus bas et tous sont perdants. Il y a donc conflit entre les
incitations sociales à coopérer et les incitations privées de ne pas le faire.
Un exemple chiffré microéconomique simple permet de le comprendre:
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 51
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 52
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 53
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 54
L'OPEP a donc bien compris que la stratégie de rétention de l'offre pouvait être
rémunératrice, à condition toutefois que les forces centrifuges ne mettent pas en
péril l’entente entre les divers opérateurs.
A la différence du Cartel des Sept sœurs, qui était relativement homogène du point
de vue des intérêts, le cartel de l’OPEP est en effet hétérogène, certains pays ayant
un plan court de valorisation de leurs réserves de pétrole (Iran, Algérie) alors que
d'autres optent pour un plan long de valorisation, préférant des augmentations de
prix limitées afin de ne pas trop inciter les acheteurs à procéder à des substitutions
(Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis).
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 55
Le problème du partage des rentes d'oligopole
En admettant que l'ensemble des membres de l'oligopole adoptent le même taux
d'actualisation, leur stratégie de prix et la quantité totale à produire
correspondante peut normalement être déterminée. Mais il se pose toujours un
problème supplémentaire, qui est le partage de cette quantité à produire.
C'est, pour reprendre le cas de l'OPEP, le délicat problème de la fixation des quotas
de chaque membre. En examinant ce problème, on constate qu'il n'y a pas de
règles incontestables, en particulier pas de rationalité économique pure, qui
permette de fixer ces quotas. Par conséquent leur contestation en est fréquente, ce
qui peut conduire l'oligopole à s'écarter de la politique de prix qui pourtant
maximise le revenu collectif.
En réalité, la possibilité d'une détermination de la rente et du prix par une
rationalité économique simple, du type maximisation du revenu, qui semblait
résulter de la théorie du monopole parfait, s'évanouit donc pour peu que l'on
veuille bien considérer le fonctionnement concret des oligopoles réels.
Cours Economie de l'Energie Mme TEMIMI-MAMI Souha 56
Vous aimerez peut-être aussi
- Les transitions énergétiques: Discours consensuels, processus conflictuelsD'EverandLes transitions énergétiques: Discours consensuels, processus conflictuelsPas encore d'évaluation
- Fiche de Paie RACHID CHENAFDocument1 pageFiche de Paie RACHID CHENAFRadh Ibenaelmekki100% (2)
- Questionnaire Sur L'estime de SoiDocument2 pagesQuestionnaire Sur L'estime de SoiMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Mini Projet Éfficacité ÉnergétiqueDocument24 pagesMini Projet Éfficacité ÉnergétiqueAmAroui FátimaPas encore d'évaluation
- Cours Economie International Introduction PowerPointDocument18 pagesCours Economie International Introduction PowerPointAMINE ZNIDARPas encore d'évaluation
- Transition ÉnergétiqueDocument4 pagesTransition ÉnergétiqueHafid Lerari100% (1)
- Cours ProductionDocument32 pagesCours ProductionBennaceur ThamiPas encore d'évaluation
- La Théorie de La ProductionDocument42 pagesLa Théorie de La Productionabdelrh100% (2)
- Cours EnergieDocument55 pagesCours EnergieAmal ToucheriftePas encore d'évaluation
- Evaluation ConsommationDocument4 pagesEvaluation ConsommationmokademaminaPas encore d'évaluation
- Avis D Impot 2023 Sur Les Revenus 2022Document3 pagesAvis D Impot 2023 Sur Les Revenus 2022nilavan93210100% (3)
- Cours Economie de L'environnement Chap I (Version Finale)Document79 pagesCours Economie de L'environnement Chap I (Version Finale)Souha Temimi100% (6)
- Exposé Énergies RenouvelablesDocument15 pagesExposé Énergies Renouvelableszebulon111180% (5)
- Bulletin de Paie: Vauban BatimentDocument2 pagesBulletin de Paie: Vauban Batimentayoub.mk53000Pas encore d'évaluation
- Introduction Aux Énergies Renouvelables1Document12 pagesIntroduction Aux Énergies Renouvelables1Mohamed-Iliasse Mahraz100% (1)
- Modèle de Calcul de L'irppDocument7 pagesModèle de Calcul de L'irppChiara Tindo67% (3)
- Energies Renouvelables Production Et StockageDocument60 pagesEnergies Renouvelables Production Et StockageAimen KerkoudPas encore d'évaluation
- Bulletin de Paie: Février 2023: Net A Payer Avant Impot Sur Le Revenu 1335,06Document1 pageBulletin de Paie: Février 2023: Net A Payer Avant Impot Sur Le Revenu 1335,06Kis AlouPas encore d'évaluation
- Cours Marketing IndustrielDocument32 pagesCours Marketing IndustrielEl Arbi Abdellaoui AlaouiPas encore d'évaluation
- Énergie Renouvelable ExposéDocument6 pagesÉnergie Renouvelable ExposéLydia DjdPas encore d'évaluation
- Dialnet EnergiesRenouvelablesEtDeveloppmentDurableAuMaroc 6638115 PDFDocument30 pagesDialnet EnergiesRenouvelablesEtDeveloppmentDurableAuMaroc 6638115 PDFAbdelhakPas encore d'évaluation
- Les Energies Renouvelables Plan Maroc So PDFDocument172 pagesLes Energies Renouvelables Plan Maroc So PDFAmine Ziouziou100% (1)
- 1 - Définition Et Objet de La Science ÉconomiqueDocument11 pages1 - Définition Et Objet de La Science ÉconomiqueAbdenbiBelghitiPas encore d'évaluation
- Energies RenouvelablesDocument26 pagesEnergies RenouvelablesYosra JbeliPas encore d'évaluation
- Exposé Sur ÉnergieDocument9 pagesExposé Sur ÉnergieMouhamed FayePas encore d'évaluation
- Cours - Energies RenouvelablesDocument90 pagesCours - Energies Renouvelablesdhia lkPas encore d'évaluation
- E2 ACT4 Stockage Energie CORRIGEDocument6 pagesE2 ACT4 Stockage Energie CORRIGEaliPas encore d'évaluation
- Mini Projet EnergieDocument46 pagesMini Projet EnergieIbtissam Afkir100% (1)
- Cours Economie de L'energie Chap IDocument46 pagesCours Economie de L'energie Chap IMzoughi Dorsaf100% (1)
- Cours Economie de L'energie Chap IDocument46 pagesCours Economie de L'energie Chap IMzoughi Dorsaf100% (1)
- Les Energies Renouvelables Au MarocDocument6 pagesLes Energies Renouvelables Au Marocserec1Pas encore d'évaluation
- Les Energies Renouvelables Au Maroc Bilan Et Perspectives PDFDocument24 pagesLes Energies Renouvelables Au Maroc Bilan Et Perspectives PDFJihadJijiPas encore d'évaluation
- Cours de Recherche OperationnelleDocument53 pagesCours de Recherche OperationnelleParfait DahouiPas encore d'évaluation
- Energie Et CroissanceDocument86 pagesEnergie Et CroissanceIdrissa Yaya Diandy0% (1)
- Volet 2 - CRM Et Stratégies de FidélisationDocument40 pagesVolet 2 - CRM Et Stratégies de FidélisationSamira TaziPas encore d'évaluation
- Correction MicroDocument10 pagesCorrection MicroAwa Diop100% (1)
- Cours 3 Transition Energetique Et DD M1 GPetro S2 PDFDocument5 pagesCours 3 Transition Energetique Et DD M1 GPetro S2 PDFtahar bahfirPas encore d'évaluation
- Presentation Expose ENRDocument17 pagesPresentation Expose ENRYoussra Elkd100% (1)
- La Fidélisation de La Clientèle Dans Le Secteur Bancaire PDFDocument125 pagesLa Fidélisation de La Clientèle Dans Le Secteur Bancaire PDFJosue Ithamar KouyoPas encore d'évaluation
- Economie D Énergie - Optim Puiss Électrique V2Document30 pagesEconomie D Énergie - Optim Puiss Électrique V2AMAL ER RAJIPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Micro IIDocument51 pagesChapitre 3 Micro IIMzoughi Dorsaf100% (1)
- Id 6812Document32 pagesId 6812Sami JaballahPas encore d'évaluation
- Master Energetique Web Tlemcen Juillet2018Document12 pagesMaster Energetique Web Tlemcen Juillet2018Letoile SaraPas encore d'évaluation
- La Théorie Du Revenu Permanent Et Ses ExtensionsDocument15 pagesLa Théorie Du Revenu Permanent Et Ses ExtensionsabdelrhPas encore d'évaluation
- Plan de Cours L2Document4 pagesPlan de Cours L2Ali Safia Balde100% (1)
- Memoire de Master Recherches/DEA en Sciences de l'ingénieur/UFD-PSI Université de Douala/CamerounDocument101 pagesMemoire de Master Recherches/DEA en Sciences de l'ingénieur/UFD-PSI Université de Douala/CamerounNGOUNE0% (1)
- La Stratégie Énergétique Au MarocDocument9 pagesLa Stratégie Énergétique Au MarocAaiar AminePas encore d'évaluation
- ExercicesDocument71 pagesExercicesRamdane SidiPas encore d'évaluation
- L'efficacité ÉnergétiqueDocument52 pagesL'efficacité ÉnergétiqueJohn CasaPas encore d'évaluation
- Méthodes D'analyse MacroéconomiqueDocument5 pagesMéthodes D'analyse MacroéconomiqueRonald GonzalezPas encore d'évaluation
- Polycope de Cours - Energie RenouvDocument64 pagesPolycope de Cours - Energie RenouvBensalem100% (1)
- Plan PFE 2Document2 pagesPlan PFE 2Geer EnsahPas encore d'évaluation
- Id 8996 PDFDocument47 pagesId 8996 PDFAmel AlidraPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Microeconomie CDocument30 pagesChapitre 1 Microeconomie CalaPas encore d'évaluation
- Biens Publics Et ExternalitésDocument30 pagesBiens Publics Et ExternalitésAbdlghni RahmouniPas encore d'évaluation
- Cours Addyoubah REIDocument17 pagesCours Addyoubah REISoufian SaidiPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument24 pages1 PBHamid OUTZGUINRIMTPas encore d'évaluation
- FichiersDocument12 pagesFichiersby Mari TbPas encore d'évaluation
- Exposè Sarra BoulanouarDocument11 pagesExposè Sarra BoulanouarBOULANOUAR SarraPas encore d'évaluation
- Syllabus Cours Microecodev M1 - EcoDocument7 pagesSyllabus Cours Microecodev M1 - EcoEliada OlapadePas encore d'évaluation
- L'énergie Au Maroc Les Objectifs Et Les OrientationsDocument41 pagesL'énergie Au Maroc Les Objectifs Et Les OrientationsDoucita Doucita100% (1)
- Cours Micro DEADocument44 pagesCours Micro DEABiblio These100% (1)
- Les Énergies Renouvelables Et Le Développement Socio-ÉconomiqueDocument26 pagesLes Énergies Renouvelables Et Le Développement Socio-ÉconomiqueIMANE EL BOURKADIPas encore d'évaluation
- Economie de L'environnement 1 - V2020Document5 pagesEconomie de L'environnement 1 - V2020ousseini GOUNTANTEPas encore d'évaluation
- Economie S1GDocument2 pagesEconomie S1GjadPas encore d'évaluation
- Moteur À Combustion InterneDocument2 pagesMoteur À Combustion InterneAissa HanifiPas encore d'évaluation
- Ent Et Pouvoir de Marche 217665Document7 pagesEnt Et Pouvoir de Marche 217665uriel johnnyPas encore d'évaluation
- Lettre BourseDocument32 pagesLettre BourseOuiame MoukitePas encore d'évaluation
- Cours Offre Global Et Demande Gloabl - 2023 - InitialeDocument28 pagesCours Offre Global Et Demande Gloabl - 2023 - InitialeMar IemPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Les Objectifs de La Politique ÉconomiqueDocument62 pagesChapitre 2 Les Objectifs de La Politique ÉconomiqueMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Taf 1Document3 pagesTaf 1Mzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Liste AthleteDocument1 pageListe AthleteMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Fiche de PosteDocument3 pagesFiche de PosteMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Bac 2018Document8 pagesBac 2018Mzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Projet DeveloppementDocument2 pagesProjet DeveloppementMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- 2022economie Indstrielle Support 1Document29 pages2022economie Indstrielle Support 1Mzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Croissance Et InflationDocument13 pagesCroissance Et InflationMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 PDFDocument5 pagesChapitre 3 PDFMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- CH0 - INTRODUCTION Aux Finances Publiques - SECTION 3Document23 pagesCH0 - INTRODUCTION Aux Finances Publiques - SECTION 3Mzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Micro IIDocument51 pagesChapitre 3 Micro IIMzoughi Dorsaf100% (1)
- 2022 Economie Industrielle Support 3Document17 pages2022 Economie Industrielle Support 3Mzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Ote Sur Les Evolutions Economiques Et Monetaires Et Les Perspectives A Moyen TermeDocument21 pagesOte Sur Les Evolutions Economiques Et Monetaires Et Les Perspectives A Moyen TermeMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Chapitre Introductif Théorie de L'intégration ÉconomiqueDocument22 pagesChapitre Introductif Théorie de L'intégration ÉconomiqueMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Chap.1. Les Caractéristiques Du SDDocument45 pagesChap.1. Les Caractéristiques Du SDMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Les Stratégies de DéveloppementDocument17 pagesLes Stratégies de DéveloppementMzoughi DorsafPas encore d'évaluation
- Le MarchéDocument15 pagesLe Marchéij azePas encore d'évaluation
- Exposé de Theorie MarketingDocument13 pagesExposé de Theorie MarketingMOUYOUME DIEUDONNEPas encore d'évaluation
- Etat EraDocument4 pagesEtat EraAbdelMajidMohamed100% (2)
- 2024 01 BP JanvierDocument1 page2024 01 BP Janvierstephanie.racherPas encore d'évaluation
- Exposé de MarketingDocument5 pagesExposé de Marketinglorraine N'gohouPas encore d'évaluation
- Pr. Benjamaa TD 1 MacroDocument5 pagesPr. Benjamaa TD 1 Macrohamdi fekkakPas encore d'évaluation
- Cgi 2022Document791 pagesCgi 2022moustaphaPas encore d'évaluation
- G 29 Sous Word+excelDocument4 pagesG 29 Sous Word+excelOmar BoulaaresPas encore d'évaluation
- Supply & Demand TradingDocument11 pagesSupply & Demand TradingCheick Bypass225100% (1)
- Macro Chap 3Document37 pagesMacro Chap 3Rachid Ait Ben AssilaPas encore d'évaluation
- 2 - Part-1 Chapitre-1 Lecon-2 Comment Le Marche Concurrentiel Fonctionne-T-IlDocument8 pages2 - Part-1 Chapitre-1 Lecon-2 Comment Le Marche Concurrentiel Fonctionne-T-IlIsrael DjeguePas encore d'évaluation
- Mémoire FinalDocument113 pagesMémoire FinalToufik CherradPas encore d'évaluation
- Chap 0 Economie PubliqueDocument15 pagesChap 0 Economie PubliqueMartìalPas encore d'évaluation
- Prévision de La DemandeDocument13 pagesPrévision de La DemandeHamza EssebbarPas encore d'évaluation
- Introduction Au MarketingDocument16 pagesIntroduction Au Marketinganon_634518006Pas encore d'évaluation
- Cours Marketing StrategiqueDocument35 pagesCours Marketing StrategiqueAbdelhafid SatfiPas encore d'évaluation
- DC 11 11 03 Repas CDocument5 pagesDC 11 11 03 Repas CabdosmartoPas encore d'évaluation
- Cours Analyse EcoDocument99 pagesCours Analyse EcoKouakou Jean eliezerPas encore d'évaluation
- La Démarche Stratégique - PDFDocument8 pagesLa Démarche Stratégique - PDFeadenPas encore d'évaluation
- D 358099Document32 pagesD 358099AbdessalamBoulaajoulPas encore d'évaluation
- (ExercicesSynthèse) PDFDocument2 pages(ExercicesSynthèse) PDFYahya ElamraniPas encore d'évaluation
- Mcif CoursDocument161 pagesMcif CoursSkyler LatmaniPas encore d'évaluation