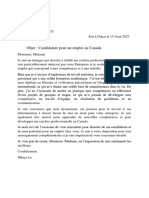Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cee CM 1 3
Transféré par
Mbaye babacar LoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cee CM 1 3
Transféré par
Mbaye babacar LoDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
Université Assane Seck de Ziguinchor
UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines (LASHU)
Département d’Histoire et Civilisations
BP : 523 Ziguinchor – Sénégal
HC 3521 : Conflits en Europe
Dr. Ludovic Boris NJUH
Année académique : 2021/2022
HC 3521 – Conflits en Europe
2
Introduction générale
Localisée dans l’hémisphère Nord, l’Europe, 10 180 000 km2 pour 743 000 000
d’habitants, est un continent qui fascine par son dynamisme et son attractivité. Là-bas s’articulent
bien d’enjeux majeurs des relations internationales contemporaines. Elle fait également parler
d’elle en tant qu’édifice géopolitique qui entretient un rapport plus ou moins conflictuel avec le
reste du monde, oscillant entre l’ouverture et le repli sur elle-même. En ce début du XXIe siècle,
l’Europe ne constitue plus en effet le centre du monde, même si elle est toujours un acteur
relativement décisif. Or, il y a environ un siècle, elle était encore considérée comme le centre en
question, tant dans les domaines de l’économique, du social, de la diplomatie que de la culture.
Comment comprendre cette situation actuelle de son histoire ? L’étude des conflits qui ont
ponctué son XXème siècle et qui continuent de se produire dans certaines de ses sous-régions ou
sous d’autres formes en ce début du XXIème siècle occupe une place importante au regard des
enjeux que soulève cette question.
Les conflits comme fait de sociétés, traversent en effet l’histoire de tous les peuples,
indépendamment des aires géographiques. Ils sont indissociables, voire inévitables, dans leurs
évolutions. Le concept conflit est cependant polysémique : « Le terme de conflit évoque le
combat, la lutte (« un conflit armé ») ; il suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent (« le
conflit entre la raison et la passion »), de positions antagonistes (« l’arbitrage d’un conflit ») ; il
renvoie souvent à une relation de tension et d’oppositions entre personnes (« les conflits
familiaux »). La notion de conflit désigne donc une situation relationnelle structurée autour d’un
antagonisme. Celui-ci peut être dû à la présence simultanée de forces opposées, à un désaccord
(sur des valeurs, des opinions, des positions…), à une rivalité lorsque des acteurs sont en
compétition pour atteindre le même but ou posséder le même objet (personne, bien, statut,
territoire…) ou à une inimitié affective (animosité, hostilité, haine…) »1. Un conflit, peut être ainsi
défini comme un état d’opposition entre personnes ou entités, motivé par une tension ou une
nervosité émotionnelle (colère, frustration, peur, tristesse, rancune, dégoût, etc.) le plus souvent
sur fond d’agressivité et de violence.
Cette pluralité de sens dénote une ambivalence fonctionnelle du conflit au sein des
sociétés. Dans la perspective de Georg Simmel, il est certes destructeur –telle est la vision
dominante– ; mais il est aussi constructeur du groupe2. Quels rôles les conflits ont-ils occupé
dans l’histoire contemporaine de l’Europe ? En quoi l’histoire de l’Europe rend-t-elle compte de
l’ambivalence fonctionnelle des conflits au sein de sa société ? Quelle corrélation peut-on faire
entre les conflits comme source de drames multiples et de décadence, mais aussi une expérience
historique qui fait la force de l’Europe ? Les réponses à ces questions se trouvent dans les
conséquences multiples des conflits pour la société et le leadership européens d’une part, et
d’autre part dans la prise de conscience de ses effets néfastes qui se traduit par un effort plus ou
moins constant d’œuvrer en faveur de la neutralisation des tensions sur le sol du contient.
L’objectif général de cet enseignement est donc de comprendre le contexte de naissance
des conflits en Europe, les raisons de leur permanence et les stratégies communautaires de leur
résolution. De manière spécifique il s’agit de : cerner l’influence des tensions diverses Europe,
alors qu’elle est à son apogée, sur son emballement dans les conflits et la perte de son hégémonie
au début XXe siècle (chapitre I) ; appréhender les formes et les logiques de superpositions entre
les conflits qui ruinent l’Europe et la relègue au second plan de la géopolitique mondiale durant
les quarante-cinq premières années du XXe siècle (chapitre 2) ; distinguer les formes, les
1 D. Picard et E. Marc, Les conflits relationnels, Paris, Presses Universitaires de France, 2015.
2 G. Simmel, Le conflit, Paris, Circé, 1992.
HC 3521 – Conflits en Europe
3
dynamiques et les enjeux des conflits en Europe de la fin de la Seconde Guerre mondiale au
début du XXIe siècle (chapitre 3) et enfin dégager et comprendre les stratégies de construction
d’une paix durable en Europe et les enjeux particulier de l’intégration régionale y relative (chapitre
4). Dans un souci de contextualisation, l’ambition qui sous-tend cette démarche est, à terme, la
captation des arguments psychologiques indispensables à une appréciation objective des choix
politiques susceptibles de conduire la paix ou la guerre, dans une Afrique embarquée dans un
projet de renaissance sur lequel la permanence des coups d’États, les tares des processus de
construction des États-nations, les conflits (infra- et interétatiques) font peser de lourdes
menaces.
HC 3521 – Conflits en Europe
4
Chapitre 1er : L’Europe au début du XXe siècle : le
poids des tensions
La brutalité avec laquelle s’ouvre le XXe siècle européen surprend. Comparée aux autres
continents, l’Europe d’alors domine, fait et défait à sa guise l’ordre international. Elle avait certes
reculé en Amérique latine suite aux nationalismes ; mais le manteau colonial avec lequel elle était
parvenue à recouvrir l’Afrique et l’Asie au courant de la seconde moitié du XIXe siècle lui
donnait une position conformable dans les affaires mondiales. Elle surfait pour ainsi dire sur une
vague d’hégémonie qu’elle perd subitement, en l’espace de quelques années à l’entame du XXe
siècle. Pour en arriver à ce déclin comme avec toutes les civilisations qui ont atteint leur apogée, il
est évident qu’en-dessous du rayonnement international, l’Europe secrétait des signes qui
l’exposaient à la permanence des conflits. L’objectif de ce chapitre est de les identifier et de les
analyser pour comprendre pourquoi cette situation s’est produite. Le bien-être des populations, le
sentiment de protection par l’autorité morale gouvernante et les alliances pacifiques étant entre
autres les principaux gages de stabilité et de paix, quels sont les facteurs socioéconomiques et
politiques qui prédisposent la société européenne à un emballement dans les conflits depuis le
tournant début du XXe siècle ? Ce chapitre dresse un état des lieux des conditions
socioéconomiques de vie et des rapports (géo)politiques en Europe au début du XXe siècle.
I. Inégalités, crises et tensions socio-économiques
Le XXe siècle s’ouvre en Europe sur un panorama socioéconomique chargé de tensions.
Pourtant, une centaine d’années avant, on était parti sur une lueur d’espoir pour toutes les
couches sociales. L’invention de la machine à vapeur par le britannique James Watt en 1769
rendait possible en effet le rêve d’une amélioration des mœurs économiques et des conditions
sociales de vie des populations, au détriment du système féodal et de l’oligarchie. Le machinisme
qui s’en suit suscite une modification profonde des systèmes de transformation des matières
premières et de production richesses. En engageant un processus de substitution de la motricité
humaine par la puissance de l’acier et de la machine, l’on espère l’avènement d’une société où,
disposant de moyens de labeur permettant de devenir « maîtres et possesseurs de la nature » –
comme le disait Descartes–, l’Homme s’arque-bouterait de moins en moins, tout en disposant de
ressources plus abondantes que la physiocratie ne satisfaisait plus techniquement. Avec une
démographie croissante comme partout dans le monde –sauf en Afrique ponctionnée par la traite
atlantique–, ces perspectives de modification des systèmes de production et des dynamiques de
développement atténuaient aussi l’angoisse que véhiculait le malthusianisme3. Malgré les guerres
napoléoniennes, une ère nouvelle s’était donc quand-même ouverte en Europe.
La révolution industrielle est en effet un fait de civilisation majeure de l’histoire moderne
et contemporaine. Elle est définit comme le processus historique du XIXe siècle qui fait basculer
la société majoritairement agraire et artisanale vers une société industrielle et commerciale.
Graduelle à la fois dans le temps et dans l’espace, elle rend compte du désir profond
d’épanouissement économique et d’émancipation sociale chez les peuples. Caractérisée par
l’industrialisme, le machinisme et l’édification des structures économiques et financières de plus
en plus complexes comme, c’est le moteur de changements majeurs en Occident. Tirant profit
des progrès scientifiques et techniques et de leurs applications pratiques, elle marque l’agenda des
transformations économiques et sociales, tour à tour au Royaume-Uni (depuis 1769), en Belgique,
3 La population de la Grande-Bretagne est multipliée par 9 entre 1500 et 1900 et de 6 à 21 millions d’habitants entre
1750 et 1850.
HC 3521 – Conflits en Europe
5
en France et en Suisse (début du XIXe siècle), en Allemagne et en Suède (milieu du XIXe siècle)
et en fin du XIXe siècle en Espagne, en Italie, en Autriche-Hongrie et en Russie. C’est le
phénomène à la mode puisqu’elle se répand aux États-Unis et au Japon (ère Meïji) au milieu du
XIXe siècle. Elle devient l’une des raisons avancées pour mettre un terme à la traite des Africains
vers les Amériques ; car la nécessité devient celle de les maintenir sur le continent une population
qui constituerait un marché et des débouchés pour leurs produits. Dans ses grandes lignes, la
révolution industrielle est concrétisée par un recours croissant aux machines avec la sidérurgie qui
rythme les progrès des transports (navires à vapeurs, chemins de fer), la fabrication des hauts
fourneaux, des outils et machines agricoles comme les tracteurs et moissonneuses-batteuses et
l’utilisation des engrais artificiels. Le monde agricole de l’Europe méditerranéenne et centrale4,
demeure quant à lui traditionnel notamment en Russie où le servage n’est aboli qu’en mars 1861.
Pour que ces progrès aient été possibles, un élément fut essentiel : le capital. Il prend de
plus d’ampleur dans la vie économique, favorise l’ascension sociale d’une minorité au grand dam
d’une majorité qui quitte, sans le savoir, le servage féodal dans les apanages ruraux pour le
« servage industriel » dans les cités urbaines. Ce sont les salariés ou ouvriers (prolétaires). Si le
capitalisme marchand existait depuis la fin du Moyen-Âge, la révolution industrielle donne plus
de relief au capital dans la vie économique en Europe au XIXe siècle. Pour accompagner leur
employabilité à des fins d’investissements, les places boursières voient ainsi le jour tout en se
multipliant. En tant qu’institutions centrales elles sont cependant l’apanage des bourgeois et des
dirigeants politiques qui entretiennent des relations de bonne intelligence, chacun usant de ses
atouts pour accroître ses intérêts et influencer ou préserver le pouvoir. Capitale de la première
puissance du monde à l’époque, Londres est une place boursière majeure. Toutefois, de
nombreuses autres se créent à travers l’Europe sur des bases concurrentes. Dans l’Allemagne
portée par la sidérurgie, la bourse de Hambourg devient dès 1856 « la place où se suivaient le plus
d’intrigues, où se négociaient le plus d’affaires secrètes d’argent », comme l’affirme Jean-Baptiste
Capefigue. Pour ce qui est des tendances, les secteurs stratégiques comme les chemins de fer, les
canaux maritimes et les banques, qui animent la révolution industrielle et constituent les moteurs
économiques de puissance des États, font l’objet d’investissements croissants. En 1868 ces trois
secteurs représentent 53 % des actions cotées à la bourse de Paris. En 1870, la capitalisation
boursière anglaise était à 76 % constituée par le chemin de fer, suivis des banques (11 %) et le
reste 13 %. C’est dire l’importance que les bourses ont dès l’époque dans les circuits
d’investissements et dans la vie économique de l’Europe.
Toutefois, certains contrastes contribuent à faire de l’activité boursière un domaine de
rivalités entre les États. À titre d’illustration, la France se dote d’un système monétaire centralisé
en plus de la concentration d’entreprises sur la base des monopoles et la production de masse.
L’Allemagne quant à elle adopte le protectionniste. Ces approches contrastent avec la doctrine
libérale britannique. Ces différences créent la concurrence qui ont des incidences du point des
vue des doctrines politiques ; chose qui prépare l’antagonisme entre les États. En effet,
l’industrialisation soulève l’épineux problème des matières premières. La recherche de ces
dernières justifie, l’expansion coloniale vers l’Afrique et l’Asie et leurs cortèges de rivalités
invoquées plus tard à la veille de la Première Guerre mondiale. Cela suscite aussi au niveau
européen, les luttes interétatiques contre les expansionnismes qui surgissent au XIXe siècle,
comme nous verrons plus loin, chaque État ou communauté essayant d’accaparer des ressources
pour créer des conditions favorables à son épanouissement, même au grand dam des autres.
Par ailleurs, à ces différences de doctrines financières, s’ajoute la spéculation. Les uns
cherchant toujours à se faire du profit plus que d’autres, des secousses comme le krach boursier
4 Dans cette partie de l’Europe, le pouvoir politique est demeuré ancré sur la féodalité, et accuse ainsi du retard sur la
modernisation en cours que revendiquent les populations comme nous verrons plus loin.
HC 3521 – Conflits en Europe
6
espagnol de 1866, les tensions de trésoreries deviennent de plus en plus fréquentes, provoquant
des crises. En Europe, la plus importante reste le krach boursier de Vienne de 1873, car elle
fragilise la vie économique du continent pendant près d’un quart de siècle. La Grande Dépression
(1873-1896) puisqu’il s’agit d’elle, débute en effet par une crise bancaire de mai 1873. Les crédits
hypothécaires entraînent une énorme bulle spéculative immobilière. Plusieurs centaines de
banques autrichiennes s’effondrent après s’être envolées et se déclarent en faillite. Or, l’Empire
d’Autriche-Hongrie est à l’époque un État majeur de l’Europe centrale. Dans une propagation en
chaîne, deux autres cités-capitales influentes sont touchées : Berlin se réveille de la spéculation
immobilière déclenchée par l’indemnité de guerre de 1871, qui avait permis à l’Allemagne de
recevoir un stock d’or égal à 25 % du PIB français. Cette réclamation renforçait l’obsession de la
revanche de la France jusqu’à l’éclatement de la Grande Guerre. Triomphant à Sedan,
l’Allemagne avait en plus fait le pied de nez à la France en lui arrachant l’Alsace-Lorraine et en
proclamant son unité au château de Versailles en 1871. Paris allait s’en souvenir en 1918. Ce
revanchisme aura été au point où sur des allégations de haute trahison –prétendument pour avoir
livré des documents secrets français à l’Empire allemand– le capitaine Alfred Dreyfus, un juif
d’origine alsacienne, subit une condamnation injuste, provoquant une déchirure sociopolitique de
douze ans (1894-1906) dans une France devenue antisémitique et aigrie envers l’Allemagne.
Ainsi, la Grande Dépression révèle les failles et les contradictions socio-économiques de
la révolution industrielle. Il apparaît que la répartition inégale des richesses par les pouvoirs
publics constitue une source majeure de tensions en Europe, la prédestinant aux conflits. Les
retombées des progrès économiques sont en effet accaparées par la bourgeoisie économique et
politique, au moyen des institutions centrales que sont les bourses et les banques. Des hommes
comme Mayer Rothschild ou encore Alfred Escher font d’énormes profits. Tout cela s’opère au
détriment d’une catégorie sociale plus nombreuse : les prolétaires. Le prolétariat est une classe
ouvrière contrainte de vendre sa force de travail aux bourgeois, détenteurs des capitaux, en se
soumettant ainsi à l’exploitation et aux abus de leurs droits de travail. Cette exploitation se
renforce avec des formes nouvelles d’organisation du travail : le fordisme et le taylorisme. Elles
conduisent, explique Karl Marx, à l’aliénation du prolétaire, condamné à être une « une simple
machine à produire la richesse pour autrui, écrasée physiquement et abrutie intellectuellement ».
C’est dans ces conditions que chez les ouvriers, toute la famille travaille : hommes,
femmes comme enfants5. Les journées sont très longues, de 12 à 15 heures en moyenne jusque
vers 1860, avec de rares pauses. Les accidents du travail, liés à la fatigue, à la pénibilité, aux
difficiles conditions de travail sont fréquents (22 pour 10 000 en France entre 1871 et 1875). Le
chômage l’est aussi du fait des licenciements abusifs et de l’importance numérique de la
population active, qui augmente avec l’exode rural, la croissance démographique et en périodes de
crises économiques comme pendant la Grande Dépression. Les salaires sont par conséquents peu
élevés (5 F par jour en France de 1900 à 1914). Dans une société européenne en mutations et où
l’on espérait de meilleurs lendemains pour tout le monde, une écrasante majorité des populations
se retrouve ainsi à devoir survivre ; car exposée aux famines (à l’instar des Irlandais en Grande-
Bretagne entre 1845 et 1847) ou obligée de consacrer une grande partie des revenus à la pitance
quotidienne. Les logements sont insalubres, la nourriture déséquilibrée et de mauvaise qualité
malgré les progrès de l’agriculture. Cette sous-alimentation affaiblit les corps et les rend
vulnérables aux maladies comme le rachitisme, le choléra ou la tuberculose. Le désespoir pousse
aussi à l’alcoolisme. En pleine « Belle Époque » (1896-1914) en France, où après la Grande
Dépression l’on sembla enregistrer une certaine croissance, l’inégalité reste flagrante : 85 % de la
propriété privée totale détenue n’est détenue que par 10 % de la population.
5 En France le phénomène des enfants-ouvriers se répand dès les années 1830.
HC 3521 – Conflits en Europe
7
Face à ce qui se perçoit comme un sentiment d’abandon par les gouvernements qui
entretiennent des relations de bonne intelligence avec les bourgeois, les ouvriers souvent
constitués en syndicats se lancent fréquemment dans la contestation des méthodes et conditions
de travail. Leurs actions posent ainsi des enjeux de réflexions sur l’organisation des sociétés, et
donnent naissance à des utopies et des doctrines politiques nouvelles. Elles critiquent le profit, la
concurrence, du moins ses excès, ainsi que la propriété privée assimilée à une spoliation. Le
déséquilibre dans la redistribution des retombées de la révolution industrielle est ainsi à l’origine
de nombreuses frustrations et revendications nationalistes. Les disparités créées par les
incohérences de leur gestion et les crises financières suscitent des tensions qui poussent les
peuples à réclamer des changements politiques profonds. Prenant de plus en plus de l’ampleur,
elles créent une atmosphère des crises permanentes qui débouchent sur une succession de
conflits au début du XXe siècle.
II. Transition républicaine douloureuse et militarisation de la vie
politique
Toutes graduelles, les revendications politiques constituent une source de tensions qui
débouchent par des conflits en Europe au début XXe siècle. Les difficultés socioéconomiques
orientent en effet la pensée et l’action vers une conception nouvelle des institutions et des mœurs
politiques, susceptibles de favoriser le changement social. Pour beaucoup, il apparait que la
distribution des richesses reste problématique parce que les systèmes politiques anciens, hérités
de l’époque féodale se montrent inaptes à assurer cela. Il faut dire que sur ce plan, tant les succès
de la révolution française (1789) que les travers qui l’ont suivi, ont contribué à la sédimentation
des revendications qui s’exacerbent de plus en plus, reposant graduellement sur le recours aux
armes pour instaurer les ordres politiques et construire les États-nations, et finalement à une
militarisation de la vie politique qui dispose les dirigeants vers la fin du XIXe à repousser
progressivement les options diplomatiques et pacifiques de règlement des conflits au profit de la
guerre. La révolution française lègue en effet à l’Europe les valeurs de luttes pour la liberté,
l’égalité et la fraternité. Ce triptyque sous-entend la justice, l’équité, l’égalité des chances (avec
l’abolition des privilèges de l’aristocratie) et la reconnaissance des droits de l’homme entre autres.
La même révolution enseigne cependant que pour en arriver à la création de la « cité idéale »
qu’appelait déjà de tous ses vœux François Noël Babeuf dit Gracchus Babeuf (1760-1797), toutes
les options pouvaient être envisagées, y compris le recours à la violence ultime (guerre) pour
réaliser les ambitions politiques. Cette révolution aura également enfanté un système qui, pour se
maintenir, estima dans un premier temps que pour la construction de l’État-nation puis de la
République, l’on pouvait s’accommoder de la terreur (Régime de Terreur), et de l’irrédentisme
violent, comme le témoignent les guerres napoléoniennes. Il apparut donc que le fondement de
l’État-nation était censé se reposer désormais sur la lutte, et que sa puissance résiderait dans sa
capacité à provoquer ses voisins pour les dominer. Malheureusement, au courant du XIXe siècle,
les progrès techniques en armement deviennent un secteur important auprès des dirigeants
politiques. Le lobby des armes, au service d’une destruction plus massive, prend ses aises6.
Le paradigme de la lutte des classes, pour la refonte des systèmes socio-économiques et
politiques et l’édification des sociétés justes et égalitaires traverse donc les sociétés européennes.
Il est consolidé par plusieurs théoriciens, de Babeuf à Joseph Lénine, en passant par Pierre-
Joseph Proudhon, Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxembourg et Jean Jaurès, entre autres.
Parallèlement, la corrélation entre « espace vital » et construction de l’État-nation devint
6 J.-F. Brun, « La mécanisation de l’armurerie militaire (1855-1869) », Revue historique des armées [Online], n° 269, 2012,
URL : http://journals.openedition.org/rha/7581. Sur la même lancée, alors qu’il cherche un moyen efficace pour
faire exploser les roches et faciliter l’exploitation des mines, Alfred Nobel met au point la dynamite. Son invention
est plus tard détournée à des fins militaires, notamment pour la fabrication des explosifs.
HC 3521 – Conflits en Europe
8
consubstantielle, c’est-à-dire que pour construire des États, il fallait forger des nations tout en leur
garantissant des territoires exclusifs et riches pour son épanouissement. Or, dans une Europe où
les frontières avaient longtemps divisé des peuples ou provoqué la soumission de certaines
communautés par d’autres, cette quête de cohésion nationale, tantôt par le droit du sol (approche
française), tantôt par celui du droit du sang (conception allemande), donna naissance à des
idéologiques concurrentes voire rivales telles que : le pangermanisme, le panslavisme, la Jeune
Italie, la Grande Idée, la Jeune Irlande, les Jeunes Turcs, la Grande Serbie, entre autres. La
particularité de ces doctrines est qu’elles ont des bases exclusivistes (tout pour la communauté) et
expansionnistes (rien pour les autres y compris leurs terres).
Ainsi, à compter des années 1820, l’Europe est traversée par des luttes de pouvoir soit
pour le maintien et la consolidation de l’ordre monarchique hérité du vieil ordre féodal, soit pour
la refonte des systèmes politiques, sur fond de transition républicaine. En effet, malgré l’existence
de la Sainte-Alliance, formée en 1815 par les souverains vainqueurs de Napoléon Ier7, pour
empêcher toute révolution, des conflits ponctuent tout le XIXe siècle européen : la Restauration
absolutiste (1814-1833) suivie des guerres carlistes (1833-1840, 1846-1849 et 1872-1876) avec
l’intermède de La Gloriosa (septembre 1868) en Espagne ; la révolution de 1821 en Moldavie et
Valachie ; la guerre d’indépendance grecque (1821-1829) ; les Trois Glorieuses (26, 27 et 28 juillet
1830) en France ; la révolution d’août 1830 - juillet 1831 en Belgique ; l’Insurrection de novembre
(novembre 1830 - septembre 1831) et ceux de 1863-1864 en Pologne ; les guerres d’indépendance
et de réunification de l’Italie ou Risorgimento (1848-1849, 1859-1860 et 1866)8 ; le soulèvement de
juillet 1848 par Jeune Irlande en Grande-Bretagne ; les révolutions autrichienne, hongroise,
roumaine, milanaise, sicilienne et polonaise de 1848 ; la guerre de Crimée (1854-1855) ; les
révolutions de 1848-1849 et la guerre franco-prussienne de 1870-1871 qui marquèrent le
processus d’unification de l’Allemagne, entre autres. Ce sont des conflits politiques aux relents
géopolitiques qui rythment l’Europe au cours des deux premiers tiers du XIXe siècle. Au-delà des
années 1870, d’autres conflits continuent de secouer l’Europe de l’Est. L’une des particularités de
ces dernières est cependant qu’ils s’inspirent des réussites de ceux qui ont eu lieu en Europe
occidentale, centrale et du Sud dont l’Italie et l’Allemagne.
Leurs expériences révolutionnaires renseignent en effet qu’autour des années 1870, le
recours aux armes serait légitime pour conduire les changements politiques, et que seule la
revendication radicale de la nationalité est susceptible de fonder une nation et consolider un État.
Le carnage que fut la bataille de Solferino (24 juin 1859)9 révèle certes à quel point la volonté de
faire gagner la cause indépendantiste et unificationniste peut être l’expression d’un patriotisme
profond ; mais aussi il témoigne de l’inclinaison dangereuse du recours à la violence de plus en
plus inouïe pour défendre des idées politiques. C’est au point de provoquer un émoi unanime et
la création en 1863 de la Croix Rouge Internationale. L’existence de l’Empire allemand traduit
quant à lui, sur la scène européenne, le triomphe d’une doctrine géopolitique nouvelle : la
Realpolitik. Avec Otto von Bismarck, le « Chancelier de fer » pour qui « la force prime le droit »,
cette une politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l’intérêt national. Elle est cœur du
projet Mittel Europa dont le pendant africain est Mittel Afrika. Empereur de 1888 à son abdication
en 1918, Guillaume II n’hésite à ajouter un zeste d’agressivité et de provocation diplomatique à
toutes ces doctrines qu’il centralise dans la Weltpolitik, destinée à faire de l’Allemagne non
seulement une puissance d’Europe, mais du monde. Avec cette ligne politique, le Reich banalise
donc la guerre, en prenant au bas mot la maxime du général prussien Carl von Clausewitz (1780-
1831) qui écrivît : « La guerre n’est que le prolongement de la politique par d’autres moyens ». Il
7 Empire d’Autriche, Royaume de Prusse, Empire russe.
8 Le royaume d’Italie est proclamé le 17 mars 1861. Toutefois, l’unification s’achève avec l’annexion de Rome,
capitale des États pontificaux, le 20 septembre 1870.
9 En une journée, elle fit 5 492 morts, 23 339 blessés et 11 560 prisonniers ou disparus dans les deux camps.
HC 3521 – Conflits en Europe
9
n’était pas seul à penser ainsi. Son contemporain Georg W.F. Hegel (1770-1831) tint aussi ces
propos incitants : « La guerre préserve la santé morale des peuples ».
Avec l’emphase sur l’importance de la guerre, les révolutionnaires de l’Europe de l’Est,
sublimés par les progrès en Europe de l’Ouest et désireux de libérer leurs patries, allaient croire
que ce qui était ainsi dit était simple à faire et sans conséquence. Ils allaient prendre l’Europe de
l’Ouest pour modèle dans le processus de (re)construction de leurs nations ; tandis que celle-ci
avait d’autres ambitions pour eux. Les Jeunes Turcs s’inspiraient notamment de la manière dont
Giuseppe Mazzini, l’une des figures clés du Risorgimento, idéologisa Jeune Italie. Les membres de
la Ligue balkanique (voulant mimer l’Italie victorieuse de l’empire ottoman en 1911-1912 comme
nous verrons plus loin) et la Serbie croyaient quant à eux établir une alliance stratégique gagnante-
gagnante, pro-chrétienne orthodoxe, quand ils comptaient sur une Russie rompue au
panslavisme. L’Autriche-Hongrie pensait faire pareil en comptant sur l’Allemagne. C’était faire fi
de la prétention paternaliste de l’Europe occidentale qui trouvait que l’Empire ottoman était
l’ « homme malade de l’Europe ». Avec Bismarck l’on avait une pensée un peu plus caricaturale et
infantilisante, quand ce dernier, voyant le cours des événements en Europe de l’Est, fit entendre
que c’est d’une « connerie dans les Balkans » que naîtra un conflit généralisé. Sans se douter de
rien, ou alors faisant semblant, les nationalistes de cette partie de l’Europe s’inspirèrent de tous
ces modèles qui ne récusaient pas la violence, et finirent par provoquer une guerre qui non
seulement anéantît leurs projets et leurs territoires, mais aussi la paix mondiale.
L’Europe du début du XXe siècle est, en fin de compte, un continent traversé par des
contradictions socioéconomiques et politiques héritées des périodes antérieures, précisément du
XIXe siècle, qui font peser des menaces importantes sur la stabilité et la paix au niveau du
continent. Son économie est au sommet du monde ; mais cela ne profite pas à tout le monde. Ses
industries, son rayonnement culturel, les retombés de l’industrialisation souffrent de confiscation
entre les mains d’une aristocratie qui veut avant tout embrigader les ressources et les richesses, au
lieu de les mettre au service de la construction et du progrès des nations. Bien plus, cette
aristocratie est réfractaire aux changements et à l’évolution des systèmes politiques. Ces écarts
traversent la société et poussent les masses frustrées à se révolter, à demander une restructuration
des dynamiques de construction des États-nations. Ces revendications, toujours plus radicales
sédimentent la violence totalitaire.
HC 3521 – Conflits en Europe
10
Chapitre 2 : Généralisation de la violence et
décadence de l’Europe : le premier cycle de conflits
et ses logiques (1900-1918)
Au début du XXe siècle, les tensions socioéconomiques et politiques poussent de plus en
plus les peuples vers la radicalisation. Ils les combattent les régimes parce qu’ils sont inaptes à
conduire pacifiquement le progrès économique et social, mais toujours prompts à satisfaire leurs
penchants pour la domination des (autres) peuples. Cette atmosphère de tensions imprime dans
les consciences un usage de la guerre comme commodité politique. Elle entraine aussi une
altération progressive des valeurs de paix dans les mœurs. Férues de la construction de l’État-
nation et la conquête du pouvoir par les armes, les élites politiques (dirigeants et nationalistes)
provoquent une généralisation de la violence (premier cycle mineur) qui propulse l’Europe et
avec le monde dans un conflit total (premier cycle majeur).
I. Europe centrale et de l’Est explosives : nationalismes, crises de
l’État et conflits dans les Balkans (1900-1914)
Sous le poids des tensions diverses, le premier quart du XXe siècle européen s’ouvre part
une séries de conflits. Ce sont contestations politiques de plus en plus armées qui visent dans un
premier temps à abolir le vieil ordre impérial, réfractaire aux réformes. De toute l’Europe, celui-ci
était parvenu à conserver ses traits les plus surannés en Europe de l’Est avec la Russie et dans les
Balkans avec l’Empire ottoman. Le conservatisme qui caractérise aussi la double monarchie en
Autriche-Hongrie (Europe centrale) exacerbe les tensions politiques et provoquent la soif de
liberté chez les peuples. Dans un second temps, ces conflits font l’objet d’une instrumentalisation
qui conduit à la formation des alliances belliqueuses, à la guerre dans les Balkans et tout juste
immédiatement à la Première Guerre mondiale.
- Le détour conflictuel de la défossilisation politique en Russie
En Russie, le système féodal a su se maintenir alors que le reste du continent vit au
rythme de la révolution industrielle et des changements politiques. Le tsarisme, vieil ordre
impérial, reposait sur la féodalité. Ce système maintenait les inégalités importantes au sein de la
société. Au début du XXe siècle on assiste à un raidissement du pouvoir, à alors que le pays avait
prise de bonne options avec le tsar Alexandre II. Celui-ci avait le servage et institué un système
libéral en 1861. On assista même avec lui à un élan de décentralisation du pouvoir avec la
création des institutions locales et provinciales appelées zemstva. Cependant, la soif d’une liberté et
d’équité plus importantes continuât de traverser le peuple, donnant lieu à une exacerbation des
tensions avec la montée d’une opposition nourrie par le populisme, le nihilisme et un soupçon de
terrorisme. C’est dans ce cafouillage qu’Alexandre II est assassiné en mars 1881. Son successeur,
Alexandre III en profite pour instaurer des mesures draconiennes pour consolider le pouvoir. Les
avancées libérales de son prédécesseur sont remises en cause, tandis qu’une police secrète très
puissante est instaurée. Son fils Nicolas II poursuit l’œuvre à partir de 1894 plongeant la Russie
pratiquement dans un état de siège de 1881 à 1904. Or, les conditions de vie des populations ne
faisaient que se dégrader. Déjà, contrairement au reste de l’Europe, la révolution industrielle n’est
amorcée en Russie que dans les années 1890. La frénésie pour l’ascension sociale, conduite par
une classe moyenne (dite Troisième Élément) à cheval entre l’aristocratie conservatrice et les
paysans, crée bientôt des disparités au sein de la société russe. La bureaucratie toujours plus
HC 3521 – Conflits en Europe
11
lourde augmente le nombre de fonctionnaires ; les classes moyennes bien qu’émancipées sont
cependant frustrées, car quasiment exclues du pouvoir politique. L’industrialisation et le
développement du capitalisme donne aussi naissance au prolétariat urbain et aux migrations des
ouvriers vers les villes. La paupérisation des paysans dans les campagnes nourrit le prolétariat
rural. Ces deux catégories sociales constituent un immense réservoir de mécontents et des masses
sensibles aux mouvements de protestation au début du XXe siècle.
Une crise économique frappe la population entre 1901 et 1903 en provoquant les faillites
industrielles, tout comme les famines dans les campagnes à cause des mauvaises récoltes. Entre
1900 et 1904, on compte 670 révoltes paysannes à travers l’empire. De plus, les ouvriers, au
chômage en villes, perdent l’espoir de trouver refuge à la campagne, frappée par la crise. Alors
que le tsar refuse toujours de procéder aux réformes, les revers dans la guerre face au Japon,
entamée en février 1904 porte un coup à son prestige et discrédite son gouvernement. C’est ainsi
qu’un collectif de travailleurs de Saint-Pétersbourg lui adresse une pétition en janvier 1905,
réclamant la suppression de la bureaucratie et la convocation de représentants du peuple sous
forme d’assemblée constituante sur base d’un vote universel, direct, secret et égalitaire pour régler
les problèmes de la nation : les efforts envers la scolarisation, la protection des droits des peuples,
la lutte contre la pauvreté et des mesures contre l’oppression du capital au travail. Pour témoigner
de leur détermination, la pétition est suivie d’une grève le 9 janvier 1905 à Bakou, Moscou et
Saint-Pétersbourg (capitale de l’empire à l’époque). C’est le « Dimanche rouge », car elle réprimée
dans le sang. Loin de décourager le peuple, d’autres mouvements d’humeurs éclatent quelques
mois plus tard, s’étendant à la fois au salariat qu’en milieu universitaire. Du 7 au 17 octobre 1905,
le pays est en effet traversé par une grève générale. Elle est réprimée une fois de plus ; mais se
répète du 22 décembre 1905 au 1er janvier 1906, marquée par des combats entre les ouvriers de
Moscou d’un côté, et de l’autre la police et l’armée, pour plus d’un millier de morts. En cette
veille de la décennie 1910, le pouvoir politique russe a en effet entamé une déliquescence
profonde auquel la Grande Guerre et la révolution de 1917 donnent plus tard un coup de grâce.
La dégradation de la vie sociopolitique au sein de l’empire multiséculaire russe, dont la
suzeraineté s’exerçait sur de nombreux pays (Pologne, pays baltes, Roumanie) a des conséquences
sur la stabilité de ces derniers au début du XXe siècle. En lien avec la révolution de 1905,
l’insurrection de Łódź (Journées de juin) est un soulèvement des ouvriers polonais dans la ville
éponyme contre le tsarisme du 21 au 25 juin 1905. Cela entraine des perturbations au sein du
Congrès polonais alors sous contrôle russe. Les insuffisances de l’État russe poussent finalement
les nationalités en Pologne, mais aussi en Finlande, dans le Caucase et dans les régions baltes à
demander leur autonomie. Ces revendications qui aboutissent dans les années 1920 passent par
des conflits sur lesquels on reviendra plus loin. Toujours en lien avec la révolution de 1905, une
révolte de la faim secoue la Moldavie en 1907 ; tandis que la Roumaine est agitée la même année
par une révolte des paysans de février à avril. En Europe du Sud-Est, la situation de l’Empire
ottoman n’est pas meilleure, ni celle de l’Autriche-Hongrie en Europe centrale.
- Instabilité et conflits au sein de l’Empire ottoman
L’Empire ottoman, fondé en 1299, glisse sur une pente politique descendante au début du
XXe siècle à cause d’un raidissement du pouvoir et des ingérences étrangères. Cette situation est
connue sous l’appellation de « Question d’Orient », c’est-à-dire l’implication des puissances
européennes dans le démembrement de l’Empire ottoman, de l’échec de la prise de Vienne par
les armées du sultan en 1683 au traité de Lausanne de 1923. Ces interventions étrangères
profitent en effet d’une atmosphère politique délétère qui règne au sein de cet empire,
particulièrement à partir de la fin du XIXe siècle. Pour arrêter l’affaiblissement de l’empire et
rétablir sa gloire d’antan, le sultan Abdülhamid II avait en effet cru qu’il fallait instaurer un
pouvoir autoritaire. À ses yeux, cela susciterait la crainte envers le pays et ses institutions, tant à
HC 3521 – Conflits en Europe
12
l’intérieur qu’aux seins des chancelleries européennes qui voulaient tirer parti de son
affaiblissement. C’est ainsi qu’il abrogea en 1878 les réformes adoptées de 1839 à 1876 (Tanzimat)
par son prédécesseur, le sultan Abdlülmecid, pour la « modernisation » du pays. Or, la nouvelle
génération trouve cette situation intenable et la fustige au sein d’un mouvement baptisé les Jeunes
Turcs. À l’instar de Jeune Italie de Giuseppe Mazzini pendant l’unification de l’Italie, les premiers
balbutiements de ce mouvement remonteraient à création à Istanbul en 1865. Mais elle évolua
sous forme de société secrète refugiée à Paris et à Londres de 1867 à 1871. À partir de 1889, il est
déterminé à lutter contre l’autoritarisme d’Abdülhamid II.
Dans un contexte où la lutte mêle renaissance politique et sauvegarde contre
l’occidentalisation de l’héritage, le raidissement du sultan déclenche des clameurs au sein de
l’empire. La première est l’insurrection d’Ilinden–Preobrajeniye (août-octobre 1903) en
Macédoine avec l’Organisation Révolutionnaire Macédonienne Interne Adrianopolitaine
(IMARO) fondée en 1893. En avril 1903, des anarchistes lancent en effet une série d’attentats
(attentats de Thessalonique) pour attirer l’attention des grandes puissances sur l’oppression
ottomane en Macédoine et en Thrace orientale. En réponse, l’armée turque, renforcée par des
mercenaires (bachibouzouks), massacre des Bulgares à Thessalonique, puis à Bitola. La brutalité de
la répression est telle que les rebelles abdiquent en octobre. Toutefois, c’est pour se replier car
l’IMARO recherche des alliances et finit par s’associer aux suprémistes en Bulgarie. L’envergure
internationale que prend l’insurrection d’Ilinden–Preobrajeniye se voit aussi à travers une réaction
du monde extérieur. En octobre 1903, François-Joseph d’Autriche-Hongrie et Nicolas II de
Russie (qui se refusent pourtant aux changements à domicile) parrainent le programme de
réformes de Muztag, prévoyant une Police étrangère de la région de Macédoine, l’indemnisation
financière des victimes (même s’il s’agit vraisemblablement de soutenir les insurectionnistes) et
l’établissement de frontières dans la région sur des bases ethniques. Cette ingérence ne fait
qu’envenimer les crises au sein de l’Empire ottoman. La question des aspirations concurrentes de
la Grèce, de la Serbie, de la Bulgarie et des défenseurs locaux de l’autonomie politique n’est
abordée par cette initiative et ne fait que prendre du relief. La notion de frontières ethniques est
par ailleurs impossible à mettre en œuvre. Et le sultan réussit à se maintenir.
Mais en 1908, il doit faire face à une dissension turco-turc provoquée par la révolution
des Jeunes Turcs, déterminés à débarrasser leur pays de l’ordre ancien (les Vieux Turcs).
Abdülhamid II a beau établir une nouvelle Constitution le 24 juillet 1908, il est déposé les
révolutionnaires le 27 avril 1909. Imprégné des idées positivistes et jacobines, le mouvement qui a
pris le temps de s’ouvrir aux milieux libéraux et à l’influence occidentale prend les rênes de
l’empire. Avec Mehmed V et le Comité Union et Progrès, une nouvelle ère. Mais elle ponctuée de
contradictions qui ne la font durer que jusqu’en octobre 1918. Obsédée par le panturquisme qui
veut redonner au pays sa gloire d’avant, la révolution de 1908 accouche d’un soupçon de
conservatisme qui précipite le processus de déclin de l’empire. En effet, le mouvement conserve
la domination turque sur les nationalités soumises jadis par voies conquêtes. Ainsi, de mai à juillet
1910, il décide d’un accroissement des impôts qui pousse les Albanais à revendiquer leur
autonomie. Jugée comme réclamation indépendantiste, l’initiative de ces derniers se heurte en
effet à une répression sanglante : exécutions sommaires et interdiction de l’usage de l’alphabet
albanais. Beaucoup d’Albanais fuient alors vers le Monténégro, accueillis par Nicolas Ier. En 1911,
ils reprennent la lutte, remportant même la bataille de Děčín. Évitant une ingérence occidentale,
Mehmed V leur propose une amnistie et promet l’ouverture d’écoles en langue albanaise.
Toutefois, les Albanais trouvent que ce n’est plus suffisant. En 1912, une révolte éclate en
effet dans l’Ouest du Kosovo. Elle prend de l’ampleur car des Albanais désertent les rangs de
l’armée ottomane pour rejoindre la rébellion. Par ailleurs, Ismail Qemali l’un des leaders sillonne
l’Europe pour trouver des appuis. Enfin, des officiers ottomans se montrent réticents à se battre
contre des rebelles principalement des albanais musulmans. Préoccupées simultanément par les
attaques italiennes, les autorités ottomanes acceptent la quasi-totalité des revendications
HC 3521 – Conflits en Europe
13
autonomistes des Albanais le 18 août 1912. Profitant de l’affaiblissement de l’empire, l’Italie avait
en effet lancé des attaques dès le 29 septembre 1911 et occupé le Dodécanèse. Cette guerre italo-
turque qui va jusqu’au 18 octobre 1912 se solde par le traité d’Ouchy par lequel l’empire ottoman
rentre en possession de ses îles en échange des provinces ottomanes de Tripolitaine, de
Cyrénaïque et du Fezzan qui forment la Libye italienne coloniale10. Ce compromis accepté par
Mehmed V apparaît aux yeux des autres chancelleries occidentales comme le signal pour
enclencher la phase active de la Question d’Orient, dont la finalité est, pour ainsi sire, de
démanteler l’Empire ottoman. Voyant la facilité avec laquelle les Italiens ont battu les Ottomans,
des élites politiques de certaines nationalités des Balkans s’embarquent dans des tractations qui,
malheureusement, se retournent contre la stabilité de leur propre sous-région.
- Les conflits dans la Balkans
Les Balkans désignent l’espace péninsulaire et géopolitique qui se trouve au Sud-Est de
l’Europe. C’est de là que s’est édifié l’Empire ottoman et où se trouve l’actuelle Turquie.
Percevant les aspirations à la puissance formulées par divers peuples dans cette partie de l’Europe
comme une menace à leur hégémonie, des chancelleries d’Europe de l’Ouest, alors pleine
expansion territoriale à travers le monde, avaient pensé à partir de la fin des années 1870 qu’il
fallait affaiblir cette sous-région tout en englobant la Russie. Cela passait notamment par le
parachèvement du processus de déclin de l’Empire ottoman, édifice géopolitique à dominance
musulmane que l’Europe occidentale et centrale chrétiennes voit depuis longtemps comme un
danger. Il était aussi question de contrer le panslavisme, idéologie ébauchée par le croate Vinko
Pribojević (c. 1470-1540), repris avec vigueur par le russe Nikolaï Danilevski (1822-1885) et qui
se structure comme mouvement avec le Congrès panslave de Prague en 1848. C’est une doctrine
politique, culturelle et sociale qui valorise l’identité commune que partagent les peuples slaves11 et
qui préconise leur union politique sur la base de cette identité. La naissance d’une telle
communauté représentait une menace pour les dirigeants d’Europe de l’Ouest.
La politique expansionniste du tsar Nicolas Ier les inquiétait notamment. De 1853 à 1856,
une coalition constituée de la Grande-Bretagne, de la France et du royaume Sardaigne (en Italie)
s’était constituée autour de sultan Abdlülmecid Ier sous prétexte de venir en aide à un Empire
ottoman menacé par les influences étrangères. En réalité, il était question de contenir
l’expansionnisme russe dans le Caucase et l’Asie centrale. La coalition y parvint in extremis après la
prise de la base navale de Sébastopol la signature du traité de Paris de 1856. Les Russes n’allaient
cependant pas renoncer leur projet. C’est ainsi qu’après la victoire de l’Empire ottoman contre la
Serbie en 1876 et la répression de l’insurrection bulgare d’avril 1876, Alexandre II qui se voulait
protecteur des chrétiens qui y vivaient, déclara la guerre au sultan. Ce conflit russo-turc (1877-
1878) se solde par le traité de San Stefano (actuelle Yesilköy), le 3 mars 1878, prévoyant
l’indépendance des États chrétiens des Balkans ; tandis que les Turcs, vaincus, ne gardent que la
Thrace orientale. Associé à l’anti-réformisme d’Abdülhamid II dès 1878, cette avancée des Russes
exacerbe l’inquiétude de l’Europe occidentale. Benjamin Disraeli, le Premier ministre sous qui
l’expansion coloniale britannique s’active, œuvre ainsi pour une rencontre qui doit contraindre la
Russie à reconsidérer les termes du traité de San Stefano. La Grande-Bretagne, première
puissance maritime, ne veut pas qu’elle se rapproche du Bosphore (politique du Grand Jeu).
L’Allemagne accueille un congrès dans ce sens le Premier Congrès de Berlin (13 juin- 13 juillet
10 Ce conflit vit l’utilisation de nouvelles technologies militaires, comme les avions. Le 1 er novembre 1911, Giulio
Gavotti réalise le premier bombardement aérien de l’histoire en larguant des grenades sur les troupes ottomanes.
11 Polonais, Tchèques, Slovaques, Slovènes, Croates, Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Gorans, Macédoniens,
Bulgares, Pomaks, Russes, Biélorusses, Ukrainiens, Cachoubes, Sorabes/Lusaciens et Ruthènes.
HC 3521 – Conflits en Europe
14
1878)12. Il réunit l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grèce, la Grande-Bretagne, l’Italie,
la Russie, la Serbie, l’Empire ottoman et le Monténégro. Il impose aux États de la balkaniques de
nouvelles frontières. En autres, la Bulgarie, sous domination ottomane depuis le XIVe siècle est
divisée en deux. Jouant de la diversité sociologique locale, cela transforme les aspirations
d’émancipation des peuples en nationalismes antagonistes. Est ainsi inauguré le processus de
fragmentation politique par le morcellement des territoires appelé « balkanisation »13.
Croyant tirer profit de cette situation, la Grèce pensa qu’il était enfin temps de donner
corps à la « Grande Idée ». Conceptualisé en 1844 par Ioánnis Koléttis, la Megáli Idéa était une
doctrine nationaliste depuis l’indépendance en 1829. Plus que de l’indépendance, les descendants
d’Hélène voulaient s’unir dans un seul État-nation qui aurait pour capitale Constantinople, celle-là
même de leur ancienne métropole coloniale. Le projet reposait donc sur une forme
d’irrédentisme. Voyant la facilité avec laquelle les Italiens avaient pris le dessus sur les Turcs, les
Grecs qui s’identifiaient à la chrétienté orthodoxe, et donc proches de la Russie, pensèrent, sous
la houlette d’Elefthérios Venizélos, qu’il était possible de tirer profit de l’affaiblissement de leur
voisin ottoman suite aux ingérences des chancelleries occidentales. Pour les Grecs, l’annexion du
Dodécanèse par l’Italie en 1911, s’ajoutant celle de la Bosnie-Herzégovine en 1908 et un peu plus
tôt par l’empire austro-hongrois et de l’île Chypre par les Britanniques en 1878 traçait le spectre
d’une série d’occupation de territoires pouvant muer en recolonisation de leur bercail. Leur projet
allait accentuer de préserver leur souveraineté voire d’agrandir leur territoire et leur détermination
poussa la France et la Grande-Bretagne, à mettre exécution leur plan nourri depuis le Congrès de
Berlin (1878) : diviser l’Europe du Sud-Est en créant des petits États, manipulables contre les
ambitions russes et turques, voire contre leurs propres intérêts.
Ainsi, entre mars et mai 1912, la Serbie, le Monténégro, la Grèce et la Bulgarie concluent
des alliances qui donnent naissance à la Ligue balkanique. C’est une alliance dont le but est de
combattre, voire démanteler l’Empire ottoman. Soutenue par la Russie au regard des affinités
articlées autour de la chrétienté orthodoxe, confrontée à la France et la Grande-Bretagne qui
veulent les dissuader de tout passage à l’acte sans avoir à se mettre à dos la Russie, combattue par
l’Allemagne qui accorde son soutien l’Empire ottoman et à l’Autriche-Hongrie menacée par cet
irrédentisme, la Ligue déclenche quand-même la guerre contre les Turcs en octobre 1912. La série
de victoires qu’elle remporte au cours de cette Première guerre des Balkans (octobre 1912- mai
1913) privent à l’Empire ottoman de ses possessions d’Europe. Toutefois, les divergences sur le
partage de la Macédoine, dont la situation est restée confuse depuis l’insurrection d’Ilinden–
Preobrajeniye (1903), révèle la mésentente entre les membres de la Ligue, notamment entre la
Serbie et la Bulgarie. C’est ainsi qu’éclate la Deuxième guerre des Balkans (16 juin - 18 juillet
1913). Dans une reconfiguration des alliances qui désintègre la Ligue, la Bulgarie affronte la
Serbie soutenue par la Grèce et le Monténégro, rejoints par la Roumanie et l’Empire ottoman, qui
en profite pour reprendre Andrinople et la Thrace orientale. La Bulgarie perd la moitié de ses
acquis territoriaux de la guerre précédente et la Dobroudja du Sud annexée par la Roumanie. La
Serbie victorieuse commence à voir grand. Elle pense pouvoir s’en prendre à l’Autriche-Hongrie
dans le seul intérêt des Serbes. Son appétit se heurte à cet empire de l’Europe centrale et
provoque l’éclatement de la Première Guerre mondiale.
II. La Première Guerre mondiale et ses conséquences (1914-1918)
L’éclatement de la Première Guerre mondiale est la résultante de plusieurs facteurs qui,
sur la longue durée, ont rendu un conflit total pratiquement inévitable. Parmi les causes
12 Le Second (novembre 1884- février 1885) porte sur le partage de l’Afrique.
13 Ce politique sert plus tard de modèle à la dislocation de la Yougoslavie dans les années 1991-1996.
HC 3521 – Conflits en Europe
15
lointaines, l’on cite notamment le désir de revanche et les rivalités géopolitiques en colonie
(France vs Allemagne depuis la guerre de 1870-1871 et au sujet du Neu Kamerun considéré comme
la petite Alsace), la course aux armements et la formation des alliances (Triple Alliance vs Triple
Entente). Toutefois, c’est un conflit dont l’élément déclencheur est parti des contradictions et de
l’enlisement du processus de construction de l’État-nation austro-hongrois, donnant lieu à
l’attentat de Sarajevo en juillet 1914.
- De la question des nationalités en Autriche-Hongrie et la guerre
Située en Europe centrale, l’Autriche-Hongrie est un empire né de la transformation de
l’Autriche en double monarchie, c’est-à-dire en deux États en 1867. Gouvernée par une diète
impériale, il constitué de l’archiduché d’Autriche, des royaumes de Bohême et de Galicie d’une
part (Cisleithanie) et d’autre part des pays de la Couronne de saint Étienne, incluant les royaumes
de Hongrie et de Croatie-Slavonie (Transleithanie). Tout au long du XIXe siècle, l’empire austro-
hongrois restera traversé par des courants idéologiques antagonistes. Cette stabilité précaire
provient notamment du fait que l’empire est un mélange de nationalités qu’un compromis de
pouvoir contient avec beaucoup de difficultés. En 1910, on y retrouve en effet des Allemands
(23,4 %), les Magyars (19,6%), les Latins (Italiens et Roumains, 7,8 %), les Juifs et les Roms
(« sujets de l’empire », 4,56 %). Constituant, 45 % de la population, la plus grande composante
sociologique était les Slaves (Tchèques, Serbes, Croates, Slovènes) et vivait mal sa subordination
aux Austro-Allemands et Magyars, groupes dominants mais moins nombreux. Dans le dualisme
austro-hongrois, les aristocrates hongrois avaient notamment le pouvoir de bloquer toute
modification constitutionnelle et toute évolution politique de l’Empire. Le slaves, plus
précisément les Tchèques, entamèrent des revendications auxquelles ils n’allaient pas obtenir de
suite. Depuis 1868, ils avaient demandé l’empereur François-Joseph un statut semblable à celui
des Hongrois avec l’octroi de l’autonomie au royaume historique de Bohême.
Tirant les leçons de la fossilisation du pouvoir qui était responsable du déclin de
l’Empire ottoman, et inquiet de la récupération du panslavisme par la Russie, l’archiduc François-
Ferdinand, héritier du trône de l’Empire austro-hongrois en 1896 et avait pris pour épouse
Sophie Chotek d’origine tchèque. Il songea à une réorganisation du pouvoir sur une base
inclusive. S’entourant des intellectuels, c’est ainsi qu’il avalisa le projet des États unis de Grande
Autriche conçu par Aurel Popovici en 1906. L’archiduc, toutefois, continuait de rechercher
l’appui de l’Allemagne pour contrer les prétentions panslavistes russes. Cela allait écorner la
sincérité de ses intentions aux yeux des Slaves de son empire. En outre, si ce projet avait tout
pour séduire les chanceliers occidentales en ce qu’il aiderait à combattre l’expansionnisme russe,
la perspective d’édification d’un État-nation soudé et invulnérable, comme le pensèrent jadis les
Grecs, inquiétaient la France et la Grande-Bretagne. Ce projet créait un contretemps sur l’agenda
que la Grande-Bretagne avait particulièrement dans les Balkans (créer des États fragiles
manipulables pour contrer la Russie). Par ailleurs, elle étendait les possibilités de mise en œuvre
de la Mittel Europa, un projet de domination politique et économique conçu par l’Allemagne dès
les années 1870. La France qui en avait été victime en 1871 tout comme la Grande-Bretagne, ne
voulaient d’une recomposition géopolitique qui basculeraient l’équilibre des pouvoirs et les
relègueraient au second rang de la scène européenne.
Alors, chaque empire allait s’immiscer dans la question des nationalités au sein de
l’empire austro-hongrois, miroitant à tour de rôle les perspectives radieuses pour les
revendicateurs d’indépendance. Le point de départ des manœuvres fut la Serbie qui s’était
émancipée de l’empire ottoman en 1817. S’appuyant sur des ébauches formulées par le prince
polonais Adam Czartoryski en 1843, le serbe Ilija Garašanin avait formulé l’idéologie pan-serbe
depuis en 1844. Il revendiquait les terres habitées par les Bulgares, les Macédoniens, les Albanais,
les Monténégrins, les Bosniaques, les Hongrois et les Croates, afin de constituer la « Grande
HC 3521 – Conflits en Europe
16
Serbie ». En 1903, un coup d’État porte sur le trône serbe Pierre Karageorgévitch, déterminé à
implémenter l’expansionnisme serbe. Il est aussi un pro-russe. Il est donc clair qu’il s’agissait d’un
autre irrédentisme qui titillait les empires voisins, y compris notamment l’Autiche-Hongrie. Mal
en prend alors François-Ferdinand qui, rentrant dans le jeu des chancelleries occidentales qui lui
ont confié l’administration de la Bosnie-Herzégovine dans le sillage du traité de Berlin (1878), ne
s’en contente plus, mais l’annexe simplement en 1908. Souhait-il simplement affirmer son
autorité sur ce territoire fasse à toute prétention extérieur ?
Les Bulgares, frustrés par la division de leur territoire depuis le traité de Berlin (1878),
n’allaient pas voir cela d’un bon œil. Les Croates ainsi que les Serbes du royaume de Serbie tout
comme ceux que venaient d’annexer François-Ferdinand non plus. C’est ainsi qu’en 1911 naît le
mouvement Jeune Bosnie, mimant les Jeunes Turcs. C’était une organisation révolutionnaire
formée de jeunes nationalistes Croates et de Serbes, dont le bras armée était une société secrète :
la Main noire, coiffée par Gavrilo Princip. À Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine qui venait d’être
annexé, le 28 juin 1914, celui-ci tire à bout portant sur l’archiduc François-Ferdinand et son
épouse. Mis aux arrêts avec ses complices, l’un d’eux (Danilo Ilić) avoue l’origine du
ravitaillement en arme, en indiquant la Serbie comme origine. C’est le début des tensions
diplomatiques entre cette dernière sur laquelle porte l’accusation d’avoir commandité l’assassinat,
de la part de l’Autriche-Hongrie.
Dans cette atmosphère tendue, l’entourage du défunt monarque est divisé : le comte
Berchtold, ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur à Paris, Londres et Saint-
Pétersbourg, défend une intervention punitive immédiate en Serbie sans déclaration de guerre ;
tandis que le comte Tisza, Premier ministre hongrois, nationaliste magyar craignant l’annexion de
territoires peuplés de Slaves, promeut la voie diplomatique. Pacque c’est une perspective qui offre
l’occasion à son pays de prendre vigoureusement pied dans les Balkans et parachever la « Course
vers l’Est » (Drangen nach Osten) avec son allié austro-hongrois, le chancelier Théobald von
Bethmann Hollweg assure les partisans de la guerre du soutien allemand. Ceci pousse l’Autriche-
Hongrie à poser un ultimatum le 7 juillet 1914. C’est une dizaine d’exigences qui visent à faire
plier la Serbie, notamment en renonçant à son idéologie et à son hostilité envers l’Autriche-
Hongrie, mais aussi en en autorisant la participation de policiers autrichiens à l’enquête sur le
territoire serbe, dans un délai de 18 jours. Le 25 juillet 1914 qui fut cette date butoir, la Serbie
soutenue par la Russie, oppose un « non » à l’ultimatum. C’est la rupture des relations
diplomatiques entre les deux États. Le 28 juillet 1914, l’Autriche-Hongrie déclare une guerre «
préventive » à la Serbie. Par le jeu des alliances, ce conflit européen se métamorphose en une série
de règlements de comptes. La Première Guerre mondiale a commencé.
- Une guerre européenne devenue mondiale
Comme l’avait prédît le comte Tisza s’opposant à la guerre, avait aussi déclaré le 8 juillet
1914 après la publication de l’ultimatum : « Une attaque contre la Serbie amènerait très
vraisemblablement l’intervention de la Russie et une guerre mondiale s’ensuivrait ». Mais justifiant
la guerre, l’Empereur et Roi d’Autriche-Hongrie François-Joseph déclarait le 29 juillet 1914: « J’ai
tout examiné et tout pesé ; c’est la conscience tranquille que je m’engage sur le chemin que
m’indique mon devoir ». Le renoncement délibéré à la paix plonge l’humanité dans une
conflagration pendant 4 ans, 3 mois et 14 jours (28 juillet 1914 - 11 novembre 1918). La querelle
serbo-autro-hongroise est en effet un conflit échappe aux dirigeants par le jeu des alliances. En
rapport avec les troubles qui se déroulaient dans la Balkans et en vue de contrebalancer leurs
pouvoirs réciproquement, les États-nations européens se lançant en filigrane à des tractations
diplomatiques pour préserver leurs intérêts. C’est ainsi se formèrent des alliances opposées. Il
s’agit d’une part de la Triplice, également appelée Triple-Alliance (ou Triple alliance), conclues
HC 3521 – Conflits en Europe
17
entre l’Empire allemand, l’Autriche-Hongrie et l’Italie en 1882. D’autre part, il y avait l’Entente
(Triple-Entente ou Triple Entente), formée en 1907 entre la France, le Royaume-Uni et la Russie.
Dans un conflit qui mélange soucis de construction d’États-nations et règlements de
comptes, les théâtres des opérations sont étendus aux colonies, notamment dans les protectorats
allemands d’Afrique (Kamerun, Togo, Sud-Est Africain allemand et Sud-Ouest africain
allemand). Les colonies britanniques et françaises d’Afrique et d’Asie sont impliquées dans les
hostilités. Le Japon entre plus tard dans la guerre aux côtés des britanniques. Cette phase de
déploiement massif et d’attaques azimutes fut la guerre des mouvements qui caractérisa le reste
de l’année 1914. Alors qu’on croyait que la Guerre serait terminée à Noël, on était loin de se
douter que l’étincelle partie des Balkans allait entretenir un brasier difficile à éteindre. À partir de
1915, et ce jusqu’en 1917 le conflit s’enlise de part et d’autre des fronts Est et Ouest. C’est la
guerre de positions au courant laquelle les tranchées et des armes de plus en plus meurtrières sont
expérimentées. Étouffés par le blocus de l’Entente, les Allemands entament une guerre sous-
marine à outrance. En janvier 1917, l’Allemagne élabore un projet d’alliance avec le Mexique
contre les États-Unis, qui engagés dans une politique expansionniste depuis 1914, ont de bonnes
relations commerciales avec l’Entente et la ravitaille. Alors, le 6 avril 1917, le Congrès américain
décide de l’entrée en guerre contre les empires centraux. L’Amérique va ainsi prendre pied
fermement dans la géopolitique européenne. Malgré la parenthèse isolationniste l’entre-deux-
guerres, elle ne va vraiment plus quitter la scène européenne. Ils y sont jusqu’à nos jours, non
sans poser d’énormes problèmes de souveraineté à l’Europe, comme le révèle la crise
ukrainienne. Dans sa folie meurtrière, l’Europe aura ainsi attiré sur son héros, aujourd’hui son
bourreau. Plusieurs pays d’Amérique latine s’engagent aussi dans le conflit aux côtés de l’Entente.
Cette recomposition des forces suit celle qui s’est opérée en avec la signature du pacte
de Londres le 25 avril 1915 entre l’Entente et l’Italie. Celle-ci, accrochée à son irrédentisme, lâche
ses alliés et négocie sa collaboration avec l’Entente dans la perspective d’un gain de territoire en
cas de victoire finale ; car ses visées se portent en Autriche-Hongrie où il y a une partie des
Italiens. Aussi, poussant le panturquisme vers la radicalité, le gouvernement des Jeunes Turcs, qui
se range du côté de l’Allemagne par anti-panslavisme russe, profite de la guerre pour liquider les
chrétiens et consolider l’Empire ottoman. Le génocide des chrétiens arméniens environ 1,5
million de victimes entre le printemps 1915 et l’automne 1916. Tolérer de telles exactions,
inquiète Rome dans une certaine mesure, surtout que contrairement au scenario de sa victoire en
1911, les Turcs font preuve d’une puissance de feu qui inflige une lourde défaite aux troupes
coalisées franco-britanniques, et donc à l’Entente. L’Italie renégocie donc sa position dans la
guerre. Son entrée dans l’Entente contraste avec la sortie de la Russie quelques temps plus tard.
Dépassée par la guerre, plus en plus déchirée de l’intérieure puisque ses dirigeants ne se sont
guère ravisé depuis les évènements de 1905, en proie à une guerre civile qui éclate finalement en
octobre 1917, le Russie signe un traité de paix séparé avec les pays de l’Axe à Brest-Litovsk en
mars 1918. De son côté, l’Empire ottoman qui mène la danse pour un moment encore dans les
Balkans impose à l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie le traité de Batoum quatre mois plus tard
(4 juin 1918). Ce sera le moment culminant pour les empires centraux. Après une salve
d’offensives, l’Axe fait en effet face à partir d’août 1918 aux contre-offensives des Alliés.
Affaiblie par les défaites et la désertion de nombreux contingents slaves, l’armée austro-
hongroise est vaincue. L’Empire austro-hongrois signe l’armistice le 4 novembre, à Villa Giusti
dans le nord de l’Italie. L’armée turque est anéantie par les Britanniques lors de la bataille de
Megiddo en septembre 1918. En Allemagne, tandis que les généraux, conscients de la défaite à
terme, songent à l’armistice, l’empereur Guillaume II qui, obsédé par sa Weltpolitik aura donné des
garanties de soutien à l’Autriche-Hongrie via von Bethmann Hollweg, refuse d’abdiquer. Il y est
contraint le 9 novembre 1918 par une vague révolutionnaire qui gagne tout l’Empire. L’état-
major, coiffé par le maréchal Hindenburg et le quartier maître général Erich Ludendorff,
demande ainsi que soit signé l’armistice. Le gouvernement de la nouvelle République allemande le
HC 3521 – Conflits en Europe
18
signe à Rethondes le 11 novembre 1918. La Première Guerre mondiale est terminée. Toutefois,
l’acte posé par les représentants de la République du Weimar (1918-1933), est perçu de manière
ambivalente. Certains, dont un certain Adolph Hitler, soldat au front, qui croyait aux chances de
son pays de remporter ce conflit, qualifient cela de « coup de poignard dans le dos ».
La Grande Guerre aura eu des conséquences dont seuls quelques traits majeurs sont
soulignés ici : dix millions de morts et environ huit millions d’invalides ; des destructions
matérielles importantes ; diffusion des maladies comme la grippe espagnole, etc. Ses
conséquences territoriales sont plus importantes. La Première Guerre mondiale peut en effet être
interprétée comme avant tout une guerre de territoires, dans la mesure où elle éclate aux confins
des négociations corsées et finalement raides entre les puissances européennes nées des
révolutions industrielles et politiques. De même la tendance se prote sur les remembrements
territoriaux dans le sillage des « traités de paix » qui meublent l’après-guerre. On peut citer : le
traité de Saint-Germain-en-Laye (10 septembre 1919), entre l’Autriche et les alliés ; le traité de
Neuilly (27 novembre 1919) entre la Bulgarie et les alliés ; le traité de Tartu (2 février 1920) entre
l’URSS et l’Estonie ; le traité de Versailles (28 juin 1919-10 juin 1920). Ces tractations eurent des
conséquences territoriales, avec la dislocation de l’Autriche-Hongrie notamment et la
reconnaissance des États baltes représentent aux yeux des démocraties européennes de l’Ouest le
moyen de maintenir la « paix » et de préserver leur hégémonie. À Versailles notamment, l’esprit
qui gouverna en partie les négociations était de « presser le citron jusqu’à ce les pépins craquent ».
On parlait punir et de faire regretter aux pays de l’Axe d’avoir cherché la guerre. Or, cette guerre,
il l’avait cherché tous ensemble. Les termes de la paix tels que négociés lors de cette rencontre va
souffrir de contestations plurielles et susciter des conflits à peine la guerre terminée, et ce durant
toute la période de l’entre-deux-guerres.
HC 3521 – Conflits en Europe
19
Chapitre 3 : Le second cycle des conflits: crises de
l’entre-deux-guerres et Seconde Guerre mondiale
(1919-1945)
Les démocraties occidentales ont gagné le « premier round » des rivalités géopolitiques qui
les opposent à l’Europe centrale et de l’Est au début du XXe siècle. C’est moment de gloire, car
leur hégémonie s’agrandi dans le monde. Avec l’isolationnisme américain, les pays de l’Europe de
l’Ouest gagnent de l’influence. Les tailles de leurs empires coloniales sont multipliées, et elles ont
réussi à réaliser la vision qu’ils poursuivaient depuis le Premier Congrès de Berlin en neutralisant
toute concurrence venant de l’Est. Engagées sur la reconstruction post-conflit, elles vont enfin
pouvoir se reposer sur leurs lauriers en tirant profit des colonies –malgré la pression de la Société
des Nations (SDN) par endroits–, et sur le dos des peuples victimes des sanctions. Leur alliée
russe qui s’était lancée dans une politique de l’Autruche, tentant de consolider un panslavisme
contrastant avec ses difficultés socioéconomiques en paie le prix fort. Le contexte de la guerre est
le point de départ d’une série de conflits qui vont la priver de nombreux territoires aux abords de
la Mer baltique. Profiter de la paix au détriment des autres peuples cause par ailleurs des
frustrations, des conflits intermittents et la montée des fascismes. À leur maturité, celles-ci
engagent une reconfiguration des rapports de force. Cela donne naissance à de nouvelles alliances
belliqueuses et à la Seconde Guerre mondiale. Ce chapitre analyse le second cycle de conflits qui
secoue l’Europe entre 1919 et 1945. Tout en entretenant une cohérence propre, on distingue un
second cycle de conflits mineurs durant l’entre-deux-guerres et un second cycle majeur qu’est la
Seconde Guerre mondiale. L’un comme l’autre apparaissent comme les avatars des solutions
tronquées, appliquées à la résolution des conflits antérieurs.
I. Les avatars de la Grande Guerre : insurrection, révolution et
communisme de guerre (1918-1922)
Deux ans demis après son éclatement, la guerre avait commencé à fatiguer. En Grande-
Bretagne, les Irlandais qui n’en peuvent plus de la misère se soulèvent. L’insurrection de Pâques
(24-29 avril 1916) est réprimée dans le sang par le pouvoir de Londres. En Europe de l’Est, le
cours des événements est plus macabre. La Russie de Nicolas II qui avait pris un engament de
trop au nom du panslavisme, alors que son pays souffrait de carences socioéconomiques et
politiques graves, fut la première à craquer. Depuis la révolution de 1905 et ses rémanences en
Pologne, en Finlande, dans le Caucase et dans les régions baltes ainsi qu’en Moldavie et en
Roumaine (1907), la Russie n’a avait cessé de s’enfoncer politiquement. À l’écoute d’un Grigori
Raspoutine (1869-1916), proche de la couronne parce que confident d’Alexandra Feodorovna
l’épouse du tsar Nicolas II, le régime s’emballe dans des scandales. Occultiste, ce paysan venu à
Saint-Pétersbourg en 1905 est devenu un homme politique par la force de ses tours
mystificateurs. Personnage controversé, il n’hésite pas souvent de mêler à ses facultés
spiritualistes un soupçon de populisme. C’est ainsi qu’après la révolution de 1905, il se heurte au
Président du Conseil, Piotr Stolypine. Nommé en juillet 1906 auprès de la cour, il se veut
réformateur et modernisateur. Avec autant de contrastes au niveau de sa personnalité, il engage
des réformes qui vont dans des directions opposées. Né après l’abolition du servage (mars 1861),
il permet à la Russie de passer au stade suivant des réformes pour espérer atténuer la grogne
sociale responsable de la révolution de 1905. C’est ainsi qu’il permet aux communautés paysannes
(mir) d’acquérir des terres. Dans un autre registre, il organise une meilleure répartition de l’impôt,
améliore le système ferroviaire et augmente la production de charbon et de fer.
HC 3521 – Conflits en Europe
20
Cela n’est pas sans heurter des aristocrates, mécontents, tapis dans l’ombre, comme
Stolypine qui ne parvient pas à comprendre son influence sur le couple impérial. Raspoutine
devra déjouer plusieurs vagues d’attentats. C’est sans doute la pointe de croissance que la Russie
amorce avec lui qui rend le tsar si confiant en lui, au point qu’il engage le pays dans les Balkans,
contre l’avis de Raspoutine lui-même, car il fallait d’abord consolider la croissance interne. Mal
l’en avait pris entre temps de penser qu’il accorde davantage de pouvoirs au Parlement (Douma)
longtemps écrasé par l’imperium unilatéral du tsar. On allait discréditer ses appels à la paix
comme gage de la stabilité en l’accusant d’avoir des relations d’affaires avec le banquier Serge
Rubinstein et ses contacts allemands. De ce conflit sociopolitique latent au sommet de l’appareil
étatique russe, les aristocrates sortent vainqueurs. C’est eux, autour du tsar, qui plongent la Russie
dans la Première Guerre mondiale. Quand elle débuta en juin 1914, l’enthousiasme avec lequel
tant les revanchards, les centristes que les opportunistes s’engagèrent était soutenu par l’idée que
la guerre serait vite finie. Sauf que le conflit s’enlisa. La Russie qui n’avait pas su patienter pour
consolider son économie en paya le prix fort. Avec des équipements rudimentaires, sans capacités
tactiques améliorées depuis la défaite face au Japon en 1905, les révères de la guerre sont lourdes
pour la Russie entrée en action en août 1914 sur le front Est. C’est le pays qui bat le record des
pertes dans les rangs des troupes avec 1 700 000 morts et 5 950 000 blessés en quelques temps.
Bientôt des mutineries handicapent l’armée, le moral des soldats étant sapé par des officiers
aristocrates qui ne perdent pas la main en brimades et punitions corporelles.
Malmenée dans une guerre de laquelle l’aristocratie s’obstine à se retirer, la Russie, coupée
de l’Europe qui la ravitaille d’habitude, est terrassée par la famine. Alors que la colère du peuple
commence à monter, Raspoutine, controversé mais rejeton de la paysannerie, est assassiné le 16
décembre 1916. L’aristocratie avait cru pouvoir porter ainsi coup au réformisme en agissant ainsi.
Mais c’était le forfait de trop, de la part d’un système multiséculaire qui s’obstinait à survivre tout
en broyant son propre peuple. Ils ouvrirent la boîte aux pandores pour l’accomplissement d’une
« prophétie » articulée par Raspoutine avant sa mort à la couronne : « Je mourrai dans des
souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n’aura point de repos. Puis tu perdras ta
couronne. Toi et ton fils vous serez massacrés ainsi que toute la famille. Après, le déluge terrible
passera sur la Russie. Et elle tombera entre les mains du Diable ». Dans la suite des évènements,
ce personnage intriguant allait de toute façon être utilisé par les révolutionnaires, à l’œuvre depuis
les évènements de 1905, pour illustrer une fois de plus la déchéance et les contradictions du
tsarisme, résolument sourd aux revendications du peuple, inapte à œuvrer pour son
épanouissement et incapable de s’améliorer. Il était temps d’en finir.
Depuis plusieurs décennies un autre sibérien y pensait: Vladimir Ilitch Oulianov dit
Lénine (1870-1924). Engagé en politique en 1901 sous la casquette de révolutionnaire
communiste, il publie un livre en 1902, Que faire ?, où il défend l’idée selon laquelle pour
s’émanciper il faut aux prolétaires, lutter de manière organisée pour le renversement de la
bourgeoisie. Là où Marx ne voyait qu’une lutte des classes pour une dialectique de l’histoire,
Lénine pense à une organisation au sein d’un appareil, le parti, pour lutter et opposer la
« dictature du prolétariat » à celle de la bourgeoisie. Son camarade politique, Léon Trotsky,
craignant une déification du parti et de son chef suggéra de nuancer en n’écartant pas la nécessité
d’une révolution permanente, c’est-à-dire de la lutte pour un système qui ne remplace pas une
immuabilité par une autre. N’écoutant que sa souffrance, le peuple n’allait écouter que Lénine qui
publie L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme (1916/1917).
C’est ainsi qu’après l’assassinat de Raspoutine, l’année 1917 s’ouvre sur des grèves et des
contestations à partir du mois de février, dénonçant la guerre en cours, l’autocratie et le tsarisme.
Débordé, le tsar se rend compte assez tardivement que la douma a pris trop de pouvoir. Il la
dissout et nomme un comité provisoire pour l’assister. Cette solution ne résolvant aucun
problème, il abdique le 2 mars 1917. Sa famille et lui sont massacrés quelques temps après. Le
tsarisme qui pèse sur la Russie depuis des siècles est terminé. Après l’abdication de Nicolas II, un
HC 3521 – Conflits en Europe
21
gouvernement provisoire prend les rênes de l’Empire. C’est un mariage de raison entre les
anciens aristocrates écartés du pouvoir par Nicolas II qui forme la Douma d’État, qui compose
avec un premier soviet, comité du peuple (paysan, travailleur) basé à Petrograd. Mais c’est une
alliance instable, car les rivalités qui opposent ces deux corps ne contiennent pas les révoltes.
C’est au point où même les femmes prennent le devant des revendications, avec des
manifestations à Saint-Pétersbourg le 8 mars 1917 qui rassemblent environ 90 000 personnes. Il
en est ainsi pendant des mois. Pendant que la Grande guerre continue toujours de faire rage, les
nouveaux dirigeants n’accèdent pas par contre à la revendication qui consiste à désengager la
Russie sur le front de l’Est. Par ailleurs, la révolution perd de sa structuration car elle manque
d’encadrement. La Russie est « République la plus libre du monde », car le pays est en effet
traversé par un grand désordre culturel et politique. En outre, la classe prolétaire qui bataille
depuis une quinzaine d’années pour la justice socioéconomique commence à se diviser entre les
bolcheviks (majorité) menés par Lénine qui prône l’organisation d’un parti de cadres, formé de
révolutionnaires professionnels, et les mencheviks (minorité) qui, autour de Julius Martov,
défendent un parti de masse, où l’adhésion est ouverte au plus grand nombre. Devançant ces
derniers et pour une révolution structurée, Lénine et les bolcheviks lancent déclenche une nouvelle
révolution en octobre 1917. Renversant progressivement la tendance, c’est eux qui initient les
négociations de paix avec l’Allemagne pour sortir le pays du bourbier de la guerre dès décembre
1917. C’est ce qui aboutit au traité de Brest-Litovsk (mars 1918). Entre temps, portés à la victoire,
Lénine et ses partisans proclament la République socialiste fédérative soviétique de Russie
(RSFSR) le 23 janvier 1918. Sa capitale est établie à Moscou.
Le triomphe des bolcheviks ne garantit pourtant pas la stabilité en Russie. Les partisans de
l’ancien système tsariste s’organisent depuis novembre 1917 et veulent reprendre le pouvoir.
Considérant la signature de la paix avec l’Allemagne comme une façon de pactiser avec l’ennemi,
ils pensent pouvoir s’organiser à partir des territoires jadis soumis par le pouvoir tsariste et dont
la situation politique n’avait évolué, pour stopper le bolchevisme. Il s’agit des actuels territoires
d’Ukraine, de Géorgie, de Pologne, de Finlande, du Kazakhstan, de Biélorussie, d’Azerbaïdjan, de
Mongolie-Extérieure ainsi que les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). Ces pro-royalistes
sont épaulés par l’Armée Blanche, pour lutter contre Lénine et ses partisans qui créent l’Armée
Rouge. La guerre civile commence et déchire le Russie jusqu’en 1923. Les Bolcheviks, portés par le
« communisme guerre » décrochent plusieurs victoires au moment où le conflit se termine ;
notamment sur le sol russe, mais aussi en Ukraine, où l’Armée noire de Nestor Makhno se bat
doublement contre l’invasion austro-allemande après le traité de Brest-Litovsk et contre le
communisme centralisé de Lénine (Makhnovchtchina, 1918-1921). Les Bolcheviks triomphent
aussi en Géorgie (guerre soviéto-géorgienne de 15 février - 17 mars 1921, puis soulèvement
géorgien contre l’Union Soviétique en 1924), au Kazakhstan, en Arménie, en Azerbaïdjan, en
Biélorussie et en Mongolie-Extérieure où ils étendent leur idéologie. Ils perdent dans d’autres
territoires avec les interventions étrangères, notamment des démocraties occidentales auprès des
forces révolutionnaires anti-bolcheviks. Peu de temps après cette série de victoires et de défaites,
Lénine proclame l’Union des Républiques Socialiste et Soviétiques (URSS) le 30 décembre 1922.
L’idée est de créer autour de Moscou une fédération d’États solidaires autour du communisme
comme base idéologique. L’URSS existera jusqu’au 25 décembre 1991, au terme d’un parcours
historique, comme entité géopolitique qui aura travers bien de péripéties sous la houlette de
différents dirigeants.
Avec Lénine, malgré les différents idéologiques avec des figures comme Trotsky avec sa
« révolution permanente », l’URSS, sous la houlette du Parti, passe d’abord par une séquence
réformiste et légèrement libérale dans le cadre de la Nouvelle Politique Économique (NEP) mis
en œuvre dès mars 1921. L’idée était de redresser l’économie d’une Russie et des républiques
satellites, terrassés par la famine et lé guerre civile. Même si Lénine rend l’âme en 1924, Joseph
Staline poursuit jusqu’en 1928. En 1929 éclate en effet une crise économique aux conséquences
HC 3521 – Conflits en Europe
22
énormes. De sorte que dès la fin des années 1930, Moscou prend dans un premier temps le parti
d’un camp résolu à réenclencher la guerre, car on pense en Russie que les anciennes alliées de
l’Entente sont un obstacle à l’expansion du communisme.
II. Les guerres par procuration des démocraties d’Europe
occidentale : les conflits liés aux conséquences territoriales du
traité de Versailles et à l’anticommunisme
Profitant de la révolution et de la guerre civile qui fragilisent la Russie, les puissances
alliées, principalement la France et l’Angleterre, prétextèrent que la paix de Brest-Litovsk
présageait un retournement de veste ; situation dans laquelle, s’étant écartée de la Triple Entente,
elle pouvait raviver le panslavisme. Que le tsar fut vaincu signifiait que cela ne représenterait plus
une menace à leur hégémonie. Mais que Lénine et ses partisans restaurent la flamme du
patriotisme et entendent répandre leur idéologie représente pour eux une menace. Elles trouvent
alors le moyen de soutenir les forces qui s’opposaient aux Bolcheviks. C’est en cela qu’il faut
comprendre le sens des démembrements territoriaux, avec la dislocation de l’Empire d’Autriche-
Hongrie et des remembrements territoriaux avec la création des États comme la Pologne, etc.
Leur plan consiste aussi à soutenir en Pologne, jusque-là influencée par la Russie, les forces anti-
bolcheviks (guerre soviéto-polonaise, février 1919- mars 1921). Il consiste aussi à prendre part aux
guerres que conduisent des « nationalistes » contre le pouvoir de Moscou en Finlande (victoire de
la Garde blanche locale à l’issue de la guerre civile du 27 janvier au 15 mai 1918) et dans les pays
baltes dans le sillage des guerres d’indépendances : Estonie (28 novembre 1918-2 février 1920),
Lettonie (5 décembre 1918-11 août 1920) et en Lituanie (décembre 1918- novembre 1920).
Leurs stratégies donnent cependant naissance à une série d’États fragiles et instables dans
leurs ambitions en Europe de l’Est de conflits tandis qu’elles préservent leur hégémonie. C’est le
lieu de citer : le conflit frontalier entre la Géorgie et l’Arménie (13-31 décembre 1918) qui n’est
résolu qu’en 1921 ; la guerre polono-ukrainienne (novembre 1918 - juillet 1919) entre la Pologne,
qu’elles ont contribué à créer et l’Ukraine, passée sous influence soviétique, pour le contrôle de la
Galicie, après la dissolution de l’Autriche-Hongrie ; l’insurrection de Grande-Pologne (décembre
1918-1919) contre l’Allemagne qui perd la Posnanie et une partie de la Poméranie ; la guerre
polono-tchécoslovaque (23-30 janvier 1919), où pour avoir violé un accord, les Polonais se font
attaquer par les Tchécoslovaques qui s’emparent de Cieszyn, divisée, mais ré-envahit par la
Pologne en octobre 1938 – deux États créés par le Traité de Versailles ; la guerre polono-
lituanienne (août - octobre 1920), entre deux États issus du Traité de Versailles (Lituanie et
Pologne) au sujet de Vilnius, Suwałki et Augustów ; et les insurrections de Silésie, série de trois
soulèvements armés des Polonais, contre les autorités allemandes, de 1919 à 1921, et grâce
auxquelles dans le sillage des négociations encadrées par la SDN, la Pologne prive l’Allemagne de
la moitié de l’industrie sidérurgique et la plupart des mines de charbon de Haute-Silésie.
Il apparaît ainsi que la Pologne recrée après le Première Guerre mondiale avec l’aide des
démocraties d’Europe de l’Est dans le sillage des négociations de Versailles est un État
inconsistant et belliqueux qui entretient un climat avec ses différents voisins et fragilise l’Europe
centrale et le voisinage de la Russie. On retrouve ces mêmes démocraties tentant de contenir
l’avancée du communisme qui gagne du terrain avec les différentes internationales. Le conflit
hungaro-roumain (avril 1919- août 1919) est ainsi une guerre anticommuniste contre la
République des conseils de Hongrie par des antibolchéviques hongrois soutenues par les troupes
dépêchées par la Roumaine, la Tchécoslovaquie, la Serbie et la France, où un Parti Communiste a
pu s’initier. L’on peut aussi citer la révolte infructueuse des rebelles antisoviétiques (août -
septembre 1924) en Géorgie, sous influence de Moscou depuis 1921 ; ainsi que l’insurrection du
23 septembre 1923 qui ouvre une période de « terreur blanche » en Bulgarie.
HC 3521 – Conflits en Europe
23
Toutefois, on voit moins sur ces fronts la Grande-Bretagne sur ce front car, s’obstinant à
résoudre la situation des Irlandais, elle est aux prises contre l’Armée républicaine irlandaise (IRA)
qui a lancé une guerre d’indépendance en janvier 1919. Jusqu’en juillet 1921, les Irlandais
déterminés à obtenir leur liberté de la couronne britannique obtiennent le Traité anglo-irlandais
créant l’État libre d’Irlande. Entre le 28 juin 1922 et le 24 mai 1923, le jeune État passe cependant
par une civile avant de connaitre l’accalmie. En Europe du Sud-Est, l’Empire ottoman fragilisé
par la Grande Guerre et sous la coupe réglée des Jeunes Turcs qui ont endurci leur pouvoir
(comme l’indique le génocide arménien de 1915), l’on a aussi une guerre d’indépendances entre
1919-1923. Mehmet V et les Jeunes turcs perdent le pouvoir, l’Empire ottoman en décadence
diaprait. Mustafa Kemal devient le premier président de la République de Türkiye.
L’après-guerre n’est pour ainsi dire pas de tout repos pour les nations d’Europe,
départagées entre les tensions sociopolitiques intérieures d’une part et les conflits interétatiques
d’autre part. Elles sont généralement liées à la volonté des démocraties d’Europe de l’Ouest
(France et Grande-Bretagne) de consolider leur puissance, en imposant des sanctions territoriales,
militaires, économiques, aux uns (pays de l’Axe vaincus), en triant profit des ressources naturelles
des autres (colonies) et en soutenant des guerres pour fragiliser toute rivalité géopolitique
nouvelle (Europe de l’Est). Elles vont surfer sur une décennie de puissance, cherchant encore et
encore à s’enrichir et à devenir puissantes, jusqu’à ce que la spéculation boursière s’en mêle à
nouveau et en octobre 1929 se déclare une crise financière internationale. Comme le krach
boursier de 1873 à Vienne, elle plonge l’Europe dans une série de crises socioéconomiques et
idéologiques pendant une dizaine d’années. Cette fois-ci tout part des États-Unis.
III. La crise économique, duel idéologique démocratie versus
nationalismes et retour aux alliances belliqueuses (1929-1939)
Ayant pris pieds dans la géopolitique de l’Europe pendant la guerre de 1914-1918,
l’Amérique capitaliste s’abstient certes d’engagements politiques (le congrès américain ne ratifie
pas le Traité de Versailles pourtant négocié ardemment par Thomas W. Wilson). Mais cet
isolationnisme ne s’étend pas aux intérêts économiques, surtout auprès d’une Europe dévastée,
en reconstruction, où les investissements ne peuvent manquer. C’est ainsi que les USA jouent les
intermédiaires dans le dossier sensible et stratégique des sanctions économiques imposées aux
puissances de l’Axe, et particulièrement à l’Allemagne, avec le plan Dawes. En théorie, il s’agit de
créer des conditions qui « faciliteraient » le remboursement de la « dette ». Ainsi, tandis que les
années 1920 marquent une période de forte croissance aux États-Unis et dans certains pays
d’Europe, l’Allemagne polit quand-même sous les sanctions et passe par un krach qui secoue la
Bourse de Berlin le 13 mai 1927. À Wall Street qui a supplanté les autres places boursières dans le
monde, cela n’attire pourtant pas l’attention de grand monde. Or, les titres émis commencent à
couter plus cher que les profits des entreprises ; de sorte que dès 1928, une bulle spéculative se
propage. En Europe, pour s’assurer que l’Allemagne va malgré tout continuer de payer les
réparations, les USA conçoivent le plan Young en 1929 : les dettes diminuées et rééchelonnées
doivent être payées quand-même jusqu’en 1988. Mais la crise de surproduction, aux USA finit par
provoquer le krach boursier qui ébranle Wall Street les 24 (jeudi noir), 28 (lundi noir) et 29 (mardi
noir) octobre 1929. C’est le point de départ de la Crise économique des années 1930. Elle est dite
aussi Grande Dépression du fait qu’il s’agit de la plus importante dépression économique du XXe
siècle. Elle dure jusqu’à l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale ; et pour cause.
- Crise économique et montée des nationalismes
Cette crise s’accompagne en effet aux USA d’une forte déflation (baisse des prix) et d’une
explosion du chômage qui poussent les autorités vers des réformes des marchés financiers. Mais
HC 3521 – Conflits en Europe
24
tandis que l’Amérique se sauve avec le New Deal à partir de 1933, la situation en est autrement
compliquée dans le reste du monde. En Europe, les démocraties qui bâtissent depuis quelques
années une partie de leurs fortunes en tirant profit de l’affaissement des autres peuples s’adaptent
en effet avec nettement moins de succès. En France, il n’y a plus d’exportations à partir de 1931,
à la suite de la dévaluation de la Livre. Elle ne parvient pas à élaborer une politique constante et
se replie alors sur son empire colonial. Et comme à l’accoutumée, elle organisa une autre
exposition universelle en 1931 (33 490 000 visiteurs) ; mais les recettes n’allaient pas être
suffisante au regard des besoins. En négligeant comme partout ailleurs la demande
d’investissement public, la reprise économique est bloquée. À un moment l’heure devra venir de
s’armer pour se défendre, elle ne sera pas en mesure ; car l’effort de production militaire est tardif
et n’a qu’une importance marginale. Le cas de l’Angleterre est relativement similaire : Londres
tente sans succès de renchérir la convertibilité de la Livre qui finit par stagner. Sa politique
d’armement pour des besoins de protection ne reprendra que vers la fin des années 1930.
L’Allemagne que les deux martyrisait, où le peuple a continué de travailler dur malgré les
injustices, a pendant ce temps pris de l’avance. Dès le début de la Grande Dépression, le
Moratoire Hoover de 1931 et la conférence de Lausanne (1932) avaient entériné une suspension
du versement des réparations, et donc du plan Young de 1929, sous réserve d’un rétablissement
de la stabilité du système financier international. Dans une Allemagne où on n’estime n’avoir
jamais perdu la guerre ni l’avoir jamais déclenché, les autorités sur leurs garde depuis le krach du
13 mai 1927 tandis que le monde s’en passait, avaient engagé une politique publique
interventionniste avec des investissements massifs qui permettent de créer des infrastructures de
développement économique (autoroutes) et de garantir le plein emploi. Globalement donc, on
surfe sur une vague d’espérance et de condition de réarmement moral, que le Parti National-
Socialiste des Travailleurs Allemands (NSDAP) appelait déjà de tous ses vœux au lendemain de la
Grande Guerre. Avec pour doctrine le national-socialisme (Nationalsozialismus ou Nazi), c’est un
parti politique d’extrême droite fondé en en 1920 et dirigé par Adolf Hitler (Nazi). En 1923, dans
la brouille contestataire qui avait secoué l’Allemagne depuis novembre 1918, Hitler avait tenté de
conquérir sans succès le pouvoir par un coup d’État. Emprisonné, il prît la peine de consolider sa
vision pour l’Allemagne dans un livre Mein Kampf (mon combat), publié en 1925, où il défendait :
la supériorité de la race aryenne (soi-disant pour sa capacité à brave les défis existentiels et les
complots tant de l’intérieur que de l’extérieur), la création d’un espace vital (Lebensraum) pour
cette race et l’avènement l’Empire millénaire (Troisième Reich), qui assura probablement la paix à
l’Europe et au monde en neutralisant les ennemis du national-socialisme. Originaire de Vienne, la
capitale de l’Autriche-Hongrie démantelée, il avait, comme beaucoup d’autres Allemands, gardé
un souvenir amer du Traité de Versailles, des sanctions imposées à l’Allemagne et de l’accusation
qu’il trouvait injuste de dire que c’est elle était responsable du déclenchement de la guerre de
1914-1918. Il avait aussi finit par avoir horreur des Juifs disséminés en Europe, pour leur forte
présence dans le secteur de la finance. Ils détenaient les banques les plus importantes, sans doute
par lesquelles transitaient les frais de réparation. Ils allaient payer au prix de leur vie, innocent ou
pas. Hitler voulut leur s’acharna plus tard à les accabler dans les camps de concentrations où on
leur martelait : Arbeit macht Frei (le travail libère).
Maintenant que les démocraties d’Europe occidentale étaient affaiblies par la crise en
cours, il eut le vent poupe et pu monter au pouvoir le 10 janvier 1933, portée par une vague
d’hallucination collective comme il y en a chez tous les peuples qui rêvent de revanche. Et ce
peuple, le prenant pour le guide qu’il revendique (Führer), va le laisser faire. On brule les livres
jugés dangereux (10 mai 1933) ; et ceux qui s’interposent sont éliminés (nuit des longs couteaux,
29-30 juin 1934), ou devront plus tard s’exiler. Avec lui, non seulement l’Allemagne défait tous les
acquis obtenus par diverses manœuvres par les démocraties d’Europe occidentale. Contrairement
HC 3521 – Conflits en Europe
25
aux dispositions du Traité de Versailles, il décide de plus payer les réparations14 ; engage le pays
dans l’économie de guerre et augmente les effectifs de l’armée ; remilitarise la Rhénanie ;
revendique les Sudètes à la Tchécoslovaquie et la Poméranie à la Pologne, etc. Cette politique
donne à Hitler en quelques années d’aspirer à un rôle important dans la géopolitique de l’Europe
et d’en redistribuer les cartes.
L’Allemagne n’est pas seule à agir ainsi après la crise économique de 1929. Les Italiens
suivent partiellement ses pas. Leurs attentes territoriales sur l’Istrie et la Dalmatie n’ayant pas été
satisfait alors que c’est en raison de cela qu’ils avaient quitté l’Axe pour l’Entente en 1915, ils
estiment que leur victoire a été mutilée lors des négociations de Versailles. Se repliant sur eux-
mêmes et critiquant la monarchie en place, le fascisme au début des années 1920 autour de la
figure de Bénito Mussolini. Le fascisme (terme dérivé de faisceau) est un système politique
autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d’un idéal collectif
suprême. Mouvement d’extrême droite révolutionnaire, il s’oppose frontalement à la démocratie
parlementaire et au libéralisme traditionnel, et remet en cause l’individualisme codifié par la
pensée philosophique des Lumières. Sous la bannière du Parti National Fasciste fondé en 1921,
Mussolini prend le pouvoir en 1922. Il sera à la tête d’une dictature en Italie jusqu’au 25 juillet
1943. Entretemps, les fascistes avaient trouvé que la crise de 1929 était une occasion pour
réveiller leur irrédentisme et exalter un nationalisme virulent. Cela se traduit en partie par ses
aventures coloniales, avec notamment l’agression de l’Éthiopie en 1935.
L’histoire se répète donc dans une certaine mesure à l’exception des visages qui changent ;
car pour tester sa stature de puissance, c’est l’Empire ottoman fragilisé qu’elle attaqua en 1911.
On retrouve sensiblement en effet les mêmes schémas qui avaient poussé l’Europe dans un
premier mineur (190-1913), puis un premier cycle majeur (1914-1918) de conflits. À la différence
qu’en lieu et place de la révolution industrielle, c’est une culture de la paix, marquée pour la
première fois par l’avènement d’une organisation chargés d’apporter l’espérance de la stabilité à
toutes les nations du monde, semble plus servir les intérêts des puissants que des faibles
davantage dominés. Cette culture de la paix qui eut voulu que l’on oppresse les autres (presser le
citron jusqu’à ce que les pépins craquent), reposant encore sur vision conflictuelle des rapports
entre les peuples aboutit à la signature d’un traité de paix qui blessa davantage l’orgueil des
peuples et légitima la revanche. C’est de cette ambiance où certaines nations cherchent à
s’enrichir sur les souffrances des autres, que la charpente économique sur laquelle cette culture
biaisée de la paix repose s’expose aux crises dont la charnière est celle de 1929. Dans les parties
de l’Europe où la stabilité politique n’a toujours pas été acquise depuis la fin de la Grande guerre
pour des raisons liées en partie aux manœuvres des puissances d’Europe occidentale, elle renforça
et suscita des conflits armées. Il y a : la révolution asturienne (5-19 octobre 1934), insurrection
infructueuse des ouvriers d’Asturies qui voulaient abolir le système républicain au profit d’un
gouvernement socialiste en Espagne ; l’insurrection de février (12-16 février 1934) guerre civile
où socialistes et conservatrices-fascistes se déchirent en Autriche ; la révolution sociale puis la
guerre civile espagnole (1936-1939), au cours de laquelle des armes allemandes sont testés.
- Recul des démocraties et retour aux systèmes d’alliances belliqueuses
En ces temps d’incertitudes pour les démocraties et d’hardiesse pour les fascistes, le
réflexe des alliances belliqueuses refit surface. Cette fois-ci ce n’est pas pour contrer les
expansionnismes impérialistes, mais pour essayer mutuellement de consolider les positions de
leadership et neutraliser les autres nations. Après un temps où les démocraties occidentales
avaient voulu préserver leur hégémonie, l’on bascula au début des années trente dans une série de
14 L’Allemagne traînera sa dette jusqu’au 3 octobre 2010, date à laquelle elle la soldera définitivement, près d’un siècle
après le début du conflit.
HC 3521 – Conflits en Europe
26
traités où elles voulurent négocier les rapports de forces avec les systèmes fascistes qu’elles
avaient lésé et qui montaient en puissance. Vers la fin de la décennie, elles allaient farfouiller des
alliances éphémères contre les fascismes, constitués en alliance de guerre, et menaient la danse
dans la géopolitique européenne, et qui passèrent à l’acte en 1939. D’abord donc les alliances
destinées à maintenir des démocraties occidentales, qui s’enchaînent après le Traité de Versailles
(1919-1924 ou « années de crispation »), marqué notamment en janvier 1923 par l’extraction
forcée du charbon ordonnée par Raymond Poincaré dans la Ruhr. Nous avons : le traité de
Trianon (4 juin 1920) qui consacre la dislocation l’empire d’Autriche-Hongrie pour en faire deux
États faibles; le traité de Sèvres (10 août 1920) entre l’Empire ottoman et les alliés ; le traité de
Paris (28 octobre 1920) rattachant la Bessarabie à la Roumanie ; le traité de Paris (février 1921)
qui consacre l’alliance franco-polonaise qui encourage la Pologne à se lancer imprudemment dans
des guerres en Europe de l’Est car croyant pouvoir compter sur l’une puissance victorieuse de la
Grande Guerre comme indiqué plus haut; la Petite Entente (23 mai 1921), alliance diplomatique
et militaire conclue entre la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et la Roumanie sous les auspices de
la France, contre la Hongrie de Miklós Horthy qui conteste le traité de Trianon.
De leur côté, les nations vaincues ou qui avaient été laissés par le traité de Versailles se
contentèrent de passer des alliances diplomatiques susceptibles de leur permettre de contenir
leurs positions de faiblesse. D’abord la Turquie. Mehmet V et les Jeunes-Turcs, après le génocide
arménien, avaient fini par devenir impopulaires car non seulement une époque assez obscure,
connue au temps précédents avec Abdlülmecid II semblait refaire surface, mais également,
l’Empire avait perdu la Grande Guerre. Puis, le traité de Serves enlevait au pays les quatre
cinquièmes de ses anciens territoires. Contre le système, des tensions avaient débuté l’année
précédente autour de la figure de Mustapha Kemal. Elles allaient s’amplifier avec le rejet du traité
de Sèvres, que Mehmet VI, le successeur de Mehmet V depuis 1918, avait signé et qui s’appuyait
sur la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, et des contingents grecs et arméniens pour lutter
contre Kemal qui estima que le pays était en réalité envahit avec la complicité du régime. Avec
l’aide des pays socialistes menés par la Russie, il triompha de la campagne de Sicile (1918-1921),
tentative d’invasion alliée sous la houlette de la France au lendemain de la Grande guerre ; mais
aussi de la guerre d’indépendance turque et gréco-turque (1919-1922). Tous ces conflits se
soldent par : la déposition de Mehmed VI, dernier sultan ottoman, le 1er novembre 1922 et du
gouvernement des Jeunes-Turcs d’une part, et d’autre part le traité de Lausanne (24 juillet 1923)
qui révise le traité de Serves et la proclamation de la République de Turquie (29 octobre 1923).
Sur d’autres fronts, pour tenter de stabiliser son patrimoine territorial, la Turquie avait signé les
traités d’Alexandroúpolis (2 décembre 1920) et de Moscou avec l’Arménie pour délimiter leurs
frontières, et le traité de Kars (13 octobre 1921) avec la Russie sur la Transcaucasie. Ayant
finalement triomphé de la révolution et réussi à maintenir leur pouvoir sur certains territoires
jadis sous influence de la Russie, et qui tentèrent de se dérober durant la guerre civile, le régime
bolchevik pour sa part avait signé avec la Pologne le traité de Riga (18 mars 1921) pour mettre un
terme à la guerre qui les opposait. Avec les autres territoires où le régime avait étendu son régime,
le traité de formation de l’URSS fut signé le 30 décembre 192215. L’Italie, un autre pays lésé par le
traité de Versailles, s’était aussi rapproché de la Yougoslavie nouvellement crée pour signer le
traité de Rapallo (12 novembre 1920) pour stabiliser leurs frontières.
En cette fin du premier quinquennat qui suivait la Paix de Versailles, la résilience et la
résignation avec lesquelles ces deux derniers pays ainsi que les pays vaincus avaient repris le cours
de leurs vies frisait une sérénité qui inquiétait. Le réarment moral accéléré, avec la montée des
fascismes en Allemagne et en Italie était tout de même angoissante pour les démocraties
d’Europe occidentale. Cela parût ainsi, surtout à la France, secouée par des crises politiques
15 Cette « première » URSS rassemble la RSFSR, la Biélorussie (RSSB), l’Ukraine (RSSU) et la Transcaucasie (RSFST ;
Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie). L’URSS va s’élargir dans la suite de l’histoire.
HC 3521 – Conflits en Europe
27
internes et plus ou moins lâchée par les USA isolationnistes et la Grande-Bretagne (préoccupée
par la question irlandaise). Alors que ses engagements militaires et diplomatiques en Europe
centrale, de l’Est et dans les Balkans s’étaient soldés par des échecs et que les dépenses y relatives
étaient des manques à gagner, Aristide Briand sentit que la France ne parvenait pas à être à la
grandeur de ses ambitions et que les rapports de force allaient se désagréger davantage en sa
défaveur. Il voulut alors créer des conditions qui permettraient de faire baisser les tensions en
Europe. Ce fut l’objet des accords de Locarno passés octobre 1926 entre l’Allemagne et les Alliés
pour poser les principes de garantie, d’interdiction d’utiliser la guerre comme moyen de règlement
des conflits et de l’arbitrage obligatoire pour les différends qui pourraient survenir. La subtilité de
ces négociations est que la France désirait rassemblement se protéger d’une Allemagne à nouveau
animée par le fière du pangermanisme, inoculé à la population par le parti nazi. Tout avait
commencé autrefois par le chauvinisme bismarckien avait fini par la défaite de Sedan (1871) et
l’annexion de l’Alsace-Lorraine. À Locarno, l’on fixa une limite entre la France et l’Allemagne,
que cette dernière ne devait franchir en aucun cas. Briand et Gustav Stresemann, le ministre des
Affaires étrangères qui avait engagé l’Allemagne, furent colauréats du Prix Nobel de la Paix
l’année suivante (1926). Pour 3 ans encore, Briand s’active à décanter les tensions dans une
Europe traversée de plus en plus le revanchisme fasciste. En 1928, il articulait un projet de de
paix par la sécurité collective dont la SDN serait garante. Il put alors, et parvint à obtenir de
Frank Billings Kellogg, le Secrétaire d’État américain la signature du pacte Briand-Kellogg (27
août 1927) visant à « mettre la guerre hors-la-loi ». Toutes ses manœuvres allaient être ruinées par
la mort tour de Kellogg (28 mars 1929) et de Stresemann (3 octobre 1929), car Briand perdait des
alliés qui pouvaient apporter des garanties à ses initiatives. Le krach boursier leur apporta un coup
de grâce ; car il priva les démocraties d’Europe occidentale des moyens de leur politique.
Habitués aux crises depuis 1919, les pays fascistes et ceux qui furent lésés par le traité de
Versailles trouvèrent que le moment était venu de renverser la vapeur et de laver l’affront que ces
dernières leur avaient fait subir. En Allemagne notamment, on était reparti, comme jadis avec
Guillaume II qu’Hitler cita souvent en référence, pour une diplomatie provocatrice appuyée par
une économie militaire. Jouant au dilatoire, Hitler avait trompé la vigilance des démocraties
occidentales en laissant croire qu’il n’avait pas d’intention belliqueuses. C’est ainsi que le 26
janvier 1934, un an après sa montée au pouvoir, il signa avec la Pologne, la protégée de la France,
un Pacte de non-agression. Moscou, où Joseph Staline avait pris le pouvoir fit pareil : le traité
franco-soviétique d’assistance mutuelle du 2 mai 1935 consacrait une alliance franco-soviétique.
On enchaina dans cet élan avec une Allemagne qui voulut montrer un visant souriant au monde
en accueillant à Berlin les Jeux olympiques du 2 au 16 août 1936. Hitler avec ses « dieux du
stades » envoyait pourtant un signal qui indiquait que sa vision de la race aryenne était toujours
intacte. Mais nul ne s’en soucia tant que l’on crut que c’était juste un esprit de compétition
poussé, à prendre au fair play. Or, dans cette ambiance bonne enfant qu’Hitler et Mussolini
s’étaient subtilement rapprochés, créant l’Axe Berlin-Rome le 1er novembre 1936. Ce duo fasciste
testa ses armes dans la guerre civile d’Espagne (17 juillet 1936 - 1er avril 1939), au profit des
nationalistes menés par Francisco Franco, aussi fasciste, ou plus littéralement, dictateur.
Mais pour les démocraties d’Europe de l’Ouest, secouées par la Grande Dépression, tous
ces incidents étaient déjà bien limités dans l’espace ; et globalement on surfait une vague de
sérénité car l’on croyait avoir perdu la paix quand il ne resta plus que Briand après le pacte
Briand-Kellogg. Berlin et Moscou que Paris craignait semblaient avoir entendu « raison » ; surtout
que le 25 novembre 1936 l’Allemagne avait signé un Pacte Anti-Kominterm avec la Japon, en
pleine expansion et qui avait annexé la Mandchourie à la Chine, membre de la SDN, sans être
iniquité. Le Pacte est rejoint par l’Italie en mai 1937, esquissant l’Axe Berlin-Rome-Tokyo. Par
complaisance, le Pacte devant limiter l’expansion de leur adversaire géopolitique de toujours, la
Russie, les d’Europe de l’Ouest laissèrent les fascistes faire. Leurs inquiétudes s’étaient d’autant
plus calmées que dans les Balkans, la Turquie n’était plus une menace. Depuis sa prise de
HC 3521 – Conflits en Europe
28
pouvoir, Mustapha Kemal Atatürk avait engagé le pays sur la voie de vastes réformes, en rupture
avec l’Empire ottoman, afin d’occidentaliser le mode de vie : démocratie, laïcité, éducation libre et
gratuite, développement des sciences. Le kémalisme rassurait, d’autant plus qu’avec l’Afghanistan,
l’Iran et l’Irak, la Turquie signe un pacte de non-agression (traité de Sa’dabad) le 9 juillet 1937. Ce
traité fut mis à profit pour lutter contre les soulèvements kurdes ; mais cela n’inquiéta personne
en Europe de l’Ouest. On se dît certainement que si les régimes longtemps redoutés se limitaient
au massacre de quelques « minorités », c’était le « prix » à payer. Hitler allait jouer là-dessus.
L’année suivante, le Führer se dît en effet que ce genre de concession représentait le
créneau par lequel il allait enfin déployer la vision du pangermaniste qui l’habite depuis vingt ans,
dans ses volets consistant notamment à créer un espace vital pour les Allemands tout en leur
donnant de quoi survivre. Pour ce qui est regroupement, il annexe ainsi l’Autriche le 12 mars
1938 (Anschluss). Ignoré par les démocraties, Kurt Schuschnigg, le Chancelier se bat en vain pour
l’autonomie de cet État pourtant né du traité de Versailles. C’est quand Hitler s’en prend à un
membre de la Petite Entente, la Tchécoslovaquie, en revendiquant les Sudètes, populations
allemandes vivant à l’Ouest de ce territoire, donc à la frontière allemande, que les démocraties se
réveillent. S’offusquant, Hitler les fait marcher en les assurant que ce dernier problème résolu,
l’Allemagne aura atteint tous ses objectifs territoriaux en Europe et ses frontières seront
définitives. C’est alors que « l’Europe connaîtra ensuite la paix pour mille ans » martèle-t-il. C’est
ainsi que les 29-30 septembre 1938, dans le cadre de l’accord de Munich, Édouard Daladier au
nom de la France et Neville Chamberlain au nom de l’Angleterre, concèdent à Hitler et à
l’Allemagne d’annexer les Sudètes et leur territoire. Tout se passe en présence de Mussolini, allié à
Hitler depuis 1936, et qui avait annexé l’Éthiopie en 1935, membre de la SDN, sans la moindre
protestation des démocraties, ni surtout de la France qui au temps de Briand comptait en faire de
la SDN le bouclier de la paix dans le monde. En réalité, comme quelques décennies à la veille de
la Première Guerre mondiale, Hitler avait refait de la guerre le pivot central de sa politique
étrangère. Ayant remilitarisé l’Allemagne, c’est un prétexte d’attaque qu’Hitler cherche pour se
lancer dans la guerre. Mais en interdisant à la Tchécoslovaquie de se défendre contre l’annexion
des Sudètes, Chamberlain retarde l’échéance. Le Premier ministre britannique parade alors à son
retour clamant avoir « sauvé la paix pour notre temps ».
N’empêche, c’est un recul de plus pour les démocraties contre une victoire de plus pour la
culture politique faisant l’apologie de la guerre. Comme rien ne semblait l’arrêter, Hitler trouva de
toute façon qu’il avait finalement libre cours pour parachever sa vision pangermaniste. C’est ainsi
qu’il annexe la moitié de la Tchécoslovaquie, créant le Protectorat de Bohême-Moravie en mars
1939 et s’empare de Memel en Lituanie. Il se retourne aussi contre la Pologne avec laquelle il a
signé un pacte de non-agression quelques années plus tôt, en lui revendiquant le corridor vital de
Dantzig (Gdańsk) qui sépare la Prusse orientale du reste de l’Allemagne. La Pologne, routinière
de la guerre depuis le début de l’entre-deux-guerres, rejette les revendications allemandes en
arguant que Dantzig est son seul accès à la mer. On se retrouve dans un schéma assez similaire
d’avant Grande guerre car la Pologne, comme les pays de la Ligue balkanique jadis, est
encouragée par la convention Kasprzycki-Gamelin du 19 mai 1939 qui institue une aide militaire
entre elle et la France en cas de guerre avec l’Allemagne nazie. La réplique de l’Allemagne, trois
jours après (22 mai 1939), est la signature du Pacte d’Acier avec l’Italie, une alliance militaire
offensive, comportant des garanties d’assistance automatique au cas où un pays comme l’autre est
attaqué, indépendamment de l’ennemi.
Déterminé pour l’Allemagne, n’ayant probablement par peur d’affronter la France et ses
alliées toujours tenues en lest par la crise économique, Hitler craignait toutefois devoir de battre
sur deux fronts. Il savait également que sur la Pologne sur qui elle maintenait sa revendication,
Moscou avait des intérêts. C’est ainsi qu’est signé le 23 août 1939 le Pacte de non-agression
Ribbentrop-Molotov entre l’Allemagne et l’URSS. Il délimite les sphères d’influence des deux
pays en Scandinavie, pays baltes, Pologne, Roumanie, Finlande. Il prévoit un partage éventuel de
HC 3521 – Conflits en Europe
29
la Pologne à l’Ouest de la ligne Curzon, si réorganisation territoriale il devait y avoir plus tard. Il
établit également la collaboration entre les milices politiques des deux pays (Gestapo et NKVD).
Moscou fit ainsi, estimant que la France et l’Anglerez avaient déçue l’alliance d’autre fois par leurs
agissements contre le communisme. Sachant qu’Hitler n’aimait guère non plus le communisme,
ce traité ne fut pour Moscou, au-delà des regains territoriaux perdus et les intérêts économiques
que l’occasion de préparer à guerre que Staline présentait inévitable. Et en effet, Hitler retira ses
troupes de l’Est pour les concentrer à l’Ouest de l’Allemagne. Mais pendant que se poursuivait ce
vaste mouvement des troupes vers l’Ouest de l’Europe, Hitler avait envahi la Pologne sans
déclaration de guerre le 1er septembre 1939. C’était le début de la Seconde Guerre mondiale.
IV. La Deuxième Guerre mondiale et ses conséquences (1939-1945)
À la différence de l’état d’esprit qui prévalait en juillet-août 1914, l’on sentait qu’Hitler
avait poussé à nouveau l’Europe au bord d’un destin tragique. Cela faisait moins d’une génération
que l’on venait de vivre l’expérience traumatisante de la Grande guerre ; et on voulait
rassemblement plus se montrer enthousiaste face à la guerre. Sauf que les dirigeants de l’Europe,
surtout ceux qui avaient décroché une victoire bricolée en novembre 1918 n’avaient rien fait, ou
firent peu, pour qu’on en arrive là à peine vingt ans après. Le Traité de Versailles que l’on passa
pour celui de la paix avait causé des frustrations, légitimé l’oppression de certains peuples, et
nourri le revanchisme. La crise économique de 1929 et la Grande Dépression face auxquelles les
démocraties ne parvinrent ne pas s’en sortir exacerba les tensions sociales, créant un contexte
favorable aux populismes, aux nationalismes dans leurs variantes fascistes, ainsi qu’à des conflits
qui servirent de galops d’essai de nouveaux armements. La remilitarisation, la complaisance des
démocraties face aux annexions d’Hitler et les reconstitutions des alliances belliqueuses sont
autant de causes qui, mises en ensemble conduisirent à la Seconde Guerre mondiale dont la cause
« immédiate » est l’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939. Suivant les termes du Pacte de
non-agression signée quelques mois plus tôt, l’URSS envahi le reste du pays le 17 septembre
1939. La Pologne recrée en 1918 disparait pour la troisième fois de son histoire. L’ordre instauré
depuis Versailles est attaqué. Un second conflit majeur qui va secouer l’Europe et plus tard le
monde vient de commencer. Elle ses particularités.
C’est une guerre de nouvelle génération, tel qu’on en voit dans l’histoire du monde depuis
l’époque. Contrairement aux temps reculés les ultimatums et autres amassements des troupes
présageaient la guerre, la guerre de 1939 inaugure le cycle des conflits qui naissent sur la base
d’événements sans importance apparente. Entre les pics de nazismes et la gueule d’ange que
faisait Hitler depuis 1934, on ne savait pas comment prendre ce qui était en marche. Ainsi quand
bien même pour honorer la convention du 19 mai 1939 les démocraties d’Europe de l’Ouest
déclarèrent la guerre à l’Allemagne, on était resté sceptique en Europe de l’Ouest. Hitler n’allait
pas refaire ça à l’Europe, une guerre totale comme en 1914-1918, pensait-on probablement. Alors
on avait déclaré la guerre, mais il n’y avait pas de mouvements de troupes. C’est la drôle de
guerre : les troupes franco-britanniques, sous commandement français, ne prennent aucune
initiative militaire et ne mènent aucune opération offensive pendant plusieurs mois, restant
retranchées derrière la ligne Maginot. Les Allemands, intrigués, ne comprenant pas pourquoi les
démocraties qui se gargarisaient tant de leur hégémonie ne se battaient pas, l’appelèrent la
« guerre assise » (Sitzkrieg).
C’est une guerre aussi qui confirme le vieux fond de toutes les stratégies de guerre réussi :
le principe de la surprise. En fait, Hitler était sérieux. Le pangermanisme dont il parlait avec tant
de rage depuis le diktat des alliées après le traité de Versailles n’était pas un vain mot. Il comptait
refaire la guerre et laver l’honneur d’une Allemagne où l’on n’avait toujours pas accepté qu’on
avait perdu en 1918, et où on tolérait encore moins que l’on accusât et punît le pays pour l’avoir
HC 3521 – Conflits en Europe
30
déclenché. Alors que l’Europe traverse un moment de doute depuis septembre 1939, vient alors
la bavure tactique qui donne à Hitler la possibilité d’avancer dans la mise en œuvre de son plan
pangermaniste. Au printemps 1940, les Alliés se préparent à couper l’approvisionnement en fer
de l’Allemagne, qui transite de la Suède vers le Reich par la Norvège. L’opération tourne au
fiasco. À cause de l’incident de Narvik, l’Allemagne envahit alors le Danemark et la Norvège le 9
avril 1940. Cela coûte à Chamberlain son poste au profit de Winston Churchill. Pendant ce temps
Hitler continue de surprendre l’Europe : en mai-juin 1940, l’armée allemande (Wehrmacht) mène à
bien l’invasion foudroyante des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique et de la France. C’est la
guerre éclair ou Blitzkrieg. Le retard militaire accusé depuis la crise de 1929 rattrape les
démocraties. Toutes leurs initiatives se soldent par des défaites. Du 27 mai au 3 juin 1940, le
Royaume-Uni doit sauver les hommes qui lui restent. Le rapatriement de Dunkerque (300 000
soldats) est la plus vaste opération du genre de l’histoire militaire. L’Italie, s’étant joint à
l’Allemagne, déclare la guerre à la France le 10 juin. Le gouvernement Pétain demande l’armistice
le 17 et en accepte les conditions le 22. Après l’armistice franco-italien qui suit, le 24, les combats
cessent le 25 juin. L’armée française, qui s’est gargarisée d’être la meilleure du monde depuis 1918
s’est effondrée en quelques semaines. S’en suit le déploiement de l’opération « lion de mer » et la
bataille d’Angleterre. Les Britanniques résistent, sauvés par leur maitrise des eaux et la Royal Air
Force. Toutefois, ils ne peuvent survivre longtemps, l’aide qu’ils trouvent est un prêt-bail voté par
le Congrès des USA toujours intéressés par les affaires. Cette « loi Prêt-Bail » de mars 1941, qui
lui permet d’apporter une « aide » matérielle illimitée au Royaume-Uni et à ses alliés.
La Seconde Guerre mondiale est donc par ailleurs une guerre de territoires. L’Allemagne a
réussi à étendre son influence en Europe de l’Ouest et du Nord. L’Italie son alliée veut quant à
elle dominer le monde méditerranéen. En septembre 1940, les forces italiennes s’engagent en
Afrique du Nord. Le duce aura oublié qu’il n’est à l’origine qu’un journaliste ; car ses initiatives
n’ont qu’un succès mitigé. Non seulement l’Italie n’avance pas en Afrique du Nord, mais il se
lance dans les Balkans et essuie une cuisante défaite contre les Grecs. Au fond, à part quelques
escarmouches çà et là, les yeux de l’Italie auront été plus grands que son ventre, et elle sera une
sorte boulet pour l’Axe. Durant toute la guerre elle sera toujours en train de se faire renforcer par
la Wehrmacht ; que ce soit en Afrique du Nord (Afrika Korp) que dans les Balkans. Cela coûtera à
Mussolini et au fascisme d’être vomi par les Italiens en 1943. Dans l’Axe, hors mis l’Allemagne,
c’est le Japon aura réussi à mener la barre aussi bien en Asie mineure, en Extrême Orient que
dans le Pacifique. Alors que la guerre et l’occupation sont en cette année 1941 déjà le quotidien
de l’Europe de l’Ouest, de l’Asie orientale, de l’Océanie et de l’Afrique (ralliée après les initiatives
de la France libre qui s’installe à Brazzaville, en AEF, et rallie l’AOF), deux actes posés par ces
porte-étendards de l’Axe totalisent le conflit en impliquant l’Europe de l’Est et les Amériques.
Vexé par l’échec de l’opération Lion de mer –car ternit l’invulnérabilité de la race
aryenne–, Hitler pense pouvoir confirmer le bienfondé de sa doctrine en envahissant les slaves et
en éliminant le communisme. Il lance l’opération Barberousse en juin 1941, contre l’avis mitigé de
son état-major. L’impressionnante armada allemande se noie dans la tactique de la terre brûlée de
Staline qui après une retraite générale vers l’Est, lance l’Armée rouge sur les trousses la Wehrmacht
fatiguée et sans ressources. L’échec est cuisant et on commence à douter légèrement d’Hitler qui
doit faire face et échapper à un attentat contre sa vie. Dans les trois années qui suivent, c’est-à-
dire jusqu’à la défaite en mai 1945, il n’est plus aussi imperturbable qu’il l’était dans les décennies
précédentes. Il se retranche souvent dans ses bunkers ou passe du bon temps dans son Nid
d’aigle (Berg Hof) dans les hauteurs d’Obersalzberg. C’est de ces lieux, coupés des réalités du
terrain qu’il continue à intimer des ordres. Il fait bientôt enrôler des enfants dans l’armée
(jeunesse hitlérienne). Dans le Pacifique, la tendance est aussi à l’expansion vers l’Est. C’est ainsi
que lors d’une de ses manœuvres aériennes, le Japon bombarde la base navale de Pearl Harbour
le 2 décembre 1941. En cette fin d’année 1941, c’est cet acte précipite les USA, qui continuaient
jusque-là de se lécher les doigts avec la loi du prêt-bail, à entrer en guerre. Il a fallu qu’ils soient
HC 3521 – Conflits en Europe
31
affectés, car en l’espace d’un mois, Washington réunit la France, la Grande-Bretagne et la Russie
au sein des Nations unies, l’alliance militaire fondée le 2 janvier 1942 pour combattre les pays de
l’Axe. Contrairement à ces derniers, les Alliés auront l’avantage du nombre puisque qu’à leurs
côtés se dressent les empires coloniaux, le Canada, la Chine et des pays de l’Amérique centrale et
latine qu’Hitler avait voulu rallier à son camp –comme Guillaume II en 1917–. Mais le nombre ne
suffira pas. Pour s’être militarisé depuis une décennie, c’est au prix de ripostes bien nourries que
les pays de l’Axe abandonnent progressivement leurs positions. Tout s’est d’ailleurs centré autour
de l’Allemagne nazie depuis la fin du fascisme et le ralliement du camp allié par l’Italie en 1943.
Après une série d’opérations en 1944, dont le débarquement de Normandie (juin 1944) qui
permet de libérer la France, l’Axe recule. Hitler se donne la mort avec sa famille en avril 1944 et
l’Allemagne capitule le 8 mai 1945. Dans un dernier sursaut d’orgueil le Japon s’emballe dans des
missions suicides (attentats kamikazes). Les frappes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en
septembre 1945 force la capitulation du Japon. La Seconde Guerre mondiale est terminée.
Les 45 ans premières années du XXe siècle européen se ferment ainsi si un sombre
panorama, alors qu’au siècle précédent elle était au sommet de ses capacités et allait à la conquête
du monde. La Seconde Guerre mondiale est un cycle de conflit de plus et de trop, dans son
histoire contemporaine. Elle a en effet plusieurs conséquences : les pertes en vies humaines
(50.000.000 de morts environ) ; les destructions matérielles et des infrastructures économiques.
Sur le plan culturel, l’Europe perd son prestige. Elle qui prétendait civiliser le monde vient de
prouver elle-même qu’elle est inapte à la moralisation, incapable qu’elle aura été produire et de
pérenniser une civilisation de la paix, de la convivialité, de l’acceptation de la différence et de sens
d’équité et de justice. Dans son côté totalitaire et génocidaire (extermination des Tsiganes,
holocauste juif), l’Europe fait preuve d’un atavisme qui plonge dans les instincts politiques les
plus primaires. Par ailleurs, se faire aider par les peuples qu’elle considérait comme des sous-
hommes ridiculise l’argumentaire impérialiste et colonial sur lequel reposait une partie de sa
domination à travers le monde jusqu’aux années 1920. Associé à la dégradation du mythe de
l’invincibilité aryenne et du Blanc tout court, c’est le point de départ de la décolonisation qui à
l’orée des années 1960 prive l’Europe de ses principales sphères d’influence dans le monde. Ces
conséquences mises en bout en bout, l’Europe n’est plus un modèle ni une référence, tant du
point de vue économique, politique que culturel. Elle est en déclin ; elle est décadente. Elle aura
réussi à être un continent hégémon, l’un des rares que l’humanité ait connue après l’Égypte ancienne.
Mais à cause d’une production permanente des sources de conflits depuis le temps de la
révolution industrielle, le continent s’emballe durant 45 ans dans des conflits qui lui font sombrer
dans la décadence. À la fin de la Seconde guerre mondiale, l’Europe perd en effet en effet son
leadership. Elle ne l’a pas toujours retrouvé. Et les moments de doute qu’elle traverse depuis lors
ne l’épargnent pas non plus de conflits de repères.
HC 3521 – Conflits en Europe
Vous aimerez peut-être aussi
- Géopolitique Et Géoéconomie Du Monde Contemporain 2021Document534 pagesGéopolitique Et Géoéconomie Du Monde Contemporain 2021Abdelhamid Karraky100% (3)
- La Géopolitique Pour Les Nuls EpDocument453 pagesLa Géopolitique Pour Les Nuls Epben larPas encore d'évaluation
- Une Breve Histoire Culturelle D - Emmanuelle LoyerDocument401 pagesUne Breve Histoire Culturelle D - Emmanuelle Loyerbruno100% (2)
- Histoire Du XXe SiècleDocument200 pagesHistoire Du XXe SiècleRamonTRD100% (1)
- Synarchie FinanciereDocument28 pagesSynarchie FinancierelulilaloPas encore d'évaluation
- Livre Innovation Organisationnelle Et Transformation Manageriale Par Le Design ThinkingDocument140 pagesLivre Innovation Organisationnelle Et Transformation Manageriale Par Le Design Thinkingمحمد فهمي100% (1)
- Maurice Vaïsse - Les Relations Internationales Depuis 1945 - 14e édition-ARMAND COLIN (2015) PDFDocument337 pagesMaurice Vaïsse - Les Relations Internationales Depuis 1945 - 14e édition-ARMAND COLIN (2015) PDFZsófi KabaiPas encore d'évaluation
- La Religion Des Anciens BabyloniensDocument68 pagesLa Religion Des Anciens Babyloniensninzu0% (1)
- Dominique Sarciaux Histoire Du XXe SiècDocument14 pagesDominique Sarciaux Histoire Du XXe SiècferkesPas encore d'évaluation
- (Collection U) Maurice Vaïsse - Les Relations Internationales Depuis 1945-Armand Colin (2008)Document292 pages(Collection U) Maurice Vaïsse - Les Relations Internationales Depuis 1945-Armand Colin (2008)MOHAMED100% (1)
- Série JavaScript Correction 4SI TICDocument5 pagesSérie JavaScript Correction 4SI TICMoncef Computer83% (6)
- Le Siecle de 1914Document456 pagesLe Siecle de 1914Chevalier Du Christ TemplierPas encore d'évaluation
- 21 Logistiques Du Commerce InternationalDocument39 pages21 Logistiques Du Commerce InternationallionsafoinePas encore d'évaluation
- Psychologie CoursDocument27 pagesPsychologie Coursqzm74l100% (1)
- UntitledDocument1 029 pagesUntitledQuemener Nicolas100% (1)
- Fascicule Géo TLeDocument53 pagesFascicule Géo TLeAlioune Badara ThiombanePas encore d'évaluation
- Les Discours de L'histoire by The Greate LibararyDocument205 pagesLes Discours de L'histoire by The Greate LibararyMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- François Chaubet-La Mondialisation Culturelle-JerichoDocument117 pagesFrançois Chaubet-La Mondialisation Culturelle-JerichoYoussef El HabachiPas encore d'évaluation
- Les Evangiles SynoptiquesDocument3 pagesLes Evangiles SynoptiquesShon TettegahPas encore d'évaluation
- Barbara Godard - TraducciónDocument1 pageBarbara Godard - TraducciónIván Villanueva Jordán100% (1)
- rajomaZafimbolaJM ESPA LC 12Document77 pagesrajomaZafimbolaJM ESPA LC 12Malcolm EmilePas encore d'évaluation
- UntitledDocument115 pagesUntitledYoro KaborePas encore d'évaluation
- Histo Tle - Livre Du ProfesseurDocument160 pagesHisto Tle - Livre Du ProfesseurDave Dave100% (2)
- Rodolphe Prager, Les Congrès de La IVe Internationale. Tome 4. Menace de La Troisième Guerre Mondiale Et Tournant Politique, 1950-1952Document506 pagesRodolphe Prager, Les Congrès de La IVe Internationale. Tome 4. Menace de La Troisième Guerre Mondiale Et Tournant Politique, 1950-1952danielgaid100% (1)
- Chapitre 7. Les Systèmes Internationaux Au Xxe Siècle - Cairn - InfoDocument28 pagesChapitre 7. Les Systèmes Internationaux Au Xxe Siècle - Cairn - InfoCarolina Amaral de AguiarPas encore d'évaluation
- Comprendre La GuerreDocument8 pagesComprendre La GuerreayoubPas encore d'évaluation
- Géopolitique de L Union EuropeDocument5 pagesGéopolitique de L Union EuropeAchraf AsriPas encore d'évaluation
- Brochure HistoireDocument6 pagesBrochure HistoireAbdoulaye SOUMAHPas encore d'évaluation
- HISTOIREDocument1 pageHISTOIREAmandine ChabrierPas encore d'évaluation
- Exo Histoire 04 L1 2023Document1 pageExo Histoire 04 L1 2023Adama NdiayePas encore d'évaluation
- L'histoire Culturelle de L'europe: Un Point de Vue TransnationalDocument27 pagesL'histoire Culturelle de L'europe: Un Point de Vue TransnationalmbasquesPas encore d'évaluation
- Litterature Trucs S1 Modifiés Ac ChatGPTDocument14 pagesLitterature Trucs S1 Modifiés Ac ChatGPTdjabeurdjaafarPas encore d'évaluation
- Diplomatie 4Document68 pagesDiplomatie 4Boris BertoliPas encore d'évaluation
- Sujet Essentiels JAS Histoire NgomDocument12 pagesSujet Essentiels JAS Histoire Ngomngjjwk58hkPas encore d'évaluation
- Le Concert Européen de 1815 À 1914Document6 pagesLe Concert Européen de 1815 À 1914Ivette LarsenPas encore d'évaluation
- La Seconde Guerre MondialeDocument4 pagesLa Seconde Guerre MondialeANGEL ChayPas encore d'évaluation
- Vue générale de l'histoire politique de l'Europe: Essai historique et politiqueD'EverandVue générale de l'histoire politique de l'Europe: Essai historique et politiquePas encore d'évaluation
- Fiche de Revision HLP 2021 L Humanite en Question Partie 2Document8 pagesFiche de Revision HLP 2021 L Humanite en Question Partie 2Nour GshakabzvPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de Leurope 3e EditionDocument710 pagesDictionnaire de Leurope 3e EditionEl Abed Amrani JouteyPas encore d'évaluation
- COURS D' Histoire Du Monde ContempoainDocument8 pagesCOURS D' Histoire Du Monde ContempoainAlphonse BinamPas encore d'évaluation
- CE 162 DIEEEO Cap.2-CE-162 Christian Harbulot FrancesDocument35 pagesCE 162 DIEEEO Cap.2-CE-162 Christian Harbulot FrancesRACHPas encore d'évaluation
- Libro - LEspagne Et La Guerre DalgerieDocument122 pagesLibro - LEspagne Et La Guerre DalgerieLok NsakPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - de La Premiere Mondialisation Aux CrisesDocument33 pagesChapitre 2 - de La Premiere Mondialisation Aux CrisesMohamadou Moustapha Sy SAMBPas encore d'évaluation
- L'europe Et L'afrique, D'un Berlin À L'autre 1985-1989Document34 pagesL'europe Et L'afrique, D'un Berlin À L'autre 1985-1989rockbenon87Pas encore d'évaluation
- Lénine, Lecteur de HegelDocument11 pagesLénine, Lecteur de HegelLouise ForrestierPas encore d'évaluation
- Fiche de Revision HGGSP Terminale 2021 Faire La Guerre Faire La Paix Formes de Conflits Et Modes de Resolution Partie 2Document5 pagesFiche de Revision HGGSP Terminale 2021 Faire La Guerre Faire La Paix Formes de Conflits Et Modes de Resolution Partie 2curatoPas encore d'évaluation
- Cosmopolitisme G CormDocument8 pagesCosmopolitisme G CormMarwan ZoueinPas encore d'évaluation
- Bloetzer. L'Union Européenne - Un Ordre Cosmopolitique Européen en Émergence, 2004.Document15 pagesBloetzer. L'Union Européenne - Un Ordre Cosmopolitique Européen en Émergence, 2004.PedroPas encore d'évaluation
- Histoire Du TravailDocument21 pagesHistoire Du Travailedher78130Pas encore d'évaluation
- Terminale SS Cours D'histoire 2023Document29 pagesTerminale SS Cours D'histoire 2023Maoro GuilavoguiPas encore d'évaluation
- Les Conflits InternationauxDocument3 pagesLes Conflits Internationauxyazid AgoumiPas encore d'évaluation
- Hri FinalDocument72 pagesHri FinalClara-Maria LaredoPas encore d'évaluation
- Hypostases de La Condition HumaineDocument102 pagesHypostases de La Condition HumaineProdan Mihai FlorinPas encore d'évaluation
- 1 - Aire AnglophoneDocument6 pages1 - Aire AnglophoneNadir KiesPas encore d'évaluation
- Presentation 1Document8 pagesPresentation 1sunfire akPas encore d'évaluation
- La Prévention Dans Les Politiques D'aménagement-Cas de MarocDocument8 pagesLa Prévention Dans Les Politiques D'aménagement-Cas de MarocAbdellatifAmirouPas encore d'évaluation
- Vive l'Europe !: Pour une Europe au service de ses citoyensD'EverandVive l'Europe !: Pour une Europe au service de ses citoyensPas encore d'évaluation
- Les Chefs Une Question Pour L Histoire DDocument18 pagesLes Chefs Une Question Pour L Histoire DHichem AbdouPas encore d'évaluation
- Écouter La Chanson Française de L'oreille DroiteDocument10 pagesÉcouter La Chanson Française de L'oreille DroiteDominique FariaPas encore d'évaluation
- Axe 1 La Dimension Politique de La Guerre PDFDocument5 pagesAxe 1 La Dimension Politique de La Guerre PDFAnatole GOLLIOTPas encore d'évaluation
- 14.XXe SIECLE, REPERESDocument2 pages14.XXe SIECLE, REPERESfatimazohralakhal32Pas encore d'évaluation
- Julie SimardDocument126 pagesJulie SimardAdi HociotaPas encore d'évaluation
- COURS COMPLET Relations InternationalesDocument31 pagesCOURS COMPLET Relations Internationalesisaure.de.lassomptionPas encore d'évaluation
- Les Guerres D'aujourd'hui Sont-Elles Les Mêmes Que Celles D'hier ?Document3 pagesLes Guerres D'aujourd'hui Sont-Elles Les Mêmes Que Celles D'hier ?creatorPas encore d'évaluation
- THEME 3 - Axe 1 - COURS ELEVESDocument12 pagesTHEME 3 - Axe 1 - COURS ELEVEScharlotte perefarresPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu Méthodologie Cultures Monde - Sabrina CarneiroDocument11 pagesCompte-Rendu Méthodologie Cultures Monde - Sabrina CarneiroSabrina CarneiroPas encore d'évaluation
- Numérisation 20230819Document1 pageNumérisation 20230819Mbaye babacar LoPas encore d'évaluation
- Numérisation 20230819Document1 pageNumérisation 20230819Mbaye babacar LoPas encore d'évaluation
- Numérisation 20230819Document1 pageNumérisation 20230819Mbaye babacar LoPas encore d'évaluation
- Lettre de Motivation Mbaye LoDocument1 pageLettre de Motivation Mbaye LoMbaye babacar Lo100% (1)
- ENGLISHDocument20 pagesENGLISHMbaye babacar LoPas encore d'évaluation
- Lettre de Motivaton Canadien Mbaye LoDocument1 pageLettre de Motivaton Canadien Mbaye LoMbaye babacar Lo100% (1)
- Eaux Et Forêt Zall 19-Nov-2020 11-31-40Document56 pagesEaux Et Forêt Zall 19-Nov-2020 11-31-40Mbaye babacar LoPas encore d'évaluation
- Plus Que ParfaitDocument1 pagePlus Que ParfaitMbaye babacar LoPas encore d'évaluation
- Plus Que ParfaitDocument1 pagePlus Que ParfaitMbaye babacar LoPas encore d'évaluation
- Burundi Sequences Pedagogiques PDFDocument44 pagesBurundi Sequences Pedagogiques PDFNeculeanu LilianaPas encore d'évaluation
- Cours Architecture Par6Document5 pagesCours Architecture Par6Othmane EL BadlaouiPas encore d'évaluation
- Projet Biomaths - CUPIT-DESTERCKE-FERREIRA-FOURNIER-HISLEURDocument7 pagesProjet Biomaths - CUPIT-DESTERCKE-FERREIRA-FOURNIER-HISLEURFila HankPas encore d'évaluation
- Evolution Ummo 1966 2018Document11 pagesEvolution Ummo 1966 2018scollePas encore d'évaluation
- Algérie, La Libération InachevéeDocument235 pagesAlgérie, La Libération InachevéeRedouane YahiaPas encore d'évaluation
- Fiche Dida Maths Fractions Et Nombres DecimauxDocument8 pagesFiche Dida Maths Fractions Et Nombres Decimauxdpg94ttssbPas encore d'évaluation
- Chapka PVT CGVDocument33 pagesChapka PVT CGVjeanneperelePas encore d'évaluation
- Isolement Et Caractérisation de Bactéries Antagonistes Contre Fusarium Oxysporum Et Sclerotium Rolfsii - Agents Causaux Des PourDocument99 pagesIsolement Et Caractérisation de Bactéries Antagonistes Contre Fusarium Oxysporum Et Sclerotium Rolfsii - Agents Causaux Des PourSaloua ElboustatiPas encore d'évaluation
- Le Discount Du PétroleDocument5 pagesLe Discount Du PétroleKawtar Raji0% (1)
- 17.appréhendez Le Cycle de Vie D'une Activité - Développez Votre Première Application Android - OpenClassroomsDocument1 page17.appréhendez Le Cycle de Vie D'une Activité - Développez Votre Première Application Android - OpenClassroomsWattman ThotPas encore d'évaluation
- 4f5ee7553ecb3dade85d5734b7dad5bc4a28bb0edb9929d4cdce8b9a7ba45e9aDocument25 pages4f5ee7553ecb3dade85d5734b7dad5bc4a28bb0edb9929d4cdce8b9a7ba45e9ahafssaPas encore d'évaluation
- Procédure Régie GoodDocument8 pagesProcédure Régie GoodRatamasGuellehPas encore d'évaluation
- FICHE PRODUIT Béton Lissé PDFDocument2 pagesFICHE PRODUIT Béton Lissé PDFAhmed Ben AlayaPas encore d'évaluation
- Joker Male EnhancementDocument4 pagesJoker Male Enhancementjo kerPas encore d'évaluation
- La Pratique de L'allaitement Maternel Exclusif Dans Le District D'avaradrano (VONJITSARA Aina Nikaria - 2007)Document52 pagesLa Pratique de L'allaitement Maternel Exclusif Dans Le District D'avaradrano (VONJITSARA Aina Nikaria - 2007)HayZara Madagascar100% (1)
- Arrêté N°99-0893 MF-SG Du 18 Mai 1999 Déterminant La Fraction Représentative de L' Impôt SynthétiqueDocument2 pagesArrêté N°99-0893 MF-SG Du 18 Mai 1999 Déterminant La Fraction Représentative de L' Impôt SynthétiqueAbdoulaye Aziz MarikoPas encore d'évaluation
- Article Commentaires de Marie Noelle Thabut Annee Liturgique A 1er Dimanche de Careme 13 Mars 2011 69139859Document14 pagesArticle Commentaires de Marie Noelle Thabut Annee Liturgique A 1er Dimanche de Careme 13 Mars 2011 69139859angelo okouPas encore d'évaluation
- Pêcher La Carpe Au Québec - Première PartieDocument6 pagesPêcher La Carpe Au Québec - Première PartieSergiu GuzunPas encore d'évaluation
- Chronologie Sociale 19ème Siècle en FranceDocument39 pagesChronologie Sociale 19ème Siècle en FranceFlorent KirschPas encore d'évaluation
- Fiche Pedagogique b1 Tes Belle Coeur de Pirate Par Clemence DoumengesDocument6 pagesFiche Pedagogique b1 Tes Belle Coeur de Pirate Par Clemence DoumengesZeggai APas encore d'évaluation
- JawadDocument3 pagesJawadaqlaty.yt59Pas encore d'évaluation
- 4 Couts Complets PDFDocument6 pages4 Couts Complets PDFEnseignant UniversiatairePas encore d'évaluation