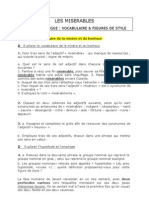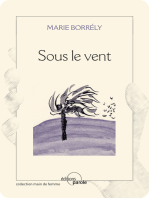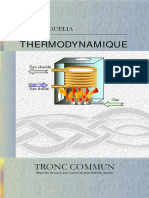Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Analyse Linéaire La Femme Gelée, Annie Ernaux
Analyse Linéaire La Femme Gelée, Annie Ernaux
Transféré par
junkie20012Droits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- Analyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de ManonDocument4 pagesAnalyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de Manonjunkie20012Pas encore d'évaluation
- LL Des Grieux Face À Son PèreDocument4 pagesLL Des Grieux Face À Son PèreJaziri Maleke100% (1)
- Le Diner Au Café Riche, Bel Ami, MaupassantDocument13 pagesLe Diner Au Café Riche, Bel Ami, MaupassantMac Arel100% (2)
- 4° Les Misérables OL VocabulaireDocument7 pages4° Les Misérables OL Vocabulairemartyludo67% (3)
- PhiloDocument2 pagesPhiloMartin AntechPas encore d'évaluation
- Lecture Analytique N°3: Femmes, Soyez Soumises À Vos Maris . Voltaire.Document3 pagesLecture Analytique N°3: Femmes, Soyez Soumises À Vos Maris . Voltaire.petitcorpsmaladeassociationPas encore d'évaluation
- Cours-PDF-Annie ERNAUX Parcours AssociéDocument7 pagesCours-PDF-Annie ERNAUX Parcours AssociélyblancPas encore d'évaluation
- Colette - Étude TEXTE 3Document9 pagesColette - Étude TEXTE 3lyblanc100% (1)
- Explication de Texte Mariage Avec MarieDocument5 pagesExplication de Texte Mariage Avec MarieSophie CERDANPas encore d'évaluation
- ERNAUX Lecture LinéaireDocument7 pagesERNAUX Lecture LinéairelyblancPas encore d'évaluation
- Quelles Significations Peuvent Avoir Pour Le Roman Jacques Le Fataliste Les Épisodes Qui Mettent en Scène Le Personnage de GousseDocument2 pagesQuelles Significations Peuvent Avoir Pour Le Roman Jacques Le Fataliste Les Épisodes Qui Mettent en Scène Le Personnage de Goussele neveu de JacquesPas encore d'évaluation
- Proust Combray StructureDocument13 pagesProust Combray Structurejy.16sbPas encore d'évaluation
- C.C. La Femme GeléeDocument3 pagesC.C. La Femme GeléecanevetannickPas encore d'évaluation
- Annie Ernaux Ou L'inaccessible Quiétude PDFDocument7 pagesAnnie Ernaux Ou L'inaccessible Quiétude PDFBri GiPas encore d'évaluation
- 12 - Annie Ernaux - La Femme GeléeDocument4 pages12 - Annie Ernaux - La Femme GeléeTorodo LiaPas encore d'évaluation
- Correction LangueDocument15 pagesCorrection Languemacairensangou2Pas encore d'évaluation
- Conférence Nobel Par Annie Ernaux-FrenchDocument10 pagesConférence Nobel Par Annie Ernaux-FrenchomyomyPas encore d'évaluation
- Explication Lineaire PerecDocument4 pagesExplication Lineaire PerecMUGNIERPas encore d'évaluation
- Corrigés Des Textes Étudiés en CoursDocument10 pagesCorrigés Des Textes Étudiés en CoursMarie-Chantal SchmitzPas encore d'évaluation
- LL 2Document5 pagesLL 2youneslachguar8Pas encore d'évaluation
- LL - L'aveu - PDCDocument5 pagesLL - L'aveu - PDCLaZio Fait Des Jeux VidéosPas encore d'évaluation
- Extrait de La Femme Gelée DDocument7 pagesExtrait de La Femme Gelée DFatima Hammoud100% (1)
- Les Types de DiscoursDocument4 pagesLes Types de DiscoursCelis LópezPas encore d'évaluation
- Les Registres LitterairesDocument14 pagesLes Registres Litterairesjagosat297Pas encore d'évaluation
- Gary Promesse Aube Chapitre 6 PDFDocument4 pagesGary Promesse Aube Chapitre 6 PDFgarruchomarieangePas encore d'évaluation
- Annie Ernaux LanguageDocument13 pagesAnnie Ernaux LanguageBorgeanaPas encore d'évaluation
- LL 13 Scène de RenoncementDocument5 pagesLL 13 Scène de RenoncementViardPas encore d'évaluation
- PDF - SEQUENCE L'autobiographieDocument9 pagesPDF - SEQUENCE L'autobiographieIdir Brigui100% (1)
- La Religieuse, DiderotDocument2 pagesLa Religieuse, Diderotanna.dumond22Pas encore d'évaluation
- Résumé Et Analyse de Madame BovaryDocument4 pagesRésumé Et Analyse de Madame BovaryCantacuz Alina0% (1)
- La Rencontre Manon LescautDocument5 pagesLa Rencontre Manon Lescautrim nouriPas encore d'évaluation
- Les Lapins - Gournay - Égalité Hommes Et FemmesDocument13 pagesLes Lapins - Gournay - Égalité Hommes Et FemmesPablo ORTEGA MASPas encore d'évaluation
- Séance 4 - Arrias - Lecture LinéaireDocument4 pagesSéance 4 - Arrias - Lecture LinéaireJean FrédéricPas encore d'évaluation
- Fiche de Citations Juste La Fin Du Monde de LagarceDocument2 pagesFiche de Citations Juste La Fin Du Monde de LagarcetomridergamingPas encore d'évaluation
- LL1 ArriasDocument5 pagesLL1 ArriasValou 46Pas encore d'évaluation
- Citations Sur Mme BovDocument12 pagesCitations Sur Mme BovLaureKerPas encore d'évaluation
- FRA Supp - Cours Lambeaux, Charles JulietDocument11 pagesFRA Supp - Cours Lambeaux, Charles JulietjoshPas encore d'évaluation
- Genette Et ErnauxDocument24 pagesGenette Et ErnauximenPas encore d'évaluation
- Carmenboustani, L'écriture Sexuée Dans L'écriture FrancophoneDocument18 pagesCarmenboustani, L'écriture Sexuée Dans L'écriture FrancophoneSara FedericoPas encore d'évaluation
- Travail Final Sur BalzacDocument20 pagesTravail Final Sur BalzacOussama BerriPas encore d'évaluation
- Ernaux, NobelDocument4 pagesErnaux, NobelRBBLAPas encore d'évaluation
- Grammaire + Lecture Linéaire Maitre Et Écolier LFDocument4 pagesGrammaire + Lecture Linéaire Maitre Et Écolier LFEl MorjanePas encore d'évaluation
- Lineaire Marivaux Parcours ECPEDocument5 pagesLineaire Marivaux Parcours ECPEBastienPas encore d'évaluation
- Corrige Brevet 2014 Francais CompletDocument4 pagesCorrige Brevet 2014 Francais CompletJah MinhPas encore d'évaluation
- Deleuze PourparlersDocument22 pagesDeleuze PourparlersNatali Incaminato0% (2)
- De l'insulte...aux femmes: Un essai linguistique sur les insultes faites aux femmesD'EverandDe l'insulte...aux femmes: Un essai linguistique sur les insultes faites aux femmesPas encore d'évaluation
- Livret Papa de SimonDocument30 pagesLivret Papa de SimonChristinelafėe Des ÉcolesPas encore d'évaluation
- OrsenaDocument7 pagesOrsenamarina chumachenkoPas encore d'évaluation
- Commentaire Linéaire 13 La Naissance de GargantuaDocument3 pagesCommentaire Linéaire 13 La Naissance de Gargantuacharlygabriel224Pas encore d'évaluation
- E.T-le Bain MaureDocument9 pagesE.T-le Bain Maureilham pro100% (1)
- Franã Ais PremiereDocument36 pagesFranã Ais Premiereaylinkd1610Pas encore d'évaluation
- Marivaux Exp 1Document5 pagesMarivaux Exp 1kakihej590Pas encore d'évaluation
- LLn2 CorrectionDocument3 pagesLLn2 CorrectionRayane Mohamed FilaliPas encore d'évaluation
- Barbe Bleue LADocument4 pagesBarbe Bleue LAjanieroberge04Pas encore d'évaluation
- Ne Pas Dire Pour Une Etude Du Non Dit Dans La Litterature Et La Culture Europeennes Les Dits Du Non DitDocument18 pagesNe Pas Dire Pour Une Etude Du Non Dit Dans La Litterature Et La Culture Europeennes Les Dits Du Non Ditmicael O'coileanPas encore d'évaluation
- EL8Document4 pagesEL8EmiliePas encore d'évaluation
- Entretien Avec Marie Darrieussecq 1Document15 pagesEntretien Avec Marie Darrieussecq 1Emilio Pérez FigueroaPas encore d'évaluation
- Pratiqueducrdit BailenalgrietatdeslieuxetperspectivesDocument19 pagesPratiqueducrdit BailenalgrietatdeslieuxetperspectivesAnis ZeghouanePas encore d'évaluation
- Fiche Individuelle: 1-Identification Du ChercheurDocument2 pagesFiche Individuelle: 1-Identification Du ChercheurWael TrabelsiPas encore d'évaluation
- Bt1 Af Corrige Comptabilite 2022Document4 pagesBt1 Af Corrige Comptabilite 2022VIEUXDANDIPas encore d'évaluation
- Manuel Cooperative Badeli 14 7 16Document7 pagesManuel Cooperative Badeli 14 7 16Job OuakkasPas encore d'évaluation
- Cours LeaderDocument23 pagesCours Leadermayssem bafiaPas encore d'évaluation
- Emploi Du Temps Automne 2022 2023 ING S1 S3 S5Document6 pagesEmploi Du Temps Automne 2022 2023 ING S1 S3 S5OUMAIMA EL YAKHLIFIPas encore d'évaluation
- Manuel Thermo A.BOUGUELIA PDFDocument236 pagesManuel Thermo A.BOUGUELIA PDFSami Sami100% (2)
- La Double ArticulationDocument3 pagesLa Double ArticulationChiboub ImanePas encore d'évaluation
- La Médiation Pour Plus D'efficacitéDocument25 pagesLa Médiation Pour Plus D'efficacitéKhouloud AmdouniPas encore d'évaluation
- Erp Rapport)Document55 pagesErp Rapport)Imane LaghlaliPas encore d'évaluation
- Listes Entreprises À Contacter Version 2SNDocument7 pagesListes Entreprises À Contacter Version 2SNbilal 4545Pas encore d'évaluation
- Figures RetóriquesDocument25 pagesFigures Retóriquesalexia_sinoble776Pas encore d'évaluation
- Activité 2 C3.1 - CorrectionDocument6 pagesActivité 2 C3.1 - CorrectionSOUHA CHAARPas encore d'évaluation
- Bro Sikadur Combiflex FR WebDocument8 pagesBro Sikadur Combiflex FR WebRaoufPas encore d'évaluation
- Norme Iso - 14001 - 2004Document34 pagesNorme Iso - 14001 - 2004RIDOPas encore d'évaluation
- Le SMS Au Service Des Ressources HumainesDocument11 pagesLe SMS Au Service Des Ressources HumaineswadieromPas encore d'évaluation
- 046 - Etude D'une Suite Definie ImplicitementDocument1 page046 - Etude D'une Suite Definie ImplicitementSouleyPas encore d'évaluation
- Liaison EncastrementDocument40 pagesLiaison EncastrementBilly BignakePas encore d'évaluation
- Be 8200 DocDocument1 pageBe 8200 DocZeinab Ben RomdhanePas encore d'évaluation
- Brocoli - WikipédiaDocument9 pagesBrocoli - WikipédiaCadnel KdoPas encore d'évaluation
- Troubles Des Conduites SexuellesDocument2 pagesTroubles Des Conduites SexuellesVichy PotchiraPas encore d'évaluation
- Formules de Calculs Statistiques en Démographie 2021Document3 pagesFormules de Calculs Statistiques en Démographie 2021Amadou Oury DialloPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Suites de FonctionsDocument7 pagesChapitre 1 Suites de FonctionsNajoua RaguaniPas encore d'évaluation
- Etampes-Domaine de PierrefitteDocument1 pageEtampes-Domaine de Pierrefittechiguer.mustaphaPas encore d'évaluation
- TEST_ QCM-BASE DE DONNEES MULTIMEDIADocument2 pagesTEST_ QCM-BASE DE DONNEES MULTIMEDIAArnaud Semevo AhouandjinouPas encore d'évaluation
- Les CosmetiquesDocument30 pagesLes CosmetiquesMassi Bouderbela100% (2)
- DTC RenaultDocument3 pagesDTC RenaultAna Belen Ismael AnaeIsmael75% (4)
- Livret de CeinturesDocument48 pagesLivret de CeinturesroutilinaPas encore d'évaluation
- Ed6146 PDFDocument52 pagesEd6146 PDFMohammad AminPas encore d'évaluation
- Elmoumen SbaiiDocument59 pagesElmoumen Sbaiimehdi.boukilPas encore d'évaluation
Analyse Linéaire La Femme Gelée, Annie Ernaux
Analyse Linéaire La Femme Gelée, Annie Ernaux
Transféré par
junkie20012Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Analyse Linéaire La Femme Gelée, Annie Ernaux
Analyse Linéaire La Femme Gelée, Annie Ernaux
Transféré par
junkie20012Droits d'auteur :
Formats disponibles
Séance n°2 : Annie Ernaux, La Femme gelée
Introduction
Présentation du contexte historique/littéraire et de l’extrait : Les années 60 sont en France une période de
réflexion et de débats, notamment sur les rapports hommes-femmes et la place de ces dernières dans la société,
dont les évènements de mai 68 seront l’expression historique. Dans La Femme gelée, œuvre largement
autobiographique, Annie Ernaux montre les limites de l’émancipation féminine dans les années 60.
Mariée à un étudiant en droit pourtant plein de théories idéales sur l’égalité des sexes, elle est vite happée par un
conditionnement imposé par la société et voit sa vie confisquée par toutes les tâches ménagères qu’elle est
finalement seule à accomplir.
Dans cet extrait, le lecteur observe la jeune femme pleine d’enthousiasme et de curiosité pour les études et
l’avenir, perdre peu à peu son élan, ses propres désirs de liberté et devenir comme tant d’autres une « femme
gelée ».
[Lecture du texte]
Problématique : Comment le récit de la narratrice montre-t-il les limites de son émancipation ?
Plan :
lignes 1-7 (« […] Il fallait changer ») : expose l’envie de la narratrice de rendre plus équitable le partage des
tâches domestiques et sa culpabilité de n’être pas bonne ménagère.
lignes 7-12 (« A la fac […] braque ») : exprime alors la décision de la narratrice de demander conseil à d’autres
étudiantes mariées, ainsi que la mise en échec de sa démarche.
lignes 12-21 (« Alors, jour après jour […] arts d’agréments ») : présente le constat d’un certain silence généralisé
autour de la condition des femmes mariées, qui pousse la narratrice à se décourager et perdre le fil de ses études.
lignes 21 à la fin du texte : confronte le discours théorique du mari sur l’égalité à la réalité pratique vécue par la
narratrice.
I. Un récit autobiographique sous le signe de la culpabilité et du ressentiment
1) Un récit rétrospectif sous forme de dialogue intérieur
- dd : « aujourd’hui c’est ton tour » → un dialogue entre deux personnages ;
- présent de l’indicatif « je travaille », « je ne veux pas » + le passé composé « je n’ai pas regimbé », « j’ai
pensé » → temps du discours ;
- première personne du singulier « je » + destinataire (le déterminant possessif « ton » dans « ton tour ») →
échange entre la narratrice et un référent encore inconnu ( mari)
MAIS en vrai : « je » qui vit les évènements (« je ne veux pas être une emmerdeuse ») ≠ « je » qui se
souvient des évènements (« j’ai pensé que ») → dialogue (entre la narratrice et son mari) inséré dans un
autre dialogue (entre la narratrice et elle-même)
cadre énonciatif d’un récit autobiographique.
2) Un évènement particulier qui reflète le quotidien de la narratrice.
- évènement semble d’abord inédit : « Je n’ai pas regimbé, hurlé ou annoncé froidement », « c’est ton
tour » ;
- évènement paraît en réalité s’inscrire dans la durée : nom commun « tour » = caractère cyclique de la
conversation + la naissance d’un sentiment (« un ressentiment mal éclairci ») → plus la durée qu’un
évènement ponctuel.
A travers le récit d’un évènement particulier, le lecteur est donc plongé dans le quotidien de la narratrice.
3) Un quotidien marqué par un non-dit entre la narratrice et son mari.
- malédiction d’un conflit qui ne s’exprime que par des détours : « des allusions, des remarques acides ».
- La tournure familière, dont la syntaxe est elliptique « Et plus rien » → bascule vers le silence.
- narratrice pense et juge ces reproches comme futiles : « des histoires de patates » ≠ ressentiment : lexique du
sentiment : « remarques acides », « ressentiment », « regrettait », « paumée »).
- Sentiment de culpabilité : comparatif de supériorité : « J’ai pensé que j’étais plus malhabile qu’une autre »
4) Des désaccords conjugaux qui portent sur les tâches domestiques.
- La culpabilité accentuée par le caractère dérisoire des raisons du conflit entre elle et son mari :
vocabulaire familier lorsqu’elle évoque les objets du conflit : « bagatelles », « patates ».
- La question rhétorique « est-ce que c’est vraiment important, tout faire capoter, le rire, l’entente, pour des
histoires de patates à éplucher » → porte au comble du ridicule cet affrontement entre jeunes étudiants
cultivés, plongés dans la plate réalité des tâches culinaires.
5) La narratrice réalise un autoportrait à charge.
- Au lieu de retourner ses reproches contre son mari, la narratrice les adresse finalement à elle-même :
l’épithète péjorative « paumée », « emmerdeuse », « flemmarde », connotées très négativement
- s’accuse de ne pas savoir « casser un œuf », critique accentué par adj « proprement » → se dévalue
II. L’ironie au cœur d’un processus de démythification
1. Une quête de solutions vouée à l’échec.
- La narratrice cherche alors à se renseigner auprès d’autres femmes mariées, autant de modèles
potentiels : présent d’énonciation « j’essaie de savoir » + compléments circonstanciels « à la fac », « en
octobre »
- Elle voudrait sortir de son impuissance
- la lourdeur de la syntaxe : proche de l’oralité, hésitations et répétitions inutiles (« comment elles font les
filles mariées ») → l’expression des difficultés de la quête imposée à la narratrice.
2. Le discrédit jeté sur un mythe par l’ironie de la narratrice.
- le fait « d’être submergée d’occupations » soit considèrent comme une « fierté », une « plénitude » → narr
dénonce modèle de la « double journée » : la femme qui veut faire des études, avoir un métier, pour son
épanouissement personnel, doit accepter d’« être submergée »
- « comme si c’était glorieux d’être submergée d’occupations » déconstruction du mythe
- réponse au discours direct « pas commode », discours prêté aux « filles mariées » → forme d’authenticité
tout en exprimant indirectement le manque de temps dont souffrent ces jeunes étudiantes, qui étouffent
sous le poids des occupations.
C’est donc par l’écriture romanesque qu’Annie Ernaux déconstruit un mythe bien ancré dans la société
de son époque
3. La disparition du sujet dans le chaos des occupations.
- verbes de réflexion à l’infinitif, comme « s’interroger », niés par l’adverbe de négation « plus » →
disparition progressive de la narratrice sous le poids des charges.
- Ce poids semble en effet exclure toute réflexion : l’adverbe « stupidement » + familiarité de
l’expression « couper les cheveux en quatre ».
- « Le réel c’est ça, un homme, et qui bouffe… » → toute la réalité de la narratrice était réduite à de
basses considérations matérielles.
III. Les désillusions d’un couple d’intellectuels
1. La violence d’un quotidien centré sur la vie domestique.
- La réalité quotidienne est évoquée de façon concrète et même brutale : termes familiers (« de petits
pois cramés en quiches trop salées ») → le modèle traditionnel a repris ses droits : rôle éternel de la «
nourricière »
- Adj « efforcés » + cc de manière « sans joie » → ne prend pas de goûts
2. L’hypocrisie du mari, reflet d’une réalité sociale.
- discours direct du mari : « Tu sais, je préfère manger à la maison...» → certaine hypocrisie
- emploie du terme « arts d’agrément » pour désigner ses études qui désignait la part culturelle réservée aux
filles dans l’éducation traditionnelle → le modèle de la soumission qui a remplacé l’aspiration à l’égalité.
3. Le déclin de l’enthousiasme et le renoncement à l’étude.
- Les compléments circonstanciels de manière s’opposent « avec peine », « sans goût », « avec
enthousiasme » : reflètent le chemin parcouru par la narratrice depuis son mariage → elle ne parvient plus
à apprécier ses études.
- Ses projections dans l’avenir (futur : « je n’aurai certainement pas le capes ») sont pessimistes + « trop
difficile » accentue
4. Un effet de balancier qui ne sert que l’un des deux membres du couple : le mari.
- L’évocation d’un « flou étrange » + phrase non verbale « Moins de volonté » → déclin du désir
d’émancipation intellectuelle chez la femme, qui profite cependant au mari.
- Les couples de pronoms personnels « je/lui » se multiplient et s’opposent : « je table sur sa réussite à lui,
qui, au contraire, s’accroche plus qu’avant » → l’homme qui bénéficie de la dilution de la volonté
d’émancipation de sa femme
IV. L’échec des discours théoriques sur l’égalité
1. Des théories égalitaires qui restent à l’état de théories
« Dans la conversation, c’est toujours le discours de l’égalité » → Annie Ernaux montre l’inconsciente mauvaise
foi de cet homme. Cette égalité est à la fois intellectuelle (« On a parlé ensemble de Dostoïevski »), et dans
l’organisation des tâches ménagères (« il a horreur des femmes popotes ») → parle mais n’agit pas
Une hiérarchie se met donc en place dans le couple et les études ou la carrière de l’homme passent avant
celles de la femme.
2. Les illusions perdues de la narratrice.
- le mari prend le dessus sur la narratrice : le pronom personnel « il » (mari), sujet des verbes au présent
d’énonciation (« il me dit », « me répète », « il est pour ma liberté ») envahit le récit.
- Le temps de la rencontre, des échanges littéraires et historiques, est terminé : l’aspect accompli du passé
composé : « Quand nous nous sommes rencontrés »
- La détresse de la narratrice : un rythme haché par une ponctuation saccadée
3. Un comique de farce centré autour du mari.
- La narratrice met en scène son mari comme un personnage de farce : discours de façade (« il a horreur des
femmes popotes ») dis ca pour faire plaisir mas ne le pense pas = fausse bienveillance, comique de
répétition (« il me dit et me répète »)
- le mari = « enfant bien élevé », « le doigt sur la bouche, pour rire » → le ridiculise jusqu’à la caricature.
- comique amplifié par la fausse naïveté de la narratrice : interrogation rhétorique « Comment me
plaindrais-je », « Comment lui en voudrais-je » → accentue par contraste la vraie mauvaise foi du mari « Il
n’a pas la naïveté de croire… »).
Conclusion
L’écrivaine Annie Ernaux utilise le cadre autobiographique pour dénoncer, à travers le récit de son quotidien
d’étudiante et de mère mariée, l’inégalité d’accès à la culture entre les hommes et les femmes dans la société
française des années 1960. Le récit de la narratrice dessine, à travers les sentiments de culpabilité et de
ressentiment qu’elle exprime, la déconstruction des mythes autour de la vie conjugale, les désillusions vécues
dans sa vie de couple et la mise en échec des discours sur l’égalité hommes-femmes, les limites de son
émancipation.
Dans L’Écriture comme un couteau (2003), Annie Ernaux explique le lien entre sa façon d’écrire et son milieu
d’origine : « J’importe dans la littérature quelque chose de dur, de lourd, de violent même, lié aux conditions de
vie, à la langue du monde qui a été complètement le mien jusqu’à dix-huit ans, un monde ouvrier et paysan.
Toujours quelque chose de réel ». Il s’agit pour elle de raconter au plus près des souffrances vécues, sans jamais
les édulcorer ni les embellir. Ce poids du réel et du quotidien fait de ses œuvres des écrits « à hauteur d’homme
», dans lequel il peut se projeter ou retrouver ses propres expériences : c’est ainsi qu’Annie Ernaux, en racontant
sa vie, raconte aussi celle des autres et atteint une dimension universelle.
Vous aimerez peut-être aussi
- Analyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de ManonDocument4 pagesAnalyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de Manonjunkie20012Pas encore d'évaluation
- LL Des Grieux Face À Son PèreDocument4 pagesLL Des Grieux Face À Son PèreJaziri Maleke100% (1)
- Le Diner Au Café Riche, Bel Ami, MaupassantDocument13 pagesLe Diner Au Café Riche, Bel Ami, MaupassantMac Arel100% (2)
- 4° Les Misérables OL VocabulaireDocument7 pages4° Les Misérables OL Vocabulairemartyludo67% (3)
- PhiloDocument2 pagesPhiloMartin AntechPas encore d'évaluation
- Lecture Analytique N°3: Femmes, Soyez Soumises À Vos Maris . Voltaire.Document3 pagesLecture Analytique N°3: Femmes, Soyez Soumises À Vos Maris . Voltaire.petitcorpsmaladeassociationPas encore d'évaluation
- Cours-PDF-Annie ERNAUX Parcours AssociéDocument7 pagesCours-PDF-Annie ERNAUX Parcours AssociélyblancPas encore d'évaluation
- Colette - Étude TEXTE 3Document9 pagesColette - Étude TEXTE 3lyblanc100% (1)
- Explication de Texte Mariage Avec MarieDocument5 pagesExplication de Texte Mariage Avec MarieSophie CERDANPas encore d'évaluation
- ERNAUX Lecture LinéaireDocument7 pagesERNAUX Lecture LinéairelyblancPas encore d'évaluation
- Quelles Significations Peuvent Avoir Pour Le Roman Jacques Le Fataliste Les Épisodes Qui Mettent en Scène Le Personnage de GousseDocument2 pagesQuelles Significations Peuvent Avoir Pour Le Roman Jacques Le Fataliste Les Épisodes Qui Mettent en Scène Le Personnage de Goussele neveu de JacquesPas encore d'évaluation
- Proust Combray StructureDocument13 pagesProust Combray Structurejy.16sbPas encore d'évaluation
- C.C. La Femme GeléeDocument3 pagesC.C. La Femme GeléecanevetannickPas encore d'évaluation
- Annie Ernaux Ou L'inaccessible Quiétude PDFDocument7 pagesAnnie Ernaux Ou L'inaccessible Quiétude PDFBri GiPas encore d'évaluation
- 12 - Annie Ernaux - La Femme GeléeDocument4 pages12 - Annie Ernaux - La Femme GeléeTorodo LiaPas encore d'évaluation
- Correction LangueDocument15 pagesCorrection Languemacairensangou2Pas encore d'évaluation
- Conférence Nobel Par Annie Ernaux-FrenchDocument10 pagesConférence Nobel Par Annie Ernaux-FrenchomyomyPas encore d'évaluation
- Explication Lineaire PerecDocument4 pagesExplication Lineaire PerecMUGNIERPas encore d'évaluation
- Corrigés Des Textes Étudiés en CoursDocument10 pagesCorrigés Des Textes Étudiés en CoursMarie-Chantal SchmitzPas encore d'évaluation
- LL 2Document5 pagesLL 2youneslachguar8Pas encore d'évaluation
- LL - L'aveu - PDCDocument5 pagesLL - L'aveu - PDCLaZio Fait Des Jeux VidéosPas encore d'évaluation
- Extrait de La Femme Gelée DDocument7 pagesExtrait de La Femme Gelée DFatima Hammoud100% (1)
- Les Types de DiscoursDocument4 pagesLes Types de DiscoursCelis LópezPas encore d'évaluation
- Les Registres LitterairesDocument14 pagesLes Registres Litterairesjagosat297Pas encore d'évaluation
- Gary Promesse Aube Chapitre 6 PDFDocument4 pagesGary Promesse Aube Chapitre 6 PDFgarruchomarieangePas encore d'évaluation
- Annie Ernaux LanguageDocument13 pagesAnnie Ernaux LanguageBorgeanaPas encore d'évaluation
- LL 13 Scène de RenoncementDocument5 pagesLL 13 Scène de RenoncementViardPas encore d'évaluation
- PDF - SEQUENCE L'autobiographieDocument9 pagesPDF - SEQUENCE L'autobiographieIdir Brigui100% (1)
- La Religieuse, DiderotDocument2 pagesLa Religieuse, Diderotanna.dumond22Pas encore d'évaluation
- Résumé Et Analyse de Madame BovaryDocument4 pagesRésumé Et Analyse de Madame BovaryCantacuz Alina0% (1)
- La Rencontre Manon LescautDocument5 pagesLa Rencontre Manon Lescautrim nouriPas encore d'évaluation
- Les Lapins - Gournay - Égalité Hommes Et FemmesDocument13 pagesLes Lapins - Gournay - Égalité Hommes Et FemmesPablo ORTEGA MASPas encore d'évaluation
- Séance 4 - Arrias - Lecture LinéaireDocument4 pagesSéance 4 - Arrias - Lecture LinéaireJean FrédéricPas encore d'évaluation
- Fiche de Citations Juste La Fin Du Monde de LagarceDocument2 pagesFiche de Citations Juste La Fin Du Monde de LagarcetomridergamingPas encore d'évaluation
- LL1 ArriasDocument5 pagesLL1 ArriasValou 46Pas encore d'évaluation
- Citations Sur Mme BovDocument12 pagesCitations Sur Mme BovLaureKerPas encore d'évaluation
- FRA Supp - Cours Lambeaux, Charles JulietDocument11 pagesFRA Supp - Cours Lambeaux, Charles JulietjoshPas encore d'évaluation
- Genette Et ErnauxDocument24 pagesGenette Et ErnauximenPas encore d'évaluation
- Carmenboustani, L'écriture Sexuée Dans L'écriture FrancophoneDocument18 pagesCarmenboustani, L'écriture Sexuée Dans L'écriture FrancophoneSara FedericoPas encore d'évaluation
- Travail Final Sur BalzacDocument20 pagesTravail Final Sur BalzacOussama BerriPas encore d'évaluation
- Ernaux, NobelDocument4 pagesErnaux, NobelRBBLAPas encore d'évaluation
- Grammaire + Lecture Linéaire Maitre Et Écolier LFDocument4 pagesGrammaire + Lecture Linéaire Maitre Et Écolier LFEl MorjanePas encore d'évaluation
- Lineaire Marivaux Parcours ECPEDocument5 pagesLineaire Marivaux Parcours ECPEBastienPas encore d'évaluation
- Corrige Brevet 2014 Francais CompletDocument4 pagesCorrige Brevet 2014 Francais CompletJah MinhPas encore d'évaluation
- Deleuze PourparlersDocument22 pagesDeleuze PourparlersNatali Incaminato0% (2)
- De l'insulte...aux femmes: Un essai linguistique sur les insultes faites aux femmesD'EverandDe l'insulte...aux femmes: Un essai linguistique sur les insultes faites aux femmesPas encore d'évaluation
- Livret Papa de SimonDocument30 pagesLivret Papa de SimonChristinelafėe Des ÉcolesPas encore d'évaluation
- OrsenaDocument7 pagesOrsenamarina chumachenkoPas encore d'évaluation
- Commentaire Linéaire 13 La Naissance de GargantuaDocument3 pagesCommentaire Linéaire 13 La Naissance de Gargantuacharlygabriel224Pas encore d'évaluation
- E.T-le Bain MaureDocument9 pagesE.T-le Bain Maureilham pro100% (1)
- Franã Ais PremiereDocument36 pagesFranã Ais Premiereaylinkd1610Pas encore d'évaluation
- Marivaux Exp 1Document5 pagesMarivaux Exp 1kakihej590Pas encore d'évaluation
- LLn2 CorrectionDocument3 pagesLLn2 CorrectionRayane Mohamed FilaliPas encore d'évaluation
- Barbe Bleue LADocument4 pagesBarbe Bleue LAjanieroberge04Pas encore d'évaluation
- Ne Pas Dire Pour Une Etude Du Non Dit Dans La Litterature Et La Culture Europeennes Les Dits Du Non DitDocument18 pagesNe Pas Dire Pour Une Etude Du Non Dit Dans La Litterature Et La Culture Europeennes Les Dits Du Non Ditmicael O'coileanPas encore d'évaluation
- EL8Document4 pagesEL8EmiliePas encore d'évaluation
- Entretien Avec Marie Darrieussecq 1Document15 pagesEntretien Avec Marie Darrieussecq 1Emilio Pérez FigueroaPas encore d'évaluation
- Pratiqueducrdit BailenalgrietatdeslieuxetperspectivesDocument19 pagesPratiqueducrdit BailenalgrietatdeslieuxetperspectivesAnis ZeghouanePas encore d'évaluation
- Fiche Individuelle: 1-Identification Du ChercheurDocument2 pagesFiche Individuelle: 1-Identification Du ChercheurWael TrabelsiPas encore d'évaluation
- Bt1 Af Corrige Comptabilite 2022Document4 pagesBt1 Af Corrige Comptabilite 2022VIEUXDANDIPas encore d'évaluation
- Manuel Cooperative Badeli 14 7 16Document7 pagesManuel Cooperative Badeli 14 7 16Job OuakkasPas encore d'évaluation
- Cours LeaderDocument23 pagesCours Leadermayssem bafiaPas encore d'évaluation
- Emploi Du Temps Automne 2022 2023 ING S1 S3 S5Document6 pagesEmploi Du Temps Automne 2022 2023 ING S1 S3 S5OUMAIMA EL YAKHLIFIPas encore d'évaluation
- Manuel Thermo A.BOUGUELIA PDFDocument236 pagesManuel Thermo A.BOUGUELIA PDFSami Sami100% (2)
- La Double ArticulationDocument3 pagesLa Double ArticulationChiboub ImanePas encore d'évaluation
- La Médiation Pour Plus D'efficacitéDocument25 pagesLa Médiation Pour Plus D'efficacitéKhouloud AmdouniPas encore d'évaluation
- Erp Rapport)Document55 pagesErp Rapport)Imane LaghlaliPas encore d'évaluation
- Listes Entreprises À Contacter Version 2SNDocument7 pagesListes Entreprises À Contacter Version 2SNbilal 4545Pas encore d'évaluation
- Figures RetóriquesDocument25 pagesFigures Retóriquesalexia_sinoble776Pas encore d'évaluation
- Activité 2 C3.1 - CorrectionDocument6 pagesActivité 2 C3.1 - CorrectionSOUHA CHAARPas encore d'évaluation
- Bro Sikadur Combiflex FR WebDocument8 pagesBro Sikadur Combiflex FR WebRaoufPas encore d'évaluation
- Norme Iso - 14001 - 2004Document34 pagesNorme Iso - 14001 - 2004RIDOPas encore d'évaluation
- Le SMS Au Service Des Ressources HumainesDocument11 pagesLe SMS Au Service Des Ressources HumaineswadieromPas encore d'évaluation
- 046 - Etude D'une Suite Definie ImplicitementDocument1 page046 - Etude D'une Suite Definie ImplicitementSouleyPas encore d'évaluation
- Liaison EncastrementDocument40 pagesLiaison EncastrementBilly BignakePas encore d'évaluation
- Be 8200 DocDocument1 pageBe 8200 DocZeinab Ben RomdhanePas encore d'évaluation
- Brocoli - WikipédiaDocument9 pagesBrocoli - WikipédiaCadnel KdoPas encore d'évaluation
- Troubles Des Conduites SexuellesDocument2 pagesTroubles Des Conduites SexuellesVichy PotchiraPas encore d'évaluation
- Formules de Calculs Statistiques en Démographie 2021Document3 pagesFormules de Calculs Statistiques en Démographie 2021Amadou Oury DialloPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Suites de FonctionsDocument7 pagesChapitre 1 Suites de FonctionsNajoua RaguaniPas encore d'évaluation
- Etampes-Domaine de PierrefitteDocument1 pageEtampes-Domaine de Pierrefittechiguer.mustaphaPas encore d'évaluation
- TEST_ QCM-BASE DE DONNEES MULTIMEDIADocument2 pagesTEST_ QCM-BASE DE DONNEES MULTIMEDIAArnaud Semevo AhouandjinouPas encore d'évaluation
- Les CosmetiquesDocument30 pagesLes CosmetiquesMassi Bouderbela100% (2)
- DTC RenaultDocument3 pagesDTC RenaultAna Belen Ismael AnaeIsmael75% (4)
- Livret de CeinturesDocument48 pagesLivret de CeinturesroutilinaPas encore d'évaluation
- Ed6146 PDFDocument52 pagesEd6146 PDFMohammad AminPas encore d'évaluation
- Elmoumen SbaiiDocument59 pagesElmoumen Sbaiimehdi.boukilPas encore d'évaluation