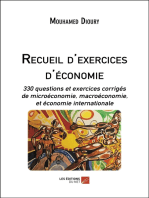Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Support MacroII
Support MacroII
Transféré par
ibrahim1985Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Support MacroII
Support MacroII
Transféré par
ibrahim1985Droits d'auteur :
Formats disponibles
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales de Tanger
Filière des sciences économiques
Semestre 3
Support de cours
Macro II
Professeur : Omar BELKHEIRI
Année universitaire 2006-2007
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
COMMENT UTILISER CE DOCUMENT ?
Contenu et objectif pédagogiques :
Ce cours vise à transmettre aux étudiants les connaissances de
base relatives à la compréhension du fonctionnement économique
de la nation (échelle macro). Il leur permet notamment d’avoir une
vision plus précise sur les principaux champs d’action de la politique
économique et d’en relever la portée, les objectifs et les limites.
Ce cours traite des approches keynésienne et classico-keynésienne
de l’équilibre macro-économique, des causes des déséquilibres et
des conditions de relance des économies en récession.
Remarques pédagogiques :
Ce document ne remplace pas le cours. C’est un outil d’appui, à
caractère orientatif. Les explications et les exemples abordés ainsi
que les questions-réponses survenues durant le cours et les TD
contribuent à mieux comprendre son contenu.
Par ailleurs, la lecture d’ouvrages de référence (manuels) est
fortement conseillée pour une meilleure prise en main de la matière.
Parmi les ouvrages disponibles dans la bibliothèque de notre faculté,
je vous propose les suivants (avec les cotes de classement) :
. « Economie politique », Gilbert Abraham-Frois (33 ABE)
. « Macro-économie », Marc Montoussé (339 MOM)
. « Economie politique », Claude Mouchot (33 MOE)
. « Analyse macroéconomique », Edmond Alphandery (339 ALC)
. « Economie contemporaine », Jean-Pierre Lorriaux (33 LOR)
Année universitaire 2006-2007 2
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Sommaire
Chapitre 1 : Théorie Keynésienne et demande globale
I – La consommation
1. La loi psychologique fondamentale de Keynes
2. La fonction de consommation
3. Enrichissement de la fonction de consommation
II – L’investissement
1. La rentabilité de l’investissement
2. Demande de biens de consommation et investissement
3. Investissement et anticipations des entrepreneurs
III – Les dépenses publiques
1. Les recettes de l’Etat
2. Les dépenses publiques
3. Le déficit public et son financement
Chapitre 2 : L’équilibre général keynésien
I – L’équilibre en économie fermée
1. La demande globale et l’équilibre
2. Le multiplicateur keynésien
II – L’équilibre avec intervention de l’Etat
1. La dépense publique et l’équilibre
2. Les impôts et l’équilibre
3. Effet combiné des multiplicateurs des dépenses et fiscal
II – L’équilibre en économie ouverte
1. L’équilibre avec les exportations et importations
2. Le multiplicateur en économie ouverte
Année universitaire 2006-2007 3
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Chapitre 3 : L’équilibre classico-keynésien
I – L’équilibre sur le marché des biens et services
1. Construction et signification de la courbe IS
2. Le déplacement de la courbe IS
II – L’équilibre sur le marché de la monnaie
1. L’offre et la demande de monnaie
2. Construction et interprétation de la courbe LM
3. Le déplacement de la courbe LM
III – L’équilibre simultané
Chapitre 4 : La politique budgétaire
I – Les instruments automatiques
II – Les instruments discrétionnaires
III – Effets de la politique budgétaire
Année universitaire 2006-2007 4
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Chapitre 1
THEORIE KEYNESIENNE ET DEMANDE GLOBALE
I – LA CONSOMMATION
La consommation d’un bien est la quantité de ce bien qui est
destinée à la satisfaction directe des besoins des agents
économiques concernés.
Les biens objets de cette consommation sont dits « bien finaux »,
par opposition aux biens intermédiaires.
L’approche macro-économique keynésienne est centrée sur la
consommation agrégée de l’ensemble des ménages.
Le facteur déterminant de cette consommation est le revenu et les
prix sont considérés comme rigides.
Le comportement de consommation est régi par la « loi
psychologique fondamentale »
1. La loi psychologique fondamentale de Keynes
Dans sa « Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la
monnaie » (1939), Keynes nous dit : « La loi psychologique
fondamentale sur laquelle nous pouvons nous appuyer en toute
sécurité, à la fois a priori en raison de notre connaissance de la
nature humaine et a posteriori en raison des enseignements détaillés
de l’expérience, c’est qu’en moyenne et la plupart du temps, les
hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur
revenu croît, mais non d’une quantité aussi grande que
l’accroissement du revenu ».
Année universitaire 2006-2007 5
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
La propension marginale à consommer
C
C=Y
S2
C=cY
C2
C1
Y
Y1 Y2
On peut remarquer qu’il existe un écart croissant entre la
consommation et le revenu. Cet écart entre les ressources et les
dépenses des ménages est le résultat de leurs comportements de
consommation à travers la notion de la propension à consommer.
La propension à consommer est un paramètre relativement stable
sur le court terme ; ce qui donne à la fonction de consommation son
caractère stable également.
Keynes distingue entre propension moyenne et marginale à
consommer :
- La propension moyenne à consommer : PMC = C/Y
- La propension marginale à consommer : pmc = C / Y
Année universitaire 2006-2007 6
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
2. La fonction de consommation
Elle permet l’analyse et l’explication de l’évolution de la
consommation globale.
La fonction de consommation est réputée stable à court terme en
raison de la stabilité de la pmc.
La fonction de consommation est formulée comme suit :
C = c Y + C0
La fonction de consommation
C C=Y
C = c Y + C0
S
C2 2
E
Ce
C1
C0
Y
Y1 Ye Y2
Puisque le revenu a une double utilisation, à savoir la consommation
et l’épargne (Y = C + S), la fonction de consommation peut
également être exprimée par la fonction d’épargne.
Keynes définit l’épargne (S) comme une renonciation à l’acte de
consommer et non comme un transfert de consommation vers le
futur.
Année universitaire 2006-2007 7
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
La fonction de consommation devient alors : S = (1 – c) Y - C0
La fonction d’épargne
S
S = (1-c) Y - C0
E Epargne
0
Désépargne Y
Ye
-C0
3. Enrichissement de la fonction de consommation
Suite à des tests statistiques, la fonction de consommation a été
vérifiée sur le court terme, puisqu’il a été observé une hausse du
taux d’épargne suite à l’accroissement du revenu.
Par contre, les hypothèses keynésiennes ont été mal vérifiées sur le
long terme, ni lorsque le revenu subit les aléas de la conjoncture.
Sur un autre plan, il est apparu que la consommation peut être liée à
d’autres variables que le revenu lui-même.
Année universitaire 2006-2007 8
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
3.1. Théorie du revenu relatif
Présentée par J. Duesenberry, cette théorie est basée sur deux
principes :
- Les ménages définissent leur niveau et structure de consommation
non, pas uniquement par rapport à leurs revenus (personnels) mais
également se référent aux dépenses, et donc aux revenus, de la
classe sociale immédiatement supérieure (revenu relatif)
- Les ménages ont tendance à vouloir maintenir leur niveau de
consommation par rapport à celui des périodes précédentes.
Autrement dit, la consommation d’une période est plus fonction du
revenu antérieur le plus élevé que du revenu de la période courante
(revenu courant)
Dans ces conditions, Duesenburry estime que dans le cadre de
fluctuations conjoncturelles de l’économie, la consommation n’évolue
pas proportionnellement au revenu.
Revenu relatif et consommation
Y
C Y
S
C
S S
Récession Reprise
0 Temps
Année universitaire 2006-2007 9
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Lorsque le revenu baisse en période de récession ou augmente en
période de reprise, la consommation ne varie pas
proportionnellement. L’effet Cliquet empêche la consommation de
baisser (ce qui se traduit par une baisse de l’épargne) et freine son
augmentation (ce qui permet de reconstituer l’épargne)
3.2. Théorie du revenu permanent
Cette théorie, œuvre de M. Friedman, critique le principe de la
stabilité de la relation consommation / revenu. L’auteur part de l’idée
que les ménages distinguent dans leurs revenus une part durable
appelée « revenu permanent » (Y p) et une part temporaire ou
accidentelle dite « revenu transitoire » (Y t : plus-values, heures
supplémentaires, …)
Parallèlement, la consommation des ménages se divise en
consommation permanente (Cp ) et en consommation transitoire (Ct )
Friedman considère que la seule relation stable qui existe est celle
liant le revenu permanent à la consommation permanente (Cp = a
Yp). Résiduellement, les ménages laissent de côté le revenu
transitoire, c’est l’épargne transitoire ; mais ils peuvent en
consommer une partie (Ct ). Cette consommation n’obéit à aucune
règle pré-établie.
De ce fait, la consommation courante, incluant la consommation
transitoire, devient aléatoire et surtout imprévisible. Par conséquent,
la relation C = a Y devient instable.
3.3. Théorie du cycle de vie
L’auteur de cette théorie, F. Modigliani, part du constat que les
revenus du travail sont irrégulièrement répartis sur la durée de vie.
Malgré cela, les ménages qui désirent garder un niveau de
consommation stable, se trouvent obligés de réaliser des transferts
de ressources sur leur cycle de vie par des opérations d’épargne et
d’emprunts.
Année universitaire 2006-2007 10
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Cycle de vie et consommation
S Revenu du travail
Y
C Epargne
C
Désépargne
Vie active Retraite
Désaccumulation
Accumulation
0
Désendettement
Endettement
Il ressort finalement, que la consommation n’est pas tributaire
uniquement du revenu mais aussi d’une nouvelle variable qui est le
stock de richesse ou le patrimoine que détiennent les ménages.
Année universitaire 2006-2007 11
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
II – L’INVESTISSEMENT
L’investissement représente l’ensemble des acquisitions de biens de
production par les entreprises.
La fonction d’investissement :
La fonction d’investissement est construite autour de la relation
inverse entre le taux d’intérêt et l’investissement. Cette fonction peut
être présentée comme suit :
Fonction d’investissement
i
r1
r2
0 I1 I2 I
Cette formulation suppose que toute chute du taux d’intérêt devrait
se traduire par une relance de l’investissement privé et que toute
augmentation de ce taux devrait déprimer l’investissement. En
réalité, bon nombre d’études empiriques ont infirmé cette supposée
relation inverse et mécanique entre le taux d’intérêt et
l’investissement. En effet, d’autres facteurs influencent également la
décision d’investir.
Année universitaire 2006-2007 12
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Si la consommation est l’élément relativement stable de la demande
globale, l’investissement est l’élément le plus irrégulier.
Trois autres déterminants de la décision d’investir sont en général
mis en valeur :
- La rentabilité du capital investi
- La demande en biens de consommation
- Les anticipations des agents économiques
1. La rentabilité de l’investissement
Dans le but de maximiser leurs profits et d’optimiser leur décision
d’investissement, les entreprises procèdent à des calculs de
rentabilité selon plusieurs méthodes.
Pour chaque projet, il est établi un état des coûts à supporter et un
état des rendements escomptés (recettes prévues). Sur la base de
ces états, les entreprises déterminent les rendements. A cet effet,
trois techniques sont utilisées :
- La technique du délai de récupération
- La méthode d’actualisation des rendements.
- La méthode du taux interne de rendement (TIR).
2. Demande de biens de consommation et investissement
La décision d’investissement dépend également de l’ampleur de la
demande de bien de consommation prévue.
Cette relation entre la variation de la demande de biens de
consommation et celle de la demande de biens d’équipement est
mise en évidence par le principe de l’accélérateur.
Année universitaire 2006-2007 13
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Exemple illustratif de l’accélérateur
t Dt D Pt Kt Int Irt It
1 10 - 10 30 0 3 3
2 60 50 60 180 150 3 153
3 85 25 85 255 75 3 78
4 100 15 100 300 45 3 48
5 100 0 100 300 0 3 3
6 85 -15 85 255 -45 3 -42
7 60 -25 60 180 -75 3 -72
8 10 -50 10 30 -150 3 -147
Dt : Demande en biens de consommation
D: Variation de la demande
Pt : Production en période t
Kt : Capital nécessaire
Int : Investissement nouveau
Irt : Investissement de renouvellement
It : Investissement total
En période de croissance de la demande, une variation en
augmentation de la demande en biens de consommation entraîne
une variation plus que proportionnelle de l’investissement.
En période de stagnation, l’investissement est ramené au niveau de
l’investissement de remplacement.
En période de baisse de la demande, la variation négative de la
demande entraîne une variation plus que proportionnelle en termes
de désinvestissement.
Limites de l’accélérateur :
Le principe de l’accélérateur tel qu’il est décrit ne peut être effectif
que si deux hypothèses sont simultanément réalisées :
- La demande en bien de consommation doit être immédiatement
suivie par une réponse : par une production équivalente.
- Le besoin de production est systématiquement et dans une
certaine proportion donnée, suivi par une augmentation de
l’investissement.
Année universitaire 2006-2007 14
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
3. Investissement et anticipations des entrepreneurs
Les essais de vérification statistique du principe de l’accélérateur
n’ont pas donné de résultats probants. De plus, l’évolution des
investissements semble parfois peu dépendante du taux d’intérêt.
Face à ce constat, et sachant que l’acte d’investissement est le fait
d’entrepreneurs qui ont plus ou moins confiance dans l’avenir, le
poids de leurs anticipations devient fondamental et nécessite d’être
intégré dans la fonction d’investissement.
Trois facteurs confortent la prise en compte des anticipations des
entrepreneurs :
Les prévisions à long terme sont incertaines :
L’investissement reste très largement imprévisible car il est difficile
de prévoir les événements futurs sur la base de l’expérience passée.
Par conséquent, la rentabilité d’un investissement est toujours
aléatoire. Ceci est d’autant plus vrai dans le contexte actuel de
mutation et de concurrence accrue.
Dans ce contexte, les rendements annuels prévus deviennent
incertains pour les raisons suivantes :
- L’incertitude sur la durée d’utilisation des biens d’équipement ;
- L’incertitude sur les perspectives de ventes ;
- L’incertitude sur les coûts de production ;
- L’incertitude sur les taux d’intérêts futurs.
Année universitaire 2006-2007 15
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Le climat de confiance (ou non) dans l’avenir :
L’investissement dépend de l’état psychologique de confiance des
entrepreneurs.
Anticipations des agents et investissement
rd
0ptimisme
0 Pessimisme
I1 Id I2 I
La spéculation financière :
La bourse exerce un effet attrayant en raison des plus values à court
terme qu’elle rend possibles. Les agents économiques pourraient ne
plus décider d’investir en fonction de la rentabilité à long terme du
projet mais en fonction des bénéfices à court terme qu’il peut
engendrer.
Cette facilité peut avoir un inconvénient : c’est le risque de détourner
les agents économiques de l’investissement productif vers un
comportement plus spéculatif.
Dans ce contexte, l’attitude anticipative de l’agent économique porte
sur l’opinion des marchés financiers dans le court terme.
Année universitaire 2006-2007 16
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
III – LES DEPENSES PUBLIQUES
L’Etat agit économiquement par le biais du budget. Ce dernier est
constitué de recettes et de dépenses correspondant aux ressources
et aux emplois publics.
1. Les recettes de l’Etat
Au Maroc, ces recettes sont principalement constituées par les
impôts. Les impôts indirects et les droits de douanes forment le
noyau de ces impôts.
2. Les dépenses publiques
Les dépenses de l’Etat se répartissent en dépenses courantes ou
ordinaires pour la majeure partie et en dépenses d’investissement.
3. Le déficit public
Les recettes permettant de financer les dépenses, lorsque ces
dernières sont plus importantes, l’Etat est dit en situation de déficit
budgétaire.
Deux groupes de facteurs peuvent être à l’origine d’un déficit
budgétaire. Le premier, d’ordre conjoncturel, englobe notamment
l’insuffisance de la croissance économique. Le second, d’ordre
structurel. Il s’agit de causes plus profondes telles que la croissance
démographique, le chômage, l’endettement...
Le déficit public peut être financé par la fiscalité. Mais lorsque cette
dernière est déjà trop élevée, l’Etat peut recourir à l’emprunt, soit
interne (épargne des agents économiques), soit externe (auprès des
organismes internationaux ou d’autres Etats)
Année universitaire 2006-2007 17
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Chapitre 2
L’EQUILIBRE GENERAL KEYNESIEN
I – L’EQUILIBRE EN ECONOMIE FERMEE
1. La demande globale et l’équilibre
En supposant que l’Etat n’intervient pas par ses dépenses et que
l’économie concernée n’est pas ouverte sur l’extérieur, la demande
globale (DG) est représentée par ce que les entreprises (I) et les
ménages (C) prévoient de dépenser en biens et services par rapport
à un niveau de revenu.
La fonction de la demande globale se présente de la manière
suivante (DG = C + I) :
La fonction de la demande globale
C DG = C + I
I
Année universitaire 2006-2007 18
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Pour une fonction de consommation donnée, la fonction de la
demande globale est située à un niveau supérieur quelque soit le
niveau du revenu.
La droite DG est parallèle à la fonction de consommation et leur
pente est déterminée par la propension marginale à consommer.
Définition de l’équilibre (optique production) :
Dans un contexte où les prix sont fixes et le produit est déterminé
par la demande, on dit que le marché des biens et services est en
équilibre (à court terme) lorsque la dépense globale prévue
(demande globale) est strictement égale au produit réalisé par les
entreprises.
Représentation graphique :
Graphiquement, l’équilibre est représenté par la rencontre de la
fonction de la demande et la bissectrice (droit à 45°). Cette
intersection détermine le produit d’équilibre (revenu d’équilibre)
Année universitaire 2006-2007 19
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
L’équilibre en économie fermée sans Etat
C C=Y
I
DG = C + I
E
DG
Y
Ye
S S
I
E I
0
Ye Y
-CO
Dans la conception keynésienne, c’est un équilibre de nature stable
dans la mesure où il est atteint dans le cadre d’un processus
d’ajustement par tâtonnement et c’est un équilibre de sous-emploi
qui se manifeste simultanément par un équilibre sur le marché des
biens et services et un déséquilibre sur le marché du travail
(chômage).
Année universitaire 2006-2007 20
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Selon Keynes, à ce niveau d’équilibre, les entreprises ne sont pas
incitées à embaucher des demandeurs d’emploi car il n’y a aucune
perspective d’augmentation de la production au-delà du niveau de la
demande (d’équilibre). Autrement dit, l’insuffisance de la demande
globale constitue un frein à l’augmentation de la production jusqu’à
son niveau de plein emploi.
2. Le multiplicateur keynésien
Concept fondamental dans la théorie générale de Keynes, le
multiplicateur mesure l’ampleur de la variation du produit (ou revenu
national) lorsque la demande globale change. Il dépend étroitement
de la propension marginale à consommer.
Le multiplicateur est noté : k = 1 / 1-c ou encore k = 1 / s
c : propension marginale à consommer
s : propension marginale à épargner
2.1. Le multiplicateur et le rôle des dépenses de consommation
La consommation est une composante de la demande globale et à
ce titre, elle génère un revenu. Le multiplicateur complète l’approche
du circuit économique par la consommation en montrant que dans
une logique dynamique, les dépenses jouent un rôle moteur en
permettant l’accroissement du produit et donc du revenu national.
Par le jeu de la diminution des stocks et de leur reconstitution par
l’augmentation de la production, un processus dynamique
s’enclenche à partir d’un point d’équilibre jusqu’à un autre qui
marque la fin de ce processus. L’effet de multiplication s’arrête
lorsque l’égalité suivante se réalise : Y = (1 / 1-c) I
Année universitaire 2006-2007 21
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Le phénomène du multiplicateur keynésien
C C=Y
I DG2
E2
DG1
I
E1
Y
Y1 Y2
2.2. Le multiplicateur et l’épargne
Le mécanisme du multiplicateur permet de démontrer que l’épargne
s’ajuste toujours automatiquement au besoin d’investissement :
l’augmentation de l’investissement se transforme en une
augmentation plus forte du revenu ( Y = k I) qui va engendrer une
augmentation de l’épargne jusqu’à la réalisation de l’égalité I = S.
Cette égalité est notée I = S pour spécifier qu’elle est le résultat du
fonctionnement du circuit économique.
L’ajustement automatique entre I et S par le multiplicateur ne
fonctionne qu’à condition que l’épargne ne soit pas demandée pour
elle-même.
Année universitaire 2006-2007 22
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
2.3. Les limites du multiplicateur
- Le multiplicateur ne peut avoir d’effet que si les facteurs de
production (capital et travail) sont sous-employés.
- L’effet multiplicateur n’est pas assez efficace si l’investissement
n’est pas répété ou reproduit à chaque période.
- Le multiplicateur est fondé sur le principe de la stabilité de la
propension marginale à consommer. Or, l’observation montre au
contraire que cette propension est instable.
- Le multiplicateur exclut de son fonctionnement l’investissement
« induit ».
- Dans le cas de figure où une économie est ouverte sur l’extérieur,
l’effet multiplicateur risque d’être limité par la fuite d’une partie de la
demande supplémentaire vers l’extérieur.
II – L’EQUILIBRE AVEC INTERVENTION DE L’ETAT
L’intervention de l’Etat dans l’économie se faisant par les dépenses
et par les impôts, son influence sur la demande globale se ressent
de deux manières.
D’un côté, les dépenses publiques (G) s’accumulent avec la
consommation et l’investissement pour constituer la demande
globale (DG = C + I + G).
La fonction de la demande globale est alors composée de trois
éléments exogènes : la demande d’investissement (I), la demande
publique (G) et la consommation incompressible (Co )
1
De l’autre côté, l’Etat prélève des impôts (T) qui viennent en
diminution du revenu initial des ménages. On parle alors de revenu
disponible (Y d) avec : Yd = Y - T
Les impôts sont considérés ici comme étant proportionnels au
revenu, ce qui permet d’exprimer un taux d’imposition (t) : T = t Y
Le revenu disponible exprime finalement la part que les ménages
sont autorisés à garder pour en disposer :
Yd = (1 - t) T
1
Par souci de simplification, nous supposons ici qu’il s’agit uniquement des impôts
directs et qu’il n’existe pas de transferts.
Année universitaire 2006-2007 23
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
De par ce taux d’imposition, l’impôt a un effet direct sur la fonction de
consommation : C = c (1 – t) Y
1. La dépense publique et l’équilibre
En l’absence de l’impôt (supposition), la dépense publique agit sur la
demande globale de la même manière que l’investissement.
Une variation de la demande grâce à une augmentation de la
dépense publique entraîne une augmentation plus importante du
revenu par le jeu du multiplicateur des dépenses publiques :
Y = (1 / 1-c) G
2. Les impôts et l’équilibre
La proportionnalité de l’impôt par rapport au revenu et son impact
sur la consommation, fait que la fonction de la demande globale est
affaiblie.
L’ampleur de la baisse du revenu d’équilibre est mesurée par le
multiplicateur fiscal : Y = (-c / 1-c ) T
La valeur négative de ce multiplicateur exprime la relation inverse
qui lie l’impôt au revenu.
Impôts et diminution de l’équilibre
C=Y
C
I
DG1 = C + I
DG2 (avec T)
I
E
DG
Y
Y2 Y1
Année universitaire 2006-2007 24
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
3. Effet combiné des multiplicateurs des dépenses et fiscal
Le recours simultané de l’Etat aux impôts et aux dépenses a pour
conséquence de combiner leurs deux effets.
Lorsque l’augmentation de la dépense publique est moins importante
que celle de l’impôt, le revenu d’équilibre diminue. Cela s’explique
par le fait que l’effet de diminution du revenu dû à l’impôt a été
prédominant face à la faiblesse de la variation de la dépense
publique.
Lorsque les augmentations de la dépense publique et des impôts
sont identiques, le revenu s’accroît. La variation du revenu est donc
positive. Cela s’explique par le fait, qu’à variations en valeurs égales
et pour une propension marginale à consommer donnée, l’effet de
multiplicateur fiscal est moins important que celui du multiplicateur
des dépenses publiques. Ce phénomène est appelé « le
multiplicateur du budget équilibré » ou « théorème d’Haavelmo ».
II – L’EQUILIBRE EN ECONOMIE OUVERTE
L’ouverture d’une économie sur l’extérieur implique de prendre en
considération deux nouvelles variables : les exportations (X) et les
importations (M).
Les exportations viennent en augmentation de la valeur du PIB
(produit) et les exportations contribuent à sa diminution.
L’équation comptable de l’équilibre devient la suivante :
Y = C + I + G + X – M ; où (X – M) représente les exportations nettes
1. L’équilibre avec les exportations et importations
Lorsque le commerce extérieur est introduit dans le modèle,
l’équilibre est influencé par les effets respectifs des exportations
(demande externe destinée à la nation) et des importations
(demande interne adressée à l’extérieur)
Année universitaire 2006-2007 25
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Equilibre en économie ouverte
C=Y
C, I,
G, XN DG1 = C + I + G
DG2 = C+I+G+XN
E
EC
Y
Y2 Y1
S, M,
I, X
S+ M
E I+X
M
X
EC
0 Y
Y2
Année universitaire 2006-2007 26
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
2. Le multiplicateur en économie ouverte
Dans ce nouveau cadre d’équilibre, le multiplicateur va connaître
une transformation sous l’effet de la propension marginale à
importer. En effet, le multiplicateur va être affaibli du fait qu’une
partie des biens et services consommés ne sont pas produits
localement mais importée (influence de «m »). Plus la valeur de
« m » est élevée, plus la force du multiplicateur est réduite.
Le multiplicateur en économie ouverte qui permet de mesurer
l’impact d’une variation du commerce extérieur sur le revenu tout en
tenant compte du niveau des importations est noté :
k = 1 / s+m (s : propension marginale à épargner)
Année universitaire 2006-2007 27
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Chapitre 3
L’EQUILIBRE CLASSICO-KEYNESIEN
Après la représentation keynésienne de l’équilibre, l’économiste J.
Hicks a proposé en 1937 une nouvelle élaboration de l’équilibre qui a
été popularisée par A. Hansen.
Le principe de ce modèle est de définir l’équilibre globale, ou
simultané, à partir de deux autres équilibres.
Le premier sur le marché des biens et services (construction de la
courbe IS ) et le second sur le marché de la monnaie (construction de
la courbe LM).
I – L’EQUILIBRE SUR LE MARCHE DES BIENS ET SERVICES
1. Construction et signification de la courbe IS
La construction de la courbe IS est fondée sur les postulats
suivants : Il est supposé que les dépenses publiques et les impôts
sont constants et que la masse monétaire est le niveau des prix sont
donnés.
La courbe IS, qui exprime la condition d’équilibre sur le marché des
biens et services (I = S), se détermine comme suit : (voir graphique)
2. Le déplacement de la courbe IS
La courbe IS se déplace sous l’influence de facteurs tel que
l’investissement.
La décision d’investir dépendant également de facteurs subjectifs,
les entrepreneurs peuvent augmenter leur niveau d’investissement
(au-delà du niveau optimal permis par le taux d’intérêt) en raison, par
exemple, d’un plus grand optimisme concernant les résultats futurs
de leurs entreprises.
Dans ce cas, les entrepreneurs augmentent leur investissement
autonome. Cela se traduit par le déplacement de la courbe IS vers la
droite suite au déplacement de la fonction d’investissement vers la
droite.
Année universitaire 2006-2007 28
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Construction de la courbe IS
S S = Y- cY S
g S1 f
III II
c S1 b
Y I
Y1 Y2 I1 I2
i i
IS
d a
i1 i1
IV I
h e
i2 i2
I = f(i)
Y I
Y1 Y2 I1 I2
Année universitaire 2006-2007 29
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
II – L’EQUILIBRE SUR LE MARCHE DE LA MONNAIE
L’équilibre sur le marché de la monnaie est représenté par la courbe
LM qui exprime l’égalité entre la demande de monnaie (L) et l’offre
de monnaie (M).
1. L’offre et la demande de monnaie
L’offre de monnaie est le fait de la banque centrale car c’est elle qui
détermine le volume de la masse monétaire en circulation (donnée
exogène).
La demande de monnaie est le fait des agents économiques non
financiers tels que les ménages par exemple.
Cette demande répond à des besoins divers que Keynes regroupe
en trois catégories :
- La demande de monnaie pour motif de transaction (Mt )
- La demande de monnaie pour motif de précaution (Mp)
- La demande de monnaie pour motif de spéculation (Ms )
Considérant que Mt et Mp sont homogène, on peut distinguer entre
deux demande de monnaie : M1 = Mt + Mp et M2 = Ms
(M2 dépend du taux d’intérêt et de la relation inverse qui existe entre
ce taux et la valeur des actifs financiers que possèdent les agents).
2. Construction et interprétation de la courbe LM
De la même manière que la courbe IS, la courbe LM, qui reflète
l’équilibre sur le marché de la monnaie à travers l’égalité entre la
demande de monnaie (L) et l’offre (M), se détermine en quatre
étapes (voir graphique)
3. Le déplacement de la courbe LM
La création de la monnaie ou sa destruction agit sur la droite LM en
la déplaçant respectivement vers la droite ou vers la gauche. Dans le
cas d’une création monétaire c’est-à-dire une augmentation de l’offre
monétaire, à demande de spéculation constante, la demande de
monnaie pour transaction augmente et par conséquent le niveau du
Année universitaire 2006-2007 30
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
revenu est revu à la hausse. L’accroissement de (M1 ) agit comme un
stimulant pour la production.
Construction de la courbe LM
M1 M1
M1=M1(Y) OM=DM
g F f
III c b II
B
Y M2
C G E A
i i
LM
M2=M2(i)
h e
i2 i
IV I
d a
i1 i
Y M2
C G E A
Année universitaire 2006-2007 31
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
III – L’EQUILIBRE SIMULTANE
L’équilibre est simultané lorsque le taux d’intérêt et le revenu sont à
des niveaux qui expriment aussi bien l’équilibre du marché des biens
et services que celui de la monnaie.
Cet équilibre est représenté par la rencontre des deux droites IS et
LM au point d’équilibre (E) qui correspond à un taux d’intérêt i = ie et
à un revenu d’équilibre (Y e).
Equilibre simultané
IS LM
ie
Y
Ye
Année universitaire 2006-2007 32
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
Chapitre 4
LA POLITIQUE BUDGETAIRE
En tant qu’axe de la politique économique conjoncturelle, la politique
budgétaire est liée aux finances publiques à travers le budget.
La politique budgétaire peut être définie comme l’utilisation par l’Etat
des recettes et des dépenses pour agir sur les flux des revenus du
circuit économique.
Ces moyens ou instruments d’action budgétaire peuvent être
analysés, selon leur caractère volontaire ou pas, de deux manières.
I – Les instruments automatiques
La politique budgétaire dispose d’un ensemble de mécanismes
automatiques qui permettent de stabiliser le niveau d’activité
économique qui est en fluctuations permanentes. C’est le cas
notamment des impôts.
Les recettes fiscales ont tendance à s’ajuster de manière
automatique aux variations du revenu en stabilisant ce dernier. Ainsi,
en période de prospérité, quand le revenu augmente, les impôts
augmentent aussi et constituent une fuite du circuit économique qui
exerce une pression à la baisse du revenu. Inversement, en période
de récession, les recettes fiscales diminuent (car le revenu diminue),
ce qui favorise à nouveau l’augmentation de la demande et donc du
revenu.
Conséquences des instruments automatiques :
- Ces stabilisateurs sont des facteurs qui ont pour effet d’accroître
les déficits publics en période de récession et de les diminuer en
période d’expansion et cela sans l’intervention volontaire des
autorités publiques.
- La stabilisation automatique est un phénomène qui peut avoir,
selon les cas, un effet favorable ou défavorable selon si on est en
situation de sous -emploi ou proche du plein emploi.
Année universitaire 2006-2007 33
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
II – Les instruments discrétionnaires
Bien que les stabilisateurs automatiques permettent de réguler
l’activité économique, elles ne peuvent à elles seules supprimer les
fluctuations qui affectent cette dernière. Ces fluctuations restent
suffisamment importantes pour appeler une action volontariste des
autorités publiques par le biais des instruments discrétionnaires de la
politique budgétaire.
Les recettes et les dépenses budgétaires sont les principaux
instruments de cette politique en raison de leur impact sur la
demande globale.
La question qui s’impose est de savoir lequel des deux instruments
faut-il choisir ; ou serait-il plus indiqué d’utiliser les deux. Sur le plan
du principe et en tenant compte de l’effet multiplicateur, la
démonstration de Haavelmo semble montrer qu’à variations
identiques en valeur, l’action de la dépense est porteuse de plus de
résultat en terme d’augmentation nette du revenu.
Sur un autre plan, lorsque la récession touche un secteur particulier
ou une région déterminée, la relance économique par des dépenses
publiques bien orientées semble plus pertinente car une diminution
des impôts aurait un impact initial généralisé.
III – Effet de la politique budgétaire
Pour couvrir l’excès des dépenses sur les recettes, l’Etat peut
recourir à plus d’impôt, à l’emprunt ou encore à la création
monétaire. Le mode de financement choisi contribue à définir les
effets de la politique budgétaire.
De manière générale, toute politique budgétaire expansionniste, soit
par l’augmentation des dépenses et/ou par la diminution des impôts,
produit un accroissement de la demande et donc du niveau d’activité
économique, accompagnée d’une amélioration de la situation de
l’emploi.
La politique budgétaire produit également des effets secondaires
indésirables :
Année universitaire 2006-2007 34
MACRO II – Support de cours (S3) Omar BELKHEIRI
- La relance économique par l’augmentation de la demande entraîne
une augmentation du taux d’intérêt. Cette hausse est due à un
déséquilibre sur le marché de la monnaie : la croissance du revenu
(déplacement de la droite IS) nécessite une demande de monnaie
de transaction à laquelle l’offre de monnaie ne répond pas (elle
demeure constante) et l’excès de la demande sur l’offre entraîne
l’augmentation du taux d’intérêt. Par conséquent, l’investissement
est déprimé (effet d’éviction) et la consommation est réduite.
- L’effet d’éviction peut être expliqué également comme étant le
résultat du recours à l’emprunt pour financer le déficit public. En
effet, dans ce cas de figure, l’Etat entre en concurrence avec les
entreprises dans la demande des fonds privés (épargne privée). Il
s’en suit une spirale d’augmentation du taux d’intérêt rémunérateur
des titres de créance émis (obligations, bons de trésor). Cette
hausse est relativement faible si l’épargne oisive est disponible.
Dans le cas contraire, la hausse des taux d’intérêt devient plus
importante au point de pénaliser les entreprises désirant investir en
les évinçant du marché financier.
- Lorsque la politique budgétaire est fondée sur un financement par
création monétaire, dans un premier temps, cela ne réduit pas l’effet
positif de l’augmentation des dépenses, mais une augmentation trop
importante de la masse monétaire risque de déclencher un
processus inflationniste et un déséquilibre de la balance des
paiements. De cette manière, l’effet recherché de la demande sera
vite contourné par la hausse des prix et le déséquilibre externe.
Année universitaire 2006-2007 35
Vous aimerez peut-être aussi
- Recueil d'exercices d'économie: 330 questions et exercices corrigés de microéconomie, macroéconomie, et économie internationaleD'EverandRecueil d'exercices d'économie: 330 questions et exercices corrigés de microéconomie, macroéconomie, et économie internationalePas encore d'évaluation
- Macroéconomie L2 S3etS4Document73 pagesMacroéconomie L2 S3etS4Nuninho10100% (1)
- Chapitre3. Le Modèle Offre Globale - Demande GlobaleDocument23 pagesChapitre3. Le Modèle Offre Globale - Demande GlobaleYosra BaazizPas encore d'évaluation
- Insertion Professionnelle Des Adultes Ayant Un Trouble Autistique Ou Syndrôme D' Asperger Au QuébecDocument82 pagesInsertion Professionnelle Des Adultes Ayant Un Trouble Autistique Ou Syndrôme D' Asperger Au QuébecCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Macroéco1.Cours Et ExercicesDocument79 pagesMacroéco1.Cours Et ExercicesAsma Sallemi100% (1)
- Cours Economie Hec Prépa 22Document47 pagesCours Economie Hec Prépa 22Mareea NegPas encore d'évaluation
- 2016 Economie Publique Corrige TD 9Document4 pages2016 Economie Publique Corrige TD 9Mikapanga100% (1)
- Macro Econom I eDocument94 pagesMacro Econom I etomPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Microeconomie CDocument30 pagesChapitre 1 Microeconomie CalaPas encore d'évaluation
- COURS DE MACROÉCONOMIE v1Document56 pagesCOURS DE MACROÉCONOMIE v1Altafallah MissaouiPas encore d'évaluation
- Cours de MacroéconomieDocument9 pagesCours de MacroéconomieSaadiPas encore d'évaluation
- Cours de Microéconomie Appliquée À La Finance 2021-2022Document47 pagesCours de Microéconomie Appliquée À La Finance 2021-2022s889mkx7jyPas encore d'évaluation
- CahierExercice PDFDocument44 pagesCahierExercice PDFwassimPas encore d'évaluation
- Theorie Du Consom LareqDocument40 pagesTheorie Du Consom LareqjilaniosmanePas encore d'évaluation
- Operations FinancieresDocument92 pagesOperations FinanciereslayanePas encore d'évaluation
- Serie 3Document2 pagesSerie 3Ghazi Ben JaballahPas encore d'évaluation
- Le Modele AS-ADDocument26 pagesLe Modele AS-ADYosra BaazizPas encore d'évaluation
- Séance 4 - Modèle À Erreurs ComposéesDocument52 pagesSéance 4 - Modèle À Erreurs ComposéesayoubhaouasPas encore d'évaluation
- TD 5Document2 pagesTD 5Abdelkaber abdelkaberPas encore d'évaluation
- Macro Chap 2 - Les Marchés Des Biens Et ServicesDocument25 pagesMacro Chap 2 - Les Marchés Des Biens Et ServicesJosé Ahanda Nguini0% (1)
- Econométrie Séries Temporelles - L3 EconomieDocument33 pagesEconométrie Séries Temporelles - L3 Economieabou konan100% (1)
- Chap1 La Monnaie - Fonctions Formes MesureDocument38 pagesChap1 La Monnaie - Fonctions Formes MesureDjilene Diop100% (1)
- Cours Économétrie Licence3 2023Document99 pagesCours Économétrie Licence3 2023Souleymane YeoPas encore d'évaluation
- Exercice D'économetrie LILIANDocument9 pagesExercice D'économetrie LILIANlilian alléchiPas encore d'évaluation
- Cours Macroéconomie - L2 - SEG - 2-1Document49 pagesCours Macroéconomie - L2 - SEG - 2-1KAMBOU JULESPas encore d'évaluation
- Syllabus Cours Microecodev M1 - EcoDocument7 pagesSyllabus Cours Microecodev M1 - EcoEliada OlapadePas encore d'évaluation
- Cours de Macroéconomie IIDocument67 pagesCours de Macroéconomie IIamourPas encore d'évaluation
- Correction MicroDocument10 pagesCorrection MicroAwa Diop100% (1)
- Microéconomie de L'incertitudeDocument51 pagesMicroéconomie de L'incertitudeJEAN OUMAR THIANEPas encore d'évaluation
- Cours Macroeconomie AppliqueeDocument5 pagesCours Macroeconomie AppliqueekabbalahhPas encore d'évaluation
- 2 Exercices Corriges de MicroeconomieDocument7 pages2 Exercices Corriges de MicroeconomieHamid AzizPas encore d'évaluation
- L Economie Du Bien EtreDocument33 pagesL Economie Du Bien EtreAbdlghni Rahmouni100% (1)
- Pr. Bouzahzah TD Macroeconomie 2019-2020Document31 pagesPr. Bouzahzah TD Macroeconomie 2019-2020hamdi fekkakPas encore d'évaluation
- Séance 7 - Tests D'hypothèses en Données de PanelDocument28 pagesSéance 7 - Tests D'hypothèses en Données de PanelayoubhaouasPas encore d'évaluation
- Introduction Micro EconomieDocument13 pagesIntroduction Micro Economiestrasys1Pas encore d'évaluation
- Cours Théorie Du Producteur - 2019Document45 pagesCours Théorie Du Producteur - 2019Hurbain GbaméléPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - CointegrationDocument18 pagesChapitre 3 - CointegrationsambaPas encore d'évaluation
- 2021 2022 Fiche de Travaux Diriges de Dynamique EconomiqueDocument4 pages2021 2022 Fiche de Travaux Diriges de Dynamique EconomiqueGuillaume KOUASSI100% (4)
- Présentation Panel 2014Document72 pagesPrésentation Panel 2014CHEIKH FALIT0% (1)
- Cours Microéconomie 1 PDFDocument127 pagesCours Microéconomie 1 PDFZi EdPas encore d'évaluation
- Le Panel DynamiqueDocument17 pagesLe Panel DynamiquesmatiPas encore d'évaluation
- Macroeconomie - Partie 1 - Chapitre 3 - Revenu National D Equilibre Et Multiplicateur D InvestissementDocument8 pagesMacroeconomie - Partie 1 - Chapitre 3 - Revenu National D Equilibre Et Multiplicateur D InvestissementHassan Huit Douz100% (1)
- Politique Économique Du DéveloppementDocument220 pagesPolitique Économique Du DéveloppementBoubacar TemePas encore d'évaluation
- Introduction A L'econometrie-1Document41 pagesIntroduction A L'econometrie-1Housseyni Guindo100% (1)
- Creation MonetaireDocument3 pagesCreation MonetaireAissa HayatoPas encore d'évaluation
- Cours Econometrie Licence 3 Economie Umeci 28 04 2020Document53 pagesCours Econometrie Licence 3 Economie Umeci 28 04 2020Aaron TxgxPas encore d'évaluation
- TD N - 1 E - Conomie Mone - Taire Et Financie - ReDocument6 pagesTD N - 1 E - Conomie Mone - Taire Et Financie - ReimaneeePas encore d'évaluation
- Le Modèle de RAMSEYDocument20 pagesLe Modèle de RAMSEYAmine Zoldic100% (1)
- PR - Nizar Elkasmi 9-11-2020 EMF1.CHAP IDocument202 pagesPR - Nizar Elkasmi 9-11-2020 EMF1.CHAP INizar AhnanPas encore d'évaluation
- La Theorie Du Consommateur PDFDocument48 pagesLa Theorie Du Consommateur PDFYoussef LMPas encore d'évaluation
- Pratique de L'économétrie Linéaire - 2 - HétéroscédasticitéDocument40 pagesPratique de L'économétrie Linéaire - 2 - HétéroscédasticitéouPas encore d'évaluation
- Cours Micro Economie S1Document116 pagesCours Micro Economie S1Amine TabbaiPas encore d'évaluation
- Econométrie 2023Document64 pagesEconométrie 2023Patrick MulebaPas encore d'évaluation
- 01-PPT Math Financiere - CoursDocument15 pages01-PPT Math Financiere - CoursKhadija AbdelPas encore d'évaluation
- TD de Politique Economique Ea 2019-2020 PDFDocument3 pagesTD de Politique Economique Ea 2019-2020 PDFChristiane FLACANDJIPas encore d'évaluation
- Cours D'économie Monétaire 2ème Année. 2013 PDFDocument79 pagesCours D'économie Monétaire 2ème Année. 2013 PDFkoudougou100% (1)
- Is LMDocument19 pagesIs LMB.IPas encore d'évaluation
- L'analyse des données de sondage avec SPSS: Un guide d'introductionD'EverandL'analyse des données de sondage avec SPSS: Un guide d'introductionPas encore d'évaluation
- Autisme: Une Perception DifférenteDocument21 pagesAutisme: Une Perception DifférenteCaroline Baillez100% (1)
- Introduction Aux Neurosciences ComportementalesDocument19 pagesIntroduction Aux Neurosciences ComportementalesCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- B.D.: Lucky Luke - L'ArnaqueDocument24 pagesB.D.: Lucky Luke - L'ArnaqueCaroline Baillez67% (3)
- 10 Recommandations Pour Interagir Avec Des Enfants AutistesDocument1 page10 Recommandations Pour Interagir Avec Des Enfants AutistesCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- La Dépression Chez Les Personnes Autistes Ou AspergerDocument10 pagesLa Dépression Chez Les Personnes Autistes Ou AspergerCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Témoignage D' Une Fille AspergerDocument3 pagesTémoignage D' Une Fille AspergerCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Une Large Ration Du Dernier Livre de Tony AttwoodDocument6 pagesUne Large Ration Du Dernier Livre de Tony AttwoodCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Mon Cahier D'EuropeDocument61 pagesMon Cahier D'EuropeCaroline Baillez100% (2)
- Manisfestation de La PrécaritéDocument6 pagesManisfestation de La PrécaritéCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Guide de Rédaction Pour Une Information AccessibleDocument64 pagesGuide de Rédaction Pour Une Information AccessibleCaroline Baillez100% (1)
- Mon Cahier D'EuropeDocument61 pagesMon Cahier D'EuropeCaroline Baillez100% (2)
- Des Mots Pour Le DireDocument82 pagesDes Mots Pour Le DireCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Comprendre Le Cerveau Cle6fb68cDocument282 pagesComprendre Le Cerveau Cle6fb68cAmine Pitá100% (2)
- Syndrome D' Asperger: Evaluation, Diagnostic Et CompréhensionDocument8 pagesSyndrome D' Asperger: Evaluation, Diagnostic Et CompréhensionCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Les Aspergers Dans Les Oeuvres de Fiction ActuellesDocument7 pagesLes Aspergers Dans Les Oeuvres de Fiction ActuellesCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- L' Intervention de L' Ergothérapeute Auprès Des Enfants Autistes Ou AspergerDocument6 pagesL' Intervention de L' Ergothérapeute Auprès Des Enfants Autistes Ou AspergerCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- Instruction No 024-11-2016 - Relative A La Definition Des AttributsDocument27 pagesInstruction No 024-11-2016 - Relative A La Definition Des AttributsBarry MamadouPas encore d'évaluation
- Les Indicateurs de PerformanceDocument11 pagesLes Indicateurs de PerformancefrellePas encore d'évaluation
- Théorie Des Options MEFIDocument102 pagesThéorie Des Options MEFITheonlyone01100% (2)
- Crowd FundingDocument30 pagesCrowd FundingMustapha Elmoadin100% (4)
- Financial Afrik 15 ADA BD 1Document24 pagesFinancial Afrik 15 ADA BD 1Abderazak KcmPas encore d'évaluation
- Ashoka, Social Entrepreneurship, Revue - Copie PDFDocument12 pagesAshoka, Social Entrepreneurship, Revue - Copie PDFFatiha ArsmoukPas encore d'évaluation
- Corrigé W1 Q4 Méthode Additive TD 2ème Année S3 Tronc Commun ADF ENCG El Jadida 2020 2021 N 3Document1 pageCorrigé W1 Q4 Méthode Additive TD 2ème Année S3 Tronc Commun ADF ENCG El Jadida 2020 2021 N 3Abdelkhalek OuassiriPas encore d'évaluation
- Analyse Financiere Devoir de RechercheDocument8 pagesAnalyse Financiere Devoir de RechercheNeury MoussoyiPas encore d'évaluation
- Exercice Intensive D - Amortissement (1ère Année Master) PDFDocument3 pagesExercice Intensive D - Amortissement (1ère Année Master) PDFOuadichPas encore d'évaluation
- State Street Corporation - WikipédiaDocument3 pagesState Street Corporation - WikipédiaAutre ChosePas encore d'évaluation
- Impôt Sur La Société ExercicesDocument5 pagesImpôt Sur La Société ExercicesomarPas encore d'évaluation
- Exercice 2Document3 pagesExercice 2ABDOUL KARIM METOU DOSSOPas encore d'évaluation
- 5385 D 4 e 81 DF 8 CDocument29 pages5385 D 4 e 81 DF 8 Ckaidi chaimaa100% (1)
- Cours de La Gestion de La Trésorerie Eurom. 22 04 2022Document33 pagesCours de La Gestion de La Trésorerie Eurom. 22 04 2022touimar hamzaPas encore d'évaluation
- Agrégats Comptabilité NationaleDocument1 pageAgrégats Comptabilité NationaleZakariaPas encore d'évaluation
- Tableau de Flux de La CDBDocument12 pagesTableau de Flux de La CDBonokokoskillPas encore d'évaluation
- Cyrille Chevrillon - Les 100Document53 pagesCyrille Chevrillon - Les 100ioan domenicPas encore d'évaluation
- Comptabilite Privee Et Comptabilite PubliqueDocument4 pagesComptabilite Privee Et Comptabilite PubliqueSab DiopPas encore d'évaluation
- Projet de Loi Des Finances 2011Document267 pagesProjet de Loi Des Finances 2011Abd ElhafidPas encore d'évaluation
- Technique de Gestion Et Ingénierie Financière AppliquéDocument5 pagesTechnique de Gestion Et Ingénierie Financière AppliquéSaad BelayachPas encore d'évaluation
- Le Financement Bancaire D'un Projet D'investissementDocument93 pagesLe Financement Bancaire D'un Projet D'investissementmusta mustaPas encore d'évaluation
- Cours MACROECONOMIEDocument60 pagesCours MACROECONOMIEBen TanfousPas encore d'évaluation
- AlltogetherDocument22 pagesAlltogetherVinicius NativioPas encore d'évaluation
- Lean ManufactringDocument86 pagesLean ManufactringMohammed Chbani50% (2)
- Le Capital RisqueDocument77 pagesLe Capital RisqueKaba Mohamed EdmondPas encore d'évaluation
- Lettre D Engagement - Appel Projet DCPC 2020Document3 pagesLettre D Engagement - Appel Projet DCPC 2020Florent RatengayePas encore d'évaluation
- 53 DBC 12 D 02847Document24 pages53 DBC 12 D 02847Ikram SerribouPas encore d'évaluation
- Syllabus DSCGDocument31 pagesSyllabus DSCGdodge666100% (1)
- 20 Conseils Pour Devenir Un Trader Forex Rentable PDFDocument24 pages20 Conseils Pour Devenir Un Trader Forex Rentable PDFKouassi Justin Yao100% (1)
- Le Leverage Buy-OutDocument26 pagesLe Leverage Buy-OutB.I100% (2)