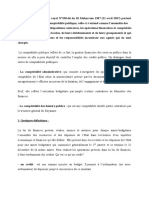Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lorganisation de La Comptabilité de Letat Au Maroc
Lorganisation de La Comptabilité de Letat Au Maroc
Transféré par
Oussama Abdel-IlahCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lorganisation de La Comptabilité de Letat Au Maroc
Lorganisation de La Comptabilité de Letat Au Maroc
Transféré par
Oussama Abdel-IlahDroits d'auteur :
Formats disponibles
ORGANISATION COMPTABLE ET TENUE
DE LA COMPTABILITE DE LETAT
AU MAROC
Mimoun LMIMOUNI
AFRITAC CENTRE
Douala: 26-29 Octobre 2009
PLAN DE LA PRESENTATION
I- Introduction
II- Organisation de la comptabilit de lEtat
III- Porte et limites de la comptabilit de lEtat
IV- Handicaps du cadre comptable actuel
V- Objectifs assigns la rforme comptable
VI- Apports attendus du plan comptable de lEtat
VII- Gense de llaboration du plan comptable de lEtat
VIII- Conclusion
I- INTRODUCTION
Les principes gnraux, le champ dapplication et les rgles
denregistrement de la comptabilit de lEtat ont t dfinis au niveau
du rglement gnral de comptabilit publique (Dcret royal du 21
Avril 1967).
La comptabilit est tenue par les comptables, par anne budgtaire,
selon la mthode de la partie double et elle comprend :
une comptabilit budgtaire qui retrace lexcution des autorisations
budgtaires,
et une comptabilit gnrale qui retrace la fois les oprations
budgtaires et les oprations de trsorerie.
Les oprations comptables peuvent recevoir, selon le cas, une
imputation provisoire ou une imputation dfinitive.
Les comptables assignataires sont seuls habilits donner une
imputation dfinitive aux oprations de recettes et de dpenses.
II- ORGANISATION DE LA COMPTABILITE DE LETAT
1/7
La comptabilit de lEtat est organise autour dune comptabilit
gnrale et dune comptabilit budgtaire.
La comptabilit budgtaire comprend, pour sa part, une comptabilit
administrative, tenue par les ordonnateurs et sous-ordonnateurs de lEtat,
et une comptabilit trsor tenue par les comptables publics de lEtat.
La comptabilit trsor comprend:
Une comptabilit deniers,
Une comptabilit matires, valeurs et titres.
La comptabilit gnrale, tenue par les comptables publics, permet de
suivre aussi bien les oprations budgtaires que les oprations de
trsorerie.
Elle est organise de manire permettre de dgager les rsultats
dexcution de la loi de finances ainsi que des oprations de trsorerie qui
en dcoulent.
II- ORGANISATION DE LA COMPTABILITE DE
LETAT 2/7
La comptabilit gnrale est tenue de manire dconcentre
par le rseau des comptables de lEtat et comprend:
la comptabilit des comptables de base ;
la comptabilit des comptables pr-centralisateurs au niveau
prfectoral et provincial;
Ces comptabilits sont centralises au niveau national par
un oprateur national ;
La tenue des comptabilits par le rseau des comptables est
porte par des applications informatiques dveloppes en
interne dune manire progressive.
II- ORGANISATION DE LA COMPTABILITE DE
LETAT 3/7
La comptabilit de lEtat est tenue par le rseau des
comptables publics, compos :
Du Trsorier principal, comptable centralisateur national,
Des trsoriers ministriels ou interministriels,
Des comptables spciaux du Parlement et de la Cour des
Comptes,
Des trsoriers prfectoraux et provinciaux,
Des percepteurs,
Des receveurs de lAdministration Fiscale,
Des receveurs comptables des douanes et impts indirects.
II- ORGANISATION DE LA COMPTABILITE DE
LETAT 4/7
La comptabilit administrative, comptabilit partie simple, est
organise de manire permettre aux ordonnateurs de suivre
l'excution des autorisations budgtaires, savoir :
la consommation des crdits aux stades de lengagement et de
lordonnancement des dpenses, ainsi que le suivi des effectifs
budgtaires dune part,
et lmission des ordres des ordres dautre part.
La comptabilit administrative est tenue par l'ordonnateur
pour les oprations de son dpartement.
Les oprations comptabilises par les sous-ordonnateurs sont
reprises dans les critures de l'ordonnateur dont ils dpendent.
II- ORGANISATION DE LA COMPTABILITE DE
LETAT 5/7
Les ordonnateurs tiennent une comptabilit pour suivre
l'excution donne :
au budget gnral de l'Etat ;
chacun des budgets des services de lEtat grs de
manire autonomes (SEGMA);
chacune des catgories de comptes spciaux.
A l'expiration de la gestion, les ordonnateurs tablissent
leur compte administratif par chapitres, articles et
paragraphes.
II- ORGANISATION DE LA COMPTABILITE DE
LETAT 6/7
Le compte administratif fait ressortir :
les prvisions de recettes,
les crdits dfinitifs dcoulant de la loi de finances de l'anne,
des lois de finances rectificatives, des prlvements oprs sur
le chapitre des dpenses imprvues et des virements de crdit,
les engagements de dpenses,
les dpenses vises par les comptables,
les recettes ordonnances au cours de la priode budgtaire
considre.
Ces rsultats sont prsents en deux tableaux, l'un
concernant les recettes, l'autre les dpenses.
II- ORGANISATION DE LA COMPTABILITE DE
LETAT 7/7
Des dveloppements annexes aux tableaux viss ci-dessus font
connatre, avec les dtails propres chaque nature de service :
Pour les recettes, les prvisions dfinitives, les droits nets
constats et leur diffrence ;
Pour les dpenses, les crdits rsultant des lois de finances, les
dpenses liquides, les ordonnancements viss par le comptable,
les crances restant ordonnancer, les dpassements de crdit ou
les crdits sans emploi ;
Les acquisitions, alinations de proprit et concessions de
jouissance du domaine priv de l'Etat effectues pendant l'anne
considre ;
Enfin, tous les renseignements de nature clairer l'examen des
faits relatifs la gestion administrative et financire de l'exercice
budgtaire ou en complter la justification.
III- PORTEE ET LIMITES DE LA COMPTABILITE
DE LETAT 1/4
La comptabilit gnrale de lEtat actuelle :
se limite au classement et lenregistrement des
oprations budgtaires et de trsorerie dans une
simple nomenclature de comptes qui sarticule
difficilement avec la comptabilit nationale,
est qualifie de comptabilit de caisse et ne permet
de suivre que les mouvements lis aux paiements et
aux dcaissements.
III- PORTEE ET LIMITES DE LA COMPTABILITE
DE LETAT 2/4
La comptabilit gnrale ne prend en compte ni le principe de la
constatation des droits et des obligations, ni la comptabilit dexercice,
Elle ne prend pas en compte non plus la dimension patrimoniale de
lEtat,
En ce sens que cest le systme de gestion qui prvaut actuellement,
puisque :
seuls les flux (encaissements et dcaissements) sont comptabiliss,
et les oprations prises en compte, sur la base caisse , au titre de la
gestion au cours de laquelle :
une dpense a t vise par le comptable assignataire, indpendamment
de la date de son paiement;
la recette a t encaisse par un comptable public.
La comptabilit gnrale ne permet pas non plus une intgration
directe des oprations financires de lEtat dans la comptabilit
nationale, sans que celles-ci naient donn lieu au pralable des
retraitements.
III- PORTEE ET LIMITES DE LA COMPTABILITE
DE LETAT 3/4
La nomenclature actuelle qui remonte 1935, a t rvise en 1960 mais
sans volution majeure.
Elle comporte 9 groupes de comptes qui se prsentent comme suit:
1- Disponibilits et valeurs mobilisables,
2- Oprations budgtaires,
3- Comptes spciaux du trsor,
4- Avances et prts du trsor,
5- Dettes de lEtat (Emprunts et Engagements),
6- Correspondants administratifs,
7- Oprations de tiers,
8- Oprations classer,
9- Comptes de Rsultats.
Cette nomenclature est loin de rpondre aux objectifs dune
vritable comptabilit dentreprise et ne permet donc pas de donner une
image fidle de la situation financire et patrimoniale de lEtat.
III- PORTEE ET LIMITES DE LA COMPTABILITE DE
LETAT 4/4
En dpit de ses limites, la comptabilit gnrale de lEtat
permet, aprs retraitement des oprations au niveau central,
dassurer :
lanalyse financire, le suivi des flux de trsorerie et
llaboration des tableaux de bord ncessaires au pilotage de
lexcution du budget;
la consolidation des comptes de lEtat et ceux des
collectivits locales, aprs retraitement et neutralisation des
oprations dordre;
la production la cour des comptes, dans les dlais, des
comptes des services de lEtat totalement informatiss, dont
certaines pices justificatives ont t dmatrialises;
llaboration des comptes gnraux de lEtat et des projets
de lois de rglement prsents au parlement.
IV- HANDICAPS DU CADRE COMPTABLE ACTUEL
Le principal handicap du cadre comptable actuel cest quil
senserre dans une logique de comptabilit budgtaire se limitant
lenregistrement des oprations budgtaires et de trsorerie dans la
seule optique: encaissements-dcaissements.
Cette optique rductrice ne favorise pas la production
dinformations financires cibles, mme de permettre :
Lapprciation des rsultats ;
La mesure des performances ;
La pertinence de la dcision .
Do la ncessit ressentie de moderniser le cadre comptable existant
et dlaborer et mettre en place un plan comptable gnral de lEtat,
sinspirant du code gnral de normalisation comptable (CGNC)
adopt par le Maroc au dbut de la dcennie 90.
V- OBJECTIFS ASSIGNS A LA RFORME COMPTABLE
Le Plan Comptable de lEtat sest fix pour objectif :
de permettre de consolider toutes les rformes engages depuis,
pour moderniser la gestion publique;
dtre le pivot du futur systme dinformation financire de
lEtat.
En faire un outil mme dapprhender lensemble de lactif et
du passif de lEtat, en vue :
dune connaissance exhaustive des situations financire et
patrimoniale de lEtat ;
de la production dune information de meilleure qualit ;
de la mise la disposition, des gestionnaires publics, doutils
de pilotage et dvaluation permanents ;
de lintgration de la comptabilit nationale et de la ncessaire
consolidation des comptes de la Nation.
VI- APPORTS ATTENDUS DU PLAN COMPTABLE DE
LETAT
Il devrait galement offrir:
une transparence de la situation patrimoniale de lEtat et de sa
situation financire,
la prise en compte des stocks,
la comptabilisation des risques potentiels,
la vision des charges futures, etc
Or, en dpit des apports attendus, le projet a connu une
longue priode dhibernation: comme la rforme comptable va
de pair avec un systme dinformation performant, un retard de
plus de plus de six ans a t enregistr ce niveau.
VII- GENSE DE LLABORATION DU PLAN
COMPTABLE DE LETAT 1/2
1989: Constitution de lEquipe-projet pour llaboration du
projet de plan comptable de lEtat, mise niveau des quipes
et dmarrage des travaux,
1989- 199o: Elaboration du plan de comptes et des rgles de
fonctionnement,
1990- 1995: Large consultation des partenaires: DGI,
Ministre du plan, professionnels (experts comptables),
2000-Prsentation du projet au SGG pour adoption,
2001- 2002: Adoption par la CNC.
Faute dun progiciel capable de le porter, le projet na pu tre
mis en uvre, mais llaboration des instructions comptables
a t engage.
Il a fallu attendre 2008, pour quun appel manifestation
dintrt soit enfin lanc auprs des diteurs de progiciels.
VII- GENSE DE LLABORATION DU PLAN
COMPTABLE DE LETAT 2/2
1
RE
TAPE: Mars- Dcembre 2008 :
Mars- Juin: Ralisation des travaux de convergence qui ont permis dlaborer
un recueil des normes comptables marocaines,
Juillet: Adoption du nouveau cadre comptable par le comit permanent du
conseil national de la comptabilit (CNC),
Dcembre: Adoption dfinitive du nouveau rfrentiel comptable par
lassemble plnire du CNC.
2
ME
TAPE : Juin - Dcembre 2009 :
Dfinition des modalits de fonctionnement des comptes et rcriture de
lensemble des instructions comptables, afin de faciliter une mise en uvre
efficace de ce nouveau rfrentiel comptable auprs des gestionnaires et des
comptables publics.
Approbation en octobre 2009 par le conseil du gouvernement du projet de
dcret portant adoption du nouveau rfrentiel comptable.
Opration dintgration et de paramtrage du progiciel nouvellement acquis .
CONCLUSION
Le nouveau rfrentiel comptable de lEtat est appel permettre:
dassurer une cohrence entre la comptabilit gnrale et la
comptabilit nationale (adoption des mmes dfinitions et des
mmes rsultats), les diffrences ventuelles seront explicites,
justifies et prsentes chaque anne dans un tableau de
passage,
une lisibilit et une meilleure crdibilit des comptes de lEtat,
de faire des tats financiers annuels lune des principales
sources dinformation chiffre sur la situation financire de
lEtat,
dapprcier et danalyser lvolution de la richesse de lEtat et
dclairer sur les marges de manuvre dont il dispose pour la
soutenabilit des finances publiques.
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours de Droit CommercialDocument159 pagesCours de Droit Commercialmeghezzihichem6502100% (30)
- Gestion budgétaire et dépenses publiques: Description comparée des processus, évolutions et enjeux budgétaires du QuébecD'EverandGestion budgétaire et dépenses publiques: Description comparée des processus, évolutions et enjeux budgétaires du QuébecÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (2)
- Le Système de Formation À La TGR - Version 5Document23 pagesLe Système de Formation À La TGR - Version 5Rosa PanafiPas encore d'évaluation
- Cours de Droit AdministratifDocument53 pagesCours de Droit Administratifdemop100% (31)
- Cours de Droit AdministratifDocument53 pagesCours de Droit Administratifdemop100% (31)
- Les 4 Étapes de L'ingénierie de FormationDocument1 pageLes 4 Étapes de L'ingénierie de FormationAbd FoulPas encore d'évaluation
- Comptabilite Publique MarocaineDocument35 pagesComptabilite Publique MarocaineDRISS BENMALEK80% (5)
- Les Enjeux de La Reforme de La ComptabilDocument20 pagesLes Enjeux de La Reforme de La ComptabilSAFAE KHARTITI100% (1)
- Rapport Cinquantenaire Developpement Humain Au MarocDocument186 pagesRapport Cinquantenaire Developpement Humain Au MarocB.I80% (5)
- Comptabilite de GestionDocument33 pagesComptabilite de Gestionmunib1966100% (3)
- Cours Institutions Judiciaires 18 HDocument96 pagesCours Institutions Judiciaires 18 HVincentVigneau92% (24)
- PR - Baryala Cours Contrôle de Gestion PR BaryalaDocument103 pagesPR - Baryala Cours Contrôle de Gestion PR BaryalaMouad RoknePas encore d'évaluation
- Budget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsD'EverandBudget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsPas encore d'évaluation
- Decentralisation Fiscale Maroc PDFDocument16 pagesDecentralisation Fiscale Maroc PDFMahdi TalebPas encore d'évaluation
- ISCAE - CP 4 - R+®forme de La Comptabilit+® de L'etat - Kers - Mars2017Document48 pagesISCAE - CP 4 - R+®forme de La Comptabilit+® de L'etat - Kers - Mars2017hicham FaridPas encore d'évaluation
- Controle de La Depenses Publique Au MarocDocument2 pagesControle de La Depenses Publique Au MarocSalim WydadiPas encore d'évaluation
- Comptabilité PubliqueDocument21 pagesComptabilité Publiqueel khaiat mohamed aminePas encore d'évaluation
- Les Finances de L'etat MAROCDocument8 pagesLes Finances de L'etat MAROCNada ElmeftahiPas encore d'évaluation
- CGM Gouvernance D'ese MarocDocument80 pagesCGM Gouvernance D'ese Marocsinou7100% (2)
- Marchés PublicsDocument13 pagesMarchés PublicsMERIEM MOUNCYF100% (1)
- Criminologie MarocDocument61 pagesCriminologie MarocDRISS BENMALEKPas encore d'évaluation
- Cours Fiscalité LocaleDocument10 pagesCours Fiscalité LocaleHana100% (1)
- SynthèseDocument4 pagesSynthèseBelmanti Ahmed100% (1)
- PFE Haimad ZakariaDocument75 pagesPFE Haimad Zakariafinixkx100% (2)
- Cours Contrat D AssuranceDocument3 pagesCours Contrat D AssuranceDRISS BENMALEK100% (1)
- La Comptabilité PubliqueDocument2 pagesLa Comptabilité PubliqueZouhir Al Kassimi100% (1)
- Al+Khazina+N +8+finalDocument36 pagesAl+Khazina+N +8+finalAdel OuchniPas encore d'évaluation
- Marche PublicDocument24 pagesMarche PublicSimo EL KhomssiPas encore d'évaluation
- Fiche de LectureDocument4 pagesFiche de LectureAmine MohammedPas encore d'évaluation
- Ila Réforme de La Comptabilité de L'EtatDocument18 pagesIla Réforme de La Comptabilité de L'EtatChaymaa Baba haddouPas encore d'évaluation
- Réforme Budgétaire Et Comptabilité Publique Au MarocDocument5 pagesRéforme Budgétaire Et Comptabilité Publique Au Marocdossari23Pas encore d'évaluation
- Gestion Des Ressources HumainesDocument40 pagesGestion Des Ressources HumainesSisou Sasou100% (1)
- ATTRIBUTIONS DE LA TGR EN MATIERE DE RECOUVREMENT 11 Nov 2019Document43 pagesATTRIBUTIONS DE LA TGR EN MATIERE DE RECOUVREMENT 11 Nov 2019ZakariyaElKhoumssiPas encore d'évaluation
- Présentation GID SaléDocument17 pagesPrésentation GID Salélemaj2010Pas encore d'évaluation
- Le Contrôle Juridictionnel Des Finances PubliquesDocument10 pagesLe Contrôle Juridictionnel Des Finances PubliquesAbdellatif100% (1)
- Présentation de La RégieDocument26 pagesPrésentation de La RégieToufik Zerouk100% (1)
- Fiscalité Locale Au MarocDocument3 pagesFiscalité Locale Au MarocMarco TsaradiaPas encore d'évaluation
- Une Reforme Comptable de L'étatDocument15 pagesUne Reforme Comptable de L'étatMohamed TakarliPas encore d'évaluation
- Contrôle Des Dépenses de L - EtatDocument52 pagesContrôle Des Dépenses de L - EtatMed SamouchePas encore d'évaluation
- Reformes Du Controle de La Depense Nouveaux Recrus 2017 Vaf2Document33 pagesReformes Du Controle de La Depense Nouveaux Recrus 2017 Vaf2AyoubAouadPas encore d'évaluation
- Catalogue MawaridDocument40 pagesCatalogue MawaridLhoussaine BRAIHIMPas encore d'évaluation
- Montage de ProjetDocument16 pagesMontage de ProjetGael Bayala100% (1)
- Exposé D'execution....Document71 pagesExposé D'execution....AISSAOUI SabrinaPas encore d'évaluation
- Les Opérations en DevisesDocument5 pagesLes Opérations en DevisesHamza ElkalaDyPas encore d'évaluation
- Formation Sur Fiscalité Locale Final .PPT Version 1Document56 pagesFormation Sur Fiscalité Locale Final .PPT Version 1idboufa100% (1)
- Rapport de Stage La Perception1Document25 pagesRapport de Stage La Perception1Colis MaPas encore d'évaluation
- Finances PubliquesDocument74 pagesFinances PubliquesSalma Nouni100% (1)
- CONTEXTE DU PROJET GID Dans Le Cadre Des Grandes Réformes de Modernisation Et deDocument6 pagesCONTEXTE DU PROJET GID Dans Le Cadre Des Grandes Réformes de Modernisation Et denouna1nounaPas encore d'évaluation
- Reforme de Lolf Saad BougarnDocument33 pagesReforme de Lolf Saad BougarnMehdiChadliPas encore d'évaluation
- Réforme de La Fiscalité LocaleDocument15 pagesRéforme de La Fiscalité Localespiritualbeing0% (1)
- Resume La Loi de Finance 2022Document14 pagesResume La Loi de Finance 2022Ismail MerchichPas encore d'évaluation
- Exécution Des Dépenses Des CTDocument16 pagesExécution Des Dépenses Des CTMed SamouchePas encore d'évaluation
- Al KhazinaDocument40 pagesAl KhazinaNOUR EL HOUDA BOUCHAABPas encore d'évaluation
- IGAT Seminaire MarocDocument31 pagesIGAT Seminaire MarocRtui MedPas encore d'évaluation
- 640 Maliya 49Document58 pages640 Maliya 49Youssef Kou50% (2)
- Gestion Des Indemnites Des For - HOUSSAM Mohammed Amine - 2011 PDFDocument55 pagesGestion Des Indemnites Des For - HOUSSAM Mohammed Amine - 2011 PDFRyadPas encore d'évaluation
- Maroc - Projet de Loi de Finances 2022Document31 pagesMaroc - Projet de Loi de Finances 2022Carina VerónicaPas encore d'évaluation
- Controle de Finance PubliqueDocument22 pagesControle de Finance PubliqueTouiti Moulay AzizPas encore d'évaluation
- Al Maliya Spécial Loi de Finances 2022-1Document156 pagesAl Maliya Spécial Loi de Finances 2022-1Othmane El HafedPas encore d'évaluation
- Tva Declaration-Trimestre MarocDocument2 pagesTva Declaration-Trimestre Marocahmed_elrajiPas encore d'évaluation
- Réforme Controle CMDDocument55 pagesRéforme Controle CMDAbdelhak ChallalPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage ImaneDocument34 pagesRapport de Stage ImaneMERYAMA EL HASSANIPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Khaoula Arr PDFDocument41 pagesRapport de Stage Khaoula Arr PDFLahcen ToutayPas encore d'évaluation
- Budget TGRDocument45 pagesBudget TGRlailaPas encore d'évaluation
- Réforme de LOLFDocument6 pagesRéforme de LOLFRéda TsouliPas encore d'évaluation
- Gestion Budgétaire PubliqueDocument14 pagesGestion Budgétaire PubliqueHala RhPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage T.s.dtlooDocument31 pagesRapport de Stage T.s.dtlooOussama Hassani100% (1)
- Nouvel Organigramme de La TGRDocument2 pagesNouvel Organigramme de La TGRSamir Sami100% (1)
- Exposé La Responsabilité Des Ordonnateurs CPDocument13 pagesExposé La Responsabilité Des Ordonnateurs CPHouda El75% (4)
- Exposé Sur La Fiscalité D Acquisition en Tun Et FRDocument16 pagesExposé Sur La Fiscalité D Acquisition en Tun Et FRAnonymous zjIDpZiaPas encore d'évaluation
- Systeme Integre de Gestion BudgetaireDocument8 pagesSysteme Integre de Gestion BudgetaireAzer Aze100% (2)
- Instruction Sur La Comptabilite Deniers Des RecettesDocument168 pagesInstruction Sur La Comptabilite Deniers Des Recettesmohamed rifkiPas encore d'évaluation
- Cours Fiscalité 2022-2023Document22 pagesCours Fiscalité 2022-2023mouhmedoumbarkPas encore d'évaluation
- Taxe ProfessionnelleDocument17 pagesTaxe ProfessionnelleelyacoubiPas encore d'évaluation
- Cot Fiscal Au Maroc Et Ion Fiscale 7231Document128 pagesCot Fiscal Au Maroc Et Ion Fiscale 7231Charaka PartenariatPas encore d'évaluation
- AgroAlimentaire KenitraDocument9 pagesAgroAlimentaire KenitraDRISS BENMALEKPas encore d'évaluation
- Dossier Justice Et Droit Au MarocDocument54 pagesDossier Justice Et Droit Au MarocAlami mehdi100% (1)
- Dialogue Social Et Gouvernance D'entrepriseDocument82 pagesDialogue Social Et Gouvernance D'entreprisedemop100% (5)
- Culture & Civilisation - L'impact de La Mondialisation Sur La Culture MarocaineDocument25 pagesCulture & Civilisation - L'impact de La Mondialisation Sur La Culture MarocaineOverDoc100% (2)
- M05 - Concepts de Base de La Comptabilité généraleTER-TSCDocument99 pagesM05 - Concepts de Base de La Comptabilité généraleTER-TSCanas5555555555555100% (4)
- Du Contrat Social (JJ Rousseau)Document152 pagesDu Contrat Social (JJ Rousseau)Casablanca, Morocco100% (1)
- L'impact de La Crise Financière Mondiale Sur L'économie MarocaineDocument2 pagesL'impact de La Crise Financière Mondiale Sur L'économie MarocaineDRISS BENMALEKPas encore d'évaluation
- Guide - Etudiant Souissi RabatDocument73 pagesGuide - Etudiant Souissi RabatDRISS BENMALEK0% (1)
- CriseDocument183 pagesCriseGhanii BakouriPas encore d'évaluation
- Droit Des AssurancesDocument16 pagesDroit Des AssurancesDRISS BENMALEK100% (1)
- m18 Gestion Budget A Ire Ter TsgeDocument65 pagesm18 Gestion Budget A Ire Ter TsgeFati Lifee100% (1)
- M05 - Concepts de Base de La Comptabilité généraleTER-TSCDocument99 pagesM05 - Concepts de Base de La Comptabilité généraleTER-TSCanas5555555555555100% (4)
- Handle 404Document8 pagesHandle 404Jo niggathugslifePas encore d'évaluation
- Faculté de Droit Et Des Sciences Politiques de Tunis: 2 Année Licence Fondamentale en Droit PublicDocument95 pagesFaculté de Droit Et Des Sciences Politiques de Tunis: 2 Année Licence Fondamentale en Droit PublicChamakh OussamaPas encore d'évaluation
- Tableau de BordDocument12 pagesTableau de BordLilia LinaPas encore d'évaluation
- Chapitre I. Budget Des Ventes-S6 FSJESDocument43 pagesChapitre I. Budget Des Ventes-S6 FSJESOussama Karn100% (2)
- Cours de Planification 6 - WatermarkDocument26 pagesCours de Planification 6 - WatermarkHamZa ChaFiPas encore d'évaluation
- Application 3Document2 pagesApplication 3chaib mustaphaPas encore d'évaluation
- Contrôle BudgétaireDocument27 pagesContrôle BudgétaireSami ElbadriPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 4 La Gestion BudgétaireDocument4 pagesCHAPITRE 4 La Gestion BudgétairelodjoPas encore d'évaluation
- GB BUDGET DE TRESO ET ETATS DE SYN-convertiDocument20 pagesGB BUDGET DE TRESO ET ETATS DE SYN-convertianass benmoussa100% (1)
- EDR Finance ComptabiliteDocument70 pagesEDR Finance ComptabiliteExlumisPas encore d'évaluation
- Rapport d'APSDocument36 pagesRapport d'APSamira madaniPas encore d'évaluation
- Formation Saari Sage Comptabilite Ligne 100Document42 pagesFormation Saari Sage Comptabilite Ligne 100rita tamohPas encore d'évaluation
- One Year To Lead FRE-2013-01Document38 pagesOne Year To Lead FRE-2013-01Badara NdiayePas encore d'évaluation
- Plan Cours2900Document14 pagesPlan Cours2900Ihab El AoumariPas encore d'évaluation
- Cours D'ogeDocument40 pagesCours D'ogeChirack Ngwej100% (1)
- Mini Projet Gestion BudgDocument16 pagesMini Projet Gestion BudgAbdellatif HoubaibaPas encore d'évaluation