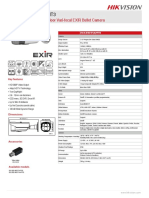Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
A Propos Du Signe Linguistique - Arbitraire Ou Motivé
A Propos Du Signe Linguistique - Arbitraire Ou Motivé
Transféré par
ludusludus0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues18 pagesTitre original
A Propos Du Signe Linguistique _ Arbitraire Ou Motivé _
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues18 pagesA Propos Du Signe Linguistique - Arbitraire Ou Motivé
A Propos Du Signe Linguistique - Arbitraire Ou Motivé
Transféré par
ludusludusDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 18
1
A propos du signe linguistique : arbitraire ou motiv ? , Actes du
colloque Universaux de la forme sonore , III
es
Journes dtudes
Linguistiques (JEL) de Nantes, 23-25 mars 2002.
Comme la publication des actes de ce colloque est repousse la Saint
Glinglin, on peut citer la communication dans sa forme actuelle
A propos du signe linguistique, arbitraire ou motiv
Georges Bohas
1.La conception structuraliste
Pour Saussure (1916 in 1995 : 99), le signe linguistique combine un
concept et une image acoustique, plus techniquement, un signifiant et un
signifi.
signe linguistique =
concept
image acoustique
plus techniquement :
signifi
signifiant
Exemple :
signifi = arbre
signifiant [arbr]
Le rapport entre ces deux composantes du signe linguistique a t
prcis par Benveniste (1939, in 1966) : Entre le signifiant et le signifi
le lien nest pas arbitraire, il est ncessaire. Le concept (signifi) arbre
est forcment identique dans ma conscience lensemble phonique
(signifiant) [arbr].
Quelle est maintenant la nature du rapport entre le signe linguistique et la
ralit ?
2
Ce rapport est arbitraire, comme le montre le fait quen franais on a :
signifi = arbre
signifiant [arbr]
en anglais :
signifi = arbre
signifiant [tri]
pour une mme ralit.
Pour schmatiser :
M
O
N
D
E
-=============================================
zone de l arbitraire
L
A
N
signifi = arbre signifi = arbre
signifiant [arbr] signifiant [tri]
GUE
Ce qui est arbitraire cest que tel signe et non tel autre soit appliqu
tel lment de la ralit et non tel autre. Cest cette relation entre les
deux qui constitue la zone de larbitraire. En dautres termes, il ny a rien
qui motive que le signe
signifi = arbre
signifiant [arbr]
soit appliqu en franais la ralit :
3
Comme le dit Martinet (1993) : En termes simples, il [l'arbitraire du
signe] implique que la forme du mot n'a aucun rapport naturel avec son
sens : pour dsigner un arbre, peu importe qu'on prononce arbre, tree,
Baum ou derevo.
Bien que Saussure ait dit : Le principe de larbitraire du signe nest
contest par personne , cest cette conception, accepte par tous, ou
presque, que mes recherches sur lorganisation du lexique de larabe vont
mamener mettre en cause.
2. Contestation
Quappelle-t-on racine ? Soit le paradigme 0 :
batara : Couper la queue un animal
: Couper, retrancher en coupant, enlever
batira : Avoir la queue coupe
battara : Perdre, anantir, dtruire
abtara : Couper la queue un animal
: Priver quelqu'un d'enfants, le laisser sans postrit
inbatara : tre coup, retranch, enlev
btirun : Qui coupe, tranchant (sabre)
battrun : Qui coupe, tranchant (sabre)
abtaru : court, qui a la queue coupe
: Mutil
: Qui n'a pas de postrit
batrun : Action de couper, amputation
On ne peut manquer de remarquer que tous ces mots comportent trois
consonnes identiques: b, t, r (qui figurent en gras dans le paradigme), et
que leur sens a quelque chose voir avec couper . C'est ce qu'on
appelle une racine. Je tiens prciser que les donnes traites dans les
quatre premiers paradigmes proviennent du Kazimirski.
Par radical, on dsigne au contraire un objet apparent, que lon peut
isoler en enlevant au mot ses prfixes ou suffixes. Ainsi, il est bien connu
qu'en arabe le verbe la forme non augmente se compose d'un radical
triconsonantique et que la conjugaison s'effectue par suffixation et/ou
prfixation :
Accompli Accompli Inaccompli. Sens
4
1
re
pers. sg 3
e
pers. sg 1
re
pers. sg
katab + tu katab + a a+ktub + u crire
arib + tu arib + a a+rab + u boire
kabur + tu kabur + a a+kbur + u tre g
Les voyelles diffrent (a, i, u) mais les trois consonnes demeurent, bien
videntes dans toutes les formes. Personne ne peut donc nier que le verbe
apparaisse sous la forme d'un radical triconsonantique : katab, arib,
kabur. Le radical est donc bien diffrent de la racine, en ce que, compos
de consonnes et de voyelles, il a une existence dans les reprsentations
phontiques de la langue, ce que na pas le concept de racine.
La racine triconsonantique dfinie plus haut permet-elle de rendre
compte de gnralisations, de rapports entre les mots que tout un chacun
peut observer, pour peu quil se donne la peine douvrir les yeux ou les
oreilles, ou les deux. ?
Ainsi, tout individu normalement constitu examinant le paradigme I :
matta : Etendre quelque chose en long (p. ex ; une corde)
mat : Etendre en long (une corde)
mataa : Tendre, tendre en long une corde
mataa : Allonger, tendre en long
matana : Tendre, tendre et allonger quelque chose
ne peut sempcher de remarquer que chaque verbe comporte la squence
mt et que tous ont le sens d tendre , avec quelques nuances.
Si lon organise le lexique en posant que la racine triconsonantique est un
primitif, ces constatations relvent simplement du hasard et rien ne
permet den rendre compte, car tous ces verbes sont rattachs des
racines diffrentes : mty, mt, mt et mtn. Cest pour des cas
semblables qua t propos dans Bohas (1997 et 2000) le niveau de
ltymon, compos binaire de phonmes, ici mt dont les termes du
paradigme I sont des ralisations. Observez que, pour extraire ltymon,
jai procd exactement comme lors de lextraction de la racine :
constatation de proprits phontiques et smantiques communes et
constantes et conclusion.
Ce paradigme peut tre dvelopp pour donner le paradigme II :
matta : Etendre quelque chose en long (p. ex; une corde)
mat : Etendre en long (une corde)
mataa : Tendre, tendre en long une corde
mataa : Allonger, tendre en long
matana : Tendre, tendre et allonger quelque chose
madda : Etendre comme un tapis
5
mad : Etendre en long
malada : Allonger, dresser les jambes en courant (se dit du cheval)
maa : Tendre et allonger une chose en la tirant avec force
maala : Allonger une corde
ma : Allonger le chemin quelquun
maaa : Accorder un dlai, une prolongation (de payement)
Ce paradigme manifeste la mme unit smantique que le prcdent et
lon retrouve dans chaque verbe le m du paradigme I combin t ou d ou
. Si lon sen tient au niveau de ltymon, on ne peut aller plus loin. Par
contre, si lon passe au niveau de lanalyse en traits phontiques, on peut
exprimer ce que t, d et ont en commun, savoir que ce sont des
segments [coronal] [-continu], tout en observant que la combinaison {m x
[coronal] [-continu]} est li l'invariant notionnel tendre, tendre .
Cest donc que pour exprimer les caractristiques phontiques communes
de ces formes, il faut passer au plan des traits phontiques, ce qui est
appel, dans Bohas (1997 et 2000), le niveau de la matrice. Dsormais je
parlerai d'invariant notionnel pour dsigner la charge smantique
commune tous les lments issus dune matrice. Il est bien clair que
celui qui ne dispose que de la racine ne peut en aucun cas exprimer ces
gnralisations phontico-smantiques pourtant flagrantes. Il faut donc
disposer dun tableau des traits phontiques pour travailler ce niveau.
m b f t d s z J
l
l n r k g q G h
[consonantal] + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
[sonorant] + - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - + + + + (+) (+)
[approximant] - - - - - - - - - - - - - - - + - + - - - - + + + + + +
[voiced] ( +) + - - + - + - + - + - + + - ( +) ( +) (+) - + - + - + - + - -
[continuant] + - + + + - - + + + + - - + + + + + - - - - + + + + - +
[labial] + + +
[coronal] + + + + + + + + + + + + + + +
[dorsal] + + + + ( +) + + + + + +
[pharyngeal] + + + + ( +) + + + + + + + +
[anterior] + + + + + + - - + + + + + + +
[distributed] + + - - - - + + - - + - - - -
[strident] ( -) ( -) (+) - - - - + + + + - - - + - - - ( -) ( -) ( -) ( -) (+) (+) + - (-) ( -)
[lateral] - - - - - - - - - + - - + - -
[nasal] + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - (-) (-)
Tableau 1
1
1
Ce tableau a t ralis par Ch. Zeroual et expos mon sminaire en 1998. Les parenthses
indiquent que la spcification dpend de la dfinition adopte pour le trait.
6
Exercice pratique : Trouver les traits commun , ie, identifier la matrice
dans la liste suivante (Paradigme III) :
{b,}
abara : Lier, attacher quelqu'un quelque chose pour telle ou telle chose,
retenir, empcher
aaba : Lier, serrer
{b,}
abba : Etre attach, s'attacher, tre, pour ainsi dire, coll au sol
abaa : Attacher avec une corde les genoux plis du chameau quelque
partie suprieure du corps
ibun : Corde (utilise cet effet)
{b,}
unubun : Longue corde avec laquelle on attache la tente aux pieux fichs
dans la terre
rabaa Lier, serrer les liens, attacher quelque chose
{b,}
abasa : Retenir, contenir, arrter ; envelopper et serrer une chose dans une
autre
abala : Serrer avec une corde
ablun : Corde, cble, lien
{b,}
abala : Lier, serrer avec des liens
Empcher quelqu'un d'aller ou de se livrer quelque chose
{b,}
abala : Lier, serrer, attacher
{f,}
afrun : Corde avec laquelle on attache un chameau
afana : Serrer avec la main les mamelles dune femelle quand on se met
la traire
{f,}
affa : Lier les pieds d'une chamelle avec quelque chose
afana : Lier, serrer et retenir
{f,}
affa : Lier serrer (les pieds d'un chameau)
{f,}
`affa : S'abstenir
`afasa : Retenir, arrter quelqu'un
`afaka : Empcher quelqu'un de faire quelque chose
Les tymons qui la composent comportent tous soit une labiale et une
gutturale, soit une labiale et une emphatique. Une analyse qui se limite
7
aux phonmes ne peut pas en dire plus ; par contre, si lon accepte
dentrer dans la problmatique dveloppe ici, et de se servir des traits, on
peut constater dans le tableau I que les emphatiques et les gutturales ont
en commun le trait [pharyngal]. On peut alors poser la matrice suivante :
{[Labial], [pharyngal]}
[-sonant]
Organisation du champ notionnel partir de : lier
spcifications :
modalit >
1
serrer
cause/effet >
2
attacher
factitif+mtaphore>
3
retenir, empcher
rflexivit >
4
s'abstenir
Des quatre spcifications, la premire ajoute la modalit, la deuxime est
de type logico-smantique : cause effet , tandis que la troisime et
la quatrime ajoutent une relation de type grammatical : factitivit et
rflexivit combines avec une relation de type mtaphorique.
Modalit, implication, factitivit, rflexivit, relation mtaphorique sont
donc des spcifications qui peuvent s'adjoindre l'invariant notionnel et
dont la combinaison constitue la signification du mot.
Si lon compare :
{b,}
abara : Lier, attacher quelqu'un quelque chose pour telle ou telle chose,
retenir, empcher
aaba : Lier, serrer
{b,}
abba : Etre attach, s'attacher, tre, pour ainsi dire, coll au sol
abaa : Attacher avec une corde les genoux plis du chameau quelque
partie suprieure du corps
ibun : Corde (utilise cet effet)
{b,}
unubun : Longue corde avec laquelle on attache la tente aux pieux fichs
dans la terre
rabaa : Lier, serrer les liens, attacher quelque chose
on observe que les deux lments de la matrice apparaissent dans des
ordres diffrents ; et lon peut faire la mme remarque pour les tymons
du paradigme IV :
{b,t}
2
2
Pour cette notation, v. la suite du paragraphe.
8
batta : Couper, retrancher en coupant
tabba : Couper, retrancher en coupant
{b,}
ba : Se calmer, s'apaiser, s'teindre (se dit du feu, de la
chaleur, de la colre)
ab : S'teindre, se calmer (feu, guerre, colre)
{b,}
baa : Travailler avec zle et assiduit quelque chose
waaba : Faire quelque chose avec assiduit
{b,}
wabaa : Mdire de quelqu'un
ba : Mdire de quelqu'un
{b,k}
bakka : Se rassembler en foule
kubba(tun) : Troupe nombreuse d'hommes
On peut donc conclure que les constituants de la matrice, et donc de l'
tymon qui en est issu, ne sont pas linairement ordonns.
Le lexique de l'arabe s'organise donc en trois niveaux :
1. matrice : () combinaison, non ordonne linairement, d'une paire de
vecteurs de traits phontiques, au titre de pr-signe ou macro-signe
linguistique, lie une notion gnrique, un invariant notionnel. Cest le
niveau o la signification primordiale nest pas lie au phonme,
mais au trait phontique qui, en tant que matriau ncessaire la
constitution du signe linguistique, forme palpable , nest pas
manuvrable sans addition de matire phontique supplmentaire.
2. tymon : () combinaison, non ordonne linairement, de phonmes
comportant ces traits et dveloppant cette notion gnrique.
3. radical : (R) tymon dvelopp par diffusion de la dernire consonne,
prfixation ou incrmentation ( linitiale, linterne et la finale) et
comportant au moins une voyelle, et dveloppant cet invariant notionnel.
3. Etude de deux matrices
Pour continuer de montrer que le recours aux traits dans la constitution
des matrices permet de rendre compte des relations phono-smantiques
que manifeste le lexique de larabe, et continuer de voir comment
s'organise la relation entre le son, le sens et le monde, on va procder
lanalyse sommaire de deux autres matrices.
A
9
{ [+consonantique], [+consonantique]
[labial] [-vois] }
[-nasal] [+continu]
autrement dit b et f combins avec une fricative sourde.
Cette combinaison traduit un flux sonore correspondant l'mission d'un
courant d'air sans vibrations laryngales. L'invariant notionnel du champ
conceptuel dessin autour des formes lexicales caractrises par cette
structure morphosmantique (Guiraud, 1967) pourrait tre :
- mouvement de l'air : vent, souffle
- expulsion de l'air chez l'homme ou l'animal
>
3
consquences (odeurs diverses)
Comme cela apparat dans la liste suivante :
f
nafaa : exhaler
f
faa : Siffler (serpent); siffler (orage)
nafaa : Souffler (vent), se rpandre (parfum)
fa/fawaa/ : Rpandre son parfum ; sentir bon ou mauvais
f
nafaa : Souffler avec la bouche ; remplir de gaz (balon)
fs
fas/fasawa/ : Lcher un vent (quon nentend pas)
nafasun : Respiration, haleine, souffle, bouffe
nafsun : Ame, principe vital
f
afara : Siffler
Avec lautre labiale, le b :
b
baa : Etre rauque (voix)
b
baa : Ronfler en dormant
baara : Laisser sortir la vapeur (marmite), s'vaporer, parfumer
l'encens
burun : Vapeur
On peut constater dans tous les cas la prsence d'une consonne labiale
et d'une fricative non voise, quel que soit son point d'articulation,
corrle la prsence de l'invariant notionnel dcrit plus haut. Dautre
part, ce paradigme fait apparatre une autre proprit : le caractre
3
Ce signe indique qu'il existe une relation smantique, ici cause>consquence.
10
mimophonique des tymons. On entend par mimophonique quil existe
entre la matire phontique de la matrice et son invariant notionnel une
analogie. Comme le disait Guiraud (1967), les bases physiologiques de
cette analogie sont de trois types : acoustique, l o les sons
reproduisent un bruit ; cintique, l o larticulation reproduit un
mouvement ; visuelle, dans la mesure o lapparence du visage (lvres,
joues) est modifie ; ce qui comporte dailleurs des lments cintiques .
(p. 125)
Quand on fait apparatre le caractre mimophonique dun tymon, on fait
apparatre, ipso facto, le caractre motiv de la relation entre le son et le
sens. En dautres termes, si fa, fa, fas expriment les diverses
expirations, cest parce quen les prononant, je souffle. Ici, la relation
mimophonique est facile saisir.
Les acceptions abstraites se dgagent des concrtes par des procds
reprs depuis longtemps dans d'autres langues et que tout le monde
accepte sans broncher. On a vu qu' partir du souffle (concret) se
dgage le sens d' me . Il en va de mme en latin
4
o spiritus passe de
souffle de l'air, air , respiration, inspiration, sentiment, esprit, me .
De mme, on a vu comment passer de lier empcher et
s'abstenir . On constatera en latin une drive analogue pour obligo
entre 1. attacher , contre , fermer d'un lien et 2. [fig] lier, engager,
obliger
5
.
B
{[labial], [dorsal]}
[ -son]
L'tude de cette matrice est assez avance (voir Serhane, en prparation et
Bohas et Serhane, en prparation), cest pourquoi il est dj possible den
donner une esquisse assez dtaille. L'invariant gnrique de son champ
conceptuel est simplement mimophonique et consiste en la forme
dispose de diverses manires, ce que Nicola (1982 et 1987) a appel la
courbure.
On entend par mimophonique , comme cela a t dit prcdement,
quil existe entre la matire phontique de la matrice et l'objet du signe
linguistique, l'objet ou l'tat du monde rel dont le signe tient lieu (vu que
l'objet/rfrent peut tre concret ou abstrait) une analogie. La
mimophonie de cette matrice rsulte du couplage de deux proprits
articulatoires, lune externe et lautre interne. Lexterne est larrondi
4
Cest dessein quon se limite au Gaffiot que chacun peut consulter.
5
Pour une tude approfondie et anti-mtaphorique, v. Nyckees (1998 : 148 et suiv.).
11
visible de la position des muscles buccaux lors de larticulation des
phonmes disposant du trait [labial] ; linterne tient la forme mme que
prend la langue lors de larticulation dune dorsale comme k et q. Le
schma suivant, extrait de Ladefoged (1975 : 50) est particulirement
loquent :
Ici encore, le fait que le j manifeste les proprits smiques de q et k
confirme quil est bien, dans le lexique, une dorsale, savoir un g,
comme le prononcent les Cairotes.
Comme on peut le remarquer dans le tableau des traits, [dorsal] n'inclut
pas seulement k, q et g ; les emphatiques comportent elles aussi le trait
12
[dorsal], et si cette thorie est fonde, on doit donc retrouver dans la
combinaison des labiales et des emphatiques les mmes smes que dans
celle des labiales et des dorsales, puisquelles peuvent toutes les deux tre
des ralisations de la matrice {[labial], [dorsal]}. C'est bien le cas, comme
je l'ai montr ailleurs (Bohas 2000), et c'est donc simplement pour
abrger que je me restreins ici aux mots impliquant q, k et g. D'autre
part, pour que l'on ne me dise pas que je travaille sur un niveau de langue
archaque, tous les exemples que je cite dans l'tude de ces deux matrices
sont dans le dictionnaire d'arabe moderne de H. Wehr, ce qui constitue un
sous-ensemble des donnes de l'arabe classique collectes dans le
Kazimirski que l'on trouve dans Bohas 2000, mais, comme on pourra le
constater, que l'on travaille sur un gros tas de donnes ou sur un petit, on
s'aperoit vite que l'organisation est la mme, comme on pouvait s'y
attendre, du reste.
Lorganisation smantique
B.1. Forme : convexe
B.1.1 Parties du corps : seins, fesses, ventre, bosse, tte, talon
aqibun : Talon
kubun : Mamelle (de la femme) (on reviendra sur cet exemple)
kaaba : Avoir les deux mamelles dj dveloppes et arrondies
rukba : Genou (on reviendra sur cet exemple)
falaka : Etre arrondi, rond (se dit des mamelles) ; avoir le sein dj
arrondi, les deux mamelles dveloppes (se dit dune fille)
mufallik : "Fille qui a des seins ronds"
kafalun : Derrire, fesse, croupe
qifun : Crne
B.1.2. Enfler, gonfler grossir
La relation avec B.1. est facile tablir : Quand une partie du corps enfle
ou grossit, elle dessine la forme .
qabqaba : Enfler
abjar : Corpulant, obse
B.1.3. La forme dans le relief et la construction : tas, tertre, colline,
montagne, coupole, vote
jabalun : Montagne, mont ; monts, chanes de montagnes
nabkatun, nabakatun : Colline qui se termine en pic ; en gn. colline
mankibun : Elvation de terrain
qubbatun : Coupole, vote ; difice construit en vote ;
qab /qabawa/ : Voter, cambrer, donner la forme dune coupole
qabwun : Vote
najafun : Dune; tertre, monticule
13
B.1.4. Courber (ventuellement : dessiner [avec son corps] cette
forme ) : infirmits impliquant cette forme : tre vot, tordu, pli,
ou l'inverse : cambr () (convexit/concavit)
jab /jabaya/ F. II : Se jeter la face contre terre, se prosterner en appuyant les
mains contre la terre (en priant)
qab / w/ : Courber, ployer
aqafa : Courber, plier, cambrer
aqafu : Courb, pli, cambr ; contourn, tortu
maqfun : Courb, vot (vieillard)
B.2. Forme : concave
La courbure est maintenant inverse et l'on obtient la forme qui
apparat dans : creux, puits, fosse, valle, et dans les ustensiles : sac,
panier, outre, comme on va le montrer en dtail.
B.2.1. Creux dans la nature (valle, puits)
jubbun : Puits ; citerne
jawbatun : Trou
jbiyatun : Bassin
birkatun : Etang
waqbun : Creux, cavit
qalbun ; pl. qulbun : Puits
qba /qawaba/ : Creuser (la terre)
qabara : Enterrer, ensevelir ; creuser, faire un tombeau quelquun
qabrun : Tombeau, tombe, spulcre
jfa /jawafa/ F.II : Rendre creux en dedans ; rendre concave
jawfun : Creux, cavit ; intrieur (ex. de la maison)
jufratun : Trou
ajwafu : Creux, concave vide
kab :Vider un bateau (noter cette relation entre creux et vide)
B.2.2. Objets creux (sacs, rcipients)
jirbun : Sac en cuir, sac de berger, sac de voyage ; besace
qirbatun : Grande outre
qlabun : Moule dans lequel on verse lairain fondu
B.2.3. Cavit du corps
jawfun : Ventre
jirbun :Scrotum
waqbun : Cavit de l'oeil, orbite
faqatun : Anus
B.2.4. Forme oriente : trou, caverne
14
naqaba : Percer un mur, y faire un trou
naqbun : Trou perc dans un mur, excavation
tanqb : Le fait de creuser, de la, approfondir, enquter
waqaba : tre enfonc dans son orbite (se dit des yeux)
waqbatun : Trou
kahfun : Grotte, caverne
nafaqun : Tunnel
faqara : Percer un trou
B.3. Extensions smantiques
B.3.1. Ouvrir la main, la bouche (dessiner un ou un )
fakka : Ouvrir (la main pour laisser tomber ce quon y tenait)
kaffun : Paume de la main, creux form par la paume de la main
B.3.2. Si lon ne considre que les deux extrmits de la courbure, se
dgage la notion d'cart et d'ouverture
faj / w / : Ouvrir (la porte)
fajwatun, pl. fajawtun : Interstice, espace entre deux choses ; cour, espace entre
les murailles d'une maison
fajja : Marcher les jambes cartes
faraja : Ouvrir, entrouvrir (une porte)
farjun : Ouverture, sexe de femme
B.3.3. De lcart, on passe scarter du droit chemin, biaiser
6
nakaba : Dvier, s'carter du chemin
F.V : Biaiser, s'carter de la ligne droite
janaf FVI : S'carter, dvier de la voie droite
B.4. Synthse 1 = : rond, boule, cercle
B.4.1. Membres du corps ronds ou cylindriques et habits qui
entourent une partie du corps > entourer
jabara : Panser, bander et remettre (un os)
aqabun : Ceinture orne
iqbun : Ceinture de femme enrichie dornements
kafana : Envelopper (le mort) dans un linceul
faqaratun : Vertbre
B.4.2. Objets circulaires ou cylindriques, boules
quffun : Pannier ou bateau rond
kabba F. II: Pelotonner, mettre en forme de boulettes, des boules
kubbatun : Peloton ; grosse boule ; boulette
6
Comme en franais : faire un cart : dvier du droit chemin physiquement ou moralement.
15
falakun : Globe, tout corps globuleux, sphrique ; sphre cleste, ciel,
corps cleste
B.4.3. Rond, cercle, roue, couronne (de l : entourer, encercler)
bakratun : Poulie ; roue de chariot ; roue dune machine irrigation
qanbun : Calice d'une fleur
kaffa F. X : Entourer quelque chose, faire un cercle autour pour voir ou
examiner quelque chose ; se rouler en spirale (se dit dun serpent)
kaffatun : Plateau de la balance
kiffun : Bordure
kafaa : Tourner autour
kanafa : Entourer dune haie, dune clture (une maison)
F. VIII : Entourer, cerner de tous cts
mukannafun : Entour, clos de tous cts
B.5. Synthse 2 : lentrelacement, le tissage, la torsion et
fabrication de cordes sont une autre forme de synthse des deux
courbures
abaka : Tisser
abkatun : Tissage
4. Conclusion
On peut constater que les implications de cesanalyses remettent en cause
la conception structuraliste du signe linguistique. Toute la linguistique
rcente, structuralisme, grammaire gnrative, ainsi que neurosciences
cognitives
7
,
a repris la position saussurienne concernant le signe
linguistique : Premier principe : larbitraire du signe (Saussure, 1916,
d. 1995 : 100). Dans la reformulation de Benveniste : Ce qui est
arbitraire cest que tel signe et non tel autre soit appliqu tel lment de
la ralit et non tel autre . Cest cette relation entre les deux qui
constitue la zone de larbitraire.
Toutes les donnes qui viennent dtre analyses montrent au contraire
que le signifiant est motiv, quil nest pas arbitraire par rapport au
signifi, et quil a une attache avec lui dans la ralit. En dautre termes,
ce nest pas par hasard que {f,} suggre l'acte de souffler , cest
parce quen prononant la squence de sons f on souffle ; ce nest pas
par hasard que les sens de concave, convexe, rond et entrelacs ont
quelque chose voir avec le trait [dorsal] : cest justement parce que la
langue revt la forme convexe, ralise la courbure, dans larticulation de
7
Pinker (1994, traduction 1999 : 145) au signe arbitraire de Saussure, qui reprsente le premier
des deux principes du fonctionnement du langage.
16
tous ces mots dont les dnominateurs communs, formels et smantiques,
sont sous-tendus par la matrice :
{[labial], [dorsal]}
[-son]
quils vhiculent cette notion.
En dautres termes entre les mots : kub = mamelle , jawf = ventre ,
kifl= fesses , rukba = genou et la ralit, il a bien un
lien mimophonique : l'invariant notionnel : la courbure
signifi courbure
signifiant{[labial], [dorsal]= de la langue}
[-son] des lvres
qui fait le lien entre le signifiant, le signifi et le monde. Il n'est donc pas
arbitraire que tel signe et non tel autre soit appliqu tel lment de la
ralit et non tel autre, dirais-je pour paraphraser Benveniste ma
manire, ayant montr que dans les cas tudis ici, la forme du mot a un
rapport naturel avec son sens ( savoir son rfrent) pour paraphraser
Martinet ma manire.
Il faut donc poser le dbat dans la perspective trace par Fonagy (1993) :
appartenant un systme, les signes linguistiques sont conventionnels,
mais ces signes peuvent tre motivs ou arbitraires, selon les langues.
L'arabe est alors une langue o les signes sont maximalement motivs.
5. Ultime consquence
Jinsisterai, pour finir, sur une dernire consquence de lorganisation que
je propose, concernant le dbat sur lorigine des langues.
A partir du moment ou la motivation mimophonique se substitue, au
moins partiellement, larbitraire postul par De Saussure, un grand
nombre darguments en faveur dune origine commune des langues
tombent. En effet, si la mimophonie motive le lien entre
{[labial], [dorsal]}
[-son]
et la courbure, elle ne motive pas ce lien en arabe seulement, mais dans
bien des langues, sans aucune parent gntique. Donc, quand Ruhlen
(1994) donne BU(N)KA genou ; courber , comme lune des 27
racines mondiales qui tayent lhypothse de lorigine unique des langues
17
du monde
8
, jobserve que je retrouve ici des manifestations de la matrice
mimophonique
{[labial], [dorsal]}
[-son]
b k
comme dans comme rukba et kub et kifl,et que cette mimophonie suffit
justifier quelle revte dans toutes ces langues le sens de la courbure :
lhypothse dune origine commune nest alors nullement ncessaire, et si
elle n'est pas ncessaire, elle est inutile..
De mme que l'tre humain a probablement merg en des lieux
diffrents, ainsi en va-t-il pour le langage. Nul besoin de postuler une
langue mre commune. Si la courbure du genou s'exprime par bk en
arabe, en mongol et en proto-australien, il n'y a pas poser pour autant
que ces langues proviennent d'une langue mre commune. Simplement, la
mimophonie, au sens dfinie au dbut de cet expos, suffit rendre
compte de cette relation : simplement, l'articulation de k implique la
ralisation du schma de la page 12 o la relation [dorsal]/courbure est
explicite. Certes, la thorie des matrices et des tymons, de par ses
objectifs et les conclusions qu'elle engendre, sinscrit dans un dbat vieux
comme le monde le langage humain est-il conventionnel ou non ? Mais
nul cratylisme naf dans cette dmarche : seulement la dcouverte et
la description dun systme o un smantisme constant et gnral est
articul autour dun jeu phontique simple, tout en procdant sur des
donnes progressivement de plus en plus larges, dans un travail dune
abstraction de plus en plus grande.
BIBLIOGRAPHIE
8
N.B. Voici quelques exemples donns par lui :
language word meaning
Omotic boq knee
Sanskrit bhugn bent
English bow, elbow
Old Uighur bk/bk To twist
Written Mongolian bken hump of a camel
Evenki buku bent, crooked
Tobelo buku knee
Proto-Algonquian *wk bend
Warrao oboka elbow
Sapiboca embako elbow
18
BENVENISTE E., Problmes de linguistique gnrale, Paris, Gallimard,
1966.
BOHAS G. Matrices, tymons, racines, lments dune thorie
lexicologique du vocabulaire arabe, Louvain-Paris, Peeters, 1997.
BOHAS G., 2000, Matrices et tymons, dveloppements de la thorie,
Lausanne, Editions du Zbre.
BOHAS G., et SERHANE R., Consquences lexicales de la dcomposition
du phonme en traits, paratre, .
FNAGY I. Physei/Thesei. Laspect volutif dun dbat millnaire ,
Faits de Langues 1, 1993, p. 29-45.
GAFFIOT F. Dictionnaire illustr latin franais, Paris, Hachette, 1934.
GUIRAUD P. Structures tymologiques du lexique franais, Paris, Payot,
1967, e
2
Paris, Larousse, 1986.
KAZIMIRSKI A. de Biberstein, Dictionnaire arabe-franais, Paris,
Maisonneuve et Cie, 1860 [Rdition Beyrouth, Librairie du Liban, s. d.].
LADEFOGED P. A Course in Phonetics, New York, Chicago, San
Francisco, Atlanta, Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
MARTINET A. Mmoires d'un linguiste, Paris, Quai Voltaire Edima 1993.
NICOLA R. De lentrelac la courbure : emprunt vel genesis ,
Comptes rendus du GLECS, t. XXIV-XXVIII, 1982, p. 241-267.
R. NICOLA R., Rflexions comparatives partir de lexiques ngro-
africains et chamito-smitiques : faits et thorie , JUNGRAITHMAYER H.
et MULLER W.W. (dir.), Proceedings of the Fourth International Camito-
Semitic Congress, Amsterdam Philadelphie,J. Benjamins, 1983, p. 47-64.
NYCKEES V., La smantique, Paris, Belin, 1998.
PINKER S., Linstinct du langage, Paris, Editions Odile Jacob, 1999.
RUHLEN M., Lorigine des langues, sur les traces de la langue mre,
Paris, Belin, 1997.
SAUSSURE F., de, Cours de linguistique gnrale, publi par Ch. Bailly et
A. Schehaye, 1916, d. critique prpare par Tulio de Mauro, post face
de J.-L. Calvet, Paris, Payot , 1995.
SERHANE R., Etude dtaille de la matrice {[labial), [dorsal]}, Thse de
doctorat, Paris 8, en prparation.
WEHR H. (ed. by J. Milton Cowan), A Dictionary of Modern Written
Arabic, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1961.
Vous aimerez peut-être aussi
- Nénuphar CM1Document1 pageNénuphar CM1berbicheasma1Pas encore d'évaluation
- Bernard Dubourg - L'Invention de Jesus1 PDFDocument136 pagesBernard Dubourg - L'Invention de Jesus1 PDFsangoku81100% (3)
- Les Constituant Ou Unités LinguistiquesDocument3 pagesLes Constituant Ou Unités LinguistiquesНаталя Кардаш100% (1)
- 001 C PDFDocument224 pages001 C PDFKakande Isaac100% (4)
- Une Breve Histoire de La Linguistique ContemporaineDocument9 pagesUne Breve Histoire de La Linguistique ContemporaineRodrigo100% (1)
- La SemantiqueDocument14 pagesLa SemantiqueDoinita Dinca0% (1)
- Saussure Et La Linguistique StructuraleDocument1 pageSaussure Et La Linguistique StructuraleGiulianaPas encore d'évaluation
- Marcel PROUST - Contre Sainte-BeuveDocument5 pagesMarcel PROUST - Contre Sainte-BeuveAna Gabriele Branco Correia Souto100% (1)
- Grammaire TheoriqueDocument110 pagesGrammaire TheoriqueAna PîslaruPas encore d'évaluation
- Cours 1 Sémantique RédigéDocument8 pagesCours 1 Sémantique RédigéEkaterina SviridovaPas encore d'évaluation
- Les Types de Grammaires Théoriques, Les Méthodes D'étude en GrammaireDocument4 pagesLes Types de Grammaires Théoriques, Les Méthodes D'étude en GrammaireȘarban Doinița100% (1)
- Questions LinguistiquesDocument9 pagesQuestions LinguistiqueselakidyassirPas encore d'évaluation
- Actes de LangageDocument13 pagesActes de Langagekk100% (1)
- FR-L1-ILing Distinction Grammaire Et LinguistiqueDocument5 pagesFR-L1-ILing Distinction Grammaire Et LinguistiqueSam AiPas encore d'évaluation
- Grammaire Du TexteDocument0 pageGrammaire Du TexteMohamed SimPas encore d'évaluation
- Pragmatique 1Document39 pagesPragmatique 1Roxelane Lou100% (1)
- Leçon 7 La Dénotation Et La ConnotationDocument1 pageLeçon 7 La Dénotation Et La ConnotationEddie NguyễnPas encore d'évaluation
- Résumé Du Cours de La Pragmatique Du ContenuDocument4 pagesRésumé Du Cours de La Pragmatique Du ContenuKhadija EL FAHLI100% (1)
- V. KERBRAT - Les Déictiques (34-68)Document35 pagesV. KERBRAT - Les Déictiques (34-68)maria.dumitru13Pas encore d'évaluation
- Elements de Pragmatique LinguistiqueDocument2 pagesElements de Pragmatique LinguistiqueMaria SimotaPas encore d'évaluation
- Intro Au Linguistique PDFDocument13 pagesIntro Au Linguistique PDFObjectif ComprendrePas encore d'évaluation
- La LinguistiqueDocument2 pagesLa LinguistiqueFreriza BoutahriPas encore d'évaluation
- Générativisme Et Grammaire Générative Et TransformationnelleDocument8 pagesGénérativisme Et Grammaire Générative Et TransformationnelleGabriel Azael Garcia GarridoPas encore d'évaluation
- Générativisme Et CognitivismeDocument12 pagesGénérativisme Et CognitivismescribdabdouPas encore d'évaluation
- Mini Memoire de WilfriedDocument28 pagesMini Memoire de WilfriedTougma WilfriedPas encore d'évaluation
- Discours Mediatiques Camus GeorgetDocument16 pagesDiscours Mediatiques Camus GeorgetAmen SoumPas encore d'évaluation
- Production Poesie SalmanDocument25 pagesProduction Poesie SalmanElieli GsPas encore d'évaluation
- L'appareil Formel de L'énonciationDocument3 pagesL'appareil Formel de L'énonciationOUSSAMA OUBELLAPas encore d'évaluation
- Djerraya ImaneDocument101 pagesDjerraya ImaneSiham HamidiPas encore d'évaluation
- Exercice MorphoDocument3 pagesExercice MorphojismailPas encore d'évaluation
- Le Champ SemantiqueDocument8 pagesLe Champ SemantiqueMarin Gheorghe-Marin100% (1)
- 1 TD Grammaire L1.docx L'ANALYSE EN CONSTITUANTS IMMEDIATSDocument9 pages1 TD Grammaire L1.docx L'ANALYSE EN CONSTITUANTS IMMEDIATSSAHRA YOUPas encore d'évaluation
- Langue2 Analyse Semique PrincipesDocument7 pagesLangue2 Analyse Semique PrincipesRoxana Roxanne100% (1)
- Aménagement de L'amazighe Ahmed Boukous Asinag03frDocument28 pagesAménagement de L'amazighe Ahmed Boukous Asinag03frAbdlemjid MoutalibPas encore d'évaluation
- Les Idées LinguistiquesDocument46 pagesLes Idées LinguistiquesWalid JouiniPas encore d'évaluation
- Signo Semio - Manuel de Sémiotique PDFDocument179 pagesSigno Semio - Manuel de Sémiotique PDFbismannPas encore d'évaluation
- Corrigé Exercices Séance 3Document6 pagesCorrigé Exercices Séance 3hicham hassouniPas encore d'évaluation
- PragmatiqueDocument16 pagesPragmatiqueTiffany RasandisonPas encore d'évaluation
- La Notion de L'écartDocument13 pagesLa Notion de L'écartMohammed KachaiPas encore d'évaluation
- Définition de La Linguistique ContrastiveDocument4 pagesDéfinition de La Linguistique ContrastiveIslam IslamPas encore d'évaluation
- LexicologieDocument6 pagesLexicologiemelisa77890% (1)
- Mini Memoire .Document6 pagesMini Memoire .basma sounniPas encore d'évaluation
- Cours1 ENS - KeyDocument23 pagesCours1 ENS - KeySs KgPas encore d'évaluation
- Syntaxe Générative S6 Option LinguistiqueDocument32 pagesSyntaxe Générative S6 Option LinguistiqueSanae El AbbassiPas encore d'évaluation
- La Sémantique Structurale Par Reboul Et Moeschler PDFDocument7 pagesLa Sémantique Structurale Par Reboul Et Moeschler PDFBarbara VodanovićPas encore d'évaluation
- Type de Discours FrancaisDocument3 pagesType de Discours FrancaisNeili-claudia GhergutiPas encore d'évaluation
- Linguistique BienDocument6 pagesLinguistique Bienالمتمدرس 对到Pas encore d'évaluation
- Modes TempsDocument78 pagesModes TempsSofiane Brdh100% (2)
- Synthèse Théorie Lingguistique Et Modèle D Analyse MR Ibn Elfarouk CopieDocument11 pagesSynthèse Théorie Lingguistique Et Modèle D Analyse MR Ibn Elfarouk Copiebasma sounniPas encore d'évaluation
- Leçon 8 Les Relations LexicalesDocument9 pagesLeçon 8 Les Relations LexicalesEddie NguyễnPas encore d'évaluation
- Linguistique Diachronique - 3e Chapitre-2022Document40 pagesLinguistique Diachronique - 3e Chapitre-2022Đorđe GavrićPas encore d'évaluation
- Lénoncé Et La PhraseDocument8 pagesLénoncé Et La PhraseMeyssem Zelellou100% (1)
- John AustinDocument54 pagesJohn AustinPinar SezerPas encore d'évaluation
- Completives Et Phrase Infinitive.2015Document26 pagesCompletives Et Phrase Infinitive.2015MilicaPas encore d'évaluation
- Bloomfield Et Le DistributionnalismeDocument2 pagesBloomfield Et Le DistributionnalismeGaming Games100% (3)
- La Sémantique InterprétativeDocument25 pagesLa Sémantique Interprétativejurbina1844100% (2)
- Leila Messaoudi (1996) Société, Langues Et Cultures Au MarocDocument7 pagesLeila Messaoudi (1996) Société, Langues Et Cultures Au MarocTaoufik AfkinichPas encore d'évaluation
- Dernière Partie Du Cours Sémantique I M28 Parcours 2semestre 5Document48 pagesDernière Partie Du Cours Sémantique I M28 Parcours 2semestre 5Tar OuadPas encore d'évaluation
- Les Slogans Avant Et Après La Révolution TunisienneDocument10 pagesLes Slogans Avant Et Après La Révolution TunisiennelukasesanePas encore d'évaluation
- Connotation SuiteDocument9 pagesConnotation SuitenikaluciPas encore d'évaluation
- Cours 5Document50 pagesCours 5Iulia Rapeanu100% (1)
- La Structure sémantique: Le lexème coeur dans l'oeuvre de Jean EudesD'EverandLa Structure sémantique: Le lexème coeur dans l'oeuvre de Jean EudesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La Variation sociolinguistique: Modèle québécois et méthode d'analyseD'EverandLa Variation sociolinguistique: Modèle québécois et méthode d'analysePas encore d'évaluation
- El Pilón (Banda) - Baritone (B.C.)Document2 pagesEl Pilón (Banda) - Baritone (B.C.)Santiago Roldán GutiérrezPas encore d'évaluation
- Séance 02 - 19 - Systèmes RépartisDocument41 pagesSéance 02 - 19 - Systèmes RépartisibouPas encore d'évaluation
- Lista Admissible CCMP MPDocument72 pagesLista Admissible CCMP MPandraxoPas encore d'évaluation
- CV Faissal IkzarnDocument1 pageCV Faissal IkzarnAbdelkafi AhmedPas encore d'évaluation
- Notions D'analyse Métrique (Revu 12-2009) Benoît de CornulierDocument21 pagesNotions D'analyse Métrique (Revu 12-2009) Benoît de Cornuliergrammaire51Pas encore d'évaluation
- Les HypothèsesDocument2 pagesLes HypothèsessophilauPas encore d'évaluation
- La Phrase ComplexeDocument5 pagesLa Phrase Complexemishy-ithreePas encore d'évaluation
- Se Présenter en Anglais Lors D'un Entretien D'embaucheDocument8 pagesSe Présenter en Anglais Lors D'un Entretien D'embaucheELOGRIPas encore d'évaluation
- Tabela ASCIIDocument2 pagesTabela ASCIInilsonnf100% (9)
- Explication Linéaire, Marie - Alcools - Apollinaire - Commentaire de Texte - Laure CoudonDocument1 pageExplication Linéaire, Marie - Alcools - Apollinaire - Commentaire de Texte - Laure CoudonTeo FetidaPas encore d'évaluation
- DS 2ce16d5t (A) Vfit3 PDFDocument1 pageDS 2ce16d5t (A) Vfit3 PDFdiaradi.28Pas encore d'évaluation
- Atelier de Traduction 5 6Document300 pagesAtelier de Traduction 5 6corinasaitisPas encore d'évaluation
- Comnum 6 TXT PDFDocument15 pagesComnum 6 TXT PDFKhaled OuniPas encore d'évaluation
- Examen Régiona3Document1 pageExamen Régiona3Youssef MAFTAH EL KHEIRPas encore d'évaluation
- DeterminantDocument1 pageDeterminantFatma SkahPas encore d'évaluation
- 10.9.321-En-12056-2 EvacuationDocument38 pages10.9.321-En-12056-2 Evacuationjbh FluidesPas encore d'évaluation
- Part Présent-GérondifDocument1 pagePart Présent-GérondifSilvia CalabresePas encore d'évaluation
- Quantificateures Et Tables de VRT CRGDocument2 pagesQuantificateures Et Tables de VRT CRGKaouther GaciPas encore d'évaluation
- LF 6 Devoir 1 1448917949 85Document21 pagesLF 6 Devoir 1 1448917949 85popjalel100% (1)
- Axe Environnement Norme NFDocument15 pagesAxe Environnement Norme NFSamir SassiPas encore d'évaluation
- 4pOO6HtNBSNiIng8Ndj JGDocument285 pages4pOO6HtNBSNiIng8Ndj JGeyesonyou3Pas encore d'évaluation
- FLE - Le Discours Rapporté - Français Langue Étrangère - LaDocument2 pagesFLE - Le Discours Rapporté - Français Langue Étrangère - Lamjst1982Pas encore d'évaluation
- Attribut Du SujetDocument5 pagesAttribut Du SujetStef TipsPas encore d'évaluation
- Révision Générale 5ème APDocument2 pagesRévision Générale 5ème APmouram07100% (2)
- En 40-2 (2004) (F)Document7 pagesEn 40-2 (2004) (F)n.etrifniPas encore d'évaluation
- Grille D Correction Francais SDocument3 pagesGrille D Correction Francais SndiayePas encore d'évaluation
- Ludo 4 Livre Du ProfesseurDocument226 pagesLudo 4 Livre Du ProfesseurLourds Mesa Rodriguez100% (2)