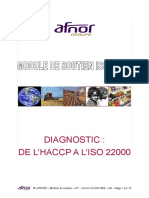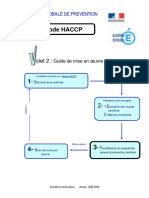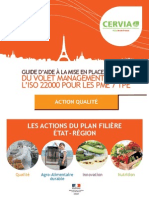Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Analyse Des Risques Et Autocontrol en Production
Analyse Des Risques Et Autocontrol en Production
Transféré par
Mariela Vinces CarrilloDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- Cas PratiqueDocument8 pagesCas PratiqueARKAS100% (1)
- CV Omar KSIBI FR 01-2023Document6 pagesCV Omar KSIBI FR 01-2023Omar KSIBIPas encore d'évaluation
- ISO 22000 Module de Soutien N 2 Diag HACCP Selon ISO 22000Document10 pagesISO 22000 Module de Soutien N 2 Diag HACCP Selon ISO 22000Safa el ouedPas encore d'évaluation
- Qualite Securite AlimentaireDocument2 pagesQualite Securite AlimentaireYasmine Badys100% (1)
- 2 - Création D'entrepriseDocument53 pages2 - Création D'entrepriseghribiemna100% (1)
- IFS Food7 Comparison of IFS Food Version 7 and IFS Food v61 FRDocument30 pagesIFS Food7 Comparison of IFS Food Version 7 and IFS Food v61 FRLobna TaakchatPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Vanelli198 (1) (1) Nouv3333Document31 pagesRapport de Stage Vanelli198 (1) (1) Nouv3333issam_da92% (12)
- HACCPDocument38 pagesHACCPachraf ezzouhairiPas encore d'évaluation
- Haccp 2014Document22 pagesHaccp 2014FouratZarkouna100% (1)
- HACCPDocument88 pagesHACCPامةاللهPas encore d'évaluation
- HaccpDocument12 pagesHaccpfatiha elgharbaouiPas encore d'évaluation
- Analyses Des Dangers AnssesDocument29 pagesAnalyses Des Dangers AnssessimaPas encore d'évaluation
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension C - Interactions avec les parties prenantesD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension C - Interactions avec les parties prenantesPas encore d'évaluation
- Manuel de communication sur les risques appliquée à la sécurité sanitaire des alimentsD'EverandManuel de communication sur les risques appliquée à la sécurité sanitaire des alimentsPas encore d'évaluation
- Commission du Codex Alimentarius: Manuel de Procédure Vingt-sixième editionD'EverandCommission du Codex Alimentarius: Manuel de Procédure Vingt-sixième editionÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension B – Fonctions de contrôleD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension B – Fonctions de contrôlePas encore d'évaluation
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension A – Intrants et ressourcesD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension A – Intrants et ressourcesPas encore d'évaluation
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Introduction et glossaireD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Introduction et glossairePas encore d'évaluation
- La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2021: Rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients face aux chocs et aux situations de stressD'EverandLa situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2021: Rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients face aux chocs et aux situations de stressPas encore d'évaluation
- Coleacp Manuel 1 FR 0 PDFDocument346 pagesColeacp Manuel 1 FR 0 PDFzgbfaija67% (3)
- Guide Analyse Des Dangers Bacteriologiques ACTION QUALITE PDFDocument36 pagesGuide Analyse Des Dangers Bacteriologiques ACTION QUALITE PDFإلا عقيدتناPas encore d'évaluation
- Construire Un Plan de Nettoyage PDFDocument20 pagesConstruire Un Plan de Nettoyage PDFazizaPas encore d'évaluation
- Support de Cours Haccp PP DessDocument36 pagesSupport de Cours Haccp PP Desskira525Pas encore d'évaluation
- Les Bonnes Pratiques D Hygi Ne 1650827515Document13 pagesLes Bonnes Pratiques D Hygi Ne 1650827515Harisson Ulrich BENIE100% (1)
- GBPH HaccpDocument146 pagesGBPH HaccpKeith KelewouPas encore d'évaluation
- Livret 10 Questions ISO22000Document24 pagesLivret 10 Questions ISO22000sabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Actia Guide Tracabilite 2007-1Document79 pagesActia Guide Tracabilite 2007-1tirlirePas encore d'évaluation
- Management Hygiène Et Sécurité AlimentaireDocument71 pagesManagement Hygiène Et Sécurité Alimentairelatifa aqchachPas encore d'évaluation
- HACCPDocument10 pagesHACCPMohamed Bourza100% (1)
- Hygiene Et Securite SONAPI-2Document42 pagesHygiene Et Securite SONAPI-2jean bidlynePas encore d'évaluation
- 2022 - Support Formation Licence Professionnelle Aix Marseille - Sécurité Alimentaire CopieDocument131 pages2022 - Support Formation Licence Professionnelle Aix Marseille - Sécurité Alimentaire CopieSalim BouhlelPas encore d'évaluation
- Cours Limites HACCPDocument17 pagesCours Limites HACCPRAFIQ100% (1)
- Hygiene AlimentaireDocument3 pagesHygiene AlimentaireAminePas encore d'évaluation
- Annexe 7Document40 pagesAnnexe 7DonMidowPas encore d'évaluation
- Qualité Sécurité Environnement PDFDocument32 pagesQualité Sécurité Environnement PDFBenouna FertPas encore d'évaluation
- ESEBAT-L3-Cours Qualité Sécurité-M DIOUFDocument100 pagesESEBAT-L3-Cours Qualité Sécurité-M DIOUFHabibe Tran-van100% (2)
- Tracabilite CharvetDocument55 pagesTracabilite CharvetMohamed ElbaghdadiPas encore d'évaluation
- Formation Iso 22000 LhichouDocument128 pagesFormation Iso 22000 LhichouMed Errami100% (2)
- HACCP - Management Securite Aliments 1Document130 pagesHACCP - Management Securite Aliments 1achnid mohamed100% (1)
- Haccp & Iso 22000Document56 pagesHaccp & Iso 22000Patricia Kamdoum100% (1)
- Principes Enjeux Management Integre QSEDocument80 pagesPrincipes Enjeux Management Integre QSEToufik DehilisPas encore d'évaluation
- Demarche Haccp en Cuisine de Collectivite PDFDocument37 pagesDemarche Haccp en Cuisine de Collectivite PDFHadja SavanéPas encore d'évaluation
- Cours CopagDocument111 pagesCours CopagAnonymous MKSfyYyODPPas encore d'évaluation
- Module-Maitrise de L'environnement agroalimentaire-2023-02-23FRDocument65 pagesModule-Maitrise de L'environnement agroalimentaire-2023-02-23FRAnne Marie PEVROL100% (1)
- Emergence Des RisquesDocument314 pagesEmergence Des RisquesAmine Hiba100% (3)
- Module Contrôle de Points Critiques (CCP) Dr. ZOUAOUI N.Document74 pagesModule Contrôle de Points Critiques (CCP) Dr. ZOUAOUI N.Aouaichia Rania100% (1)
- Module 2 - SSA HACCP Codex AlimentariusDocument31 pagesModule 2 - SSA HACCP Codex AlimentariusAyoub OUBAHA100% (1)
- Guide de Bonnes Pratiques D'hygiène - 30112021Document91 pagesGuide de Bonnes Pratiques D'hygiène - 30112021chafikPas encore d'évaluation
- Manuel Du Modèle HACCP Générique Pour Les Secteurs Du Remballage Et Du Commerce en Gros Des Fruits Et Légumes FraisDocument38 pagesManuel Du Modèle HACCP Générique Pour Les Secteurs Du Remballage Et Du Commerce en Gros Des Fruits Et Légumes FraisWalid RahmouniPas encore d'évaluation
- Fruit Et LégumeDocument81 pagesFruit Et LégumehatemPas encore d'évaluation
- Equipement Protection RespiratoireDocument26 pagesEquipement Protection RespiratoireMahmoud Abbas100% (1)
- Module Soutien Iso22000 12Document14 pagesModule Soutien Iso22000 12Laritta2010100% (1)
- Manuel HACCPDocument18 pagesManuel HACCPSaleh ChekPas encore d'évaluation
- 05 - Ehpad240512 Plan de Nettoyage HaccpDocument17 pages05 - Ehpad240512 Plan de Nettoyage HaccpEDITH KOUAMEPas encore d'évaluation
- Guide D'utilisation Pour La Mise en Place D'une Démarche HACCPDocument9 pagesGuide D'utilisation Pour La Mise en Place D'une Démarche HACCPkomad12Pas encore d'évaluation
- Coleacp Manuel 2 FR 0Document122 pagesColeacp Manuel 2 FR 0Hasnaa Mb100% (1)
- Traçabilité HACCPet BPHDocument47 pagesTraçabilité HACCPet BPHDjamel HamoudiPas encore d'évaluation
- Manuel HACCP Guide Élaboration PDFDocument10 pagesManuel HACCP Guide Élaboration PDFSharif-dine Mora LafiaPas encore d'évaluation
- 5S - Master2 GMPRDocument171 pages5S - Master2 GMPREddehbiPas encore d'évaluation
- SF2H Recommandations Hygiene Des Mains 2009Document102 pagesSF2H Recommandations Hygiene Des Mains 2009zeugma2010Pas encore d'évaluation
- Guide Cervia - IsO 22000Document17 pagesGuide Cervia - IsO 22000komad12100% (1)
- TheseDocument125 pagesTheseMarwa AlayaPas encore d'évaluation
- Prévention Des Risques Pro Liés Au RestaurationDocument20 pagesPrévention Des Risques Pro Liés Au RestaurationMahmoud Mansy100% (2)
- LeadershipDocument5 pagesLeadershipjackPas encore d'évaluation
- Présentation INSA Rouen 28 Nov 19-EnvironnementDocument100 pagesPrésentation INSA Rouen 28 Nov 19-Environnementbrahim chalhoubPas encore d'évaluation
- Project Management Professional (PMP) : Grandes Lignes Du Contenu de L'examen - Janvier 2021Document20 pagesProject Management Professional (PMP) : Grandes Lignes Du Contenu de L'examen - Janvier 2021ghribiemnaPas encore d'évaluation
- CQ Au Laboratoire Des Essais PhysicochimiquesDocument17 pagesCQ Au Laboratoire Des Essais PhysicochimiquesghribiemnaPas encore d'évaluation
- Thèse Emballage ChitosaneDocument178 pagesThèse Emballage Chitosaneghribiemna100% (4)
- 1 Ae DLCDocument55 pages1 Ae DLCghribiemnaPas encore d'évaluation
- F08 Lagunage AereDocument10 pagesF08 Lagunage AereghribiemnaPas encore d'évaluation
- Procédés Biotechnologiques InnovantsDocument39 pagesProcédés Biotechnologiques InnovantsghribiemnaPas encore d'évaluation
- Cours ConceptionDocument59 pagesCours Conceptionsbenlatifa100% (4)
- Prétraitements de La Biomasse LignocellulosiqueDocument41 pagesPrétraitements de La Biomasse LignocellulosiqueghribiemnaPas encore d'évaluation
- Dossier - Type - Agrement - Fermier LaiterieDocument49 pagesDossier - Type - Agrement - Fermier Laiteriealex brinPas encore d'évaluation
- Manuel Du Modèle HACCP Générique Pour Les Secteurs Du Remballage Et Du Commerce en Gros Des Fruits Et Légumes FraisDocument38 pagesManuel Du Modèle HACCP Générique Pour Les Secteurs Du Remballage Et Du Commerce en Gros Des Fruits Et Légumes FraisWalid RahmouniPas encore d'évaluation
- Contribution A L'audit de Suiv - QARCH Kenza - 2791 PDFDocument80 pagesContribution A L'audit de Suiv - QARCH Kenza - 2791 PDFKhalil ValhallaPas encore d'évaluation
- Poissonnerie Mai 2020Document6 pagesPoissonnerie Mai 2020jonathanPas encore d'évaluation
- Guide Cervia ISO 22000Document17 pagesGuide Cervia ISO 22000boualemtitiche1966Pas encore d'évaluation
- Cours 06 Qualite AlimentsDocument12 pagesCours 06 Qualite AlimentsMohammed Salim AmmorPas encore d'évaluation
- Boudjelti Mohamed Lamine Et Lasni Mahdi CopieDocument138 pagesBoudjelti Mohamed Lamine Et Lasni Mahdi CopieSamamo Dasilva100% (1)
- Restauration BR (1041)Document81 pagesRestauration BR (1041)Narcisse DoréePas encore d'évaluation
- Eau Potable Zenoauki HallalDocument35 pagesEau Potable Zenoauki HallalMoundir AmraniPas encore d'évaluation
- F904a-Auditor-Checklist-Site-Self-Assessment-Tool-V1 (1) FRDocument110 pagesF904a-Auditor-Checklist-Site-Self-Assessment-Tool-V1 (1) FRAmine Simo JacksonPas encore d'évaluation
- Guide BPH Pour Les Crustacés CuitsDocument461 pagesGuide BPH Pour Les Crustacés CuitsOmar KSIBIPas encore d'évaluation
- Manuel Pour Garantir Les Conditions de Sécurité Sanitaire-PoissonsDocument41 pagesManuel Pour Garantir Les Conditions de Sécurité Sanitaire-PoissonsFousseyni TRAOREPas encore d'évaluation
- 1951THV 1Document89 pages1951THV 1Rania AllaouaPas encore d'évaluation
- Recommandations Pour L'elaboration de Criteres Microbiologiques D'hygiene Des ProcedesDocument17 pagesRecommandations Pour L'elaboration de Criteres Microbiologiques D'hygiene Des ProcedesAmina Ait MalhaPas encore d'évaluation
- Redaction de Stage de Fin D'etudeDocument51 pagesRedaction de Stage de Fin D'etudeBourgeois Atangana NoahPas encore d'évaluation
- Original Plan D'affaire Nettoyage 3.0 (1) FRDocument21 pagesOriginal Plan D'affaire Nettoyage 3.0 (1) FRTresor KayitabaPas encore d'évaluation
- Hygiene TabtiDocument65 pagesHygiene TabtiihcPas encore d'évaluation
- Décret N°2023-2160 Relatif Au Contrôle Des Produ - 231114 - 143333Document23 pagesDécret N°2023-2160 Relatif Au Contrôle Des Produ - 231114 - 143333aboubacarfa206Pas encore d'évaluation
- Haccp MinoterieDocument47 pagesHaccp MinoterieDjawed BoutPas encore d'évaluation
- Communication KOLLI Hygine 17-140Document41 pagesCommunication KOLLI Hygine 17-140Selwa BayouPas encore d'évaluation
- Définition de l'HACCP PDFDocument1 pageDéfinition de l'HACCP PDFYsaline DevignePas encore d'évaluation
- 12 V1N1 MJBS 209-232Document24 pages12 V1N1 MJBS 209-232ESSANHAJI AliPas encore d'évaluation
- 156671-Article Text-408552-1-10-20170526 PDFDocument13 pages156671-Article Text-408552-1-10-20170526 PDFFREDERIC NZALEPas encore d'évaluation
- ADIAL - Brochure - Distributeur Automatique Pizzas 2020Document40 pagesADIAL - Brochure - Distributeur Automatique Pizzas 2020Marouan El MasbahiPas encore d'évaluation
- 3 - Formation - Usda - HaccpDocument6 pages3 - Formation - Usda - HaccpyoucefPas encore d'évaluation
- Plaquette Fel Part 2010Document4 pagesPlaquette Fel Part 2010stewe2009Pas encore d'évaluation
Analyse Des Risques Et Autocontrol en Production
Analyse Des Risques Et Autocontrol en Production
Transféré par
Mariela Vinces CarrilloCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Analyse Des Risques Et Autocontrol en Production
Analyse Des Risques Et Autocontrol en Production
Transféré par
Mariela Vinces CarrilloDroits d'auteur :
Formats disponibles
3 ANALYSE DES
RISQUES ET
AUTOCONTROLE
EN PRODUCTION
Le PIP est un programme de coopration europen gr par le COLEACP. Le COLEACP est un
rseau international uvrant en faveur du dveloppement durable du commerce horticole.
Le programme PIP est nanc par lUnion europenne et a t mis en uvre la demande
du Groupe des Etats ACP (Afrique, Carabes et Pacique). En accord avec les Objectifs du
Millnaire, lobjectif global du PIP est de Prserver et, si possible, accrotre la contribution
de lhorticulture dexportation la rduction de la pauvret dans les pays ACP .
La prsente publication a t labore avec laide de lUnion europenne. Le contenu de la
publication relve de la seule responsabilit du PIP et du COLEACP et ne peut aucunement
tre considr comme retant le point de vue ofciel de lUnion europenne.
A lexemple des autres manuels de formation produits par le programme PIP
du COLEACP, le manuel 3 a t conu et rdig par la Cellule de Formation du
programme. Bruno Schiffers, professeur Gembloux Agro-Bio Tech et responsable
de la Cellule, est lauteur de lensemble des chapitres de ce manuel. Babacar Samb,
expert auprs du PIP, a collabor la rdaction du chapitre 2
PIP c/o COLEACP
130, rue du Trne B-1050 Bruxelles Belgique
Tl : +32 (0)2 508 10 90 Fax : +32 (0)2 514 06 32
E-mail : pip
@
coleacp.org
www.coleacp.org/pip
ANALYSE DES RISQUES
ET AUTOCONTROLE
EN PRODUCTION
Chapitre 1 : Principes de base de lanalyse des risques
1.1. Dangers et risques
1.2. Dfnitions, intrt et composantes de lanalyse des risques
1.3. Lvaluation des risques
1.4. La gestion des risques
1.5. La communication relative aux risques
1.6. La gestion de crise
Annexes
Chapitre 2 : Les mesures de matrise des risques en entreprise
2.1. Quelles mesures de matrise ?
2.2. Exigences et mesures de matrise en production primaire
2.3. Exigences relatives au transport
2.4. Post-rcolte : exigences relatives au Milieu
2.5. Post-rcolte : exigences relatives la Main doeuvre
2.6. Post-rcolte : exigences relatives au Matriel
2.7. Post-rcolte : exigences relatives la Matire
2.8. Post-rcolte : exigences relatives la Mthode
Annexe : nettoyage et dsinfection
Chapitre 3 : Le Systme dautocontrle et les Guides dautocontrle
3.1. Principes gnraux dun systme dautocontrle
3.2. Les Guides dautocontrle
3.3. La vrifcation dans le cadre du systme dautocontrle
Abrviations et acronymes les plus utiliss
Rfrences bibliographiques
Sites Web utiles
3
1.1. Dangers et risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2. Dfnitions, intrt et composantes de lanalyse des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3. Lvaluation des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4. La gestion des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5. La communication relative aux risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.6. La gestion de crise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Principes de base
de lanalyse des risques
Chapitre 1
6
1.1. Dangers et risques
1.1.1. La naissance dun risque
Produire, transformer, distribuer des produits alimentaires sont des activits risque .
Dans leur pratique quotidienne, les entreprises agroalimentaires, les entreprises de
distribution des denres alimentaires, les entreprises de restauration collective,doivent
intgrer le fait que leurs produits sont pour la plupart prissables et sensibles , et
quil ne sagit pas de biens de consommation comme les autres car nous les
ingrons !
Le systme de production de ces entreprises doit faire face un certain nombre de
menaces
1
qui engendrent pour elles et leurs clients une srie de risques (risques
de non-conformit des produits qui peuvent tre dtruits, risques dintoxication ou
dallergie du consommateur, risques de perte dimage, risques de perte de marchs, ).
Le schma ci-dessous montre que la gestion des risques passe par la diminution de la
zone de recouvrement entre la cible , le systme de production, et la menace (la
possibilit dune contamination par un danger biologique, physique ou chimique) :
La naissance dun risque
La gestion des risques reprsente un challenge en tout premier lieu pour les
entreprises, mais aussi pour les autorits qui doivent traiter les risques , et dfinir les
limites entre ce qui est un risque acceptable et ce qui ne lest pas !
1
On prfre parler de menace que de danger , car on peut transformer une menace en
opportunit (ex. : se diffrencier par son Systme de Mangement de la Qualit Sanitaire)
mais pas un danger !
Menaces
(dangers
biologiques,
physiques ou
chimiques)
Systme de
production
(entreprise)
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
Risques
7
Pour les entreprises
Pour rpondre aux exigences rglementaires et commerciales, les entreprises de
lagroalimentaire doivent identifier tous les aspects de leurs activits qui sont
dterminants pour la scurit et la salubrit de leurs produits
2
.
Il est donc essentiel pour un oprateur de matriser tous les dangers, tous les
stades du cycle de vie de ses produits (conception, production, stockage, transport,
distribution), afin de respecter les spcifications (rglementaires et commerciales) et
garantir la scurit des consommateurs.
Les oprateurs actifs dans la chane alimentaire doivent pouvoir :
1. Identifier tous les dangers (physiques, biologiques ou chimiques) susceptibles
a priori de contaminer leurs produits aux diffrentes phases de la production.
2. Estimer, pour chacun dentre eux, le niveau de risque (la probabilit
dapparition) en fonction des conditions de travail, des procdures et des
pratiques en vigueur.
Cest sur cette base que des mesures de matrise appropries, adaptes la nature et
au niveau de risque, seront adoptes par lentreprise. Elle devra veiller ce que ces
mesures soient mises en uvre, respectes et revues rgulirement
3
. Manager une
entreprise, cest matriser ses risques ! Cest quand une entreprise sait dployer une
politique de matrise des risques efficace, et pour des risques de toutes natures, quelle
russit durablement (METAYER, Y. & HIRSCH, L., 2007).
Pour les autorits
Cest l autorit quappartiendra de dfinir lacceptabilit du risque, ce qui
implique de caractriser les risques, puis de les hirarchiser, de les diffrencier en termes
de priorits. Cest donc galement sur base dune apprhension correcte des risques que
lautorit de tutelle prendra les mesures de gestion qui conviennent pour lensemble
des oprateurs actifs dans la chane alimentaire et ramener le risque un niveau plus
acceptable : tablissement de normes (limites acceptables), de rglementations
(obligations) et organisation des contrles (vrifications).
Gravit
Probabilit
2
Les deux composantes de lhygine des produits. Voir Chapitre 2, Manuel n 1 du PIP.
3
Voir Manuel n 1 du PIP.
Plus acceptable
Avec deux problmes :
1. Comment dfinir la gravit ?
2. Comment tablir la
probabilit ?
Niveau de
risque moins
acceptable
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
8
1.1.2. Les notions de danger et de risque
4
Le danger renvoie deux notions : dune part, il ne faut considrer que les dangers
dits pertinents , cest--dire ceux qui sont susceptibles dadvenir avec une certaine
probabilit dans un produit donn, cause de sa composition et/ou de ses modes de
production (processus et environnement) ; dautre part, il faut que ce danger engendre un
effet nfaste avr sur la sant du consommateur. La gravit des effets sur la sant est
affaire de spcialistes (ex. : toxicologues) qui produisent des avis sur la toxicit et fixent
des seuils admissibles de tolrance.
Quant au risque , en parler cest rpondre au moins aux questions suivantes :
De quel type de risque parle-t-on ? Dans quel domaine ?
Quels sont les risques connus ou mergents dans ce domaine ?
Comment faire pour valuer correctement le niveau de risque ?
Comment faire pour matriser les risques identifis et rester dans le cadre dun
fonctionnement normal ?
Comment sait-on qu'on est dans le domaine de lincident ( problme qui reste
grable au niveau de lentreprise) ? Que faire pour revenir au fonctionnement normal
du processus ?
Comment sait-on qu'on est entr dans le domaine de laccident (ou crise
alimentaire ) ? Comment faire pour grer cette situation et en sortir dans les
meilleures conditions?
Et quand, pour un danger suppos, il subsiste une incertitude scientifique sur les
effets nocifs pour la sant ? Le principe de prcaution sapplique !
Dans des cas particuliers o une valuation des informations disponibles rvle la
possibilit deffets nocifs sur la sant, mais o lincertitude demeure
5
, le Rglement
europen 178/2002
6
a prvu le recours au Principe de prcaution .
4
Voir Manuel n 1 du PIP.
5
Cest le cas par exemple quand on ne dispose pas de preuves scientifiquement tablies deffets
nfastes, de liens dmontrs entre un contaminant et les effets observs, comme cest souvent
le cas pour des substances chimiques (comme les perturbateurs endocriniens), qui agissent
des niveaux de concentration extrmement faibles, et que les causes possibles dun effet global
observ sur une population sont multifactorielles. Pour ce type de contaminant (rsidus de
certains pesticides, Bisphnol A,) il est obligatoire de travailler lchelle de populations
entires, ce qui rend les tudes beaucoup plus complexes.
6
Rglement (CE) 178/2002. Journal officiel des Communauts europennes, L31/1, 1.2.2002.
Il est important de distinguer les termes danger et risque :
Danger : un agent physique, biologique ou une substance qui a le potentiel de
causer un effet nfaste avr sur la sant.
Risque : la probabilit dun prjudice. Le degr de risque repose la fois sur la
probabilit et la gravit du rsultat (type de prjudice, nombre de personnes
touches, etc.). Le risque est li lexposition au danger, cest--dire la
consommation de la denre contamine (quantit et frquence de consommation).
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
9
Des mesures provisoires de gestion du risque, ncessaires pour assurer un niveau
lev de protection de la sant, peuvent tre adoptes dans lattente dautres
informations scientifiques en vue dune valuation plus complte du risque (ex. : pour les
plantes gntiquement modifies - PGM).
On peut dailleurs distinguer :
La prudence : elle vise les risques avrs, ceux dont l'existence est dmontre
et dont on peut estimer la frquence d'occurrence (la prvalence ).
La prvention : elle vise les risques avrs, mais sans qu'on puisse en estimer
la frquence d'occurrence (ex. : le risque nuclaire. L'incertitude ne porte pas sur
le risque, mais sur sa ralisation).
La prcaution : elle vise les risques probables, non encore confirms
scientifiquement, mais dont la possibilit peut tre identifie partir de
connaissances empiriques et scientifiques.
Les limites entre ces concepts, et surtout le classement de certains risques, font
lobjet de dbats anims entre spcialistes, citoyens et politiques ! Lapplication ou la
non-application du principe de prcaution sont au cur de ces dbats.
Pour viter tout dcision arbitraire en la matire, le recours au principe de prcaution ne
devrait tre justifi que lorsque trois conditions pralables sont remplies : des effets
potentiellement ngatifs ont t identifis, les donnes scientifiques disponibles ont fait
lobjet dun examen tendu, l'incertitude scientifique demeure malgr tout un niveau
significatif.
1.1.3. Analyse des dangers et analyse des risques
Une diffrence dans les objectifs poursuivis
Il y a souvent confusion entre les termes analyse des dangers (le plus souvent
ralise dans le cadre dune dmarche HACCP
7
) et analyse des risques car ils sont
frquemment impliqus dans les mmes discussions.
Cependant, bien que les deux approches aient des points communs, il demeure
important de bien faire la diffrence entre elles. Comme elles se sont dveloppes
partir dune origine diffrente, elles ont par consquent aussi des finalits
compltement diffrentes (AFSCA, 2005).
Le tableau prsent page suivante permet de comparer plus facilement les deux
approches.
Avec :
SMQS : systme de management de la qualit sanitaire
SAC : systme dautocontrle
CCP : point du processus critique pour la matrise des risques (HACCP)
PA : point dattention dans le processus pour la matrise des risques (HACCP)
7
Hazard Analysis Critical Control Points : analyse des dangers et points critiques pour leur
matrise. Voir Chapitre 5 du Manuel n 1 du PIP.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
10
Analyse des dangers Analyse des risques
Se pratique au niveau de lentreprise, et
est spcifique une entreprise
(un des maillons de la supply chain)
Se rapporte au processus de production
de lentreprise
Fait appel de lexpertise interne
(responsable qualit de lentreprise)
Finalits :
- Prvenir et matriser les dangers
- Mettre en place un SMQS
- Identifier les comptences internes
ncessaires
Activits importantes :
- Identifier et valuer les dangers
- Etablir les PA et CCP
- Etablir les mesures de matrise
- Vrifier le SMQS
- Former le personnel
Se pratique au niveau dun secteur ou
mme de lensemble de la chane
alimentaire, et concerne tous les
oprateurs (toute la supply chain)
Se rapporte la politique sanitaire dun
tat ou dun secteur, et aux modes de
gestion mis en place
Fait appel de lexpertise interne et
externe (scientifique et indpendante)
Finalits :
- Ajuster la politique sanitaire
- Communiquer vers les oprateurs
- Identifier les risques mergents
Activits importantes :
- Identifier et valuer les risques
- Etablir les normes et rglementations
- Valider les Guides dautocontrle
- Programmer les contrles
- Communiquer
On peut aussi schmatiser comme suit la diffrence de ces deux approches, ce qui
permet de visualiser la place du Systme dAutocontrle linterface des deux types
danalyses :
SAC : systme dautocontrle (voir Chapitre 3 du Manuel).
Politique de
scurit
alimentaire
(secteurs)
HACCP
&
SMQS
(entreprise)
SAC
Analyse des risques Analyse des dangers
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
11
Lanalyse des dangers
L'analyse des dangers, ou Hazard analysis , est un terme qui fait partie du systme
HACCP. Une analyse des dangers est effectue au niveau de l'entreprise, et de ce
fait elle est spcifique l'entreprise
8
.
Elle est lie aux processus mis en uvre dans cette entreprise
9
. Ces processus doivent
avoir t dcrits de faon dtaille.
Premier des 7 principes de base de lHACCP (Commission du Codex Alimentarius, 1999)
Inventorier tous les dangers potentiels associs chaque stade, diriger une analyse
des dangers, et envisager toutes les mesures en vue de contrler tous les dangers
identifis .
Selon le Codex, lanalyse des dangers doit se composer de deux parties :
1. Une identification des dangers : identification des agents biologiques,
chimiques et physiques qui :
- sont pertinents considrer, car ils peuvent tre prsents dans une denre
alimentaire spcifique ou dans un groupe de denres alimentaires ;
- selon la nature de leurs effets, peuvent gnrer de relles consquences
nfastes pour la sant du consommateur.
Il sagit dune dmarche purement qualitative qui est lie la veille scientifique
(Saegerman, C. & Berkvens, D., 2005)
10
.
2. Une valuation des dangers numrs qui comprendra les lments suivants :
- la probabilit d'apparition de ces dangers et de la svrit de leurs effets
nocifs sur la sant ;
- l'valuation qualitative et/ou quantitative de la prsence des dangers ;
8
Il est vrai quune analyse des dangers peut ventuellement aussi tre ralise au niveau
sectoriel - dans le cadre de llaboration dun Guide dAutocontrle par exemple -, mais elle doit
alors tre encore affine au niveau de lentreprise. Cest pour viter cette confusion quau
niveau sectoriel on parlera aussi dans le Guide danalyse des risques, mme si ltendue de
celle-ci est bien plus limite que lorsque lon travaille au niveau de lensemble de la chane
alimentaire.
9
Pour rappel : un processus est un ensemble d'activits qui sont, en gnral, transversales
lorganisation de lentreprise. Dans une entreprise, on distinguera plusieurs types de
processus :
- Processus de management : lis la planification stratgique, l'tablissement des
politiques, la fixation des objectifs, la mise en place de la communication, la mise
disposition des ressources ncessaires et aux revues de direction.
- Processus de management des ressources (ou processus support ) : mise disposition
des ressources ncessaires aux processus de production.
- Processus de production (ou processus oprationnels ) : les processus qui permettent
de fournir les rsultats attendus de lentreprise (= les produits).
- Processus de mesure (ou processus de pilotage) : inspections, audits et d'amliorations
ncessaires pour mesurer et recueillir les donnes utiles l'analyse des performances et
l'amlioration de l'efficacit et de l'efficience.
10
Notons aussi que lOIE (organisation mondiale de la sant animale) fait de lidentification des
dangers un pralable lanalyse des risques, en quoi elle diffre du Codex Alimentarius.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
12
- pour les micro-organismes, leur capacit de survie et/ou de multiplication, la
production ou la persistance dans les aliments de toxines ;
- la persistance dans les aliments d'agents chimiques ou physiques, malgr les
oprations effectues dans le processus ;
- les conditions menant aux lments susmentionns.
Pour chaque danger identifi, on dtermine ainsi quel point il est ncessaire (on
parlera de criticit ) de le matriser, de manire pouvoir garantir la scurit et la
salubrit de la denre alimentaire.
On doit ensuite dcider des mesures efficaces de gestion permettant de le prvenir ou de
l'liminer ou de le ramener un niveau acceptable. Lensemble de ces mesures sera
repris sous forme de modes opratoires (ou procdures) dans un plan de matrise
et de surveillance (voir Chapitre 2) ou dans un Guide dautocontrle (voir Chapitre 3).
1.1.4. Les domaines de fonctionnement et le management du risque
Grer une entreprise, cest la fois grer les risques et prvoir le pire ! On peut donc
schmatiser comme suit les diffrents domaines de fonctionnement afin de visualiser
plus facilement les limites du management des risques (et donc les limites du SMQS) :
On voit donc que les modes opratoires (ou procdures) couvrent non seulement le
domaine normal mais aussi le domaine incidentel . Ils doivent donc prvoir les
modalits respecter en cas de constatation dune dfaillance du SMQS. Quand une
limite critique - paramtre qui affecte la scurit sanitaire des produits - a t dpasse
(ex. : dpassement de LMR), une information des autorits est souhaitable : cest la
notification .
Gestion de crise
(Autorits)
Procdure de
gestion de crise
Plan de crise
Saisies/rappels
Notification aux
autorits
Management des risques
(Entreprises)
Modes opratoires du SMQS
Plan de matrise et Plan durgence
de surveillance (actions correctives)
(vrifications internes) Retraits
Traabilit Information
Domaine normal
de fonctionnement
Incident
Crise
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
13
On peut caractriser les diffrents domaines de fonctionnement comme suit :
Le domaine normal
Le processus de production est efficace sil satisfait aux exigences des clients
(externes ou internes) : on est dans le domaine normal . Mais le domaine normal de
fonctionnement nest facile caractriser que si les processus ont t correctement
dcrits et si les indicateurs de performance ont t clairement identifis.
La frquence de surveillance des indicateurs est essentielle : elle se fait au jour le jour,
par heure, par pause, par saison, par anne,
La prvention du risque consiste permettre au processus de production de rester
dans le domaine normal : toutes les observations, toutes les valeurs enregistres
sont conformes la consigne. Cest lobjectif poursuivi par la mise en place dun SMQS
(Systme de Management de la Qualit Sanitaire) et lautocontrle.
Le domaine incidentel
Le domaine incidentel est atteint lorsque le processus ne fonctionne plus de manire
totalement efficace :
un au moins des indicateurs du processus de production (processus clef) nest pas
conforme la consigne : un des risques identifis se manifeste de faon vidente, et
la limite de tolrance ventuelle est dpasse ;
un nombre significatif d'indicateurs de l'ensemble des processus (y compris les
processus supports) ne sont pas conformes, et cela risque davoir un impact sur les
produits la sortie du processus de production.
Dans le domaine incidentel, les informations / les indicateurs considrer sont plutt en
amont (de la mise en march des produits).
Une situation incidentelle n'implique pas forcment de graves consquences : on n'est
pas encore en crise. Mais une action correctrice est ncessaire, comme :
revoir le systme de management du processus (SMQS) ;
revoir le systme de traabilit ;
revoir les indicateurs et mieux estimer leurs qualits (pertinence, etc.) ;
redfinir les contrles, leur frquence, les mthodes dobservation, ... ;
rtudier les indicateurs et les objectifs ;
amliorer la formation du personnel.
Mais si les incidents se rptent, on peut tre conduit :
redfinir le ou les processus ;
changer de responsable du ou des processus, ou redfinir ses responsabilits ;
augmenter, temporairement ou pas, les contrles ;
rtudier les indicateurs et les objectifs (changer la nature des contrles) ;
etc.
A priori, toutes ces actions ou ractions seront conduites et mises en uvre avec les
moyens et les ressources courantes de l'entreprise. Il n'y a pas lieu, ce stade, de
rechercher de nouvelles mthodes ou de faire appel des appuis externes inhabituels.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
14
Le domaine accidentel
On entre dans le domaine de la crise quand le fonctionnement du ou des processus
n'est plus du tout celui qui tait dsir, ou courant (cest laccident). La crise peut affecter
une partie du processus, ou une partie de l'entreprise, mais elle appelle une action
immdiate de la part du management.
Au contraire du domaine incidentel, il est peu probable que des informations amont
permettront de dfinir l'tat de crise. Ce seront plutt des signaux en aval tels que
(METAYER, Y. & HIRSCH, L., 2007) :
la fermeture de certains marchs, pertes financires ;
des pertes importantes de clients, afflux de rclamations ;
une campagne de presse contre lentreprise, contre les produits, contre lorigine ;
etc.
La rsolution de la crise va ncessiter la collaboration entre lentreprise et les
autorits, et, le plus souvent, lappel des ressources externes spcialises qui
interviendront galement au niveau des entreprises si ncessaire (rorganisation en
profondeur de lentreprise et de son SMQS).
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
15
1.2. Dfinitions, intrt et composantes
de lanalyse des risques
1.2.1. Origine du concept danalyse des risques
A l'origine, l'analyse des risques tait conue comme un outil devant aider prendre les
dcisions adquates concernant le risque de certains dangers carcinognes. En 1983,
le National Research Council (NRC) a publi le document Risk Assessment in the
Federal Government: Managing the Process
11
, qui a constitu la base de la notion
gnrale d'valuation des risques et a pos une base claire pour l'valuation des risques
chimiques et la gestion des risques.
Les dfinitions reprises dans ce document taient suffisamment larges pour tre
appliques de faon gnrale, et aussi suffisamment concrtes pour viter la confusion
en cours de communication. Depuis un certain nombre d'annes, cette systmatique de
l'analyse des risques est galement applique d'autres dangers et situations, parmi
lesquels les dangers microbiologiques, physiques et chimiques qui sont importants dans
l'industrie alimentaire.
Malgr le fait que l'on travaille selon la mme systmatique de base, il y a des diffrences
perceptibles dans l'approche et la terminologie entre l'analyse ces types de risques. Au
sein du Codex Alimentarius, des directives spcifiques ont t ds lors rdiges pour
l'valuation et la gestion des risques biologiques (AFSCA, 2005).
Lorsqu'on effectue une analyse des risques , on utilise des informations et des
techniques venant de disciplines trs diverses, parmi lesquelles la microbiologie, la
chimie, la toxicologie, la mdecine, l'pidmiologie, les statistiques, le management, la
sociologie,
1.2.2. Intrt du recours lanalyse des risques
L'objectif final d'une analyse des risques est de pouvoir prendre une dcision
stratgique, fonde sur base dun rsultat qualitatif ou quantitatif.
Sur base du rsultat dune valuation des risques (quantitative et qualitative), une
autorit de tutelle peut prendre des mesures de gestion des risques, avec une
communication pour les groupes/personnes concern(e)s (les donnes danalyse
quantitative des risques pouvant tre comprises dans cette communication).
Il en va ainsi dans le cadre des changes commerciaux entre les Etats. Laccord de
Marrakech de lOrganisation mondiale du Commerce (OMC) davril 1994
12
relatif
11
NRC, Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process, National Academy
Press, Washington D.C., 1983.
12
OMC, 1994. Accord sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires. Parlement
europen et Conseil, 2002. Journal officiel des Communauts europennes, L31, 1.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
16
lapplication de mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) prvoit que les Etats
ont le droit de dfinir le niveau de protection des consommateurs quils jugent appropri
et de restreindre, si ncessaire, le commerce international dans le but de protger la
vie des personnes, des animaux et des vgtaux.
Ces mesures SPS ne peuvent toutefois pas comporter de restrictions infondes,
arbitraires ou dguises entravant le commerce. Lexistence dun risque doit tre
justifie scientifiquement
13
, sauf dans le cas de mesures durgence ou dans le cadre
du principe de prcaution.
Deux options peuvent tre utilises cette fin :
1. Se baser sur des normes, des recommandations (ex. : celles du Codex
Alimentarius) ou des directives internationales (harmonisation des exigences)
14
.
2. A dfaut, utiliser une valuation scientifique des risques
15
, o le rapport
cot/bnfice des diffrentes options et mthodes de matrise est pris en
considration dans la conclusion de lanalyse.
Lvaluation des risques ne doit pas se limiter lapplication aveugle de normes.
Le dveloppement dune expertise approfondie dvaluation collective des risques
au sein de chaque tat est indispensable la bonne excution dune valuation des
risques. Le dploiement de cette expertise ne doit pas non plus se limiter aux seuls
agents des services publics, les oprateurs privs tant - rappelons-le ! - les premiers
responsables dans la chane alimentaire.
Lanalyse des risques est la base des politiques sanitaires gres dans le cadre des
Systmes SPS (ou systmes de gestion de la scurit sanitaire et phytosanitaire des
denres), car il existe diffrentes manires de garantir un mme niveau de
protection (principe dquivalence), et les mesures prises doivent tre annonces le plus
rapidement possible (principe de transparence) (SAEGERMAN, C. & BERKVENS, D.,
2005).
13
Cest--dire, non seulement de faon transparente et indpendante de toute pression, mais
aussi en utilisant une mthodologie scientifiquement reconnue.
14
LAccord SPS reconnat plus prcisment le caractre international des normes tablies
respectivement par lOrganisation mondiale de la sant animale (OIE), la Commission du
Codex Alimentarius (CCA) pour la scurit des denres alimentaires, et la Convention
internationale pour la Protection des Vgtaux (CIPV) pour les mesures relatives la sant des
vgtaux. Ces organisations, conjointement avec lAutorit europenne de scurit des
aliments (EFSA), dictent galement des directives en rapport avec les mthodes et les
procdures pour lexcution dune valuation des risques.
15
LAccord SPS dfinit une valuation scientifique des risques comme : (i) lvaluation de la
probabilit de lentre, de ltablissement ou de la dissmination dun parasite ou dune maladie
sur le territoire dun Etat membre, en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui
pourraient tre appliques, et des consquences biologiques et conomiques qui pourraient en
rsulter, ou (ii) lvaluation des effets ngatifs que pourrait avoir sur la sant des personnes et
des animaux la prsence dadditifs, de contaminants, de toxines ou dorganismes pathognes
dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
17
1.2.3. Les composantes danalyse des risques
Selon le Codex Alimentarius, une analyse des risques se compose de trois parties
relies entre elles par un lien logique :
1. Evaluation des risques (risk assessment).
2. Gestion des risques (risk management).
3. Communication sur les risques (risk communication).
La structure de la systmatique d'analyse des risques peut tre illustre de diffrentes
faons. La figure ci-aprs est la plus utilise :
Chacune des trois composantes sera dtaille plus loin.
La premire composante est l valuation des risques : elle correspond un
processus fond scientifiquement, qui doit avoir lieu indpendamment de la gestion des
risques et que nous prsenterons plus en dtails ci-aprs. L'valuation des risques est
encore elle-mme scinde en 4 lments :
1. l'identification des dangers (hazard identification) ;
2. la caractrisation des dangers (hazard characterisation)
16
;
3. l'estimation de l'exposition (exposure assessment) ;
4. la caractrisation des risques (risk characterisation).
Sur base des rsultats de cette valuation, sont tablies les mesures de gestion des
risques. Cette seconde composante correspond donc aux dcisions politiques prises
notamment par les autorits pour maintenir les risques des niveaux acceptables.
16
Ou encore dose-response assessment .
Evaluation
des risques
Communication
sur les risques
Gestion
des risques
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
18
Enfin, la troisime composante est fondamentale : la communication sur les risques
permet toutes les parties prenantes dtre informes sur la nature, lorigine et la criticit
des risques dune part. Elle permet ainsi aux autorits de construire un programme de
surveillance et de planifier les contrles dans la chane alimentaire. Dautre part, elle
permet aussi dinformer les oprateurs sur les mesures de matrise qui se sont avres
rellement efficaces. Elle comprend la veille sur les risques mergents ou r-mergents.
Cest pourquoi, pour mieux souligner limportance de la communication dans le
processus danalyse des risques, certains auteurs proposent un autre schma :
Evaluation et gestion des risques baignent dans la communication.
Evaluation
des risques
Gestion
des risques
Communication sur les risques
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
19
1.3. Lvaluation des risques
Lvaluation des risques est un processus structur, indpendant, objectif et transparent
dorganisation et danalyse des donnes disponibles. Ce processus comporte les
4 tapes suivantes : (i) lidentification du danger ; (ii) la caractrisation du danger ; (iii)
lvaluation de lexposition et (iv) la caractrisation du risque. On peut le reprsenter
comme suit :
Identification du danger
Caractrisation du danger
Evaluation de lexposition
Caractrisation du risque
Analyse de
lincertitude et de la
variabilit
Evaluation des
options de matrise
Conclusion
Evaluation
quantitative
Approche
probabiliste
Approche
dterministe
Evaluation
semi-
quantitative
Evaluation
qualitative
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
20
On remarque que, pour tre complte, lanalyse ne doit pas
sarrter un chiffre caractrisant le risque : prenant en
considration la qualit des donnes, il est galement
important de relativiser le rsultat obtenu en tudiant
lincertitude et la variabilit qui y sont lies (ex. : recours des
extrapolations, travail par analogie, utilisation de scnarios
plus ou moins ralistes, entre de donnes qui sont des
moyennes,).
Dautre part, lanalyse se basant gnralement sur des
scnarios , que lon peut faire varier, il est utile de
produire des commentaires sur lvolution possible du
rsultat si on intgre dans ce ou ces scnario(s) les diverses
mesures de matrises possibles.
Il apparat clairement que la qualit des conclusions qui peuvent tre tires dune
valuation des risques dpend largement de la quantit, de la qualit des donnes
disponibles et de la pertinence des donnes pour raliser cette analyse.
La dmarche dvaluation des risques constitue un travail important de collecte, de
rassemblement et danalyse critique des donnes. Elle ncessite aussi le dveloppement
de modles qui peuvent tre plus ou moins complexes (ex. : approches dterministes
ou probabilistes ; elles seront expliques plus loin).
Passons en revue chacune des tapes ! Deux exemples seront dvelopps en annexe.
Etape n 1 : Lidentification des dangers
Lobjectif de cette tape est de dcrire les dangers (micro)biologiques, chimiques ou
physiques
17
qui sont lorigine dun risque pour la sant du consommateur dans le
domaine de la scurit alimentaire (au sens large, y compris les maladies ou les
infections des animaux, ou celles qui affectent la sant des plantes
18
).
Pour identifier les dangers, il faut se poser un certain nombre de questions et chercher
les rponses dans la littrature scientifique, les rapports dtude, les rapports danalyse,
les bases de donnes, les avis publis par les agences alimentaires du monde entier,
etc.
17
La nature et lorigine de ces diffrents dangers sont exposes dans le Manuel 1 (Chapitre 2) du
PIP. Il sagit ici de les dcrire le plus compltement possible en consultant le maximum de
sources scientifiques fiables.
18
Dans ce dernier cas, il sagit des maladies et ravageurs qui sont nuisibles aux plantes cultives
et susceptibles dtre transports vers des zones jusque-l exemptes de leur prsence : ce sont
plus gnralement les organismes dits de quarantaine (repris dans les annexes de la
Directive 2000/29/CE).
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
21
Ainsi, en ce qui concerne les dangers (micro)biologiques, plusieurs questions seront
systmatiquement poses :
- Le danger est-il connu (taxonomie, facteurs de virulence, pidmiologie,
pathologie, cologie, interaction avec lhte, ) ?
- Quelle en est la source et quelles sont les voies de transmission ?
- De quoi est constitue la symptomatologie ?
- Quelle est la gravit de la maladie ?
- Combien de cas ou de foyers ont t rapports ?
- Quelles denres alimentaires sont concernes ?
- Quels facteurs influencent la croissance et la survie du microorganisme ?
- Des informations concrtes sur le danger sont-elles disponibles dans des
banques de donnes ?
Lidentification des dangers chimiques consiste dcrire les effets nocifs de la
substance ainsi que le profil (groupe dge, sexe,) et ltendue de la population qui
court un risque. Etant donn que les donnes pidmiologiques chez lhomme sont
souvent disponibles en quantit insuffisante, lvaluation du risque sappuie frquemment
sur des tudes toxicologiques exprimentales menes sur des animaux de laboratoire
ainsi que sur des tudes in vitro. Pour lidentification des dangers chimiques, plusieurs
questions seront systmatiquement poses :
- Le danger est-il connu ?
- Quels sont les composs chimiques nocifs ?
- Quelle en est la source et quelles sont les voies de transmission ?
- De quoi est constitu le syndrome ?
- Quelle est la gravit de la maladie ?
- Combien de cas ont t rapports ?
- Quelles denres alimentaires sont concernes ?
- Le danger peut-il donner lieu une intoxication ?
- Le danger induit-il des ractions dhypersensibilit (allergnes) ?
-
O trouver les informations sur les dangers ?
Les principales sources scientifiques consulter sont les suivantes :
Les sites des grandes organisations internationales
OMS : www.who.int
FAO : www.fao.org
OIE : www.oie.int
Les bases de donnes spcialises
PubMed : www.ncbc.nlm.nih.gov
Toxnet : toxnet.nlm.nih.gov
IPCS : www.who.int/pcs
IARC : www.iarc.fr
ChemIDplus : chem.sis.nlm.nih.gov/chemid
Sciencedirect : www.sciencedirect.com
Google scholar : scholar.google.com
VDIC : www.vesalius.be
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
22
Les sites des agences alimentaires europennes
EFSA : www.efsa.eu.int (agence europenne)
AFSCA : www.afsca.fgov.be (agence belge)
ANSES : www.afssa.fr (agence franaise)
VWA : www2.vwa.nl (agence nerlandaise)
FSA : www.foodstandards.gov.uk (agence anglaise)
Etape n 2 : La caractrisation des dangers
La caractrisation des dangers est lvaluation qualitative (dcrire les symptmes, les
effets) et/ou quantitative (dcrire la gravit du danger en fonction de la dose) de la
nature des effets nfastes sur la sant associs aux agents biologiques, chimiques et
physiques qui peuvent tre prsents dans les denres alimentaires :
- pour les agents biologiques et physiques, on procdera une dtermination de la
dose-rponse si on peut se procurer des donnes.
- pour les agents chimiques, il y a lieu de procder une dtermination de la courbe
dose-rponse (si les donnes sont disponibles).
Pour les dangers (micro)biologiques, on tient compte du fait que leur concentration et
leurs proprits (degr de virulence, caractre infectieux, production de toxines, )
peuvent varier en fonction de la matrice et/ou de linteraction avec lhte. Les micro-
organismes peuvent provoquer des infections aigus ou chroniques ou subsister sous
forme latente et donner lieu une excrtion et une contamination continues ou
rcidivantes de lenvironnement.
En ce qui concerne lhte, on tient compte des populations sensibles (en fonction de
lge, du statut de vaccination, de la grossesse, de ltat nutritionnel,). Si possible, on
utilise une courbe nombre-rponse , o sont indiques diffrentes valeurs limites,
comme la concentration toxique, le nombre de germes pour linfection ou celui qui
engendre la maladie.
Concernant de la caractrisation des dangers (micro)biologiques, les questions suivantes
peuvent tre poses :
- Quelle dose induit linfection, la maladie, lhospitalisation ou la mort ?
- Quelle est la gravit de la maladie ?
- Quelles informations de relation dose / rponse sont disponibles concernant les
cas survenus, les tudes avec des volontaires, les modles animaux ?
- Cela concerne-t-il agent infectieux ou une bactrie produisant des toxines ?
Pour les dangers chimiques, la caractrisation des dangers consiste dcrire la
relation dose-rponse pour les effets les plus sensibles et nocifs sur la sant. Dans
ce cadre, on value si le mcanisme daction de la substance chimique, observ la
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
23
plupart du temps dans des tudes exprimentales avec des doses leves, est
galement pertinent pour lexposition de lhomme des concentrations plus basses.
Au cas o leffet toxique se manifeste partir dune valeur limite (valeur toxicologique
de rfrence), la caractrisation des dangers pour les contaminants tiendra alors compte
de niveaux dingestion, comme :
un niveau sr dingestion (Acceptable Daily Intake - ADI
19
). La valeur de lADI pour
un danger chimique est obtenue par calcul sur base dun essai toxicologique sur
animal. On part de la dose pour laquelle aucun effet nocif nest observ (NOAEL)
chez les animaux de laboratoire et on applique ensuite un facteur de scurit de cent
(un premier facteur de scurit de dix tient compte des ventuelles diffrences de
sensibilit aux effets toxiques entre lhomme et lanimal de laboratoire, et un
deuxime facteur de scurit de dix tient compte de la variabilit de sensibilit aux
effets toxiques entre individus ou sous-groupes de la population)
20
.
un niveau acceptable dingestion ( Tolerable Daily Intake - TDI). La TDI est une
valeur analogue lADI, mais elle est utilise pour les contaminants chimiques qui ne
sont pas ajouts volontairement dans la chane alimentaire (mtaux lourds, PCB,
dioxines, HAP,). Les valeurs toxicologiques de rfrence pour les substances
cancrignes gnotoxiques peuvent varier selon que leur calcul est bas sur une
combinaison dtudes pidmiologiques ou sur des expriences animales. Divers
modles mathmatiques sont utiliss lors de lextrapolation de lanimal lhomme.
On trouvera donc aussi encore dautres valeurs de rfrence telles que la PTMI
(Provisional Tolerable Monthly Intake) ou la PTWI (Provisional Tolerable Weekly
Intake).
Etape n 3 : Lvaluation de lexposition
Lestimation de lexposition consistera combiner des informations sur la prvalence et
la concentration du danger dans la denre avec celles relatives la consommation.
On traduira ainsi la probabilit que le consommateur soit expos des quantits ou des
concentrations variables dun agent biologique, chimique ou physique via lalimentation
et, le cas chant, par dautres voies dexposition.
19
En franais : la Dose Journalire Acceptable ou DJA (en mg/kg de poids corporel/jour). On
considre comme sr le niveau correspondant la DJA (ou ADI). Par consquent, plus on
scarte de la DJA (comme les LMR par exemple fixes bien en dessous des valeurs de la
DJA), plus grande est la scurit pour le consommateur. Dans le cas des rsidus de produits
phytosanitaires, la valeur de rfrence considrer peut cependant tre lARfD (Acute
Reference Dose ou dose de rfrence aige) et non la DJA (voir Manuel n 1 du PIP et
annexes de ce chapitre).
20
Voir Manuel 4 du PIP.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
24
Pour raliser cette valuation, on doit donc disposer de donnes :
1. Sur la contamination de la denre :
Il faut connatre par exemple la quantit moyenne de pathognes alimentaires, ou la
concentration probable en contaminants, auxquelles le consommateur peut tre
expos au moment de la consommation. Il faut donc disposer dinformations sur la
prvalence de lagent pathogne, sur la concentration en nombre de pathognes dans
une prparation alimentaire, sur la quantit dun additif consomm quotidiennement
par un consommateur reprsentatif, sur les concentrations habituellement retrouves
en rsidus (sinon, travailler avec les limites acceptables fixes telles que les LMR).
2. Sur la consommation de la denre :
Pour le calcul, on aura besoin de donnes relatives aux habitudes alimentaires
(enqutes de consommation). Lestimation se base soit sur la moyenne (en g/jour)
de la consommation/jour de la population dans son ensemble, soit, pour tenir compte
des gros consommateurs , sur les percentiles (P
97,5
, P
90
) des consommations/jour.
Il faut aussi prendre en considration, quand cest possible et quand cest justifi,
certaines catgories spcifiques de la population (ex. : les adultes et les enfants, pour
lesquels le niveau de risque peut tre diffrent en raison de leurs diffrences de
consommation et de poids corporel)
21
.
Les donnes relatives aux consommations doivent tenir compte des influences socio-
conomiques et culturelles (ex. : les vgtariens) ou de facteurs lis aux saisons, aux
diffrences dge, au comportement du consommateur (ex. : groupes ethniques,
interdits religieux), etc.
Lestimation de lexposition sera effectue successivement : de manire qualitative,
semi-quantitative ou quantitative :
Il est conseill en effet de raliser dabord une estimation qualitative de
lexposition avant de passer une approche quantitative. Lvaluation
qualitative de lexposition sappuie essentiellement sur lopinion dexperts et se
compose de la collecte, de lassemblage et de la prsentation de connaissances
et de certitudes pour tayer un jugement sur le risque. Une chelle descriptive
peut tre utilise pour exprimer une gradation du risque (absent, ngligeable,
faible, moyen, lev).
Ensuite, une valuation semi-quantitative de lexposition sera ralise en se
basant sur les rsultats de lvaluation qualitative et un traitement numrique
partiel des donnes sur base dune analyse de scnario sera effectu.
Finalement, une valuation quantitative de lexposition sera ralise si
suffisamment dinformations sont disponibles. Suivant lincertitude prsente sur
les donnes, il est possible de raliser une valuation de lexposition par une
approche dterministe . Par exemple : on multiplie la concentration
moyenne (en germes, en rsidus) dans la denre par la consommation au P
97.5
(
savoir que 97,5 % des personnes consomment au moins cette quantit de
denre/jour), et on obtient un rsultat chiffr.
21
En particulier, les groupes risque (appels les YOPIs : young, old, pregnant and
immunosuppressed).
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
25
Dans une approche probabiliste , on utilise des distributions de donnes
de concentration et de consommation, pour obtenir comme rsultat des
distributions de probabilits. Il est gnralement fait usage de programmes
informatiques pour le traitement de ces donnes (ex. : software comme @Risk
qui permettent les simulations de type Monte Carlo
22
).
On peut distinguer le cas des dangers biologiques et celui des dangers chimiques :
a) Pour les dangers (micro)biologiques
Dans le cas de dangers microbiologiques, lestimation de lexposition est base sur la
contamination de laliment par le pathogne (ou par les toxines de celui-ci) et sur les
donnes de consommation. Lors de lestimation quantitative de lexposition un danger
biologique, on peut suivre une approche dterministe ou probabiliste.
On doit prendre en considration la frquence de contamination de laliment par lagent
biologique et lvolution de sa concentration en fonction du temps. Ces paramtres sont
entre autres influencs par les proprits du pathogne, la microflore prsente, la
concentration initiale de contamination de la denre alimentaire, les conditions traitement
pendant le processus de production, les facteurs de procd, le conditionnement, les
conditions de distribution, de stockage, de prparation et de conservation de laliment
(voir Manuel n 1 du PIP).
Le degr de contamination microbienne dune denre alimentaire peut fortement varier
en fonction des conditions du milieu (de lenvironnement)
23
. Do limportance
de suivre une approche modulaire structure lors de lestimation de lexposition,
lors de laquelle le risque du danger est valu ou calcul pour les diffrentes tapes
intermdiaires de la filire, depuis la production primaire (au champ) jusqu la
consommation, en passant par le processus de conditionnement et la distribution.
Le degr dexposition du consommateur dpend de diffrents facteurs comme : le degr
de contamination initial du produit non transform, les caractristiques de la denre et
les conditions de transformation, la multiplication ou la disparition du germe, les
conditions de conservation et de prparation avant consommation. Dans certaines
circonstances, il faut galement prendre en considration la possibilit dune
contamination croise.
Exemple dapproche modulaire sur une filire alimentaire :
Evolution de la population microbienne chaque tape ?
22
Cette technique fait appel un chantillonnage alatoire de chaque distribution de probabilit
dans un modle pour produire un grand nombre de scnarios ou ditrations. Le prlvement
de lchantillon est effectu en tenant compte de la forme de la distribution.
23
Se rfrer la mthode dite des 5 M (voir Manuel n 1 du PIP).
Parcelle Transport Conditionnement Distribution Consommation
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
26
On peut se baser sur des modles microbiologiques prdictifs afin de prvoir lvolution
(croissance, inactivation, survie) des pathognes au cours des tapes successives du
processus de production, puis lors de la distribution et enfin de la conservation des
denres alimentaires avant consommation. Les donnes ncessaires concernent alors
les conditions de conservation (temprature, dure) et le mode de prparation de la
denre (ex. : crue ou cuite).
b) Pour les dangers chimiques
Pour lestimation de lexposition aux dangers chimiques, on value lingestion totale du
danger chimique via lalimentation. Pour certaines substances chimiques, une seule
denre alimentaire doit tre prise en compte ; pour dautres, diffrentes denres
alimentaires devront tre considres. Il arrive que lingestion de la substance chimique
via lalimentation reprsente seulement une partie de lingestion totale.
Lors du calcul de lestimation de lexposition, on peut suivre une approche dterministe
(estimation ponctuelle) ou probabiliste (en prenant en compte la distribution).
Etape n 4 : Caractrisation des risques
La caractrisation du risque est une estimation base sur lintgration de toutes les
donnes obtenues lors des tapes prcdentes. Elle a pour objectif de dterminer la
probabilit de survenue dun danger, ainsi que lampleur des consquences
indsirables qui y sont lies. La caractrisation du risque traduit de manire qualitative
et/ou quantitative la probabilit et la gravit des effets nocifs sur la sant qui peuvent se
produire dans une population dtermine : danger x survenue x consquences.
La caractrisation du risque peut tre exprime qualitativement (risque lev, moyen
ou faible) ou quantitativement (ex. : en % de lARfD ou de la DJA pour un groupe de
consommateurs).
La caractrisation du risque doit tenir compte explicitement de la variabilit, des
incertitudes (donnes incompltes, connaissance partielle), ainsi que des suppositions
faites, avec pour but de donner une ide de la fiabilit de lestimation du risque.
La mthode utilise pour caractriser le risque dpend en effet des informations
disponibles (ou de labsence de celles-ci) concernant la probabilit de survenue et les
consquences du danger en question. Il existe diffrentes manires dexprimer le niveau
de connaissance (ou linverse dincertitude), mais cest en tout cas la responsabilit
de(s) lvaluateur(s) de risque de veiller ce que lincertitude existante soit
communique de manire correcte aux gestionnaires de risques. Ils doivent en effet
savoir quelle est la fiabilit de lvaluation des risques pour prendre leurs dcisions.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
27
Lvaluation sera complte par la dfinition des options possibles de matrise du risque :
liste des mthodes disponibles, des moyens permettant a priori de contrler le risque. En
changeant les paramtres dun modle dvaluation des risques, les experts pourront
aussi slectionner et proposer aux gestionnaires les options les plus efficaces.
Quelques rgles ne pas oublier
en rapport avec lvaluation des risques
La formulation du problme est un lment clef de la russite !
Une bonne valuation du risque part dune bonne question. Une formulation
correcte du problme rsoudre et des objectifs de lvaluation des risques
mettre en uvre est essentielle (termes de rfrence, questions poses).
Lvaluateur du risque doit examiner si la question est suffisamment claire et
pertinente. Cela ncessite une communication entre les gestionnaires et les
valuateurs afin que le rsultat final soit utile pour la prise de dcisions visant
assurer la scurit de la chane alimentaire et de la sant des consommateurs.
Lvaluation des risques ncessite une approche multidisciplinaire !
Une valuation objective, transparente et sans parti pris.
Pour mener bien une valuation des risques, des experts regroupant plusieurs
disciplines doivent interagir selon le risque valuer (ex. : hygine, chimie,
physique, biologie, agronomie, pidmiologie, mthodologie dvaluation des
risques, mdecine, virologie, bactriologie, parasitologie, microbiologie,
technologie des denres alimentaires, sociologie,).
Ces expertises ne sont pas simplement additionnes les unes aux autres mais un
synergisme doit tre recherch.
Une bonne valuation du risque est base sur une approche scientifique
objective et neutre. Les jugements de valeur relatifs des aspects conomiques,
politiques, lgaux ou environnementaux du risque ne doivent pas influencer le
rsultat de lvaluation. Les experts doivent agir avec transparence et en toute
indpendance. Ils ne reprsentent en aucun cas leur institution dorigine. Il sagit
dune expertise scientifique collective qui doit tre structure et qui rend plus
pertinents les rsultats obtenus.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
28
Des connaissances scientifiques et des hypothses logiques, les meilleures
donnes disponibles et la mesure objective de lincertitude !
Une bonne valuation du risque est base sur des connaissances scientifiques et
des hypothses formules clairement, qui sont importantes pour pallier les
connaissances ou les donnes manquantes. Une bonne valuation du risque doit
dcrire clairement les hypothses, les modles utiliss et les calculs, de sorte
que les managers du risque et les parties concernes puissent bien comprendre
lvaluation du risque malgr sa complexit.
Une bonne valuation du risque utilise des donnes quantitatives, qualitatives
ou semi-quantitatives prcises et fiables. On utilise, quant cest possible, des
modles informatiques valids. On fait rfrence la source des donnes et des
informations bibliographiques.
Une bonne valuation du risque dcrit de manire explicite ltendue, limportance,
la nature et la source de lincertitude. On essaie autant que possible de rduire
lincertitude avec les techniques les plus adaptes (opinion dexperts, examen de
base, techniques qualitatives et quantitatives comme lanalyse de la sensibilit, les
techniques probabilistes et lanalyse de Monte Carlo. Si ncessaire, la variabilit
est dcrite sparment et de manire explicite.
Evaluation du risque versus principe de prcaution en fonction de
lincertitude !
La limite entre une valuation correcte des risques et la prsence dune incertitude
trop grande nest pas toujours claire et dpend du danger considr. Un risque
nest dfini que lorsque certaines connaissances minimales donnes sur la
probabilit de survenue ainsi que sur les consquences sont disponibles. Lorsque
ces connaissances minimales ne sont pas disponibles, il faut en informer
clairement le(s) gestionnaire(s) de risques pour lui (leur) permettre dappliquer
le principe de prcaution. Bien entendu, on prendra soin de ne passer
lapplication du principe de prcaution uniquement aprs que toutes les autres
possibilits aient t puises.
Une remise en question permanente !
Lvaluation des risques est un processus continu et le risque estim doit tre
rvalu rgulirement. Une valuation du risque sert de base une dcision du
management un moment donn. Cependant, lorsque des informations
supplmentaires susceptibles de rduire lincertitude se prsentent, il est indiqu
de reconduire lvaluation du risque.
Aprs que des options de gestion ont t slectionnes et mises en uvre par les
gestionnaires de risques, il faut vrifier que le risque estim soit bien revenu au
niveau de risque jug acceptable. Lorsque des normes internationales sont
modifies, lorsque le risque jug acceptable a volu, lorsque des incertitudes
ont t combles par de nouvelles connaissances scientifiques, lorsque des
modifications extrieures sont apparues (changement de processus de
production, un changement climatique) ou lorsque de nouvelles donnes sont
disponibles, il faut galement estimer limpact de ces modifications sur lvaluation
des risques qui a t ralise.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
29
1.4. La gestion des risques
1.4.1. Dfinir la criticit dun risque
Le gestionnaire de risque tant amen faire des choix , il est ncessaire de dfinir
les risques qui sont prioritaires. On dfinira la criticit du risque (Cr) comme tant le
produit de la probabilit (Pa) par la gravit des effets (Ge) du risque envisag :
Cr = Pa x Ge
On peut reprsenter visuellement cette criticit du risque dans un diagramme (de Farmer)
en utilisant un systme de cotation de 1 4 pour la probabilit et de 1 4 pour la
gravit des effets observables :
Gravit des
effets
Types deffet
sur la sant
Importante 4 8 12 16
Dommages
irrversibles
(mortel)
Modre 3 6 9 12
Effet plus ou
moins grave
mais rversible
Faible 2 4 6 8
Effets limits
(de courte dure)
Minime 1 2 3 4
Aucun effet
connu
Probabilit
Minime Faible Modre Importante
T
h
o
r
i
q
u
e
&
p
e
u
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
b
l
e
S
e
s
t
d
p
r
o
d
u
i
t
p
a
r
l
e
p
a
s
s
-
c
e
r
i
s
q
u
e
p
e
u
t
s
e
r
e
p
r
s
e
n
t
e
r
L
e
r
i
s
q
u
e
s
e
p
r
o
d
u
i
t
r
g
u
l
i
r
e
m
e
n
t
L
e
r
i
s
q
u
e
s
e
p
r
o
d
u
i
t
r
g
u
l
i
r
e
m
e
n
t
s
y
s
t
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
30
Cette faon permet facilement au gestionnaire de risque de situer chaque risque en
termes de priorit :
Carrs rouges : actions prioritaires et immdiates ncessaires. Les risques
potentiels identifis doivent tre limins, prvenus ou rduits jusqu un niveau
acceptable (ex. : changement de pratiques, retrait de certains produits, abandon
de certaines oprations,).
Carrs jaunes : actions souhaitables pour limiter lvolution, surveillance accrue.
Carrs verts : pas daction ncessaire mais lapplication des bonnes pratiques.
Cependant, quand il sagit de dfinir le risque au niveau dune entreprise, ou dun
secteur de production, la formule utiliser doit forcment tre plus complexe :
Cr = f (Pa, Ge, Pnd, Pnc, Pnce)
avec :
Pa : probabilit d'apparition du risque
Ge : valuation de la gravit de l'effet
Pnd : probabilit de non-dtection du risque
Pnc : probabilit de non-correction
Pnce: probabilit de non-compensation de leffet produit
1.4.2. Rle du dirigeant dentreprise, gestionnaire de risque
La gestion du risque (sa matrise) passe par la dfinition des objectifs stratgiques
de l'entreprise, ce qui est le rle du dirigeant de lentreprise. C'est en fonction de ces
objectifs - et donc plus globalement de sa stratgie - que la dcision d'accepter ou de
matriser un risque est pertinente ou ne lest pas :
Identification
dun risque
Evaluation
de la criticit
Acceptable ?
Gestion du risque
rsiduel
Evaluation de
lefficacit de
laction
Engagement
dune action de
matrise du risque
Objectifs stratgiques
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
31
Une politique de management des risques dfinit, avant tout, les niveaux de risques
(criticit) jugs acceptables. Dans ses objectifs stratgiques, lentreprise intgre aussi les
exigences des parties prenantes et en tout premier lieu celles de ses clients.
Le but de la direction de lentreprise sera daboutir un plan de matrise et de
surveillance des risques (PMSR) qui sera mis en uvre et qui fera lobjet de
contrles adquats. Les chapitres 2 et 3 en prsenteront les principes.
L'laboration du plan de matrise et de surveillance des risques se ralise aussi bien au
niveau dune entreprise que dun secteur tout entier. Il doit rpondre certaines
rgles de base :
Il se fera sur le mode participatif : c'est une condition essentielle sa qualit, et
en particulier en ce qui concerne la pertinence de lidentification et de la
caractrisation des risques.
L'laboration des actions de matrise se fera galement sur le mode
participatif, afin d'en optimiser le dploiement et lacceptation.
Le processus de rvision sera pilot via des audits et/ou des revues de direction
priodiques, sur lesquels une communication adapte sera faite vers le
personnel.
Les oprateurs impliqus dans les processus et concerns seront forms. Cest
une condition ncessaire la qualit du dploiement et leur motivation. Un
systme de reconnaissance interne sera dailleurs mis en place.
Un systme dautocontrle sera mis en place (application du PMSR).
Le rle du dirigeant dentreprise sera notamment :
De fixer, et de veiller respecter, des objectifs de scurit alimentaire ou Food
Safety Objective (FSO) : cest une dclaration exprimant le niveau de danger
tolrable dans un aliment en relation avec un niveau appropri de protection. Un FSO
exprime la frquence et/ou la concentration maximale d'un danger microbiologique
dans une denre alimentaire au moment de la consommation, de manire satisfaire
aux niveaux de risques acceptables (ou ALOP) qui ont t fixs par les autorits (cf.
infra).
Il s'agit donc typiquement de concentrations en micro-organismes ou en toxines au
moment de la consommation. Mais un FSO peut aussi tre utilis pour les dangers
chimiques (tels que les carcinognes, les pesticides, les nitrates, ).
Un FSO traduit le risque en un objectif bien dfini qui doit tre atteint via le
SMQS bas sur les bonnes pratiques, lHACCP et lautocontrle. De prfrence, un
FSO est une valeur quantitative et vrifiable.
Dtablir, pour les agents biologiques, des critres de performance atteindre
grce au SMQS de son entreprise : un critre de performance est le rsultat requis
dune ou de plusieurs mesures de matrise (control measures) lors dune tape de
production, ou dune combinaison dtapes de production, qui sont mises en uvre
dans le but de garantir la conformit des denres.
Quand on tablit des critres de performance, il faut prendre en compte le degr
initial de contamination de la denre par le danger microbiologique et les
changements de contamination microbienne qui se produisent au cours de la
production, de la transformation, de la distribution, du stockage, de la prparation et
jusquau moment prvu de la consommation de cette denre.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
32
De dployer le PMSR dans son entreprise. Le dploiement correspond gnralement
aux deux cas de figure ci-aprs :
A B
Le type de dploiement adopt dpend naturellement du contexte et du niveau de
professionnalisme dans les filires.
Le dploiement top-down (Figure A) devrait avoir plus de chances de russir dans les
organisations de petite taille, mais souvent la direction de lentreprise ne simplique pas
dans les aspects techniques, ce qui complique alors ce mode de dploiement par
manque dune bonne perception des besoins et des enjeux.
Le dploiement mtiers (Figure B) est le plus souvent rencontr dans les entreprises
qui produisent et exportent des fruits et lgumes, et les cadres intermdiaires (en
particulier le RQT) jouent un rle essentiel cet gard. Cependant, sans validation ni
engagement de la direction, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Lobstacle
principal est alors celui de la communication entre les cadres, jugs comme trop
pointilleux et la direction perue comme dsintresse des efforts raliser dans
le domaine et seulement centre sur les rsultats.
Le management a dautres obligations qui ne sont pas toujours rencontres :
l'exemplarit : la fois dans le traitement des risques et dans le comportement de
tous les jours : rien de pire qu'un patron qui entre dans une station de conditionnent
sans se laver les mains, sans tenue de protection, sans respecter les rgles
affiches.
la transparence : toute lefficacit d'une dmarche de management des risques
repose sur la confiance que les collaborateurs peuvent nourrir vis--vis de cette
dmarche ; rien de pire, l aussi, que la dcouverte dun risque majeur cach,
comme par exemple une pollution des produits via leau utilise.
Dploiement top-down : toute
l'nergie est dissipe partir de la
Direction, qui cherche diffuser les
mesures de matrise partout dans
lentreprise, en mme temps, et
verticalement.
Cest le patron qui a linitiative.
Dploiement mtiers : l'nergie est
principalement dpense un niveau
intermdiaire, gnralement par le
RQT (responsable qualit traabilit).
Une validation par la Direction est
ncessaire, mais c'est son seul rle et
l'nergie quil dpense est donc
moindre.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
33
la visibilit de lengagement personnel : la fois dans les discours mais aussi
dans les actes, y compris celui de donner des ressources ou de rserver du temps
pour la formation !
1.4.3. Rle de lautorit, gestionnaire de risque
Fixer les niveaux de risques acceptables
Il revient lautorit comptente de fixer ce qui est acceptable ou non, et de
contrler le respect par les oprateurs des limites considres comme telles (ce
sont notamment les normes qui seront fixes par la rglementation).
a) Pour les dangers (micro)biologiques
Pour les dangers microbiologiques, il sagit notamment de fixer un niveau de
protection appropri ou Appropriate Level of Protection (ALOP) (niveau de risque
tolrable / niveau de risque acceptable).
Exemples dALOP :
Le nombre de cas de maladie provoqus par un micro-organisme dans une denre
alimentaire, par an et par 100.000 habitants dune population, qui est cens pouvoir tre
tolr .
Il n'y aura pas plus de 20 cas d'une maladie alimentaire donne par 100.000 habitants
par an dans un pays dtermin .
L'ALOP est le niveau atteint, ou qui peut tre atteint, par le danger microbiologique pour
lequel on tient compte : (1) de l'impact sur la sant publique ; (2) de la faisabilit
technologique et (3) des consquences conomiques, et o lautorit fait la
comparaison avec d'autres risques de la vie quotidienne pour prendre les mesures de
matrise juges appropries.
Une fois fix, un ALOP est un objectif qui doit tre atteint par une filire de
production entire d'une denre alimentaire donne (depuis la matire premire
jusqu'au produit fini)
24
.
b) Pour les dangers chimiques
Il existe des valeurs limites qui ont t fixes rglementairement sur base dune analyse
de risque pour le consommateur. Par exemple :
LMR ou limite maximale applicable aux rsidus de pesticides :
Une concentration maximale du rsidu d'un pesticide autorise dans ou sur des
denres alimentaires ou aliments pour animaux, fixe sur la base des bonnes
pratiques agricoles et de lexposition la plus faible possible permettant de protger
tous les consommateurs vulnrables (Rglement (CE) 396/2006).
24
Pour satisfaire aux ALOP au moment de la consommation, les oprateurs doivent fixer et
respecter des objectifs de scurit alimentaire ou Food Safety Objective (FSO).
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
34
LMR ou limite maximale de rsidus de mdicaments vtrinaires :
La teneur maximale en rsidus, rsultant de l'utilisation d'un mdicament vtrinaire
(exprim en mg/kg ou en mg/kg sur la base du poids frais), que lon peut accepter
comme lgalement autorise ou qui est reconnue comme acceptable dans des
denres alimentaires dorigine animale (Rglement (CEE) 2377/90).
ML (Maximum Level) ou Teneur maximale :
Teneur maximale admissible dapplication pour les autres contaminants (ex. : mtaux
lourds) (Rglement (CE) 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour
certains contaminants dans les denres alimentaires).
Programmer et planifier les contrles en fonction des risques identifis
Input du secteur
(Analyse des
risques sectorielle)
Analyse des
risques
(Niveau autorit)
Programmation (Quoi ? Dans
quel produit ?) :
En fonction des risques et de
lautocontrle dans le secteur.
Planification (O ? Quand ?
Frquence ?) :
Des contrles (dans le secteur, sur
base de la programmation).
Ralisation des contrles :
Contrles, chantillonnages,
inspections, audits.
Rapportage des rsultats :
Rsultats danalyse.
Rapports des contrles, des
inspections et des audits.
Obligations
internationales
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
35
Les contrles officiels, raliss par lautorit, reposeront sur toute une srie de choix.
Lvaluation des risques, qui est ralise non seulement pas les experts travaillant sous
la responsabilit de lautorit, mais aussi par les professionnels dun secteur (dans le
cadre de la rdaction dun Guide dautocontrle par exemple - voir Chapitre 3), est un
lment essentiel dans le choix des contrles programms car elle prend notamment
en compte la gravit des effets nfastes causs par les dangers (mtaux lourds, rsidus
de pesticides, salmonelles, ) et limportance des constatations faites les annes
antrieures.
Les obligations lgales et les recommandations des instances internationales (ex. : OIE,
IPPC, OMS,), ou les recommandations des diffrents comits (dont le Comit du
Codex Alimentarius), sont galement des critres considrs lors de la programmation
des contrles officiels.
La prsence, dans un secteur, dun systme dautocontrle valid chez une majorit
des oprateurs, ainsi que les rsultats des inspections et des sanctions antrieures chez
ces oprateurs, constituent quelques lments dterminants pour la programmation
des contrles.
Les contrles officiels sont planifis et organiss par lautorit dans un
Programme de contrles
25
. Ils consistent en inspections (identification des
oprateurs, examens des registres, inspections relative lhygine, par exemple), en
analyses (bactriologiques, rsidus), et en audits des systmes dautocontrle (y compris
pour la traabilit)
26
. Lors de ltablissement du programme de contrles avec
chantillonnages, il y a lieu de distinguer diffrents cas de figures qui conditionneront la
manire de dterminer le nombre danalyses :
le nombre danalyses est impos par la rglementation (surtout secteur animal) ;
le nombre danalyses est fix par lanalyse des risques (ex : dans le cadre de
lautocontrle) ;
le nombre danalyses sinscrit dans le cadre dun monitoring (national ou
international);
le nombre danalyses est estim a priori (si les donnes manquent).
Le cas chant, le nombre danalyses peut tre ajust par lautorit pour tenir compte
de sensibilits mdiatiques, politiques, de celle des consommateurs ou de considrations
conomiques (ex. : redonner confiance dans une origine).
A ct des contrles planifis, dautres contrles ne peuvent ltre. Il sagit notamment de
contrles raliss suite un rsultat danalyse positif ou douteux, dans le cadre dune
enqute ou dintervention aux postes dinspection frontaliers (HOUINS, G., 2007).
25
Programme de contrles : plan de contrle au sens l'article 42 du Rglement (CE) 882/2004
relatif aux contrles effectus pour sassurer de la conformit des produits alimentaires. La
notion de programme de contrles couvre les contrles programms avec et sans
chantillonnage. A titre d'exemple, le contrle concerne galement la vrification des
prescriptions rglementaires relatives l'utilisation des produits phytosanitaires ou des engrais,
dans la mesure o ils peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la scurit de la chane
alimentaire.
26
La notion d audit est rserve la dsignation des contrles en vue de la validation des
systmes de qualit et des systmes dautocontrle.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
36
1.5. La communication relative aux
risques
1.5.1. Quels sont les objectifs de la communication sur les risques ?
La communication relative aux risques correspond un change dinformations et
dopinions concernant les risques, entre les responsables de lvaluation des risques,
les responsables de la gestion de risques et les autres parties intresses telles que les
milieux professionnels et mme le public (par exemple, les associations de
consommateurs, les milieux scientifiques). Elle assure la transparence de lvaluation
des risques qui a t mene et sa cohrence.
La communication sur les risques concerne entre autres :
les conclusions des analyses de risques qui sont ralises ;
les rsultats des analyses (au moins les synthses) qui sont effectues dans le
cadre de lautocontrle (pour les entreprises) ou du plan de surveillance gnral
(pour lautorit) ;
les mesures de matrise qui se sont montres efficaces ou non ;
les campagnes de mesures qui doivent tre ralises et pourquoi ;
les rclamations et rejets de produit, les crises auxquelles il a fallu faire face ;
les retraits et les rappels ;
Communiquer sur les risques est avant tout une responsabilit de lautorit. Cest
pour le gestionnaire de risques, dcider de dinformer les milieux professionnels et/ou le
public propos des risques existants et des mesures prventives mettre en place ou
dj adoptes pour rduire les risques et les ramener un niveau acceptable. Cest
aussi communiquer sur lefficacit de ces mesures et sur lvolution des risques.
Ce nest toutefois pas une activit ddie aux seuls gestionnaires publics de risques,
mais toutes les parties prenantes, et notamment une des tches dvolues aux chefs
dentreprise qui doivent galement communiquer sur les risques dans leur entreprise et
auprs des producteurs qui leur fournissent les produits conditionner.
Des modalits particulires (niveau de communication, forme de la communication,
messages clefs) doivent donc tre dfinies, selon quil sagit dune communication par
lautorit ou par un chef dentreprise :
pour conduire efficacement cette communication vers les diverses catgories
dinterlocuteurs. La forme de la communication est donc trs importante.
pour faire circuler linformation de manire approprie entre les parties intresses
ou entre les membres du personnel. Les messages doivent tre clairs, pertinents
pour le destinataire et comprhensibles par tous.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
37
1.5.2. Principes gnraux de la communication
Quelques principes gnraux ont t dfinis lors dune consultation conjointe FAO/
OMS en vue dune communication efficace sur les risques (FAO, 1998) que lon peut
synthtiser comme suit :
1. Connatre lopinion publique. Comprendre la motivation, les opinions, les
proccupations et impressions des individus et des groupes qui forment lopinion
et concevoir des messages communiquant des informations sur les risques afin
daborder ces problmes, permet damliorer la communication. Lcoute de
toutes les parties concernes constitue galement un aspect important de la
communication sur les risques.
2. Impliquer les experts scientifiques. Ces experts doivent tre impliqus car ils
peuvent fournir des informations sur la dmarche dvaluation des risques et sur
ses rsultats, y compris sur les hypothses et jugements subjectifs. Les
dcideurs chargs de la gestion des risques auront ainsi une information et une
comprhension compltes des risques.
3. Disposer de comptences dexperts en communication. Lexpertise en matire de
communication est essentielle pour faire passer de faon claire, comprhensible
et instructive, le message appropri dinformation sur les risques. Il est donc
ncessaire, ds le tout dbut, dimpliquer ces experts dans le processus de
communication.
4. tre une source dinformation crdible. Linformation qui provient dune source
crdible est susceptible dtre mieux accepte par le public. La cohrence des
messages reus depuis des sources multiples confre de la crdibilit au
message dinformation sur les risques. Pour tre crdible, il faut fournir au public
la possibilit de reconnatre la comptence, la fiabilit, lhonntet et limpartialit.
En outre, le spcialiste en communication doit sappuyer sur des faits, se
montrer expert et attentif au bien-tre de la population, responsable, honnte et
avoir une bonne rputation. Une communication efficace reconnat
lexistence de problmes et difficults, ses contenus et approches doivent tre
ouverts et elle doit tre opportune.
5. Partager les responsabilits. La communication doit faire intervenir de multiples
acteurs, parmi lesquels les fonctionnaires chargs de la rglementation, les
industriels, les consommateurs et les mdias. Chacun a un rle spcifique
jouer mais en partageant les responsabilits, chacun peut assumer le sien de
telle faon que cela permette une communication efficace.
6. Distinguer la science et les jugements de valeur. Lors de llaboration dun
message communiquant des informations sur les risques, il est essentiel de bien
distinguer les faits des opinions.
7. Assurer la transparence. Pour tre sr que la population accepte les messages
dinformation sur les risques, le processus doit tre ouvert et contrlable par les
parties intresses.
8. Mettre le risque en perspective. Il est possible de mettre le risque en
perspective en lexaminant sous langle de ses ventuels avantages ou en le
comparant avec dautres risques plus familiers. Il ne faut cependant pas faire
cela de faon telle que la population ait limpression que la comparaison sert
diminuer limportance du risque ! Il faut notamment viter dutiliser certaines
images ou analogies inappropries.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
38
1.6. La gestion de crise
1.6.1. La notion de crise
Il existe diverses dfinitions de la crise (de ltat de crise) car il existe de nombreux
types de crises :
1. un accident industriel (explosion nuclaire, pollution, accident de transport, ...) ;
2. une catastrophe naturelle (tremblement de terre, tsunami, incendie, ...) ;
3. une dfaillance des sites de production (panne gnrale, dfauts produits majeurs,
destruction du site, ...) ;
4. une crise sociale (grves, violence sur le lieu de travail, occupation des locaux, )
ou humanitaire ;
5. et bien entendu, la crise alimentaire, comme : la crise de la dioxine (poulets de chair
et ufs contamins par des dioxines) ; la crise de la mlamine dans la poudre de lait
chinoise ; la crise de la vache folle ; etc.
La plupart des auteurs saccordent sur une dfinition qui est proche de celle-ci :
Crise : une situation o de multiples organisations, aux prises avec des problmes
critiques, soumises de fortes pressions externes, d'pres tensions internes, se
trouvent brutalement et pour une longue dure sur le devant de la scne, projetes
aussi les unes contre les autres... le tout dans une socit de communication de masse,
c'est--dire en direct avec lassurance de faire la une des mdias sur une longue
priode .
Lide gnrale qui se dgage derrire ces dfinitions est le fait quune entreprise, ou
plus gnralement une organisation (y compris un Etat), peut faire lobjet dune forte
exposition mdiatique quand les clients et le public sont informs quun
dysfonctionnement grave, pouvant porter atteinte la sant, est survenu pour lequel,
objectivement ou non, elle noffre plus la garantie de pouvoir faire face la situation, et
de pouvoir rsoudre seule le problme.
Il y a donc, dans la crise, considrer des lments objectifs (ex. : le dpassement
constat dune norme lors dune analyse ; les capacits de lentreprise ; lexistence de
procdures internes ; ) et des lments subjectifs (ex. : le manque de crdibilit de
loprateur dont les comptences sont remises en cause : on ne pense pas quil sera
capable de rsoudre le problme ).
A cause des ces lments subjectifs, lentre et la sortie de crise sont des moments
difficiles cerner. On est en crise quand la stabilit de lentreprise est compromise.
Ensuite, mme si le problme a t rsolu (ex. : les produits dfectueux ont t retirs ou
rappels, les causes de la crise ont t identifies et la production est prsent
parfaitement matrise), le moment du retour au fonctionnement considr par les clients
et le public comme normal est parfois difficile cerner : il peut tre compliqu de
savoir quand la crise est rellement termine (quand le doute a disparu et que la
confiance des clients est revenue ? et si celle-ci ne revient jamais ?).
La dfinition de la crise faisant la part belle l'aspect mdiatique, si lattention des
mdias est attire par un autre sujet plus urgent, la perception du public changeant, la
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
39
crise passe au second plan, ou disparat tout fait de lactualit : la crise nexiste plus
quand bien mme le problme subsisterait ! Certains (politiciens, groupes industriels,
groupes dopinion) sont passs matres dans la faon de manipuler les mdias, et de
sortir de scne en allumant des contre-feux .
1.6.2. La gestion de crise par lentreprise
En cas de crise alimentaire, lentreprise doit pouvoir ragir rapidement et
efficacement afin dune part, de pouvoir retourner au domaine de fonctionnement normal
dans les plus brefs dlais, et dautre part de pouvoir tirer les leons de cette crise pour
amliorer son mode de fonctionnement
27
.
Il est donc souhaitable que lentreprise intgre dans son fonctionnement la possibilit
dune crise et se dote de procdures suivre dans lventualit dune crise. Elle sera
ainsi prpare pour faire face. Dans ce type de procdures, lentreprise devra aussi
dfinir des seuils daction
28
pour quelle puisse savoir sil y a crise ou non.
Quelle que soit lorigine de la crise, lattitude que lentreprise doit adopter sera la mme :
1. Dcider qu'on est en crise et le faire savoir ( ses clients, aux autorits). En
matire de communication, on prendra soin :
- de vrifier quels peuvent tre les effets de la dfaillance constate pour les
clients. Notamment grce la traabilit des produits, on pourra cerner le
nombre de lots concerns et leurs destinations ;
- de fournir aux clients directs toutes les informations utiles pour les aider
dans leurs propres oprations de gestion de crise.
- si la source du problme vient dun fournisseur, lentreprise communiquera
galement vers ce dernier (car dautres entreprises pourraient tre alors
touches dans le secteur) ;
- dinformer les autorits si ncessaire. La notification des autorits n'est pas
requise dans le cas o un danger est constat et gnr dans l'entreprise,
ou lors du processus de transformation, si le systme d'autocontrle
prvoit des actions correctives internes permettant d'liminer ou de
rduire un niveau acceptable ce danger et pour autant que la traabilit de
ces actions correctives soit garantie.
2. Organiser le management de la crise : une quipe de crise sera constitue
pour toute la dure de la crise et sera dote du pouvoir de prendre les dcisions
immdiates qui simposent. Les mesures auxquelles on devra recourir le plus
souvent sont :
27
Nous nirons pas jusqu considrer comme certains auteurs que toute crise a du bon . Sil
est possible den tirer parti dans une certaine mesure, la plupart des crises alimentaires
engendrent des consquences sanitaires inacceptables (des intoxications) et des dgts
conomiques considrables, non seulement pour lentreprise en cause, mais souvent pour un
secteur tout entier : on voit seffondrer pour plusieurs mois la consommation dun produit quel
quen soit le producteur ou lorigine.
28
Le seuil daction nest pas seulement une valeur ne pas dpasser pour quil y ait crise.
Cela peut tre aussi une combinaison entre une mesure et une opration dfectueuse (ex. : un
dpassement de LMR et une absence de traabilit de certains lots).
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
40
- le retrait des produits qui sont encore sous la responsabilit de lentreprise:
toute mesure visant empcher la distribution et la mise en vente dun
produit ;
- le rappel des produits aprs distribution : toute mesure visant en
empcher la consommation ou lutilisation par le consommateur et
linformer du danger quil court ventuellement sil a dj consomm le
produit.
Contrairement ce que pensent parfois certains, la responsabilit du retrait et du
rappel de produits du commerce repose avant tout sur la (les) entreprise(s)
concerne(s). L'autorit qui en a t informe ne prend pas son compte la
responsabilit de l'exploitant, mme si un dialogue s'impose en cas
d'incident grave !
3. Prendre rapidement les mesures ncessaires la sauvegarde de
lentreprise : la sauvegarde de lentreprise passe obligatoirement par une sortie
rapide de crise qui peut imposer entre autres de :
- revoir en profondeur les responsabilits, et si ncessaire oprer des
changements au niveau des responsables de processus ;
- refondre de l'quipe de direction ;
- revoir la description complte des processus de lentreprise, voire pratiquer
un reengeneering complet ou partiel
- au besoin, faire appel des conseils ou des comptences managriales
externes ;
- revoir la stratgie globale de lentreprise ;
- communiquer sur les mesures qui sont prises, puis sur la sortie de crise.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
41
Annexes
A1. Terminologie recommande en analyse de risque
Dfinition des termes utiliss selon la terminologie de lAFSCA (Belgique) et du Codex
Alimentarius.
Analyse des dangers Hazard analysis
Le processus de collecte et d'valuation des informations sur les dangers et sur les
circonstances qui mnent la prsence de ces dangers, afin de dcider quels dangers
sont significatifs pour la scurit alimentaire et doivent par consquent tre repris dans le
plan HACCP.
Analyse des risques Risk analysis
Un processus comportant trois volets interconnects : l'valuation des risques, la gestion
des risques et la communication sur les risques.
Analyse de scnario
Dans une analyse de scnario, diffrentes mesures de matrise du risque (aussi
appeles scnarios) sont compares les unes aux autres pour examiner laquelle permet
le mieux de limiter le risque. Lanalyse de scnario peut aussi tre utilise si les
connaissances actuelles ne permettent pas deffectuer une seule valuation des risques,
cest--dire si les informations sont manquantes ou insuffisantes pour pouvoir attribuer
une probabilit aux diffrents scnarios.
Caractrisation des dangers Hazard characterisation
L'valuation qualitative et/ou quantitative de la nature des effets nfastes sur la sant
associs aux agents biologiques, chimiques et physiques qui peuvent tre prsents dans
les denres alimentaires. Pour les agents chimiques, il y a lieu de procder une
dtermination de la courbe dose-rponse. Pour les agents biologiques et physiques, on
procdera une dtermination de la dose-rponse si on peut se procurer des donnes.
Caractrisation des risques Risk characterisation
L'estimation qualitative et/ou quantitative, y compris les incertitudes y affrentes, de la
probabilit d'apparition et de la gravit des effets potentiels nfastes sur la sant dans
une population donne, base sur l'identification et la caractrisation des dangers et sur
l'estimation de l'exposition.
Communication sur les risques Risk communication
L'change interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et
d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs lis aux risques et les perceptions des
risques, entre les responsables de l'valuation des risques et de la gestion des risques,
les consommateurs, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation
animale, les milieux universitaires et les autres parties intresses, et notamment
l'explication des rsultats de l'valuation des risques et des fondements des dcisions
prises en matire de gestion des risques.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
42
Dose-rponse Dose-response
La dtermination de la relation entre l'ampleur de l'exposition (dose) un agent chimique,
biologique ou physique, et la gravit et/ou la frquence des effets associs sur la sant
(rponse).
Estimation des risques Risk estimate
Le rsultat de la caractrisation des risques.
Evaluation des risques dterministe
La mthode dterministe utilise, pour chaque variable du modle, une estimation
ponctuelle (par exemple, la moyenne) pour dterminer le rsultat du modle.
Evaluation des risques probabiliste
Dans la mthode probabiliste, les variables du modle sont considres comme des
distributions.
Evaluation de l'exposition Exposure assessment
L'valuation qualitative et/ou quantitative de l'absorption [ingestion] probable d'un agent
biologique, chimique ou physique via l'alimentation, ainsi que des expositions d'autres
sources si c'est pertinent.
Evaluation des dangers Hazard evaluation
L'valuation du risque qu'entranent les dangers mentionns. Pour ce faire, il faut vrifier
quelle est la probabilit que le danger cit se prsente et, s'il se prsente, quel est alors
son effet sur la sant publique.
Evaluation des risques Risk assessment
Un processus reposant sur des bases scientifiques et comprenant quatre tapes:
l'identification des dangers, leur caractrisation, l'valuation de l'exposition et la
caractrisation des risques
Gestion des risques Risk management
Un processus distinct de l'valuation des risques, consistant mettre en balance les
diffrentes politiques possibles, en consultation avec les parties intresses, prendre
en compte l'valuation des risques et d'autres facteurs lgitimes, et, au besoin, choisir
les mesures de prvention et de contrle appropries.
Identification des dangers Hazard identification
L'identification des agents biologiques, chimiques et physiques qui peuvent gnrer des
consquences nfastes pour la sant et qui peuvent tre prsents dans une denre
alimentaire spcifique ou dans un groupe de denres alimentaires.
Incertitude
Lincertitude (aussi appele incertitude pistmique) est un manque de connaissance
parfaite. Lincertitude, associe la variabilit, a pour consquence quil est impossible
de prdire ce quil va se produire dans lavenir.
Incidence
Lincidence est dfinie comme le nombre de nouveaux cas dune maladie par unit de
temps, dans une population considre. Lincidence ne doit pas tre confondue avec la
prvalence qui indique combien de personnes/danimaux dune population donne
souffrent un moment donn dune maladie.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
43
Percentile
Un percentile dun ensemble de donnes est lun des 99 points qui partagent lensemble
ordonn de donnes en 100 parties de grandeur gale. Le 95
e
percentile est, par
exemple, un nombre auquel 95 % des donnes sont infrieures ou gales et 5 % plus
grandes ou gales.
Prvalence
La prvalence indique combien de personnes/danimaux dune population donne
souffrent un moment donn dune maladie.
Principe de prcaution
Le Rglement europen 178/2002 dcrit le principe de prcaution comme suit : dans des
cas particuliers o une valuation des informations disponibles rvle la possibilit
deffets nocifs sur la sant, mais o il subsiste une incertitude scientifique, des mesures
provisoires de gestion du risque, ncessaires pour assurer un niveau lev de protection
de la sant, peuvent tre adoptes dans lattente dautres informations scientifiques en
vue dune valuation plus complte du risque.
PTMI (Provisional Tolerable Monthly Intake)
La quantit dun compos donn, exprime par kg de poids corporel, qui peut tre
ingre mensuellement pendant une vie entire sans que cela ne gnre de problmes
de sant ; typiquement utilis pour les contaminants aux proprits cumulatives ayant
une demi-vie trs longue dans le corps humain. Cette ingestion doit tre considre
comme une valeur temporaire qui peut tre modifie si des connaissances scientifiques
supplmentaires sont disponibles.
PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake)
La quantit dun compos donn, exprime par kg de poids corporel, qui peut tre
ingre de manire hebdomadaire pendant une vie entire sans que cela ne gnre de
problmes de sant; typiquement utilis pour les contaminants aux proprits
cumulatives. Cette quantit doit tre considre comme une valeur temporaire qui peut
tre modifie si des connaissances scientifiques supplmentaires sont disponibles.
Simulation de Monte Carlo
Cette technique fait appel un chantillonnage alatoire de chaque distribution de
probabilit dans un modle pour produire un grand nombre de scnarios ou ditrations.
Le prlvement de lchantillon est effectu en tenant compte de la forme de la
distribution.
TDI (Tolerable Daily Intake)
La quantit dun compos donn, exprime par kg de poids corporel, qui peut tre
ingre quotidiennement pendant une vie entire sans que cela ne gnre de problmes
de sant ; typiquement utilis pour les contaminants (par opposition la dose journalire
acceptable).
TWI (Tolerable Weekly Intake)
La quantit dun compos donn, exprime par kg de poids corporel, qui peut tre
ingre de manire hebdomadaire pendant une vie entire sans que cela ne gnre de
problmes de sant ; typiquement utilis pour les contaminants.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
44
A2. Exemples dvaluation de risques (approche dterministe)
Etude de cas n 1 :
Quel risque reprsente la prsence de rsidus dthphon une concentration
suprieure la LMR dans des ananas ?
Y a-t-il une diffrence entre certains groupes de consommateurs ?
Cette tude de cas reprsente un exemple dvaluation dterministe du risque pour les
rsidus de pesticides.
Un lot dananas a t analys lors de son arrive sur le territoire europen. La valeur du
rsidu dthphon communique par le laboratoire danalyse est de 3,3 mg/kg,
suprieure la LMR sur ananas
29
de 2 mg/kg. Une analyse de risque est donc mene.
Etape n 1 : identification du danger
La matire active thphon (acide 2-chlorothyl-phosphonique) est un rgulateur de
croissance prsentant des proprits systmiques (il pntre l'intrieur des tissus de la
plante et se dcompose en thylne, agissant ainsi sur les processus de croissance).
Lthphon est utilis sur ananas et dautres cultures (ex. : la tomate) notamment pour
induire la floraison. Un dpassement de la LMR peut avoir plusieurs origines :
- Non-respect de la dose/ha ?
- Non-respect du dlai avant la rcolte (DAR) ?
- Non-respect du nombre dapplications ?
- Mauvaise application ?
- Anomalie de concentration dans le produit ?
- Circonstances fortuites (climatiques) ?
Lexamen du registre de champ doit permettre de dterminer lorigine du problme.
Etape n 2 : caractrisation du danger
LEFSA a tabli des valeurs toxicologiques de rfrence. En ce qui concerne lthphon,
la valeur de lARfD (risque toxicologique aigu pour le consommateur) est de 0,05 mg
s.a./kg pc/jour (PRAPeR Meeting 54, EFSA, 2008, avec un facteur de scurit de 100
retenu).
Une DJA de 0,03 mg/kg pc/jour a t galement tablie par lEFSA avec un facteur de
scurit de 1000 (EFSA, 2009).
Etape n 3 : estimation de l'exposition
Le risque dingestion dune denre alimentaire contenant des rsidus de pesticides qui
dpassent la LMR (Limite Maximale applicable aux Rsidus) est valu dans le pire des
scnarios en calculant le PSTI (Predictable Short Term Intake). A cet effet, les donnes
toxicologiques du pesticide, les donnes relatives aux habitudes alimentaires (97,5
e
percentile) et la quantit du rsidu dans la denre alimentaire sont ncessaires.
29
LMR disponible sur : http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
45
Pour les donnes relatives aux habitudes alimentaires, on peut utiliser diffrentes
donnes de consommation alimentaire (GEMS/Food Regional Diets ou donnes du PSD-
UK). Pour les autres donnes relatives au calcul du PSTI et linterprtation des
rsultats du PSTI, on consultera les rfrences suivantes :
- Directive 2006/85/CE modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue dy inscrire
les substances actives fenamiphos et thphon.
- EFSA (2008). MRLs of concern for the active substance ethephon. EFSA Scientific
Report (2008) - Prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR), 159, 1-31.
- EFSA (2009). Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethephon.
EFSA Journal 2009; 7(10):1347.
- PSD (Pesticides Safety Directorate), 13 January 1998. UK Technical policy on the
estimation of acute dietary intake of pesticide residues.
- SANCO, 2001. Draft Proposal on how to notify pesticide residues in foodstuffs in the
Rapid Alert System for Foodstuffs. Ref.: SANCO/3346/2001 rev 3.
Donnes ncessaires pour le calcul du PSTI
Donnes Valeur
Donnes de consommation au P
97,5
pour un adulte
(UK-PSD, LP adulte)
0,3456 kg
Donnes de consommation au P
97,5
pour un enfant
(UK-PSDLP enfant)
0,4149 kg
Poids corporel dun adulte (UK-PSD, pc adultes) 76 kg
Poids corporel dun enfant (UK-PSD, pc enfant 4-6
ans)
20,5 kg
Concentration en rsidu observe (OR) 3,3 mg/kg
Poids unitaire de la denre alimentaire (U) 1,6 kg
Facteur de variabilit (v) 5
Facteur de transformation (t) (propos par lEFSA,
limination de la peau de lananas)
0,25
Lestimation de lexposition court terme de deux groupes de consommateurs dananas
contamins lthphon est ralise par la formule de calcul du PSTI (selon DG SANCO
3346 & PSD) :
((U
*
OR
*
v) + (LP-U)
*
OR)
*
t
PSTI =
pc
avec
U = unit (poids unitaire de la denre) en kg
OR = observed residue, en mg/kg (ici : 3,3 mg/kg > LMR)
v = variability factor = 5
t = transformation factor, ici : 0,25
pc = poids corporel du groupe considr
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
46
Adultes Enfants
Valeur du rsidu
dthphon observ dans
les ananas :
3,3 mg /kg
PSTI 0,0750 0,3339
PSTI
en tenant compte
d'un facteur de
transformation de
0,25
0,0187 0,0835
% ARfD 37,4% 167,0%
Etape n 4 : caractrisation des risques
Le rsultat de lestimation de lexposition (PSTI) est compar avec lARfD (dose aigu de
rfrence) :
Groupe des adultes : (0,0187 / 0,050) x 100 = 37,4 %
Groupes des enfants : (0,0835 / 0,050) x 100 = 167,0 %
Le risque toxicologique est considr comme inacceptable pour le consommateur si le
PSTI > lARfD.
Conclusion
Il ny a pas de risque dintoxication pour le groupe des adultes (37,4 % de lARfD) mais
un risque certain pour les enfants (167 % de lARfD !).
Les lots contamins ne devraient donc pas tre commercialiss.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
47
Etude de cas n2 : (daprs larticle de K. BAERT et al., AFSCA, 2007)
Quel risque reprsente la prsence de la patuline dans le jus de pomme ?
Y a-t-il une diffrence entre les jus bios et les autres ?
Etape n 1 : identification du danger
La patuline est une mycotoxine qui est
principalement forme par Penicillium expansum,
une moisissure que l'on retrouve frquemment sur
les pommes et les poires.
L'infection des pommes se produit pendant la
rcolte et le stockage des pommes. En cours du
stockage, la moisissure va poursuivre son
dveloppement et produire de la patuline.
Lors de la production de jus de pomme, la patuline
se retrouve dans le jus, ce qui entrane l'exposition
du consommateur.
La patuline prsente une certaine toxicit aigu.
Elle est aussi gnotoxique, cytotoxique,
tratogne, immunosuppressive, et
ventuellement neurotoxique. Nanmoins, elle ne
provoquerait vraisemblablement chez lhomme que
des effets toxiques locaux.
Etape n 2 : caractrisation du danger
Sur base d'une tude dose-rponse, le NOAEL pour la patuline a t tabli
43 g/kg de poids corporel/jour (g/kg pc/jour). Sur base de cette valeur et d'un
facteur de scurit de 100, le JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives) a prconis la valeur (VTR) de 0,4 g/kg de poids corporel/jour comme
TDI pour la patuline.
Etape n 3 : estimation de l'exposition
a) Niveaux de contamination
Une tude a montr que la prvalence de la patuline dans le jus de pomme
biologique (12 %), conventionnel (13 %) et artisanal (10 %) n'est pas
significativement diffrente.
La concentration moyenne en patuline dans les chantillons contamins est
significativement plus leve dans le jus de pomme biologique (41,3 g/litre) que
dans le jus de pomme conventionnel (10,2 g/litre) et artisanal (10,5 g/litre).
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
48
Pour les donnes de contamination de cette tude de cas, on a analys 177 jus de
pomme quant leur teneur en patuline.
b) Donnes de consommation
Le jus de pomme et le nectar de pomme sont les principales sources de patuline. Les
jeunes enfants sont plus exposs la patuline via le jus de pomme. Une tude a
montr une ingestion de patuline plus leve des jeunes enfants, gros
consommateurs de jus, en comparaison avec les autres groupes de la population.
La consommation de jus de pomme a t dtermine d'aprs une tude sur les
habitudes nutritionnelles chez les enfants en bas ge (2,5 6,5 ans). On a fait
lhypothse qu'un consommateur n'utilise qu'un des 3 types de jus de pomme (un
utilisateur de jus de pomme biologique ne consommera que du jus de pomme
biologique). On a galement suppos que le schma de consommation pour les
3 groupes de consommateurs (biologique, artisanal et conventionnel) tait le mme.
c) Calculs
Dans cette tude de cas, l'exposition d'enfants en bas ge la patuline par la
consommation de jus de pomme a t dtermine l'aide de techniques
probabilistes bases sur une simulation de Monte Carlo.
La base de calcul est la suivante :
Ingestion de patuline (g/kg pc/jour) = concentration de patuline dans le jus de
pomme (g/kg) x consommation de jus de pomme (g/kg pc/jour) x 0.001 (g/kg)
Exposition la patuline (g/kg pc/jour) pour diffrents jus de pomme (JP)
(mdiane [90% d'intervalle de confiance]) :
JP biologique JP conventionnel JP artisanal
P83* 0 [0-0] 0 [0-0] 0 [0-0]
P90 0.039 [0.014-0.069] 0.030 [0.011-0.049] 0.037[0.013-0.066]
P95 0.072 [0.027-0.117] 0.059 [0.031-0.085] 0.065 [0.027-0.102]
P97.5 0.135 [0.053-0.229] 0.095 [0.057-0.133] 0.102 [0.047-0.151]
P99 0.350 [0.143-0.822] 0.156 [0.106-0.206] 0.150 [0.084-0.229]
P99.9 1.471 [0.526-3.066] 0.328 [0.210-0.548] 0.298 [0.156-0.460]
*83
e
percentile
Les simulations montrent que 83 % des enfants n'ingrent pas de patuline via le jus
de pomme. Seuls les trs gros consommateurs de jus bio dpassent la TDI
(= 0,4 g/kg pc/jour), les autres groupes sen approchent.
Etape n 4 : caractrisation des risques
La simulation de l'exposition a montr que la TDI pour la patuline est parfois
dpasse (jus biologique). Les enfants qui consomment du jus de pomme
conventionnel ou artisanal ne dpasseront pas la TDI.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
49
Le rassemblement des donnes tires de la caractrisation des dangers et de
l'estimation de l'exposition a montr que la probabilit de dpasser la TDI avec la
consommation de jus de pomme biologique tait de 0.009 [IC 90%: 0.003-0.018],
tandis que pour les jus de pomme conventionnel et artisanal, elle tait
respectivement de 0.001 [IC 90%: 0-0.003] et de 0 [IC 90%: 0-0.002].
Conclusion
La consommation de jus de pomme et plus prcisment de jus de pomme
biologique par de jeunes enfants peut conduire au dpassement de la TDI. Il sera
donc recommand :
a) de limiter la consommation en jus de pomme ;
b) pour les cultures biologiques, dviter les temps de stockage des pommes.
Labsence de fongicide favorise le dveloppement du champignon et donc
lapparition de la mycotoxine. Un tri des pommes et un temps rduit de stockage
permettent de rduire le niveau de concentration en patuline dans les jus
produits.
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
50
Notes personnelles
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Chapitre 1
Principes de
base de
lanalyse des
risques
3
2.1. Quelles mesures de matrise ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2. Exigences et mesures de matrise en production primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3. Exigences relatives au transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.4. Post-rcolte : exigences relatives au Milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.5. Post-rcolte : exigences relatives la Main doeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.6. Post-rcolte : exigences relatives au Matriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.7. Post-rcolte : exigences relatives la Matire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.8. Post-rcolte : exigences relatives la Mthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Annexe : nettoyage et dsinfection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Les mesures de matrise
des risques en entreprise
Chapitre 2
52
2.1. Quelles mesures de matrise ?
Pour dcider des mesures de matrise intgrer dans son Plan de Matrise et de
Surveillance des Risques sanitaires (PMSR)
1
, le responsable de la qualit sanitaire
et de la traabilit dans une entreprise devra :
1. Prendre en compte les recommandations reconnues internationalement et les
exigences de la rglementation (dans ce cas, les mesures de matrise
deviennent en effet des exigences ).
2. Procder une valuation systmatique des risques et des sources de
contamination sur son exploitation, en utilisant par exemple la mthode dite des
5M
2
, et dcider sur cette base des mesures appropries.
2.1.1. Approche sur base de rfrences internationales
Pour choisir des mesures de matrises appropries (efficaces et conomiquement
supportables), le chef dentreprise pourra sappuyer :
1. Sur les exigences dfinies par la Commission du Codex Alimentarius dans
la norme Code dusages international recommand - principes gnraux
dhygine alimentaire CAC/RCP 1-1969, REV, 4 (2003). Ces exigences sont
applicables tous les pays membres de lOMC signataires de lAccord sur
lApplication des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires (ou Accord SPS).
Cest le document de base, consulter en priorit, car ce Code reprend
galement les lments relatifs la production primaire (Section III).
1
A noter que nous prfrerons parler dun Plan de matrise et de surveillance des risques
sanitaires (PMSR) et non, comme certains auteurs, dun plan de matrise sanitaire (PMS) pour
faire rfrence aux oprations de vrification (autocontrles) qui sont indissociables de la
gestion rationnelle des risques.
2
Ou diagramme dIshikawa. Voir Manuel 1 du PIP.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Dcider des mesures de matrise mettre en place est un exercice propre
chaque entreprise. Chaque responsable doit avoir pralablement valu les
risques auxquels son entreprise est confronte et fix les objectifs poursuivis.
Le prsent chapitre prsente un catalogue de mesures gnriques de matrise,
gnralement appropries au secteur de la production et du conditionnement des
fruits et lgumes frais. La plupart dentre elles sappuient sur les recommandations
du Codex Alimentarius, les exigences de la rglementation internationale et les
lignes directrices de rfrentiels reconnus ou de Guides de Bonnes Pratiques.
Il est toutefois ncessaire dadapter les mesures et le niveau dexigence requis
en fonction du produit, du processus et des circonstances locales !
53
On y trouvera des conseils d'ordre gnral applicables tous les oprateurs,
mme si les usages en matire d'hygine varient considrablement d'une denre
une autre, et qu'il faille, au besoin, appliquer des Codes spcifiques.
Il faudra donc aussi se rfrer au Code dusages en matire dhygine pour les
fruits et lgumes frais - CAC/RCP 53 2003 du Codex Alimentarius.
2. Sur les exigences du Rglement (CE) 852/2004 (Annexe I, Partie A)
3
en
matire dhygine et de tenue de registres. Ce rglement reprend les dispositions
gnrales dhygine applicables la production primaire et aux oprations
connexes comme le transport, lentreposage ou la manipulation.
3. Sur le rfrentiel intitul Exigences relatives la matrise de la scurit
sanitaire des aliments applique aux IAA (BTSF, DG SANCO, janvier 2010).
Il sagit dun rfrentiel technique qui a t rdig pour tre utilis par les
autorits comptentes des Etats membres de lUnion africaine en vue de la
certification des entreprises agro-alimentaires.
Ce rfrentiel reprend les exigences des
Bonnes Pratiques dHygine applicables aux
entreprises de transformation et, dans la mesure
o elles les compltent, il reprend aussi certains
lments des Bonnes Pratiques de Fabrication.
Il est bas sur les principes gnraux dhygine
alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rv. 4-2003) du
Codex Alimentarius et concerne donc la scurit
sanitaire des denres alimentaires, mais pas la
qualit de celles-ci. Ce rfrentiel peut tre
associ des grilles daudit permettant den
valuer la mise en uvre.
Il pourra tre consult par les entreprises des
pays ACP, et le prsent chapitre reprendra de nombreux lments qui y sont
mentionns. Toutefois, ce rfrentiel ne considre pas les exigences
relatives la production primaire, ce qui en limite son intrt dans le cadre de
la production de fruits et lgumes frais.
4. Sur les principes gnraux dhygine de tous les Codes de Bonnes Pratiques
(Bonnes Pratiques Agricoles, Bonnes Pratiques de Transport, Bonnes Pratiques
dHygine, Bonnes Pratiques de Fabrication, Bonnes Pratiques de Distribution).
5. Sur les normes internationales (notamment la norme ISO 22000 base sur
lHACCP), les normes nationales ou industrielles.
3
Rglement (CE) 852/2004 relatif lhygine des denres alimentaires. JO L139/1 du
30.04.2004.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
54
2.1.2. Approche sur base dune analyse des dangers
Le Codex reconnat prcisment que : Il se produira invitablement des situations o
certaines des exigences spcifiques prsentes dans le Code dusages ne seront pas
applicables . Et donc, La question fondamentale sera : quelle est la mesure
ncessaire et approprie sur la base de la scurit et de l'acceptabilit des aliments pour
la consommation ?
Dans la pratique, cela signifie que, bien qu'une exigence reprise dans ces documents de
rfrence soit gnralement approprie et raisonnable, il peut exister des situations o
elle n'est ni ncessaire ni adapte du point de vue de la scurit des aliments et de
leur acceptabilit.
Lorsquil s'agit de dcider si une prescription est ncessaire ou
approprie, il convient donc didentifier les dangers (ex. : avec
la dmarche HACCP) et d'en valuer le niveau de risque
acceptable.
Le choix des niveaux acceptables de dangers devra tre justifi !
Pour les dangers biologiques et chimiques, le responsable de lentreprise pourra
sappuyer : (1) sur les exigences rglementaires et lgales (en priorit) ; (2) sur les
objectifs de scurit sanitaire (FSO) qui ont t dfinis pour son produit.
Pour les dangers physiques, il pourra plutt sappuyer sur des exigences contractuelles
(cahier des charges du produit fini).
Cette approche, base sur une analyse des dangers, permet d'appliquer les exigences
des Codes dusages et des rfrentiels avec flexibilit et bon sens, tant entendu que
l'objectif gnral est de produire des aliments salubres et propres la consommation
(Codex Alimentarius, 2004).
Les exploitants doivent (adapt de BTSF, 2010) :
1. Identifier toutes les tapes de leurs processus et activits qui sont dcisives pour
la scurit des aliments (analyse des dangers) ;
2. Mettre en uvre des procdures de vrification (autocontrles) efficaces
chacune de ces tapes ;
3. Assurer le suivi des autocontrles pour assurer leur effectivit et leur efficacit
continues (inspections et audits internes) ;
4. Passer en revue les procdures de contrle priodiquement (afin den vrifier
leffectivit et lefficacit) et chaque fois que les oprations ou que les produits
fabriqus changent (amlioration continue) ;
5. Etablir une documentation relative leur PMSR, qui devra comprendre
lenregistrement des contrles et des mesures effectus (traabilit).
Pour identifier tous les dangers et pour en identifier la source, les responsables
dentreprise peuvent utiliser la mthode dite des 5 M .
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
55
Quels sont les sources potentielles de contamination sur le processus ?
Main-duvre Milieu Produit fini
Matire
Mthode Matriel
La mthode des 5 M consiste identifier les sources de contamination possible dans
le procd, en examinant :
Matire (matire premire)
Plusieurs aspects sont considrer comme : lorigine, la propret, la conformit,
ltiquetage et les caractristiques (ex. : la temprature, la teneur en eau) des
produits. Pour ce qui nous concerne, il sagit non seulement des produits rcolts
(matire premire conditionner), mais aussi des intrants utiliss (semences, eau,
engrais, amendements, emballages, produits phytosanitaires,).
Main-duvre
Chacune des personnes qui manipulent les produits est potentiellement porteuse de
micro-organismes pathognes transmissibles par les aliments. cet effet, diffrentes
prcautions doivent tre prises afin de minimiser les risques. Notons que le lavage
des mains, ainsi que le comportement du personnel est la premire tape
essentielle. La tenue vestimentaire fait aussi partie des lments souligner. La
plupart des consignes relatives lhygine du personnel sont devenues monnaie
courante, comme lexamen mdical, le port dun tablier, dune rsille afin de
recouvrir les cheveux, ou encore lexclusion de tout bijou lors de la manipulation des
aliments.
Mthode
Il sagit de lensemble des procds utiliss pour la production (itinraire technique,
depuis le semis jusqu la rcolte), la rcolte, le transport et le conditionnement
jusqu lexpdition du produit. Il sagit entre autres de respecter les GMP ou
Bonnes Pratiques de Production.
Matriel
Tout matriel (quipement, ustensile et matriau demballage) est susceptible de
contaminer les aliments sil nest pas entretenu adquatement ou adapt lusage.
Pour ce faire, il ne suffit pas de les laver correctement. Lentreprise doit galement
inclure dans les tches du personnel de penser la maintenance des machines, des
appareils dpandage, des moyens de transport et des chambres froides (dgivrage,
nettoyage, dsinfection).
Milieu
Les lieux de travail, quil sagisse des champs ou de la station de conditionnement,
doivent rester propres et protgs de lintrusion des nuisibles. Il est primordial de
faire en sorte, par exemple, dajuster et de fermer les portes et les fentres, de
vrifier lhygine des locaux et de lensemble du plan de travail, de soccuper des
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
56
tuyaux dvacuation des eaux, des dpts de dchets, de la ventilation et de
lclairage.
Lexistence, dans un secteur, dun document de rfrence tel quun Guide
dAutocontrle , qui contient les bases dun plan HACCP pour la production de
produits identiques aux siens, facilitera grandement la tche du responsable dentreprise.
Ce dernier pourra aussi utilement se rfrer au Guide dApplication. Bonnes Pratiques
de Fabrication, Bonnes Pratiques dHygine et HACCP (2010) prpar par le
Programme BTSF (Better Training for Safer Food, DG SANCO).
2.1.3. Mise en uvre des PRP sur base des 5M
Rappel sur les programmes pr-requis (PRP)
Les Programmes pr-requis (PRP) sont dfinis comme tant les conditions et
activits de base ncessaires pour maintenir tout au long de la chane alimentaire un
environnement hyginique appropri la production, la manutention et la mise
disposition de produits finis srs et de denres alimentaires sres pour la
consommation humaine (selon la norme ISO 22000 qui identifie au moins 10 mesures
transversales
4
).
Les Programmes pr-requis (PRP) :
1. dpendent du secteur (et du type de produit), de loprateur et du segment de la
chane alimentaire concerns ;
2. concernent les mesures de matrise qui ne sont pas spcifiques une tape
du processus de production ;
3. concernent des lments qui ne peuvent pas tre mesurs en continu et pour
lesquels il serait trs difficile de dfinir une limite critique, tels que : la qualit
des installations, la propret de la tenue de travail des oprateurs, leur niveau
de connaissance des rgles de base de l'hygine alimentaire, ou encore
l'efficacit du plan de nettoyage et de dsinfection, etc.
En accord avec le rfrentiel du BTSF (2010) et la norme ISO 22000, on retiendra et on
prsentera ci-aprs en dtail les mesures transversales suivantes :
les exigences relatives limplantation et lorganisation gnrale dune
exploitation ou celles dune station, ainsi quaux locaux, aux quipements et
leur maintenance, l'alimentation en air, en eau, en nergie et autres ;
les exigences relatives la mise en uvre et au suivi dun plan de lutte contre
les nuisibles ;
les exigences relatives la mise en place dun contrle des
approvisionnements ainsi qu lenregistrement des informations ncessaires au
fonctionnement dun systme de traabilit ;
les exigences relatives la mise en uvre dune politique de sant des
personnels ;
4
Voir Chapitre 2 du Manuel 1 du PIP.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
57
les exigences relatives la matrise de lhygine du personnel, portant sur
lhygine des mains ainsi que sur lhygine vestimentaire ;
les exigences relatives la mise en uvre, au suivi et la vrification dun plan
de nettoyage pr tabli.
Dtermination des sources de contamination sur base des 5M
En utilisant le diagramme dIshikawa on peut identifier les sources de contamination
(daprs BOUTOU, 2008) :
Main-duvre Milieu
Nettoyage et dsinfection
Port tenue adapte Emplacement
Soins Conception Lutte contre les nuisibles
Visite mdicale occasionnels
dembauche Gestion des dchets
Formation Air/Pluies/Poussires
Accs visiteurs Eclairage
Intrants
Matire
Eau Emballages Marche en avant Conception
FIFO
Chane du froid Etalonnage Plan de nettoyage
Procdures
Autocontrles Traabilit Dsinfection
Respect des Maintenance
rgles dhygine
Mthode Matriel
Maintenir un
environnement
hyginique
tout au long du
processus de
production
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
58
Origine des principaux problmes en production primaire
Slection du site de
production (champ,
verger)
Prsence de mtaux lourds dans le sol
Sol contamin par des rsidus de pesticides
Dbris de verre et de mtaux dans le sol
Production des plants Traitement chimique non autoris sur les semis
Irrigation
(qualit des eaux)
Les rivires et les rservoirs deau sont des sources
plus exposes la contamination que les puits
La contamination fcale dorigine humaine ou animale
est le principal problme concernant les eaux
dirrigation
Contamination de leau par des matires chimiques
Nutrition des cultures
(emploi des fertilisants)
Excs dengrais (spcialement lazote qui produit des
concentrations leves en nitrates dans les plantes).
Mauvais calibrage de lquipement utilis pour
appliquer lengrais
Risque de contamination des cultures par les fumiers
des animaux (agents pathognes). Lutilisation de
fumiers danimaux et de volailles reprsente un risque
car ils contiennent des organismes pathognes
dangereux pour les humains. Les pathognes des
fumiers peuvent se transmettre par les claboussures
de pluie, durant les oprations culturales pendant les
oprations comme le dsherbage et la rcolte et par
absorption par les racines.
Gestion des Pesticides
Choix inappropri des pesticides
Application incorrecte des pesticides
Mauvais calibrage du pulvrisateur
Drive des/sur les cultures voisines
Contamination de leau par des matires chimiques
Formation inadquate du personnel qui pulvrise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Pour tre mme de mettre sur le march des denres rpondant aux critres de
qualit sanitaire et phytosanitaire exigs, toute entreprise devra mettre en place un
certain nombre de mesures (ou PRP) permettant de respecter les principes
gnraux dhygine du Codex Alimentarius.
La premire catgorie de mesures mettre en place dans une entreprise vise
matriser les contaminations (biologiques, chimiques et physiques) provenant des
installations, des matires premires ou des oprateurs.
Une seconde catgorie de mesures vise assurer la propret des locaux, de leur
environnement et des matriels utiliss pour la production, ainsi que lhygine du
personnel.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
59
Rcolte
(hygine du personnel)
Conteneurs de rcolte sales
Equipements de rcolte/couteaux mal entretenus
Absence dhygine personnelle des ouvriers chargs
de la rcolte, prsence denfants, absence de toilettes
Vtements inappropris/sales du personnel charg de
la rcolte
Emploi des machines et
des quipements
Mauvais entretien provoquant des fuites
(hydrocarbures, lubrifiants, rfrigrant)
Point de stockage avant
expdition la station
Contamination par contact avec la vermine
Conteneurs sales et casss
Origine des principaux problmes en station de conditionnement
Amnagement des locaux
et qualit de construction
Contamination biologique (manque dhygine)
Pas de marche en avant, contamination croise
Moisissures et mycotoxines (mauvais nettoyage, pas
de dsinfection, matriaux absorbants)
Corps trangers (site mal tenu). Infestation par des
nuisibles (portes et fentres non grillags)
Rception des produits
Absence dhygine personnelle et vtements
inappropris du personnel
Conteneurs sales, mal entretenus
Lavage
Contamination fcale ou chimique de leau
Frquence inapproprie de renouvellement de leau du
bac de lavage
Equipement de lavage mal entretenu
Absence dhygine personnelle et vtements
inappropris du personnel
Triage & parage
Absence dhygine personnelle et vtements
inappropris du personnel
Equipement mal entretenu
Traitement aprs rcolte
Choix inappropri du pesticide
Application incorrecte des pesticides
Equipement mal entretenu
Traitement la cire
Cires non approuves (ou mulsionnant non
approuv)
Mauvaise application de cire
Equipement dapplication mal entretenu
Schage Equipement de schage mal entretenu
Calibrage
Absence dhygine personnelle et vtements
inappropris du personnel
Equipement de calibrage mal entretenu
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
60
Emballage
Absence dhygine personnelle et vtements
inappropris du personnel
Equipement demballage mal entretenu
Conteneurs sales ou casss
Palettisation Bois cass ou fendu
Pr-rfrigration
Contamination fcale ou chimique de leau
Equipement de refroidissement mal entretenu
Stockage
Equipement de stockage mal entretenu (mauvais
contrle de temprature)
Btiments non protgs de la vermine (nuisibles)
Dchets non enlevs, corps trangers
Conteneurs sales ou casss
Perte de traabilit
Contamination chimique (engrais, biocides ou
pesticides)
Transport Expdition
Vhicule sale ne convenant pas au transport des
aliments
2.1.4. Gnralits sur la matrise des dangers biologiques
Les dangers biologiques (bactries, virus, vers,) peuvent tre matriss en limitant
leur nombre dans le produit. Ce qui est possible en les liminant (ex. : par la cuisson, la
pasteurisation, le rayonnement ionisant, etc.) ou en agissant sur les facteurs de
croissance dont ils ont besoin pour survivre et se multiplier (ou fabriquer des toxines).
Ces facteurs de croissance sont essentiellement la temprature (les agents pathognes
peuvent tre dtruits, limins ou matriss par chauffage ou par conglation), mais aussi
lactivit en eau (Aw) (inhibition par schage), le pH, le potentiel redox, la prsence
dadditifs, etc.
5
Les responsables de production doivent se fixer trois objectifs en relation avec les
risques biologiques :
1. Eliminer ou rduire le danger un niveau acceptable ;
2. Prvenir ou minimiser la croissance des micro-organismes et la production de
toxines ;
3. Matriser la contamination des produits.
En ce qui concerne les dangers biologiques, rappelons que le niveau acceptable de
risque correspond au niveau d'un danger particulier dans le produit fini qui sort de
lentreprise qui est ncessaire l'tape suivante de la chane alimentaire pour
garantir la scurit des denres alimentaires (soit pour la consommation, soit pour la
transformation ultrieure. Par exemple, des fruits peuvent tre consomms ltat frais
ou presss pour le jus).
5
Voir Manuel 1 du PIP.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
61
Pour matriser les bactries
La plupart des bactries, aux tempratures
habituelles de travail, peuvent se dvelopper
rapidement dans le produit.
De ce fait, outre les Bonnes Pratiques
dHygine qui sont dterminantes dans le
cadre de la prvention de la
contamination par les bactries, les
mesures de matrise en production doivent
viser empcher leur dveloppement dans
le produit, notamment par (AFNOR, 2008):
lexploitation du couple temprature / temps :
- une matrise approprie de la dure de rfrigration ou un traitement
thermique appliqu pendant une dure et une temprature adquates
(cuisson, pasteurisation, appertisation) ;
- le respect de la chane du froid ;
le schage (dont laction vise rduire lAw des aliments et ainsi inhiber la
croissance bactrienne), lexploitation du pH ou le conditionnement sous vide
6
;
la matrise des approvisionnements, cest--dire lassurance de disposer de
matires premires/de denres peu contamines (lobtention de la part des
fournisseurs et des transporteurs, des preuves quils matrisent effectivement la
contamination par les micro-organismes) ;
le nettoyage et la dsinfection, qui permettent dliminer ou de rduire les
niveaux de contamination microbienne ;
la conception et la gestion des installations qui vitent la contamination croise
entre produits bruts ( sales ) et produits finis ( propres ).
Pour matriser les virus
Pour rappel, les virus dorigine alimentaire
peuvent, provenir de leau ou des aliments
contamins par des humains, des animaux
ou lenvironnement.
Contrairement aux bactries, les virus sont
incapables de se reproduire en dehors dune
cellule vivante. Ils ne peuvent donc pas se
multiplier dans les aliments, ce dernier
ntant quun vecteur inanim.
6
Deux phnomnes jouent dans ce cas : (1) inhibition des bactries arobies par absence
doxygne ; (2) suivi dune slection des bactries lactiques, aptes se dvelopper en
anarobiose, dont les mtabolites acidifient le milieu et inhibent la croissance dautres micro-
organismes du fait dune diminution du pH. De manire gnrale, lacidification des produits ou
l'addition de sel inhibent la croissance des micro-organismes.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
62
Les mesures de matrise seront donc essentiellement :
un traitement thermique : les mthodes de chauffage ou de cuisson telles que la
cuisson la vapeur, la friture ou la cuisson au four peuvent dtruire la plupart
mais non la totalit des virus (le type de virus dtermine la mthode de matrise
appliquer) ;
des pratiques hyginiques du personnel, en particulier lexclusion des travailleurs
atteints de maladies virales, comme lhpatite.
Pour matriser les autres parasites
Outre la matrise des approvisionnements, les mesures de matrise peuvent tre :
le chauffage, le fumage, le schage et la conglation ;
le salage ou le saumurage.
2.1.5. Gnralits sur la matrise des dangers chimiques
Certaines substances chimiques, dorigine naturelle (ex. : mycotoxines, alcalodes,
allergnes) ou de synthse (ex. : pesticides) peuvent prsenter un risque si elles se
trouvent des concentrations inacceptables (suprieures aux limites maximales fixes)
dans le produit.
Lorsque les autorits ont tabli des limites maximales (LM ou LMR) dans une denre,
le danger en question devient automatiquement pertinent pour ce produit.
En matire de gestion des risques associs ces substances, on peut grossirement
distinguer deux cas de figure
7
:
1. Soit le produit rcolt apport la station est contamin au champ, la rcolte
ou pendant le transport. La contamination peut venir du sol lui-mme, de
lenvironnement (pollution) ou provenir des oprations culturales et des pratiques
phytosanitaires. Cest notamment le cas des rsidus de produits phytosanitaires.
2. Soit le produit conditionner est contamin pendant les oprations qui
suivent la rcolte (graisses/lubrifiants prsents sur les machines et bandes
transporteuses, dsinfectants, dtergents, fongicides appliqus en post-rcolte,
soufrage des fruits, etc.).
7
Dans la pratique, ce nest pas toujours aussi tranch : ainsi, certaines mycotoxines peuvent
apparatre dj avant la rcolte, lors du dveloppement dun champignon au champ, alors que
dautres ne se formeront que durant le stockage. Des produits phytosanitaires sont utiliss
avant mais aussi aprs la rcolte.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
63
Application dengrais chimiques.
Sans appareil de mesure, le dosage
est alatoire !
(Photo AFD)
Les principales mesures de matrise porteront sur :
la matrise des approvisionnements en matire premire : tablissement de
spcifications pour ces matires premires, ainsi que pour tous les ingrdients
susceptibles dtre employs (engrais, pesticides, amendements du sol,
dsinfectants et autres biocides, dtergents, ), traabilit et tenue de registres
lors de lemploi des intrants, formation du personnel ;
lexigence dun systme de certification du fournisseur et du transporteur qui
garantit que les produits livrs ne contiennent pas de contaminants chimiques
dangereux ;
la matrise des procds de conditionnement : matrise des oprations de post-
rcolte (lavage, traitements), utilisation approprie des additifs et de leur
concentration ;
lutilisation de matriaux de transport et demballage accepts pour la
manipulation des denres alimentaires (viter les migrations) ;
la sparation des produits de qualit non alimentaire (dont les sous-produits et
les dchets) pendant le stockage et la transformation ;
la surveillance des risques de contamination accidentelle (dtergents, graisses,
lubrifiants, encres, produits de traitement de leau dusage courant ou de
chaudire, peintures, etc.) ;
la matrise de ltiquetage (sassurer que le produit est correctement tiquet en
citant les ingrdients et les allergnes).
2.1.6. Gnralits sur la matrise des dangers physiques
La prsence de corps trangers (pierres, morceaux de verre, mtal, clat de bois,)
dans les aliments peut rsulter de la contamination accidentelle et/ou de mauvaises
pratiques.
En identifiant les principales sources de risques physiques dans les aliments, on peut
plus facilement imaginer les mesures de matrise appropries :
le verre : les sources courantes, dans les tablissements de transformation des
aliments, sont les ampoules et les contenants de verre pour la nourriture ou
autres ;
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
64
le mtal : les sources courantes de mtal sont les fragments venant de
lquipement (clats, lames, aiguilles casses, morceaux dustensiles uss,
agrafes, etc.) ;
les plastiques : les sources courantes sont le matriel demballage, les gants
ports par les employs, les ustensiles utiliss pour nettoyer lquipement ou les
outils qui servent retirer les produits transforms des machines ;
les pierres : les plantes de grande culture, comme les petits pois ou les haricots
par exemple, sont susceptibles de contenir des petites pierres ramasses
pendant la rcolte. Les pierres peuvent aussi provenir des structures et des sols
de bton de ltablissement ;
le bois : clats venant de structures et de palettes de bois utilises pour
lentreposage et le transport des ingrdients ou des produits.
Les exemples suivants reprsentent des cas de mesures de matrise des dangers
physiques (Agence canadienne dinspection des aliments - ACIA) :
en inspectant les ingrdients et les denres brutes pour voir sils ne contiennent
pas de contaminants venant des champs (comme par exemple de petites
pierres) qui auraient chapp linspection larrive ;
en prcisant les caractristiques attendues de tous les ingrdients et
composantes utiliss, y compris les denres brutes et les matriaux demballage
(ex. : le carton recycl utilis pour les emballages contient parfois des traces de
mtal), et en indiquant les mesures de contrle tablies.
en installant des dtecteurs de mtal ou des aimants permettant de dceler les
fragments de mtal dans la chane de production et des filtres ou des grilles
permettant dextraire les corps trangers la rception. Les dtecteurs de mtal
doivent tre rgls et tre bien entretenus pour rester prcis et ne pas donner de
faux positifs ;
en matrisant lenvironnement : sassurer que les bonnes pratiques de fabrication
sont appliques et quaucune contamination physique ne provient des btiments,
des installations, des salles de travail ou de lquipement. Adopter de bonnes
habitudes dentreposage, valuer les risques qui peuvent exister dans les zones
dentreposage (sources de verre cassable, comme les ampoules, ou agrafes sur
les cartons, etc.) et utiliser des couvre-ampoules et des couvre-lampes de
protection en acrylique ;
en entretenant correctement et rgulirement lquipement afin dviter les
sources de risques physiques, telles les machines uses.
en organisant priodiquement des sances de formation du personnel en matire
dexpdition, de rception, dentreposage et de manutention, ainsi que dentretien
et dtalonnage de lquipement.
Exemple dun dtecteur de mtal
utilis en industrie
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
65
2.2. Exigences et mesures de matrise
en production primaire
En production primaire, les principaux dangers pour la sret des fruits et lgumes frais
concernent lutilisation des pesticides, ainsi que lhygine du personnel, du matriel
de rcolte et de transport des produits vers la station de conditionnement. Dautres
facteurs comme la prsence de mtaux lourds dans le sol, lirrigation, la pollution ou la
fertilisation peuvent tre aussi source de dangers.
2.2.1. Implantation et caractristiques du site
Contamination
des produits
par :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Les pesticides
rsiduels du sol
Ne pas utiliser une terre que
lon sait contenir des rsidus
de pesticides
Evaluation de lhistorique des
rcoltes prcdentes et de
lutilisation du site.
Procder une analyse du sol
avant toute plantation si on ignore
tout de lutilisation pralable du
site ou de cultures prcdentes.
Les mtaux
lourds
Ne pas utiliser une terre que
lon sait contenir des rsidus
de mtaux lourds.
Evaluation de lhistorique des
rcoltes prcdentes et de
lutilisation du site.
Evaluation de lhistoire des
rcoltes prcdentes et de
lutilisation du site.
Procder une analyse du sol
avant toute plantation si on ignore
tout de lutilisation pralable du
site ou de cultures prcdentes.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
De manire gnrale, il faut viter les zones pollues et dactivits industrielles
reprsentant une grave menace de contamination pour les aliments (rejets dans
latmosphre, risque de pollution par voie arienne), les zones sujettes aux
inondations (contamination par de leau souille), les zones constituant une source
potentielle dinfestation par des nuisibles (ex. : prsence de nombreux rongeurs
vecteurs de maladies ou de mouches) et les zones o les dchets, solides ou
liquides, ne peuvent tre efficacement vacus.
Le marachage pri-urbain ne rpond pas toujours ces exigences !
66
Les animaux,
oiseaux,
insectes ou la
vermine
Voir sil est efficace denclore
la zone de culture et dutiliser
des repoussoirs.
Envisager de refuser le site si le
problme ne peut tre limin.
Les eaux
dirrigation sales
Ne pas utiliser une terre o on
a eu recours des eaux uses
non traites.
Revoir les sources deau en
raison dune utilisation sur une
terre adjacente.
Envisager dutiliser des
mthodes dirrigation plus
sophistiques.
Prendre en compte des
facteurs comme la hauteur des
cultures par rapport au sol, les
cultures prtes consommer
ou cuire, peles ou non et
lintervalle qui spare
lirrigation de la rcolte.
Vrifier rgulirement les
sources potentielles de
dangers microbiologiques.
Evaluation de lhistoire des
rcoltes prcdentes et de
lutilisation du site.
Procder une analyse du sol
avant toute plantation si on ignore
tout de lutilisation pralable du
site ou de cultures prcdentes.
Effectuer une valuation des
risques de la source deau et de
la possibilit de contamination
fcale humaine et animale.
Changer la source deau si
ncessaire.
Prlever un chantillon deau et
enregistrer les rsultats des
analyses
(selon lOMS, norme minimale :
<1000 ufc/100ml pour les
coliformes fcaux)
Les eaux de
crue
Limiter la possibilit pour les
eaux de crue contamines
datteindre la culture, par
exemple avec des fosss.
Effectuer une valuation des
risques du site.
2.2.2. Emploi des fertilisants
Contamination
des produits
par :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Les fertilisants
chimiques
Appliquer les quantits
ncessaires pour respecter les
exigences des rcoltes.
Recommandations concernant
les engrais donnes par un
conseiller form.
Calibrer le pulvrisateur
engrais
Recommandations concernant les
engrais.
Fichiers des engrais.
Enregistrement des formations.
Fiches de calibrage.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
67
Les fertilisants
organiques
Ne pas appliquer directement
sur les cultures.
Maximiser lintervalle de temps
entre lapplication sur la terre
et la rcolte.
Composter pour rduire la
charge microbienne (le
compostage du fumier avant
application peut limiter
considrablement le
dveloppement des
pathognes).
La prsence danimaux
domestiques sur les sites de
production doit tre contrle,
voire interdite (exigences
requises dans certains
rfrentiels).
Rduire le ruissellement, le
filtrage ou la contamination
rpandue par le vent.
Assurer la conformit avec le
Code de pratique du client
pour lintervalle entre
lapplication et la rcolte.
Fiches dapplications. Garder le
code de pratique dans des
fichiers.
Fiches de parcelle.
Bien nettoyer lquipement aprs
contact avec les fumiers et avant
contact avec tous les produits.
2.2.3. Emploi des pesticides
Dans la gestion des pesticides, 2 facteurs doivent tre pris en considration :
1. Seuls les pesticides autoriss peuvent tre utiliss sur les cultures (ce sont
les seuls disposer en principe dune LMR). Le producteur doit en effet utiliser
uniquement des produits phytosanitaires homologus pour lusage souhait, car
ce sont ceux dont lefficacit vis--vis de la cible a t vrifie par des essais
multiples permettant de fixer : la dose, le mode demploi et le dlai avant rcolte
(DAR)
8
.
2. Les BPA (Bonnes Pratiques Agricoles) doivent imprativement tre
respectes pour que les rsidus de pesticides sur la denre soient
infrieurs la Limite Maximale de Rsidus (LMR)
9
. En labsence de LMR
nationales ou de lUE, ce sont les LMR du Codex Alimentarius qui sappliquent.
8
Les rfrentiels privs font obligation aux producteurs demployer uniquement les produits
homologus localement, mais ils imposent aussi le plus souvent (ex. : GLOBALG.A.P.) de
nutiliser que des substances actives autorises dans lUnion europenne.
9
Afin de prvenir le risque de non-respect des LMR, certains importateurs ou distributeurs
europens effectuent des analyses dans le pays de production avant lexportation et la
rception des lots. En cas de dpassement des LMR, limportateur et son fournisseur peuvent
se voir refuser des lots lors de prochaines livraisons (au Royaume-Uni notamment, ils peuvent
tre mis sur une black list).
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
68
Petit rappel sur les BPA et la LMR !
Une LMR (en mg de substance active par kg de denre)
reprsente le niveau maximum de rsidus du pesticide que lon
peut sattendre trouver la rcolte dans la partie comestible si
la Bonne Pratique Agricole est respecte comme il se doit. Les
LMR fournissent un moyen quantifiable de s'assurer quil ny a
pas dabus dans lutilisation des produits phytosanitaires.
La Bonne Pratique Agricole (BPA) est lie principalement :
lemploi de substances actives recommandes ;
la dose dapplication/ha (ou dose/hl) ;
le Dlai Avant Rcolte (DAR, exprims en jours) ;
le nombre (maximum) dapplications.
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Pas de fichiers
sur le lieu
dorigine des
produits
(important pour
le retrait des
produits et les
fichiers sur
lutilisation des
pesticides)
On doit pouvoir retracer
lidentit de chaque lot en
partant de la rcolte, de la
production et de la propagation
jusquau semis.
Garder les dossiers appropris
depuis lensemencement jusqu
la rcolte.
Absence de
dossiers
complets sur les
pesticides
Tous les dtails de
lapplication sur les rcoltes
doivent tre actualiss et
gards pendant 3 ans.
Sassurer que les dossiers
existent.
Risque de
culture
contamine par
les pesticides en
raison dun
mauvais dosage
et de mauvaises
pratiques
dapplication.
Seul le personnel rellement
qualifi sera charg
dappliquer les pesticides.
Raliser une formation.
Conserver les enregistrements de
formation du personnel.
Inspection des magasins.
Dossiers dapplication.
Risque
dappliquer les
mauvais
pesticides la
rcolte.
Sassurer quil existe une liste
jour approuve sur le plan
national et par le client sur le
plan commercial.
Liste des pesticides autoriss,
approuve, tenue jour et
disponible (mention de la dose
/ha et du dlai avant rcolte).
Remettre lexportateur la liste
dutilisation des pesticides
propose avant le dbut de la
saison.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
69
Risque de
culture
contamine par
les pesticides en
raison dun
pulvrisateur
mal calibr.
Appliquer le programme de
maintenance et de calibrage
du pulvrisateur.
Fiches des calibrages.
Contamination
de la rcolte par
leau sale
utilise dans la
solution
pulvrise.
Examiner les sources deau
sur les terres adjacentes.
Vrifier rgulirement les
sources potentielles de
dangers microbiens.
Entreprendre une valuation des
risques de la source deau pour
vrifier lventualit dune
contamination par matires
fcales ou animales.
Prlever un chantillon deau et
garder les enregistrements des
rsultats.
Contamination
de la culture due
un
emplacement
inappropri ou
la scurit du
stockage des
pesticides.
Lieu de stockage situ une
certaine distance des voies
deau.
Sassurer que lextrieur du
btiment est sain, sr et
protg par un muret.
Etagre fixe avec un
clairage et une ventilation
adquats.
Bon contrle des stocks.
Effectuer un audit rgulier des
btiments et du contenu.
2.2.4. Hygine la rcolte
Lhygine du personnel est particulirement
importante pour viter la contamination des
produits lors de la rcolte, notamment pour les
produits non lavs avant lexportation ou prts
tre consomms sans tre pels.
Il faut sensibiliser et former le personnel aux
bonnes pratiques dhygine individuelle, et
mettre sa disposition tout moyen lui
permettant de respecter ces bonnes pratiques.
Des preuves concernant lapplication de ces
bonnes pratiques peuvent tre demandes par
certains importateurs ou distributeurs europens.
Exemple de point deau pour se laver les mains
(Photo B. Schiffers)
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
70
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Contamination
par les bijoux, les
vtements et des
corps trangers
(excrments
danimaux
provenant du
fumier, cadavres
dinsectes, caillou,
etc.)
La collecte et le stockage des fruits
ou lgumes sur des palettes.
Nettoyer la terre et les dbris de
vgtaux qui peuvent adhrer aux
parois des cageots, cartons ou
caisses utiliss et de ce fait souiller
les produits.
Inspecter rgulirement les
rcipients utiliss pour la
manutention des fruits ou lgumes.
Les risques physiques peuvent
provenir des pices du matriel de
conditionnement ou des engins de
manutention qui peuvent tomber
dans les emballages. En effet, les
palettes et certains types
demballages (carton en bois)
contiennent des pices mtalliques:
clous, agrafes, liens, qui peuvent
se dtacher du support dans des
conditions anormales dutilisation.
Choisir des rcipients et du matriel
de nature rduire au minimum les
possibilits de dommages
physiques sur les produits.
Superviser le personnel sur le
terrain lors de la rcolte.
Assurer lutilisation de vtements
appropris.
Mise en place dune politique
concernant lusage du tabac, de la
nourriture et des boissons.
Offrir au personnel une
formation lhygine.
Sensibilisation du
personnel.
Contamination
microbienne des
produits par les
ouvriers agricoles
Raliser une formation approprie :
hygine personnelle et hygine
alimentaire de base.
Fournir des installations sanitaires
et des lavabos prs des ouvriers.
Etat de sant de louvrier, (avec
maladies infectieuses).
Prvoir des zones fumeurs
spares des produits.
Tenir des dossiers du
personnel.
Dossiers du personnel.
Dpistage mdical et
responsabilisation du
personnel.
Formation en matire
dhygine personnelle et de
comportement.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
71
Le personnel doit dclarer toute
maladie susceptible de se
transmettre par les aliments,
comme la jaunisse, la fivre ou la
diarrhe ou de blessures infectes
ou de problmes de peau,
dcoulement des yeux, des oreilles
et du nez.
Comportement personnel comme
cracher, ternuer et tousser au-
dessus des produits.
Bien recouvrir les
blessures, les corchures
et les plaies infectes.
Pansement bleu
comportant une bande
magntique.
Sensibilisation du
personnel.
2.2.5. Emploi des machines et quipements
Les machines et quipements
peuvent tre source de
contamination du sol ou des
produits (mtaux, huiles et
graisses, dbris divers), du fait
dun dfaut dentretien, dun
mauvais nettoyage ou par
accident.
Une maintenance, un nettoyage et
un entretien appropris des
machines sont les meilleurs
moyens de prvention.
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Contamination
par des fragments
de mtaux ou des
lubrifiants.
Sassurer que lquipement utilis
pour la rcolte est en bon tat
grce au programme de
maintenance.
Contrles rguliers,
programme de
maintenance et dossiers
dentretien.
Contamination
par le sol, le
verre, le
plastique, le bois
et les pierres.
Adapter les mthodes de rcolte
pour viter les contaminations.
Sassurer que les conteneurs sont
intacts et non endommags.
Inspecter et enregistrer les
conteneurs sur fiches.
Contamination
due un
quipement de
rcolte ou de
manutention sale
ou au transport.
Ne pas utiliser les remorques et les
conteneurs de la rcolte pour
transporter des fumiers. Les
remorques utilises pour
transporter les produits la station
demballage doivent tre couvertes.
Sassurer quun programme
de nettoyage est en place.
Vrifier le programme de
nettoyage.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
72
Contamination
des produits due
un quipement
de rfrigration
mal rgl ou mal
entretenu.
Assurer un programme rgulier de
maintenance.
Dossiers dentretien.
2.2.6. Stockage des produits avant transport ou expdition
Au cas o il est ncessaire de
stocker les produits sur
lexploitation, cela doit se faire dans
des conditions appropries. Il faut
viter en particulier de maintenir les
produits au soleil et une chaleur
excessive, au risque dune
dtrioration physique et
microbiologique.
En cas de stockage, il faut disposer
dinstallations de stockage
adquates (idalement des
magasins rfrigrs) et dune
procdure approprie de gestion
des stocks. Le nettoyage et
lentretien des aires et des magasins
de stockage est un lment
essentiel pour le maintien de
lintgrit des produits.
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Contamination
des produits due
un mauvais
entretien des
aires et locaux de
stockage.
Programme dentretien et de
maintenance.
Procdure de nettoyage.
Dossiers dentretien.
Equipement de
rfrigration mal
rgl ou mal
entretenu.
Programme dentretien et de
maintenance.
Contrle des tempratures.
Dossiers dentretien.
Enregistrement rgulier des
tempratures.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chambre de stockage provisoire
rfrigre (Photo B. Schiffers)
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
73
2.3. Exigences relatives au transport
Lors du transport, il faut limiter les
dangers pour la scurit des
produits aussi bien entre le champ
ou le verger et la station de
conditionnement, quentre le site
de conditionnement et le port ou
laroport dexpdition, jusqu
larrive au pays importateur.
Des dangers peuvent apparatre
lorsque les produits sont laisss
au soleil sur les routes, sur les
pistes daroport ou dans les ports
avant le dpart, ce qui peut
entraner un stress respiratoire et
une dtrioration des produits.
Une contamination peut aussi apparatre lors du transport, par le conteneur ou un
mlange avec dautres marchandises transportes en mme temps ou prcdemment.
Si lentreprise sous-traite le transport, il faut tablir un accord crit concernant : ltat
dhygine du vhicule, la possibilit de mettre les produits labri, lassurance dviter la
contamination par dautres marchandises transportes en mme temps ou transportes
prcdemment, et si possible lassurance de la matrise de la temprature dans les
vhicules pendant la dure du transport.
Si les produits sont en bon tat lorsquils sont chargs dans un conteneur scell,
temprature contrle avec un quipement en bon tat et que laccs en est restreint, il y
a peu de possibilit de contamination externe et de dtrioration des produits.
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Dtrioration des
produits en raison
dune mauvaise
matrise des
tempratures.
Sassurer que les quipements de
contrle de la temprature ont t
bien calibrs et rgulirement
entretenus.
Sassurer que les produits sont
correctement chargs pour
permettre la circulation dair frais
autour du chargement et viter la
formation de points chauds.
Enregistrement et suivi de
la temprature.
Dterminer un volume
maximum de chargement.
Contamination
par les
chargements
prcdents.
Inspecter le vhicule avant le
chargement.
Nettoyage en profondeur si
possible.
Refuser le vhicule.
Preuve du nettoyage.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
74
Contamination
par dautres
substances lors
de chargements
partags.
Voir avant le chargement si les
produits peuvent tre transports
avec une autre substance.
Etat des lments de
sparation entre les
diffrentes marchandises
transportes.
Contamination
due la prsence
de nuisibles.
Assurance du transporteur dune
absence de nuisibles.
Nettoyage adquat.
Preuve du nettoyage.
Contamination
par la poussire
et les diffrents
lments du
vhicule.
Limiter le nombre douvertures.
Lquipement doit tre maintenu en
bon tat pour viter que la peinture
ne scaille, viter la boue, lhuile la
graisse, la rouille ou les dbris de
produits.
Toutes les surfaces doivent pouvoir
se nettoyer facilement.
Calendrier de nettoyage.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
75
2.4. Post-rcolte : exigences relatives
au Milieu
2.4.1. Exigences gnrales relatives limplantation et
lorganisation gnrale dune station de conditionnement
10
Les exigences relatives aux zones viter sont globalement les mmes que pour les
champs ou les vergers. En outre, lapprovisionnement en eau et en nergie doit pouvoir
tre garanti en toute situation, par les rseaux dapprovisionnement et ventuellement
par des dispositifs de substitution propres aux tablissements (rservoirs deau, groupe
lectrognes, ), et activs en cas de ncessit.
Les principes gnraux respecter sont les suivants :
La marche en avant : les oprations de travail successives doivent assurer une
progression du produit vers l'avant sur la ligne de fabrication, sans retour en
arrire, du moins labor vers le plus labor, du moins sain vers le plus sain, du
moins fragile vers le plus fragile. Afin de ne pas pervertir cette rgle, les
oprateurs ne doivent pas se dplacer et sont tenus de se maintenir au poste de
travail auquel ils sont affects.
Le non-entrecroisement : les diffrentes files de production ne doivent pas
s'entrecroiser. Elles peuvent fusionner (assemblage de produits composs, mise
dans un conditionnement pralablement lav) ou se sparer (files de
transformation des sous produits obtenus au cours de la prparation du produit
principal).
La sparation de la zone chaude et de la zone froide : les zones o sont
traites les denres chaudes doivent tre clairement diffrencies des zones o
sont traites les denres froides, afin d'viter toute rupture de la chane du froid
par pollution thermique des denres froides.
La sparation du secteur sain et du secteur souill : les dchets produits
chaque tape de fabrication doivent pouvoir tre vacus immdiatement et le
plus directement possible vers les locaux consacrs leur traitement (plonges)
ou leur entreposage (local poubelle). Pour certains tablissements, la solution
alternative de sparation dactivits incompatibles, dans le temps plutt que dans
lespace, peut aussi tre prise en compte.
Lapprovisionnement en eau potable : les circuits deau potable et non potable
(rseau incendie, production de vapeur, circuits de refroidissement, ) doivent
tre clairement spars et identifis (couleur des tuyaux).
Les rgles de construction sont applicables tous les locaux y compris ceux
qui sont consacrs lentreposage des denres alimentaires : elles concernent
les matriaux employs, les locaux, lagencement des locaux, lamnagement
10
In BTSF (2010), les recommandations dorganisation des tablissements.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
76
des locaux, le nettoyage et la maintenance des locaux. Ces exigences seront
dtailles plus loin.
Lamnagement et lagencement des locaux de la station sont des facteurs importants.
Il faudrait au moins disposer des espaces suivants :
1. de sanitaires (toilettes et postes de lavage des mains) ;
2. de vestiaires ;
3. dune zone de rception des produits ;
4. dune zone de traitement des produits (tri, contrle qualit, lavage, calibrage,
emballage) ;
5. dune zone de stockage des emballages ;
6. dune zone de stockage ou dentreposage (rfrigre) ;
7. dune zone pour les dchets ;
8. de magasins pour stocker les intrants ;
9. de bureaux, laboratoires, etc. spars.
2.4.2. Btiments et constructions
Par leur agencement, leur
conception, leur construction
et leur dimension, les locaux
doivent permettre la mise en
place de bonnes pratiques
d'hygine et notamment
prvenir toute
contamination des denres
alimentaires.
(Photo B. Schiffers)
Les surfaces (sol, murs, plafonds) doivent tre bien entretenues et en bon tat, tre
faciles nettoyer et/ou dsinfecter. Elles doivent tre en matriaux durs, non
absorbants, lavables et non toxiques.
Les locaux, y compris les installations sanitaires, doivent tre suffisamment ventils.
Tout flux dair dune zone sale vers une zone propre doit tre vit.
Les plafonds doivent tre conus, construits et entretenus de manire empcher
lencrassement, la condensation, lapparition de moisissures ou laccumulation de
particules.
Des clairages scuritaires sont utiliss (avec protection plastique ou gaines afin que
les clats de verre restent dans larmature de protection), mais ils ne sont obligatoires
que lorsquil y a un rel danger de contamination du produit, cest--dire lorsque
lclairage fixe est directement install au dessus des produits vgtaux rcolts.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
77
Remplacer vitres, lampes, miroirs. casss (briss, fls).
Toutes les ouvertures (portes, fentres,) restent fermes et sont pourvues de
dispositifs empchant lentre des nuisibles (insectes, rongeurs, oiseaux,
animaux,).
Les btiments de stockage et de conditionnement sont suffisamment loigns des
dpts dordures, de dbris et des dchets (ex. : carts de tri).
Lorsque des citernes de carburant se trouvent sur le site de production, de
transformation et/ou de stockage, il faut une distance suffisante entre la citerne et les
produits primaires (au moins 4 mtres ou une sparation physique).
Sanitaires : toilettes et postes de lavage des mains
- Il est essentiel de disposer de toilettes et de poste de lavage propres et bien
entretenus pour promouvoir lhygine et la propret du personnel et ainsi rduire les
risques de contamination des fruits et lgumes, notamment dus au pril fcal.
- Les locaux doivent avoir des toilettes en nombre suffisant. Elles doivent tre
quipes dune chasse deau et raccorde un systme dvacuation efficace des
eaux uses. Ces toilettes doivent tre maintenues en permanence en bon tat de
propret.
- Les toilettes et urinoirs ne peuvent pas communiquer directement avec les locaux de
travail. Ils doivent tre situs suffisamment loigns de la zone de manipulation des
produits mais ils doivent tre agencs de manire en faire un passage oblig pour
que le personnel puisse se laver les mains de manire systmatique avant de
commencer le travail, chaque absence de la ligne de conditionnement ou aprs
tre all aux toilettes.
- Dans les toilettes ou aux abords immdiats doit se trouver un lavabo aliment en eau
chaude et froide, et le ncessaire pour se laver et scher les mains de manire
hyginiques (serviettes en papiers). Les toilettes et les postes de lavage des mains
doivent tre nettoys priodiquement.
- Lemploi dun sche-mains pulsion dair est interdit dans les locaux o se trouvent
des denres non emballes ou non protges.
Postes de lavage des mains (Photos B. Schiffers).
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
78
Vestiaires
- Il faut interdire au personnel
de boire, de manger ou de
fumer dans les zones de
travail.
- En outre, les employs ne
doivent pas amener leurs
effets personnels (bijoux,
montre, monnaie, ) dans la
salle de conditionnement.
- Pour faciliter le respect de ces
mesures, il faudrait amnager
des vestiaires dans la station
et prendre des dispositions
pour que les travailleurs
puissent garder en toute
scurit leurs affaires, dans
des placards, armoires ou casiers
fermant cl.
- Les travailleurs peuvent sorganiser en quipe pour partager les infrastructures
dfaut dinstallations en nombre suffisant.
Zone de rception des produits
- Il est essentiel que les
btiments, quipements et
aires de conditionnement
soient propres et bien
entretenus.
- A ce titre, il faut veiller ne
pas contaminer les aires de
conditionnement par des
matires contaminantes
provenant des champs au
moment de la rception des
cageots de rcoltes.
- Il est conseill daffecter
une partie de laire de
rception au nettoyage des
palettes et des rcipients
utiliss pour le transport des
produits frais. Il faut dbarrasser les palettes, les cageots, des dchets animaux et
vgtaux qui peuvent tre prsents leur surface.
- Cette zone de rception des rcoltes peut galement tre utilise pour procder
lidentification des lots en fonction de la provenance des livraisons, dans le cadre
du suivi de la traabilit.
- Les zones de rception des fruits frais sont nettement spares des aires de
stockage des produits finis (cartons).
- Les zones de rception ont une dimension suffisante pour abriter lensemble des
produits et les protger de la pluie et du soleil.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
79
- Elles ont suffisamment dclairage naturel ou artificiel pour faciliter lexamen visuel du
stock et reprer les infestations.
- Afin dviter une contamination croise, aucun contenant ou poubelle pour dchets
de fruits et lgumes ou dchets alimentaire ne peut se trouver dans les aires de
stockage.
- Des mesures adquates sont prises dans les aires de stockage afin de repousser ou
dliminer les nuisibles (pigeages, trappes). Les appts de lutte contre les nuisibles
sont protgs pour viter toute contamination des produits.
Une zone de triage et de prparation des produits
- Aprs la rception et
lidentification des lots, les
produits doivent tre achemins
dans la zone de traitement pour
des oprations de tri, de
contrle qualit, de pese, de
lavage, de calibrage, et
demballage en suivant le
principe de marche en
avant .
- En effet, pour rduire les risques
de contamination, il est
important de ne pas mlanger
les flux de produits
rceptionns (produits bruts)
aux flux de produits
conditionns (produits finis).
- Un marquage au sol et/ou des
panneaux de signalisation
peuvent tre utiliss pour
matrialiser les zones et
sensibiliser le personnel.
- Elle doit tre loin du stockage
des ordures, dbris et dchets.
- Elle a suffisamment dclairage
naturel ou artificiel pour faciliter
lexamen et reprer les
infestations.
- Des appts protgs ou toute
autre forme de moyens de lutte
contre les nuisibles (piges)
doivent tre placs dans les
locaux de transformation et/ou
de conditionnement.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
80
Zone de stockage ou dentreposage des produits tris
- Pour respecter le principe de
la marche en avant, la zone
de stockage ou
dentreposage doit tre situe
juste aprs la ligne de
conditionnement.
- Elle doit tre amnage en
fonction des consignes de
temprature et dhumidit
dfinies pour la stabilit et la
bonne conservation des
produits frais.
- Le stockage ou lentreposage
est gnralement fait en
chambre froide. Le
responsable de la chambre
froide doit alors observer deux
principes :
1. Regrouper les produits par catgorie de fruits et lgumes et par lots : pour
assurer la traabilit des produits en fonction des lots, il est essentiel de ne pas
les mlanger au moment de lentreposage.
2. Placer les premiers lots de produits rceptionns devant et les derniers derrire
et tenir compte si possible du planning prvisionnel dexpdition. Les produits
frais tant prissables, il faudrait raccourcir autant que faire se peut la
dure de leur entreposage. Des couloirs de circulation doivent tre rservs
pour pouvoir procder lenlvement des produits.
Locaux de stockage des engrais et des pesticides
11
- Il est interdit de stocker des engrais ou des produits phytosanitaires proximit du
produit. Ils doivent tre rangs dans des locaux spars, ferms cl et non
accessibles aux personnes non comptentes et aux enfants.
- Les locaux de stockage des engrais ou des produits phytosanitaires ne peuvent pas
communiquer directement avec les locaux.
- Ils doivent comporter un seuil et tre conus pour empcher tout coulement ou fuite
de produit vers lextrieur du local.
- A dfaut utiliser des coffres ou des armoires fermes cl, et places hors des
locaux de transformation, de conditionnement ou de stockage des produits.
- Les engrais solides peuvent tre conservs en vrac dans un espace propre et sec.
Cet espace aura un sol dur (en aucun cas, il ne peut y avoir de risque de pollution
des nappes phratiques).
- Locaux labri de la pluie et secs.
- Bonne ventilation : prvoir une ouverture grillage pour la ventilation.
- Ils ont suffisamment dclairage naturel ou artificiel pour faciliter lexamen visuel du
stock et reprer les fuites.
- Pas de bureau dans les locaux de stockage.
11
Pour plus de dtails, voir Manuel n 4 du PIP.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
81
2.4.3. Nettoyage et dsinfection des locaux
Le nettoyage
Le nettoyage est l'opration qui consiste liminer les salissures afin dassurer la
propret, lhygine, lesthtique et la maintenance prventive des revtements et des
btiments, selon des procds mcaniques et/ou chimiques (rendre une surface
visuellement propre).
4 facteurs sont indispensables un nettoyage efficace : la temprature (de leau), le
temps daction (dure de contact), laction mcanique (selon lintensit), laction chimique
(selon la concentration).
Le nettoyage est ralis laide de produits dtergents (autoriss)
12
, choisis en fonction
des souillures et des surfaces nettoyer. Les dtergents peuvent tre diffrencis en
fonction de leur pH. On rencontre des dtergents acides, neutres et alcalins.
Quelles salissures ? Exemples frquents Quel pH ?
Salissures dorigine organique
(salissures animales,
vgtales ou humaines : huile,
graisse, vin, sang, urine, )
Dpts frais de protines
et graisses
Bon dgraissant,
pH entre 6 et 8
Graisses cuites
Dgraissant alcalin,
pH entre 9 et 12,5
Cambouis, huiles
mcaniques, graisses
carbonises,
Dgraissant trs
alcalin,
pH entre 13,5 et 14
Rsidus trs sucrs
Dtergent acide,
pH < 6
Salissures dorigine minrale
(tartre, ciment, pltre, rouille).
Elles forment une pellicule sur
les surfaces.
Tartre (calcaire)
Dtergent acide,
pH < 6
12
La directive europenne biocides (98/8/CE) impose que les produits dsinfectants et
insecticides mis sur le march et destins l'agro-alimentaire soient homologus.
L'homologation des dsinfectants pour le traitement des locaux et matriels de rcolte,
transport et stockage des produits d'origine animale et/ou produits d'origine vgtale
(POA/POV) est gnralement obligatoire dans toute l'industrie agro-alimentaire.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
82
Chlore + Acide Dgagement de gaz toxiques !
(ex. : Javel + Dtergent acide)
Alcalin + Acide Perte defficacit ! (neutralisation)
La qualit de leau, notamment sa duret
13
, joue galement sur lefficacit du
nettoyage :
une eau trop dure (au-del de 35 degrs de duret) peut altrer lefficacit des
produits (do linstallation dadoucisseurs deau) ;
une eau trop douce rend le rinage difficile.
La dsinfection
Cest une opration qui vise rduire provisoirement le nombre total de germes
vivants et dtruire les germes pathognes (opration diffrente dune strilisation qui
vise lobtention dun milieu totalement exempt de germes).
13
Pour rappel, la duret est lindicateur de la minralisation de leau. Elle est surtout due aux ions
calcium et magnsium. La duret sexprime en mg/L de CaCO
3
ou en degr franais.
REGLES GENERALES DE SECURITE POUR LE NETTOYAGE
Former le personnel aux oprations de nettoyage et de dsinfection.
Porter des vtements non lches, adapts aux produits utiliss (qui
peuvent tre mordants, agressifs pour la peau et les yeux) pour viter
les accidents.
Ne pas mlanger les produits de nettoyage !
Ne pas transvaser les produits dans des bidons sans tiquette.
Ne pas entrer dans les chambres froides pendant la dsinfection.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
83
Cette opration est ralise laide de produits dsinfectants (biocides), autoriss pour
cet usage, et choisis en fonction des types de microorganisme liminer et des surfaces
nettoyer.
Il existe 5 activits diffrentes regroupes sous le terme de dsinfection :
Bactricide : Produit qui tue les bactries
Levuricide : Produit qui tue les levures
Fongicide : Produit qui tue les champignons (levures et moisissures)
Sporicide : Produit qui tue les spores bactriennes
Virucide : Produit qui inactive les virus
Ainsi un dsinfectant peut n'tre que bactricide, alors qu'un autre sera la fois
bactricide, fongicide et virucide.
Le rsultat de l'opration de dsinfection est limit aux micro-organismes prsents au
moment de lopration : la dsinfection n'empche pas les recontaminations
ultrieures, c'est pourquoi elle doit tre renouvele rgulirement !
Pour tre autoriss en usage alimentaire, les produits
dsinfectants utiliss doivent rpondre la norme
europenne NF EN 1276 Mars 2010
14
.
Il sagit dune norme d'application qui prcise les
conditions d'efficacit du dsinfectant (dose
d'application, etc.) pour un usage donn.
Plan de nettoyage des locaux
- Il y a ncessit de dfinir et dappliquer un plan de nettoyage et de dsinfection
adapt aux locaux et aux risques identifis.
- La frquence, lentretien et les produits autoriss pour le nettoyage (salles de
conditionnement) sont indiqus dans le plan de nettoyage des locaux :
nettoyage quotidien du sol en insistant sur les zones les plus sales ;
nettoyage et dsinfection hebdomadaire minimum des tapis et zones de
contact avec les fruits ;
entretien rgulier des murs, cloisons et portes au minimum 2 fois par an.
- Les locaux doivent tre propres et bien entretenus. Les aires dentreposage doivent
tre dgages en permanence de tout objet inutile et dbarrasses de tous dbris et
de toutes salets visibles. Les carts de tri, les dchets, les produits abms et
pourris doivent tre rgulirement enlevs des locaux. Les excrments
danimaux sont interdits dans les locaux.
- Eviter autant que possible les gaz dchappement dans les locaux. Il faut veiller ce
quun minimum de gaz dchappement nentre lors de la rception des produits.
14
Norme NF EN 1276 mars 2010 (antiseptiques et dsinfectants chimiques - essai quantitatif de
suspension pour l'valuation de l'activit bactricide des antiseptiques et des dsinfectants
chimiques utiliss dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines
domestiques et en collectivit).
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
84
Nettoyage et dsinfection des chambres froides
Le nettoyage et la dsinfection des
chambres froides (sol, murs) doivent tre
raliss une frquence rgulire et
adapte (ex. : 2 fois par an).
Plusieurs procds sont envisageables pour
dsinfecter les locaux de stockage.
Les techniques de fumigation, brumisation
ou thermonbulisation permettent au
produit dsinfectant datteindre des zones
peu accessibles et assurent simultanment
la dsinfection des parois, des vaporateurs
et de latmosphre.
La ventilation favorise une bonne rpartition.
Certains produits sont homologus pour une
utilisation en prsence des emballages.
Risques lis au nettoyage et la dsinfection
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Contamination
des produits par
les solvants de
nettoyage, les
dtergents, les
biocides
Tous les produits chimiques de
nettoyage doivent tre compatibles
avec une utilisation alimentaire.
Lister les produits autoriss.
Former le personnel.
Contrler ltiquette des
produits.
Conserver les fiches de
scurit.
Liste des produits autoriss
lemploi dans lentreprise.
Odeurs et
infection par
dautres produits
alimentaires,
dsinfectants,
manations
Tous les produits chimiques de
nettoyage doivent tre compatibles
avec une utilisation alimentaire et
ne doivent pas tre parfums.
Certains produits alimentaires vont
dgager une odeur.
Les produits chimiques doivent tre
stocks loin des produits
alimentaires.
Contrler les tiquettes des
produits.
Sparer tous les produits
chimiques des produits
alimentaires.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
85
2.4.4. Lutte contre les nuisibles
Tous les nuisibles, les oiseaux, les rongeurs et les insectes, sont des vecteurs potentiels
de contamination microbienne des fruits et des lgumes frais. Les problmes poss par
les nuisibles peuvent tre combattus en prenant les prcautions suivantes :
1. Mettre en place un programme de contrle des nuisibles :
Un programme de contrle des nuisibles doit tre mis en place dans toutes les
installations. Cest un lment essentiel pour combattre le risque de contamination
pos par les animaux, tels les rongeurs. Pour garantir son efficacit, ce programme
doit inclure des visites rgulires et frquentes des endroits susceptibles
dinfestation.
Un carnet de contrle permet de consigner les dates dinspection, les rapports ainsi
que les mesures prises pour corriger chaque problme. Un programme de contrle
des nuisibles doit aussi inclure de frquentes visites des endroits infests et traits
pour valuer lefficacit de la technique de protection ou dradication employe.
2. Maintenir les lieux bien entretenus :
Aucune ordure ni rsidu ne devrait traner aux environs immdiats des aires de
conditionnement. Les surfaces couvertes dherbes dans lesquelles certaines
espces de nuisibles, comme les rongeurs ou les reptiles, peuvent se reproduire, se
nicher ou se nourrir, devraient tre fauches ou tondues.
Il faut dgager des lieux tout accessoire et tout matriel inutile, obsolte ou en
panne, afin dviter que les rongeurs, les reptiles et les insectes ne sy logent. Les
restes de fruits ou de lgumes rcolts pouvant attirer les nuisibles doivent tre
limins chaque jour des aires de traitement et de stockage de mme que de leurs
abords.
Un bon drainage du sol permet de mieux contrler la reproduction et la multiplication
des nuisibles.
LES 7 REGLES DOR DE LA LUTTE CONTRE LES RONGEURS
1. Utiliser des produits spcifiques contre les rongeurs observs.
2. Disposer les appts tous les 5 10 mtres le long de murs ou dans
les angles. Ne pas dposer dappts sur les lieux de djection
(laisser au moins, un mtre de distance). Dposer les appts au ras
du sol afin quils ne puissent pas tomber sur des aliments.
3. Traiter en bote dappt : les rongeurs tant peureux, les appts
seront de prfrence disposs dans des botes leur permettant de
consommer davantage.
4. Traiter tous les locaux susceptibles dhberger des rongeurs ainsi
que les abords du btiment.
5. Traiter tous les locaux sauf ceux de fabrication.
6. Nettoyer les locaux
7. Nourrir jusqu arrt de la consommation.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
86
La matrise des nuisibles doit tre effectue par des professionnels.
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Contamination
par les nuisibles
Les btiments doivent tre conus
de faon viter linvasion des
nuisibles.
Les portes doivent rester closes en
dehors des dplacements.
Il est prfrable davoir la fois des
portes extrieures et intrieures.
Utiliser des crans traits contre les
insectes lorsque les fentres
doivent rester ouvertes.
Vrifier quil ny a pas de nuisibles
aux points dvacuation des eaux
uses.
Il ne doit y avoir ni dchets ni
herbes ni dtritus sur le terrain
autour de la station demballage.
Fiches de dratisation par
un professionnel.
Contamination
par les matires
fcales ou les
organismes morts
Les produits ne doivent pas tre
mis sous les perchoirs des oiseaux.
Recours aux services dun
professionnel connu de la
dratisation moins quune
comptence suffisante nexiste
linterne.
Contrats dintervention
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
87
2.5. Post-rcolte : exigences relatives
la Main doeuvre
2.5.1. Mesures gnrales relatives lhygine du personnel
Pour combattre les risques de contamination microbienne, lhygine et la propret
corporelle du personnel sont des facteurs dterminants. Sils ne connaissent pas les
rgles dhygine indispensables, les employs peuvent involontairement contaminer les
fruits et lgumes frais (contamination directe), les ressources en eau, le matriel utilis ou
les autres travailleurs, et propager ainsi des micro-organismes pathognes.
Propret corporelle et tenue du personnel
Les employs qui travaillent au
niveau de la station, doivent
avoir une bonne hygine
corporelle et porter une tenue
propre.
Une bonne hygine protge le
travailleur des maladies tout en
rduisant le risque de
transmission aux fruits et
lgumes frais dagents
pathognes, qui pourraient
sinon infecter un grand nombre
de consommateurs.
Les rcents cas dintoxication alimentaire lis la consommation de fruits et de
lgumes frais ont souvent eu pour origine une contamination par des matires
fcales. La priorit doit donc tre accorde aux pratiques dhygine lmentaire
telles que le port dune tenue propre et le lavage rgulier des mains !
Par ailleurs, les employs atteints de maladies infectieuses, de troubles de sant
accompagns de diarrhes ou de lsions ouvertes sont une source dagents
pathognes.
Selon la sensibilit du produit, la tenue sera
adapte : tablier ferm jusquau col, charlotte (pour
couvrir les cheveux), bottes, gants, etc.
(Photo B. Schiffers)
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
88
Importance du lavage des mains
Lemploy doit se laver les mains
lorsquil manipule des fruits et lgumes
frais ou tout autre matriel entrant en
contact avec ceux-ci.
Avant de commencer des activits
dans lesquelles il doit manipuler des
fruits et lgumes, il doit se laver les
mains chaque fois quil retourne aux
aires de manutention aprs une
pause, immdiatement aprs avoir
utilis les toilettes et aprs avoir
manipul tout produit contamin
Il est primordial que les employs se
lavent soigneusement les mains avant
de commencer le travail et aprs tout
passage aux toilettes.
Bien des agents pathognes lorigine dintoxications alimentaires peuvent tre les htes
du tractus intestinal et se retrouver dans les matires fcales. En gnral, les travailleurs
ne savent pas comment se laver les mains correctement. Il faut leur enseigner les
rgles suivantes :
Il faut se laver les mains leau.
Il faut utiliser du savon.
Le brossage (notamment sous les ongles et entre les ongles), le rinage et le
schage doivent tre soigneux.
Lutilisation de serviettes communes ou partages est dconseille.
PRINCIPALES REGLES DHYGIENE EN STATION
Ne pas fumer en station.
Porter une blouse, cheveux attachs, ongles courts et propres.
Lavage des mains systmatique aprs passage aux toilettes.
Lavage des mains aprs manipulation de matriels sales.
Avoir une tenue propre et correcte.
Eviter de tousser, dternuer au-dessus des produits alimentaires.
En cas de blessures aux mains, dsinfecter et porter un pansement
tanche.
Eviter les bagues, bracelets, montres.
Ranger le matriel sa place aprs usage et lavage.
Lavage des mains avant lentre en station
(Photo B. Schiffers)
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
89
Mesures relatives laccs aux locaux
- Loprateur et son personnel connaissent les mesures dhygine (port de tenue et
lavage des mains) et respectent lhygine gnrale de lentreprise.
- Les visiteurs et les employs sont informs des mesures dhygine au sein de
lentreprise et du secteur.
2.5.2. Comportement personnel
Le travailleur agricole doit viter les comportements risquant dentraner une
contamination des aliments, par exemple fumer, cracher, mcher de la gomme, manger,
ternuer ou tousser proximit daliments non protgs.
Les effets personnels tels que bijoux, montres ou autres objets ne doivent pas tre
ports ou introduits dans les aires de production des fruits et lgumes frais sils posent
une menace pour la salubrit et lacceptabilit des aliments.
Dans certaines circonstances, les gants jetables sont trs utiles en complment au
lavage des mains. Si des gants sont employs, il faudra viter quils ne deviennent
eux-mmes un vecteur de propagation des agents pathognes. Le recours aux gants
ne doit en aucun cas se substituer aux autres mesures dhygine indispensables comme
le lavage des mains.
Le travailleur agricole doit viter les comportements qui peuvent entraner une
contamination des fruits et lgumes, par exemple, fumer, cracher, manger, ternuer
directement ou proximit des produits non couverts. Les effets personnels tels que
bijoux, montres ou autres objets ne doivent pas tre ports dans les zones de production,
surtout en station.
Les mesures sanitaires applicables toute personne travaillant dans le secteur alimentaire
sappliquent galement ceux du secteur primaire.
Il faudrait galement sassurer que les visiteurs au niveau des champs et notamment de la
station de conditionnement, respectent les pratiques dhygine tables quand ils touchent
les fruits ou les lgumes frais.
2.5.3. Ltat de sant du personnel
Les personnes que lon sait ou
croit tre porteuses dune maladie
ou affection ne doivent pas tre
autorises pntrer dans une aire
de manutention des produits. Toute
personne se trouvant dans cette
situation doit immdiatement
informer la direction de la maladie
ou des symptmes.
Tenue de registres du personnel.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
90
Les employs atteints de troubles de sant accompagns de diarrhe ou de lsions
ouvertes (lsions cutanes ou plaies infectes) constituent des vecteurs de risques. La
personne ayant des coupures ou des blessures, doit se protger de manire viter tout
contact direct avec les produits. Une lsion purulente ou une plaie infecte peut au
contact des fruits et lgumes frais, ou des matriels utiliss pour leur rcolte, leur tri ou
leur conditionnement. Il faut mettre en place un programme de formation pour familiariser
le personnel dencadrement aux symptmes typiques de maladies infectieuses.
Quelques symptmes typiques de maladies infectieuses
Maladies Symptme
Virus de l'hpatite A Fivre, jaunisse
Salmonella typhi Fivre
Souches de Shigella Diarrhe, fivre, vomissement
Virus de Norwalk et apparents Diarrhe, fivre, vomissement
Staphylococcus aureus Diarrhe, vomissement
Streptococcus pyogenes Fivre, angine avec fivre
2.5.4. Formation du personnel
Lensemble du personnel
(chefs dquipe, employs
temps plein ou temps partiel,
de mme que les travailleurs
saisonniers) doit avoir une
connaissance pratique des
rgles sanitaires lmentaires,
chacun en rapport avec le
poste quil occupe.
Un programme de formation
doit tre dfini en rapport avec
les risques identifis.
Il faut former tout le personnel de lexploitation de bonnes pratiques sanitaires. En rapport
avec le poste quil occupe, chaque employ doit comprendre les risques de
contamination alimentaire poss par des pratiques insalubres et une mauvaise hygine
personnelle.
Il est important denseigner aux travailleurs comment se laver correctement les mains, ne
pas contaminer les ressources en eau ou propager des micro-organismes lorigine
dintoxications alimentaires.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
91
2.5.5. Synthse des mesures de matrise en rapport avec le
personnel
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Contamination
par les bijoux, les
vtements et des
corps trangers
Ne pas avoir de bijoux non ports
prs du corps dans la zone
demballage.
Mise en place dune politique
concernant lusage du tabac, de la
nourriture et des boissons.
Offrir des zones fumeurs spares.
Le systme de dtection des
mtaux doit tre en tat de
fonctionnement.
Enregistrement de la
formation lhygine.
Sassurer que le personnel
est au courant de la
politique.
Mise en place dune
signalisation.
Contamination
microbienne par
vtements sales,
mains sales,
habitudes non
hyginiques et
maladies
infectieuses
Tout le personnel (visiteurs
compris) doit se laver les mains en
entrant dans les zones demballage
et aprs utilisation des toilettes,
aprs avoir mang ou bu.
Fournir des toilettes et des
installations pour se laver.
Le personnel doit dclarer toute
maladie susceptible de se
transmettre par les aliments,
comme la jaunisse, la fivre ou la
diarrhe ou de blessures infectes
ou de problmes de peau,
dcoulement des yeux, des oreilles
et du nez.
Comportement personnel comme
cracher, ternuer et tousser au-
dessus des produits.
Porter des vtements propres dans
les zones demballage.
Le personnel doit pouvoir
montrer quil a reu une
formation.
La direction doit apporter la
preuve de lexistence des
fiches de formation.
Dpistage mdical et
rapport du personnel.
Hygine personnelle et
formation au comportement
appropri.
Bien recouvrir les
blessures, les corchures
et les plaies avec des
pansements tanches et
bande mtallique.
Sensibilisation du
personnel.
Sanitaires
Installer un nombre appropri de
toilettes pour les ouvriers et
sassurer quelles restent propres.
Sparer les toilettes des femmes
de celles rserves aux hommes.
Fournir savon, eau propre et
serviettes en papier.
Installer des robinets commande
fmorale, pdale ou piston pour
rduire les risques de
recontamination.
Programme de nettoyage.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
92
2.6. Post-rcolte : exigences relatives
au Matriel
2.6.1. Entretien des installations et des quipements
Tous les quipements de tri, de calibrage et de conditionnement peuvent propager des
germes pathognes aux produits avec lesquels ils sont en contact. Chaque jour, il faut
liminer la terre et les dbris de ces quipements. Il faut nettoyer et dsinfecter les
aires de conditionnement, les chanes de lavage, de tri, de calibrage et demballage. Les
accessoires, tels que les couteaux, scies, lames, bottes, gants, blouses et tabliers,
doivent tre nettoys et inspects rgulirement. Il faut les remplacer si leur tat
nautorise pas un bon nettoyage.
Les quipements doivent tre conus pour faciliter leur nettoyage. Ces facteurs ainsi que
le mode dutilisation des quipements peuvent contribuer rduire le risque de
contamination.
2.6.2. Exigences relatives lhygine des conteneurs
Hygine des conteneurs et emballages
Les conteneurs et les emballages entrant en contact avec les fruits et lgumes frais
doivent tre faits de matriaux non toxiques. Ils doivent tre conus et fabriqus de faon
en faciliter le lavage, la dsinfection et lentretien. Les exigences hyginiques
particulires chaque pice dquipement utilise doivent tre dtermines en rapport
avec les types de fruits ou de lgumes.
Quelques rgles gnrales qui doivent tre appliques aux conteneurs
Etablir un programme de nettoyage
des conteneurs et des emballages.
Utiliser un registre pour enregistrer
toutes les oprations de nettoyage et
dentretien effectus sur les
conteneurs et emballages.
Aprs dchargement, toujours
nettoyer les conteneurs, les bacs et
les rcipients utiliss pour viter
toute contamination croise des fruits
et des lgumes frais.
Inspecter les conteneurs et les
emballages pour vrifier leur odeur et
leur propret avant tout chargement.
Nettoyage des conteneurs au champ
(Photo B. Schiffers)
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
93
Tenir compte de la nature des derniers chargements effectus dans les conteneurs
avant des les utiliser pour une nouvelle cargaison. Sils ne sont pas nettoys entre
les diffrents chargements, les conteneurs ayant par exemple servis au transport de
produits non comestibles peuvent contaminer les fruits et lgumes frais.
Inspecter rgulirement les conteneurs et les emballages (caisses, cageots,
barquettes, ) pour vrifier sils sont endommags, car ; le cas chant, ils peuvent
constituer des rservoirs de germes pathognes et abmer la surface des fruits et
lgumes.
Rparer ou jeter les caisses et les cageots endommags. Les emballages qui ne
rpondent plus aux critres hyginiques devraient tre mis au rebut.
Protger les rcipients nettoys et les emballages neufs de toute contamination
durant leur entreposage. Tout matriel demballage doit tre protg de toute
contamination possible par les nuisibles comme les rongeurs, la salet,
Si les rcipients sont entreposs hors de laire de conditionnement, ils doivent tre
nettoys et assainis avant leur utilisation.
Les contenants destins aux dchets, aux sous-produits, et aux substances non
comestibles ou dangereuses doivent tre spcialement distingus.
Utiliser de palettes pour viter de poser les emballages mme le sol.
Si possible, viter dutiliser les mmes cageots pour des produits de natures
diffrentes pour rduire les risques de contamination croise. Au besoin, on peut
choisir un code couleur pour diffrencier les rcipients.
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Contamination
des produits par
les solvants de
nettoyage, les
dtergents, les
biocides
Tous les produits chimiques de
nettoyage doivent tre compatibles
avec une utilisation alimentaire.
Lister les produits autoriss.
Former le personnel.
Contrler ltiquette des
produits.
Conserver les fiches de
scurit.
Liste des produits autoriss
lemploi dans lentreprise.
Contamination du
conditionnement
et des matriels
demballage
Les matriels doivent tre stocks
dans des zones propres sans
poussire.
Tous les matriels demballage
doivent tre composs de matires
de qualit alimentaire.
Programme de nettoyage
des btiments.
Conteneurs salis
par une utilisation
inapproprie ou
labsence de
programme de
nettoyage
Sassurer que les conteneurs
utiliss ne le sont que pour un
produit donn.
Programme de nettoyage des
conteneurs.
Fiches des conteneurs.
Enregistrement des
nettoyages.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
94
Contamination du
bois des palettes
et botes
Essayer de ne pas utiliser de bois
non poli l o sont manipuls les
produits.
Les surfaces en bois doivent tre
recouvertes de peinture pour
permettre un nettoyage facile.
Inspections de routine.
2.6.3. Exigences relatives la matrise de la chane du froid
Il faut maintenir les
installations frigorifiques en
bon tat de fonctionnement.
Chaque jour, le matriel de
refroidissement doit tre
inspect, dbarrass de tous
dbris et nettoy si ncessaire.
Lensemble des installations
doit tre inspect rgulirement
pour dtecter une ventuelle
infestation par des nuisibles ou
une contamination dorigine
animale. Il faut sefforcer
dliminer toute source de
nourriture ou deau profitable
aux nuisibles.
Tout animal (ex. : oiseaux, souris) et tout insecte mort ou enferm dans les installations
doit tre enlev immdiatement pour maintenir les lieux salubres et pour viter dattirer
dautres nuisibles se nourrissant de ces espces. Supprimer le plus possible tous les
endroits dans lesquels les nuisibles peuvent se cacher ou se reproduire.
La maintenance des chambres froides est
indispensable (Photo B. Schiffers)
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
95
2.7. Post-rcolte : exigences relatives
la Matire
2.7.1. Qualit de leau
Dans le domaine agricole, leau sert de nombreux usages : irrigation, dilution des
pesticides, dispersion des engrais, lavage, nettoyage des installations,
Elle peut tre une source majeure de contamination directe ou indirecte et propager des
micro-organismes dans les cultures, sur des installations agricoles ou le long des filires
de transport. Toute eau au contact de fruits et lgumes est une source potentielle
dagents pathognes qui peuvent survivre sur les produits et menacer la sant du
consommateur. Plusieurs facteurs influencent la propagation des agents pathognes et
ainsi la possibilit dune intoxication alimentaire :
la nature de la rcolte,
le dlai dexposition leau contamine avant la rcolte,
les modes de manipulation des produits rcolts
Toutes les sources de contamination des eaux agricoles devraient tre recherches et
contrles. En pays ACP, cet exercice peut paratre difficile car les sources deau sont
variables (rseau de distribution, forages, eaux courantes, tangs, canaux dirrigation et
les canaux ouverts, lacs, rivires, puits).
Le degr de contamination de fruits ou de lgumes frais par de leau souille dpend la
fois de la provenance de cette dernire, de la manire et du moment de son utilisation,
de mmes que des caractristiques de la culture.
Les varits de large surface (comme les lgumes feuilles) ou de forme et de texture
(rugueuse, par exemple) favorisant lemprisonnement ou lattache des micro-organismes
sont plus susceptibles dtre contamines, surtout si le contact avec une eau a lieu peu
avant la rcolte ou au cours des tapes suivant la rcolte.
Pour mieux valuer la qualit des eaux sur leurs exploitations et pour choisir les mesures
de contrle des risques de contamination alimentaire, les exploitants devraient
slectionner les pratiques les mieux adaptes leur cas particulier pour atteindre
lobjectif de salubrit alimentaire recherch.
Contamination des eaux sur lexploitation
Les eaux de surface peuvent tre contamines de manire intermittente comme par le
lixiviat de fermes dlevage situes en amont, lentre du btail dans leau, le rejet des
sanitaires dans la pice deau,... Quant aux eaux souterraines, elles sont plus
vulnrables une contamination (fosse septique fissure, ). Dans la mesure du
possible, il faut essayer de rechercher et de matriser par des mesures adaptes, toutes
les sources de contamination possibles des eaux sur lexploitation. Plusieurs mesures
sont envisageables : construction de fosses septiques adaptes, ou installation de
systme de bio-puration des matires fcales, adoption de mthodes dirrigation
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
96
limitant ou vitant le contact entre de leau et les fruits et lgumes (ex. : viter
laspersion, lirrigation la raie et prfrer le goutte--goutte).
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Leau des
inondations ou
des fuites sur le
toit
Le btiment doit empcher lentre
de la pluie.
Le drainage du site doit tre
suffisant pour assurer lhygine du
site.
Inspection du site.
Eau recycle
Ne devrait pas entrer en contact
avec le produit fini. Nutiliser que de
leau potable.
Prlever un chantillon
pour contrler la charge
microbienne sil sagit deau
recycle ou filtre.
Eau de
refroidissement
contamine
Evaluer la probabilit que leau soit
contamine par des produits sales
ou par sa source.
Prlever un chantillon
deau.
Evaluation des risques.
Programme de
maintenance et de
nettoyage de lquipement.
Qualit de potabilit de leau
Leau au contact des aliments (y compris leau de rinage aprs nettoyage) doit tre
potable. Pour tre considre comme potable leau doit rpondre des critres
microbiologiques et physico-chimiques.
Potabilit de leau : critres microbiologiques (rglementation franaise)
(*) 95 % au moins des chantillons prlevs ne doivent pas contenir de coliformes totaux
dans 100 ml d'eau.
Normes microbiologiques
Expression des
rsultats pour
Concentration maximale
admissible
Coliformes totaux (*) 100 ml 0
Coliformes thermo-tolrants 100 ml 0
Streptocoques fcaux 100 ml 0
Clostridium sulfito-rducteur 20 ml 1
Salmonelles 5 l 0
Staphylocoques pathognes 100 ml 0
Entrovirus 10 l 0
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
97
Potabilit de leau : critres physico-chimiques
Critre physico-
chimiques
Expression des
rsultats en
Concentration
maximale admissible
(eaux potables en
France)
Directive
europenne
Temprature C 25 12
Potentiel hydrogne units pH 6,5 < pH < 9 6,5 < pH < 8,5
Chlorures mg/l Cl 250 25
Sulfates mg/l SO
4
250 25
Magnsium mg/l Mg 50 30
Sodium mg/l Na 150 20
Potassium mg/l K 12 10
Aluminium total mg/l Al 0,2 0,05
Nitrates mg/l 50 25
Duret degr franais 50 -
Rsidus sec mg/l ( sec 180C) 1500 -
Si lentreprise nest pas approvisionne en eau potable, elle procdera au traitement de
leau disponible lhypochlorite de sodium (eau de javel), de faon obtenir 1 2 mg/l
de chlore actif dans l'eau pour la rendre potable. La concentration en chlore actif de leau
traite doit tre alors vrifie chaque jour.
L'OMS publie des normes internationales sur la
qualit de l'eau et la sant humaine sous la forme de
lignes directrices qui sont utiliss comme base de la
rglementation et de normalisation dans le monde
entier.
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
98
2.7.2. Emballages : hygine et nature des matriaux
Les matriaux de conditionnement
(ex. : cartons) devront tre stocks
dans des conditions hyginiques,
afin de ne pas saltrer ou de ne pas
devenir des sources de contamination
pour les produits alimentaires.
Quand les cartons sont jets en vrac
comme illustr dans cette photo, il est
impossible de garantir labsence de
contamination.
Des cartons bien rangs, isols du sol par
une palette propre.
(Photos B. Schiffers)
La conception et les matriaux des emballages, doivent assurer une protection optimale
des produits alimentaires afin de rduire efficacement la contamination, empcher les
dommages aux aliments, et permettre un tiquetage adquat :
les matriaux de conditionnement ne doivent prsenter aucun caractre toxique
(solvants des matires plastiques, encres de marquage, colles des tiquetages, gaz
injects dans le conditionnement, ) ;
les conditionnements rutilisables (dans le cadre dchanges entre professionnels)
doivent pouvoir tre facilement et efficacement nettoys et dsinfects (verre,
matire plastique). Dans le cas o ces conditions ne sont pas remplies, la
rutilisation des conditionnements doit tre proscrite.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
99
2.8. Post-rcolte : exigences relatives
la Mthode
2.8.1. Dchargement des fruits ou lgumes la station
Lors des oprations de
dchargement des colis, des
corps trangers peuvent
sintroduire en cas de
manutention peu soigneuse :
dpt de colis sur un sol,
empilement inadapt de colis de
taille ou de nature diffrente
Les risques physiques
proviennent essentiellement des
pices du matriel de
conditionnement ou des engins
de manutention pouvant tomber
dans les fruits ou lgumes, au
moment de la rcolte, durant le
transport ou au cours du conditionnement au niveau de la station. Un corps tranger
introduit dans les produits en cours de conditionnement est difficilement reprable une
fois lemballage termin. Une vigilance particulire est donc ncessaire pendant cette
tape ! Il faudra tablir un programme de surveillance et de contrle des corps trangers
susceptibles dtre dtects. Lutilisation dune check-list est souvent trs efficace.
2.8.2. Oprations de nettoyage et lavage des produits
Le lavage des fruits et lgumes
frais apports des champs peut
rduire le risque de contamination
microbienne. Il sagit dune
tape essentielle, car cest bien
la surface de ces lments que
se trouvent la plupart des agents
pathognes. Si ces agents ne
sont pas limins, neutraliss ou
contrls, ils peuvent se propager
et contaminer un volume
important de la rcolte.
Bac de lavage des mangues par immersion
(Photo B. Samb)
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
100
Le nettoyage des fruits et lgumes est plus efficace avec des brosses, mais celles-ci
doivent tre nettoyes rgulirement.
Un lavage, vigoureux et nendommageant pas le fruit ou le lgume, peut aider liminer
des agents pathognes de la surface des produits rcolts. Le lavage leau, mme
traite avec un antimicrobien (eau de Javel, ) rduit la charge en agents pathognes
la surface du produit, mais sans lliminer totalement. Quand un dsinfectant est
utilis, la charge microbienne peut tre divise par un facteur compris entre 10 et 100 !
Dans certains cas, un lavage multiple est prfrable. Le traitement peut commencer
avec un premier lavage destin liminer la terre, suivi de plusieurs autres lavages
et/ou dun trempage dans une solution dsinfectante (on parle plutt dassainir que
de dsinfecter !), et finalement dun rinage leau potable frache.
Selon le produit, le lavage peut se faire par immersion, par pulvrisation ou encore en
combinant les deux techniques. A priori, un lavage leau pulvrise propage moins
les germes pathognes ventuellement prsents au sein de la rcolte quun lavage
par immersion.
Par ailleurs, si leau du lavage est rutilise, elle peut contribuer la propagation.
Quelle que soit la mthode de lavage choisie, les exploitants devraient adopter des
mesures adquates pour garantir en permanence la qualit de leau utilise.
2.8.3. Oprations de calibrage et de conditionnement
Les installations de calibrage et demballage varient normment entre les entreprises en
termes de complexit des systmes et des installations. Les zones de calibrage et
demballage peuvent ventuellement prsenter de srieux niveaux de contamination si
les mesures dhygine ne sont pas bien mises en place. Les btiments pour le calibrage
et lemballage doivent tre conus pour permettre une maintenance et un nettoyage
adquats. Les btiments doivent tre bien ventils pour viter la condensation. Les
contrles de poussire doivent tre mis en place, cest--dire des ventilateurs dextraction
et un clairage adquat.
Sur les chanes de calibrage et demballage, des produits venant de sources multiples
sont manipuls et expdis. Si on ne respecte pas le simple calendrier des nettoyages,
un lot peut contaminer plusieurs lots de produits destins des marchs diffrents.
Les produits ne sont pas les seuls responsables de la contamination dans la station
demballage : avec les nombreux ouvriers travaillant sur les chanes, le personnel est une
source potentielle importante de contamination des produits si la priorit nest pas
donne aux rgles sanitaires et lhygine personnelle.
Il faut pouvoir clairement identifier la provenance de tous les produits qui entrent
dans la zone demballage. Les lots en provenance de sites multiples doivent tre
identifiables.
Les produits emballs (cartons, palettes) qui quittent le site de conditionnement
doivent tous tre identifis et tiquets
15
.
15
Voir Manuel n 2 du PIP consacr la traabilit.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
101
2.8.4. Surveillance des machines et appareillages
Pour rduire les risques lis lutilisation des machines et appareillages utiliss au
niveau des champs (tracteur, groupe lectrogne, pompe, ) ou de la station de
conditionnement (calibreuses, trieuses, emballeuses, chariot lvateur, ), il faudra
suivre scrupuleusement les instructions des fabricants et les conserver.
Toutes les machines doivent faire lobjet dun programme de maintenance et
dentretien :
Etablir un programme de maintenance et dentretien des machines en se rfrant aux
instructions des fabricants : graissage, vidange, changement de pices.
Vrifier les fuites et les rparer automatiquement (carburant ou huile) sur les
machines qui peuvent souiller les fruits et lgumes de manire directe ou indirecte.
Si les vidanges sont effectues au champ ou en station, il faudra prendre toutes les
dispositions pour quelles soient faites dans une aire suffisamment loigne des
zones de culture ou de stockage des rcoltes.
Pour les chanes de tri, de calibrage ou demballage, il faudra suivre rigoureusement
les programmes dentretien et de maintenance tablis, pour non seulement viter les
contaminations des denres mais galement prvenir les dfaillances techniques.
Les chambres froides doivent faire lobjet dun programme de nettoyage et de
maintenance. Les diffrentes composantes des systmes de rfrigration, les
conduits lectriques et les recouvrements de lumire doivent tre vrifis de manire
rgulire.
2.8.5. Traitements de post-rcolte
Les traitements raliss aprs la rcolte comportent :
1. Lapplication de pesticides, cires et conservateurs aprs la rcolte. Lutilisation
de pesticides aprs la rcolte prsente une vritable menace pour la scurit
des produits alimentaires en raison du risque de dpassement des LMR du fait
que lapplication se fait trs prs de la consommation
16
. Il est ncessaire de se
conformer la mthode dapplication et de connatre lintervalle entre les
applications de pesticides aprs la rcolte et la consommation, ainsi que les
restrictions sur lutilisation de produits imposes par la rglementation et les
clients.
2. Lapplication de produits chimiques de nettoyage. Lutilisation de produits
chimiques de nettoyage dans les zones de calibrage et demballage peut aussi
provoquer une contamination du produit juste avant la consommation.
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Matriels non
approuvs (cires,
polymres)
Nutiliser que les agents
dencirement autoriss.
Vrifier les tiquettes des
produits.
16
Les rsultats des programmes de surveillance en Europe en attestent : nombreux sont les cas
de dpassement des LMR avec des traitements raliss en post-rcolte sur bananes, agrumes,
etc.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
102
Pas de dossier
sur le lieu
dorigine du
produit (important
pour le retrait de
produit et
lenregistrement
de lutilisation des
pesticides)
On doit pouvoir retracer lidentit de
chaque lot aux diverses tapes de
la rcolte, de la production et
jusqu la source de semis.
Garder des dossiers de
lensemencement la
rcolte.
Absence de
dossiers complets
sur les pesticides
Tous les dtails des applications
sur les cultures doivent tre
actualiss et gards pendant 3 ans.
Sassurer quil existe bien
des dossiers.
Risque de
contamination de
la culture par les
pesticides en
raison dun
mauvais dosage
et de mauvaises
pratiques
dapplication
Seul le personnel rellement
qualifi applique les pesticides.
Raliser une formation.
Vrifier les certificats, les
fiches de personnel.
Inspecter les magasins.
Dossiers dapplication.
Risque
dappliquer le
mauvais pesticide
sur les produits
Sassurer quil existe une liste
disponible et jour approuve sur
le plan national et sur le plan
commercial par le client.
Liste actualise de
pesticides approuvs et
autoriss.
Soumettre lexportateur la
liste dutilisation des
pesticides propose avant
le dbut de la saison.
Risque de culture
contamine par
les pesticides du
fait dun
quipement de
pulvrisation mal
calibr
Effectuer la maintenance
programme et le calibrage de
lquipement.
Enregistrement des
calibrages effectus.
Contamination de
la culture par
leau sale utilise
dans la solution
pulvrise
Entreprendre une valuation de
risques de la source deau en
prenant en considration la
probabilit dune contamination
humaine et animale.
Vrifier rgulirement les sources
potentielles de risques microbiens
(maximum 1000 UFC par 100 ml
pour des coliformes fcaux).
Leau utilise pour le dernier
rinage doit tre potable.
Sassurer que lvaluation
de risques est disponible
pour linspection si elle est
demande.
Prlever des chantillons
deau et garder les rsultats
sur fiche.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
103
Contamination de
la culture du fait
de lemplacement
ou de la scurit
inappropris du
magasin de
pesticide
Magasin situ distance des voies
deau.
Sassurer que lextrieur des
btiments est sain, sr et protg
par un muret.
Etagres fixes avec un clairage
et une ventilation suffisants.
Contrle des stocks.
Effectuer un audit rgulier
des btiments et de leur
contenu.
2.8.6. Matrise des produits non conformes - Gestion des dchets
Les produits non conformes doivent tre placs dans un endroit clairement identifi.
Il est important denlever les dchets temps et de faon efficace pour rduire la
probabilit de contamination. Lvacuation des dchets doit tre rapide, au minimum
quotidienne. Le stockage des dchets doit tre loign des zones de conditionnement et
imprativement rester lextrieur des btiments.
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Produits non
conformes en
raison des
souillures, dgts,
excs
dbranchage ou
non-respect des
spcifications
La transformation des produits
rejets devrait se faire dans un lieu
donn pour viter une
contamination croise.
Faciliter lenlvement des dchets.
Plan de gestion des
dchets (inventaire,
classification, mesures de
collecte, de stockage, de
dlimination, de traitement
ou de recyclage).
Gestion du personnel.
2.8.7. Stockage et matrise des stocks
Les installations de stockage doivent tre situes loin de tout risque dinondation et de
pollution industrielle. Elles doivent disposer dun systme dvacuation des eaux uses,
dune temprature adquate, tre faciles nettoyer et maintenues dans de bonnes
conditions dhygine.
Une mauvaise matrise des stocks peut entraner une dtrioration des produits et un
risque de contamination microbienne. Les matires premires, les travaux en cours,
lemballage et les produits finis doivent tre correctement tiquets pour permettre des
rotations efficaces des stocks bases en gnral sur le principe FIFO (First In, First
Out - premier entr, premier sorti ).
Des analyses microbiologiques des produits toutes les tapes peuvent tre demandes
ou effectues par certains clients fort niveau dexigence (flore totale, moisissures,
levures, E.coli, salmonelles, Staphyloccocus, ).
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
104
Origine du
danger :
Mesures de matrise : Preuves de matrise :
Rcoltes
contamines par
les pesticides
avant le dpart de
lexploitation
agricole
Garder les rcoltes loin des locaux
de stockage des pesticides et
protger lquipement de
pulvrisation.
Magasins adapts aprs la
rcolte.
Contamination
par les nuisibles
avant lexpdition
Sassurer quil ny a pas de nuisible
dans les zones de stockage.
Dratisation et contrle.
Contamination
par les dchets
avant lexpdition
Retirer frquemment les dchets
des chanes dlagage et viter
laccumulation.
Calendrier denlvement
des dchets.
Contamination
par les
conteneurs de
stockage
contamins
Sassurer quun programme de
nettoyage est en place.
Ne pas utiliser les conteneurs de
stockage pour transporter des
fumiers, de lhuile, des engrais, etc.
Enregistrement des
nettoyages.
Accroissement
des dchets
Se conformer la politique de stock
et sassurer que tous les produits
sont expdis frais et la bonne
temprature.
Politique et enregistrement
de la matrise des stocks
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
105
Annexe : nettoyage et dsinfection
A.1. Oprations de nettoyage et dsinfection de routine
Le nettoyage et la dsinfection seront raliss comme suit :
A la fin de chaque journe de travail, les caisses, les paniers, les bidons, les
couteaux et tous les ustensiles de travail sont ramasss ;
Tous les dchets sont racls et placs dans les poubelles ;
La surface des murs, du sol et de toutes les surfaces de travail est asperge
deau pour effectuer un premier rinage ;
Une solution de soude caustique 0,5 % 1 % est applique manuellement,
l'aide d'une ponge, sur toutes les surfaces nettoyer ;
Aprs 30 minutes, un deuxime rinage leau est effectu ;
Une dsinfection des surfaces est ralise par application manuelle dune
solution dhypochlorite de sodium (eau de Javel) 200 mg/l de chlore actif. Le
dsinfectant de base est leau de Javel 12 chlorimtrique qui renferme 3,6
% de chlore actif. Une solution dsinfectante 200 ppm est prpare en
mlangeant 56 ml de solution de base, ce qui correspond environ 5 grandes
cuilleres soupe, 10 litres deau ;
Un rinage leau, aprs 30 minutes, pour vacuer le dsinfectant ;
Tous les ustensiles de travail sont rincs leau, puis placs dans une solution
de soude caustique 1 % pendant 30 minutes, avant dtre rincs de nouveau et
plongs dans une solution dsinfectante 200 ppm de chlore actif pendant
30 minutes. Aprs rinage leau, les ustensiles sont schs et rangs jusqu
prochaine utilisation ;
Au besoin, notamment quand il fait chaud et lorsque le volume de travail est
important, deux oprations de nettoyage et dsinfection sont effectues, une la
pause de midi et lautre la fin de la journe. De plus, les surfaces sont
rgulirement racles et rinces pendant le travail.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
106
A.2. Exemple de programme de nettoyage et dsinfection
Local ou matriel
Oprations effectuer
Concentration
en dtergent
ou en
dsinfectant
Frquence de
nettoyage et
dsinfection
Salle de
conditionnement
(sol, murs,
drains...)
- Raclage des
surfaces
- Rinage l'eau
- Nettoyage au
dtergent (contact
de 30 min)
- Rinage l'eau
- Dsinfection
(contact de 30 min)
- 1 %
- 200 mg/l
Une fois par jour.
Parfois deux fois
par jour, midi et
la fin de la journe
de travail.
Tables et
paillasses de
travail
- Raclage des
surfaces
- Rinage l'eau
- Nettoyage au
dtergent (soude,
contact de 30 min).
- Rinage l'eau.
- Dsinfection leau
de Javel
- Rinage l'eau
aprs 30 min
- 1 %
- 200 mg/l
Une fois par jour.
Parfois deux fois
par jour, midi et
la fin de la journe
de travail.
Sanitaires et
locaux
annexes
- Raclage des
surfaces
- Rinage l'eau
- Nettoyage au
dtergent (contact
de 30 min)
- Rinage l'eau
- Dsinfection leau
de Javel
- 1 %
- 200 mg/l
Une fois par jour,
gnralement la
fin du travail.
Parfois deux fois
par jour et autant
que ncessaire.
Conteneurs,
ustensiles de
travail,
- Rinage l'eau
- Nettoyage au
dtergent (Soude:
contact de 30 min)
- Rinage l'eau
- Dsinfection leau
de Javel
- Rinage l'eau
aprs 30 min
- 0,5 % 1 %
- 200 mg/l
Aprs utilisation,
les ustensiles sont
ramasss et lavs
puis dsinfects et
laisss s'goutter.
Vhicules de
transport
- Raclage des
surfaces
- Rinage l'eau
- Nettoyage au
dtergent (contact
de 30 min)
- 0,5 % 1 %
- 200 mg/l
Aprs chaque
livraison.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
107
- Rinage l'eau
- Dsinfection leau
de Javel
- Rinage l'eau
aprs 30 min
Nettoyage et
dsinfection des
mains
- Rinage l'eau
- Nettoyage au
dtergent
- Rinage l'eau
- Dsinfection leau
de Javel
- savon
- 50 mg/l
A chaque retour au
travail, aprs la
visite des toilettes
et autant que
ncessaire.
A.3. Contrle de lefficacit du nettoyage et dsinfection
La mthode prsente ci-dessous fait appel des manipulations lmentaires qui
peuvent tre ralises en entreprise moyennant une formation et un quipement de
base. Leau strile et les botes de PCA peuvent sobtenir aisment auprs dun
laboratoire (centre mdical, universit, laboratoire danalyse).
Principe de la mthode
Aprs nettoyage et dsinfection, la charge microbienne des surfaces est estime en
balayant la surface analyser l'aide d'un couvillon strile qui est ensuite transfr
dans de l'eau distille strile pour dilution. Les germes sont disperss par agitation dans
leau et la numration est ralise sur milieu de culture glos.
Mthode
Les zones critiques de l'entreprise sont identifies. Ce sont les zones o il y a une
concentration d'oprations prparatoires et qui ncessitent un nettoyage et une
dsinfection minutieux. Une surface de 100 400 cm est dlimite. Elle est balaye
l'aide d'un couvillon strile qui est transfr dans 250 ml d'eau peptone strile (0,1 %
poids/volume). Les germes sont disperss (ex. : l'aide d'un mixeur Vortex) avant de
prparer des dilutions dcimales successives dans l'eau peptone (0,1 % p/v). La
numration est ralise en ensemenant, partir des dilutions, la glose Plate count
agar PCA pour la flore totale. Les botes de Ptri de PCA sont ensemences et
incubes 35 C pendant 72 heures.
Interprtation des rsultats
L'efficacit du nettoyage et de la dsinfection est value selon le tableau suivant :
Charge microbienne (en ufc/ 50 cm) Classement
> 300 Inacceptable
100 - 300 Acceptable
10 - 100 Satisfaisant
* ufc : units formant des colonies
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
108
Il faut noter que seule une certaine proportion (environ 40 %) de la microflore prsente
sur la surface analyse est prleve. L'exploitation des rsultats se fait surtout en
comparant deux surfaces diffrentes et en tudiant l'volution des rsultats dans le temps
pour dtecter le dveloppement des germes de l'atelier . Auquel cas, il faut changer
de dsinfectant et de programme de nettoyage et dsinfection, du moins temporairement
jusqu' la disparition de ces germes.
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
109
Notes personnelles
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
110
Notes personnelles
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Chapitre 2
Les mesures de
matrise des
risques en
entreprise
3
3.1. Principes gnraux dun systme dautocontrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.2. Les Guides dautocontrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.3. La vrifcation dans le cadre du systme dautocontrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Le Systme dautocontrle et
les Guides dautocontrle
Chapitre 3
112
3.1. Principes gnraux dun systme
dautocontrle
3.1.1. Origine du concept dautocontrle
La difficult de grer les crises alimentaires connues au cours des dernires annes a
dmontr la ncessit dexiger des oprateurs
1
concerns :
La mise en place de systmes dautocontrle fiables dans leurs entreprises ;
Une grande transparence lgard des services de contrle officiels et
notamment lobligation de notifier sans dlai toute information sur des faits
susceptibles de mettre en pril la scurit de la chane alimentaire ;
Linstauration de la traabilit des produits de manire organiser rapidement leur
rappel en cas de ncessit et, le cas chant, retrouver la source de
contamination.
Ces exigences sont pour lessentiel reprises dans le Rglement (CE) 178/2002
2
, socle
de la rglementation relative lhygine alimentaire, fondateur de lAutorit europenne
de scurit sanitaire des aliments (EFSA) et du rseau dalerte rapide europen
(RASFF). Ce rglement fixe les grands principes de prcaution, de transparence, de
traabilit et dfinit les obligations spcifiques applicables aux professionnels de la
chane alimentaire (obligation de rsultat), lesquels doivent dsormais dmontrer quils
ont mis en place les mesures de matrise adaptes pour atteindre les objectifs de la
rglementation.
Les dispositions du Paquet hygine
3
de la rglementation europenne ont eu pour
effet de renverser la charge de la preuve de la conformit des productions vgtales
sur les oprateurs (et non plus sur les services officiels lorsquils dtectent des non-
conformits)
4
. Ce dispositif rglementaire a pour but :
1. de fixer des rgles d'hygine applicables pour tous les exploitants du secteur
alimentaire, dont les importateurs ;
2. de responsabiliser lexploitant en lui confrant une obligation de rsultat tout en
lui laissant le choix des moyens pour atteindre ce rsultat. Le Rglement (CE)
852/2004 dtermine toutefois certains des moyens que les exploitants doivent
observer afin datteindre leur obligation de rsultat et dapporter la preuve que la
sret alimentaire des denres dorigine vgtale est atteinte (ex. : recours la
dmarche HACCP afin de dterminer les mesures de matrise de la scurit
sanitaire qui doivent tre appliques et tenues jour au sein des entreprises), en
distinguant les exigences lies la production primaire de celles lies la
transformation (comme le schage, par exemple).
1
Par oprateur on entend tous ceux qui interviennent directement dans la filire et peuvent
avoir ainsi un impact sur la qualit et la scurit du produit : les producteurs, les collecteurs, les
transporteurs, les transformateurs, les exportateurs, On utilisera aussi le mot exploitant .
2
En vigueur depuis le 1
er
janvier 2005.
3
Notamment, Rglements (CE) 882/2004, 852/2004, 853/2004 et 183/2005.
4
Voir le Manuel n 1 (Chapitre 1) du PIP.
Chapitre 3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
113
3. d'encourager la rdaction et l'application de Guides de Bonnes Pratiques
dHygine (mais aussi de Guides dAutocontrle).
Les exploitants responsables dactivits de production primaire, de transformation, de
distribution et dexportation de denres alimentaires doivent veiller grer et mettre en
uvre ces activits de manire prvenir, liminer ou rduire les dangers
susceptibles de compromettre la scurit des denres alimentaires des niveaux
acceptables. A chaque tape du processus, lexploitant doit tre mme de fournir
tous les lments (ex. : registres, rsultats des contrles et des analyses) propres
justifier la conformit de ses productions, tant vis--vis de lexploitant intervenant
ltape suivante (ex. : limportateur) que des autorits de contrle.
Cest pourquoi lentreprise doit adopter une stratgie et mettre en place une
dmarche qualit et veiller satisfaire en permanence lensemble des exigences
en termes de qualit des produits alimentaires qui se sont accrues avec la complexit
grandissante de lorganisation des filires et des marchs.
Pour atteindre cet objectif, cela implique tout dabord que lentreprise mette en place un
Systme de Management de la Qualit Sanitaire et phytosanitaire (SMQS), dont
ltendue et la complexit dpendront :
des marchs viss (ex. : des exigences rglementaires des marchs de destination
et de la nature du standard priv exig par le client) ;
de la taille et de la complexit de la chane dapprovisionnement (y compris la nature
des liens de lentreprise avec les petits producteurs) ;
de la nature et de la forme du produit export ;
du nombre et du type de risques identifis pour ce produit.
Ceci implique ensuite quune dmarche
damlioration continue (de type P,D,C,A) soit
adopte par lentreprise
5
.
Ainsi, pour progresser, lentreprise doit se doter
de mthodes et doutils efficaces pour valuer
la performance et identifier les
dysfonctionnements de son systme de
management ( Check ).
Des mesures correctives doivent ensuite tre
prises pour amliorer le fonctionnement et
lefficacit du systme ( Act ). Et lefficacit de
ces mesures devra elle-mme tre vrifie.
5
Pour rappel (voir Manuel n 1, Chapitre 7 du PIP), le principe damlioration continue est
symbolis par la Roue de Deming . Il est caractris par un cycle continu en quatre phases
(PDCA) qui se rptent sans cesse : (1) Plan : on dtermine les objectifs atteindre (respect
des normes et des exigences) et on planifie la liste des actions de matrise. (2) Do : on ralise
les actions prvues (dans les procdures). (3) Check : on vrifie, on mesure ou on value
lefficacit des actions ralises et l'atteinte des objectifs (ex. : respect des LMR). (4) Act : enfin,
partir de l'analyse des performances et des rsultats du systme, on dcide de ragir ou non,
et sur quoi (ex. : formation du personnel).
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
114
Lautocontrle est lensemble des mesures que l oprateur , doit prendre pour faire
en sorte qu toutes les tapes de la production, de la collecte, du transport, du
conditionnement, de la transformation et de la distribution, ses produits :
rpondent aux prescriptions rglementaires relatives la scurit alimentaire ;
rpondent aux prescriptions rglementaires relatives la qualit des produits ;
rpondent aux prescriptions sur la traabilit et la surveillance du respect effectif
de ces prescriptions.
En fonction de ses activits, de la nature de ses produits, de ses procds et des risques
ventuels qui y sont lis, loprateur doit mettre en place des mesures de matrise et des
procdures garantissant linnocuit de la production (une identification des dangers et
une analyse du niveau de risque sont donc pralablement indispensables).
Loprateur doit aussi tre en mesure de pouvoir tablir tout moment la traabilit
complte et prcise de ses oprations et de ses produits ( dossier de traabilit ).
L'autocontrle implique que les prescriptions soient respectes toutes les tapes de la
production, de la transformation et de la distribution des produits et que le respect effectif
des prescriptions soit surveill.
La pratique de lautocontrle apparat donc la fois comme une garantie du respect des
Bonnes Pratiques offerte par le producteur. Lautocontrle sera aussi pour lui un des
lments pertinents pour construire son systme de traabilit.
Dans le cadre de la production primaire, la mise en place
dun autocontrle , organis et systmatique, est
vivement encourag (tout comme lHACCP), mais elle nest
pas obligatoire. Les producteurs doivent toutefois pouvoir
tout moment dmontrer leur respect des bonnes pratiques
agricoles, des bonnes pratiques dhygine et enregistrer les
traitements appliqus leurs cultures.
Soulignons, en outre, que lautocontrle ne doit pas
ncessairement sarrter aux seuls aspects lis la
qualit sanitaire et phytosanitaire des produits : il est
permis dy inclure bien dautres aspects (ex. : protection de
lenvironnement, protection sociale, production
biologique,), et dautres exigences pourvu quelles ne
soient pas en contradiction avec les exigences
rglementaires lies la scurit des produits.
Tout SMQS doit donc avoir un systme de vrification interne et externe :
cest la mise en place de lautocontrle.
Il sagit de vrifier au niveau des oprateurs que le SMQS fonctionne bien et garantit
que les produits commercialiss sont conformes aux exigences de scurit
alimentaire.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
115
3.1.2. La construction dun Systme dAutocontrle
Objectifs considrer
- Il faut donner confiance aux consommateurs : on ne doit pas jouer avec leur sant,
quils soient locaux ou trangers ; outre la dimension morale de mise en danger de la
vie dautrui, limpact conomique serait svre en termes de perte de clientle et
daccs aux marchs ; consquences sociales sur les revenus, lemploi, la pauvret ;
- Il faut donner des garanties de conformit aux acheteurs : il faut donc vrifier et
donner des preuves que le produit est sain toutes les tapes de la chane, y
compris jusqu la mise en consommation (obligation de rsultat mentionne en
prambule) ; ne pas oublier la responsabilit pnale pesant sur les importateurs UE
en cas dintroduction de produits contamins sur le territoire europen ;
- Le dispositif de contrle ne doit pas compromette la rentabilit des entreprises
(efficacit et efficience) ; il serait trop cher et inefficace de vrifier chaque lgume ou
chaque fruit, chaque producteur, chaque activit ; trop cher et de durabilit incertaine
de se faire certifier individuellement titre priv sur base du volontariat ;
- La dmarche collective du secteur doit tre transparente, crdible, prvisible et
volutive : par le biais du guide sectoriel, chaque exploitant, chaque tape, sait
quelles bonnes pratiques doivent tre appliques et comment vrifier quelles le sont
bien (autocontrles). Cest possible sous rserve que chacun connaisse bien ses
responsabilits, individuelles et collectives, et joue bien son rle (ou sexpose
aux sanctions prvues) ; les volutions rglementaires peuvent tre introduites au fur
et mesure dans le guide sectoriel et les bonnes pratiques ajustes en consquence
pour prise en compte par tout le secteur (communication plus efficace) ;
- La responsabilit des tats, aux plans national et international, peut sexercer sur
base de contrles officiels eux-mmes plus efficaces et efficients : moyens
disponibles mieux utiliss par sondage toute tape de la filire et sur tout type
dexploitant, puis par ciblage l o des faiblesses sont identifies (et non plus sur les
lieux de mise en consommation locale ou aux points de sortie lexport quand toute
la valeur ajoute introduite a renchri le produit) ; besoins de renforcement des
capacits eux-mmes mieux cibls et justifis, ds lors mieux susceptibles dtre
satisfaits ;
- Le dialogue public-priv, mis en place chaque phase de la dmarche collective
dautocontrle, doit favoriser le passage dun dispositif de contrles officiels par
sanction (et de sa drive pas vu- pas pris ) une dmarche plus pdagogique,
plus proactive, plus conomique et plus responsable que sapproprieront les
oprateurs.
Lautocontrle doit permettre une volution sans rvolution dans un secteur
donn.
Les oprateurs qui sobstineraient mettre en pril limage collective du secteur
se verront plus efficacement mis en demeure de ragir ou dexercer leurs talents
ailleurs.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
116
Un systme dautocontrle se construit au niveau dun secteur
Lautocontrle ne doit pas tre la simple application du respect de prescriptions reprises
dans une check list gnrique (ex. : GLOBALG.A.P). En cela, le systme
dautocontrle se diffrencie fortement des rfrentiels-qualit qui reprennent un
ensemble de prescriptions respecter strictement quelles que soient les particularits du
processus, le milieu et les moyens des oprateurs.
Il sagit, au contraire, dimplanter dans les entreprises dun secteur donn un systme
danalyse des risques et de surveillance des pratiques, bas sur une rflexion en
profondeur de lensemble des oprateurs dun secteur
6
, qui mettent en commun :
leur connaissance fine des processus de production (au sens large) ;
leur connaissance des dangers potentiels pour ce type de production ;
leur capacit valuer les niveaux de risque en rapport avec leur contexte
habituel de travail ;
leur exprience dans lefficacit des mesures de matrise des risques encourus,
en rapport avec leurs ressources disponibles ;
leur intrt pour une surveillance effective de lensemble des produits de leur
secteur qui arrivent sur le march.
Tous les oprateurs dun secteur doivent collaborer la dfinition de mesures de matrise
et de vrification appropries, et participer volontairement au Systme d'Autocontrle .
Pour la scurit des denres alimentaires, ce systme doit tre bas sur l'HACCP.
Lanalyse des risques tant revue priodiquement, les exigences requises par le secteur
(mesures de matrises recommandes et les contrles effectuer) sont galement mis
jour rgulirement, en intgrant par exemple les rsultats des contrles, inspections et
audits raliss dans le secteur.
La rdaction de Guides dAutocontrle
Afin daider les oprateurs mettre en uvre lautocontrle au
sein de leur entreprise, les diffrents secteurs peuvent rdiger
des Guides dAutocontrle.
Ils doivent tre approuvs par lautorit de tutelle avant dtre
applicables. Ils sont grs et diffuss par les associations
professionnelles du secteur.
Les entreprises qui le souhaitent
7
pourront saider de ces
Guides pour mettre en place leur autocontrle et rdiger leurs
procdures internes. A dfaut, ils sont au moins tenus de
complter des registres.
6
Plus la proportion doprateurs dun secteur implique dans un systme dautocontrle
saccrot, meilleur sera le rsultat de cette dmarche. Pour quelle soit crdible, on estime quun
minimum de 70 80 % des oprateurs doit rallier le systme.
7
Cela reste une dmarche volontaire, et elles restent libres de ne pas utiliser ces Guides pour
dvelopper leur systme dautocontrle.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
117
Les Guides doivent tre bass sur une analyse des dangers
pertinents pour le secteur, et traiter de sujets tels que les
Bonnes Pratiques dHygine (les PRP
8
), lHACCP, la traabilit,
les plans de contrle et la notification aux autorits des non
conformits dtectes.
Ils doivent tre aisment utilisables par les entreprises
concernes. Ces Guides doivent rpondre un certain nombre
critres qui seront dcrits plus loin.
Il est intressant de rdiger et dutiliser un Guide pour les raisons suivantes :
premirement, ces Guides fournissent une aide prcieuse pour la mise en place
des systmes dautocontrle au sein des entreprises, notamment par la
description des dangers identifis, des mesures de matrise prendre et la liste
des contrles effectuer (o, quand et comment) ;
ensuite, les Guides permettent aux autorits de sassurer que les prcautions en
matire de scurit sanitaire seront prises et que les professionnels sengagent
effectuer delles-mmes tous les contrles de base ;
enfin, les Guides permettent aux entreprises intresses (notamment pour
rassurer leurs clients) de faire appel des organismes certificateurs (OCI) pour
raliser des audits combins validation du systme dautocontrle/respect de
cahiers des charges privs et, si les audits aboutissent un rsultat favorable,
dobtenir des certificats.
Comment mettre en place un Systme dAutocontrle ?
Le Systme dAutocontrle comprend deux lments indissociables et
complmentaires :
1. Les mesures de matrise et de vrification (plan de contrle) que loprateur,
actif dans un secteur, simpose volontairement (autocontrle proprement dit) ;
2. La vrification externe de son systme de management de la qualit (avec ou
sans certification de ce dernier
9
).
Il implique obligatoirement une concertation entre les oprateurs privs (professionnels
actifs dans le mme secteur de production) et le secteur public.
La mise en place dun Systme dAutocontrle sera, pour le secteur qui adopte cette
dmarche, un gage de transparence et de crdibilit. Il renforcera la confiance des
clients et des autorits de tutelle dans les systmes de management de la qualit
sanitaire qui sont mis en place dans les entreprises de ce secteur.
8
Pour rappel, il sagit des programmes pr-requis (en anglais Pre-Requisite Programs), ceux qui
sont pralables la mise en place dune dmarche HACCP (voir Manuel n 1 du PIP). Les PRP
renvoient aux mesures de matrise qui ne sont pas spcifiques une tape du processus de
fabrication, mais applicables de manire gnrale, par exemple : le nettoyage des installations
et la dsinfection des instruments, la matrise des nuisibles (rongeurs, insectes, oiseaux),
l'hygine des membres du personnel, etc.
9
La certification ntant possible que par rapport un rfrentiel, dans le cas prsent lexistence
dun Guide dAutocontrle adopt par la majorit des oprateurs actifs dans un secteur (on
parle plus gnralement de Guide sectoriel dAutocontrle - SAC).
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
118
La mise en place dune dmarche lautocontrle dans un secteur comprendra plusieurs
tapes, grer comme un projet par lensemble des oprateurs concerns, que lon
peut schmatiser comme suit :
REDACTION DU GUIDE
Elaboration dun projet de Guide dAutocontrle
Oprateur
priv
Oprateur
priv
Oprateur
priv
Oprateur
priv
Experts
indpendants
VALIDATION
Examen du Guide dAutocontrle par lautorit,
pour vrifier si :
1. Les rfrences normatives sont compltes
2. Lanalyse des risques a t correctement
effectue pour le secteur
3. Le plan de contrle est acceptable
APPLICATION DU GUIDE
Diffusion et mise en pratique des
recommandations reprises dans le Guide
VERIFICATION
Vrification (contrles, inspections, audits)
Certification des oprateurs
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
119
On peut illustrer la mthode suivre en prenant comme
exemple le cas de la production vgtale primaire
(par exemple : produire des litchis):
Etape 1 : Sensibilisation de la filire et mise en place dun Comit de Pilotage
Il faut dfinir avec les experts locaux des secteurs priv et public les bases de la
dmarche sectorielle danalyse des risques et la mthodologie suivre pour llaboration
dun Guide dAutocontrle. Ces interlocuteurs locaux se feront les relais auprs de
tous les producteurs. Un Comite de Pilotage compos au moins de reprsentants du
secteur priv (producteurs et exportateurs) et de reprsentants du secteur public est
constitu afin de favoriser la mobilisation et la concertation des parties prenantes
lexercice danalyse des risques sur le terrain et la bonne communication en direction des
oprateurs publics et privs concerns tout au long du processus. Il sera anim de
prfrence par un expert extrieur la filire.
Le rle du Comite de Pilotage sera dorganiser une mise en commun et une
validation des rsultats chaque tape du programme, de faciliter lorganisation de
groupes de travail secteur priv/secteur public, de faciliter la validation des rsultats et
des documents constituant le Guide dAutocontrle et de prparer un plan daction
pour la mise en place du systme dautocontrle dans la filire.
Il faut :
- Identifier les oprateurs du secteur, rassembler les informations sur le secteur.
- Rdiger un plan du Guide (texte et visuels).
- Sensibiliser et former les experts-relais locaux.
- Lancer une campagne de communication auprs des oprateurs du secteur.
- Crer et animer le Comit de Pilotage.
Etape 2 : Enqutes dans les principaux bassins de production, inventaire de la
rglementation et des normes pertinentes pour le secteur
Au cours de cette tape, il sagit de rassembler les donnes et les informations utiles
pour que lanalyse des risques, les mesures de matrises qui seront prconises et le
plan de contrle qui sera tabli soient ralistes et adapts au contexte du secteur.
Il faut :
- Dfinir les principaux schmas de production (les processus) existant dans la filire
litchi, partir desquels seront analyss les risques SPS existants et mergents.
- Recenser et analyser la rglementation et les normes locales ou internationales
applicables au secteur du litchi.
- Identifier les laboratoires de contrle disponibles et leur niveau de performance en
fonction des types danalyse (types danalyses ralisables, capacits annuelles,
qualifications du personnel, cots des analyses et niveaux de performance,
certifications existantes ou en cours).
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
120
- Rassembler toute linformation et les donnes conomiques et techniques sur la
filire (oprateurs, OP, volumes produits, types de produits, supply chain, oprateurs
techniques,) : itinraires techniques de production, de rcolte, de transport et de
conditionnement : nombre de vergers, ge des arbres, varits, pratiques de
production, utilisation dintrants, matriel et personnel dapplication des intrants,
personnel et matriel de rcolte, personnel de conditionnement (qualification,
exprience), infrastructures dhygine de base, conditions de transport, organisation
du conditionnement, installations de conditionnement, gestion des dchets, systme
denregistrement et de documentation en place, contrles qualit effectus, ;
principaux problmes phytosanitaires en production et en post-rcolte ; traitements
chimiques et non chimiques raliss (nature, produits employs, modes dapplication,
dlais avant rcolte, alternatives, efficacit des moyens de lutte,) ;
- Identifier tous les points critiques non rsolus dans la filire en regard des exigences
rglementaires et normatives de la filire ( Gap Analysis ) et les principaux
problmes rencontrs au niveau de la qualit des produits.
Etape 3 : Analyse des Risques en fonction du processus / Propositions de
mesures de matrise des risques / Traabilit des oprations et des
produits / Procdures de suivi des non conformits.
A cette tape, il sagira pour de consolider et dexploiter les donnes des enqutes, de
raliser une analyse approfondie des risques en fonction des processus et des conditions
de production et de proposer des mesures de matrise appropries. Il sera galement
utile de travailler en concertation avec le secteur pour la prconisation des autocontrles
effectuer, pour ce qui concerne les limites de notification obligatoire, pour tablir une
procdure de raction en cas de non-conformits, et pour les bases dun plan de contrle
du secteur.
Il faut notamment :
- Procder lanalyse des risques proprement dite et au reprage des points critiques
matriser dans la filire en ce qui concerne les aspects SPS, en utilisant les
donnes de terrain et la littrature scientifique disponible.
- Proposer des mesures de matrise ralistes mettre en uvre.
- Proposer les autocontrles effectuer en entreprise et au niveau du secteur.
- Dfinir les limites pour linformation par les entreprises aux autorits.
- Analyser les manques / opportunits de la rglementation locale face aux exigences
internationales SPS.
- Vrifier si les capacits des laboratoires de contrle rpondent aux besoins. Produire
un projet de Guide dAutocontrle de la filire.
Au terme de cette tape, le Guide dAutocontrle est disponible. Les risques sanitaires et
phytosanitaires sont inventoris et catgoriss selon leur importance (frquence, gravit
des effets) (travail ralis en troite collaboration avec le secteur et les experts locaux).
La nature des autocontrles conduire dans la filire (types de contrle, frquence
dchantillonnage, limites daction en cas de non-respect des normes, ) en fonction des
catgories de risques est identifie, et le schma dautocontrle est valid par la majorit
de la profession. Des limites critiques sont fixes pour chaque catgorie de risque. Des
procdures de gestion des non-conformits par les entreprises et de communication avec
les autorits sont tablies. Les exigences de traabilit et de documentation des
autocontrles et de leurs rsultats sont dfinies.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
121
Etape 4 : Concevoir et rdiger des outils de vulgarisation pour faciliter la mise en
application du Systme dAutocontrle / Formation de reprsentants des
OP et agents des services publics
A cette tape, les lments du Guide sont traduits sous la forme de Guides de Bonnes
Pratiques , illustrs et pratiques, adapts au niveau et lutilisation par chaque
catgorie doprateur. Au moyen de ces outils, ils superviseront lapplication du SAC
dans les entreprises. Une formation destination de reprsentants des organisations
professionnelles et dagents qualifis des services publics doit tre organise.
Etape 5 : Evaluer les besoins de certification des entreprises / Produire un Plan
daction pour la filire
Il sagira didentifier les besoins en certification du secteur et, si cest le cas, dfinir les
schmas possibles de certification. Dans certains cas, il faut aussi rpertorier les besoins
de la filire (ex. : nouvelles normes) et produire un plan daction : renforcer les capacits
danalyse pour les contrles, laborer un calendrier de mise niveau des structures, une
mise jour des normes et/ou des rglementations, un renforcement de capacit dans le
secteur,
3.1.3. Les avantages offerts par un Systme dAutocontrle
La mise en place dun Systme dAutocontrle dans un secteur de production prsente
des avantages, aussi bien pour les oprateurs que pour les autorits comptentes
10
.
Avantages pour les producteurs
Pour les producteurs, linstauration dun systme dautocontrle prsentera plusieurs
avantages :
1) Au niveau des contrles en production et du contrle final des produits :
Mieux cibler les contrles, notamment pouvoir rduire le nombre des analyses
les plus coteuses (analyses de rsidus, analyses microbiologiques) car
actuellement le niveau dchantillonnage exig nest pas toujours justifi par les
importateurs (il en est ainsi, par exemple, des analyses exiges pour chaque lot,
quand bien mme il sagit dune srie de petits lots).
Rduire la charge financire du contrle final des produits : quand un processus
est entirement sous autocontrle, le contrle final se rsume souvent un simple
contrle documentaire
11
(par exemple, la lecture des registres o sont
mentionns les produits utiliss, leur dosage, les dates dapplication et de rcolte
au lieu de procder des prlvements et des analyses de rsidus
systmatiquement).
10
Autorits (comptentes) : toute instance d'un Etat (ex. : ministre, agence alimentaire, )
reconnue par lui comme comptente pour effectuer les contrles requis par la
rglementation (et valider le systme dautocontrle). A noter que lautorit de tutelle dun Etat
peut dans certaines conditions dlguer une partie de ses comptences un autre
organisme quelle agre pour procder en son nom des tches de contrle dtermines.
11
La crdibilit tant confirme par des audits internes rguliers, en respect des procdures
dautocontrle, faute de quoi, les procds de contrle pourraient driver ou tre inadquats et
engendrer la sortie de produits non conformes.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
122
Rduire le nombre de vrifications externes : un oprateur qui ne dispose pas
d'un systme d'autocontrle valid sera considr comme moins sr par les
autorits (on dira quil prsente un profil risque ) et sera ds lors plus
frquemment contrl, et plus en profondeur. Si le contrleur mandat par les
autorits constate des manquements, il prendra des mesures immdiates et
effectuera autant de nouvelles visites que ncessaires, pour sassurer que les
mesures correctives exiges ont bien t prises par loprateur et sont respectes.
2) Au niveau de la matrise du procd de production :
Dtection des non-conformits et des dfaillances le plus tt possible (notamment
avant lentre en station et lexpdition des produits) : les retombes
financires positives sont lies aux conomies et au fait qu'il n'y aura pas de valeur
ajoute inutile pour les produits dfectueux (ex. : lemballage).
La recherche et la dtection rapide des non-conformits par un contrle
systmatique des oprations de production par ceux-l mme qui l'ont ralis,
amliorent le respect des spcifications par la prise de conscience et le
changement des pratiques.
3) Au niveau de limplication de loprateur dans son travail :
Contrler son propre travail est rput responsabiliser l'oprateur (quand
l'importance et la complexit de ce contrle ne dpassent pas ses comptences).
L'oprateur qui fournit des produits non conformes se sent alors plus concern et
est encourag mieux matriser ses procds.
L'autocontrle est un des moyens pour l'oprateur de prouver et de mesurer la
qualit de son travail (ou des qualits et dfauts dans son processus).
4) Au niveau des petits producteurs, offrir une alternative moins coteuse aux
certifications prives tout en garantissant un niveau de qualit sanitaire quivalent.
Avantages pour les autorits
Pour les autorits, linstauration dun systme dautocontrle prsentera galement
plusieurs avantages, non ngligeables quand on connat la faiblesse des ressources
disponibles dans beaucoup de services publics :
identification des producteurs et de tous les oprateurs (visibilit, traabilit,
contrle plus ais) ;
aide la mise en place dun systme national de contrle sanitaire efficace, car
bas sur une analyse des risques effectue dans les diffrents secteurs ;
renforcement des capacits de contrle auprs de tous les acteurs impliqus
grce un ciblage plus efficace ;
programmation et planification des contrles facilites, et rduction du contrle
des produits finis ;
transparence des problmes relevs dans chaque secteur (communication des
rsultats aux autorits) ;
garantie de traabilit et de mesures efficaces de retrait ou de rappel en cas de
crise (procdure prvue) ;
crdibilit globale de lorigine et du systme SPS national ;
transferts possibles des acquis entre les diffrents secteurs.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
123
3.2. Les Guides dautocontrle
3.2.1. Guides de Bonnes Pratiques et Guide dAutocontrle
Pour guider les producteurs, fabricants ou distributeurs, et leur permettre de rpondre
leurs obligations en matire dhygine, les professionnels dun secteur (ex. : fruits et
lgumes, viande, lait, chocolat,) peuvent laborer ensemble un Guide de Bonnes
Pratiques dHygine , adapt leurs activits et aux risques spcifiques de leur secteur.
Au dpart, ce type de guide rassemble avant tout les rgles dhygine applicables aux
diverses tapes de la chane alimentaire. Dans le cadre des rglementations
europennes relatives la scurit alimentaire et lhygine des denres alimentaires
(Rglements (CE) 178/2002 et 852/2004), en y intgrant aussi les lments relatifs au
contrle systmatique des pratiques sur lensemble du processus, la notion de Bonnes
Pratiques a t tendue l Autocontrle en production.
Le Guide dAutocontrle repose sur une analyse sectorielle des risques
12
, base
sur une identification des dangers qui sont pertinents pour un type de produit donn
(ex. : la production de viande, la production du lait, la fabrication de farine, la production
vgtale, ). Il comprendra en outre : les bases dun systme de matrise des risques en
production, lapplication des principes HACCP (relev des points de contrle critiques et
leur matrise), une proposition de plan dchantillonnage faite par le secteur (type et
nombre dchantillons prlever chaque anne, ainsi que les paramtres danalyse
jugs pertinents : rsidus, mtaux lourds, microorganismes, etc.), les enregistrements
obligatoires et la procdure de notification aux autorits en cas de non-respect des
normes.
12
La dfinition du secteur nest pas toujours aussi vidente quil parat. On peut travailler sur
une filire (ex. : le litchi) ou sur plusieurs filires la fois (ex. : Les fruits et lgumes ou
mme la Production primaire vgtale ). Limportant tant de toujours garder une cohrence
des exigences entre les diffrents Guides sectoriels, ce quoi doivent tre attentives les
autorits. Il peut en effet exister des recouvrements entre le champ dapplication des Guides
dautocontrle : ainsi, on peut imaginer un Guide de production du litchi mais aussi un
Guide de production de jus de fruit .
Chapitre 3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
Un Guide pour chaque secteur de production, car :
Existent des dangers diffrents, lis aux activits, aux procds, aux
quipements, au personnel, l'environnement et aux produits concerns.
La sensibilit aux contaminations dpendra beaucoup du produit, mais aussi
des conditions locales de production et de conditionnement.
Ce sont les oprateurs actifs dans le secteur qui ont la meilleure apprhension
des problmes rencontrs habituellement.
Ce sont les oprateurs qui estiment le mieux les mesures et contrles qui seront
conomiquement supportable pour eux.
124
Dune part, ces Guides sectoriels dAutocontrle sont labors par les professionnels
eux-mmes et sont valus par un comit dexperts dsign par les autorits afin de voir
si lanalyse sectorielle des dangers, sur laquelle le guide est bas, est complte et les
mesures appropries. Dautre part, une fois le Guides valid, les autorits en vrifieront
la bonne application au niveau du secteur.
Il existe en Europe des guides nationaux, disponibles sur les sites Web des agences
nationales (ANSES, AFSCA,) et des guides communautaires, labors au niveau des
secteurs alimentaires europens et publis dans le Journal Officiel de lUnion
europenne (srie C).
Un Guide dAutocontrle doit :
tre valable pour toutes les entreprises dune filire (ou secteur ) ;
et transposable dans chaque entreprise ;
proposer un plan dchantillonnage bas sur lanalyse sectorielle de risque ;
tre aisment utilisable par les entreprises concernes : comprhensible
(illustrations, schmas, ), facilement applicable (exemples dtaills pour lHACCP),
accessible (distribu ou vendu par le secteur) ;
tre rdig et diffus par les diffrents secteurs ou sous-secteurs, en concertation
avec les reprsentants des parties intresses dont les intrts peuvent
rellement tre en cause ;
tre valid, la fiabilit du Guide relevant des autorits.
Les recommandations gnrales pour llaboration des guides figurent dans la partie B
de lAnnexe 1 du Rglement (CE) 852/2004.
3.2.2. Composition des Guides dAutocontrle
Le Guide sectoriel est labor pour aider une petite ou une grande entreprise du secteur
concern respecter les rgles dhygine et appliquer les principes dHACCP. Un tel
guide se doit dtre pratique, abordable par un oprateur mme peu qualifi et illustr
dexemples et de cas concrets pour en faciliter la comprhension et lusage, mais il doit
rester un document de rfrence, avec des bases scientifiques solides.
Des exemples concrets, parmi lesquels une analyse des dangers est prsente selon la
dmarche HACCP, peuvent faciliter la comprhension et lapplication du Guide. Mais il
est souvent prfrable de prparer en mme temps que le Guide proprement dit un
certain nombre doutils de vulgarisation, illustrs et simplifis, adresss chaque
catgorie doprateurs prsents sur la chane de production. Par exemple : un premier
document de vulgarisation pour les petits planteurs, un autre pour les collecteurs, un
troisime pour les exportateurs.
On prsentera ci-aprs un exemple de sommaire-type dun Guide dAutocontrle pour
le secteur vgtal (ex. : Guide dAutocontrle pour la mangue prpar pour le Mali et le
Burkina Faso en 2009, par le PCDA et le PAFASP avec la collaboration du COLEACP) :
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
125
Premire partie : Dispositions gnrales du Guide
Objet et champ dapplication
- Activits couvertes par le Guide
- Procds de production et de commercialisation
- Culture de la mangue
- Critres de qualit
Utilisation du Guide
- Utilisateurs du Guide
- Mode demploi du Guide
- But et relation avec la lgislation
- Mode demploi pour les producteurs
- Mode demploi pour le contrle de lentreprise
Groupes de travail et rdaction du Guide
- Expertises
- Composition des groupes de travail
- Reprsentativit du secteur
- Concept du Guide sectoriel de lAutocontrle
Renvoi normatif
- Lgislation nationale et europenne
- Autres normes
Termes, dfinitions et abrviations
Diffusion, mise jour du Guide et accs au Guide
Seconde partie : Analyse des risques et exigences gnrales pour le secteur
Exigences gnrales relatives la qualit sanitaire et phytosanitaire
Analyse des risques sur le processus de production
- Schma de production
- Identification des dangers
- Caractrisation du risque (scores)
Exigences gnrales en matire dhygine (Autocontrle, GGHP, HACCP)
- Personnel et tiers
- Site de production
- Entreprise et btiments
- Machines, appareils et outils en contact avec le produit pendant le traitement de
pr- et post-rcolte
- Caisses, conteneurs, matriel de conditionnement et palloxes
Description des techniques de culture :
- Itinraire technique et BPA
- Identification des organismes nuisibles
- Traitements phytosanitaires
- Traitements post-rcolte
- Gestion des dchets
- Contrle des oprations : check list des exigences gnrales du Guide
(exigences majeures, mineures et recommandations)
Traabilit :
- Identifications raliser
- Enregistrements
- Documentation
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
126
Troisime partie : Plan de contrle et suivi des non conformits
Plan d'chantillonnage
Conditions gnrales :
- Base pour une approche statistique de l'chantillonnage
- chantillonnage et analyse raliss par un tiers indpendant
- Organisation du plan sectoriel d'chantillonnage et d'analyse
- Collecte et utilisation des rsultats
Contrles raliser en pr-rcolte
Echantillonnage et contrles raliser aprs la rcolte
Procdure de notification des autorits :
- Gnralits
- Aperu des limites daction (notification)
- Procdures de blocage et de rappel
Quatrime partie : Certification du systme dautocontrle des entreprises
Cadre et objectifs de la certification
Objet, domaine dapplication
Procdures dinspection et daudit
Conditions pour les organismes de certifications indpendants (OCI)
Procdures de certification
Obligations des auditeurs / contrleurs et des producteurs
Mesures de sanction
3.2.3. Recommandations pour la rdaction des Guides dAutocontrle
Gnralits
Le guide introduit doit indiquer clairement le numro de version car c'est uniquement la
version introduite qui pourra tre ultrieurement valide.
De mme, la communication dans ce contexte en tiendra compte galement.
Dfinir le champ d'application
Dfinitions :
- des activits couvertes par le guide (sur base du processus complet)
- des procds de production, de transport, de commercialisation,
- des produits finis (fruits frais, fruits sches, lgumes, jus, conserves, )
Un seul guide par champ d'application. Un guide doit spcifier clairement quelles
activits, quels procds de fabrication ou de commercialisation, quels produits il se
rapporte. Ceci doit s'inscrire de faon pertinente dans le cadre de l'autocontrle.
Un mme champ d'application (mmes activits et/ou mme type de produits) ne peut
pas tre trait dans des guides diffrents.
Cependant, sur base de facteurs sociaux, conomiques ou traditionnels, certains cas
peuvent tre considrs comme des soussecteurs spars, et l'existence de guides
spars peut donc tre autorise si elle se justifie.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
127
Dfinir l'usage attendu
Spcification de tous les utilisateurs possibles.
Mode d'emploi, instructions, :
- But
- Quelles donnes dans le Guide
- De quelle manire ces spcifications se rapportent aux prescriptions lgales
- Comment utiliser concrtement ces donnes
Tous les utilisateurs possibles doivent tre identifis et dfinis.
Il faut indiquer clairement quel(s) type(s) d'utilisateurs le guide est destin. Seuls les
utilisateurs spcifis feront usage du Guide. Les utilisateurs possibles doivent tre
pertinents pour ce qui se rapporte la scurit sanitaire et phytosanitaire.
Il faut expliquer comment utiliser le Guide. Un mode d'emploi doit inciter l'utilisateur
possible l'application du Guide dans son exploitation (par ex. attirer lattention sur
certains aspects favorisant la facilit d'utilisation/dapplication du Guide). Il doit indiquer le
but du Guide en relation avec l'autocontrle lgalement impos.
L'utilisateur doit tre sensibilis/conscientis, il faut lui expliquer pourquoi il doit appliquer
ce Guide. L'importance de l'autocontrle et de la responsabilisation qui y est lie doit
tre clairement mise en vidence. Un utilisateur qui est conscient des objectifs mettra
plus de conviction mettre en place, appliquer et maintenir son systme d'autocontrle.
Outre le but, on devra aussi indiquer quelles recommandations/donnes contient le
Guide (une table des matires claire, avec un bref commentaire indiquant quelles
donnes on peut retrouver dans le Guide). L'utilisateur devra se retrouver facilement
dans le Guide.
Etant donn que le guide sera utilis pour satisfaire aux prescriptions lgales, il y aura
lieu d'indiquer clairement de quelle manire les dispositions du Guide se rapportent aux
prescriptions rglementaires.
Il est trs important d'indiquer comment les recommandations peuvent tre utilises
concrtement. Il faut par consquent expliquer tape par tape comment l'utilisateur
peut parvenir via le Guide son propre systme d'autocontrle, adapt
l'entreprise.
Dsignation du groupe de travail et de la concertation
Le secteur :
- Les donnes du secteur
- Indiquer la reprsentativit
Le groupe de travail (composition) :
- Le nom des membres du groupe de travail
- Leur qualit (prsident, observateur, )
- Leur provenance (venant de quelle organisation)
- Leur expertise (experts locaux et experts externes)
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
128
Les parties concernes :
- Enumration de toutes les parties concernes par la rdaction/lapplication du Guide
- La manire dont toutes ces parties auront t consultes
Dans un Guide doi(ven)t tre clairement mentionne(s) (au moyen de l'indication du nom
et des coordonnes) l(es)' association(s) professionnelle(s).
Si la demande de validation est introduite par une organisation coordinatrice, on
indiquera le nom et les coordonnes de cette organisation. Outre les donnes de
l'organisation coordinatrice, on spcifiera galement les donnes (nom, coordonnes,
domaine qu'elles reprsentent) des associations professionnelles qui y sont associes.
Il faut galement indiquer le degr de reprsentativit de cette (ces) association(s)
dans le(s) secteur(s) concern(s). Pour dmontrer la reprsentativit, on utilise des
paramtres comme le nombre d'entreprises (par ex. % d'entreprises du secteur qui sont
membres de l'association professionnelle), le nombre de personnes employes, le
tonnage, le chiffre d'affaires, ou une combinaison de ces facteurs. Il faut motiver
pourquoi un (des) paramtre(s) donn(s) a (ont) t retenu(s) pour dmontrer la
reprsentativit dans le secteur.
Le groupe de travail qui a t habilit laborer et rdiger le guide doit tre
nettement indiqu. A cette fin, on numre les noms de tous les membres du groupe de
travail. Outre le nom, on doit galement tablir la qualit (p. ex. prsident,
observateur), l'origine (provenant de quelle organisation) et l'expertise de tous les
membres.
Dans un guide, toutes les parties qui ont t associes la rdaction du guide doivent
tre mentionnes, ainsi que la manire dont ces parties ont t consultes pour son
laboration (via le groupe de travail ou d'une autre manire, par crit ou par le biais de
runions, ). Donc mme les parties qui ne sigent pas dans le groupe de travail mais
sont cependant partie intresse doivent tre numres et il faut tablir dans quelle
mesure et comment elles ont t associes. Des parties intresses seront notamment
les producteurs, les pisteurs, les collecteurs, les fournisseurs (semences, plants,
intrants) et les clients (importateurs galement).
Indiquer les moyens
Description des moyens et de l'expertise utiliss. Dans le guide, il faudra indiquer
quels moyens (ex. : consultations dans les bassins de production) et quelle expertise
(locale et externe) on a fait appel pour sa rdaction. Par exemple : consultations de
centres de recherche, projets ou bureaux de consultance, tudes duniversits, analyses
de laboratoire (sol, eau, rsidus,), rfrences bibliographiques, autres. L'indication
d'URL (adresses de sites internet) pertinents peut galement constituer une plus value
pour les utilisateurs.
Recommandations propos du contenu
Points de dpart et prise en compte des utilisateurs prvus :
- Le guide devrait tre adapt aux utilisateurs prvus
- Avertissements propos d'exemples ventuels
- La rdaction doit avoir pour point de dpart et tenir compte :
d'une analyse des dangers (base sur lHACCP)
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
129
des codes d'utilisation recommands au niveau international
de la lgislation pertinente
de toutes les autres sources pertinentes
Les dispositions d'un guide doivent tre adaptes aux utilisateurs prvus. Ceuxci
doivent pouvoir lire, comprendre et mettre le guide facilement en pratique.
Le Guide sera rdig en prenant pour point de dpart et en tenant compte :
d'une analyse des dangers concernant les activits, les procds, les
quipements, le personnel, l'environnement et les produits en question ;
des codes internationaux recommands dans le domaine des produits concerns
(ex. : ceux du Codex Alimentarius) ;
des diffrentes exigences de la lgislation et rglementation (selon les marchs) ;
de toutes les autres sources pertinentes (ex. : articles scientifiques, rsultats
danalyse pour construire le plan dchantillonnage).
L'analyse des dangers et la lgislation locale, rgionale et europenne sont des
lments cls obligatoires.
Des exemples concrets du systme d'autocontrle seront dcrits dans le guide. Il faudra
indiquer trs clairement qu'il ne s'agit que d'exemples et qu'un systme d'autocontrle
doit tre tabli sur mesure pour l'entreprise concerne.
A cette fin, l'exemple devra au moins tre prcd de l'avertissement suivant ou d'un
similaire : Cet exemple n'est donn qu' titre d'illustration ; il ne peut en aucun cas tre
utilis en tant que tel pour l'application du systme d'autocontrle dans une entreprise
donne .
Ce point est assez sensible car le fait de reprendre des exemples littralement peut en
fait tre assimil l'absence d'un solide systme d'autocontrle.
Prsence de toutes les exigences essentielles concernant :
Les BPA (Bonnes Pratiques Agricoles) ;
Les BPH (Bonnes Pratiques d'Hygine) ;
L'HACCP (Hazard analysis and critical control points) : tenir compte de tous les
types de dangers de contamination : biologiques, chimiques et physiques.
Les dispositions du Guide ne pourront pas paraphraser sans plus les exigences
rglementaires de base. Toutes les exigences essentielles des BPA (et donc BPP
13
)
doivent tre dcrites et prcises dans le guide. Toutes les exigences essentielles en
matire d'hygine doivent tre dveloppes et prcises par les dispositions du
Guide. Ces dispositions et leur mode d'application devront tre adaptes aux diverses
entreprises du secteur.
Le Guide doit attirer l'attention des entreprises sur une srie de dangers importants,
d'autant plus que le Guide doit tre notamment bas sur une analyse des dangers et doit
contenir des directives claires expliquant aux entreprises comment doit tre effectue
une bonne analyse HACCP, base sur les 7 principes. Un exemple HACCP peut tre
donn en annexe.
13
BPA : Bonnes Pratiques Agricoles ; BPP : Bonnes Pratiques Phytosanitaires.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
130
Le Guide doit tenir compte de tous les types de dangers de contamination des produits
en ce qui concerne la scurit alimentaire (dangers biologiques, chimiques et physiques),
mme thoriques. Une criticit (probabilit x gravit) sera tablie sur cette base.
Ne jamais simplement paraphraser les exigences lgales de base (mettre en application).
Deux points particulirement importants :
Concernant la rglementation, locale ou internationale, on ne pourra nulle part trouver :
des interprtations,
des drogations,
des contradictions.
Le Guide contiendra tous les aspects pertinents concernant :
la scurit sanitaire et la qualit des produits,
la traabilit,
la notification aux autorits et la gestion des non-conformits.
On attend d'un Guide qu'il explique l'utilisateur comment il peut satisfaire la lgislation
en matire de scurit alimentaire. Il est ncessaire que pour chaque aspect trait
concernant la scurit alimentaire, le guide contienne une rfrence toute la
lgislation pertinente, et qu'il soit indiqu de quelle manire l'entreprise peut satisfaire
ces dispositions lgales.
En complment, un chapitre spcifique reprenant l'inventaire de la lgislation
pertinente sera rdig. En mme temps, il doit tre clair pour l'instance de contrle que
tous les aspects lgaux (concernant la scurit alimentaire) doivent tre contrls (par
ex., prvoir une check list relative la lgislation). Pour autant que les aspects relatifs
la qualit soient repris dans le guide, il est conseill (mais non obligatoire) d'indiquer la
rfrence lgale dans ce cadre (ex. : normes Codex, ).
Les aspects relatifs la scurit alimentaire et la traabilit y sont obligatoires : le
Guide doit indiquer comment est ralis le lien entre les produits entrants et les produits
sortants, et jusqu' quel niveau ce lien doit tre au minimum tabli. Outre cette traabilit
interne, il est galement important que soit indiqu quelles techniques on doit / on peut
utiliser pour prvenir les erreurs d'enregistrement dans les registres. De mme, la
notification est un aspect obligatoire.
Les aspects relatifs la qualit ne devront pas obligatoirement tre repris dans le Guide,
mais cest conseill. Les rfrentiels privs internationaux (p. ex. GLOBALG.A.P, BRC,
IFS, ) ne sont pas des Guides dAutocontrle et donc ne peuvent tre valids en
tant que tels par une agence alimentaire nationale. Il leur manque des lments ou
bien ils contiennent des lments qui ne peuvent pas tre valids par ce type dagence.
Exigences lies aux organismes de contrle externes
Description des rgles relatives aux organismes de contrle agrs :
- les normes de rfrence pour l'accrditation ;
- un systme de certification avec des rgles de certification (y compris la priodicit et
la porte des audits) ;
- un systme d'inspection avec la priodicit des inspections ;
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
131
- la documentation sur la qualit, les enregistrements et les aspects techniques qui
doivent au minimum tre contrls par les auditeurs / les inspecteurs ;
- les rgles en rapport avec l'chantillonnage et l'analyse des produits ;
- le nombre minimum dheures/journe de travail appliquer ;
- le contenu minimum des rapports ;
- les qualifications requises des inspecteurs et des auditeurs.
Etant donn qu'il faut prvoir la possibilit de faire vrifier lapplication et le respect des
prescriptions du Guide par des organismes externes, le Guide devra galement
mentionner de quelle norme d'accrditation relveraient l'organisme d'inspection ou les
organismes de certification ventuellement mis en uvre (norme de rfrence EN
45004, EN 45011 ou EN 45012 ou la srie ISO 17000). Le choix fait devra tre motiv.
Dans un systme de certification, les rgles de certification appliquer doivent tre
fixes (elles vont notamment de la demande la dlivrance de certificats, y compris la
surveillance des certificats dlivrs, les obligations des utilisateurs, ), y compris la
priodicit et la porte des audits.
Dans un systme d'inspection, la priodicit des inspections doit tre fixe. Doivent
galement tre spcifis, la documentation sur la qualit, les enregistrements et les
aspects techniques qui doivent au minimum tre contrls par les auditeurs / les
inspecteurs. Le contenu minimum des rapports dinspection doit tre dfini, en tenant
compte des destinataires.
Des rgles concernant l'chantillonnage et l'analyse de produits devront tre reprises.
Cela ira des mthodes et des frquences jusqu' la manire dont ces oprations seront
organises.
Pour pouvoir effectuer convenablement l'audit / l'inspection, il faudra prvoir de rdiger
des directives concernant le temps que les auditeurs / les inspecteurs (nombre dheures
ou de journes de travail, selon les volumes et activits) doivent au moins consacrer
dans l'entreprise contrler l'application du Guide. Ces donnes devront tre rdiges de
manire empcher toute possibilit d'interprtations.
La fixation d'exigences concernant les qualifications des inspecteurs / des auditeurs
sera d'une importance particulirement grande !
La comptence des auditeurs dtermine en effet, avec le contenu du Guide, quelle
sera la valeur du systme d'autocontrle mis en place.
Des exigences qui peuvent tre fixes, sont notamment la qualification de base, la
formation (ex. : sur lHACCP), l'exprience du secteur, le nombre dannes de travail et
l'exprience de l'audit (dans ce type de secteur de production).
Directives sur la forme
Les lments du Guide seront :
accessibles aux producteurs ;
clairs ;
cohrents ;
logiques.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
132
Tous les lments de ce guide doivent tre prsents de faon claire, cohrente et
logique. Tout cela concerne videmment la facilit d'utilisation du Guide. Il faudra donc
accorder beaucoup dattention la forme de prsentation du Guide (illustrations,
photos,) et la langue.
Diffusion
Les conditions auxquelles le Guide sera disponible. Dans le Guide, il devra aussi tre
indiqu quelles conditions il est disponible. Il doit pouvoir tre obtenu par toute
personne dont l'intrt pour le guide est motiv. Aprs validation, le guide devrait tre
disponible sur Internet.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
133
3.3. La vrification dans le cadre du
systme dautocontrle
3.3.1. La vrification interne
La vrification interne est celle qui est ralise par loprateur lui-mme ou par une tierce
partie agissant pour son propre compte. Elle porte sur lvaluation du SMQS de
lentreprise. Il peut s'agir dun contrle global et systmatique (contrles visuels,
mesures, audit interne) ou dun contrle plus cibl et ponctuel (analyses de rsidus,
analyses microbiologiques, analyses de sol, de leau, ).
La vrification a pour but de sassurer que:
les procdures internes en place fonctionnent rellement et sont efficaces ;
les enregistrements effectus attestent et apportent toutes les preuves de la
matrise de la scurit sanitaire des produits alimentaires et du respect des
exigences rglementaires (scurit des produits), ainsi que de celles de cahiers
de charge ou de rfrentiel qualit (qualit des produits).
Le systme de vrification interne ou autocontrle comprend
14
:
1. Des contrles permanents : visites et inspections ralises avec une frquence
prtablie dans un plan de contrle interne , plus dautres, inopines. Elles sont
ralises par le responsable qualit-traabilit (et son quipe dans les grandes
structures). Elles sont compltes par des mesures, des chantillonnages et des
analyses cibles en fonction de lanalyse des risques qui a t mene sur base des
processus.
2. Des audits internes : ils sont mens par des auditeurs forms laudit de la scurit
des produits alimentaires pour sassurer que le SMQS fonctionne efficacement dans
toutes ses composantes. Il faut noter que, mme sil sagit bien daudits internes
(cest--dire dont les rsultats ne sont pas communiqus en principe lextrieur),
lentreprise peut faire appel des auditeurs externes quelle rmunre pour suppler
le manque de comptences internes ou pour avoir lavis dun expert extrieur. Laudit
interne est ralis gnralement une deux fois par an ou lorsque les processus
clefs changent !
14
Voir Manuel n 1 du PIP.
Lvaluation du SMQS doit pouvoir rpondre aux 3 questions suivantes :
- Le SMQS rpond-il aux objectifs fixs par lentreprise dans sa politique de
qualit et de scurit sanitaire de ses produits ?
- Le SMQS satisfait-il aux exigences des clients ?
- Le SMQS permet-il une amlioration permanente des processus et des
procdures de scurit et de qualit mises en uvre ?
Chapitre 3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
134
La frquence des vrifications et celle des analyses doivent suffire confirmer que
lidentification des dangers, lvaluation des risques, les contrles et les actions
correctives fonctionnent correctement.
Les contrles, analyses et audits internes, leur contenu et leur frquence, seront dfinis
dans une procdure spcifique relative la vrification du SMQS.
3.3.2. La vrification externe
Quelles vrifications et comment les planifier ?
Rappelons que tout Systme dAutocontrle comprend non seulement un Guide
dautocontrle (dapplication pour le secteur priv), mais aussi un ensemble de
procdures de contrle (dapplication par le secteur public).
La planification des vrifications externes (nature et frquence des contrles) sera
base sur lanalyse des risques ralise au niveau de la filire.
Les vrifications externes comprennent essentiellement :
Des prlvements en vue danalyse (en pr-rcolte, en station sur les produits
bruts ou les produits finis, aux points dexpdition ou mme sur les marchs).
Ces prlvements (chantillonnages) sinscrivent dans le Plan de surveillance
gnral.
Des inspections, ralises sur base de chek lists connues (les mmes que
celles utilises par les exploitants pour leurs vrifications internes). Elles font
partie du Plan de contrle appliqu pour le secteur.
Des audits raliss soit par les agents de lautorit, soit par une tierce partie
dsigne et accrdite par elle, pour sassurer notamment de lapplication des
consignes dhygine et la tenue des registres.
Inspection : vrification un instant t de ltat de fonctionnement du SMQS et de ses
performances. Elle donne une vision instantane du respect des prescriptions, sans
donner de garantie sur la dure du bon fonctionnement.
Audit : examen systmatique et indpendant destin dterminer si des activits et
leurs rsultats sont conformes aux plans tablis et si ces plans ont t excuts de
manire efficace et restent adquats pour atteindre les buts fixs (source : Rglement
(CE) 882/2004). Il permet de sassurer de la robustesse du systme.
Dans le cadre dun systme dautocontrle, les vrifications les plus importantes sont les
audits en entreprise, qui seront effectus avec une frquence prdtermine (ex. : 1 audit
tous les 3, 6 ou 12 mois) en fonction du secteur. Seuls les rsultats de lanalyse de risque
ralise en concertation avec les professionnels du secteur et valide par des experts
scientifiques indpendants, permettent de prdterminer, de manire objective, la
frquence des vrifications externes ncessaires, en considrant les deux lments
suivants :
Le profil de risque de la filire , sur base de la sensibilit du produit
(ex. : risques a priori plus levs pour le consommateur avec des produits
dorigine animale en comparaison des fruits et lgumes) ;
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
135
Le profil moyen des oprateurs actifs dans la filire, sur base de leur
niveau dorganisation, de la mise en place dautocontrles, de lexistence de
certifications de leurs SMQS ou autres, des caractristiques de lenvironnement
gnral de la filire (ex. : itinraires techniques adopts, avec ou sans pesticides
et engrais chimiques).
La frquence des vrifications effectuer dans les entreprises dpendra donc de
nombreux facteurs qui seront apprcier par les autorits. Pour des oprateurs qui
appliquent volontairement les recommandations du Guide dAutocontrle de leur secteur,
la frquence pourra tre rduite.
Lorganisation des audits externes
Un audit ne simprovise pas et comprend toujours plusieurs tapes. Lentreprise doit avoir
t avertie pralablement de la date de passage de lauditeur et de la porte de laudit.
Lidal est de disposer dune check list daudit : cest un document qui prsente les
tapes de laudit, les documents/lieux inspecter, les personnes interroger et les
objectifs de laudit.
Runion pralable :
Lauditeur vrifie :
les rapports d'audits prcdents.
tous les documents qui peuvent contenir des informations importantes.
Lauditeur reoit toutes les donnes pertinentes concernant lentreprise auditer. Les
formulaires ncessaires sont prpars et ils sont complts des donnes dj connues.
Runion d'ouverture :
Lors de la runion d'ouverture, le droulement de laudit tel qu'il a t communiqu par
crit l'entreprise est confirm. L'auditeur sassure quil n'y a pas d'obstacles quant au
planning et au droulement de laudit et la disponibilit des documents et des
personnes.
Examen et valuation des rsultats :
Lauditeur vrifie si les prescriptions dhygine prvues dans le Guide dAutocontrle sont
respectes et si les registres prvus sont prsents et sils comportent les lments
ncessaires et sont correctement conservs.
Les documents prsents sont contrls, valus quant leur contenu par lauditeur qui
est galement attentif, lors des interviews et des contrles visuels, la mise en uvre
pratique des exigences.
Une certaine tolrance peut tre accepte l'gard des erreurs non conscientes ,
mais le nombre de non-conformits, l'interprtation des chiffres et la confiance que
suscite la mise en uvre des bonnes pratiques dhygine et la tenue des registres sont
dterminants pour le rsultat final.
En cas de manquements, l'auditeur prpare un rapport prsenter lexploitant lors de
la runion de clture.
Runion de clture
Lors de la runion de clture, les rsultats sont communiqus l'entreprise par l'auditeur.
Les principales non-conformits constates sont communiques. Les non-conformits
graves sont, cependant, exposes aux responsables de lentreprise et communiques
par crit ds la fin de l'audit. Les responsables de lentreprise peuvent proposer des
actions correctives. L'auditeur communique son avis propos des actions correctives.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
136
Aprs laudit, un rapport est rdig par l'auditeur et envoy l'entreprise. Si tout est en
ordre, lauditeur signe pour validation de la mise en uvre des bonnes pratiques
dhygine et de la tenue registres . Dans le cas contraire, une dcision peut tre prise
par les autorits suite ce rapport (ex. : nouvel audit, interdiction dexploiter,). Les non-
conformits doivent tre corriges pour laudit suivant. De mme, il peut tre dcid en
fonction des constatations de modifier le rgime daudit appliqu.
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
137
Notes personnelles
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
138
Notes personnelles
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Chapitre3
Le Systme
dautocontrle
et les Guides
dautocontrle
3
Abrviations et
acronymes les plus
utiliss
140
Abrviations et acronymes
les plus utiliss
ACP
Afrique Carabe Pacifique (pays du Groupe des ACP, ayant sign une
srie daccords particuliers avec lUE appel accords de Cotonou )
ACV Analyse du Cycle de Vie
AOEL
Acceptable Operator Exposure Level : Niveau dexposition acceptable pour
loprateur dans le cas de lpandage des pesticides
ARfD Acute Reference Dose, Dose de rfrence aigu
ARP Analyse des Risques Professionnels
BPA
Bonnes Pratiques Agricoles (ensemble des conditions dapplication qui
doivent tre dfinies : dose, volume, formulation, technique, DAR)
BPL Bonnes Pratiques de Laboratoire
BPP
Bonnes Pratiques Phytosanitaires (ensemble de consignes respecter pour
viter la contamination de loprateur, de lenvironnement et les rsidus)
CAS Chemical Abstracts Services. N didentification des substances chimiques.
CCP Points critiques pour la matrise (dans la mthode HACCP)
CIPV Convention Internationale pour la Protection des Vgtaux
CLP
Le rglement CLP est lappellation donne au Rglement (CE) 1272/2008
relatif la classification, ltiquetage et lemballage des substances et
des mlanges
CMR Substances cancrognes, mutagnes ou reprotoxiques
Abrviations
et acronymes
141
CNUED Confrence des Nations Unies sur l'Environnement et le Dveloppement
DAR Dlai avant rcolte (nombre de jours respecter avant la rcolte)
DJA Dose journalire acceptable (en mg/kg pc/jour)
DL
50
Dose ltale 50 (en mg/kg pc)
DSE Dose sans effet (observ). Synonymes : NOAEL.
DT
50
Temps de demi-vie dune substance dans un sol donn (en jours)
EC Concentr mulsionnable, formulation liquide de pesticide base de solvant
EPA Environmental Protection Agency (USA)
EPI Equipement de Protection Individuelle (en anglais PPE)
ETI Ethical Trading Initiative
EVPP Emballages Vides de Produits Phytosanitaires
EvRP Evaluation des Risques Professionnels
FAO
Food and Agriculture Organisation : organisation des Nations Unies charge
de traiter des problmes dalimentation dans le Monde
FDS
Fiche de donnes de scurit : note technique o sont repris les dangers
dun produit, les moyens de prvention et les mesures durgence
FLO
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) est une association de
20 initiatives de labellisation quitables situes dans plus de 21 pays
HACCP
Systme qui dfinit, value et matrise les dangers qui menacent la salubrit
des aliments (analyse des dangers et points critiques pour la matrise)
Abrviations
et acronymes
142
IARC International Agency for Research on Cancer
ICM Integrated Crop Management ou Production intgre
ILO International Labour Organisation
INERIS Institut National de l'Environnement industriel et des risques
INRS Institut National de Recherche et de Scurit
IPM Integrated Pest Management ou Lutte intgre contre les parasites (LIP)
ISO
International Standard Organisation. ISO regroupe les organismes nationaux
de normalisation de 149 pays et labore des normes internationales
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
JECFA Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
Kd Coefficient dadsorption (dun pesticide sur un sol donn)
LD Limite de dtection
LMR Limite Maximale applicable aux Rsidus
LOAEL
Lowest observed adverse effect level. Le niveau de concentration le plus
faible provoquant un effet nfaste. Voir aussi DSE, Dose sans Effet.
LOQ Limite de quantification (aussi LD : limite de dtermination)
MSDS Medical Safety Data Sheet (en franais FDS)
NOAEL No Observed Adverse Effect Level ou DSE (en franais Dose sans Effet)
Abrviations
et acronymes
143
NVP Norme Volontaire Prive
OCDE Organisation de Coopration et de Dveloppement Economique
OCI Organisme de Certification Indpendant
OEPP Organisation Europenne de Protection des Plantes (ou EPPO en anglais)
OGM Organisme Gntiquement Modifi
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series
OILB Organisation Internationale de Lutte Biologique
OIT Organisation Internationale du Travail
OMC Organisation Mondiale du Commerce
OMS Organisation Mondiale de la Sant
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OSHA-EU European Agency for Safety and Health at Work
PCB Polychlorobiphnyles, composs aromatiques chlors (209 congnres)
PCR Technique damplification de squences de gnes
PNEC Concentration sans effet prvisible pour les organismes aquatiques
Abrviations
et acronymes
144
PPNU Produit Phytosanitaire Non Utilisable (prim ou obsolte)
PTMI Provisional Tolerable Monthly Intake
PTWI Provisional Tolerable Weekly Intake
RCE Risque Chimique Emergent
REACH Rglement (CE) 1907/2006 sur les substances chimiques (1er juin 2007)
RSE Responsabilit sociale des entreprises
SA 8000
Norme considre comme la premire norme prive internationale de
rfrence sur les droits et le respect de l'individu au travail
SGH Systme Gnral Harmonis (classification et tiquetage des produits)
SME Systme de Gestion Environnementale
SMQS Systme de Management de la Qualit Sanitaire
TDI Tolerable Daily Intake
TEQ Equivalence toxique
TIAC Toxi-Infections Alimentaires Collectives
TNC Tesco Nature Choice : standard priv de TESCO
TWI Tolerable Weekly Intake
UE Union europenne
Abrviations
et acronymes
145
UL Solution huileuse concentre, formulation liquide de pesticide
UNECE The United Nations Economic Commission for Europe
VLEP Valeur Limite d'Exposition Professionnelle
VTR Valeur toxicologique de rfrence
WG Granul dispersable dans leau, formulation solide de pesticide
WP Poudre mouillable, formulation solide de pesticide
Abrviations
et acronymes
146
3
Rfrences
bibliographiques
148
Rfrences bibliographiques
AFSCA (2004).
Guide des Bonnes pratiques agricoles en matire de scurit alimentaire , dit par
lAgence Fdrale pour la Scurit Alimentaire, AFSCA (diteur responsable : Piet
Vanthemsche, rdaction: DG Contrle, version fvrier 2004).
AFSCA (2005).
Terminologie en matire d'analyse des dangers et des risques selon le Codex
alimentarius. PB 05 - I 01 - REV 0 2005 30.
AFSCA (2005).
Lautocontrle, galement dans votre entreprise. Brochure davril 2005. D/2005/10413/6.
AFSCA (2007).
Lvaluation du risque en tant que processus de base dun avis formel du Comit
Scientifique (Approche gnrale pragmatique). DRAFT-Version 5: 19-3-07.
BAERT, K., DE MEULENAER, B., VERDONCK F., HUYBRECHTS, I., DE HENAUW, S.,
VANROLLEGHEM, P., DEBEVERE, J. & DEVLIEGHERE F. (2006).
La patuline dans le jus de pomme. Workshop Sci. Com, AFSCA -FASFC, Bruxelles, 20
October, 2006.
BLANC, D. (2007).
ISO 22000 HACCP et scurit des aliments. 2e dition, AFNOR Editions, La Plaine
Saint-Denis, 416 pages.
BLANDIN, B. (2005).
Normes, standards, labels, chartes et dmarches qualit pour le-formation, in CEDEFOP
Centre Info. Pratiques innovantes en formation et enjeux pour la professionnalisation des
acteurs. Luxembourg : Office des publications officielles des Communauts
europennes, p. 52-57.
BTSF (Better Training for Safer Food, DG SANCO) (2010).
Lharmonisation de linspection en hygine alimentaire. Document de travail final.
BTSF - Une Meilleure Formation Pour Des Denres Alimentaires Plus Sres -
Programme Afrique. Organisation and implementation of food security training activities
in Africa. SANCO/D3/2008/SI2.514845, Dr. R.BONNE et F. BOCCAS, AETS, 25 janvier
2010, 43 pages.
BTSF (Better Training for Safer Food, DG SANCO) (2010).
Guide dApplication. Bonnes Pratiques de Fabrication, Bonnes Pratiques dHygine et
HACCP (Manuel). Rdaction coordonne par Dr. R.BONNE, AETS, 2010, 115 pages.
BOUTOU, O. (2008).
De lHACCP lISO 22000 Management de la scurit des aliments. 2me dition,
AFNOR Editions, La Plaine Saint-Denis, 332 pages.
Rfrences
149
CLAEYS, W., SCHMIT J.F., BRAGARD C., MAGHUIN-ROGISTER G., PUSSEMIER L. &
SCHIFFERS B. (2010)
Exposure of several Belgian consumer groups to pesticide residues through fresh fruit
and vegetable consumption.
Food Control 22 (2011): 508-516.
COMMISSION EUROPEENNE (DG SANCO) (2002).
Preliminary report: Risk assessment of food borne bacterial pathogens: quantitative
methodology relevant for humane exposure assessment.
COMMISSION EUROPEENNE (DG SANCO) (2005).
Guidance Document - Key questions related to import requirements and the new rules on
food hygiene and official food controls, DG SANCO 2005, 29 pages.
COMMISSION EUROPEENNE (DG SANCO) (2005).
Guidance Document - Implementation of procedures based on the HACCP principles,
and facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses,
DG SANCO 2005, 29 pages.
DOUCET, C. (2005).
La qualit. PUF, Paris, 128 pages.
EFSA Strategy for cooperation and networking between the EU member states and
EFSA (MB 19.12.2006).
FAO & OMS (Commission du Codex Alimentarius) (2003).
Code dusages international recommand Principes gnraux dhygine alimentaire,
CAC/RCP 1-1969, Rv. 4 (2003), 29 pages.
FAO & OMS (Commission du Codex Alimentarius) (2003).
Code dusages en matire dhygine pour les fruits et lgumes frais (CAC/RCP 53 -
2003), 26 pages.
FAO & OMS (Commission du Codex Alimentarius) (2006).
Principes applicables la traabilit/traage des produits en tant quoutil dun systme
dinspection et de certification des denres alimentaires. CAC/GL 60-2006, 3 pages.
FAO & WHO (2007).
Analyse des risques relatifs la scurit sanitaire des aliments. Guide lusage des
autorits nationales responsables de la scurit sanitaire des aliments.
Etude FAO Alimentation et nutrition, N87, FAO, Rome, 120 p.
FAO & OMS (Commission du Codex Alimentarius) (2007).
Principes de travail pour lanalyse des risques en matire de scurit sanitaire des
aliments destins tre appliqus par les gouvernements. FAO & WHO, Premire
dition. Rome, 33 pages.
FAO (2008).
Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP 1 31), Secrtariat de la
Convention internationale pour la protection des vgtaux, FAO, Rome, dition 2008, 432
pages.
Rfrences
150
ISO (2005).
ISO 22000 :2005 - Systmes de management de la scurit des produits alimentaires -
Exigences pour les organismes tous les niveaux de la chane alimentaire, ISO, 2005.
KLETER, G.A., POELMAN, M., GROOT, M.J. & MARVIN, H.J.P. (2006).
Inventory of possible emerging hazards to food safety and an analysis of critical factors.
Report 2006.010. RIKILT.
OIE (2004).
- Handbook on import risk analysis for animals and animal products.
Vol 1. Introduction and qualitative risk analysis.
- Handbook on import risk analysis for animals and animal products.
Vol 2. Quantitative risk assessment.
OECD (2006).
Guidelines on Risk Analysis. Scheme for the Application of International Standards for
Fruit and Vegetables. AGR/CA/FVS (2006)1. Criteria for defining inspection priorities.
SAEGERMAN, C. (2006).
Risk assessment: a continuous approach. Slides du Workshop Sci Com, AFSCA -
FASFC, Bruxelles, 20 October, 2006.
SCHIFFERS (2006).
Guidelines pour la ralisation dune analyse des risques sur une filire. COLEACP/PIP.
UG/PIP Octobre 2006, 19 pages.
Rfrences
3
Sites Web utiles
152
Sites Web utiles
AFSCA-FAVV (Agence belge de scurit sanitaire) :
http://www.afsca.be/home-fr/
ANSES (Agence franaise de scurit sanitaire) :
http://www.anses.fr/
ACIA (Agence canadienne dinspection des aliments / Canadian Food Inspection
Agency) :
http://www.inspection.gc.ca/
BRITISH RETAIL CONSORTIUM (BRC) :
http://www.brcdirectory.com/
COMMISSION EUROPEENNE :
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_fr
COMMISSION EUROPEENNE : Base de donnes sur les pesticides (LMR et VTR)
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
FOOD SAFETY MANAGEMENT :
http://www.foodsafetymanagement.info
FSS (Food Surveillance System) :
http://www.food.gov.uk/enforcement/monitoring/fss/
GLOBALG.A.P :
http://www.globalgap.org
INTERNATIONAL FOOD SAFETY :
http://www.ifs-online.eu
NORME-ISO22000.INFO :
http://www.norme-iso22000.info/pourquoi.htm
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) :
http://www.iso.org/iso/fr/22000_implementation_ims_06_03.pdf
PSD (Pesticide Safety Directorate) :
http://www.pesticides.gov.uk/
RASFF(CE) :
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
Sites Web
3 ANALYSE DES RISQUES ET AUTOCONTRLE EN PRODUCTION
8 ORGANISATION ET TECHNIQUES DE FORMATION
9 PRODUIRE DE FAON DURABLE ET RESPONSABLE
10 LUTTE BIOLOGIQUE ET PROTECTION INTGRE
11 LA PRODUCTION THIQUE
12 PRODUIRE EN ACP DES FRUITS ET LGUMES ISSUS DE
LAGRICULTURE BIOLOGIQUE
Manuels de formation
du COLEACP-PIP
Le PIP est nanc par lUnion europenne. Imprim sur du papier certi FSC, laide dencres cologiques sans solvant.
Date de publication : Mars 2011
Vous aimerez peut-être aussi
- Cas PratiqueDocument8 pagesCas PratiqueARKAS100% (1)
- CV Omar KSIBI FR 01-2023Document6 pagesCV Omar KSIBI FR 01-2023Omar KSIBIPas encore d'évaluation
- ISO 22000 Module de Soutien N 2 Diag HACCP Selon ISO 22000Document10 pagesISO 22000 Module de Soutien N 2 Diag HACCP Selon ISO 22000Safa el ouedPas encore d'évaluation
- Qualite Securite AlimentaireDocument2 pagesQualite Securite AlimentaireYasmine Badys100% (1)
- 2 - Création D'entrepriseDocument53 pages2 - Création D'entrepriseghribiemna100% (1)
- IFS Food7 Comparison of IFS Food Version 7 and IFS Food v61 FRDocument30 pagesIFS Food7 Comparison of IFS Food Version 7 and IFS Food v61 FRLobna TaakchatPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Vanelli198 (1) (1) Nouv3333Document31 pagesRapport de Stage Vanelli198 (1) (1) Nouv3333issam_da92% (12)
- HACCPDocument38 pagesHACCPachraf ezzouhairiPas encore d'évaluation
- Haccp 2014Document22 pagesHaccp 2014FouratZarkouna100% (1)
- HACCPDocument88 pagesHACCPامةاللهPas encore d'évaluation
- HaccpDocument12 pagesHaccpfatiha elgharbaouiPas encore d'évaluation
- Analyses Des Dangers AnssesDocument29 pagesAnalyses Des Dangers AnssessimaPas encore d'évaluation
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension C - Interactions avec les parties prenantesD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension C - Interactions avec les parties prenantesPas encore d'évaluation
- Manuel de communication sur les risques appliquée à la sécurité sanitaire des alimentsD'EverandManuel de communication sur les risques appliquée à la sécurité sanitaire des alimentsPas encore d'évaluation
- Commission du Codex Alimentarius: Manuel de Procédure Vingt-sixième editionD'EverandCommission du Codex Alimentarius: Manuel de Procédure Vingt-sixième editionÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension B – Fonctions de contrôleD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension B – Fonctions de contrôlePas encore d'évaluation
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension A – Intrants et ressourcesD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Dimension A – Intrants et ressourcesPas encore d'évaluation
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Introduction et glossaireD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Introduction et glossairePas encore d'évaluation
- La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2021: Rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients face aux chocs et aux situations de stressD'EverandLa situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2021: Rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients face aux chocs et aux situations de stressPas encore d'évaluation
- Coleacp Manuel 1 FR 0 PDFDocument346 pagesColeacp Manuel 1 FR 0 PDFzgbfaija67% (3)
- Guide Analyse Des Dangers Bacteriologiques ACTION QUALITE PDFDocument36 pagesGuide Analyse Des Dangers Bacteriologiques ACTION QUALITE PDFإلا عقيدتناPas encore d'évaluation
- Construire Un Plan de Nettoyage PDFDocument20 pagesConstruire Un Plan de Nettoyage PDFazizaPas encore d'évaluation
- Support de Cours Haccp PP DessDocument36 pagesSupport de Cours Haccp PP Desskira525Pas encore d'évaluation
- Les Bonnes Pratiques D Hygi Ne 1650827515Document13 pagesLes Bonnes Pratiques D Hygi Ne 1650827515Harisson Ulrich BENIE100% (1)
- GBPH HaccpDocument146 pagesGBPH HaccpKeith KelewouPas encore d'évaluation
- Livret 10 Questions ISO22000Document24 pagesLivret 10 Questions ISO22000sabourikhalid4745Pas encore d'évaluation
- Actia Guide Tracabilite 2007-1Document79 pagesActia Guide Tracabilite 2007-1tirlirePas encore d'évaluation
- Management Hygiène Et Sécurité AlimentaireDocument71 pagesManagement Hygiène Et Sécurité Alimentairelatifa aqchachPas encore d'évaluation
- HACCPDocument10 pagesHACCPMohamed Bourza100% (1)
- Hygiene Et Securite SONAPI-2Document42 pagesHygiene Et Securite SONAPI-2jean bidlynePas encore d'évaluation
- 2022 - Support Formation Licence Professionnelle Aix Marseille - Sécurité Alimentaire CopieDocument131 pages2022 - Support Formation Licence Professionnelle Aix Marseille - Sécurité Alimentaire CopieSalim BouhlelPas encore d'évaluation
- Cours Limites HACCPDocument17 pagesCours Limites HACCPRAFIQ100% (1)
- Hygiene AlimentaireDocument3 pagesHygiene AlimentaireAminePas encore d'évaluation
- Annexe 7Document40 pagesAnnexe 7DonMidowPas encore d'évaluation
- Qualité Sécurité Environnement PDFDocument32 pagesQualité Sécurité Environnement PDFBenouna FertPas encore d'évaluation
- ESEBAT-L3-Cours Qualité Sécurité-M DIOUFDocument100 pagesESEBAT-L3-Cours Qualité Sécurité-M DIOUFHabibe Tran-van100% (2)
- Tracabilite CharvetDocument55 pagesTracabilite CharvetMohamed ElbaghdadiPas encore d'évaluation
- Formation Iso 22000 LhichouDocument128 pagesFormation Iso 22000 LhichouMed Errami100% (2)
- HACCP - Management Securite Aliments 1Document130 pagesHACCP - Management Securite Aliments 1achnid mohamed100% (1)
- Haccp & Iso 22000Document56 pagesHaccp & Iso 22000Patricia Kamdoum100% (1)
- Principes Enjeux Management Integre QSEDocument80 pagesPrincipes Enjeux Management Integre QSEToufik DehilisPas encore d'évaluation
- Demarche Haccp en Cuisine de Collectivite PDFDocument37 pagesDemarche Haccp en Cuisine de Collectivite PDFHadja SavanéPas encore d'évaluation
- Cours CopagDocument111 pagesCours CopagAnonymous MKSfyYyODPPas encore d'évaluation
- Module-Maitrise de L'environnement agroalimentaire-2023-02-23FRDocument65 pagesModule-Maitrise de L'environnement agroalimentaire-2023-02-23FRAnne Marie PEVROL100% (1)
- Emergence Des RisquesDocument314 pagesEmergence Des RisquesAmine Hiba100% (3)
- Module Contrôle de Points Critiques (CCP) Dr. ZOUAOUI N.Document74 pagesModule Contrôle de Points Critiques (CCP) Dr. ZOUAOUI N.Aouaichia Rania100% (1)
- Module 2 - SSA HACCP Codex AlimentariusDocument31 pagesModule 2 - SSA HACCP Codex AlimentariusAyoub OUBAHA100% (1)
- Guide de Bonnes Pratiques D'hygiène - 30112021Document91 pagesGuide de Bonnes Pratiques D'hygiène - 30112021chafikPas encore d'évaluation
- Manuel Du Modèle HACCP Générique Pour Les Secteurs Du Remballage Et Du Commerce en Gros Des Fruits Et Légumes FraisDocument38 pagesManuel Du Modèle HACCP Générique Pour Les Secteurs Du Remballage Et Du Commerce en Gros Des Fruits Et Légumes FraisWalid RahmouniPas encore d'évaluation
- Fruit Et LégumeDocument81 pagesFruit Et LégumehatemPas encore d'évaluation
- Equipement Protection RespiratoireDocument26 pagesEquipement Protection RespiratoireMahmoud Abbas100% (1)
- Module Soutien Iso22000 12Document14 pagesModule Soutien Iso22000 12Laritta2010100% (1)
- Manuel HACCPDocument18 pagesManuel HACCPSaleh ChekPas encore d'évaluation
- 05 - Ehpad240512 Plan de Nettoyage HaccpDocument17 pages05 - Ehpad240512 Plan de Nettoyage HaccpEDITH KOUAMEPas encore d'évaluation
- Guide D'utilisation Pour La Mise en Place D'une Démarche HACCPDocument9 pagesGuide D'utilisation Pour La Mise en Place D'une Démarche HACCPkomad12Pas encore d'évaluation
- Coleacp Manuel 2 FR 0Document122 pagesColeacp Manuel 2 FR 0Hasnaa Mb100% (1)
- Traçabilité HACCPet BPHDocument47 pagesTraçabilité HACCPet BPHDjamel HamoudiPas encore d'évaluation
- Manuel HACCP Guide Élaboration PDFDocument10 pagesManuel HACCP Guide Élaboration PDFSharif-dine Mora LafiaPas encore d'évaluation
- 5S - Master2 GMPRDocument171 pages5S - Master2 GMPREddehbiPas encore d'évaluation
- SF2H Recommandations Hygiene Des Mains 2009Document102 pagesSF2H Recommandations Hygiene Des Mains 2009zeugma2010Pas encore d'évaluation
- Guide Cervia - IsO 22000Document17 pagesGuide Cervia - IsO 22000komad12100% (1)
- TheseDocument125 pagesTheseMarwa AlayaPas encore d'évaluation
- Prévention Des Risques Pro Liés Au RestaurationDocument20 pagesPrévention Des Risques Pro Liés Au RestaurationMahmoud Mansy100% (2)
- LeadershipDocument5 pagesLeadershipjackPas encore d'évaluation
- Présentation INSA Rouen 28 Nov 19-EnvironnementDocument100 pagesPrésentation INSA Rouen 28 Nov 19-Environnementbrahim chalhoubPas encore d'évaluation
- Project Management Professional (PMP) : Grandes Lignes Du Contenu de L'examen - Janvier 2021Document20 pagesProject Management Professional (PMP) : Grandes Lignes Du Contenu de L'examen - Janvier 2021ghribiemnaPas encore d'évaluation
- CQ Au Laboratoire Des Essais PhysicochimiquesDocument17 pagesCQ Au Laboratoire Des Essais PhysicochimiquesghribiemnaPas encore d'évaluation
- Thèse Emballage ChitosaneDocument178 pagesThèse Emballage Chitosaneghribiemna100% (4)
- 1 Ae DLCDocument55 pages1 Ae DLCghribiemnaPas encore d'évaluation
- F08 Lagunage AereDocument10 pagesF08 Lagunage AereghribiemnaPas encore d'évaluation
- Procédés Biotechnologiques InnovantsDocument39 pagesProcédés Biotechnologiques InnovantsghribiemnaPas encore d'évaluation
- Cours ConceptionDocument59 pagesCours Conceptionsbenlatifa100% (4)
- Prétraitements de La Biomasse LignocellulosiqueDocument41 pagesPrétraitements de La Biomasse LignocellulosiqueghribiemnaPas encore d'évaluation
- Dossier - Type - Agrement - Fermier LaiterieDocument49 pagesDossier - Type - Agrement - Fermier Laiteriealex brinPas encore d'évaluation
- Manuel Du Modèle HACCP Générique Pour Les Secteurs Du Remballage Et Du Commerce en Gros Des Fruits Et Légumes FraisDocument38 pagesManuel Du Modèle HACCP Générique Pour Les Secteurs Du Remballage Et Du Commerce en Gros Des Fruits Et Légumes FraisWalid RahmouniPas encore d'évaluation
- Contribution A L'audit de Suiv - QARCH Kenza - 2791 PDFDocument80 pagesContribution A L'audit de Suiv - QARCH Kenza - 2791 PDFKhalil ValhallaPas encore d'évaluation
- Poissonnerie Mai 2020Document6 pagesPoissonnerie Mai 2020jonathanPas encore d'évaluation
- Guide Cervia ISO 22000Document17 pagesGuide Cervia ISO 22000boualemtitiche1966Pas encore d'évaluation
- Cours 06 Qualite AlimentsDocument12 pagesCours 06 Qualite AlimentsMohammed Salim AmmorPas encore d'évaluation
- Boudjelti Mohamed Lamine Et Lasni Mahdi CopieDocument138 pagesBoudjelti Mohamed Lamine Et Lasni Mahdi CopieSamamo Dasilva100% (1)
- Restauration BR (1041)Document81 pagesRestauration BR (1041)Narcisse DoréePas encore d'évaluation
- Eau Potable Zenoauki HallalDocument35 pagesEau Potable Zenoauki HallalMoundir AmraniPas encore d'évaluation
- F904a-Auditor-Checklist-Site-Self-Assessment-Tool-V1 (1) FRDocument110 pagesF904a-Auditor-Checklist-Site-Self-Assessment-Tool-V1 (1) FRAmine Simo JacksonPas encore d'évaluation
- Guide BPH Pour Les Crustacés CuitsDocument461 pagesGuide BPH Pour Les Crustacés CuitsOmar KSIBIPas encore d'évaluation
- Manuel Pour Garantir Les Conditions de Sécurité Sanitaire-PoissonsDocument41 pagesManuel Pour Garantir Les Conditions de Sécurité Sanitaire-PoissonsFousseyni TRAOREPas encore d'évaluation
- 1951THV 1Document89 pages1951THV 1Rania AllaouaPas encore d'évaluation
- Recommandations Pour L'elaboration de Criteres Microbiologiques D'hygiene Des ProcedesDocument17 pagesRecommandations Pour L'elaboration de Criteres Microbiologiques D'hygiene Des ProcedesAmina Ait MalhaPas encore d'évaluation
- Redaction de Stage de Fin D'etudeDocument51 pagesRedaction de Stage de Fin D'etudeBourgeois Atangana NoahPas encore d'évaluation
- Original Plan D'affaire Nettoyage 3.0 (1) FRDocument21 pagesOriginal Plan D'affaire Nettoyage 3.0 (1) FRTresor KayitabaPas encore d'évaluation
- Hygiene TabtiDocument65 pagesHygiene TabtiihcPas encore d'évaluation
- Décret N°2023-2160 Relatif Au Contrôle Des Produ - 231114 - 143333Document23 pagesDécret N°2023-2160 Relatif Au Contrôle Des Produ - 231114 - 143333aboubacarfa206Pas encore d'évaluation
- Haccp MinoterieDocument47 pagesHaccp MinoterieDjawed BoutPas encore d'évaluation
- Communication KOLLI Hygine 17-140Document41 pagesCommunication KOLLI Hygine 17-140Selwa BayouPas encore d'évaluation
- Définition de l'HACCP PDFDocument1 pageDéfinition de l'HACCP PDFYsaline DevignePas encore d'évaluation
- 12 V1N1 MJBS 209-232Document24 pages12 V1N1 MJBS 209-232ESSANHAJI AliPas encore d'évaluation
- 156671-Article Text-408552-1-10-20170526 PDFDocument13 pages156671-Article Text-408552-1-10-20170526 PDFFREDERIC NZALEPas encore d'évaluation
- ADIAL - Brochure - Distributeur Automatique Pizzas 2020Document40 pagesADIAL - Brochure - Distributeur Automatique Pizzas 2020Marouan El MasbahiPas encore d'évaluation
- 3 - Formation - Usda - HaccpDocument6 pages3 - Formation - Usda - HaccpyoucefPas encore d'évaluation
- Plaquette Fel Part 2010Document4 pagesPlaquette Fel Part 2010stewe2009Pas encore d'évaluation