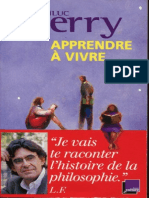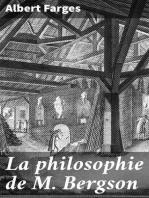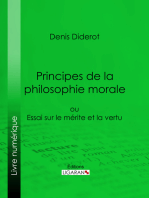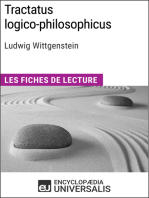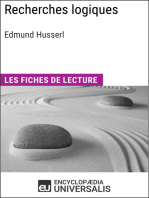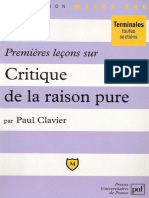Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ricoeur Les Sens D Une Vie
Ricoeur Les Sens D Une Vie
Transféré par
jamming1001Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ricoeur Les Sens D Une Vie
Ricoeur Les Sens D Une Vie
Transféré par
jamming1001Droits d'auteur :
Formats disponibles
03-04-2008
08:02
Page 1
Franois Dosse
Paul Ricur
Les sens dune vie
(1913-2005)
CHAPITRES ANNEXS
La Dcouverte
9 bis, rue Abel-Hovelacque
75013 Paris
La Dcouverte, 2001, 2008
III.1/III.2
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 2
III.1/III.2
09-04-2008
18:26
Page 3
Sommaire
ANNEXES LA PARTIE III
1. Le triomphe de lexistentialisme sartrien ...................................
2. Une voie phnomnologique inspire par Merleau-Ponty ......
5
13
ANNEXE LA PARTIE IV
1. Lintroducteur de Husserl ...........................................................
21
ANNEXES LA PARTIE V
1. Esprit aprs le tournant de 1958 .................................................
2. Massy-Palaiseau sous le charme de Louis-Simon .....................
33
41
ANNEXES LA PARTIE VI
1. La confrontation avec le marxisme althussris ........................
2. La dmythologisation chez les catholiques ...............................
3. La dmythologisation chez les protestants ................................
4. Un heideggrianisme bien tempr ............................................
53
63
73
85
ANNEXE LA PARTIE VII
1. Leuven-Paris : les archives Husserl ............................................
93
ANNEXE LA PARTIE VIII
1. Temps et Rcit en dbat ...............................................................
103
ANNEXES LA PARTIE IX
1. Le plus court chemin de soi soi passe aussi par ltranger ....
2. La rfrence du tournant pragmatique et interprtatif
des sciences humaines ..................................................................
113
127
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 4
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 5
A.III.1
Le triomphe de lexistentialisme sartrien
Pendant que Ricur savoure le calme propice llaboration de sa thse
au Chambon-sur-Lignon, Jean-Paul Sartre devient ltoile triomphante
de la philosophie : son influence dpasse de trs loin le seul milieu des philosophes professionnels. la faveur de lengouement dont il bnficie, il
innove en faisant descendre la philosophie dans la rue, dans les cafs.
Lexistentialisme devient lexpression dune soif de vivre aprs les longues
annes noires de la guerre. Comme lcrit Simone de Beauvoir, lexistentialisme est sur toutes les bouches en lautomne 1945. Sa simple vocation
attire les foules et les bousculades.
Lannonce de la confrence de Sartre Lexistentialisme est un humanisme le 29 octobre 1945, organise par le club Maintenant, provoque
quasiment une meute. Le guichet dentre est rduit nant par une foule
compacte qui se bouscule pour prendre place. Sartre arrive seul par le
mtro et croit une manifestation dhostilit des communistes, car le parti
des 75 000 fusills napprcie gure ses orientations philosophiques qualifies de bourgeoises . Le dbut de sa confrence est dailleurs destin
leur rpondre. Mais Sartre se trompe ; ce sont ses fans qui sont venus
fter le nouveau matre des temps modernes, avides dapprendre de la
bouche du matre ce quest lexistentialisme : un mode de vie ? une philosophie ? la mode de Saint-Germain-des-Prs ?
La presse se fait lcho amplifi de cet vnement culturel sans prcdent qui voit un philosophe provoquer Paris quinze vanouissements , trente siges dfoncs . Une star est ne : La confrence du
club Maintenant devint rtrospectivement le must suprme de lanne
1945 1 , immortalis peu aprs par Boris Vian dans Lcume des jours
1. Annie COHEN-SOLAL, Sartre, Gallimard, Paris, 1985, p. 331.
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 6
PAUL RICUR
dans la scne o Jean-Sol Partre, ouvrant la route coups de hache ,
progresse lentement vers lestrade.
Sartre, nophyte sur la scne intellectuelle en cet aprs-guerre, incarne
le dsir de coupure absolue tant avec lavant-guerre et ses compromissions coupables quavec les horreurs de la guerre. Il devient le matre
penser dune France livre elle-mme : Sartre qui na (malgr son dsir)
t ni lhomme de la Rsistance ni celui de la Libration est lhomme de la
fin de la guerre 2. Il exprime alors ce besoin radical de recommencement,
de renaissance, dune France qui veut rompre avec son pass : Dieu est
mort, les droits imprescriptibles et sacrs sont morts, la guerre est morte,
avec elle ont disparu les justifications et les alibis quelle offrait aux mes
faibles 3.
La rumeur se rpand vite : un phnomne est n, lexistentialisme, il a
son gourou, ses avocats et ses dtracteurs. Certains exgtes en proposent
une version commerciale pour achever de convaincre un public davance
sduit. Ainsi, Christine Cronan publie en 1948 un Petit Catchisme de
lexistentialisme pour les profanes, qui en fait une nouvelle religion. Mais
quelle est donc cette philosophie qui sort du silence de la nuit ? La thse
de la philosophie sartrienne est de dmontrer que lexistence prcde
lessence . Sartre se fait, avec lexistentialisme, lintroducteur du programme phnomnologique, celui de Husserl, dont il dcouvre luvre
ds 1933 lorsquil sjourne Berlin. Mais il ajoute aux thses husserliennes, partir de 1939, comme lattestent les Carnets de la drle de
guerre, les thses de Heidegger. Mlange dontologie heideggerienne et de
phnomnologie husserlienne, Ltre et le Nant propose une version
singulire, propre Sartre, qui donne au nant un statut prvalent. Cest
partir de cette nantisation que la libert peut prendre forme. Le premier
principe de lexistentialisme est daffirmer quil ny a pas de nature
humaine, que le propre de lhomme est de nen pas avoir, contrairement
au coupe-papier dtermin par ses proprits, par son essence. partir de
ce postulat lhomme devient pleinement responsable de ce quil est :
Lhomme est condamn tre libre 4. Do sans doute laudience
exceptionnelle de cette philosophie : le climat de la Libration cre une
situation de symbiose tout fait exceptionnelle entre la libert retrouve
de la France et la vision sartrienne de la libert.
Lontologie sartrienne oppose deux rgions de ltre : l tre-poursoi de la conscience humaine prrflexive et l tre-en-soi opaque
2. Paul THIBAUD, Jean-Paul Sartre : un magistre ? , Esprit, juillet-aot 1980, repris dans
Traverses du XXe sicle, La Dcouverte, Paris, 1988, p. 163.
3. Jean-Paul SARTRE, La fin de la guerre , Situations III, Gallimard, Paris, 1949, cit par
Paul THIBAUD, art. cit, p. 164.
4. Jean-Paul SARTRE, Lexistentialisme est un humanisme, Nagel, Paris, 1946, p. 37.
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 7
LE TRIOMPHE DE LEXISTENTIALISME SARTRIEN
lui-mme. Le tragique de lhomme se situe pour lui dans cette tentation
constante de rduire l tre-pour-soi l tre-en-soi , ce quil est. La
sortie de cette tension se trouve pour Sartre dans le pouvoir de rupture
quest le nant : Cette possibilit pour la ralit humaine de scrter un
nant qui lisole, Descartes, aprs les stociens, lui a donn un nom : cest
la libert 5. Cest donc une philosophie de la libert que dploie Sartre.
Il explique le faible usage que lhomme en fait par lampleur de la mauvaise foi. Le personnage du garon de caf au geste vif, inclin avec
empressement et sollicitude vers la table des consommateurs, est devenu
lgendaire. quoi joue-t-il ? se demande Sartre : Il joue tre garon de
caf. Son tre chappe son tat et cette inadquation le contraint dautant plus correspondre sa fonction. Le garon de caf va trs vite devenir la figure ponyme de la mauvaise foi qui est au cur de la philosophie
sartrienne telle quelle se donne lire dans Ltre et le Nant, paru en
1943, mais qui marque surtout lanne 1945.
Lexistentialisme se veut un humanisme chez Sartre. Le sens quil
donne lhumanisme est que lhomme est constamment hors de lui-mme
et nexiste quen se projetant hors de lui pour rejoindre un univers
humain. Cest cette relation transcendante dans laquelle lhomme sort de
son enfermement en lui-mme qui dfinit l humanisme existentialiste .
Heidegger, dont Sartre dit que son influence fut providentielle, ne reconnat cependant pas en Sartre un disciple et, ds 1946, il envoie Jean
Beaufret sa Lettre sur lhumanisme, dans laquelle il rcuse linterprtation humaniste de sa pense que dveloppe Sartre. Loin dtre une
simple mcomprhension, il y a l vritable dsaccord de fond entre les
deux projets philosophiques. Sartre se refuse dporter la question de
l origine du nant hors de la ralit humaine. Dun ct, Heidegger
sefforce de penser lhomme non plus comme sujet, mais comme Dasein 6,
de construire une archologie du cogito dans laquelle lhomme se trouve
dcentr, assujetti une histoire dont il nest plus le sujet. De lautre,
Sartre poursuit le projet cartsien de penser partir du cogito en remodelant la conception de la conscience dans un sens qui approfondit la
thmatique de la libert du ct du sujet pratique.
Pour Sartre, lexistentialisme se divise selon deux grandes sources dinspiration : la branche chrtienne reprsente par Gabriel Marcel et Karl
Jaspers, et les existentialistes athes parmi lesquels il faut ranger Heidegger,
et aussi les existentialistes franais et moi-mme 7 . Pas plus ce mode de
5. Jean-Paul SARTRE, Ltre et le Nant, Gallimard, Paris, 1943, p. 59.
6. Dasein ou tre-l : avant Heidegger, on traduit cette notion par existence et on
loppose ncessit ou possibilit. Avec Heidegger, la notion signifie le moment douverture
constitutif de lhomme, dans son rapport immdiat aux choses, voquant une rupture avec
lide mtaphysique dune opposition entre un sujet (la conscience) et un objet (le monde).
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 8
PAUL RICUR
clivage que la dclaration premptoire de Sartre selon laquelle Dieu
nexiste pas 8 ne peuvent entraner ladhsion de Ricur. Ses rserves
lgard des thses sartriennes sont de divers ordres. Il ne partage pas sa
valorisation du nant situ du ct de lhumain. Ensuite, Ricur, pratiquant une sorte dagnosticisme philosophique, dlimitant ce qui relve du
registre philosophique et du registre thologique, supporte mal les intrusions dathisme militant dans largumentation philosophique de Sartre.
Enfin, il se sent assez tranger une argumentation sartrienne souvent
plus littraire que conceptuelle. Cependant, sur le moment, Ricur est
trop occup la ralisation de sa propre thse pour se consacrer un travail critique des thses sartriennes ; en outre, sil est attir par les confrontations thoriques, il na pas de got particulier pour les polmiques
frontales. Il faut donc attendre dix ans aprs la publication du fameux
Lexistentialisme est un humanisme pour quil expose, une fois la mode
retombe, les divergences de fond qui lopposent Sartre 9.
La rponse lhypostase des actes nantisants assimils au nant chez
Sartre sappuie sur la reprise de l affirmation originaire , qui repose,
selon Jean Nabert, au cur mme de la dngation : La dngation nest
jamais que lenvers dune affirmation plus originaire 10. Pour Sartre, la
caractristique ontologique de ltre humain se situe dans un nant o
senracine la libert et qui chappe donc tout dterminisme : La libert,
cest ltre humain mettant son pass hors de jeu en scrtant son propre
nant 11. La libert se trouve donc coupe de toute historicit, de toute
forme didentit. Ricur se demande si un refus peut tre sa propre origine lui-mme : Une ngation peut-elle commencer de soi 12 ? La traverse de lacte nantisant partir de la finitude de lexistence nest pas
rfute par Ricur, mais reprise par lui de manire la dpasser. La
rflexion philosophique doit alors sappuyer sur le noyau daffirmation
que contient lacte darrachement au donn, lacte de refus, de dsengluement. cet gard, Ricur rcuse lalternative sartrienne entre la
libert-nant et ltre ptrifi dans lessence : ses yeux, cette perspective
vhicule une conception volontairement rductrice et appauvrissante de
ltre qui est assimil au donn, la chose. Une fois cette quation pose,
il entend larracher la rification grce la raction de ltre confront
7. Jean-Paul SARTRE, Lexistentialisme est un humanisme, op. cit., p. 17.
8. Ibid., p. 21.
9. Paul RICUR, Ngativit et affirmation originaire , Aspects de la dialectique, Descle
de Brouwer, Paris, 1956, p. 101-124 ; repris dans Histoire et Vrit, Le Seuil, Paris, 1964,
p. 336-360.
10. Histoire et Vrit, op. cit., p. 350.
11. Jean-Paul SARTRE, Ltre et le Nant, op. cit., p. 66.
12. Paul RICUR, Histoire et Vrit, op. cit., p. 352.
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 9
LE TRIOMPHE DE LEXISTENTIALISME SARTRIEN
la nantisation et ralisant sa libert en se constituant comme non-chose.
linverse, Ricur prconise de poser la question de ltre dans son
ouverture. La philosophie du nant lui apparat comme une philosophie
tronque qui ne reprsente quun seul versant, la seule moiti dombre
dun acte total amput de sa partie lumineuse sans laquelle lacte mme de
ngativit net pas t possible. Cette dimension de lumire souvre sur
un agir, non sur un dgagement ou un arrachement, mais sur un engagement : Sous la pression du ngatif, des expriences en ngatif, nous avons
reconqurir une notion de ltre qui soit acte plutt que forme, affirmation vivante, puissante dexister et de faire exister 13.
Lamiti entre Ricur et Marcel ne peut que renforcer les prventions
de Ricur par rapport Sartre. Les relations entre Sartre et Marcel sont
dissymtriques : Sartre nprouve pas une particulire estime pour Marcel,
alors que Marcel lui voue une relle admiration. Il apprcie son talent,
mais bien videmment sur fond de dsaccord. Marcel considre les positions de Sartre comme profondment nocives : Dans laprs-guerre, on
demandait mon beau-pre de faire confrence sur confrence sur Sartre
et il disait : Je me sens comme un commis voyageur en poudre antisartrique 14. Marcel et Ricur se retrouvent donc du mme ct pour
contester la part de nihilisme contemporain dans la prvalence accorde
au nant qui dbouche sur le rien ne vaut.
Une faille essentielle leur parat perceptible lintrieur du projet
sartrien, et en affaiblit la porte, celle dune thique tout aussi impossible
que dans le projet heideggerien, dans la mesure o le sujet ne peut exister
que dans un arrachement solipsiste, cest--dire au moyen dune individuation absolutise. Cette voie ne permet pas de penser autrui car, dit
Sartre, on se perd en se donnant 15 . tre, cest tre avec selon Marcel et
Ricur, alors que le fameux lenfer, cest les autres 16 de Sartre fait
fortune.
La perspective de Sartre est celle de lexaltation dun individualisme :
Loptique sartrienne est rsolument individualiste 17. Il tourne ainsi le
dos toute forme de dialogique ou dintersubjectivit. La conscience se
constitue partir dune dialectique entre len-soi et le pour-soi, mais
lcart dautrui. La libert de ltre, selon Sartre, ne se pense pas avec les
autres, grce un dtour vers lautre, mais comme un dgagement de
lemprise des autres. Cest en ce sens que, par-del la controverse entre
Heidegger et Sartre, leurs points de vue se rejoignent dans la rfrence
13. Paul Ricur, ibid., p. 360.
14. Anne Marcel, entretien avec lauteur.
15. Jean-Paul SARTRE, cit par Alain RENAUT, Sartre, le dernier philosophe, Grasset, Paris,
1993, p. 226.
16. Jean-Paul SARTRE, Huis clos, Gallimard, Paris, 1944.
17. Alain RENAUT, Sartre, le dernier philosophe, op. cit., p. 212.
III.1/III.2
10
31-03-2008
15:47
Page 10
PAUL RICUR
des figures vanouissantes du sujet qui ne laissent pas de place la dimension thique 18. Sartre tente ce niveau une coupure, qui se veut aussi radicale que celle de Heidegger, avec la dmarche rflexive. La conscience
chappe se saisir elle-mme, et doit donc passer par autrui, non pour se
raliser, mais pour faire lexprience dun arrachement constitutif de sa
libert : Il ne sagit pas l dune mtaphysique de la prsence, mais dune
ontologie du manque 19. Dans cette mesure, et contrairement limage
usuelle dun Sartre port par lexaltation dun sujet divinis, on pourrait
considrer son horizon comme celui dune fuite incessante anime par
labsolutisation de labsence, du nant, dune pense du dehors. Cette
aspiration par le nant nest pourtant pas ltre-pour-la-mort de Heidegger,
car la mort ne peut donner sens des projets quelle nantise ; elle tombe
dun coup dans labsurde 20 . Le nant affecte toute mdiation avec autrui.
Quant au cogito chez Sartre, il porte la marque dune prsence soi toujours dcale, fissure par la mauvaise foi, marque par une part dabsence
soi. Cet horizon aportique donnant la mauvaise foi une position centrale, Sartre reste lcart de ce quapportent les sciences sociales en plein
essor dans la comprhension de la relation entre le Mme et lAutre, et
notamment lanthropologie et la smiologie. Cette clture face lessor
des sciences sociales condamne de manire prcoce le projet sartrien, alors
mme que le travail de Merleau-Ponty va servir de passerelle entre la philosophie et le dfi pos par la question de linconscient individuel et des
pratiques sociales.
Par ailleurs, le thtre devient pour Sartre un lieu privilgi dexpression de ses positions philosophiques. Au dbut des annes cinquante, le
grand vnement thtral est assur par la reprsentation de sa pice, Le
Diable et le Bon Dieu, qui tient laffiche de juin 1951 mars 1952 sans
interruption. Louis Jouvet ralise cette occasion sa dernire mise en
scne. Malgr le plbiscite du public, le climat est loin dtre consensuel
autour dune pice qui sent le soufre. Le hros Goetz veut choisir en toute
libert le Mal, le Diable, mais il en mesure vite la bouffonnerie. Il se tourne
alors vers le Bien, le Bon Dieu, sur les conseil dun prtre, Heinrich, mais
il nen retire quun sentiment drisoire de comdie, dimposture. Lintrigue
se situe dans une Allemagne de la Renaissance dchire par la guerre
sociale. Les choix du hros, sans ncessit, coups des enjeux de son sicle,
apparaissent totalement factices. Aprs avoir mesur son incapacit
18. Voir Alain RENAUT, Lthique impossible Sartre, le dernier philosophe, op. cit.,
p. 153-233.
19. Jol ROMAN, loge de lexistentialisme franais , Les Enjeux philosophiques des
annes cinquante, centre G.-Pompidou, Paris, 1989, p. 139.
20. Jean-Paul SARTRE, Ltre et le Nant, op. cit., p. 624.
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 11
LE TRIOMPHE DE LEXISTENTIALISME SARTRIEN
11
trouver un sens dans le Mal comme dans le Bien, Goetz renonce Dieu,
proclame son athisme et se jette dans la praxis, par son engagement
auprs des paysans rvolts contre la noblesse. Le hros renonce donc
sa qute dabsolu et affirme : Dieu est mort... il ny a que les hommes.
Dans ce dbut des annes cinquante, en pleine guerre froide, dans un
monde bipolaire, le message est clair et situe Sartre du ct de l horizon
indpassable quest pour lui le marxisme et de ce qui lincarne alors, le
compagnonnage avec le mouvement communiste, aprs lchec du
RDR 21. Laccueil de certains critiques est particulirement violent : On
attaqua le blasphme drisoire, Mauriac ironisa sur Sartre, lathe
providentiel, Thierry Maulnier titra : Y a pas de Bon Dieu 22.
Ricur na pas lintention de hurler avec les loups, mais il profite de
loccasion pour noncer ses rticences philosophiques lgard des positions sartriennes et consacre la pice un article dans Esprit. Cest en
termes particulirement forts quil exprime, contrairement son habitude,
ses motions devant une pice qui la bless : Je dois dire que certaines
scnes mont t presque insupportables , par leur outrance juge inadmissible 23 . Et pourtant, il nen reste pas cette premire raction de
rejet. Il reprend la lecture de la pice de Sartre, la lit et la relit pour en tirer
le meilleur delle-mme. Et il superpose sa premire impression celle
dune lecture qui dplace le problme central de la pice : celui-ci lui semblait tre celui de la foi, dun noyau sain dathisme perverti par le masque
dune relation Dieu drisoire, mais derrire cette apparence se joue,
selon Ricur, une autre question, qui est celle de lthique et de la politique. La traverse de limposture devient alors le parcours ncessaire
lmergence de la question thique. La dramaturgie ne fait quillustrer la
thse philosophique de Sartre, selon laquelle la dimension divine aline
lhumanit de lhomme.
Ricur accompagne Sartre dans sa dmonstration lorsque son hros,
Goetz, atteste lquivoque de la foi et de la mauvaise foi : Si la foi est la
mauvaise foi consolide, lhomme, en jetant le masque de la mauvaise foi,
dpouille aussi lexistence ou linexistence du croyant 24. En
revanche, la mise en scne de cette concidence nest pas sans faire souffrir,
convient Ricur, le spectateur qui, comme lui-mme, aspire une autre
ascse de cette imposture dont la foi nest jamais sre de se distinguer 25 .
21. RDR : Rassemblement dmocratique rvolutionnaire, cr en fvrier 1948, dont le
comit dinitiative est constitu de Jean-Paul Sartre, David Rousset, Paul Fraisse, Georges
Altman, Daniel Bndite, Jean Ferniot, Bernard Lefort, Charles Ronsac, Roger Stphane, ainsi
que de quatre parlementaires et six militants ouvriers syndicalistes.
22. Annie COHEN-SOLAL, Sartre, op. cit., p. 416.
23. Paul RICUR, Le Diable et le Bon Dieu , Esprit, novembre 1951, repris dans Lectures 2,
op. cit., p. 137.
24. Lectures 2, op. cit., p. 148.
25. Ibid.
III.1/III.2
12
31-03-2008
15:47
Page 12
PAUL RICUR
Sartre rpondra cet article de Ricur par une lettre dans laquelle il le
remercie pour son honntet : Vous avez parfaitement vu quil y a deux
sujets et toute lambigut de la pice ; parfaitement compris que Goetz
est un truqueur. Vous me semblez trop svre pour Heinrich... Et puis je
vous signale aussi que le passage de la mauvaise foi la foi nest pas opr
par artifice. Mon intention nest pas doprer une substitution de termes
pour duper le spectateur. Vous, chrtien, pouvez penser quil y a substitution de termes mais alors je vous demande de croire que jen suis la dupe
et non lauteur. Ce ne sont que des dtails, pour le reste, je suis daccord
sur tout 26.
26. Jean-Paul Sartre, lettre Paul Ricur, non date, archives du Fonds Paul Ricur, IPT.
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 13
A.III.2
Une voie phnomnologique inspire
par Merleau-Ponty
En 1945 parat un ouvrage majeur dont Ricur peroit tout de suite limportance : la Phnomnologie de la perception, de Maurice MerleauPonty. Les thses dveloppes se trouvent tre dans le prolongement
direct de son propre cheminement philosophique, puisquil est en train de
rdiger sa thse sur le volontaire et achve la traduction des Ideen I de
Husserl. La fcondit dun travail dordre phnomnologique se trouve
atteste pour lui par la force de la dmonstration de Merleau-Ponty. Alors
que Ricur a des prventions lgard de Sartre, il a tout de suite la plus
grande admiration pour Merleau-Ponty, quil rencontre dailleurs plusieurs reprises entre 1945 et 1948 Lyon, o il enseigne. Il le croise aussi
Leuven en consultant les archives Husserl. Au lendemain de sa soutenance de thse, Ricur se retrouve ses cts en avril 1951 au colloque
international de phnomnologie organis Bruxelles par le pre franciscain Van Breda, directeur des archives Husserl. Le choix de son sujet de
thse sur le volontaire prcde la publication de louvrage de MerleauPonty. La Phnomnologie de la perception permet Ricur de concevoir
son travail comme le prolongement, sur le champ pratique, de ltude
phnomnologique. Merleau-Ponty a centr son tude sur la perception,
sur lintentionnalit, laissant place pour une tude de lagir humain.
Ricur retrouve avec la Phnomnologie de la perception son propre
souci dviter les dichotomies appauvrissantes et de rcuser notamment
lopposition entre sujet et objet au moyen de la traverse de lexprience.
Cest en effet la dmonstration que ralise Merleau-Ponty : Comprendre
la subjectivit comme inhrence au monde 1. Il convient donc de repenser
1. Maurice MERLEAU-PONTY, Phnomnologie de la perception (1945), Gallimard, coll.
Tel , Paris, 1976, p. 464.
III.1/III.2
14
31-03-2008
15:47
Page 14
PAUL RICUR
la perception en train de se faire, son mergence dbarrasse des thories
fossilises qui tendent parasiter notre mode de connaissance. MerleauPonty montre que le sujet connaissant et lobjet connu co-naissent dans
une dynamique endogne ltre-au-monde. Ce travail sinscrit dans le
prolongement de la rduction eidtique de Husserl, de cette qute dun
sujet concret, vcu au travers dun monde environnant qui nest plus seulement existant, mais phnomne dexistence. Merleau-Ponty vise donc
comprendre les rapports de la conscience et de la nature, de lintrieur et
de lextrieur 2 . Pour mener bien son entreprise, il rcuse les deux positions symtriques du ralisme et de lidalisme. La contestation de ce
vieux dbat philosophique lui permet de souvrir une dimension longtemps occulte qui est celle du corps, lieu mdian o simpriment la fois
la conscience et le monde ; il devient le lieu privilgi de linterrogation
philosophique et apparat comme un objet subjectif .
La seconde innovation de Merleau-Ponty, et qui sera reprise son
compte par Ricur, est le dialogue entrepris avec les sciences humaines,
avec leurs recherches et leurs dcouvertes. Le renoncement la coupure
entre la philosophie et la connaissance empirique, positive, le fait de se
situer sur le terrain mme de celle-ci afin de mesurer en quoi elle sen
dtache forment un mouvement qui deviendra constant chez Ricur.
Dans sa traverse de la gestalt-theorie (Koffka, Koehler, Goldstein...),
Merleau-Ponty ouvre le chemin quempruntera Ricur avec luvre
freudienne.
La Phnomnologie de la perception se donne pour objet de faire
converger les rsultats de la psychologie contemporaine et la phnomnologie de Husserl 3 . Lopacit de lexprience vcue dans son immdiatet oblige le philosophe raliser un dtour par la psychologie, annonce
le futur dtour de Ricur par la psychanalyse, et plus largement prlude
cette conviction que la vrit ne se donne pas dans un rapport de simultanit, dosmose, mais par une srie gradue de mdiations ncessitant les
dtours du philosophe.
la base de linterrogation de Merleau-Ponty on retrouve le cogito cartsien, mme si le je pense se transforme avec le corps propre en je
peux ; mais la diffrence du mouvement heideggerien dexpropriation
radicale de la prsence soi, cest par une habitation, une reprise inlassable des questions cartsiennes quune ontologie non cartsienne va tre
conquise 4 . Lnigme lucider se situe du ct de la constitution du soi
2. Ibid., p. 488.
3. Renaud BARBARAS, Gradus philosophique, Flammarion, coll. G.F. , Paris, 1994, p. 515.
4. Maria VILLELA-PETIT, Le tissu du rel , Maurice Merleau-Ponty. Le psychique et le corporel, Aubier, Paris, 1988, p. 91.
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 15
UNE VOIE PHNOMNOLOGIQUE INSPIRE
15
par la corporit, dans cette manire singulire dont le corps propre
dploie son tre-au-monde. Ricur dcouvre une autre dimension centrale pour lui : la communication, dont il avait dj montr limportance
chez Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Lanalyse de la perception selon
Merleau-Ponty permet de mieux comprendre lexprience dautrui, donc
de mieux poser cette question de la communication. Elle se situe larticulation entre la conscience intime de soi et lanonymat de la vie corporelle, qui en est la condition dexistence. Merleau-Ponty, prenant le corps
comme partie de soi-mme, vise incarner lipsit 5 . Cette vise philosophique le conduit faire sienne une conception plus restrictive du
cogito comme possession ou pense de soi plutt que prsence soi 6 .
Dans la troisime et dernire partie de la Phnomnologie de la perception, Merleau-Ponty sloigne de lgologie transcendantale quil a dcouverte chez Husserl pour dcentrer lego et ouvrir ainsi le moi vers lautre :
La subjectivit nest pas lidentit immobile avec soi : il lui est, comme
au temps, essentiel, pour tre subjectivit, de souvrir un Autre et de
sortir de soi 7. Cest grce la perception que se ralise le rapport
autrui. Cette mdiation qui valorise le rapport affirmatif lexistence dans
lacte de la communication diffre radicalement du point de vue de Sartre
qui privilgie labme, le nant, et oppose le moi lautre. Selon MerleauPonty, la subjectivit qui permet davoir accs lautre grce au corps se
prsente comme ouverture la fois dpendante et indcidable 8 , rendant caducs aussi bien lobjectivisme qui se heurte lindcidable que
lidalisme qui occulterait la part dpendante du sujet.
Dcouvrant le relais possible par le biais phnomnologique de questions quil se posait au plan existentiel, Ricur est plus quintress, fascin, par la dmonstration de Merleau-Ponty. Sa raction nest dailleurs
pas sans une certaine ambivalence, car il ressent toujours le besoin de ne
pas se laisser aspirer et dissoudre par ses adhsions et engagements successifs. Plong lintrieur de luvre de Jaspers, il considre alors la
dmarche de Merleau-Ponty comme trop exclusivement tourne vers
limmanence : Il ma avou il y a peu quil a t tellement fascin par
la Phnomnologie de la perception que ctait pour chapper cette phnomnologie quasi immanentiste quil avait fait sa Philosophie de la
volont 9. Il a pu considrer que cette libert tait trop contingente chez
Merleau-Ponty et rechercher derrire un vouloir la restitution de valeurs
5. Maria VILLELA-PETIT, Le soi incarn, Merleau-Ponty et la question du sujet , MerleauPonty, le philosophe et le langage, Vrin, Paris, 1993, p. 421.
6. Renaud BARBARAS, Gradus philosophique, op. cit., p. 521.
7. Maurice MERLEAU-PONTY, Phnomnologie de la perception, op. cit., p. 413.
8. Ibid., p. 459.
9. Guy Petitdemange, entretien avec lauteur.
III.1/III.2
16
31-03-2008
15:47
Page 16
PAUL RICUR
et la crdibilit dun autre niveau, dune autre anthropologie plus en rapport avec la transcendance. En fait, Merleau-Ponty avait dj esquiss la
possible articulation de ces deux niveaux dans la dtermination de la subjectivit comme temporalit. Cest le rapport au temps, la conscience
comme capacit passer dun horizon pass ou venir qui invite considrer que la transcendance du monde est bien prserve en son immanence mme 10 . Par ailleurs, louverture vers le champ pratique explor
par Ricur dans sa thse sur le volontaire nest pas en discordance avec
ltude de Merleau-Ponty qui ouvre sa rflexion sur la dimension de
lagir : La vraie philosophie est de rapprendre voir le monde [...].
Nous prenons en main notre sort, nous devenons responsables de notre
histoire par la rflexion, mais aussi bien par une dcision o nous engageons notre vie, et dans les deux cas il sagit dun acte violent qui se
vrifie en sexerant 11.
Merleau-Ponty aura ainsi orient le projet de Ricur vers la dialectique
qui se joue entre le sens profr et celui qui se rvle dans les choses. Cela
va le mener un dialogue de plus en plus rapproch avec les sciences
humaines, en plein essor dans les annes cinquante. Dans cette perspective, une rappropriation de la science dans le champ de la pense philosophique est possible. Chaque science est le foyer dune ontologie
rgionale que le philosophe doit repenser pour permettre les recoupements des regards et en restituer le sens pour le sujet : Merleau-Ponty
avait un projet trs ambitieux qui tait dentretenir une espce de rapport
de complmentarit entre la philosophie et les sciences de lhomme.
Il sest donc efforc de suivre toutes les disciplines 12. Initiateur dans son
exploration dune certaine psychologie et dans la critique de son caractre rifiant et mcaniste, Merleau-Ponty est aussi prcurseur, ds 1951,
dans le tournant linguistique en cours, montrant tout lintrt de luvre
de Saussure comme inauguration de la linguistique moderne : Ce que
nous avons appris dans Saussure, cest que les signes un un ne signifient
rien, que chacun deux exprime moins un sens quil ne marque un cart de
sens entre lui-mme et les autres 13. Cette intgration de la linguistique
dans le champ de la rflexion philosophique est proclame loccasion
10. Renaud BARBARAS, Gradus philosophique, op. cit., p. 523.
11. Maurice MERLEAU-PONTY, Phnomnologie de la perception, op. cit., 1976, p. XVI.
12. Vincent Descombes, entretien avec lauteur pour Histoire du structuralisme, La Dcouverte, Paris, 1991-1992.
13. Maurice MERLEAU-PONTY, Sur la phnomnologie du langage , communication au
premier colloque international de phnomnologie, Bruxelles, 1951, repris dans Signes,
Gallimard, Paris, 1960, p. 49.
III.1/III.2
31-03-2008
15:47
Page 17
UNE VOIE PHNOMNOLOGIQUE INSPIRE
17
du colloque de Van Breda Bruxelles. Ricur y est prsent et explorera
plus tard systmatiquement les divers niveaux du langage.
Dans le mme souci, Merleau-Ponty encourage le dialogue entre sociologie et philosophie, dont il dplore la frontire disciplinaire qui les
oppose : La sparation que nous combattons nest pas moins prjudiciable la philosophie quau dveloppement du savoir 14. Laile marchante de la sociologie en ce dbut des annes cinquante est reprsente
par le projet danthropologie sociale de Claude Lvi-Strauss 15. MerleauPonty se rapproche de lui et cest mme lui qui, lu au Collge de France
en 1952, suggre Lvi-Strauss de se prsenter et contribue son lection
en 1960. Il dfend avec vigueur le programme dfini en 1950 par LviStrauss dans son Introduction luvre de Marcel Mauss : Les faits
sociaux ne sont ni des choses, ni des ides, ce sont des structures [...]. La
structure nte rien la socit de son paisseur ou de sa pesanteur. Elle
est elle-mme une structure des structures 16. Le projet de MerleauPonty est alors de reprendre un un les acquis des sciences humaines dans
une perspective phnomnologique, gnralisante, en redfinissant leurs
connaissances du point de vue philosophique, testant la compatibilit des
dcouvertes scientifiques avec leur valeur en termes dexprience subjective et de signification globale. Cette vitalit du programme phnomnologique, grce cette proximit cultive avec le champ des sciences
humaines, sert incontestablement de modle pour Ricur, qui sinstallera aussi linterface de la philosophie du langage et de la phnomnologie, de lhistoire et de lpistmologie, de la psychanalyse et de sa reprise
hermneutique...
Ce dialogue fcond entre sciences de lhomme et philosophie donne
la situation intellectuelle franaise une singularit qui contraste avec
dautres traditions nationales. Lautre aspect qui a sduit Ricur, cest de
trouver en Merleau-Ponty un philosophe porteur du programme phnomnologique de Husserl, mais sans se rduire pour autant une simple
application en France des principes dune tradition importe dAllemagne. Merleau-Ponty tente en effet de concilier celle-ci avec la tradition
rflexive franaise, celle qui va de Descartes, Maine de Biran et Bergson
Lachelier, Lavelle et Nabert. Merleau-Ponty et Ricur ont en commun
cette tradition franaise 17 . Ils partagent cette position en tension entre
des points de vue quils ne veulent pas juger comme contradictoires. Au
contraire, ils aspirent les penser ensemble et contribuent raliser ce
14. Maurice MERLEAU-PONTY, Cahiers internationaux de sociologie, X, 1951, p. 55-69 ;
repris dans Signes, op. cit., p. 127.
15. Voir Franois DOSSE, Histoire du structuralisme, op. cit., t. 1.
16. Maurice MERLEAU-PONTY, De Marcel Mauss Claude Lvi-Strauss , Signes, op. cit.,
p. 146-147.
17. Renaud Barbaras, entretien avec lauteur.
III.1/III.2
18
31-03-2008
15:47
Page 18
PAUL RICUR
programme. Alors quil sera de bon ton aprs la disparition prmature de
Merleau-Ponty lge de cinquante-trois ans, en 1961, de considrer ce
dernier comme dpass par un programme de radicalisation qui va dans le
sens dune nouvelle coupure, cette fois au profit des sciences de lhomme
avec le succs du programme structuraliste, Ricur continuera se rfrer luvre de Merleau-Ponty : Il est lhonneur de Ricur de ne
jamais avoir rpudi Merleau 18. La fascination exerce sur la philosophie franaise par les penseurs allemands Husserl, Heidegger est alors
si forte quelle a occult un espace propre au dploiement dune phnomnologie franaise spcifique.
Ainsi, la centralit du corps propre chez Merleau-Ponty senracine dans
cette dj longue tradition dune anthropologie philosophique qui
remonte au dbut du XIXe sicle avec Maine de Biran 19. Celui-ci avait en
effet dj montr lirrductibilit des deux voies daccs : lune psychologique et lautre physiologique, comme les deux faces de lintriorit et de
lextriorit qui ne permettent pas didentifier le discours en premire
personne au discours en troisime personne. Cest donc larticulation et
non la rduction des phnomnes de conscience intime avec les phnomnes physiologiques que sest consacr Maine de Biran. Cette ambition
unifiante est annonce demble en avant-propos des Nouveaux Essais
danthropologie : Ce titre annonce que je veux considrer tout lhomme,
et non pas seulement une partie ou une face de lhumanit 20. Certes,
Ricur considre que Maine de Biran ne parvient pas dduire une thorie des catgories de sa philosophie du corps propre, mais il lui rend hommage dans sa thse sur le volontaire : Le regard rvle le voir comme
acte. Ici Maine de Biran est invincible 21. Il estime que Maine de Biran
reprsente une voie daccs trop courte, mais il lintresse dans sa thorie
du corps propre, qui lui parat dune relle consistance et profondeur 22 .
La double source dinspiration existentialiste et phnomnologique est
revendique par Ricur lui-mme lorsquil considre la gense de sa
thse sur le volontaire : Si cest Husserl que je devais la mthodologie
dsigne par le terme danalyse eidtique, cest Gabriel Marcel que je
devais la problmatique dun sujet la fois incarn et capable de mettre
distance ses dsirs et ses pouvoirs 23.
18. Ibid.
19. Maine de BIRAN, Mmoire sur la dcomposition de la pense (1804-1805), uvres, t. III,
Vrin, Paris, 1988 ; Rapports des sciences naturelles avec la psychologie (1813-1815), uvres,
t. VIII, Vrin, Paris, 1986 ; Nouveaux Essais danthropologie, uvres, t. X-2, Vrin, Paris, 1989.
20. Maine de BIRAN, Nouveaux Essais danthropologie, op. cit., p. 1.
21. Paul RICUR, Philosophie de la volont, t. 1, Le Volontaire et lInvolontaire (1950),
Aubier, Paris, 1988, p. 318.
22. Franois Azouvi, entretien avec lauteur.
23. Paul RICUR, Rflexion faite, op. cit. , p. 24.
III.1/III.2
03-04-2008
08:03
Page 19
UNE VOIE PHNOMNOLOGIQUE INSPIRE
19
Passionn par la lecture de la Phnomnologie de la perception, Ricur
cherche tablir le contact avec Merleau-Ponty. Il a certes quelques occasions de rencontre, mais ils appartiennent deux courants intellectuels
opposs dans laprs-guerre. Pourtant, Merleau-Ponty avait t, avantguerre, le correspondant dEsprit, animant un groupe de la revue
Chartres, mais en 1945, il est alors lalter ego de Sartre dans lanimation de
la nouvelle revue Les Temps modernes. Il participe activement au comit
de rdaction et rdige souvent les ditoriaux. Jusquen 1952, lattelage
Sartre-Merleau fonctionne bien. Cest Merleau-Ponty qui accueille la traduction des Ideen de Husserl par Ricur chez Gallimard : Il se trouve
que Gallimard a dcid de crer une collection de philosophie (outre la
Bibliothque des Ides)... Cette collection, dont Sartre et moi serions les
conseilleurs, devrait notre sens comprendre des ouvrages de plusieurs
tendances (nous lappellerons : Philosophies ), mais, juger des choses
par la valeur des ouvrages, faire une grande place la philosophie allemande contemporaine... Il est clair que votre traduction des Ideen serait,
pour la collection, un bon dbut. Verriez-vous un inconvnient ce
quelle y figure 24 ? videmment, Ricur rpond positivement cette
requte de Merleau-Ponty qui lui propose mme peu aprs de publier
quelques recensions dans Les Temps modernes : Accepteriez-vous en
attendant une collaboration plus ample, si vous le souhaitez, de donner
aux Temps modernes une note sur les Textes choisis de Calvin qui viennent
de paratre avec une prface de Karl Barth 25 ? Mais le christianisme militant de Ricur, sa participation active la revue Esprit rendent dlicate
une relation de trop grande proximit. Merleau-Ponty sest donc tenu
distance : Merleau-Ponty a toujours vit le contact. Il na mme pas
rpondu ses lettres... Ricur en a t attrist 26. Jacques MerleauPonty, cousin germain de Maurice Merleau-Ponty et philosophe lui aussi
dans le domaine de lpistmologie des sciences, se souvient quavant de
le rejoindre luniversit de Nanterre il reoit un coup de tlphone
de Ricur qui lui demande les coordonnes tlphoniques de son cousin
Maurice : Je lui ai dit : je vous les donne parce que vous tes Paul Ricur.
Je ne les aurais pas donnes quelquun dautre. Mais cela prouve quil
ntait pas de ses familiers 27. Trs certainement, Sartre a contribu
maintenir Ricur distance de Merleau-Ponty. Le caractre athe militant des Temps modernes dans le climat intellectuel de laprs-guerre a
favoris sa mise lcart, dautant que Ricur tait considr par Sartre
24. Maurice Merleau-Ponty, lettre Paul Ricur, 11 novembre 1948, archives du Fonds
Paul Ricur, IPT.
25. Maurice Merleau-Ponty, lettre Paul Ricur, 12 dcembre 1948, archives du Fonds Paul
Ricur, IPT.
26. Roger Mehl, entretien avec lauteur.
27. Jacques Merleau-Ponty, entretien avec lauteur.
III.1/III.2
20
31-03-2008
15:47
Page 20
PAUL RICUR
comme une espce de cur qui soccupait de phnomnologie 28. Cette
attitude sectaire a donc rendu impossible la transformation au plan
humain dune proximit intellectuelle trs forte. Elle nest pas sans avoir
laiss quelques blessures : Ricur nous a dit un jour que les rapports
quil a eus dans sa jeunesse avec Les Temps modernes lpoque o Merleau y tait encore avaient t douloureux 29. La question religieuse a d
aussi contribuer les maintenir dans deux mondes part. Non que Merleau-Ponty partage le point de vue de Sartre mais, dducation catholique,
il tait plutt en cet aprs-guerre dans un moment de dprise, de dtachement du no-thomisme qui avait t le sien, sans rien manifester danticlrical, la religion restant son jardin secret : Je suis persuad que ctait
par respect pour sa mre, qui tait une catholique trs sincre et pour
laquelle il avait une vnration particulire 30.
Par-del cette non-rencontre, qui tient davantage aux diffrends de
leurs milieux respectifs dappartenance, il reste que Merleau-Ponty et
Ricur vont incarner deux orientations un peu diffrentes de la phnomnologie franaise : dun ct, chez Merleau-Ponty, une attention
davantage centre sur le corps propre, la chair, et, de lautre, avec Ricur,
une approche de la chair plus abstraite, par le biais de la textualit, mme
si au moment de sa thse sur le volontaire, le problme du corps est encore
abord frontalement.
28. Marc Richir, entretien avec lauteur.
29. Ibid.
30. Jacques Merleau-Ponty, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 21
A.IV.1
Lintroducteur de Husserl
Strasbourg, Ricur est nomm sur un poste de matre de confrences
spcialis en histoire de la philosophie. Cette discipline dans une universit de province revt lpoque un caractre familial que lon a peine
imaginer aujourdhui. LInstitut de philosophie nest pas dans le palais
universitaire, mais dans une maison situe au coin de la rue Goethe. Un
tage est consacr la psychologie, lautre la philosophie, dont lenseignement est assur par quatre professeurs. La licence se dcompose en
quatre certificats : morale et sociologie, psychologie gnrale, histoire de
la philosophie, philosophie gnrale. Ricur a pour collgues Juliette
Boutonnier en psychologie gnrale, Georges Duveau en morale et sociologie, et Georges Gusdorf, nomm la mme anne que lui, succdant
Georges Canguilhem. Le nombre des tudiants en philosophie est trs
limit : une vingtaine au maximum. Les cours ont pour cadre une petite
salle, pas plus grande quun modeste bureau : On tait une quinzaine
autour dune table recouverte dune nappe verte 1. Dans de telles conditions, les relations sont trs faciles entre professeurs et tudiants. En
revanche, laspect microcosmique de cette vie universitaire peut gnrer
quelques animosits et conflits larvs. Cest le cas entre Gusdorf et
Ricur : Sans Gusdorf, Ricur serait rest Strasbourg. Il ma dit plusieurs fois quil aurait aim faire toute sa carrire Strasbourg si Gusdorf
navait pas t l 2. Gusdorf, qui a dj ralis une uvre monumentale,
manifeste une certaine jalousie lgard du rayonnement acquis par
Ricur et de la force dimpulsion qui anime son travail. ce titre, on sait
1. Roland Goetschel, entretien avec lauteur.
2. Roger Mehl, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
22
31-03-2008
15:49
Page 22
PAUL RICUR
dj Strasbourg que Ricur fait une uvre au sens o il y a un souffle
initial et une ligne qui senrichit sans se dmentir 3. Ricur a tout fait
pour apaiser les craintes de Gusdorf et amliorer la situation, essayant
mme de linviter, mais il se heurte des refus ritrs. De plus, comme il
est nomm sur un poste dhistoire de la philosophie, la mtaphysique et
la philosophie morale restent le domaine rserv de Gusdorf. Cette situation permet Ricur de consolider sa connaissance personnelle de lhistoire de la philosophie : Mon bagage de fond en matire de philosophie
grecque, moderne et contemporaine date de cette priode 4. En mme
temps, il regrettait et aurait prfr avoir la chaire de Gusdorf, celle de
mtaphysique et de morale 5 . La susceptibilit personnelle, dj rudement mise lpreuve en gnral dans le monde universitaire, lest de
manire dcuple dans cet univers confin, et lorsquun brillant tudiant
comme Roland Goetschel choisit de faire son DES avec Paul Ricur et
Andr Nher, il est certain que Gusdorf en prend ombrage.
En revanche, ces difficults sont compenses par lintensit des relations avec les tudiants. Parmi ceux-ci, Alex Derczansky est un sacr
phnomne, un vritable rudit ; il suit des tudes de philosophie et sympathise avec Ricur au point que, lorsquil se marie en 1958, je lui ai
impos dtre mon tmoin, et Domenach a t le tmoin de ma femme 6 .
Il nat l une complicit jamais dmentie. Derczansky est encore lun des
rares pouvoir appeler toute heure Ricur, qui dteste le tlphone.
Historien de la philosophie, Ricur consacre chacune de ses annes
denseignement un auteur, dont il lit toute luvre pendant la priode
des vacances universitaires : Je me donnai en particulier pour rgle de lire
chaque anne un auteur philosophique de faon aussi exhaustive que
possible 7. Mais il nen devient pas pour autant un historien classique de
la philosophie, droulant dans un ordre chronologique les auteurs et les
uvres. Lhistoire de la philosophie ne lintresse pas en tant que savoir
acadmique. Elle ne vaut que par sa capacit dactualisation de problmes
rencontrs dans le prsent. Elle est conue par Ricur comme rappropriation dune tradition 8 . La pdagogie luvre chez Ricur part dun
problme, dun thme, et cest autour de lui que se tissent les fils de la philosophie de chaque auteur : Jai suivi un cours de Ricur sur le problme
de la libert dans lhistoire de la philosophie 9. Il prend pour objet aussi
3. Roger Mehl, ibid.
4. Paul RICUR, Rflexion faite, op. cit., p. 27.
5. Roger Mehl, entretien avec lauteur.
6. Alex Derczansky, entretien avec lauteur.
7. Paul RICUR, Rflexion faite, op. cit., p. 27.
8. Myriam Revault dAllonnes, entretien avec lauteur.
9. Roland Goetschel, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 23
LINTRODUCTEUR DE HUSSERL
23
bien le problme de limagination que celui de la rduction transcendantale... Cest Strasbourg, en 1953-1954, quil fait son fameux cours sur
Platon et Aristote autour des notions dessence et de substance, cours que
nous retrouverons massivement distribu sous forme de polycopi place
de la Sorbonne, o il acquiert la rputation dincontournable. Prparant
Finitude et Culpabilit, il donne des cours sur le mal et sur la tragdie
grecque. Cest aussi Strasbourg quil entreprend ltude systmatique de
luvre de Kant, si fondamentale pour lui quil se dira plus tard kantien
posthglien . Il attire aussi des tudiants de thologie : Jtais la
facult de thologie, mais je suivais ses cours de philosophie. Jtais passionn par la philosophie et par la mystique persane et arabe, et Ricur
mintressait surtout comme hermneute 10 , se rappelle Sliman Boukhechem, futur professeur de philosophie au Chambon-sur-Lignon, de 1967
1983. Marc Lienhard, doyen de la facult de thologie protestante en
1995, habitait alors la mme rue que Ricur. Il avait jou au football avec
ses fils. Plus tard, il suit occasionnellement ses cours luniversit, entre
1953 et 1957, alors quil est inscrit dans un cursus de thologie. En mme
temps, il assiste aux cours de Jaspers Ble et dAim Forest Montpellier.
Mais la pice matresse de lenseignement philosophique de Ricur est
reprsente en ces annes cinquante par Husserl : Au niveau de la
licence, il nous a fait un programme assez lourd qui ma beaucoup impressionn : la phnomnologie. Il prenait un texte allemand des Ideen I et
nous le faisait traduire 11. Luvre de Husserl permet notamment de
jouer le rle de passerelle entre lInstitut de philosophie de luniversit et
la facult de thologie o se trouve un disciple de Husserl, Hater, professeur de dogmatique depuis 1945 Strasbourg o Jean Hring avait
publi un ouvrage sur la phnomnologie de Husserl en 1925 : Il y
avait donc Strasbourg tout un courant qui se rclamait de Husserl 12.
Ricur joue un rle majeur dintroducteur de Husserl en France qui va
lui permettre de former plusieurs gnrations de philosophes coutumiers
de la phnomnologie. En 1949, il publie un long article sur Husserl et
le sens de lhistoire dans la Revue de mtaphysique et de morale 13.
Il aborde publiquement cet immense ocan philosophique de quarante
mille pages de manuscrit par la fin de luvre, celle qui couvre les annes
10. Sliman Boukhechem, entretien avec lauteur.
11. Roland Goetschel, entretien avec lauteur.
12. Marc Lienhard, entretien avec lauteur.
13. Paul RICUR, Husserl et le sens de lhistoire , Revue de mtaphysique et de morale,
n 54, 1949, p. 280-316. Ce numro thmatique consacr aux problmes de lhistoire comporte
aussi des articles de Lucien FEBVRE, Henri-I. MARROU, Dominique PARODI, TRN DUC THAO,
Georges DAVY, Claude LVI-STRAUSS et Raymond ARON. On mesure, par ces signatures, limportance accorde en France au thme de lhistoricit.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
24
31-03-2008
15:49
Page 24
PAUL RICUR
trente et forme la Krisis (La Crise des sciences europennes et la phnomnologie transcendantale). Husserl tente de ressaisir le sens dans une Allemagne en pleine tourmente, en proie la maladie nazie. Certes, il avait
dj crois le thme de lhistoricit, mais la crise est alors son paroxysme
et Husserl, ayant des ascendances juives, va dailleurs en tre victime
personnellement : Cest le tragique mme de lhistoire qui a inclin
Husserl penser historiquement 14. Ricur fait le diagnostic dun inflchissement de la pense de Husserl confront au drame de son temps, car
la phnomnologie transcendantale noffre pas un terrain particulirement propice lintrt pour lhistoire. La double rcusation prconise par Husserl du logicisme et du psychologisme ne le prdispose pas
dans un premier temps la prise en compte de la contingence historique.
Bien au contraire, la problmatique husserlienne semble liminer ce
souci par lopration pralable de la rduction transcendantale 15. Certes
la temporalit est interne la conscience en tant que forme unifiante de
tous les vcus. Mais comment raliser une Histoire avec des consciences ?
Pour le faire, Husserl assimile lhistoire la notion de tlologie. Dans
la tradition des Lumires, il reprend lide dune Europe anime par la
Raison, la Libert, lUniversel. Le sens de son histoire est donc dans
la ralisation de sa fonction philosophique : La crise de lEurope ne peut
tre quune dtresse mthodologique 16.
la base de la crise de projet de lEurope, Husserl pointe les effets
funestes de lobjectivisme, de la rduction de la tche indfinie du savoir
sa sphre la plus brillante, le savoir mathmatico-physique. Cest l que
Husserl ralise le nud qui permet darticuler la phnomnologie et lhistoricit en considrant que cette dimension historique nest pas extrieure
mais intrieure la conscience : Parce que lhistoire est notre histoire, le
sens de lhistoire est notre sens 17. Ricur retrouve l, dans cette liaison
entre une philosophie critique et un dessein existentiel, la projection chez
Husserl au plan collectif dune philosophie rflexive dj acheve sur le
plan de lintriorit 18 . Dans ses remarques critiques, Ricur met en
garde contre les excs possibles dune histoire des ides, donc dun idalisme trop dcontextualis, et conseille de se confronter systmatiquement lhistoire des historiens. Il invite donc au dtour par la discipline
historique elle-mme. Par ailleurs, il oppose la trop grande unit de sens
que postulerait une histoire unique la part dimprvisibilit propre toute
14. Paul RICUR, Husserl et le sens de lhistoire , art. cit, p. 281 ; repris dans lcole de
la phnomnologie, Vrin, Paris, 1986, p. 22.
15. Ibid., p. 284 ; p. 25.
16. Ibid., p. 292 ; p. 33.
17. Ibid., p. 293 ; p. 34.
18. Ibid., p. 299 ; p. 40.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 25
LINTRODUCTEUR DE HUSSERL
25
historicit. Ce paradoxe de lhistoire deviendra un des axes majeurs de
linvestigation de Ricur, toujours soucieux de ne jamais abandonner
cette tension propre au rgime dhistoricit. Il est dj clairement explicit
en 1949 dans sa lecture de Husserl : Optimisme de lide et Tragique de
lambigut renvoient une structure de lhistoire o la pluralit des tres
responsables, lvnement du penser sont lenvers de lunit de la tche, de
lavnement du sens 19.
En 1950, Ricur publie sa traduction dIdeen I, Ides directrices pour
une phnomnologie 20, quil a ralise en captivit et acheve au Chambonsur-Lignon. On sait dans quelles conditions Ricur a effectu cette traduction dans les marges du texte allemand, faute de papier. Elle nen est que
plus hroque et constitue LA relique la plus prcieuse de sa bibliothque
personnelle. Il a pourtant craint, alors quil tait au Chambon, quun autre
traducteur ne publie le mme ouvrage, mais Merleau-Ponty a plaid
pour ma traduction, contre lautre, qui ntait pas acheve 21. Ricur
ddie cette traduction son compagnon de captivit, Mikel Dufrenne. Le
premier volume des Ides directrices date de 1913 et constitue un inflchissement idaliste dans le parcours philosophique de Husserl. Selon
Eugen Fink, collaborateur de Husserl, la question pose dans Ideen I
nest pas la question kantienne des conditions de validit pour une
conscience objective, mais la question de lorigine du monde : Elle est
une philosophie qui montre linclusion du monde dans labsolu du
sujet 22. Contrairement aux interprtations usuelles, Ricur ne voit ni
rupture ni reniement de Husserl entre, dune part, le ralisme et le logicisme des Recherches logiques de 1900-1901 et, dautre part, lidalisme et
lexaltation de la subjectivit transcendantale des Ides directrices. Cependant, Husserl a connu une phase aigu dhsitation, de ttonnements, de
remise en question entre 1907 et 1911, et cest dans cette phase dcisive
que sorigine la problmatique phnomnologique : Cest sous la menace
dun vrai solipsisme, dun vrai subjectivisme que nat la phnomnologie 23. La phnomnologie prend alors son ancrage dans une psychologie
revisite par le philosophe au moyen dun certain nombre de procdures
constitutives dune vritable ascse. La phnomnologie remet en question
lvidence de lattitude de la conscience nave, qui est celle de lattitude
naturelle : Par la vue, le toucher, loue, etc., selon les diffrents modes de
la perception sensible, les choses corporelles sont simplement l pour
19. Paul RICUR, ibid., p. 312 ; p. 53.
20. HUSSERL, Ides directrices pour une phnomnologie (1950), Gallimard, coll. Tel ,
Paris, 1985.
21. Paul RICUR, La Critique et la Conviction, op. cit., p. 37-38.
22. Paul RICUR, introduction du traducteur, in HUSSERL, Ides directrices, op. cit.,
p. XXVIII.
23. Ibid., p. XXXIV.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
26
31-03-2008
15:49
Page 26
PAUL RICUR
moi 24. Le philosophe, allant lencontre de cette illusion psychologique,
procde une rduction phnomnologique afin daccder lorigine des
choses. Dans un premier temps, il sagit donc de faire retour aux choses
mmes, de les penser dans leur immanence. Mais en un second temps, le
phnomnologue retrouve le rapport la transcendance ressaisie grce
lintentionnalit. Husserl procde la dissociation du phnomne pur et
du phnomne psychologique grce la notion dintentionnalit,
emprunte son ancien matre Brentano. La conscience est toujours la
conscience de quelque chose, donc la conscience est intentionnalit :
Cest lintentionnalit qui caractrise la conscience au sens fort et qui
autorise en mme temps traiter tout le flux du vcu comme un flux de
conscience et comme lunit dune conscience 25. Il peut alors pratiquer
une dsimbrication du sujet de la connaissance et du sujet psychologique
et se dissocier ainsi du scepticisme psychologiste en lui substituant une
qute des essences, de ltre de lobjet (ou eidos), qui demeure identique
par-del ses variations. Lessence est, selon Husserl, la chose mme qui
se rvle soi dans une donation originaire. Cette opration de rduction
obtenue grce une poch ( mise en suspens ) du sens permet daccder un moi transcendantal en tant que ce moi est vise de quelque chose.
Avec les Ideen I, Husserl essaie donc de fonder une science de lEsprit
qui sorte du traditionnel dilemme entre extriorit et intriorit. Ricur
voit dans cette ascse phnomnologique un prolongement de lexigence
existentielle, du geste de dpassement de soi, de lvitement du pige de
lalination qui pousse le sujet au dehors de lui-mme : La rduction est
le premier geste libre, parce quil est librateur de lillusion mondaine. Par
lui, je perds en apparence le monde que je gagne vritablement 26. En
effet, la chose donne par la perception est restitue dans son indtermination et nest plus conue comme un absolu, mais comme appartenant au
flux variable du vcu. Dans le langage technique des Ideen I, Husserl substitue au vieux dualisme de lintriorit et de lextriorit la distinction
entre nome (le noyau, le sens) et nose (lacte de donation de sens). Le
lien entre la pense et ce qui est pens sexprime alors en termes de
structures notico-nomatiques de la conscience 27. Cest la constitution dune vritable science des phnomnes purs que vise le projet
phnomnologique et cest en ce sens que Husserl aspire mriter le
nom dun commenant rel en qute de cette phnomnologie considre comme commencement du commencement 28. Ricur adhre
la radicalit du projet, contribue le faire connatre en France, mais ne se
24. HURSSEL, ibid, p. 87, 27.
25. Ibid., p. 283, 84.
26. Paul RICUR, Introduction du traducteur, op. cit. , p. XX.
27. HUSSERL, chap. IV, p. 335 sq.
28. HUSSERL, cit par Ricur, Introduction du traducteur, Ides directrices, op. cit., note 2,
p. XXXVIII.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 27
LINTRODUCTEUR DE HUSSERL
27
limite pas en tre le simple passeur passif. Il russit surtout concilier ce
commencement prometteur avec la tradition rflexive franaise et son
horizon existentiel.
Entre 1951 et 1954, Ricur multiplie la publication de ses tudes sur le
corpus husserlien en particulier et sur la phnomnologie en gnral.
Invit au colloque international de phnomnologie par Van Breda
Bruxelles en 1951, il y prsente une communication sur Mthode et
tches dune phnomnologie de la volont qui fait le lien entre le projet
de Husserl et la thse quil vient juste de soutenir la Sorbonne 29. En
1952, il fait connatre aux lecteurs franais Ideen II, restes indites, intitules Recherches phnomnologiques sur la constitution de la ralit dans
son ensemble. Ricur y voit une mise lpreuve de la mthode intentionnelle dfinie dans Ideen I et un clairage rtrospectif de la cohrence
de la dmarche de Husserl. Ideen II accentuent le mouvement amorc par
Ideen I de dplacement de lintrt de la philosophie des sciences vers une
phnomnologie de la perception. Cest dans ce second volet des Ides
directrices que Husserl ralise le passage du peru au corps percevant, laborant pour la premire fois sa doctrine du corps 30. Par ailleurs, Husserl
amorce le mouvement qui lavait men du solipsisme dans Ideen I lintersubjectivit : La validit de droit de lobjectivit et la condition de fait
de lintersubjectivit sont tenues ensemble par Husserl : son analyse suppose que lon fonde lintersubjectivit dans lobjectivit 31. La sphre
psychique telle que Husserl lanalyse est un ordre de ralit auquel on
accde en combinant une approche du psychique, dune part, comme
limite dun mouvement dobjectivation et, dautre part, comme limite
dun mouvement dintriorisation. La psych est la croise de ce double
mouvement convergent de ralisation du moi pur et animation du
corps-objet 32. Les risques dune rduction solipsiste conduisent Husserl
valoriser davantage le niveau intersubjectif comme principal accs au
psychisme. La connaissance dautrui nest pas ce stade linstrument de la
rsolution du problme de lobjectivit, mais il permet de rsoudre le
problme de la constitution du niveau psychique.
Aprs avoir dfini lesprit (Geist) comme autre, non rductible la
nature, Husserl pose la question des conditions dans lesquelles ces deux
29. Paul RICUR, Mthode et tches dune phnomnologie de la volont , Problmes
actuels de la phnomnologie, actes du colloque international de phnomnologie, ParisBruxelles, 1951, Descle de Brouwer, Paris, 1952, p. 110-140 ; repris dans lcole de la
phnomnologie, op. cit., p. 59-86.
30. Paul RICUR, Analyses et problmes dans Ideen II de Husserl , Revue de mtaphysique et de morale, n 57, 1952, p. 35 ; repris dans lcole de la phnomnologie, op. cit., p. 99.
31. Ibid., p. 41 ; p. 105.
32. Ibid., p. 42 ; p. 106.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
28
31-03-2008
15:49
Page 28
PAUL RICUR
ordres de ralit sont pensables ensemble. Lesprit a un soubassement qui
est la nature, mais celle-ci ne joue pas le rle de causalit mcanique, localise. cet gard, Husserl entend affirmer la prminence ontologique
de lesprit sur la nature 33. Toute forme de rductionnisme pratique
entre les sensations vcues et lorganisation du systme nerveux la
manire dont le fait Jean-Pierre Changeux dans LHomme neuronal est
exclue par Husserl, qui opre une distinction entre la part notique (intentionnelle) de la conscience et la part non notique, quil dnomme lhyl
et qui renvoie aux sensations, pulsions, affects. Ricur voit dans cette
dimension intermdiaire de lesprit telle que la dfinit Husserl les bases
dune philosophie de la personne qui lui permet de relier lascse phnomnologique non seulement lexistentialisme, mais aussi au personnalisme de Mounier : Husserl se trouve ainsi une des sources de ces
philosophies de la personne, de lexistence, du sujet concret, etc., qui tentent de combler le hiatus creus par Kant entre la rflexion transcendantale et la psychologie empirique 34. Lappropriation du programme
phnomnologique ne signifie donc pas une rupture dans litinraire philosophique de Ricur. Dailleurs lhritage husserlien est pluriel et ne
peut se transformer en dogme. Cest sur cette pluralit quil insiste dans
Esprit en 1953. Luvre de Husserl tant elle-mme profuse, arborescente, ttonnante, la phnomnologie est pour une bonne part lhistoire
des hrsies husserliennes 35. Ricur distingue cet gard trois familles
distinctes lintrieur mme du projet phnomnologique. En premier
lieu, une manire critique, kantienne, daborder les conditions dobjectivation de la nature du sujet. En deuxime lieu, une phnomnologie de
type hglien reprsente par La Phnomnologie de lesprit. Cette orientation privilgie les mdiations, le passage par le ngatif et par le dpassement des contradictions dans le savoir absolu. Cette double filiation
provoque en troisime lieu une tension ontologique que Ricur voit
disparatre grce la voie offerte par Husserl pour lequel il ny aurait rien
de plus dans ltre que ce qui apparat lhomme. Lascse husserlienne
serait donc un considrable travail dvitement de lontologie : Ne
serait-elle pas en marche vers une philosophie sans absolu 36 ?
En 1954, Ricur se fait le commentateur mticuleux des confrences
prononces par Husserl la Sorbonne en 1929 et regroupes sous le titre
de Mditations cartsiennes. Dans ce haut lieu du cartsianisme, ces confrences se rclament de son hritage, mais en rejetant le dualisme institu
33. Paul RICUR, ibid., p. 70 ; p. 134.
34. Ibid., p. 75 ; p. 139.
35. Paul RICUR, Sur la phnomnologie , Esprit, n 21, 1953, p. 836 ; repris dans lcole
de la phnomnologie, op. cit., p. 156.
36. Ibid., p. 824 ; p. 144.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 29
LINTRODUCTEUR DE HUSSERL
29
par Descartes entre corps et esprit. Husserl reprend le mouvement cartsien en le radicalisant. Selon lui, le doute cartsien nest pas all assez loin.
Il aurait d remettre en question toute extriorit objective et dgager
une subjectivit sans dehors absolu 37. Le cheminement de Husserl le
mne vers la conscration dune gologie transcendantale au stade de la
quatrime Mditation. Il court alors le risque du renfermement solipsiste.
Cette gologie apporte la perspective husserlienne la dimension gntique dans la mesure o il sagit de restituer les conditions de lautoengendrement des vcus. Le solipsisme auquel aboutit Husserl peut donc
tre conu comme nayant quun caractre purement mthodologique 38 . Il aboutit cependant un point aportique dans llucidation
impossible dun monde commun tous partir dune pure gologie. Cest
la cinquime Mditation qui offre la voie de sortie possible de cette aporie en ouvrant lego sur le problme dautrui. Il accorde cette ultime
Mditation cartsienne (qui elle seule est presque aussi longue que les
quatre autres) une tude ultrieure spcifique 39. Ricur y voit un
moment dcisif, une pierre dangle de la phnomnologie transcendantale
dans la mesure o Husserl pose la question de larticulation de lego
lautre, autrui. Il sagit de rpondre deux exigences apparemment
contradictoires : Constituer lautre en moi, le constituer comme autre 40.
Ce double processus dappropriation et de mise distance est ralis par
Husserl au moyen de la saisie analogique de lautre comme un autre moi.
Cest grce cette capacit analogique que le solipsisme peut tre vaincu
sans que lgologie soit sacrifie 41 . cette premire difficult surmonte dans la reconnaissance de lautre comme autre sajoute un nouvel obstacle qui est la ncessaire constitution dune nature objective commune.
Jusque-l, le corps propre, la chair servait de mdiation dans la reconnaissance de lautre, mais il fallait trouver un autre mdiateur pour signifier
que la nature pour moi est la mme nature pour autrui : La notion intermdiaire quil faut ici introduire est celle de perspective 42.
Sur ce point, qui rejoint les vises des sciences sociales, Ricur oppose
les dmarches du sociologue et de lanthropologue, qui partent de la
communaut, du groupe, et celle du phnomnologue, dont lanalyse va
linverse du solipsisme la communaut. Husserl fonde ainsi la
37. Paul RICUR, tude sur les Mditations cartsiennes de Husserl , Revue philosophique de Louvain, n 92, 1954, p. 76 ; repris dans lcole de la phnomnologie, op. cit.,
p. 162.
38. Nathalie DEPRAZ, Gradus philosophique, Flammarion, coll. GF , Paris, 1994, p. 346.
39. Paul RICUR, E. Husserl. La cinquime Mditation cartsienne, lcole de la
phnomnologie, op. cit., p. 197-225.
40. Ibid., p. 199.
41. Ibid., p. 206.
42. Ibid., p. 214.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
30
31-03-2008
15:49
Page 30
PAUL RICUR
ncessit dun point de vue qui nest pas celui (de survol) de Sirius, mais
dun ancrage partir dun corps propre, seul mme de comprendre
ltranger, le diffrent. Le projet phnomnologique ne se referme donc
pas dans un systme, mais ouvre au contraire le champ des possibles et ne
constitue quun systme de sens possible pour nous 43 . Outre la technicit du langage husserlien, sa philosophie adopte donc une attitude fondamentalement modeste qui permet darticuler la vise universalisante
avec le pouvoir qua chacun de faire retour soi dans la rflexion.
Ricur na pas t le seul introduire la phnomnologie husserlienne
en France. Outre Merleau-Ponty, dont nous avons voqu luvre matresse sur la perception, il est un autre introducteur de Husserl qui a jou
un certain rle en ces annes cinquante, cest le communiste vietnamien
Trn Duc Thao. N en 1917, form au lyce franais de Hanoi, il poursuit
ses tudes au lyce Louis-le-Grand, puis Henri-IV, avant dentrer
lENS dUlm. Agrg de philosophie en 1943, il se lance avec passion dans
ltude de Husserl. Il adhre au Parti communiste et dfend le Vit-minh
en pleine guerre dIndochine, ce qui lui vaut quelques mois de prison.
Trn Duc Thao essaie de concilier phnomnologie et marxisme et publie
son premier ouvrage en 1951 44. Ce livre connat un certain retentissement
puisque Merleau-Ponty et Roland Barthes sen font lcho. Ricur fait
son loge dans son article sur la phnomnologie paru dans Esprit 45. Il y
salue surtout une excellente premire partie, historique et critique, qui
prsente lentreprise husserlienne. Trn Duc Thao se donne pour objectif
de dmontrer que la phnomnologie est la dernire figure de lidalisme,
mais un idalisme qui a la nostalgie de la ralit. Il se fait fort cet gard
de donner une assise matrialiste la phnomnologie, grce au marxisme.
Certes, Ricur ne le suit pas sur ce point et montre au contraire les difficults incommensurables dun tel projet, qui prtend raliser la phnomnologie dans le marxisme. Sil considre que le philosophe
vietnamien a raison daccorder lanalyse de laction une place privilgie,
il critique sa survalorisation de la notion de travail qui est envisage
comme un tout (ce qui renvoie un dbat au sein mme de la revue
Esprit) : Thao veut que la structure du travail rel tienne en germe toute
lintentionnalit du langage et par l tout ldifice de la raison logique 46.
Appel devenir un philosophe cout en France, Trn Duc Thao choisit pourtant un autre destin. Son pays conquiert son indpendance au
terme de la confrence de Genve en 1954. Il part pour Hanoi o il
43. Paul RICUR, ibid., p. 224.
44. TRN DUC THAO, Phnomnologie et matrialisme dialectique, d. Minh-Tan, Paris,
1951.
45. Paul RICUR, Sur la phnomnologie , art. cit.
46. Ibid., p. 833 ; p. 153.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 31
LINTRODUCTEUR DE HUSSERL
31
devient en 1956 doyen de la facult dhistoire. Trs vite victime dun
rgime qui rvle son totalitarisme, il est interdit denseignement deux ans
seulement aprs son arrive, qualifi de trotskiste , un chef daccusation
particulirement grave. Il est rduit limpuissance par le gouvernement
vietnamien, et confin des travaux alimentaires de traduction 47. Son
destin se termine tragiquement en France, o il revient en 1992. JeanToussaint Desanti met en contact Trn Duc Thao avec Thierry Marchaisse,
diteur responsable de Lordre philosophique au Seuil. Trn lui
explique quil a pris parti pour la perestroka de Gorbatchev ds le milieu
des annes quatre-vingt, mais que le dpart du numro un sovitique a
provoqu un changement dans la direction du PC vietnamien. La ligne
quil incarnait sest trouve soudainement condamne : Ils mont envoy
en France pour y passer en jugement 48. On lui procure alors un aller
simple pour Paris, o il doit tre dfr devant un tribunal form par des
cadres communistes du PCF : Tout sest pass dans les rgles. On ma
laiss parler. Jai d plaider une cause, trs longuement. Seulement, la
partie tait perdue davance... Jai donc t condamn et exclu comme
tratre [...]. Et, le verdict peine rendu, je recevais du Vit-nam une lettre
mapprenant la confiscation de tous mes biens et me faisant savoir que jy
tais personna non grata. Me voil donc la rue, sans argent, sans appui
et coinc en France pour le restant de mes jours 49. Est-ce l lexpression
dune paranoa entretenue par un rgime fond sur la peur ou y a-t-il eu
rellement procs de Moscou Paris visant un Vietnamien ? Nul ne peut
le savoir vraiment, dautant que lhorloge du temps stait arrte pour
lui au dbut des annes cinquante 50 . Se sentant traqu, Trn Duc Thao
mit le souhait de rencontrer un des rares philosophes en qui il avait
pleine confiance : Ricur. Thierry Marchaisse crit donc immdiatement
Ricur pour solliciter de sa part une entrevue, dont il recevra ensuite ce
compte rendu de Ricur : Jai rencontr Thao il y a quelques semaines
et cette rencontre ma boulevers mon tour. Je ne sais pas ce qui relve
de la fabulation ou de la perscution dans des rapports de toutes faons
pervertis par la peur et par le mensonge [...]. Jai eu limpression dun
homme menac de mort... Je ne sais pas de quoi nous sommes vritablement responsables 51. Peu de temps aprs, au printemps 1993, la ple
silhouette de Trn Duc Thao steignait Paris.
Il est un autre introducteur de Husserl dimportance, cest Emmanuel
Levinas qui est trs tt en contact avec Husserl. Il suit son dernier cours
47. Informations tires dun document indit de Thierry MARCHAISSE, Tombeau sur la
mort de Trn Duc Thao .
48. Trn Duc Thao, cit par Thierry MARCHAISSE, ibid.
49. Ibid.
50. Thierry MARCHAISSE, Tombeau sur la mort de Trn Duc Thao , op. cit.
51. Lettre de Paul RICUR, ibid.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
32
31-03-2008
15:49
Page 32
PAUL RICUR
Fribourg-en-Brisgau en 1928-1929 : Cest toute laventure de la phnomnologie qui commence pour moi 52. Cest lorsque Levinas achve sa
licence de philosophie en 1927 Strasbourg que Gabrielle Peiffer lui
conseille de lire Husserl. Il dcouvre alors Les Recherches logiques avec
enthousiasme, non en tant quune nouvelle construction philosophique
aprs beaucoup dautres, mais comme ouverture de nouvelles possibilits de penser 53 . Il crit ds 1929 un article sur Husserl 54 et se lance
ensuite avec Gabrielle Peiffer dans la traduction des Mditations cartsiennes. Il dpose par ailleurs un sujet de thse sous la direction de Maurice
Pradines : La Thorie de lintuition dans la phnomnologie de Husserl 55,
et cest pour raliser ce travail quil se rend en Allemagne suivre les cours
du matre Husserl : Cet homme dallure assez grave, mais affable, dune
tenue extrieure sans dfaillance, mais oublieux de lextrieur, lointain
mais non hautain, et comme un peu incertain dans ses certitudes, soulignait la physionomie de son uvre prise de rigueur et cependant
ouverte, audacieuse et sans cesse recommenante comme une rvolution
permanente 56. Il devient familier du foyer des Husserl et donne des
cours de franais madame Husserl. Levinas soutient et fait paratre sa
thse en 1930 57. Puis, participant aux activits de la Socit franaise de
philosophie de Jean Wahl, il est un des premiers en ces annes trente
exposer les principes de la phnomnologie Paris. Pourtant, ce travail est
immdiatement relay par un autre choc, qui est la dcouverte par Levinas
de luvre de Heidegger. Parti en Allemagne pour y trouver Husserl,
il croise Heidegger sur son chemin, et suit quelques-uns de ses cours,
dialogues et sminaires : Jai pu assister la fameuse rencontre de
Davos en 1929 o Heidegger a parl de Kant et o Cassirer a parl de
Heidegger 58. Lenthousiasme de Levinas pour Heidegger va vite
refouler Husserl au second plan, et cest ainsi que la diffusion des thses
husserliennes auprs des nouvelles gnrations de philosophes passera
donc bien davantage dans laprs-guerre par le travail de commentaire
ralis par Ricur.
52. Emmanuel LEVINAS, E. Levinas, dialogue avec Franois POIRI, La Manufacture, Besanon, 1992, p. 61.
53. Ibid., p. 61.
54. Emmanuel LEVINAS, Sur les Ideen de Monsieur Husserl , Revue philosophique de la
France et de ltranger, mars-avril 1929.
55. Informations reprises de Marie-Anne LESCOURRET, E. Levinas, Flammarion, Paris,
1994, p. 72.
56. Emmanuel LEVINAS, En dcouvrant lexistence avec Husserl et Heidegger (1949), Vrin,
Paris , 1988, p. 126.
57. Emmanuel LEVINAS, La Thorie de lintuition dans la phnomnologie de Husserl,
Alcan, Paris, 1930.
58. Emmanuel LEVINAS, E. Levinas, dialogue avec Franois POIRI, op. cit., p. 65.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 33
A.V.1
Esprit aprs le tournant de 1957
En 1957, un mini-coup dtat a lieu lintrieur de lquipe dEsprit,
selon les termes mmes de lauteur du putsch : Jean-Marie Domenach.
Secrtaire de la rdaction depuis 1946, il na pu succder Mounier en
1950 du fait de son trop jeune ge : vingt-huit ans. Mais lorsque Albert
Bguin disparat en mai 1957, le toujours jeune Domenach (il na alors que
trente-cinq ans), et dj vtran de la revue, sait que son heure est venue
dassurer la direction dEsprit. Il en prend pour vingt ans ! Plus quun
changement dhomme, 1957 reprsente une relle mutation quaffirme
haut et fort la livraison de novembre 1957 qui sintitule Esprit, nouvelle
srie . Domenach est codirecteur de la revue aux cts dAlbert Bguin
depuis juin 1956. Cela lui permet de prparer la relve de gnration quil
ralise en 1957. Les plus proches de Mounier quittent le comit directeur
dEsprit, commencer par la veuve dEmmanuel Mounier, Paulette
Mounier, laquelle se joignent Paul Fraisse, Jean Lacroix, Henri Marrou,
Bertrand dAstorg, Henri Bartoli, Marcel David 1.
Le tournant radical impuls par Jean-Marie Domenach nest pourtant
pas une rupture avec le personnalisme et avec tout lhritage lgu
par Mounier que revendique Domenach : Nous acceptons notre hritage [...]. Toute recration est retour la source [...] Cest sur une fidlit
mieux comprise que nous assurerons notre nouveaut 2. Cest donc le
changement, mais dans la continuit du personnalisme.
1. De lancienne quipe restent aux cts de Domenach : Paul Ricur, Jean Ripert, Georges
Suffert, Olivier Chevrillon, Bernard Lambert. Parmi les nouveaux arrivants : Destanne de
Bernis, Ren Pucheu, Jean Conilh, Michel Debatisse, Rabier et quelques trangers, dont le
Polonais Krasinski et lAnglais Darling.
2. Jean-Marie DOMENACH, Esprit, nouvelle srie , Esprit, novembre 1957, p. 468-485.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
34
31-03-2008
15:49
Page 34
PAUL RICUR
Des diffrences se font sentir nanmoins dans une rupture avec ce qui
est qualifi douvririsme. La revue oriente sa rflexion sur lefficacit de
la gestion tatique et participe ce que lon qualifie dj de nouvelle idologie technocratique. Beaucoup de membres du club Jean-Moulin, qui est
devenu un haut lieu de rencontre pour les responsables de la planification
et les reprsentants du monde syndical, ainsi que des universitaires et des
journalistes, deviennent des rdacteurs rguliers dEsprit. Une orientation
plus pragmatique et moins prophtique est donc impulse par Domenach,
qui se donne une double ambition critique : se dfaire de mythes considrs comme encombrants et dcouvrir la socit franaise dans sa ralit
moderne par le biais des sciences humaines. Leffort principal consiste
laborer une analyse concrte, en mobilisant tous les instruments possibles
afin daccompagner laction des dcideurs. ce rythme, le temps des
agrgs prend fin laissant place une gnration de technocrates 3 . Paul
Thibaud, ancien de la JEC, est charg de centraliser les efforts concernant
les recherches extrieures la revue. Les engagements militants refluent,
si lon excepte la guerre dAlgrie, et le recours aux spcialistes est de plus
en plus frquent pour traiter les questions de socit. La mtamorphose
de celle-ci est telle que lon baptise lre nouvelle socit consommation . Esprit doit se faire lcho de cette volution vers une place croissante des loisirs, vers le repli sur soi qui laisse sur le bord de la route les
inadapts, les personnes ges, les classes dfavorises... La revue doit tre
lexpression de ce que Domenach qualifie de dsespoir esprant 4 , et
rhabilite le sens de la crativit et la place de la spiritualit, peu clbres
dans cette socit de consommation. Un rapprochement sopre entre
Esprit et Le Monde grce au directeur du grand quotidien du soir, Hubert
Beuve-Mry qui appartient la rdaction dEsprit depuis la guerre.
Beuve-Mry interviendra assez rgulirement dans Esprit : en septembre
1959, il participe encore lenqute sur la dmocratie 5 . Beaucoup de
journalistes du Monde crivent dans les colonnes dEsprit 6. La dynamique engage attire aussi vers la revue des chrtiens progressistes issus
de lUNEF et de la CFTC, que lon qualifiera plus tard de deuxime
gauche , ne du rejet du molltisme et du combat pour lindpendance
3. Olivier BRETON, Esprit. Dun sous-titre lautre ou dune nouvelle srie Changer
la culture et la politique : J.-M. Domenach (1957-1977), Mmoire de DEA, 1990, Paris-VII,
Archives Mounier.
4. Jean-Marie Domenach, cit par Olivier BRETON, ibid.
5. Rmy RIEFFEL, La Tribu des clercs, les intellectuels sous la Ve Rpublique, Calmann-Lvy,
Paris, 1993, p. 337.
6. Cest le cas de Jean Lacouture, Pierre Viansson-Pont, Andr Fontaine, Jean Planchais,
Paul Fabra, Raymond Barillon, Claude Julien... Informations tires de Rmy RIEFFEL, ibid.,
p. 338.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 35
ESPRIT APRS LE TOURNANT DE 1957
35
de lAlgrie. Parmi les reprsentants de ce courant : Jacques Julliard et
Michel Winock. Cette anne 1956 ma dfinitivement attach Esprit 7.
Abonn la revue, il y crit son premier article en 1962 sous le pseudonyme de Christophe Calmy. Nomm Montpellier aprs lagrgation
dhistoire, Michel Winock profite de la premire occasion, la Nol 1961,
pour demander voir Domenach. Il est reu par Paul Thibaud et se lance
dans la publication de quelques chroniques pendant trois ans. Puis il rencontre fortuitement Domenach, qui ne le connaissait pas, au cinma des
Ursulines. Il se prsente lui et le voil intgr dans lquipe, signant de
son vrai nom partir de 1965 : Domenach me dit : On a besoin dun
rajeunissement, je te propose dentrer au comit directeur. Cest ainsi
que je suis entr en mme temps que Daniel Moth, autour de 1969 8.
La relve est donc brillamment assure par Domenach, qui connat
nanmoins quelques problmes avec la hirarchie catholique. Il est en
effet convoqu en 1957 par deux cardinaux et un archevque, qui esprent
lintimider pour faire rentrer Esprit dans le rang et lui donner un ton plus
romain : Ils mont dit : Monsieur le directeur, nous avons appris que
Rome allait vous condamner, aussi avons-nous pris les devants 9. JeanMarie Domenach stonne et demande en savoir davantage sur les chefs
daccusation. Il apprend alors quil a commis au moins trois pchs capitaux : manque de respect envers la hirarchie, absence de soutien lcole
libre et croyance selon laquelle il y aurait des valeurs dans lathisme. Si
Domenach regrette de navoir pas dit en face de ses accusateurs masqus
ce quil pensait de leur lchet 10 , il a nanmoins prpar la parade.
Il leur prcise que si lui, catholique, se soumet aux autorits, Esprit ne se
soumet pas parce que ce nest pas une revue catholique, et jen confierai la
direction monsieur Paul Ricur, qui est protestant 11 . Lefficacit de la
menace est immdiate. Le cardinal bat en retraite : Mieux vaut un mauvais catholique quun bon protestant 12. Ricur avait accept de diriger
ventuellement la revue pour viter lexcommunication, alors quil na
aucun got pour le pouvoir : Son attitude a t courageuse, mais cela
aurait t un dsastre car il naurait pu dire non. Or, diriger une revue
consiste savoir dire non 13.
Lhypothque religieuse peine leve par le recul du cardinal, la situation politique provoque quelques remous lintrieur mme de la revue.
7. Michel WINOCK, De lintrieur lextrieur , Esprit, n 73, janvier 1983, p. 141.
8. Michel Winock, entretien avec lauteur.
9. Jean-Marie Domenach, entretien avec lauteur.
10. Jean-Marie DOMENACH, Esprit, dcembre 1976.
11. Jean-Marie Domenach, entretien avec lauteur.
12. Ibid.
13. Ibid.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
36
31-03-2008
15:49
Page 36
PAUL RICUR
La IVe Rpublique meurt en 1958, un certain 13 mai. la faveur de cette
disparition dans les sables algriens, le gnral de Gaulle est de retour et
une nouvelle rpublique se met en place. Or, le nouveau directeur dEsprit,
Domenach, adhre aux positions du gnral, lexception de la manire
dont il gre le dossier algrien : De Gaulle, nous lavons dabord assimil
un apprenti dictateur. Je lai rencontr ensuite en 1954 la suite de mon
livre sur Barrs et jai t sduit. Do mon crypto-gaullisme vers 1957.
Jtais content de le voir au pouvoir 14. Le gaullisme de Domenach nengage pas la rdaction dEsprit et y provoque mme quelques remous perceptibles dans les livraisons de la revue. En octobre 1962, au moment du
rfrendum sur lamendement constitutionnel qui institue llection du
prsident de la Rpublique au suffrage universel, Paul Thibaud appelle
voter oui, alors que Georges Lavau, avec toute la gauche, donne comme
consigne de voter non. En 1964, les clubs Esprit sengagent pour la candidature de Gaston Defferre alors que Jean-Marie Domenach, refusant de
soutenir Franois Mitterrand, vote blanc au second tour des prsidentielles de 1965. En 1966 encore, il raffirme sa confiance en de Gaulle dans
un manifeste avec vingt-neuf autres personnalits de gauche 15. Cette
adhsion au gaullisme ne correspond pas lengagement politique de
Ricur qui, sans rompre, se distancie manifestement de la revue Esprit
dans laquelle il crit moins entre 1962 et le milieu des annes soixante-dix :
Domenach avait sentimentalement une grande admiration pour de
Gaulle que Ricur ne partageait pas, sans tre dans la dnonciation contre
le prtendu fascisme 16. Ricur reste le philosophe de rfrence dEsprit,
continue collaborer activement sa rflexion collective. Cest en 1963
(nous y reviendrons) qua lieu le fameux dbat entre Lvi-Strauss et
Ricur et en 1964 lenqute anime par Ricur sur ltat de luniversit.
Mais il est trop facilement rquisitionn son got aux avant-postes des
controverses intellectuelles. Face la leve de boucliers lacano-althussrienne qui accueille au vitriol son essai sur Freud en 1965, il ressent avec
une certaine amertume une grande solitude, galement Esprit, o il na
probablement pas trouv le soutien quil aurait voulu 17 .
Pendant une dizaine dannes, de 1965 1975, Ricur va prendre
quelque peu ses distances avec la revue. Si le diffrend politique qui loppose Domenach a eu sa part dans ce retrait, un autre facteur a jou : il ne
14. Jean-Marie Domenach, entretien avec Rmy RIEFFEL, La Tribu des clercs..., dans
R. RIEFFEL, op. cit., p. 332.
15. Olivier BRETON, Esprit. Dun sous-titre lautre..., op. cit. Parmi les cosignataires :
Emmanuel dAstier de La Vigerie, Paul-Marie de La Gorce, Pierre Emmanuel, Franois Perroux,
Maurice Rolland, Armand Salacrou...
16. Paul Thibaud, entretien avec lauteur.
17. Ibid.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 37
ESPRIT APRS LE TOURNANT DE 1957
37
supporte pas dtre sur le front constamment. Domenach le considre en
effet comme un munitionnaire fondamental dans le dbat intellectuel qui
se durcit dans les annes soixante. Or, cest un homme qui a profondment peur dtre rquisitionn 18 . Il a en effet un besoin vital de dfendre
la singularit de sa pense, de son parcours, et ne peut donc se laisser
embrigader ou diluer dans un combat collectif quelconque quelle quen
soit la justesse : On peut beaucoup demander Ricur condition de ne
pas avoir trop besoin de lui, paradoxalement 19.
En 1967, Paul Thibaud est promu rdacteur en chef sous la direction de
Domenach 20. Les annes soixante-dix sont marques par une critique
plus acerbe de ltat, coupable de vider la socit de sa substance. Cest
lpoque des fronts secondaires au cours de laquelle les avances et les
luttes contournent le pouvoir pour promouvoir les thmes autogestionnaires. Les grandes sources dinspiration dEsprit sont alors les thses
dIvan Illich, qui multiplie ses interventions dans la revue et dont Le Seuil
publie les ouvrages qui mettent en cause l industrialisme, le productivisme et le mythe de largent 21 . Domenach sengage avec ferveur dans
un des fronts secondaires, celui des prisons, aux cts de Michel Foucault
et de Pierre Vidal-Naquet. Ils crent le GIP en 1971 (Groupe informations prisons), qui multiplie meetings, actions de soutien et propagande
contre le durcissement de la politique rpressive et la duret du systme
pnal. Mais surtout, Esprit devient une des composantes dun vritable
front antitotalitaire partir de lexpulsion dAlexandre Soljenitsyne
dURSS. Le bannissement de Soljenitsyne voque laffaire Dreyfus : ce
nest pas seulement une erreur judiciaire, cest un crime de gouvernement
contre lhonneur dun peuple 22. Le creuset de la critique du systme
totalitaire et du soutien aux dissidents est constitu par les thses de Socialisme ou Barbarie et notamment de leurs deux figures de proue, Cornlius
Castoriadis et Claude Lefort. Celui qui a permis la ralisation dun
change intellectuel fructueux entre ces deux familles de pense trs dissemblables est un ancien ouvrier, militant de la CFDT, venu de Socialisme
ou Barbarie, et collaborant de plus en plus rgulirement la revue Esprit,
Daniel Moth : Bizarrement, il a fallu que ce soit un proltaire, un vrai
ajusteur de chez Renault, un type en or comme Moth, qui soit capable de
faire se rencontrer des groupes dintellectuels 23.
18. Paul THIBAUD, ibid.
19. Ibid.
20. On reviendra sur le passage de mai 1968.
21. Jean-Marie DOMENACH et Paul THIBAUD, Avancer avec Illich , Esprit, n 426, juilletaot 1973, p. 1-16.
22. Jean-Marie DOMENACH, Soljenitsyne ou le destin de lEurope , Esprit, n 433, mars
1974, p. 392.
23. Paul Thibaud, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
38
31-03-2008
15:49
Page 38
PAUL RICUR
En 1976, alors quEsprit est un des lments constitutifs dune configuration plus large qui englobe la CFDT et la deuxime gauche rocardienne,
Domenach quitte la direction dEsprit sans dsaccord rel, mais parce
quil considre quil est temps de passer la main la nouvelle gnration :
Jai toujours pens, comme Mounier, quune revue est une affaire de
gnration. La mienne a dur un peu plus longtemps quil ne fallait 24.
Cest Paul Thibaud, second par un nouveau secrtaire de rdaction,
Olivier Mongin, quincombe la responsabilit de diriger Esprit. Signe du
changement, la revue se dote dun autre sous-titre en forme de vu :
Changer la culture et la politique . Thibaud veut viter les deux cueils
que constituent, dune part, une posture dnonciatoire et, dautre part,
ladhsion pure et simple des technologies sociales modernes. La fin du
divorce entre l insertion pratique du professionnel et la frustration
didal social 25 passe par lappropriation de la culture par la socit, par
le vcu social. Paul Thibaud prend, et avec lui la jeune gnration qui lentoure, des distances de plus en plus marques avec le personnalisme, si
bien qu loccasion du cinquantenaire de la fondation dEsprit, en 1982,
ses positions sont ouvertement critiques. Le seul des anciens le suivre
sur cette voie est Ricur, qui fait dailleurs une intervention sans quivoque en cette occasion solennelle : Meurt le personnalisme, vive la
personne. videmment, jai dit des choses tout fait quivalentes qui
ont t trs mal reues. Mais la fin, Ricur ma dit quil tait tout fait
favorable cette sorte de liquidation 26. La critique du legs personnaliste
se traduit par une mise distance de la pense dIvan Illich, qui avait t
jusque-l une des grandes rfrences de la revue Esprit : Illich a t la
dernire forme de personnalisme, cest--dire, selon la formule de Mounier,
une socit oriente selon des valeurs 27. Le personnalisme de Mounier,
comme le libertarisme communautaire dIllich, ne semble plus dactualit
dans les annes soixante-dix pour Paul Thibaud : Personnellement, jen
suis sorti, et je ne suis pas le seul, travers Louis Dumont 28. Ce nest pas
tant lanalyse de lInde ou le holisme qui sduisent Thibaud, mais sa prface lHomo hierarchicus 29, qui rintroduit Tocqueville au centre du
dispositif intellectuel. Lindividu peut alors tre vcu comme valeur positive sans mauvaise conscience : Le communautarisme, je nai rien contre,
24. Jean-Marie DOMENACH, Sans adieu , Esprit, n 463, dcembre 1976, p. 743.
25. Paul THIBAUD, Aujourdhui , Esprit, dcembre 1976, p. 760, cit par Rmy RIEFFEL,
La Tribu des clercs..., op. cit., p. 351.
26. Paul Thibaud, entretien avec lauteur.
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Louis DUMONT, Homo hierarchicus, le systme des castes et ses implications, Gallimard,
Paris, 1967.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 39
ESPRIT APRS LE TOURNANT DE 1957
39
mais cest fini. Nous sommes dans une socit o lindividualisme est
notre idal social 30. Toute une gnration collabore Esprit sur ces nouvelles bases 31.
Ce rarmement idologique est li une attitude plus offensive et en
pointe sur le terrain de lantitotalitarisme, port de plus par le projet de
socit dune deuxime gauche sortie de la marginalit depuis son adhsion au Parti socialiste. Esprit poursuit son chemin sans tutelle paternelle.
Cest justement dans ces conditions que Ricur, ne risquant plus dtre
rquisitionn et marginalis dans des polmiques, intervient plus volontiers dans les colonnes de la revue : Une fois quil a vu quon sen sortait,
il sest senti plus laise. Il tait dailleurs profondment en accord avec
cette orientation 32. cela Olivier Abel objecte que Ricur, marqu par
le dsir dchapper lindividualisme protestant, a toujours maintenu
lhorizon communautaire, la fois comme espace partag dexprience et
comme horizon commun dattente. Il a toujours port cette dimension
dimagination commune et ce projet dun vivre-ensemble, contribuant
sortir Esprit de son ct phalanstre, sans pour autant adhrer la clbration de lindividualisme.
30. Paul Thibaud, entretien avec lauteur.
31. En 1977, le directeur dEsprit est Paul Thibaud, le secrtaire de rdaction Olivier
Mongin, et le comit de rdaction est compos de Christian Andejean, Jacques Caroux, JeanMarie Domenach, Jean-Claude Eslin, Jacques Julliard, Philippe Meyer, Jean-Pierre Rioux,
Alfred Simon.
32. Paul Thibaud, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 40
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 41
A.V.2
Massy-Palaiseau sous le charme de Louis Simon
Depuis son arrive aux Murs blancs, tous les dimanches, Paul Ricur
sinstalle au mme endroit avec sa femme Simone dans le temple de MassyPalaiseau. partir de 1961-1962, cette paroisse a, en la personne de Louis
Simon, un pasteur dont les prdications attirent bien au-del du territoire
paroissial. Ancien aumnier des tudiants de la Fd parisienne, il a particip avec le mouvement tudiant toute leffervescence de la fin de la
guerre dAlgrie. Engag gauche, il est membre du PSA, et il est toujours
sur les listes de soutien du PCF loccasion des lections de Palaiseau. La
frquentation des normaliens et des polytechniciens la pouss parfaire
sa culture thologique : Cest pendant ces quelques annes que je me suis
oblig me faire une culture thologique intensive 1. Palaiseau, son
rayonnement est tel que toute une srie de gens nhsitent pas traverser
Paris pour suivre sa prdication, aussi bien des thologiens confirms,
comme Jacques Maury (prsident de lERF), Jacques Beaumont (secrtaire de la Cimade), Jacques Lochard (secrtaire de Christianisme social),
le pasteur Ren Cruse (un des animateurs du MIR : Mouvement international de la rconciliation), Ennio Floris (ancien directeur du CPN :
Centre protestant du Nord), Bernard Picinbono (prsident de la Cimade
de 1970 1982), les Casalis, qui habitent Antony, que des tudiants de la
facult de thologie protestante de Paris comme Pierre Encrev, Jean
Baubrot, Philippe de Robert, auxquels se joignent bien sr les habitants
de la paroisse : Paul Ricur, Andr Encrev...
On se presse donc le dimanche au temple de Palaiseau o lon compte
jusqu cent cinquante personnes : La prdication de Simon sortait de
1. Louis Simon, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
42
31-03-2008
15:49
Page 42
PAUL RICUR
lordinaire. Ctait un prdicateur hors pair, trs original 2. Ses prdications sont toujours trs crites, trs stylises, prononces dune langue
rude, gutturale, dployant un pathos et une force potique particulirement vhments dans sa dimension critique : Elles taient iconoclastes
en tout cas, toujours 3. La parole de Louis Simon est dautant plus singulire et engage quelle est suivie Palaiseau dune discussion dun
niveau exceptionnel puisque lauditoire compte parmi les meilleurs exgtes ou thologiens protestants. Lide nest donc pas de profrer une
vrit dernire, mais de surprendre, davancer des positions discutables.
Son discours vise donner une dimension politique lengagement du
chrtien, non pas au sens dun ditorial politique, mais ctait une faon
de lire qui mettait les gens en situation de sengager eux-mmes 4 .
La prdication de Louis Simon devait conduire les paroissiens non pas
se justifier, mais tre heureux de ce quils faisaient : Elle librait les gens
pour que, dans leurs actions, ils soient srs dtre prs de lvangile 5.
Cette articulation de la parole sur lagir correspond bien aux positions du
paroissien Ricur, de mme que la mthode hermneutique utilise par
Simon. Pour lui, les textes originaux, les textes bibliques ont t, comme
le fut la parole du Christ, des propos qui tonnent et drangent leurs auditeurs ou leurs lecteurs. Il convient donc de retrouver cette force originelle
en nhsitant pas bousculer la poussire accumule par les sicles. Il parvient donc faire prouver une partie de ltonnement premier : Il avait
un art fantastique pour dpoussirer les textes et pour faire surgir ce qui
devait choquer les auditeurs initiaux, et dans une certaine mesure nous
choquer nous-mmes. Ctait laspect le plus fort de sa mthode 6.
Au plan de son inspiration thologique, Simon suit une volution semblable celle de Ricur, et qui est commune toute une gnration de
protestants. Lorsquil arrive Massy-Palaiseau en 1962-1963, il est encore
trs marqu par lenseignement barthien, corrig toutefois par la lecture
de Bultmann. Sa prdication vise donc dvelopper une critique radicale
de la religion qui prtend tre capable de Dieu, alors que lhomme, selon
Barth, ne relve pas de lordre divin : Cest une priode de prdication
contre la religion. Ctait trs important pour moi parce que lvangile ne
pouvait se comprendre que dans une opposition radicale avec la religion 7. Par ailleurs, il est le premier membre du corps pastoral de Paris
2. Bernard Picinbono, entretien avec lauteur.
3. Louis Simon, entretien avec lauteur.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Bernard Picinbono, entretien avec lauteur.
7. Louis Simon, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 43
MASSY-PALAISEAU SOUS LE CHARME
43
mettre en place un groupe de travail au CPED (Centre protestant dtude
et de documentation) de la rue de Vaugirard sur les uvres de Bultmann.
Cette phase critique entrane ladhsion et lenthousiasme de nombreux
tudiants de la facult de thologie protestante de Paris. Au dbut des
annes soixante, Pierre Encrev suit la fois les cours de lettres classiques
la Sorbonne et le cursus de thologie boulevard Arago. Alors quil est
domicili rue de Vaugirard, il rejoint Louis Simon Palaiseau. Ils entretiennent un lien privilgi et djeunent ensemble tous les dimanches. En 1962,
inscrit en troisime anne de thologie, Pierre Encrev doit faire un stage
dans une paroisse, et cest tout naturellement Massy-Palaiseau quil choisit : Jy ai mme prch et Ricur est venu me fliciter. Ctait sur le
thme de la tour de Babel 8. Plus attir par la linguistique, les langues
mortes et lenseignement de Benveniste que par la philosophie, Pierre
Encrev est ce point enthousiasm par les cours que donne Ricur boulevard Arago sur les grands mythes, dans le cadre de Finitude et Culpabilit, quil dcide dassister ses cours la Sorbonne. Il y retrouve un
prolongement de ses propres centres dintrt puisque Ricur initie alors
ses tudiants la philosophie du langage et Freud : Il a t le premier
donner des cours sur la psychanalyse dans une facult de thologie protestante. Ctait formidable. Il nous avait dit : Il ne sagit pas de faire des
pasteurs des psychanalystes, mais simplement quils comprennent le
moment o leur rle sachve et commence celui du psychanalyste. Donc,
vous devez savoir le moment o, au lieu de continuer couter, vous
devez vous faire couter par un autre 9.
Aprs sa phase barthienne, Louis Simon radicalise encore sa critique de
la religion en sappuyant sur les thses de Dietrich Bonhoeffer, thologien
allemand rsistant au nazisme. Ayant particip une tentative dlimination de Hitler, Bonhoeffer avait t excut sur lordre de ce dernier dans
sa prison le 9 avril 1945. Louis Simon trouve en lui celui qui poursuit
lenseignement de Barth en raffirmant fortement la rvlation de Dieu
dans le Christ, mais en mme temps ouvert lhermneutique bultmannienne. Cette position mdiane, bien mise en valeur par Andr Dumas 10,
est partage par Ricur, qui sort lui aussi progressivement du barthisme.
Bonhoeffer insiste sur la responsabilit humaine, sur le discriminant que
reprsente son comportement dans le monde afin dviter une justification trop facile par la seule foi. Lengagement politique est lhorizon
des thses de Bonhoeffer, et cest cet impratif qui sduit Louis Simon :
8. Pierre Encrev, entretien avec lauteur.
9. Ibid.
10. Andr DUMAS, Une thologie de la ralit : Dietrich Bonhoeffer, Labor et Fides, Genve,
1968.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
44
31-03-2008
15:49
Page 44
PAUL RICUR
La religion console et lvangile doit dresser les hommes pour btir un
monde nouveau 11. Les lettres de captivit de Bonhoeffer, publies sous
le titre Rsistance et Soumission 12, ont une forte influence sur les prdications de Simon. Ses thses, selon lesquelles la modernit donne naissance
un tre adulte, contraignent la pense chrtienne une conversion profonde 13 . Au point que Bonhoeffer avance la formule dun christianisme
areligieux en dfinissant le parcours dune foi qui traverse la scularisation
comme lexpression dune libration : Ce nest pas lacte religieux qui
fait le chrtien, mais sa participation la souffrance de Dieu dans la vie du
monde 14. Le paroissien Ricur est totalement en phase avec ces positions, qui font cho son fameux texte, Le socius et le prochain , mais
aussi ses convictions philosophiques des annes soixante sur la ncessaire traverse des matres du soupon, Marx, Freud, Nietzsche : Je sais
que Ricur a mieux aim cette tape que la premire 15.
Avec la monte de la contestation dans la fin des annes soixante, Louis
Simon connat une troisime phase de ses prdications inspires par ce
que lon appelle alors la thologie du monde. Allant jusquau bout de
lorientation impulse par Bonhoeffer, il sagit ce stade de dmontrer
que lon peut mme se passer dglise pour prner une relation vanglique directe, non mdie, une relation directe Christ-monde qui peut
ventuellement passer par lglise, mais de manire secondaire. Cest un
moment o lon cesse de considrer que tout se construit partir de
lglise : En gnral, on tablit dabord le rapport Christ-glise, et aprs
on fait un projet pour le monde. Il fallait casser cela. Il y a eu une grande
bataille sur ce thme avec Ellul 16. Jean Bosc et Jacques Ellul, dfenseurs
farouches de lorthodoxie, campent sur des positions ecclsiologiques
face ceux quils considrent comme les liquidateurs de Massy-Palaiseau
qui courent le risque de se perdre dans le monde. Ellul, membre du conseil
national, attaque mme violemment la position du trio Casalis-RicurSimon au point de demander sans succs une excommunication : Bosc et
Ellul taient des chevaliers de lorthodoxie 17.
En 1968, une quatrime phase souvre lunivers de la prdication de
Louis Simon, cette fois inspir par le thologien luthrien allemand
Gerhard Ebeling. Simon ne peut qutre trs sduit par ses positions, qui
insistent sur le primat de la parole comme vnement. Cela correspond
11. Louis Simon, entretien avec lauteur.
12. Dietrich BONHOEFFER, Rsistance et Soumission, Labor et Fides, Genve, 1973.
13. Roger MEHL, Le Protestantisme : hier-demain, op. cit., p. 147.
14. Dietrich BONHOEFFER, Rsistance et Soumission, op. cit. , p. 167.
15. Louis Simon, entretien avec lauteur.
16. Ibid.
17. Ibid.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 45
MASSY-PALAISEAU SOUS LE CHARME
45
tout fait au style mme de la prdication telle quil lentend, toujours
ouverte sur la cration, sur un tonnement retrouv et un effet recherch
sur laction. Selon Ebeling, la parole est premire et lcriture seconde.
Elle ne peut donc tre garantie de lextrieur comme substance, soit divine
soit humaine. Elle porte en elle-mme sa propre force, sa capacit tre
interprte. Marqu par le dernier Heidegger, celui de la Parole qui
parle , Ebeling dfinit la thologie comme hermneutique. Il aura trouv
aussi ce primat de la parole chez Luther, qui a dit prfrer couter lvangile plutt que de lire les critures. Cette position, partage par Ebeling,
considre lAncien Testament, lancienne Alliance, comme criture
et le Nouveau Testament, la nouvelle Alliance, comme Parole. Cest par
faiblesse et ncessit que la Parole sest transforme en criture, alors
quelle devrait rester Parole. Cest donc le texte comme vnement de
Parole quil sagit de retrouver et qui sinterprte lui-mme par la rappropriation du lecteur. Cest ce mouvement qui assure la possibilit dune
nouvelle Parole, dune nouvelle prdication : Ricur a aussi ador cette
phase. Cest la dernire partie de mon parcours avec lui 18.
Ricur, fidle paroissien, na aucune vise dintronisation dans les instances dirigeantes du protestantisme franais. Il na jamais sig ni au
conseil national de lglise rforme ni au conseil de la Fdration protestante de France. Prsident de lERF entre 1968 et 1977, puis de la Fdration entre 1977 et 1987, Jacques Maury est paroissien Palaiseau partir
de 1968. Pour lui, Ricur aurait eu toute sa place dans les instances dirigeantes, et il regrette de navoir pas fait bnficier davantage le protestantisme de son apport. Mais en vingt ans de responsabilits au plus haut
niveau, il na pas os mobiliser Ricur pour des tches qui risquaient de
le distraire de son uvre : Jtais trs touch, mu par sa qualit de
paroissien de base tout fait admirable 19. Dans sa paroisse, Ricur est
surtout lcoute. Il participe aux discussions qui suivent les prdications,
mais il nest pas question pour lui de sriger en donneur de leons et de
prendre un air docte. Au contraire, il prend des notes et se comporte
comme un chrtien tout fait ordinaire. Il y a toujours un moment o il
dit : Je ne suis plus l pour vous prouver quoi que ce soit, je le crois. cest
tout. Cest admirable de la part dun homme comme lui 20 . Un change
singulirement intense circule entre ce silence du paroissien Ricur et la
parole de son pasteur Simon : Cest moi qui parlais, il coutait, et ctait
dcisif. Quand il coutait, il crait, ctait fantastique cela. Aprs la prdication, il se levait et disait ce quil avait cout. Ce ntait pas du tout ce
18. Louis Simon, ibid.
19. Jacques Maury, entretien avec lauteur.
20. Ibid.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
46
31-03-2008
15:49
Page 46
PAUL RICUR
que javais dit. Cest grce son coute que jarrivais parler. Cest
un matre. On laimait tous et on ne le lui disait pas assez souvent
dailleurs 21.
Tourne vers laction, la paroisse de Palaiseau a mme accueilli avant
1968 des grvistes de la faim du centre de Saclay. Celui-ci faisait appel
des socits de gardiennage et de nettoyage. Les ngociations entre le
centre et les employs naboutissaient pas : Cinq ingnieurs ont fait la
grve de la faim pour dfendre les femmes de mnage. Cela nous a paru
tellement vanglique, et de plus il y avait deux protestants parmi eux,
donc ce ntait pas de la rcupration 22. Comme toute grve de la faim,
elle nest efficace qu condition de se faire connatre. Les grvistes taient
abrits dans les sous-sols du temple. Outre la publicit donne sur le
territoire de la paroisse, Ricur et Picinbono ont sign ensemble un
article publi par Le Monde, ce qui a permis de dbloquer la situation et
de dcrocher un accord peu prs satisfaisant.
Dans lauditoire de Palaiseau, un paroissien prend trs souvent la parole
dans les dbats, cest lItalien dorigine sicilienne Ennio Floris. Litinraire
de cet chapp de Rome et du Centre protestant du Nord est tonnant.
Chacune des crises quil a traverses propos du dogme chrtien ont
boulevers ses conditions dexistence, car son sens de lintgrit et son
refus de tout compromis auront pouss jusquau paroxysme ses choix
successifs. Avant de devenir protestant, Ennio Floris est catholique,
docteur en thologie, enseignant Rome chez les Bndictins. Il traverse
une premire crise pendant la guerre lorsquil voit affluer tous les jours
des femmes juives plores devant son couvent de Santa della Minerva
Rome : Cela ma rvolt, et je pensais ces femmes qui pleuraient
et ce verset biblique que lon chantait, racontant Rachel pleurant ses
enfants 23. Ennio Floris, dsespr, dcouvre un immense espace au grenier de lglise. Il se dit que ce grenier ntant pas un lieu consacr, il peut
devenir, sans droger la rgle, un lieu de refuge pour ces populations
juives traques par le fascisme : Jai ainsi runi quarante personnes dans
ce grenier 24. Lorsque les autorits saperoivent du subterfuge, Ennio
Floris passe devant un tribunal de lordre, est jug et condamn comme
fou, sans que ses accusateurs naient le courage de lui signifier une
excommunication crite. Lacte dhumanit dEnnio Floris est pourtant
irrversible, et lorsque les Amricains arrivent Rome, ce sont jusqu
une centaine dhommes qui sont hbergs par le couvent. Ils sont alors
presque aussi nombreux que les cent vingt frres de la communaut.
21. Louis Simon, entretien avec lauteur.
22. Ibid.
23. Ennio Floris, entretien avec lauteur.
24. Ibid.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 47
MASSY-PALAISEAU SOUS LE CHARME
47
Ennio Floris nen reste pas moins profondment branl. Il noue des
contacts de plus en plus frquents avec des pasteurs protestants qui le
confirment dans lide que lon ne peut rien faire bouger en Italie. Il reoit
dailleurs plusieurs propositions pour aller sinstaller aux tats-Unis,
puis en France.
Cest une histoire apparemment banale de pigeon qui va prcipiter son
dpart : Un jour daot, aux vpres, sous une terrible chaleur, autour de
15 heures, jtais dans le chur de lglise Santa Maria. Je vois un pigeon
et je ne sais pourquoi, mais jai t pris de tendresse pour ce pigeon. Je rencontre un frre converse, un Florentin. Je lui dis quil faut faire sortir ce
pigeon. Il sest mis rire et me rpond que cest impossible. Je lui rtorque
que sil est entr, il peut sortir. Je tombe ensuite sur une chapelle dans
laquelle huit pigeons morts jonchent le sol. Alors mon frre me dit en
riant : Mon cher ami, quand on entre dans la sainte glise de Dieu, on ne
peut en sortir que mort. Alors, effectivement, je me suis senti comme un
pigeon. Je monte dans ma chambre, je cherche ladresse de mon contact,
professeur au Chambon, je fais mes valises et cours la gare 25. Pour
vivre, Ennio Floris doit se faire ouvrier dans la rgion de Nevers, puis en
Allemagne. Londres, il est porteur dans un hpital, avant quon lui
propose de se rendre Genve pour suivre des tudes de thologie
protestante.
Cest aprs cette conversion quil est dsign comme responsable du
centre protestant du Nord. Il le dirigera pendant dix ans. Il rencontre
pour la premire fois Ricur, quil fait venir au Centre pour faire des
confrences. Mais un article sur la mort de Dieu paru dans la revue protestante de Montpellier lui vaut son exclusion du Centre du Nord. Grce
Jacques Maury, il bnficie dune bourse doctorale et quitte Lille pour
la rgion parisienne. Cest l quon le retrouve parmi les paroissiens de
Palaiseau, partageant avec Louis Simon lesprit iconoclaste et lide que le
christianisme est davantage porteur de valeurs que de vrits. Il sinscrit
en doctorat Nanterre, avec Ricur, pour une recherche sur Vico. Alors
quil se retrouve sans toit avec sa famille, Ricur lui laisse sa maison lors
de son dpart pour les tats-Unis : Ricur a t pour moi plus quun
frre 26. Il poursuit en mme temps un norme travail historico-critique
sur le commentaire de Marc, qui est rest ltat de manuscrit, faute
dditeur 27. Ennio Floris considre que Ricur est rest trop fidle
linstitution thologique de la foi chrtienne, alors que le christianisme
nest pour lui quun systme de sens appliqu lexistence. Il ne faut
25. Ennio Floris, ibid.
26. Ibid.
27. Ennio FLORIS, Sous le Christ, Jsus. Le portrait de Jsus sous la fresque de Marc.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
48
31-03-2008
15:49
Page 48
PAUL RICUR
pas en faire une science ou une philosophie selon lui, mais une posie.
Cependant : Je nai jamais rien crit contre Ricur. Pour moi, cest le
saint Augustin de ce sicle 28.
On imagine sans mal la crativit des commentaires dans cette assemble de paroissiens du temple de Palaiseau. Pourtant, au dbut des annes
soixante-dix, Louis Simon, devenu reprsentatif dun courant critique
dans le protestantisme, se voit promu au rang lev de prsident de rgion
(quivalent dvque pour les protestants), pouss par ses amis qui voient
en lui quelquun ayant les capacits de rformer linstitution et pouvant
donc incarner les espoirs de changement : L, jai t malheureux comme
un chien 29. Georges Casalis lui avait pourtant fortement dconseill
daccepter : Fais attention, Louis, le pouvoir corrompt toujours, ne fais
pas cela , lui avait-il dit. Sitt nomm en ces temps agits de laprs-68,
Louis Simon est confront une douloureuse affaire quil na pas su bien
rgler. Deux couples de pasteurs dans la paroisse de Pantin pratiquaient
lchangisme, vivant ensemble, mettant en pratique le partage des biens,
des projets, du travail et des partenaires. Cette paroisse tait particulirement active et les paroissiens ne se doutaient pas que cette cohabitation
tait pousse ce point. Louis Simon a eu grer ce qui est devenu un
scandale public. Lors dun synode national extraordinaire runi Vienne
en huis clos, les quatre pasteurs ont tmoign de leur sincrit, mais, en
dpit de celle-ci, ils sont jugs et radis : Je me suis trouv dans la mme
situation que Ricur Nanterre, dans lobligation de mettre un peu
dordre. La fonction nous emprisonnait dans un maintien de lordre qui
nous a casss 30. Cette sanction a provoqu une rupture brutale et dfinitive entre Simon et Casalis : Cela nous a totalement coups de Louis
Simon, il ne nous a jamais pardonn davoir pris le parti de ces jeunes
contre lui 31. Il fallait pouvoir ruser avec linstitution, ce dont ne sont
capables ni Louis Simon ni Ricur, dont les dboires sur ce plan sont en
effet analogues. Ils ont tous deux t pris au pige de linstitution, lun
comme doyen de luniversit de Nanterre doyen la poubelle sur la tte
laissant la police intervenir sur le campus , lautre comme prsident de
rgion de lERF pre la vertu renvoyant deux couples de pasteurs non
conformistes : Jtais triste que Louis se laisse enfermer dans cette
logique-l. Jai bien sr refus de signer quoi que ce soit contre lui, mais
je ne pouvais pas non plus lui donner raison pour les formes dautoritarisme quil avait adoptes 32.
28. Ennio Floris, entretien avec lauteur.
29. Louis Simon, entretien avec lauteur.
30. Ibid.
31. Dorothe Casalis, entretien avec lauteur.
32. Pierre Encrev, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 49
MASSY-PALAISEAU SOUS LE CHARME
49
Louis Simon ayant quitt Palaiseau, Ricur participe la paroisse de
Chtenay-Malabry cre autour de 1966 et qui a t baptise du nom de
Robinson par un de ses anciens tudiants, Jean-Marc Saint. Aprs ses
tudes de thologie et un travail de recherche anim par Andr de Robert
en vue de crer des ponts entre la vie professionnelle et la vie religieuse,
Jean-Marc Saint est nomm dans cette paroisse de Chtenay-Malabry, qui
navait pas encore de nom. Le territoire qui lui a t assign couvre Le
Plessis-Robinson, Chtenay et Sceaux. Il fallait trouver une dnomination
qui ne froisse pas la susceptibilit de lglise luthrienne de Bourg-laReine. Un ami anglais de Jean-Marc Saint venait de lui donner lire un
ouvrage, devenu un best-seller ayant atteint jusqu 200 000 exemplaires
en Angleterre, dun vque anglican dnomm Robinson 33. Les positions
soutenues par Robinson, entre Bonhoeffer et Tillich, sentent un peu le
soufre et plaisent particulirement Jean-Marc Saint, au point quil propose de donner ce nom la paroisse.
Le premier pasteur de Robinson, Jean Abel (pre dOlivier Abel), qui
arrive lautomne 1966, est issu dune gnration barthienne ayant lu
Bonhoeffer et cherchant prolonger lapport thologique par un renouvellement des formes de vie paroissiales et communautaires. Supprimant
le conseil presbytral (conseil des Anciens), la paroisse de Robinson
se donne une structure de dcision collgiale ouverte qui en fait un
rgime dautogestion do fusent les initiatives. Cette paroisse, galement
trs intellectuelle, est sduite par ce pasteur bouillant, ludique, thtral,
qui habite la Butte -Rouge, en plein quartier ouvrier. Son fils, Olivier
Abel, qui est au lyce de Chtenay avec tienne, le dernier fils de Ricur,
entrait facilement aux Murs blancs avec dautres jeunes de Robinson et du
lyce : La premire fois, ctait propos dun expos en seconde sur le
mal, le tragique et la fragilit humaine, je venais de lire LHomme faillible
et ce que Ricur appelle le chemin du consentement la fin de son livre
sur la volont 34. Il se souvient aussi quel point il a t impressionn par
Limage de Dieu et lpope humaine 35 . Ce sens pique de laction
soulev par lide thologique de rcapitulation tait pour lui particulirement suggestif : Pour moi, ctait lide que dans chaque geste il y a
quelque chose comme une rcapitulation, la fois le rassemblement dune
intrigue plus vaste et quelque chose qui ouvre, qui tient en rserve et que
nous ne savons pas 36. Il discute de ce thme avec Henri-Irne Marrou,
33. John Arthur Thomas ROBINSON, Dieu sans Dieu, Nouvelle ditions latines, 1964.
34. Olivier Abel, entretien avec lauteur.
35. Paul RICUR, Limage de Dieu et lpope humaine , Christianisme social, 1960,
p. 493-514 ; repris dans Histoire et Vrit, op. cit., p. 112-131.
36. Olivier Abel, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
50
31-03-2008
15:49
Page 50
PAUL RICUR
qui habitait au-dessus de la famille Ricur, et sympathise aussi beaucoup
avec Paulette Mounier : Jallais la voir tout le temps. On avait organis
en 1970 une exposition Mounier au lyce 37. Le pasteur Abel et Paul
Ricur sont ensemble, plusieurs annes de suite, les deux personnalits
extrieures cooptes au conseil dadministration du lyce de Chtenay,
qui devient alors lyce Emmanuel-Mounier. Le groupe de jeunes de la
paroisse de Robinson, trs implant dans le lyce dans les annes 19711973, atteindra le chiffre important, mme pour lpoque, de cent cinquante
membres.
Ricur reste fidle la paroisse de Palaiseau, mais Jean-Marc Saint le
retrouve comme paroissien de la communaut de Robinson entre 1977
et 1980 lorsquil revient comme pasteur de cette communaut : Palaiseau
avait polaris la vie thologique. Robinson voulait innover dans les
formes de vie 38. Afin denrayer la perte dinfluence des paroisses et de
redynamiser lactivit intellectuelle, Ricur organise chaque anne partir de 1985 les entretiens de Robinson . Un thme dactualit est choisi
chaque fois avec lide de laborder sous trois regards diffrents : le thologique, le philosophique et le technique. Ces entretiens attirent une
trs large affluence pour participer aux dbats qui suivent les trois confrences tenues trois dimanches dhiver entre 16 heures et 18 heures.
Ricur se charge toujours dune des trois confrences, sur des thmes
varis comme le pluralisme, le pouvoir, la justice, la complexit, le travail,
la mmoire et le pardon. Ces entretiens de Robinson mobilisent une
petite quipe de quatre personnes, parmi lesquelles Alain Brigodiot,
ingnieur-conseil dans le domaine du management, est le responsable de
lorganisation. Aujourdhui, le succs de ces confrences a permis de
renouer le fil rompu il y a vingt ans entre la paroisse de Robinson et celle
de Palaiseau qui les organisent dsormais ensemble. De nouveau, comme
lpoque de Simon, on se presse lintrieur du temple pour couter une
parole prpare avec soin : Ricur prpare normment ses confrences.
Il fait chaque fois un travail original, avec un respect exceptionnel du
public 39. Outre le milieu protestant, nombreux sont ainsi venus exposer
leurs thses Robinson partir de 1985 : Jol Roman, Yves Cannac, Marie
Balmary, Jean-Pierre Dupuy...
Jusquau bout, Ricur aura accord le plus grand soin lorganisation
et lanimation de ces Entretiens de Robinson . En 2003, le cycle est
consacr Linestimable ou le sans prix et Ricur donne la confrence
douverture le dimanche 12 janvier des trois entretiens . Il la consacre
une Petite histoire du don et, avec son esprit toujours factieux, il
37. Olivier Abel, ibid.
38. Jean-Marc Saint, entretien avec lauteur.
39. Alain Brigodiot, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 51
51
placarde derrire lui le supplment du Monde sur lArgent qui parat tous
les week-ends. Le tout dernier cycle auquel il participera, mais dj trs
affaibli, sera celui de janvier 2004 qui eut pour thme : Le religieux et
la violence . Entre le point de vue du sociologue des religions donn
par Jean Baubrot et celui dune bibliste psychanalyste, Marie Balmary,
Ricur donna avec Olivier Abel le point de vue du philosophe sur la
question. Il insiste cette occasion sur le fait que le religieux peut comporter une part de violence et que cette dernire ne lui est donc pas extrieure.
Au discours qui peut devenir lnifiant sur la bont, le pardon, la nonviolence, Ricur oppose la part irrductible et rocailleuse dun christianisme qui doit continuer faire scandale par rapport aux catgories
communes.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 52
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 53
A.VI.1
La confrontation avec le marxisme althussris
Si Ricur a fait une traverse systmatique de luvre de Freud et des travaux des linguistes, la pense de Marx la galement accompagn depuis
les annes trente. Tout en ayant des rticences, dj voques, face lconomisme et lambition totalisatrice et systmatique de Marx, il accueille
un certain nombre de chercheurs marxistes dans son laboratoire de phnomnologie du CNRS, o travaillent ses cts des philosophes
marxistes comme Jacques Texier ou Solange Mercier-Josa.
tudiante la Sorbonne et lve lENS en 1959, Michle Bertrand
prpare, sous la direction de Ricur, un DES de philosophie consacr
lide de vrit chez Kierkegaard. Elle adhre lUEC (Union des tudiants communistes) et devient une marxiste fervente. Elle sinscrit en
thse de doctorat sur la question de lanticipation de lavenir par la socit :
Ricur tait le seul professeur duniversit, philosophe, qui pouvait
accepter que lon soit marxiste. En mme temps, il avait des rapports
conflictuels avec le marxisme 1. Jacques Texier est aussi militant du PCF
et occupe mme des responsabilits de direction au CERM (Centre
dtudes et de recherches marxistes) jusquen 1978. Lorsquil intgre le
CNRS en 1968, il a dj publi des travaux sur Gramsci et est accueilli par
Ricur dans son sminaire de la rue Parmentier sur cette base. Partisan
dune lecture historiciste, gramscienne de luvre de Marx, Jacques Texier
dveloppe des thses contradictoires celles des althussriens 2. Il envoie
son tude critique Ricur qui lui crit une lettre tellement efficace que
jen ai t vritablement dstabilis 3 . Ricur dit le suivre dans sa lecture
1. Michle Bertrand, entretien avec lauteur.
2. Jacques TEXIER, Sur la dtermination en dernire instance (Marx et/ou Althusser) , Sur
la dialectique, CERM, ditions sociales, Paris, 1977, p. 251-308.
3. Jacques Texier, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
54
31-03-2008
15:49
Page 54
PAUL RICUR
critique des althussriens et pense que Texier a raison du point de vue philologique de contester radicalement les notions de dtermination en dernire instance ou dinstance dominante. Cependant, Ricur procdait
une critique gnralise dans le sens o il remettait en cause le concept de
totalit 4 . Les diverses interprtations de Marx sopposent en effet sur le
plan de lordonnancement interne dune totalit, mais la question radicale
que pose Ricur Texier est celle de la validit mme de cette rfrence
une totalit, ce qui la rend possible et pensable.
Certes, Marx compte pour Ricur dans la ncessaire entreprise de
dvoilement du sens. la manire de Freud, Marx offre sur le plan social
et politique les armes de la critique, du soupon, donc du dpassement
ncessaire de la navet premire. Il contribue aussi enrichir ce que
Ricur qualifie, au milieu des annes soixante-dix, dimaginaire social,
considrant que lidologie et lutopie en sont les deux expressions indispensables. Alors que ces deux formes de limaginaire social sont particulirement dcries lidologie est en effet disqualifie comme simple
dissimulation de la science et lutopie comme fuite du rel , Ricur
trouve en Marx le moyen de restituer leur double fonction dintgration
et de subversion. Il dfinit trois usages de la notion didologie 5. Celle-ci
est dabord envisage comme moyen de dissimulation, comme image
inverse de la ralit qui transforme la praxis en imaginaire ; elle ressort
du jeune Marx des Manuscrits et de LIdologie allemande. Mais il est un
second sens qui passe par un processus de lgitimation, duniversalisation
des intrts particuliers : Marx lui-mme a ctoy ce sens lorsquil
dclare que les ides de la classe dominante deviennent des ides dominantes en se faisant passer pour des ides universelles 6. ces deux fonctions sen ajoute une troisime, une fonction dintgration, qui se manifeste
notamment loccasion des crmonies commmoratives. Lidologie est
donc porteuse dune positivit, dune vise constructive. En mme temps,
les trois niveaux peuvent se confondre et lidologie dgnrer en se transformant de sa premire manifestation falsificatrice sa dimension lgitimante. Dans le contexte des annes soixante-dix, cette rvaluation du
rle de lidologie reprsente une alternative par rapport au courant
althussrien dominant et sa lecture purement ngative de ce concept,
restreint sa premire acception de vcu illusoire et de dissimulation.
De la mme manire, propos de lutopie, Ricur envisage trois
niveaux defficience dans une relation de complmentarit avec lidologie.
4. Jacques Texier, ibid.
5. Paul RICUR, Idologie et utopie : deux expressions de limaginaire social , Philosophical Exchange, New York, 1976, n 2, sous le titre : Ideology and Utopia ; repris dans Cahiers
du CPO, n 49-50, 1983 ; repris dans Du texte laction, op. cit., p. 379-392.
6. Ibid., p. 382.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 55
CONFRONTATION AVEC LE MARXISME ALTHUSSRIS
55
Face la fonction intgratrice de celle-ci, lutopie est son ailleurs, son
alternative. Elle peut tre une source dinspiration pour des versions
pathologiques, prtendant annoncer des eschatologies ralises. Mais
lutopie peut retrouver une fonction libratrice lorsquelle maintient le
champ des possibles : Lutopie est ce qui empche lhorizon dattente de
fusionner avec le champ dexprience. Cest ce qui maintient lcart entre
lesprance et la tradition 7.
Dans une autre intervention, Ricur interroge le couple science/idologie, central chez Althusser et fond sur le thme de la coupure 8. Il soppose l encore une dfinition restrictive de lidologie telle que lutilise
le marxisme lorsquil assimile cette dimension une simple instrumentalisation sociale en termes de mensonge, dillusion et de falsification.
Derrire cette stratgie dnonciatrice de la normativit de lautre, Ricur
rappelle celui qui adopte cette dmarche de soupon quil le fait aussi au
nom de valeurs implicites, elles-mmes masques par une posture de
surplomb. Il est alors prsuppos que lidologie, cest la pense de mon
adversaire ; cest la pense de lautre. Il ne le sait pas, mais moi je le
sais 9 . Aristote rcusait dj une telle prtention nonce au nom de la
science dgage de toute contamination chez les platoniciens : il leur
opposait le pluralisme des mthodes et des degrs de vrit. Certes,
Ricur nentend pas renoncer toute forme dopposition entre science et
idologie, mais condition de la reformuler et de se dfaire du caractre
premptoire de lalthussrisme.
Lidologie recouvre plusieurs fonctions et linterprtation de Marx
nest quun des maillons dun phnomne pluriel, son versant de dissimulation, ngatif, de dformation du rel. Il spcifie un niveau certes important de lidologie, en le rfrant la constitution symbolique du lien
social 10 sur lequel sa fonction mystifiante se greffe et qui en fait un phnomne indpassable de lexistence sociale, dans la mesure o la ralit
sociale a depuis toujours une constitution symbolique 11 . Renonant
toute position de surplomb, Ricur propose un discours plus modeste de
symtrisation et dhistoricisation du regard savant dans un discours de
caractre hermneutique sur les conditions de toute comprhension de
caractre historique 12 . Le couple science/idologie en sort fondamenta7. Paul RICUR, ibid., p. 391.
8. Paul RICUR, Science et idologie , Revue philosophique de Louvain, t. LXXII,
mai 1974, p. 326-358 ; repris dans Du texte laction, op. cit., p. 303-331.
9. Ibid., Du texte laction, p. 305.
10. Paul RICUR, La structure symbolique de laction , actes de la 14e confrence internationale de sociologie des religions. Symbolisme religieux, sculier et classes sociales ?, Strasbourg,
Lille, secrtariat CISR, 1977, p. 29-50.
11. Paul RICUR, Du texte laction, op. cit., p. 314.
12. Ibid., p. 327.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
56
31-03-2008
15:49
Page 56
PAUL RICUR
lement transform partir dun certain nombre de prsuppositions : le
savoir objectivant est prcd dune relation dappartenance. On peut lui
reconnatre une marge dautonomie puisque lacte de la distanciation est
tout fait ncessaire, mais si la critique des idologies saffranchit de ses
conditions denracinement, elle ne le peut que partiellement et la
thorie de lidologie subit ici une contrainte pistmologique de noncompltude et de non-totalisation qui a sa raison hermneutique dans la
condition mme de la comprhension 13 .
Ce dbat sur lidologie au temps des fameux appareils idologiques
dtat a men Ricur lire de manire systmatique les thses dAlthusser
et des althussriens. En 1975, cette traverse de lalthussrisme donne
lieu une srie de confrences prononces par Ricur luniversit de
Chicago. Sur dix-huit cours consacrs aux relations entre idologie et
utopie, trois sont exclusivement consacrs Althusser 14. Ricur montre
quel point chacun des concepts cls dAlthusser doit Freud et Lacan :
la notion de surdtermination et celle dappareil dtat trouvent leur quivalent dans la notion de surmoi, tandis que latemporalit de lidologie
fait face latemporalit de linconscient. Ricur sait gr Althusser de
rompre avec la vulgate et avec sa conception purement mcaniciste de la
causalit. La combinaison opre par le jeu des instances offre un concept
plus riche de causalit 15 . Cette volont de complexification de la relation causale choue cependant en se structuralisant et en adoptant une
notion dappareils idologique qui voque quelque chose de mcanique 16 , alors que les questions de justification ou de lgitimation sont
moins du ressort dappareils que de celui des motivations.
Ricur restitue avec soin la logique des positions althussriennes, tout
en grenant sa prsentation de quelques questions qui dstabilisent ldifice. Ainsi, Althusser considre que la notion dhumanisme socialiste
revt un caractre de monstruosit conceptuelle. Il reste silencieux en
1968 lors de linvasion de la Tchcoslovaquie par les armes du pacte de
Varsovie. De la mme manire, si lhomme est un mythe thorique qui
doit tre rduit en cendres, comme le pensent de concert Althusser et
Foucault, on ne voit pas bien au nom de quoi protester contre les dnis du
droit. Si le point de vue global de Ricur sur le marxisme structuralis est
critique, il sen inspire pour une part, ce qui est perceptible dans son
13. Ibid., p. 330.
14. Paul RICUR, Lectures on Ideology and Utopia, texte restitu par George H. Taylor,
daprs les notes de Ricur et la transcription des versions orales, Columbia University Press,
New York, 1986 ; trad. fran. Jol ROMAN et Myriam REVAULT DALLONNES, Idologie et
Utopie, Le Seuil, Paris, 1997.
15. Ibid., repris dans M, n 43, janvier 1991, p. 16, trad. Jol Roman.
16. Ibid., p. 19.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 57
CONFRONTATION AVEC LE MARXISME ALTHUSSRIS
57
article sur lalination, crit en 1968 17. Il ne se limite pas la lecture
althussrienne du concept. Derrire sa surcharge smantique, il remonte
aux premires acceptions modernes du terme chez Rousseau et aux divers
glissements de sens du plan juridique au niveau politique. La marque
althussrienne se rvle cependant lorsquil oppose un jeune Marx qui
boucle le cycle historique de la tradition, et un Marx de la maturit, celui
du Capital, qui rompt avec lanthropologie du jeune Marx, sur ce point.
Il avalise ainsi un peu vite la fameuse coupure pistmologique qui fonde
les thses althussriennes sur les deux Marx. Cependant, contestant la
lgitimit de la position scientiste de surplomb que prconisent les althussriens, Ricur dfinit une voie plus longue, celle dune hermneutique
de la comprhension historique 18 .
Plus radical encore dans sa critique dAlthusser, le phnomnologue
Michel Henry publie une norme somme sur Marx en 1976 19. Son projet
est de dissocier la parole originelle de Marx des lectures postrieures qui
en sont faites dans les divers courants marxistes : Le marxisme est lensemble des contresens qui ont t faits sur Marx 20. Michel Henry voit en
Marx lunit dun projet philosophique et lutilisation de concepts fondamentaux, dordre ontologique. Les marxistes ont donc pris pour concepts
majeurs de Marx (les forces productives, les rapports sociaux de production, les classes sociales...) des concepts qui ne sont que des drivs de sa
philosophie. Faire retour Marx exige de mieux comprendre ce quil a
voulu dire, et Henry a pour ambition de rejoindre son intention philosophique en prenant Marx au srieux 21 . Il consacre dix annes ce travail
et entend dmontrer que lanalyse de Marx consiste chaque fois affirmer que la totalit sexplique par lindividu, par le travail vivant, qui est
individuel. Toutes ses dmonstrations consistent prendre un seul individu. Toute lanalyse du Capital repose sur un seul travailleur 22 .
ses yeux, les marxistes althussriens ou autres , qui invoquent lexplication par le systme passent ct de Marx, dont la finalit est dexpliquer le systme et non dexpliquer par le systme. De la mme
manire, Marx explique les classes par les individus qui les composent,
alors que pour les marxistes un individu laboure parce quil est laboureur :
cest une ineptie. Le marxisme est une ineptie 23.
17. Paul RICUR, Alination , Encyclopdia Universalis, 1968, p. 660-664.
18. Paul RICUR, Du texte laction, op. cit., p. 328.
19. Michel HENRY, Marx, t. 1 : Une philosophie de la ralit ; t. 2, Une philosophie de lconomie, Gallimard, Paris, 1976.
20. Ibid., p. 9.
21. Ibid., p. 32.
22. Michel Henry, entretien avec lauteur.
23. Ibid.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
58
31-03-2008
15:49
Page 58
PAUL RICUR
Ricur publie un long compte rendu de louvrage de Michel Henry 24.
Il dcrit lanalyse de Henry dans le cadre dun projet philosophique quil
connat bien, pour avoir particip son jury de thse en 1963, aux cts
de Jean Walh, Jean Hyppolite, Henri Gouhier et Ferdinand Alqui. Cette
thse a donn lieu publication sous le titre LEssence de la manifestation 25. Elle conteste lide de lapparatre qui rgne dans la philosophie
occidentale et le fait de lui opposer un autre mode dapparatre qui se situe
au niveau de laffectivit : Il y a l une autorvlation absolue qui est tout
fait diffrente de lcart, de la diffrence, et qui est la vie qui scoule ellemme en tant quaffective 26. Il situe Marx dans le sens de sa dmonstration philosophique. Pour Marx, selon Henry, la ralit nest pas
identifiable une ontologie de lobjectivit : En crivant son Marx,
Michel Henry continue son vieux combat contre le prtendu primat de la
transcendance de la conscience, autrement dit le primat dune conscience
se donnant des objets, sy alinant pour se prendre enfin elle-mme dans
la transparence soi 27. Ricur retrace la logique propre la dmonstration de Michel Henry et met laccent sur lopposition radicale entre la
lecture dAlthusser et la sienne. La seule totalit accessible pour Marx,
selon Henry, serait celle de lindividu : Voil pourquoi Marx rclame de
faon apparemment dmente que chacun soit chasseur, pcheur, ptre,
peintre, sculpteur, critique : parce que son analyse est une analyse phnomnologique de la subjectivit absolue 28.
Quelle position Ricur prend-il par rapport cette lecture, dont le
moins que lon puisse dire est quelle frappe par son originalit au regard
de la majorit des exgses ? Dabord, il y voit une lecture cratrice qui
rtablit une voix de Marx le plus souvent touffe sous les interprtations
purement pistmologiques. Sil suit Henry propos de la centralit chez
Marx de lindividu agissant, il exprime ses rticences face loption immanentiste qui risque de passer ct de la dimension anthropologique de
Marx. Selon ce dernier, lhomme est toujours dj-l dans lhistoire, il est
le produit de conditions dont il nest pas lauteur et travers lesquelles il
doit pourtant agir. Se dvoilent l deux orientations divergentes, deux
voies de la phnomnologie.
Ricur ayant prouv les impasses dune vise phnomnologique
directe avec sa thse sur la volont, il se dirige de plus en plus vers les
mdiations ouvrant indirectement laccs au cogito : les symboles, les
24. Paul RICUR, Le Marx de Michel Henry , Esprit, octobre 1978 ; repris dans Lectures 2,
op. cit., p. 265-293.
25. Michel HENRY, LEssence de la manifestation, PUF, Paris, 1963.
26. Michel Henry, entretien avec lauteur.
27. Paul RICUR, Le Marx de Michel Henry , Lectures 2, op. cit., p. 267.
28. Michel HENRY, Marx, op. cit., t. 1, p. 273.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 59
CONFRONTATION AVEC LE MARXISME ALTHUSSRIS
59
manifestations de linconscient, la textualit. Pour Ricur, le philosophe
na pas dobjet spcifique et fait son miel de tout ce qui peut recueillir la
connaissance du sujet, mais cela oblige un vaste dtour par le monde. Au
contraire, pour Michel Henry, la philosophie est porteuse dun savoir
immdiat : Jai pris loption inverse. Nous sommes avec Ricur aux
deux ples de la phnomnologie 29. Michel Henry cherche en effet se
frayer une voie directe, considrant les multiples dtours de lhermneutique comme fondamentalement garant, se dtournant de lessentiel.
Selon lui, la valorisation des mthodes dinterprtation textuelle visant
recueillir les symboles fondamentaux nest pas la bonne dmarche pour
rpondre lauthenticit du texte : Il faut avoir la rponse en soi pour
pouvoir prendre position 30. Il prne donc un accs radical soi, direct,
intrieur, non mdi par le monde, dans la mesure o la vrit nest pas
chercher dans un ailleurs, mais en nous-mmes : Husserl le dit lorsquil
affirme : Je suis au monde, cest cela la vrit 31. Cette diffrence dinterprtation du projet phnomnologique explique les rticences exprimes par Ricur devant certains aspects de la lecture de Marx par Michel
Henry : Lagir, me semble-t-il, diffre du souffrir en ce quil nest pas
dfini purement par limmanence de ses modalits affectives. Lagir a une
vise, donc un moment dextriorit, et, pour remplir cette vise, lagir
doit toujours composer avec des circonstances quil na pas faites 32. La
phnomnologie de laction suggre, selon Ricur, une composition avec
des circonstances que laction na pas produites, et en mme temps elle
prsuppose de se rgler sur une vise, sur une reprsentation qui en
exprime le cheminement possible avec ses obstacles. Ricur se diffrencie radicalement sur ce plan de linterprtation dHenry, qui considre la
praxis enferme en elle-mme tout entire subjective, concidant avec
son faire et spuisant en lui 33.
Ricur demande quelques spcialistes de Marx qui travaillent avec lui
au laboratoire de phnomnologie de raliser un dossier sur le Marx de
Michel Henry pour la Revue de mtaphysique et de morale. Jean-Luc
Petit y crit une contribution 34, et Jacques Texier sattache une lecture
serre de louvrage de mille pages de Michel Henry sous le titre : Marx
est-il marxiste 35 ? Jacques Texier, inscrit en thse avec Ricur sur le
29. Michel Henry, entretien avec lauteur.
30. Ibid.
31. Ibid.
32. Paul RICUR, Lectures 2, op. cit., p. 283.
33. Michel HENRY, Marx, t. 1, op. cit., p. 358.
34. Jean-Luc PETIT, Marx et lontologie de la praxis , Revue de mtaphysique et de
morale, n 3, 1977, p. 365-385.
35. Jacques TEXIER, Marx est-il marxiste ? , Revue de mtaphysique et de morale, n 3,
1977, p. 386-409.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
60
31-03-2008
15:49
Page 60
PAUL RICUR
thme des rapports entre histoire et subjectivit, tait a priori intress par
une lecture accordant une place centrale aux formes dindividualit, quil
tente lui-mme danalyser partir du corpus de luvre de Marx et de
mettre en relation avec les formations sociales. Son projet de recherche
sinscrit en effet dans la tentative dlaboration dune thorie du sujet
critique. Mais il est loin dtre convaincu par la dmonstration de Michel
Henry : Cela ne me semblait pas soutenable, mais mritait une argumentation prcise 36. Jacques Texier souligne que si Michel Henry ne
critique que trs peu Marx lui-mme, il laisse de ct pour les besoins de
sa thse tous les textes historico-politiques de Marx dont limportance
aurait t majore par les marxistes. Cette mise lcart est tout de mme
bien gnante pour une pense qui se prsente avant tout comme une
philosophie de la praxis. Henry est mme parfois amen pratiquer une
lecture symptomale de Marx quil rcuse pourtant fermement chez
Althusser. Ainsi, sil reconnat que Marx se dit matrialiste et athe, il
convient de distinguer ce quil est et ce quil croit tre. Ce qui compte, ce
nest dailleurs pas ce que Marx pensait et que nous ignorons, cest ce que
pensent les textes quil a crits. Ce qui parat en eux, de faon aussi vidente quexceptionnelle dans lhistoire de la philosophie, cest une mtaphysique de lindividu. Marx est lun des premiers penseurs chrtiens de
lOccident 37 . Cest donc le dploiement dune mtaphysique de lindividu que Michel Henry voit en Marx au nom dune vision non marxiste,
mais marxienne. Cela le conduit considrer toute rfrence lconomique et au social comme autant de sources dalination et mettre entre
parenthses tout le matrialisme historique de Marx. Inspir par Maine de
Biran, Michel Henry dbouche sur une lecture de Marx que Texier qualifie d idalisme monadologique dans lequel ltre est esprit et lesprit
pure affectivit 38 .
Ce compte rendu de Jacques Texier, aussi prcis que critique, est plutt
bien accueilli par Ricur. On peut en effet difficilement dissocier ce
point Marx de sa destine et prsenter son uvre comme une simple
pure, mme au terme dune longue rduction eidtique de tous ses
concepts. cet gard, Ricur se tient dans une position tout aussi critique
lgard de Marx que du marxisme, tout en considrant leur traverse
comme indispensable pour nourrir le versant de dvoilement, de soupon,
de la dmarche hermneutique. De son ct, Michel Henry juge Ricur
comme un marxiste trs intelligent [...]. Mais il est marxiste, car il me
rtorque que dans Marx ce sont les classes sociales qui importent, alors
que lindividu reste pris dans les mailles du systme conomique 39 .
36. Jacques Texier, entretien avec lauteur.
37. Michel HENRY, Marx, t. 2, op. cit., p. 445.
38. Jacques TEXIER, Marx est-il marxiste ? , art. cit, p. 407.
39. Michel Henry, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 61
CONFRONTATION AVEC LE MARXISME ALTHUSSRIS
61
Fondateur de discursivit, comme la prsent Michel Foucault 40, Marx
reste pris de manire indissoluble dans les mtamorphoses de sens investies partir de son uvre. Le sectionner en deux de part et dautre de la
coupure pistmologique comme le fait Althusser, en sparant le bon
grain du Marx de la maturit de livraie de ses crits de jeunesse, ou lisoler
de son destin historique, comme le fait Michel Henry, semblent bien
relever dun vain rductionnisme.
40. Michel FOUCAULT, Quest-ce quun auteur ? , 22 fvrier 1969 ; repris dans Littoral,
n 9, juin 1983, p. 18.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 62
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 63
A.VI.2
La dmythologisation chez les catholiques
Lintense dialogue que mne Ricur avec les sciences humaines se double
dun travail de dmythologisation des textes religieux. Cest au cours des
annes soixante quil va pouvoir illustrer la fcondit de La Symbolique
du mal, selon laquelle le symbole donne penser. La rgularit de ses
contributions dans ce domaine vient dune rencontre avec un personnage
haut en couleur : Enrico Castelli. Cet aristocrate italien, originaire de
Turin, non-conformiste militant, est dune telle habilet quil dcroche
Rome tous les fonds ncessaires la ralisation de ses projets. Il dcide de
renouveler la philosophie de la religion et de rassembler rgulirement
Rome quelques minents penseurs, chaque hiver, du 5 au 11 janvier. Les
colloques Castelli vont se tenir partir de 1961 sous le titre gnrique de
la dmythisation. Ce thme lavait sduit par la possibilit de dmanteler, de rduire nu tous les prtextes qui ajournent lchance dune foi
existentielle, dune foi de rigueur 1 . Castelli pouvait ainsi donner libre
cours son scepticisme et cultiver sa rputation de mauvais gnie, regrettant chaque anne que le diable nait pas davantage de place pour donner
plus de sel la divinit, selon le mot de Benedetto Croce : Dieu, sans le
diable, manquerait de sel.
Personnage curieux, Castelli est prsent par ses adversaires comme
lincarnation du mauvais il. Il aurait en effet un art consomm pour
obtenir ce quil souhaite en regardant son interlocuteur de telle faon quil
ait limpression dtre vou aux pires malheurs sil nabonde pas dans son
sens. Dautres prsentent ce seigneur dun autre temps au visage prolong
1. Xavier TILLIETTE, Hommage dun ami franais , Archives de philosophie, avril 1977,
p. 11-14.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
64
31-03-2008
15:49
Page 64
PAUL RICUR
dune barbiche pointue comme le dtenteur de caisses noires du Vatican.
En tout cas, il jouait du caractre magique quon lui attribuait, et en
mme temps il avait des amis au Vatican qui lui ont permis de rester dans
un Institut annexe de luniversit de Rome, sans jamais avoir t professeur titulaire de cette universit 2. Philosophe et ami du pape Paul VI,
dont il avait t le condisciple, Castelli est lauteur dun ouvrage sur
lExistentialisme thologique 3.
Lorigine de ces colloques remonte limmdiat aprs-guerre. En 1948,
Castelli participe Rome un centre de synthse qui se tient prs de Santa
Cecilia, dirig par monseigneur Raffa, prtre de haute Italie, romain
dadoption. Cest l que se runit une bonne partie de lintelligentsia italienne en droute, aprs son engagement dans les rangs du fascisme. Dans
ce contexte, Castelli dcide de sortir de la torpeur et de reprendre linitiative une chelle europenne afin de retrouver les voies dune foi purifie.
Castelli a t li Lucien Laberthonnire, dfenseur dune thologie
existentielle, condamn ne plus prcher ni crire. Stanislas Breton se
retrouve Rome en 1947, o il enseigne pendant dix ans comme professeur de philosophie la Propagande, qui sappelle depuis luniversit
Urbain-VIII : Cest moins compromettant 4. Il est alors le collgue de
Castelli : Avec le P. Lotz, de la Grgorienne, et le dramaturge Diego
Fabbri, javais assist leur prhistoire, au domicile mme de Castelli, qui
nous faisait part dun projet, dont la ralisation ferait appel la comptence dintellectuels de lAncien et du Nouveau Monde. Toute la culture,
disait-il, serait l, dans une Rome plus libre, romaine certes, mais dlie
dun thomisme dont il redoutait les troitesses 5. Le charme irrsistible
de Rome a fortement contribu crer des fidlits. Sises sur les hauteurs
de la ville dans un quartier rsidentiel, la villa Mirafiori, dpendance de la
facult des lettres, et lhtel Arancini, rsidence des castelliens, ont tt
fait dvoquer La Montagne magique 6 . La beaut du site, lharmonie
des lieux moussent la force de corrosion des critiques les plus virulentes.
Le malin gnie ne peut venir bout de cette magie dune Rome dont la
force denvotement est telle qu on arrive rvolutionnaire pour finir
professeur de droit canon 7 . Il y avait certes de la provocation venir
dmythiser et proclamer la mort de Dieu au pied du Vatican, mais latmosphre romaine, avec son parfum trusque, parvenait nimber cette
2. Maurice de Gandillac, entretien avec lauteur.
3. Enrico CASTELLI, Existentialisme thologique, Hermann, Paris, 1948.
4. Stanislas Breton, entretien avec lauteur.
5. Stanislas BRETON, De Rome Paris. Itinraire philosophique, Descle de Brouwer, Paris,
1992, p. 127.
6. Marie-Anne LESCOURRET, Emmanuel Levinas, op. cit., p. 272.
7. Stanislas Breton, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 65
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES CATHOLIQUES
65
contestation en lui renvoyant la force dinertie de ses principes de
conservation.
Ces runions nont pourtant rien de touristique. Elles sont places au
contraire sous le signe de laustrit dun labeur particulirement intensif :
six heures quotidiennes de confrences peine interrompues par quelques
petites pauses pour se sustenter et permettre aux dbats de se poursuivre
dans un cadre plus dtendu entre philosophes, thologiens et exgtes
runis l pour une semaine. Ce conclave intellectuel international se tient
dans une salle de cours o prennent place autour dune grande table une
quarantaine de participants. Le contenu des interventions est systmatiquement publi par la revue Archivio di filosofia, et repris dans dpais
volumes dits par les ditions Aubier. Ils rassemblent une relecture
collective des critures, inspire par le tournant hermneutique impuls
par Heidegger en philosophie et Bultmann en thologie. Castelli recrute
directement les participants et, parmi ceux-ci, Ricur fait figure de pilier.
Aprs lintroduction du matre des lieux, Castelli, cest en gnral Ricur
qui donne la communication centrale du colloque. Prenant soin de prparer minutieusement chaque anne une tude majeure et indite, Ricur
fait loccasion de ces colloques des interventions fondamentales, qui ont
balis le mouvement interne de son uvre partir de 1961, le plus souvent
reprises ici et l dans ses recueils darticles, notamment dans Le Conflit
des interprtations 8.
Les Franais sont bien reprsents dans ces colloques. Stanislas Breton,
familier de Castelli depuis 1948, mais ayant quitt Rome depuis 1956 pour
enseigner en France o il deviendra un des amis les plus fidles dAlthusser,
est un des habitus des lieux : De Ricur, je garde tout dabord limpression dun visage. Beaucoup de jeunesse sur ses traits, mais traverse,
en cet merveillement denfance, qui est le bon gnie de son apparente distraction, par une ligne de mlancolie que la gnrosit autant que la
pudeur voudraient rendre imperceptible ses amis 9. Xavier Tilliette est
un autre fidle parmi les fidles des colloques Castelli, mme sil est
8. Le nombre et limportance des communications de Ricur aux colloques Castelli sont
impressionnants : Hermneutique des symboles et rflexion philosophique , 1961 et 1962 ;
Symbole et temporalit , 1963 ; Technique et non-technique dans linterprtation , 1964 ;
Dmythiser laccusation , 1965 ; Le mythe de la peine , 1967 ; Approche philosophique
du concept de libert religieuse , 1968 ; La paternit : du fantasme au symbole , 1969 ;
vnement et sens , 1971 ; Lhermneutique du tmoignage , 1972 ; Hermneutique et
critique des idologies , 1973 ; Objectivation et alination dans lexprience historique ,
1975 ; Lhermneutique de la scularisation : foi, idologie, utopie , 1976 ; La fonction narrative et lexprience humaine du temps , 1980 ; Ipsit. Altrit. Socialit , 1986 ; Fides
quaerens intellectum. Antcdents bibliques ? , 1990 ; Lenchevtrement de la voix et de
lcrit dans le discours biblique , 1992.
9. Stanislas BRETON, De Rome Paris, op. cit., p. 173.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
66
31-03-2008
15:49
Page 66
PAUL RICUR
momentanment cart entre 1965 et 1969 pour pch dhistoricisme.
Philosophe jsuite, il soutient sa thse sur Schelling en 1970 sous la direction de Jean Wahl et devant un jury compos de Ricur, Philonenko,
Janklvitch et Gandillac. Il enseigne partir de cette date plein temps
lInstitut catholique de Paris, mais ds 1972, devant une requte pressante
de Rome, il doit partager son temps denseignement entre Rome et Paris.
Tilliette est un des premiers avoir publi une tude sur luvre de
Ricur. Cadet de ce dernier dune dizaine dannes, il avait trs tt
entendu parler de Ricur en des termes logieux par son matre Pierre
Haubtmann : En captivit, il avait littralement envot par son intelligence, son travail et sa gentillesse un certain nombre de prisonniers, dont
le futur jsuite Pierre Haubtmann, qui venait dune grande famille de
Saint-tienne 10. Lorsque, grce Jean Wahl, il croise Ricur dans les
annes cinquante au Collge de philosophie, son uvre lui est dj familire. Leur amiti commune pour Gabriel Marcel et leur participation aux
colloques Castelli ont permis de tisser des liens qui sont devenus amicaux,
mme si Tilliette regrette chez Ricur de trop nombreuses concessions
aux sollicitations de lactualit : Il a voulu, inconsciemment, tre lesprit
de son temps. Il a fait sienne cette devise du jeune Hegel : Tu ne seras pas
mieux que ton temps, mais tu le seras le mieux possible. Cest ce quil a
fait et il a t pour nous un an plutt quun matre, un trs bon initiateur 11. Parmi les habitus de ces colloques, Ricur nest pas le seul protestant franais. Outre Jean Brun et Jacques Ellul, trs rgulirement
prsents, Castelli est all solliciter la participation dun thologien protestant enseignant luniversit de Syracuse, prs de New York, Gabriel
Vahanian, dont louvrage paru en 1962, La Mort de Dieu, sent le soufre
ncessaire pour pimenter les rencontres.
Vahanian a t tt familiaris avec le nom de Ricur, bien avant de le
connatre. Originaire de Marseille, n en 1927, il fait ses tudes Valence
et apprend langlais dans la salle Ricur, ainsi nomme en lhonneur du
pre de Paul Ricur, tu lors de la guerre de 1914-1918 et ancien professeur danglais du lyce de Valence. En 1946, tudiant Paris la facult de
thologie du boulevard Arago, il participe au premier camp francoallemand dtudiants qui se tient au Chambon-sur-Lignon. Cest l quil
rencontre Ricur pour la premire fois. Parti pour un an aux tats-Unis
une fois ses tudes de thologie termines, il y reste trente-cinq ans,
dabord neuf ans Princeton, puis Syracuse, quatre cents kilomtres
de New York. Aprs une phase trs kierkegaardienne, Vahanian subit
linfluence de Barth, comme beaucoup de protestants de sa gnration,
10. Xavier Tilliette, entretien avec lauteur.
11. Ibid.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 67
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES CATHOLIQUES
67
mais il connat son vritable coup de foudre avec Bultmann, qui a une
structure de pense en phase avec ma sensibilit 12 . Iconoclaste, Vahanian
publie son premier livre La Mort de Dieu, en 1961 aux tats-Unis, et en
France en 1962 13. Il srige contre toutes les formes de fondationnalisme
et se flicite dune scularisation totale la faveur de lavnement de la
modernit : La mort de Dieu nous renvoie notre monde, la ncessit
de parler de Dieu en fonction de notre monde 14. Dieu est donc immanent la modernit, tomb dans le domaine public la manire des hpitaux, de la mdecine : Salut et sant vont ensemble. Quand il sagit de
salut dans lautre monde, ce nest pas biblique du tout 15. La modernit,
selon Vahanian, a profondment boulevers le rapport entre lhomme et le
monde : La vision chrtienne du monde est transcendantale, la ntre est
immanentiste 16. La technique nest plus linstrument par lequel passe
lhomme, cest lhomme qui est devenu linstrument de la technique :
Il y a l un universalisme de la singularit que la technique rend possible
et qui dplace la dfinition de lutopie vers un utopisme du rel 17. Tournant rsolument le dos au pass, et en cela trs loign des positions de
Ricur malgr leur commune appartenance lglise rforme de France,
Vahanian considre lhistoire comme le lieu du bruit et de la fureur, rappelant les mises en garde des prophtes contre une conception historicisante
de la relation de lhomme Dieu : Lphmre, pour moi, cest lemblme de lternel. Je vis une fois pour toutes. Jsus ntablit pas de gnalogie 18. Ce thme de la mort de Dieu correspond la crise que connat
le christianisme confront la scularisation de la socit occidentale.
Il aura un trs grand succs aux tats-Unis, au point que le magazine
Times publiera un dossier sur la question avec une couverture non illustre sur fond noir et sous le titre : Is God Dead ? Cet iconoclaste avait
tout pour sduire Castelli, qui linvite Rome en 1968, date partir de
laquelle il ne manquera aucune sance des colloques, sympathisant avec
Sergio Cotta et Stanislas Breton. Rome, on retrouve aussi deux minents reprsentants de Louvain avec Alphonse de Waelhens, le spcialiste
de Heidegger, et Antoine Vergote : Lorsque Vahanian est venu nous
expliquer la mort de Dieu, cela sentait un peu le spulcre ! De Waelhens et
Vergote me disent : Cest tellement triste, allons boire un coup de vin
blanc. Ce sont des perles, des histoires divines ! 19
12. Gabriel Vahanian, entretien avec lauteur.
13. Gabriel VAHANIAN, La Mort de Dieu, Buchet-Chastel, Paris, 1962.
14. Gabriel Vahanian, entretien avec lauteur.
15. Ibid.
16. Gabriel VAHANIAN, La Mort de Dieu, op. cit., p. 133.
17. Gabrien Vahanian, entretien avec lauteur.
18. Ibid.
19. Stanislas Breton, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
68
31-03-2008
15:49
Page 68
PAUL RICUR
Autre invit de marque des colloques Castelli, Emmanuel Levinas participe la rflexion sur Lanalyse du langage thologique : le nom de
Dieu en 1969, et fait cette occasion une communication sur Le nom
de Dieu daprs quelques textes talmudiques . Il sera fidle ces
runions, donnant une dizaine de confrences Rome jusquen 1986.
Heureux de ces rencontres et flatt dtre invit au cur de la rflexion
chrtienne, Levinas a cependant tendance se tenir dans une certaine
rserve ; accompagn de sa femme, il reste volontiers lcart des autres
participants, linverse de Ricur, toujours disponible et plus sociable.
Dautres reprsentants de la France figurent parmi les habitus des colloques
Castelli : Henri Gouhier, Claude Bruaire, puis, partir des annes
soixante-dix, Claude Geffr et Jean Greisch. Ces colloques se sont poursuivis au-del de la mort de Castelli en 1977. Son disciple Marco Olivetti
a repris la responsabilit de leur organisation en inflchissant la rflexion
du ct de la dconstruction derridienne et en souvrant davantage sur le
monde anglo-saxon.
Les premires interventions de Ricur aux colloques Castelli approfondissent le travail entrepris dans La Symbolique du mal. On a dj vu
quun des ressorts essentiels de cette rflexion sur le mal tait de se librer
de la naturalisation du pch souvent pratique dans le christianisme,
notamment augustinien ou calviniste. Le projet de dmythologisation est
loccasion de reprendre la question, et de relativiser encore davantage le
poids de culpabilit qui pse sur le monde chrtien. Lors du premier
colloque Castelli en 1961, Ricur vient juste de publier le second volume
de sa Philosophie de la volont, Finitude et Culpabilit. Il se penche, ce
moment de sa rflexion, sur le symbole, qui lincite se tourner vers ce
que peut tre une hermneutique des symboles articule une rflexion
philosophique. cette occasion, il rappelle lopposition entre deux traditions des mythes sur lorigine du mal. ceux qui voient une antriorit
du mal par rapport lhomme, rpondent ceux qui situent en lhomme
lui-mme cette origine. Dun ct, les mythes babyloniens et la configuration tragique dun destin implacable qui pse sur lhomme son insu ;
de lautre, le rcit biblique qui fait porter sur lhomme, avec la chute
dAdam, tout le poids de la transgression et du mal. Mais cette division
nest pas aussi simple. Ricur insiste sur un clivage interne au mythe adamique, introduit par la prsence du serpent, et qui rvle linclusion du
conflit lintrieur mme du mythe adamique, comme autre face du mal,
comme lAutre de lhomme : Le mal dj l, le mal antrieur, le mal qui
attire et rduit lhomme. Le serpent signifie que lhomme ne commence
pas le mal. Il le trouve 20. Pour penser partir de la symbolique, Ricur
20. Paul RICUR, Hermneutique des symboles et rflexion philosophique , art. cit ;
repris dans Le Conflit des interprtations, op. cit., p. 291.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 69
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES CATHOLIQUES
69
dfinit trois tapes de la pense envisages comme autant de paliers
complmentaires. un premier niveau, une comprhension du symbole
par le symbole doit rsulter dune dmarche phnomnologique. Aprs ce
stade prliminaire, on accde une hermneutique qui a pour objectif de
dchiffrer la singularit du message. Mais la rflexion ne sapproprie vritablement le symbole quen ajoutant une troisime tape, proprement
philosophique, celle dune pense partir du symbole 21 . ce dfi du
mal Ricur oppose la logique paulinienne de la surabondance, celle du
combien plus . Le passage par la dmythologisation a pour fonction de
faire apparatre le mythe comme mythe. Ce premier versant, ngatif, peut
tre qualifi de dmystification et correspond au ncessaire dcapage
critique dune logique de soupon. Mais il est doubl dun versant positif
qui est de faire apparatre lhomme comme producteur de son existence
humaine 22 . Lopration pratique par Ricur revient replacer lobjet
de laccusation et la culpabilit qui en rsulte du ct du krygme, dans la
lumire de la promesse. La religion ne doit plus se prsenter comme un
simple doublet de laccusation et doit donc cesser de sacraliser linterdiction. L encore, cest chez saint Paul que Ricur trouve la voie dune
dmystification radicale de laccusation ainsi que de la transgression : Le
contraire du pch nest pas la moralit, mais la foi 23.
Rome en 1967, Ricur prend pour objet de rflexion le mythe de la
peine. Celui-ci est porteur dune signification hybride faite de rationalit
selon laquelle une logique dquivalence relie le crime et son chtiment,
mais il est aussi tiss dun versant mythique selon lequel une souillure
exige rparation, purification, afin dtre annule. Dans la peine se conjoignent donc une rationalit froide et une sacralisation. Do la ncessit
dun travail de dconstruction du mythe afin de ramener la peine sa
sphre de validit, ce qui permet de prendre des distances par rapport
la porte onto-thologique 24 de la peine. Suivant la dmonstration de
Hegel dans Principes de la philosophie du droit, Ricur procde une
dmythologisation de la peine. Ce premier temps dconstructif npuise
pas cette dmythologisation de la peine, qui doit faire lobjet dune rinterprtation. Elle conduit Ricur proposer lide dun mmorial de
la peine. Une nouvelle fois, cest saint Paul qui linspire, dans un double
mouvement qui porte lextrme de la condamnation pour se renverser
en extrme de la misricorde : Comme la faute dun seul a entran sur
21. Paul RICUR, ibid., p. 295.
22. Paul RICUR, Dmythiser laccusation , art. cit ; repris dans Le Conflit des interprtations, op. cit., p. 330.
23. Ibid., p. 342.
24. Paul RICUR, Le mythe de la peine , art. cit ; repris dans Le Conflit des interprtations, op. cit., p. 354.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
70
31-03-2008
15:49
Page 70
PAUL RICUR
tous les hommes une condamnation, de mme luvre de justice dun seul
procure tous une justification qui donne la vie 25. La logique de la
peine, confronte cette logique du surplus, de la grce, laisse cependant
subsister un mythe bris, un mmorial , cest--dire un pass dpass :
La peine est plus quune idole briser et moins quune loi idoltrer 26.
La dmythologisation laisse donc un reste qui ne peut tre repris par la seule
logique juridique de lquivalence ni par celle, sacre, de la surabondance.
Paris, Ricur est sollicit pour intervenir dans un autre cadre catholique, celui des Semaines des intellectuels catholiques (SIC), organises
par le CCIF 27 depuis 1947. Lcho de ces Semaines, rivales des Semaines
de la pense marxiste, est ce point important dans les annes soixante
quelles parviennent runir une affluence qui pouvait aller jusqu
remplir la grande salle de la Mutualit 28 . La proximit avec Ren
Rmond, prsident du CCIF partir de 1964, favorise la participation de
Ricur ces semaines jusquau dbut des annes soixante-dix, date du
dclin inexorable dun centre emport, comme bien dautres institutions,
par leffet de souffle de mai 1968. Les communications de Ricur au
CCIF dbutent en 1956. Invit par tienne Borne, alors secrtaire gnral
du mouvement, il intervient sur Heidegger interprte du nihilisme
nietzschen le 13 mars 1956 29. Ricur est appel un dbat autour de
son essai sur Freud, De linterprtation, lanne de sa parution, le
15 novembre 1965, avec Claude Bruaire, Claude Imbert et le rvrend
pre Beirnaert.
En cette mme anne 1965, Ricur participe une Semaine des intellectuels catholiques consacre aux sciences humaines et aux conditionnements culturels, historiques de la foi. Prolongeant lexpos de Georges
Balandier, ax sur les conditionnements de la foi, il pose la question de ce
qui chappe ces dterminations dans llan et lexprience vcue qui
recouvrent le phnomne de la foi. La dialectique mme de la religion et
de la foi implique un processus de dmystification et de dmythologisation dont on retrouve la source dinspiration ds lAncien Testament,
25. ptre de Paul aux Romains, Rom. V, 18-19.
26. Paul RICUR, Le mythe de la peine , art. cit, p. 369.
27. CCIF : Centre catholique des intellectuels franais.
28. Rmy RIEFFEL, La Tribu des clercs, Calmann-Lvy, Paris, 1993, p. 419.
29. Ricur interviendra ensuite dans le cadre des Semaines des intellectuels catholiques en
1959 sur Lhomme et son mystre , puis en 1965, Sciences humaines et conditionnements
de la foi , Dieu aujourdhui, Recherches et Dbats, n 52, Descle de Brouwer, Paris, p. 136144 ; puis en 1967, Violence et langage , La Violence. Recherches et Dbats, n 59, Descle de
Brouwer, Paris, p. 86-94 ; puis en 1971, La foi souponne , Foi et Religion, Recherches et
Dbats, n 73, Descle de Brouwer, Paris, p. 64-75. Informations communiques par Claire
Guyot.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 71
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES CATHOLIQUES
71
dans lequel la prdication est dirige contre le culte de limage, de lidole.
La modernit des socits industrielles porte en elle toujours davantage de
rationalit, qui semble faire reculer la foi, mais elle est aussi place sous le
signe de labsurdit croissante, de labsence de finalit et cest ce niveau
que la foi peut sarticuler sur le monde moderne : comme thique vivante
du politique 30 . Autant le croyant, selon Ricur, doit se laisser interpeller par les sciences humaines et assimiler leur interrogation critique,
autant les sciences humaines de leur ct doivent admettre que leur travail
dobjectivation concerne davantage lobjet religieux que la foi elle-mme,
qui leur chappe pour lessentiel, car lintention religieuse excde son
propre conditionnement. Le phnomne de la foi ne se situe pourtant pas
en position dextriorit par rapport au champ dinvestigation des
sciences humaines, condition de laborder par une sorte de respect, de
dlicatesse, dattention au sens, lintention, qui ne spuisent jamais
entirement dans la forme, dans la structure 31 .
En 1967, Ricur participe une nouvelle semaine consacre un thme
qui revt une importance particulire pour lui : la violence. Il met en vidence lexistence dun champ mdian, tiss de discours et de violence, qui
est celui de la parole humaine. LAutre de la violence est la recherche du
sens, mais celle-ci doit viter quelques cueils qui la feraient retomber
dans les errements de la violence. Elle ne doit pas se rduire une simple
raison instrumentale, calculatrice. Habiter le discours de manire non
violente revient respecter la pluralit et la diversit des langages 32 ,
pour faire avancer le sens raisonnable.
Mais le grand moment de cette participation de Ricur aux semaines a
lieu en 1971 sur le thme de la foi souponne , loccasion de la
confrontation avec Roger Garaudy. Avec ce dialogue, Ricur retrouve
la force et les limites de la pense du soupon et rappelle la ncessaire traverse de lpreuve du feu. Tout en intgrant lathisme lhistoire de la
foi, il nest pas question pour lui de baptiser lathe malgr lui : Rien ne
mest plus tranger quune quelconque dmarche oblique de rcupration
qui ferait confesser la foi lathe 33. Ricur souligne un point de divergence avec Marx lorsque celui-ci met laccent unilatralement sur la ncessit, au point de dissoudre lhomme, alors que lesprance ne peut se
concevoir que comme perce du possible contre le ncessaire. Lobjection
que Ricur fait la position marxiste se situe au plan philosophique,
contre sa prtention offrir une thorie gnrale saturant le sens de la ra-
30. Paul RICUR, Sciences humaines et conditionnements de la foi , art. cit, p. 141.
31. Ibid., p. 143.
32. Paul RICUR, Violence et langage , art. cit, p. 94.
33. Paul RICUR, La foi souponne , art. cit, p. 65.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
72
31-03-2008
15:49
Page 72
PAUL RICUR
lit, et au plan politique, contre les risques que lhistoire soit capte par un
groupe dindividus rigs en parti, en avant-garde. Contre ces deux cueils,
Ricur prconise la coexistence de deux types de communaut : la
communaut politique, qui relve dune thique de la responsabilit, et la
communaut ecclsiale, qui doit rester une communaut de parole porte
par une thique de conviction, selon le schma wbrien. Roger Garaudy
invoque de son ct le contexte singulier de circonstances historiques
ayant produit la perversion stalinienne, qui ntait nullement dans Marx,
et de manire polmique il oppose Ricur les perversions propres
lhistoire du christianisme.
On sait depuis que le contexte des annes vingt ne suffit pas puiser
lexplication du phnomne stalinien. La ncessaire ascse dune dmythologisation radicale simpose aux deux communauts, chrtienne et
marxiste.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 73
A.VI.3
La dmythologisation chez les protestants
Rudolf Bultmann va inspirer cette rflexion sur le langage de la foi, impulser un vaste mouvement de dmythologisation et favoriser la mise distance de Barth pour toute une gnration de protestants. Professeur de
thologie Marbourg jusquen 1951, il a t trs marqu par ses contacts
amicaux avec Heidegger et a intgr son exgse biblique dans le cadre
dune interprtation existentiale. Cest partir de cette double finalit du
croire et du comprendre quil labore son programme de dmythologisation. Le krygme 1 est interprt du point de vue du message existentiel
quil porte. Bultmann participe au regain dintrt pour lhermneutique
et redonne lexgse biblique une centralit quelle avait perdue avec
Barth, pour lequel tout leffort a port sur la construction dune dogmatique. Il prend aussi ses distances lgard de la mthode historicocritique. Les rcits vangliques naccdent pas la ralit de la vie de
Jsus et lorsque Bultmann publie son Jsus en 1926, ce quil retient surtout
cest la parole qui vient jusqu lui et constitue une interpellation existentielle. La dmythologisation laquelle procde Bultmann ne vise pas une
vacuation des mythes, mais conduit leur rinterprtation rendue ncessaire car la science comme lexprience vcue ont contredit le cadre des
croyances du pass : La thse fondamentale de Bultmann est que lensemble de la rvlation biblique nous est donn dans un cadre cosmologique que nous ne pouvons plus considrer que comme mythique 2. La
1. Le krygme, la diffrence de la prophtie qui est une annonce portant sur un vnement
venir, est une annonce portant sur un vnement actuel, sinon quasi prsent, comme la venue
du Christ dans le Nouveau Testament.
2. Roger MEHL, Le Protestantisme : hier-demain, op. cit., p. 128.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
74
31-03-2008
15:49
Page 74
PAUL RICUR
prdication chrtienne doit une nouvelle fois sadapter rsolument la
modernit, rpter ainsi le geste de Luther afin de sadresser aux hommes
dans un langage non mythologique. Sa confrence de 1941 Nouveau
Testament et mythologie dfinit un vaste programme 3. Bultmann voit
dans lvangile une perspective de dmondanisation et une voie offerte
une dcision existentielle, privilgiant la catgorie du prsent, du moment
de lvnement, de la dcision. Selon Ricur, le mrite de Bultmann est de
mettre laccent sur limportance de tout un travail textuel et de rompre
ainsi radicalement avec toutes les formes de fondamentalisme en dmythologisant et en renouant ainsi avec la tradition hermneutique. Il correspond tout fait en ces annes soixante la traverse des matres du
soupon et au tournant linguistique que prend Ricur. Le Jsus de
Bultmann est publi au Seuil en 1968 et Paul-Andr Lesort demande
Ricur dcrire une prface ce livre : Cest moi qui ai exig de lui quil
fasse une prface au petit livre de Bultmann sur Jsus, admirable prface,
passionnante, mais jai d insister plusieurs annes 4.
Bultmann pose comme centrale la question hermneutique, soit la
transformation des traces crites en parole vivante. La distance temporelle
qui nous spare de la prdication originaire est en effet source dun problme dordre hermneutique. Dabord, la parole est devenue criture,
ensuite, la distance temporelle nous a loigns de lacte originel, et enfin
la Bible est devenue un texte parmi les autres, soumis aux mmes rgles de
lecture pour les modernes de lge postcritique. Le premier aspect de
lentreprise de Bultmann semble purement ngatif puisquil consiste
prendre conscience du revtement mythique sous lequel est enveloppe la
prdication. Ce premier stade revient restituer la spcificit de la cosmologie implicite du texte, reprsentation mentale jamais dpasse dans le
monde moderne. Cest le versant pistmologique de cette dmythologisation, forme de forage sous le sens littral lui-mme, une d-struction,
cest--dire une d-construction de la lettre elle-mme 5 . Le second
moment de la dmythologisation ncessite de faire affleurer sous le sens
apparent de la fonction explicative ou tiologique une signification
seconde du mythe. Cest le versant positif de la dmythologisation et il
permet dentrer dans le cercle hermneutique : Dmythologiser, cest
alors interprter le mythe 6. Bultmann permet de ne plus tourner le dos
au monde du logos, la philosophie, puisquil considre quon ne peut
absorber un texte, ft-ce la Bible, sans prsupposition. Il ny a donc pas
3. Rudolf BULTMANN, Foi et Comprhension, I et II, Le Seuil, Paris, 1969, 1970.
4. Paul-Andr Lesort, entretien avec lauteur.
5. Paul RICUR, prface Rudolf BULTMANN, Jsus, mythologie et dmythologisation,
Le Seuil, Paris, 1968 ; repris dans Le Conflit des interprtations, op. cit., p. 381.
6. Ibid., p. 383.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 75
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES PROTESTANTS
75
dinterprtation neutre, comme lavait dj soulign Dilthey. Mais il signifie
aussi par l que lon ne peut accder lintelligibilit dun texte qu
condition davoir une anthropologie en affinit avec lui. Cest cette
dernire qui fonde linterprtation existentiale du Nouveau Testament. Le
rapport entre philosophie et exgse se conoit chez Bultmann comme
une relation de complmentarit dans laquelle lvnement proclam par
la Bible avre la virtualit des possibles de la philosophie et la ralise en
mme temps quelle la condamne. Cest ce niveau une limite de Bultmann
que critique Ricur. Il lui reproche de mettre un cran darrt cette tche
de dmythologisation lorsquil est question dacte de Dieu, de la parole de
Dieu : Lagir de Dieu, plus prcisment son agir pour nous, dans lvnement de lappel et de la dcision, est llment non mythologique 7. Ce
noyau non mythologique qui sexprime en termes de transcendance, de
tout autre, dau-del ou dexpressions comme celles dacte, de parole,
dvnement... chappe au questionnement sur le sens. Ricur entend
penser avec, mais aussi contre Bultmann pour mieux penser ce qui reste
impens chez lui. Il lui reproche notamment de ne pas aller assez loin dans
sa rflexion sur le langage qui se limite chez Bultmann au seul souci dobjectivation. Dans la fin des annes soixante, Ricur, qui vient de raliser la
traverse du champ smiotique, structuraliste, considre que Bultmann
reprsente un courant certes important mais dpass de la pense, son
moment encore existentialiste. Par cette appartenance, Bultmann a trop
tendance sappuyer sur la dichotomie diltheyienne entre lexpliquer et le
comprendre et valoriser le caractre psychologisant, existentiel du
comprendre aux dpens de la considration du langage dans toute son
ampleur. la manire de Heidegger, Bultmann a donc opt pour une voie
courte. Or, une thorie de linterprtation qui court demble au
moment de la dcision va trop vite 8 .
Il nen reste pas moins que Ricur, malgr ses rserves, trouve chez
Bultmann un solide appui dans le geste de se pencher sur le texte biblique
comme pratique fondamentale dune foi qui se situe au-devant du lecteur
en tant que source constante douverture critique et interrogative sur le
champ des possibles. Bultmann approfondit la thmatique trs protestante de critique de la religion et de dfense du langage de la foi 9. Lide
que cherche faire prvaloir Ricur est celle dun ge postreligieux de la
foi. Lexercice du soupon doit dboucher sur la comprhension de ce que
signifie le krygme, la proclamation chrtienne, dans la culture moderne.
7. Paul RICUR, ibid., p. 386.
8. Ibid., p. 389.
9. Paul RICUR, La critique de la religion et Le langage de la foi , Bulletin du CPED,
n 4-5, 1964, p. 5-16 et p. 17-31.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
76
31-03-2008
15:49
Page 76
PAUL RICUR
Porteurs du dvoilement de la conscience fausse, les matres du soupon
contribuent une exgse gnrale et leur capacit dchiffrer les structures doit tre assimile. Il convient de sapproprier luvre dmystificatrice de Marx comme tche de vracit et dauthenticit 10 . Pour
Ricur, chez Marx, Nietzsche ou Freud, la critique radicale de la religion
est tout fait justifie lorsque celle-ci devient masque de la peur, masque
de la domination, masque de la haine 11 .
cette dmythisation externe par rapport la religion sajoute une critique interne avec la dmythologisation prconise par Bultmann, et rendue invitable du fait de lloignement culturel qui nous spare du monde
de lvangile. Ce travail de dcapage du pass rend possible une recollection du sens qui est la tche positive de lhermneutique 12 . Ce nest
pas dans la nostalgie dun pass perdu que ce sens peut trouver une inscription, mais au contraire dans la restauration dun espace dinterrogation. La prcomprhension du langage de la foi passe par trois moments.
En premier lieu, il convient de construire une anthropologie philosophique que Ricur pratique dans le style de la phnomnologie ou de la
tradition existentielle 13 . En deuxime lieu, il convient de faire prvaloir tout ce qui restaure la question de lhumanit conue comme totalit
et, cet gard, lanthropologie kantienne des passions humaines (lavoir,
le pouvoir, le vouloir) a valeur dexemple. En troisime lieu, la comprhension pralable de la prdication se situe au niveau du langage luimme : Humboldt disait que lhomme est langage 14. La tche consiste
empcher lclatement en langages pluriels purement techniques enferms dans leur fonctionnalit propre. Cette prcomprhension rend possible le dploiement du travail de restauration du sens. La foi se situe
au-devant, dans les possibilits ouvertes : Le rvl comme tel, cest une
ouverture dexistence, une possibilit dexistence 15. La foi ouvre lhomme
sur ce qui le constitue au cur de sa puissance mythico-potique, par la
parole cratrice.
Cette rouverture sur limaginaire et sur le cratif na pas t du tout
comprise par le spcialiste de limaginaire symbolique Gilbert Durand,
qui na retenu de la dmythologisation chez Bultmann et chez Ricur
que son versant destructeur. Nos techniques modernes, toutes profanes
il va sans dire, vont permettre Ricur et Bultmann de dnoncer ce quil
y a de prim dans les critures : telle est la tche de la fameuse dmythologisation bultmanienne... Trancher, forer, dtruire, ter les enveloppes
10. Ibid., p. 9.
11. Ibid., p. 12.
12. Ibid., p. 18.
13. Ibid., p. 21.
14. Ibid., p. 24.
15. Ibid., p. 31.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 77
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES PROTESTANTS
77
du mythe, telle est selon Ricur et Bultmann la dmarche de cette hermneutique inquisitoriale 16. Cette violente critique, qui se poursuit en
sen prenant au caractre ethnocentrique et la manifestation dagnosticisme du non-sens de Bultmann et de Ricur, qui ne voit dans le mythe
que lexpression de tout ce quil faut liminer, car charg de tous les
pchs de linsignifiance, est un manifeste contresens d une lecture unilatrale. La dmythologisation ne se conoit en effet pour Ricur que
comme tape dans lascse de la recollection du sens.
Un autre thologien a beaucoup compt pour Ricur dans cette
priode, cest Gerhard Ebeling. Postbultmannien, il a particulirement
insist sur la parole, sur le Christ comme vnement de langage, comme
advenir de la parole. Ricur voit trs vite lintrt quil peut tirer de cette
argumentation thologique pour servir de contre-feu la tendance structuraliste qui vacue la parole au profit des seules logiques systmiques de
la langue.
En communion avec le pasteur Louis Simon pour accorder une primaut la prdication comme actualisation de lcriture par rapport au
dogme, Ricur apprcie quavec Ebeling le problme du langage devienne
fondamental, comme pour Heidegger dans ses crits des annes cinquante.
Ebeling reprsente en effet une accentuation du tournant hermneutique,
alors que Bultmann reste encore trs imprgn par lexistentialisme.
Gerhard Ebeling et Ernst Fuchs ont fond, lun Zurich et lautre
Marburg, deux instituts dhermneutique. Cest en effectuant un retour
sur Luther que lun et lautre ont renouvel le problme hermneutique :
Lide fondamentale de la Rforme, selon Ebeling, cest davoir mis la
parole la place de lontologie 17. Contre toute rification, avec son
cortge de reliques, la Rforme replace lglise comme lieu de jonction
entre un vnement de parole et une autre parole qui linterprte : Lglise
est de part en part exgse 18. Cette historicisation de lglise assigne la
catgorie de linterprtation une centralit thologique et dbouche sur
un procs dactualisation constant de la parole. Cest en ce point que se
pose le problme hermneutique de la reconversion dune parole devenue
texte et quil faut de nouveau traduire en parole. Cette exigence pose tout
le problme de la traverse du monde profane, scularis, car lhermneutique est une et non divisible en une simple juxtaposition dun versant
sacr et dun versant profane. Au contraire de Karl Barth, pour Ebeling,
la parole divine nest pas spare de la parole humaine. Cest au sein de la
parole unique que lon peut discerner la polarit Dieu/homme : Cest
16. Gilbert DURAND, Science de lhomme et tradition, Berg-International, Paris, 1979, p. 67-68.
17. Paul RICUR, Ebeling , Foi ducation, n 81, octobre-dcembre 1967, p. 40.
18. Ibid., p. 42.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
78
31-03-2008
15:49
Page 78
PAUL RICUR
ainsi quEbeling essaie de comprendre le mot de saint Jean : La parole a
t faite chair. Cela veut dire : il y a eu un moment de lhistoire, et cest
cela le krygme chrtien, o la parole a t entirement accomplie 19. En
ce sens, Ebeling contribue liquider la distinction de Dilthey, que
Ricur qualifie de dangereuse et dappauvrissante, entre lexpliquer et le
comprendre. Ebeling reprsente donc en cette fin des annes soixante une
rfrence de plus en plus invoque par Ricur qui trouve en lui un solide
appui dans son tournant hermneutique.
En Suisse francophone, dans les milieux thologiques protestants,
Ricur a eu un cho considrable auprs de la nouvelle gnration de ces
annes soixante, notamment dans lcole genevoise : chez Pierre Gisel,
Henri Mottu, ric Fuchs, Marc Faessler... tudiant en thologie entre
1966 et 1970 Genve, Pierre Gisel, responsable de lEncyclopdie du protestantisme, a consacr son mmoire de fin dtudes Ricur sous le titre
Distance et Appropriation. Ce quil retient de Ricur, cest son insistance
sur la notion de distance, quil oppose lhritage bultmannien, qui considre trop vite la lecture en termes dappropriation : Ricur soulignait
fortement, et de manire positive, les mdiations ncessaires 20. Cest le
versant, kantien, critique, de Ricur quil retient avant tout. Il suit donc
pleinement les rserves exprimes par Ricur dans sa prface au Jsus de
Bultmann.
Lautre lieu privilgi de la rception des thses de Ricur en Suisse
francophone est reprsent par des thologiens bultmanniens de Neuchtel, universit o enseigne le thologien Pierre Bhler. Le doyen de
la facult de thologie de Lausanne, Denis Mller, a fait ses tudes
Neuchtel dans les mmes annes que Pierre Gisel : 1966-1970. Il entend
assez vite parler de Ricur par son professeur dhistoire du christianisme, Pierre Barthel, qui arrivait de Strasbourg o il venait de soutenir
une thse en hermneutique sur la dmythologisation. Celui-ci avait
conduit une tude compare des thses dHenri Dumry, de Paul Tillich,
de Rudolf Bultmann et de Paul Ricur. Denis Mller ressent son enseignement comme une grande ouverture, alors que les autres professeurs,
barthiens pour la plupart, nvoquaient Bultmann, Tillich ou Ricur
quavec un certain ddain, considrant quils ne relevaient ni de la thologie ni de la philosophie pure. Denis Mller complte sa formation thologique en se lanant dans la lecture de philosophes, Husserl, Heidegger,
et lorsque parat en 1969 Le Conflit des interprtations de Ricur, il se
trouve en quatrime anne de thologie : Je me souviens avoir lu et
comment tout louvrage avec un groupe de quatre camarades 21. Cest
19. Ibid., p. 48.
20. Pierre Gisel, entretien avec lauteur.
21. Denis Mller, entretien avec lauteur.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 79
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES PROTESTANTS
79
pour ce groupe dtudiants loccasion de sortir du dogmatisme dune lecture traditionnelle ou dune approche philologique troite et de concilier
leur double apptit thologique et philosophique : Ricur arrivait
point nomm pour contester nos professeurs et sortir du dogmatisme
comme du positivisme 22. Aprs avoir soutenu son mmoire avec son
professeur de dogmatique, Jean-Louis Leuba, sur Loi et vangile dans la
thologie protestante, Denis Mller entreprend sa thse sur Pannenberg 23.
Outre sa recherche acadmique, ce qui le passionne alors, cest la thorie
des symboles et ses prolongements hermneutiques qui mnent se dtacher dun certain dogmatisme et de reprsentations objectivistes et
renouveler ainsi une thologie considre comme invitablement mdie
par la tradition et les symboles qui donnent penser : Cela a t extrmement librateur et a permis de remettre en question la myopie de certains
philosophes et celle dune lacit fonde sur le dsintrt pour le phnomne religieux 24.
Professeur de dogmatique et auteur dune thse sur Ksemann 25, Pierre
Gisel est toujours trs fortement marqu par son premier travail sur
Ricur : Cela continue mhabiter et consonne avec des choses profondes chez moi 26. Il consacre Ricur en 1974 une mise en perspective de son uvre 27. Dans cette tude, il insiste sur le mouvement
dobjectivation que Ricur retient du programme phnomnologique et
le long cheminement qui en rsulte. Cette mise distance de la subjectivit, encore renforce avec le dtour par la psychanalyse, conforte tout
fait Pierre Gisel dans sa volont de maintenir un niveau autonome dans sa
positivit et sa diffrence irrductible la conscience que jen ai 28 . Ce
que Pierre Gisel retient surtout en tant que thologien de la lecture de
Ricur en 1974 est sa capacit rompre avec la filiation hermneutique
hrite du romantisme et fonde sur une opposition stricte entre lexpliquer et le comprendre. Selon Gisel, Bultmann confirme et poursuit cette
vision dichotomique et ruineuse, alors que Ricur part des apories kantiennes sans pour autant revenir des positions antrieures au moment de
la pense critique. Le modle dont il est porteur, et qui rcuse demble les
fausses disjonctions, met fin la question qui a hant les thologiens
22. Denis MLLER, ibid.
23. Denis MLLER, Parole et Histoire. Dialogue avec Wolfhart Pannenberg, Labor et Fides,
Genve, 1983.
24. Denis Mller, entretien avec lauteur.
25. Pierre GISEL, Vrit et Histoire. La thologie dans la modernit : Ernst Ksemann, Beauchesne/Labor et Fides, Paris-Genve, 1977.
26. Pierre Gisel, entretien avec lauteur.
27. Pierre GISEL, Paul Ricur , tudes thologiques et religieuses, n 1, 1974, p. 31-50.
28. Ibid., p. 41.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
80
31-03-2008
15:49
Page 80
PAUL RICUR
modernes : celle de la qute des origines. Il contribue ainsi radicaliser la
critique de la mtaphysique : Le procs de la mtaphysique doit aller jusqu mettre en cause, me semble-t-il, toute pense qui vit du modle dune
vrit conue en termes dadquation avec elle-mme. Les concepts dvidence, dunit et dimmdiatet dans lorigine, de concidence possible
avec son objet doivent ici plaider coupables 29. Ricur oppose cette
qute originelle et ses rves de symbiose entre le rel et le rationnel les
notions de positivit, dautonomie et de pluralit. Il est le porteur dune
voie nouvelle qui rend possible de penser ensemble la vrit et le monde.
Selon cette perspective, le sens nexiste quen prise sur une positivit
contingente, particulire chaque fois, constitutive et pourtant non
dfinitive 30 .
Toujours en Suisse, on retrouve un ancien lve de Ricur de lpoque
du Chambon : Alain Blancy (Bielschowsky de son vrai nom), qui fut pendant dix ans, entre 1971 et 1982, directeur dtudes dans le conseil cumnique des glises linstitut Bossey, mi-chemin entre Genve et
Lausanne. Cet institut a t fond en 1946 pour rconcilier les chrtiens
spars par la guerre, avec une volont laque et lambition de peser sur les
dcisions des politiques, des conomistes, en favorisant le dialogue pluridisciplinaire. Des sessions sont organises sur des thmes prcis et cest
dans ce cadre quAlain Blancy a invit Ricur en 1974 pour parler des
rapports entre science et thologie.
La radicalisation du mouvement de dmythologisation en ces annes
soixante passe par la proximit avec les thses de Bonhoeffer. Disciple de
Barth, il fait figure, nous lavons dj vu, de hros de la rsistance au
nazisme. Ds quil apprend la dclaration de guerre, alors quil se trouve
aux tats-Unis, il sembarque sur le dernier bateau qui le ramne en Allemagne pour tre au milieu de son peuple. Rsistant au nazisme jusqu
participer une tentative dlimination de Hitler, il est excut sur ordre
du Fhrer le 9 avril 1945, lge de trente-neuf ans, quelques heures seulement aprs avoir prononc un dernier sermon devant ses camarades de
captivit. Continuateur de Barth, Bonhoeffer ouvre en mme temps toute
une rflexion qui va engendrer une thologie dite de la mort de Dieu ou
un christianisme irrligieux. En revanche, la diffrence de Barth qui
soppose avec fermet au programme de dmythologisation de Bultmann,
Bonhoeffer reprend son compte ce travail critique pour dfinir ce
quAndr Dumas qualifie de Thologie de la ralit 31. Ce sont surtout ses
29. Ibid., p. 47.
30. Ibid., p. 49.
31. Andr DUMAS, Une thologie de la ralit, Labor et Fides, Genve, 1968.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 81
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES PROTESTANTS
81
lettres et papiers de prison, parus en 1951 sous le titre Rsistance et
Soumission, qui deviennent la source dun profond renouvellement de la
rflexion thologique : ses yeux, la religion constitue leffort impossible de lhomme pour rejoindre Dieu, une tentative pcheresse dautojustification 32. Lhomme moderne, devenant adulte, peut se passer de la
religion traditionnelle au moment o la science limine lide dun Dieu
bouche-trou. La scularisation progressive de la socit, de son ct, ruine
la mtaphysique. La religion nest plus alors que l opium de la foi au
profit de lexcitation de leros spirituel 33 . Cette critique radicale de la
religion ne remet pas en cause la foi. Elle implique que lglise vive celleci sans appui extrieur, dans la seule promesse de Dieu.
Ricur a comment les positions de Bonhoeffer 34. Il rtablit la gnalogie barthienne de la question, dj prsente dans le commentaire de
lptre aux Romains lorsque Barth crit que le christianisme nest pas
une religion . Mais Barth na pas tir, selon Bonhoeffer, toutes les consquences logiques de son constat. La scularisation ne permet plus dinvoquer Dieu ni comme explication du monde, ni comme chappatoire aux
questions non rsolues. Le monde moderne est celui dun dsenchantement radical et Bonhoeffer propose une thologie du Dieu souffrant ou
un athisme du Dieu philosophique. Jsus-Christ abolit la dualit mtaphysique et la vie dans un monde sans Dieu se manifeste par labandon du
fils de Dieu sur la croix : Dieu se laisse dloger du monde et clouer sur
la croix. Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement il
est avec nous et nous aide 35. Ce que tente de faire Bonhoeffer est de
penser thologiquement la contemporanit dun ge post-religieux. La
transcendance est devenue immanente notre monde et conduit le
chrtien une thique fonde sur lexistence pour autrui, dans une souffrance partage : Ce nest pas lacte religieux qui fait le chrtien, mais sa
participation la souffrance de Dieu dans la vie du monde 36.
Bonhoeffer suit Nietzsche lorsquil affirme que Dieu est mort, mais il
reste le Dieu en Jsus-Christ. Ricur approuve cette traverse du nihilisme inaugure par Nietzsche et que ralise Bonhoeffer, mais condition
de bien comprendre lopposition entre laffirmation selon laquelle Dieu
est mort et celle selon laquelle Dieu nexiste pas . Cela veut dire : le
Dieu de la religion, de la mtaphysique et de la subjectivit est mort, la
place est vide pour la prdication de la croix et pour le Dieu de Jsus-
32. Andr DUMAS, ibid., p. 194.
33. Ibid., p. 195.
34. Paul RICUR, Linterprtation non religieuse du christianisme chez Bonhoeffer ,
Cahiers du Centre protestant de lOuest, n 7, novembre 1966, p. 3-20.
35. Dietrich BONHOEFFER, Rsistance et Soumission, Labor et Fides, Genve, 1973, p. 366.
36. Ibid., p. 167.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
82
31-03-2008
15:49
Page 82
PAUL RICUR
Christ 37. Bonhoeffer parvient donc dfinir une christologie qui fait
lexprience dun Dieu faible et souffrant. Il aura ainsi repris lide nietzschenne dun Dieu tout-puissant face un homme faible en la retournant
en son contraire. Son Dieu souffrant immanent la plnitude de la vie
ouvre la voie chez Bonhoeffer ce quil qualifie de polyphonie comme
exprience vritable du chemin vers Dieu . Lglise devient alors, selon
lui, lglise pour les autres, comme le Christ est homme pour les autres.
On peut reconnatre dans cet horizon pluriel et dialogique un univers
trs proche de celui de Ricur, aux limites dune thologie agnostique,
tisse dune conception foncirement pluraliste et tourne vers lengagement dans la cit, vers laffirmation dune prsence au monde, dlaissant
les aspects de la croyance concernant le salut : La terre promise, le sol,
cest cette terre. LAncien Testament ne parle pas du ciel... Sil faut que
lglise revienne lAncien Testament, cest donc, selon Bonhoeffer, pour
enraciner mondainement sa prdication, contre la tentation den faire un
message cleste... Ce que nous trouvons dans lAncien Testament, cest un
sens mondain de la vie, un retour au sol, ce monde, pour y exister et
pour y agir dans une communaut humaine 38.
Ce programme de dmythologisation nest pas sans provoquer
quelques ractions critiques au sein de la communaut protestante. Cest
le cas notamment dans le courant vanglique oppos au libralisme et au
modernisme professs par lglise rforme de France. Peu reprsentative
au dpart, cette tendance traditionaliste, fondamentaliste, du protestantisme fait des mules grce de solides liens avec des glises anglaises et
amricaines et surtout parce quelle est porte par la crise identitaire collective. Cest lintrieur de cette mouvance trs clate que la facult libre
de thologie vanglique de Vaux-sur-Seine et lInstitut biblique de
Nogent-sur-Marne forment des pasteurs dune glise baptiste. Les points
de clivage essentiels des baptistes par rapport aux rforms se portent sur
le sacrement du baptme. Les baptistes refusent le baptme des nourrissons
et ne consacrent lentre dans la communaut confessante qu lge de
raison. Au plan des orientations thologiques, une autre diffrence
majeure se cristallise sur la manire de dire le Credo. Alors que lglise
rforme a affirm un principe pluraliste propos de la profession de foi,
lappartenance la communaut baptiste prsuppose ladhsion une
conception de la rsurrection du Christ au sens des premiers sicles du
christianisme.
37. Paul RICUR, Linterprtation non religieuse du christianisme chez Bonhoeffer , art.
cit, p. 11.
38. Ibid., p. 17.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
31-03-2008
15:49
Page 83
LA DMYTHOLOGISATION CHEZ LES PROTESTANTS
83
Le doyen de cette facult vanglique, Henri Blocher, est un excellent
connaisseur de luvre de Ricur, quil a eu pour professeur lors de son
retour dAlgrie en 1961-1962. Il avait dailleurs dj entendu parler de
Ricur trs tt par son pre, Jacques Blocher, pasteur baptiste qui,
lissue de sa captivit, au moment des regroupements sur le chemin du
retour, sest retrouv dans un lieu de transit avec Ricur, qui lui a expliqu lexistentialisme contemporain. Mais surtout, cest la lecture dun
article de Ricur sur Jaspers dans la revue de philosophie de Strasbourg
qui dcide Henri Blocher suivre ses cours : Javais t tellement
enthousiasm par ce texte que javais dcid de saisir loccasion daller
son cours 39. Henri Blocher suivra avec attention et commentera luvre
de Ricur, mais dans une distance critique, en tant que membre dun courant oppos au sien dans le protestantisme. Dans une tude trs fine dans
laquelle il retrace litinraire de lhermneutique de Ricur, Henri Blocher
ne cache pas ses profonds dsaccords 40. Certes, il reconnat Ricur
un grand apport thologique, une consistance suprieure celle de
Bultmann, une sensibilit particulire aux problmes historico-critiques,
trop souvent relgus linsignifiance, et une comprhension hors pair de
lintention du rcit adamique. Cependant, au passif de sa christologie,
Henri Blocher met son rejet de la doctrine apostolique de lcriture. Le
diffrend se cristallise surtout sur la question du pch originel, dont nous
avons vu quelle a t un des puissants motifs de rflexion et de contestation de la part de Ricur. De son ct, Henri Blocher se fait le dfenseur
dune orientation augustinienne qui subordonne la philosophie lengagement de la foi et sappuie sur la toute-puissance du Seigneur, au point
que le titre de sa revue, Hokhma ( sagesse en hbreu) porte comme
sous-titre : La crainte du SEIGNEUR est le commencement de la sagesse.
Cet exergue suffit saisir labme qui spare le parcours de Ricur de
cette culture de la peur 41. Pour Henri Blocher, Ricur tombe dans lillusion quil peut faire comme si propos du commencement historique
du mal. Il lui reproche de pourfendre la vision morale de lcriture, ainsi
que son aversion pour la morale du commandement et son effort pour
tirer lthique du dsir 42 . Autre point de clivage, Henri Blocher sen
prend ce quil considre comme une entreprise de dralisation dvnements historiques attests par des tmoins oculaires. Lentreprise de
dmythologisation est alors la cible de critiques au nom dune vrit
39. Henri Blocher, entretien avec lauteur.
40. Henri BLOCHER, Lhermneutique selon Paul Ricur , Hokhma, n 3, 1976, p. 11-57.
41. Il convient nanmoins dattnuer lopposition en restituant le sens biblique de la
crainte qui ne se confond pas avec la simple peur . Selon la Bible, la crainte renvoie
une qualit de la relation de lhomme Dieu faite de respect, de rvrence et de paisible
confiance.
42. Henri BLOCHER, Lhermneutique selon Paul Ricur , art. cit, p. 36.
IV.1/V.1/V.2/VI.1/VI.2/VI.3
84
31-03-2008
15:49
Page 84
PAUL RICUR
historique au regard de laquelle les conversions en termes de symboles,
dvnements-signes, ont pour effet de faire vaciller lobjectivit et la
consistance de lvnement. La traverse des matres du soupon se solde
donc, aux yeux dHenri Blocher, par des concessions regrettables 43 .
Il ne suit pas Ricur dans sa dfense dune autonomie de la pense rationnelle. Il la considre comme purement illusoire. La tension propre la
croyance en un cogito autonome et laffirmation selon laquelle le savoir
dont il est porteur est abstrait, vide et vain participe dun attelage disparate 44 . Autre sujet de dsaccord, Henri Blocher peroit une virtualit
panthiste chez Ricur, qui rapproche le Divin de la nature naturante:
Il y a un lment paen quil accueille trop volontiers. L, je rsiste sa
proximit avec Aristote 45. Henri Blocher oppose lorientation de
Ricur celle dune hermneutique de la repentance et de la confession 46 , bien loin en effet du renouvellement permis par Ricur puisquil y est fait appel la comprhension comme repentance. Le chemin
dfini est celui de la crainte du SEIGNEUR 47 , soit peu prs tout ce
contre quoi lentreprise philosophique de Ricur, depuis sa thse sur le
volontaire, sest leve, savoir cette naturalisation, au nom de lhistoire,
de la culpabilit. Tout le programme de la dmythologisation a consist au
contraire librer les forces cratives du prsent de la gangue cosmologique du pass.
43. Ibid., p. 45.
44. Ibid., p. 47.
45. Henri Blocher, entretien avec lauteur.
46. Henri BLOCHER, Lhermneutique selon Paul Ricur , art. cit, p. 51.
47. Ibid., p. 57.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 85
A.VI.4
Un heideggerianisme bien tempr
Parlant de Heidegger, Levinas dit que deux choses sont certaines : cest le
plus grand philosophe du XXe sicle et il a t nazi. Il laisse donc un hritage qui ne peut que plonger les philosophes dans des abmes de perplexit. Comment penser ces deux assertions ensemble ? On comprend la
relation ambivalente, complexe, de Ricur avec luvre de Heidegger.
Au mois daot 1955, une rencontre a lieu entre eux Cerisy loccasion dune dcade consacre Heidegger, organise par Jean Beaufret et
Kostas Axelos. Elle runit cinquante-quatre participants, parmi lesquels
Gilles Deleuze, Lucien Goldmann, Maurice de Gandillac, Jean Starobinski,
Gabriel Marcel... : Pour marquer leur hostilit, Sartre et Merleau-Ponty
boudrent la runion [...]. Quant Lucien Goldmann, il lut en pleine
sance les textes de la priode du Rectorat, malgr la rprobation gnrale
des participants, qui laccusrent davoir rompu le charme consensuel de
la grande rencontre 1. Le premier soir, madame Heurgon ouvre la crmonie et annonce que le matre va saluer lassistance. Heidegger apparat
sur le perron, sort un bout de papier et proclame en allemand : Ce qui
importe, ce nest pas la rapidit du langage, mais lcoute du silence.
Ricur est prsent, dans le but de faire une objection de fond lintervention de Heidegger sur le thme Quest-ce que la philosophie ? 2 .
Il met en effet le doigt sur langle mort de lhorizon heideggerien : tout
lhritage hbraque est absent de son uvre. Ricur ne voit pas pourquoi exclure de la philosophie ce qui constitue un insondable vnement
1. Elisabeth ROUDINESCO, Jacques Lacan, Fayard, Paris, 1993, p. 299.
2. Martin HEIDEGGER, Quest-ce que la philosophie ?, trad. Kostas Axelos et Jean Beaufret,
Gallimard, Paris, 1957.
VI.4/VII.1
86
31-03-2008
15:50
Page 86
PAUL RICUR
et un pan essentiel de notre culture occidentale. Heidegger rtorque que
cela correspond ce quil a appel nagure le caractre onto-thologique
de la mtaphysique et se dit convaincu que le questionnement dAristote
prend sa racine dans la pense grecque et na aucun rapport avec la dogmatique biblique 3 . Bien videmment, Ricur ne se satisfait pas de cette
rponse dilatoire : au moment o il est en train dcrire La Symbolique du
mal, il cherche justement penser ensemble les deux hritages, grec et
judo-chrtien. Exaspr par le barrage tabli par Beaufret et ses amis afin
dviter toute interpellation intempestive du matre allemand, Ricur
intervient mme au nom de tous les participants pour exiger des relations
plus directes. Le psychanalyste Antoine Vergote est invit tenir compagnie Heidegger au cours du repas, privilge quil doit sa bonne matrise de la langue allemande. Heidegger vient de passer quelque temps
avec Lacan Guitrancourt. Vergote, curieux, interroge Heidegger. Il me
rpond : Oui, Lacan ? Il commence tout juste penser. quoi je
rtorque par une phrase de Husserl dans Krisis selon laquelle nous
sommes tous dternels commenants. Il na plus dit un mot ni au dessert
ni au caf. On sest salus comme des Japonais. Il na pas support 4.
Pour Heidegger, cette dcade de Cerisy sera surtout loccasion de faire la
connaissance de Ren Char avec lequel il se lie rapidement damiti 5 .
La distance prcoce de Ricur vis--vis de Heidegger tient donc cet
vitement systmatique du massif biblique. Selon lui, rien ne peut justifier
le caractre exclusif de lintrt port par Heidegger aux prsocratiques et
son vacuation des prophtes dIsral, de saint Paul ou de saint Augustin,
soit de toute une mmoire judo-chrtienne qui offre non seulement un
vritable gisement de pense, mais aussi les bases dune possible thique,
absente chez Heidegger, pouvant laisser prise son adhsion au nazisme.
La rfrence Heidegger est pourtant omniprsente dans luvre de
Ricur, notamment en ce moment de greffe hermneutique, comme en
tmoigne son dialogue de 1968 avec son ami Gabriel Marcel. Il a mme
tendance dlaisser Jaspers, ce quil se reprochera plus tard, au profit de
Heidegger : Quand jai crit sur vous, jai t beaucoup plus sensible
votre proximit lgard de Jaspers qu celle de Heidegger. Or, avec le
recul, jaurais tendance aujourdhui accentuer la distance et mme
lopposition, que javais dailleurs aperues, entre Jaspers et vous, et au
contraire souligner tout ce qui, en dpit dapparences contraires et qui
sont certainement trs fortes, vous rapproche de Heidegger 6. La greffe
3. Martin HEIDEGGER, cit par Jean BEAUFRET, Heidegger et la thologie , in Richard
KEARNEY (dir.), Heidegger et la question de Dieu, Grasset, Paris, 1980, p. 22.
4. Antoine Vergote, entretien avec lauteur.
5. Rdger SAFRANSKI, Heidegger et son temps, Grasset, Paris, 1996.
6. Paul RICUR, Entretiens Paul Ricur, Gabriel Marcel, op. cit., p. 83-84.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 87
UN HEIDEGGERIANISME BIEN TEMPR
hermneutique et le dtour vers la filiation, tudie plus haut, qui va de
Schleiermacher Dilthey conduisent Ricur vers une attention renouvele aux thmatiques heideggeriennes. Il y peroit le passage dune
conception encore rduite de lhermneutique, simple pistmologie des
sciences de lesprit selon Dilthey, une pense qui vise une ontologie du
comprendre chez Heidegger, dans Sein und Zeit 7. Ricur peroit dans
le caractre dissimul du phnomne selon Heidegger, dans cet tre-l, ce
dasein qui ne dsigne ni un sujet ni un objet, mais le lieu o la question
de ltre surgit, le lieu de la manifestation 8 , louverture sur une phnomnologie hermneutique. Lopacification qui rgne dans la rencontre du
phnomne, loubli de la question de ltre justifient le dtour hermneutique. Cette explicitation ncessaire russit creuser plus profondment
en visant le sol ontologique sur lequel reposent les sciences de lesprit. La
deuxime mutation de Heidegger par rapport Dilthey consiste se
librer de lemprise encore trop psychologisante, trop romantique, de la
notion de comprhension : Dans Sein und Zeit, la question de la comprhension est entirement dlie du problme de la communication avec
autrui 9. Heidegger substitue la question du rapport avec lautre, qui
risque de redoubler la notion de subjectivit, la notion dtre-au-monde :
En mondanisant ainsi le comprendre, Heidegger le dpsychologise 10.
Ce dplacement fondamental oriente la philosophie de Heidegger vers
le langage, sans partir de lui. En effet, la triade heideggerienne situationcomprhension-interprtation part de lancrage, de tout systme linguistique pour rendre possible le comprendre conu comme une capacit
dorientation. Ce nest quen troisime lieu quintervient la notion dinterprtation, car avant lexgse des textes vient lexgse des choses 11 .
Ce nest quau terme de ce triple mouvement de la pense quintervient la
question du langage comme articulation seconde. Cette secondarit sert
de manire implicite largument de Ricur dans la controverse qui loppose
au structuralisme, dans sa tendance hypostasier ce niveau langagier.
Outre cet aspect conjoncturel, la thse de Heidegger selon laquelle il
convient daccorder le primat dans le dire au couple couter-se taire
rsonne fortement par rapport aux convictions de Ricur pour lequel
comprendre, cest entendre 12 .
7. Martin HEIDEGGER, tre et Temps (1927), trad. Alphonse de Waelhens et R. Boehm,
Gallimard, Paris, 1964.
8. Paul RICUR, La tche de lhermneutique , op. cit.; repris dans Du texte laction,
op. cit., p. 89.
9. Ibid., p. 90.
10. Ibid., p. 91.
11. Ibid., p. 92.
12. Ibid.
VI.4/VII.1
88
31-03-2008
15:50
Page 88
PAUL RICUR
Ricur adhre-t-il donc purement et simplement lontologie heideggerienne ? Il nen est rien, car aprs avoir montr toute la fcondit de ce
cheminement, il dnonce une aporie qui, non rsolue, est tout simplement
dplace et par l mme aggrave ; elle nest plus dans lpistmologie
entre deux modalits du connatre, mais elle est entre lontologie et lpistmologie prise en bloc 13 . Ce quil rcuse, cest que cette remont aux
fondements ontologiques rend impossible le mouvement en retour vers
lpistmologie. Laller simple qui se coupe ainsi des questions de
mthode tourne le dos aux sciences et ferme la philosophie sur elle-mme
dans un pur soliloque. Rendant impossible la question critique, lhermneutique ontologique offre certes une voie sduisante, un chemin direct,
mais trop court et qui finit par court-circuiter les longs dtours rendus
ncessaires par linterrelation entre la philosophie et les sciences.
Nanmoins, Heidegger constitue un lment dcisif dans la rflexion
quentreprend Ricur sur le temps. Il se pose le problme de savoir si
Heidegger parvient rsoudre la double aporie du temps, selon que lon
se situe sur le versant du temps intime avec Augustin et Husserl ou sur le
versant cosmologique avec Aristote et Kant. La notion de ltre-l, du
dasein, donne la possibilit de dpasser lopposition traditionnelle entre le
monde physique et le monde psychique. Heidegger offre trois prolongements fconds la rflexion sur la temporalit. En premier lieu, il envisage
la question du temps comme totalit enveloppe dans la structure fondatrice du Souci. En deuxime lieu, il relie les trois dimensions du temps
pass, prsent, devenir dans une unit ek-statique, processus commun
dextriorisation. En troisime lieu, le dploiement de cette unit ek-statique rvle son tour une constitution que lon dirait feuillete du temps,
une hirarchisation de niveaux de temporalisation, qui requiert des dnominations distinctes : temporalit, historialit, intra-temporalit 14 .
Heidegger situe dans le Souci 15 lui-mme le principe de la pluralisation du
temps, sa dcomposition en pass, prsent, futur. Il aura accord la
dimension du devenir une prvalence sur les deux autres relations au
temps. Lintention de Heidegger est dchapper deux cueils classiques
de la pense historique, dune part, envisager les phnomnes historiques
demble comme phnomnes appartenant la sphre publique et, dautre
part, en sparant le pass de son futur, rduire lhistoire une simple
13. Ibid., p. 94.
14. Paul RICUR, Temps et Rcit, t. 3, op. cit., p. 116.
15. Le Souci, au sens philosophique moderne, se rfre dabord lintentionnalit chez
Husserl : Toute conscience est conscience de quelque chose. Chez Heidegger, lintentionnalit devient le Souci comme structure a priori (existential) et totale du dasein, ltre-l. Le
Souci (Sorge), cest lembarras qui tente de saisir ses propres traits existentiaux.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 89
UN HEIDEGGERIANISME BIEN TEMPR
rtrospection. linverse, Heidegger insiste sur la notion dhritage
transmis qui laisse entrevoir comment tout retour en arrire procde
dune rsolution essentiellement tourne vers lavant 16 . Lhermneutique heideggerienne, avec le concept de rptition, permet cette rouverture des potentialits, des possibles non avrs ou rprims du pass, en
direction de l-venir. Mais elle se heurte cependant ce que Ricur qualifie daportique de la temporalit, qui reste incapable de trouver les
mdiations adquates pour penser ensemble le temps cosmologique et le
temps intime, en termes heideggeriens, le temps vulgaire de la quotidiennet des sciences et le temps intime du dasein : Si lon met laccent sur les
deux extrmes de cette promotion de sens, ltre-pour-la-mort et le temps
du monde, on dcouvre une opposition polaire, paradoxalement dissimule travers le processus hermneutique dirig contre toute dissimulation : dun ct le temps mortel, de lautre le temps cosmique 17.
Si Ricur considre comme majeure la rflexion sur le temps de
Heidegger, il ne le suit pas lorsquil pratique une hypostase de ltre,
notamment dans sa priode mdiane, celle des annes cinquante. Ltre
sautonomise alors chez Heidegger et vient se faire histoire, se retirant et
se dvoilant en mme temps. Cette primaut radicale accorde ltre
dans la pense heideggerienne est dautant plus trangre Ricur quelle
vient brouiller la distinction laquelle il tient entre le registre philosophique et thologique, imposant un nouvel absolu qui risque de tout
absorber et de faire systme. De plus, labsolutisation de ltre fait cran
tout dialogue avec le monde de la science.
Un spcialiste de Heidegger, ancien tudiant de Ricur, Michel Haar,
dveloppe dans sa thse des rserves semblables celles de Ricur
lgard de cette hypostase de lhistoire de ltre 18. Malgr lenthousiasme
quil prouve pour luvre de Heidegger, il considre que celui-ci
accorde ltre tous les attributs humains : il y a une mmoire de ltre,
une sorte de grce de ltre... mais quelle part reste-t-il lhomme 19 ? .
partir de l, Michel Haar dveloppe une critique interne des positions
de Heidegger qui reviennent une sorte de fatalisme historial : Si lorigine de tout oubli est scellement de ltre, cest bien lhomme qui oublie,
et qui, oubliant cet oubli, tomber dans lerrance. Seul lhomme erre. Ltre
nerre pas 20. Cette errance est certes la condition mme du destin, de
lhistoricit, mais Heidegger arrache toute subjectivit celle-ci car la pra-
16. Paul RICUR, Temps et Rcit, t. 3, op. cit., p. 136.
17. Ibid., p. 173-174.
18. Michel HAAR, Heidegger et lessence de lhomme, Millon, Grenoble, 1990.
19. Michel Haar, entretien avec lauteur.
20. Michel HAAR, Heidegger et lessence de lhomme, op. cit., p. 191.
VI.4/VII.1
90
31-03-2008
15:50
Page 90
PAUL RICUR
tique de sa libert rside en un arrachement toute relation pratique ou
thorique ltant, et aboutit un dpouillement total : Lhomme ne
veut rien, ne recherche rien, sinon dans le pur renoncement tout but
particulier 21. Quelle est, se demande Michel Haar, cette trange libert
qui nat de la quasi-disparition de lhomme ? cet gard, les mtaphores
utilises par Heidegger sont clairantes : lhomme est le berger de ltre, le
tmoin de ltre. Il est rduit une position purement passive, dimpuissance. Heidegger pratique une fausse symtrie entre un tre dont tout
dpend et un homme dont lindividualit est purement et simplement
supprime. De la mme manire que la voie courte de lhermneutique
heideggerienne ne parvient pas parcourir le chemin inverse vers lpistmologie, lasymtrie radicalise entre ltre et lhomme ne permet pas non
plus de remonter de lontologie lthique. Lanalytique de Heidegger ne
reconnat pas vraiment la place de lautre et par l mme nattribue pas de
statut la dimension thique.
Par ailleurs, Ricur laisse percevoir son irritation devant la prtention
de Heidegger incarner la sortie de la clture mtaphysique o il estime
que ses devanciers sont enferms. Il ne peut suivre Heidegger dans cette
voie et dnonce en 1975 dans La Mtaphore vive son inadmissible prtention 22 vouloir mettre un terme lhistoire de ltre, comme si ltre
disparaissait dans lEreignis (lvnement). Il qualifiera mme plus tard, en
1991, cette attitude d arrogante et ajoutera que cest l ce qui me
parat intolrable chez Heidegger 23 .
Ricur aura cependant consacr une bonne partie de son enseignement
et de ses recherches Heidegger. Dans son cours sur Freud la Sorbonne,
au dbut des annes soixante, il est trs attentif au tournant linguistique et
voque souvent le dernier Heidegger, non encore traduit lpoque de
lAcheminement vers la parole 24. Cest ainsi que son tudiante Franoise
Dastur entreprit un mmoire de matrise sous sa direction consacr au
dernier Heidegger. Il ma tout de suite dit : Oui, faites votre mmoire
l-dessus. Jai donc traduit les textes de cette priode et il revoyait mes
traductions 25. Ricur est particulirement sensible deux moments de
la pense de Heidegger : celui de lanalytique existentiale et celui du
langage. En revanche, sa rflexion sur la mythologie, lenracinement ne
correspond pas du tout aux proccupations de Ricur. Dans son sminaire
21. Ibid., p. 196.
22. Paul RICUR, La Mtaphore vive, Le Seuil, Paris, 1975, p. 397.
23. Paul RICUR, Un entretien avec Paul Ricur, Soi-mme comme un autre , propos
recueillis par Gwendoline JARCZYK, Rue Descartes, Collge international de philosophie, Des
Grecs, Albin Michel, Paris, 1991, p. 234.
24. Martin HEIDEGGER, Acheminement vers la parole (1959), Gallimard, Paris, 1976.
25. Franoise Dastur, entretien avec lauteur.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 91
UN HEIDEGGERIANISME BIEN TEMPR
de phnomnologie, il consacre une anne entire ltude de la temporalit chez Heidegger.
Ricur dcide mme de participer avec son groupe de phnomnologues de la rue Parmentier un colloque organis par un de ses proches,
lIrlandais Richard Kearney, sur Heidegger et la question de Dieu 26.
Il ny avait quun Irlandais pour organiser une telle rencontre Paris et
runir autour dune mme table les fidles des fidles de Heidegger,
comme Jean Beaufret, Franois Fdier ou Franois Vezin aux cts de
Levinas, Ricur, Marion, Breton, Greisch... La note introductive de
Ricur nlude pas les problmes et repose simplement la question de
Cerisy : Pourquoi rflchir seulement sur Hlderlin et non pas sur les
Psaumes, sur Jrmie ? Cest l ma question 27. Richard Kearney
stonne mme de cette entre en matire provocatrice : Ce qui ma
dailleurs frapp chez Ricur car il est toujours trs gentil, mdiateur,
conciliateur, mais quand il fait une critique, il peut tre abrupt 28. Dans
cette confrontation qui se droule en 1980 au Collge irlandais, la tension
est vive entre les participants. Fdier commence son intervention par un
Aujourdhui, nous sommes le jour de la Saint-Jean, pendant que Levinas
commente dans son coin : Comment ose-t-il citer un saint ? Quest-ce
quil connat la Saint-Jean, lui 29 ? Beaufret, de son ct, rappelle la
fameuse sance de Cerisy du 4 septembre 1955 lors du dialogue de sourds
entre Heidegger et Ricur. Il reproche celui-ci de vouloir dissocier dans
La Mtaphore vive la mtaphysique et la philosophie occidentale, que
Heidegger considre comme strictement synonymes selon lacception
quen donnent les Grecs. Fumant cigarette sur cigarette la tribune, il
finit par indisposer Ricur qui passe un petit mot Kearney : Peux-tu
demander Beaufret de sarrter de fumer, il me tue ! peine le mot de
Ricur est-il communiqu Beaufret que celui-ci replonge dans son
paquet pour allumer une nouvelle cigarette. Le climat tait ce point
tendu que Levinas, en gnral trs affable, refuse de prter son exemplaire
de lAncien Testament Stanislas Breton, qui voulait en lire un passage :
Cest un texte sacr ! rtorque-t-il pour conduire le pre Breton,
subitement transform en paen. Deux lignes sopposaient frontalement :
celle selon laquelle la question de Dieu dpend de ltre, rassemblant les
disciples de Heidegger, et celle qui voit la question de Dieu comme irrductible celle de ltre, runissant tous les autres, dont Levinas et
Ricur. Dans le prolongement de ce colloque, Jean-Luc Marion, qui par-
26. Richard KEARNEY et Joseph Stephen OLEARY (dir.), Heidegger et la question de Dieu,
Grasset, Paris, 1980.
27. Paul RICUR, ibid., p. 17.
28. Richard Kearney, entretien avec lauteur.
29. Ibid.
VI.4/VII.1
31-03-2008
92
15:50
Page 92
PAUL RICUR
tage le point de vue de Ricur, publie un ouvrage qui va dans ce sens :
Parce que Dieu ne relve pas de ltre, il nous advient en et comme
un don 30.
Lorsque Victor Farias publie son livre sur Heidegger en 1987 31, vulgarisant auprs dun large public le dossier dj connu mais peu accessible
sur lengagement nazi de Heidegger, Ricur reste trs discret. Sil ne participe pas au dbat autour de louvrage, cest quil prsume une entreprise
de discrdit jete sur les philosophes franais : Le livre de Farias me
semble avoir t une opration antifranaise. Cest un ouvrage qui a t
cibl [...]. Ce devait tre la drision gnrale de toute la profession philosophique [...]. Il convient donc de ne pas se laisser entraner dans cette
polmique 32. Tout en restant dans lexpectative, Ricur est confort
dans la pertinence de sa question sur les lacunes par les silences de
Heidegger, notamment labsence totale de rfrence la tradition judochrtienne, qui peuvent faire place des paroles qui appartiennent au
cycle meurtrier 33 . Linterrogation sur les lignes de moindre rsistance
de luvre de Heidegger, et notamment sa neutralisation des dimensions
morales, doit inciter une distance vigilante et laisse en suspens lnigme qui
fait cohabiter une certaine mdiocrit et une gnialit philosophique 34 .
Confirm par ce quil apprend sur le comportement inadmissible de
Heidegger vis--vis de Husserl, Ricur ressent un dgot profond,
comme la plupart des philosophes familiers de la pense de Heidegger, et
connat un raidissement vident qui lui inspire un certain remords
lgard dun Jaspers un peu oubli. Mais en mme temps, il sen dfend
pour ne pas confondre le plan de luvre et la biographie de son auteur.
En pleine polmique autour du livre de Farias, une runion se tient
Esprit. Olivier Mongin demande Marc Richir de prparer une intervention pour introduire le dbat. Richir se fait trs acerbe, intitulant son
expos, qui deviendra un article, Dun ton mgalomaniaque en philosophie : Je critiquais donc Heidegger y compris dans sa forme de pense
et jai senti chez Ricur une grande rticence lgard dune distance trop
marque par rapport Heidegger 35. Ricur refuse dentrer dans les
termes de la polmique autour du livre de Farias, mais sa mfiance est
cependant grandissante face la violence hyperbolique du langage et de la
pense heideggeriens, dans leur prtention dgager des structures
ultimes ; elle se double malgr tout dune profonde admiration pour un
philosophe qui aura accompagn tout son cheminement personnel.
30. Jean-Luc MARION, Dieu sans ltre, Fayard, Paris, 1982, p. 12.
31. Victor FARIAS, Heidegger et le nazisme, Verdier, Paris, 1987.
32. Paul RICUR, entretien avec Gwendoline JARCZYK, rue Descartes, op. cit., p. 236.
33. Ibid., p. 235.
34. Ibid.
35. Marc Richir, entretien avec lauteur.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 93
A.VII.1
Leuven-Paris : les archives Husserl
En 1961, aprs la mort de Maurice Merleau-Ponty et celle de Gaston
Berger, Ricur devient directeur du centre Husserl de la Sorbonne. Il lui
revient la responsabilit de conserver et de faire fructifier intellectuellement lnorme fonds Husserl qui a dj toute une histoire particulirement rocambolesque.
lorigine de ce fonds darchives se trouve la passion dun pre franciscain flamand, le pre Van Breda, dont le nom voque le temps o les
Provinces-Unies taient sous la tutelle de lEspagne. Son temprament
fougueux et son catholicisme confirment cette origine lointaine. Van
Breda prpare une thse de doctorat dans les annes trente lInstitut de
philosophie de Leuven (Louvain), dirig alors par Mgr Lon Nol. Si
bien quun jour est venu un collgue franais qui nous a demand :
comment va le pre Nol 1 ? Or, le pre Nol a t un des premiers
avoir mesur limportance de Husserl, ds la publication des Recherches
logiques. Il a conseill Van Breda de faire un travail sur Husserl ax sur
la notion fondamentale de rduction.
Van Breda se rend donc Fribourg pour voir Husserl en 1936 et revient
en 1937. Victime des mesures nazies antijuives, Husserl est alors contraint
darrter son enseignement (Husserl nest pas juif, mais un de ses grandsparents est juif). Il est radi en mars 1936 du corps professoral et, lorsque
Van Breda revient en 1938 Fribourg, Husserl est mort. Son pouse craint
que lon vienne brler ses manuscrits. Or la plus grande part de son uvre
nest pas publie et reprsente une norme somme de manuscrits de quarante mille pages !
1. Jean Ladrire, entretien avec lauteur.
VI.4/VII.1
94
31-03-2008
15:50
Page 94
PAUL RICUR
Van Breda propose madame Husserl de les faire sortir de lAllemagne
nazifie. Il va trouver son ambassade, celle de Belgique Berlin, pour
exposer laffaire et demander sil est possible de faire passer les manuscrits
par valise diplomatique. Les responsables de lambassade lui donnent leur
accord la condition quon les leur apporte Berlin. Et voil ltonnant
pre franciscain les transportant lui-mme de Fribourg Berlin, valise par
valise, dans la plus grande discrtion, entreposant sur sa route ses colis
dans divers couvents tapes. Une fois les documents rassembls lambassade de Belgique, ils sont achemins Leuven. Madame Husserl confie
aussi Van Breda la bibliothque de son mari, car elle a lintention de
quitter lAllemagne et de rejoindre ses deux fils aux tats-Unis. Une fois
en scurit Leuven, le travail de transcription des manuscrits commence
sous limpulsion de Van Breda, qui recrute deux philosophes allemands,
anciens lves de Husserl, Eugen Fink 2 et Ludwig Landgrebe 3.
De son ct, madame Husserl envoie tous ses effets personnels
Anvers pour prendre le bateau qui doit la conduire en Amrique. Avant
de partir, elle passe par Leuven pour voir le pre Van Breda. Linvasion du
10 mai 1940 la surprend et la bloque au cur de la Belgique. Sans courir
de rel danger, elle est toutefois mise labri par Van Breda, qui la loge
dans un couvent de religieuses, prs de Leuven : En 1942, je me rappelle
avoir assist la soutenance de thse de Van Breda. Au premier rang, il y
avait madame Husserl. Ctait fantastique 4. En 1943, Van Breda
apprend que les bombardements allis sur Anvers ont touch le hangar o
sont entreposs les effets personnels de madame Husserl. Il se rend sur
place et trouve en effet des caisses ventres, ramne ce quil peut et sauve
ainsi une bonne partie de la correspondance de Husserl ainsi que son
buste en bronze et lurne contenant les cendres du philosophe. Revenant
Leuven, il nose sen ouvrir madame Husserl : Entre 1943 et la fin de
la guerre, il a donc gard dans ce couvent les cendres de Husserl 5. Une
fois la guerre finie, au printemps 1945, lpouse de Husserl a pu prendre
le premier bateau, sudois, acceptant des passagers civils. En remerciement,
elle laisse Van Breda le buste en bronze de Husserl, aujourdhui plac
lentre des archives Husserl de lInstitut de philosophie de Leuven, ainsi
que certains de ses meubles : son bureau de travail, son fauteuil. Van
Breda a ainsi pu reconstituer lunivers de travail de Husserl Leuven.
2. Eugen FINK, De la phnomnologie, trad. fran. par Didier Franck, Minuit, Paris, 1974 ;
Proximit et Distance : essais et confrences phnomnologiques, Millon, Grenoble, 1994 ;
Sixime Mditation cartsienne, Millon, Grenoble, 1994.
3. Ludwig LANDGREBE, The Phenomenology of Edmund Husserl : Six Essays, Cornell University Press, Ithaca, Londres, 1981.
4. Jean Ladrire, entretien avec lauteur.
5. Ibid.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 95
LEUVEN-PARIS : LES ARCHIVES HUSSERL
95
Lorsquil a commenc un sminaire dtudes sur les textes de Husserl en
1946, on tait une vingtaine. Latmosphre tait particulire, avec un ct
culte husserlien. Van Breda tait assis dans le fauteuil de Husserl, son
bureau, avec son cendrier, entour de sa bibliothque 6. Entre-temps,
Fink et Landgrebe avaient t mobiliss dans larme allemande et
nomms dans des universits en Allemagne aprs-guerre. Pendant la
guerre, cest un philosophe juif allemand, Stephan Strasser, qui, rfugi en
Belgique, est embauch par Van Breda pour travailler aux transcriptions.
Lui, sa femme et ses enfants sont cachs par le pre franciscain dans un
appartement do ils ne sortaient jamais, Van Breda venant leur apporter
le ravitaillement. Aprs la guerre, Strasser est nomm en Hollande luniversit de Nimgue. Le couple Walter et Marlie Biemel, puis Rudolf
Boehm poursuivront luvre de transcription, alors que dbute un travail
de rflexion collectif au sminaire mis en place par Van Breda, o se
retrouvent ceux qui sont chargs de la publication des Husserliana, mais
aussi Alphonse de Waelhens, qui a t le premier crire sur Heidegger,
Jean Ladrire et quelques autres.
Maurice Merleau-Ponty, alors caman lENS, entre en contact avec le
pre Van Breda et dsire consulter le dactylogramme dIdeen II dans le
cadre de la prparation de sa Phnomnologie de la perception. Il se rend
donc Leuven ds avril 1939. Entre 1944 et 1948, un nombre important
de manuscrits transcrits sont dposs lENS : Le pre Van Breda avait
acquis la conviction qu Paris un groupe de jeunes philosophes, constitu pour lessentiel de normaliens, sintressait srieusement Husserl 7.
En effet, un petit comit parisien vient de se constituer, compos entre
autres de Maurice Merleau-Ponty, de Trn Duc Thao et de Jean Hyppolyte, pour obtenir la prise en charge des manuscrits de Leuven Paris.
Mais mile Brhier, directeur des tudes philosophiques la Sorbonne,
crit Van Breda en 1946 une lettre qui rvle le peu dintrt des responsables universitaires franais pour la question : Je me demande sil
est bien utile que nous ayons Paris une copie de tout ou partie des
manuscrits de Husserl 8. Les chercheurs franais doivent donc faire le
voyage. Merleau-Ponty et Trn Duc Thao effectuent deux sjours
Leuven en 1944. Ricur sy rend en 1946 et 1947, alors quil enseigne au
Chambon-sur-Lignon. Jean Nabert donne son accord pour accueillir la
6. Ibid.
7. Jean-Franois COURTINE, Fondation et proto-fondation des archives Husserl Paris ,
Husserl, collectif sous la dir. dliane ESCOUBAS et de Marc RICHIR, Millon, Grenoble, 1989,
p. 201.
8. mile Brhier, cit par Jean-Franois COURTINE, ibid., p. 202.
VI.4/VII.1
96
31-03-2008
15:50
Page 96
PAUL RICUR
Sorbonne les manuscrits de Husserl, mais au dernier moment cest Le
Senne qui refuse de signer le contrat. La consultation des archives
Leuven permet Ricur dcrire sa premire grande analyse de Husserl
en 1949, aprs sa traduction en captivit des Ideen I 9.
Au milieu des annes cinquante, Ricur reoit Strasbourg la visite de
Van Breda, qui vient de lancer une nouvelle collection, Phenomenologica , elle doit tre le pendant de ldition critique des manuscrits de
Husserl, les Husserliana. Van Breda est accompagn du jeune philosophe
quil a nomm secrtaire de rdaction, Jacques Taminiaux, qui fait pour la
premire fois la rencontre de Ricur au milieu de sa famille. Il sollicite sa
participation au comit de rdaction de cette nouvelle collection 10 :
Ricur a jou un rle dterminant au dbut de la collection parce quil
tait un lecteur trs critique des manuscrits quon lui proposait. Il a t un
des lments moteurs de la collection 11. Au moment de la publication
du premier ouvrage de Phenomenologica , celui dEugen Fink 12, la
situation en France change enfin grce au phnomnologue Gaston Berger,
qui a soutenu sa thse en 1942 sur le cogito chez Husserl et qui est devenu
directeur de lenseignement suprieur et des tudes philosophiques en
1957. Avec la contribution de Maurice Merleau-Ponty, de Jean Hyppolite,
de Jean Wahl et de Paul Ricur, il parvient en mai 1958 louverture officielle dun centre Husserl la bibliothque de la Sorbonne, o le dpt
des manuscrits peut cette fois se faire.
Larrive de Ricur la Sorbonne en 1957 facilite les choses. En 1961,
il devient directeur de ce centre, qui nest encore quun lieu de consultation
o lon peut avoir accs aux archives Husserl Paris. Une seconde phase
dbute en 1967 lorsque se constitue un centre de recherche associ au
CNRS et fonctionnant avec Nanterre, o se trouve Ricur. partir de
cette date, un vrai laboratoire de phnomnologie se met en place avec un
sminaire rgulier dirig par Ricur. Ce laboratoire dispose dun petit
local encore bien modeste, qui en dit long sur la manire dont on considre en France la phnomnologie dans les annes structuralistes. Pour
atteindre ce local, il faut descendre dans les sous-sols, dans les bas-fonds
de la Sorbonne, lInstitut dtudes indiennes, do le surnom dIndiens
que vont avoir les chercheurs du laboratoire. L, ils se runissent dans une
9. Paul RICUR, Husserl et le sens de lhistoire , Revue de mtaphysique et de morale,
n 54, 1949, p. 280-316.
10. Collection Phenomenologica , comit de rdaction de la collection : H. L. Van Breda
(Louvain). Membres : M. Farber (Buffalo), E. Fink (Fribourg), J. Hyppolite (Paris), L. Landgrebe
(Cologne), M. Merleau-Ponty (Paris), P. Ricur (Paris), K. H. Volkmann-Schluck (Cologne),
J. Wahl (Paris). Secrtaire : Jacques Taminiaux.
11. Jacques Taminiaux, entretien avec lauteur.
12. Eugen FINK, Sein Wahrheit Welt, Martinus Nijhoff, La Haye, 1988.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 97
LEUVEN-PARIS : LES ARCHIVES HUSSERL
97
salle ronde au-dessus de laquelle les pigeons font leurs fientes ! Venue voir
Ricur pour lui parler de sa thse en 1969, Franoise Dastur sest retrouve enferme avec lui dans ces sous-sols un vendredi soir, avec le risque de
rester prisonniers des Indiens pour le week-end. Sans tlphone, il a
fallu crier, taper et finalement casser une porte vitre : Cest une des raisons du dmnagement rue Parmentier. Il ntait plus possible de faire un
sminaire dans ces bas-fonds o lon risquait dtre engloutis 13.
En 1971, le laboratoire se dplace pour des locaux plus spacieux au
Centre dhistoire des sciences et des doctrines, dans des locaux appartenant au CNRS, rue Parmentier. Dans la mesure o Ricur est absent une
bonne partie de lanne du fait de son enseignement Chicago, il dlgue
lessentiel de ses pouvoirs de direction une matresse femme, Dorian
Tiffeneau, recrute au CNRS en 1956. Jusqu sa retraite, elle va se consacrer au laboratoire, usant de la bipartition du temps de Ricur pour prononcer sa guise de multiples interdictions daccs aux archives. Si elle
bnficie jusquau bout de la protection et de la confiance de Ricur, elle
a tout pouvoir pour inclure ou exclure les chercheurs. Ses choix plus ou
moins arbitraires loignent certains dentre eux du laboratoire et de
Ricur, sans que ce dernier ne sen rende compte, par oukases non ngociables. Il en sera ainsi, entre autres, de Jacques Garelli ou de Jean-Grard
Rossi. Le plus souvent, les participants du sminaire ont d dfendre leurs
liens privilgis avec Ricur en dfiant lautorit de Dorian Tiffeneau, ce
sera le cas notamment, avec passion, de la philosophe dorigine brsilienne
Maria Villela-Petit, qui se voyait interdire lemprunt douvrages au laboratoire sous prtexte quavec son salaire de chercheur elle pouvait se les
acheter. La victime expiatoire de cette gestion singulire aura surtout t
Mireille Delbraccio. Ancienne tudiante de philosophie Nanterre partir de 1968-1969, ayant chou lagrgation, engage dans un travail de
recherche avec Jean-Toussaint Desanti sur Logique formelle et logique
transcendantale, de Husserl, elle est embauche par le CNRS pour des
vacations dans le laboratoire de phnomnologie en 1976. Stagiaire pendant un an et demi pour un poste de documentaliste adjointe mitemps , elle doit travailler au point de sacrifier totalement ses recherches
personnelles, sans horaires fixes, assurant trente-cinq heures de prsence
hebdomadaire au lieu des vingt heures dues pour la modique somme de
1 200 francs par mois. De plus, Mireille Delbraccio, qui faisait le plus gros
du travail de prparation du sminaire et aidait linsertion des nombreux
chercheurs trangers, navait pas le droit dassister au sminaire, sur ordre
de Dorian Tiffeneau !
13. Franoise Dastur, entretien avec lauteur.
VI.4/VII.1
31-03-2008
98
15:50
Page 98
PAUL RICUR
En juin 1977 se tient le dernier sminaire de lanne comme tous les ans
Chtenay, aux Murs blancs. Dans le beau parc o on a install les tables,
il rgne une atmosphre festive : Simone et Paul accueillaient les gens.
Ricur, qui tait avec sa femme, sest approch de moi et ma dit :
Mireille, je suis trs content parce que enfin ce stage est termin. Or,
Dorian Tiffeneau venait de massurer deux jours auparavant quon ne me
gardait pas. Jai dit Paul : coutez, je suis un peu gne et je nosais vous
en parler, mais Dorian ma dit que vous ne me gardiez pas. Il est all
chercher Dorian qui a affirm que je navais pas compris ce quelle avait
voulu dire 14. Il aura fallu cette confrontation pour lever les malentendus
et les usurpations multiples de pouvoir sous-jacentes ce tandem pour le
moins tonnant, de personnalits aussi contrastes : Ricur-Tiffeneau.
La bipartition des archives Husserl entre Paris et Leuven se double
partir de 1968 dune autre sparation, linguistique celle-l, entre Flamands
et Wallons. Jacques Taminiaux obtient de Van Breda un accord pour avoir
un double de tous les manuscrits de Husserl. La maison mre reste
Leuven, lInstitut de philosophie, mais les francophones doivent partir
sinstaller entre 1969 et 1975 Louvain-la-Neuve, o sinstalle un Centre
dtudes phnomnologiques (le CEP) qui fonctionne en troite collaboration avec Leuven. Dans lancien bureau de Van Breda, dans lequel
logent la bibliothque et les meubles de Husserl, cest Samuel Ijsseleg,
dorigine hollandaise, qui dirige depuis 1974 les archives Husserl : Ricur
a jou un rle tout fait important dans ma nomination, parce que je
ntais pas du tout husserlien. Jai fait ma thse sur Heidegger 15. tudiant la philosophie Paris dans les annes 1967-1968, il suivait le cours
et le sminaire de Ricur, bien que davantage sduit par la radicalit de
Derrida et par les thses de Lacan. Il est la tte dun centre dornavant
internationalement reconnu, qui accueille beaucoup de chercheurs trangers, amricains, italiens et franais, plus quallemands.
En 1980, Ricur, qui vient de quitter la codirection de la collection
Lordre philosophique , connat de nouveaux problmes de sant avec
plusieurs alertes cardiaques srieuses. Son mdecin le pousse ralentir son
rythme dactivit et il dcide brutalement dinterrompre ses activits
denseignement Paris. Cette dcision, sans doute mrement rflchie,
semble pourtant prise sur un coup de tte. En novembre 1979, il sapprte
donner son cours dagrgation Nanterre, quittant Chtenay pour une
heure de trajet sous une pluie battante. Lorsquil arrive devant la salle de
cours, il ne trouve quun seul tudiant ! Il lui demande o sont les autres
pour sentendre rpondre quil ne faut pas rver, avec une telle pluie, il est
14. Mireille Delbraccio, entretien avec lauteur.
15. Samuel Ijsseleg, entretien avec lauteur.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 99
LEUVEN-PARIS : LES ARCHIVES HUSSERL
99
prfrable de rester chez soi. Il en est ce point stupfait quil est tout de
suite mont au service administratif et comptable pour connatre les
dmarches suivre afin de prendre une retraite anticipe 16.
Quittant son poste de Nanterre, Ricur doit abandonner aussi le laboratoire de phnomnologie qui en dpend. Se pose alors le problme de sa
succession. Il nest pas question pour lui dtre interventionniste et de
dsigner son successeur. Un certain nombre de ses collgues vont solliciter
Derrida, qui est toujours lENS en tant que caman (rptiteur). Ils parviennent le pousser soutenir au plus vite une thse pour prendre le
poste libr par Ricur : De manire un peu rticente, je me suis laiss
convaincre et jai donc soutenu une thse sur travaux dans les plus brefs
dlais 17. La soutenance a lieu la Sorbonne avec un jury compos de
Jean-Toussaint Desanti, Emmanuel Levinas et Pierre Aubenque. Dans
lt qui suit sa soutenance, Derrida pose sa candidature, mais les soutiens
dont il dispose Nanterre finissent par indisposer la majorit du dpartement de philosophie, qui a limpression quon veut lui forcer la main. Une
runion lectorale est organise sur le campus, en la prsence du
candidat Derrida. On runissait les gens pour leur dire : je pourrais tre
candidat, mais jhsite encore un peu. Vous tes tout de mme des gens
respectables, donc vous tes dignes de moi. Cela ma mis en colre 18. Si
bien quau moment du dcompte des voix, lheureux lu nest pas Derrida,
mais le marxiste Georges Labica. Il semble aussi quil y ait eu contre
Derrida des pressions dAlice Saunier Seit, qui ne voulait aucun prix
quil occupe ce poste aprs les tats gnraux de la philosophie, quil
venait de runir en 1979 et qui mettaient en cause frontalement linstitution et notamment linspection.
Voil donc Labica, spcialiste de Hegel et de Marx, hritier du laboratoire de phnomnologie, alors quil na jamais assist la moindre sance
du sminaire de la rue Parmentier. La partie est dautant plus dlicate que
le caractre fdrateur et cumnique de Ricur a permis de faire fonctionner ensemble des personnalits aux orientations trs diffrentes, et
souvent mme opposes. Personne ne peut vraiment le remplacer dans un
rle o lquation personnelle compte avant tout. Georges Labica est vite
dans une impasse totale : Jai hrit de Parmentier, que jai gr tant bien
que mal pendant deux ou trois ans pour constater limpossibilit de le
grer 19.
Labica, ne parvenant pas donner au laboratoire une existence collective soude autour dune communaut de pense, dcide de convoquer
16. Jean Greisch, entretien avec lauteur.
17. Jacques Derrida, entretien avec lauteur.
18. Jacques Merleau-Ponty, entretien avec lauteur.
19. Georges Labica, entretien avec lauteur.
VI.4/VII.1
31-03-2008
100
15:50
Page 100
PAUL RICUR
tous les membres du sminaire pour une grande runion plnire en 1983.
Il propose de constituer deux structures de recherche : dun ct, la phnomnologie et, de lautre, un ple de philosophie politique. Le comit
national accepte de crer deux units de recherche associes (URA) pour
remplacer le laboratoire de Ricur. Cest ainsi que ce dernier sest scind
en deux. Dune part, lunit de recherche sous la direction de Labica,
toujours lie Nanterre, reste rue Parmentier et prend le nom de Philosophie politique, conomique et sociale . Elle regroupe les chercheurs
marxistes de lquipe Ricur comme Jacques Texier, Solange MercierJosa ou Karis Kanepoulos, ainsi que Mireille Delbraccio. De lautre,
lunit de recherche phnomnologique conserve les archives Husserl et
se retrouve sous la direction dHenri Birault, lie Paris-IV-Sorbonne,
entranant derrire lui lessentiel du laboratoire de Ricur. Les annes
Birault, entre 1983 et 1985, ne permettent pas vraiment de retrouver un
dynamisme propre lquipe, dautant que Birault ne se sent pas vraiment
impliqu par cette responsabilit. Par ailleurs, son engagement droite
cest un ancien ptainiste et son penchant antismite sont loin de crer
lunanimit et contribuent faire de ces annes une priode de flottement.
Lorsque Birault prend sa retraite, cest Jean-Franois Courtine, professeur Paris-X-Nanterre et lENS, qui est sollicit par lquipe pour le
remplacer 20.
Celui-ci accepte, condition que le centre de phnomnologie soit
rattach une vritable institution denseignement et de recherche. Sengage alors un processus de dsassociation avec Paris-IV-Sorbonne et de
transfert du centre avec ses archives vers lENS, Ulm. La cheville
ouvrire de ce transfert est Didier Franck. Nomm caman Ulm en 1984,
il succde ainsi Derrida, qui obtient un poste lEHESS. Henri Birault
ne sintressant pas vraiment au sort des archives, Franck pense que lENS
est leur place naturelle. Lorsque la succession est ouverte, Jean-Franois
est venu me voir un jour en me disant : On fait venir les archives lENS,
je prends la direction et tu seras directeur adjoint 21. Franck en parle
des collgues, Bernard Pautrat, Denis Kambouchner, qui ragissent plutt favorablement. Mais ladministrateur de la partie littraire de lENS,
Marcel Roncayolo, nen voit pas bien lintrt et ne veut pas sengager. Du
ct de la direction scientifique, Franck sadresse au mathmaticien
Georges Poitou, quil parvient convaincre. Avec les accords de lENS,
du CNRS et laide de Rudolf Bernet, de Leuven, le transfert donne un
second souffle au laboratoire de phnomnologie : Ricur en a t trs
content, je crois. Il vient de temps en temps emprunter des livres, consul-
20. Jean-Franois COURTINE, Suarez et le Systme de la mtaphysique, PUF, Paris, 1990.
21. Didier Franck, entretien avec lauteur.
VI.4/VII.1
31-03-2008
15:50
Page 101
LEUVEN-PARIS : LES ARCHIVES HUSSERL
101
ter les manuscrits. On la invit plusieurs fois donner des confrences.
Cest une solution qui lui convenait, mais il est rest trs discret pour ne
pas peser sur une dcision. Il na jamais essay de garder le contrle 22.
La poursuite de la recherche sur les textes de Husserl, la progression
dans la transcription des Husserliana permettent aujourdhui une lecture
quelque peu rectifie de son uvre par rapport celle de la premire
gnration phnomnologique, celle justement de Ricur, de MerleauPonty, de Trn Duc Thao, qui sappuyaient pour lessentiel sur son uvre
publie. Les interprtations plus rcentes ralisent mieux quel point il
sagit dune uvre profuse, porte par une hsitation intrieure, moins
enferme dans une gologie quon la cru, cherchant au contraire rinterprter tout le langage du transcendantal dans le langage du Lebenswelt
(du monde de la vie ). Lide dune greffe hermneutique rendue ncessaire par rapport un programme husserlien encore prisonnier du cogito
cartsien en est donc quelque peu relativise pour cette nouvelle gnration de phnomnologues : Husserl lui-mme tait dj trs attentif
tout ce qui est de lordre de linterprtation qui structure lintuition et la
perception 23. Limage dun Husserl privilgiant la transparence, limmdiatet, la voie courte, serait donc une interprtation lgitime au regard de
ses publications canoniques, mais rviser en fonction de ce quapporte la
lecture des manuscrits. Cela nenlve rien la validit des critiques
quadresse Ricur Husserl. Elles restent fondes car il y a en effet
quelque chose chez Husserl dun peu hyperbolique dans cette affirmation
de la puissance de la structure du cogito 24 . Mais il faut tenir compte dun
effet gnrationnel qui vient du fait que son entre dans Husserl a t
mdiatise par les grands textes officiels comme Ideen I, traduit par lui,
ainsi que les Recherches logiques, les Mditations cartsiennes ou encore
Logique formelle et transcendantale, textes dans lesquels Husserl a le
profond souci de dmontrer aux autorits universitaires le caractre
scientifique de la phnomnologie. Husserl lui-mme ntait qu moiti
satisfait de ces ouvrages publics, quil considrait toujours comme trop
dogmatiques. La comparaison avec les trente volumes des Husserliana
engage aujourdhui les spcialistes mieux mesurer quel point il tait
conscient de tout ce quil y avait de problmatique dans sa dfense du rle
de lgot transcendantale : Luvre de Husserl est une uvre en archipels. On nen a vu pendant toute une priode que quelques grands lots,
sans voir quil y avait des lots plus petits, et surtout des espces de continents enfouis 25.
22. Jean-Franois Courtine, entretien avec lauteur.
23. Ibid.
24. Marc Richir, entretien avec lauteur.
25. Ibid.
VI.4/VII.1
102
31-03-2008
15:50
Page 102
PAUL RICUR
Luvre de Husserl est donc essentiellement polyphonique, et lgologie qui ressort de ses ouvrages canoniques nest quun des linaments
possibles des virtualits qui taient les siennes. La publication par Iso
Kern en 1973 des manuscrits des annes trente 26 permet de mieux situer
ce qui chappe lgologie dans la dernire Mditation cartsienne, ce qui
la porte au contraire vers une thorie de lempathie, de lintersubjectivit,
revendique en pointills et dveloppe dans ces manuscrits : Iso Kern a
t invit au sminaire de Ricur pour nous prsenter son dition 27. On
saperoit que ce thme de lintersubjectivit commence trs tt, ds les
annes 1905-1906. Il remonte aux origines mmes de la phnomnologie
et rend possible, selon Jean-Luc Petit, le lien avec la philosophie analytique sans passer par lobjection heideggerienne 28, et permet dviter ainsi
laporie de la ngation du sujet, tout en rejoignant le rapport la communaut et lhistoire. Il apparat en effet que Husserl a labor une thorie
de la communautarisation, du devenir de la communaut ouvrant sur un
devenir-monde entendu comme horizon de comprhension.
Si ces potentialits de la philosophie husserlienne nont donc pas t
retenues par Ricur pour des raisons gnrationnelles, cest aussi parce
quil a fait un autre choix : celui de suivre une voie hermneutique, plus en
phase avec le primat accord la textualit et avec ses lectures bibliques.
Mais il y a toute une archologie du sens chez Husserl, qui ntait pas du
tout crisp, comme on la dit, sur une sorte de cogito conscient 29 . Les
manuscrits rvlent mme son intrt pour une thorie de lintentionnalit pulsionnelle faisant partie intgrante du dveloppement du comprendre, selon une approche non fondationnelle, mais au contraire
variationnelle : Le sens dans sa position normale ne serait quun indice
de variation. videmment, Ricur na pas emprunt cette voie-l 30.
Le laboratoire de phnomnologie, sous la direction de Ricur, trouvait bien sa source dinspiration chez Husserl, mais sans se cantonner
professer un strict husserlianisme. Les annes soixante-dix sont celles du
dtour analytique, aprs celui de la greffe hermneutique. Ces orientations, toujours nouvelles, correspondent dailleurs bien la volont de
Ricur de ne jamais sarrter, de ne jamais se laisser enfermer dans le rle
dun spcialiste dune priode de lhistoire de la philosophie, ft-elle
majeure.
26. Iso KERN, Edmund Husserl, Zur Phnomenologie. Dern Intersubjektivitt Dritter Teil
1929-1935, Den Haag Martinus Nijhoff, Katholieke Universiteit te Leuven, 1973.
27. Jean-Luc Petit, entretien avec lauteur.
28. Jean-Luc PETIT, Solipsisme et Intersubjectivit. Quinze leons sur Husserl et Wittgenstein,
Cerf, Paris, 1996.
29. Jean-Luc Petit, entretien avec lauteur.
30. Ibid.
VIII.1
31-03-2008
15:51
Page 103
A.VIII.1
Temps et Rcit en dbat
La conjonction du succs que Ricur connat sur le continent amricain
et du dclin du paradigme structuraliste au dbut des annes quatre-vingt
va contribuer au retour de Ricur sur la scne intellectuelle franaise,
dautant que Temps et Rcit, vaste trilogie sur lhistoricit, est une vritable somme philosophique. Au mme moment, Histoire et Vrit reoit
le prix Hegel 1985. Sur tous les plans, le nouvel ouvrage de Ricur
connat un cho considrable ds la publication du premier tome en 1983.
Il trouve immdiatement un lectorat consquent puisque, tir 5 000 exemplaires, quelque 2 500 sont vendus dans les quatre premiers mois et ce premier tome est rimprim ds 1986. Cet ouvrage constitue une rfrence
tout fait fondamentale : Vous avez plus que rempli votre contrat avec
le lecteur et vous venez dsormais, dans la pense du temps, la suite
incontournable de Husserl et de Heidegger ; incontournable : je veux dire
quon ne pourra vous contourner 1. Lorsque le Collge international de
philosophie annonce en 1983 une confrence de Ricur sur le thme Le
temps racont , loccasion de la sortie du premier tome de Temps et
Rcit, ce sont plus de cinq cents personnes qui se pressent pour lentendre
sur le site de la montagne Sainte-Genevive : Jy suis all. Deux cent cinquante personnes ont pu rentrer dans le grand amphithtre et il y en avait
autant dehors devant la porte 2. Le virage est pris, la traverse du dsert
termine et les anathmes jets contre Ricur par les chapelles sectaires
ne font plus dadeptes : Il y avait l le tout-Paris philosophique. Jai vu
Jean-Franois Lyotard lappeler par son prnom et lembrasser, alors quil
1. Franois Wahl, lettre Paul Ricur, 26 avril 1985, archives Le Seuil.
2. Jean Greisch, entretien avec lauteur.
VIII.1
31-03-2008
104
15:51
Page 104
PAUL RICUR
lavait contest Nanterre. Ctait une sorte de triomphe. Il a donn voir
aux intellectuels prsents le bonheur ressenti dune vie consacre au travail. Ctait trs beau et impressionnant 3. Aprs un long dtour, Ricur
renoue avec le succs au dbut des annes quatre-vingt. Il est enfin
reconnu comme celui qui, loin des feux mdiatiques, a simplement poursuivi un travail exigeant qui enfin simpose tous.
La presse, jusque-l bien discrte, fait un large cho Temps et Rcit.
Cette fois, les recensions dpassent, et de loin, les habituels articles pour
spcialistes parus dans les revues de philosophie ou les quelques organes
de presse chrtienne proches de Ricur. Sans attendre la parution du premier tome de la trilogie, prenant rapidement la mesure du phnomne, Le
Monde fait paratre un grand entretien avec Ricur o ce dernier est prsent comme lun des philosophes franais les plus connus aux tatsUnis. Son itinraire est retrac loccasion de lentretien avec Christian
Delacampagne, sous le titre Paul Ricur, philosophe de la mtaphore et
du rcit 4 . Toujours dans Le Monde, cest Danile Sallenave et Michel
Contat qui rendent justice Ricur. Nous avons rencontr ce philosophe qui reste encore trop mconnu en France 5 , ou encore : Le
Collge de France, o lon peut stonner que Paul Ricur nait jamais t
lu 6. Danile Sallenave clbre avec le tome 2 de Temps et Rcit la rconciliation de la littrature et de la philosophie, qui tranche avec les impasses
dans lesquelles on avait enferm jusque-l une expression littraire rduite
une simple superstructure idologique. Linterrogation sur des questions de sens, de sujet, de rfrence et dauteur dans la critique littraire,
dlaisse par le structuralisme, peut, selon Danile Sallenave, grce
Ricur, redevenir fconde, en adoptant sa position darticulation de la
structure et du sens. Lorsque Michel Contat dit Ricur quil sent venir
un moment Ricur , ce dernier lui rpond en souriant avec humour
que ce ne serait quune promotion tardive, lanciennet 7 . Dans Libration, une page entire est consacre la parution du premier tome de
Temps et Rcit sous le titre : Les belles histoires des oncles Paul . Les
deux Paul en question, Paul Ricur et Paul Veyne, sont ainsi rassembls
dans une mme famille par le journaliste Didier Eribon, assimils pour
loccasion comme deux tentatives convergentes 8 ! Le Nouvel Observateur envoie Frdric Ferney Chicago pour un long entretien qui
3. Paul Thibaud, entretien avec lauteur.
4. Paul RICUR, entretien avec Christian DELACAMPAGNE, Le Monde, 1er fvrier 1981.
5. Michel CONTAT, Le Monde, 7 fvrier 1986.
6. Danile SALLENAVE, Le Monde, 21 novembre 1986.
7. Paul RICUR, dialogue avec Michel CONTAT, Le Monde, 7 fvrier 1986.
8. Didier ERIBON, Les belles histoires des oncles Paul , Libration, 9 mars 1983.
VIII.1
31-03-2008
15:51
Page 105
TEMPS ET RCIT EN DBAT
105
devient le document de la semaine 9. Dans Le Quotidien de Paris, aprs
avoir dj rendu compte du premier tome 10, Lucile Laveggi rapproche
avec davantage de pertinence la parution de Temps et Rcit de Ricur et
LOrdre du temps de Krzysztof Pomian 11. Dans La Croix, Jean-Maurice
de Montrmy et Marcel Neusch saluent La synthse Ricur . Paul
Ricur : sans doute lun des plus grands de nos philosophes du XXe sicle.
Srement le plus nglig et le plus occult par la mode et les coles. Depuis
plus de vingt ans son uvre aurait pu tirer bien des philosophes de leurs
ornires. Mais il ny avait pas de terrorisme-Ricur. Bonne raison pour
saluer Temps et Rcit, un grand livre et une date 12. La clture du triptyque donne lieu la publication dune page entire consacre un entretien ralis par Jean-Maurice de Montrmy avec Ricur 13. ces
recensions sajoutent celles du Magazine littraire et de La Quinzaine
littraire. Quant lhebdomadaire protestant Rforme, lui, il ne dcouvre
pas Ricur en 1985 car il a soutenu toutes ses publications depuis le dbut
et cest tout naturellement quil fait paratre de longues et logieuses
recensions 14.
Aprs ces multiples chos viennent les analyses de fond dans les revues
Esprit 15 et tudes 16. Quant Jean Greisch, philosophe proche de Ricur
et chercheur au laboratoire de phnomnologie de la rue Parmentier,
outre son article dans Esprit, il consacre plusieurs tudes la trilogie de
Ricur dans la Revue des sciences philosophiques et thologiques 17. Jean
Greisch souligne le caractre triangulaire de la conversation que mne
Ricur entre historiographie, critique littraire et phnomnologie, et
son caractre indit qui vient contredire la fameuse dichotomie diltheyenne entre lexpliquer et le comprendre. Il plaide ensuite pour une
9. Un philosophe au-dessus de tout soupon , entretien de Paul RICUR avec Frdric
FERNEY, 11 mars 1983.
10. Lucile LAVEGGI, Paul Ricur : le temps mode demploi , Le Quotidien de Paris,
14 juin 1983.
11. Lucile LAVEGGI, Le temps en question , Le Quotidien de Paris, 5 mars 1985.
12. Marcel NEUSCH, Auditeur de la parole ; Jean-Maurice DE MONTRMY, Lhomme et
son nigme , La Croix, 26 mars 1983.
13. Paul Ricur dans son temps , entretien de Paul RICUR avec Jean-Maurice
DE MONTRMY, La Croix, 25 janvier 1986.
14. Martine CHARLOT, Temps et rcit selon Paul Ricur , Rforme, 2 juin 1984 ; ric
BLONDEL, Philosophie du temps et du rcit , Rforme, 5 juillet 1986.
15. Henri-Jacques STIKER, criture et temps , Esprit, janvier 1984, p. 173-179 ; Jean
GREISCH, Penser le rcit , Esprit, mai 1986.
16. Paul VALADIER, tudes, avril 1983.
17. Jean GREISCH, Bulletin de philosophie. De lintrigue lintrication. Quelques tudes
rcentes sur la narrativit , Revue des sciences philosophiques et thologiques, n 68, 1984,
p. 250-264 ; Le temps bifurqu. La refiguration du temps par le rcit et limage-temps du
cinma , ibid., n 70, 1986, p. 419-437.
VIII.1
31-03-2008
106
15:51
Page 106
PAUL RICUR
rencontre de troisime type entre la pense de Ricur et celle de
Deleuze sous le signe de lAnalogue. En fait, cette rencontre a dj eu lieu
dans le croisement qui sinstaure autour de leur lecture respective de
Proust, ce qui ne signifie pas confusion des deux approches dont lune,
celle de Deleuze, est qualifie de chronosmiologie et celle de Ricur
de potique de la figuration temporelle 18 .
Cette rception massive et positive fait nanmoins apparatre de
manire encore plus flagrante une absente de marque, laquelle cette
intervention tait pourtant en partie destine : la corporation historienne.
Installs dans le confort et lautosatisfaction du triomphe public de lcole
des Annales, rebaptise nouvelle histoire , les historiens ne peuvent pas
encore prendre la mesure de la pertinence et de la force dbranlement des
interrogations de Ricur. Celles-ci mettront dautant plus de temps tre
reues que les historiens franais se tiennent en gnral distance des philosophes et de toute forme dpistmologie. Au mieux, ils ont une mthodologie, mais leur tradition les pousse tourner le dos la philosophie
comme la littrature, avec lesquelles ils ont radicalement coup le cordon ombilical pour se poser comme discours scientifique depuis la fin du
XIXe sicle. Cependant, les signes prcurseurs de la crise de lcole des
Annales, de son clatement, sont dj l. Le tournant critique opr en
1988-1989 rendra peu peu possible lappropriation des questionnements
de Ricur 19.
Le dbat qui sengage propos de Temps et Rcit est donc dans un premier moment circonscrit la sphre des philosophes. Il mobilise cependant un franc-tireur tonnant : philosophe, historien, psychanalyste,
jsuite, passeur de frontires, Michel de Certeau est en effet lauteur douvrages qui figurent parmi les meilleurs livres de rflexion sur lhistoire 20.
pistmologue de lhistoire, il est aussi historien part entire ayant
consacr la plus grande part de ses recherches rudites reconstituer la
mystique chrtienne des XVIe et XVIIe sicles 21, mais aussi psychanalyste,
membre de lcole lacanienne et compagnon de route de la nouvelle histoire , collaborant Faire de lhistoire en 1974 pour y dfinir l opration historique 22 . Il est, au contraire de Ricur, li linstitution
historienne et aux historiens de mtier 23. Cest lui qui va participer au
18. Jean GREISCH, Temps bifurqu , art. cit, p. 436.
19. Sur le tournant critique des Annales, voir Christian DELACROIX, La falaise et le rivage.
Histoire du tournant critique , Espaces Temps, n 59-60-61, 1995, p. 86-111.
20. Michel DE CERTEAU, LAbsent de lhistoire, Mame, Paris, 1973 ; Lcriture de lhistoire,
Gallimard, Paris, 1975.
21. Michel DE CERTEAU, La Fable mystique XVIe-XVIIe sicle, Gallimard, Paris, 1982.
22. Michel DE CERTEAU, Lopration historique , Faire de lhistoire, Gallimard, Paris,
1974, t. 1, Nouveaux Problmes, p. 3-41.
23. Michel DE CERTEAU, en collaboration avec Dominique JULIA et Jacques REVEL, Une
politique de la langue. La Rvolution Franaise et les patois, Gallimard, Paris, 1975.
VIII.1
31-03-2008
15:51
Page 107
TEMPS ET RCIT EN DBAT
107
premier grand dbat organis par la revue Confrontations ds la parution
du premier tome de Temps et Rcit. Cest en effet le 2 dcembre 1983 qua
lieu au centre Svres une discussion autour de louvrage de Ricur avec
sa participation et celles de Michel de Certeau, de Jean Greisch et de
Pierre-Jean Labarrire, alors doyen de la facult de philosophie du centre
Svres.
Cette confrontation se situe un moment dlicat car Michel de Certeau
et Ricur sont la fois trs proches (et donc potentiellement concurrents)
dans leurs positions sur lhistoire, par leur appartenance au monde chrtien
ainsi que par leur situation de double reconnaissance franaise et amricaine. Michel de Certeau est alors professeur luniversit de San Diego
et Ricur Chicago. Lautre lment qui contribue donner un tour
crisp au dialogue tient au fait que Michel de Certeau a t davantage de
plain-pied avec lesprit post-soixante-huitard 24 et sest trouv en phase
aussi bien avec le lacanisme quavec les orientations dconstructives de la
nouvelle histoire , alors que Ricur sort juste du purgatoire en 1984.
Lorganisateur de la rencontre, Pierre-Jean Labarrire, ressent vite un
malaise quil navait pas prvu : Jtais entre les deux. Ils se regardaient
en chiens de faence. Javais mal mesur la chose : ils taient un peu en
comptition et chacun tait venu en pensant quil tait au centre et que
lautre tait venu parler de son uvre. Il y a eu l un chass-crois, un quiproquo un peu tragique, mme si le dbat ne sest pas mal pass. Mais il
ny avait pas cette recherche harmonieuse de deux individus suffisamment
assurs et heureux dabonder dans le sens de lautre. Ils taient chacun sur
leurs rticences 25.
Ricur a dj discut les thses sur lhistoire de Michel de Certeau dans
le cadre de son sminaire de la rue Parmentier entre 1975 et 1978. Certains
chercheurs, comme Jacques Colette ou Jean Greisch, participent mme,
nous lavons vu, la fois au sminaire de Ricur et celui de Michel de
Certeau. Or, Ricur manifeste ses rticences lgard de positions qui
alimentent, selon lui, une forme de relativisme historique. Par ailleurs,
une diffrence de perspective oppose lapproche plus intra-textuelle de
Ricur, qui reste dans les limites dune intervention proprement philosophique, mme sil intgre dans son analyse la lecture des travaux des
historiens, alors que de Certeau situe lopration historique comme pratique, lie une institution, avec les pesanteurs et les logiques de celle-ci :
Cette dimension nintresse pas du tout Ricur. Il ny a jamais chez lui
danalyse institutionnelle en tant que ralit corporelle, corporative 26.
24. Michel DE CERTEAU, La Prise de parole, Descle de Brouwer, Paris, 1968.
25. Pierre-Jean Labarrire, entretien avec lauteur.
26. Luce Giard, entretien avec lauteur.
VIII.1
31-03-2008
108
15:51
Page 108
PAUL RICUR
Michel de Certeau se situe, dans son dialogue avec Ricur, comme historien : Mon point de vue sera justement celui de lhistorien, qui nest pas
souvent un objet pour le philosophe 27. Il place son interrogation sur
divers plans. En premier lieu, celui de la manire dont lhistorien se pose
la question du discours historique, et il rappelle ce propos lancrage du
texte dans une institution productrice, avec tous les signes de reconnaissance par une communaut savante, lappareil institutionnel, les titres universitaires qui valident le discours de lhistorien. Cette dimension, absente
de ltude de Ricur, ne se traduit pourtant pas en dsaccord dans la
mesure o de Certeau aboutit par une autre voie une conclusion similaire celle de Ricur, selon laquelle il est vain de rduire lanalyse du discours historique une alternative entre nomologie et narrativisme. En
second lieu, de Certeau se fait lavocat de la nouvelle histoire en rejetant la critique de Ricur, qui y voit une tentative dclipse de lvnement. Il dfend alors lhistoire srielle, considrant que la pertinence des
scansions historiques dpend des sries envisages. Ainsi, le 14 juillet 1789
nest pas pertinent dans une histoire dmographique ou conomique,
alors quil devient fondamental pour une histoire des mentalits. Il prend
acte de lclatement en cours du discours historien et remet ainsi en question, de la mme manire que Foucault, la validit dune histoire totale,
dun temps global. En revanche, propos de la logique propre du rcit, de
Certeau suit la dmonstration et les conclusions de Ricur. Ce dernier
ritre sa distance par rapport toute analyse en termes institutionnels et
entend lui substituer le prsent de la trace. Or, la trace, cest justement
ce qui ne peut pas tre institutionnalis, peut-tre un lment de surprise ;
cest ce qui rsiste 28 . lexception de cette dimension contextuelle lie
linstitution, on saisit beaucoup de points daccord, que ce soit travers
lutilisation par Ricur de la notion psychanalytique daprs-coup propos de la dfinition de ce quest un vnement historique ou encore avec
lemploi par de Certeau de la notion d entrelacs , qui rejoint ce que
signifie Ricur par sa structure de lintrigue en dsquilibre comme figuration la fois concordante et discordante.
Peu de temps aprs ce dbat, en 1985, Michel de Certeau disparat, et
Ricur est prsent la messe denterrement parmi une foule de plus de
mille personnes venues lui rendre un dernier hommage. En ce lundi
matin, Luce Giard se souvient du visage boulevers de Ricur et je me
suis dit que sa prsence tait un geste symbolique fort de sa part, une
faon de matrialiser quil avait mieux compris dans les dernires annes
27. Michel DE CERTEAU, Dbat autour du livre de Paul Ricur Temps et Rcit , Confrontations, 1984, p. 17.
28. Paul RICUR, ibid., p. 26.
VIII.1
31-03-2008
15:51
Page 109
TEMPS ET RCIT EN DBAT
109
le travail de Michel de Certeau 29 . Cette esquisse de dialogue vite interrompue poursuit son cheminement chez Ricur dans ses rflexions plus
rcentes sur les rapports entre la mmoire, lhistoire, loubli, le pardon,
qui prennent en partie appui sur luvre de Michel de Certeau : La tche
de lhistorien nest pas de rpter le trauma, mais de le remettre sa place,
dviter le spectre dont parle Derrida ou ce pass qui ne veut pas passer. De
Certeau lavait vu dans LAbsent de lhistoire. Le statut de lhistorien est
davoir faire avec un absent de son propre discours historique 30.
Un autre front du dbat sest ouvert avec les disciples dHabermas,
Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz 31. Bouchindhomme peroit
dans Temps et Rcit une volution rebours entre les promesses de
lAufklrer, dhomme des Lumires, qui manaient de ses travaux de 1965
et son renoncement celles-ci en 1983-1985 par son adhsion massive aux
thmes heideggeriens : La proximit avec Heidegger dans Temps et Rcit
est vritablement tonnante 32. Selon lui, Ricur ferait retour ses
sources initiales dinspiration et le Temps ne ferait analogiquement que
prendre la place du Mal. Bouchindhomme procde par ailleurs une critique visant disqualifier Ricur au nom de ses convictions religieuses :
Comment, sur un postulat qui ne peut que relever de la foi, Ricur
peut-il esprer convaincre par largumentation 33 ? Dans une critique
tout aussi radicale et qui va dans le mme sens, Rainer Rochlitz repre une
involution entre La Mtaphore vive et Temps et Rcit. Le premier ouvrage
affirmait encore que la pense spculative pouvait seule noncer le sens
ultime des mtaphores potiques, alors que Temps et Rcit se dploie sur
postulat dimpuissance du discours philosophique noncer le rapport de
lhomme au temps : Quest-ce qui peut trancher, dans le conflit des
interprtations ? Quest-ce qui peut mettre un terme la fuite des significations possibles ? Cest, dune part, un sacr et une foi rests intacts en
dpit du travail subversif des penseurs du soupon. Mais cest, dautre
part, la posie 34. Il approuve Ricur dans sa manire de prendre plus au
srieux la confrontation avec les sciences humaines que la tradition hermneutique reprsente par Heidegger et Gadamer, mais la place assigne
la mthode reste drive. Cependant il retrouverait Heidegger dans une
29. Luce Giard, entretien avec lauteur.
30. Paul RICUR, Histoire, mmoire, oubli , Les Revues parles, centre Beaubourg,
24 janvier 1996.
31. Christian BOUCHINDHOMME et RAINER ROCHLITZ, Temps et Rcit de Paul Ricur en
dbat, Cerf, Paris, 1990.
32. Ibid., p. 177.
33. Ibid., p. 181.
34. Ibid., p. 141.
VIII.1
31-03-2008
110
15:51
Page 110
PAUL RICUR
perspective tout aussi irralisante qui tendrait dtemporaliser et tourner
le dos la modernit pour faire prvaloir le contexte pour lessentiel
atemporel de lexistence authentique 35 . Rainer Rochlitz se livre donc l
aussi une critique radicale de Temps et Rcit, quil peroit comme un instrument de dfense de la tradition contre la modernit. Il serait donc la
version franaise de la confrontation allemande entre un Gadamer reprsentant le conservatisme et un Habermas incarnant la poursuite du programme moderne des Lumires.
Dans le mme ouvrage, Ricur apporte sa rponse ces critiques.
Il rectifie lhypothse selon laquelle le ressort essentiel de Temps et Rcit
serait une confrontation, un combat apologtique avec Heidegger, en rappelant que ses premires thmatisations sur le temps lui sont venues de la
confrontation entre les Confessions de saint Augustin et la Potique
dAristote. Il dfinit par ailleurs son champ dinvestigation face la critique danhistorisme qui lui est faite. Cest en effet dans cette zone
transhistorique, intermdiaire entre lanhistorique, o tout demeure sans
pass, et lhistorique, o tout passe sans demeurer, que se meuvent mes
recherches 36 . Quant la suggestion de Bouchindhomme selon laquelle
Ricur verrait dans le Dieu de la Bible la garantie du sens, elle ne fait
quexprimer une tentative tout fait vaine de rechercher chez Ricur une
ontologie capable de constituer une assise solide, un socle fondateur.
Bouchindhomme ne peut en effet rien trouver de tel puisque nous avons
dj vu que lontologie chez Ricur est une ontologie brise, pluraliste,
jamais une terre conquise. Ce dbat avec les partisans dHabermas est trs
significatif du mode de stigmatisation de la pense de Ricur au nom de
ses convictions. Ricur a toujours eu grand soin de bien dlimiter les
divers registres dargumentation. Il rpond ainsi ses dtracteurs : La foi
dans le Dieu de la Bible nappartient pas aux prsupposs de mes investigations philosophiques 37.
Temps et Rcit va creuser un nouveau clivage dans la direction que vont
prendre les tudes phnomnologiques. Deux voies semblent souvrir
avec une tendance valoriser les mdiations, selon la voie longue dfinie
par Ricur au terme de laquelle lidentit est narrative, comme tenant-lieu
de lidentit corporelle. Par ailleurs, une autre tendance de la phnomnologie, plus dans la ligne de Husserl, lcart de la greffe hermneutique,
privilgie des accs plus directs la corporit et une traverse plus intrieure lexprience elle-mme. Outre que le monde du texte a toujours t une proccupation de Ricur, il renvoie son tre propre, sa
35. Christian BOUCHINDHOMME et Rainer ROCHLITZ, ibid., p. 147.
36. Ibid., p. 206.
37. Ibid., p. 211.
VIII.1
31-03-2008
15:51
Page 111
TEMPS ET RCIT EN DBAT
111
singularit de philosophe de lcoute qui fait parler les textes tout en les
polissant, en les recrant lintrieur de son propre chantier de recherche.
Toujours rticent face aux risques de lhyperbole, convaincu du caractre
aportique de toute qute directe, de toute tentative de remonte aux
conditions de constitution ultimes de la temporalit, Ricur privilgie
les mdiations qui donnent accs une temporalit toujours dj constitue, dj-l, et donc ncessairement imparfaite. La voie courte est invitablement barre. Cest la grande leon de la greffe hermneutique depuis
La Symbolique du mal.
VIII.1
31-03-2008
15:51
Page 112
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 113
A.IX.1
Le plus court chemin de soi soi passe aussi
par ltranger
La conscration nationale de Ricur correspond aussi leffet retour
dune reconnaissance dont nous avons voqu le versant amricain et qui
stend peu peu sur tous les continents, et particulirement en Europe.
Enthousiasms par ses orientations, nombreux sont les philosophes qui
contribuent activement la diffusion internationale de ses thses. En
1988, la France qui le clbre ne fait que se mettre au diapason dune
notorit dj fortement assise ltranger. Le caractre doiseau migrateur de Ricur, qui a un besoin vital de voyager, dcouvrir et dialoguer
avec lautre sous toutes les latitudes, accompagne ce mouvement dappropriation en profondeur de ses ouvrages. Sa double ouverture aux deux
grandes traditions, continentale et analytique, aura pour effet de faciliter
louverture de la philosophie franaise un dialogue philosophique international qui passait jusque-l par-dessus lHexagone et se limitait pour
lessentiel un dialogue germano-amricain. Isol dans cette position
dialogique dans les annes soixante, Ricur sera peu peu rejoint : Sil
navait pas fait cela, on aurait t moins arms 1. Des institutions comme
le Collge international de philosophie ou le CREA lui sont donc redevables de cette ouverture et du type de dialogue quil a engag en franctireur. Le sminaire de la rue Parmentier, lieu de passage de nombreux
tudiants trangers, aura t terme un espace privilgi pour le rayonnement des travaux de Ricur. Son engagement dans lInstitut international de philosophie, quil a prsid et qui tient un congrs annuel dans
un pays chaque fois diffrent, aura jou son rle.
1. Jacques Poulain, entretien avec lauteur.
IX.1/IX.2
31-03-2008
114
15:52
Page 114
PAUL RICUR
Le pays de prdilection de Ricur, dj voqu propos des fameux
colloques Castelli, est lItalie. Il sy rendait non seulement chaque anne
en janvier linvitation dEnrico Castelli, retrouvant les plus minents
phnomnologues et hermneutes, mais depuis 1983, il est aussi, au mois
daot, linvit du pape, dans sa rsidence dt de Castel Gandolfo, situe
dans les environs de Rome. Le pape Jean-Paul II sest dit rjoui de
prendre son repas entre le protestant Ricur et le juif Levinas. Karol
Wojtyla, archevque de Cracovie, devenu pape en 1978, a la double
singularit de ntre pas un pape italien (il est le premier pape non italien
depuis 1523) et davoir une solide formation philosophique, qui la
conduit jusqu une soutenance de thse sous la direction de Roman
Ingarden en 1959 sur le systme phnomnologique de Max Scheler :
Il en tira une phnomnologie de la personne humaine, laquelle il
accordait en dignit une place au-dessus des communauts en tous
genres 2. Un Institut des sciences de lhomme (lIWM) se met en place
Vienne, rassemblant des chercheurs des deux cts de lEurope, encore
coupe en 1982 par le rideau de fer. Cet institut est fortement soutenu par
Jean-Paul II, qui y voit un moyen privilgi de renouer avec les rseaux
de lEst comme ple de rsistance au totalitarisme et de revitalisation du
christianisme. Parmi les membres franais de son conseil scientifique,
Ricur est aux cts de Levinas et dEmmanuel Le Roy Ladurie. Tous les
deux ans, des sminaires conclusifs des travaux entrepris sur un thme
pralablement choisi se tiennent Castel Gandolfo. Le premier sminaire,
intitul Limage de lhomme dans la perspective des sciences modernes ,
se tient en 1983 : Le Saint-Pre coute, profondment attentif, la tte
incline... Ce quil dit ne doit pas filtrer hors les murs, en raison du dogme
de linfaillibilit pontificale proclame par Vatican I 3. cette premire
assemble au sommet, Ricur est bien prsent Castel Gandolfo, honorant linvitation papale, mais il est alit et fivreux la suite dun accident
auquel il navait pas prt suffisamment attention : arrivant dune dcade
de Cerisy consacre son ami Greimas, se promenant autour du chteau
une heure tardive de la nuit, il est attir par la musique et la lumire provenant dune cave qui donne sur le foss et dcide daller voir de plus
prs. Il se dirige alors vers lescalier pour descendre, mais ne se rappelant plus quil fallait prendre la rampe gauche et la prenant de lautre
ct, il tombe dans le vide 4 . Il fait une chute de plus de deux mtres
dans le foss ! Il se relve sans salarmer srieusement des douleurs quil
ressent, entre dans les lieux, salue tout le monde et, le lendemain, il intervient comme si de rien ntait et discute savamment avec Greimas de la
2. Marie-Anne LESCOURRET, Emmanuel Levinas, op. cit., p. 294.
3. Ibid., p. 299.
4. Maurice de Gandillac, entretien avec lauteur.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 115
LE PLUS COURT CHEMIN DE SOI SOI
115
pertinence du carr smiotique. Puis il senvole directement pour Castel
Gandolfo o il est attendu par le pape. Cest seulement l quil finit par
scrouler et que lon diagnostique une clavicule casse ! la session suivante, en 1985, il sera question de La crise et le pape, assis sur un banc,
prend consciencieusement des notes.
Rome sest constitu autour de Ricur un petit cercle damis trs
proches qui lentoure dune affection quasi familiale. Sa traductrice
Daniella Iannotta, ainsi que Francesca Guerrero Bruzzi, professeur
la Sapienza o Ricur a eu loccasion denseigner en 1987 sa petite
thique parue dans Soi-mme comme un autre, et la phnomnologue
Angela Ales Bello font partie de cette seconde famille, italienne, de
Ricur. Il est aussi adopt dans un autre haut lieu philosophique de
lItalie : Naples, o Gerardo Marotta a fond en 1975 lInstituto Italiano
per gli Studi filosofici (Institut italien dtudes philosophiques), qui
entend renouer avec la grande tradition philosophique dune ville o a
enseign Benedetto Croce. Dans un magnifique palais, Marotta a cr ce
qui est devenu la premire fondation philosophique mondiale.
Naples, Ricur retrouve un philosophe, devenu un de ses fervents
partisans et grand spcialiste de son uvre, Domenico Jervolino. De passage Paris en 1967 lge de vingt ans, il achte tout ce quil trouve de
Ricur dans les librairies. Nayant jamais tudi le franais, il ralise la
performance de lapprendre en lisant Ricur. Alors disciple de Pietro
Piovani, philosophe napolitain qui a poursuivi la ligne historiciste de
Croce, mais en lorientant dans un sens existentiel et en accordant une
attention particulire la vie pratique, morale et aux individus concrets,
Domenico Jervolino ne fait la rencontre de Ricur quen 1982 : Javais
une sorte de rticence. Je lui ai dit en le voyant : Vous tes un mythe
pour moi, monsieur. Il ma rpondu : Il faut dmythiser le mythe 5.
Jervolino a trouv laudace daller au-devant de son mythe car il se prsente lui au nom de linstitut cr par Marotta pour linviter Naples.
Par ailleurs, trs engag politiquement dans la gauche italienne, il est
dput rgional, reprsentant un tout petit parti, la Dmocratie proltarienne, qui est un peu lquivalent du PSU des annes soixante-dix. Non
seulement Ricur est pour lui un grand phnomnologue, mais ayant t
un des promoteurs du mouvement des chrtiens pour le socialisme en
Italie, il se sent de plain-pied avec son socialisme chrtien. Jervolino essaie
de concilier son marxisme avec lattitude hermneutique de Ricur :
Jespre pouvoir faire une relecture de Marx en utilisant ce que Ricur
ma enseign 6. Cest cette conjonction entre un engagement total aussi
5. Domenico Jervolino, entretien avec lauteur.
6. Ibid.
IX.1/IX.2
31-03-2008
116
15:52
Page 116
PAUL RICUR
bien religieux que politique qui a fortement sduit ds le dpart Jervolino.
En revanche, ce qui linquite dans la rception que connat Ricur, cest
lappropriation dont il est lobjet comme philosophe catholique :
Beaucoup de gens pensent lui comme monseigneur Ricur ou cardinal Ricur, ne sachant mme pas quil est protestant 7 ! Cela peut
prendre des allures de rcupration, encourage par le fait que la maison
ddition qui a publi lessentiel de son uvre en Italie, Jaca Book, est
non seulement catholique, mais lie un mouvement de masse dun christianisme plutt conservateur, proche des positions du pontificat : Il pse
donc une quivoque sur la rception en Italie 8 , et Jervolino essaie de la
lever en tordant le bton dans lautre sens, insistant sur le marxisme de
Ricur et son lacisme philosophique.
Aprs avoir t invit au colloque de phnomnologie organis en
lhonneur du soixante-dixime anniversaire de Ricur Paris, Jervolino
communique ce dernier le manuscrit consacr son uvre, quil vient
dachever : Il me la renvoy avec une trs belle prface, mais aussi avec
une lettre personnelle dans laquelle il me disait quel point il avait apprci, car il y avait l quelque chose qui lavait aid retrouver son itinraire 9. Louvrage de Jervolino parat en 1984 10. Ricur, dans sa prface,
confronte limpression de discontinuit quil prouve au regard de sa
propre uvre avec la dmonstration minutieuse de Jervolino selon
laquelle un principe de cohrence runit un long travail de quarante ans
autour de la question du sujet : Je sais gr lauteur davoir peru la
continuit de la critique du cogito. Je lui suis surtout reconnaissant
davoir aperu que cette critique ne constituait pas la liquidation de la
question mme du sujet, mais la reconqute du je suis, sur la fonction
reprsentative qui la recouvre 11. Ricur reconnat aussi la pertinence
de lanalyse de Jervolino lorsquil voit la vise de ses travaux place sous
lgide dune hermneutique de la pratique, dune philosophie de lagir.
Jervolino achve son ouvrage par lexpression dune attente, celle de la
construction dune potique de la libert capable de relever le fameux dfi
lanc par Marx selon lequel lon doit passer de linterprtation du monde
sa transformation. Cette attente aura particulirement touch 12
Ricur.
7. Domenico Jervolino, ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Domenico JERVOLINO, Il Cogito e lErmeneutica. La questione del sogetto in Ricur,
Procaccini, Naples, 1984. Cette publication, issue dun petit diteur, ne connatra quune
diffusion manuelle. Mais louvrage, traduit aux tats-Unis, reparat chez un grand diteur
italien en 1993 : Casa Editrici Marietti, Gnes.
11. Paul RICUR, prface, ibid., 1984, p. 7-8.
12. Ibid., p. 9.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 117
LE PLUS COURT CHEMIN DE SOI SOI
117
LItalie, dans ses diverses composantes intellectuelles et politiques, a
donc adopt Ricur, devenu source dinspiration de toute une gauche
catholique. Ses travaux sont systmatiquement traduits. Avant dtre
lauteur maison de Jaca Book, il a t publi par une grande maison
ddition milanaise laque qui a dit Husserl, Merleau-Ponty et qui fait
paratre De linterprtation en 1967 13. Ricur est traduit en Italie depuis
limmdiat aprs-guerre 14. Quant la maison ddition Jaca Book, alors
encore de dimension trs modeste, elle prend la dcision de publier Le
Conflit des interprtations en 1977 15 et reprend ensuite les droits de traduction de tous les ouvrages de Ricur lanne mme de leur parution en
France. Ainsi, les trois volumes de Temps et Rcit seront dits en Italie
entre 1986 et 1988 16 et Soi-mme comme un autre en 1993 17.
Pour faire contrepoids une rception italienne souvent conservatrice,
Jervolino, lors de la dcade de Cerisy consacre Ricur en 1988, voit
des dveloppements possibles vers la formulation dune thique de la
libration : Jentrevois une autre dmarche une seconde navigation
qui irait de leffort dautoralisation thique et de libration vers une
comprhension ontologique de ltre que nous sommes... La libration
serait alors la voie privilgie vers la terre promise dune ontologie pas
seulement pense, mais aussi de quelque faon ralise dans la
praxis 18. Au terme de la dcade, dsireux de poursuivre le dialogue avec
Ricur, il sinvite Chtenay avec sa femme. Jervolino dcouvre ensuite
que ce thme de la libration est dj trs utilis chez les philosophes
latino-amricains, qui ont mme cr un mouvement international
dnomm Philosophie de la libration , n en Argentine au mme
moment que lessor de la thologie de la libration. Jervolino entre donc
en contact avec eux et organise un colloque sur ce thme Naples en
1991. Cest encore Naples, o Ricur est rgulirement convi, que se
tient la clbration de son quatre-vingtime anniversaire lors dun colloque
international qui runit ses proches sur le thme de Lhermneutique
13. Paul RICUR, Della interpretazione, Saggio su Freud, trad. E. Renzi, Il Saggiatore,
Milan, 1967.
14. Le contrat de traduction en italien de K. Jaspers et la Philosophie de lexistence est sign
le 16 juin 1948.
15. Paul RICUR, Il Conflitto delle interpretazioni, trad. R. Balzorotti, F. Botturi et
G. Colombo, Jaca Book, Milan, 1977.
16. Paul RICUR, Tempo e racconto, vol. I, trad. G. Grampa, Jaca Book, Milan, 1986 ;
vol. 2 : 1987 ; vol. 3 : 1988.
17. Paul RICUR, S como un altro, trad. Daniella Iannotta, Jaca Book, Milan, 1993.
18. Domenico JERVOLINO, Hermneutique de la praxis et thique de la libration , in Jean
GREISCH et Richard KEARNEY (dir.), Les Mtamorphoses de la raison hermneutique, op. cit.,
p. 230.
IX.1/IX.2
31-03-2008
118
15:52
Page 118
PAUL RICUR
lcole de la phnomnologie 19 . Dans sa communication, Jervolino
revient sur la question de la praxis, confrontant les deux formes de
lhermneutique contemporaine, celle de Gadamer et celle de Ricur,
cet impratif 20.
Ladhsion de Jervolino aux thses de Ricur nest pourtant pas
dnue dune distance critique qui naffecte en rien leur relation amicale
et intellectuelle. Un peu surpris par la radicalit de la critique affirme par
Ricur lgard du cogito dans sa prface Soi-mme comme un autre,
Jervolino a ragi par une sorte dapologie pour le cogito qui sintitule :
Penser avec Ricur contre Ricur, de faon trs amicale 21. Il ne suit
pas non plus Ricur sur la sorte de dtachement, de sagesse qui lui fait
renoncer aux notes desprance, doptimisme sur lavenir, sur laprs, y
compris sur laprs de la mort, comme sil y avait une coupure entre ltre
vivant jusqu la mort et la part de Dieu pour laprs. Dans son dernier
ouvrage sur Ricur 22, il exprime la frustration quil ressent devant la
dclaration d agnosticisme philosophique sur laquelle sinterrompt
Soi-mme comme un autre : Je suis moi-mme partag entre une thologie ngative et une sorte dathisme chrtien. Mais je ne peux lattribuer
Ricur car jai vu dans sa vie une foi remarquable, une attitude de
croyant. Cest pourquoi jai parl de frustration, car on aimerait quun
matre nous donne la fin un espoir, un idal, une conclusion un peu difiante. Faute de cela, on se retrouve un peu seul 23. Par rapport au but
que sassigne Jervolino de construire une hermneutique philosophique
qui serait la synthse de la pense biblique et de la pense philosophique,
Ricur le rejoint pour affirmer que la pense nest pas puise par la philosophie, quil y a bien un Autre de la philosophie. Cependant, il lui rappelle que son christianisme est lui-mme partiel et partial et justifie donc
la plus grande humilit et la plus grande prudence pour accueillir dautres
modes de croyance et de pense. Il en rsulte un respect des limites qui
fait de lui, selon lexpression de Lon Brunschvicg, reprise par Jean Nabert,
un christianisme de philosophe , lequel ne devrait aucunement tre
tenu pour une philosophie chrtienne, ou son substitut 24 .
Le monde hispanique, aussi bien espagnol que latino-amricain, est lui
aussi trs rceptif aux thses de Ricur. Les traductions de ses ouvrages
19. Paul RICUR, in Jean GREISCH (dir.), LHermneutique lcole de la phnomnologie,
op. cit., p. 183-344. Le colloque de Naples sest tenu les 7 et 8 mai 1993 avec la participation
dHans INEICHEN, Jean GREISCH, Richard KEARNEY, Peter KEMP, Domenico JERVOLINO,
Franoise DASTUR, Bernhard WALDENFELS.
20. Domenico JERVOLINO, Lhermneutique de la praxis , op. cit., p. 261-281.
21. Domenico Jervolino, entretien avec lauteur.
22. Domenico JERVOLINO, Ricur. Lamore difficile, Edizioni studium, Rome, 1995.
23. Domenico Jervolino, entretien avec lauteur.
24. Paul RICUR, prface Domenico JERVOLINO, Ricur. Lamore difficile, op. cit., p. 16.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 119
LE PLUS COURT CHEMIN DE SOI SOI
119
commencent au milieu des annes soixante en Espagne 25, notamment
grce Manuel Maceiras, dans les milieux catholiques espagnols. De
manire un peu similaire lItalie, la rception de Ricur en Espagne
donne une version conservatrice, tradionaliste son uvre. Son essai sur
Freud connat un retentissement spectaculaire puisque, sorti en 1970,
lditeur mexicain en publie la quatrime dition en 1978 26. Les traductions seront dsormais disponibles pour le lectorat hispanique peu aprs
leur parution franaise 27. Non seulement Soi-mme comme un autre
bnficie dun contrat avec Siglo Ventiuno lanne mme de sa parution
en France, mais la presse espagnole lui fait dj cho par des entretiens et
des recensions 28. Un symposium international sest tenu sur le thme
Paul Ricur : Autocomprhension et Histoire du 23 au 27 novembre
1987 Grenade 29.
Ricur a t souvent invit en Espagne, o des philosophes reconnus
sont proches de lui, comme Maceiras Madrid 30. Lors dun rcent
voyage en Espagne, au dbut des annes quatre-vingt-dix, la distraction
lgendaire de Ricur a failli tourner la catastrophe. Il participait avec
tout un groupe de philosophes franais une tourne de confrences.
Prenant lavion Orly en compagnie de Jean-Marie Domenach, en pleine
discussion avec lui, il oublie son bagage lenregistrement et se dirige vers
la salle dembarquement aprs avoir achet Le Monde. Le haut-parleur
appelle plusieurs fois monsieur Ricur , qui est pri de bien vouloir se
rendre de toute urgence au comptoir dAir France. Mais Ricur est ce
point absorb par sa lecture du journal quil ne prte pas vraiment attention ces appels : Tout coup, il se dit : mais, Ricur ? Cest moi 31 !
25. Histoire et Vrit, contrat sign le 4 fvrier 1965 avec la maison ddition espagnole
Guadarrama. Puis, sortie en 1969 de Finitud y culpabilitad, trad. C. Sanchez Gil, Taurus,
Madrid.
26. Paul RICUR, Freud : una interpretacion de la cultura, trad. A. Suarez, Siglo Ventiuno,
Mexico DF, Madrid, Buenos Aires, 1970.
27. Paul RICUR, La metafora viva, trad. G. Maravelle, Megapolis, Buenos Aires, 1977 ; La
metafora viva, trad. Neira Calvo, Cristiandad, Madrid, 1980 ; Tempo y narracion I et Tempo
y narracion II, trad. A. Neira, Cristiandad, Madrid, 1987.
28. La libertad es un problema superado dice el filosofo Paul Ricur , El Pais, 28 avril
1991 ; Jaime DE SALAS, Aproximaciones a la identidad , ABC, Madrid, 9 juin 1990.
29. Avec la participation de Ricur. Les intervenants sont Manuel Maceiras, Isidro Munoz,
J. A. Prez Tapias, Angel Espina, Antonio Pintor Ramos, Tomas Calvo Martinez, Angel
Gabilondo, Patricio Penalver, Jos Seco Prez, F. Birules, Jos Aranguez, Juan Manuel
Navarro, Olivier Mongin, Juan Jos Acero, Carlos A. Balinas, Francisco Jarauta, J. L. Martinez
Duenas, Juan Carlos Moreno, Mauricio Beuchot, Jos M. Rubio, Mariano Penalver, Guy
Petitdemange.
30. Fafian M. MACEIRAS, Que es Filosofia ? El Hombre y su mundo, prface de Paul Ricur,
Cincel, Madrid, 1985.
31. Jean Greisch, entretien avec lauteur.
IX.1/IX.2
31-03-2008
120
15:52
Page 120
PAUL RICUR
Il se prcipite, passe la douane lenvers et se trouve devant un attroupement de policiers, de tireurs en position avec veste blinde, qui venaient
de faire sauter toutes les courroies de son bagage avec des pinces et
lavaient dpos dans un caisson blind pour le faire exploser. Il a pu rcuprer sa valise in extremis, mais sans courroies. On lui a donn une
ficelle en lui disant : dbrouillez-vous 32 ! Il a d ainsi faire tout son
voyage espagnol, o il tait balad dune ville lautre chaque jour,
avec une valise en accordon !
Les travaux de Ricur bnficient galement dune bonne rception
dans les pays scandinaves, notamment grce un philosophe danois
devenu un de ses amis, professeur luniversit de Copenhague, Peter
Kemp. lissue de sa licence de philosophie prpare au Danemark,
Peter Kemp se rend Strasbourg avec lintention de faire une thse de
philosophie et de thologie. Il suit alors les cours de Roger Mehl et de
Pierre Burgelin, qui lui recommandent de prendre contact avec Ricur.
Peter Kemp lui prsente ltat de ses travaux : Il a t trs dur, mais je
suis revenu plus tard, en mai 1968 Chtenay et, cette fois, il a t trs
positif sur ce que javais crit 33. La thse termine en 1971, Peter Kemp
la soutient en 1973 Copenhague devant un jury compos de trois professeurs danois et de trois Franais : Ricur, Michel de Certeau et Roger
Mehl 34. Avant sa soutenance, Peter Kemp avait propos Ricur de
traduire et de faire paratre un certain nombre de ses articles au Danemark.
Cest ainsi que lorsque Ricur est invit par des linguistes de Copenhague
en 1970, parat son premier ouvrage en danois 35. Pourtant, lors de sa
venue, ce qui fait vnement est tout autre. Happ par la presse ds sa
sortie de lavion, il passe dans les radios, est invit la tlvision pour
parler de lagitation nanterroise et de la fameuse poubelle, ce qui a t
finalement une bonne occasion pour prsenter sa philosophie. Lcho
favorable permet une seconde publication en 1973 36. En 1979, loccasion du cinq-centime anniversaire de luniversit de Copenhague, Peter
Kemp russit faire dsigner Ricur docteur honoris causa. Il est donc
invit avec son pouse cette clbration trs officielle qui consacre une
32. Jean Greisch, ibid.
33. Peter KEMP, entretien avec lauteur.
34. Peter Kemp, Thorie de lengagement, t. I et II, Le Seuil, Paris, 1973.
35. Paul RICUR, Sprogfilosofi (Philosophie du langage), trad. Gr K. Sorensen et Peter
Kemp, introduction de Peter KEMP, Vinten, Copenhague, 1970. Ce recueil regroupe trois
articles de Ricur, La structure, le mot, lvnement , La question du sujet : le dfi de la
smiologie , La paternit : du fantasme au symbole .
36. Paul RICUR, Filosofiens kilder (Les Sources de la philosophie), recueil de quatre articles
et dun entretien avec Ricur, traduction et introduction de Peter KEMP, Vinten, Copenhague,
1973.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 121
LE PLUS COURT CHEMIN DE SOI SOI
121
trentaine de chercheurs du monde entier. En ce grand jour de fte, au
cours de laquelle la reine du Danemark doit honorer luniversit de sa
prsence, lorsque Peter Kemp pntre dans la salle de la crmonie, il voit
que tout le monde est en place : Roman Jakobson est l parmi les autres
personnalits invites, mais la chaire attribue Ricur est dsesprment vide. Or, la reine doit arriver heure fixe et Peter Kemp sinquite,
sadresse Simone Ricur qui ne sait pas non plus o a pu passer son
mari : Quelques minutes seulement avant lheure prvue, peut-tre deux
ou trois minutes, je le dcouvre assis au dernier rang dans une autre salle,
ct de celle prvue pour lui. Je lui fais de grands signes pour quil
vienne prendre place o il devait tre. Je lui ai demand ensuite pourquoi
il tait l. Il ma rpondu : Cest parce que je me suis trouv entre le recteur de luniversit de Jrusalem et le recteur de luniversit de Damas et
je nosais pas disparatre parce quils ne pouvaient pas sentendre 37 !
Si Peter Kemp a jou un rle dcisif pour faire connatre Ricur en le
traduisant, et en rendant compte de ses ouvrages dans le journal Politiken,
dans lequel il a crit pendant vingt ans de 1971 1990, la partie na pas t
facile car les philosophes franais nintressent en gnral au Danemark
que les romanistes. Un double blocage existe : linguistique, en premier
lieu, car on lit surtout langlais et lallemand dans ce pays, mais dordre
philosophique en second lieu, car la plupart des philosophes sont partisans de la philosophie analytique. Son uvre touche donc surtout les
littraires et il est significatif que ses premiers articles traduits soient ceux
ayant un rapport avec le structuralisme, ou avec la textualit et le rcit.
Peter Kemp a aussi t professeur un an en Sude, Gteborg. Avec
Bengt Kristensson, auteur de la premire grande thse sur Ricur et qui
habite Stockholm, Peter Kemp a organis une invitation de Ricur lautomne 1987. Cette visite va tre le point de dpart de sa notorit en
Sude, o un numro spcial de la revue Res publica lui est consacr,
prpar par Kemp et Kristensson. Au lendemain de sa visite, Du texte
laction parat en Sude 38. En 1995, Peter Kemp organise Aarhus,
deuxime ville du Danemark, un colloque sur Ricur avec la participation
de plusieurs philosophes sudois et danois. En mai 1996, il invite Ricur
un grand colloque international organis par le centre Biothique et
Biodroit , quil a cr, pour faire la confrence douverture.
Tous les pays europens ne sont pourtant pas aussi rceptifs aux thses
de Ricur. En Angleterre, si lon excepte quelques dpartements littraires,
la philosophie analytique domine presque sans partage. Curieusement,
37. Peter Kemp, entretien avec lauteur.
38. Paul RICUR, Fran texte till Handling, extraits, introduction Peter Kemp et Bengt Kristensson, Brutus stlings Bokfrlog, Symposion, Stockholm/Stehag, 1988.
IX.1/IX.2
31-03-2008
122
15:52
Page 122
PAUL RICUR
Ricur y est connu, mais on lui reproche un certain manque de
rigueur 39 ! Si lon respecte Ricur outre-Manche, on peroit surtout
son uvre comme une tentative de syncrtisme qui a tendance mettre
sur le mme plan des penseurs trs diffrents, aux positions contradictoires : Il a ce ct germanique de tout embrasser, un peu comme
Habermas, et cela ne plat pas du tout en Angleterre 40. Certes, ses livres,
tous traduits aux tats-Unis, sont diffuss en Angleterre, mais ils restent
sans grand impact.
LAllemagne est un peu plus rceptive aux thses de Ricur, mais
malgr une stylistique philosophique assez germanique et des travaux qui
ont commenc par lappropriation de la philosophie allemande, Jaspers,
Husserl..., Ricur connat aussi quelques obstacles la diffusion de ses
travaux outre-Rhin. La polmique ne de son essai sur Freud lui a valu
une traduction rapide de De linterprtation chez un diteur particulirement prestigieux, Suhrkamp 41, mais ce dernier ne donne pas suite aux
contacts pris pour la publication de La Mtaphore vive. Lditeur munichois Ksel, qui avait dj publi en 1973 Le Conflit des interprtations 42,
donne aussi un avis ngatif, invoquant le fait que louvrage sappuie trop
exclusivement sur le domaine anglo-saxon pour trouver son public en
Allemagne. Cest finalement une version ampute de ses quatrime et
cinquime tudes qui sera dite plus de dix ans aprs sa publication en
France 43. En revanche, Temps et Rcit sera publi assez vite en Allemagne 44, et le contrat de traduction de Soi-mme comme un autre est
sign lanne mme de sa parution avec cet diteur munichois. Lancrage
enfin tabli au plan ditorial dans la vie intellectuelle allemande a t
acquis en grande partie grce la contribution dun philosophe allemand,
originaire de Munich, professeur luniversit de Bochum, Bernhard
Waldenfels. Cest lui qui, en ouvrant une collection Passages chez
Wilhelm Fink Munich, spcialis dans les ouvrages de phnomnologie,
a accueilli aussi bien La Mtaphore vive que Temps et Rcit et Soi-mme
comme un autre : Jai travaill sur tous ces textes, mais la rception en
Allemagne est trs hsitante. Cest le cas aussi pour Merleau-Ponty. On
39. Catherine Audard, entretien avec lauteur.
40. Ibid.
41. Paul RICUR, Die Interpretation. Ein Versuch ber Freud, trad. E. Maldendauer, Suhrkamp, Francfort-sur-le-Main, 1969.
42. Paul RICUR, Hermeneutik und Strukturalismus. Der Konflikt der Interpretationen I,
trad. J. Rtsche, Ksel, Munich, 1973.
43. Paul RICUR, Die lebendige Metapher, trad. R. Rochlitz, prface de Paul Ricur,
Wilhelm Fink Verlag, Munich, 1986.
44. Paul RICUR, Zeit und Erzhlung, Band I, trad. R. Rochlitz, Wilhlem Fink Verlag,
Munich, 1988 ; Band II, 1989, Band III, 1992.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 123
LE PLUS COURT CHEMIN DE SOI SOI
123
a tendance dire en Allemagne que nous avons tout cela : la phnomnologie et lhermneutique, cest un patrimoine allemand 45.
Bernhard Waldenfels a t trs tt passionn par la phnomnologie
franaise. Venu Paris entre 1960 et 1962, il a suivi le dernier cours de
Merleau-Ponty au Collge de France et le cours de Ricur sur Husserl
la Sorbonne. Paradoxalement, il achetait son premier livre de Husserl...
Paris, puis sest rendu aux archives Husserl Louvain. Il publiera en 1983
un ouvrage sur la phnomnologie en France 46 dont le chapitre cinq, intitul Les entours de la signification , est consacr Ricur. Il rencontre
Ricur personnellement en 1973 Munich loccasion dun colloque
organis par une socit pour les recherches phnomnologiques dont il
est lun des membres du groupe fondateur. Par sa position originale entre
les deux traditions, franaise et allemande, Waldenfels aura donc beaucoup
compt dans la rception des thses de Ricur dans son pays. Cependant,
on ne comprend pas trs bien sa position dans un champ qui reste trs
bipolaris entre Gadamer, dun ct, et Habermas, de lautre : Moi, je
suis du ct de Ricur car son hermneutique est proche des sciences.
Gadamer reprsente la vrit sans mthode, alors que Ricur, cest la
vrit travers les mthodes 47. Cependant, selon Waldenfels, Ricur
reste encore trop hglien. Sil pluralise le champ des vrits, il ne tient
pas assez compte de lhtrognit des espaces de pense. Sur ce plan, il
se sent plus en phase avec la manire dont Michel Foucault valorise les
phnomnes de discontinuit, les csures, alors que lapproche de Ricur
lui semble toujours trop bienveillante et conciliatrice. Waldenfels entend
au contraire mettre laccent sur lirrductibilit de la figure de lAutre,
reprenant sur ce point la distinction, traditionnelle en Allemagne, entre
lautre et ltranger. Cest dailleurs sur ce thme quil intervient au colloque de Naples loccasion du quatre-vingtime anniversaire de Ricur
en 1993 48. Proche de Ricur, il est davantage sur laxe de lautre, de
laltrit, diffrenciant le sens que lui accorde Platon et lexprience de
ltranger : Ce qui est tranger moi ou soi nest pas seulement autre
que moi-mme ou autre que soi-mme, il se drobe moi-mme tout en
minterpellant 49. Ricur, prsent Naples, coute cette critique et lui
donne raison sur la ncessaire distinction entre les diverses manires de
parler de ltranger. La position de lentre-deux, de conciliation, que
45. Bernhard Waldenfels, entretien avec lauteur.
46. Bernhard WALDENFELS, Fanomenology in Frankreich, Suhrkamp, Francfort-surle-Main, 1983.
47. Bernhard Waldenfels, entretien avec lauteur.
48. Bernhard WALDENFELS, Lautre et ltranger , in Jean GREISCH (dir.), Paul Ricur.
Lhermneutique lcole de la phnomnologie, op. cit., p. 327-344.
49. Ibid., p. 344.
IX.1/IX.2
31-03-2008
124
15:52
Page 124
PAUL RICUR
Waldenfels juge comme trop hglienne chez Ricur, conciliant Aristote
et Kant, Gadamer et Habermas, serait une des raisons dune rception
difficile en Allemagne, o lon a davantage tendance lhyperbole, des
positions tranches, mme si elles sexpriment dans un discours austre.
Cependant, les considrations gnrales valent moins pour lAllemagne
que pour la France, compte tenu du caractre trs morcel de ltat
allemand. Bnficiant de la relle dcentralisation allemande, la rception
de Ricur peut se faire en certains lieux et dans des secteurs particuliers
de lactivit intellectuelle. Cest ainsi que, dit Munich, il est docteur
honoris causa de luniversit de cette ville, membre honoraire de la Socit
de phnomnologie allemande. Ses travaux suscitent le plus grand intrt
dans les facults de thologie, et pas seulement chez les protestants. Par
ailleurs, il noue des relations trs fcondes avec les historiens de Bielefeld,
qui linvitent en 1974. Reinhart Koselleck, un des reprsentants de cette
cole 50, est devenu une rfrence majeure dans sa tentative de construction dune hermneutique de la conscience historique 51.
Les chos de la pense de Ricur se font entendre jusquen ExtrmeOrient. Au Japon, la plupart de ses ouvrages ont t traduits depuis la
parution en 1977 de La Symbolique du mal 52. Les annes quatre-vingt
voient paratre successivement De linterprtation en 1982 53, La Mtaphore vive en 1983 54, et les trois volumes de Temps et Rcit entre 1987 et
1990 55. En Core du Sud, la situation est plus dlicate, car la plupart des
philosophes de ce pays sont tourns vers les tats-Unis et sont donc attirs par la philosophie analytique. Cependant, un petit noyau de professeurs commence sorganiser pour travailler, traduire et faire connatre
les thses de Ricur. Membre du dpartement de franais de la facult des
sciences humaines de luniversit Chon Nan Kwangju, Madeleine Jang
Kyung, professeur de littrature franaise, sintresse la critique littraire et se rend Paris entre 1983 et 1987 pour parfaire sa formation en
philosophie lInstitut catholique, o elle prpare une thse sous la direction de Jean Greisch sur Lhermneutique et la critique littraire . Une
fois revenue en Core, elle entreprend seule la traduction de La Mtaphore vive, mais, insatisfaite de son travail, elle na pas encore contact
50. Reinhart KOSELLECK, Le Futur pass, EHESS, Paris, 1990.
51. Voir Paul RICUR, Temps et Rcit, t. 3, chap. 7, Vers une hermneutique de la
conscience historique .
52. Paul RICUR, Aku no Shinborizuma, Keisei-Sha, Tokyo, 1977.
53. Paul RICUR, Furoito o Yomu. Kaisha Kugaku Shiron, Shingo-Sha, Tokyo, 1982.
54. Paul RICUR, Ikita Inyu, Iwanami-Shoten, Tokyo, 1983.
55. Paul RICUR, Jikan to Monogatari I, 1987 ; II, 1988, III, 1990, trad. H. Kume, ShingoSha, Tokyo,
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 125
LE PLUS COURT CHEMIN DE SOI SOI
125
dditeur. Avec ses tudiants, elle lit et commente les ouvrages de Ricur
et participe activement lAssociation corenne de littrature et dhermneutique. Elle a russi mettre en place un groupe de quatre professeurs
spcialistes de Ricur. Ce groupe des quatre , constitu de deux enseignants de Kwangju et de deux de Soul, entend mener un travail collectif
de traduction de Ricur.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 126
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 127
A.IX.2
La rfrence du tournant pragmatique
et interprtatif des sciences humaines
Les sciences humaines en France ont longtemps vcu avec un modle en
surplomb, celui de la physique mcanique, qui, par ses lois et son usage
de la causalit, semblait reprsenter la quintessence de la scientificit, en
ralisant une coupure radicale avec les humanits classiques. En est
rsulte laspiration construire une physique sociale : cest du ct de la
dcouverte des invariants, des rgularits, des mcanismes de reproduction, des phnomnes statiques, des logiques binaires, que se sont orientes ces sciences de lhomme au XIXe sicle lge du positivisme comtien,
puis au XXe sicle avec la domination des grands paradigmes unitaires
comme le fonctionnalisme, le marxisme ou le structuralisme. Aujourdhui, ces sciences commencent entrevoir limpasse dans laquelle elles
sengagent lorsquelles visent enfermer dans des lois la condition
humaine, dont la spcificit tient justement sa capacit sarracher aux
forces du conditionnement qui la contraignent. Les sciences humaines ne
peuvent devenir humaines qu condition de passer par un stade de
rflexivit qui induit une traverse hermneutique et ouvre sur la valorisation des phnomnes mergents, des processus de changement, de
lvnementialisation, du sens, de lintersubjectivit, des comptences des
acteurs sociaux, des conventions...
Ce basculement trouve chez Ricur une inspiration dautant plus forte
quil a toujours pens le rapport de la philosophie avec son autre, son vis-vis constitu par les sciences humaines, sappropriant le stade de la
mthode comme moment indispensable de la dmarche hermneutique.
Ds 1977, Ricur en fait la dmonstration dans un article dont la nouvelle sociologie va semparer beaucoup plus tard, vers la fin des annes
IX.1/IX.2
31-03-2008
128
15:52
Page 128
PAUL RICUR
quatre-vingt 1. Il y reprend les termes mmes de la querelle des
mthodes qui a eu lieu en Allemagne la fin du XIXe sicle entre les
partisans de lexplication, de lobjectivation, de lpistmologie et les
dfenseurs de la comprhension, des sciences de lesprit, de lontologie.
Il se donne pour objectif de mettre en question la dichotomie qui
assigne aux deux termes de comprhension et dexplication deux champs
pistmologiques distincts 2 . Cest donc toujours un espace de lentredeux, un espace mdian, que cherche construire Ricur, rcusant lalternative propose par Dilthey entre des sciences de la nature qui seraient du
ct de lexplication et des sciences de lesprit situes du ct dune
thorie du Verstehen (de la comprhension). Il montre comment les
mdiations utiles la thorie du texte peuvent tre autant dinstruments
de construction dune thorie de laction et dune thorie de lhistoire. Au
plan pistmologique, Ricur considre quil ny a pas deux mthodes en
opposition, seule lexplication est mthodique 3 , mais elle doit souvrir
sur un second niveau, celui de la rflexivit, celui du comprendre, car ce
souci tmoigne, au cur de lpistmologie, dune appartenance de
notre tre ltre qui prcde toute mise en objet, toute opposition dun
objet un sujet 4 .
Cette exigence de la traverse hermneutique au cur mme de lesprit
de mthode ne sera pas entendue au moment o la configuration des
sciences humaines trouve son expression philosophique dans les penses
du soupon, les stratgies de dvoilement, le paradigme critique , dans
lide que la vrit scientifique est accessible mais cache, voile. Les
sciences humaines exaltes durant cette priode taient celles qui avaient
la plus grande capacit exproprier la prsence, lattestation de soi, et en
premier lieu tout ce qui relevait de laction, de lacte de langage, toutes
occasions de conduire des oprations signifiantes. Le structuralisme
permettait dans ce cadre de conjuguer les effets du dessein thorique de
destitution du sujet et lambition dune saisie objectivante vocation
scientifique.
Autour des annes quatre-vingt, le basculement est manifeste et se traduit par une tout autre organisation intellectuelle, dans laquelle le thme
de lhistoricit se substitue celui de la structure 5. Cette nouvelle priode
est surtout marque par la rhabilitation de la part explicite et rflchie
1. Paul RICUR, Expliquer et comprendre , Revue de philosophie de Louvain, t. XXV,
fvrier 1977, p. 126-147 ; repris dans Du texte laction, op. cit., p. 161-182.
2. Ibid., p. 161.
3. Ibid., p. 181.
4. Ibid.
5. Voir Franois DOSSE, LEmpire du sens. Lhumanisation des sciences humaines, op. cit.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 129
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
129
de laction 6 . Il ne sagit pas pour autant dun simple retour du sujet
tel quil tait envisag autrefois dans la plnitude de sa souverainet postule et dune transparence possible. Il est question dun dplacement
de la recherche vers ltude de la conscience, mais dune conscience
problmatise.
Le programme de recherche est avant tout non rductionniste et ce
dplacement vers la part explicite et rflchie de laction est particulirement sensible dans la nouvelle sociologie. Cette orientation prend au
srieux le tournant linguistique et attache une grande attention aux
discours sur laction, la narration, la mise en intrigue des actions,
comme lappelle Ricur, sans pour cela senfermer dans la discursivit.
Pour raliser ce programme et viter toute forme stabilise dinterprtation, la nouvelle sociologie doit faire un certain nombre de dtours et
dinvestissements du ct de la philosophie analytique, de la pragmatique, du cognitivisme, de la philosophie politique, autant de domaines
connexes, de cheminements croiss qui contribuent faire merger un
sentiment dunit autour du renversement en cours vers un nouveau
paradigme 7. Celui-ci peut tre qualifi de paradigme interprtatif dans la
mesure o il rvle la place de linterprtation dans la structuration de
laction en revisitant tout le rseau conceptuel, toutes les catgories
smantiques propres laction : intentions, volonts, dsirs, motifs,
sentiments... Lobjet de la sociologie passe ainsi de linstitu linstituant
et rinvestit les objets du quotidien ainsi que les formes parses et varies
de la socialit.
Les sciences humaines, retrouvant lacte dinterprtation, rejoignent le
parcours exigeant et rigoureux de Ricur, qui ne pouvait laisser indiffrent les chercheurs des sciences sociales soucieux de sortir des causalits
mcaniques et des schmas dterministes. Le sociologue Louis Qur
avait lu Le Conflit des interprtations ds sa parution, en 1965, et cest
loccasion dun sjour au Canada au dbut des annes quatre-vingt quil
dcouvre, en anglais, un texte de Ricur qui remonte 1971 8. Dans cet
article, Ricur dmontre lanalogie existant entre lapproche des textes et
celle de laction, au point que les sciences humaines peuvent tre dites
hermneutiques 9 . Les divers niveaux du discours sarticulent la manire
dun quadrilatre qui prend en compte la singularit de la parole comme
6. Marcel GAUCHET, Le Dbat, n 50, mai-aot 1988, p. 166.
7. Voir Ce quagir veut dire , Espaces Temps, n 49-50, 1992.
8. Paul RICUR, The Model of the Text : Meaningful Action Considered as a Text , Social
Research, 38/3, 1971, p. 529-562 ; repris sous le titre : Le modle du texte : laction considre
comme un texte , Du texte laction, op. cit., p. 183-211.
9. Ibid., p. 183.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 130
130
PAUL RICUR
vnement, le discours comme interlocution, le sens de celui-ci par le
contenu de ce qui est transmis, et enfin la rfrence, soit ce dont on parle.
Ce modle textuel est aussi luvre quant au processus de fixation de
laction : Ma thse est que laction elle-mme, laction sense, peut devenir objet de science sans perdre son caractre de signifiance la faveur
dune sorte dobjectivation semblable la fixation opre par lcriture 10. Les actes de langage tudis par Austin et Searle rendent possible
la construction de types idaux analogues ceux conus par Max Weber.
De la mme manire, un texte sautonomise par rapport son auteur
comme une action se dtache de son agent et dveloppe ses propres
consquences. Cette autonomisation de laction humaine constitue la
dimension sociale de laction 11 . Par ailleurs, la manire du monde du
texte, celui de laction humaine est dirig vers un nombre indfini dappropriations diverses : Comme un texte, laction humaine est une uvre
ouverte, dont la signification est en suspens 12. partir de cette analogie, Ricur dfinit toute une mthodologie spcifique de linterprtation qui combine explication et comprhension dans le cercle
hermneutique. Ce dplacement du binme expliquer/comprendre est
dcisif, il permet Ricur de dpasser les apories sur lesquelles butent la
sociologie comprhensive et lhermneutique romantique dans leur
ambition de percer les intentions de lauteur. Ricur montre en effet que
la comprhension dun texte relve surtout de la relation du texte avec un
lecteur qui advient lui-mme au travers de cette confrontation. Le paradigme de la lecture se prsente ainsi comme une solution au paradoxe
mthodologique des sciences humaines, et une rponse possible la
dichotomie de Dilthey entre lexpliquer et le comprendre.
Ce point de convergence va tre lorigine dune rencontre qui aura
lieu en 1985 entre le Centre de sociologie de lthique et le Centre dtude
des mouvements sociaux, dun ct et, de lautre, Paul Ricur. Dans la
lettre dinvitation, Paul Ladrire, Louis Qur et Pascale Gruson placent
les recherches sociologiques dans le voisinage de la philosophie hermneutique, dautant que les hypothses systmatiques constitutives de la
discipline sociologique ne permettent pas daccder au sens que les acteurs
sociaux confient leur action, qui est laiss en suspens. Les sociologues
reconnaissent la dmarche hermneutique le mrite de rouvrir cette
question du sens et davoir montr limportance des jeux de langage dans
les interactions sociales. Dans sa confrence, Paul Ricur se situe davantage du ct de Max Weber que de Dilthey pour dpasser lopposition
10. Paul RICUR, ibid., p. 191.
11. Ibid., p. 193.
12. Ibid., p. 197.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 131
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
131
entre explication et interprtation. Il rappelle cet gard lexpression de
comprhension explicative 13 de Weber. Devant les sociologues,
Ricur dfend une thorie de laction englobant la smiotique, ou tout
au moins lune de ses branches, celle de la thorie des actes de langage. Or,
ce domaine de laction est impropre lide de causalit mcanique dans
la mesure o le rapport dimplication entre cause et effet nest quun rapport externe de conscution. Aucune rduction physicaliste nest alors
possible et cette irrductibilit fonde le souci dune approche toujours
complmentaire entre lexpliquer et le comprendre : Expliquer plus,
cest comprendre mieux 14.
La dcouverte de luvre de Ricur par les sociologues franais est
facilite par la triple influence de la phnomnologie, de la pragmatique
et de lethnomthodologie. Ricur sest situ au centre de ces courants
pour confronter leurs positions propos de laction, reposant notamment la question dispute entre philosophie analytique et phnomnologie propos de leur conception respective de lintentionnalit. Ce
dialogue est symptomatique dun profond remaniement dans les relations entre les sciences humaines, qui ne cessaient de proclamer dans les
annes soixante la mort de la philosophie pour se retrouver en position de
demande dans les annes quatre-vingt : Je fais partie des gens qui ressentent un besoin norme de philosophie. Tout le monde lve le pied et
lon se remet rflchir. Cest de ce moment que date la monte de
Ricur. Ce que jen attends, cest quil dgage les lignes gnrales dune
entreprise culturelle multiforme 15. Alain Touraine, comme beaucoup,
ressent les limites dune simple traverse de lexprience du monde au
plan empirique, mal arme conceptuellement. Il se sent en proximit avec
une pense qui, dune part, met en garde contre les navets dun optimisme bat dans un XXe sicle tragique et, dautre part, se confronte avec
les problmes de la modernit : Il y a chez Ricur un ct dramatique.
Tout est toujours dangereux, urgent. Il y a l un ct SAMU. Moi, je partage parfaitement cette manire de voir. La pense est de lordre du
SAMU 16.
Ricur rencontre aussi un cho chez les sociologues dans la mesure o
ceux-ci rvaluent les comptences des acteurs sociaux et leur capacit
dcrire le monde social qui est le leur, donc lui donner une explication.
Il en est ainsi pour Luc Boltanski et pour Laurent Thvenot. Cette
13. Paul RICUR, Philosophie et Sociologie. Histoire dune rencontre, Groupe de sociologie
de lthique, Centre dtude des mouvements sociaux, EHESS, Paris, 1985, p. 24.
14. Ibid., p. 37.
15. Alain Touraine, entretien avec lauteur.
16. Ibid.
IX.1/IX.2
31-03-2008
132
15:52
Page 132
PAUL RICUR
nouvelle sociologie a d prendre les acteurs au srieux pour mener son
enqute sur les litiges et construire une sociologie de la dispute et de la
justification 17. De la mme manire, lanthropologie des sciences de
Bruno Latour et Michel Callon a mis en question le grand partage entre
connaissance scientifique et normativit, entre le jugement de fait et le
jugement de valeur 18. La connaissance ordinaire, le sens commun est
alors reconnu comme gisement de savoir et de savoir-faire.
Un domaine de la sociologie sinistr connat rcemment un essor spectaculaire et se nourrit des travaux de Ricur : la sociologie des religions 19.
Jean-Paul Willaime a succd Jean Baubrot comme directeur dtudes
la Ve section de lEPHE (section des sciences religieuses), aprs avoir
enseign la sociologie des religions la facult de thologie protestante de
luniversit des sciences humaines de Strasbourg, ville o il est toujours
domicili et o il a longtemps dirig un laboratoire du CNRS sur Socits, droits et religions en Europe , travaillant entre autres avec Danile
Hervieu-Lger et Gilbert Vincent 20. Willaime a suivi une triple formation : thologique, philosophique et sociologique. Auteur dune thse
dtat en sociologie des religions sur les pasteurs, soutenue en 1984 21, il
a vcu de lintrieur le basculement qui a permis son secteur de recherche
de devenir central dans le champ des sciences sociales : Soccuper de
sociologie des religions dans les annes soixante condamnait tre dans
la communaut sociologique un marginal, vou un secteur en dliquescence avanc. Aujourdhui, au contraire, ceux qui travaillent dans ce
domaine ont rejoint les problmatiques des sciences sociales 22. Il prend
connaissance de luvre de Ricur en tant que philosophe et protestant
ds la lecture de Finitude et Culpabilit. Mais cest surtout lantirductionnisme de Ricur et son attention lintentionnalit de laction qui
vont tre le plus suggestifs pour ses propres recherches : Cela a t
dterminant pour moi de comprendre que le niveau symbolique nest pas
rductible aux dterminations sociales de laction 23. Dans la perspective
17. Luc BOLTANSKI et Laurent THVENOT, De la justification, Gallimard, Paris, 1991.
18. Voir Bruno LATOUR, Nous navons jamais t modernes. Essai danthropologie symtrique, La Dcouverte, Paris, 1991 ; et Michel CALLON, La Science et ses rseaux, La Dcouverte, Paris, 1989.
19. Jean-Paul WILLAIME, Sociologie des religions, PUF, Paris, 1995.
20. Jean-Paul WILLAIME et Gilbert VINCENT, Religions et transformations de lEurope,
Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1993.
21. Jean-Paul WILLAIME, Profession pasteur : sociologie de la condition de clerc la fin du
XXe sicle, Labor et Fides, Genve, 1986.
22. Jean-Paul Willaime, entretien avec lauteur.
23. Ibid.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 133
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
133
phnomnologique de Ricur, ainsi que dans sa qute de la vise de sens,
il trouve le moyen de rsister aux schmas mcanistes alors largement en
usage dans la sociologie des annes soixante-dix : Il fallait plaider pour
la consistance propre de lobjet, mettre en vidence les logiques spcifiques au monde symbolique. Or, une uvre comme celle de Ricur
aidait le penser 24.
Son collgue Roland Campiche, lui aussi sociologue des religions, professeur la facult de thologie de luniversit de Lausanne, a commenc
sa formation de thologie Lausanne entre 1956 et 1960 et la poursuivie
Chicago, o il a particip au sminaire de Tillich. Les thses que dveloppe Ricur dans Le Conflit des interprtations lui sont trs prcieuses :
Au niveau du rapport sujet/objet, il conduit ne plus estimer quil y
aurait un monopole de linterprtation, mais plutt plusieurs possibilits
dinterprter, et il invite donc rflchir leur articulation 25. Roland
Campiche y voit la possibilit de parvenir un stade plus riche, plus respectueux de lobjet, grce linclusion de lapproche thologique du religieux. Sur ce plan, il a rpondu aux critiques de Bourdieu, qui avait accus
tous les sociologues des religions dtre danciens curs dfroqus prisonniers de leur objet et incapables dun regard scientifique 26. Face
cette tentative de disqualification au nom dune scientificit de surplomb
du sociologue roi, Roland Campiche rtorque quil laisse la prtendue
affirmation dune sociologie purement scientifique et neutre aux idologues, tout en reconnaissant la ncessit de respecter les rgles dune
objectivit comme horizon heuristique 27 . Si la stigmatisation de
Bourdieu peut toucher juste lorsque des sociologues de la religion subordonnent la sociologie la dfense de la religion pare des atouts de la
scientificit, il sgare quand, posant le problme de linvestissement
dans lobjet, de ladhrence lie une forme dappartenance, il voit dans
le fait que linstitution religieuse organise la croyance un quasi-empchement llaboration de ce quil appelle une sociologie scientifique du
champ religieux 28 . Par ailleurs, Roland Campiche sappuie sur les positions de Ricur pour dfendre la ncessit dun enseignement de sociologie lintrieur des facults de thologie, afin de crer une tension
fconde entre la ralit et le message biblique. uvrant donc un dialogue
24. Ibid.
25. Roland Campiche, entretien avec lauteur.
26. Pierre BOURDIEU, Sociologues de la croyance et croyance de sociologues , Archives de
sciences sociales des religions, vol. 63-1, Paris, 1987, p. 155-161.
27. Roland CAMPICHE, Une approche sociologique du champ religieux , Revue de thologie et de philosophie, n 120, 1988, p. 123.
28. Ibid., p. 125.
IX.1/IX.2
31-03-2008
134
15:52
Page 134
PAUL RICUR
interne des deux cultures au sein de la mme institution, il ne partage pas
les rserves souvent exprimes par Ricur lorsquil entend sparer les
deux domaines. Il privilgie les enqutes sociologiques de terrain menes
avec Jean-Paul Willaime et Gilbert Vincent, au cours desquelles ils tudient, entre autres, le fonctionnement des conseils paroissiaux et presbytriens, ainsi quune enqute plus spcifique sur le thme Croire en
Suisse 29 , centre sur lindividu et lvolution de son comportement
religieux.
Du ct des historiens, la publication entre 1983 et 1985 de Temps et
Rcit na pas donn lieu sur le moment au dbat escompt. Certes, la rencontre organise par Esprit en 1987 a permis une confrontation avec
Roger Chartier 30, et une rencontre avec Ricur se tient en juin 1988
linitiative de Franois Hartog au Centre de recherches historiques de
lEHESS, avec la participation de Jacques Revel, Bernard Lepetit, Roger
Chartier, mais ce dbat restera sans traces crites. La rflexion de Ricur
sur lcriture historique va pourtant avoir dimportants effets la faveur
de la crise du paradigme des Annales qui a domin la production historique en France depuis les annes cinquante.
La revue Annales sengage partir de 1988-1989 dans un tournant
critique trs novateur. Lhistorien Bernard Lepetit, alors secrtaire de la
rdaction, va jouer un rle majeur dans la dfinition de nouvelles orientations et dune nouvelle alliance qui mobilise lhermneutique comme
ressource thorique ou plutt qui engage une premire mise en traductibilit de lhermneutique dans le dispositif du premier tournant critique 31 . Un nouveau paradigme se cristallise et ralise une double
conversion pragmatique et hermneutique qui rompt radicalement avec
la priode prcdente, marque par la prvalence exclusive des phnomnes de longue dure chez Braudel et dune histoire immobile chez
Le Roy Ladurie. Au plan institutionnel , en 1994, le comit de direction des Annales intgre Laurent Thvenot et Andr Orlan, et la revue
change significativement le sous-titre en usage depuis 1946, conomies,
socits, civilisations , qui devient Histoire, sciences sociales . Bernard
Lepetit accorde une attention particulire la socit envisage comme
catgorie de la pratique sociale. Partant du principe des conomistes des
conventions selon lequel la socit produit ses propres rfrences et ne
29. Roland CAMPICHE et al., Croire en Suisse (1), Lge dhomme, Lausanne, 1992.
30. Voir Franois DOSSE, Paul Ricur rvolutionne lhistoire , EspacesTemps, Le Temps
rflchi, n 59-60-61, 1995, p. 6-26.
31. Christian DELACROIX, La falaise et le rivage. Histoire du tournant critique , EspacesTemps, Le Temps rflchi, op. cit., p. 97.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 135
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
135
doit pas tre renvoye quelque naturalit profonde, il accorde une prvalence la question de laccord. Lincidence majeure de ce redploiement sur les acteurs pour lhistorien est une reconfiguration du temps,
avec une revalorisation de la courte dure, de laction situe, de laction
en contexte. Cest le point de vue extrieur au temps qui doit tre relativis. Une telle position, guide par la notion dappropriation, aboutit
placer dans le prsent le centre de gravit du temporel : Le pass, ainsi,
est un prsent en glissement 32. Cette prsentification propre au nouveau discours historique qui sort de son sommeil structural vise prendre
au srieux les modles temporels daction des acteurs du pass en suivant
lexemple de ce que font les conomistes des conventions sur la socit
prsente. Bernard Lepetit fait sien le tournant pragmatique des sciences
sociales. Il constate la cristallisation dun nouveau paradigme et entend
bien y faire participer une histoire transforme et recentre sur une
problmatisation de la notion daccord ou de convention. lide de
reprsentations collectives qui se rigidifient dans des institutions, modle
dominant jusque-l dans les sciences humaines, il prfre celle de convention, qui renvoie aussi un ancrage dans des institutions ou des objets,
mais indissociables de leur dotation de sens et produits de linteraction
sociale, relevant de formes et de dures variables : Je vous renverrai un
article de Bourdieu paru dans les Actes de la recherche en sciences sociales
qui sintitule Le mort saisit le vif. Vous y verrez que la dtermination
par lhabitus conduit une espce de glaciation de lespce, par rarfaction successive de lespace de choix 33.
La force des conventions parat relever de son paisseur temporelle, de
lhritage dun long pass, mais, comme remarque Bernard Lepetit, elle
tient aussi et surtout leur capacit dactualisation. Elles relvent donc au
plan de leur tude dune dotation de sens variable selon le contexte et
dune capacit polysmique. Dans un renversement rhtorique spectaculaire et significatif du nouveau moment historiographique, Bernard Lepetit
prconise un modle temporel valide pour le mtier dhistorien qui participe utilement de lhermneutique de la conscience historique daujourdhui 34 . Dans la dfinition de celui-ci, sa rfrence est trs explicitement
une analyse emprunte Temps et Rcit. Le prsent subit une perte de
sens, car il se trouve cartel entre un pass rvolu que lon ne souhaite
pas reproduire et un futur totalement opaque. Face une telle crise
du sentiment dhistoricit, Bernard Lepetit distingue deux attitudes
32. Bernard LEPETIT, Les Formes de lexprience, Albin Michel, Paris, 1995, p. 296.
33. Bernard LEPETIT, La question sociale : visions de sociologues, visions dhistoriens ,
Vie sociale, CEDIAS, n 6, 1996, p. 30.
34. Bernard LEPETIT, Les Formes de lexprience, op. cit., p. 297.
IX.1/IX.2
31-03-2008
136
15:52
Page 136
PAUL RICUR
possibles. La premire est celle qui, prenant acte de cette rupture,
enfermerait lopration historique lintrieur des risques dune musification de la mmoire. Mais il est une autre voie. On trouve sous la
plume de Ricur lindication dune seconde attitude possible, qui relve
dune morale de laction. Il convient, dit-il, dviter que la tension entre
les deux ples de lattente et de lexprience ne devienne schisme. Pour ce
faire, il faut, dun ct, empcher lhorizon dattente de fuir, cest--dire
se doter de projets dtermins, finis, modestes, prcisment chelonns.
Il faut, de lautre, rsister au rtrcissement de lespace dexprience, en
cessant de considrer le pass comme rvolu pour redonner au contraire
vie ses potentialits non accomplies 35 .
Lautre grand enseignement que les historiens commencent tirer des
analyses de Ricur tient une attention plus grande lcriture mme de
lhistoire. Lintervention de Franois Hartog dans le numro de la revue
Autrement consacr lhistoire est cet gard trs significative : Cest
dun philosophe quest venue la rflexion majeure sur la question du rcit
(dans son rapport avec lhistoire). Dans Temps et Rcit, Paul Ricur, soucieux de scruter le mystre du temps, considre tour tour lhistoire et la
fiction et arrive la conclusion quil ne saurait y avoir dhistoire sans un
lien, aussi tnu soit-il, avec le rcit 36.
Lintervention de Ricur aura aussi beaucoup compt pour les historiens en ce qui concerne le statut attribuer la notion dvnement, dont
il rcuse tout aussi bien les tentatives de dissolution au nom de lefficience
de la structure que sa simple exaltation comme purement dtache de son
substrat contextuel. Lvnement, selon Paul Ricur, subit une mtamorphose qui tient sa reprise hermneutique. Rconciliant les approches
continuiste et discontinuiste, Paul Ricur propose de distinguer trois
niveaux dapproche de lvnement : 1. vnement infra-significatif ;
2. Ordre et rgne du sens, la limite non-vnementiel ; 3. mergence
dvnements supra-significatifs, sursignifiants 37. Le premier emploi
correspond simplement au descriptif de ce qui arrive et voque la surprise, le nouveau rapport linstitu. On peut avancer une analogie avec
les orientations de lcole mthodique de Langlois et Seignobos. Cest le
stade de ltablissement critique des sources. En deuxime lieu, lvnement est pris lintrieur de schmes explicatifs qui le mettent en corrlation avec des rgularits, des lois. Ce deuxime moment tend subsumer
la singularit de lvnement sous le registre de la loi dont il relve, au
35. Bernard LEPETIT, ibid., p. 298.
36. Franois HARTOG, Lart du rcit historique , Autrement, Passs recomposs, n 150151, janvier 1995, p. 185.
37. Paul RICUR, vnement et sens , Raisons pratiques, Lvnement en perspective ,
n 2, 1991, p. 51-52.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 137
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
137
point dtre aux limites de la ngation de lvnement. On peut y reconnatre lorientation du paradigme des Annales. ce stade de lanalyse doit
succder un troisime moment, interprtatif, de reprise de lvnement
comme mergence, mais cette fois sursignifie. Lvnement est alors partie intgrante dune construction narrative constitutive didentit fondatrice (la prise de la Bastille) ou ngative (Auschwitz). Lvnement qui est
de retour nest donc pas le mme que celui qui a t rduit par le sens
explicatif, ni celui infrasignifi qui tait extrieur au discours. Il engendre
lui-mme le sens. Cette salutaire reprise de lvnement sursignifi ne
prospre quaux limites du sens, au point o il choue par excs et par
dfaut : par excs darrogance et par dfaut de capture 38.
Les vnements ne sont dcelables qu partir de leurs traces, discursives ou non. Sans rduire le rel historique sa dimension langagire, la
fixation de lvnement sa cristallisation seffectue partir de sa nomination. La constitution de lvnement est tributaire de sa mise en intrigue.
Elle est la mdiation qui assure la matrialisation du sens de lexprience
humaine du temps et joue le rle doprateur, de mise en relation dvnements htrognes se substituant la relation causale de lexplication
physicaliste. Lhermneutique de la conscience historique situe lvnement dans une tension interne entre deux catgories mtahistoriques que
repre Koselleck, celle despace dexprience et celle dhorizon dattente.
Les concepts restent ancrs dans le champ dexprience do ils sont ns
pour subsumer une multiplicit de significations. Peut-on affirmer alors
que ces concepts russissent saturer le sens de lhistoire jusqu permettre une fusion totale entre histoire et langage ? Comme Paul Ricur,
Reinhart Koselleck ne va pas jusque-l et considre au contraire que les
processus historiques ne se limitent pas leur dimension discursive :
Lhistoire ne concide jamais parfaitement avec la faon dont le langage
la saisit et lexprience la formule 39. Cest, comme le pense Paul Ricur,
le champ pratique qui est lenracinement dernier de lactivit de temporalisation.
Ce dplacement de lvnementialit vers sa trace et ses hritiers a suscit un vritable retour de la discipline historique sur elle-mme, lintrieur de ce que lon pourrait qualifier de cercle hermneutique ou de
tournant historiographique. Ce nouveau moment invite suivre les mtamorphoses du sens dans les mutations et glissements successifs de lcriture historienne entre lvnement lui-mme et la position prsente.
Lhistorien sinterroge alors sur les diverses modalits de la fabrication et
de la perception de lvnement partir de sa trame textuelle.
38. Ibid., p. 55.
39. Reinhart KOSELLECK, Le Futur pass. Contribution la smantique des temps historiques, EHESS, Paris, 1990, p. 195.
IX.1/IX.2
31-03-2008
138
15:52
Page 138
PAUL RICUR
En proie la mondialisation des informations, lacclration de leur
rythme, le monde contemporain connat une extraordinaire dilatation
de lhistoire, une pousse dun sentiment historique de fond 40 . Cette
prsentification a eu pour effet une exprimentation moderne de lhistoricit. Elle impliquait une redfinition de lvnementialit comme
approche dune multiplicit de possibles, de situations virtuelles, potentielles, et non plus comme laccompli dans sa fixit. Le mouvement sest
empar du temps prsent jusqu modifier le rapport moderne au pass.
La lecture historique de lvnement nest plus rductible lvnement
tudi, mais envisage dans sa trace, situe dans une chane vnementielle.
Tout discours sur un vnement vhicule, connote une srie dvnements
antrieurs, ce qui donne toute son importance la trame discursive qui les
relie dans une mise en intrigue.
Le 14 mai 1992, Ricur participe une table ronde organise par
Franois Bdarida sur lhistoire du temps prsent et dfend la lgitimit
de cette forme dhistoire, souvent conteste pour son manque de recul
critique. Il attire nanmoins lattention sur les difficults dune configuration inscrite dans la perspective dune distance temporelle courte et prconise de distinguer dans le pass rcent, dune part, le temps inachev, le
devenir en cours lorsque lon en parle au milieu du gu ce qui constitue un handicap pour cette historiographie, cest la place considrable des
prvisions et des anticipations dans la comprhension de lhistoire en
cours 41 et, dautre part, le temps clos, celui de la Seconde Guerre
mondiale, de la dcolonisation, de la fin du communisme... cet gard,
1989 devient une date intressante de clture qui permet de configurer de
s ensembles intelligibles une fois un cycle achev.
Mais lhistoire du temps prsent a aussi la capacit de retourner plusieurs de ces inconvnients en avantages. Le travail dinvestigation sur
linachev contribue dfataliser lhistoire, relativiser les chanes causales qui constituaient les grilles de lecture, le prt--penser de lhistorien.
Lhistoire du temps prsent est cet gard un bon laboratoire pour briser le fatalisme causal.
Inscrit dans le temps comme discontinuit, le prsent est travaill par
celui qui doit lhistoriciser par un effort pour apprhender sa prsence
comme absence, la manire dont Michel de Certeau dfinissait lopration historiographique 42. Cette dialectique est dautant plus difficile
raliser quil faut procder une dsintrication volontariste pour lhis-
40. Pierre NORA, De lhistoire contemporaine au prsent historique , crire lhistoire du
temps prsent, IHTP, Paris, 1993, p. 45.
41. Paul RICUR, Remarques dun philosophe , crire lhistoire du temps prsent, op. cit.,
p. 38.
42. Michel DE CERTEAU, LAbsent de lhistoire, Mame, Repres, Paris, 1973.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 139
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
139
toire du temps prsent, plus naturelle lorsquil sagit dun temps rvolu :
La question est de savoir si, pour tre historique, lhistoire du temps
prsent ne prsuppose pas un mouvement semblable de chute dans
labsence, du fond duquel le pass nous interpellerait avec la force dun
pass qui fut nagure prsent 43. On saisit ici quel point lhistoire du
temps prsent est anime par des motivations plus profondes que celles
dun simple accs du plus contemporain. Cest la qute de sens qui
guide ses recherches, autant que le refus de lphmre.
La smantique de laction ncessite un agent situ historiquement car,
pour Ricur, vcu et concept sont inextricablement lis. Rcusant la
double invitation au repli sur une ontologie fondamentale, la manire
heideggerienne, ainsi que la fermeture sur un discours purement pistmologique, Ricur met en scne des mdiations imparfaites , sources
dlaboration dune dialectique inacheve . Cest lintrieur de cet
espace intermdiaire entre doxa et pistm que se situe le domaine du
doxazein qui correspond justement chez Aristote la dialectique et
exprime la sphre de lopinion droite, celle qui ne se confond ni avec la
doxa ni avec lpistm, mais avec le probable et le vrai-semblable 44 .
Lutilisation de mdiations imparfaites convient dautant mieux lopration historiographique que celle-ci doit rester ouverte de nouvelles
lectures, de nouvelles appropriations pour les gnrations venir. Pris
dans une dialectique de larch et du tlos, le rgime dhistoricit est tout
entier travers par la tension entre espace dexprience et horizon dattente. Ricur rcuse donc le renfermement du discours historien que lon
voit se dployer aujourdhui dans un rapport purement mmoriel de
reprise du pass, coup dun avenir devenu soudainement forclos. Il rappelle la fonction de lagir, de la dette thique de lhistoire lgard du
pass. Le rgime dhistoricit, toujours ouvert vers le devenir, nest certes
plus la projection dun projet pleinement pens, ferm sur lui-mme. La
logique mme de laction maintient ouvert le champ des possibles. ce
titre, Ricur dfend la notion dutopie, non quand elle est le support
dune logique folle, mais comme fonction libratrice qui empche lhorizon dattente de fusionner avec le champ dexprience. Cest ce qui
maintient lcart entre lesprance et la tradition 45 . Il dfend avec la
mme fermet le devoir, la dette des gnrations prsentes par rapport au
pass, source de lthique de responsabilit. La fonction de lhistoire reste
donc vive. Lhistoire nest pas orpheline, comme on le croit, condition
de rpondre aux exigences de lagir.
43. Paul RICUR, Remarques dun philosophe , op. cit., p. 39.
44. Olivier MONGIN, Paul Ricur, op. cit., p. 27.
45. Paul RICUR, Du texte laction, op. cit, p. 391.
IX.1/IX.2
31-03-2008
140
15:52
Page 140
PAUL RICUR
Ricur ayant toujours eu pour vis--vis privilgi les sciences humaines,
des reprsentants de celles-ci continuent tre en dialogue avec lui. Dans
le champ de la linguistique, Jean-Claude Coquet, disciple de Greimas,
organisateur de lcole smiotique de Paris, sest dtach dune linguistique purement formelle et objectale pour se tourner vers une autre
orientation, incarne par Benveniste, qui donne la possibilit de penser
une smiotique subjectale 46 . Cette inflexion vers la prise en considration de la pertinence de lunit discursive et de la place de lnonciateur
consolide les liens dj tablis avec Ricur, mais cette fois dans une perspective de grande proximit avec ses positions philosophiques. Ricur
sappuie dailleurs sur les arguments de Jean-Claude Coquet dans sa
dmonstration de la constitution du soi lorsquil utilise la notion de nonsujet telle quelle ressort de la smiotique du sujet de discours ou daction 47.
De son ct, Jean-Claude Coquet ddie Ricur un article consacr aux
relations de Benveniste avec la phnomnologie 48. Il montre limportance des emprunts non explicites de Benveniste la phnomnologie. Ce
dernier avait dailleurs confi Ricur et Francis Jacques quel point
la lecture de Husserl avait t une de ses lectures favorites lpoque de
sa jeunesse 49 . Jean-Claude Coquet salue dans cet article la lucidit prcoce de Ricur qui, ds 1967, a peru ce quapportait la smantique de
Benveniste avec ses notions dnonciation, de prsence de la personne, de
position et de monstration... face une orientation hjelmslvienne envisage comme science des signes dans des systmes. Au smantisme clos
dominant, dplor par Ricur, Benveniste offre une alternative : la
question pose nagure par P. Ricur de savoir si lanalyse linguistique
ntait pas une phnomnologie qui signore 50, cette note sur Benveniste
apporte donc des lments de rponse positive 51.
Pour le linguiste Jean-Claude Coquet, limportance de Ricur est fondamentale pour une linguistique comme la sienne, qui accorde toute sa
pertinence aux notions de personne, de temps, de devenir, cest--dire
tout ce qui permet davoir un Je ancr dans un univers qui soit un uni-
46. Jean-Claude COQUET, Linguistique et smiologie , Actes smiotiques, IX, 88, 1987,
p. 13 ; repris dans La Qute du sens. Le langage en question, PUF, Paris, 1997, p. 31-43.
47. Paul RICUR, Jadopte ici le vocabulaire de Jean-Claude Coquet dans Le Discours et
son sujet : 1. Essai de grammaire modale ; 2. Pratique de la grammaire modale, Klincksieck,
Paris, 1984-1985 , Soi-mme comme un autre, op. cit., n. 1, p. 196.
48. Jean-Claude COQUET, Note sur Benveniste et la phnomnologie , LINX, n 26,
1992-1, p. 41-48 ; repris dans La Qute du sens. Le langage en question, op. cit., p. 73-79.
49. Ibid., p. 42.
50. Paul RICUR, Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines,
t. 2, Mouton-Unesco, Paris-La Haye-New York, 1978, p. 1466.
51. Jean-Claude COQUET, Note sur Benveniste et la phnomnologie , art. cit, p. 48.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 141
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
141
vers empli de possibles et dobstacles. Son anti-rductionnisme est particulirement fcond pour un examen des discours dans leur pluralit
dapproches et dobjets 52 .
Le dbat se poursuit aussi, plus tendu et plus conflictuel, au plan des
relations avec la psychanalyse. Jean-Jacques Kress, prsident de lAssociation franaise de psychiatrie, invite Ricur en 1986 participer au
congrs national de la socit, dont les travaux ont port sur les relations
entretenues par les psychiatres avec les thories. Il russit vaincre les
rticences de Ricur, qui prononce une confrence fortement apprcie
sur La psychanalyse confronte lpistmologie 53 . Il y repose la
question de la preuve en psychanalyse et rpond aux objections classiques des pistmologues, qui stigmatisent la psychanalyse comme une
non-science en raison de son caractre infalsifiable. Ces dtracteurs
commettent lerreur dappliquer la psychanalyse les critres dune
science de lobservation. Au contraire, Ricur insiste, dans sa dfense de
la psychanalyse, sur la spcificit de lexprience analytique en tant que
privilgiant la dimension smantique du dsir et sur la centralit de la
notion de transfert dans la relation autrui institue par la cure. Il apparente le processus engag par celle-ci au travail de deuil, dintriorisation de lobjet perdu, et rappelle aussi limportance de laprs-coup en
reprenant le concept freudien de translaboration, donc de rouverture du
chemin de la mmoire grce des squences rendues signifiantes et
ordonnes en un rcit, en une histoire de vie. Toutes ces caractristiques
de la psychanalyse font de celle-ci, selon Ricur, une pratique qui privilgie linterprtation et sapparente donc aux procdures dinvestigation
en usage dans les disciplines dinterprtation textuelle 54 . Mais il prcise
bien, rpondant aux critiques qui lui ont t adresses lpoque de la
publication de son essai sur Freud, quil ne sagit l que dune analogie et
que la psychanalyse ne se rduit pas une rgion dune hermneutique
gnrale : Nous omettrions alors des traits spcifiques de linterprtation qui ne peuvent tre saisis que quand la mthode dinvestigation est
jointe la mthode de traitement 55.
Malgr cette dfense et illustration du fait que la psychanalyse a son
propre appareil de preuves, le psychanalyste Andr Green, appel tre
le discutant de Ricur, tmoigne des rsistances encore vives dune
corporation sur la dfensive et qui rpond par lagressivit au dialogue
52. Jean-Claude Coquet, entretien avec lauteur.
53. Paul RICUR, La psychanalyse confronte lpistmologie , Psychiatrie franaise,
mai 1986, numro spcial, p. 11-23.
54. Ibid., p. 18.
55. Ibid., p. 19.
IX.1/IX.2
31-03-2008
142
15:52
Page 142
PAUL RICUR
avec la philosophie. Alors quAndr Green na pas donn dans le tir de
barrage lacanien des annes soixante, il voque l inquitante tranget 56 que suscite chez lui la confrence de Ricur et sinterroge sur le
fait que les organisateurs aient demand un philosophe de traiter de
psychanalyse : Serais-je jaloux de la place quoccupe aujourdhui
Ricur dans notre discussion ? Peut-tre 57. front renvers, alors que
Ricur avait promu le caractre scientifique de la psychanalyse, Andr
Green juge prfrable de renoncer cette ide de science pour lui substituer le qualificatif dapproximation de la vrit que lui donne Wilfried
Bion.
Parvenant vaincre les rsistances disciplinaires, Ricur aura largement contribu la ralisation du basculement interprtatif gnral que
connaissent les sciences humaines. Cette ouverture vers un nouvel espace
dialogique assurant une vritable humanisation des sciences humaines
rend possible, au-del des problmes mthodologiques, le questionnement rcent de celles-ci sur lnigme jamais rsolue de cet treensemble , du lien social, sacrifi jusquaujourdhui au profit des
diverses formes de rductionnismes, que ce soit au nom de la dtermination holiste de grandes causalits conomiques ou tatiques ou au nom de
la simple maximisation de lintrt individuel et donc dun utilitarisme
gnralis. Il semble bien que lon comprenne mieux que les monocausalismes nont pu percer lnigme du lien social et que le pluralisme explicatif, la combinatoire de modles, la controverse dinterprtations soient
plus appropris aux objets des sciences humaines. Laccs nest plus alors
lillusion dune voie directe, mais celui des dtours par de multiples
mdiations grce auxquelles les acteurs sont envisags comme des acteurs
quips, insubstituables et de ce fait plus explicites, plus rflchis. Cest
pourquoi le trait commun aux recherches en cours est la prise en compte
de ces multiples mdiations imparfaites qui font le lien social et dpassent
le faux clivage entre holisme et individualisme mthodologique : le texte
avec ses rgles discursives ainsi quavec les divers mcanismes dappropriation du ct des lecteurs, larchive et son efficace, la mmoire dans ses
diverses procdures deffectuation, les objets dans laction, les conventions comme processus rgls et fluctuants, la cognition locale et distribue, lenaction... autant de chantiers qui engagent aussi bien la nouvelle
anthropologie des sciences, la nouvelle sociologie de laction que les
sciences cognitives vers lexploration des formes dvnements autorflexifs. Cette multiplication des interprteurs, des mdiations, atteste
quil nest pas question dun simple retour un sujet transparent luimme et matre du sens de son action.
56. Andr GREEN, La psychanalyse, une science ? , ibid., p. 26.
57. Ibid.
IX.1/IX.2
03-04-2008
08:05
Page 143
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
143
Les sciences humaines dans leur qute de dterminations, de causalits
expriment les limites qui simposent la Potentia. Elles constituent donc
un dtour impratif pour saisir les points de rsistance leffectuation de
la puissance. Les sciences humaines ont toujours reprsent un dfi pour
Ricur. Leur importance se situe en effet un double niveau : celui dtre
une condition de possibilit de lexercice de la puissance dagir en tant
que limite et en mme temps un frein cette action. Ce dfi a t relev
frontalement par Ricur qui a tout au long de son parcours investi leur
logique. Ricur aura trouv aussi chez Karl Jaspers cette pense des tensions, des apories quil fera sienne. Il a dvelopp toute une pense qui
vise poser les apories en dvoilant la fois la fcondit de chacune des
positions et lincommensurabilit de chaque plan qui rend impossible
le dpassement de leur contradiction. Chacun des ples est lgitim dans
son efficience et le geste prn par Ricur est celui de lchappement de
la tension pour la rendre productive en crant des mdiations toujours
imparfaites, labiles et mouvantes qui permettent de dgager un entre-deux,
un entrelacs dans lequel une sphre de lagir humain puisse se dployer.
Il en rsulte une philosophie de larges dtours ncessaires pour sortir de
lalternative entre une philosophie de ltre-pour-soi et une philosophie
de ltre-pour-la mort, ainsi quune tentative de conciliation entre une
philosophie qui privilgie ltre-avec , celle des annes 1950 jusqu ses
rfrences lhorizontalit chez Hannah Arendt et une philosophie qui
accorde un caractre plus originaire au oui la vie par rapport la finitude et au ngatif selon les thses spinozistes de laffirmation.
Cette vise thique doit cependant faire le dtour pistmologique et
cest en ces multiples dtours que Ricur croise les sciences humaines.
cet gard, il est un des rares philosophes ouvrir sa problmatisation
en traversant leur champ dexprimentation. Son objectif en traversant
le territoire des sciences humaines est double. Il vise en premier lieu
dfendre le bien-fond de lpistmologie rgionale, spcifique de telle ou
telle approche des sciences humaines. En second lieu, il envisage son
intervention comme lexercice dune vigilance ; il fait figure de vigie face
la dmesure qui peut semparer ici et l de stratgies imprialistes
conduites par telle ou telle discipline lorsquelle srige au singulier comme
La science sociale capable dunifier sous sa baguette tout le concert des
autres sciences humaines. Dans le mme esprit, Ricur exerce sa vigilance
contre toute forme de rabattement des sciences humaines sur une physique sociale mcaniciste, vis--vis dun scientisme qui prtendrait saturer
le sens ou qui se prtendrait reprsenter une mathesis universelle.
Pour viter ces cueils, Ricur privilgie une dmarche rsolument
rflexive, au second degr, et qui ne pose pas comme alternative la qute
de la vrit et lexercice de la mthode, do son commentaire critique
vis--vis de Gadamer quand ce dernier dlaisse le pan mthodologique
IX.1/IX.2
31-03-2008
144
15:52
Page 144
PAUL RICUR
pour mieux se consacrer la vrit. Cest dans la conjonction, dans le
et que se trouve la voie suivre. Les sciences humaines sont marques
par le souci mthodique de reconstruction des structures grammaticales
du social et Ricur aura montr quelles naccomplissent leur objectif
qu condition daccepter la crise hermneutique qui doit travailler en
permanence le double mouvement du connatre et du re-connatre. La
capabilit se trouve donc mise lpreuve des dterminations sociales en
acceptant leurs conditionnements, sans y rduire lhomme. Cest ce geste
que lon retrouve dun bout lautre de limmense parcours de Ricur
entre le milieu du XXe sicle et le dbut du XXIe.
Ainsi, dans la fin des annes 1990, Ricur entreprend de dialoguer
avec celui qui incarne les neurosciences dans leur ambition la plus forte,
Jean-Pierre Changeux, dialogue qui se traduit par une publication
commune en 1998 58. De la mme manire quil stait fait accueillant aux
dcouvertes de la psychologie dans les annes 1950, Ricur est tout aussi
dispos admettre le bien-fond et lapport des sciences cognitives, mais
l encore condition quelles ne srigent pas en mathesis universelle :
Je combattrai donc ce que jappellerai dsormais un amalgame smantique, et que je vois rsum dans la formule, digne dun oxymore :
Le cerveau pense 59. Ricur oppose au rductionnisme potentiel des
neurosciences un dualisme smantique qui puisse laisser sexprimer une
dualit de perspective. Il distingue en effet trois rgimes discursifs qui
restent incommensurables : le discours du corps-objet qui relve bien
des comptences de Changeux, mais il faut y ajouter le discours du corps
propre avec ses incitations thiques et enfin le discours normatif, juridico-politique. Ricur joue donc encore une fois son rle de vigie, attentif aux passages des limites : Mes rserves ne concernent aucunement
les faits que vous articulez, mais lusage non critique que vous faites de la
catgorie de causalit dans le passage du neuronal au psychique 60.
Ricur critique notamment la relation didentit postule par Changeux
entre le signifi psychique et la ralit corticale. Cette identification abolit
la diffrence entre le signe et ce quil dsigne. Tout au contraire, pour
Ricur, cest lhtrognit smantique entre le phnomne psychique
et sa base corticale qui est importante, faisant du premier niveau lindice de lautre. Depuis le dbut de ses interventions dans le champ des
sciences humaines, la position de Ricur est la mme et consiste
dfendre fermement la position selon laquelle je veux expliquer plus
pour comprendre mieux 61 . Il avance une tierce dimension en tension
58. Jean-Pierre Changeux et Paul Ricur, La Nature et la rgle Odile Jacob, 1998.
59. Paul Ricur, Ibid., p. 25.
60. Paul Ricur, Ibid., p. 60.
61. Paul Ricur, Ibid., p. 143.
IX.1/IX.2
31-03-2008
15:52
Page 145
LA RFRENCE DU TOURNANT PRAGMATIQUE
145
entre le vcu que souhaite atteindre lapproche phnomnologique
et le connu que vise le savoir scientifique. Pour ce faire, il ne suffit pas
de brandir le comme de lanalogie qui suggre une causalit entre
le substrat et la conscience, mais la conjonction et qui permet la
connexion entre la base neuronale de la conscience et la conscience. Au
contraire, Changeux ne cesse de chevaucher sans problme les limites :
Ma position sera donc de sengager dans la voie dune naturalisation des
intentions... Une physique de lintrospection devient mme possible 62.
Cette position de nature hgmonique et totalisante est dnonce par
Ricur comme rductionniste et appauvrissante : Le reproche que
je ferais nouveau votre projet scientifique est de fdrer toutes les
disciplines annexes sous la bannire de la neurobiologie, sans tenir
compte de la varit des rfrents respectifs de ces sciences 63. La presse
salue la grande rencontre entre le savant et le philosophe et Marc Ragon
pose avec humour la question dans Libration : Lesprit soluble dans le
cortex 64 ? Claude Lefort salue la performance de Ricur dans une
lettre quil lui envoie et dans laquelle il juge lapport de Ricur dcisif
contre une nouvelle sorte de scientisme aux couleurs de la neuropsychologie et le flicite de tracer une ligne de dmarcation laquelle son interlocuteur reste aveugle 65.
62. Jean-Pierre Changeux, Ibid., p. 82.
63. Paul Ricur, Ibid., p. 197.
64. Marc RAGON, Libration, 12 mars 1998.
65. Claude Lefort, lettre Paul Ricur, 2 mars 19998, archives du Fonds Paul Ricur, IPT.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Puissance de La JoieDocument102 pagesLa Puissance de La JoieEddybarclay100% (4)
- Ferry, Luc - Apprendre À VivreDocument195 pagesFerry, Luc - Apprendre À VivreOussama Ouamari100% (3)
- Les Mots Et Les Choses - FoucaultDocument322 pagesLes Mots Et Les Choses - FoucaultIgor Arréstegui92% (13)
- Être et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÊtre et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Eric Alliez-De L'impossibilite de La Phenomenologie - Sur La Philosophie Francaise Contemporaine (Problems Et Controverses) - J. Vrin (1995)Document64 pagesEric Alliez-De L'impossibilite de La Phenomenologie - Sur La Philosophie Francaise Contemporaine (Problems Et Controverses) - J. Vrin (1995)Colectivo de Pensamiento PsicoanalíticoPas encore d'évaluation
- Gadamer - La Philosophie HerméneutiqueDocument258 pagesGadamer - La Philosophie Herméneutiquekairotic100% (1)
- Vocabulaire KantDocument1 360 pagesVocabulaire KantJoseph Omis100% (1)
- Musique Rituel SavoirDocument19 pagesMusique Rituel SavoirAmin ChaachooPas encore d'évaluation
- Alain Flajoliet La Premiere Philosophie de SartreDocument963 pagesAlain Flajoliet La Premiere Philosophie de Sartrenpite486Pas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- Alain de Libera La Querelle Des Universaux de Platon A La Fin Du Moyen AgeDocument246 pagesAlain de Libera La Querelle Des Universaux de Platon A La Fin Du Moyen AgeLeandro AntonelliPas encore d'évaluation
- HyppoliteasdDocument254 pagesHyppoliteasdAli Özdemir100% (1)
- Georg Lukács - Le Jeune Hegel. Sur Les Rapports de La Dialectique Et de L'économie, Tome I - Berne 1793 - Début D'iéna 1801.-Gallimard (1981)Document447 pagesGeorg Lukács - Le Jeune Hegel. Sur Les Rapports de La Dialectique Et de L'économie, Tome I - Berne 1793 - Début D'iéna 1801.-Gallimard (1981)antoine1255Pas encore d'évaluation
- (Jean Leroux) Une Histoire Comparée de La Philoso (B-Ok - Xyz) PDFDocument205 pages(Jean Leroux) Une Histoire Comparée de La Philoso (B-Ok - Xyz) PDFAnonymous NE7Bwby7100% (1)
- (Philippe Lacoue-Labarthe) L?Imitation Des ModerDocument286 pages(Philippe Lacoue-Labarthe) L?Imitation Des ModerXavier CanedaPas encore d'évaluation
- JERVOLINO - Paul Ricoeur - Une HermeneutiqDocument92 pagesJERVOLINO - Paul Ricoeur - Une HermeneutiqAdriane Da S. Machado Möbbs100% (6)
- AsdfDocument278 pagesAsdfMPas encore d'évaluation
- De L'essence de La Vérité. Approche de L 'Allégorie Annas Archive LibgenrsDocument198 pagesDe L'essence de La Vérité. Approche de L 'Allégorie Annas Archive Libgenrsbooks100% (1)
- Frithjof Schuon - L'oeil Du CoeurDocument111 pagesFrithjof Schuon - L'oeil Du CoeurPedro100% (1)
- Pierre Macherey Querelles CartésiennesDocument49 pagesPierre Macherey Querelles CartésiennesKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Worms - Phil Franc Sec XXDocument627 pagesWorms - Phil Franc Sec XXEmilian MărgăritPas encore d'évaluation
- Richir Le Rien Et Son ApparenceDocument194 pagesRichir Le Rien Et Son ApparenceMihaiPas encore d'évaluation
- La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- BARBARAS, R. Sartre - Désir Et LibertéDocument190 pagesBARBARAS, R. Sartre - Désir Et LibertéGiovana Temple100% (2)
- Derrida, J. PositionsDocument67 pagesDerrida, J. PositionsJohann HoffmannPas encore d'évaluation
- Le Vocabulaire de Merleau-PontyDocument64 pagesLe Vocabulaire de Merleau-Pontyegonschiele9100% (4)
- Prejuzgados - Ante La Ley, Derrida y LyotardDocument236 pagesPrejuzgados - Ante La Ley, Derrida y LyotardVero S. Luna100% (1)
- Marseille Poesie Philo 97Document290 pagesMarseille Poesie Philo 97paragesPas encore d'évaluation
- Husserl, La Crise de L' Humanité EuropéenDocument81 pagesHusserl, La Crise de L' Humanité EuropéenRobert Francis Aquino100% (1)
- Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandTractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Barbara Cassin, O. Cayla, Ph. Salazar - Verité, Réconciliation, Réparation - Com Texto de Derrida Sobre Ubuntu PDFDocument384 pagesBarbara Cassin, O. Cayla, Ph. Salazar - Verité, Réconciliation, Réparation - Com Texto de Derrida Sobre Ubuntu PDFCeleste CostaPas encore d'évaluation
- Recherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandRecherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Esthétique (Friedrich Hegel (Hegel, Friedrich) )Document1 346 pagesEsthétique (Friedrich Hegel (Hegel, Friedrich) )Anas Benayad100% (1)
- 50 de Philosophie FrançaiseDocument64 pages50 de Philosophie Françaiseeadu_toma100% (1)
- Heidegger M. - Schelling Le Traité de 1809 Sur L'essence de La Liberté HumaineDocument352 pagesHeidegger M. - Schelling Le Traité de 1809 Sur L'essence de La Liberté HumaineJean Paul100% (2)
- Alain Flajoliet La Premiere Philosophie de SartreDocument963 pagesAlain Flajoliet La Premiere Philosophie de SartreLeonardo Neusa100% (2)
- (B) Comment A Ire Des 'Meditations Cartesiennes de Husserl (Ed. J.-F. Lavigne Vrin 2008)Document145 pages(B) Comment A Ire Des 'Meditations Cartesiennes de Husserl (Ed. J.-F. Lavigne Vrin 2008)almatheyaPas encore d'évaluation
- Lyotard - Des Dispositifs PulsionnelsDocument120 pagesLyotard - Des Dispositifs PulsionnelsJoãoCamilloPenna100% (3)
- Friedrich Nietzsche Fragments Posthumes Debut 1888 Debut Janvier 1889Document578 pagesFriedrich Nietzsche Fragments Posthumes Debut 1888 Debut Janvier 1889Sergio Fernando Maciel Correa100% (1)
- Méditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Poétique D'aristote Cours H4Document55 pagesLa Poétique D'aristote Cours H4Gros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Serge Trottein Lesthetique Naitelle Au Xviiie Siecle PDFDocument85 pagesSerge Trottein Lesthetique Naitelle Au Xviiie Siecle PDFprofaudaPas encore d'évaluation
- Le Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandLe Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Dostoievski IvanovDocument177 pagesDostoievski IvanovduckbannyPas encore d'évaluation
- Jean Hyppolite - Ontologie Et Phénomenologie Chez Martin HeideggerDocument9 pagesJean Hyppolite - Ontologie Et Phénomenologie Chez Martin HeideggermeregutuiPas encore d'évaluation
- Bourgeois Bernard (2005) - La Fin de L'histoire Selon Hegel - ASMPDocument14 pagesBourgeois Bernard (2005) - La Fin de L'histoire Selon Hegel - ASMPcouturatPas encore d'évaluation
- Jean Grondin - Kant-Critérion (1993) PDFDocument102 pagesJean Grondin - Kant-Critérion (1993) PDFLucas FernandezPas encore d'évaluation
- (Clavier Paul) Premieres Lecons Sur Critique de La (B-Ok - CC) PDFDocument129 pages(Clavier Paul) Premieres Lecons Sur Critique de La (B-Ok - CC) PDFkhalidePas encore d'évaluation
- Lyotard Derive A Partir de Marx Et Freud PDFDocument106 pagesLyotard Derive A Partir de Marx Et Freud PDFDaniel Cifuentes100% (1)
- Gadamer, Hans-Chemins de HeideggerDocument259 pagesGadamer, Hans-Chemins de Heidegger140871raphPas encore d'évaluation
- Bouveresse Hermeneutique Et LinguistiqueDocument102 pagesBouveresse Hermeneutique Et Linguistiquecors495Pas encore d'évaluation
- Giova 2017 PDFDocument145 pagesGiova 2017 PDFJosé Carlos Cardoso100% (1)
- Le Problème Moral Dans La (... ) Delbos VictorDocument604 pagesLe Problème Moral Dans La (... ) Delbos VictorFabianaPas encore d'évaluation
- Delbos, Le Spinozisme, 1913Document234 pagesDelbos, Le Spinozisme, 1913hugomaxEPS100% (1)
- Revue de Droit CanoniqueDocument256 pagesRevue de Droit CanoniqueCynthia PassagliaPas encore d'évaluation
- Diogo Sardinha - L'Emancipation de Kant À Deleuze (2013, Hermann)Document246 pagesDiogo Sardinha - L'Emancipation de Kant À Deleuze (2013, Hermann)lorenamfPas encore d'évaluation
- These Sur HegelDocument480 pagesThese Sur Hegeljuandiegog10Pas encore d'évaluation
- N°208-22 Décret de Nominations 2022Document21 pagesN°208-22 Décret de Nominations 2022aa mnjkPas encore d'évaluation
- 126 Je Veux Me RéjouirDocument1 page126 Je Veux Me RéjouirPaul PHAMPas encore d'évaluation
- Sermons Sur La PassionDocument494 pagesSermons Sur La PassionClaudioPas encore d'évaluation
- Shaykh Al-Ishraq Suhrawardi's Interpretation of Shaykh Ar-Ra'is Ibn Sina's AnthropologyDocument372 pagesShaykh Al-Ishraq Suhrawardi's Interpretation of Shaykh Ar-Ra'is Ibn Sina's AnthropologyS⸫Ḥ⸫RPas encore d'évaluation
- Intro PDFDocument2 pagesIntro PDFMichael SebbanPas encore d'évaluation
- Qu'Est-ce Que Le Temps - Michele Angelo Murgia - InLibroVeritasDocument3 pagesQu'Est-ce Que Le Temps - Michele Angelo Murgia - InLibroVeritasCésar Sáenz-SuárezPas encore d'évaluation
- Read Me (Liste Des Livres Parus Pour Nephilim)Document4 pagesRead Me (Liste Des Livres Parus Pour Nephilim)thakhysisPas encore d'évaluation
- Tariq Ramadan Et Tareq Oubrou - Religiosité, Entre Émotion Et RaisonDocument1 pageTariq Ramadan Et Tareq Oubrou - Religiosité, Entre Émotion Et RaisonAnthonyPas encore d'évaluation
- Avec Une Brûlante Inquiétude - Encyclique de Pie XI Contre Le NaizismeDocument17 pagesAvec Une Brûlante Inquiétude - Encyclique de Pie XI Contre Le NaizismeHades Éditions100% (1)
- MANUEL 40 JOURS 2024 Deuxième Semaine Du 17 Au 23 Janvier 2024 OK 3Document41 pagesMANUEL 40 JOURS 2024 Deuxième Semaine Du 17 Au 23 Janvier 2024 OK 3Ndigngar BonaPas encore d'évaluation
- 2014 Meessen Yves TheseDocument379 pages2014 Meessen Yves TheseingmarvazquezPas encore d'évaluation
- Palimpseste 01Document16 pagesPalimpseste 01Kim LevrelPas encore d'évaluation
- Invocation Pour La Dette Et Les Difficultés - Hassen AmdouniDocument2 pagesInvocation Pour La Dette Et Les Difficultés - Hassen AmdouniMansour XPas encore d'évaluation
- EMC LaïcitéDocument8 pagesEMC LaïcitématisseduqPas encore d'évaluation
- La Justice de Dieu William M Greathouse & Linda M StargelDocument120 pagesLa Justice de Dieu William M Greathouse & Linda M Stargelkossi abaloPas encore d'évaluation