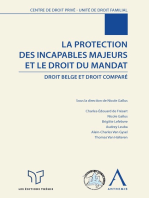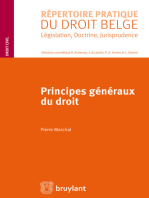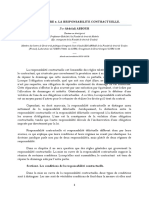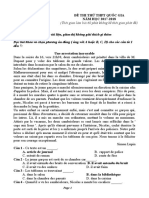Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Legalite Dissertation Droit Penal S2 PDF
Legalite Dissertation Droit Penal S2 PDF
Transféré par
Christopher ShepherdTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Legalite Dissertation Droit Penal S2 PDF
Legalite Dissertation Droit Penal S2 PDF
Transféré par
Christopher ShepherdDroits d'auteur :
Formats disponibles
Principe de contrle de la lgalit
Semestre 2
Bien quil existe plusieurs dfinitions du principe de lgalit tantt matrielle que formelle, une citation
peut le rsumer de faon simple : pas de crime ni de peine sans loi . Sous l'ancien rgime, la
lgislation royale comportait de nombreuses lacunes en matire pnale. Les juges disposaient d'un
large pouvoir pour dfinir les comportements rprhensibles et fixer la peine applicable. La peine
encourue devenait indtermine et alatoire. Au XVIII me sicle, l'arbitraire des juges est devenu
synonyme d'injustice. Progressivement le principe de la lgalit des dlits et des peines va se mettre
en place et il va y rester. Historiquement ce n'est qu'en 1789 dans la Dclaration des Droits de
l'homme et du citoyen qu'a t affirme la ncessit de ce qu'une infraction soit prvue et
sanctionne par un texte. Aujourdhui nous sommes dans un Etat de droit o des rgles sont poses
par la loi et la Constitution. Le juge ne peut pas punir quelquun dont lactivit na pas t juge
rprhensible par un texte. Il ny a pas de condamnations sans un texte. Le principe de lgalit s'est
rpandu et a fait l'objet d'une certaine reconnaissance au niveau international, avec une sanction
juridique plus ou moins efficace. Cesare Beccaria est lauteur du Trait des dlits et des peines et
principal acteur dans la dmarche de reconnaissance du principe de lgalit. Il propose une
illustration trs prcise en dclarant quen prsence de tout dlit, le juge doit former un syllogisme
. Le principe de lgalit des dlits et des peines existe probablement depuis longtemps. Par contre il
a t identifi quau Sicle des Lumires puisquavant la loi t arbitraire.
I) La place du lgislateur face au principe de lgalit des dlits et des peines
Le lgislateur est soumis certaines obligations mais aussi des interdictions. Il doit imprativement
crer des rgles juridiques claires et prcises. De plus, il lui est interdit, en matire pnale, de
lgifrer de manire rtroactive. Larticle 34 de la Constitution dfini la place du pouvoir
rglementaire au sein de la socit. La Constitution rpartit la fonction de punir entre le lgislateur et
le pouvoir rglementaire. En tant que source principale du principe de lgalit des dlits et des
peines, le lgislateur est soumis certaines obligations mais aussi des interdictions.
A-
Les obligations du lgislateur
Sa premire obligation est de lgifrer des textes clairs et prcis, non seulement pour dfinir
linfraction mais aussi la sanction encourue. Ce principe oblige le lgislateur lgifrer des textes
afin que chaque individu puisse prvoir les consquences encourues par le non respect dun tel
comportement. Les textes doivent tre accessibles et prvisibles pour tous afin de lutter contre
larbitrage. Une dfinition trop vague de linfraction contraindrait le juge pnal interprter, ce qui sort
de sa comptence. Toute infraction doit tre dfinit par le lgislateur lui-mme. De plus,
lincrimination dont dcoule la sanction pnale doit aussi faire lobjet de prcision. Cependant, la
sanction se trouve parfois face limprcision des textes rpressifs parce que certaines
incriminations chappent la sanction quelque soit leurs caractres moralement punissable. Le
lgislateur peut lgifrer des textes, par contre il lui est interdit ddicter des rgles juridiques pnales
rtroactives.
B-
Interdiction ddicter des textes rtroactifs
Le principe de la non rtroactivit des lois dcoule directement du principe de lgalit des dlits et
des peines qui sont fond sur le principe de la scurit juridique. Il convient de le dfinir et de
prciser ses effets dans le droit pnal. La non rtroactivit sapplique pour les lois pnales plus
strictes. Cela signifie que lon ne peut condamner un individu pour un fait quil aurait commis avant
lentre en vigueur de la loi nouvelle.
La date de linfraction est parfois difficile dterminer. En principe cest celle du jour o elle a tait
commise. Lapplication de ce principe entrane des difficults, comme par exemple lorsque linfraction
est continue, ce moment l, si elle perdure sous la loi nouvelle elle lui sera soumise. La relle
difficult se rvle lorsque les faits sont commis avant lentre en vigueur de la loi nouvelle et que le
jugement nest pas encore dfinitif. En principe si une infraction nest pas encore juge alors que la
loi nouvelle est en vigueur, mais que linfraction fut commise sous couvert de la loi ancienne, la loi
nouvelle ne pourra pas sappliquer. Concernant les lois interprtatives qui viennent claircir une loi
dj existante, elles rtroagiront la date dentre en vigueur de la loi quelle interprte.
II) Restriction du juge pnal
Le juge pnal ne peut pas pouvoir crer des rgles juridiques pnales puisque linterprtation de la
loi est trs stricte. Il nest pas habilit contrler la Constitutionnalit dune loi. On explique cette
incomptence par le principe de la sparation des pouvoirs. Le juge ne peut pas simmiscer dans la
fonction lgislative.
A- Linterdiction de crer des rgles juridiques pnales
En droit pnal le juge est soumis 2 obligations dcoulant directement du principe de la lgalit des
dlits et des peines. En effet, il doit appliquer la rgle textuelle dicte par le lgislateur et ne peut
pas la changer. Le juge ne peut pas relever dinfraction l o la loi nen prvoit pas. Le juge est
totalement li au texte, il doit interprter le texte de manire littrale. Par consquent, il ne peut pas
prononcer de peines non prvues, ni sanctionner un comportement non dfinit par un texte lgislatif.
Il ne doit que constater lensemble des lments constitutifs prvus par le texte dincrimination. Le
juge ne peut crer de rgles juridiques.
B- Linterprtation stricte de la loi
Larticle 111-4 du code pnal ne lui laisse aucune libert dinterprtation. Il ne peut y avoir de
jurisprudence en la matire mais la prsence du juge est tout de mme ncessaire et il dispose dun
certain pouvoir. A diffrence du droit civil o il est dot dun rel pouvoir dinterprtation des textes
lorsque ces derniers sont imprcis, en droit pnal le juge est tenu aux dispositions du texte, il ne peut
en tendre son champ dapplication. Les raisons de cette restriction se fondent sur la sauvegarde
des liberts des citoyens. Larticle 111-5 du code pnal prvoit que les juridictions pnales sont
comptentes pour interprter les actes administratifs rglementaires ou individuels, et pour en
apprcier la lgalit lorsque de cet examen dpend la solution du procs pnal qui lui est soumis.
MED BENAYAD
https://www.facebook.com/benayad.officiel.design
https://www.facebook.com/fac.tanger
Vous aimerez peut-être aussi
- Méthode Cas Pratique DROIT PENALDocument7 pagesMéthode Cas Pratique DROIT PENALseptemiunii97% (31)
- Fiches D'arret 2 Conf.Document6 pagesFiches D'arret 2 Conf.de moPas encore d'évaluation
- Michel Rousset - Contentieux Administratif Au Maroc PDFDocument18 pagesMichel Rousset - Contentieux Administratif Au Maroc PDFMohamed Amine Benayad67% (3)
- Résumé Procédure PénaleDocument25 pagesRésumé Procédure PénaleAnas LeonardoPas encore d'évaluation
- DLF - S5 - Contrats Nommés - PR ARBAOUI - Chapitre 1Document26 pagesDLF - S5 - Contrats Nommés - PR ARBAOUI - Chapitre 1Hasnæ ÑlPas encore d'évaluation
- Exposé (Droit Processuel)Document22 pagesExposé (Droit Processuel)Du Ja50% (2)
- الاثراء بلا سببDocument53 pagesالاثراء بلا سببDRISS BENMALEK67% (6)
- Arrêt Bartholo - CA Alger 24 Décembre 1889Document5 pagesArrêt Bartholo - CA Alger 24 Décembre 1889Mohamed Amine Benayad100% (2)
- Chapitre 1 - Principe de La Légalité CriminelleDocument8 pagesChapitre 1 - Principe de La Légalité Criminelleedvin78160100% (1)
- Cas PratiqueDocument7 pagesCas PratiqueAlice Faverot100% (2)
- Fiches Droit Penal Special l3Document43 pagesFiches Droit Penal Special l3septemiunii67% (3)
- DissertationDocument3 pagesDissertationrombdrPas encore d'évaluation
- Résumé Du DIPDocument3 pagesRésumé Du DIPBadr fkPas encore d'évaluation
- Les Contrats Commerciaux S5Document5 pagesLes Contrats Commerciaux S5Mohamed Amine Benayad80% (10)
- Les Instruments de Paiement Et de CréditDocument5 pagesLes Instruments de Paiement Et de CréditMohamed Amine Benayad71% (7)
- Le Tournant Linguistique en AnthropologieDocument32 pagesLe Tournant Linguistique en AnthropologieLaurie SavardPas encore d'évaluation
- Sémiotique Figurative Et Sémiotique Plastique PDFDocument28 pagesSémiotique Figurative Et Sémiotique Plastique PDFvelhobiano67% (3)
- Droit Pénal Général PDFDocument23 pagesDroit Pénal Général PDFOunacer Aboumarwa100% (3)
- Mesures d'exécution et procédures collectives: Confrontation des règles de l'exécution et du droit des entreprises en difficultéD'EverandMesures d'exécution et procédures collectives: Confrontation des règles de l'exécution et du droit des entreprises en difficultéPas encore d'évaluation
- La protection des incapables majeurs et le droit du mandat: Droit belge et droit comparéD'EverandLa protection des incapables majeurs et le droit du mandat: Droit belge et droit comparéPas encore d'évaluation
- Les obligations contractuelles en pratique: Questions choisies (Belgique)D'EverandLes obligations contractuelles en pratique: Questions choisies (Belgique)Pas encore d'évaluation
- À la découverte de la justice pénale: Paroles de juristeD'EverandÀ la découverte de la justice pénale: Paroles de juristePas encore d'évaluation
- Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesD'EverandLe contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesPas encore d'évaluation
- Résumé Général de La Matière Instruments de Paiement Et de CréditDocument3 pagesRésumé Général de La Matière Instruments de Paiement Et de CréditSàRàa Büyûkûstún IIPas encore d'évaluation
- L'element Moral de L'infraction PenaleDocument2 pagesL'element Moral de L'infraction PenaleCharlie BrownPas encore d'évaluation
- Droit de L'hommeDocument17 pagesDroit de L'hommeihab hajjajPas encore d'évaluation
- Criminologie 2014Document12 pagesCriminologie 2014Lacramioara MitrofanPas encore d'évaluation
- Cours Droit Pénal Général - ResuméDocument39 pagesCours Droit Pénal Général - ResuméHAMIDPas encore d'évaluation
- Code de La Procédure PénaleDocument279 pagesCode de La Procédure Pénaledossari23100% (1)
- Resume Cours Libertes Publiques - CursDocument13 pagesResume Cours Libertes Publiques - Curslaviniasuta50% (2)
- Le Role de Juge Dans La Protection de LeDocument40 pagesLe Role de Juge Dans La Protection de LeYoussef BoutayebPas encore d'évaluation
- Droit Pénal Des MineursDocument22 pagesDroit Pénal Des MineursZina ZGPas encore d'évaluation
- Le Ministère Publique Au MarocDocument3 pagesLe Ministère Publique Au MarocHabib Med Ramires50% (4)
- COURS PROF 1 - Organisation AdministrativeDocument23 pagesCOURS PROF 1 - Organisation AdministrativeLina Ad100% (1)
- Police Administrative - Définition, Mesures Et Limites - Cours de Droit PDFDocument14 pagesPolice Administrative - Définition, Mesures Et Limites - Cours de Droit PDFPierre Carol KouangaPas encore d'évaluation
- Pr. Taoufik RABHI Droit Pénal GénéralDocument216 pagesPr. Taoufik RABHI Droit Pénal Généralsaid100% (1)
- La Perte de La Nationalité MarocaineDocument16 pagesLa Perte de La Nationalité Marocainenoureddine50% (2)
- Détention PréventiveDocument18 pagesDétention PréventiveMohamed Aitoujdid addiPas encore d'évaluation
- Master 1 Privé - Droit COURS DE PROCEDURE PENALEDocument66 pagesMaster 1 Privé - Droit COURS DE PROCEDURE PENALEDegre Lakota100% (3)
- Cours de Procédure Pénale (Version Actualisée 2020)Document53 pagesCours de Procédure Pénale (Version Actualisée 2020)Bouchra Ktami100% (1)
- L'action Publique Et L'action CivileDocument2 pagesL'action Publique Et L'action CivileReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Droit Penal SpecialDocument64 pagesDroit Penal Specialelodie pichardPas encore d'évaluation
- Cours de Droit International Prive I.Document57 pagesCours de Droit International Prive I.Flo FeralPas encore d'évaluation
- Responsabilité Civil ContractuelleDocument6 pagesResponsabilité Civil ContractuelleAli Mes100% (1)
- Résumé Du Procédure Pénale by LebbarDocument34 pagesRésumé Du Procédure Pénale by Lebbarsara saraPas encore d'évaluation
- Action Administrative DLF S3Document72 pagesAction Administrative DLF S3ReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Cours Droit Penal GeneralDocument32 pagesCours Droit Penal GeneralIbrahima Gueye83% (6)
- Commentaire D'arrêtDocument18 pagesCommentaire D'arrêtKhaoula Khaoula100% (3)
- L'organisation JudiciaireDocument14 pagesL'organisation JudiciaireSalma Ouardane100% (2)
- Elements Constitutifs de L' Infraction FicheDocument2 pagesElements Constitutifs de L' Infraction Fichefafinette100% (1)
- Droit PénalDocument105 pagesDroit PénalZahi Abdelaziz0% (1)
- Element Correction DissertationDocument72 pagesElement Correction DissertationMarion FerryPas encore d'évaluation
- Les Principes Directeurs Du Process JudiciaireDocument722 pagesLes Principes Directeurs Du Process JudiciaireAnonymous HIjKhbspPas encore d'évaluation
- TC Blanco 1873Document2 pagesTC Blanco 1873tomcap33100% (3)
- Résumé Action Administrative S3Document15 pagesRésumé Action Administrative S3sim100% (1)
- Droit Pénal SpécialDocument5 pagesDroit Pénal Spécialnouna1nouna100% (3)
- Cours Des Grands Systèmes Constitutionnels Cours NachetDocument68 pagesCours Des Grands Systèmes Constitutionnels Cours NachetYassmineBichichiPas encore d'évaluation
- S2 Organisation AdministrativeDocument4 pagesS2 Organisation AdministrativeBouchra AzrafPas encore d'évaluation
- Code de Procedure Civile MarocDocument141 pagesCode de Procedure Civile Marocberradam7693Pas encore d'évaluation
- Le Droit AdministratifDocument6 pagesLe Droit AdministratifMohamed Amine Benayad100% (2)
- Procédure Pénale 2Document27 pagesProcédure Pénale 2Othmane El YakoubiPas encore d'évaluation
- Expose Circonstances AggravantesDocument18 pagesExpose Circonstances AggravantesSouhaima ZeghoudPas encore d'évaluation
- Droit Pénal Général Au MarocDocument56 pagesDroit Pénal Général Au MarocMohamed Amine Benayad100% (24)
- Cours Economie MondialeDocument70 pagesCours Economie MondialeDaf Abdessalam FadPas encore d'évaluation
- Statistique I Cours (A&b) - 12!13!14xDocument35 pagesStatistique I Cours (A&b) - 12!13!14xMohamed Amine BenayadPas encore d'évaluation
- Arrêt BauffrementDocument1 pageArrêt BauffrementMohamed Amine BenayadPas encore d'évaluation
- Ex. Cour de CassationDocument1 pageEx. Cour de CassationMohamed Amine BenayadPas encore d'évaluation
- Les Méthodes de Rédaction Juridique: La Courte Échelle Pour Les Juristes, Les Futurs JuristesDocument37 pagesLes Méthodes de Rédaction Juridique: La Courte Échelle Pour Les Juristes, Les Futurs JuristesMohamed Amine Benayad100% (7)
- La Règle de Conflits Des Lois Et GRANDS ARRETS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVEDocument8 pagesLa Règle de Conflits Des Lois Et GRANDS ARRETS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVEMohamed Amine Benayad100% (1)
- Les Sources Du DroitDocument2 pagesLes Sources Du DroitMohamed Amine Benayad100% (4)
- Centralisation Et DécentralisationDocument1 pageCentralisation Et DécentralisationMohamed Amine Benayad100% (1)
- Droit BudgétaireDocument5 pagesDroit BudgétaireMohamed Amine Benayad100% (1)
- Criminologie S5 ExposéDocument17 pagesCriminologie S5 ExposéMohamed Amine Benayad0% (1)
- Droit CommercialDocument3 pagesDroit CommercialMohamed Amine Benayad100% (1)
- Organisation Judiciaire Au Maroc S2Document5 pagesOrganisation Judiciaire Au Maroc S2Mohamed Amine Benayad100% (4)
- La Tentative en Droit Pénal S2Document1 pageLa Tentative en Droit Pénal S2Mohamed Amine Benayad100% (1)
- La Non Rétroactivité Des Lois Pénales S2Document2 pagesLa Non Rétroactivité Des Lois Pénales S2Mohamed Amine BenayadPas encore d'évaluation
- Droits de L'hommeDocument4 pagesDroits de L'hommeMohamed Amine BenayadPas encore d'évaluation
- Le Pouvoir en IslamDocument2 pagesLe Pouvoir en IslamMohamed Amine BenayadPas encore d'évaluation
- Droit FiscalDocument7 pagesDroit FiscalMohamed Amine Benayad100% (3)
- Méthode de Travail UniversitaireDocument4 pagesMéthode de Travail UniversitaireMohamed Amine BenayadPas encore d'évaluation
- Libertés PubliquesDocument5 pagesLibertés PubliquesMohamed Amine Benayad100% (1)
- Le Droit de TravailDocument4 pagesLe Droit de TravailMohamed Amine Benayad100% (1)
- La Règle de DroitDocument7 pagesLa Règle de DroitMohamed Amine Benayad75% (4)
- Notions Fondamentales de Droit PublicDocument5 pagesNotions Fondamentales de Droit PublicMohamed Amine BenayadPas encore d'évaluation
- Droit PositifDocument11 pagesDroit PositifMohamed Amine Benayad100% (1)
- Le Droit AdministratifDocument6 pagesLe Droit AdministratifMohamed Amine Benayad100% (2)
- Gui 2Document6 pagesGui 2Phú NguyễnPas encore d'évaluation
- CNED Agreg-Phi Cours CiceronDocument109 pagesCNED Agreg-Phi Cours Ciceronzinelh100% (1)
- French Ab Initio Paper 1 SL Markscheme FrenchDocument8 pagesFrench Ab Initio Paper 1 SL Markscheme FrenchAymeric Marty100% (1)
- Perceval Le Gallois Tome 1Document713 pagesPerceval Le Gallois Tome 1murielle hautphennePas encore d'évaluation
- Le Parnasse, Grand Mouvement Littéraire PoétiqueDocument2 pagesLe Parnasse, Grand Mouvement Littéraire Poétiquesaida.rhanoui07Pas encore d'évaluation
- Carmen Bernand - de Colonialismos e Imperios: Respuesta A Annick LempérièreDocument6 pagesCarmen Bernand - de Colonialismos e Imperios: Respuesta A Annick LempérièreCarlos G. Hinestroza GonzálezPas encore d'évaluation
- Daruma 14Document132 pagesDaruma 14chreod99Pas encore d'évaluation
- TEC La CultureDocument3 pagesTEC La CultureMoe FinancePas encore d'évaluation
- On Derrida and NancyDocument14 pagesOn Derrida and NancyEmmanuel VelayosPas encore d'évaluation
- Connexions Entre Le Neo Chamanisme Et Le Neo Druidisme Con Tempo Rains Etude en Anthropologie Ethnologie CompareeDocument29 pagesConnexions Entre Le Neo Chamanisme Et Le Neo Druidisme Con Tempo Rains Etude en Anthropologie Ethnologie CompareeJacques FourcadePas encore d'évaluation
- Comment Faire Une Étude OrganisationnelDocument14 pagesComment Faire Une Étude Organisationnelsofiane ouchenePas encore d'évaluation
- Cartas de Comte Ao Dr. RobinetDocument98 pagesCartas de Comte Ao Dr. RobinetTiago AlmeidaPas encore d'évaluation
- Ducrot (Quelques Raisons de Distinguer 'Locuteurs' Et 'Énonciateurs')Document13 pagesDucrot (Quelques Raisons de Distinguer 'Locuteurs' Et 'Énonciateurs')Claudiene DinizPas encore d'évaluation
- Résultats TEFAQ PDFDocument2 pagesRésultats TEFAQ PDFAnkitAgrawaly2k4Pas encore d'évaluation
- Emile Benveniste - Problemes de Linguistique Generale, 1 (1976, Gallimard) - Libgen - LiDocument7 pagesEmile Benveniste - Problemes de Linguistique Generale, 1 (1976, Gallimard) - Libgen - LiCurriculum VitaePas encore d'évaluation
- Le Poème de Gudrun, Cycle de Légendes de La Mer Du NordDocument294 pagesLe Poème de Gudrun, Cycle de Légendes de La Mer Du NordXru Whitestag ValkyrnightPas encore d'évaluation
- Le Sens de L'ouïeDocument145 pagesLe Sens de L'ouïeyeno100% (2)
- Ricci JGDocument25 pagesRicci JGliujialev13Pas encore d'évaluation