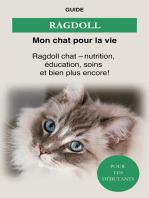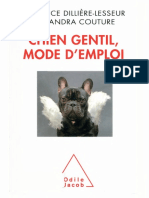Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Couleurs de La Robe Chez Le Chien
Transféré par
Christian De BoeckCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Couleurs de La Robe Chez Le Chien
Transféré par
Christian De BoeckDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les couleurs de la robe chez le chien
par le Professeur Courreau (Service de Zootechnie, cole Nationale Vtrinaire d'Alfort) reproduit avec l'aimable autorisation de La Lettre du Chien
La gntique des robes est une discipline encore mal connue par les leveurs. Au travers de quelques exemples, le lecteur en comprendra le dterminisme. La grande varit des robes chez le chien fait croire que le dterminisme gntique des couleurs de la robe est extrmement complexe. En fait, c'est assez simple dans la plupart des cas. Ce court article va essayer de le montrer. Pour une information complte, envisageant la totalit des robes et des gnes connus, il conviendra de se reporter au fascicule "les couleurs de robes chez le chien" que la S.C.C. a fait paratre (auteur : Professeur Bernard Denis de l'cole Vtrinaire de Nantes).
PRAMBULE
Le poil de l'animal sauvage, en particulier celui du loup, contient deux types de pigment : l'eumlanine, pigment sombre (noir marron) plutt concentr la pointe du poil, et la phaeomlanine, pigment clair (rouge jaune) plutt prsent la base du poil. Les nombreuses robes observes chez le chien sont la consquence de mutations qui agissent dans trois directions ; limination de l'un ou de l'autre des pigments, attnuation de l'intensit d'une ou plusieurs couleurs, extension ou rgression des couleurs sur le corps. Ces trois volutions peuvent se combiner. Elles dterminent les grands types de robes que nous envisagerons en allant des plus simples aux plus compliques. La prsence de blanc dans la robe sera tudie la fin. Prcisons, avant de commencer, que huit groupes ou sries de gnes sont ncessaires pour dterminer la robe d'un chien. On les appelle sries A, B, C, D, E, G, M et S.
LES ROBES PRIMAIRES
Les robes primaires sont des robes dont tous les poils de couleur sont identiques
Les robes poils unicolores
Les robes sombres Ce sont les robes noires ou marron. On ne voit donc que l'eumlanine. La robe marron correspond aussi aux appellations chocolat, foie et, parfois, chtaigne ou chtain. Les gnes en cause constituent la srie B : "B" (B pour "Black"), dominant et "b", rcessif. Dans une race o n'existe que le noir, tous les chiens sont porteurs du couple "B.B" ;
s'il n'existe que le marron, tous les animaux sont "b.b". Dans une race o coexistent noir et marron on en dduit que : - un chien noir peut tre de type "B.B" ou "B.b" ; accoupl une chienne noire, on n'obtiendra des chiots marron, en minorit, que si celle-ci est "B.b". - un chien marron est "b.b" ; il ne donnera des chiots marron qu'avec une chienne "b.b" (100 % de chiots marron) ou "B.b" (environ 50 % de chiots marron). Le gnotype d'un reproducteur noir peut donc tre rvl par la couleur de robe des descendants. La recherche d'un ascendant marron est l'autre moyen de souponner qu'il possde un gne "b" ; si cet ascendant est pre ou mre, la prsence est certaine. Ces quelques principes de gntique mendlienne, rappels ici pour la srie B, s'appliquent de la mme faon aux sries de gnes venir. Les robes claires Ce sont toutes les robes qui vont du jaune au rouge (pigments phaeomlaniques). Elles correspondent de nombreuses appellations, telles que froment, citron, dor ou golden, orange, chtain, acajou. En fait toutes ces robes peuvent tre regroupes en une seule : la robe dite fauve. Elles ont toutes en commun de possder le gnotype "e.e". Celui-ci a la proprit d'effacer toute trace d'eumlanine, comme si les gnes "B" et "b" ne fonctionnaient pas. Le gne "e" est rcessif et l'allle dominant correspondant est "E" (E pour "extension de l'eumlanine") ; tous les animaux qui ont du noir ou du marron dans la robe le possdent et son soit "E.e", soit "E.E". Ensemble, les gnes de la srie B et de la srie E vont raliser des gnotypes quatre gnes. Dans une race o coexistent noir, marron et fauve, un chien fauve peut tre de gnotype "B.B"-"e.e" ou "B. b"-"e.e" ou "b.b"-"e.e". Si ne coexistent que le noir et le fauve, un chien fauve est "B.B"-"e.e". Enfin, comment expliquer de telles diffrences de tons entre les robes fauves ? Cela tient l'existence de gnes dits modificateurs qui claircissent ou foncent la couleur. Ces gnes sont nombreux et peuvent se slectionner de la mme manire que ceux qui permettent d'augmenter ou de diminuer la taille. Les robes dilues. Il s'agit de couleurs bleue, beige et sable ; elles s'obtiennnent partir des noire, marron et fauve. La dilution est le fait d'un gne appel "d", soit d'un autre tout fait diffrent appel "Cch" (ch pour "chinchilla"). Tous deux sont rcessifs, respectivement par rapport "D" (D pour "Dilution) et "C" (C pour "Coloration), allles dominants prsents chez les chiens robe noire, marron ou fauve. Le bleu dont on parle n'a rien voir avec la dnomination "bleu" qui correspond un mlange de poils noirs et de poils noirs donnant, distance, une apparence bleute (ex. : le Bleu de Gascogne). Il faut aussi le distinguer du gris : le chien bleu l'est ds sa naissance et sa truffe est bleu-noir. On trouve le bleu chez le Whippet, par exemple. Le chien robe bleue possde le couple de gnes "d.d" (le chien noir est "D.D" ou "D.d") ; pour les gnes des sries B et E, il porte les mmes qu'un chien noir.
Le beige est exactement au marron ce que le bleu est au noir. Le Braque de Weimar est beige. Le sable va d'un fauve trs ple au blanc. Cette dilution peut, elle, tre obtenue par deux voies : le chien est de gnotype "Cch. Cch" ou "d.d". Cela dpend des races ; en fait, le savoir n'a gure d'importance. Le degr d'claircissement dpend de gnes modificateurs que les animaux possdent en plus ou moins grand nombre. Le Labrador biscuit ou ivoire et le samoyde sont des chiens sable. Pour les sries B et E, ces chiens portent les mmes que les chiens fauves.
Les robes poils bicolores.
Ces robes sont semblables au type sauvage : le poil est fauve ou sable la base et fonc (noir, rarement marron) l'extrmit. On parle de robes fauve charbonn ou sable charbonn. Elles sont appeles, entre autres, poil de sanglier, poil de livre, poivre et sel, gris fer, parfois grises simplement. Les races concernes sont nombreuses : Tervueren, Griffon Nivernais, Schnauzer, par exemple. Une nouvelle srie de gnes intervient ici : la srie A (A pour "Agouti", rongeur amricain). Les robes charbonnes sont dtermines par le gne "Ay" qui rgit donc la rpartition peu prs quilibre de l'eumlanine et de la phaeomlanine sur le poil. Cette action vient compliquer celles des autres sries de gnes ; par exemple, outre "Ay", le chien sable charbonn de noir portera au moins un "B", au moins un "E" et "d.d" ou "Cch. Cch". Il faut savoir que le gne dominant dans la srie A n'est pas "Ay". Juste au-dessus de lui existe "As" qui donne le caractre uniforme aux robes sombres : un chien tout noir ou tout marron est ainsi porteur d'au moins u, gne "As". Si ces chiens sont Homozygotes "As.As", leur descendance sera de robe sombre uniforme quel que soit le partenaire de l'accouplement.
LES ROBES DRIVES
Les robes drives comportent deux ou trois types de poils de couleurs diffrentes.
Les robes unicolores
L'apparence unicolore est due au mlange intime des types de poils. La robe la plus rpandue est la grise. C'est la seule qu'il convient d'appeler ainsi. Le chiot nat noir et devient gris en grandissant du fait de la pousse de poils blancs ; la truffe reste noire. Citons les exemples du Caniche gris ou du Bedlington terrier. Plus rares sont les robes dites grge et aubre, respectivement mlanges de poils blancs et marron et de poils blancs et fauves. L'arrive de poils blancs est due un gne "G" d'une nouvelle srie, la srie g (G pour "Grisonnement"). Ce gne qui provient d'une lointaine mutation est dominant par rapport au gne normal, originel "g" qui n'a pas d'action. Pour savoir ce que sont les
gnes des autres sries, il faut se reporter simplement la robe du chiot la naissance, c'est--dire noire, marron ou fauve.
Les robes pluricolores.
Les robes pluricolores sont formes par la juxtaposition de plages de couleurs diffrentes, blanc exclus. Les robes fauves ou sable manteau sombre. Ces robes sont trs rpandues : on se contentera de citer le Berger Allemand pour le fauve manteau et le Malamute pour le sable manteau. Le manteau sombre (de noir charbonn, le marron existant aussi) peut tre rduit une petite selle sur le dos ou, au contraire, aller jusqu' l'envahissement de presque tout le corps ; cette extension est, l encore, le fait de gnes modificateurs. Proche de la robe fauve ou sable charbonn, la robe manteau lui serait, selon certains auteurs, gntiquement identique. Retenons plutt que le gne responsable, appartenant la srie A, lui aussi, est "Asa" (sa pour "saddle", selle en anglais). Du point de vue de la dominance, il se situe au mme niveau que "Ay". Les robes sombres marques fauves ou sable Elles correspondent la robe dite "noire et feu", telles que rencontres en race Doberman. Ce type de robe se caractrise par ses marques feu de faible tendue, trs prcisment localises : lvres, joues, paupires, gorge, poitrine, pieds, devant des cuisses, fesses, anus. Ceci permet peu prs toujours la distinguer de certaines robes manteau sombre trs envahissant. De plus, les marques feu varient peu en tendue de la naissance l'ge adulte. Le gne responsable de la robe marques feu appartient la srie A et s'appelle "at". Il est rcessif par rapport tous les autres gnes de la srie : tous les chiens prsentant cette robe sont donc de gnotype "at.at" ; ainsi, leur descendance, dans sa totalit, n'aura la mme robe que si l'autre partenaire de l'accouplement porte celle-ci aussi. La robe bringe et la robe masque Ces deux robes sont bien connues mais parfois difficiles reprer quand les bringeures ou le masque sont discrets et que, de surcrot, le poil est long : il peut alors y avoir confusion avec une robe simplement charbonne. Celle-ci n'est, par ailleurs, pas incompatible avec le masque alors que, normalement, le bring s'impose au charbonn. Gntiquement, l'origine de ces deux robes se situe dans la srie E. La robe bringe est due au gne "Ebr", de mme niveau de dominance que "E" ; le masque quant lui, est d au gne "Em", d'o la possibilit d'avoir des chiens bringeures et masque : ils sont de gnotype "Em.Ebr". Bien sr, "Em" et "Ebr" ne peuvent s'exprimer quand le chien porte "As" puisque la robe est uniformment sombre ! Ils peuvent le faire, en revanche, avec les autres gnes de la srie A ; leur action est cependant discrte avec "at" (robe noire et feu).
Les robes bigarres Les robes bigarres sont celles que l'on appelle Merle ou Arlequin. Leur particularit tient l'existence de plages dchiquetes d'une certaine couleur sur un fond de la mme couleur dilue : noir sur bleu, parfois marron sur beige, exceptionnellement fauve sur sable. Une dilution trs forte allant jusqu'au blanc explique l'Arlequin. Le gne responsable est le gne "M" de la srie M qui domine le gne normal "m", sans action. Le gnotype homozygote "MM" est connu pour tre li des anomalies oculaires et auditives. L'action de "M" se superpose l'action des gnes des autres sries.
LES ROBES PANACHES
Ce sont toutes les robes qui portent une panachure, c'est--dire des taches blanches. On les dit pie, aussi. Toutes les robes tudies auparavant peuvent avoir une variante avec une panachure plus ou moins tendue. Gntiquement, pour expliquer la prsence de blanc, il suffit d'ajouter l'action des gnes des sries prcdentes celles des gnes de la srie S. On en distingue quatre qui sont, par ordre de dominance dcroissante "S" (absence de blanc), "si" (trs peu de blanc), "sp" (quilibre des plages blanches et colores), "sw" (blanc envahissant). Toutes les panachures intermdiaires entre ces quatre types sont possibles grce l'action de gnes modificateurs. En pratique cela veut dire que l'on peut slectionner assez facilement une certaine proportion de blanc dans la robe, voire une certaine forme de tches. l'extrme, on peut slectionner des chiens blancs partir du gnotype "sw. sw", comme cela s'est fait en race Coton de Tular.
CONCLUSION
Pour amliorer la qualit de la robe, il faut comprendre comment celle-ci est dtermine gntiquement. Pour cela il faut d'abord l'identifier exactement et la rattacher l'un des types que nous venons de voir. Ceci n'est pas toujours ais : des robes de gnotypes apparemment diffrents ont le mme gnotype. L'tude et l'exprience permettront, petit petit, de dominer la plupart des problmes.
1997-2000 CCCE crire au Club 15 janvier 2000
er 2000
Vous aimerez peut-être aussi
- Theorie Galop 4 CorrectionsDocument6 pagesTheorie Galop 4 Correctionsandaloussi billelPas encore d'évaluation
- Document Manipulation-ContentionDocument21 pagesDocument Manipulation-ContentionLwalidaPas encore d'évaluation
- Les Peurs Chez Le ChienDocument182 pagesLes Peurs Chez Le ChienDany Noe100% (1)
- HS-HA Chez Le ChienDocument7 pagesHS-HA Chez Le ChienDany NoePas encore d'évaluation
- Nomenclature - PDF ChienDocument12 pagesNomenclature - PDF ChienAmos NIYOGUSERUKAPas encore d'évaluation
- Livre Gratuit Le Système Brûleur de Graisse Cétogène Avis PDFDocument19 pagesLivre Gratuit Le Système Brûleur de Graisse Cétogène Avis PDFNadia MsallemPas encore d'évaluation
- Technique-Formation 2014 Elevage de ReinesDocument34 pagesTechnique-Formation 2014 Elevage de ReinesGuillaume DentrellePas encore d'évaluation
- Dossier Oeuf - L'aliment Le Plus Indispensable Après 50 AnsDocument19 pagesDossier Oeuf - L'aliment Le Plus Indispensable Après 50 Ansfrédéric gourlainPas encore d'évaluation
- Neurologies 114Document47 pagesNeurologies 114IndiSkrecija100% (1)
- Mon Herbier Médicinal (15 Plantes Curatives)Document36 pagesMon Herbier Médicinal (15 Plantes Curatives)my_Scribd_pseudoPas encore d'évaluation
- Présentation Ethnologie Canine 22-23.ppsxDocument62 pagesPrésentation Ethnologie Canine 22-23.ppsxNoor SinePas encore d'évaluation
- 1 Ethnologie AnimalDocument6 pages1 Ethnologie AnimalKhaled LajmiPas encore d'évaluation
- Ragdoll: Ragdoll chat - Nutrition, éducation, Soins et bien plus encore !D'EverandRagdoll: Ragdoll chat - Nutrition, éducation, Soins et bien plus encore !Pas encore d'évaluation
- ACACED - Autres - AlimentationDocument10 pagesACACED - Autres - AlimentationdouniaguechraPas encore d'évaluation
- ACACED - Autres - SantéDocument10 pagesACACED - Autres - SantédouniaguechraPas encore d'évaluation
- Technique D - Angraissement Des AgneauxDocument4 pagesTechnique D - Angraissement Des Agneauxabdessemed100% (1)
- Comportements Et Bien-Être AnimaleDocument187 pagesComportements Et Bien-Être AnimaleAndrianamenosoa RakotondrasoaPas encore d'évaluation
- Chapitre III - Physiologie de La DigestionDocument9 pagesChapitre III - Physiologie de La Digestionchaima TEMMAMPas encore d'évaluation
- Conduite À Tenir Devant Une Morsure Par Un Animal Suspect de RageDocument5 pagesConduite À Tenir Devant Une Morsure Par Un Animal Suspect de Ragewooden latexPas encore d'évaluation
- F - Cuniculture - Chapitre 5Document4 pagesF - Cuniculture - Chapitre 5Kaddy ChonPas encore d'évaluation
- Conseils Pour Les Éleveurs de LapinsDocument11 pagesConseils Pour Les Éleveurs de LapinsYedidya Simplice LibiPas encore d'évaluation
- Galop 6Document2 pagesGalop 6orlando47777Pas encore d'évaluation
- Comportement - Gentil Chien Mode D'emploiDocument228 pagesComportement - Gentil Chien Mode D'emploiSofiane Yessad100% (1)
- Cuniculture TSE 1Document40 pagesCuniculture TSE 1sounga75Pas encore d'évaluation
- Guide ApicultureDocument20 pagesGuide Apiculturee2052394100% (1)
- Éducation Du Chiot Et Du ChienDocument36 pagesÉducation Du Chiot Et Du Chienmehdihijazie1999100% (1)
- Les Principales Races: Du PorcDocument3 pagesLes Principales Races: Du PorcFranciscoPas encore d'évaluation
- VOX ANIMAE - Les Signaux D ApaisementDocument23 pagesVOX ANIMAE - Les Signaux D Apaisementdouniaguechra100% (1)
- Biologie Des AbeillesDocument95 pagesBiologie Des AbeillesMadjokfaOscarPas encore d'évaluation
- Stop Aux Idées Reçues Sur Les CéréalesDocument2 pagesStop Aux Idées Reçues Sur Les CéréalesLargierPas encore d'évaluation
- Genetique Appliquee PDFDocument159 pagesGenetique Appliquee PDFIbrahima AbdallahPas encore d'évaluation
- Manuel Premiers SecoursDocument51 pagesManuel Premiers SecoursMonica RuizPas encore d'évaluation
- Brochure LapinDocument16 pagesBrochure LapinAnonymous ZmRV6WqPas encore d'évaluation
- La CésarienneDocument22 pagesLa CésarienneMihai SaboPas encore d'évaluation
- 2-2. Systématique Taxonomie PDFDocument41 pages2-2. Systématique Taxonomie PDFFatima Zahra Rarhoute100% (1)
- Élevage de LapinsDocument14 pagesÉlevage de LapinsmatrixleblancPas encore d'évaluation
- Premiers Pas Avec Vos Poules PondeusesDocument9 pagesPremiers Pas Avec Vos Poules PondeusesDelma sam100% (1)
- FT Ameliorer La Sante Des AgneauxDocument16 pagesFT Ameliorer La Sante Des Agneauxvsdfsd258Pas encore d'évaluation
- Rapport Mission Élevage de PouletDocument48 pagesRapport Mission Élevage de PouletSana BoulgadimPas encore d'évaluation
- Le Nourrissement Des AbeillesDocument8 pagesLe Nourrissement Des AbeillesFabienPas encore d'évaluation
- Élevage Lapin PDFDocument86 pagesÉlevage Lapin PDFbil abdelkafiPas encore d'évaluation
- Btta 100Document4 pagesBtta 100jeyid100% (1)
- Developpe MentDocument71 pagesDeveloppe MentKhalid Jbilou100% (1)
- VacheDocument8 pagesVacheserge RPas encore d'évaluation
- Le Cycle de Reproduction Chez La VacheDocument13 pagesLe Cycle de Reproduction Chez La Vachesasasousou213100% (1)
- E - Cuniculture - Chapitre 4 PDFDocument17 pagesE - Cuniculture - Chapitre 4 PDFKaddy ChonPas encore d'évaluation
- Herbicides Et Leur Mode D'action PDFDocument3 pagesHerbicides Et Leur Mode D'action PDFchadlikamal1315Pas encore d'évaluation
- Livret Pedagogique InterculturelDocument70 pagesLivret Pedagogique InterculturelHAJAR IKKENPas encore d'évaluation
- Apprendre Langlais Pour Faire Ses CoursesDocument2 pagesApprendre Langlais Pour Faire Ses CoursesAmine BoubakeurPas encore d'évaluation
- Salmonella Pullorum Et Gallinarum PDFDocument2 pagesSalmonella Pullorum Et Gallinarum PDFchouar0% (1)
- Estime de SoiDocument10 pagesEstime de SoiClient FirstPas encore d'évaluation
- 1578323904-Elevage BourdonDocument2 pages1578323904-Elevage BourdonGrosBedPas encore d'évaluation
- Connaître - L - Éléphant PDFDocument4 pagesConnaître - L - Éléphant PDFPancake76100% (1)
- Génétique Des Canaris Mélaniques Classiques (Notions) : Ème ÈmeDocument11 pagesGénétique Des Canaris Mélaniques Classiques (Notions) : Ème ÈmeAdel AlouiPas encore d'évaluation
- Toxoplasmose 2020 - DUMETREDocument30 pagesToxoplasmose 2020 - DUMETREMassouh AssouiPas encore d'évaluation
- Conduite D'élevage de Poule PondeuseDocument52 pagesConduite D'élevage de Poule Pondeusekarim abdelkadirPas encore d'évaluation
- Histoire de L'alimentation en FranceDocument13 pagesHistoire de L'alimentation en Franceblabla28989% (19)
- PSG ConservesDocument11 pagesPSG ConservesThomas RodriguezPas encore d'évaluation
- Abeille FinDocument42 pagesAbeille Finnadine gegehPas encore d'évaluation
- Anxiété AnimaleDocument95 pagesAnxiété AnimaleDany NoePas encore d'évaluation
- Symbolisme Animaux - Les Animaux MonstrueuxDocument7 pagesSymbolisme Animaux - Les Animaux MonstrueuxJelzz100% (1)
- Bien-Être Du ChevalDocument26 pagesBien-Être Du ChevaldonPas encore d'évaluation
- Sébastien Machefaux - Le Diagnostic de Trouble de L'identité de GenreDocument18 pagesSébastien Machefaux - Le Diagnostic de Trouble de L'identité de GenreFondation Singer-PolignacPas encore d'évaluation
- 8 Choses À Savoir Sur Le LasikDocument9 pages8 Choses À Savoir Sur Le LasikYASMEROPas encore d'évaluation
- Correction BacterioDocument14 pagesCorrection BacterioGhislain AssogbaPas encore d'évaluation
- Bohui Serges PacomeDocument207 pagesBohui Serges PacomeberniquelokpoPas encore d'évaluation
- 50 41904Document5 pages50 41904salimPas encore d'évaluation
- Dermatophytes Et Dermatophytoses.2ocxDocument2 pagesDermatophytes Et Dermatophytoses.2ocxZomloa FabricePas encore d'évaluation
- Cours 1 Genie GenetiqueDocument123 pagesCours 1 Genie GenetiqueAmina-Amel elhaffafPas encore d'évaluation
- Bac S 2018 - Amérique Du Sud - SVT - Académie de BesançonDocument10 pagesBac S 2018 - Amérique Du Sud - SVT - Académie de Besançongzqg9cp7mtPas encore d'évaluation
- Confusion MentaleDocument14 pagesConfusion Mentaleskyclad_21100% (1)
- UNIVERSITE de TLEMCEN Caractérisation Épidémio - Génétique de La Population de Tlemcen ParDocument63 pagesUNIVERSITE de TLEMCEN Caractérisation Épidémio - Génétique de La Population de Tlemcen ParAla eddine BoudichePas encore d'évaluation
- Croissance Staturo-Pondérale Cours MédecineDocument8 pagesCroissance Staturo-Pondérale Cours MédecinesikatalibPas encore d'évaluation
- Genetique BacterienneDocument36 pagesGenetique Bacteriennejuste ben johnsonPas encore d'évaluation
- 0.16.1 Diagnostic de Lhypersensibilite Retardee Des Mecanismes Immunologiques Aux Tests de DiagnosticDocument11 pages0.16.1 Diagnostic de Lhypersensibilite Retardee Des Mecanismes Immunologiques Aux Tests de DiagnosticTinaPas encore d'évaluation
- CSVT-102-La Replication Cycle CellulaireDocument5 pagesCSVT-102-La Replication Cycle CellulaireJean-Pierre PolnareffPas encore d'évaluation
- Les VentousesDocument16 pagesLes VentousesastonredaPas encore d'évaluation
- Histologie Moléculaire Et Fonctionnelle Humaine MMEDB203Document350 pagesHistologie Moléculaire Et Fonctionnelle Humaine MMEDB203Laura100% (1)
- 1 Endocrinologie GeneraleDocument74 pages1 Endocrinologie GeneraleHq sishPas encore d'évaluation
- Comprendre La Maladie de BergerDocument9 pagesComprendre La Maladie de BergerElias transportsPas encore d'évaluation
- 280 Produits Naturels Pour Se Surpasser - Ronald MaryDocument218 pages280 Produits Naturels Pour Se Surpasser - Ronald MaryLexis Nexis100% (1)
- COURS 3 RéplicationDocument27 pagesCOURS 3 RéplicationHikari KazuePas encore d'évaluation
- Chapitre IDocument14 pagesChapitre Isihem DjaouiPas encore d'évaluation
- PEDIATRIE CHU Blida 2 PDFDocument430 pagesPEDIATRIE CHU Blida 2 PDFcondé talla100% (7)
- Guide de L'insomnieDocument28 pagesGuide de L'insomnieJeremy RoyauxPas encore d'évaluation
- Cure de RaisinsDocument4 pagesCure de Raisinspeace4animalsPas encore d'évaluation
- La Revue Du Praticien-HépatoGastroEntérologieDocument175 pagesLa Revue Du Praticien-HépatoGastroEntérologiedrbadis100% (3)
- Urgences Chirurgicales NéonatalesDocument18 pagesUrgences Chirurgicales Néonataleskajol14100% (3)
- Tissu OsseuxDocument92 pagesTissu OsseuxFaculté De Médecine BécharPas encore d'évaluation