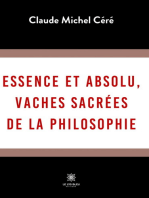Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Extrait
Transféré par
Justa YaqTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Extrait
Transféré par
Justa YaqDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fiche 1
Les Présocratiques
I. Vies et doctrine
1. Naissance de la philosophie
« Au commencement exista le Chaos, puis la Terre à la large poitrine, demeure
toujours sûre de tous les Immortels qui habitent le faîte de l’Olympe neigeux ;
ensuite le sombre Tartare, placé sous les abîmes de la Terre immense ; enfin l’Éros,
le plus beau des dieux, l’Éros, qui amollit les âmes, et, s’emparant du cœur de
toutes les divinités et de tous les hommes, triomphe de leur sage volonté » : voici
les lignes célèbres de la Théogonie par lesquelles le poète Hésiode commence le
récit de la naissance des dieux. Hésiode vécut sans doute à la fin du VIIIe siècle et
au début du VIIe. Un siècle plus tard, un discours d’un genre nouveau apparaît en
Grèce, que nous appelons maintenant « philosophie ». Ce terme a été fixé beaucoup
plus tard, au IVe siècle, par Platon et Aristote. Mais ceux que l’on appelle « préso-
cratiques » s’inscrivent déjà dans un mouvement de rationalisation de la pensée.
En effet, s’il existe une diversité d’écoles et de penseurs, toutes ont pour point
commun de rompre avec ce qu’il est convenu de nommer aujourd’hui « mythe »
(le grec múthos a le sens plus général de discours, récit), dont Homère ou Hésiode
sont les plus célèbres représentants. Le propre du mythe est de donner du monde
une représentation dominée par les dieux traditionnels, et par le destin (la thémis).
Ce nouveau discours des premiers « philosophes » est souvent présenté comme
remplaçant le mythe par la raison, le múthos par le logos. Qu’entend-on par-là ?
La question ne va pas de soi, car on peut faire des lectures contrastées de ces
9782340-027725_001_504.indd 7 27/09/2018 14:02
origines de la pensée « rationnelle ». S’agit-il déjà d’une rupture radicale avec la
pensée traditionnelle, ou bien n’assiste-t-on encore qu’aux balbutiements de ce
qui deviendra plus tard la « vraie » philosophie ?
Peut-on, par exemple, considérer les premières recherches sur la nature (celle
des « physiologues » : Thalès, Anaximandre, Anaximène, Héraclite) comme une
simple transposition du discours mythique sous forme abstraite ? Certains inter-
prètent tentèrent ainsi de montrer que l’on trouve chez ces auteurs une reprise de
la logique hésiodique de la naissance des dieux (c’est-à-dire de la nature divinisée) :
un état d’indistinction (semblable au Chaos primitif d’Hésiode), puis des entités
qui émergent par ségrégation, et qui finissent ensuite par interagir selon un cycle
indéfini. Ce jugement sévère ne date cependant pas de l’époque moderne. Platon,
dans un passage du Sophiste voit dans certains penseurs du passé une approche
poétique de la nature, qui laisse la raison sur sa faim : « Il semble que chacun nous
ait débité sa fable comme à des enfants. L’un nous présente les êtres au nombre
de trois, se faisant de temps en temps la guerre ; d’autres fois, redevenus amis,
se mariant, engendrant, nourrissant les fruits de leurs unions. Un autre n’en
compte que deux, le sec et l’humide, ou bien le chaud et le froid, et il les marie
et les met en ménage. Nos Éléates, à partir de Xénophane et même de plus loin,
arrangent leur fable en réduisant à un seul être ce qu’on appelle l’univers. Plus
tard des Muses d’Ionie et de Sicile ont pensé qu’il serait plus sûr de combiner les
deux opinions, et de dire que l’être est à la fois un et multiple, et qu’il se maintient
par la haine et par l’amitié ; car tout se sépare et se réunit sans cesse, disent celles
de ces Muses qui chantent sur le ton le plus hardi ; celles qui le prennent sur un
ton plus doux, ne prétendent plus que les choses soient toujours ainsi, mais que
tantôt l’univers est un et en bonne harmonie, par l’influence de Vénus, et tantôt,
par celle de la discorde, multiple et en guerre avec lui-même. Que tout cela soit
vrai ou faux, il serait difficile et téméraire d’en oser décider contre d’anciens et
illustres personnages » (Platon, Sophiste, 242c-243a, tr. V. Cousin).
Aristote, quant à lui, sera plus sensible aux efforts rationnels des premiers
penseurs de la nature. Le jugement peut sembler opposé à celui de Platon : dans
sa Physique, Aristote voit dans leurs œuvres une tentative pour penser la nature
à partir d’un élément (l’eau, le feu etc.) et non plus à partir des dieux : mais,
justement, ils en restent selon lui à des explications trop matérielles, incapables
qu’ils seraient de s’élever à la logique abstraite du réel (l’opposition de la matière
et de la forme par exemple).
Incontestablement, l’univers des premiers penseurs est encore « divinisé »,
mais sans que les dieux de la tradition y agisse. Comme le dit Jean-Pierre Vernant :
« les éléments des Milésiens ne sont pas des personnages mythiques comme Gaia,
8 • Fiche 1
9782340-027725_001_504.indd 8 27/09/2018 14:02
mais ce ne sont pas non plus des réalités concrètes comme la terre ; ce sont des
puissances éternellement actives, divines et naturelles tout à la fois. L’innovation
mentale consiste en ce que ces puissances sont strictement délimitées et abstrai-
tement conçues : elles se bornent à produire un effet physique déterminé, et cet
effet est une qualité générale abstraite » (Du mythe à la raison. La formation de la
pensée positive dans la Grèce archaïque, 1957).
2. Les Milésiens
Il n’est donc pas douteux qu’une rupture se produit dans la pensée grecque
par rapport aux formes traditionnelles, même si l’état fragmentaire des textes
rend difficile d’apprécier pleinement ces anciens auteurs. Selon le découpage
établi par des philosophes de la fin de l’Antiquité, toute l’histoire première de
la philosophie peut se représenter selon une logique géographique : les écoles
d’Asie mineure (Les Milésiens) qui s’intéressent avant tout à la nature ; celles de
Grande-Grèce (sud de l’Italie et Sicile) comme les Éléates ou les Pythagoriciens
qui se préoccupent des principes abstraits (les Nombres, l’Être…). Les atomistes
se rattachent à cette recherche, car l’atome est d’abord une réalité intelligible.
Enfin au Ve siècle Athènes devient le centre de la Grèce et de nombreux penseurs
vont y converger et rendre possible la naissance de la « philosophie » proprement
dite avec l’affrontement entre Socrate et les sophistes, affrontement dont sortira
la pensée de Platon. Quoi qu’il en soit de la simplification opérée par ce schéma,
il permet de dégager une première donnée : la plus ancienne forme de pensée
« rationnelle » est née sur la côte d’Asie Mineure autour de penseurs tels que
Thalès, Anaximandre, Anaximène ou Héraclite, qui mettent la nature au centre
de leurs écrits – d’où le terme qu’on leur donne de « physiologues ». Les textes
sont très lacunaires, mais il ressort que chacun d’eux met au premier plan un
élément d’où procède l’ensemble de la phúsis (la nature) : l’eau, le feu, l’illimité…
Mais cet élément est-il, comme le disait Aristote, « matériel » ? On peut plutôt
insister sur la dimension « abstraite », comme le dit Vernant, de notions telle
que l’« illimité » (apeiron) d’Anaximandre (v. 610-v. 545) : « De ceux qui disent
que le principe est un, mû et illimité, Anaximandre […] a dit que l’Illimité est
le principe et l’élément des choses qui sont, étant du reste le premier à user du
terme de principe (archè). Il dit qu’il n’est ni l’eau, ni rien d’autre de ce que l’on
dit être des éléments, mais qu’il est une certaine autre nature illimitée dont sont
engendrés tous les cieux et tous les mondes qui se trouvent en eux. Ce dont la
génération procède pour les choses qui sont et aussi ce vers quoi elles retournent
sous l’effet de la corruption, selon la nécessité » (Simplicius, Commentaire sur la
Physique d’Aristote, tr. J.-P. Dumont).
Les Présocratiques • 9
9782340-027725_001_504.indd 9 27/09/2018 14:02
On peut aussi souligner le fait que, derrière un terme « concret », comme le
feu chez Héraclite (v. 576-v. 480), on trouve le Logos : comme ce sera le cas plus
tard chez les Stoïciens, l’univers est pénétré d’une raison qui est en même temps
principe matériel de toute chose, et qui préside à l’unité des contraires, grand
principe de cette pensée. Contrairement à ce qu’on pense souvent, Héraclite n’est
pas un penseur de la lutte, mais de l’unité profonde, dont la lutte n’est qu’une
forme apparente : « L’harmonie cachée surpasse l’harmonie visible ». Il ne s’agit
donc ni de « mythe », ni de « matérialisme », mais bien d’une vision du tout animé
par une logique sous-jacente et difficile d’accès (« la nature aime à se cacher »).
3. Éléates et pythagoriciens : naissance de la métaphysique ?
À l’autre extrémité du monde grec, en Italie en en Sicile, ce n’est plus tant
la nature qui est au centre des réflexions, que la recherche d’un principe
d’intelligibilité fondamental de toute chose : l’un, les nombres, l’être… Le nom
de Pythagore est resté célèbre jusqu’aujourd’hui, mais sa vie est baignée d’une
aura légendaire : le dieu Hermès lui aurait donné la capacité de se souvenir de
tout et de se réincarner en plusieurs corps… Ce qui est certain en revanche, c’est
le caractère très exigeant de son école (les disciples devaient passer d’abord
par une période de probation de trois ans) et de sa pensée, spéculation sur les
nombres qui engendrent toutes les réalités : « La monade est le principe de toutes
choses ; produite par la monade, la dyade indéfinie existe en tant que substrat
matériel pour la monade, qui est cause ; c’est la monade et la dyade indéfinie qui
« engendrent » les nombres, puis les nombres qui « engendrent » les points puis
les points qui (engendrent) les lignes. À leur tour celles-ci produisent les figures
planes, lesquelles produisent les figures à trois dimensions (les êtres physiques),
lesquelles produisent les corps sensibles dont les éléments sont précisément au
nombre de quatre : le feu, l’eau, la terre et l’air » « (Diogène Laërce, Vies, VIII 24,
tr. J.-P. Dumont). On ne doit pas être surpris de retrouver à la fin de ce processus
d’engendrement les éléments chers aux Milésiens : toutes les écoles philosophiques
cherchent à comprendre le réel, mais les éléments sont ici rapportés à une origine
« intelligible ». Cette mathématisation du réel sera considérée parfois comme pure
imagination, mais fascinera aussi de très grands penseurs : Platon a incontesta-
blement repris certains aspects du pythagorisme dans sa physique, qui met des
atomes géométriques au cœur du réel. C’est aussi à un pythagoricien, Philolaos,
qu’est attribuée la formule rendue célèbre par Platon : l’âme est enfermée dans
le corps comme un « tombeau », comme punition de ses fautes. Ce qu’on appelle
la « métempsycose » platonicienne (la réincarnation des âmes) trouve là une de
ses sources majeures.
10 • Fiche 1
9782340-027725_001_504.indd 10 27/09/2018 14:02
Une autre grande école se développe à partir de la deuxième moitié du
VIe siècle dans le sud de l’Italie, à Élée, dont le fondateur est Xénophane mais
les représentants les plus célèbres sont Parménide et Zénon. Le primat donné
par ces auteurs (et principalement Parménide) à l’opposition de l’Être et du
non-Être conduit souvent à les considérer comme les fondateurs de la réflexion
« métaphysique » (cf. le commentaire du texte de Parménide plus bas). Mais,
si on considère la métaphysique comme un effort pour dégager les structures
profondes du réel, on peut aussi bien voir dans chacun des présocratiques un
« métaphysicien ». D’autre part, si l’éléatisme a une grande présence dans l’histoire
de la philosophie, cela tient aussi aux paradoxes de Zénon, le plus célèbre disciple
de Parménide. Dans sa Physique, Aristote discute de près la façon dont Zénon
tente de réfuter l’existence même du mouvement. Étrange idée : mais il s’agit en
réalité pour Zénon d’affirmer que la seule réalité est celle de l’Être immobile, le
mouvement n’étant qu’une apparence. Le plus célèbre de ces paradoxes est celui
d’Achille et la tortue : jamais Achille ne pourra rejoindre la tortue, car il faudra
qu’il franchisse un certain espace, mais avant il lui faudra franchir la moitié de
cet espace, et ainsi de suite : l’espace étant infiniment divisible, Achille ne pourra
pas se mouvoir… Aristote répond que Zénon confond la division mathématique
actuelle et la divisibilité en puissance, le mouvement étant un processus continu
et non discret. Une autre réponse est peut-être plus célèbre : celle de Diogène (ou
Antisthène) le cynique, qui se contenta de se lever et de marcher…
4. Les premiers atomistes
On retrouve ce souci spéculatif, ce goût de l’intelligible jusque dans la forme
première de l’atomisme grec, fondé à Abdère (en Thrace) au Ve siècle par Démocrite
et Leucippe. Bien sûr, on trouve déjà chez ces penseurs ce qui formera le cadre de
la doctrine épicurienne : l’univers est tout entier composé d’atomes (particules
insécables) et de vide. Mais l’épicurisme sera un matérialisme. Or, il ne semble
pas du tout que le souci de Démocrite (v. 460-370) soit de défendre une doctrine
matérialiste contre les tenants de l’« idéalisme » (qui pourraient être dans ce cas
les Éléates). C’est même tout le contraire : le néo-platonicien Proclus, au Ve siècle
après J.-C., fera même de Démocrite un héritier direct des Éléates ! Cette lecture
en apparence surprenante s’appuie sur les termes mêmes utilisés par ces auteurs :
l’être et le non-être. C’est en tout cas ce que nous restitue ce témoignage d’Aristote :
« Leucippe et son compagnon Démocrite déclarent que le plein et le vide sont les
éléments, qu’ils dénomment respectivement être et non-être, l’être étant le plein et
l’étendue, et le non-être le vide et le rare (C’est pourquoi ils concluent que l’être n’a
pas plus d’existence que le non-être, parce que le vide n’existe “pas moins” que le
Les Présocratiques • 11
9782340-027725_001_504.indd 11 27/09/2018 14:02
corps) » (Aristote, Métaphysique, A, IV, tr. J.-P. Dumont). Pourquoi utiliser cette
terminologie pour qualifier de la « matière » (Aristote considère que Démocrite
ne dépasse justement pas la définition matérielle de la nature) ? Ce que Proclus
semble indiquer, c’est qu’en qualifiant les atomes d’« être », Démocrite en fait
des particules sans doute matérielles, mais insaisissables par les sens, et par-là
même « intelligibles » : l’atome et le vide sont des constructions rationnelles,
qui constituent la vérité en soi des choses. Ce que saisissent nos sens, ce n’est
finalement que le résultat contingent du rapport entre les atomes, le vide et notre
corps. L’univers des sens est celui du relatif, ou, comme le précise cet extrait du
sceptique Sextus Empiricus (IIe siècle apr. J.-C.), de l’opinion : « Démocrite, quant
à lui, abolit les phénomènes qui concernent les sens, et pense qu’aucun phénomène
n’apparaît conformément à la vérité, mais seulement conformément à l’opinion,
ce qu’il y a de vrai dans les substances consistant dans la réalité des atomes et du
vide : “Convention que le doux”, dit-il en effet, convention que l’amer, convention
que le chaud, convention que le froid, convention que la couleur ; et en réalité :
les atomes et le vide » (Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII, 135-136,
tr. J.-P. Dumont). Épicure prendra ici le contre-pied radical de Démocrite en
affirmant qu’au contraire nos sensations ne nous trompent jamais. La critique
du relativisme des sens rapproche en revanche Démocrite de son contemporain,
celui qu’on lui opposerait pourtant volontiers : Platon. Certes, ce n’est pas vers
les « idées » rationnelles qu’il faut dépasser les sens pour Démocrite, mais vers
la réalité sous-jacente de la nature, composée d’atomes et de vide. Mais l’acte
par lequel nous dépassons le monde de l’opinion pour atteindre la vérité est un
acte authentiquement rationnel, qui nous permet d’atteindre l’« être » lui-même.
5. Conclusion
La pensée des premiers atomistes vient au fond confirmer la difficulté de classer
les présocratiques (terme d’ailleurs incorrect, puisque certains étant contempo-
rains de Socrate, il faudrait parler de penseurs « préplatoniciens ») dans des cases
qui ont été constituées bien plus tard. Après Platon et Aristote, par exemple, il
semble aller de soi de définir un auteur comme « matérialiste », ou « idéaliste ».
Mais que signifient ici ces termes ? Les Milésiens sont-ils matérialistes parce qu’ils
cherchent à définir l’élément premier de la nature ? Mais s’agit-il d’un élément
matériel ou d’un concept qui permet de donner son unité au cosmos ? Comme nous
l’avons dit, le « feu » héraclitéen est « logos », et il nous est difficile aujourd’hui de
comprendre ce caractère inséparable de la matière et de la pensée. De même, il
existe chez les Pythagoriciens une incontestable « mystique » des nombres, mais
ces nombres ont pour fonction de donner une structure d’ensemble à l’univers,
12 • Fiche 1
9782340-027725_001_504.indd 12 27/09/2018 14:02
jusqu’à ses aspects les plus matériels (il existe ainsi une théorie de la génération
des animaux qui refuse la « génération spontanée », qui sera définitivement
réfutée par Pasteur…). Cette perplexité face à ces pensées est peut-être une des
originalités de la philosophie occidentale. En effet, dans le Phédon, Platon nous
montre Socrate exprimer sa déception devant l’enseignement d’un grand penseur
« présocratique » du Ve siècle, Anaxagore de Clazomènes (cité proche de Milet)
l’introducteur à Athènes de la pensée des Milésiens. Ayant entendu parler d’un
livre où Anaxagore disait que « c’est l’intelligence qui met tout en ordre et qui est
la cause universelle », Socrate lit l’ouvrage, ne trouve finalement qu’aucun rôle
effectif n’a été donné à cette « intelligence » : aucune intention, aucune volonté,
tout se faisant finalement par des causes matérielles. Cette déception a tourné
Socrate vers la dialectique. Mais elle nous apprend aussi à ne pas chercher chez
les présocratiques ce qu’ils ne prétendent pas offrir : un système fondé sur une
divinité rationnelle et bienfaisante. Platon, de ce point de vue, renoue davantage
avec les sources religieuses de la philosophie que nombre de ses prédécesseurs.
II. Texte commenté
La tradition a conservé de Parménide un extrait de son long poème intitulé De
la Nature. Les premiers philosophes s’expriment souvent sous forme versifiée (on
retrouve ce type d’écriture beaucoup plus tard dans un autre poème sur la nature,
le De Natura rerum de Lucrèce). Ce choix n’est pas sans importance : il montre que
le penseur s’inscrit dans la tradition poétique pour mieux s’en séparer. Le début
de l’extrait le montre éloquemment : Parménide se présente dans la posture de
l’inspiré. Mais ce ne sont plus des muses poétiques qui viennent révéler l’origine
des dieux ou les hauts faits des héros : l’objet de la révélation n’est autre que la vérité
rationnelle. Le contenu de cette révélation est à la fois simple et assez obscur. Il s’agit
en effet d’opposer deux pôles : l’Être, seule réalité, absolument un et immobile,
et le Non-Être, néant absolu qui ne peut être l’objet d’un quelconque discours. Si
ce texte occupe une place à part dans ce qui nous reste des présocratiques, c’est
qu’on y trouve la première affirmation du lien indéfectible entre les trois piliers
de ce qu’on nommera plus tard la métaphysique rationnelle : l’Être, le Logos et
la Raison. Seul l’Être peut se « dire » (légein), et cette expression est accomplie
par le noûs, l’intelligence. Or, jusqu’à Hegel compris, en passant par Platon,
Thomas d’Aquin, Descartes ou Leibniz, c’est bien l’unité foncière de la réalité,
de son intelligibilité et de la capacité de la raison à formuler cette intelligibilité
qui caractérisera cette forme de philosophie. Est-ce outrepasser les intentions de
Parménide que d’en faire le fondateur de la « métaphysique occidentale » ? Il n’en
Les Présocratiques • 13
9782340-027725_001_504.indd 13 27/09/2018 14:02
reste pas moins que la force de sa pensée a été reconnue très tôt, puisque Platon lui
accorde une place non négligeable dans la fondation de son propre système. Mais,
dans le Sophiste, ce sont surtout les difficultés posées par l’opposition absolue de
l’Être et du Non-Être qui arrêtent Platon. Le risque n’est-il pas en effet d’enfermer
paradoxalement la pensée dans le silence ? Si seul l’Être est, qu’il est absolument
un et immobile, que peut-on réellement en dire, sinon qu’il est ? Accomplissant
un geste qu’il qualifie lui-même de « parricide », Platon estime qu’il ne faut pas
hésiter à dépasser ce père spirituel et montrer que le logos n’est possible que si
l’Être n’est pas le seul « genre », mais qu’il est relié à quatre autres : le repos et le
mouvement, le même et l’autre. Penser c’est relier des éléments opposés, c’est-à-
dire d’une certaine façon, comme le dira Hegel, comprendre qu’il faut intégrer la
« négativité ». À ce titre, si Parménide est le père de la métaphysique, c’est tout
autant par les limites de sa pensée que par sa doctrine elle-même.
« Hé bien ! je vais parler, et toi, écoute mes paroles : je te dirai quels sont les deux
seuls procédés de recherche qu’il faut reconnaître. L’un consiste à montrer que l’être
est, et que le non-être n’est pas : celui-ci est le chemin de la croyance ; car la vérité
l’accompagne. L’autre consiste à prétendre que l’être n’est pas, et qu’il ne peut y avoir
que le non-être ; et je dis que celui-ci est la voie de l’erreur complète. En effet, on ne
peut ni connaître le non-être, puisqu’il est impossible, ni l’exprimer en paroles. Car
la pensée est la même chose que l’être.
Il faut que la parole et la pensée soient de l’être ; car l’être existe, et le non-être n’est
rien. N’oublie pas ces paroles ; et d’abord, éloigne ta pensée de cette voie. Ensuite,
laisse de côté celle où errent incertains les mortels ignorants, dont l’esprit flotte
agité par le doute ; ils sont emportés, sourds, aveugles, et sans se connaître, comme
une race insensée, ceux qui regardent l’être et le non-être à la fois comme une même
chose et comme une chose différente ; ils sont tous engagés dans une route sans issue.
Mais toi, éloigne ta pensée de cette route, et que la coutume ne te précipite pas dans
ce chemin vague, où l’on consulte des yeux aveugles, des oreilles et une langue reten-
tissantes ; mais examine, avec ta raison, la démonstration savante que je te propose.
Il ne reste plus qu’un procédé ; c’est celui qui consiste à poser l’être. Dans cette
voie, bien des signes se présentent pour montrer que l’être est sans naissance et sans
destruction, qu’il est un tout d’une seule espèce, immobile et infini ; qu’il n’a ni passé,
ni futur, puisqu’il est maintenant tout entier à la fois, et qu’il est un sans discontinuité.
Quelle origine, en effet, lui chercheras-tu ? D’où et comment le feras-tu croître ? Je ne te
laisserai ni dire, ni penser qu’il vient du non-être ; car le non-être ne peut se dire ni se
comprendre. Et quelle nécessité, agissant après plutôt qu’avant, aurait poussé l’être à
sortir du néant ? Donc il faut admettre, d’une manière absolue, ou l’être, ou le non-être.
14 • Fiche 1
9782340-027725_001_504.indd 14 27/09/2018 14:02
Vous aimerez peut-être aussi
- Perspectivisme & Multinaturalisme Dans La Amérique Indigène - Viveiros de CastroDocument13 pagesPerspectivisme & Multinaturalisme Dans La Amérique Indigène - Viveiros de CastroFlorencia Rodriguez GilesPas encore d'évaluation
- Althusser, Louis - Le Courant Souterrain Du Matérialisme de La RencontreDocument18 pagesAlthusser, Louis - Le Courant Souterrain Du Matérialisme de La RencontrethymothycusPas encore d'évaluation
- Les Dieux Et Le Rois PDFDocument319 pagesLes Dieux Et Le Rois PDFalexis peña100% (3)
- American Gods - Neil GaimanDocument254 pagesAmerican Gods - Neil GaimanmrabdoPas encore d'évaluation
- Module 3 La Mise en Oeuvre La Résine Epoxy Clé en MainDocument19 pagesModule 3 La Mise en Oeuvre La Résine Epoxy Clé en Maintommy100% (1)
- Expose Philosophie HeracliteDocument5 pagesExpose Philosophie Heraclitesucces infoPas encore d'évaluation
- Le Partage Du Logos Dans Les Naissances de La Philosophie GrecqueDocument7 pagesLe Partage Du Logos Dans Les Naissances de La Philosophie GrecqueVirgile110Pas encore d'évaluation
- La Pensée MythiqueDocument6 pagesLa Pensée Mythiquecherubin.1489Pas encore d'évaluation
- Les Origines Et La Naissance de La PhilosophieDocument11 pagesLes Origines Et La Naissance de La PhilosophiePablo LázaroPas encore d'évaluation
- Cosmogonie D'aristoteDocument16 pagesCosmogonie D'aristoteandreacirlaPas encore d'évaluation
- Mythe Et Philosophie Chez Anaximandre: Marcel de CorteDocument22 pagesMythe Et Philosophie Chez Anaximandre: Marcel de Cortekennyobame255Pas encore d'évaluation
- Tableau Comparatif Philosophie Antique Et Philosophie MédiévaleDocument2 pagesTableau Comparatif Philosophie Antique Et Philosophie MédiévaleScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Les Origines Et La Spécificité de La Philosophie Par Rapport Aux Mythes, Religions Et Sciences - SunudaaraDocument21 pagesLes Origines Et La Spécificité de La Philosophie Par Rapport Aux Mythes, Religions Et Sciences - Sunudaaradkgjrxwj5nPas encore d'évaluation
- Semaine 4Document6 pagesSemaine 4HanaaPas encore d'évaluation
- Brunner - Le Conflit Des Tendances Platoniciennes Et AristotéliciennesDocument14 pagesBrunner - Le Conflit Des Tendances Platoniciennes Et AristotéliciennesRupertoPas encore d'évaluation
- Les Présocratiques PDFDocument6 pagesLes Présocratiques PDFamoroshenry100% (1)
- Essence et absolu, vaches sacrées de la philosophieD'EverandEssence et absolu, vaches sacrées de la philosophieÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Largeault La Philosophie de La Nature À L'âge ClassiqueDocument23 pagesLargeault La Philosophie de La Nature À L'âge ClassiquePhilippe GagnonPas encore d'évaluation
- Dualisme (Philosophie de L'esprit) PDFDocument14 pagesDualisme (Philosophie de L'esprit) PDFMouhsine ChePas encore d'évaluation
- Heraclite Et Le CyceonDocument19 pagesHeraclite Et Le CyceonFiorenzo TassottiPas encore d'évaluation
- Perecydide Cosmos PDFDocument37 pagesPerecydide Cosmos PDFgeorges BIZOTPas encore d'évaluation
- Exposé MétaphysiqueDocument13 pagesExposé MétaphysiqueKomlan Jérémi AtamekloPas encore d'évaluation
- SCHMUTZ - Qui A Inventé Les Mondes Possibles ?Document38 pagesSCHMUTZ - Qui A Inventé Les Mondes Possibles ?Arthur Le Reste-JuliardPas encore d'évaluation
- Hom 0439-4216 1988 Num 28 106 368966Document7 pagesHom 0439-4216 1988 Num 28 106 368966Aurélien AllardPas encore d'évaluation
- Croissant, Jeanne - Matière Et Changement Dans La Physique IonienneDocument35 pagesCroissant, Jeanne - Matière Et Changement Dans La Physique IonienneAnonymous 8VbEv5tA3Pas encore d'évaluation
- Philosophie 3Document69 pagesPhilosophie 3ابراهيم تيروزPas encore d'évaluation
- Les 8 Maisons Astrales 1 - 2 L'Espace Qualitatif Par Patrice GuinardDocument6 pagesLes 8 Maisons Astrales 1 - 2 L'Espace Qualitatif Par Patrice GuinardAbasse DiédhiouPas encore d'évaluation
- Theomachy and Theology in Early Greek MythDocument25 pagesTheomachy and Theology in Early Greek MythPABLO ROUSSE100% (1)
- Platon Et LeibnizDocument6 pagesPlaton Et LeibnizLouise ForrestierPas encore d'évaluation
- INTRODUCTION Selon Jean Pierre Vernant La Question de L Origine de La Philosophie PeutDocument2 pagesINTRODUCTION Selon Jean Pierre Vernant La Question de L Origine de La Philosophie PeutArdy NsemiPas encore d'évaluation
- Bertrand Russell - Le Mysticisme Et La LogiqueDocument50 pagesBertrand Russell - Le Mysticisme Et La LogiqueThierno Mamadou Aliou DIALLO100% (1)
- Du Mythe À La Raison Jean Pierre VernantDocument25 pagesDu Mythe À La Raison Jean Pierre VernantMoncif DaoudiPas encore d'évaluation
- 9782020977487Document22 pages9782020977487balde10boubacar10Pas encore d'évaluation
- Du Mythe A La Raison J.P.vernantDocument25 pagesDu Mythe A La Raison J.P.vernantJorge Carrillo100% (1)
- Aristotle, L'être Et L'un Chez Aristote I, Lambros Couloubaritsis (Metaphysics, Being)Document51 pagesAristotle, L'être Et L'un Chez Aristote I, Lambros Couloubaritsis (Metaphysics, Being)Nazareno Eduardo100% (1)
- MytheDocument23 pagesMythekankoumous009Pas encore d'évaluation
- LEFEBVRE, Henri. Claude Lévi-Strauss Et Le Nouvel ÉléatismeDocument12 pagesLEFEBVRE, Henri. Claude Lévi-Strauss Et Le Nouvel ÉléatismeCláudio SmalleyPas encore d'évaluation
- A Propos D'un Nouveau Fragment de XénocrateDocument5 pagesA Propos D'un Nouveau Fragment de XénocrateaavvPas encore d'évaluation
- Programme de Philosophie Classe de PremiereDocument5 pagesProgramme de Philosophie Classe de PremiereJuanito RASAMOELPas encore d'évaluation
- Conference 4Document14 pagesConference 4trofouPas encore d'évaluation
- Anaximène: Marcel de CorteDocument25 pagesAnaximène: Marcel de CorteNicole BakiliPas encore d'évaluation
- Etudes Sur La Mathèse 1-56 CompressedDocument56 pagesEtudes Sur La Mathèse 1-56 CompressedEnric RilloPas encore d'évaluation
- Augustin - La Cité de Dieu Livre 8Document35 pagesAugustin - La Cité de Dieu Livre 8etudiantPas encore d'évaluation
- Expose de Philo 1Document4 pagesExpose de Philo 1Robert GallonPas encore d'évaluation
- Cep 77Document96 pagesCep 77M. CenziPas encore d'évaluation
- Cours 1 Micro MacroDocument8 pagesCours 1 Micro MacroSamia SouiatPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de la Philosophie antique: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire de la Philosophie antique: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Réalisme (Philosophie)Document11 pagesRéalisme (Philosophie)Mike BurdickPas encore d'évaluation
- IsisdevoileeDocument1 645 pagesIsisdevoileeyo2aPas encore d'évaluation
- Brisson 2002Document26 pagesBrisson 2002Ricardo SantolinoPas encore d'évaluation
- Whitehead Procès Et Réalite-Fait Et FormeDocument37 pagesWhitehead Procès Et Réalite-Fait Et FormePhilippeGagnonPas encore d'évaluation
- Sciences Humaines, Sciences ExactesDocument14 pagesSciences Humaines, Sciences ExactesSrmito1Pas encore d'évaluation
- Ordre Et Désordre en Territoire GrecDocument12 pagesOrdre Et Désordre en Territoire GrecJamaa OuarezzamenPas encore d'évaluation
- Cosmologie Chez Saint AugustinDocument11 pagesCosmologie Chez Saint AugustinValery Lionel NangaPas encore d'évaluation
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Brunner - Création Et Émanation - Fragment de Philosophie ComparéeDocument16 pagesBrunner - Création Et Émanation - Fragment de Philosophie ComparéeRupertoPas encore d'évaluation
- Pour Un Dialogue Mondial Entre Traditions Philosophiques: Les Noyaux Problématiques UniverselsDocument12 pagesPour Un Dialogue Mondial Entre Traditions Philosophiques: Les Noyaux Problématiques UniverselsNicolas TreiberPas encore d'évaluation
- Histoire de La PhilosophieDocument11 pagesHistoire de La PhilosophieArdy NsemiPas encore d'évaluation
- Michel Serres - RETOUR AU CONTRAT NATURELDocument8 pagesMichel Serres - RETOUR AU CONTRAT NATURELNicoleta AldeaPas encore d'évaluation
- Les Origines de La PhilosophieDocument6 pagesLes Origines de La PhilosophieMamadou DiagnePas encore d'évaluation
- Histoires de VideDocument78 pagesHistoires de VideZLPas encore d'évaluation
- Format Label 113Document5 pagesFormat Label 113Marlisa IchaPas encore d'évaluation
- Formula D PDFDocument16 pagesFormula D PDFNour-Eddine BenkerroumPas encore d'évaluation
- Babas Savarins-1Document1 pageBabas Savarins-1Benjamin GevoldePas encore d'évaluation
- Generateur High Tech Mig Mag Digiwave III Saf-Fro FRDocument16 pagesGenerateur High Tech Mig Mag Digiwave III Saf-Fro FROmar MaalejPas encore d'évaluation
- Brevet Sur Le Front Populaire Avec CorrectionDocument2 pagesBrevet Sur Le Front Populaire Avec Correctiondouzi nourPas encore d'évaluation
- 1715944Document1 page1715944ADRIANNE BETTAPas encore d'évaluation
- Histoire Et Géographie Sacrées Dans Le CoranDocument37 pagesHistoire Et Géographie Sacrées Dans Le CoranCatharsis HaddoukPas encore d'évaluation
- Compl Biologie Etudiant S-1Document43 pagesCompl Biologie Etudiant S-1aloys NdziePas encore d'évaluation
- Droit Des Affaires 2019 - 2020Document104 pagesDroit Des Affaires 2019 - 2020YassminaPas encore d'évaluation
- Manuel MilitaireDocument204 pagesManuel MilitaireFRED100% (1)
- Ligne Directrice 2021 - DyslipidémieDocument1 pageLigne Directrice 2021 - Dyslipidémiesara harvey vachonPas encore d'évaluation
- Atelier1 PowerQueryDocument2 pagesAtelier1 PowerQuerylouay bencheikhPas encore d'évaluation
- 1710 PDF Du 30Document26 pages1710 PDF Du 30PDF JournalPas encore d'évaluation
- Algorithmes de Traitement Suggeres HTADocument3 pagesAlgorithmes de Traitement Suggeres HTAZiedBenSassiPas encore d'évaluation
- ExamSys1 LMD 2010 2011 EpreuveCorDocument2 pagesExamSys1 LMD 2010 2011 EpreuveCorSira NdiayePas encore d'évaluation
- FoQual Rapport Incidents FRDocument40 pagesFoQual Rapport Incidents FRMarco SanPas encore d'évaluation
- Série TD 5 Phys2 2019 2020+corrigéDocument5 pagesSérie TD 5 Phys2 2019 2020+corrigéamiranomi5Pas encore d'évaluation
- Bourdieu Emprise JournalismeDocument4 pagesBourdieu Emprise JournalismebobyPas encore d'évaluation
- SAAD 2019 ArchivageDocument224 pagesSAAD 2019 ArchivageCarlos Redondo BenitezPas encore d'évaluation
- 27 Eme - Tob - 02-10-2021Document2 pages27 Eme - Tob - 02-10-2021Joyce DouanlaPas encore d'évaluation
- Moez El Kouni: ExperienceDocument1 pageMoez El Kouni: ExperienceMoezPas encore d'évaluation
- Construire en TerreDocument274 pagesConstruire en Terreridha1964100% (4)
- Pinpankôd Désigne Celle Des Jeunes Garçons Et Filles Dont L'âge VarieDocument20 pagesPinpankôd Désigne Celle Des Jeunes Garçons Et Filles Dont L'âge VarieNajimou Alade TidjaniPas encore d'évaluation
- A3 2 PDFDocument34 pagesA3 2 PDFLéopold SENEPas encore d'évaluation
- Flyer Passerelle VF (18752)Document2 pagesFlyer Passerelle VF (18752)grosjeanblandinePas encore d'évaluation
- Pyramide MaslowDocument3 pagesPyramide Maslowvibus2014Pas encore d'évaluation
- Endo Revision PDFDocument13 pagesEndo Revision PDFMedecine Dentaire100% (2)
- PHARMACO Respi. Médicaments de La TouxDocument40 pagesPHARMACO Respi. Médicaments de La TouxyvesPas encore d'évaluation