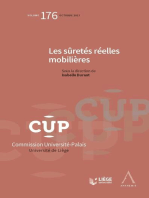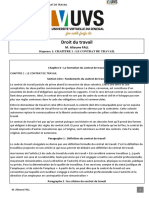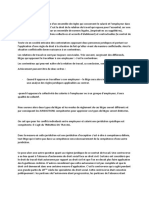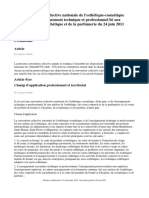Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
6-Droit Du Travail Extraits
6-Droit Du Travail Extraits
Transféré par
PhilippeCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
6-Droit Du Travail Extraits
6-Droit Du Travail Extraits
Transféré par
PhilippeDroits d'auteur :
Formats disponibles
Daniel MARCHAND
Professeur titulaire de la Chaire de Droit Social
du Conservatoire National des Arts et Métiers
Ouvrage initié par Yves DELAMOTTE
Professeur Honoraire au Conservatoire National des Arts et Métiers
Ancien directeur du Centre de Formation des Inspecteurs du Travail
LE DROIT
DU TRAVAIL
EN PRATIQUE
Dix-septième édition mise à jour
au 15 juillet 2004
䉷 Éditions d’Organisation – 1983, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ISBN : 2-7081-3196-6
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
Introduction
Le droit du travail est le droit applicable aux relations entre les
employeurs et les salariés. Un artisan ou un commerçant qui travaille
seul, n’est pas un employeur et n’est pas concerné par le droit du travail.
Le droit du travail s’applique essentiellement au secteur privé.
Les fonctionnaires de l’État et des collectivités locales sont soumis à un
statut et ne relèvent pas du droit du travail mais du droit administratif.
Les salariés agricoles relèvent du droit du travail mais sont couverts, sur
certains points, par des dispositions spécifiques qui ne sauraient être exa-
minées dans le cadre de cet ouvrage.
1. Emploi
L’employeur et le salarié concluent un contrat de travail qui place le
salarié sous l’autorité de l’employeur.
Le Code civil (1804) ne mentionnait pas le contrat de travail mais le
contrat de louage de services et n’y consacrait que deux articles. Le même
Code civil consacrait 174 articles aux successions, 20 aux murs et fossés
mitoyens, 32 au louage de cheptel, questions capitales dans une société
qui, au début du XIXe siècle, restait à dominante rurale.
Au cours du XIXe siècle, l’industrie se développe et le nombre des ouvriers
augmente. Une législation sociale apparaît (§ 2). L’expression contrat de
travail est substituée à celle de contrat de louage de services en 1901. Le
principe subsiste toutefois que le contrat conclu sans détermination de
durée peut cesser à tout moment à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Pour le salarié, il n’existe donc aucune sécurité de l’emploi. Tout au plus,
à la fin du XIXe siècle, les tribunaux commencent à admettre que certains
licenciements peuvent être abusifs et ouvrir droit pour le salarié à des
dommages-intérêts, ce que consacre l’article 1780 du Code civil, alinéa 2
issu d’une loi de 1890. Mais il faudra attendre 1973 pour qu’une loi
définisse les conditions dans lesquelles un licenciement est justifié.
䉷 Éditions d’Organisation 15
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I NTRODUCTION
La deuxième partie de cet ouvrage est consacrée au contrat de travail
et aux règles selon lesquelles il peut être rompu, autrement dit à l’accès à
l’emploi, à la perte de l’emploi, ainsi qu’à d’autres aléas de la vie professionnelle.
2. Salaire et conditions de travail
Au début du XIXe siècle, le vide législatif en matière de conditions de
travail était total. Selon l’idéologie héritée de la Révolution de 1789,
l’employeur et le salarié étaient censés s’entendre librement pour fixer le
salaire et la durée du travail ; l’État n’avait pas à intervenir. Avec le
développement de l’industrie, les effets de ce libéralisme se sont concré-
tisés dans la misère et l’exploitation des ouvriers. On a commencé à
comprendre que la libre discussion des contrats était un mythe et qu’il
n’y avait pas égalité entre l’employeur qui dispose des moyens de produc-
tion, et le salarié qui n’a à offrir que sa force de travail et n’a souvent
d’autre ressource que d’accepter les conditions imposées par l’employeur.
Si l’idée d’une législation sociale protectrice des salariés s’impose alors, il
reste entendu que cette législation ne se justifie que pour combattre les
excès les plus visibles. La première loi sociale (1841), ne concernait que
les enfants (elle fixait l’âge d’admission au travail à 8 ans). Des lois ulté-
rieures ont limité la durée du travail des femmes et des enfants, groupes
particulièrement vulnérables. Ce n’est qu’en 1919 qu’apparaît la première
loi limitant la durée du travail pour tous les salariés. En 1936, au moment
du Front populaire, est posé le principe de la semaine de quarante heures
(les heures travaillées au-delà de quarante heures étant des heures supplé-
mentaires payées à un taux majoré). C’est également en 1936 que les
congés payés sont légalisés ; ils seront portés de deux semaines par an à
trois semaines (1956), puis à quatre semaines (1969) et à cinq semaines
(1982). Une ordonnance du 16 janvier 1982 a fixé la durée légale de
la semaine de travail à 39 heures. Des textes récents ont apporté des
assouplissements aux dispositions de cette ordonnance pour culminer avec
la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail, dite des 35 heures, aménagée par la loi du 17 janvier 2003.
La législation relative à la durée du travail a pour objet de préserver
l’intégrité physique des travailleurs. C’est la même préoccupation qui a
inspiré toute la partie de la législation relative à l’hygiène et à la sécurité
qui vise essentiellement à prévenir les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Il existe en la matière une réglementation très abondante,
imposant à l’employeur de prendre les mesures de précaution appropriées
aux risques que présente son entreprise, compte tenu des techniques utili-
sées. C’est à l’Inspection du travail qu’il revient de vérifier que cette
16 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I NTRODUCTION
réglementation, inaugurée par un décret de 1913 et qui n’a cessé de se
développer depuis, est correctement appliquée. Quant à la réparation des
accidents du travail (c’est-à-dire les soins appropriés et l’indemnisation),
elle est assurée maintenant par la Sécurité sociale. La responsabilité pénale
de l’employeur peut toutefois être reconnue en cas d’accident survenu à
un membre du personnel de son entreprise. La loi protège également le
contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle et veille à sa réinsertion professionnelle.
Le salaire constitue pour le travailleur le moyen de subvenir à ses besoins
et à ceux de sa famille. On comprend qu’il y attache au moins autant
d’importance qu’à ses conditions de travail. En la matière, la législation
a d’abord cherché à protéger le salarié en tant que créancier de son
employeur et a doté cette créance, parce qu’elle est « alimentaire » (le
travailleur a besoin de son salaire pour vivre), d’un statut juridique parti-
culier. En ce qui concerne le montant du salaire, le principe est encore
aujourd’hui qu’il est fixé librement. La loi intervient pour prévenir toute
discrimination et prévoir un salaire minimum au-dessous duquel aucun
salarié ne peut être payé.
La troisième partie de cet ouvrage traite du salaire et des conditions de
travail (durée du travail, congés payés, hygiène et sécurité).
3. Organisation des relations collectives du travail
C’est encore le souci de protéger le salarié qui a inspiré le volet collectif
de la législation sociale. La protection n’est cependant plus recherchée par
des obligations ou des interdictions imposées à l’employeur dans sa rela-
tion directe avec chaque salarié mais dans la possibilité reconnue aux
salariés de s’organiser et d’affirmer, face aux employeurs, leur existence
collective. Le salarié isolé est en général démuni devant son employeur.
C’est seulement lorsque les salariés sont réunis et organisés qu’un équilibre
peut être rétabli.
Ceci suppose que les salariés puissent constituer des syndicats et recourir
à la grève comme ultime moyen de pression. La première Révolution
française avait expressément condamné toute forme d’entente ou de « coa-
lition ». Il faudra attendre le Second Empire (loi du 5 mai 1864) pour
que le délit de coalition soit supprimé et que les grévistes ne risquent
plus la prison. Ce n’est que sous la IIIe République (loi du 21 mars
1884), que les syndicats pourront sortir de la clandestinité et acquérir
une existence légale. Le droit de grève, le droit d’adhérer au syndicat de
son choix sont, depuis 1946, reconnus solennellement par la Constitution
française.
䉷 Éditions d’Organisation 17
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I NTRODUCTION
Pour les syndicats de salariés et pour les travailleurs eux-mêmes, la
grève est un moyen, non une fin. L’objectif est toujours, si on laisse de
côté certaines visées politiques, d’obtenir des rémunérations plus élevées,
de meilleures conditions de travail. Les revendications en ce domaine
feront l’objet d’une négociation avec les employeurs et la négociation
pourra aboutir à un accord fixant de nouvelles règles. Ces règles devront,
en principe, être plus favorables pour les salariés que celles qui résultent
de la législation sociale.
La législation sociale, dans presque tous les pays industrialisés, organise
la négociation des conventions collectives ; elle détermine le cadre de la
négociation (ce peut être l’entreprise ou une branche d’activité), elle pré-
cise notamment quelles sont les parties à la négociation et quels seront
les effets de la convention collective une fois conclue.
En France, la première loi en la matière est apparue en 1919, c’est-à-
dire bien longtemps après que les syndicats aient été dotés d’une existence
légale. De nouvelles lois furent promulguées en 1936, 1946 et 1950. La
loi du 11 février 1950 a, pendant plus de trente ans, avec quelques amen-
dements législatifs en 1971, constitué la base juridique du développement
des conventions collectives. C’est dans le cadre de cette loi qu’ont été
conclues de nombreuses conventions collectives complétant la législation
sociale et constituant avec elle une des sources les plus importantes du
droit du travail.
La loi de 1950 privilégiait la négociation dans le cadre d’une branche
d’activité et peu de conventions collectives d’entreprise furent conclues
sous son empire. La loi du 13 novembre 1982 a profondément modifié
la loi de 1950. Désormais, la négociation collective est encouragée aux
deux niveaux à la fois : branche et entreprise. Une obligation de négocier
annuellement sur les salaires et la durée du travail a même été imposée
par cette loi aux chefs d’entreprises dotées d’une section syndicale. Une
dernière loi du 4 mai 2004 a rééquilibré la négociation en faveur du
niveau de l’entreprise.
Un des facteurs qui expliquait la relative rareté des conventions d’entre-
prise est que, dans le cadre de l’entreprise, l’employeur doit faire face à
une représentation élue du personnel et qu’ainsi se présentent de multiples
occasions de contacts et de discussions. La législation a d’abord institué
les délégués du personnel (créés en 1936 mais régis ensuite par une loi du
16 avril 1946) puis, à la Libération, les comités d’entreprise (ordonnance du
22 février 1945, loi du 16 mai 1946). Les délégués du personnel sont
chargés de présenter les réclamations du personnel. Le comité d’entreprise
est un organisme d’information et de concertation qui permet de faire
18 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I NTRODUCTION
participer des représentants du personnel à la marche de l’entreprise. Les
délégués du personnel et au comité d’entreprise sont élus par le personnel.
Ce sont les « institutions représentatives » qui ont encore été renforcées
par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
et le comité de groupe, en 1982, ainsi que par le comité européen en
1996.
Les syndicats de salariés sont associés à la mise en place et au fonctionne-
ment de ces institutions représentatives et souvent les élus du personnel
sont aussi des militants syndicaux. Depuis une loi du 27 décembre 1968
(dont le principe avait été admis dans les « accords » de Grenelle en mai
1968), les syndicats peuvent en outre constituer des sections syndicales
et désigner des délégués syndicaux dans les entreprises.
La loi du 28 octobre 1982 a étendu les attributions des institutions
représentatives et renforcé les moyens d’action dont disposent les syndicats
dans les entreprises. La loi, dite quinquennale, du 20 décembre 1993 a
voulu simplifier le fonctionnement des institutions représentatives ;
d’autres textes, telle la loi du 12 novembre 1996, ont cherché à améliorer
la participation des salariés et de leurs représentants à la vie des entre-
prises.
Le chef d’entreprise se trouve confronté, on le voit, dès que l’entreprise
atteint une certaine taille, à de nombreux interlocuteurs (délégués du
personnel, élus du comité d’entreprise, délégués syndicaux,...).
La quatrième partie traite ainsi des relations collectives de travail.
Quant à la première partie, elle présente, en guise d’introduction à ce
qui suit et pour en permettre une meilleure compréhension, les principales
institutions, administratives et judiciaires, qui interviennent dans la prépa-
ration ou la mise en œuvre du droit du travail et donne une vue d’en-
semble des sources du droit du travail.
N.B. : Chaque partie de l’ouvrage est divisée en chapitres et chaque chapitre en
paragraphes. À l’intérieur d’un chapitre, la parenthèse (§ 5) renvoie au § 5 du
même chapitre ; la parenthèse (III, 4) renvoie au § 4 d’un autre chapitre, en
l’occurrence, le chapitre III.
䉷 Éditions d’Organisation 19
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
Daniel MARCHAND
Professeur titulaire de la Chaire de Droit Social
du Conservatoire National des Arts et Métiers
Ouvrage initié par Yves DELAMOTTE
Professeur Honoraire au Conservatoire National des Arts et Métiers
Ancien directeur du Centre de Formation des Inspecteurs du Travail
LE DROIT
DU TRAVAIL
EN PRATIQUE
Dix-septième édition mise à jour
au 15 juillet 2004
䉷 Éditions d’Organisation – 1983, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ISBN : 2-7081-3196-6
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
CHAPITRE IV
Sources du droit
Le droit du travail est constitué d’un ensemble de règles dont les
sources, c’est-à-dire les modes d’élaboration, sont multiples. On distingue
les sources internationales et les sources nationales puis, à l’intérieur des
sources nationales, celles qui sont d’origine étatique (constitution, loi,
règlement,...) et celles qui résultent d’un accord (convention collective,
contrat de travail), d’usages ou d’un acte unilatéral de l’employeur (règle-
ment intérieur). Il s’agit là de sources que, par opposition aux sources
étatiques, on conviendra d’appeler sources professionnelles. Au-delà des
sources internationales, étatiques et professionnelles, figurent les principes
généraux du droit, source du droit non écrite qui s’impose à tous.
SOURCES INTERNATIONALES
1. Conventions de l’Organisation internationale du travail
L’Organisation internationale du travail (OIT), créée en 1919 par le
traité de Versailles, est la seule à avoir survécu à la Seconde Guerre mon-
diale et l’une des institutions spécialisées des Nations unies, au même
titre que l’UNESCO, l’UNICEF,... de création plus récente. L’instance
suprême de l’OIT est la Conférence internationale du travail qui se réunit
chaque année pendant trois semaines en juin, à Genève. Le secrétariat
permanent de l’OIT est constitué par le Bureau international du travail
(BIT) dont le siège est à Genève.
La conférence rassemble les délégations des 177 États membres. Chaque
délégation comprend quatre personnes : deux représentants du gouverne-
ment, un représentant des employeurs, un représentant des travailleurs.
À la différence d’autres institutions internationales, les délégations ne
䉷 Éditions d’Organisation 59
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
sont donc pas exclusivement gouvernementales. Le tripartisme caractérise
l’OIT.
L’une des missions de la Conférence est d’élaborer des conventions. Cer-
taines portent sur des problèmes généraux (Inspection du travail, Sécurité
sociale, durée du travail, chômage et placement, droit syndical,...), d’autres
concernent des catégories particulières de salariés (femmes, jeunes gens,
travailleurs agricoles, gens de mer, travailleurs migrants,...).
Le choix des questions qui feront l’objet d’une convention incombe au
Conseil d’administration (tripartite) du BIT et c’est le Bureau qui, après
consultation des États membres, prépare un projet de convention. Ce pro-
jet est examiné par la Conférence au cours de deux sessions consécutives
et peut être modifié (de la même façon qu’au plan national le Parlement
français peut modifier un projet de loi gouvernemental). Le texte final
doit être approuvé par la Conférence.
Une fois le texte de la convention adopté, il reste aux États membres
à le soumettre à leur autorité compétente pour décider s’ils procèderont
à la ratification de la convention. En France, l’instance compétente pour
ratifier une convention internationale (ou un traité) est le Parlement. Si
le Parlement ratifie une convention de l’OIT, celle-ci prend le caractère
obligatoire d’un engagement international formel et devient partie inté-
grante de la loi nationale. Si des dispositions de la législation antérieure
sont en contradiction avec les dispositions de la convention, celle-ci l’em-
porte. Dans la pratique, la législation nationale sera modifiée pour la
mettre en harmonie avec la convention. La France est le pays qui a ratifié
le nombre le plus élevé de conventions (124 sur 186). Il existe un système
original de contrôle de l’application des conventions par les États qui les
ont ratifiées, organisé par l’OIT (commission d’experts puis commission
de la conférence et conférence plénière).
2. Règlements et directives de l’Union européenne
La Communauté Économique Européenne (CEE) a été instituée en 1957
par le traité de Rome, modifié depuis et encore amendé en 2001 par
le traité de Nice. Elle a été intégrée, fin 1993, à l’Union européenne et
comprend aujourd’hui vingt-cinq États membres. Aux six États fondateurs :
Belgique, République Fédérale d’Allemagne, France, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, se sont joints le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark (1973),
la Grèce (1981), l’Espagne et le Portugal (1986), l’Autriche, la Finlande
et la Suède (1995). Dix autres États ont été intégrés le 1er mai 2004 :
Chypre, Malte ainsi que des États d’Europe centrale (Pologne, Hongrie,
60 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
République Tchèque, Slovaquie, Slovénie) et baltes (Estonie, Lettonie,
Lituanie).
Les institutions de l’Union européenne comprennent :
– le Conseil européen qui réunit les chefs d’État et de gouvernement des
États membres avec le président de la Commission, deux fois par an,
pour donner les grandes orientations communautaires ;
– le Parlement européen, élu au suffrage universel direct, dont les fonctions
sont devenues plus importantes avec l’entrée en vigueur du traité
d’Amsterdam, le 1er mai 1999, et qui exerce un contrôle sur le fonction-
nement de la Commission ;
– le Conseil qui réunit régulièrement les représentants des gouvernements
des États membres ; sa composition varie selon les questions traitées
et sa présidence est assurée, par roulement, pour six mois, par chaque
État membre ; c’est lui qui détient le pouvoir de décision ;
– la Commission, ayant à sa tête 30 commissaires, qui est l’organe exécutif ;
– la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social,...
Face au Conseil qui représente les États membres, la Commission
incarne l’Europe et c’est d’elle que viennent les propositions qui sont à
l’origine du droit social européen : règlements et directives (le Conseil,
auquel ils sont soumis, ne pouvant, en règle générale, que les adopter
sans les modifier).
Les règlements sont directement applicables dans les États membres (à la
différence des conventions de l’OIT qui ne deviennent applicables qu’après
ratification par l’autorité compétente). À titre d’exemple, c’est un règle-
ment qui a défini les modalités de coordination entre les systèmes natio-
naux de Sécurité sociale, coordination nécessaire si on veut que la libre
circulation des travailleurs, à l’intérieur de la Communauté, ne soit pas
entravée, alors que c’est l’un des principes posés par le traité de Rome.
L’Acte Unique Européen de 1986 a donné une importance accrue aux
directives, notamment dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité du
travail (XV, 2 et 3). À la différence des règlements, directement appli-
cables dans les États membres, les directives se bornent à fixer des objectifs
et un délai, les gouvernements étant libres de déterminer les moyens (lois,
décrets, arrêtés, dispositions conventionnelles) permettant d’atteindre les
objectifs assignés dans le délai prescrit. Certaines d’entre elles peuvent
être adoptées à la majorité qualifiée.
Une charte des droits sociaux fondamentaux, sorte de programme social,
a été adoptée en 1989 sous la présidence française. Le traité de Maastricht,
entré en vigueur le 1er novembre 1993 et intégré au traité de Rome par
le traité d’Amsterdam à compter du 1er mai 1999, développe la compé-
䉷 Éditions d’Organisation 61
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
tence sociale et ouvre le dialogue social européen. Il a notamment conduit
à l’adoption rapide d’un texte en chantier depuis 1980, la directive du
22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise euro-
péen ou d’une procédure dans les entreprises ou les groupes d’entreprises
de dimension communautaire, en vue d’informer et de consulter les sala-
riés (XXI, 30).
L’existence de deux sources du droit international du travail, aux
niveaux mondial et européen, peut être à l’origine de difficultés, comme
cela a été le cas à propos du travail de nuit, par exemple (XIII, 12).
Il faut d’ailleurs également mentionner une troisième source, les textes
élaborés par le Conseil de l’Europe (Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, charte
sociale européenne de 1961, charte sociale européenne révisée de 1996 et
autres traités européens), une organisation qui réunit actuellement quarante-
cinq membres, y compris donc des États de l’ancienne Europe de l’Est
dont la fédération de Russie. Ces textes sont à l’origine d’une importante
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui siège à
Strasbourg.
3. Traités bilatéraux
Parmi les sources internationales, on mentionnera encore les traités bila-
téraux conclus entre la France et un autre État, par exemple, sur les
travailleurs migrants : accords de main-d’œuvre ou conventions de Sécurité
sociale. Il existe de tels accords avec les pays (autres que ceux de l’Union
européenne qui garantit la liberté de circulation et de travail dans tous
les États membres (V, 2)) dont les nationaux sont nombreux à travailler
en France : Algérie, États d’Afrique francophone,...
SOURCES D’ORIGINE ÉTATIQUE
4. Constitution
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, avait pour
objet de consacrer solennellement certains droits qui garantissent la liberté
politique. La Constitution de 1946, dans son préambule, a énuméré un
certain nombre de droits sociaux qui complètent les droits de l’homme.
La Constitution du 4 octobre 1958 qui a créé les institutions de la Ve Répu-
blique se réfère aux droits de l’homme énoncés en 1789 et confirme les
droits sociaux définis en 1946.
62 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
Sont ainsi reconnus, outre le principe général d’égalité de traitement :
– le droit au travail (« chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir
un emploi ») ;
– le droit syndical (« tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action
syndicale et adhérer au syndicat de son choix ») ;
– la négociation collective (« tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la
gestion des entreprises ») ;
– le droit de grève (« dans le cadre des lois qui le réglementent ») ;
– le droit à la Sécurité sociale.
Dans leurs jugements, les tribunaux ne font que rarement référence à
ces droits exprimés en termes généraux ; ils se fondent sur les dispositions
plus précises de la loi. Un salarié qui s’estime injustement licencié n’invo-
quera pas le droit au travail, reconnu par la Constitution, mais la loi
qui dispose qu’un licenciement n’est justifié que s’il a un « motif réel
et sérieux ». Il ne faudrait pas en déduire cependant que l’influence des
principes posés par la Constitution est nulle. La jurisprudence de la Cour
de cassation sur l’exercice du droit de grève serait probablement moins
libérale (XXIV, 1), si la grève n’était pas un droit reconnu solennellement
par la Constitution.
Le Conseil constitutionnel se prononce, lorsqu’il est saisi par des députés
ou des sénateurs, sur la conformité à la Constitution des dispositions d’une
loi votée par le Parlement. Il examine notamment si ses dispositions ne
violent pas les principes constitutionnels de non-discrimination et d’éga-
lité (égalité devant la loi, égalité entre les femmes et les hommes,...).
Le Conseil constitutionnel a ainsi annulé un article de la loi du 28 oc-
tobre 1982 relative au développement des institutions représentatives (une
des « lois Auroux ») qui interdisait, sauf dans certains cas, les actions en
dommages-intérêts, intentées à l’encontre de délégués ou de syndicats, à
la suite d’une grève (XXIV, 10). Le Conseil constitutionnel a considéré
que cet article, en interdisant à certaines personnes (employeurs, éventuel-
lement salariés,...) d’agir en réparation, violait le principe d’égalité devant
la loi. Il a, par contre, déclaré constitutionnels les articles de la loi du
4 mai 2004 qui bouleversent fondamentalement les règles du dialogue
social en France (§ 13 et chapitre XIX).
5. Loi, ordonnance et règlements : Code du travail
La loi reste une source essentielle du droit du travail. Toute loi résulte
d’un projet de loi, préparé par le gouvernement, ou d’une proposition de loi
déposée par un membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
䉷 Éditions d’Organisation 63
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
En fait, la plupart des lois intéressant le droit du travail, ont résulté
d’un projet gouvernemental. Il en est ainsi des lois sur le licenciement
(1973-1989-2002), sur la prévention des accidents du travail (1976), sur
les conseils de prud’hommes (1979-2002). Les importantes réformes intro-
duites en 1982 ont résulté de projets de loi préparés par le ministre du
Travail, J. Auroux : loi du 4 août 1982 sur les libertés des travailleurs
dans l’entreprise (règlement intérieur, droit disciplinaire, expression des
salariés), loi du 13 novembre 1982 sur la négociation collective et le règle-
ment des conflits collectifs du travail, loi du 28 octobre 1982 sur les
institutions représentatives du personnel,... Il en est de même pour la loi
dite quinquennale du 20 décembre 1993, la loi, dite Aubry II du 19 jan-
vier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la loi dite
de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et la loi du 4 mai 2004
relative notamment au dialogue social.
Le projet ou la proposition, est examiné par l’Assemblée nationale et
le Sénat, article par article. Des amendements peuvent être adoptés qui
modifient le projet initial. Le résultat n’est pas toujours parfait. On ren-
contrera des exemples d’incohérence...
Certains textes légaux ont la forme d’une ordonnance. Le gouvernement
intervient alors dans un domaine réservé au pouvoir législatif, soit parce
que celui-ci n’existe pas encore (ordonnance de 1945 créant les comités
d’entreprise), soit en vertu de pouvoirs spéciaux accordés par le Parlement
au gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution. C’est
ainsi que le Parlement a autorisé le gouvernement à prendre des ordon-
nances en 1982, en 2001, en 2003 et en 2004 (cf. avant-propos).
Les règlements relèvent du seul pouvoir exécutif, sans intervention du
Parlement. Les règlements comprennent les décrets portant règlement d’admi-
nistration publique, dont certains sont destinés à apporter des précisions à
une loi (et la loi n’est pas applicable tant que les décrets d’application
n’ont pas été publiés), les décrets en Conseil d’État et les décrets simples. En
outre, sur certains points, les ministres, les préfets ou les maires peuvent
prendre des arrêtés (arrêté interministériel fixant le nouveau taux du SMIC
en cas de revalorisation automatique – XI, 6 ; arrêté du préfet concernant
le travail du dimanche – XIII, 8).
Selon la Constitution de 1958, le domaine de la loi est « la détermina-
tion des principes généraux du droit du travail et du droit syndical ».
Cette indication est assez vague. En fait, les questions les plus importantes
font l’objet d’une loi. Les décrets complètent la loi en la précisant sur
certains points ou traitent de questions techniques qui ne touchent pas
aux principes généraux (par exemple en matière de sécurité).
64 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
La distinction entre la loi et les règlements se reflète dans la structure
du Code du travail qui comprend trois parties :
– la partie législative (tous les articles commencent par la lettre L) ;
– les dispositions résultant de règlements d’administration publique et
de décrets en Conseil d’État (les articles commencent par la lettre R) ;
– les dispositions résultant de décrets simples (les articles commencent
par la lettre D).
La partie législative comprend 9 livres : conventions relatives au travail ;
réglementation du travail (il s’agit de dispositions législatives mais il
est convenu d’appeler réglementation du travail les règles se rattachant à
la durée du travail, aux congés, à l’hygiène et à la sécurité) ; placement
et emploi ; groupements professionnels, représentation des salariés, parti-
cipation, intéressement et plans d’épargne salariale ; conflits du travail ;
contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du tra-
vail ; dispositions particulières à certaines professions ; départements d’outre-
mer ; formation professionnelle continue.
Chaque livre comprend plusieurs titres. Par exemple, le livre I comprend
cinq titres : contrat d’apprentissage, contrat de travail, conventions et
accords collectifs de travail, salaire, pénalités. Le dernier titre de chaque
livre est toujours consacré aux pénalités qui sanctionnent les infractions
aux règles posées dans le livre. Chaque titre comprend en général plusieurs
chapitres. Chaque article de la partie législative est affecté d’un nombre
de trois chiffres, auquel s’ajoute le n° de l’article dans le chapitre.
Exemple : l’article L. 124-2 est le deuxième article du quatrième cha-
pitre (travail temporaire) du titre II (contrat de travail) du livre I (conven-
tions relatives au travail).
On voit sur cet exemple que le premier chiffre indique le livre, le
second le titre et le troisième, le chapitre.
Les deux autres parties du code ont la même structure et le même
système de numérotation que la partie législative. Il y a donc une corres-
pondance entre les trois parties. Aussi bien la table des matières du Code
Dalloz donne pour chaque rubrique l’ensemble des articles L, R, et D,
qui s’y rapportent. Exemple : contrat de travail : L. 120-1 à L. 129-3 ;
R. 122-1 à R. 129-5 ; D. 121-1 à D. 129-12.
D’autres éditeurs font figurer ces articles les uns à la suite des autres,
chapitre par chapitre.
Certaines dispositions législatives n’ont pas de correspondance dans la
partie réglementaire, ce qui explique le décalage entre les premiers articles
L, R et D dans cet exemple.
䉷 Éditions d’Organisation 65
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
Chaque nouvelle loi votée par le Parlement prend en principe la forme
d’une addition ou d’une modification de la partie législative et s’insère
dans le système de numérotation qui vient d’être exposé. De même pour
les règlements.
Certains textes réglementaires, en matière d’hygiène et de sécurité
notamment, n’ont pas été insérés dans le code, du fait de leur longueur
et de leur technicité. Dans le Code Dalloz, ils sont cependant publiés
sous la rubrique « Textes non codifiés ».
6. Jurisprudence
La jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation et du Conseil
d’État, est parfois aussi présentée comme une source du droit du travail,
du fait qu’elle pose certaines règles, relatives à des points non précisés
par la loi. Les règles relatives à l’exercice du droit de grève (XXIV, 1 à
7), domaine où la loi est quasiment muette, ont ainsi été définies par la
jurisprudence de la Cour de cassation.
En réalité, si l’on se réfère à l’article 5 du Code civil, « il est défendu
aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire
sur les causes qui leurs sont soumises » ; de ce principe la Cour de cassa-
tion en a justement déduit que la référence à une décision rendue dans
un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de
fondement à cette dernière (Soc. 27 février 1991). Ce qu’il faut retenir en
outre, c’est l’article 4 du Code civil selon lequel « le juge qui refusera de
juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi,
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Ceci revient à
dire que le juge est obligé de trancher le litige qui lui est soumis mais
que sa décision ne concerne que ce litige précis.
Il n’en reste pas moins qu’il est toujours intéressant de savoir comment
un juge a tranché telle ou telle difficulté et de l’invoquer comme précé-
dent, si l’on se trouve dans une situation que l’on estime semblable, mais
rien ne garantit qu’un autre juge prendra dans ce cas la même décision,
ni même que le premier juge prendra une décision identique ; ce sont les
aléas des « revirements de jurisprudence » qui interdisent de parler de
prétendus « arrêts de principe ».
SOURCES D’ORIGINE PROFESSIONNELLE
7. Conventions
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites », stipule l’article 1134 du Code civil.
66 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
La convention collective est une des sources importantes du droit du
travail. Un chapitre spécial lui est consacré dans ce manuel (XIX).
C’est dans ce chapitre qu’on trouvera des indications sur les parties à
la négociation collective, les divers types de convention, les conditions
d’application d’une convention collective à une entreprise, l’extension.
On se bornera, ici, à noter que la convention collective peut couvrir
une branche d’activité (par exemple la métallurgie, le textile naturel, les
banques) ou une entreprise. Dans le premier cas, elle est négociée par des
organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs de la branche ;
dans le second cas, par l’employeur et, normalement, les syndicats présents
dans l’entreprise. La loi du 13 novembre 1982 a eu pour objet principal
de développer les conventions d’entreprise qui étaient jusqu’alors peu fré-
quentes.
La convention de branche peut être nationale, régionale ou locale.
La plupart des conventions collectives contiennent des dispositions sur
les salaires (ce sont des minimas, dépassés le plus souvent en fait), les
primes, la durée de la période d’essai, la durée du préavis à respecter en cas
de licenciement ou de démission, les congés (notamment pour événements
familiaux), les indemnités de licenciement, les indemnités qui seront ver-
sées par l’employeur en cas de maladie, d’accident ou de grossesse et qui
complètent les allocations versées par la Sécurité sociale,...
La convention collective peut contenir également des dispositions adap-
tées aux conditions d’activité propres à la branche qu’elle concerne ; par
exemple la convention collective du bâtiment et des travaux publics pré-
voit des indemnités de grand déplacement, des indemnités en cas d’intem-
péries.
Lorsqu’une convention collective est applicable à une entreprise, elle
couvre l’ensemble du personnel. Ceci ne signifie pas que l’ensemble du
personnel se voie reconnaître les mêmes droits ; en effet, la convention
collective peut accorder aux cadres ou aux employés des avantages refusés
aux ouvriers ou vice versa (par exemple une prime d’ancienneté). Cette
différenciation a été à l’origine de la politique de mensualisation
(XVII, 9).
Outre la convention collective, de branche ou d’entreprise, la convention
conclue entre l’entreprise et le salarié, c’est-à-dire le contrat de travail,
est également une source importante du droit qui régit les relations indivi-
duelles de travail. Il est étudié dans le détail au cinquième chapitre ci-
après pour ses caractéristiques générales et au sixième chapitre pour ses
formes particulières (contrat à durée déterminée, temporaire ou à temps
partiel).
䉷 Éditions d’Organisation 67
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
8. Usages
On appelle ainsi les habitudes suivies et pratiquées de longue date dans
une profession ou un champ géographique ; ce sont des coutumes anciennes,
connues, respectées.
Exemples d’usages : dans la région de Bordeaux et dans le commerce,
selon un usage, le délai de préavis en cas de licenciement part, non pas
de la date de la notification du licenciement, mais du premier jour du
mois suivant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié (VII,
10). À Paris, il est d’usage, en cours de préavis de licenciement, que
l’employeur accorde au salarié deux heures par jour pour rechercher un
emploi (VII, 11).
Il existe aussi des usages d’entreprise que, selon la jurisprudence de la
Cour de cassation, l’employeur peut d’ailleurs dénoncer s’il observe un
préavis suffisant, sans qu’une durée précise soit prévue (Soc. 12 février
1997), pour permettre l’ouverture de négociations ; il doit aussi notifier
cette dénonciation « non seulement aux représentants du personnel mais
aussi à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui
leur profite » (Soc. 13 février 1996). La Cour précise que « s’il est exact
que la dénonciation d’un usage n’a pas à être motivée, elle est néanmoins
nulle s’il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l’employeur
est illicite » (il s’agissait en l’espèce d’une tentative de faire échec à l’exer-
cice normal par les salariés du droit de grève). L’employeur peut différer
dans le temps les effets de la dénonciation d’un usage à condition qu’il
en informe les salariés (Soc. 16 mars 2004). Par ailleurs, un accord d’entre-
prise peut mettre fin à un usage en vigueur, même si ce dernier n’a fait
l’objet d’aucune dénonciation mais à condition que les dispositions
conventionnelles contiennent bien une disposition relative à l’avantage
dont le personnel bénéficiait par usage (Soc. 9 juillet 1996). Enfin, un
usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur dans l’entreprise,
y compris pour les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation
irrégulière (Soc. 2 mai 2002).
Avec le développement du droit écrit (législation, conventions collec-
tives), cette source du droit du travail a perdu de son importance, mais
elle subsiste. Aussi bien, la loi y renvoie parfois : à propos du contrat à
durée déterminée (VI, 1) ou de travail temporaire (VI, 12), ou encore en
matière de préavis (VII, 2).
68 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
9. Règlement intérieur
De tout temps, les chefs d’entreprise ont estimé nécessaire de définir
des règles s’imposant au personnel. Les règlements intérieurs traitaient de
nombreuses questions : horaires, modalités de la paye, hygiène et sécurité,
discipline,... Aucune disposition légale ne circonscrivait le champ qui pou-
vait ainsi être couvert.
Actuellement, en application de la loi du 4 août 1982 sur les libertés
des travailleurs dans l’entreprise, le contenu du règlement intérieur est
strictement délimité. En effet, la loi (L. 122-34) définit le règlement inté-
rieur comme un document écrit en français (L. 122-35 qui admet la tra-
duction en une ou plusieurs langues étrangères) par lequel l’employeur
« fixe exclusivement » :
– les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et
de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement ;
– les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment
la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur,...
Ainsi le règlement intérieur peut comporter l’obligation de respecter
les horaires et, en conséquence, de pointer ou de prévenir la direction en
cas d’absence. Mais les questions relatives à la durée du travail qui relèvent
désormais de la négociation collective, sont exclues.
En outre, le règlement intérieur doit « énoncer les dispositions relatives
au droit de la défense », c’est-à-dire rappeler la procédure qui doit être
suivie lorsqu’une sanction est prévue à l’encontre d’un membre du person-
nel, procédure définie par la loi (X, 5) ou, le cas échéant, par la convention
collective applicable à l’entreprise.
La loi précise aussi que le règlement intérieur ne peut contenir de clause
contraire aux lois et règlements ainsi qu’aux dispositions des conventions
et accords collectifs de travail applicables à l’entreprise. Il ne peut compor-
ter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en
raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur
âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou
confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme ou de leur
handicap, à capacité professionnelle égale. Par contre, il doit rappeler les
dispositions relatives à l’interdiction de harcèlement moral (X, 4). Il ne peut
non plus contenir des dispositions qui apporteraient « aux droits et libertés
des personnes des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature
de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (L. 122-35).
La loi vise sur ce dernier point à écarter des clauses qui figuraient dans
certains règlements, telles que celles prévoyant des investigations du per-
sonnel. Le recours à l’alcootest peut néanmoins être prévu lorsqu’il s’agit
de vérifier le taux d’alcoolémie d’un salarié qui manipule des produits
䉷 Éditions d’Organisation 69
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
dangereux ou transporte des personnes (Soc. 22 mai 2002, confirmé par
la Cour européenne des droits de l’homme, 7 novembre 2002 – § 2) ; la
fouille peut être admise à titre préventif pour empêcher, par exemple,
l’introduction de certains produits dans l’entreprise ou à la suite de vols ;
la CNIL (I, 21) a également admis, le 8 avril 2004, que, pour des impéra-
tifs incontestables de sécurité, l’identification des salariés puisse se faire
par une base de données d’empreintes digitales.
Tous les employeurs occupant au moins vingt salariés doivent établir
un règlement intérieur. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise nouvelle, le règle-
ment intérieur doit être établi dans les trois mois suivant l’ouverture de
l’entreprise (R. 122-16). Le Code du travail précise les conditions d’élabo-
ration du règlement intérieur :
– « Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été sou-
mis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués
du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à
l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
(L. 122-36). L’avis doit aussi être demandé en cas de modification du
règlement intérieur. Le règlement intérieur, introduit ou modifié, sans
que l’avis prescrit par la loi ait été sollicité, est nul (on dit qu’il s’agit
d’une formalité « substantielle »).
– Dans un second temps, l’employeur doit adresser (en double exemplaire)
le texte du règlement intérieur à l’inspecteur du travail. Les observa-
tions qui ont pu être faites par le comité d’entreprise ou les délégués
du personnel ainsi que, le cas échéant, par le CHSCT, sont communi-
quées par l’employeur à l’inspecteur. Celui-ci peut, lorsque le règlement
lui est soumis et ultérieurement à tout moment, exiger le retrait ou
la modification des dispositions qui seraient contraires à la loi et aux
règlements en vigueur ainsi qu’à la convention collective applicable
à l’entreprise et aux droits et libertés des personnes (L. 122-37). Un
recours peut être formé devant le directeur régional du travail et de
l’emploi puis devant les juridictions administratives contre la décision
de l’inspecteur du travail (II, 8 et 9).
Les clauses du règlement intérieur qui ont fait l’objet de demandes de
modification par l’inspection du travail relèvent, en cas de contestation
par l’employeur, de la juridiction administrative. Ceci n’empêche pas que
la juridiction judiciaire peut être saisie, à tout moment, de la légalité
d’une clause du règlement intérieur par tout salarié concerné.
Les notes de service, portant prescriptions générales et permanentes dans
les matières qui relèvent du règlement intérieur, sont soumises aux mêmes
conditions d’élaboration et de contrôle par l’inspecteur du travail que le
règlement intérieur proprement dit (L. 122-39).
70 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
Le règlement intérieur doit être déposé au secrétariat-greffe du conseil
de prud’hommes de la situation de l’établissement où le travail est exécuté
(R. 122-13). Il doit être affiché à une place convenable, aisément acces-
sible, dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux
et à la porte des locaux où se fait l’embauchage (R. 122-12). Il entre en
vigueur un mois après l’accomplissement de ces formalités.
L’employeur qui omet d’établir un règlement intérieur, de consulter les
représentants du personnel, de soumettre le règlement intérieur à l’inspec-
teur du travail, ou d’effectuer la publicité prévue, est passible d’amendes
pouvant aller jusqu’à 750 € (R. 152-4).
PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT
10. Droits non écrits qui s’imposent à tous
Antigone, fille d’Œdipe, sœur d’Étéocle et de Polynice, parvint devant
les murs de Thèbes où gisaient les cadavres de ces derniers. Voulant leur
donner une sépulture, elle fut informée d’un édit du roi Créon l’interdi-
sant. Elle passa outre et déclencha la colère du roi auquel elle répondit :
« Je ne croyais pas tes édits – qui ne viennent que d’un mortel – assez forts pour
enfreindre les lois sûres, les lois non écrites des dieux. » (Sophocle) : il en est ainsi
du droit de donner une sépulture aux défunts et d’honorer leur mémoire.
Ce mythe illustre la notion de principes généraux du droit qui sont des
règles de droit non écrites et valables quel que soit le pays, l’époque, la
civilisation, la religion ou le régime politique considéré.
Les principes généraux du droit ont, pour la plupart, au cours des âges
été inclus dans des déclarations des droits (Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948, charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
de 2000, pour les textes les plus proches de nous) et ont été reconnus
constitutionnellement (§ 4).
Restent cependant des principes tels le droit d’entreprendre, corollaire
du droit de propriété, dont le Conseil constitutionnel français a eu l’occa-
sion de faire application en 1981 en refusant le droit à réintégration des
salariés protégés, licenciés pour faute lourde, prévu par une loi d’amnistie.
Il y a, de nouveau, fait référence dans sa décision relative à la loi du
13 juin 1998, dite Aubry I, pour décider « qu’en dépit des contraintes
qu’elle fait peser sur les entreprises, cette règle nouvelle ne porte pas à
la liberté d’entreprendre une atteinte telle qu’elle en dénaturerait la por-
tée », et à propos de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,
䉷 Éditions d’Organisation 71
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
en écartant une définition par trop restrictive du licenciement économique
qui portait « à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement exces-
sive au regard de l’objectif poursuivi du maintien de l’emploi ».
HIÉRARCHIE DES SOURCES DU DROIT
Il existe une hiérarchie entre les différentes sources du droit qui viennent
d’être examinées et toutes doivent respecter les principes généraux du
droit.
11. Prééminence des principes généraux du droit
et du droit international
Les principes généraux du droit, ayant une valeur permanente et univer-
selle, ont une suprématie sur toutes les autres sources du droit, y compris
le droit international.
Selon la Constitution française (art. 55), les traités régulièrement ratifiés
et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur
application par l’autre partie. Ce principe vaut aussi pour les conventions
de l’OIT qui l’emportent, en cas de divergence, sur la loi nationale (§ 1),
sous réserve des difficultés qui peuvent résulter de l’application de deux
règles internationales contradictoires comme, par exemple, les normes de
l’OIT et de l’Union européenne concernant le travail de nuit des femmes
(§ 2 et XIII, 12).
12. Hiérarchie des sources d’origine étatique
À l’intérieur du droit national étatique, la loi doit respecter la Constitu-
tion (le contrôle de la constitutionnalité des lois est exercé par le Conseil
constitutionnel). Les règlements doivent respecter la loi (le contrôle de la
légalité des règlements est exercé par le Conseil d’État qui peut annuler
un règlement dont certaines dispositions seraient contraires à la loi).
13. Hiérarchie des sources professionnelles
La même idée de hiérarchie régit la relation entre les diverses sources
professionnelles. Le règlement intérieur ne peut comprendre de disposi-
tions contraires à la convention collective applicable à l’entreprise. Et
celle-ci l’emporte sur les usages, même si ceux-ci sont plus favorables aux
travailleurs que les dispositions conventionnelles ; les usages ne s’imposent
qu’en l’absence de règle écrite de droit. Le contrat individuel de travail,
72 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
enfin, doit respecter les règles professionnelles écrites, c’est-à-dire qu’il ne
peut comporter que des clauses plus favorables au salarié que toutes les
autres sources du droit ; cela signifie aussi que l’avantage qui trouve sa
source dans le contrat de travail ne peut être mis en cause par la signature
d’un accord collectif (Soc. 22 mars 1995 et 25 février 1998).
De même une hiérarchie s’établissait traditionnellement entre la conven-
tion collective de branche et la disposition conventionnelle interprofession-
nelle, d’une part, et la convention d’entreprise, d’autre part, qui était donc
subordonnée aux premières.
Depuis la loi du 4 mai 2004, deux alinéas complétant l’article L. 132-
23 du Code du travail règlent de manière différenciée cette question.
L’avant-dernier alinéa maintient le principe de la hiérarchie entre conven-
tion de branche et convention d’entreprise en matière de salaires minima,
de classifications, de protection sociale complémentaire et de mutualisa-
tion des fonds pour la formation professionnelle. Dans tous les autres
domaines, le dernier alinéa stipule que « la convention ou l’accord d’entre-
prise ou d’établissement peut comporter des dispositions dérogeant en tout
ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d’une convention ou
d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large,
sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. » La loi
précise, en outre, que pour les accords de groupe qu’elle crée, toute déroga-
tion au principe traditionnel de hiérarchie des normes est exclu (L. 132-
19-1), de même que « la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires
aux conventions et accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente
loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs » (article 45 de
la loi).
Enfin, la Cour de cassation donne une valeur toute particulière au
contrat de travail en décidant qu’un accord collectif ne peut le modifier
(Soc. 25 février 1998) (XIX, 9) ; à l’inverse, elle décide également que des
salariés ne peuvent, individuellement, renoncer aux avantages qu’ils tien-
nent d’un accord collectif (Soc. 26 mai 1998).
14. Combinaison des deux hiérarchies.
Convention collective et loi
La question se pose essentiellement à propos de la relation du règlement
intérieur ou de la convention collective avec la loi ou le règlement.
Le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions contraires aux
lois ou règlements. C’est là d’ailleurs l’objet du contrôle de l’inspection
du travail sur le projet de règlement préparé par l’employeur (§ 9). Celui-
ci ne connaît pas nécessairement toute la législation sociale et le projet
䉷 Éditions d’Organisation 73
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
de règlement intérieur, acte unilatéral, risque de comporter des disposi-
tions qui soient en retrait par rapport aux dispositions légales.
La relation de la convention collective avec la loi et le règlement, se
pose dans des termes plus complexes. Il est clair que la loi (entendue au
sens large, en y annexant le règlement) l’emporte sur la convention collec-
tive car elle se situe plus haut dans la hiérarchie des sources. Mais est-ce
que ceci doit entraîner que sur tous les points qu’elle traite et qui font
souvent l’objet de dispositions légales, la convention collective doive s’ali-
gner sur les dispositions légales ? S’il est clair que la convention collective
a pour objet justement d’assurer aux travailleurs une protection et des
droits qui aillent au-delà du minimum prévu par la loi en faveur de tous
les salariés, on notera que depuis l’ordonnance du 16 janvier 1982, relative
à la durée du travail et aux congés payés, il est prévu que, sur un certain
nombre de points, les conventions collectives peuvent déroger aux règles
qu’elle a posées (XIII, 17). Cette tendance se confirme et la négociation
collective est maintenant souvent utilisée pour mettre en place des « inno-
vations sociales » qui, ensuite, sont entérinées par la législation.
La convention collective peut aussi contenir des dispositions qui traitent
d’une question non couverte par la législation. Cela a été longtemps le
cas pour les retraites (X, 12).
Aussi bien, si le Code du travail prévoit que « la convention collective
peut comporter des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles
des lois et règlements en vigueur » (L. 132-4), le même article précise
que « la convention collective ne peut déroger aux dispositions d’ordre
public des lois et règlements ».
C’est là, transposée en droit du travail, l’application d’un principe du
droit civil. Le Code civil stipule (article 6) que « on ne peut déroger par
des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public ».
L’ordre public est généralement défini comme « ce qui est indispensable
au maintien de l’organisation sociale ».
C’est la jurisprudence qui a défini progressivement les dispositions de
la législation sociale qui sont d’ordre public et auxquelles les conventions
collectives ne peuvent déroger. La question s’est notamment posée à pro-
pos des institutions représentatives du personnel et du délégué syndical.
On aurait pu penser que les dispositions légales relatives à l’âge auquel
un salarié est éligible ou auquel il peut être désigné comme délégué
syndical, âge fixé par la loi, ne pouvaient être modifiées par une conven-
tion collective et qu’il s’agissait là de dispositions d’ordre public. La Cour
de cassation, après avoir adopté ce point de vue, admet maintenant que
ces dispositions peuvent être modifiées par une convention collective, à
74 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
I V . S OURCES DU DROIT
condition que ce soit dans un sens favorable aux salariés. C’est le cas si
l’âge est abaissé.
De même, l’ancienneté dans l’entreprise, exigée par la loi, peut être
réduite par la convention collective. Dans les deux cas, la modification
est considérée comme avantageuse aux salariés, du fait qu’elle permet aux
syndicats de faire figurer sur les listes de candidats ou de désigner comme
délégués des salariés qui ont toutes les qualités requises pour exercer leur
mandat mais qui n’ont pas l’âge ou l’ancienneté exigés par la loi.
Dans l’état actuel de la jurisprudence, il reste un certain nombre de
règles légales auxquelles une convention collective ne saurait déroger,
même si la dérogation paraissait favorable aux salariés. Il en est ainsi,
notamment, des dispositions organisant les élections professionnelles (double
tour de scrutin, représentation proportionnelle,...) et plus généralement
de celles qui organisent le fonctionnement des institutions sociales. Ainsi,
une convention collective ne peut prévoir que les litiges entre employeurs
et salariés seront portés devant une commission disciplinaire instituée par
la convention collective elle-même, au lieu d’être soumis au conseil de
prud’hommes. On en vient ainsi à distinguer les dispositions légales
d’ordre public absolu, auxquelles la convention collective ne peut déroger,
et les dispositions d’ordre public relatif, que la convention collective peut
modifier dans un sens favorable aux salariés. Par exemple, une convention
collective peut prévoir des salaires plus élevés que le SMIC, des congés
payés plus longs que ceux prévus par la loi, des indemnités de licencie-
ment supérieures à l’indemnité légale.
En résumé :
– la convention collective ne peut déroger aux dispositions légales d’ordre
public (mais on a vu que la portée de ces dispositions est aujour-
d’hui réduite) ;
– la convention collective ne peut comporter des dispositions illégales ou
moins favorables aux salariés que les dispositions légales (elle ne peut
prévoir, par exemple, un délai de préavis, en cas de licenciement, infé-
rieur au délai prévu par la loi) ; elle ne peut priver un salarié d’un
droit que lui reconnaît la loi mais peut comporter des dérogations ou
« assouplissements » prévus par la loi ;
– elle peut comporter des dispositions plus favorables que la loi (et c’est
bien là sa fonction essentielle).
䉷 Éditions d’Organisation 75
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
Daniel MARCHAND
Professeur titulaire de la Chaire de Droit Social
du Conservatoire National des Arts et Métiers
Ouvrage initié par Yves DELAMOTTE
Professeur Honoraire au Conservatoire National des Arts et Métiers
Ancien directeur du Centre de Formation des Inspecteurs du Travail
LE DROIT
DU TRAVAIL
EN PRATIQUE
Dix-septième édition mise à jour
au 15 juillet 2004
䉷 Éditions d’Organisation – 1983, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ISBN : 2-7081-3196-6
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS ........................................................................................ 13
INTRODUCTION ........................................................................................ 15
Première partie
INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
CONSEILS DE PRUD’HOMMES
SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL
Chapitre I : ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS DANS
LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI ...................................................... 23
I. Ministère, administration centrale et services extérieurs ;
Inspection du travail ...................................................................... 23
II. Instances consultatives ................................................................... 27
– Commission nationale de la négociation collective ................... 28
– Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels 28
– Conseil supérieur de la prud’homie .......................................... 29
– Conseil supérieur de la participation ........................................ 29
III. Organismes rattachés ...................................................................... 30
– Agence Nationale pour l’Emploi ............................................... 30
– Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 31
– Centre d’Études de l’Emploi ..................................................... 31
– Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Tra-
vail ............................................................................................. 31
– Office des Migrations Internationales ........................................ 32
– Délégué interministériel au codéveloppement et aux migrations
internationales ........................................................................... 32
– Agence Nationale pour les Chèques-Vacances .......................... 32
– Mission de liaison interministérielle pour la lutte contre le tra-
vail clandestin ........................................................................... 33
– Délégation interministérielle à l’insertion des jeunes ............... 33
– Centre pour le développement de l’information sur la formation
permanente ................................................................................ 33
– Observatoire de la parité entre les hommes et les femmes ...... 34
– Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale .... 34
– Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ......... 35
䉷 Éditions d’Organisation 7
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
S OMMAIRE
Chapitre II : TRIBUNAUX ............................................................................... 37
– Juridictions civiles ..................................................................... 37
– Juridictions pénales ................................................................... 38
– Cours d’appel ............................................................................. 40
– Cour de cassation ...................................................................... 40
– Juridictions administratives ....................................................... 41
Chapitre III : CONSEILS DE PRUD’HOMMES ....................................................... 45
– Organisation des conseils de prud’hommes ............................... 46
– Conditions d’électorat et d’éligibilité – Scrutin ........................ 48
– Statut des conseillers prud’hommes .......................................... 50
– Compétence des conseils de prud’hommes ................................ 52
– Procédure ................................................................................... 53
Chapitre IV : SOURCES DU DROIT ................................................................... 59
– Sources internationales ............................................................... 59
– Sources d’origine étatique .......................................................... 62
– Sources d’origine professionnelle ............................................... 66
– Principes généraux du droit ...................................................... 71
– Hiérarchie des sources du droit ................................................ 72
Deuxième partie
ACCÈS À L’EMPLOI ET PERTE DE L’EMPLOI
ALÉAS DE LA VIE PROFESSIONNELLE
Chapitre V : ACCÈS À L’EMPLOI – CONTRAT DE TRAVAIL ................................... 79
– Formalités et conditions du recrutement .................................. 80
– Formations en alternance – Apprentissage ................................ 86
– Contrat de travail ...................................................................... 90
Chapitre VI : CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE – CONTRAT DE TRA-
VAIL TEMPORAIRE – CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL .......................... 105
I. Contrat de travail à durée déterminée ......................................... 106
– Situations dans lesquelles une entreprise peut recourir aux
contrats à durée déterminée ...................................................... 106
– Terme, durée et cessation du contrat ........................................ 109
– Forme et contenu du contrat – Période d’essai ........................ 113
– Statut des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée 114
– Succession de contrats à durée déterminée – Sanctions ............ 116
II. Contrat de travail temporaire ........................................................ 118
– Situations dans lesquelles une entreprise peut faire appel à un
salarié temporaire ...................................................................... 119
– Terme, durée et cessation du contrat de travail ....................... 121
– Forme et contenu des contrats – Période d’essai ...................... 123
– Statut des salariés intérimaires .................................................. 125
– Succession des contrats – Contrôle et sanctions ........................ 126
III. Contrat de travail à temps partiel ................................................ 128
8 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
S OMMAIRE
Chapitre VII : RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE :
DÉMISSION DU SALARIÉ, LICENCIEMENT POUR FAIT PERSONNEL ........................ 135
I. Démission du salarié ...................................................................... 135
II. Licenciement pour fait personnel ................................................. 138
– Procédure applicable en cas de licenciement ............................ 139
– Exigence d’un motif réel et sérieux .......................................... 144
– Préavis ....................................................................................... 149
Chapitre VIII : LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE ................................ 153
I. Procédures qui s’imposent à l’employeur .................................... 159
– Licenciement individuel pour motif économique ...................... 159
– Licenciement collectif pour motif économique visant moins de
dix salariés dans une même période de trente jours ................. 161
– Licenciement collectif pour motif économique concernant au
moins dix salariés dans une même période de trente jours ...... 162
II. Sanctions d’un licenciement irrégulier ou injustifié .................. 170
III. Mesures d’accompagnement .......................................................... 174
Chapitre IX : CESSATION DU CONTRAT : INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT – CERTIFI-
CAT DE TRAVAIL – REÇU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE – CLAUSES PARTICULIÈRES
– ASSURANCE CHÔMAGE ............................................................................... 183
– Indemnité de licenciement ........................................................ 184
– Récapitulation : indemnités et dommages-intérêts éventuelle-
ment dus au salarié ................................................................... 186
– Certificat de travail ................................................................... 188
– Reçu pour solde de tout compte, transaction ........................... 190
– Clauses particulières .................................................................. 191
– Assurance chômage .................................................................... 196
Chapitre X : PRÉROGATIVES DE LA DIRECTION ET ALÉAS DE LA VIE PROFESSION-
NELLE .......................................................................................................... 199
– Pouvoir de direction – Ses limites ............................................ 200
– Pouvoir disciplinaire .................................................................. 208
– Aléas tenant à la conjoncture économique ................................ 215
– Maladie et accident du travail .................................................. 220
– Retraite ...................................................................................... 225
Troisième partie
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Chapitre XI : SALAIRE .................................................................................... 235
– Composantes du salaire ............................................................. 236
– Statut juridique du salaire ........................................................ 239
– Montant du salaire .................................................................... 245
䉷 Éditions d’Organisation 9
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
S OMMAIRE
Chapitre XII : PARTICIPATION – INTÉRESSEMENT – ACTIONNARIAT DES SALARIÉS 255
I. Participation aux résultats ............................................................. 256
– Réserve spéciale de participation ............................................... 257
– Accords de participation ............................................................ 260
II. Intéressement .................................................................................. 262
III. Actionnariat des salariés – Épargne salariale .............................. 264
Chapitre XIII : DURÉE DU TRAVAIL – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ... 269
– Durée légale du travail – Heures supplémentaires ................... 271
– Repos hebdomadaire .................................................................. 283
– Travail de nuit – Travail en équipes successives ...................... 287
– Horaires de travail ..................................................................... 290
– Rôle de la négociation collective .............................................. 293
– Pénalités .................................................................................... 294
Chapitre XIV : JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS ........................................................ 295
– Jours fériés ................................................................................. 295
– Congés payés annuels ................................................................ 297
– Chèques-vacances ....................................................................... 304
– Congés spéciaux ......................................................................... 305
– Compte épargne temps .............................................................. 320
Chapitre XV : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ............................................................. 323
– Législation et réglementation en matière d’hygiène et de sécu-
rité ............................................................................................. 324
– Pouvoirs reconnus à l’Inspection du travail .............................. 327
– Sanctions pénales en cas d’infraction à la réglementation ou d’ac-
cident du travail ........................................................................ 329
– Sécurité intégrée dans la conception des machines et la fabrica-
tion des produits ....................................................................... 333
– Droit pour le salarié de se retirer d’une situation dangereuse 334
Chapitre XVI : COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
– EXPRESSION DES SALARIÉS – SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL ....................... 337
I. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ....... 338
– Organisation et composition – Statut des représentants du per-
sonnel ........................................................................................ 338
– Mission du comité ..................................................................... 341
– Fonctionnement ......................................................................... 343
– Délit d’entrave ........................................................................... 344
II. Expression des salariés ................................................................... 345
III. Services de santé au travail ........................................................... 347
– Organisation .............................................................................. 347
– Statut et attributions du médecin du travail ............................ 350
– Contrôle et sanctions ................................................................. 353
10 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
S OMMAIRE
Chapitre XVII : DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNEL DANS L’ENTREPRISE .. 355
– Jeunes travailleurs, femmes salariées : salaire et conditions de
travail ........................................................................................ 355
– Protection de la femme enceinte ............................................... 356
– Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ........... 361
– Catégories professionnelles – Mensualisation ............................ 363
Quatrième partie
RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Chapitre XVIII : SYNDICAT ........................................................................... 373
– Objet et création du syndicat ................................................... 373
– Liberté syndicale : aspect individuel .......................................... 375
– Capacité civile du syndicat ........................................................ 377
– Organisations syndicales les plus représentatives ...................... 379
– Organisation du syndicat et insertion dans les structures de la
confédération ............................................................................. 382
Chapitre XIX : CONVENTION COLLECTIVE ....................................................... 385
– Champ d’application de la loi – Différents types de conventions
et d’accords – Parties à la négociation ...................................... 386
– Adhésion – Relations entre les signataires de la convention ou
de l’accord ................................................................................. 391
– Conventions et accords de branche – Obligation de négocier 395
– Extension des conventions collectives et des accords ................ 398
– Conventions et accords collectifs d’entreprise – Obligation de
négocier ..................................................................................... 403
– Information du personnel – Sanctions et contrôle .................... 408
– Accords de groupe ..................................................................... 410
Chapitre XX : DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ........................................................ 413
– Champ d’application de la législation ....................................... 413
– Cadre et modalités de l’élection ................................................ 415
– Attributions des délégués du personnel .................................... 424
– Conditions d’exercice des fonctions ........................................... 426
Chapitre XXI : COMITÉ D’ENTREPRISE ............................................................ 433
– Champ d’application de la législation – Cadre dans lequel le
comité est constitué .................................................................. 433
– Composition du comité – Modalités de l’élection .................... 435
– Conditions de fonctionnement .................................................. 440
– Attributions du comité d’entreprise (autres que la gestion des
activités sociales et culturelles) ................................................. 445
– Gestion des activités sociales et culturelles ............................... 458
– Comités d’établissement et comité central d’entreprise ............ 462
– Unité économique et sociale – Comité de groupe .................... 465
䉷 Éditions d’Organisation 11
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
S OMMAIRE
– Bilan social ................................................................................ 468
– Comité d’entreprise européen .................................................... 470
Chapitre XXII : DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE ..................................... 473
– Champ d’application de la législation ....................................... 474
– Section syndicale ........................................................................ 475
– Délégués syndicaux .................................................................... 478
Chapitre XXIII : PROTECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL CONTRE LE
LICENCIEMENT – DÉLIT D’ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
REPRÉSENTATIVES ET À L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ................................. 487
– Salariés protégés ........................................................................ 488
– Procédure ................................................................................... 491
– Cumuls de procédures ............................................................... 495
– Sanctions applicables en cas d’inobservation de la procédure par
l’employeur ................................................................................ 497
– Deux voies de recours contre la décision de l’inspecteur du tra-
vail : recours hiérarchique et recours contentieux ..................... 499
– Délit d’entrave ........................................................................... 503
Chapitre XXIV : CONFLITS DU TRAVAIL – GRÈVE ........................................... 505
– Objet et déclenchement de la grève ......................................... 506
– Modalités de la grève ................................................................ 508
– Conséquences de la grève pour les salariés ............................... 511
– Ripostes patronales .................................................................... 513
– Modes de règlement des conflits collectifs du travail ............... 518
– Responsabilités civiles engagées à l’occasion de la grève .......... 521
– Responsabilité pénale du fait d’actes commis au cours d’une
grève .......................................................................................... 523
Chapitre XXV : DROIT APPLICABLE DANS LES ENTREPRISES NATIONALISÉES – LOI
DE DÉMOCRATISATION DU SECTEUR PUBLIC .................................................... 527
ANNEXES :
I. Questions devant être couvertes par les dispositions d’une
convention collective de branche pour que celle-ci puisse être
étendue ............................................................................................. 531
II. Élections des délégués du personnel : attribution des sièges (cas
pratique) ........................................................................................... 535
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES ...................................................... 539
INDEX .......................................................................................................... 543
12 䉷 Éditions d’Organisation
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org
Vous aimerez peut-être aussi
- Contrats de travail : l'essentiel: Comprendre les enjeux du droit social et du travail belge dans son contratD'EverandContrats de travail : l'essentiel: Comprendre les enjeux du droit social et du travail belge dans son contratPas encore d'évaluation
- La responsabilité du travailleur, de l’employeur et de l’assuré socialD'EverandLa responsabilité du travailleur, de l’employeur et de l’assuré socialPas encore d'évaluation
- Contrat de TravailDocument8 pagesContrat de TravailBrahim KamaraPas encore d'évaluation
- Cours Droit SocialDocument30 pagesCours Droit Socialاسرار الصحراوياتPas encore d'évaluation
- GRH Rémunération Du Personnel PDFDocument66 pagesGRH Rémunération Du Personnel PDFSara Bel86% (7)
- Suspension Du Contrat de TravailDocument5 pagesSuspension Du Contrat de TravailRachid OmariPas encore d'évaluation
- TC3 - Droit Du Travail National Et InternationalDocument78 pagesTC3 - Droit Du Travail National Et Internationalyanzi6273Pas encore d'évaluation
- Modèle Fiche de PaieDocument1 pageModèle Fiche de PaieAmadou N'daouPas encore d'évaluation
- Ta Pr. Guenbour Saida Cours de Droit Des SocietesDocument211 pagesTa Pr. Guenbour Saida Cours de Droit Des SocietesCh HamzaPas encore d'évaluation
- Le Juge Des Referes A La Lumiere de La Loi 49 16 Relative Aux Baux CommerciauxDocument133 pagesLe Juge Des Referes A La Lumiere de La Loi 49 16 Relative Aux Baux CommerciauxMohamed DahbiPas encore d'évaluation
- BDESEDocument55 pagesBDESEHOCHARTPas encore d'évaluation
- M21 - Réponses Examens - AbrégéDocument10 pagesM21 - Réponses Examens - Abrégéyassmine elbPas encore d'évaluation
- Cours de Législation de TravailDocument23 pagesCours de Législation de Travailkaoutar SAKARPas encore d'évaluation
- Relations Collectives Du TravailDocument144 pagesRelations Collectives Du TravailFlo FeralPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Social Approfondi M1CCA U-AubenDocument28 pagesCours de Droit Social Approfondi M1CCA U-AubenDjeneba OuedraogoPas encore d'évaluation
- Le Controle Des Dirigeants Sociaux Par La RepressionDocument18 pagesLe Controle Des Dirigeants Sociaux Par La Repressionpaskovie Kouakou100% (1)
- Cours Droit Du Travail-ConvertiDocument53 pagesCours Droit Du Travail-ConvertiPurple SocialPas encore d'évaluation
- Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesD'EverandLe contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesPas encore d'évaluation
- Les Grands Arrêts - Licenciement Pour Motif ÉconomiqueDocument11 pagesLes Grands Arrêts - Licenciement Pour Motif ÉconomiqueKhady Alao FaryPas encore d'évaluation
- Droit Social 3-1 PDFDocument35 pagesDroit Social 3-1 PDFIcare MendozaPas encore d'évaluation
- Contrat de Travail en Droit MarocainDocument2 pagesContrat de Travail en Droit MarocainBATARD 18Pas encore d'évaluation
- Droit Des Sociétés FinalDocument88 pagesDroit Des Sociétés FinalkarimePas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Représentation Des SalariésDocument8 pagesChapitre 4 Représentation Des SalariéssihemPas encore d'évaluation
- Droit Du Travail - SEQ2Document9 pagesDroit Du Travail - SEQ2alassane cissePas encore d'évaluation
- La Physionomie Du Syndicalisme Au MarocDocument2 pagesLa Physionomie Du Syndicalisme Au Maroclounes41Pas encore d'évaluation
- Guide Sur L'organisation Et Le Fonctionnement Du Comité de Sécurité Et D'hygièneDocument19 pagesGuide Sur L'organisation Et Le Fonctionnement Du Comité de Sécurité Et D'hygièneOumaima CHAIERIPas encore d'évaluation
- Droit Du TravailDocument39 pagesDroit Du TravailLaura BonefPas encore d'évaluation
- Arret 16 Juillet 1997Document3 pagesArret 16 Juillet 1997RahiMa Fara100% (1)
- Expose Personnes MoralesDocument21 pagesExpose Personnes MoralesJihane JaadanPas encore d'évaluation
- Législation Marocaine Du TravailDocument5 pagesLégislation Marocaine Du TravailbhtkimPas encore d'évaluation
- 338209254-Droit-Commercial-Dr-Khalid-Farid-S4 - Copie PDFDocument24 pages338209254-Droit-Commercial-Dr-Khalid-Farid-S4 - Copie PDFSalsabil SendidPas encore d'évaluation
- Le Droit Pénal Du TravailDocument5 pagesLe Droit Pénal Du TravailDouba Doumbouya0% (1)
- Cours Sociétés 2023Document32 pagesCours Sociétés 2023Iswat OkoroPas encore d'évaluation
- 100 Ans Du Droit Du Dpi MarocDocument5 pages100 Ans Du Droit Du Dpi MarocKaoutaruPas encore d'évaluation
- La Fin de La Relation de Travail Pour Motif Économique PDFDocument93 pagesLa Fin de La Relation de Travail Pour Motif Économique PDFMutanga Shemny100% (1)
- Exposé Société en FormationDocument25 pagesExposé Société en Formationbtissamkarmouni3Pas encore d'évaluation
- COURS DROIT DE LA CONSOMMATION ET DE LA FRANCHISE (Doc. Complet)Document21 pagesCOURS DROIT DE LA CONSOMMATION ET DE LA FRANCHISE (Doc. Complet)Manil SchoolPas encore d'évaluation
- RT-S4-M13.1-Droit Social - CRS 2-AFAKHRI PDFDocument40 pagesRT-S4-M13.1-Droit Social - CRS 2-AFAKHRI PDFGhizelan ÀaaPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 4 - Les Modifications Du Contrat de TravailDocument7 pagesCHAPITRE 4 - Les Modifications Du Contrat de TravailMariePas encore d'évaluation
- Theme 2 Le Droit de La Fonction Publique Et Le Droit Du TravailDocument7 pagesTheme 2 Le Droit de La Fonction Publique Et Le Droit Du TravailOmar GueyePas encore d'évaluation
- Contentieux Du TravailDocument3 pagesContentieux Du TravailMyandriamaholyzi RazakatianaPas encore d'évaluation
- Techniques Sociétaire 2Document34 pagesTechniques Sociétaire 2Mouha LyPas encore d'évaluation
- la responsabilité des acteurs de l'internet finDocument30 pagesla responsabilité des acteurs de l'internet finf9zg2kdmnzPas encore d'évaluation
- PDF TD DRT ST - 2011Document108 pagesPDF TD DRT ST - 2011Rekaya Izzaouihda100% (1)
- Partie II Le Droit Des Groupes de SociétésDocument10 pagesPartie II Le Droit Des Groupes de SociétéssihemPas encore d'évaluation
- Droit SocialDocument32 pagesDroit SocialRabie El Ouad100% (1)
- Inspection Du TravailDocument10 pagesInspection Du TravailRachidi OuassimPas encore d'évaluation
- La Cessation Des Fonctions Des Dirigeant PDFDocument20 pagesLa Cessation Des Fonctions Des Dirigeant PDFNabis IsmailaPas encore d'évaluation
- La Gestion Des Contrats de Travail PlanDocument4 pagesLa Gestion Des Contrats de Travail PlanHæ MïdPas encore d'évaluation
- Contrat de TravailDocument13 pagesContrat de TravailÃÿ MánPas encore d'évaluation
- Droit Du TravailDocument28 pagesDroit Du TravailMADZOUPas encore d'évaluation
- Module Droit Social 2021-2022Document90 pagesModule Droit Social 2021-2022El ghanmi soufianePas encore d'évaluation
- Les Différentes Formes Ou Catégories de Sociétés Et Groupements VoisinsDocument3 pagesLes Différentes Formes Ou Catégories de Sociétés Et Groupements VoisinsIssam NajibPas encore d'évaluation
- Ordre Public Economique PriveDocument50 pagesOrdre Public Economique Privejihane amraniPas encore d'évaluation
- Relation Professionelle Au MarocDocument35 pagesRelation Professionelle Au MarocLazrek HibaPas encore d'évaluation
- La Preuve en DRT FiscalDocument114 pagesLa Preuve en DRT Fiscalsaid amalPas encore d'évaluation
- Les IPM PDFDocument14 pagesLes IPM PDFbjuufPas encore d'évaluation
- L'égalité Entre AssociésDocument17 pagesL'égalité Entre Associésbedel mouloPas encore d'évaluation
- Les Salariés Dans Les Procédures Collectives OHADADocument14 pagesLes Salariés Dans Les Procédures Collectives OHADAAbdellatif Ousman TidjaniPas encore d'évaluation
- Cours - Introduction Au Droit Du TravailDocument11 pagesCours - Introduction Au Droit Du TravailDCO AquitainePas encore d'évaluation
- 2 IntroductionDocument2 pages2 Introductionbeebac2009Pas encore d'évaluation
- Corrigé Synthèse Chap 3 Les Responsabilités Civile Et PénaleDocument3 pagesCorrigé Synthèse Chap 3 Les Responsabilités Civile Et PénaleCARON Lisa100% (1)
- Memo LicenciementDocument5 pagesMemo LicenciementjalilPas encore d'évaluation
- Droit Pénal Spécial Et Des AffairesDocument11 pagesDroit Pénal Spécial Et Des AffairesAlexandre KouadioPas encore d'évaluation
- Cours Le Contrat Et La Liberte ContractuelleDocument8 pagesCours Le Contrat Et La Liberte ContractuelleEl Habib DriouichPas encore d'évaluation
- Liste Numéro 2 Des Groupes Recherche D'emplois FacebookDocument10 pagesListe Numéro 2 Des Groupes Recherche D'emplois FacebookEl polo LocoPas encore d'évaluation
- Guide Du TravailleurDocument59 pagesGuide Du Travailleurericnad75% (4)
- Nouveau Document Microsoft Office WordDocument3 pagesNouveau Document Microsoft Office WordJean-luc D GlaouPas encore d'évaluation
- CCN EstethiqueDocument50 pagesCCN Estethiqueabdelseb1Pas encore d'évaluation
- Certificat Cessation 3Document1 pageCertificat Cessation 3hermancebindangPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage.S6Document18 pagesRapport de Stage.S6Imane El hassouniPas encore d'évaluation
- Vocabulary List HRDocument5 pagesVocabulary List HRTsvetana IlievaPas encore d'évaluation
- Mali Code 1992 Du Travail MAJ 2017Document78 pagesMali Code 1992 Du Travail MAJ 2017Souleymane Drame100% (1)
- Imad Oct 2022Document1 pageImad Oct 2022Antonio GonzalezPas encore d'évaluation
- Bulletin 2023 12 S17Document3 pagesBulletin 2023 12 S17rayantelliproPas encore d'évaluation
- Limosafiche PC 200 FRDocument25 pagesLimosafiche PC 200 FRArnis RrustemajPas encore d'évaluation
- Fiche de Paie Juillet 2023Document2 pagesFiche de Paie Juillet 2023mbaye0544Pas encore d'évaluation
- Pharmacie, Parapharmacie, Produits Vétérinaires: Fabrication Et CommerceDocument8 pagesPharmacie, Parapharmacie, Produits Vétérinaires: Fabrication Et CommerceMohamed KadriPas encore d'évaluation
- Etat 9421 EDIDocument26 pagesEtat 9421 EDIel khaiat mohamed aminePas encore d'évaluation
- Bulletin 2024 01 S17Document3 pagesBulletin 2024 01 S17rayantelliproPas encore d'évaluation
- Code Du Travail Au MarocDocument38 pagesCode Du Travail Au MarocLotisia TouritaPas encore d'évaluation
- Tabl AuxDocument12 pagesTabl Auxsalma GoualiPas encore d'évaluation
- MMétaloJuin 2019 PDFDocument16 pagesMMétaloJuin 2019 PDFCGTTurbomecaTarnosPas encore d'évaluation
- Guide RH Sanitaire PublicDocument30 pagesGuide RH Sanitaire Publicvogiw42064Pas encore d'évaluation
- BUL - PAIE Mois 11-2023-260Document1 pageBUL - PAIE Mois 11-2023-260elhamraouichaimaaPas encore d'évaluation
- Contrat de Travail D Un Extra Pour ReceptionDocument1 pageContrat de Travail D Un Extra Pour Receptionfdywkyf5z5Pas encore d'évaluation
- RGL 2 DDocument22 pagesRGL 2 DjpPas encore d'évaluation
- TH3237 PDFDocument190 pagesTH3237 PDFMouhcine ZianeePas encore d'évaluation
- 03-La Formation Et L'execution Du Contrat de TravailDocument8 pages03-La Formation Et L'execution Du Contrat de Travailcbegora1Pas encore d'évaluation