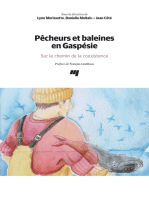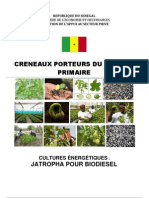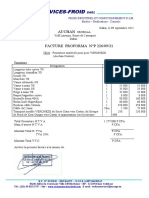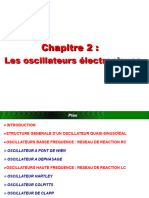Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
PFE07 Le 03 Novembre - Revu CHEIKH B
Transféré par
Sidi MohamedTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
PFE07 Le 03 Novembre - Revu CHEIKH B
Transféré par
Sidi MohamedDroits d'auteur :
Formats disponibles
République Islamique de Mauritanie
Académie Navale
Institut Supérieur des Sciences de la Mer
Projet fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme de licence
professionnelle en filière : Sciences Halieutiques et Industries de pêche
Intitulé du projet :
Exploitation et transformation de la Sardine
(Sardina pilchardus) dans la zone
Mauritanienne de 2011 à 2020
Présenté par : Encadré par :
Nzaha Isselmou Sabar Dr. Mahfoud Taleb Sidi
Dr. Cheikh Baye Bra
Année universitaire 2020-2021
Remerciements
La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs
personnes à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance.
Je voudrais tout d’abord adresser toute ma gratitude à Dr. Mahfoud Taleb Sidi
et Dr. Cheikh Bay Braham pour leur patience, disponibilité et surtout leurs
judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion.
Je désire aussi remercier les professeurs de l’ISSM, qui m’ont fournir les outils
nécessaires à la réussite de mes études universitaires.
Je tiens a remercié spécialement Mr. Hammoud El Vadhel, Mr. Abdelkerim
Souleimane et Mr. Yeslm Vally pour m’avoir accueilli et conseillé, plusieurs
fois dans leurs bureaux et même sans rendez-vous.
Je tiens à témoigner toute ma gratitude pour Mr. Abderrahmane Mainatt pour
sa confiance et son soutien inestimable durant la phase de collecte des données
ainsi que tous les membres de l’équipe de SSPAC.
Je voudrais exprimer ma reconnaissance envers les amis et collègues qui m’ont
apporté leur support moral et intellectuel tout au long de ma démarche.
Année universitaire 2020-2021 i
Liste des abréviations
COPACE : Comité des Pêches de l’Atlantique Centre Est
FAO : Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture)
IMROP : Institut Mauritanien de Recherches Océanographique et des Pêches
NKTT : Nouakchott
PNBA ; Parc Nationale de Banc d’Arguin
SSPAC : système de suivi de la pêche artisanale et côtière
ZEEM : Zone Economique Exclusive Mauritanienne
Année universitaire 2020-2021 ii
Liste des figures
Figure 1 : Unités de stock et pêcheries de sardine (COPACE 2018, l’évolution des petits
pélagiques au large de l’Afrique nord occidentale, 2018)..........................................................5
Figure 2 : migration de la Sardine. (Kifani & Gohin, 1991) ......................................................6
Figure 3 : Evolution des captures de la sardine par segment de flottilles de 1990 à 2018
d’après GT 2019. ........................................................................................................................7
Figure 4: evolution de la capture interannuelle de la Sardine (en tonne) réalisée par la pêche
piroguière .................................................................................................................................10
Figure 5: evolution de la capture de sardine par zone ..............................................................11
Figure 6: evolution de la capture de sardine en tonnes par zone au niveau de la pêche
piroguière .................................................................................................................................12
Figure 7: evolution de la capture de Sardine en tonnes par pêche côtière ...............................13
Figure 8 :pourcentage de la capture de sardine par type de licence .........................................13
Figure 9: évolution de la capture de la sardine par pêche côtier et hauturier ...........................14
Figure 10: evolution de la capture de la sardine par pêche hauturière .....................................15
Figure 11: capture de la sardine par saison ..............................................................................16
Figure 12: evolution du nombre d’usine à Nouadhibou de 2005 à 2020 .................................17
Figure 13: Evolution des exportations mensuelles (%) de farine et huile de poisson (Source :
Douane) ....................................................................................................................................18
Figure 14: Composition par taille des captures dans la Zone C ...............................................19
Liste des tableaux
Tableau 1 : evolution de la capture interannuelle de la Sardine(en tonne) réalisée par la pêche
piroguière .................................................................................................................................11
Tableau 2 : evolution du capture moyenne des petites pélagiques ..........................................19
Année universitaire 2020-2021 iii
Résumé
La Sardine (Sardina pilchardus) est l’espèce dominante dans les captures enregistrées dans la
zone nord-ouest africaine (Maroc, Mauritanie et Sénégal). Elle représente environ 48% en 2021
(COPACE 2021, non publié).
Au Maroc la pêche sardinière est l’une des principales composantes des pêcheries. Elle
constitue plus de 70% des ressources halieutiques et 72% de la production mondiale de sardine
en 2017. (Commission européenne, juin 2017).
La capture totale de la Sardine en Mauritanie a connu une augmentation importante passant
d’une capture d’environ 79 000 tonnes en 2016 à de plus de 166 000 tonnes en 2017 pour
culminer à 400 000 tonnes en 2018 et 2019. Elle enregistre une baisse en 2020 environ 351 251
tonnes. La contribution de la pêche côtière s’élève à 56% en moyenne de 2011 à 2020, alors
que la pêche hauturière représente 42% et 2% Par la pêche piroguière.
Ce travail cherche à combler partiellement les nombreuses lacunes de connaissances sur cette
importante espèce qui pourra être mieux valorisée sous forme de conserves comme au Maroc
créant ainsi plus de richesses et plus d’emplois. De plus la majorité d’études sont effectuées
dans la zone marocaine et saharienne mais très peu en Mauritanie.
La Sardine est une espèce saisonnière. Elle est plus capturée en saison froide qu’en saison
chaude. 86% de capture de sardine sont effectués dans la saison froide (de janvier à mai) et
chaud-froid (novembre-décembre). 14% dans la saison chaude et froide chaude.
La sardine, qui est presque totalement destinée à la fabrication de la farine, contribue en
moyenne avec 32% sur les 5 dernières années de l’ensemble de captures des petits pélagiques
en Mauritanie mais plus de 67 % en 2018 et 2019.
Actuellement, il n’il n’y a pas de transformation de la Sardine en conserve en Mauritanie. Il y’
avait le projet MEIPP (2001-2004) qui consiste à la transformation de la Sardine en boite de
conserves à Nouadhibou. Ce projet a été handicapé par plusieurs facteurs défavorables : non
régularité des approvisionnements, difficultés techniques à la mise en marche, manque de
formation du personnel et difficulté de mise sur le marché des produits nouveaux.
Année universitaire 2020-2021 iv
Summary
The Sardine (Sardina pilchardus) is the dominant species in the catches recorded in the
northwest African area (Morocco, Mauritania and Senegal). It represents about 48% in 2021
(COPACE 2021, unpublished).
In Morocco, sardine fishing is one of the main components of the fisheries. It constitutes more
than 70% of the fishery resources and 72% of the world sardine production in 2017. (European
Commission, June 2017).
The total catch of Sardines in Mauritania has increased significantly from a catch of about
79,000 tons in 2016 to more than 166,000 tons in 2017 to peak at 400,000 tons in 2018 and
2019. It recorded decrease in 2020 about 351,251 tons. The contribution of inshore fishing
amounts to 56% on average from 2011 to 2020, while offshore fishing represents 42% and 2%
by pirogue fishing.
This work seeks to partially fill the many gaps in knowledge about this important species,
which could be better valorized in the form of preserves as in Morocco, thus creating more
wealth and more jobs. Moreover, most studies are carried out in the Moroccan and Saharan
area but very few in Mauritania.
The Sardine is a seasonal species. It is caught more in the cold season than in the warm season.
86% of the sardine catch is taken in the cold season.
The sardine, which is almost totally destined for the manufacture of meal, contributes on
average with 32% over the last 5 years of the total catch of small pelagics in Mauritania but
more than 67% in 2018 and 2019.
Currently, there is no processing of canned sardines in Mauritania. There was the MEIPP
project (2001-2004) which consists in the transformation of the Sardine in cans in Nouadhibou.
This project was handicapped by several unfavorable factors: non-regularity of supplies,
technical difficulties in starting up, lack of staff training and difficulty in bringingnew products
to the market.
Année universitaire 2020-2021 v
نبذة مختصرة
هو النوع السائد في المصيد المسجل في منطقة شمال غرب إفريقيا )(Sardina pilchardusالسردين
،).غير منشور( (COPACE 2021المغرب وموريتانيا والسنغال) .يمثل حوالي ٪48في عام 2021
يعتبر صيد السردين في المغرب من أهم مكونات الثروة السمكية .ويشكل أكثر من ٪70من الثروة السمكية و ٪72من
إنتاج السردين العالمي في عام ( 2017المفوضية األوروبية ،يونيو )2017
ارتفع إجمالي صيد السردين في موريتانيا بشكل كبير من حوالي 79000طن في عام 2016إلى أكثر من 166000طن
في عام 2017ليبلغ ذروته عند 400000طن في عامي 2018و .2019وقد انخفض في عام 2020بنحو 351251طنًا
تصل مساهمة الصيد الساحلي إلى ٪56في المتوسط من 2011إلى ،2020بينما يمثل الصيد في أعماق البحار ٪42و٪2
عن طريق الصيد بالزورق
.
يسعى هذا العمل إلى سد الفجوات المعرفية العديدة حول هذا النوع المهم جزئيًا والتي يمكن تقييمها بشكل أفضل في شكل
محميات كما هو الحال في المغرب ،وبالتالي خلق المزيد من الثروة والمزيد من فرص العمل .باإلضافة إلى ذلك ،يتم
.إجراء غالبية الدراسات في المناطق المغربية والصحراوية ،ولكن القليل منها في موريتانيا
السردين من األنواع الموسمية .يتم التقاطه في موسم البرد أكثر منه في الموسم الحار ٪56 .من صيد السردين في الموسم
البارد ل
يساهم السردين ،المصمم بالكامل تقريبًا لتصنيع الدقيق ،في المتوسط بنسبة ٪ 32على مدى السنوات الخمس الماضية من
.جميع المصيد من أسماك السطح الصغيرة في موريتانيا ولكن أكثر من ٪ 67في 2018و2019
الذي يتضمن ) MEIPP (2001-2004حاليا ،ال توجد معالجة لسردين السردين المعلب في موريتانيا .كان هناك مشروع
معالجة السردين في األغذية المعلبة في نواذيبو .وقد أعاقت عدة عوامل غير مواتية هذا المشروع :عدم انتظام اإلمدادات،
والصعوبات الفنية في البدء ،ونقص تدريب الموظفين ،وصعوبة جلب منتجات جديدة إلى السوق
Année universitaire 2020-2021 vi
Table of Contents
Remerciements........................................................................................................................................i
Liste des abréviations ............................................................................................................................ii
Liste des figures .................................................................................................................................... iii
Liste des tableaux ................................................................................................................................. iii
Introduction générale ........................................................................................................................... 1
1. Matériel et méthode...................................................................................................................... 3
2. Présentation de l’IMROP : établissement d’accueil .................................................................. 3
3. Présentation des caractéristique hydroclimatique de la zone et l’éco-biologie de l’espèce.... 4
3.1. Caractéristiques hydroclimatiques ............................................................................. 4
3.2. Caractéristiques biologique de la sardine .................................................................. 5
3.2.1. Identité du stock ........................................................................................................... 5
3.2.2. Zone et période de reproduction ................................................................................. 6
4. Système d’exploitation ................................................................................................................. 6
4.1. Historique des captures dans la zone nord-ouest africaine et en Mauritanie ......... 6
4.2. Les flottilles ................................................................................................................... 7
4.3. Les captures .................................................................................................................. 9
4.3.1. Les captures de la pêche piroguière ............................................................................ 9
4.3.2. Les captures de la pêche côtière ................................................................................ 12
4.3.3. Les captures de la pêche hauturière ......................................................................... 15
5. La transformation et la valorisation de la sardine .............................................................. 16
5.1. Transformation de la sardine en farine et huile de poissons .................................. 16
5.1.1. Evolution des quantités traitées ................................................................................ 18
5.1.2. La structure de la taille de sardine............................................................................ 19
5.1.3. Impacts des effluents sur la Baie de Lévrier ............................................................ 20
5.2. Valorisation en conserves........................................................................................... 20
5.2.2. Perspectives de développement de la conserve en Mauritanie et dans la région .. 22
Conclusion ........................................................................................................................................... 23
Bibliographie....................................................................................................................................... 24
Année universitaire 2020-2021 vii
Introduction générale
Les petits poissons pélagiques constituent un potentiel halieutique important le long des côtes
mauritaniennes qui s’étendent sur 720 km allant de l’embouchure du fleuve Sénégal au sud
jusqu’à le point du Cap Blanc au nord. La zone économique exclusive mauritanienne (ZEEM)
a une superficie de 234 000 km² avec un plateau continental de 39 000Km². Cette zone est
classée parmi les zones les plus poissonneuses au monde. Cette richesse est due au phénomène
de l’upwelling. Ce Système d’upwelling est variable selon, les saisons, les années et les zones.
Il se manifeste 12 mois par an (permanant) pour la zone entre 20°N et 25°N (centré sur le Cap
Blanc) et 9 mois sur 12 dans la zone centre et sud.
Les Petits pélagiques sont les principales ressources halieutiques des systèmes d’Upwelling qui
représentent 1 % de la superficie de l’océan mais plus de 30 à 35 % de captures. La ZEE
Mauritanienne est caractérisée par la présence de plusieurs espèces d’affinité aussi bien
tropicales (sardinelles, chinchards noir et jaune) que tempérées (sardine, anchois, chinchard de
l’Atlantique et le maquereau).
La Sardine (Sardina pilchardus) est l’espèce dominante dans la zone nord-ouest africaine
(Maroc, Mauritanie et Sénégal) dans les captures des petits pélagiques. Elle représente environ
48% en 2020(COPACE 2021, sous presse).
Au Maroc la pêche sardinière est l’une des principales composantes des pêcheries constitue
plus de 70% des ressources halieutiques, les sardines sont destinées au fabriques de conserves
pour lesquelles le Maroc est le premier exportateur mondial puisqu’il représente 72% de la
production mondiale de Sardina pilchardus, (Commission européenne , Juin 2017). Grâce à
les investissements dans ce secteur qui créé beaucoup d’opportunités d’emploi. En 2020,
suivant les données de l’organisation internationale des douanes la Mauritanie a importé
environ 5000 tonnes de sardines en conserve principalement du Maroc.
La capture totale de la Sardine en Mauritanie a connu une augmentation importante passant
d’une capture d’environ 79 000 tonnes en 2016 à de plus de 166 000 tonnes en 2017 pour
culminer à 400 000 tonnes en 2018 et2019. Elle enregistre une baisse en 2020 environ 351 254
tonnes. La contribution de la pêche côtière s’élève à 56% en moyenne de 2011 à 2020, alors
que la pêche hauturière représente 42% et 2% Par la pêche piroguière.
Année universitaire 2020-2021 1
En 2018, environ 400.000 tonnes de sardine ont été pris et orientée vers la farine et huile de
poissons en créant environ un millier d’emploi du fait de la mécanisation très poussée de cette
industrie. Avec la même quantité de poissons, des usines de conserves peuvent créer 10000
nouveaux emplois dans ce sous-segment. Il est donc important de s’intéresser à cette espèce en
compilant et en analysant les données facilement mobilisables. C’est l’objet de ce stage de fin
d’études pour l’obtention du diplôme de licence professionnelle de la filière Sciences
Halieutiques et Industries de Pêches (SHIP).
Nous allons passer rapidement en revue, les matériels et méthode et la structure d’accueil
avant de revenir plus longuement les caractéristiques éco-biologique de la sardine.
Année universitaire 2020-2021 2
1. Matériel et méthode
Le stage a été précédé par une initialisation par le responsable des enquêtes de la méthode de
collecte suivie par le SSPAC pour connaitre l’activité de la pêche en Mauritanie en particulier
celle ciblée les petits pélagiques. Pendant une dizaine de jours, nous avons arrivés à maitriser
les différents outils et approches utilisé par le système d’échantillonnage de l’IMROP. Les
enquêtes de terrain sont essentiellement de quatre types ;
1. Enquête retour de mer (journalière) : elle se focalise sur les caractéristiques de
l’embarcation.
2. Enquête de lot (mensuration) : c’est une enquête journalière qui consiste à mesurer les
poissons, prendre leurs poids, leurs tailles et des informations au niveau de l’usine.
3. Enquête de récupération des registres d’achat des usines (mensuel) : elle suit les
statistiques de production
4. Enquête RMPC : c’est une enquête de recensement mensuel pour avoir une idée sur
l’effort de pêche.
La cinquième enquête, c’est une enquête semestrielle qui n’entre pas dans le SSPAC. Elle donne
une photo du parc piroguier en instant de celle de l’enquête cadre effectué une fois pendant
l’année.
Pour rendre ce travail exhaustif, nous avons procédé aux traitements de données du journal de
pêche (de 2011 à 2020) en utilisant les logiciels : R (4.1.0) et IBM SPSS statistics 20.
2. Présentation de l’IMROP : établissement d’accueil
Mon stage de fin d’étude a eu lieu à l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et
des Pêches (IMROP). Cette institution est l’unique institut de recherche halieutique en
Mauritanie. C’est un établissement public à caractère administratif, ayant un objectif culturel et
scientifique. Il a succédé au Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches
plus connu sous le sigle CNROP créé en 1979 et qui, lui-même, a été précédé par le
Laboratoire des Pêches qui a vu le jour en 1953.
L’IMROP est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et il est placé sous la
tutelle du Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime.
Année universitaire 2020-2021 3
Comme le précise le décret de 2002-036 transformant le centre en un Institut de recherche,
l’IMROP a pour objet principal d’analyser les contraintes et les déterminants biologiques,
physiques, socio-économiques et techniques du secteur des pêches. Il est en charge d’évaluer
les différents scenarii des stratégies nationales d’aménagement et de développement pour une
exploitation durable des ressources halieutiques maritimes et continentales. Il doit également
mettre à disposition des connaissances qui contribueront à une valorisation accrue de la
production nationale et à une meilleure rentabilisation de l’investissement. Depuis 2020, des
nouvelles missions sont rentrés dans le champ d’activité de l’IMROP comme l’étude des
impacts de l’exploration pétrolières et la salubrité du milieu marin, etc. Mais sa mission
principale reste l’évaluation des stocks halieutiques et la détermination des caractéristiques
bioécologiques des espèces importantes comme la sardine.
3. Présentation des caractéristique hydroclimatique de la zone et l’éco-
biologie de l’espèce
Cette partie porte sur l’écologie et la biologie de cette espèce notamment l’environnement hydro
climatique.
3.1. Caractéristiques hydroclimatiques
Le secteur maritime mauritanien est sous l’influence de deux systèmes de courants de surface
principaux : le courant des Canaries venant du nord et le courant équatorial de Guinée venant
du sud. L’interaction entre ces courants, la topographie, la largeur du plateau continental et les
vents, qui sont la source première des upwellings le long de la côte, sont à l’origine de la très
grande richesse de notre zone maritime.
L’upwelling côtier est particulièrement important et permanent dans la zone nord. Il est
saisonnier en zone sud. Des facteurs météorologiques (force et direction du vent, houle, état de
la mer, barre) interviennent directement dans l’exploitation des unités de pêche artisanales et
côtières. Ainsi avec des senneurs de taille inférieure à 20 m, la force du vent qui atteint 35
nœuds (17 m/s) de mars à juin dans la zone nord, devient un facteur limitant pour ce mode de
pêche et gène sensiblement les autres types. Le phénomène de la barre, avec un gradient du
nord au sud, du Cap Timiris jusqu’à la frontière avec le Sénégal, constitue une contrainte
majeure limitant les sorties en mer des pêcheurs peu expérimentés. Ainsi, les pêcheurs
nationaux travaillant en zone sud ne sortent pas plus de dix jours par mois.
Année universitaire 2020-2021 4
Ces caractéristiques hydro climatiques contribuent à influencer fortement, l’abondance et la
distribution de cette ressource et donc l’activité de pêche. C’est aussi le cas des caractéristiques
biologiques.
3.2. Caractéristiques biologique de la sardine
Les petits pélagiques côtiers auxquels appartient la sardine se caractérisent par une mortalité
naturelle élevée, un comportement grégaire qui permet des captures massives et une faible
valeur unitaire. Cette espèce d’affinité tempérée est localisée essentiellement au nord du cap
Timiris en saison froide.
3.2.1. Identité du stock
Trois stocks sont retenus par les groupes de travail du COPACE (FAO)
- le stock nord (35°45’-32°N) ;
- le stock central, Zones A+B (32°N-26°N) ;
- et le stock sud, Zone C (26°N – Nord de la Mauritanie) (figure 1).
Figure 1 : Unités de stock et pêcheries de sardine (COPACE 2018, l’évolution des petits
pélagiques au large de l’Afrique nord occidentale, 2018)
Année universitaire 2020-2021 5
• Localisation et migration
La sardine se déplace dans le sens côte-large selon un rythme saisonnier, en relation avec la
ponte (Furnestin & Furnestin, 1970). Elle migre au printemps et en hiver vers le large au niveau
des fonds de 50 à 100 rn et se concentre à la côte en été et en automne sur des fonds de 20 à 50
m (Figure2).
Figure 2 : migration de la Sardine. (Kifani & Gohin, 1991)
3.2.2. Zone et période de reproduction
La Sardine se reproduit toute l’année avec une saison de reproduction maximale entre novembre
et février dans la zone de Laâyoune (Amenzoui, Ferhan-tachinante, Yahyaoui, Mesfioui, &
Kifani, 2004 - 2005). La taille moyenne à la première maturité sexuelle (L50) était atteinte à
16,3±0,31 cm et 17,5 ±0,35 cm respectivement chez les mâles et les femelles. La sardine se
reproduisait à des températures comprises entre 16,3 °C et 18,9 °C. Ainsi, la ponte de la sardine
est maximale en hiver, Elle est faible en été. La température semble être le facteur essentiel
dans le déclenchement de la ponte soit par stimulation des mécanismes physiologiques, soit par
enrichissement trophique du milieu.
Ce pendant la période de reproduction que l’exploitation est la plus intense
4. Système d’exploitation
4.1. Historique des captures dans la zone nord-ouest africaine et en Mauritanie
La sardine, Sardina pilchardus, n’apparaissait pas dans les données sur les captures de la pêche
industrielle avant 1969-1970. Elle occupe maintenant une place importante parmi les pêches de
clupéidés : dans le secteur compris entre 20 et 26 N, Sa limite sud est le cap Blanc (20 46N).
Cette espèce, européenne et méditerranéenne, se rencontre à partir de 1969 d’abord dans les
apports des chalutiers, puis dans ceux des senneurs, le long des côtes mauritaniennes jusqu’au
Année universitaire 2020-2021 6
sud du Banc d’Arguin (19°N). Sa production est passée de 80 000 t en 1969 à 650 000 t en
1976. De 1974 à 1976, elle fut aussi signalée au large de Dakar. (Anonyme, 1982).
Ne dépassant pas le 50.000 milles tonnes par an dans les années 1990 et le début des années
2000.Depuis 2002 ces captures commence à augmenter régulièrement jusqu’à atteindre
200.000 tonnes en 2011.La diminution en 2012 et 2013 peuvent s’expliquer par le retrait des
flottilles européennes et par des raisons environnementaux en 2015.
En 2016 la capture commence à augmenter régulièrement pour culminer à 400.000 tonnes en
2018.Ce record plus important a déjà observé et enregistré en (1969-1976) (figure3).
Figure 3 : Evolution des captures de la sardine par segment de flottilles de 1990 à 2018
d’après GT 2019.
4.2. Les flottilles
4.2.1. La pêche artisanale
La pêche artisanale est un sous-secteur très dynamique dont les activités s’étendent le long du
littoral mauritanien, de Nouadhibou au nord à N’Diago au sud
Année universitaire 2020-2021 7
L’essentiel de l’effort de pêche est concentré dans la zone Nord (54%) suivie de la zone de
NKTT avec 20 % et la zone Centre avec 16%. L’effort pour la zone Sud et le PNBA se situe
autour de 5 % chacun.
4.2.2. La pêche côtière
La définition des unités de pêche côtière pélagique (nationale et affrétée) a évolué au cours des
dernières années. Actuellement, elle désigne toute pêche effectuée à l’aide de navires pontés ou
non pontés, de longueur hors-tout compris entre 14,5 et 60 m utilisant majoritairement les
engins passifs.
La pêche côtière pélagique concerne des bateaux côtiers de longueur inférieure à 60 m, dépourvus de
tout moyen de congélation et utilisant pour leur grande majorité la senne tournante. Les bateaux du
segment 1 sont des bateaux de longueur inférieure à 26 m. Les bateaux côtiers du segment 2 sont de
taille comprise entre 26 m et 40 m. Ceux du segment 3 sont de taille supérieure à 40m et inférieure à 60
m. Les navires de cette dernière catégorie peuvent utiliser la senne ou le chalut (GT2019, Septembre
2020)
• Pêche côtière pélagique piroguière
La pêche piroguière côtière type sénégalais est caractérisée par l’utilisation des pirogues
senneurs supérieure à 14m dont le nombre a atteint 264 senneurs en 2019 soit une augmentation
de 140% par rapport à 2018.
+8Pourtant en 2019 de 400 licences aux pêcheurs artisanaux sénégalais pour une durée de 3
mois renouvelable au cours de l’année avec l’obligation de débarquement en Mauritanie.
• Pêche côtière par des grands senneurs
Les unités de pêche côtière pélagique type turc et chinois sont classées en trois segments selon
le critère de la longueur. Le trait caractéristique commun à ces trois segments de la pêche
pélagique côtière est l’interdiction de système de congélation à bord. Ces segments se
distinguent comme suit :
• Segment 1 : il est composé d’unités de longueur de moins de 26 m. Cette catégorie
regroupe les pirogues et les bateaux qui utilisent la senne ;
• Segment 2 : il regroupe les unités de longueur comprise entre 26-40 m utilisant la senne
tournante ;
Année universitaire 2020-2021 8
• Segment 3 : il comprend des bateaux côtiers de longueur comprise entre 40 à 60 m.
Cette catégorie de pêche regroupe à la fois des senneurs et des chalutiers.
Ces unités ont atteint en 2019 environ 75 bateaux majoritairement constitués des navires
segments 3 dont le nombre a atteint 43 navires.
.
4.2.3. Pêche hauturière
La flottille hauturière est composée des grands bateaux dont le nombre est arrivé à 58 unités en
2019.
L’activité des bateaux côtiers est affectée en 2019 par l’application des mesures techniques liées
au respect du maillage fixé à 40 mm dans la réglementation. Un arrêt de quelques mois est
observé durant le deuxième trimestre. Une dérogation provisoire est accordée aux senneurs avec
une autorisation de maillage de 28 mm, accompagnée d’un programme d’observateurs d’août
à décembre 2019. Cette année est caractérisée aussi par le démarrage de l’activité du port de
Tanit qui assure actuellement le débarquement de plusieurs unités artisanales et côtière, et
l’éloignement des unités du segment côtière au-delà de 20 m durant les deux périodes d’arrêt
de pèche (printanier et automnal).
4.3. Les captures
4.3.1. Les captures de la pêche piroguière
La pêche piroguière enregistre des evolution de capture en dent de scie. Elles étaient nulles en
2014 et en 2016 et très faibles en 2018 en revanche elles ont enregistré 35.000 tonnes en 2017,
20.000 tonnes en 2020 ,10.000 tonnes en 2019 (figure 4).
Cette variation interannuelle très rapide des captures de la Sardine par les pirogues
s’expliquerait :
o La migration cote-large. En effet la Sardine migre au printemps et en hiver vers le large
au niveau des fonds de 50 à 100 rn. Dans ce cas elle devient plus accessible aux bateaux
côtiers. Par contre elle se concentre à la côte en été et en automne sur des fonds de 20
à 50 m devenant plus accessible à la pêche piroguière
o Migration latitudinale. Dans le nord de la Mauritanie la sardine se trouve à sa frontière
sud. Les années favorables pour cette espèce (années froides) il y a expansion de cette
espèce .les années chaudes elle n’atteint pas la zone mauritanienne.
Année universitaire 2020-2021 9
o La pêche piroguière de type sénégalais s’intéresse principalement aux sardinelles
rondes. Les années ou cette ressource n’est pas disponible ces pirogues peuvent
rechercher d’autres clupéidés comme la sardine.
Figure 4: evolution de la capture interannuelle de la Sardine (en tonne) réalisée par la pêche
piroguière
En 2015 les captures de la Sardine sont rapportées uniquement au niveau de Nouadhibou.
En 2017 elle a été pêchée jusqu’à Nouakchott mais principalement en Nouakchott, 50% en
Nouakchott, 38% au niveau de la zone nord et 12% au niveau de la zone centre (figure 5).
Année universitaire 2020-2021 10
Figure 5: evolution de la capture de sardine par zone
En 2018 la sardine est capturée en zone centre et Nouakchott
En 2020 les captures sont presque égales dans les trois zones (tableau1)
• La zone nord (Nouadhibou)
• La zone centre (entre cap Timiris et Nouakchott)
• La zone de Nouakchott (principalement Nouakchott)
Tableau 1 : evolution de la capture interannuelle de la Sardine (en tonne) réalisée par la pêche
piroguière
Zone Nouadhibou Centre Nouakchott
Année
2015 12000 0 0
2016 0 0 0
2017 13000 4000 17000
2018 0 1000 200
2019 0 0 9800
2020 5500 5500 5900
42 % des captures sont enregistré dans la zone Nord
44% des captures sont enregistré dans la zone de Nouakchott
14% des captures sont enregistré dans la zone Centre (figure 6).
Année universitaire 2020-2021 11
Figure 6: evolution de la capture de sardine en tonnes par zone au niveau de la pêche piroguière
4.3.2. Les captures de la pêche côtière
Avec l’arrivée des senneurs côtiers turcs en 2016 les prélèvements sur le stock C (26°N – Nord
de la Mauritanie) de la sardine montrent l’accroissement le plus spectaculaire en tonnage entre
2018 et 2020 (Figure 7).Depuis 2014 la capture de la Sardine augmente régulièrement, passant
de 2.300 tonnes en 2014 pour culminer à environ 325000 tonnes en 2018
Année universitaire 2020-2021 12
Figure 7: evolution de la capture de Sardine en tonnes par pêche côtière
La contribution de la pêche côtière s’élève à 56% en moyenne de 2011 à 2020. Alors que la
pêche hauturière représente 42% et 2% Par la pêche piroguière (figure8).
Figure 8 : pourcentage de la capture de sardine par type de licence
Année universitaire 2020-2021 13
La capture de la Sardine est ciblée par la pêche côtière (senneurs côtiers).
Ne dépassant pas 40.000 tonnes en 2014 et 2015.Puis la capture augmente régulièrement à partir
de 2016 pour atteindre environ 324.000 tonnes en 2018 et 320.000 tonnes 2019.
L’augmentation de la capture de Sardine est due à l’entrée en zone de pêche de la flotte côtière
turque, avec unités redoutablement efficaces, qui ont remplacé progressivement une grande
partie de l’effort de pêche des pirogues sénégalaises. (Figure 9)
Les capture de la Sardine a subit une augmentation importante au niveau des segments côtiers
et hauturières à partir de 2016. Cette abondance s’expliquerait par :
o La migration de la Sardine de la Maroc vers la Mauritanie
o L’arrivée des senneurs turcs redoutablement efficace
Figure 9: évolution de la capture de la sardine par pêche côtier et hauturier
Année universitaire 2020-2021 14
4.3.3. Les captures de la pêche hauturière
La capture de la pêche hauturière de la sardine est à la voit de diminution passant de 200.000
en 2011 à 52.000 en 2019 (figure 10).
La capture est nulle en 2015.
En 2016 la capture augmenter jusqu’à 2020
Figure 10: evolution de la capture de la sardine par pêche hauturière
4.3.4. Saisonnalité des captures et distribution par zone de pêche
La Sardine est une espèce saisonnière. Elle est plus capturée en saison froide qu’en saison
chaude.86% de capture de sardine sont effectués dans la saison froide (de janvier à mai) et
chaud-froid (novembre-décembre). 14% dans la saison chaude et froide chaude (figure 11).
Année universitaire 2020-2021 15
Figure 11: capture de la sardine par saison
5. La transformation et la valorisation de la sardine
5.1.Transformation de la sardine en farine et huile de poissons
Avec 32 unités actives, l’industrie de la farine et huile de poisson se présente actuellement
comme un moyen essentiel de la chaine de valeur de petits pélagiques en Mauritanie et plus
particulièrement à Nouadhibou ;
En effet, le développement de l’industrie de farine et de l’huile de poisson depuis 2005 à
Nouadhibou a connu une croissance spectaculaire passant d’une unité à 2005 à 5 en 2010 à 18
en 2015 et 32 actuellement. Au départ les unités de farine ont constitué une opportunité pour
la valorisation des rebuts (déchets) des usines de traitement et des espèces de poissons
demersaux (figure12).
Année universitaire 2020-2021 16
Figure 12: evolution du nombre d’usine à Nouadhibou de 2005 à 2020
Au départ le nombre des usines étaient limité. Ces usines s’approvisionnaient à partir de la
production des unités de pêche artisanales et côtières utilisant la technique de la senne
tournante. Cette technique, dont l’utilisation était relativement récente à Nouadhibou, est
pratiquée par des pêcheurs sénégalais et quelques mauritaniens surtouts dans le cadre de
l’affrètement.
L’exportation mensuelle de la farine et huile de poisson en pourcentage(%), suivant les données
de la douane, varie sur la période 2010-2019 d’environ 5% pour la farine et l’huile en mois de
mai à 12% pour la farine et 17% pour l’huile en décembre (figure 13).
Année universitaire 2020-2021 17
Figure 13: Evolution des exportations mensuelles (%) de farine et huile de poisson (Source :
Douane)
5.1.1. Evolution des quantités traitées
Les quatre espèces les plus transformes en farine sont :
• Sardina pilchardus
• Sardinelle madarensis
• Sardinelle aurita
• Trachurus trachurus
• Ethmalosa fimbriata
• La sardine, qui est presque totalement destinée à la fabrication de la farine, contribue en
moyenne avec 32% sur les 5 dernières années de l’ensemble de captures des petits
pélagiques en Mauritanie (tableau 2) mais plus de 67 % en 2018 et 2019.
Année universitaire 2020-2021 18
• Les captures de la sardine ont représenté 400.000 tonnes en 2018 et 2019.les quantités
de poissons frais destinés à être transformés en farine s’élève à environ 600.000 tonnes
par an.
Tableau 2 : evolution du capture moyenne des petites pélagiques
Espèce 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne
capture
Anchois 0,22 % 0,25 % 0,13 % 0,6 % 0,6 % 0,13 %
Chinchard 41,08 % 31,45 % 21,08 % 27,11 % 27,58 % 28,38 %
Maqueraux 13,20 % 17,32 % 17,06 % 20,39 % 13,26 % 16,53 %
Sardine 13,03 % 23,34 % 33,84 % 41,64 % 39,55 % 31,83 %
Sardinelles 32,46 % 27,65 % 27,89 % 10,81 % 19,55 % 23,13 %
5.1.2. La structure de la taille de sardine
La structure de tailles de la sardine dans la Zone C est établie sur la base des données de captures
marocaines et russes pour la zone Cap Bojador-Cap Blanc et sur la base de données de captures
russes et européennes pour la zone située au sud du Cap Blanc.(CAPACE 2021).
Les principaux modes sont situés entre 20 et 24 cm (LT) avec le pic à 23cm. Le nombre
d’individus inferieur à la taille règlementaire (16cm) représente moins de 1%. Ce qui signifie
en se basant sur ce seul indice nous pouvons avancer que cette exploitation est durable, nous
pouvons aussi considérer que la production de l’huile en dehors de la période de reproduction
serrait importante (figure13)
Figure 14: Composition par taille des captures dans la Zone C
Année universitaire 2020-2021 19
5.1.3. Impacts des effluents sur la Baie de Lévrier
La Baie du Lévrier est le siège d’une importante activité industrielle (dix ports et quais des
pêche centrale, 73 usines de congélation, 32 usines de farine, etc.). Les infrastructures dans la
ville de Nouadhibou produisent environ 2,3 millions de m3 d’eaux usées dont 99,6% sont
déversé directement dans la baie du lévrier. (Legraa, 2014)
Une étude est faite a permis de montrer que la baie n’est pas polluée. Il est donc nécessaire de
continuer à suivre ut le littoral mauritanien qui est de plus en plus menacé par diverses sources
de pollution.
L’absence d’un système de traitement des eaux usées entraînera un apport continu de polluants
chimiques et biologiques dans la baie qui aura des répercussions à long terme sur la qualité de
ses eaux. (Brahim, Taleb, Braham, Kane, & Bouzouma, septembre 2020)
5.2.Valorisation en conserves
En 2018 400.000 tonnes de sardine ont été pris et orientée à la farine et huile de poissons en
créant environ un millier d’emploi du fait de la mécanisation très poussée de cette industrie.
Avec la même quantité de poissons, des usines de conserves peuvent créer 10000 nouveaux
emplois dans ce sous-segment
Si l’attention est orienté vers la création de l’emploi ce n’est pas au niveau de la farine c’est au
niveau de la conserve car la farine est très mécaniser.
Actuellement, il n’il n’y a pas de transformation de la Sardine en conserve en Mauritanie. Il y’
avait le projet MEIPP (2001-2004) qui consiste à la transformation de la Sardine en boite de
conserves à Nouadhibou.
5.2.1. Le Cas de MEIPP : raisons de l’arrêt des activités de cette première usine
Exploitation 2003
L’exploitation de l’exercice 2003, a été handicapée par des facteurs résultant du fait qu’elle
est l’année de mise en marche de l’usine, avec tout ce que cela implique d’aléas négatifs.
Néanmoins tous ces facteurs ont été plus ou moins maîtrisés, ce qui permettra de réaliser
une production normale, à partir de l’exercice 2004. Ces facteurs sont entre autres :
➢ Le non régularité des approvisionnements
➢ Les difficultés techniques à la mise en marche
Année universitaire 2020-2021 20
➢ La formation du personnel
➢ La mise sur le marché des produits nouveaux
Ces facteurs explique le niveau faible de production réalisé, à savoir 5,6 Millions de boites,
(Voir Production 2003), ce qui nous a amené à immobiliser une partie des charges de
l’exercice, qui a malgré tout enregistré une perte d’exploitation de 36 Millions (Voir C.E
2003).
Emplois crées par la société
La mise en marche de la société, a généré la création de 581 emplois fixes, dont 480 femmes.
4 postes d’expatriés se sont avérés nécessaires pour la bonne marche de l’usine, il est prévu de
les mauritanien en 2006.
Les emplois nationaux crées dégagent une masse salariale annuel de 234 Millions UM (Voir
Effectif du Personnel).
Production Prévisionnelle
Afin de rester le plus réaliste possible, nous avons considéré une production de 195.000
boites/Jour, sur seulement 220 Jours de travail l’an, à partir de 2004 soit 42 Millions de boite
pour cette année.
A partir de 2005 nous avons considéré une augmentation de production de 10% l’an.
Il est à noter que la capacité de production de l’usine est de 70 Millions de boites l’an.
La répartition de cette production est comme suit : (Voir état de Production)
➢ Sardines 75%
➢ Maquereaux 15%
➢ Thon 10%
Les marges bénéficiaires appliquées, sont dictées par la situation du marché, qui alors qu’elle
permet une marge confortable pour le thon, dont la consommation est faible eu égard au nombre
de ces consommateurs, ne la permet pas pour la Sardine, en raison des prix de la concurrence.
En ce qui concerne les maquereaux, c’est un produit destiné essentiellement à l’exportation, le
contrat actuel avec DANI dégage une marge de %.
Année universitaire 2020-2021 21
5.2.2. Perspectives de développement de la conserve en Mauritanie et dans la
région
La situation de la Sardine devra s’améliorer, dès que les démarches entreprises actuellement,
pour s’installer sur le marché africain, aboutissent.
Cette situation devra changer, dès que les démarches entreprises actuellement, pour s’installer
sur le marché africain, pour la sardine essentiellement aboutissent
Année universitaire 2020-2021 22
Conclusion
Dans la zone nord-ouest-africaine, le stock C de la sardine est considéré comme non pleinement
exploité (COPACE 2021, non publié). Néanmoins, des signes de stabilité de sa biomasse et
l’augmentation de ses prises sont observées lors de-là période de 2011 à 2020. L’espèce est
devenue plus ou moins fragile (Dr. Cheikh Baye, communication personnelle).
Ce qui nécessite la prise en compte de l’approche de précaution dans l’exploitation de cette
espèce.
Plus 86% des captures de la sardine sont effectuées dans la saison froide (janvier-mai) et chaude froide.
Dans la zone mauritanienne la capture de la sardine a enregistré une tendance rapide à l’accroissement
passant de 25 000 tonnes en 2013 à 400.000 tonnes en 2018 et 2019 avant de baisser en 2020 (351 000
tonnes). Cette évolution remarquable s’explique principalement par l’arrivée des navires côtiers turcs
particulièrement en 2016. Ce stock est très influencé par des facteurs environnementaux et montre des
fluctuations de biomasse indépendantes de la pêche.
Ces impressionnantes augmentations des débarquements de la sardine à Nouadhibou sont-elles
durables ? Avec l’arrivée des senneurs côtiers turcs en 2016, il était admis qu’il était impossible
pour une flotte de navires côtiers d’exercer une mortalité par pêche aussi élevée que celle
déployée par les flottes étrangères de gros chalutiers pélagiques qui étaient des navires usines1.
La réalité s’est avérée tout autre. L’entrée en zone de pêche de la flotte côtière turque, des unités
redoutablement efficaces, qui ont remplacé progressivement une grande partie de l’effort de
pêche des pirogues sénégalaises ; combinée à une demande quasi illimitée en raison de
l’accroissement du nombre d’usines de farine de poissons, ont entraîné une augmentation de la
mortalité par pêche sur cette espèce largement supérieure à celle générée par les flottes
étrangères chalutières pélagiques.
La mortalité par pêche élevée tant dans la zone nord mauritanienne qu’au sud du Maroc, les
conditions environnementales devenant défavorables et une possible augmentation de la
prédation par les thons hauturiers peuvent avoir des conséquences désastreuses sur cette
ressource stratégique, qui constitue désormais la première source d’approvisionnement des
usines de farine et d’huile de poissons à Nouadhibou.
Nous recommandons d’entamer de façon progressive la reconversion vers les conserves pour
bénéficier pleinement des retombées économiques et sociales de cette espèce, qui représente
désormais une composante essentielle des captures des petits pélagiques dans notre zone (soit
1/3)
1
Jusqu’à 2011 presque toutes les tentatives d’exploitation des clupéidés dans la zone nord de la Mauritanie par
les navires côtiers étaient un échec cuisant.
Année universitaire 2020-2021 23
Bibliographie
Amenzoui, K., Ferhan-tachinante, F., Yahyaoui, A., Mesfioui, A. H., & Kifani, S. (2004 - 2005). Etude de
quelques aspects de la reproduction de Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)de la région de
Laâyoune (Maroc). Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat, section Sciences de la Vie, n°26-
27, 43-50. Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat, section Sciences de la Vie, 2004-2005,
n°26-27, 43-50.
Anonyme. (1982). Les ressources en poissons pélagiques des côtes ouest-africaines entre la
Mauritanie et le fleuve Congo. ORSTOM: Paris, France.
Brahim, K., Taleb, H., Braham, C. B., Kane, E. A., & Bouzouma, M. E. (septembre 2020). Amenagement
des ressources halieutiques et gestion de la biodiversite au service du developpement durable
.
Commission européenne . (Juin 2017). étude da cas la sardine en conserve au Portugal.
Commission européenne. (juin 2017). Sardine en conserve au portugal.
Domain, F. (Décembre 1976). Les ressources halieutiques de la cote ouest-Afeicaine entre 16 et 24
Lat. N.
Furnestin, J., & Furnestin, M. L. (1970). La sardine marocaine et sa peche.
GT2019, r. s. (Septembre 2020). Rapport de la neuvième édition du groupe de travail de l’IMROP.
Kifani, S., & Gohin, F. (1991). Dynamique de l'upwelling et variabilité spatio-temporelle de la
répartition de la Sardine marocaine,Sardina pilchardus.
Legraa, M. e. (2014). l'industrie de la farine et de l'huile de poisson à Nouadhibou (Mauritanie) : quels
impacts sur la ressource halieutique et l'environnement marin?
Mohamed Lemine Ould Tarbiya, F. O. (Décembre 2011). Etude diagnostique de la filiére de la farine
et de l'huile de poisson en Mauritanie et au niveau et international.
Tarbiya, M. L., & Mouhamédou, F. O. (Décembre 2021). Etude diagnostique de la filiére de la farine et
de l'huile de poisson en Mauritanie et au niveau et international.
Année universitaire 2020-2021 24
Vous aimerez peut-être aussi
- Pêcheurs et baleines en Gaspésie: Sur le chemin de la coexistenceD'EverandPêcheurs et baleines en Gaspésie: Sur le chemin de la coexistencePas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Vanelli198 (1) (1) Nouv3333Document31 pagesRapport de Stage Vanelli198 (1) (1) Nouv3333issam_da92% (12)
- La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2022: Vers une transformation bleueD'EverandLa situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2022: Vers une transformation bleuePas encore d'évaluation
- La Péche Au MarocDocument44 pagesLa Péche Au MarocFadwa SaroukhPas encore d'évaluation
- La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2020: La durabilité an actionD'EverandLa situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2020: La durabilité an actionPas encore d'évaluation
- BAZIE ClotildeDocument142 pagesBAZIE Clotildeouedraogo abdoul nassirPas encore d'évaluation
- Rapport Peche FKF VFDocument27 pagesRapport Peche FKF VFGamuzPas encore d'évaluation
- Histamine Dans Les Semi-ConserveDocument33 pagesHistamine Dans Les Semi-ConserveMohamed Elgarouge100% (1)
- Recueil de Fiches Techniques Validees VFDocument46 pagesRecueil de Fiches Techniques Validees VFAlmoustaphaPas encore d'évaluation
- Rapport CET Mahajanga 2021 - Session 1 - 2021-10-12Document29 pagesRapport CET Mahajanga 2021 - Session 1 - 2021-10-12Ocea ConsultPas encore d'évaluation
- Filiere Soie - FormattedDocument16 pagesFiliere Soie - FormattedaandriamihantatianaPas encore d'évaluation
- ANCHOIS - SALES Last VersionDocument17 pagesANCHOIS - SALES Last VersionYoussef BouazzaouiPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Lambare PDFDocument74 pagesRapport de Stage Lambare PDFPape SeckPas encore d'évaluation
- Conserves de La Sardine VFDocument20 pagesConserves de La Sardine VFYoussef BouazzaouiPas encore d'évaluation
- Etude Sur Produits Halieutiques VProvisoireDocument40 pagesEtude Sur Produits Halieutiques VProvisoireSelemba NdoyePas encore d'évaluation
- Senegal Infoconseil Mpea Apercu Filiere HalieutiqueDocument23 pagesSenegal Infoconseil Mpea Apercu Filiere HalieutiqueseydinaPas encore d'évaluation
- RPP - 07.04.23 - WP2 - Thematique - Analyse FonctionnelleDocument147 pagesRPP - 07.04.23 - WP2 - Thematique - Analyse FonctionnellewilfridteteganPas encore d'évaluation
- FIRCA - Hévéa Analyse Fonctionnelle FINAL - Août 2020Document48 pagesFIRCA - Hévéa Analyse Fonctionnelle FINAL - Août 2020KornPas encore d'évaluation
- 0chapitre 14 - Peche Et ElevageDocument11 pages0chapitre 14 - Peche Et ElevageCars for lifePas encore d'évaluation
- Rapport Evaluation FINALE PDCV Au MaliDocument76 pagesRapport Evaluation FINALE PDCV Au MaliLIE NLC100% (1)
- AmbinintsoaRabeariveloD AGRO Lic 19Document33 pagesAmbinintsoaRabeariveloD AGRO Lic 19Tinarivo Mac CarlosPas encore d'évaluation
- Document 526057 PDFDocument34 pagesDocument 526057 PDFNIRINTSOA Samoelinica Nanah Sidonie100% (1)
- Guide Pour La Production D'alevins De: Clarias GariepinusDocument14 pagesGuide Pour La Production D'alevins De: Clarias Gariepinussyrius100% (3)
- Culture Energétique BIO CARBURANT JATROPHADocument21 pagesCulture Energétique BIO CARBURANT JATROPHAsakhoib100% (1)
- Note Explicative Du ProjetDocument35 pagesNote Explicative Du Projetjassim igharouane0% (1)
- Rapport Cote Ivoire Offensive LaitDocument29 pagesRapport Cote Ivoire Offensive Laiteysther.kokouaPas encore d'évaluation
- Rabeby UFP Lic 04Document41 pagesRabeby UFP Lic 04Patiente ROBERSONPas encore d'évaluation
- Rapport Maroc 20041Document168 pagesRapport Maroc 20041youpesPas encore d'évaluation
- UntitledDocument9 pagesUntitledRachidPas encore d'évaluation
- La Filière Avicole de Ponte PDFDocument35 pagesLa Filière Avicole de Ponte PDFsallbaba100% (3)
- IPREMBOUCHEMLPIDocument29 pagesIPREMBOUCHEMLPIFall KoutouanPas encore d'évaluation
- Sdsr-Pnia 2020-2030 FRDocument146 pagesSdsr-Pnia 2020-2030 FRpaul BapahPas encore d'évaluation
- Val MerDocument258 pagesVal MerGhizlane SalimPas encore d'évaluation
- Valorisation Du Thon en ConservesDocument21 pagesValorisation Du Thon en Conservessakhoib67% (3)
- Plan de Travail: CamerounDocument18 pagesPlan de Travail: CamerounZAKARI YAOUPas encore d'évaluation
- TDR - Recrutement Consultant Pour Le Dimensionnement Système IrrigationDocument10 pagesTDR - Recrutement Consultant Pour Le Dimensionnement Système IrrigationBernard lozoPas encore d'évaluation
- Projet 4 - DIT-CVA-Cajou - Développement-Innovations & technologies-CVA-anacarde - ActuDocument55 pagesProjet 4 - DIT-CVA-Cajou - Développement-Innovations & technologies-CVA-anacarde - ActuFlorian HOUNGUEPas encore d'évaluation
- Écloserie Piscicole Silures Clarias GariepinusDocument78 pagesÉcloserie Piscicole Silures Clarias GariepinusLancine Magassouba100% (1)
- Boite PhytoDocument48 pagesBoite Phytoakbilizakaria97Pas encore d'évaluation
- Rapport de L'Etude Preparatoire Pour Le Projet de Construction Du Centre de Recherche Et de Technologies Conchylicoles AU Royaume Du MarocDocument146 pagesRapport de L'Etude Preparatoire Pour Le Projet de Construction Du Centre de Recherche Et de Technologies Conchylicoles AU Royaume Du Marocyounes BaylouxPas encore d'évaluation
- Technologies Agricoles Climato-Intelligentes Pour Le Sahel Et La Corne de LafriqueDocument44 pagesTechnologies Agricoles Climato-Intelligentes Pour Le Sahel Et La Corne de LafriqueOlsaint TenelusPas encore d'évaluation
- Revue SectorielleDocument46 pagesRevue SectorielleMouhamed NdiayePas encore d'évaluation
- Etat Des Lieux Senegal Bamboung FinalDocument20 pagesEtat Des Lieux Senegal Bamboung FinalconstantinoPas encore d'évaluation
- VF BechirDocument33 pagesVF BechirBarack del Leaquoter100% (1)
- Peche Thoniere PolynesieDocument60 pagesPeche Thoniere PolynesiePhil LebretonPas encore d'évaluation
- Onp FinalDocument29 pagesOnp Finaltoufik youssfiPas encore d'évaluation
- DJAMDJOU TCHAPPA Alvine LaurenceDocument33 pagesDJAMDJOU TCHAPPA Alvine LaurencecaedcongoPas encore d'évaluation
- Proposition Projet Developpement - LetenneurDocument42 pagesProposition Projet Developpement - LetenneurBAKOLY ANDRIAMIANDRISOAPas encore d'évaluation
- Rapport Du Stage Corrigé-12Document37 pagesRapport Du Stage Corrigé-12rzikikrame10Pas encore d'évaluation
- RP AS38f PDFDocument81 pagesRP AS38f PDFChaiMae TourBiPas encore d'évaluation
- Stratégie Du Secteur Du Tourisme 2020Document4 pagesStratégie Du Secteur Du Tourisme 2020Yassine OuakkiPas encore d'évaluation
- Synthese Rapport Sur La Filiere Mangue Face A Covid-VfDocument13 pagesSynthese Rapport Sur La Filiere Mangue Face A Covid-VfAma WanePas encore d'évaluation
- Template Rapport D'activité 2021Document28 pagesTemplate Rapport D'activité 2021Dalel Toumi AzouzPas encore d'évaluation
- Industrie Des Peches Et de LaquacultureDocument73 pagesIndustrie Des Peches Et de LaquacultureBen BangouraPas encore d'évaluation
- SDSR-PNIA ActualiseeDocument125 pagesSDSR-PNIA ActualiseeGaelle Claude100% (4)
- Exposé À EnvoyerDocument12 pagesExposé À EnvoyerAnjara ariusPas encore d'évaluation
- VCA4D 31 - Mali Fisheries FR - 0Document6 pagesVCA4D 31 - Mali Fisheries FR - 0Mad DoloPas encore d'évaluation
- FatimaDocument22 pagesFatimaRabe MahamanPas encore d'évaluation
- BI Elevage MadagascarDocument16 pagesBI Elevage MadagascarAbdoul AnzizyPas encore d'évaluation
- Mali Soil Fertility Action Plan FRDocument82 pagesMali Soil Fertility Action Plan FRGregory MaigaPas encore d'évaluation
- Modèle Page Couverture MasterDocument12 pagesModèle Page Couverture MasterSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Plan Ahmedou Model 1Document1 pagePlan Ahmedou Model 1Sidi MohamedPas encore d'évaluation
- Facture Prof 226 Auchan CASTORSDocument2 pagesFacture Prof 226 Auchan CASTORSSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Plan Ahmedou Model 1Document1 pagePlan Ahmedou Model 1Sidi MohamedPas encore d'évaluation
- Guide AchatDocument13 pagesGuide AchatSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Solution Midterm Exam 2019Document8 pagesSolution Midterm Exam 2019Sidi MohamedPas encore d'évaluation
- Statique 2009 Corrige StagiaireDocument82 pagesStatique 2009 Corrige StagiaireOnguetou JulesPas encore d'évaluation
- 1000 Expressions Preferees Des Francais EchantillonDocument78 pages1000 Expressions Preferees Des Francais EchantillonIleana Cosanzeana100% (2)
- UATYQ-A-series - Product Profile - ECPFR-BE18-117 - FrenchDocument8 pagesUATYQ-A-series - Product Profile - ECPFR-BE18-117 - FrenchSidi MohamedPas encore d'évaluation
- ThermExcel - Programme HydroFluidDocument21 pagesThermExcel - Programme HydroFluidSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Rendement Moteur Pompe, Pompes, NPSH, Hauteur Manometrique, Pression, Charge, HydrauliqueDocument6 pagesRendement Moteur Pompe, Pompes, NPSH, Hauteur Manometrique, Pression, Charge, HydrauliqueSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Dimensionnement Protection 56Document24 pagesDimensionnement Protection 56f2130Pas encore d'évaluation
- CableDocument13 pagesCableSidi MohamedPas encore d'évaluation
- HPM HPDDocument8 pagesHPM HPDSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Court CircuitDocument26 pagesCourt CircuitSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Pannes ClassiquesDocument16 pagesPannes ClassiquesSidi MohamedPas encore d'évaluation
- La Section Des Cables ElectriquesDocument7 pagesLa Section Des Cables ElectriqueslyahiaouiPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés Installations Électriques: ÉnonceDocument1 pageTravaux Dirigés Installations Électriques: ÉnonceSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Ku KsDocument1 pageKu KsSidi MohamedPas encore d'évaluation
- 02CoursAppareillage ElectriqueDocument29 pages02CoursAppareillage ElectriqueSidi MohamedPas encore d'évaluation
- IT N°246 Désenfumage Des ERP PDFDocument26 pagesIT N°246 Désenfumage Des ERP PDFSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Controle tf1 Ts 2004 2005 PDFDocument4 pagesControle tf1 Ts 2004 2005 PDFcosinusPas encore d'évaluation
- IT N°246 Désenfumage Des ERP PDFDocument26 pagesIT N°246 Désenfumage Des ERP PDFSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Typem PDFDocument16 pagesTypem PDFSidi MohamedPas encore d'évaluation
- v2 Le Circuit FrigorifiqueDocument2 pagesv2 Le Circuit Frigorifiqueolivier CHOUILLOU100% (4)
- Recolement Froid Et Clim PDFDocument1 pageRecolement Froid Et Clim PDFSidi MohamedPas encore d'évaluation
- m4s2s70nt2 T Controle ElecDocument2 pagesm4s2s70nt2 T Controle ElecSidi MohamedPas encore d'évaluation
- Climatisation Industrie CommerceDocument26 pagesClimatisation Industrie CommerceSidi MohamedPas encore d'évaluation
- IntroDocument46 pagesIntrotouil_redouanePas encore d'évaluation
- 160908Document2 pages160908FAVREPas encore d'évaluation
- Prisonniers Du Temps - CrichtonDocument539 pagesPrisonniers Du Temps - CrichtonMelanie VincentPas encore d'évaluation
- TP 3 ThermoDocument8 pagesTP 3 ThermokikoPas encore d'évaluation
- Pilotage PerformanceDocument31 pagesPilotage PerformanceMarc BoldsPas encore d'évaluation
- Sdic PL0277Document38 pagesSdic PL0277Asmae illoussamenPas encore d'évaluation
- Jean Paul II Et La V MarieDocument4 pagesJean Paul II Et La V MarieEmmanuel BakunguPas encore d'évaluation
- ConnectivismeDocument4 pagesConnectivismeAllioui WalidPas encore d'évaluation
- KF 240Document2 pagesKF 240RomanoPas encore d'évaluation
- TD Cristaux LiquidesDocument4 pagesTD Cristaux LiquidesHabjia AbdeljalilPas encore d'évaluation
- Cours de Pharmacie Galénique La BiopharmacieDocument14 pagesCours de Pharmacie Galénique La BiopharmacieZineb fella Mahi100% (1)
- FACES John Cassavetes ScriptDocument101 pagesFACES John Cassavetes ScriptManuel GarcíaPas encore d'évaluation
- DTU 31.1 P1 - Charpente BoisDocument24 pagesDTU 31.1 P1 - Charpente BoisDinh Anh Quan100% (6)
- Fiches de Synthèse Des ExpositionsDocument117 pagesFiches de Synthèse Des ExpositionsMaster Métiers et arts de l'expositionPas encore d'évaluation
- 1 Agent-Socio-éducatif - TDocument2 pages1 Agent-Socio-éducatif - TProf HassanPas encore d'évaluation
- TP 4 - Variateur de VitesseDocument8 pagesTP 4 - Variateur de VitesseLayla AgamanPas encore d'évaluation
- La MétacognitionDocument14 pagesLa Métacognitionamiral proPas encore d'évaluation
- Affiliation 150 A 1000Document20 pagesAffiliation 150 A 1000Rabah BenbellilPas encore d'évaluation
- Syllabus Sylviculture Et Agroforesterie - UCG - ButemboDocument62 pagesSyllabus Sylviculture Et Agroforesterie - UCG - ButemboMuyisa Kambale100% (7)
- Un Lève-PlaqueDocument8 pagesUn Lève-Plaquetayeb FittPas encore d'évaluation
- 28.10 Traitement de La Prononciation en LangueDocument25 pages28.10 Traitement de La Prononciation en LangueOlga PermyakovaPas encore d'évaluation
- Epreuve E2 Bac Pro SN Juin 2022 Risc Elements de CorrectionDocument22 pagesEpreuve E2 Bac Pro SN Juin 2022 Risc Elements de CorrectionerwanPas encore d'évaluation
- Le Guide de La Maçonnerie - Ciment CalciaDocument112 pagesLe Guide de La Maçonnerie - Ciment CalciaAEMa CCCPas encore d'évaluation
- Chapitre 4ABC1Document5 pagesChapitre 4ABC1William Yves YanogoPas encore d'évaluation
- PcastucesDocument92 pagesPcastucesMyandriamaholyzi RazakatianaPas encore d'évaluation
- COA88 Cle2c4226Document62 pagesCOA88 Cle2c4226Khamassi AmerPas encore d'évaluation
- Etude D'un Batiment R+8+S-sol PDFDocument226 pagesEtude D'un Batiment R+8+S-sol PDFرسوم متحركة ماشا والدبPas encore d'évaluation
- STEG - PDF Version 1Document19 pagesSTEG - PDF Version 1barragan150691Pas encore d'évaluation
- Serie Resonnance D'intensite AapcDocument2 pagesSerie Resonnance D'intensite Aapcacademie archimedePas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document40 pagesChapitre 3othman azPas encore d'évaluation