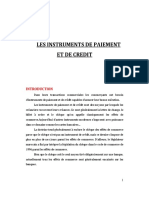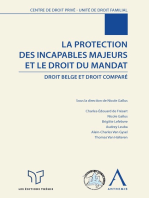Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Responsabilité Civile Support
La Responsabilité Civile Support
Transféré par
ReĐønə Benz M-Psy0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
8 vues4 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
8 vues4 pagesLa Responsabilité Civile Support
La Responsabilité Civile Support
Transféré par
ReĐønə Benz M-PsyDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
La responsabilité civile
Les axes préliminaires ou introductifs du module sont :
- la définition de la responsabilité civile
- les fondements de la responsabilité civile
- la différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale
- la différence entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité
civile délictuelle.
D’ailleurs, on a deux paries dans cette matière :
- la première partie : la responsabilité contractuelle : dans ce cadre, on a les
éléments suivants :
• les conditions d’existence de la responsabilité
• les causes d’exonération du débiteur
• la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle
• les conventions relatives à la réparation du dommage
- la deuxième partie : la responsabilité délictuelle, à ce propos, on a les
éléments suivants :
• le dommage : le dommage : le dommage réparable
• les différents types de dommage
• le fait générateur de la responsabilité : la responsabilité du fait personnel
• le fait générateur de la responsabilité : la responsabilité du fait d’autrui
• le lien de causalité
(1) – la définition de la responsabilité civile :
La responsabilité est le mécanisme par lequel une personne va répondre des
conséquences dommageables de son agissement. Elle emporte l’obligation de
réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité
contractuelle), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun
dommage à autrui.
De là, on distingue entre les actes juridiques et les faits juridiques. Les actes
juridiques sont des obligations volontaires, qui résultent de la volonté de celui
qui s’oblige. Alors que, les faits juridiques sont des obligations non volontaires,
qui résultent de la loi indépendamment de la volonté du débiteur.
Le non-respect des actes juridiques, comme le contrat et la déclaration
unilatérale de volonté, nous génère la responsabilité civile contractuelle.
L’accomplissement des faits juridiques, comme les délits, les quasi-délits (des
faits dommageables. Juste, le délit est un fait dommageable intentionnel et le
quasi-délit est un fait dommageable involontaire), et les quasi-contrats
(désignent un ensemble de mécanismes qui ont en commun de servir à éviter
l’enrichissement injustifié d’un personne au détriment d’une autre. Ces
mécanismes sont : l’enrichissement sans cause, la répétition de l’indu et la
gestion d’affaires. Ils sont profitables et non dommageables), nous engendre la
responsabilité délictuelle.
(2) – les fondements de la responsabilité civile
Dans ce contexte, on distingue entre deux fondements :
- la théorie de la faute : d’après ce fondement, la responsabilité est personnelle
et subjective. En fait, la personne commet l’infraction, et elle-même qui doit
assumer les conséquences de ladite infraction. Cette théorie est expliquée par
la règle suivante : l’homme est libre mais en contrepartie est responsable. La
liberté juridique est délimitée par la responsabilité juridique afin d’écarter
l’anarchie et la liberté économique est délimitée par la responsabilité
économique afin de moraliser la vie des affaires.
- la théorie du risque : selon ce fondement, la responsabilité est du fait d’autrui
et objective. De là, une personne commet l’infraction, et une autre qui doit
supporter les conséquences de ladite infraction.
Deux raisons principales expliquent le déclin de la responsabilité subjective et
l’essor concomitant de la responsabilité objective, fondée sur le risque.
Certaines tiennent au développement du machinisme et l’avènement de la
société industrielle, d’autres tenants au développement des assurances.
En ce sens, le risque professionnel est le risque inhérent à l’exercice d’une
profession, indépendant de la faute des ouvriers et des patrons. L’accident ne
procède plus du risque, cas fortuit, elle est la conséquence du travail. Le
patron, c’est-à-dire l’entreprise est responsable de plein droit des dommages
survenus aux salariés à l’occasion de leur travail.
La responsabilité de l’employeur du fait de l’employeur est expliquée par deux
raisons :
- la théorie du risque –profit ou bien la théorie du risque-activité : selon
laquelle, celui qui tire profit d’une activité doit en supporter les charges. Le
chef de l’entreprise est responsable parce qu’il tire profit de son entreprise.
- la théorie du pouvoir : le pouvoir détenu par le chef d’entreprise qui a paru le
plus apte à fondre la responsabilité du dirigeant. Le chef d’entreprise est
responsable parce qu’il détient le pouvoir (un pouvoir économique à l’égard
des biens et un pouvoir de direction à l’égard du personnel) d’empêcher la
commission de l’infraction.
(3) – Rapports entre responsabilité civile et responsabilité pénale
Les points de divergence entre les deux responsabilités :
- la responsabilité civile est générale, encourue pour tout fait quelconque qui
cause un dommage à autrui.
- la responsabilité pénale est spéciale, encourue seulement pour les faits et les
peines stipulées par le code pénal.
- la responsabilité civile est une responsabilité envers un individu.
- la responsabilité pénale est une responsabilité envers la société.
- la responsabilité civile née d’un préjudice causé à l’autrui.
- la responsabilité pénale née d’une infraction à l’ordre social.
- la responsabilité civile conduit à une réparation (les dommages-intérêts) due
à la victime de l’infraction
- la responsabilité pénale conduit à une peine due à la société.
D’ailleurs, le plus souvent une infraction à la loi pénale, qu’elle soit classifiée
crime, délit ou contravention, cause un dommage à autrui ; c’est le cas, par
exemple, d’une personne blessée après avoir subi des violences volontaires.
Dans cette hypothèse, l’infraction donne naissance à deux actions en justice :
Une action tendant à faire appliquer à l’auteur des violences une peine prévue
par la loi. C’est l’action publique.
Une action ayant pour objet la réparation du dommage corporel, matériel ou
moral subi par la victime c’est l’action civile.
Il arrive cependant que l’infraction ne provoque aucun dommage à une
personne en particulier ; tel est le cas, par exemple, de celui qui porte sur lui,
sans droit, une arme à feu soumise à autorisation. Cette infraction ne fera
naître qu’une seule action : l’action publique.
Les deux actions naissent d’un même fait : infraction.
Dans ce cas on a les règles suivantes :
- l’action publique toujours exercée devant les juridictions répressives.
- l’action civile peut être exercée devant un juge répressif ou juge civil. La
victime a une option entre la voie pénale et la voie civile.
Lorsque la victime porte son action devant le tribunal répressif (plainte avec
constitution de partie civile) alors que l’action publique n’a pas été mise en
œuvre, son initiative déclenche l’action publique.
Si l’action civile est portée par la victime devant le juge civil, ce dernier doit
tenir compte de la décision prise par le tribunal répressif. Il ne peut contredire
la chose jugée sur l’action publique : on parle alors d’autorité sur le civil de la
chose jugée au criminel.
Cette règle montre que le juge répressif statue le premier. Le juge civil ne peut
pas statuer tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé : on dit que le criminel
tient le civil en état.
(4) Rapports entre responsabilité civile contractuelle et
responsabilité civile délictuelle.
Vous aimerez peut-être aussi
- Responsabilité Civile Fasc 1Document18 pagesResponsabilité Civile Fasc 1Mohamed Taha Bouzidi100% (1)
- S5 Méthodologie Jur IntroductionDocument22 pagesS5 Méthodologie Jur IntroductionReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- La responsabilité du travailleur, de l’employeur et de l’assuré socialD'EverandLa responsabilité du travailleur, de l’employeur et de l’assuré socialPas encore d'évaluation
- Droit Pénal Des AffairesDocument84 pagesDroit Pénal Des AffairesRaphael Sitor NdourPas encore d'évaluation
- Droit Administratif Tous de Serge Velley.1Document16 pagesDroit Administratif Tous de Serge Velley.1ReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Abus de Biens SociauxDocument14 pagesAbus de Biens SociauxSamir AMRANEPas encore d'évaluation
- L'assurance du particulier: Tome 2 - Assurances de personnesD'EverandL'assurance du particulier: Tome 2 - Assurances de personnesPas encore d'évaluation
- Abus de ConfianceDocument3 pagesAbus de ConfianceAmine Sbai El IdrissiPas encore d'évaluation
- Droit de La Famille Et PatrimonialDocument73 pagesDroit de La Famille Et PatrimonialNada NejjarPas encore d'évaluation
- Droit Pénal Général1Document47 pagesDroit Pénal Général1Sm .mimouniPas encore d'évaluation
- Les Fondements La Responsabilité Civile DélictuelleDocument7 pagesLes Fondements La Responsabilité Civile Délictuellefatime-zzahra100% (1)
- Cours DPS FinaliséDocument50 pagesCours DPS FinaliséHAMIDPas encore d'évaluation
- De la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieuxD'EverandDe la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieuxPas encore d'évaluation
- La Responsabilite Civile Du NotaireDocument5 pagesLa Responsabilite Civile Du NotaireSanae MarikhPas encore d'évaluation
- La Responsabilité Pénale Des Personnes MoralesDocument4 pagesLa Responsabilité Pénale Des Personnes MoralesBoukouraych AdamPas encore d'évaluation
- Le Régime Juridique de La RCDDocument52 pagesLe Régime Juridique de La RCDZainab BoubechraPas encore d'évaluation
- L'execution Et L'extinction de L'obligation l3 2ème PartieDocument36 pagesL'execution Et L'extinction de L'obligation l3 2ème PartieMory Ouattara100% (1)
- Sanction de L4inexecution Des Obligations A Envoyer 2020Document40 pagesSanction de L4inexecution Des Obligations A Envoyer 2020zineb lemhainiPas encore d'évaluation
- Dommage ReparableDocument19 pagesDommage ReparableOuissal EilaPas encore d'évaluation
- Dépénalisation Du Droit Des AffairesDocument3 pagesDépénalisation Du Droit Des AffairesBouslimSabrinePas encore d'évaluation
- Pfe Droit PriveDocument82 pagesPfe Droit PriveAougui Maiga Aboubacar100% (1)
- TD Séance 7 Droit Des SuretésDocument4 pagesTD Séance 7 Droit Des SuretésAngela LewisPas encore d'évaluation
- Proverbes Et Maximes Peuls Et (... ) Gaden Henri bpt6k261619 PDFDocument408 pagesProverbes Et Maximes Peuls Et (... ) Gaden Henri bpt6k261619 PDFDeroy GarryPas encore d'évaluation
- Instrument de Credit Et Paiement Original S4Document51 pagesInstrument de Credit Et Paiement Original S4ReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Resp CivileDocument39 pagesResp CivileImane KabouriPas encore d'évaluation
- Le Droit Pã©nal Dã©termine Les Infractions Et Les Dã©finit Comme Tout Comportement Puni Par La Loi Pã©nale Et Cause Un Trouble à LDocument13 pagesLe Droit Pã©nal Dã©termine Les Infractions Et Les Dã©finit Comme Tout Comportement Puni Par La Loi Pã©nale Et Cause Un Trouble à Lasmaagartoum20Pas encore d'évaluation
- Jurisprudences Importantes en Matière de Responsabilité CivileDocument3 pagesJurisprudences Importantes en Matière de Responsabilité Civileaya00077100% (2)
- Le Droit de L - Famille Au Maroc PDFDocument73 pagesLe Droit de L - Famille Au Maroc PDFYassine LahmidiPas encore d'évaluation
- S2 DPG Cours Mouhib 2018Document22 pagesS2 DPG Cours Mouhib 2018alioui100% (1)
- Dissertation CrimeDocument2 pagesDissertation Crimeparis780% (1)
- Le Controle Des Dirigeants Sociaux Par La RepressionDocument18 pagesLe Controle Des Dirigeants Sociaux Par La Repressionpaskovie Kouakou100% (1)
- Cours Responsabilité - civ.AKKOURDocument38 pagesCours Responsabilité - civ.AKKOURRajaaPas encore d'évaluation
- Le Régime de La Responsabilité Du Fait D'autruiDocument48 pagesLe Régime de La Responsabilité Du Fait D'autruiAya SemmarPas encore d'évaluation
- Délits & Quasi-DélitsDocument76 pagesDélits & Quasi-DélitsRatish ThacoorPas encore d'évaluation
- Respo Civile S3Document26 pagesRespo Civile S3Ali MesPas encore d'évaluation
- Master Juriste D'affaires (M1) Module: Droit de La Responsabilité CivileDocument26 pagesMaster Juriste D'affaires (M1) Module: Droit de La Responsabilité Civileariana liyaPas encore d'évaluation
- Les responsabilités en matière commerciale: Actualités et perspectivesD'EverandLes responsabilités en matière commerciale: Actualités et perspectivesPas encore d'évaluation
- Droit de la responsabilité: De la détermination des responsabilités à l'évaluation du dommage, un parcours interdisciplinaireD'EverandDroit de la responsabilité: De la détermination des responsabilités à l'évaluation du dommage, un parcours interdisciplinairePas encore d'évaluation
- La protection des incapables majeurs et le droit du mandat: Droit belge et droit comparéD'EverandLa protection des incapables majeurs et le droit du mandat: Droit belge et droit comparéPas encore d'évaluation
- Mesures d'exécution et procédures collectives: Confrontation des règles de l'exécution et du droit des entreprises en difficultéD'EverandMesures d'exécution et procédures collectives: Confrontation des règles de l'exécution et du droit des entreprises en difficultéPas encore d'évaluation
- Responsabilité, indemnisation et recours: CUP 174 - Morceaux choisisD'EverandResponsabilité, indemnisation et recours: CUP 174 - Morceaux choisisPas encore d'évaluation
- L’assurance R.C. auto: Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989D'EverandL’assurance R.C. auto: Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989Pas encore d'évaluation
- L'assurance du particulier: Tome 1: Assurances de dommagesD'EverandL'assurance du particulier: Tome 1: Assurances de dommagesPas encore d'évaluation
- 00.exposé N°7 - L'élément Moral de L'infractionDocument20 pages00.exposé N°7 - L'élément Moral de L'infractionothmane zemranPas encore d'évaluation
- AbusDocument21 pagesAbushaytamPas encore d'évaluation
- Cours TH Orie G N Rale Des ObligationsDocument13 pagesCours TH Orie G N Rale Des ObligationsCharaf EddinePas encore d'évaluation
- Difficultés de L'entreprise PathosdoDocument33 pagesDifficultés de L'entreprise PathosdoHamza Kabir KabirPas encore d'évaluation
- La Faute en Droit CivilDocument2 pagesLa Faute en Droit CivilsalaheddinePas encore d'évaluation
- Responsabilité CivileDocument26 pagesResponsabilité Civilekawtar100% (1)
- Chapitre 1Document17 pagesChapitre 1Bouchra KtamiPas encore d'évaluation
- Les Actes Et Les Faits JuridiquesDocument8 pagesLes Actes Et Les Faits JuridiquesKael LasriPas encore d'évaluation
- Responsabilités des dirigeants de sociétés: 3e édition de l'ouvrage d'Olivier RaletD'EverandResponsabilités des dirigeants de sociétés: 3e édition de l'ouvrage d'Olivier RaletPas encore d'évaluation
- Droit Civil Des Biens Semestre 4Document99 pagesDroit Civil Des Biens Semestre 4Bassirou BadjiPas encore d'évaluation
- La Responsabilite - CivileDocument18 pagesLa Responsabilite - Civilemarwa boutoubaPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Responsabilité Civiles Contractuelle Et DélictuelleDocument11 pagesChapitre 2 Responsabilité Civiles Contractuelle Et Délictuelleaco_rsk100% (1)
- S2-DOC-1 - L'exception D'inexécutionDocument3 pagesS2-DOC-1 - L'exception D'inexécutionzineb lemhainiPas encore d'évaluation
- Les Contentieux Dans Le ContratDocument9 pagesLes Contentieux Dans Le ContratSouhaima ZeghoudPas encore d'évaluation
- Dissertations - Droit Des AssurancesDocument7 pagesDissertations - Droit Des Assurancestahaelhajji8953Pas encore d'évaluation
- Plan Du Cours Responsabilité Civile S3Document4 pagesPlan Du Cours Responsabilité Civile S3mohameed100% (1)
- Mémoire Droit Pénal Des Entités - Mécanismes D'évitement D'engagement de La Responsabilité Pénale Des Personnes MoralesDocument47 pagesMémoire Droit Pénal Des Entités - Mécanismes D'évitement D'engagement de La Responsabilité Pénale Des Personnes MoralesRudy AlbinaPas encore d'évaluation
- Faute - Fait Des Choses - Fait D'autruiDocument19 pagesFaute - Fait Des Choses - Fait D'autruilamine100% (1)
- 2 Eme Partie Responsabilité Civile D'avocatDocument3 pages2 Eme Partie Responsabilité Civile D'avocatBouchra KtamiPas encore d'évaluation
- BIP 74 1998 La Responsabilité Pénale Des Sociétés CommerciaDocument9 pagesBIP 74 1998 La Responsabilité Pénale Des Sociétés CommerciaAhmed FrikelPas encore d'évaluation
- Le Contrat de VenteDocument8 pagesLe Contrat de VenteKamal Labay100% (1)
- Plan Cours Da II PR GohinDocument7 pagesPlan Cours Da II PR GohinReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Memo Arret Cour de CassationDocument2 pagesMemo Arret Cour de CassationReĐønə Benz M-Psy100% (1)
- Droit Administratif Tous de Serge Velley.2Document16 pagesDroit Administratif Tous de Serge Velley.2ReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Boris Barraud, Méthodologie Du Commentaire D'arrêt en DroitDocument17 pagesBoris Barraud, Méthodologie Du Commentaire D'arrêt en DroitReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- La Police Administrative ToutDocument24 pagesLa Police Administrative ToutReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- La Jeunesse Au Carrefour de La Famille de La Communaute Du Droit Et de La SocieteDocument271 pagesLa Jeunesse Au Carrefour de La Famille de La Communaute Du Droit Et de La SocieteReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- L'action Publique Et L'action CivileDocument2 pagesL'action Publique Et L'action CivileReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Théorie Générale de L'instance Le Formalisme de L'instanceDocument15 pagesThéorie Générale de L'instance Le Formalisme de L'instanceReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Le Régime Juridique Des Actes Administratifs UnilatérauxDocument17 pagesLe Régime Juridique Des Actes Administratifs UnilatérauxReĐønə Benz M-Psy100% (1)
- Le Droit Du TravailDocument34 pagesLe Droit Du TravailReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- S5 Méthodologie Jur 1er ChapitreDocument25 pagesS5 Méthodologie Jur 1er ChapitreReĐønə Benz M-PsyPas encore d'évaluation
- Modele de Demande de Contrat A EDFDocument3 pagesModele de Demande de Contrat A EDFjesaismaintenantPas encore d'évaluation
- Séance 2 - Les Principes Directeurs Du Procès PénalDocument3 pagesSéance 2 - Les Principes Directeurs Du Procès PénalThomas CesairePas encore d'évaluation
- Mandat Spécial Pour Louer Un PropriétéDocument2 pagesMandat Spécial Pour Louer Un PropriétéScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Le DroitDocument3 pagesLe Droitherold.antoine29gmail.com Janelsalomongmail.comPas encore d'évaluation
- Lista Abogados PDFDocument22 pagesLista Abogados PDFLuis Alberti DimenticoPas encore d'évaluation
- DocDocument20 pagesDocfaniry mizaPas encore d'évaluation
- Siantou-Bts-Droit Comm-Correction CCDocument2 pagesSiantou-Bts-Droit Comm-Correction CCYves jordanPas encore d'évaluation
- 1 STMG Drec M1Document87 pages1 STMG Drec M1iwamashiPas encore d'évaluation
- Jurisprudence OHADADocument19 pagesJurisprudence OHADAAysabouPas encore d'évaluation
- Cours Introduction Au Droit 2024 Partie 1Document21 pagesCours Introduction Au Droit 2024 Partie 144n7tksctxPas encore d'évaluation
- Cours 4Document19 pagesCours 4marine henryPas encore d'évaluation
- Seminaire Droit de La Concurrence v. oDocument9 pagesSeminaire Droit de La Concurrence v. oInfaillible ManPas encore d'évaluation
- Projet de Société AGCDocument27 pagesProjet de Société AGClukandajoseph466Pas encore d'évaluation
- Extrait Vidéo Du Procès de Klaus Barbie Filmé Par Antenne 2Document1 pageExtrait Vidéo Du Procès de Klaus Barbie Filmé Par Antenne 2BGH BGHPas encore d'évaluation
- Copie de TDDocument7 pagesCopie de TDPauline advPas encore d'évaluation