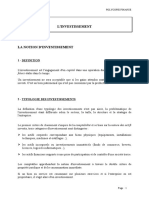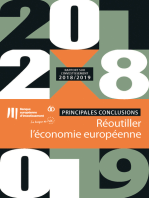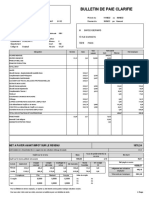Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Investissement Cours D'économie
Investissement Cours D'économie
Transféré par
soumia.zemmahiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Investissement Cours D'économie
Investissement Cours D'économie
Transféré par
soumia.zemmahiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME.
EDM : Economie
Savoir 5324 : l’investissement
Comme nous nous intéressons aux facteurs de production des entreprises, nous retiendrons la
notion de capital technique. Une entreprise, pour produire, utilise une certaine quantité de capital
technique (machines…). Pour acquérir ce capital technique, elle procède à des investissements.
L’investissement est un enjeu économique essentiel. Prenant différentes formes, il modèle le capital
technique et plus largement les capacités de production ultérieures. Il conditionne donc en partie le
dynamisme d’une économie, sa capacité à croître et à se moderniser.
I. Notion d’investissement :
1. Définition :
L’investissement est l’acquisition ou la création des biens capital servant à ajouter du capital
au stock déjà existant par l’accroissement, ou le renouvellement des capacités productives.
Une définition plus restreinte de l’investissement : les dépenses engagées par l’entreprise pour
améliorer ses capacités de production. . Les investissements permettent aux unités de
production de maintenir, d’augmenter et de moderniser leur capital technique (matériel).
L’investissement concerne le capital fixe, C’est pourquoi la comptabilité nationale parle de
formation brute de capital fixe (FBCF) : qui est définie comme la valeur des acquisitions
(nettes de cession) d’actifs fixes par les producteurs résidents.
La formation brute de capital fixe (FBCF) reprend :
- le total des investissements productifs des entreprises et les achats immobiliers des ménages
(investissement privé)
- les investissements réalisés par les administrations publiques, comme la construction de routes ou
d’écoles (investissement public)
2. Typologies
On distingue plusieurs modalités d’investissement :
Les investissements matériels comprennent l’acquisition de l’ensemble des biens de production
physiques (achats de terrains, bâtiments, machines, véhicules…).
On distingue généralement :
- Investissement de remplacement : qui consiste à remplacer une machine ou équipements
usés par d’autre, sans modifier le volume global de production de l’entreprise.
- Investissement de capacité (ou d’extension): qui consiste à acheter des biens de production
supplémentaires à technologie identique permettant de produire des volumes supérieurs.
- Investissement de productivité (ou de rationalisation ou encore de modernisation) : qui
permet d’intégrer les progrès techniques et de rendre la combinaison de production plus performante,
c’est à dire qui permet de produire le même volume à moindre coût.
Les investissements immatériels (ou incorporels) se distingue de l’investissement matériel par
le fait qu’il n’augmente pas le stock de biens durables de l’entreprise. Il correspond aux achats de
logiciels, de brevets, de marques, aux dépenses de recherche et développement, de formation du
personnel, de publicité, marketing et aux autres dépenses commerciales…
L’investissement brut est l’ensemble des investissements qui consiste à remplacer des machines
usées ou encore obsolescentes (amortissement); ou à acquérir de nouvelles machines afin
d’augmenter la production de l’entreprise.
L’investissement net : en retranchant les amortissements de l’investissement brut. pour mieux
cerner l’investissement qui permettra d’augmenter la production de l’entreprise,
L’investissement productif définit, les seuls investissements des entreprises, puisque, à l’opposé
des dépenses en bâtiment de l’Etat ou des logements des particuliers, ils permettent seuls de
produire des biens.
3. Comptabilisation : FBCF
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 1
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
La FBCF comprend l’investissement de l’ensemble des agents économiques résidents : les
entreprises, les ménages (les investissements des ménages au sens de l’INSEE ne concernent que
l’achat de logements, leurs autres achats relèvent de la consommation finale), l’État et les
collectivités locales (équipements collectifs tels qu’écoles, armement…).
La FBCF inclut des biens (investissements physiques) et des services marchands lorsqu’ils
sont inséparables des investissements matériels (par exemple en cas de réparation d’un équipement,
on prend en compte les pièces et la main-d’œuvre).
Ainsi, l’investissement immatériel (les brevets par exemple) n’apparaît pas dans la FBCF.
L’investissement national n’est donc qu’imparfaitement comptabilisé. On considère que la FBCF
correspond à l’investissement national, mais l’importance croissante des investissements immatériels
relativise la pertinence de cette interprétation.
On calcule aussi un taux d’investissement global qui traduit l’effort national (de l’ensemble des
agents résidents) :
Le taux d’investissement = FBCF x 100
PIB
Ce taux constitue une indication sur l’évolution de la production dans les années à venir, ils
contribuent aux prévisions en matière de croissance.
II. Les déterminants de l’investissement :
Le niveau d'investissement d'un pays est mesuré par le taux d'investissement. On recense
traditionnellement quatre facteurs qui influencent la décision d'investir :
1. La rentabilité :
Un investissement est rentable si son coût est inférieur aux revenus qu’il entraînera. L’entrepreneur
fait donc un calcul de rentabilité en comparant le coût de l’investissement et son rendement espéré, il
en déduit le profit escompté.
Mais ce calcul est incertain car il inclut différentes variables qui ne peuvent être qu’anticipées :
- l’évolution de la valeur de la monnaie (on ne connaît pas le niveau qu’atteindra l’inflation),
- La durée de vie de l’investissement (l’obsolescence est difficile à prévoir)
- La vente de la production qui permettra la réalisation des profits escomptés.
2. L’anticipation de la demande effective
La demande effective (anticipée) est essentielle du point de vue keynésien. Une anticipation à la
hausse a un effet incitatif : une entreprise maintiendra et accroîtra sa production si elle prévoit un
accroissement des débouchés (demande).
La réalisation de l’investissement pour répondre à une telle anticipation suppose toutefois plusieurs
conditions :
-la saturation des capacités de production (sinon, le surcroît de demande sera satisfait par l’utilisation
des équipements actuels),
- l’insuffisance des stocks (sinon, il suffira de les écouler),
- la capacité de répondre en termes de qualité et de prix.
On peut ajouter une condition supplémentaire : le climat de confiance ou de méfiance en l’avenir
dans lequel évoluent les entrepreneurs.
Mais rien ne garantit que les ménages consomment suffisamment et que les entreprises
investissent. Selon Keynes l’Etat doit intervenir donc pour soutenir la demande effective :
Par une politique de redistribution : une augmentation des prestations sociales ou une diminution
des charges sociales pour accroître les revenus des plus pauvres dont la propension moyenne à
consommer est la plus élevée.
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 2
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
Par une augmentation des dépenses publiques directes qui vise à donner des débouchés aux
entreprises ces mesures peuvent être financées par une augmentation des taux d’imposition sur les
ménages les plus aisées dont la propension moyenne à épargner est très élevée.
Remarque : L'investissement peut être considéré comme un moteur de la croissance. En effet,
l'investissement est une des composantes de la demande : la dépense d'investissement correspond à
une demande auprès des producteurs de biens d'équipement. De plus, tout investissement donne lieu
à une distribution de revenus qui stimulera la demande. C'est l'effet multiplicateur : une dépense
d'investissement supplémentaire se traduit par un accroissement plus que proportionnel du niveau de
la demande. Ainsi, on peut dire que la croissance dépend fortement du taux d'investissement.
3. le taux d’intérêt :
Parce que les taux d’intérêts sont faibles : une entreprise doit souvent emprunter pour investir. Cet
emprunt occasionne des coûts (paiement d’intérêts). Plus les taux d’intérêt sont faibles, plus une
entreprise sera donc incitée à investir.
L’endettement contribuant à financer l’investissement, il vaut mieux que le taux d’intérêt (coût de
l’endettement) soit inférieur à la rentabilité, il s’agit du taux d’intérêt réel (taux nominal diminué de
l’inflation). Si le taux d’intérêt est supérieur à la rentabilité, l’entreprise a intérêt à se désendetter ou à
placer son épargne. Un taux d’intérêt réel élevé décourage plutôt l’investissement des entreprises
Remarque : Le taux d’intérêt nominal désigne le montant du taux inscrit sur le contrat de prêt.
En revanche, on parlera de taux d’intérêt réel pour définir le taux d’intérêt diminué de l’inflation.
On appelle taux de profitabilité du capital (donc d’un investissement) la différence entre la
rentabilité du capital productif et le taux d’intérêt.
On prend en considération le taux d’intérêt réel à long terme sur le marché financier. Si la
profitabilité est négative (voire faible), il devient plus intéressant de réaliser des placements que des
investissements. Les entrepreneurs réalisent donc en fait un arbitrage entre ces deux usages alternatifs
de leur épargne.
4. D’autres déterminants :
- La situation financière de l'entreprise a son importance : si elle se rapproche du seuil
d'insolvabilité, elle préfère utiliser les profits réalisés pour se désendetter.
- Des subventions versées par les administrations publiques peuvent dans certains cas favoriser
l’investissement puisqu’elles en diminuent le coût pour l’entreprise.
III. Les moyens de financement de l’investissement :
Pour financer ses investissements, un agent économique dispose de différents moyens
substituables ou complémentaires. L’épargne est le seul fondement du financement de
l’investissement. Mais cette épargne présente des formes diverses sur le marché et donc divers
moyens de financement pour l’investisseur :
Financement interne : épargne constituée par l’entreprise elle-même (Autofinancement)
Financement externe indirect (la banque) : L’épargne peut aussi être constituée par les dépôts
des ménages auprès des banques qui octroient des crédits.
Financement externe direct : L’épargne enfin peut provenir du marché financier (émission des
actions, des obligations…)
1. Financement interne
Le financement interne ou autofinancement : l’investisseur utilise ses ressources propres (partie
de ses revenus épargnés, donc non immédiatement consommée).
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 3
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
Pour une entreprise, cela suppose qu’ayant réalisé de bons résultats, elle ait donc un excédent brut
d’exploitation (EBE) élevé et donc dispose d’une épargne substantielle (à partir de son EBE,
l’entreprise rembourse ses dettes, distribue des dividendes et constitue une épargne brute).
On mesure le taux d’autofinancement par le rapport suivant :
Le taux d’autofinancement = épargne brute x 100
Investissement
Un taux de 100 % signifie que l’épargne réalisée couvre les investissements projetés. L’agent
économique a un besoin de financement si son taux d’autofinancement est inférieur à 100 % et une
capacité de financement s’il est supérieur à 100 %.
2. Financement externe, direct ou indirect
Le financement externe consiste à faire appel à l’épargne des autres agents économiques. Il vient
généralement compléter l’autofinancement.
Une entreprise réalise un financement externe soit en augmentant son capital, soit en s’endettant, soit
encore en combinant les deux. Elle fait le pari que sa rentabilité sera suffisante pour lui permettre de
verser des dividendes et/ou de rembourser ses dettes.
Le financement externe indirect (intermédiation) : recourt à des intermédiaires financiers
auprès de qui on réalise un emprunt. En général, il s’agit d’un emprunt bancaire.
Financement indirect monétaire : les banques en créant de la monnaie accordent
des crédits aux emprunteurs
Financement indirect non monétaire : des institutions monétaires (dont les
banques) accordent des crédits à partir des dépôts qu’elles ont préalablement
recueillis.
Le financement externe direct est réalisé sur le marché financier.
Une entreprise peut y procéder à une émission d’actions qui conduit à une augmentation de
son capital social et donc de ses fonds propres.
Elle peut aussi émettre des obligations (emprunt à moyen et long terme) pour lever des fonds
externes qu’il lui faudra rembourser.
Schéma 1 : mécanisme de financement direct et indirect
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 4
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
Schéma 2 : les différents moyens de financement
3. Le choix du moyen de financement :
Le choix du mode de financement pour les entreprises relève d’un arbitrage entre : - l’utilisation
des ressources propres - soit utiliser l’épargne pour l’autofinancement (financement interne), soit
augmenter le capital en émettant des actions (financement externe)
- et l’endettement (bancaire ou sur les marchés en émettant des obligations).
Mode de financement Avantages inconvénients
Financement interne Pas de coût de - Les actionnaires attendent
remboursement des profits élevés
-rarement suffisant
Financement externe Les profits futurs Hausse de l’endettement
(emprunt) reviennent aux actionnaires Remboursement et paiement des intérêts
(effet de levier**)
Financement externe il est pratiquement "gratuit" Entraîne le versement de
(Augmentation de dividendes plus importants
capital) qu’auparavant (augmentation du nombre des
actionnaires)
** effet de levier : est l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise grâce au recours à
l’endettement. Il est avantageux si le rendement des investissements est durablement supérieur au
taux d’intérêt.
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 5
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
Conclusion :
1) Les effets sur la demande
L’investissement permet d’accroître la demande, principalement par deux biais :
- L’investissement de productivité permet d’accroître la productivité, est donc augmentation de la
demande, surtout via la hausse des salaires et la baisse des prix ;
- Le mécanisme du multiplicateur, qui montre qu’une variation du niveau de l’investissement a un
impact plus que proportionnel sur la demande.
2) Les effets sur l’offre
Investissement de remplacement rajeunissement de capital du risque de panne et
meilleure réactivité hausse potentielle de la production
Investissement de capacité de la quantité de capital productif disponible hausse de la
production
Investissement de productivité modernisation de l’appareil productif
de l’efficacité hausse potentielle de la production
3) Un cercle vertueux investissement/croissance
L’investissement est source de croissance, mais la croissance génère des revenus qui seront à leur
tour source d’une nouvelle demande adressée aux entreprises, ainsi que de nouveaux profits
permettant de financer de nouveaux investissements…
Documents de synthèse :
Au-delà de l’atout émanant de sa situation géographique privilégiée à la jonction de l’Europe, de
l’Afrique et du monde arabe, le Royaume du Maroc bénéficie d’un capital immatériel important
constitué par :
Sa stabilité institutionnelle, politique et macro-économique (une croissance stable, une
inflation maîtrisée à moins de 2%, et une dette réduite).
Son ouverture économique (un accès à un marché de près d’un milliard de consommateurs
grâce aux Accords de Libre Echange (ALE) conclus.
Doc 1 :
PROGRAMME INCITATION A L’INVESTISSEMENT
De nombreux efforts ont été déployés pour faire du Maroc une destination attractive pour les
investissements et ce, en mettant en place un certain nombre de stratégies et de réformes notamment :
Des stratégies sectorielles ambitieuses visant à préparer une offre attractive et à appuyer les
secteurs à forte valeur ajoutée en particulier le secteur agricole, le tourisme, l’industrie, les
technologies de l’information et de la communication, les énergies renouvelables, le
commerce et la distribution, et l’innovation.
Des réformes nombreuses notamment sur les plans législatifs, réglementaire et institutionnel
pour accroître la compétitivité du pays et attirer les IDE.
Des efforts massifs dans les infrastructures routières, aériennes, portuaires et industrielles qui
font actuellement du Maroc une nation Multi-Connectée, favorisant la rapidité de
déplacement.
L’engagement du Maroc pour l’encouragement et la promotion des investissements
étrangers, à travers notamment le lancement de plans sectoriels ambitieux, visant notamment
les secteurs Tourisme (VISION 2020), Agriculture (PLAN MAROC VERT), Industrie
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 6
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
(PLAN ACCÉLÉRATION INDUSTRIELLE), Énergies Renouvelables (STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE 2030), Commerce (PLAN RAWAJ), Logistique (STRATÉGIE DE
COMPÉTITIVITÉ LOGISTIQUE), Pêche maritime (HALIEUTIS), et les ports
(STRATÉGIE PORTUAIRE À L’HORIZON 2030).
Les accords de libre-échange qui font du Royaume une destination importante pour
répondre aux besoins du marché national. Le Maroc a développé un réseau d’accords
internationaux en la matière comportant 63 accords bilatéraux en matière de promotion et de
protection des investissements (APPI),
Grâce à une politique d’Open Sky, les 18 aéroports du Maroc dont 16 internationaux du
Maroc (première plateforme aéroportuaire de la région) sont desservis par une multitude de
compagnies internationales et sont reliés aux principales capitales économiques et
plateformes d’affaires mondiales.
Doc 2 :
MESURES FISCALES
La simplification du système fiscal à travers la réforme fiscale, acte pour des fins d’incitation à
l’investissement, à promouvoir l’entreprise, améliorer sa compétitivité et à soutenir le pouvoir
d’achat du marché marocain. Le cadre réglementaire et fiscal marocain consacre des mesures
majeures encourageant les IDE, notamment :
Les entreprises qui s’engagent à réaliser un investissement portant sur un montant égal ou
supérieur à 100 millions de dirhams bénéficient de l’exonération des droits de douane
applicable aux biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation de leur
projet dans les 36 mois qui suivent la date de la signature de la convention.
.
Toute nouvelle société bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés pendant 5 ans
pour toutes les exportations de biens ou de services. Passé ce délai de 5 ans, le taux d’impôt
passe à 17,50%.
Le Maroc a signé avec plusieurs pays des conventions de non double imposition. Ces
conventions établissent la liste des impôts et revenus concernés, les règles d’assistance
administrative réciproques et le principe de non-discrimination.
Doc 3:
ce contexte, l’épargne nationale devrait représenter 28,4% du PIB suite à une amélioration de
l’épargne intérieure qui devrait maintenir son taux à 22,2% du PIB en 2022 et compte tenu des
revenus nets en provenance du reste du monde qui devraient atteindre 6,2% du PIB en liaison avec le
maintien des transferts des MRE à un niveau confortable.
Avec un taux d’investissement brut qui serait de 32% du PIB en 2022, le compte épargne-
investissement dégagerait en conséquence un besoin de financement de l’ordre de 3,6% du PIB, en
creusement par rapport à 2,5% du PIB attendu en 2021.
Doc 4:
Le taux d’investissement du Maroc est parmi les plus élevés au monde, représentant 30% du PIB du
pays, alors que la moyenne mondiale est de 20%, a annoncé Mohcine Jazouli, ministre délégué
chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques.
Les efforts déployés par le Maroc au cours des deux dernières décennies pour améliorer son climat
des affaires ont contribué à faire du pays l’une des meilleures destinations d’investissement en
Afrique, a rappelé le ministre délégué.
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 7
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
Exercice :
1- mettre une croix dans la case appropriée.
2- classer les opérations de l’investissement en : investissement privé ou publique.
opérations
de consommation D’épargne D’investissement
finale intermé Matériel Immatér Privé ou
diaire iel publique
Lancement d’une grande
compagnie publicitaire par
la SA SALAM
Acquisition de 5 micro-
ordinateurs par la famille
Ahmed pour usage
personnel
Organisation d’un
important stage à l’étranger
par la Sté SOMAF au profit
de ses ingénieurs
Acquisition de logiciels par
l’administration
Achat de farine par la
boulangerie BADRE et
frères
Achat de riz par le ménage
Réda
Construction du barrage
ALWAHDA (Ministère de
l’équipement)
Dépôt de 10 000 DH dans
un compte bloqué à la
BMCE BANK par Nabil
Construction du 2éme étage
d’une maison familiale
(ménage Rizki)
Cotisation à un régime de
retraite complémentaire par
un fonctionnaire
Achat d’actions par la
famille Abrahimi
Achat de fuel par la Sté
SOMAFOR
Repas servis aux élèves
dans l’internat d’un lycée
public
Construction de locaux
dans le siège d’une partie
politique
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 8
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
Savoir 5325 : La répartition
L’activité de production crée des richesses (= valeur ajoutée) qui feront l'objet d'un partage entre
les différents agents économiques qui ont contribué à leur formation.
La répartition des richesses (Le revenu national) se répartie en deux étapes : d’abord la répartition
primaire des revenus librement organisée dans les entreprises. Puis la répartition secondaire (ou
redistribution) réalisée par les pouvoirs publics pour corriger les inégalités. En dépit de cette dernière,
les inégalités subsistent.
I. La formation des revenus primaires :
1. Répartition primaire :
C’est le partage de la valeur ajoutée, qui après avoir été créée par l’activité productive, doit
ensuite être redistribuée (répartie) sous forme de revenus primaires(les revenus engendrés de
manière directe ou indirecte par les activités de production) .En conséquent, la répartition
primaire des revenus consiste donc à rémunérer les facteurs de production : Le travail est rémunéré
par les salaires bruts et le capital est rémunéré par l’EBE (ou profit au sens large).
VA
Rémunération pour Rémunération du travail Rémunération du capital
l’État
Salaires bruts EBE Ou Profit au sens large
Impôts et taxes Salaires nets Cotisations Profit distribué Profit non
sociales distribué
Intérêts, Epargne brut
dividendes
Si la part des salaires augmente dans la valeur ajoutée c’est donc au détriment de la part des
Profits dans la valeur ajoutée.
En effet, si l’on privilégie les salariés, cela stimulera la consommation et donc la demande
(Keynes). Au contraire, si l’on privilégie les profits, on stimule alors l’offre par l’investissement
(Libéraux).
2. Les types de revenus primaires:
Revenu d’activité salariale :
Les revenus du travail salarié (salaires) sont la rémunération versée au salarié qui effectue un travail
pour le compte d’un employeur conformément à un contrat de travail.
Cette rémunération comprend un salaire de base, auquel s’ajoute les compléments du salaire
(primes, indemnités, avantages…)
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 9
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
En théorie, le salaire est fixé sur le marché du travail en fonction de l'offre et de la demande de
travail. Dans la réalité, Les salaires dépendent en grande partie du rapport de force entre les
partenaires sociaux, de la capacité de négocier, de l'évolution de la croissance.
Les salaires évoluent au court du temps en fonction de nombreux facteurs et malgré l’existence
récente de la crise et la remontée du chômage, la baisse du salaire ne se produit pas en raison
principalement :
- De l’existence d’une législation protectrice (SMIG et l’assurance chômage)
- L’influence des syndicats
- La généralisation de la négociation collective (négocier une fois par an les salaires).
Revenus mixtes ou revenus des entrepreneurs individuels :
Ils peuvent être agriculteur, commerçants membres des professions libérales…Leur
rémunérations est constituée par le bénéfice de leur entreprise. Les non-salariés qui travaillent pour
leur propre compte ne disposent pas d'un revenu aussi régulier que les salariés.
On distingue principalement :
- les bénéfices : ils sont tirés des activités artisanales, agricoles, industrielles ou commerciales. Les
activités de ces entrepreneurs entraînent des coûts et des recettes.
- les honoraires : ce sont les revenus des professions libérales : médecins, avocats, notaires,
architectes. Ces revenus, extrêmement variables, sont très difficiles à évaluer
Les revenus de la propriété :
Pour un agent économique, la propriété est formée par l'ensemble des biens mobiliers et
immobiliers et des créances. Tantôt désignée le capital, tantôt le patrimoine, la propriété peut
rapporter à son détenteur des revenus.
On distingue généralement deux types de revenus de la propriété :
- les revenus fonciers ou revenus immobiliers : il s'agit du loyer perçu par le propriétaire d'un bien
immobilier (logement, local professionnel) qui le loue. Le propriétaire peut aussi percevoir une rente
foncière lorsqu'il s'agit d'un terrain loué (terre agricole… etc.).
- les revenus mobiliers comme les dividendes (revenus des actions) perçus par les actionnaires ou les
intérêts (revenus des placements financiers, revenus des obligations) perçus par les épargnants.
II . Répartition secondaire des revenus ou redistribution :
1. le système de redistribution
Nommée aussi "opérations de transfert" ou "transferts sociaux", La redistribution est définie
comme « l‘ensemble des opérations par l’intermédiaire desquelles une partie des revenus
primaires est prélevée sur certains agents économiques pour être reversée au bénéfice d’autres
agents ».
C’est une politique d'atténuation des inégalités de revenus opérée au moyen des transferts sociaux.
Elle vise à réduire les écarts de revenu entre les ménages d'une même société.
La « redistribution » concerne davantage les États-providence (Désigne l’ensemble des
interventions de l’État dans le domaine social, qui visent à garantir un niveau minimum de bien-être à
l’ensemble de la population, en particulier à travers un système étendu de protection sociale).
Les ménages ne disposent pas des revenus primaires mais d’un revenu disponible. En effet, des
prélèvements obligatoires sont effectués permettant de financer notamment le versement de revenus
de transfert.
Revenu disponible = revenu primaire – prélèvements obligatoires (impôt et charges
sociales) + prestations sociales (revenu de transfert)
Revenus disponibles : revenus après impôts directs et prestations sociales, que le ménage
peut consacrer à la consommation ou à l’épargne
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 10
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
Revenus de transfert : ce sont des revenus distribués par les administrations publiques. Il
s’agit des prestations sociales pour les ménages.
Exemple : retraites, allocations chômage, allocations familiales…
Prélèvements obligatoires : ensemble des contributions auxquelles sont assujettis les
entreprises et les ménages (impôts et cotisations sociales) au profit des administrations
publiques.
2. les objectifs du système redistributif :
Le débat sur la légitimité du système de redistribution oppose les libéraux et les Keynésiens.
Approche Keynésienne: Le marché est imparfait, le secteur privé n'est pas apte.il faut une
intervention étatique (fonction de redistribution) pour réduire les inégalités engendrées par le
marché.
Approche des libéraux: La redistribution suppose des prélèvements obligatoires qui peuvent
décourager l'épargne et l'effort d’investissement.
La courbe de Laffer (du nom de l'économiste américain Arthur Laffer) montre qu'au-delà
d'un certain seuil de prélèvement fiscal, plus la pression fiscale augmente, plus les recettes
fiscales diminuent, en raison de l'effet décourageant sur l'offre de travail. Elle est résumée par la
formule trop d'impôt tue l'impôt (ou parfois : les hauts taux tuent les totaux).
Les objectifs :
Mettre en place une justice sociale en protégeant les démunis (personnes sans revenu), les
personnes économiquement faibles .La généralisation de la protection sociale obligatoire à
l'ensemble de la population, pour faire face aux risques de la vie (chômage, maladie…). on
parlera de redistribution horizontale => les cotisations sociales
Réduire la pauvreté et les inégalités engendrées par la répartition primaire. Cette réduction
des inégalités se fait par le versement de prestations sociales. On parlera alors de
redistribution verticale => impôts et taxe (la fiscalité)
Etablir une solidarité entre les générations et permettre aux personnes inactives, les retraités
par exemple, de percevoir leurs pensions de retraite, aux étudiants ou lycéens, d’obtenir des
bourses d’études, aux personnes invalides d’obtenir une pension d’invalidité....
3. les outils su système de redistribution :
Le système redistributif est fondé sur des prélèvements obligatoires qui donnent lieux
aux versements de prestations par les autorités publiques .Ces prélèvements sont divisés
en prélèvements sociaux et prélèvements fiscaux :
- Prélèvements sociaux:
Les cotisations sociales sont assises sur les salaires (assurance par ex), une partie
payée par l'employeur et une partie par le salarié. L'ensemble de ces cotisations est reversé
à des organismes sociaux (CNSS, CIMR…)
- Prélèvements fiscaux:
Ils sont votés chaque année avec le budget de l'Etat. Les Impôts indirect sont payés
par tout le monde. Exemple : TVA, TIC (taxe d’imposition à la consommation) et les
impôts directes (IR, impôts sur les sociétés)
Les différents types de prestation:
- Prestation de vieillesse : retraite, minimum vieillesse, retraite complémentaire.
- Prestation familiale : allocations familiales
- Prestation chômage : indemnité de chômage (indemnité de perte d’emploi)
- Prestation santé: AMO (assurance maladie obligatoire
III. Le constat des inégalités
1. Les inégalités économiques et sociales
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 11
Lycée ALLAYMOUNE- centre BTS 1er année PME. EDM : Economie
Les inégalités de revenus
Les inégalités de revenus les plus connues sont les inégalités de salaires, elles concernent une
population importante, puisque plus de 80% des actifs sont salariés.
Les inégalités de salaire peuvent s’expliquer du point de vue économique par la rareté de la main
d’œuvre (plus on est diplômé, plus on va être rare) et par des écarts de gains de productivité.
Il faut également tenir compte des disparités à la participation, les primes diverses, les avantages
en natures… etc. D’un montant différent selon les entreprises, les compléments de salaire tend en
générale à s’accroitre avec le niveau hiérarchique et la qualification.
Les inégalités de patrimoine
Le patrimoine d’un ménage ou tous autres agents économiques peut se définir comme l’état de ses
avoirs et de ses dettes a un moment donné.
Patrimoine = Actif réel (terrain, maison)
+ Actifs financiers (action...)
– Les dettes (crédits immobilier et à la consommation)
Les inégalités de patrimoine sont plus importantes que les inégalités de revenus et
s’expliquent par :
- Héritages.
- Hauts revenus.
- La forte capacité d’épargne et d’endettement des hauts revenus.
Les inégalités de niveau de vie :
D’autres inégalités économiques et sociales peuvent être observées :
- Inégalités de niveau de vie qui sont en partie le résultat des inégalités de revenus et patrimoine. Le
niveau de vie d’un ménage peut être mesuré par le niveau de consommation par personne.
Toutefois à revenu égale le niveau de vie entre deux ménages diffère en raison du nombre de
personnes à charge.
2. Les exclusions
La pauvreté
La pauvreté peut être définie de deux façons :
- pauvreté absolue, c’est la situation d’une personne disposant d’un revenu inférieur au seuil (1 dollar
par ex) qui permet de satisfaire les besoins alimentaires.
- pauvreté relative, c’est la situation d’une personne relativement aux autres, avec un revenu inférieur
dont le seuil international est fixé à 2 dollars par personne et par jour.
La précarité et l’exclusion
La précarité est lié à la difficulté de se maintenir au dessus du seuil de pauvreté, pour des raisons
diverses qui en générale se cumule (instabilité de l’emploi, insuffisance de formation, problème de
santé, problème de logement, séparation familiale).
La précarité peut conduire à l’exclusion, c'est-à-dire la rupture du lien social.
DOC 1 : Les inégalités empiriques au Maroc :
- 3,2 millions de personnes supplémentaires basculent dans la pauvreté (1,15 million) ou dans la vulnérabilité
(2,05 millions) au Maroc sous l'effet de la Covid-19 et de l'inflation.
- Par catégorie sociale, le niveau de vie par personne aurait baissé de 8% pour les ménages les moins aisés entre
2019 et 2022, passant de 7.000 DH à 6.440 DH, de 6,6% à 14.700 DH pour les ménages intermédiaires et de
7,5% à 44.200 DH pour les ménages les plus aisés.
- La vulnérabilité économique a connu une importante hausse. Le taux de vulnérabilité est passé de 7,3% en
2019 à 10% en 2021 au niveau national.
Inflation: - Les prix à la consommation ont augmenté plus vite durant la période allant de janvier à juillet 2022
et le taux d'inflation moyen, en glissement annuel, a atteint 5,5%, soit un niveau 5 fois supérieur à celui
enregistré entre 2017 et 2021.
Prof : ZEMMAHI SOUMIA Page 12
Vous aimerez peut-être aussi
- Chapitre 4-3 - Épargne Et Investissement Le CoursDocument17 pagesChapitre 4-3 - Épargne Et Investissement Le CoursSou HìLaPas encore d'évaluation
- Modalités Du Choix Des InvestissementsDocument11 pagesModalités Du Choix Des InvestissementsAli Safia Balde100% (3)
- Fiche 1 - Définition Et Mesure de L'investissementDocument4 pagesFiche 1 - Définition Et Mesure de L'investissementMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Le CapitalDocument17 pagesLe CapitalCharlesRotinPas encore d'évaluation
- Les Déterminants de L'investissement Et de La ConsommationDocument21 pagesLes Déterminants de L'investissement Et de La Consommationsouheil_sou100% (1)
- Support Cours Ch1 L'INVESTISSEMENT ET LE FINANCEMENTDocument7 pagesSupport Cours Ch1 L'INVESTISSEMENT ET LE FINANCEMENTSaida abidiPas encore d'évaluation
- Chapitre 5Document15 pagesChapitre 5Ibrahima DIOPPas encore d'évaluation
- Fiche Chapitre 6 Le Facteur CapitalDocument6 pagesFiche Chapitre 6 Le Facteur CapitalJimmy MandoukouPas encore d'évaluation
- Chapitre 7 Investissement Et CroissanceDocument8 pagesChapitre 7 Investissement Et CroissanceMaría José Vázquez ParetsPas encore d'évaluation
- InvestissementDocument6 pagesInvestissementMarie NdyPas encore d'évaluation
- Fiche 3 - Les Sources de La CroissanceDocument15 pagesFiche 3 - Les Sources de La CroissanceMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Iface Codex de Choix Des Investissements L3 Bif 2018 2019Document27 pagesIface Codex de Choix Des Investissements L3 Bif 2018 2019Ablaye GoumballaPas encore d'évaluation
- Dossier 4Document12 pagesDossier 4Arthur MssPas encore d'évaluation
- Theme Du PFEDocument13 pagesTheme Du PFEMarouane KhattabiPas encore d'évaluation
- Le Financement de L'entreprise IG2 ET MK 2Document7 pagesLe Financement de L'entreprise IG2 ET MK 2Mathieu KodioPas encore d'évaluation
- Chapitre 3. Macro 1 (1ére Année LG)Document30 pagesChapitre 3. Macro 1 (1ére Année LG)Rä Høuba100% (1)
- 2) Choix D'invesDocument13 pages2) Choix D'invesSalah DahbiPas encore d'évaluation
- Gestion FinancièreDocument12 pagesGestion Financièrelailaelafaoui11Pas encore d'évaluation
- Gestion FinancièreDocument12 pagesGestion Financièrefatimazahrasaadouni696Pas encore d'évaluation
- S2 - SEG - ANNÉE 2017-2018 SERIE 5 de Macro-Économie: CorrectionDocument4 pagesS2 - SEG - ANNÉE 2017-2018 SERIE 5 de Macro-Économie: CorrectionYasmine FahssiPas encore d'évaluation
- L'InvestissementDocument23 pagesL'InvestissementYahia mhaniPas encore d'évaluation
- Gestion Des InvestissementsDocument40 pagesGestion Des InvestissementsCosme AkpoviPas encore d'évaluation
- Chap2 GESTION FINANCIERDocument5 pagesChap2 GESTION FINANCIERmajdolinyahia26Pas encore d'évaluation
- Les Modalitã©s de Choix D'investissementDocument5 pagesLes Modalitã©s de Choix D'investissementFATIMAPas encore d'évaluation
- Investisssement CoursDocument18 pagesInvestisssement CoursBennaceur ThamiPas encore d'évaluation
- Le Droit Des InvestissementsDocument6 pagesLe Droit Des InvestissementsJonathan BehiPas encore d'évaluation
- Cesag 21 22 Codex de Financement Des Entreprises LPSG2 A B CDocument43 pagesCesag 21 22 Codex de Financement Des Entreprises LPSG2 A B CMarthoze DogblePas encore d'évaluation
- Choix D'investissement en Contexte de CertitudeDocument24 pagesChoix D'investissement en Contexte de CertitudeSophia Db0% (1)
- 4 Chap 4 ITB 1 Connaissances ÉconomiquesDocument17 pages4 Chap 4 ITB 1 Connaissances ÉconomiquessafiandoyePas encore d'évaluation
- Cours Gest Fin Fac 2020Document26 pagesCours Gest Fin Fac 2020Khaoula SabrîPas encore d'évaluation
- Le Rôle de L'investissement Sur La CroissanceDocument4 pagesLe Rôle de L'investissement Sur La CroissancelahouassaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Généralité Et Concepts de Base Sur Les InvestissementsDocument13 pagesChapitre 1 Généralité Et Concepts de Base Sur Les InvestissementsD IMPas encore d'évaluation
- DBDBDBDBDBDDocument2 pagesDBDBDBDBDBDbadr.belkhbiziPas encore d'évaluation
- Partie 1 - Notion D'investissementDocument11 pagesPartie 1 - Notion D'investissementArthur RamillonPas encore d'évaluation
- Le Choix D'investissementDocument22 pagesLe Choix D'investissementAbdessamad Abdessamad80% (5)
- Le Rôle de L'investissement Sur La Croissance PDFDocument5 pagesLe Rôle de L'investissement Sur La Croissance PDFMlouki WejdenPas encore d'évaluation
- Choix D - Investissement en Contexte de Certitude 2Document28 pagesChoix D - Investissement en Contexte de Certitude 2fabionacci0% (2)
- Choix D'investissementDocument16 pagesChoix D'investissementAyoub Serrakhi80% (5)
- EC1 - L'Investissement Déterminant de La Croissance ÉconomiqueDocument1 pageEC1 - L'Investissement Déterminant de La Croissance ÉconomiqueMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- L InvestissementDocument4 pagesL InvestissementamalamalPas encore d'évaluation
- Cours de L'investissement 1Document30 pagesCours de L'investissement 1Pagui OrnellePas encore d'évaluation
- Chap InvestissementDocument6 pagesChap InvestissementElawifen MarwaPas encore d'évaluation
- Politique Fcière Et IEFDocument67 pagesPolitique Fcière Et IEFBadr Eddine SebbahiPas encore d'évaluation
- Cours GST Financire 2Document26 pagesCours GST Financire 2Ben TanfousPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Concepts de Base Des Projets D'invtDocument6 pagesChapitre 1 - Concepts de Base Des Projets D'invtNoureddineLahouel100% (1)
- Cash FlowDocument32 pagesCash FlowAymane HammouchPas encore d'évaluation
- 5385 Ca 30 Ecb 12Document18 pages5385 Ca 30 Ecb 12Yassine BoughaidiPas encore d'évaluation
- 5326c3e0ce9f7 PDFDocument3 pages5326c3e0ce9f7 PDFBrahim YaminiPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Gestion Budgetaire Des InvestissementsDocument51 pagesChapitre 4 Gestion Budgetaire Des Investissementsanass saoudi100% (1)
- Fiches de Cours Facteur CapitalDocument2 pagesFiches de Cours Facteur CapitalglaminePas encore d'évaluation
- Dans Son Processus de Développement LDocument28 pagesDans Son Processus de Développement LLydia OunnoughPas encore d'évaluation
- Projet D Investissement - CoursDocument13 pagesProjet D Investissement - CoursMil De MilPas encore d'évaluation
- Cours Gestion Financière - 231130 - 135619Document37 pagesCours Gestion Financière - 231130 - 135619yousra.agoumirPas encore d'évaluation
- Les Déterminants de L'investissementDocument28 pagesLes Déterminants de L'investissementNour ElhoudaPas encore d'évaluation
- Cours Gestion Financière. S5-1Document30 pagesCours Gestion Financière. S5-1Mehdi benhimajPas encore d'évaluation
- 8 Investissement PDFDocument27 pages8 Investissement PDFBen TanfousPas encore d'évaluation
- Rapport de la BEI sur l'investissement 2018-2019 : réoutiller l'économie européenne – Principales conclusionsD'EverandRapport de la BEI sur l'investissement 2018-2019 : réoutiller l'économie européenne – Principales conclusionsPas encore d'évaluation
- Maîtriser l'Art de l'Investissement : De la Fondation à l'Ère NumériqueD'EverandMaîtriser l'Art de l'Investissement : De la Fondation à l'Ère NumériquePas encore d'évaluation
- L'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comD'EverandL'optimisation fiscale pour les particuliers: édition 2022 - retrouvez nous sur www.jpsudconseil.comPas encore d'évaluation
- Le payback period: Évaluer la rentabilité des investissements et prendre des décisions éclairéesD'EverandLe payback period: Évaluer la rentabilité des investissements et prendre des décisions éclairéesPas encore d'évaluation
- Actualisation 12 2022Document3 pagesActualisation 12 2022GlowackiPas encore d'évaluation
- Chap 1 Intro À La MacroDocument8 pagesChap 1 Intro À La MacroLauric TrebucqPas encore d'évaluation
- Hausse de PrixDocument2 pagesHausse de PrixAyoubPas encore d'évaluation
- Fiche de Paie Juillet 2023Document2 pagesFiche de Paie Juillet 2023mbaye0544100% (1)
- Sous-Thème 3 - Quels Sont Les Grands Déséquilibres Macro ÉconomiquesDocument27 pagesSous-Thème 3 - Quels Sont Les Grands Déséquilibres Macro ÉconomiquesMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Résumé D'articleDocument3 pagesRésumé D'articlefadwaPas encore d'évaluation
- Courant MonetaristeDocument8 pagesCourant Monetaristeeya elkamelPas encore d'évaluation
- Le Monde Du Travail en FranceDocument9 pagesLe Monde Du Travail en FranceIdaline RioletPas encore d'évaluation
- Instruction DGI IRGDocument26 pagesInstruction DGI IRGGhaouti ZidaniPas encore d'évaluation
- 23 24 HUE Doc Assimilation HE VinciDocument2 pages23 24 HUE Doc Assimilation HE Vincioufkiryoussef200Pas encore d'évaluation
- Chap.5 - Synthã Se rédigéeDocument4 pagesChap.5 - Synthã Se rédigéerayane.elhabachiPas encore d'évaluation
- Fiche de Paie Type 1Document1 pageFiche de Paie Type 1zampaligresomedPas encore d'évaluation
- Pop SeptDocument1 pagePop SeptBERNARD BAROZAPas encore d'évaluation
- AP Travail Sur La DissertationDocument2 pagesAP Travail Sur La DissertationMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Autoentrepreneur Information 2019Document15 pagesAutoentrepreneur Information 2019berPas encore d'évaluation
- Macroéconomie - PPT ParDocument52 pagesMacroéconomie - PPT ParYonnel MbienePas encore d'évaluation
- Preavis Greve OBCDocument2 pagesPreavis Greve OBCPadji CalvinPas encore d'évaluation
- Aide A La Formation 20161129Document2 pagesAide A La Formation 20161129Usi redPas encore d'évaluation
- Lexique Pour CV Et Lettre de Motivation en Anglais Et FrancaisDocument4 pagesLexique Pour CV Et Lettre de Motivation en Anglais Et FrancaisHervé ZamiPas encore d'évaluation
- Bulletin de Salaire Van Praet ChristopherDocument5 pagesBulletin de Salaire Van Praet ChristopherAndrée AdriennePas encore d'évaluation
- Fiche de Paie Type 1Document1 pageFiche de Paie Type 1cscschuman.67Pas encore d'évaluation
- 2013 Analyse Sujets ChoixDocument4 pages2013 Analyse Sujets Choixsecoucamara261092Pas encore d'évaluation
- EntrepreneuriatDocument53 pagesEntrepreneuriatIhab Seaghi100% (3)
- Lancer Son entreprise-CCIDocument28 pagesLancer Son entreprise-CCICédric FRICOUPas encore d'évaluation
- Mission de L'etatDocument1 pageMission de L'etatJanviMehtaPas encore d'évaluation
- Fiche de Paie Au Format ExcelDocument3 pagesFiche de Paie Au Format Exceldem tahianjanaharyPas encore d'évaluation
- Livret D'accueil: Pôle Emploi Et Vous Pôle Emploi Et VousDocument24 pagesLivret D'accueil: Pôle Emploi Et Vous Pôle Emploi Et VousAlexis TouraillePas encore d'évaluation
- 2020 PDFDocument15 pages2020 PDFsubulataPas encore d'évaluation
- Att10069 202106072123 008314Document9 pagesAtt10069 202106072123 008314Darckluffy BenjaminPas encore d'évaluation
- DDAC (Assurance Et Expression Des Besoins)Document9 pagesDDAC (Assurance Et Expression Des Besoins)Timour AvonPas encore d'évaluation