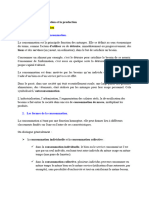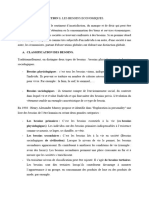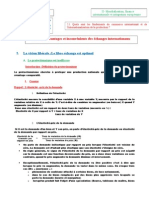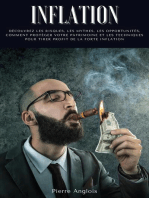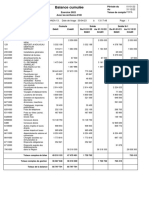Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Consommation - Économie
La Consommation - Économie
Transféré par
soumia.zemmahiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Consommation - Économie
La Consommation - Économie
Transféré par
soumia.zemmahiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Centre BTS Les ORANGERS 1ère année PME Economie générale
CHAPITRE V : LA CONSOMMATION
L'activité principale des ménages est la consommation. Le revenu disponible est utilisé
essentiellement dans le but de le dépenser en biens de consommation. Le volume et la composition
de la consommation dépendent de multiples facteurs. Au cours du temps, avec la croissance
économique, la structure de la consommation se modifie.
I. Définition de la consommation.
La consommation, au sens économique du terme, c'est l'action d'utiliser ou de détruire,
immédiatement ou progressivement, des biens et des services dans le but de satisfaire un besoin.
Consomme run aliment par exemple, c'est le détruire pour satisfaire le besoin de se nourrir.
Consommer de l'information, c'est aussi en quelque sorte la détruire pour l'intégrer à son propre
capital culturel.
Dans le passé, dans une société qui était essentiellement rurale, une large partie des produits
alimentaires, des vêtements, était réalisée par les ménages pour leur usage personnel.
L’autoconsommation était la forme principale de consommation.
L’industrialisation, l’urbanisation, l’augmentation des salaires réels, la diversification des besoins a
fait entrer la société dans une ère de consommation de masse, multipliant les produits.
La structure de la consommation
La structure de la consommation désigne la répartition des dépenses de l'ensemble des ménages. Un
certain nombre d'instruments permettent de l'analyser :
- les postes de consommation, répertoriés généralement en 8 postes (alimentation, équipement et
entretien du logement, transport, logement, habillement, santé, loisirs et culture, biens et services
divers).
- les coefficients budgétaires : ils représentent la part d'une certaine consommation dans l'ensemble
des dépenses de consommation.
II. Les formes de la consommation.
La consommation n’étant pas une fonction homogène, elle peut donner lieu à différents classements
fondés sur l'une ou l'autre de ses caractéristiques. On distingue généralement :
La consommation individuelle et la consommation collective :
la consommation individuelle : en fonction de ses besoins et de ses moyens, chaque ménage
décide du moment et de la quantité à consommer. Exemple : aliments, boissons, vêtements.
Dépenses en eau, chauffage, voyages…
la consommation collective : elle correspond aux services collectifs non marchands fournis par
des administrations publiques (justice, police, enseignement, santé publique). Ils sont
généralement gratuits ou offerts à un prix bien inférieur à leur coût de revient.
La consommation finale et la consommation intermédiaire :
la consommation finale, qui est uniquement le fait des ménages (on parle de consommation
finale des ménages ou privée), est composée des biens et des services destinés à la satisfaction
directe des besoins, ainsi que de l’autoconsommation, c'est-à-dire de la consommation que les
individus font de leur propre production (produits des jardins, utilisation des logements dont ils
sont propriétaires...).
Prof : Mme . ZEMMAHI SOUMIA Page 1
Centre BTS Les ORANGERS 1ère année PME Economie générale
la consommation intermédiaire, qui est le fait des entreprises (on parle de consommation
intermédiaire des entreprises), concerne les matières premières ou les produits semi-finis qui sont
détruits, transformés ou incorporés, au cours du processus de production, pour réaliser le produit
final (l'énergie et la farine utilisées pour fabriquer une baguette de pain).
La consommation marchande et la consommation non marchande :
la consommation marchande qui concerne tous les biens, qui sont par nature marchands dans la
mesure où ils sont échangés sur un marché à un prix couvrant au moins leur coût de production.
la consommation non marchande qui concerne essentiellement les services obtenus
gratuitement ou pour un prix inférieur à leur coût de revient
La consommation selon la nature des biens :
les biens matériels et non matériels :
les biens durables, semi-durables et non-durables : les biens durables sont les biens utilisés
plusieurs fois et durant une période assez longue (Electroménager, voiture...), les biens semi-
durables sont les biens utilisés plusieurs fois mais dont la durée de vie est assez courte
(vêtements, chaussures...) et les biens non durables sont des biens qui sont détruits à la première
utilisation (nourriture..).
La consommation selon la nature des besoins à satisfaire :
Habillement - Logement, chauffage - Equipement du logement - Santé - Transport, -
Communication - Loisir, culture - Autres biens et services….
III. Les déterminants économiques de la consommation :
Les agents économiques font acte de consommation afin de satisfaire des besoins.
Néanmoins, le consommateur est limité dans sa fonction de consommation par son revenu, et par le
prix des biens et services qu’il doit acquérir. Il doit donc procéder à des arbitrages permanents de
manière à classer ses besoins par ordre d’importance.
1. les facteurs économiques :
Il s'agit des deux contraintes économiques auxquelles sont confrontés les individus et qui
limitent leur capacité à consommer, à savoir le prix des biens et le revenu disponible. La question
est de savoir comment le consommateur va classer ses besoins à satisfaire et effectuer ses choix,
quelle relation va s'établir entre la demande et l'évolution du prix et la demande et l’évolution du
revenu.
Le prix :
Par principe, plus le prix d’un bien est élevé, moins la demande le concernant émanant des
ménages ou des entreprises sera forte. Par contre, si le prix d’un bien diminue, la demande exprimée
pour ce bien à de fortes chances de s’accroître. Cette relation inverse entre le prix d’un bien et la
demande exprimée par les agents économiques définit ce que l’on appelle l’élasticité-prix de la
demande. Cette élasticité permet de mesurer la relation qui lie l’évolution du prix et l’évolution de la
demande d’un bien. Elle se mesure de la manière suivante :
Elasticité-prix de la demande = variation de la quantité demandée en % / variation des prix (en %) .
Prof : Mme . ZEMMAHI SOUMIA Page 2
Centre BTS Les ORANGERS 1ère année PME Economie générale
élasticité-prix négative : une hausse du prix de vente entraîne une diminution de la demande du
bien de la part des ménages. A l’inverse, une baisse du prix de vente se traduit par une
augmentation de la demande du bien.
élasticité-prix nulle : la variation du prix de vente d’un bien n’a aucune incidence sur la
demande globale adressée à ce bien. Cela signifie que la demande est inélastique.
élasticité-prix positive : une hausse du prix de vente entraîne une augmentation de la demande
adressée à ce bien (cas des biens de luxe). On peut alors distinguer deux types :
Un bien de Giffen ou effet Giffen (d'après Robert Giffen) est un type de bien de première nécessité
(exemple : le pain , farine..) ; lorsque son prix augmente, cela réduit assez fortement le pouvoir
d'achat des consommateurs pour les forcer, pour équilibrer leur budget, à renoncer à d'autres biens de
substitution plus coûteux (ex : la viande) et à reporter leur demande sur le premier produit.
Un bien de Veblen ou effet Veblen (d'après Thorstein Veblen) est un type de bien de luxe (ex : le
parfum, les voitures de sport ou la haute-couture) ; lorsqu'il n'est « pas assez cher » (c’est-à-dire que
son prix ne reflète pas son positionnement haut de gamme) sa demande est faible (soit car la qualité
perçue est inférieure, soit parce qu'il n'est plus un symbole de statut). Lorsque son prix augmente, sa
demande augmente aussi et on parle alors d'effet Veblen ou d'effet de démonstration.
Le revenu :
Par principe, une hausse du revenu se traduit par une augmentation de la consommation.
Néanmoins, une partie du revenu supplémentaire peut ne pas être consommée immédiatement, ce qui
donne lieu à la constitution d’une épargne. Le comportement de consommation évolue donc avec le
niveau du revenu. Plus le revenu est élevé, plus une partie importante sera épargnée.
Ce comportement est mis en évidence par l’élasticité-revenu de la demande. Elle se détermine de la
manière suivante :
Elasticité-revenu de la demande = variation de la demande (en %) / variation du revenu (en %)
Comme tous les biens n'ont pas la même élasticité-revenu, l'augmentation du revenu change la
structure de la consommation.
Selon la classification définie par Ernst Engel, on distingue trois catégories de biens :
les biens inférieurs : le coefficient budgétaire de ce bien diminue quand le revenu augmente
(élasticité-revenu négative), et augmente quand le revenu baisse. Il s'agit de biens de mauvaise
qualité auxquels les consommateurs préfèrent substituer de nouveaux biens lorsque leur revenu le
permet. C'est le cas de certains produits alimentaires tels que le pain …
les biens normaux : le coefficient budgétaire de ce bien stagne ou varie peu quand le revenu
augmente dans une proportion inférieure ou égale à 1 (élasticité-revenu comprise entre 0 et 1).
On parle également de biens nécessaires. C'est le cas de la nourriture (prise dans son ensemble) et
des biens de première nécessité.
les biens supérieurs: le coefficient budgétaire de ce bien augmente quand le revenu augmente
(élasticité-revenu strictement supérieure à 1). C'est le cas de nombreuses dépenses de loisirs,
de transport, de culture ou de santé. Nous avons appelé ces biens des biens de luxe.
2. Les déterminants non économiques de la consommation :
La classe sociale : la consommation d’un individu varie en fonction des habitudes qu’il a
acquises de par son éducation. La reproduction du mode de vie de la classe sociale d’origine
influence donc la consommation.
Prof : Mme . ZEMMAHI SOUMIA Page 3
Centre BTS Les ORANGERS 1ère année PME Economie générale
La CSP : dans le même ordre d’idée, la consommation peut-être influencée par la catégorie
socioprofessionnelle à laquelle appartient l’individu. Ceci s’explique en partie par un besoin
d’identification.
L’âge : un individu âgé consomme par exemple plus de services de santé qu’un adolescent…
Le comportement ostentatoire : le fait de consommer correspond ici à un besoin d’être reconnu
par la société comme appartenant à un groupe social particulier (effet de « snobisme »).
L’effet d’imitation : la consommation répond parfois au besoin de copier la consommation de la
classe sociale supérieure.
La publicité : l’acte de consommer est en partie influencé par la publicité produite par les
entreprises. La consommation est donc provoquée par le producteur.
Lorsqu’un individu parvient à satisfaire ses besoins primaires, son surplus de consommation sera en
grande partie influencé par ces facteurs non économiques. De nombreux actes de consommation
répondent alors à des phénomènes de mode.
Les périodes de ralentissements économiques par contre donnent aux facteurs économiques une
place plus importante dans le processus de consommation.
IV. Les différentes approches théoriques de la consommation
1. L’approche Keynésienne
Pour Keynes le niveau de consommation dépend essentiellement du revenu. En effet il estime qu’en
cas d’une hausse de revenu la consommation augmente mais moins rapidement que le revenu. Tout
revenu est partagé entre une consommation et une épargne. On appel proportion moyenne à
consommer, la part du revenu qui est consommé. (C/R). La proportion moyenne à épargner =
épargne/revenu = la part du revenu qui est à épargner.
2. La théorie du cycle de vie Modigliani
Pour lui un ménage a un cycle de vie et a chaque âge du cycle de vie correspond un certain besoin
spécifique et un certain niveau de revenu.
De se point de vue les individus sont prévoyant et organisent leurs consommations et leurs épargnes
sur leur durée entière de vie.
3. Les rapports entre la consommation et le revenu et les lois d’Engel
Engel observait que la part de l’alimentation sur la consommation totale diminue lorsque le revenu
augmente de même, il notait que la proportion du revenu consacré au dépense de logement et
habillement reste toujours sensiblement le même quel que soit le revenu.
En se qui concerne les dépenses de loisir, culture, voyage… elles apparaissent qu’à partir d’un
certain niveau de revenu.
4. La théorie du revenu permanant de Milton Friedman
Il pense que le comportement du consommateur n’est pas lié au revenu qu’il perçoit à un moment
donné mais au revenu permanent qu’il prévoit, le consommateur anticipe donc ces biens et prend ces
décisions d’épargne ou de consommation en tenant compte non seulement de son revenu actuel mais
surtout de ses revenus futurs.
Prof : Mme . ZEMMAHI SOUMIA Page 4
Centre BTS Les ORANGERS 1ère année PME Economie générale
Chapitre VI : l’épargne
Les ménages disposent d’un revenu disponible qu’ils consacrent en grande partie à des dépenses
de consommation. Néanmoins, une partie de ce revenu n’est pas dépensée immédiatement par les
ménages qui préfèrent l’épargner en vue d’une utilisation future.
I. la notion d’épargne :
1. Définition :
L’épargne correspond à la partie du revenu disponible des ménages qui n’est pas consacrée à
une consommation immédiate ou finale.
L’épargne est donc, en sciences économiques, considérée comme une consommation différée
dans le temps.
Chaque année, les ménages épargnent une partie de leur revenu disponible. Cet effort d’épargne se
traduit donc par des flux monétaires qui vont alimenter le patrimoine des ménages.
Selon les économistes classiques, l’épargne est l’accumulation de capitaux améliorant la
productivité et déterminant la croissance à moyen et long terme.
Les agents économiques n’épargnent que pour investir ; toute épargne est donc à la fois une
«non-consommation ». Renoncer à consommer, c’est investir.
Pour les keynésiens, l’épargne affaiblit la consommation actuelle et peut engendrer une baisse
de l’investissement. Le niveau d’épargne peut varier au cours du temps en fonction de l’évolution
des attitudes de consommation.
Le taux d’épargne permet de mesurer l’effort d’épargne des ménages.
Epargne
Taux d'épargne=
Revenu disponible
2. Les types d’épargne :
Les sommes épargnées sont employées de différentes façons qui combinent dans des proportions
variables les avantages de la liquidité, de la sécurité et de la rentabilité.
On distingue généralement plusieurs formes :
- Épargne financière thésaurisée : valeur inactive conservée par les ménages et retirée du circuit
économique.
- Épargne financière placée : affectation de l’épargne auprès du système financier en vue d’obtenir
un revenu financier. Ex : Achat d'actions, d'obligations, ouverture d'un compte d’épargne (livret de
caisse d'épargne), etc.,
- Épargne financière contractuelle par la voie de l'assurance vie ou du plan d'épargne logement…
- Épargne non financière : désigne la partie de l’épargne consacrée à l’achat de biens de production
et des biens immobiliers pour les ménages.
L'épargne peut résulter d'une volonté des individus (épargne libre) ou être imposée (les impôts,
les cotisations vieillesse, les cotisations maladie constituent une épargne forcée).
L’épargne publique est constituée essentiellement de l’épargne budgétaire qui résulte de tout
surplus des recettes publiques sur consommation publique (dépenses publiques)
L’épargne privée provient également de deux sources : l’épargne des entreprises privées qui
est définie comme les bénéfices des sociétés après déduction de l’ensemble des charges. Et
l’épargne des ménages consiste simplement dans la part non consommée de leurs revenus.
II. les déterminants de l’épargne :
1. les facteurs explicatifs de l'épargne :
Les facteurs qui incitent les ménages à épargner sont multiples :
Prof : Mme . ZEMMAHI SOUMIA Page 5
Centre BTS Les ORANGERS 1ère année PME Economie générale
- l'épargne de précaution : elle permet de se prémunir contre les risques potentiels de la vie
(chômage, maladie) ou de se constituer un complément retraite ;
- la constitution d'un patrimoine : devenir propriétaire de son logement pour éviter de payer un
loyer, augmenter son capital pour le léguer à ses enfants, etc.,
- l'épargne de liquidités : la monnaie constitue une réserve de valeur et un moyen d'échange qui
permet d'acquérir des biens,
- l'épargne de placement : l'épargne est un moyen d'obtenir des revenus à partir des placements
financiers,
- l'épargne de spéculation : la spéculation consiste à acquérir des titres (actions, obligations) en
espérant les revendre à la hausse pour dégager une plus-value.
2. Les déterminants du taux d’épargne des ménages
Le rôle du revenu : Le revenu des ménages constitue un élément clé de leur comportement
d’épargne. Le problème est de savoir la nature du revenu pris en compte par les ménages. Pour
Keynes, plus le revenu du ménage augmente, plus le ménage aura tendance à épargner.
Le cycle de vie : Le comportement d’épargne dépend de l’âge de l’épargnant. Normalement un
agent est sensé voir ses revenus augmenter ainsi que son patrimoine tout au long de sa vie. Au
début de sa vie, ses revenus sont faibles et ses besoins importants ce qui peut provoquer un
endettement. Lorsqu’il travaille plus sa capacité d’épargne augmente ce qui lui permet de
rembourser les emprunts contractés auparavant et d’épargner notamment pour la période suivante
ou les revenus généralement baisse.
Le cadre institutionnel : L’existence de système de retraite, de protection sociale exerce une
influence notamment sur l’épargne de précaution. Il peut générer une augmentation d’épargne
Le taux d’intérêt réel :Des taux d’intérêts (= rémunération de l’épargne) réels élevés devraient
stimuler l’épargne. L’agent économique cherche à maximiser son utilité et lorsqu’il est amené à
faire un arbitrage entre consommation et épargne, il va considérer ce que lui rapportera l’épargne
(le taux d’intérêt). Si celui ci est élevé, l’agent sera incité à épargner .Puisque épargner permettra
d’assurer des revenus importants dans le futur. On parle de l’ :
Effet de substitution : l’épargne augmente quand les taux d’intérêts sont élevés. L’épargne
devient attrayante au sens où elle rapporte quelque chose au ménage.
Mais la relation positive entre taux d’intérêt et épargne, est contrebalancée par un Effet de
revenu : l’augmentation des taux d’intérêts stimule la consommation car les placements
rapportant davantage contribuent à faire diminuer le taux d’épargne. En effet si les taux d’intérêts
augmentent, les agents économiques épargneront moins d’argent pour constituer un patrimoine
donné.
L’inflation: L’inflation (=hausse générale du niveau des prix) est généralement considérée
comme un facteur de hausse du taux d’épargne. D’un côté pour conserver la valeur réelle de leur
patrimoine financier, les agents sont contraints à épargner plus, mais d’un autre côté,
l’anticipation de l’inflation par les agents économiques, peut les conduire à acheter dès
maintenant ce qu’ils paieront plus cher plus tard.
En tenant compte des deux facteurs que sont le revenu et l’inflation, il est possible de rendre
compte de façon satisfaisante des variations à court terme du partage des revenus entre
consommation et épargne. Seulement, depuis le début des années 90, on observe une modification
dans le comportement des agents. Ces derniers ont épargné plus que prévu, dans un contexte de
ralentissement économique. Cela s’explique en partie par la peur de l’avenir qui tend à développer
une épargne de précaution face à la hausse du chômage et à l’incertitude entourant le système de
retraite.
Prof : Mme . ZEMMAHI SOUMIA Page 6
Vous aimerez peut-être aussi
- Éclaration DE Dons Manuels ET DE Sommes D Argent: CerfaDocument6 pagesÉclaration DE Dons Manuels ET DE Sommes D Argent: Cerfanduong90Pas encore d'évaluation
- Avantages comparatifs: Ricardo et les avantages de la spécialisationD'EverandAvantages comparatifs: Ricardo et les avantages de la spécialisationÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Recueil Questions Réponses DGI - TVADocument413 pagesRecueil Questions Réponses DGI - TVABENABDALLAH ABDELOUAHB80% (5)
- Syscohada Revise - Notes Annexes Aux Etats FinanciersDocument63 pagesSyscohada Revise - Notes Annexes Aux Etats Financierssosuke aizen100% (3)
- Consommation Et Épargne, InvestissementDocument9 pagesConsommation Et Épargne, InvestissementDz DidouPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Consommation Et ProductionDocument11 pagesChapitre 3 Consommation Et Productiontchitembo taty arystarck jasonPas encore d'évaluation
- Livre - Séquence - 4 Economie GénéralDocument12 pagesLivre - Séquence - 4 Economie GénéralKy Serge Alias WilfriedPas encore d'évaluation
- La ConsommationDocument13 pagesLa ConsommationAyoub Ayt HramouPas encore d'évaluation
- 1la Consommation L EpargneDocument5 pages1la Consommation L EpargneAHMEDPas encore d'évaluation
- ConsommationDocument3 pagesConsommationjennicharmedPas encore d'évaluation
- Fiches de Cours La ConsommationDocument2 pagesFiches de Cours La ConsommationKevinKiemele50% (2)
- Chapitre 3Document10 pagesChapitre 3Axel AxelPas encore d'évaluation
- Moodule I - Chapitre III - Mesure Et Calcul de La Consommation pdf-1Document21 pagesMoodule I - Chapitre III - Mesure Et Calcul de La Consommation pdf-1Oussama McPas encore d'évaluation
- Chapitre 4-2 - ConsommationDocument16 pagesChapitre 4-2 - ConsommationSou HìLaPas encore d'évaluation
- Chapitre5 Eco Géné 2023 24 SupportDocument8 pagesChapitre5 Eco Géné 2023 24 Supportmmmibrahi3Pas encore d'évaluation
- ConsommationDocument30 pagesConsommationRoselyne FernandPas encore d'évaluation
- CosommationDocument3 pagesCosommationAsma MensiPas encore d'évaluation
- La ConsommationDocument28 pagesLa ConsommationSoufiane RiyadPas encore d'évaluation
- Cours 8 La ConsommationDocument5 pagesCours 8 La ConsommationRima OurradPas encore d'évaluation
- E 2A 01 La ConsommationDocument13 pagesE 2A 01 La ConsommationYacine MARICHEPas encore d'évaluation
- ConsommationDocument2 pagesConsommationMohammed MounirPas encore d'évaluation
- 1STMG Droit Et Economie L Arbitrage Entre La Consommation Et L EpargneDocument4 pages1STMG Droit Et Economie L Arbitrage Entre La Consommation Et L EpargneiwamashiPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 1 La ConsommationDocument4 pagesCHAPITRE 1 La ConsommationUlrich ToukamPas encore d'évaluation
- ECONOMIE GénéraleDocument31 pagesECONOMIE Généraler7hskcks5hPas encore d'évaluation
- Synthèse Chapitre 7Document3 pagesSynthèse Chapitre 7Bradley RimbertPas encore d'évaluation
- Introduction À L'économie - La ConsommationDocument26 pagesIntroduction À L'économie - La ConsommationAsmae Benmoussa0% (1)
- Chapitre I. Sections 1,2 Et 3Document6 pagesChapitre I. Sections 1,2 Et 3Abdallah Doukara DjallalPas encore d'évaluation
- Chapitre Utilisation R+Document5 pagesChapitre Utilisation R+maryam sidquiPas encore d'évaluation
- Les Facteurs Qui Affectent La ConsommationDocument3 pagesLes Facteurs Qui Affectent La ConsommationMarouane ZoubdanePas encore d'évaluation
- Chapitre IIIDocument13 pagesChapitre IIImanelhassanitirimtirim2023Pas encore d'évaluation
- Copain Jo Macro Chapitre 3Document18 pagesCopain Jo Macro Chapitre 3Arame diouf DiagnePas encore d'évaluation
- Introduction Economie S1Document61 pagesIntroduction Economie S1mamadoPas encore d'évaluation
- Macroéconomie RHARIBDocument19 pagesMacroéconomie RHARIBPlanet FriendsPas encore d'évaluation
- Introduction À L Économie 1Document18 pagesIntroduction À L Économie 1fod100% (1)
- 2-La ConsommationDocument1 page2-La ConsommationHasna JãPas encore d'évaluation
- Macroeconomie Chapitre I Et II 2Document38 pagesMacroeconomie Chapitre I Et II 2nembesamanthaPas encore d'évaluation
- Ses Synthese de PremiereDocument18 pagesSes Synthese de PremiereQUEEN AYEBIEPas encore d'évaluation
- BTS 1 - Part 5 - Premières Notions D'économieDocument7 pagesBTS 1 - Part 5 - Premières Notions D'économie8gt6s2ks7zPas encore d'évaluation
- Introduction À La Macroéconomie - Séquence 3Document8 pagesIntroduction À La Macroéconomie - Séquence 3Amina ThiarèPas encore d'évaluation
- L'Activite Économique Et L'entrepriseDocument6 pagesL'Activite Économique Et L'entreprisewayPas encore d'évaluation
- Verbatime MicroDocument8 pagesVerbatime MicrokomornickaPas encore d'évaluation
- Cours Macro Micro EcoDocument63 pagesCours Macro Micro EcoQuentin HPas encore d'évaluation
- 1STMG Droit Et Economie Le Pouvoir D Achat Des MenagesDocument5 pages1STMG Droit Et Economie Le Pouvoir D Achat Des MenagesiwamashiPas encore d'évaluation
- Fiche Consommation Et ÉpargneDocument8 pagesFiche Consommation Et Épargnemaria bakouriPas encore d'évaluation
- Consommation Et EpargneDocument2 pagesConsommation Et EpargneMihaela ElenaPas encore d'évaluation
- Economie Descriptive Et MondialisationDocument14 pagesEconomie Descriptive Et MondialisationLog SevenPas encore d'évaluation
- Biens ÉconomiquesDocument7 pagesBiens ÉconomiquestarnawtPas encore d'évaluation
- Economie Generale FCFDocument47 pagesEconomie Generale FCFyretrzPas encore d'évaluation
- Introduction À L'économieDocument32 pagesIntroduction À L'économiekaena125100% (1)
- Introduction À L - ÉconomieDocument19 pagesIntroduction À L - ÉconomieELAliPas encore d'évaluation
- Plan-5-Conso Et ÉpargneDocument5 pagesPlan-5-Conso Et ÉpargneEmile GuillotPas encore d'évaluation
- Chapitre IiiDocument3 pagesChapitre IiiClement MeliPas encore d'évaluation
- LE FASCICULE D'ECONOMIE BTS 1 BisDocument64 pagesLE FASCICULE D'ECONOMIE BTS 1 BisMelissa MaletPas encore d'évaluation
- Leçon 2 - Avantages Et Inconvénients Des Échanges Internationaux - OdtDocument15 pagesLeçon 2 - Avantages Et Inconvénients Des Échanges Internationaux - OdtMme et Mr Lafon100% (1)
- Vocabulaire Acquis en SecondeDocument3 pagesVocabulaire Acquis en Secondezorice gionoPas encore d'évaluation
- L'économie RésuméDocument7 pagesL'économie RésuméAmal AtPas encore d'évaluation
- Macro & Micro Économie BisDocument28 pagesMacro & Micro Économie BisMarie NdyPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Egs Révision.Document8 pagesChapitre 1 Egs Révision.unessPas encore d'évaluation
- Chapitre 2-5Document8 pagesChapitre 2-5ekocelinePas encore d'évaluation
- Fiche 1.1 Dans Un Monde Aux Ressources Limitées, Comment Faire Des ChoixDocument5 pagesFiche 1.1 Dans Un Monde Aux Ressources Limitées, Comment Faire Des ChoixMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- ECG - 1 - Micro - Cours - Séance N°1-2-3-4Document41 pagesECG - 1 - Micro - Cours - Séance N°1-2-3-4TARIQ BICHARPas encore d'évaluation
- Investir en tenant compte de l'inflation: Pour maintenir son pouvoir d’achat à tout prixD'EverandInvestir en tenant compte de l'inflation: Pour maintenir son pouvoir d’achat à tout prixPas encore d'évaluation
- Inflation: Découvrez les risques, les mythes, les opportunités, comment protéger votre patrimoine et les techniques pour tirer profit de la forte inflationD'EverandInflation: Découvrez les risques, les mythes, les opportunités, comment protéger votre patrimoine et les techniques pour tirer profit de la forte inflationÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Canevas - Demande - Financement-VF-09 - 09 - 21-Guichet 2Document6 pagesCanevas - Demande - Financement-VF-09 - 09 - 21-Guichet 2samira abdoulmoumouniPas encore d'évaluation
- Pro - Forma - 2023-06-06T105625.390Document2 pagesPro - Forma - 2023-06-06T105625.390Johnny BalyPas encore d'évaluation
- Comptabilité ApprofondieDocument51 pagesComptabilité ApprofondieBajjõù Sï Mô100% (1)
- PISA Lib Math ItemsDocument105 pagesPISA Lib Math ItemsEyog VictoriaPas encore d'évaluation
- Legislation Cours Ok OkDocument44 pagesLegislation Cours Ok OkJoel MumberePas encore d'évaluation
- ExercicesDocument8 pagesExercicesMtr Sanni Emcka100% (1)
- Initiation À La Comptabilité FinancièreDocument51 pagesInitiation À La Comptabilité FinancièreMhand AtlaghPas encore d'évaluation
- Finance IslamiqueDocument26 pagesFinance IslamiqueErnest SimmonsPas encore d'évaluation
- HEM Business Plan Modèle Sept.2018Document15 pagesHEM Business Plan Modèle Sept.2018karim benhaddouPas encore d'évaluation
- Fondements de L'économie-PolitiqueDocument541 pagesFondements de L'économie-PolitiqueMah Moh100% (2)
- Pilotage de La PerformanceDocument13 pagesPilotage de La Performancebadrou100% (1)
- Rapport de Stage s6 VFDocument32 pagesRapport de Stage s6 VFKa RiimPas encore d'évaluation
- S2.2 Le Retraitement Des AmortissementsDocument2 pagesS2.2 Le Retraitement Des AmortissementsMohamed DiawaraPas encore d'évaluation
- Bal 13 PDFDocument1 pageBal 13 PDFdienePas encore d'évaluation
- Défaillance Des Entreprises Au MarocDocument1 pageDéfaillance Des Entreprises Au Marocabdelhadino100% (2)
- Définition de La Communication InstitutionnelleDocument4 pagesDéfinition de La Communication InstitutionnelleDyna CiccéPas encore d'évaluation
- La Chèvre de Ma Mère (Version PDF - Cadeau)Document25 pagesLa Chèvre de Ma Mère (Version PDF - Cadeau)Le Foot c'est ici100% (4)
- M1048Document131 pagesM1048Rafik BelkahlaPas encore d'évaluation
- 12-Procédure Marchandises en Dépôt Vendues Aux Enchères - V1 - 230210-1Document6 pages12-Procédure Marchandises en Dépôt Vendues Aux Enchères - V1 - 230210-1François HounconnouPas encore d'évaluation
- Théorie Générale Des Obligations AGOURRAM S2 2015Document11 pagesThéorie Générale Des Obligations AGOURRAM S2 2015Karim Moujanni80% (5)
- Cours Travaux Fin ExerciceDocument54 pagesCours Travaux Fin ExercicenamPas encore d'évaluation
- Les Indicateurs de Performance Financiere Et Non FDocument18 pagesLes Indicateurs de Performance Financiere Et Non FWael ToujaniPas encore d'évaluation
- Rapport Fonction Finan 0002Document6 pagesRapport Fonction Finan 0002Hamza IkherazenPas encore d'évaluation
- Expertise Evaluation TpeDocument7 pagesExpertise Evaluation TpeHamoutni MohamedPas encore d'évaluation
- Introduction Cours DFDocument6 pagesIntroduction Cours DFben talebPas encore d'évaluation
- Evaluation Des Actions Et Parts SocialesDocument10 pagesEvaluation Des Actions Et Parts SocialesSILUE GERARDPas encore d'évaluation
- Screenshot 2022-12-18 at 22.28.39Document124 pagesScreenshot 2022-12-18 at 22.28.39Hassane BAMBARAPas encore d'évaluation