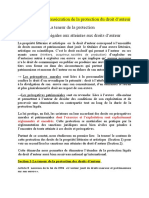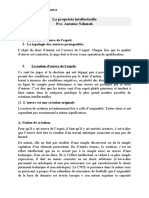Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Droit de La Propri T Intellectuelle COMPLET
Droit de La Propri T Intellectuelle COMPLET
Transféré par
irma_j_1Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Droit de La Propri T Intellectuelle COMPLET
Droit de La Propri T Intellectuelle COMPLET
Transféré par
irma_j_1Droits d'auteur :
Formats disponibles
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Deux branches dans le DPI : droit dauteurs et proprit industrielle (protection dun rsultat esthtique dessins et modles industrielle, brevets dinventions, protection dun avantage commercialedroit des marques). / ! \ Plan de cours disponible sur le site de la fac (peut tre modifi en cours danne).
Titre 1 : Proprit littraire et artistique
Rappel historique Le concept mme de droits dauteurs est assez ancien car on en trouve trace lpoque romaine dans les crits de Cicron. Le droit dauteur dpend des progrs techniques et de la possibilit de multiplier les supports. Pas de droit dauteur avant la dcouverte de limprimerie. Jusqu la rvolution ce droit tait accord sous forme de privilge par le pouvoir royal. Octroy non pas aux auteurs eux-mmes mais aux libraires imprimeurs. Le droit est trs souvent le rsultat de linfluence de groupe de pression (lobbying). Lobjectif de ces groupes tait de mettre en avant que limprimerie tait une invention nouvelle dont on ignore lavance, do des risques conomiques. Ces risques devaient tre protgs avec un droit lexclusivit de limpression de tel ou tel ouvrage. Cette situation va perdurer durant tout lAR, avantage : assure un contrle efficace des publications par le pouvoir royal jusqu 1777 arrts du conseil du Roi. Depuis ces arrts les privilges vont tre accords aux auteurs eux-mmes. Avec la rvolution il y a labolition des privilges, ds lors cette protection des droits dauteur tombe. Le lgislateur rvolutionna ire est intervenu rapidement avec deux dcrets lois fondateurs (1791 sur le droit de reprsentation, 1793 sur le droit de reproduction). Le lgislateur rvolutionnaire sest dabord occup de la situation des uvres dramatiques (thtre) en 1791, cette loi donne aux auteurs un droit exclusif qui est le droit dautoriser ou dinterdire la reprsentation de leur ouvrage. Ce droit dure la vie de lauteur et 5 ans aprs sa mort, ce droit est assorti dune rmunration. En 1793 le lgislateur sintresse aux uvres crites, cest un droit exclusif des auteurs, on peut tirer un revenu de ces droits. Le droit dure la vie de lauteur est 10 ans aprs sa mort. Aprs alignement du droit de reprsentation sagissant de sa dure. Ds 1844 la dure est fixe la vie de lauteur et 50 ans aprs sa mort, puis 70 ans partir dune loi de 1997 (harmonisation avec la directive Dure). Il y a une csure entre les attributs du droit dauteur, cette csure est le fruit dun hasard historique. Cette csure est toujours existante lheure actuelle. Cette csure entre la reprsentation et la reproduction est gnante au point que certains ont propos de la supprimer au profit dun moyen unique (communication de luvre publique).
Structure et principes gnraux du droit dauteur La structure est assez particulire, le droit dauteur est dit dualiste car il donne son titulaire (lauteur) deux sries de prrogatives appartenant des champs juridiques totalement diffrents :
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
+ Prrogatives morales : sapparente au cercle des droits de la personnalit, ce droit moral trois caractristiques (droit personnel, droit perptuel, droit incessible). Ce droit moral comporte 4 attributs : - Droit de divulgation : droit exclusif appartenant lauteur de dcider du moment o il va livrer son uvre au public. - Droit la paternit : droit dattacher son nom son uvre. - Droit au respect : droit pour lauteur dexiger que son uvre soit communique au public dans son intgrit. - Droit de retrait et repentir : droit pour lauteur de revenir sur une autorisation dexploitation. + Prrogatives patrimoniale (droit dexploitation) : Ce droit nat de la divulgation de luvre. Cest un droit personnel (sous la dpendance du droit moral), limit dans le temps (dure la vie de lauteur et 70 ans aprs sa mort), cessible. CE droit dexploitation comprend deux sries de prrogatives : - Droit de reproduction : multiplier les supports ou exemplaires des uvres. - Droit de reprsentation : caractre phmre, luvre est diffuse au public mais pas le support. Prrogative profitant aux auteurs duvres graphiques et plastiques, cest le droit de suite.
Question de la protection internationale des droits dauteurs ? En matire de proprit intellectuelle toute violation est un dlit car cest la fois un dlit civil et un dlit correctionnel (la victime a le choix). Le terme usit est contre faon. 90% des affaires de contre faons sont portes devant les tribunaux civiles. Aucun DPI ne serait efficace sil tait limit au territoire franais. Pendant tout le 18me il y a eu des conventions bilatrales (plus ancienne entre la France et les Pays Bas). Ces conventions sont peu efficaces, do la runion de pays pour faire des conventions internationales. Convention de Berne 1886, rvise plusieurs fois, la dernire rvision a eu lieu Stockholm en 84. Certains Etats estiment que la protection accorde aux auteurs par cette convention est trop importante do une convention dite universelle sur les droits dauteurs (Genve 1952) qui a un minimum de protection moins lev que celui de la convention de Berne. Par ailleurs il y a un principe dassimilation, tous les tats membres sengagent traiter les trangers ressortissants des autres EM comme ils traitent leurs nationaux. En UE il y a un principe de non discrimination.
Partie 1 : Champs dapplication du droit dauteur
Chapitre 1 : Objet du droit dauteur
Pour quune uvre soit protge certaines conditions sont ncessaires. Ces conditions ne figurent pas dans la loi car le CPI actuel lart L 111-1 et s, cest une codification droit constant venant dune loi du 1er juillet 1992. Le texte fondateur est une loi du 11 mars 1957,
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
succde aux textes de la priode rvolutionnaire. Toute ladaptation des principes rvolutionnaires la modernisation de la socit est le rsultat de la JP. Notamment en 1985. En 1957 le lgislateur a considr que les conditions taient suffisamment fixes par la JP pour quelles soient reprises dans une loi. En revanche il va numr des conditions qui ne doivent pas tre prise en compte dans la protection. Section 1 : Conditions de protection Il y a deux conditions. Il faut quil y ait une forme mais une forme originale. 1 Une forme On exclu les ides et les informations. Absence de protection des ides : dans aucun systme il y a cette protection, car le fait davoir une ide na pas de support il y a une vanescence, par ailleurs il ny a pas de preuve de lide. De plus il est admis que le progrs intellectuel suppose la libre circulation des ides. Cela sapplique diffremment selon que lon a affaire lide elle-mme (application intangible) ou quand lide est incorpore dans une uvre. Quand le juge va tre confront a une action en contre faon, il va devoir distinguer entre la reprise de lide qui est licite et la reprise du mode dexpression de lide qui elle est interdite et va pouvoir donner lieu une poursuite en contre faon. Cour de Paris 1957, conflit entre 2 professeurs de musiques (diteurs), il a mis en uvre une mthode personnalise pour simplifier le solfge pour les enfants. Un deuxime diteur reprend la personnalisation des notes de musiques. Nimporte qui peut faire une mthode de solfge o les notes de musiques prennent laspect de personnage. Si on retrouve dans la seconde uvre que les notes de musiques sont personnalises dans les mmes traits alors on peut dj fonder la contre faon. Affaire qui concerne Rgine Desforges La bicyclette bleue / autant en emporte le vent Margaret Michel, plainte en contrefaon, bicyclette bleue serait une contrefaon. CA Paris : pas de contrefaon car le thme des deux uvres tait certes commun mais banal. Apprciation de loriginalit de lide. Ccass 1 civ 4 fvrier 1992 casse au motif que la CA aurait du rechercher si, dans leur composition et dans leur expression (pas sur lide, sur son mode), les scnes des deux ouvrages qui dcrivent des rapports comparables ne comportent pas des ressemblances. Arrt 15 dcembre 1993 CA Versailles lecture des deux ouvrages, a men une comparaison, do il ressort que les pisodes de la bicyclette bleue sintgrent dans une cration originale. CA Paris avait apprci loriginalit du thme/ide, il fallait apprci le mode dexpression. Arrt 1 chambre civ 13 novembre 2008 dit Paradis : Question dart conceptuel et de sa protection. Concept = ide =>problme. Un auteur avait affich au dessus de la porte des
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
toilettes le mot Paradis , cette uvre dart avait t reproduite par Bettina Rheims dans une ouvrage. Est-ce une ide ou une forme, mode dexpression de lide ? Ccass : le pourvoi soutenait que a ntait quune ide, c d dtourner le sens dun lieu par une inscription en dcalage. Ccass approuve la CA Paris davoir retenu quil sagissait bien dune uvre, inscription en lettre dorepatineporte vtusteserrure croixmur dont la peinture scaille. CA fait ressortir que loin dtre un concept il sagit dune cration de forme. Ccass lapprouve, CA a fait ressortir une combinaison qui implique des choix esthtique faisant ressortir la personnalit de lauteur. Distinction ide/ mode dexpression qui ncessite parfois une vraie analyse. Dans certains cas la reprise de lide est fautive. Action au secours de lauteur, non pas pour lui accorder un droit privatif mais pour sanctionner un comportement dloyal. Lorsque la reprise a lieu dans des circonstances telles que contraire la morale commerciale 1382 cciv. Arrt CA Paris 8 juillet 1972 concernant une chanson satyrique dont le thme tait la publicit. Un auteur tait venu voir un diteur de musique pour lui proposer sa chanson. Lditeur dcline loffre, mais la propose Jacques Dutronc laccepte et linterprte. Quand la chanson est sortie, lditeur a plaid en rclamant la protection de lide et demandait la condamnation . ? CA condamne lditeur, les circonstances lobligeaient ne pas rvler une ide qui lui avait t confie lors dune ngociation contractuelle. La protection des informations : Non protges par le droit dauteur. Immatrielles. Ne sont pas protges parce quelles ont une nature particulire, savoir quelles ne sont personne car tout le monde. En revanche lorsque linformation est traite, luvre est larticle du journal. Info non protge mais son mode de traitement oui. Celui dont le mtier est de recueillir des informations, exemple du documentaliste qui doit trouver des informations sur un personnage, il ne peut pas prtendre que cest une uvre, informations qui ne sont pas le support du droit dauteur. Il ne pourra pas sintgrer a ux auteurs du film. Diffrence entre un travail et une cration. Pour les informations comme pour les ides laction en concurrence dloyale va venir au secours de celui qui nest pas protg par le droit dauteur si le comportement du second utilisateur est contraire la morale commerciale. 2 Originalit
Fait la distinction entre les uvres qui vont tre protges par le droit dauteur et celles qui en sont exclues. Le problme est que les tribunaux utilisent cette notion de faon maladroite. Se contentent dun motif de convenance : uvre originale car montre la personnalit de lauteur , en a se mettent labri de la cassation car question de fait. Mais na pas dmontr en quoi luvre est originale. Il est vrai quil est difficile de la dfini r.
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
On peut lopposer une notion voisine utilise en matire de proprit industrielle : la notion de nouveaut. Est nouveau ce qui apparat pour la premire fois, nexistait pas avant. Par opposition, est original ce qui est marqu dune empreinte personnelle. Loriginalit est propre au droit dauteur et on ne peut utiliser la nouveaut de lindustriel. Ex de la peinture avec ses coles. Si on utilisait la notion de nouveaut on ne pourrait protger aucun impressionniste sauf le premier. La nouveaut est une notion absurde en droit dauteur. Chaque peintre qui se situe dans un mouvement a son style. Notion de loriginalit maladroitement utilise. Analyse comme celle du Paradis rare. -Une notion large : Elle permet de protger par le droit dauteur des uvres qui sinspirent duvres antrieures. Existent alors des uvres totalement originales et dautres relativement originales que le droit dauteur appelle uvres drives ou encore uvres composites. L.113-3 et 4 Il faut revenir aux lments qui caractrisent une uvre, on considre quelle est compose de 3 lments : le thme ou lide, la composition : le plan ou lintrigue, lexpression : le mode de communication choisi par lauteur (uvre crite ou orale, uvre audiovisuelle, musicale, langue,). Luvre est absolument originale lorsquelle lest la fois dans sa composition ou dans son expression (pas danalyse doriginalit de lide). A linverse uvre drive si seulement originale dans sa composition ou dans son expression. Ex : uvres drives originales dans leur composition, cas des anthologies, uvre de cration accessible au droit dauteur. Anthologie de la posie romantique, choix dauteurs et choix duvres. Originalit par le choix. uvres originales dans lexpression : adaptations (au cinma) on ne reprend pas intgralement luvre adapte, choix ; les traductions, transposition dune uvre dans une autre langue, le traducteur fait un choix. Tout traducteur (mme mode demploi) est auteur. -Question de la protection des titres : Exemple de la difficult dapplication de loriginalit. Les titres sont des uvres de lesprit, article L.112-4 (seul article faisant mention de la otion doriginalit) : le titre, ds lors quil est original est protg comme luvre elle -mme. Mais le titre est ncessairement court, par sa brivet, originalit difficile analyser. Apprciation question de fait, soustraite la Ccass. JP disparate. Ligne directrice : on peut dire quun titre est banal lorsquil fait partie du langage courant, tant entendu que le titre doit tre apprci en lui-mme et non pas par contraste avec luvre avec laquelle il sert de support. TGI Paris 8 fvrier 1960 propos dun titre sketch Bourreau denfant , titre original parce quen opposition avec le contenu de luv re. EN
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
matire dapprciation du titre, titre original en lui-mme et non pas en opposition avec luvre. A linverse est original le titre soit parce que il sagit dune dcision argotique cre par lauteur lui-mme. JP sur lexpression du rififi Amsterdam cre par Auguste Lebreton. Le titre est original lorsque lauteur a opr entre deux mots du langage courant un rapprochement inusit. Charlie Hebdo CA Paris 25 octobre 95 Charlie = De Gaulle, journal satyrique. Le pre noel est une ordure Trib Paris 86, rapprochement inusit entre deux notions antinomiques. Deuxime alina : Nul ne peut, mme si luvre est tombe dans le domaine public, utiliser son titre pour identifier une uvre du mme genre dans des conditions crant un risque de conflit. Ainsi lorsque luvre est tomb dans le domaine public, action en concurrence dloyale JP a interprt largement, interprtation a fortiori : si on peut sanctionner le double emploi du titre lorsque domaine public, a fortiori, lorsque luvre est encore p rotge, il est possible dutiliser laction en concurrence dloyale. Apparat quil y aurait deux C : uvre du mme genre et que le double emploi du titre entraine un risque de confusion => lment de laction en concurrence dloyale. JP a utilis cet article pour sanctionner le double emploi du titre, Affaire du Fantme de lopra Trib Paris 10 janvier 72, deux ouvrages religieux Affaire de la Bible de Jrusalem 8 juillet 86 Trib Paris. Deux uvres du mme genre, ne pose pas de problme. Mais la JP a t confront un double emploi de titre dans deux uvres qui ne sont pas du mme genre, il sagissait dun roman et dun film : affaire des liaisons dangereuses TGI 10 novembre 1961. Titre du roman repris par Vadim pour un film nayant aucun rapport . Roman tomb dans domaine public. Les uvres ne sont pas du mme genre. Le tribunal a volontairement nglig la condition didentit de genre pour se focaliser sur le risque de confusion. Le double emploi du titre laisse croire au public que cest une adaptation, Vadim attire vers son film le public avec ce titre connu. Condamnation sur le fondement de cet article. Est demand Vadim dintgrer au titre un lment de distinction montrant au public quil ne sagit pas dune adaptation (=> Liaisons dangereuses 1960). Section 2 : Elments indiffrents la protection. 1 La question des formalits On parle de dpt comme il en existe en proprit industrielle. Il y a un principe lart L111 1 du CPI : le droit nat du seul fait de la cration sans aucune formalit. Le dpt lgal nest pas une condition de protection du droit dauteur, cest un systme administratif cr pour la conservation des uvres. Les films doivent faire lobjet dun dpt devant le CFC.
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
2 Le genre et la forme dexpression Ils ont des points communs. Art L112-2 de la CPI donne une liste des uvres protges par le droit dauteur. Cette liste est numrative ( notamment ). Cette numration est simplement illustrative, c'est--dire que des crations ne figurant pas dans cette numration peuvent tre protges. On trouve dans lnumration, des uvres crites, uvres musicales, uvres thtrale, arts plastiques, uvres orales, des plans, des cartes gographique, des uvres chorgraphiques ou des tours de cirque Du fait de la JP des crations peuvent tre qualifier duvre protge, par exemple la dcoration florale du Pont Neuf par Kenzo. Il y a une limite dans la protection des parfums, les uns comme les autres ont en commun quils ne peuvent pas se voir octroyer un droit privatif par un autre systme de droit que le systme de droit dauteur. Les parfums ne sont pas brevetables, donc on ne peut donner un droit privatif autre que le droit dauteur. Cest aussi le cas pour les logiciels. Le droit des brevets exigent pour les parfums que linvention soit communique au public or les parfumeurs veulent conserver un certain secret. Cette exigence de publication et la protection trop courte du droit de brevet ont conduit les parfumeurs rechercher un droit privatif par le biais du droit dauteur. La fragrance dun parfum est elle ou non une forme dexpression originale protge par les droits dauteurs ? La CC la refus dans un arrt du 13 juin 2006 en disant que le parfum tait un simple savoir faire et non pas une forme dexpression protgeable par le droit dauteur. Les juges du fond ont rsists la position adopte par la CC. La CC a du raffirmer le 22 janvier 2009 son principe pour faire face la rsistance des juges du fond. Dans les uvres protges il y en a qui ont un statut particulier, les uvres orales notamment (sermon, allocution, plaidoirie). Il y a un problme de preuve du contenu de luvre. Les uvres orales voient leur progression limite par lart L122 -5 qui numre des exceptions au droit dauteur et certaines exceptions concernent certaines uvres orales : les uvres orales peuvent tre reproduites par voie de presse ou de radio diffusion titre dinfo dactualit et cette reproduction peut tre partielle ou intgrale , il y a deux conditions : + Condition gnrale : on doit citer clairement le nom de lauteur et la source + Lexception est justifie par les ncessits dinformations, il y a une condition de temps qui intervient : la publication doit intervenir dans un temps rapproch par rapport au discours ou la plaidoirie en question avec une tolrance en raison de la priodicit de lorgane de presse qui publie le discours (ex : Affaire PASSERON TGI 6 juillet 1972). 3 Question du mrite Le juge nest pas un esthte, la question de savoir si luvre est belle ou pas, si elle a ncessit un grand effort intellectuelle ou non na rien voir dans loctroie de la protection de la cration.
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Le juge sait trs bien que il ne doit pas faire dpendre la protection de luvre de leffet esthtique quelle a sur lui. A fortiori quand il emploi une formule qui emploi le terme de mrite la sanction est immdiate. CA Lyon 27 juin 1984 protection de vido cassette caractre pornographique. Sanction de la cour dappel car le juge prcdent a jug le mrite. 4 La destination Le droit dauteur protge les formes mme si celles-ci ont une destination utilitaire. Cela vient dun principe propre au droit franais, le principe de lart. Lart sexprime de la mme manire quil sagisse dune uvre but purement esthtique ou une uvre ayant une fonction utilitaire . Le fait que la destination de luvre ne rentre pas en ligne de compte pour loctroie de la protection. Pour le dessin industriel il peut tre protger par la loi industriel sous la condition de nouveaut. Les dessins et modles peuvent bnficier dun cumul de protection avec le droit dauteur et cette loi spciale. En revanche quand il y a un conflit sur la nature de la cration, il va plutt se tourner sur le droit spcial car le contenu de luvre est fix par le dpt. On a pu inclure dans les uvres protgs les logiciels, ces derniers taient la recherche de protection car ils sont trs frquemment copis. Mais les logiciels sont des crations abstraites non protges par le brevetage ds lors on recherche la protection par les droits dauteurs. La JP a admis que les logiciels pouvaient tre considrs comme des formes originales, puis loi du 11 mars 1957 consacre cette position, loi de 1985 inclut les logiciels dans lnumration des uvres protgs par les droits dauteurs. Les logiciels doivent satisfaire aux conditions gnrales et en particulier celle doriginalit. Arrt AP 7 mars 1986 PACHO, CC a dfinit en quoi consist cette originalit, sont originaux les logiciels dont lauteur va au-del dune logique mathmatique et contraignante en choisissant au contraire une structure individualise adapte la question quil entend rsoudre. Cet arrt insiste sur le choix du crateur du logiciel. Mais il y a une JP dviante qui applique aux logiciels les critres de la protection industriel, c'est--dire le critre de la nouveaut, le mrite ou encore de lactivit inventive dont aurait fait preuve le crateur du logiciel. Il aurait t prfrable de faire une loi spciale pour la protection du logiciel. Dautre part les logiciels bnficient dun rgime particulier, la loi a btie pour les logiciels lintrieur de la protection des droits dauteurs un rgime drogatoire (affaiblissement du rgime gnral par le rgime drogatoire). Aspects dfavorables pour le crateur de logiciel : protection amoindrie par rapport un crateur ordinaire. Quand logiciel cr dans le cadre dun contrat de travail, les dr oits sont dvolus lemployeur (art L113-9). Art L121-7, sagissant des droits moraux le crateur de logiciel na pas le droit de retrait ou repentir mais surtout le crateur ne peut pas procder une adaptation (modification) de son uvre. Aspects favorables pour lexploitant : art L122-6 en matire de logiciel la copie prive est interdite sauf la copie de sauvegarde, lexploitant garde le contrle des utilisations secondaires du logiciel.
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
Chapitre 2 : Sujet du droit dauteur
http://zarow.kazeo.com
Sur la tte de qui nat le droit ? Art L111-1. Le droit nat de la cration ds lors il nat sur la tte de lauteur. Seul lauteur se voit investis du droit dauteur. Ce droit apporte des attributs moraux et des attributs patrimoniaux. Les attributs moraux sont exercs que par lauteur, et les attributs patrimoniaux pourront tre exerc par des tiers considrs comme cessionnaire de lauteur. Section 1 : Les difficults dapplication du principe rservant la qualit dauteur crateur 1 Lauteur salari Journaliste, ralisateurs de films et autres Les employeurs sont trs tents de considrer quils sont les seuls auteurs des uvres cres par leurs salaris ou sur leurs instructions (art L111-1 al 2 : lexistence ou la conclusion dun contrat de louage douvrage ou de service par lauteur dune uvre de lesprit nemporte pas drogation la jouissance du droit reconnu par le premier alina). Le droit nat sur la tte de lauteur quand bien mme il serait un auteur salari, la CC a du intervenir plusieurs reprises pour rappeler ce principe (influence du droit US qui contient le principe inverse). Une partie du droit dauteur peut tre cd lemployeur (droits patrimoniaux). En cas de contrat de travail est ce que la cession des attributs patrimoniaux intervient du seul fait de ce contrat ou est il ncessaire quil y ait un contrat spar ? Pour faciliter la situation des employeurs les tribunaux estimaient que la cession des droits dexploitations lemployeur rsultait ipso facto de lexistence dun contrat de travail (cession implicite). Ce systme a t condamn par la CC 1re chambre civile le 16 dcembre 1992, raffirmation avec les arrts du 27 janvier 1993 et 21 octobre 1997 : La cession des droits dexploitation doit faire lobjet dune mention expresse dans le contrat de travail, clause qui doit rpondre aux exigences du droit de la proprit intellectuelle (conditions lart L131-2 : chacun des droits doit faire lobjet dune mention expresse , dans chaque droit on doit numrer les modes dexploitations, la cession doit comporter obligatoirement une rmunration proportionnelle). Ce principe est assez peu appliqu en pratique malheureusement. En droit dauteur on est en prsence de deux oprateurs co de poids diffrents, les auteurs (individualistes et peu organiss) et les employeurs/exploitants/producteurs (en position de force et trs bien organis). 2 Lidentit de lauteur est inconnue Cela concerne des uvres anonymes et pseudonymes. Luvre anonyme est publie sans le nom de lauteur et luvre pseudonyme est publie sous un nom demprunt (un nom de plume en matire littraire). au
Droit de la proprit intellectuelle
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Le droit nat bien sur la tte du crateur mais comment vas t on appliquer ce droit alors quon ne connat pas la personne de lauteur. Art L113-6 du CPI, puisque lidentit de lauteur est inconnu, le droit dauteur da ns toutes ces prrogatives va tre exerc par un tiers qui sera considr par la loi comme le mandataire de lauteur. La loi le dsigne sous le nom dditeur ou publicateur originaire. En droit dauteur diter et publier ne sont pas synonymes, en droit d auteur diter signifie multiplier les exemplaires alors que publier cest rendre accessible au publique. En droit dauteur la reprsentation est un mode de publication. Le lgislateur a voulu couvrir toutes les hypothses. Lhypothse est celle dun auteur versatile qui va changer dditeur ou publicateur chaque fois quil communique une uvre au public. Le mandataire est non pas attach la personne mais luvre. Le mandataire exerce toutes les prrogatives de lauteur y compris celles morales. Disposition particulire sagissant du calcul de la dure de protection du droit dauteur : le calcul des 70 ans va soprer partir de la publication/communication/dition. Ce rgime spcifique peut cesser tout moment ds que lauteur rvle son identit, partir de ce moment on retombe dans le rgime de droit commun. Seul lauteur lui-mme peut dcider du moment o il va rvler son identit , lditeur na pas le droit de la rvler. 3 Les uvres de collaboration Elles font partie des uvres plurales : o plusieurs personnes ont particips directement ou indirectement la cration dune uvre. Ex : uvres drivs ou composites Dans les uvres de collabo plusieurs auteurs ont mis en mme temps leur travail en commun pour aboutir une uvre dinspiration commune. Il y a 2 conceptions : -Conception restrictive : il ny a duvre de collaboration que lorsque les auteurs appartiennent au mme genre. Ce nest pas la conception franaise. Pour le droit franais les BD par exemple sont des uvres de collaboration tout comme les opras. Ce qui compte pour le droit franais cest le travail commun peu importe le rsultat. -Conception extensive Quand on veut parler des auteurs des uvres de collaboration on les qualifie de co-auteur. A/ Rgime gnral Art L113-3 CPI : rgime dindivision, luvre de collabo est la proprit commune des co auteurs. Mais ce nest pas lindivision de droit commun. Rgime particulier organis par le CPI, toutes les dcisions obissent la rgle de lunanimit. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropries pour sortir dventuels difficults entre les auteurs. On utilise notamment le systme de labus de droit. Cela ne concerne pas les actions en justice pour la dfense de luvre, ici il faut tre prudent car il y a une nuance. Les actions en contre faon pour les uvres en collaboration pour la
Droit de la proprit intellectuelle
10
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
dfense du droit patrimonial peuvent tre exerce par un seul co-auteur mais il doit auparavant mis en cause les autres co-auteurs. CC 1re 10 mai 1995 et chambre crim 19 septembre 2000. Il faut quil avertisse les autres co-auteurs pour quils puissent le rejoindre. Laction pour dfendre le droit morale : un co-auteur peut agir seul quand bien mme il naurait pas mis en cause les autres, car cest une atteinte au droit de la personnalit. Ce coauteur souffre alors seul. Si au dcs de lauteur, il y a plusieurs hritiers, un seul de ces hritiers peut agir seul (Cour de Paris 19 dcembre 2008). Les diffrents coauteurs peuvent mourir des ages diffrents, par faveur pour les auteurs la dure des 70 ans se calcule partir du dcs du dernier coauteur. B/ Question des uvres audio-visuelles Cest une modalit particulire duvres de collaboration, donc la question du calcul de la dure sapplique galement ces uvres. Lorigine du CPI en matire de droit dauteur est une loi de mars 1957, au moment du vote de la discussion de cette loi il y avait une affaire qui agitait les tribunaux. Le film sappe lait la bergre et le ramoneur : dissension entre les coauteurs, lun deux critique la modification sans son autorisation. Selon certain le meilleur moyen pour viter ces complications seraient que les producteurs devraient tre les seuls auteurs de luvre. En 1957 le lgislateur a rsist la demande des producteurs, mais il a amnag le rgime de luvre pour tenir compte des producteurs et viter qu cause de la revendication dun seul coauteur lentreprise commune cours la faillite. Ce rgime a t reconduit en 1985 avec la rforme, le seul apport a t de remplace le terme duvre cinmatographique par le terme duvre audio-visuelle. + Dtermination des co-auteurs de luvre audio-visuelle Art L113-7 du CPI : raffirmation de la position du lgislateur (cest une uvre de collabo). Lalina 2 r insiste sur ce point. Cet article donne une liste des personnes prsums coauteurs : - Lauteur du scnario - Lauteur du texte parl - Lauteur de la musique si elle est spcialement ralise - Lauteur de ladaptation - Le ralisateur La personne doit prouver quelle raliser une uvre et que celle-ci soit originale. Cela donne aux personnes ci-dessus une certaine force (grce au gnrique, contrat etc.). La prsomption est simple cela dit. Une personne nomme dans le gnrique par ex comme ralisateur peut voir sa qualit dauteur remise en cause, procdure devant les tribunaux par une personne intresse. Des personnes qui ne sont pas coauteurs peuvent essayer dtablir quils ont fait un travail dauteur pour une uvre dtermine, cest assez souvent le directeur de pho tographie mme si leurs actions ont souvent t rejetes car les tribunaux considrent que les choix de loprateur photo ne sont pas ses choix mais ceux du ralisateur.
Droit de la proprit intellectuelle
11
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Lalina 3 traite de la situation de lauteur de luvre adapte lcran, on assim ile cet auteur aux co-auteurs. Il intgre par le fait de la loi le cercle des coauteurs mme sil na pas particip au film, mme sil est mort depuis 20 ans. Il sagit dune prsomption irrfragable. Le statut des uvres audio visuelles a t adapt sans discussion, cette assimilation de lal3 est dicte par des considrations conomique ou patrimoniale. On prolonge la dure de protection de lauteur de luvre originaire car elle a t intgre dans un film. + Droits des coauteurs Le lgislateur a amnag les droits des auteurs pour faciliter la tche du producteur et faciliter ses intrts patrimoniaux. Cela touche la fois le droit moral et le droit patrimonial. -Droits moraux : Art L121-5 fait une distinction, dans la vie dune uvre AV il y a deu x priodes, une de ralisation de luvre et une dexploitation. Ces deux priodes tant spare par une procdure dachvement. Cet art son dernier alina dispose que le droit moral ne peut tre exerc que sur luvre acheve. Une fois que luvre est fixe par la procdure dachvement les coauteurs peuvent interdire que cette version soit modifie sans leur accord. Mais avant lachvement les coauteurs jouissent du droit moral mais ils ne peuvent pas lexercer. Le coauteur peut quitter lentreprise commune en laissant la disposition de lquipe la partie de luvre qui a dj t ralis. Ou il reste sans contester, il retrouvera aprs lachvement de luvre lexercice du droit dont il a t priv pendant la priode de ralisation. Aprs lachvement le film est dfinitivement fix, la version ne peut jamais tre change. Procdure dachvement= accord entre le ralisateur ou ventuellement les coauteurs et le producteur sur la version dfinitive (art L121-5 du CPI). Toute modification ultrieure ne peut avoir lieu du fait dune des parties, il faut un nouvel accord. -Droits patrimoniaux : art L132-24 CPI. Ces arts concernent les contrats dexploitation des droits dauteurs. Chaque auteur signe avec le producteur un contrat appel contrat de production audio-visuelle. Par le seul effet de ce contrat il y a cession au producteur des droits dexploitation de luvre. Cet art ne concerne pas lauteur de luvre musicale, la plupart des musiciens sont membres de la SACEM qui est une socit de gestion collective qui soccupe en particulier de percevoir les droits dauteurs pour ses adhrents et de les redistribuer ensuite. En adhrant la SACEM ils apportent leur rpertoire qui est compos des uvres dj composes mais aussi de leurs uvres futures. Le musicien ne peut pas cder ses droits aux producteurs aussi sil a cd ses droits la SACEM. Il sagit exclusivement dune cession du droit dexploitation audiovisuelle, on cde au producteur que ce qui est ncessaire pour quil exerce sa fonction de producteur (que les droits dexploitation audiovisuelle). Cela ne concerne pas les droits graphiques qui sont rservs aux auteurs, de mme pour les droits thtraux. Il sagit dune cession des droits dexploitation et non une cession des revenus. Cette cession doit tre assortie dune rmunration professionnelle. Le lgislateur carte la rmunration forfaitaire, il a voulu associer les auteurs au succs de leurs uvres. La rmunration se fait donc en pourcentage, mais sur quelle assiette sapplique ce pourcentage ?
Droit de la proprit intellectuelle
12
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Avant la loi de 1985 il y avait un conflit sagissant de cette assiette. Il y a deux moyens de calculer cette rmunration : les producteurs prfraient la recette nette part producteur (la part de la recette qui va revenir au producteur quand tous les frais dexploitation ont t pays, mais les auteurs prfrent la recette salle (solution retenue par le lgislateur) qui est laddition du prix de tous les billets vendues aux spectateursArt L132-24. Quelque soit luvre un auteur est rmunr en pourcentage. Section 2 : Personnes nayant pas la qualit dauteur Les personnes morales ne peuvent pas tre reconnues comme auteur car elles sont inaptes la cration. Mais il y a un cas o la personne morale est reconnue comme auteur, il sa git des uvres collectives (art L113-5). Les personnes qui participent une uvre collective ne sont pas des coauteurs mais des contributeurs/participants. 1 La notion duvre collective Cest une notion particulire au droit franais, car en dehors du droit franais seul le droit nerlandais reconnat cette notion. Cette notion permet dattribuer la qualit dauteur titre originaire une personne morale. Le lgislateur a pens au dictionnaire ou aux encyclopdies en crant cette uvre, partir de cet exemple en 1957 le lgislateur va raisonner sur les uvres collectives. A lorigine de luvre il y a un initiateur (personne morale), cette PM est en gnral un diteur qui va prendre linitiative de la cration de luvre. Il va choisir les diffrent s contributeurs quon pourrait assimiler des sous-traitants . Au cours de llaboration il va runir les contributeurs et faire des amnagements, une fois le travail termin lditeur va publier luvre sous son nom. Dans cette uvre il y a des auteurs des diffrentes rubriques, chaque auteur dispos dun droit dauteur sur sa contribution. Le droit sur lensemble de luvre appartient la PM, cette dernire est considre comme lauteur de luvre et bnficie de tous les droits dcoulant de cette qualit. 2 Evolution de luvre collective La question se pose le plus souvent pour des uvres qui sont labores par les salaris dans des bureaux de style/dtude. En gnral il sagit de modle. Lemployeur essaye de faire juger que luvre est une uvre collective. Dans une 1re tape la JP a toujours refus de donner ce type de cration le caractre duvre collective, elle estimait que la qualit duvre collective ne devait tre attribue une uvre que de faon rsiduelle (faut dabord rechercher si luvre rpond aux conditions de luvre de collaboration). Position des annes 80 (CC 6 novembre 1979 pour les modles de sac). Ces modles sont souvent contrefaits, le plus souvent le contrat de travail des salaris ne contient pas de clause de cession lemployeur donc ce dernier nest pas considr comme titulaire du droit dexploitation. Il ne peut agir en contre faon. Ds lors les personnes qui font des contrefaons peuvent copier les modles.
Droit de la proprit intellectuelle
13
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
La JP a ragit dans deux dcisions de la CC du 19 fvrier 1991 et 22 octobre 1991 : elle a estim que dans le cadre dune action en contre faon et en labsence de revendication des auteurs personnes physiques luvre exploite par une personne morale est prsume tre une uvre collective. Malgr toutes ses prcautions prises par la CC, la doctrine a protest en disant que la chambre civile largissait de faon excessive le champ des uvres collectives. Au vu de ces critiques la CC a modifi sa motivation, 24 mars 1993 et 28 mars 1995, 9 janvier 1996 : la socit qui exploite une uvre sous son nom accomplis sur celle -ci des actes de possessions qui en labsence de revendication des personnes physiques layant ralis sont de nature faire prsumer lgard des tiers contre facteurs que la socit exploitante est titulaire sur cette uvre quelque soit sa qualification des droits de proprit incorporels. Deux conditions sont poses : - Condition positive : la socit doit exploiter luvre sous son nom. - Condition ngative : la prsomption de titularit des droits dexploitations ne joue quen labsence de revendication des auteurs. Il y a une petite maladresse la fin de son motif car les CA par raccourcis disent que la PM est considre comme auteur.
Droit de la proprit intellectuelle
14
Prise de notes M1 2009-2010 Partie 2 : Contenu du droit dauteur
Chapitre 1 : Droits moraux
Section 1 : Droit moral du vivant de lauteur
http://zarow.kazeo.com
4 attributs : divulgation, paternit, droit au respect, droit de retrait/repentir. 1 Droit de divulgation Divulguer cest porter une uvre la connaissance du public quelque soit le moy en de communication utilis. Tout mode de communication de luvre au public est considr comme une divulgation. Le droit de divulgation est le droit exclusif appartenant lauteur de dcider du moment o il va communiquer son uvre au public et de la forme que prendra cette communication. Ce droit est la prrogative la plus importante du droit morale car il gouverne la naissance et lexercice des droits patrimoniaux. + Gouverne la naissance des droits patrimoniaux : partir de la communication le droit dexploitation va intervenir. Il est trs important pour lauteur de garder la matrise de la divulgation. Mme engag dans un contrat ddition/de commande lauteur conserve linitiative de cette divulgation. + Gouverne lexercice des droits patrimoniaux : lauteur dcide aussi de la forme que prendra la communication. Par exemple il va dcider si son uvre oral peut tre dit, mais aussi si son uvre crite en franais peut tre traduite dans une langue trangre En fonction de son droit de divulgation il va dcider du nombre dexemplaire et dcider aussi dventuelles rditions. Cette possibilit dtre exerc chaque mode dexploitation fait difficult aujourdhui, la majorit de la doctrine soutient que le droit de divulgation spuise par le 1r usage. Ce droit de divulgation va donner lieu des difficults dapplication, notamment quand lauteur est engag dans un contrat de commande. + Force du droit de divulgation -Conflit entre droit de divulgation et droit de proprit : par exemple un auteur va vendre un tableau un client, le client peut il communiquer ce tableau au publique et peut il tirer des revenus de ce tableau ? Art L111-3 CPI : principe de lindpendance du droit dauteur par rapport au support matriel. Cela signifie quil y a une distinction fondamentale entre le droit de lauteur et le droit du propritaire du support. En raison de cet article la rponse la question est ngative, la proprit du tableau na un droit que sur le support. Malgr la vente du support tous les droits dauteurs restent sur la tte de lauteur. Le droit de divulgation est trs fort car il prive le propritaire du support du fructus.
Droit de la proprit intellectuelle
15
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
CC 29 novembre 2005 sur une donation dune tude qua fait un peintre pour prparer des dcors de thtre. CC a jug que la donation de luvre nemportait pas divulgation au public mais seulement pour lacqureur. -Conflit entre le droit de divulgation et le principe de la force obligatoire du contrat. Dans le cas du contrat dentreprise, une personne commande une uvre un auteur. Lauteur peut il se retrancher derrire son droit de divulgation pour refuser de livrer luvre commande ? CC WHISTLER 14 mars 1900 : ctait un peintre anglais rput pour avoir mauvais caractre, il a reu la commande dun tableau dun commanditaire. Plus tard W refuse de le livrer car le rsultat ne lui plat pas et quil tait pas digne de son talent. Lhistoire dit quil a refus de livrer car il tait mcontent des honoraires obtenus pour raliser le tableau. Le commanditaire a assign le peintre devant les tribunaux. La CC a rendu cette dcision qui est ambigu. La convention par laquelle un peintre sengage excuter un portrait moyennant une somme dtermine est un contrat dune nature spciale, en vertu duquel la proprit nest dfinitivement acquise la partie qui la command que lorsque lartiste a mis le tableau sa disposition et quil a t agre par elle . La volont de divulguer luvre commande se manifeste par la livraison. Que va-t-il se passer quand luvre est dj livre ? Cour de Paris ROUAULT c/ VOLLART 9 mars 1947 : Au 19me et dbut du 20me il y avait beaucoup de marchands de tableaux qui tait aussi des mcnes. Un marchand de tableau permettait un peintre davoir un atelier (et lentretenir) et le peintre promettait au marchand des points de peinture, la difficult cest que latelier de ROUAULT tait dans les locaux de VOLLART, loccasion de la succession de VOLLART il a fallu t distinguer dans la masse des uvres de lateliers celles dont la proprit avait t transmise VOLLART et celles conserves par ROUAULT. Il a fallut recourir une autre analyse. La distinction sest faite autour du point de savoir quelle uvre avait t divulgue et celle qui ne ltait pas. La JP a analys les habitudes du peintre, ROUAULT pour manifester quune uvre tait acheve la signait. La rponse est positive mais lauteur devra indemniser le commanditaire frustr. Ici on a conflit entre deux droits dits absolus. Lauteur aurait pu rester indpendant. On le sanctionne car il sest engag dans un contrat quil ntait pas sur de remplir. En cas de prjudice il sera oblig de rparer ce prjudice. Prjudice qui peut tre moral. La sanction de lauteur ne peut tre que pcuniaire car il a une obligation personnelle de faire (pas dastreinte ou dexcution force). Le droit de divulgation est trs fort car il paralyse les rgles normales du transfert de proprit. Des fois le commanditaire nexcute pas ses obligations contractuelles, on peut avoir le droit lexcution force. CC 16 mars 1983, concernant un sculpteur se nommant DUBUFFET. Il tait bnficiaire dune commande pour une sculpture nomme le salon dt. Cette sculpture tait destine orne le sige social de la socit. Il tait prvu que le commanditaire se chargeait de lexcution matrielle de la structure. Or le commanditaire nexcute pas comme promis la sculpture en question. La divulgation dpend de lexcution matrielle du commanditaire, ds lors la non excution du commanditaire faisait obstacle la divulgation de luvre.
Droit de la proprit intellectuelle
16
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
DUBUFFET obtient gain de cause, le commanditaire est condamn raliser la structure sous astreinte. Lorsque la divulgation de luvre dun auteur dpend de lobligation dun tiers. Si le tiers ne respecte pas son obligation il fait obstacle la divulgation de luvre de lauteur. 2 Droit la paternit Art L121-1 CPI : droit au respect du nom et de la qualit dauteur. Lauteur peut exiger que luvre soit diffuse au public sous son nom. Dans les uvres publicitaires il est extrmement rare que dans un visuel on trouve le nom du photographe ou du graphiste qui a cr laffiche. Normalement cest une atteinte au droit de paternit. On a 2 oprateurs de poids conomiques diffrents, savoir le producteur/publicitaire qui a un poids important et le crateur qui a un poids moindre (menace de licenciement ou de suppression des contrats). Facette positive : droit pour lauteur dexiger que son nom figure sur luvre Facette ngative : droit dexiger que luvre soit publie comme anonyme/pseudonyme. Le problme essentiel de ce droit est lexistence des contrats portant sur la paternit dune uvre. Le droit la paternit est incessible. La pratique connat des conventions portant sur ce droit, presque exclusivement dans le domaine de ldition. On appelle cela des contrats de ngres : un auteur sengage a crire pour le compte de lditeur un ouvrage publi sous le nom dun tiers. Il y a certains auteurs qui sont rcalcitrants. Ex 1 : Affaire MONPESAT CA de Paris 10 juin 1986, souvenirs de m. SEGAL qui raconte ses aventures, mises en forme par monsieur de MONPESAT. uvre qui un grand succs, mais monsieur MONPESAT est mcontent de ce quil a touch do sa rclamation. Ex 2 : CA 1er juillet 1989 BRAGAMCE, ouvrage publi sous le nom de Michel De Grce mais crit par BRAGAMCE. Livre qui a du succs. Dans ces deux affaires la CA de Paris na pas annule les conventions porta nt sur le droit la paternit. La CA dit quil sagit duvres de collaboration entre les deux auteurs. Ce sont des arrts en contravention avec les PGD du droit dauteur : les ides et les infos ne sont pas protgs par les droits dauteur or ici ils sont protgs. Pas de pourvoi en cassation dans ces deux affaires car il y a eu des transactions entre les auteurs. 3 Droit au respect Art L121-1. Droit pour lauteur dexiger que sont uvre ne soit pas modifi sans son consentement. Cette question ne se pose que quand luvre a t divulgue au public. A) Droit au respect et des contrats dexploitation En matire de droits dauteur il y a 2 sortes de contrats dexploitation.
Droit de la proprit intellectuelle
17
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
+ Les contrats dexploitation proprement dit (dition, reprsentation et reproduction audiovisuelle). Cest dans ce cas que le droit au respect est le plus fort. Art L121-5 : aucune modification ne peut tre apporte sur luvre audiovisuelle acheve sans lautorisation des personnes ayants pris part la procdure dachvement. Ex : Ajout dune musique un film muet, exemple du Kid (Charlie Chaplin) CA de Paris 29 avril 1959. Ex 2 : Affaire Huston, film Asphalte Jungle: affaire de colorisation dun film en N&B sans lautorisation de lauteur. Il sagit dune uvre amricaine, aux USA le producteur est considr comme lauteur unique du film. Application de la loi franaise une uvre amricaine, la CC a juge que les lois sur le droit dauteur tait des lois dapplications immdiates do la mise en lcart du droit amricain en France, par consquent condamnation de la chane TV qui a coloris. Dans le contrat ddition art L132-11 : aucune modification ne peut tre apporte luvre par lditeur sans lautorisation crite de lauteur. Autorisation crite donne au coup par coup et non de manire gnrale car ce serait une cession/renonciation au droit moral. Ex : Affaire de la suite des Misrables, Un des hritiers de V. Hugo a protest contre la publication dune suite donne aux misrables. Dans un 1 er temps la cour de Paris a dit quil sagissait dune violation du droit moral (31 mars 2004). Mais par la suite CC estime quil sagissait dune adaptation (30 janvier 2007). En matire de contrats de reprsentation cest lart L132-22 : luvre doit tre reprsente conformment aux usages de la profession. Il ne peut pas y avoir de chahut dans la salle de spectacle, il faut sassurer que les conditions de calme soient respectes. + Le droit au respect et ladaptation de luvre : les choses sont compliques car il faut concilier le droit moral avec la libert reconnue ladaptateur. A partir de quel mom ent on quitte le terrain de la libert ncessaire de lauteur pour entre dans celui de la violation. Pour essayer de guider les juges dans leur apprciation de la violation, la CC est intervenu le 22 novembre 1966 dans une affaire appele le dialogue des Carmlites. Il est rare que la CC donne des directives aux juges du fond, la CC dit que pour juger de la fidlit dune adaptation les juges du fond doivent rechercher si luvre seconde respecter lesprit, le caractre et la substance de luvre originale. Il y a violation lorsquil dnature luvre adapte, soit il modifie lesprit de luvre ou sil modifie les caractres des personnages. CC 12 juin 2001, adaptation au cinma du Petit Prince, les hritiers de St Exupry on estimait que ladaptation au cin dnaturait luvre. CC : ladaptation au cin dun livre implique une certaine libert pour ladaptateur, il ny a pas violation du droit au respect ds lors que luvre adapte respectait lesprit de luvre prexistante. Et que bien que comportant un apport personnel de ladaptateur elle reproduisait fidlement lintrigue et le caractre du personnage principal. B) Droit au respect et la cession du support matriel La question se pose en majorit pour les uvres graphiques ou plastiques. Le droit de divulgation paralyse un des aspects du droit de proprit qui est lusus.
Droit de la proprit intellectuelle
18
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Est-ce que le propritaire du support matriel dune uvre peut la dtruire ? En modifier laspect extrieur ou la laisser se dgrader ? Question pose dans une affaire concernant le peintre Bernard Buffet : il avait peint un rfrigrateur, ce dernier a t vendu aux enchres au profit dune uvre caritative. Lacqureur du rfrigrateur avait dcoup chacun des panneaux du rfrigrateur et les a vendu sparment. Protestation de lauteur au nom du droit au respect, atteinte au respect de luvre. CC lui donne raison le 6 juillet 1965 : rejet du pourvoi en disant que le droit moral appartenant lauteur lui donne la facult de veiller aprs la divulgation ce que son uvre ne soit ni dnatur ni mutile. Affaire VASARELY de la cour de Versailles (28 janvier 1999) : le peintre avait peint 31 panneaux destins orner la salle manger de la direction. Des panneaux ont disparus, on a dissocier ce que lauteur considrait tre un ensemble. Les tribunaux lui donne raison sur latteinte au droit moral et au droit au respect. Le droit au respect de lauteur est plus fort que le droit de proprit et paralyse labusus. Dans la JP la plus rcente le droit au respect connat au moins 2 limites : - CC 3 dcembre 1991 : fontaine difie pour le compte dune commune. Avec le temps cette fontaine sest dgrade. Selon sculpteur la commune est tenue de lentretien. La CC lui a donn tort (au sculpteur) pour deux raisons : Seul justifie la mise en avant du droit au respect des actes graves mettant en pril lexistence mme de luvre. Ces actes graves doivent tre le fait du propritaire mme de luvre. Limite pour un type duvres : caractre utilitaire et que celle-ci est une uvre architecturale. Deux arrts de la CC loigns dans le temps, 7 janvier 1992 et 11 juin 2009. Lorsque luvre a un aspect utilitaire le propritaire a le droit dapporter des modifications justifies par des besoins nouveaux sous rserve dune autorisation de lautorit judiciaire sur leurs importances et sur les circonstances qui lont conduit y procder.
4 Droit de retrait/repentir Art L121-4. On va rencontrer la force obligatoire des contrats. On part dans lhypothse ou lauteur a conclut avec un tiers un contrat dexploitation. LE droit de retrait permet de revenir pour retirer luvre de la circulation soit pour la retirer dans le but de la modifier et de lexploiter nouveau (repentir). Prcaution du lgislateur contre lexercice la lgre de ces droits et pour tenir compte des intrts de lexploitant. Ce sont des prcautions de nature financires. Avant dexercer le droit de retrait/repentir lauteur doit indemniser lavance son cessionnaire du prjudice quil aura subi. Comment valuer ce prjudice. Exigence peut paralyser le droit de repentir/retrait. Prcaution qui touche que le droit de repentir : pour viter le dtournement du droit de lauteur, la loi exige que ce dernier propose par priorit son uvre lexploitant dorigine et a des conditions financires identiques celles du contrat initial.
Droit de la proprit intellectuelle
19
Prise de notes M1 2009-2010
-
http://zarow.kazeo.com
Le droit de retrait/repentir ne peut tre exerc que pour des raisons artistiques ou esthtiques (CC 14 mai 1991 : retrait/repentir pour des raisons financires rejet).
Section 2 : Droit moral posthume 1 Droit moral est perptuel Qui peut exercer le droit moral en cas de successions vacantes ? A la mort de lauteur le droit moral se transforme par les faits de la morte de lauteur. Du vivant de ce dernier est un droit goste. Droit nest pas fait pour satisfaire les intrts de lauteur lui-mme. Don qui doit tre exerc dans lintrt dun tiers). Il faut organiser un contrle sur lexercice du droit moral. Prrogatives du droit moral sont pepertuelles sauf a le droit de retrait et de repentir. Art L121-12 traitent des hritiers pour le droit au respect et dun ordre au droit de divulgation. On trouve les descendants au premier rang, la dvolution nest pas bloque la 1re gnration. Puis cet article dsigne le conjoint : il ne faut pas de remariage aprs le dcs de lauteur. Pour droit de divulgation, en labsence denfant transfre de droit au conjoint sil ne se remarie pas. Puis il y a les hritiers autres que les descendants (pre et mre, frres et surs) : sils ont accepter le reste de la succession. Pour les descendants la condition nexiste pas. Dans le 3me ordre il faut quils aient recueillis tout.
Cas de labsence de successibles Les successibles disparaissent avec lcoulement du temps, la quest ion se pose surtout pour le droit au respect. Qui peut exercer ce droit alors quil ny ait plus personne qui peut se rattacher par un lien successoral lauteur ? On a 2 associations qui peuvent exercer le droit au respect : socit des gens de lettre (SDGL) fonde par V. Hugo dont la fonction est de propag et dfendre la langue et la culture franaise, centre national du livre (CNL) rattach au ministre de la culture ce centre a dans ses statuts la fonction de veiller au respect du droit moral mme aprs la mort de lauteur et mme aprs la chute de luvre dans le domaine publique. Le droit dagir pour ces organismes est difficilement admis par la JP. Organismes ne peuvent agir que en cas de dserrance. TGI de Paris du 5 mars 1997. Organismes peuvent agir dans certains cas (affaire des liaisons dangereuse et CA de Paris 14 juin 1972 affaire Le bossu) la JP a dni le droit dagir en justice pour la dfense du droit moral. Largument est que la dfense du droit au respect dans une affaire particulier mettant en cause le droit au respect dun auteur nest p as la dfense dun intrt pro. Or il rsulte de la loi (art L331-1 indice 2 CPI) que les associations nont vocation que pour agir pour la dfense des intrts de la profession. Cette attitude des tribunaux sest modifie dans laffaire de la suite des Misrables (CA de Paris du 31 mai 2004 et CC 1re civile du 30 janvier 2007), la socit
Droit de la proprit intellectuelle
20
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
des gens de lettre est intervenue au ct de Pierre Hugo pour dfendre les intrts des auteurs. Son intervention a t juge recevable par la CA de paris et la CC : elle nexerait pas le droit moral titre personnel mais entendait protester contre la pratique des suites douvrages romanesques susceptible davoir des rpercussions sur les intrts de ses membres. 2 Droit fonction Contrle de lexercice du droit moral. Ce nest plus un droit absolu par consquent il doit pouvoir tre contrl, le contrle de lexercice nest prvu que pour le droit de divulgation (art L121 -3). Il ny a donc pas de contrle de lexercice du droit au respect. Ce contrle a t tendu par la loi de 1985 au contrle du droit dexploitation (art L122-9). Quest ce que prvoit cet article pour le contrle de la divulgation ? En cas dabus de droit dans lusage ou le non usage du droit de divulgation (ou dexploitation) les tribunaux peuvent prendre toutes mesures appropries. Ils peuvent tre saisis notamment par le ministre de la culture. Ds lors qui peut agir ? Et il faut dfinir la notion dabus de droit. A) Qui peut agir ? On sait que le ministre de la culture peut agir, il a agit notamment dans laffaire du peintre FOUJITA (CA de Versailles 3 mars 1987 et CC 28 fvrier 1989), affaire pendante au vote de la loi de 2005. Pendant la discussion de la loi le ministre Jack Lang tait au courant de cette affaire et du fait quil devait prendre partie. Des diteurs de livre dart voulaient publier un ouvrage de rfrence pour les uvres de FOUJITA dont la veuve sopposait la publication de cet ouvrage de toutes ses forces. Il ntait pas question proprement parler du droit de divulgation. Il tait davantage question de divulgation sur un autre mode ou tout simplement de droit dexploitation. Jack Lang linitiative de la modification de la loi de 1957 a inclus dans la loi de 1985 labus notoire du droit dexploitation. La JP donne des ex de personnes pouvant agir : lditeur de lauteur dfunt peut agir (affaire MONTHERLANT : dition des correspondances de Montherlant Tribunal de Paris 1982, affaire Antonin Artaud cour de paris dcembre 1997 rejet par CC le 24 octobre 2000). Les autres hritiers peuvent agir (13 septembre 1979 : uvres de Marguerite Duras). Est aussi admis agir un des co-titulaires du droit de divulgation (CC 3 novembre 2004 sagissant des papiers dun explorateur). B) Conditions de laction Action possible en cas dabus notoire selon les textes. Dfinition selon langage courant de labus notoire : abus dont lexistence ne suppose aucune discussion. Il y a dans les arrts prcits, il y a abus notoire quand le titulaire du droit de divulgation viole une volont certaine et dlibre de lauteur soit dans un sens soit dans lautre.
Droit de la proprit intellectuelle
21
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Dans les arrts FOUJITA et Antonin Artaud, les tribunaux analysent la volont des auteurs, ils voulaient un grand rayonnement et donc voulait la publication. La personne qui sopposait la publication tait coupable dabus notoire. Artaud a sign un contrat ddition pour ses uvres compltes, sa mort la question se pose pour le droit du cocontractant et de ses hritiers. Un des petits enfants sest oppose la communication des uvres compltes. Quand lauteur na pas pris position, ou quand il a tout le temps changer davis sagissant de la publication de ses uvres de son vivant et quil dcde, on ne peut pas prsum quil ait accept ou non. Le TGI analyse la volont de MONTHERLAND : il a toujours chang davis sur la publication de sa correspondance. Ds lors il ny a pas dabus notoire. Mme chose pour lexplorateur, sagit de la publication de papier dexplorateur : aucune volont de publier de prime abord.
Chapitre 2 : Droits patrimoniaux Composante : droit dexploitation distinguer du droit de suite. Il y a un droit de reproduction et un droit de reprsentant, cession pour des raisons historiques (lois rvolutionnaires). Caractres de ce droit : ce sont des droits exclusifs puisquil naisse sur la tte de lauteur et ils sont gouverns par une divulgation. Cest un droit cessible, contrat possible sur le droit dexploitation mais pas sur le droit de suite. Ce son des droits limits dans le temps (70 ans aprs la mort).
Section 1 : Contenu de ce droit 1) Droit de reproduction Cest le droit exclusif appartenant lauteur dautoriser ou dinterdire la reproduction de son uvre. Et den tirer une rmunration. La reproduction sest faire figurer cette uvre sur un support matriel. Toute initiative dun tiers consistant faire figurer luvre sur un support matriel mme sur un exemplaire est considre comme reproduction. Laccs luvre par lintermdiaire dun support matriel est une reproduction. Corollaire : droit dadaptation et droit de traduction. Ces droits sont en gnral cds en mme temps que le droit de reproduction. Le tiers doit demander lautorisation de lauteur chaque reproduction et lui v erser une redevance. En droit franais les redevances verses aux auteurs sappellent des droits dauteurs. Le terme de copyright ou royalties nexiste pas en droit franais. Toute initiative prise par nimporte qui pour mettre luvre la disposition d es autres sous forme de support est considre comme une reproduction. Lintrt cest quil y a des exceptions nombreuses. Ce sont ces exceptions qui posent problme.
Droit de la proprit intellectuelle
22
Prise de notes M1 2009-2010
2 Exceptions au droit de reproduction
http://zarow.kazeo.com
a- Principe gnral Les exceptions figurent l'article L 122-5, il contient de nombreuses exceptions qui concernent le droit de reproduction, le droit de reprsentation ou les deux. Toutes les exceptions sont soumises un principe gnral qui est celui de l'interprtation restrictive, pour bnficier de l'exception il faut se placer exactement dans la circonstance et les conditions d'application vises par le texte. Elles doivent galement satisfaire le test en 3 tapes, mme si l'exception est prvue par un texte, le tribunal doit vrifier que le cas particulier l'exception dont se prvaut est conforme trois conditions que l'on retrouve dans la directive droit d'auteur dans la socit de l'information, d'abord les exceptions doivent tre limites certains cas spciaux, ensuite l'exception ne doit pas porter atteinte l'exploitation normale de l'uvre protge, enfin l'exception ne doit pas causer un prjudice injustifi aux ayant droits. b- Question de la copie prive Art. L 122-5 2me, lorsque l'uvre a t divulgue l'auteur ne peut interdire les copies ou reproduction strictement rserves l'usage prive du copiste et non destine une utilisation collective. Pour rentre dans le cadre de l'exception, il faut runir trois conditions cumulatives: - La copie doit tre ralise par le copiste lui-mme - Elle doit tre rserve son usage priv - Elle ne doit pas tre utilise de manire collective La Cour de Cassation a t confronte la question de la dfinition du copiste cet gard elle a rendu un arrt le 7 mars 1984, plusieurs diteurs d'ouvrages scientifiques ont mandat une personne qui sous contrle d'un huissier photocopi l'intgralit d'ouvrages scientifiques, les diteurs ont fait un procs l'officine de photocopies en disant qu'on tait pas dans le cadre de la copie prive car la copie avait t faite par une personne et qu'elle n'avait pas t faite pour l'usage prive de cette personne. La Cour de Cassation a dit que dans le cas de l'espce le copiste est celui qui dtenant dans ces locaux le matriel ncessaire la conception de photocopies exploite ce matriel en le mettant la disposition de ces clients. Le copiste ici est l'officine de photocopies et on le dissocie de l'utilisateur de la copie. A priori cet arrt est curieux, mais depuis 1984 ce motif est reproduit dans les affaires de copies prives. La Cour de Cassation a entendu obliger verser des droits d'auteur ceux qui font commerce de l'exploitation d'uvres protgs sans payer de droits d'auteur. c- La question de la copie des uvres musicales En 1985, les producteurs de disque et de films ont mis en avant que la copie prive tait devenue un nouveau mode d'exploitation. Le lgislateur a instaur la rmunration pour copie prive qui est une taxe qui assise sur le support d'enregistrement vierge et rmunrant les artistes, producteurs ou diteurs, elle est paye par le fabricant ou l'importateur au forfait.
Droit de la proprit intellectuelle
23
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Tout internaute qui veut copier une uvre par un systme Peer to Peer met disposition ses propres fichiers, si on analyse ce systme celui qui se raccorde au systme reproduit destination du public les uvres qui figurent dans ces fichiers et ce sans autorisation. Celui qui va chercher un fichier va profiter de la contrefaon en connaissance de cause est un receleur de contrefaon. La contrefaon est punie de 4 ans d'emprisonnement et de 400 000 d'amende, face ce phnomne les tribunaux ont intent des poursuites au hasard ce qui a entrain une application anarchique et injuste de la loi due au hasard, une inadquation de la rponse pnale et l'incomprhension du corps social. Dans la loi DADVSI, il tait prvu de responsabiliser les auteurs de logiciels Peer to Peer (L 335-1-3), le lgislateur a essay un systme de riposte gradue censur par le Conseil Constitutionnel (DC 27 juillet 2006). La loi du 12 juin 2009 s'est engag dans un nouveau systme de riposte gradue diligente par une autorit administrative HADOPI, qui est censur de nouveau par le Conseil Constitutionnel (DC 10 juin 2009) en raison du fait qu'une sanction pnale ne peut tre prononce par une autorit administrative. Cette loi a t rexamine le 28 octobre 2009, relative la protection pnale de la PLA sur internet (HADOPI 2). Cette loi est d'application immdiate et se concentre sur le FAI et le titulaire de l'accs qui est considr comme gardien de la connexion, elle met en place le systme de riposte gradue et la mission d'HADOPI est d'adresser des avertissements aux abonns pour leur signaler qu'ils ont raliss des copies non autorises. La suspension de l'accs ne peut pas tre prononce par l'HADOPI et doit tre prononce par une autorit pnale. 3 Le droit de reprsentation. 1- Principe Reprsenter une uvre (L122-2) c'est communiquer l'uvre directement au public sans l'intermdiaire de support matriel, par tout type de moyen ou mthode. Le droit de reprsentation est le droit exclusif appartenant l'auteur d'autoriser ou d'interdire la communication directe de l'uvre au public et la perception cette occasion d'une rmunration. Cette rmunration peut tre unique ou plurale, et peut donner lieu plusieurs versements de droits d'auteur. Pour un concert, cette initiative peut toucher plusieurs publics ceux qui sont au concert, ceux pour qui le concert est diffus par des moyens de tlvision, si un htelier prend l'initiative de diffuser l'mission dans ces salons il devra payer une redevance soumise. Donc chaque fois qu'un oprateur prend une initiative de reprsenter une uvre pour un autre public il devra verser une redevance. On peut se demander ce qu'il se passe dans les chambres d'htel, pour balancer l'initiative qu'il a pris d'installer des tls ou des radios dans ces chambres. En autorisant la reprsentation audiovisuelle ou radiotlvise cela ne modifie pas le champ de l'autorisation car il autorise la rception dans une multitude de lieux privs, cf. 1re Civ. 23 novembre 1971 Htel Le Printemps, en revanche si l'htelier un systme de
Droit de la proprit intellectuelle
24
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
cblodistribution dans son htel, il doit payer une redevance (CA Paris 18 septembre 1974, Htel Hilton). 1re Civ. 6 avril 1994, arrt CNN, a partir de cet arrt la Cour de Cassation estime que l'ensemble des clients d'un htel bien que chacun occupe titre prive une chambre individuelle constitue un public auquel la direction de l'tablissement transmet des programmes de tlvision pour les besoins de son commerce exerant ainsi une initiative donnant prise au droit de reprsentation, cf. CJCE 7 dcembre 2006, Htel Raphael. 2- Exception (L 122-5 1re) Pour tre dans le cadre de l'exception, il faut que la reprsentation soit gratuite, prive et ralise dans le cercle de famille. Un cercle de famille ce n'est pas une runion de personne due au hasard, une runion de personne lie par une communaut d'intrts. Un cercle de famille est une runion de personnes lies par un lien de parent ou d'alliance ou par des liens d'amiti. C'est une exception au droit de reprsentation et pas au droit de reproduction. 4 Le droit de suite 1- Physionomie gnrale Le droit de suite t cre par une loi du 20 mai 1920, et a t repris l'article L.122-8. En 1920, il a t cre pour rpondre un besoin savoir que les auteurs d'uvres graphiques et plastiques ont peu d'occasions d'exercer les prrogatives classiques du droit d'auteur tant pour la reproduction que la reprsentation. De plus l'auteur d'un e uvre graphique et plastique est entirement lie la vente du support matriel or on constate que certaines uvres qui ont t vendues peu chres vont atteindre une grande valeur. C'est pourquoi en 1920, le droit de suite a t cre au bnfice des aut eurs d'uvres graphiques et plastiques, le lgislateur a assorti ce droit d'une condition d'incessibilit de son droit de suite qui ne peut tre l'objet d'un legs. 2- Rgime Le march de l'art a t hostile au droit de suite car il a longtemps t une particularit franaise. La directive du 27 septembre 2001 a tendu tous les tats membres le droit de suite, la transposition a modifi le fonctionnement du droit de suite. Le champ d'application a t largie quant aux uvres, en principe les uvres graphi ques et plastiques sont en un exemplaire, et la directive l'a tendue aux uvre originaux multiples (photographie 15, lithographie 45, bronze 9) et la loi s'applique aux exemplaires en quantit multiple excut par l'artiste lui mme ou sous sa responsabilit et ca exclut les originaux multiples aprs la mort de l'auteur. Le champ d'application a t largie quant aux ventes, avant le droit s'appliquait aux ventes aux enchres publiques ou par l'intermdiaire d'un commerant ce qui ncessitait un dcret d'application qui n'a jamais t pris, la responsabilit de l'tat a t engage (CE 9 avril 1993) et le droit de suite ne s'appliquait qu'aux ventes aux enchres publiques.
Droit de la proprit intellectuelle
25
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Le droit de suite s'applique toute vente aprs une premire cession faire par l'auteur ou ses ayant droits conditions qu'intervienne en temps que vendeur, acheteur ou intermdiaire un professionnel du march de l'art. Le droit de suite se calcule en pourcentage du prix de vente qui va revenir l'auteur ou ses ayant droits (avant la directive 3% partir de 750), le versement du droit de suite est la charge du vendeur et l'exercice du droit de suite est subordonn une dclaration d'intention de l'auteur ou de ses ayants droits (ADAGP: association des auteurs d'uvres graphiques et plastiques). La directive fixe un taux dgressif, pour les uvres les moins chres jusqu' 50000 (4%), entre 50 000 et 200 000 (3%), entre 200 000 et 350 000 (1%), entre 350 000 et 500 000 (0,5%) et 0,25% pour les uvres dont le prix excde 500 000 et plafonn 12500. 5 Droit patrimonial posthume A) Droit dexploitation 1) uvres publis du vivant de lauteur. -Dure du droit : vie de lauteur + 70 ans. Pour certaines uvres on ne compte pas partir du dcs de lauteur. -Titulaire du droit : art L123-1 ayants droit de lauteur et les cessionnaires de lauteur et ses cessionnaires. CS a un usufruit spcial sur le droit dexploitation condition quil ne soit ni divorc ni spar, et quil ne se soit pas remari aprs le dcs de lauteur. 2) uvres posthumes Art L123-4 Si luvre posthume est publie pendant la dure du monopole, les titulaires seront les ayants droits. La dure de protection sera le temps restant entre la date de publication et la chute de luvre dans le domaine public. Si luvre est publie aprs lextinction du monopole. Le droit dexploitation appartient au propritaire du support. Dure de 25 ans compter de la publication B) droit de suite Cest un droit incessible mme aprs le dcs de lauteur (pas de legs). Transfert par dvolution lgale seulement. Section 2 : mise en uvre du patrimoine. Avant la loi de 1957 les contrats dexploitation du droit dauteur ntaient soumis aucune rgle particulire. Le lgislateur sest rendu compte quen matire de droits dauteurs les contractants taient de poids co diffrents. Lauteur tait peu au courant des subtilits juridiques.
Droit de la proprit intellectuelle
26
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
En 1957, modification du lgislateur. Il entoure les contrats dexploitation du droit dauteur de rgles impratives de droit public destine protger lauteur (partie faible du contrat). Rgles assorties dune nullit relative. 1 Conclusion du contrat Srie de conditions de forme et de fonds. A) Conditions de forme + Exigence du consentement personnel de lauteur (art L132-7). La condition sapplique tous les contrats dexploitation du droit dauteur. On veut sassurer de la ralit de la dcision de divulgation. Cette exigence sapplique tous les auteurs mme aux incapables. Le fait mme de conclure le contrat ncessite lintervention personnelle. + Exigence dun crit (art L131-2). Tous les contrats doivent tre constats par crit, il sagit donc dune rgle de preuve et non de forme. Les contrats dexploitation du droit dauteur ne peuvent qutre prouv par crit (contrat de cession du droit dadaptation audiovisuelle art L131-3, contrat ddition, contrat de reprsentation, contrat de production). En 1985 la pratique tait que le droit dadaptation audio visuelle tait cd en mme temps que le droit ddition, les auteurs ne faisaient pas attention ce quils signaient. La cession du droit dadaptation audio visuelle doit tre faites dans un contrat spar de celui ddition. Cette disposition qui exige un crit est drogatoire au droit commun de la preuve, linter prtation sera restrictive (seuls la preuve des contrats viss par le texte doit tre vise par crit). Ces contrats sont des contrats mixtes car ils unissent un auteur (non commerant) avec un exploitant qui lui est commerant. La personne prive a la libert de la preuve contre le commerant ds lors. B) Conditions de fond Art L131-1 : interdiction de la cession globale des uvres futures. On veut protger lauteur contre la tentation quil aurait de cder une fois pour toute un seul exploitant la total it de sa production future. Interprtation dlicate, car il est frquent que lauteur cde des uvres qui ne sont pas encore ralises. La doctrine a prsente plusieurs interprtations de cette cession. Interprtation exgtique : la prohibition de cet art sapplique ds lors que la cession porte sur toutes les uvres venir de lauteur et sur tous les droits sur ces uvres. Linterprtation doit tre rejete car elle donne peu dimpact cet article. Linterprtation extensive soutient que lart L131-1 condamne toute cession partir du moment o elle porte au moins sur 2 uvres non identifies dans le contrat. Linterprtation mdiane veut quil y a cession des uvres futur ds lors quil ny a pas de limite temporelle et pas de limite dans le nombre duvres. Le lgislateur a pos une exception linterdiction de la cession globale des uvres futures, il sagit de lart L132 -4 qui intresse la clause de prfrence des diteurs (mnag un diteur qui a pris un risque en publiant un auteur inconnu une faveur pour le risque pris en lui donnant la possibilit davoir une priorit sur la publication des uvres futures. Mais ce droit de prfrence est limit pour chaque genre soit 5 ouvrages nouveaux soit la production de lauteur pendant 5
Droit de la proprit intellectuelle
27
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
ans. JP abondante en la matire notamment pour dfinir la notion de genre. Cette clause de prfrence se rachte. 2 Excution du contrat Les obligations de lexploitant sont au nombre de deux. A) Obligation dexploiter Il contracte vis--vis de lauteur lobligation de mettre en uvre le droit qui lui a t cd. Cela figure dans la partie du code traitant de ldition (art L132 -1). En gnral lauteur contracte pour que son uvre soit diffus auprs du public, la mission de lexploitant est de diffus luvre dans le publique. La rmunration de lauteur est fonction du nombre dexemplaires vendus, place de thtre ou cinma vendu. La rmunration dpend du niveau dexploitation. B) Obligation de verser une rmunration lauteur. Ce sont des droits dauteurs et non des royalties. Sagissant de cette rmunration il y a le principe et lexception. Le principe est nonc lart L132-5 CPI, rmunration proportionnelle : pourcentage du prix de vente de luvre ou plus exactement du prix pay par le public pour avoir accs luvre. Cela soppose la rmunration forfaitaire. Pour protger lauteur de la cession contre un forfait, le lgislateur rejette le systme du forfait. Quand le public paye un prix pour avoir communication dune uvre, la rmunration verse lauteur est proportionnelle ce prix. La difficult est que le lgislateur quand il choisit la rmunration proportionnelle donne lassiette de la rmunration mais il ne choisit pas le quantum. Dune faon gnrale la moyenne est de 7 et 10% du prix HT du livre. Si bien que dans certains cas quand le quantum est trop faible on utilise les rgles de droit commun, notamment le droit de la vente. Le lgislateur a prvue des hypothses assez larges o par exception on peut recourir au forfait. + Choix du forfait : art L131-4 permet le choix du forfait dans certaines hypothses. Au titre des exceptions on trouve que par exception le choix du forfait est autoris quand la base de calcul de la rmunration proportionnel ne peut pas pratiquement tre d termine. Il sagit de toutes les hypothses diffuses la TV, les droits sont vendus au forfait et la rmunration verse aux auteurs est faites sous forme de forfait. Par ailleurs, cest le cas pour les uvres publicitaires. Art L132-6 prvoit une liste duvres pour lesquelles par exception la rmunration proportionnelle, le forfait est autoris. Par exemple les ouvrages scientifiques, ditions de luxe, encyclopdie A linverse il y a des uvres peu cher produire avec une diffusion importante, ditions populaires bon march, album de coloriages Puis on a des annexes, accessoires, des uvres. Il sagit des prfaces, annotations, illustrations, traductions, livres de prires
Droit de la proprit intellectuelle
28
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
+ Rvision du forfait : le forfait peu tre disproportionn par rapport au profit ralis par lexploitant. En cas de succs inattendu le forfait peut aussi tre injuste. Art L131 -5 : action en rescision pour lsion, lsion au dtriment de lauteur de plus de 7/12 me. La diffrence avec le droit commun est que le dsquilibre peut tre une imprvision (dsquilibre en cours du contrat).
Droit de la proprit intellectuelle
29
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Titre 2 : La proprit industrielle
Partie 1 : La protection dun rsultat technique (droit des brevets dinvention)
1 Dfinitions On entre dans le domaine de la protection avec formalit, c'est--dire soumise lexigence dun dpt suivi dun enregistrement. Dpt devant lINPI qui est charg de dlivrer les titres de proprit industrielle la suite de la demande. Art L611-1 et suivant. Brevet dinvention : titre dlivr par les pouvoirs publics en loccurrence lINPI donnant son bnficiaire moyennant le respect dobligations un monopole dexploitation limit dans le temps (20 ans compter du dpt de la demande) le droit dexploiter une invention. Lobjet est une invention technologique, on a deux intrts contradictoires. Il sagit dune part celui de linventeur et dautre part celui de la socit. Linventeur veut garder le plus longtemps possible le secret de son invention afin davoir lexclusivit de la mise en uvre de linvention. Lintrt de la socit est daccder le plus rapidement possible la connaissance dlments ncessaires son progrs technologique. Le droit des brevets sest efforc de concilier ces 2 intrts. Do le rejet de la protection par le s ecret. Le droit franais nignore pas totalement la protection par le secret, on a une disposition pnale lart L621-1 du CPI qui punit la violation du secret de fabrique quand elle est ralise par un salari. Malgr les apparences la protection par le secret offre une protection limite car elle ne donne aucun monopole, elle permet juste de ragir contre la violation du secret. La loi ne punit pas dune faon gnrale la violation du secret mais seulement la violation de ce secret par un salari. Cela dit certains industriels prfrent cette voie notamment les parfumeurs. Ces derniers gardent le secret sur leur parfum et ne demande pas la protection du brevet car dans la procdure du droit de brevet il y a un moment ou linvention est libre du secret . La protection par le secret entrave la diffusion de la connaissance et donc lintrt gnral. Le droit des brevets essaye de combiner les intrts en donnant linventeur un monopole mais en contre partie en exigeant que la collectivit immdiatement la connaissance de linvention. La doctrine moderne considre que le brevet est un contrat entre lEtat et linventeur au terme duquel linventeur sengage faire connatre son invention au profit de la socit. LEtat lui assure un monopole pour une dure de 20 ans. 2 Sources Privilge : monopole dexploitation accord par le parlement avant. Dcret du 7 janvier 1791 : linventeur est considr comme propritaire de son invention un monopole dexploitation limit 15 ans sans examen pralable (pas de conditions) avec en
Droit de la proprit intellectuelle
30
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
contre partie pour linventeur une obligation dexploit linvention et une obligation den donner une description suffisante. Ce droit rvolutionnaire contenait des nouveauts comme lobligation dexploiter de linventeur, mais ce droit tait excessif car il considre linventeur comme propritaire mais surtout ce droit contenait le brevet dimportation qui donnait en France un brevet au premier qui importait en France une invention trangre. Modification par la loi du 5 juillet 1844 : maintient des solutions antrieures notamment labsence dexamen pralable mais aussi lobligation dexploiter et le caractre temporaire du monopole. Mais elle rompt avec lide du droit de proprit au profit dun monopole dexploitation. Rompt galement avec le brevet dimportation. Il y a une lacune, la dlivrance du brevet nest soumise aucun contrle administratif, notamment sur la nouveaut de linvention. Cela engendre une grande instabilit du droit du brevet. La dure des 15 ans est maintenue. Un dcret de 1939 fait passer le dlai 20 ans. Loi moderne du 2 janvier 1968 remplace la loi de 1844, avec une rforme importante avec une loi du 19 juillet 1978. Loi de 1968 instaure un examen pralable sur les conditions de brevetabilit. 3 Sagissant du droit international La protection limite un territoire est insuffisante car elle laisse libre les contre faons faites ltranger. Convention de Paris de 1882, repose sur les mmes principes que la convention de Berne : -association de lunioniste au national -droit de priorit : partir dun 1er dpt ralis dans un des EM, le dposant dispose dun dlai de 12 mois pour pratiquer le dpt dans les autres pays sans que le 1 er dpt soit considr comme dtruisant la nouveaut de linvention. Sur le plan europen il y a deux conventions. -Convention de Munich de 1973, cration dun systme europen de dlivrance des brevets. Aprs un dpt unique au greffe dune seule administration (office europen des brevets) dbouche sur un faisceau de brevets valable dans chacun des Etats signataires de cette convention. -Convention de Luxembourg 1975, sur le brevet communautaire, a serait un brevet communautaire de proprit industrielle. Ratification en France en 1977, elle entrera en vigueur quand elle sera ratifie par tous les EM. Dsaccords notamment sur lobligation de traduction du brevet dsaccord rgl, mais problme sur lharmonisation du contentieux et sur le cot du brevet.
Chapitre 1 : Linvention brevetable.
Une invention pour tre susceptible dun brevet doit prsenter trois caractres : -Etre nouvelle -Manifester une activit inventive -Etre susceptible dapplication industrielle.
Droit de la proprit intellectuelle
31
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Section 1 : La nouveaut Est nouveau ce qui nest pas antrioris. Cette exigence sexplique par la structure du droit des brevets, rcompense donne un inventeur car il donne la technique de quelque chose de nouveau. Il sagit dtudier les lments qui vont dtruire cette nouveaut : -Existence dune antriorit -Divulgation prmature (due linventeur lui-mme qui communique linvention au public) -Existence dune demande de brevet dpos par un tiers sur la mme invention (double brevetabilit). 1) Le dfaut de nouveaut A) Lexistence dune antriorit Cest tout pice ou document qui dmontre que linvention tait connue du public avant le dpt de la demande de brevet. En gnral cest tout simplement un brevet accord avant pour la mme invention. Cette antriorit pose 2 questions. Quelle est ltendue de lantriorit ? 1) Etendue de lantriorit Recherche de lantriorit par lINPI au moment du dpt de la demande est elle limite dans le temps ou lespace. On a deux systmes, par ex en droit allemand on considre les antriorits de moins de 100 ans. Les brevets anglais font lobjet dune recherche de brevet que sur le territoire du RU. En France il ny a ni de limite dans le temps ni dans lespace. Pour ltendue de lantriorit il ny aucune limite en France. 2) Caractres de lantriorit Ils sont au nombre de 3, numr lart L611-13 du CPI : -Antriorit doit tre publique : Lexploitation antrieure de linvention objet du brevet ne constitue pas lantriorit si elle a t ralise dans le secret. Linvention doit tre accessible au public. Le mode daccessibilit est indiffrent. Par exemple la divulgation par le biais dune confrence ou dun rapport par le biais dun article de presse, la communication de linvention par les ingnieurs dune socit tierce ou encore lenvoi de cette invention un sous-traitant quand il nest pas tenu au secret. La divulgation un tiers constitue une antriorit. Mais on se demande comment on va traiter le cas dun tiers lui-mme inventeur qui a ralis secrtement linvention avant la demande de brevet. On va donner au tiers un droit de possession personnelle antrieur (art L613-7 CPI). Ce droit permet au tiers qui a ralis dans le secret une invention analogue celle faisant lobjet de la demande de continuer dexploiter son invention concurremment
Droit de la proprit intellectuelle
32
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
avec le brevet sans tre considr comme contre facteur. Celui qui rclame ce droit doit apporter la preuve mais ralisation dans le secret do PROBATION DIABOLICA. Mais il existe lenveloppe soleau, celle-ci a t cre en 1914 : enveloppe qui est diffus par linpi, enveloppe scell par linpi et perfore. En cas de litige on ressort lenveloppe et on prouve par son contenu la teneur de linvention antrieure (40 000 enveloppes de ce genre lan dernier).
-Antriorit doit tre suffisante : Les lments qui ont t communiqus au public portant sur linvention doivent permettre un homme du mtier de raliser linvention.
-Antriorit doit tre totale : pour dtruire lantriorit on doit retrouver dans ce qui a t retrouv les lments composants linvention dans la mme forme, le mme annoncement, le mme fonctionnement, en vue du mme rsultat technique (CC cial 6 juin 2001, Cour de Paris 6 janvier 2006). Cette exigence est prsente car il existe des inventions de combinaison qui ne pourrait exister si leur antriorit pouvait tre dtruite quen prouvant quun des lments de la combinaison existaient dj. B) Divulgation prmature Communication de linvention ralise par linventeur lui-mme. Soit la suite dessai/exprimentation soit la suite dun dmarcha ge commercial. 1) Divulgation en cour dessai/exprimentation Souvent les inventeurs veulent tester leurs inventions, quel est le public auquel fait rfrence notamment lart L611-11 ? Est-ce que la divulgation a un public limit dtruit la nouveaut de l invention. Dans un 1er temps on sest intress au seuil, est ce quil y a un minimum de personne au del duquel on se trouverait en prsence dun publique. La transmission une personne ne dtruit pas le secret mais la transmission plusieurs dtruirait le secret. A partir de combien de personnes ? Trib fdral Suisse propos dun coussin chauffant, la divulgation de ce coussin 10 personnes constituait la divulgation au public. Alors que ce tribunal dcider que la livraison de 9 voitures ne dtruisait pas la nouveaut. Combien de personnes sont aptes la comprendre, partir de leur comprhension laptitude la raliser. Cour de Paris 6 juillet 1993 : le public sentend de toute personne non tenue au secret et qui la seule vue du produit sera en mesure de le comprendre. Et donc de le reproduire. Aptitude juridique du public : non tenu au secret (origine lgale ou contractuelle). Sont aussi tenus au secret les agents des services dexprimentation. Les tribunaux accordent une grande importance la faon dont le secret a t respect. Il nest pas suffisant que le secret ait t prescrit encore faut il quil ait t tenu. Aptitude scientifique .
Droit de la proprit intellectuelle
33
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Il faut rechercher quelle tait la composition du public destinataire de la rglementation. A partir du moment o il est apte, il doit pouvoir la raliser avec les informations qui lui ont t divulgue, donc la divulgation doit tre suffisamment prcise pour que le public puisse la reconstituer.
2) Question du dmarchage commercial Linventeur essaie de savoir comment a marche, il va galement essayer de tester le march pour savoir si son invention est notable. Car les frais engendr pour une demande de brevet sont importants et il estime parfois que le brevet trop cher ne lui apportera rien. Cest un peu illusoire, car cest une vision court terme. Linventeur va faire alors un dmarchage commercial sur son invention, en principe, si en faisant son dmarchage commercial, trs souvent ce dmarchage lieu lors de foires et de salon professionnel. Lintrt de ces foires est de communiquer au public des choses nouvelles donc des inventions. Le lgislateur avait la ncessit de maintenir la nouveaut de linvention qui risque dtre dtruite par ces salons mais il avait galement la ncessit de maintenir ces foires. Dans L 611-13 b : le lgislateur a prvu de manire drogatoire que la nouveaut nest pas dtruite si aprs communication de son invention dans une foire ou un salon, linventeur peut dposer une demande de brevet dans les 6 mois sans quon lui oppose que la nouveaut soit dtruite. C) lhypothse de la demande de brevet dpos par un tiers : question de la double brevetabilit Suppose que deux inventeurs explorant la mme voie dposent chacun une demande de brevet pour la mme invention dans un temps limit. En raison de ltat de la technique il y des priodes o on dira que linvention est dans laire exemple dans les annes 1903 1905, plus de 100 demandes de brevet pour les aroplanes. Comment le droit rsout ce type de problme quelle est lincidence sur la nouveaut de ces dpts de demande de brevet qui ont lieu dans un temps limit ? Dans la procdure doctroi dun brevet il y le dpt de la demande et ce dpt est obligatoirement publi dans les 18 mois. La distinction se fait entre le point de savoir si la premire demande est publie ou non au moment du dpt de la seconde. Si la premire est dj publie la date du dpt de la seconde il ny pas de problme car la nouveaut de la deuxime demande est dtruite par la publication de la premire. Si la premire demande nest pas encore dpose : Si la demande est toujours secrte, pourtant il serait de mauvaise politique juridique de donner deux brevets concurrents deux inventeurs diffrents sur deux inventions. Car dans le cas dune contrefaon on ne saurait pas qui attribuer les dommages et intrts.
Droit de la proprit intellectuelle
34
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
La loi prvoit alors en cas de cette concurrence une assimilation artificielle de la premire demande mme non encore publie ltat de la technique c'est--dire quon lassimile une brevetabilit. =>donc en cas de concurrence de demande. 2) Les effets de la nouveaut ON va classer les inventions brevetables selon lobjet auquel sapplique la nouveaut. Lancienne loi de 58 contenait une classification qui a disparu lors de la rforme de 78 mais reste utile pour savoir comment sorganisent les inventions brevetables. On classe les inventions brevetables en 4 catgories : A) linvention de produit Un produit nouveau est un projet matriel comportant des caractristiques qui ne se retrouvent pas dans les produits similaires antrieurs. Cela peut tre un corps chimique, jusque l inconnu exemple la dynamite, ou le tflon, ou encore un objet matriel exemple un saxophone. Lintrt est que lOn dit que le produit est protg en soi, ce qui veut dire que la contrefaon est ralise ds que l produit est fabriqu quel que soit le mode de fabrication. Le brevet de produit pose deux questions : 1) la distinction entre la fabrication dun produit qui est brevetable et la dcouverte dun produit qui nest pas brevetable Lorsquil sagit dune dcouverte exemple la dcouverte de la cellulose du bois car le produit existe dj. Par contre il pourra obtenir un brevet pour des applications particulires de la cellulose, comme avec le papier cellophane. La raison est que la dcouverte ne cre pas le produit. 2) la distinction entre le produit et le rsultat Rsultat fourni par le produit. Seul le produit nouveau est brevetable mais pas le rsultat auquel il parvient. B) linvention de procd Porte sur le procd de fabrication dun produit, ici le brevet est limit au procd qui fait lobjet de linvention. Trs souvent le procd en question est un procd de fabrication dun produit qui lui mme est dj brevet, un inventeur qui invente un produit nouveau le fait trs souvent de faon empirique, c'est--dire que le procd de fabrication est susceptible damlioration et un autre inventeur va mettre au point un meilleur procd de fabrication.
Droit de la proprit intellectuelle
35
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Pour viter quil ne soit ainsi doubl par un autre, linventeur est protg pour tout le produit et tout le modes de fabrication du produit donc en principe, le deuxime inventeur qui invente le meilleur procd ne va pas pouvoir dposer brevet le temps de la protection. Sauf -en cas dentente entre les deux inventeurs -si le second inventeur obtient dun juge un licence de dpendance ou une licence de perfectionnement C) linvention portant sur une application nouvelle de moyens connus Il sagit dutiliser pour la premire fois un moyen technique connu ou un produit connu pour en tirer un rsultat entirement nouveau ou qui jusqualors tait obtenu diffremment. Par exemple les sulfamides lorigine matire colorante, lorsquon a dcouvert quelles avaient des vertus antibiotiques. Il faut que le rsultat soit radicalement diffrent de ce que le produit ou le moyen permettait dobtenir jusqualors. En revanche si il sagit Dun emploi nouveau le rsultat auquel parvient linventeur ne compte pas : -exemple des roulettes, un inventeur a eu lide de mettre les roulette quon mettait sous les pianos, sous les fourneaux et il a demand de breveter cette pratique il a t dbout car il ne sagissait que dun emploi nouveau. Arrt de 1850 -Arrt 1882, qui concerne la peinture phosphorescente, un inventeur a demand un brevet le fait denduire les aiguilles dune montre dune peinture on la rembarr sec. D) linvention portant sur la combinaison nouvelle de moyens connus Invention de groupements ou inventions de combinaisons. Il ne sagit plus de prendre un moyen ou un produit isol, mais de combiner plusieurs moyens pour leur faire produire un effet particulier. Ce sont les inventions les plus courantes, car le technicien qui rencontre un problme nouveau, il va chercher alors si il peut combiner les diffrentes ressources dont il dispose pour essayer de rsoudre le problme. Si on na rien dans nos ressources, alors on invente. Ces inventions sont les plus courantes, il va falloir faire une distinction entre la combinaison de moyen qui est brevetable et la juxtaposition de moyen qui nest pas brevetable. Pour obtenir un brevet pour une invention de groupement ou de combinaison il faut que les moyens mis en uvre cooprent en vue dune rsultat commun diffrent de laddition des rsultats propres chacun de ces moyens. Exemple le crayon gomme, ce nest pas un invention de combinaison car chacun des moyens continu remplir leur fonction propre. Section 2 lactivit inventive
Droit de la proprit intellectuelle
36
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
L 612-14 qui dfinit lactivit inventive, condition introduite par la loi de 68 qui est la loi moderne sur les brevets dinvention et dveloppe ensuite en 78 qui a prcis les conditions de lactivit inventive afin de mettre la loi franaise avec les droits trangers. Les critres qui permettent de dgag lactivit inventive L 611-14 qui dispose quune invention est considre comme impliquant une activit inventive si pour un homme de mtier elle ne dcoule de manire vidente de ltat de la technique. A) labsence dvidence Dabord prendre une mthode subjective c'est--dire observer la dmarche de linventeur il y activit inventive lorsque linventeur a eu un clair de gnie. ON exclut les inventions ralises par chance ou par hasard. Mthode objective qui consiste comparer ltat de la technique avant linvention et ltat aprs linvention. On dira quil y activit inventive lorsque linvention fait dy raliser un progrs dans ltat de la technique. Donc deux mthodes opposes. Les tribunaux apprcient lactivit inventive en retenant un faisceau dindice et parmi ces indices on trouve la victoire sur un prjug rsultant sur ltat de la technique, c'est --dire que tout conduisait linventeur vers une certaine voie et il en a emprunt un autre exemple dans le domaine chimique. Tout le monde considrait comme un herbicide total et un inventeur a mis en lumire que contrairement ce que tout le monde croyait ctait un herbicide slectif. Autre lment la difficult vaincue, le mme inventeur a pratiqu des recherches et aucune de ces recherches nont abouti. Le fait que le chercheur soit all explorer un domaine qui lui tait tranger, rentre aussi en ligne de compte la dure plus ou moins longue des recherches. Enfin on va considrer le rsultat, est ce quil est surprenant, avantageux, soit en terme dconomie de temps soit de moyens ou de productivit. B) Qui est lhomme de mtier ? Cest lagent de rfrence, la personne lgard de qui linvention ne doit pas avoir t vidente. Cet homme du mtier a t dgag par la jurisprudence et a t introduite par la loi en 1978. Il sagit dun professionnel moyen normalement dot de la connaissance dans son mtier, ce nest donc pas un spcialiste, car plus on augmente la capacit de lhomme du mtier plus on lve le seuil de brevetabilit. Chambre commerciale, arrt du 17 dcembre 1995, lhomme du mtier est celui qui possde les connaissances normales de la technique en cause, et est capable laide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problme que se propose de rsoudre linvention.
Droit de la proprit intellectuelle
37
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Par cet arrt la Cour de Cassation se dtache, de la jurisprudence de loffice europen des brevets. C) Quest ce que lEtat de la technique ? En matire de nouveaut on assimile cet tat les demandes mme non publiques pout ltat de la technique on prend ici en compte on sen tien a ce qui a t rendu accessible au public. Section 3 lapplication industrielle La dfinition est donne dans larticle L 611-15 du code de proprit intellectuelle, une invention est susceptible dapplication industrielle si son objet peut tre fabriqu ou utilis dans tous genres dindustries y compris lagriculture. Cest une dfinition qui est trs librale, car on ne demande pas que linvention ait une application industrielle, il suffit quelle soit susceptible dapplication industrielle. Cette dfinition cela vise les objets qui peuvent tre fabriqus ou utiliss dans tout genre dindustrie ce mot tant compris de faon gnrique. Cette dfinition sert faire sortir du champ de la brevetabilit certains lments qui ne peuvent tre ni fabriqus ni utiliss industriellement. Donc tudier le critre de lapplication industrielle cest tudier les inventions exclues pour dfaut dapplication industrielles. L 611-10 2. 1 Les crations scientifiques Larticle L611-15 du CPI : une invention est susceptible dapplication industrielle qui son objet peut tre fabrique ou utilis dans tous genres dindustries y compris lagriculture. Cest une dfinition trs librale, on ne demande pas que linvention ait une application industrielle dfinie ; il suffit quelle soit susceptible dapplication industrielle. Cette dfinition vise les brevets de produits et de procds. Cette dfinition qui est donn dans larticle L611-15 du CPI sert faire sortir du champ de la brevetabilit certains lments qui ne peuvent tre ni fabriqus ni utiliss industriellement. Ces inventions sont numres larticle L611-10 2 du CPI. Pour tre brevetable linvention doit se concrtiser dans un objet. Linventi on ne concerne pas la science pure mais uniquement la science applique. Les thories scientifiques ne sont pas brevetables. Ex : La dcouverte de llectricit atmosphrique, cest une dcouverte scientifique non brevetable. En revanche, le paratonnerre parce quil se concrtise dans un objet est une invention brevetable. Les savants nont aucun moyen de protger leur dcouverte, part le secret qui est fragile. Certains ont pens protger les savants par un brevet de principe , ce projet na pu prendre corps. Les industriels ont mis en avant que ce projet tait dangereux et contre-productif. Il est difficile de savoir quel est exactement le principe scientifique qui a t mis en uvre. 2 Les crations ornementales
Droit de la proprit intellectuelle
38
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Larticle 611-10 2 b du CPI parle des crations esthtiques. Elles nont pas leur place dans le droit du brevet et sont protges par dautres systmes. Lorsquun objet prsente la fois un caractre technique et ornemental, peut-il cumuler ce mme objet ? Le problme est le risque du dtournement des crations esthtiques ? Le crateur va rechercher le protection la plus longue, celle du droit dauteur. La loi a prvu ce risque de dtournement. Larticle L511-8 CPI carte la protection des dessins et modles lorsque lobjet ou le pro duit a une apparence exclusivement impose par sa fonction technique. Le lgislateur a adopt un critre qui est celui de la multiplicit des formes. Lorsque plusieurs formes sont possibles pour obtenir le mme rsultat technique on considre que le crate ur de lobjet en choisissant une forme a fait un choix esthtique et en fonction de lexistence de ce choix lobjet peut tre la fois protg par le droit des brevets et par le droit des dessins et modles. A linverse, lorsquune seule forme est possible, cette forme est lie au rsultat industriel et seule la protection du droit des brevets peut sappliquer au produit. 3 Les plans, principes et mthodes dans lexercice de lactivit intellectuelle en matire de jeu ou dans le domaine des activits conomiques ainsi que les programmes dordinateurs A) Les plans, principes et mthodes Larticle L611-10 2c du CPI. Cest une nouvelle manifestation de ce que linvention doit avoir un caractre technique. Les mthodes de commercialisation, les ides publicitaires, les rgles dorganisations scientifiques du travail, les rgles comptables ou celles de gestions financires sont exclues de la brevetabilit malgr leur aspect utilitaire. En revanche, pourront tre brevets les moyens matriels concrets qui pe rmettent la mise en uvre de ces mthodes. Cela a t jug dans un arrt de la Cour de Paris du 13 dcembre 1990 propos de la construction dune usine visant remdier al fabrication en grande srie dobjets industriels. La conception dune usine visant remdier aux inconvnients classiques de la fabrication en grande srie de produits industriels nest pas exclue de la brevetabilit pur dfaut dapplication industrielle lorsquelle se concrtise par la structure particulire dun btiment. B) les programmes dordinateurs Les logiciels ont t inclus par la loi de 1985 dans lnumration des ouvrs protges des par le droit dauteur. Cest larticle L612-10 2 c du CPI qui exclu les logiciels parce quils ne satisfont pas lexigence de lapplication industrielle. La chambre commerciale dans un arrt d 28 mai 1975 Mobil Oil a prcis que minteraction de breveter les logiciels tait une interdiction gnral et quil ny a aucune raison de distinguer selon que le logiciel dbuche sur des infirmations ou sur des instructions donnes une machine. Un important correctif a t apport dans larticle L612-10 3 du CPIU mais il est si obscur quil ncessite une traduction. Cet article dispose que la brevetabilit des logiciels des programmes et logiciels dordinateur nest interdite que si la protection du droit des brevets nest rclam que pour le programme lui-mme. Les exclusions de brevetabilit ne concernent pas la machine (les ordinateurs) ni les crations obtenues grce lintervention dun ou p lusieurs logiciels : arrt de la Cour de Paris 15 juin 1981 Schlum Berger : un procd ne peut pas tre priv de brevetabilit pur le seul motif quune ou plusieurs de ses tapes sont ralises par un ordinateur devant tre command par un programme. Une rsolution contraire aboutirait
Droit de la proprit intellectuelle
39
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
exclure de la brevetabilit la plupart des inventions rcentes et dboucherait sur des rsultats aberrants sur le plan pratique . 4 Les prsentation dinformation Article L611-10 2 d du CPI. Cest une exclusion nouvelle introduite dans la loi des brevets en 1978 qui avait pour objectif de mettre la loi franaise en conformit avec la Convention de Munich sur le brevet europen. Sous couvert de la prsentation dinformation, il ne faut pas restreindre la brevetabilit aux objets qui prsentent des informons. Si on interprte de faon extensive les brevets de prsentation dinformation, on exclurait les objets comme un instrument de mesure ou dhorlogerie sous prtexte quils prsentent une informatif. Si la prsentation dinformation se rsout dans une mthode de caractre abstrait, elle nest pas brevetable. En revanch lorsquelle se concrtise dans un produit (instrument de mesure ou dispositif dhorlogerie) elle est brevetable sus rserve de la condition de nouveau t.
Chapitre 2 : Les restrictions la brevetabilit
Section 1 : Les interdictions de brevetabilit Ces interdictions intressent plusieurs types dinventions. 1 Les inventions dont la publication ou la mise en uvre seraient contraires lordre pu blic ou aux bonnes murs Cest larticle L611-17 du CPI. Cest une interdiction classique qui na reu quune seule application jurisprudentielle en 1981 dans un arrt sur une machine qui exploitait des jeux de hasard. 2 Le corps humain Linterdiction de breveter les lments du corps humain est issue de l article L611-18 du CPI lui-mme de la loi du 6 aot 2004 sur la biothique. Cette loi a pour objet de transposer une directive communautaire 0944 sur les inventions biotechnologiques. La difficult est que la loi de biothique transpose imparfaitement cette directive. Cest larticle L611-18 du CPI qui nonce le principe de la non brevetabilit du corps humain qui ressort de linterdiction des lments contraires lordre public. Il nonce aussi la non brevetabilit du gnome humain, il sera de toute faon non brevetable en raison du fait quil a le caractre dune dcouverte et non dune invention. Larticle L611-18 al.3 du CPI interdit le clonage et la modification gntique des tres humains. le c de cet article interdit lactivit marchande autour des embryons de ltre humain. Deux dispositions posent problme : article L611-18 al.2 et 3 d du CPI. Larticle 5 de la directive communautaire 0944 admet la brevetabilit dun lment du corps huma in partir du moment o il a t isol ou reproduit par des procds techniques. Elle spare llment biologique et le corps humain. Le raisonnement suivi par la directive est que dans le corps humain llment biologique en cause ne peut donner lieu a ucune invention, en revanche,
Droit de la proprit intellectuelle
40
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
lorsque cet lment est spar du corps humain il devient brevetable mme si sa structure est identique celle quil a dans le corps humain car il constitue de la matire biologique qui est le rsultat de procds techniques qui lont identifi, purifi, caractris et multiplier en dehors du corps humain. Larticle du CPI restreint la brevetabilit de cet lment biologique contrairement la directive. Dans cet article il est dit quun lment biologique existait ltat naturel dans un tre humain peut tre brevet dans la stricte mesure ncessaire la ralisation et lexploitation dune application industrielle particulire. Lalina 3 d traite de la brevetabilit des squences partielles de gnes humains. La directive nexcluait la brevetabilit des squences que dans leur environnement naturel (le corps humain), la loi franaise exclue totalement toute la brevetabilit des squences totales ou partielles de gnes. 3 les obtentions vgtales Les produits agricoles sont exclues du champ de la brevetabilit car ils sont exclus dune activit industrielle mais dune force naturelle bien que diriges par la main de lhomme. On assiste au dveloppement de lagriculture et de lhorticulture et la cration de catgories de plantes ou de semences qui prsente des caractres particuliers qui ne se trouve pas ltat naturel. On a cr un systme particulier aux articles L623-1 et suivants du CPI. Cest une loi du 11 juiN 1970 qui va donner aux obtentions vgtales assez proches du droit des brevets. Le crateur dune obtention vgtale nouvelle peut obtenir, aprs un dpt au comit de protection des obtentions vgtales, un titre de Proprit lui donnant un droit exclusif sur sa varit vgtale dune dre de 20 ans. 4 Les races animales Article L611-9 1 du CPI. Les animales sont des produits naturels vivants, leur brevetabilit est exclue pur des raisons tenants la technique des brevets et la morale pour ne pas encourager les manipulations gntiques. Cette interdiction de brevetabilit comporte une exception : elle ne concerne pas les inventions micro biologiques qui sont des produits infrieurs un micro comme des bactries, des levures, moisissures
Section 2 : Le rgime particulier du brevet de mdicaments Lindustrie pharmaceutique a une place particulire dans lindustrie car les frais occasionns par la recherche et la mise au point dun mdicament sont trs importants et on considre que la mise au point dun mdicament dure en moyenne 10 ans et que le produit auquel on aboutit cote en moyenne entre 100 et 150 millions d. Dautre part, si on naide pas lindustrie pharmaceutique par un systme dincitation la recherche on risque de la voir se sclroser et de voir lexploitation ancien plutt que de faire des efforts dans la mise au point de nouveaux mdicaments. Cest pourquoi les lois modernes carte lide que els mdicaments parce quils ont un but dIG ne sont pas exclus du droit des brevets. Au XIXme tout un courant excluait les mdicaments du droit des brevets.
Droit de la proprit intellectuelle
41
Prise de notes M1 2009-2010
1 La nouveaut du mdicament
http://zarow.kazeo.com
Particularit: question de l'application nouvelle d'un moyen connu. Un mdicament connu ayant certaines proprits curatives peut-il tre de nouveau brevet pour de nouvelles proprits curatives ? Cela n'est pas possible (art L611-11 al4). 3 raisons: raison pratique on ne peut pas admettre qu'un produit dont la composition est identique puisse tre librement fabriqu et couvert par un brevet en ce qu'il soignerait un certain type de maladie secret mdical mdecin prescrit des mdicaments sans indiquer la maladie dont souffre le patient. Les mdicaments st vendus sans indication de la maladie qu'il soigne si l'application nouvelle d'un moyen connu est admis, risque de faire sortir du domaine public un brevet qui y est dj tomb ou de faire augmenter la dure de protection. Jurisprudence est un peu plus nuance parce que l'OEB, Grande chbre des recours Pharmika 1984: a admis la brevetabilit condition que le mdicament, dans son utilisation nouvelle, prsente une modification de prsentation ou de dosage. CA de Paris 1991 Synthlabo: reprend la solution de la Grande chbre des recours. Application nouvelle suppose une modification de prsentation et de dosage. Chbre commercial 1993: casse l'arrt. Ms CA de Paris a maintenu sa dcision sans que la CCass soit saisie. 2 La dure de protection Dure de protection d'un brevet: 20 a compt du dpt de la demande. Pb avec les brevets de mdicament: pour tre mis sur le Ma, un mdicament doit avoir obtenu une autorisation de mise sur le Ma dlivre par le ministre de la sant consistant vrifier que le mdicament ne prsente pas des effets secondaires importants. Ms cette demande d'autorisation dtruit la nouveaut. Donc l'inventeur ne peut pas faire une demande d'autorisation avant d'avoir fait une demande de brevet. Et ensuite il ne pourra pas mettre son mdicament sur le Ma avant un certain temps assez long (temps des exprimentations au ministre de la sant). Cela ampute par consquence une partie de la dure de protection. EU en 1984 et Japon en 1986 ont allong la dure des brevets des mdicaments pour tenir compte de ce temps d'exprimentation. France a alors allong sa dure en 1990: certificat complmentaire de protection pour le mdicament. Puis la communaut europenne avec un rglement de 1992: c'est substitu la loi de 1990. A adopt la mme solution que la loi franaise certificat complmentaire de protection. Prend effet au terme de la protection de base pour une dure gale la priode coule entre la date du dpt de la demande et la date d'obtention de l'autorisation de mise sur le march. Ne saurait excder 5 ans.
Droit de la proprit intellectuelle
42
Prise de notes M1 2009-2010
Chapitre 3 le droit au brevet.
http://zarow.kazeo.com
Dans le droit de la proprit industrielle, la protection ne dcoule pas du seul fait de la cration. Dans ce systme, la protection ne du brevet cest dire de l'octroi d'un titre dlivr par les pouvoirs publics. L'invention ne fait natre aucun droit au profit de l'inventeur si ce n'est celui de dposer une demande de brevet et un petit droit la paternit (art L611-9). Pb va se poser lorsque l'inventeur est sous contrat avec des tiers. Qui a le droit de demander le brevet ? L'inventeur ou le tiers ? 3 cas: inventeur indpendant, inventeur sous contrat de recherche et inventeur salari. Section 1 : Linventeur indpendant Cas le plus simple ms aussi le plus rare: moins de 10% des inventions st ralises par des inventeurs indpendants. 2 questions peuvent tout de mme se poser. 1 Les inventions simultanes Priode dans l'histoire des sciences o une invention est dans l'air et o donc plusieurs inventeurs peuvent explorer la mme voie. Loi va devoir dcider quel inventeur elle va accorder le brevet. Art L-611-6: le dr au brevet appartient au premier dposant. Possible que le premier dposant est agi en fraude des droits de l'inventeur. Loi va devoir donc rgler la question de la spoliation de l'inventeur et le fait par une proc particulire l'action en revendication. 2 La spoliation de linventeur. Se peut que l'invention ait t soustraite par un tiers qui va faire une demande de brevet son nom. Possible action en revendication: art L611-8. Invention soustraite soit l'inventeur soit ses ayants-droits. Ou inventeur a demand un brevet son nom alors que ce droit appartenait son commanditaire ou son employeur. Revendication se prescrit par 3 ans. Si le demandeur est de bonne foi (bonne foi prsume), le dlai de 3 ans se dcompte compter de la publication de la dlivrance du brevet. Si le demandeur est de mauvaise fois, le dlai de 3 ans se dcompte compter de l'expiration du dlai de 20 ans. Si l'action en revendication russie, le spoli est subrog dans les droit du vritable titulaire du droit au brevet. Dans ce cas l, il va souffrir des vices qui entachent le brevet. Le spoliateur est considr comme contrefacteur l'gard du vritable brevet, donc les contrats de licence qu'il a accord doivent tre annuls et les prtentions doivent tre restitues. Section 2 : Linventeur sous contrat de recherche
Droit de la proprit intellectuelle
43
Prise de notes M1 2009-2010
1 La nature de lobligation du chercheur
http://zarow.kazeo.com
Pb de savoir si le chercheur est tenu l'gard de son cocontractant d'une obligation de moyen ou de rsultat. La mise au point d'une invention a toujours pour objet des prestations dont le rsultat est alatoire. Donc le contrat de recherche suppose une obligation de moyen et la non obtention du rsultat espr n'engage pas la responsabilit contractuelle de l'inventeur. Le tiers devra prouver la mauvaise excution des travaux par l'inventeur preuve difficile. 2 La question du sort des rsultats de la recherche Qui a le droit au brevet ? Clause prvoyant la mise dispo du commanditaire des rsultats de la recherche. Difficult est que cette clause ne prvoit pas toujours la possibilit pour le commanditaire de dposer une demande de brevet son nom. Lorsque la clause prvoit que le commanditaire pourra dposer une demande de brevet commanditaire a un droit contractuel au brevet. Si inventeur dpose une demande de brevet son nom, il sera considr comme spoliateur, donc possible action en revendication remettant en cause sa responsabilit contractuelle. Savoir-faire protg par le secret. Donc commanditaire l'est aussi. Chercheur a une obligation de faire communiquer les rsultats de la recherche son cocontractant + fournir ventuellement une assistance technique. A aussi une obligation de ne pas faire ne pas communiquer aux tiers les rsultats de la recherche. Dr punit la violation du secret: art L621-1 violation du secret de fabrication qui est une infraction pnale. Champ d'application limit car concerne que la violation par les salaris de l'entreprise. Section 3 : Linventeur salari Plus de 80% des inventions sont issues d'inventeur salari. Art L611-7: loi de 1978. Av 1978, cette question tait traite uniquement par la jurisprudence. Elle rpartissait les inventions selon une division tripartite: l'invention de service issue de recherches ordonnes par l'employeur, lequel avait pris en compte le risque de recherches infructueuses et cette invention lui appartenait donc. l'invention occasionnelle (invention mixte) invention intressant l'entreprise ms qui est le fruit d'un salari auquel aucun ordre de recherches n'a t donn. Arrt CA de Paris 1874 Socit vieille Montagne: ces inventions appartiennent aux salaris. Ms ralit peut tre plus complexe cest dire que dans certains cas, le salar i peut s'ouvrir de son projet son employeur et obtenir l'encouragement et des moyens de l'employeur pour mettre au point l'invention. Dans ce cas l, la jurisprudence considre que l'invention appartient en coproprit au salari et l'employeur car c'est le fruit d'un effort commun. l'invention libre compltement trangre l'activit de l'entreprise. Appartient
Droit de la proprit intellectuelle
44
Prise de notes M1 2009-2010
alors entirement au salari.
http://zarow.kazeo.com
Loi de 1978 va faire une simple division bipartite: inventions occasionnelles ont t considrs comme provocatrices de litiges. Par consquence disparition. Ms les inventions libres ont tendance se diviser en deux catg. Rgime suppltif ne s'applique qu' partir du moment o dans le contrat de travail il n'y a pas de dispos particulires plus favorables au salari. 1 Les diffrentes catgories dinventions de salaris Art L611-7 du CPI I. Les inventions de mission Majorit des inventions de salaris. A) Domaine Deux catgories 1) Les inventions de missions permanentes Les inventions de mission permanente sont ralises dans l'excution d'un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant aux fonctions du salari. La mission inventive: il faut la rechercher dans les fonctions du salari ou dans la description du contrat de travail. Fonctions effectives du salari: lorsque l'excution du contrat de travail s'tale sur une longue dure, peut exister des cas o il y a une volution des fonctions du salari sans modification du contrat de travail. Faudra donc dterminer qu'elles taient les fonctions du salari au moment de l'invention. En excution de la mission inventive. Jurisprudence n'exige pas que l'employeur est dirig ou confi directement une mission inventive son salari. 2) Les inventions personnelles Aucune mission inventive nest confie au salari dans le cadre de son contrat de travail mais mission inventive occasionnelle confie au salari. Inventions de mission appartiennent lemployeur quelle soit permanente ou occasionnelle = propritaire. Salari auteur dun e telle invention doit ncessairement jouir dune rmunration supplmentaire spcifique prvue par son contrat de travail ou convention collective. Peut tre forfaitaire ou au % du CA. B) Inventions hors missions L6 611-7 2 Toutes les autres inventions appartiennent au salari.
Droit de la proprit intellectuelle
45
Prise de notes M1 2009-2010
Inventions hors mission attribuables lemployeur
http://zarow.kazeo.com
Prennent l suite des inventions mixte avec un systme de coproprit abandonn au profit dun systme dattribution lemployeur. Il sagit des inventions faites par le salari au cours de ces fonctions dans lentreprise. - Inventions faites dans le domaine dactivit de lentreprise. Lemployeur peut se faire attribuer soit la proprit soit la jouissance de tout ou partie des droits attribues au brevet condition de verser au salari le juste prix de son invention.
Inventions hors missions dites libres attribuables au salari Invention ralise par le salari en dehors de son temps de travail et qui nintresse le domaine dactivit de lentreprise. 2 Procdures de classement Lgislation de 1978 : instaurer le dialogue entre le salari et lemployeur sagissant du classement dune invention Lettre recommand AR. A) Obligation du salari Quelque soit le domaine dans lequel intervient linvention, y compris dans le cadre dune mission, le salari doit en faire la dclaration auprs de son employeur. Doit faire une proposition de classement dans sa dclaration en recommand par AR. Imperfections de la procdure en ce que les salaris rechignent utiliser ce moyen. Problme de lemployeur qui a connaissance de linvention forclusion du dlai de laction en revendication (3 ans) ? Lacune = pas de sanctions prvues par le texte. Un dcret de 1984 pose que la procdure de dclaration par lettre AR peut tre remplace pour toutes les inventions, lexception des inventions de missions, par remise du double de la dclaration de linvention lINPI. B) Obligation de lemployeur. - Rpondre la dclaration du salari. La dclaration du salari ouvre lemployeur un dlai de 4 mois pendant lequel il va devoir prendre partie sur lopportunit de rclamer quelque chose sur linvention et sur lopportunit de classement. Peut aussi se dcomposer en 2 dlais de 2 mois. 1er dlai de 2 mois : lemployeur doit donner son avis sur le classement propos par le salari.
Droit de la proprit intellectuelle
46
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Dans le cas particuliers des inventions hors missions attribuables lemployeur lemployeur a un droit de revendiquer un droit sur le brevet pendant 4 mois. 3 Le contentieux du classement Il y a une particularit : il y a un contentieux mais presque jamais port devant les tribunaux car sagissant de deux oprateurs conomiques de poids diffrents, avec une menace de licenciement pour le salari. Dans certains pays trangers, le contentieux ntait pas soumis aux tribunaux ordinaires mais soumis une commission dont le rle tait de connatre des conflits des inventions de salaris. Dans ce cas l, le contentieux sest rveill. On a donc transpos cette ide en France et on a cr dans la loi de 1978 a Commission Nationale des Invention de Salaris (CNIS) : Art L 615-21 du CPI. Cette commission a vocation connaitre des droits du salari et de lemployeur sur les inventions. Son prsident est toujours un magistrat de lordre judiciaire, souvent le prsi dent de la 4me chambre de la Cour de cassation. Ce magistrats est entoure de deux assesseur choisit pour chaque affaire : un dans la liste des reprsentants des employeurs et une dans la liste des salaris. La saisine de la commission nest pas obligatoire mais dpend de la dcision dau moins un des parties. Les deux parties peuvent donc saccorder sur le choix dune procdure judiciaire, ou prfrer larbitrage ordinaire. Mais si une des parties saisit la commission et lautre le tribunal, alors le tribunal doit surseoir statuer jusquau jugement de la commission.
Droit de la proprit intellectuelle
47
Prise de notes M1 2009-2010
Chapitre 4 : Lattribution du brevet
http://zarow.kazeo.com
Cela consiste connaitre des conditions administratives qui entourent lattribution du brevet. La procdure de dlivrance dun brevet se droule en deux phases : la premire est linitiative du demandeur (le dposant) et la deuxime est linitiative de ladministration. Section 1 : Le dpt de la demande 1 Les formalits du dpt O ? A lINPI, qui a son sige Paris. Tout dpt saccompagne du dpt dune taxe. Par qui ? Cest linventeur lui-mme : sil sagit dun inventeur indpendant, ou un salari qui a fait une invention libre. Donc celui qui a le droit de brevet, ou lemployeur. En ralit le dossier de dpt de brevet est complexe, don c il est rare que le dposant nest pas recours un professionnel : lingnieur conseil en proprit industrielle. Comment ? Quelle est sa forme ? En ralit le dossier de demande se compose de plusieurs documents qui sont tous obligatoire et doivent tre rdigs sous une forme particulire : Une requte rdige sur un formulaire spcial dlivr par lINPI
- Un mmoire descriptif de linvention : ce nest pas un document scientifique cest plutt un article de vulgarisation. Ce mmoire contient un certain nombre de dveloppement obligatoire : indication du secteur technique auquel appartient linvention. Ensuite, il expose ltat de la technique en soulignant linsuffisance des solutions existantes auxquelles linvention va apporter des solutions. Enfin on prsente linvention donc ton donne une description gnrale puis dtaille. Cette description doit tre suffisante pour quun homme de mtier laide des seuls renseignements de cette description puisse raliser cette invention, cette description peu saccompagner de dessin ou de plan. - Les revendications : il faut avoir affaire un professionnel. Celles-ci ont pour but de cerner ltendue du brevet. Ces revendications doivent tre claires et prcise : un lment qui est dcrit dans la description mais non revendiqu, nest pas brevet. 2 Les effets de la date du dpt En matire de brevet, la date du dpt est fix avec prcision, la seconde prs. Il y a deux raisons. A. La date permet de trancher le conflit entre deux inventeurs Cest le cas des inventions simultanes, le brevet est donn au premier dposant. B. Lorsque le brevet est accord il rtroagit au jour du dpt de la demande Cela entrane deux consquences :
Droit de la proprit intellectuelle
48
Prise de notes M1 2009-2010
-
http://zarow.kazeo.com
Pour les poursuite en contrefaons : qui peuvent exerc pour des faits qui se situent entre le jour du dpt et le jour de la dlivrance effective du brevet. Selon les cas, ce laps de temps peut tre assez long. Pour mnager les droits des tiers, il est prvu que la demande de brevet dpos, doit tre publie sous forme de demande dans les 18 mois du dpt. Consquences fiscale : pour entretenir son brevet, le brevet doit payer une taxe.
Section 2 : La phase de dlivrance du brevet En thorie il y a trois systmes : - Le systme du simple enregistrement : cest celui qui existait sous lancienne loi de 1844 : sans garantie du gouvernement. Dans ce systme ladministration se borne enregistrer les titres et elle na pas pour mission de faire des recherches sur les conditions de brevetabilits. Il y a donc une grande instabilit des titres qui peuvent tre remis en cause devant les tribunaux dans un conflit, en loccurrence lors de contrefaons. Cela a aboutit une infriorit du titre dlivr par lautorit publique sur le titre tranger. Le systme de lexamen pralable : adopt en particulier dans les pays anglosaxons. Dans ce systme, le brevet nest dlivr quaprs que ladministration est vrifi que linvention remplies toutes les conditions de brevetabilit. Cela prsente une grande scurit pour le titre, mais linconvnient est que cest long et trs couteux et peut donc retarder loctroie du brevet, La dure moyenne est de 6ans. De plus on peut refuser si on ne comprend pas Le systme de lexamen diffr : dans ce systme, le brevet est publi au terme dun dlai secret de 18 mois. Ce qui est publi, cest le dossier de demande de brevet. Cette publication dbouche sur une protection partielle du demandeur vis--vis des tiers. La plnitude des droits ne sera acquise quaprs la dlivrance du brevet. Mais pour lobtenir, le dposant va devoir demander que linvention soit soumise lexamen pralable. La protection totale ne se fera que si le dposant demande lexamen pralable qui dbouchera sur un rapport de recherche. Lavantage de ce systme est quil sauvegarde le principe de lexamen pralable, donc il entretient la scurit du brevet, mais il permet au brevet de tester lintrt de son invention et son succs avant de demander cet examen pour lequel il devra payer des taxes assez lourdes. La dlivrance se fait en deux phase : un contrle administratif sur la demande et si le demandeur le requiert, la rdaction dun rapport de recherche et la dlivrance dun brevet.
3 Le droit de regard de la dfense nationale
Droit de la proprit intellectuelle
49
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Cest un pralable : Art L 612-9 et L 612-10 : plusieurs fois par semaine, des fonctionnaires du ministre de la dfense vont lINPI consulter les demandes de brevet et donc le mmoire descriptif de linvention. A laide de ces documents ils vont apprcier si ces inventions intressent la dfense nationale : 90 95 % des inventions sont cartes. Celles retenues sont mise au secret pendant un priode de 5 mois, qui peut tre prolong dune dure dun an lissu des 5 mois, ventuellement renouvelable. Mais lorsquil y a un allongement, le dposant a droit une indemnit, car pendant ce dlai de secret la procdure est bloque et donc toute exploitation est interdite au dposant. 4 Le contrle administratif sur la rgularit de la demande : Art L 612-12 A. Le contrle de la forme Les services de lINPI contrlent si la demande est correcte dans sa forme et sur le fond. Sur la forme : les services de lINPI vont rejeter la demande de brevet si elle ne se prsente pas dans les conditions requise : procdure de description, ou si linventeur nest pas dsign. Sil sagit dun brevet tranger, il doit tre traduit, rejet si les taxes de dpt nont pas t acquitt, lorsque la description ou les revendications en permettent pas un homme de mtier de raliser linvention. Le cout du brevet : il coute cher quand on pose un brevet europen : la traduction coute cher. On peut valuer le cout dun brevet europen 50.000. Pour le brevet franais, cest environ 4.000. B. Le contrle du fond IL y a deux raisons : - Si la demande porte sur invention manifestement non brevetable : c'est--dire une invention contraire lordre public, soit une obtention vgtale ou portant sur le corps humain ou les races animales. - Lorsque la demande de brevet porte sur un objet qui ne peut tre considr comme une invention ou insusceptible dadaptation industrielle. Le rejet de demande de brevet est susceptible de recours. Si elle est accepte elle est publie 18 mois au plus tard aprs la date de son dpt dans le bulletin officiel de la proprit industrielle. Cette publication au BOPI va dclencher la procdure dexamen et aussi le paiement de taxes qui correspondent cet examen. 5 Lobtention du brevet Il y a en ralit deux types de proprit industrielle : Un titre long : 20 ans cest le brevet. Il est dlivr aprs ltablissement dun rapport de recherche. Un titre court : 6 ans dont lobtention ne ncessite pas la dlivrance dun certificat de recherche mais dun certificat dutilit. Cest un titre qui offre une protection moindre. En ralit il existe des parcelles qui permettent de transformer une demande de brevet en une demande dutilit, quand le dposant en demande ou attends plus de 18 mois avant demander un rapport de recherche.
Droit de la proprit intellectuelle
50
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
A. La rdaction du projet de recherche : Le rapport de recherche prliminaire Cest lINPI avec laide de loffice europen des brevets vont tablir un projet dtablissement de recherche en tenant compte des information et des revendication dposes par le brevet. Ce projet a pour but de faire apparaitre des antriorits et dtudier ltat de la technique au moment ou le demandeur a mis au point son invention. Une fois rdig, le dposant peut lui-mme faire des observations. Lorsque le projet fait apparaitre un dfaut de nouveaut, le dposant a trois mois pour modifier ses revendications ou prsenter des observations sils maintient ses revendications antrieures. Si ces observations fallacieuses ou mal fonde, le directeur de lINPI rejette la demande de brevet. Ladministration na le pouvoir de la rejeter que lorsque le dfaut de nouveaut est manifeste. Sil y a simplement un doute sur la nouveaut, ladministration dlivrera un brevet et la nouveaut sera rejete devant les tribunaux judiciaires. B. La publication au BOPI Il est donc rendu public, les tiers peuvent donc prendre connaissance du projet de rapport de recherche et ventuellement formuler des observations. Les tiers ont 3 mois pour le faire, le dposant a galement 3 mois pour rpondre ses observations. C. Ltablissement du rapport de recherche dfinitif Cest ce rapport qui va dclencher automatiquement la dlivrance du brevet. Sil y a un doute sur la nouveaut ce sera aux juges judiciaires de statuer sur la nouveaut.
Chapitre 5 : Les consquences de lattribution du brevet
Section 1 : Les droits du brevet Le brevet est un titre dlivr par les pouvoirs publics, confrant au brevet un monopole dexploitation limit dans le temps et ayant un caractre territorial. 1 La dure du droit Cest 20 ans compter du dpt de la demande si le titre dlivr est un brevet et 6 ans si le dposant choisit la voie du certificat dutilit. Avec possibilit de parcelles. 2 La sphre gographique dapplication du droit Lattribution dune brevet est une manifestation du pouvoir tatique : chaque tat est libre de soumettre aux conditions quil estime ncessaire, la dlivrance des brevets sur son territoire. Puisque chaque tat est libre, cela dbouche sur le principe de la territorialit des brevets. Lorsquun dposant veut tre protg dans plusieurs tats, il do it faire autant de demande
Droit de la proprit intellectuelle
51
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
de brevet dans les tats dans lesquels il veut tre protg. Cela est handicapant, les conventions internationales ont essay calmer : Convention de Lunion de Paris de 1883 : sur la proprit industrielle qui institue pour les bnficiaire de la convention, un d lai de priorit qui leur permet pendant un ans partir dune premire demande de brevet dans un pays signataire, le dposant peut solliciter des brevets dans les autres pays sans quon lui oppose le dfaut de nouveaut, qui rsulterait du premier dpt. Les diffrents brevets dposs dans les diffrents pays sont indpendants les uns des autres. Les Etat membres de la communaut ont sign la convention de Munich de 1973, entr en application en France le 7 Octobre 1977, qui instaure un systme europen de dlivrance des brevets, qui suppose une procdure unique. Cette procdure va dclencher un faisceau de brevet valable dans chacun des pays de lUnion dsign par le dposant au moment de la dlivrance de la demande. 3 Le contenu du droit du brevet Linventeur a le droit dtre nomm inventeur dans le brevet, quelque soit le type de brevet concern. Le brevet se voit confrer un monopole dexploitation sur linvention brevet : les contours de ce monopole dexploitation sont dfinit dans les articles L 613-3 et suiv du CPI qui dterminent les prrogatives du brevet de faon ngatives : les actes interdit sans lautorisation du brevet. Quels sont ces actes ? La fabrication, utilisation, Vente, Dtention dun pro duit brevet Importer en France un produit brevet fabriquer ltranger - Livraison une personne autre que le brevet des moyens ncessaires la fabrication ou la mise en uvre dun produit ou dune invention brevet. Le monopole du brevet ainsi dfinit connait deux limites : - Art L 613-5 : savoir que le monopole du brevet ne couvre que lutilisation industrielle ou commerciale du produit brevet. Restent en dehors du monopole les actes dusage domestique ou exprimental. Ex : un autocuiseur, sil y aune contrefaon, si cest un htelier qui lutilise : contrefacteur ou un si cest un dmonstrateur sur un march : ne sera pas contrefacteur. Article L 613-6 : cest la thorie de lpuisement des droits : thorie lorigine communautaire introduit en droit franais. Cette thorie consiste qu partir du moment o un produit couvert par un brevet a t commercialis sur le territoire communautaire avec lautorisation du brevet. Le brevet perd tout droit de regard sur lusage que lutilisateur final peut faire de ce produit. Ainsi, toutes les interdictions ultrieures de commercialisation ne relvent que du droit des contrats ou de la concurrence mais pas du droit des brevets.
Le monopole du brevet sanalyse comme un bien qui rentre dans le patr imoine du brevet, et susceptible de tous les actes dapplication aux biens. Il peut tre vendu, mais on parle de
Droit de la proprit intellectuelle
52
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
cession de brevet . Il peut aussi faire lobjet dune location, mais on parlera de licence de brevet . Section 2 : Les obligations du brevet Il y a deux obligations principales : payer des annuits fiscales et exploiter linvention. 1 Lobligation dentretient du brevet A. Principe Pour entretenir son brevet, il doit payer chaque anne un taxe fiscale, dont la particularit est quelle augmentent avec lge du brevet. Pendant les 5 premires annes : 35 par an. Dans les 5 dernires annes : 600 Cest pour faire sortir du champs des brevet, faire tomber dans le domaine public, les brevet qui ne rapportent pas assez dargent pour courir les taxes dentretient. Il sont nombreux, sur 100 brevet accord, 1 rapporte beaucoup dargent, 9 qui procurent de largent, 2 couvrent les frais, 70 coutent de largent. Ces taxes doivent tre payes chaque anne, au plus tard le dernier jour du mois de la date anniversaire du brevet. Le brevet qui na pas pay ses taxe IL y aura un dlai de grce de 6 mois, pendant lesquels il pourra payer lindemnit chues. B. Sanction Cest la dchance : le brevet tombe dans le domaine public ? Cette dchance a une particularit car elle rtroagit au jour de lannuit aurait du normalement tre pay. Pourquoi la dchance rtroagit ? Cest pour viter que soit considr comme contrefacteur des industriels qui auraient exploit le brevet dans dlais de grces. [ ] 2 Lobligation dexploiter linvention En ralit cette obligation est fonde sur une considration dintrt national : lEtat accepte de donner un monopole dexploitation sur une invention pour rcompenser linventeur et aussi pour que le pays profite immdiatement des avantages procurs par linvention. Cest un contrat entre lEtat linventeur : ltat permet linventeur dexploiter de manire exclusive linvention pendant 20 ans, en contrepartie linventeur sengage faire profiter immdiatement la socit. La licence lgale : est une licence de brevet il ya deux types de licence: . Licence obligatoire octroyait par lautorit judiciaire .Licence doffice : confr par lautorit administrative
A. Les licences obligatoires
Droit de la proprit intellectuelle
53
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Il y a un rgime gnral et un particulier pour les licences de dpendance : pour les amliorations dune invention. 1. Le rgime gnral Elles rsultent dune demande en Justice portes devant lun des TGI comptent sur la proprit industrielle. a. Les conditions Le demandeur doit tablir la fois la carence du brevet et il doit tablir sa propre comptence. La carence du brevet rsulte de deux lments savoir un dfaut dexploitation personnelle : qui est assorti dune condition de dlai de 3 ans compt de la dlivrance du brevet ou 4 ans compt du dpt de la demande. Le tiers doit prouver la carence et tablir quil a lui-mme demand une licence dexploitation qui lui a t refuse. Elle a t soumise au brevet dans des conditions telles quelle tait inacceptable. Le brevet peut se dfendre en faisant un excuse lgitime la non-exploitation : : en tablissant quil est devant un obstacle matriel srieux lexploitation envisag. b. Effets Lorsque les conditions sont runies le tribunal va accorder la licence quil rclame qui est obligatoirement non exclusive. Elle a un caractre personnel, elle ne pourra tre cder quavec laccord du tribunal, la dure, le champ dapplication et le montant des redevances sont fixes par le tribunal, toutes les modalits sont susceptibles de rvisions soit la demande du dposant du brevet ou du salari. 2. Le rgime des licences dpendance : L 613-15 du CPI Un tiers a apport une amlioration une invention initiale et a obtenu pour cette amlioration, un brevet de perfectionnement. Pour mettre en uvre son brevet de perfectionnement, il doit avoir le consentement du titulaire du brevet initial. IL se peut que la collaboration soit pacifique, comme elle pet ne pas ltre. Larticle L 616 -15 prvoit la solution de conflit entre les deux inventeurs et prvoit les licences de dpendances. Elles sont indistinctement accordes soit au titulaire du brevet de perfectionnement ou linverse au titulaire de u brevet initial. Cette licence est soumis une condition de dlai, doit tre introduite dans les 3 ans compt de la dlivrance du brevet de perfectionnement ou 4 ans compt du dpt de la demande. Ensuite elle est soumis des conditions de fond, savoir que le brevet de perfectionnement propose un progrs technique important ou prsente un intrt conomique considrable. Le montant est dtermin par le tribunal. B. Les licences doffice Ces licences ne sanctionnent pas un dfaut dexploitation, elle sanctionne une insuffisance dexploitation. Elles sont dlivres par ladministration, lorsque les intrts de la collectivit lexigent. Elle touche un certain nombre de brevet limitativement numrs : ceux touchant la sant publique (L 613-16 et L 613-17) touchant lconomie nationale (L 613-18) et enfin des brevets touchant la dfense nationale ( L 613-19). Ex : Il sagit des brevets de mdicament ou les procds dobtention de mdicament, des brevets pour des produits ncessaire lobtention de mdicament et des brevets pour des procds de fabrications de ces produits l.
Droit de la proprit intellectuelle
54
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Le terme de mdicament est pris dans un sens trs large : il sagit de tout produit lucratif, humain ou vtrinaire. Pour tre mis sous le rgime de la licence doffice, ces mdicament ou produits de base doivent tre mis sur le march en quantit ou en qualit insuffisante ou encore des prix anormalement lev. Les deux premiers cas nont que peu dimportance pratique. La question ce pose pour le prix anormalement lev qui constitue un rempart efficace ltendu de monopole auxquels peuvent tre tent les laboratoires qui fabriquent les matires premires. Il y a une menace pour une pilule avortive car le produit navait pas eu lautorisation de mise sur la march. Procdure : Quand on constante que les produits en question sont mis sur le march sont de quantit ou de qualit insuffisante : le ministre de la sant publique (pour les mdicaments) prend un arrt qui place les produits en question sous le rgime de la licence doffice. A partir de la publication de cet arrt, toute personne qualifie peut demander pour un ou plusieurs produits une licence dexploitation. Sa dure et son tendue gographique sont fixes par le ministre de la sant, en revanche les redevances sont librement ngocie entre le titulaire du brevet et le bnficiaire de la licence doffice. En cas de dsaccord cest le TGI qui interviendra.
Droit de la proprit intellectuelle
55
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
2me Partie : La protection dun avantage commercial : les marques de fabrique, de commerce ou de service
Introduction
Historique : Elle existe depuis les romains, on a retrouv des amphores avec des signes distinctifs. Sous lancien rgime ctait le cas des corporations : toutes les activits artisanales taient verrouilles par les corporations qui disposaient de marques. Elles avaient donc une double fonction : elles rapprochaient le produite une corporation et sassurer de ltanchit des corporations. A la rvolution, cest la premire loi sur les marques Loi du 22 Germinal An XI, suivit dune loi du 23 Juin 1857 qui est la premire loi moderne sur les marques. Cette loi du 1857 va organiser le rgime des marques jusqu la loi du 31 Dcembre 1964 avec un systme diffrents dans les deux lois. Dans la premire il ny avait pas denregistrement, ctait la rgle du premier occupant. La seconde instaure en droit franais un rgime denregistrement obligatoire sur les marques : la proprit de la marque sacquiert par le dpt lINPI. Cette loi de 1964 va tre remplac par une loi du 4 Janvier 1991, qui forme la partie du CPI ; les articles L 711-1 et suivant. En effet, il y avait une directive e communautaire qui intresse les marques de 1988 dont leffet est dunifier la protection des marques dans tous les Etats de la communaut. Ce qui fait quen matire de marque les arrts de la CJCE vont tre trs important car vont dicter les positions de la jurisprudence franaise. Il y a un systme international : Cest la convention dUnion de Paris de 1883, mais surtout on a un systme dattribution dune marque communautaire (rglement du 20 Dcembre 1993). Dfinition : LArticle L 711-1 donne la dfinition de la marque : la marque est un signe susceptible de reprsentation graphique, servant distinguer les produits du service dune personne physique ou morale . Cest un signe : une information qui sadresse aux sens qui permet la reconnaissance de quelque chose. On a des marques qui sont des marques verbales ou nominales qui sadressent lou. Parfois des marques sonores. Il y a des marques qui sadressent la vue : constitue de couleur, combinaison, sparation de couleur Ainsi que des formes demballage du produit ou de pro duit lui-mme. On pourrait avoir des marques gustative ou olfactive. Linsigne : doit tre susceptible de reprsentation graphique : introduite de la transposition de la directive communautaire. Le sens de cette condition a t prcis par la CJCE dans trois dcisions importantes : CJCE 12 Dcembre 2002 Sieckman: concernait les marques olfactives CJCE 6 Mars 2003 Libertel : problme de marque de couleur orange sans forme ni contour CJCE 26 Novembre 2003 Schield Mark : les marques sonores Question de lexigence de la reprsentation graphique : sentend dune reprsentation au moyen de figure ligne ou caractre qui doivent tre clair et prcis compltes par elle-mme, facilement accessibles, intelligible, durable et objective. On exige toutes ces qualits car les marques sont enregistres lINPI et publies au BOPI et doit permettre quelquun qui consulte ce livre de se faire une ide prcise dune ide de la
Droit de la proprit intellectuelle
56
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
marque. La reprsentation graphique ne doit pas saltrer avec le temps. Ces conditions vont tre appliques ces trois types de marques Larrt Sieckman du 12 Dcembre 2002 : il tait question de la possibilit de reprsent graphiquement une marque olfactive : un signe qui avait une odeur de cannelle. La cour applique la dfinition et dit que sagissant dune signe olfactif les exigences de la reprsentation graphique ne sont pas remplis par une description de la formule chimique, ni le dpt dun chantillon, ni par la combinaison de ces deux lments. On ne peut admettre le dpt des marques olfactives. Larrt Libertel 6 mars 2003 : Pour une couleur sans forme, ni contour la CJCE : un chantillon de la couleur va saltrer avec le temps, il ne peut pas sagir du dpt dune formule physique faute daccessibilit. En revanche, lassociation dun chantillon et dune description verbale peut constituer une reprsentation graphique si sa description se rfre un code didentification internationalement reconnu : Code Panton. Larrt Schield Mark : reprsentation graphique des marques sonores. Cest un bureau de dpt de marque, Schield Mark a voulu forc la CJCE a prendre position sagissant de la reprsentation graphique des sons : Schield mark a dpos un certain nombre de marque sonore : chant du coq et les 5 premire note de la lettre Lise . La cour de Justice rpond en disant que sagissant des marques sonores il est exclu que la reprsentation graphique consiste dans un description crite ( lindication que le signe est constitu es 5 premire note, ou du cri dun animal). Ca ne p eut pas non plus tre dans une onomatope : Cocorico ! Non plus par : Do r mi sol. Indication sur un graphique dun ordinateur les diffrentes hauteurs ses sons ? Non la seule possibilit pour les marques sonores de satisfaire lexigence dune reprsent ation graphique est une porte musicale divise en mesure, sur laquelle figure une cl, des notes de musiques et des silences dont la forme indique la valeur relative. Leffet immdiat de cette jurisprudence est dexclure de la possibilit dun enregistre ment tous les bruits, car insusceptible de notes de musiques. Seule pourront tre admise au dpt les marques constitu de son. Servant distinguer : on rencontre ici, la notion de la fonction de ma marque. Cette fonction est une fonction distinctive, qui a t dgag par la CJCe dans plusieurs dcisions dont la plus connue : Arrt Phillips 16 Avril 2002. Il sagissait du dpt de la forme dune tte de rasoir : elle rappelle la fonction de la marque il sagit de permettre au public de distinguer sans confusion possible un produit et de le rattacher une entreprise unique qui sera considre comme responsable de sa qualit . Cest une fonction distinctive et de garantie qui permet au public de rattacher le produit une entreprise unique responsable de sa qualit. Cette fonction a volu avec les temps : dans un premier temps la CJCe considrait que la fonctionde marque tait de prtger le titulaire du signe contre des contrefaons manants de concurrents cherchant profiter de la renommer ou de la qualit de la marque. Mais cette fonction, la CJCE a dcouvert une autre fonciton : celle du garantie du public quil ne trouvera pas de produits concurrents. Les produits ou services : la marque appartient une catgorie particulire de signe, quon appelle signe distinctif. Dans cette catgorie, il ny a pas que la marque qui dsigne un produit, il y a plusieurs signe distinctifs qui dsigne autre chose que des produits. La marque est un signe distinctif associ un produit. A ct il y aussi le nom commercial, qui dsigne une entreprise ou la dnomination sociale et lenseigne qui dsigne un tablissement
Droit de la proprit intellectuelle
57
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
commercial dans sa localisation . Chaque signe distinctif dsigne une entit. La marque est parmi les signes distinctifs qui dsignent des produits ou des services. Elle les dsigne parmi des produits, ces produits devant tre concurrents. On n'a besoin dune marque que pour distinguer par exemple des poupes entre elles. Il en dcoule un principe cardinal qui rgit le droit des marques : le principe de spcialit. Que signifie ce principe ? Cela signifie que le signe dpos comme marque, ne sera rserv que pour dsigner les produits dsigner dans le dpt pour des produits identiques ou similaires. Le signe restera donc libre dans les autres secteurs conomiques et pourra tre apport par un autre commerant, qui par hypothse ne commercialisera que des produits non identique ou similaire. Ex : Mont Blanc : Dessert et stylo ! Pourquoi ce principe ? Tout simplement, parce que les signes ne sont pas en nombre infini, on doit combiner le droit des marques avec le principe de la libert du commerce et de lindustrie. En principe, tous les produits peuvent tre dsign par une marque. Un problme sest pos pour au moins une catgorie de produit : les produits de presse ( journaux et magazines). Pourquoi ? Parce que le produit nest jamais identique, la une est changeante. La cour de cassation a tranch la question dans une affaire concernant le journal Mademoiselle : les journaux comme tous les autres produits pouvaient tre dsign par une marque car cest un signe de permanence de la rdaction du journal. On a galement une difficult sagissant des titres des uvres de lesprit. On a un dtournement possible de la loi sur le droit dauteur : le droit dauteur soumet la protection des titres loriginalit et limit dans le temps 70 ans. Or la protection de la marque est de 10 ans, mais cette dure est indfiniment renouvelable. Dans un premier temps, la jurisprudence a admis la protection des titres : que pour les titres de sries (mais simplement parce que ctait la question pose). Ultrieurement la cour de cassation a admis que tous les titres duvre de lesprit pouvait tre protg par une marque, car le titre rempli la mme fonction que la marque : il permet au public de distinguer par exemple dans toutes la production littraire, un livre particulier.
Chapitre 1 : La cration de la marque
Section 1 : Les diffrents signes susceptibles de constituer une marque 1 Les dnominations Les dnominations sous toutes les formes. Ce sont des marques nominales, on peut choisir un mot du langage courant sous rserve de distinctivit. On peut aussi dposer un assemblage de mot ou un slogan (ex : fermeture clair). Le dpt comme un marque est un moyen facile de protger un slogan. On peut aussi dposer un terme de fantaisie (ex : frigidaire), un mot dune langue trangre. On peut dposer un nom patronymique, un nom gographique, une combinaison de lettres, un chiffre, aussi une combinaison de lettres et de chiffres. Ladmission de ces termes ne pose pas de problmes particuliers sauf deux cas.
Droit de la proprit intellectuelle
58
Prise de notes M1 2009-2010
-
http://zarow.kazeo.com
Sagissant du nom patronymique : problme des homonymes. Chacun la libre utilisation commerciale de son nom. La libert des uns est freiner par la libert des autres, deux commerants homonymes veulent tous les deux utiliser leur nom comme marque. Comment on va amnager la coexistence de ces 2 patronymes. Sous la loi de 1964, on posait un principe de libert dusage du nom pour chacun des deux titulaires. Sauf ce que cette pratique soit limite ou interdite si elle portait atteinte au premier dposant. Il y a eu des excs, en particulier des fraudes par ex on formait une socit commerciale avec le porteur du patronyme convoit auquel on donnait un nombre symbolique de part (Cas Lapidus). Ou encore les conventions de prte nom. En 1991 le lgislateur revient sur cette thorie des homonymes, art L713-6a utilisation du nom comme dnomination sociale, nom commerciale ou enseigne et non comme marque si cela ne porte pas prjudice au titulaire de la marque. Sagissant des noms gographiques : on a des indication go qui sont attaches des produits en raison dun lien entre le produit et le terroir. Cela sapplique toute sortes de produits. Ex : Calais pour de la dentelle. Il y a les appellations dorigines, ce sont des noms gographiques qui unissent un produit est un terroir mais en revanche la distinction des indications de provenance, elles manent de dcret. Ces appellations dO ne profitent qu des produits agricoles ou alimentaires. Un nom go peut tre dpos comme marque condition quil ne constitue ni une appellation dorigine ni une indication de provenance (Cour de Paris Verrerie de Viot, confirmation : CC cial 7 mai 1980).
2 Les signes sonores Ils sont valables sous rserve de leur possibilit de reprsentation graphique, dposable sous forme de porte musicale (ce qui exclut les bruits). 3 Les signes figuratifs Art L711-1 al 2c. A) Signes figuratifs 2 dimensions (dessins, tiquettes) Lorsque on dpose une marque figurative, la protection dont bnficie le titulaire de cette marque stend la marque nominale correspondante (extension du symbole au nom). Linverse ntant pas vrai. Lorsque on dpose une marque figurative, on obtient une protection sur lemblme en question quelque soit les formes quil prend. Un commerant concurrent qui fabrique ou distribue des produits identiques ne peut changer la forme de lemblme et dposer cette nouvelle forme. B) Formes On peut tre en prsence dun risque de dtournement du droit des marques. La marque permet a travers le dpt dacqurir une protection quasi perptuelle en raison de sa
Droit de la proprit intellectuelle
59
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
possibilit de renouvellement successifs va durer aussi longtemps que le produit. Or les formes sont protges par le droit dauteur ou le droit des dessins et modles mais aussi brevet, mais ces droits sont limits dans le temps. On craint que celui qui dispose dun brevet pour une forme, dpose cette forme comme marque de sorte qu il va chercher obtenir une protection qui va prendre le relais de ses autres droits. Art L711-2c : On ne peut pas dposer comme marque les signes constitus exclusivement par la forme impos par la nature ou la fonction du produit ou confrant ce dernier sa valeur substantielle. + Formes remplissant une fonction technique ou utilitaire : on veut viter le dpt comme marque de la forme dun produit. Exemple de la marque lego, ils taient couverts par un brevet (qui a expir 20 ans aprs), le fabricant dposer comme marque la forme pour protger sa cration. CJCE Phillips 18 juin 2002, ne constitue pas une marque valable la forme ncessaire lobtention dun rsultat technique quand bien mme le rsultat pourrait tre obtenu par dautres formes. Cet arrt a t appliqu par la JP franaise, non seulement dans laffaire phillips mais aussi sagissant dune affaire lxomil (CC 21 janvier 2004). Une bouteille remplis une fonction utilitaire, si lon suit le prcdent raisonnement. La forme dune bouteille ne peut tre une marque, or une JP existante dit que la forme dune bouteille peut tre une marque. Dans larticle il y a le terme exclusivement , ce qui veut dire que les marques complexes unissant une forme et un autre lment distinctif, la forme serait alors une marque galement. + Formes ornementales : ne peut tre adopt comme un marque confrant un produit sa valeur substantielle. Il faut analyser ltat desprit du public. Est-ce que le public aurait quand mme achet le produit sil tait sous une forme diffrente ? Si la rponse est positive, ce quil recherche cest dabord est un produit. La forme joue son rle de marque, elle lui permet seulement de distinguer le produit quil cherche dun produit de mme nature se prsentant diff remment. Si la rponse est ngative, la forme joue un rle dterminant dans le choix du produit, le produit tant recherch pour sa forme. Celle-ci confre au produit sa valeur substantielle, et la forme ne peut tre dpose comme marque. C) Couleurs Dispositions, nuances ou combinaisons de couleurs, avant loi de 1991, on disait que le nombre des couleurs fondas taient limits. Il tait impossible de choisir comme marque une de ces couleurs. Cest pourquoi on admettait le dpt de couleur sous la forme de combinaison ou de disposition. Une combinaison de couleur cest lassemblage de plusieurs couleurs dans un ordre dtermin. La disposition : prsentation de plusieurs couleurs ou une couleur unique dans une forme ou dans un dessin.
Droit de la proprit intellectuelle
60
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Si le nombre des nuances de couleurs est illimit, on admet le dpt dune marque constitu par la nuance dune couleur. A condition que le dpt soit prcis et quil identifie la nuance de couleur. LINPI admettait au dpt que les nuances de couleurs. La distinction entre les couleurs fondas et nuance de couleurs a disparus avec la loi de 1991, nimporte quelle couleur peut tre dpose comme marque mme sil ny pas de forme ou contours condition dtre identifie de faon scientifique et de faire lobjet de la reprsentation graphique sous un code international. Section 2 : Conditions de validit de la marque Caractre distinctif (art L711-2), caractre licite (art L711-3), caractre dispo (art L711-4). 1 Caractre distinctif Le signe choisit doit tre distinctif. Autrement dit le signe choisit doit tre arbitraire, aucun rapport entre le signe choisit et le produit. Il faut respecter la libert du commerce et de lindustrie, qui plus est la marque doit tre distinctive (cest pourquoi elle doit tre arbitraire. La ncessit de prsenter un caractre distinctif dbouche sur un nombre dinterdictions. A) Apprciation du caractre distinctif. On ne peut pas dire de manire abstraite ou gnral quun signe est distinctif ou non. Cela rsulte de la confrontation entre le signe choisit et le produit que ce signe vise identifier. La distinctivit est une notion relative. Lart L711-2 considre comme dpourvu de caractre distinctif des signes gnriques, descriptifs Cet article exclu un certain nombres de signes non distinctifs : 1) Signes gnriques ncessaires ou usuels Concerne les marques nominales ET les marques figuratives. -Sagissant des marques nominales : art L711-2a. La JP est disparate, on ne peut savoir lavance si un signe va tre considr comme distinctif ou non ds lors. Selon cet article voque le langage courant ou pro , la marque doit tre distinctive pour ces deux cercles de personnes. Problme des marques dposes en langue trangres, partir de quand on va considrer quun mot tranger est distinctif ? La plupart des dposant ne choisissent pas un signe arbitraire mais choisisse le mot qui identifie le produit en langue tranger. Rponse : si le terme tranger na pas de signification pour la majorit du public alors le terme est di stinctif mme sil dsigne le produit. En revanche si le public comprend le mot comme synonyme du produit la marque sera invalide pour dfaut de distinction. -Invalidation quand le signe figuratif est considr comme ncessaire ou usuel. Signes usuels : sont des signes gnralement associs au produit ou encore les formes qui servent gnralement son emballage.
Droit de la proprit intellectuelle
61
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Signes ncessaires : signes faisant rfrence la composition dun produit, par exemple lemballage en forme dun citron pour contenir un jus de citron (CA Paris 1956) est non distinctif. Distinction entre loriginalit et la distinctivit. Sont considrs aussi comme ncessaires les signes faisant rfrence limpratif technique, par exemples les formes de conditionnement. Ne sont pas distinctives non plus les couleurs des composants lectroniques, qui obissent des codes techniques. 2) Signes descriptifs Ils ne concernent que les marques nominales (art L711-2b). Cet article interdit les signes pouvant servir dsigner une caractristique du produit ou du service. Tout signe servant dsigner une caractristique du produit est considr comme non distinctif par exemple : lespce, la qualit, la quantit, la destination, la valeur, la provenance go, lpoque de production du produit ou du service. B) Apprciation du caractre distinctif en fonction de lusage En principe ce caractre est apprci au jour du dpt. Loi de 1991, les tribunaux se sont toujours refuss invalider une marque qui par usage gnralis avait perdu son caractre distinctif au point que le public ignore que le terme dsigne une marque. Changement avec cette loi, dans lart L714-5 : dchance pour excs de notorit (le titulaire dune marque perdra son droit sur le signe si ce dernier est devenu de son fait la dsignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La dchance nest pas auto, il faut en plus de prouver, tablir que le titulaire de la marque na rien fait contre lassimilation de sa marque un type ou un genre de produit. Lusage joue aussi un rle positif, c'est--dire quil va faire acqurir une marque un caractre distinctif quelle navait pas lorigine. La question ne se pose pas quand le signe est franchement non distinctif. Mais on a des signes dits faiblement distinctifs, marques enregistres malgr le caractre faiblement distinctif. Pour viter que les titulaires de marques largement connues du public subissent un prjudice du fait de la faiblesse de la distinctivit. La convention de Paris art 6ter contient une rgle ins taurant que lusage constant et gnralis du signe permet ce signe qui a lorigine tait faiblement distinctif lui permet dacqurir le caractre distinctif qui lui fait dfaut (CC cial 7 mai 1980 CAMPING CAR). 2 Le signe doit tre licite Art L711-3, sous cette condition de licit plusieurs conditions sont prcises dans lart. A) Le signe choisit comme marque ne doit pas tre compos de signes exclus par lart 6 bis de la convention de Paris.
Droit de la proprit intellectuelle
62
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Les signes exclus sont : les drapeaux, emblmes officielles et armoiries des Etats parties cette convention. B) Le signe ne doit pas faire lobjet dune interdiction dusage titre de marque Ex : Dcorations, poinon officiel, symboles/sigles/dnominations des organisations internationales (ex : drapeau olympique, sigle dinterpol). Mais aussi les signes dont la reprise est interdite par un texte particulier. C) Les signes contraires lOP et les bonnes murs. Il ne sagit pas de signes/slogans subversif. Problme des signes faisant rfrence des produits dangereux pour la sant (ex : affaire Opium). Ligues de vertu conteste cette appellation contraire lOP, mais pas dannulation par la cour de Paris car il ny a pas de lien avec le produit et nombreuse rfrence lopium dans les livres autrement quen tant que drogue. Cour de Paris 18 octobre 2000 Cannabia, interdite comme contraire lOP car la bire est un produit de consommation courante, et parce que la bire vise un public de jeunes qui pourraient croire que la consommation de cannabis est lgal. D) Le signe ne doit pas tre dceptif Art L711-3c, il ne faut pas induire le public en erreur. Ide que le choix dune marque induisant le public en erreur est contraire la loyaut envers les concurrents mais aussi vis--vis du consommateur. La marque nest bien sur pas une garantie juridique de qualit, elle na quune fonction didentification de lobjet. La marque reste une garantie psychologique de qualit. Tromperie notamment sur la nature du produit (ex : Evian fruit), sur la qualit du produit, sur la provenance go du produit.
Sanction des deux premires conditions voques : les deux premires conditions sont vrifies par les services de lINPI avant lenregistrement de la marque. Si lINPI se rend compte du vice, il rejette la demande. Si un signe non distinctif ou illicite est enregistr, la marque sera susceptible dtre annule (nullit absolue), mme le ministre public peut agir doffice (prescription de laction est de 5 ans).
3 Le signe doit tre disponible La disponibilit nest pas vrifie par lINPI au moment de lenregistrement, le contrle est laiss aux tribunaux saisis du titulaire dune antriorit. Mais ici la nullit est relative, o seul le titulaire de lantriorit peut agir. Il ne doit exister sur le signe aucun droit antrieur constitu au profit dun tiers. Art L711-4 contient une numration des droits antrieurs faisant obstacle au choix du mme signe comme marque. Certains droits antrieurs sont des droits sur des signes
Droit de la proprit intellectuelle
63
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
distinctifs autre que la marque ds lors gouvernance du principe de spcialit, lantriorit ne pourra tre oppose que si le signe est repris dans le mme secteur concurrentiel. Dautres droits antrieurs sont absolus, ds lors il sera interdit de reprendre le signe comme marque dans tous les secteurs de lactivit conomique. A) Antriorits relatives Ce sont des droits antrieurs qui existent au profit du titulaire dun signe distinctif. 1) La marque Lexistence dune marque antrieure enregistre au profit dun tiers interdit le dpt et lenregistrement dune autre marque constitu par u n signe identique ou similaire destin identifier des produits identiques ou similaires. Difficult : identifier la notion de produits similaires, notion complique, apprciation souveraine des juges du fond. JP disparate l encore. La CJCE a donn au juge des indications pour juger de la similitude de produit (dans larrt Canon 29 septembre 1998), CJCE guide le magistrat national. La notion de similitude de produit est une notion objective prenant en compte la nature, la destination, lutilisation des produits/services ainsi que leur caractre concurrent ou complmentaires. Sont considrs comme similaires des produits dont la nature et lusage sont extrmement voisins ou qui ont une destination commune. JP LASSERRE. Depuis la loi de 1964 la proprit dune marque sacquiert par lenregistrement. Ce principe connat une exception = rsulte de la convention dunion de Paris a savoir que lorsquune marque est notoire elle est protge bien quelle nest pas fait lobjet dun enregistrement. Il faut que la marque soit notoire en France mais aussi quelle soit notoire. Ici on retient une dfinition restrictive de la marque notoire = Une marque connue dune large fraction du public cad une marque a lannnonce de laquelle le public va faire spontanment le rapport avec le produit quelle recouvre. Provoque immdiatement une association dide. Lorsquon est en face dune marque comme a en gnral le titulaire de la marque prend la prcaution de la dposer dans tous les pays et de la dposer dans toutes les catgories de produits mais il se peut que les services qui dtiennent cette marque notoire aient ngliges certaines formalits de dpts il y a longtps c la raison pour laquelle la loi de 1964 a estime que pour les marques notoire mm si elles ne sont pas dposes constituent une antriorit qui empeche le dpt dune autre marque. Ex = marque Orient express qui na pas t dpos mais qui est pourtant une marque notoire. 2) Lantriorit rsultant dune dnomination ou dune raison sociale. Cette dnomination sociale sert a individualiser une personne morale dans lensemble de ses activits = l'quivalent du nom patronymique mais pour une personne physique.
Droit de la proprit intellectuelle
64
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Le droit sur la dnomination sociale sacquiert par ladoption de celle ci dans les statuts qui constituent cette personne morale. A partir du moment ou elle a t adopte dans les statuts elle a vocation a tre dfendue par son titulaire des limmatriculation au registre du commerce. La question de l'antriorit rsultant dune dnomination sociale pose la question de ltendue de la spcialit, question de savoir si comme tous les signes distinctifs cette dnomination sociale est limite par l'activit ou est ce quelle naurait pas une tendue plus grande a savoir que la personne morale ayant vocation a tendre son activit a dautres secteurs conomique est ce que cette dnomination sociale peut saffranchir de La jsp = la protection de la dnomination sociale s'tend a tous les secteurs de la vie conomique. Mais en mm temps quelle tend la protection de la dnomination sociale la jsp pose comme principe que la reprise de celle ci nest interdite que dans la mesure ou il existe un risque de confusion. Sa protection s'tend ventuellement a tous les secteurs de l'activit eco donc sa reprise comme marque serait interdite a condition que le titulaire de la dnomination tablisse le risque de confusion. Risque de confusion = dfinie par la cour de justice dans le mm arrt que les produits similaire 29 septembre 1998 CANON selon la cour = il y a risque de confusion lorsque le public peut croire que les produits commercialiss sous les deux signes proviennent de la mm entreprise ou dentreprises lies conomiquement. 3) Lantriorit rsultant dun nom commercial ou dune enseigne. Le nom commercial = le nom sous lequel est exploit un fond de commerce. Lenseigne = dsigne un tablissement commercial dans sa localisation = le nom dune boutique. Avec la protection du nom commercial et de lenseigne on renco ntre un problme qui est la question de ltendue gographique du nom commercial ou de lenseigne en question. Est ce que le nom commercial lenseigne constituent une antriorit a condition quils aient un rayonnement national ou est ce que ce rayonnement est indiffrent ? Dans la loi de 1964 le statut du nom commercial tait diffrent de celui de lenseigne. Lexistence dun nom commercial constituait toujours une antriorit au dpt dune marque et a linverse lantriorit rsultant dune enseigne tai t subordonne a la preuve que cette enseigne tait connue sur lensemble du territoire. Situation modifie par la loi de 1991, lexigence dun rayonnement national vaut pour les deux signes. Doivent tre connu sur lensemble du territoire. Lexplication tient dans le fait que le nom commercial comme lenseigne sont appropries par lusage et que la situation du dposant dune marque est rendue dans ce cas la plus difficile parce que mm sil a fait des recherches avant denregistrer sa marque en demandant l INPI sil existe un produit ou un signe similaire c beaucoup plus difficile lorsquils ne sont pas enregistres mais appropris par lusage. Pour constituer une antriorit il faut donc que le nom commercial comme lenseigne soient connu sur lensemble du territoire.
Droit de la proprit intellectuelle
65
Prise de notes M1 2009-2010
4) Autre antriorit, lexistence dune appellation dorigine.
http://zarow.kazeo.com
Dfinies par le Code de la proprit intellectuelle et reprise du Code rural et du Code de la consommation. Il sagit de la dnomination dun pays, dune rgion ou dune localit ser vant a designer un produit qui en est originaire et dont les qualits ou les caractres sont dues au milieu gographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Ces appellations dorigine sont dlivres par ladministration et par lINAO (institut national des appellations et des origines). Ne sapplique quaux produits agricoles, alimentaires et aux produits de la mer. Dlivr aprs une procdure complexe, par dcret qui fixe lair gographique et lappellation dorigine est accorde un produit a partir du moment ou les producteurs respectent le cahier dcharges qui fixe prcisment les conditions de production. Cette appellation dorigine est classe dans la catgorie des signes distinctifs donc permet de distinguer un produit qui en bnficie dun produit qui nen bnficie pas. Cette appellation est indisponible et donc ceux qui nen bnficie pas ne peuvent pas se lapproprier en la dposant comme marque. Pour les producteurs de la rgion considre lappellation dorigine est indispo nible pour constituer une marque si lappellation dorigine est utilise seule. Parce que par la suite a la suite de succession la terre peut tre divise et il faut laisser intacte aux autres propritaires la possibilit de Chambre commerciale arrt 1er dcembre 1997 la Ccass a dit que lappellation dorigine tait indisponible pour constituer une marque en revanche les producteurs qui en bnficient peuvent la dposer dans une marque complexe cad quils peuvent la combiner avec un signe ou nom distinctif. Va leur permettre de distinguer leur production des autres bnficiaires de lappellation dorigine.
B) Antriorits absolues 1) Les antriorits rsultant dun droit dauteur ou dun droit sur des dessins et modles La loi et le code a la suite de la loi de 57 reconnat a lauteur un droit exclusif, ce droit prsente des lments patrimoniaux et moraux permettant a lauteur de dcider la forme sous laquelle il dsire exploiter son uvre. Permet davoir la gouvernance de sa cration et de dcider des formes dexploitation qui lui conviennent et celles qui ne lui convienne pas. Lexploitation commerciale sous forme de marque dune uvre de lesprit requiert lautorisation de lauteur. Donc toute exploitation mm sous forme partielle sans autorisation est une contrefaon. 2) Les antriorits rsultant des droits de la personnalit A savoir le nom patronymique. Mais les principes dgags par le nom patronymique vont sappliquer de la mme faon au prnom, au pseudonyme ou limage.
Droit de la proprit intellectuelle
66
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Problme de la commercialisation du nom dun tiers sans autorisation. Par hypothse le titulaire du nom nest pas commerant. Il sagit la dune personne prive qui va ragir la commercialisation de son nom sans son autorisation. Le nom patronymique = a la fois une institution de police et un droit de la personnalit. Sil est incessible dans sa fonction didentification des personnes physiques en revanche le titulaire dun nom patronymique peut commercialiser son nom soit en exerant lui mm le commerce soit en autorisant un tiers a pratiquer le commerce sous son nom. Les sportifs par exemple font un grand usage de ces conventions. Par consquent les personnes qui sont clbres ont le plus grand intrt a garder la maitrise de la commercialisation de leur nom patronymique. Lorsque la jsp a t saisie de question tenant a la commercialisation du nom dun tiers sans autorisation a poser le principe que la reprise dun nom patronymique a des fins commerciales ncessite que le demandeur tablisse lexistence dune confusion a laquelle il a intrt de mettre fin = affaire du 19 dcembre 1967 SAVIGNAC et affaire du 26 mai 1970 DOP, aussi 13 fvrier 1967 BADOIT. Dans quelles circonstances y aura t il un risque de confusion ? Lexistence dune confusion suppose deux lments : Quand y aura t il existence du risque de confusion. Elle suppose 2 lments:
le nom patronymique doit tre connu du public, donc faire relation entre la personne qu'il connat sous se nom et le produit de la marque. Cette confusion n'aura aucune consquence sur la personne elle mme. Il fallait que le nom patronymique soit repris l'identique avant, mais si on reprend une partie du nom (affaire Planta Kirgener de Planta). La jP a modifi lgrement son exigence, dans arrt VIAGRA 15/12/2000, la marque est l'anagramme du nom du mdecin qui a mis sur le march le produit, docteur VIRAAG avait initi une procdure du fait sur son nom. La cour de paris a un peu modifi son analyse et recevabilit de l'action si la confusion ou le risque est tablit avec d'autres lments que la reprise du nom l'identique. La reprise est interdite quand elle est fautive quand il Il y a confusion ou risque de confusion. Donc si le nom est clbre ou rare mais dans l'hypothse o le nom est rpondu, la JP n'interdit pas la reprise du nom comme marque.
3) Les collectivits territoriales. Le snat est le garant des CL, un nom de marque ne peut porter atteinte a l'image (Deauville pour des parapluies ou St tropez pour un parfum bon march, atteinte financire). Comme les personnes physiques les CL tirent des revenus de la commercialisation de leur nom. Pour ne pas dtourner les investissements raliss, il est ncessaire d'interdire le dpt de leur nom comme marque, donc quand atteintes leurs intrts. La sanction des antriorits: pas vrifier par l'INPI, elle est laiss a la diligence de leur titulaire, donc une marque adopte en violation de tel ou tel droit est sanctionn par une
Droit de la proprit intellectuelle
67
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
action en nullit relative donc qui ne peut tre introduite que par le titulaire de l'antriorit, prescription par 5 ans. Concernant les antriorits rsultant d'une marque: quand le titulaire d'une marque se rend compte qu'une autre marque identiques ou similaires dans le mme secteur concurrentiel, il y a une procdure d'opposition. Elle est rserve aux titulaires de marques. Opposition la marque qui pourrait leur faire prjudice. Mais il est difficile de le rparer quand il rsulte d'une mauvaise image auprs du public. Au lieu de rparer le prjudice une fois arriv, il tait de meilleure choix d'viter que le prjudice se ralise, donc laisser un droit au titulaire du droit antrieur un mcanisme pour la protection. Procdure devant l'INPI et suppose que le dpt de la demande soit publi donc rendu public dans un registre spcial; le registre national des marques et que le titulaire viennent consulter priodiquement ce registre pour savoir si une marque ne serait pas en instance d'enregistrement. Mais aussi de la possibilit de faire une demande en nullit relative.
Chapitre 2 : Lacquisition, la conservation et la perte du droit sur la marque.
Section 1: acquisition du droit sur la marque L'acquisition du droit sur la marque se fait par un dpt, suivi d'un enregistrement a l'INPI, c un dpt simple: formulaire simple a remplir, officiel et dans ce dpt on fait figurer la marque (nom, forme, couleurs) et a cot du dpt on donne la liste des produits et services que l'on cherche a identifier par la marque. Cette liste va servir a identifier l'tendue de la spcificit du signe. Le signe reste libre dans les autres secteurs de la vie conomique. Dans des classes, il sont mis, il existe une classification administrative des produits et services: 35 de produits et 9 de services mais c classes ne servent pas dterminer l'tendue de la protection du titulaire de la marque. Elles servent uniquement l'administration pour calculer les droits dus par le dposant. 225 pour 3 classes et 40 par classe supplmentaire. Il n'y a pas d'entretien de la marque, donc le droit pay au moment du dpt vaut pour toute la vie de la marque cad 10 ans renouvelables. L'INPI ne vrifie que si le signe est valable et vrifie la distinctive et licit. Mais ne vrifie pas la disponibilit du signe. Si ces contrles passent, la marque est enregistre et elle est publie au registre national des marques. Le dpt est aussi publi pour permettre la procdure d'opposition. L'enregistrement donne un monopole de protection de 10 ans et rtroagit. Section 2: Conservation droit sur la marque Protection de 10 ans mais la proprit peut durer indfiniment. Avant loi 91, le renouvellement de la marque se faisait comme la procdure de dpt. 2 inconvnients: - si on tombait sur examinateur plus tatillon, on risquait de voir son signe invalid lors du renouvellement; - la procdure d'opposition, marque non protge pendant une certaine priode pendant laquelle pouvait s'infiltrer un contrefacteur. Donc modification de la procdure, loi 91, plus d'examen de renouvellement par l'INPI: donc sur simple demande du titulaire, dans les 6 derniers mois de validit du signe et si le titulaire
Droit de la proprit intellectuelle
68
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
ne modifie pas le signe ni les produits et services compris dans la liste du signe, simple dclaration. Section 3 : Perte du droit sur la marque 2 causes principales : - Annulation du signe (aprs action en nullit). - Dchance du droit soit pour dfaut dexploitation soit pour perte du pouvoir distinctif de la marque. 1 Perte du droit la suite dune action en nullit Action en nullit absolue : quand le signe est insusceptible de constituer une marque, savoir quand il est non distinctif. Ou encore quand il est illicite ou dceptif (conditions de validit vrifies par lINPI). Prescription quinquennale. Actions en nullit relative : ces actions sanctionnent lantriorit, seul le tiers disposant de lantriorit peut agir en nullit. La prescription est l aussi quinquennale mais il y a une particularit, on appelle cela la forclusion par tolrance. Art L714-3 al3 prvoit que laction du titulaire de lantriorit ne sera plus recevable ds lors que la marque a t dpose de bonne foi et quil en a tolr lusage pendant 5 ans. 2 Actions en dchance. Deux causes : - Dfaut dexploitation - Perte du pouvoir distinctif du signe A) Dchance pour dfaut dexploitation. Le titulaire de la marque na pas une obligation dentretien, le titulaire une obligation dexploiter le signe dont il sest rserv lusage titre de marque. Car les signes disponibles finissent par tre moins nombreux, mais aussi car le droit des marques est une exception au principe de la libert du commerce et de lindustrie. Le lgislateur a voulu lutter contre des pratiques dans lesquelles un signe est appropri comme marque alors que le titulaire du droit na pas lintention de lexploiter : Marques de barrages : marques qui sont dposes sans aucune intention dexploitation mais uniquement pour gner lactivit dun concurrent dont on sait quil sapprte dposer le signe comme marque. Ces marques de barrages sont des atteintes la libert de commerce et de lindustrie, cest pourquoi cest illgal. Marques de dfense : marques dposes sans intention dexploitation, mais pour entourer un signe dont on a la proprit quon utilise comme marque faiblement distinctive (ex : la vache qui rit pouvait tre considr comme une marque faible). Ces marques de dfense parasite le registre des marques.
Droit de la proprit intellectuelle
69
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
Marques de rserve : pratique qui conomiquement est intressante mais si elle dure trop longtemps elle sexpose la dchance. Il sagit dune marque que les services marketing ont mis au point pour identifier un produit quand il sera prt.
Loi de 1791 reprend cette dchance qui existait dj. Art L714-5 CPI. Le propritaire dune marque qui na pas fait usage de celle-ci pendant une priode ininterrompue de 5 ans sexpose tre dchue de sa marque. Cest une dchance pour non usage. Quels sont les usages ncessaires pour conserver les droits ncessaires sur la marque ? 1) Usage du signe ncessaire Trois caractres : + Il doit constituer un usage srieux : Il sagit dune usage titre de marque c'est--dire pour dsigner des produits ou des services, ds lors le titulaire qui utilise son signe pour identifier un FDC/tablissement commercial ne fait pas un usage srieux de son signe titre de marque. Il faut aussi un usage en direction du public, la marque permet didentifier un produit ou un service et de rattacher cela une entreprise. Cela suppose donc que des produits/services soient diffuss dans le public. Il faut par consquent une prise de contact. Le titulaire dune marque ne peut se dfendre en arguant de la ralisation dacte prparatoire (publicit, tablissement de tarifs). En revanche si la loi exige que le signe soit utilis titre de marque, on nexige pas u n seuil minimum dexploitation car il faut prendre en compte les trs petites entreprises dont la capacit de production ne permettrait pas datteindre un certain seuil. + Il faut un usage dans les conditions du dpt : Condition sur la forme du signe dpos comme marque, pour chapper lchance en principe il faut que le signe exploit soit identique celui qui figure dans le dpt. Ceci tant dit il y a une attnuation, lorsquon a affaire une marque ancienne le titulaire peut moderniser son signe sans quil pense pratiquer un nouveau dpt. Quand le titulaire modernise ainsi son signe, il faut lui viter dtre dchu de sa marque pour non exploitation car il exploite le nouveau signe. La JP prvu un accommodement avec le principe savoir quest considr comme un usage srieux : lusage dun signe sous une forme modifie ds lors que persiste le caractre distinctif de la marque . Il demeure une limite, on doit viter de tomber dans les marques de dfense. La forme du signe doit tre rpte, la modification doit tre lgre et ne pas altrer. Le titulaire ne doit pas modifier les produits ou les services viss dans le dpt.
Droit de la proprit intellectuelle
70
Prise de notes M1 2009-2010
http://zarow.kazeo.com
+ Lusage du signe doit tre le fait du propritaire ou dun tiers autoris par lui. Il nest pas ncessaire que lexploitation du signe soit ralise par un licenci r gulier, notamment par un licencier dont le contrat de licence a t publi au registre national des marques. Pour chapper la dchance il nest pas ncessaire que le tiers autoris exploit soit titulaire dune licence en bonne et due forme, la simple autorisation du titulaire suffit. 2) Laction en dchance stricto sensu + Lintrt agir : dans la plupart des affaires cest un contrefacteur. On peut penser aussi un concurrent qui soit est titulaire dun signe voisin qui craint que le propritair e de la marque ne lattaque en contre faon soit un concurrent qui veut dposer un signe semblable/voisin mais la maque non exploite gne. + Question de la preuve du non usage : Cest au demandeur de rapporter la preuve des faits quil allgue. Or les preuves ngatives relvent de la probation diabolica. Contrairement aux rgles gnrales, cest au titulaire de la marque de prouver que contrairement aux allgations du dfendeur il a bien exploit. Le titulaire sil a exploit son signe va avoir dans sa compta des actes prouvant que des produits ou services ont t couls dans le public sous la marque en question. + Moyens de dfense : le texte rserve les cas o il y aurait des justes motifs la non exploitation de la marque. Lexploitation doit tre empch soit par des circonstances de faits soit de droits srieuses. Les caractres de la force majeure ne sont pas ncessaires. Ex : il na pas pu fabriquer son produit car les matires premires sont sous embargo + Effets de la demande : Le signe dpos comme marque nest plus appropri, il tombe dans le domaine public. Il faut 5 ans de non exploitation pour aboutir la dchance du signe. Une fois la dchance prononce prend elle effet lexpiration du dlai de 5 ans ou rtroagit elle ? La JP antrieure la loi de 1991 fixait la date deffet au prononc du jugement. Dsormais lorsque la dchance est prononc elle rtroagis au jour o le dlai de 5 ans est expir. On cherche protger le demandeur. B) La dchance pour perte du pouvoir distinctif de la marque. Art L714-6, cest une dchance qui sanctionne une circonstance particulire, c'est --dire un signe qui existait lorigine comme une marque est devenu le nom commun dun produit. Cette circonstance de fait ne suffit entraner la dchance de la marque. Il faut aussi que ce glissement smantique a t encourag/tolr par le titulaire du signe. + Condition objective La marque doit tre devenue la dsignation usuelle du produit dans le commerce (Kleenex, bretelles, pdalo). A lorigine caractre distinctif mais la marque est devenu gnrique ou tout du moins ncessaire. Soit en raison de facilit dusage soit car il nexiste pas un de nom commun pour dsigner le produit. Pendant longtemps (avant loi de 1991) on appliquait le principe gnrale : caractre distinctif doit tre apprci au jour du dpt peut importe lvolution. Cette volution a t modifie dans la loi de 1991 avec cette dchance.
Droit de la proprit intellectuelle
71
Prise de notes M1 2009-2010
+ Condition subjective
http://zarow.kazeo.com
Le titulaire doit tre considr comme responsable de cette perte du pouvoir distinctif. On sanctionne la passivit. On amne les titulaires de marque surveiller leurs signes et viter cette dchance. Quelles sont les actions possibles ? - Actions contentieuses : le titulaire va intenter des actions en contre faon quand il constatera que sa marque est utilise comme synonyme dun produit. - Action en responsabilit civile : utilisation de la marque comme nom commun dans un article de journal. Leffet pervers de cette mesure est dencombrer les tribunaux avec des actions incessantes des propritaires de marques. On peut aussi penser des actions non contentieuses, pour avertir le public que le signe considr comme un nom commun est en vrit une marque dpose via la publicit par exemple. Actions non contentieuses contre les journaux pour des rectifications notamment.
Quand ces 2 conditions sont runies, laction en dchance va pouvoir aboutir et le propritaire de la marque sera dchu de son droit, la marque sera dans le domaine public. Aucun commerant ne diffusant des produits similaires ne pourra se lapproprier. Il sagit dune perte dun droit de proprit, en cela elle ne peut tre sanctionne que par les tribunaux.
Droit de la proprit intellectuelle
72
Prise de notes M1 2009-2010
Chapitre 3 : La protection de la marque
http://zarow.kazeo.com
Sagissant de laction en contre faon : la victime peut son gr saisir soit les tribunaux civils soit les tribunaux correctionnels. En gnral elle saisit les tribunaux civil car laction pnal en contre faon ncessite la dmonstration de lintention alors quau civil la contre faon existe mme si le contre facteur est de bonne foi. De plus, on observe que les D&I accord par les tribunaux rpressifs sont moins importants. Aujourdhui tendance saisir les tribunaux correctionnels quand la contre faon est de grande ampleur ou quand le titulaire de la marque est important. Section 1 : Action en contre faon. Art L713-2 et 713-3 du CPI. Art L716-9 et L716-10. La victime na qu prouver le fait matriel de la contre faon quand sa marque est reproduite sur des produits identiques ceux dsign dans son dpt. En revanche si la marque est reproduis sur des produits similaires ceux figurant sur le dpt ou quand la marque est imite sur des produits identiques ou similaires, la victime devra prouver le risque de confusion. 1 Reproduction sur des produits identiques En droit franais les tribunaux avaient lhabitude dassimiler une reproduction, la reproduction quasi servile (reproduction avec modification insignification) et la reproduction par adjonction inoprante (reproduction en ajoutant un lment qui ne retient pas lattention du public). CJCE LTJ Diffusion 20 mars 2003, on est dans le cadre dune reproduction quand le signe reproduit sans modification ni ajout tous les lments constituant la marque ou lorsque considr dans son ensemble il recel des diffrences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperue aux yeux dun consommateur moyen. Le lendemain de la directive la JP franaise sest modifie en adoptant une position plus souple. La JP ne retient comme reproduction que la reproduction de tous les lments de la marque si bien que le champ dapplication de la contre faon par reproduction est trs restreint. Ex : Reproduction des marques de luxes sur des sites denchres, il sagit l de contre faon pure et simple. Ou encore la reproduction des marques dans des noms de domaines. Pour que la victime soit dispense de la preuve de la confusion il faut que la marque soit reproduite sur des produits identiques. Produits identiques : produits ayant la mme nature ou qui remplis la mme fonction. Ou encore lorsque lun des produits rentre dans la catgorie de lautre.
Droit de la proprit intellectuelle
73
Prise de notes M1 2009-2010
2 Exigence dun risque de confusion.
http://zarow.kazeo.com
Pour la reproduction de marque sur des produits similaires et pour limitation de la marque sur produits identiques ou mme similaires que ceux du dpt. CJCE SABEL 11 novembre 1997 et Canon 28 septembre 1998, LLOYD 21 juin 1999. La cour remonte la fonction de la marque qui est de permettre au public de rattacher sans confusion possible un produit une entreprise qui est considre comme responsable de sa qualit. Risque de confusion : fait que le public puisse croire que les produits/services en cause proviennent de la mme entreprise ou le cas chant dentreprises lies conomiquement. Le risque de confusion dpend de nombreux facteurs notamment de la connaissance de la marque sur le march, de lassociation qui peut en tre faite avec le signe utilis ou enregistr, du degr de similitude entre la marque et le signe, et entre les produits ou services dsigns. A) Agent de rfrence du risque de confusion Il sagit de la victime du risque de confusion, cest le consommateur moyen de la catgorie de produits concerns. Si cest un produit de grande consommation on se rfre au grand public y compris sagissant dun mdicament. En revanche quand le produit est un produit spcialis soit en raison du caractre pro soit car le produit sadresse un catgorie de consommateur, on se rfrera alors celui qui lhabitude des produits en question. B) Facteurs du risque de confusion + Similitude entre les produits/services. Quand est ce que lon considre la similitude ? CJCE retient une dfinition objective qui a t voqu dans larrt Canon et larrt Lloyd. Similaires lorsquils ont la mme nature, destination ou alors quils sont complmentaires. Cela suppose quil existe entre eux un lien troit et ncessaire (mme processus de fabrication, mme usage ou finalit, qui remplissent la mme fonction, ou encore distribution dans les mmes (rayons) magasins, produits qui sont choisis par les entreprises du luxes quand elles dcident de se diversifier). Les produits proches vont porter des signes proches aussi. + Structure des deux marques : y a-t-il des ressemblances visuelles, auditives ou intellectuelle ? Par exemple la similitude visuelle, il sagit soit dune similitude dans la construction, dans la prsentation (logo semblable, mme code de couleur/typographie. Pour la similitude auditive, quand deux marques malgr une structure diffrente se prononcent de la mme manire. Pour la similitude intellectuelle, par exemple pages jaunes et pages soleil/eau dynamisante et eau stimulante. On peut recourir une locution complmentaire (Cogito et Cogito ergo sum).
Droit de la proprit intellectuelle
74
Prise de notes M1 2009-2010
Section 2 : Protection des marques renommes.
http://zarow.kazeo.com
Les marques sont gouvernes par le principe de spcialit. Pour les marques notoires se pose le problme suivant, un agent peut essayer de dtourner la notorit de la marque pour des produits et services nayant rien voir avec elle. Embarras en raison du principe de spcialit. Le titulaire pourrait dposer la marque dans tous les secteurs conomiques mais il y a la dchance pour dfaut dexploitation. Ds lors cration de la thorie des agissements parasitaires : application de lart 1382 c civ qui devient laction en concurrence dloyal or il ny a pas de concurrence car clientle diffrente, do la qualification dagissement dloyal. Engage sa responsabilit le commerant dposant une marque notoire ou renomme pour identifier des produits diffrents. JP Pontiac en 1962 et Mazda en 1970. Art L713-5 CPI : emploi dune marque jouissant dune renomme engage la responsabilit civile de son auteur sil est de nature porter prjudice au titulaire de la marque ou sil constitue une exploitation injustifie de cette dernire. 1 La question de la dfinition de la marque renomme Une marque renomme est ce la mme chose quune marque notoire ? Marque notoire : marque connue de la majorit du public. CJCE a du intervenir pour prciser le concept de marque renomme, arrt Cheville : une marque renomme est une marque connue de la majorit du public intress par les produits et services diffuss par les titulaires de la marque. La marque renomme est protge contre sa reprise pour des produits sortant de son secteur concurrentiel condition que lart 713-5 soient runies. 2 Conditions dapplication de lart L713-5. A priori cest la faute. Il sen suit un prjudice port au titulaire de la marque, il peut tre conomique ou tout simplement un prjudice en dperdition en terme dimage. Lart va plus loin en disant que laction peut intervenir quand les agissements de lagent constituent une utilisation injustifie de la notorit de la marque, cest plus simple en terme de preuve. Par ces agissements lagent a cherch se situer dans son sillage, il emprunte la marque renomme le prestige quelle avait. Ex : Affaire Champagne c/ Saint Laurent. Prcisions sur lexamen : Pas de changement dhoraires pour les oraux. Sujet tir au sort pour loral. Sujets porteront sur les 3 thmes Code interdit pour lcrit, mais les sujets sont des commentaires de textes. On doit sen tenir au texte. Les HS sont sanctionns, mme si HS lies la thmatique note en dessous de la moyenne toujours sen tenir au texte. Maximum une copie double plus un intercalaire.
Droit de la proprit intellectuelle
75
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours Du Droit de La Propriété Intellectuelle 2020Document55 pagesCours Du Droit de La Propriété Intellectuelle 2020koko100% (18)
- Apprendre Facilement Les Verbes Anglais Irriguliers PDFDocument9 pagesApprendre Facilement Les Verbes Anglais Irriguliers PDFzotila100% (3)
- Japonais PDFDocument64 pagesJaponais PDFFlorence SculierPas encore d'évaluation
- Une Carte Mentale de La Méthodologie de La DissertationDocument1 pageUne Carte Mentale de La Méthodologie de La DissertationMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Cours de Propriété IntellectuelleDocument57 pagesCours de Propriété Intellectuelleibid_ibidemPas encore d'évaluation
- Propriété Intellectuelle (Cours Entier)Document45 pagesPropriété Intellectuelle (Cours Entier)Hassan Cisse100% (1)
- Le Cours de Propriete IntellectuelleDocument13 pagesLe Cours de Propriete IntellectuelleLokoPas encore d'évaluation
- Propriete Intellectuelle FichesDocument42 pagesPropriete Intellectuelle Fichesjephte NonouPas encore d'évaluation
- ADIfilestoutes20les20leçons - PDF 2Document32 pagesADIfilestoutes20les20leçons - PDF 2cabjacqPas encore d'évaluation
- Exercices Etre Et Avoir 2 PDFDocument3 pagesExercices Etre Et Avoir 2 PDFMónica TapiaPas encore d'évaluation
- Morale ResponsabiliteDocument165 pagesMorale ResponsabilitebastilianusPas encore d'évaluation
- Dossier - Protections Et Propriété IntellectuelleDocument41 pagesDossier - Protections Et Propriété IntellectuelledxsszszPas encore d'évaluation
- Droit de La Propriete Intellectuelle CMDocument93 pagesDroit de La Propriete Intellectuelle CMAlexandre Gombert100% (1)
- Droit D'auteurDocument32 pagesDroit D'auteurquadrigePas encore d'évaluation
- Connaître Les Grands Principes Du Droit D'auteurDocument3 pagesConnaître Les Grands Principes Du Droit D'auteurSoufiane DergounPas encore d'évaluation
- Fiche - Droit de La Communication CMDocument16 pagesFiche - Droit de La Communication CMErika RiosPas encore d'évaluation
- Tableau Des Sons Pour 3ème Et 4èmeDocument1 pageTableau Des Sons Pour 3ème Et 4èmesara25100% (4)
- Exposé Droit D'auteurDocument12 pagesExposé Droit D'auteurArnaud BomissoPas encore d'évaluation
- Les Droits D'auteurDocument3 pagesLes Droits D'auteursalaheddinePas encore d'évaluation
- Le Mot TOUT Exercices Et CorrigeDocument6 pagesLe Mot TOUT Exercices Et CorrigeJohn BoumtchePas encore d'évaluation
- La Propriété Littéraire Et ArtistiqueDocument22 pagesLa Propriété Littéraire Et ArtistiqueHayat ElmessaouriPas encore d'évaluation
- Droit Des Propriété IntellectuellesDocument39 pagesDroit Des Propriété IntellectuellesLia NadolskiPas encore d'évaluation
- Fiche Boxson 1: Droits D'auteurs Et Droits Voisins en MusiqueDocument27 pagesFiche Boxson 1: Droits D'auteurs Et Droits Voisins en Musiqueboxsonotes100% (2)
- Droit D'auteurDocument42 pagesDroit D'auteurmilk1985100% (1)
- TP N°2: Exploiter Une Base de Données AccessDocument7 pagesTP N°2: Exploiter Une Base de Données Accesszouhour souleiman100% (1)
- Titre 1 Chapitre 3Document25 pagesTitre 1 Chapitre 3souid yasminePas encore d'évaluation
- Droit de (1) ..Document65 pagesDroit de (1) ..FabioDelfiniPas encore d'évaluation
- Propriété IntellectuelleDocument2 pagesPropriété IntellectuellecharpymaximePas encore d'évaluation
- DroitDocument11 pagesDroitJoris FortPas encore d'évaluation
- Cours DplaDocument72 pagesCours Dplanoesavino1Pas encore d'évaluation
- Projet de Propriété IntellectuelleDocument17 pagesProjet de Propriété Intellectuelleisraa meriemPas encore d'évaluation
- Droit de La Propriété IntellectuelleDocument49 pagesDroit de La Propriété IntellectuelleJessy TotoPas encore d'évaluation
- 039 AuteurDocument4 pages039 Auteurparokov478Pas encore d'évaluation
- Droit Des MédiasDocument11 pagesDroit Des MédiasSarra El FekihPas encore d'évaluation
- Droit D'auteur Et Liberte de CreationDocument19 pagesDroit D'auteur Et Liberte de Creationlouis.giraudeau.proPas encore d'évaluation
- Droit de La Propriete Intellectuelle Pme-PmiDocument24 pagesDroit de La Propriete Intellectuelle Pme-Pmiolga100% (1)
- Examen DIHDocument5 pagesExamen DIHimanePas encore d'évaluation
- Propriété IntellectuelleDocument3 pagesPropriété IntellectuelleRoxelane LouPas encore d'évaluation
- Sujet 1 DPIDocument3 pagesSujet 1 DPImargotbottonPas encore d'évaluation
- Null - Pour Fusion PDFDocument16 pagesNull - Pour Fusion PDFGlamby JeanyPas encore d'évaluation
- 06 10 21 Moupfouma 2Document12 pages06 10 21 Moupfouma 2Matilde SchneiderPas encore d'évaluation
- 0 Révision Droit Moral Droit Au Respect 2Document8 pages0 Révision Droit Moral Droit Au Respect 2Max AiméPas encore d'évaluation
- Ulip 28062023Document7 pagesUlip 28062023CataurPas encore d'évaluation
- Le Droit Dauteur Creative Commons Et Les Licences Sur Zeste de SavoirDocument13 pagesLe Droit Dauteur Creative Commons Et Les Licences Sur Zeste de SavoirGbati BASSABIPas encore d'évaluation
- Droit D'auteur - WikipédiaDocument55 pagesDroit D'auteur - WikipédiaRollin LouisnéPas encore d'évaluation
- DROITDocument8 pagesDROITGnimtou POTOKOYEPas encore d'évaluation
- Droit Dauteur 020721 PDocument27 pagesDroit Dauteur 020721 PLeila LASSOUEDPas encore d'évaluation
- Droit D'auteur Et Internet - WikipédiaDocument21 pagesDroit D'auteur Et Internet - Wikipédiaatebafranc258Pas encore d'évaluation
- Recherche Sur Le Droit MoralDocument2 pagesRecherche Sur Le Droit MoralGaelle SandraPas encore d'évaluation
- Industrie MusicaleDocument10 pagesIndustrie MusicaleXinyu ZhouPas encore d'évaluation
- Cours P Inti 1ére, 2 Éme Et 3éme ConférenceDocument25 pagesCours P Inti 1ére, 2 Éme Et 3éme Conférencehamida yefsahPas encore d'évaluation
- La Propriété Intellectuelle Guide DintroductionDocument26 pagesLa Propriété Intellectuelle Guide DintroductionCherif LiliaPas encore d'évaluation
- Droit D'auteurDocument13 pagesDroit D'auteurLatifa OussiiPas encore d'évaluation
- Seance 1Document6 pagesSeance 1christakashouhPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Droit Des MédiasDocument5 pagesChapitre 2 - Droit Des MédiasSarra El FekihPas encore d'évaluation
- Droit AuteurDocument46 pagesDroit AuteurAamy NaaPas encore d'évaluation
- 002CR001Document9 pages002CR001Sa LimPas encore d'évaluation
- Droits de L'informatiqueDocument40 pagesDroits de L'informatiqueBoualem ArasPas encore d'évaluation
- BANKSYDocument3 pagesBANKSYEloi GoursaudPas encore d'évaluation
- TD 3 Propriete Intellectuelle - PDFDocument9 pagesTD 3 Propriete Intellectuelle - PDFDylan MinkomaPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 - Les Titulaires Du Droit D'auteurDocument6 pagesChapitre 2 - Les Titulaires Du Droit D'auteursisoha3272Pas encore d'évaluation
- Cours Magistral de Propriete IntellectuelleDocument36 pagesCours Magistral de Propriete IntellectuelleTodd Pepin KazePas encore d'évaluation
- Introduction 1 Propriete Intelectuelle s5Document6 pagesIntroduction 1 Propriete Intelectuelle s5Zack juristePas encore d'évaluation
- Exposé - Droits D'auteur Et Supports NumériquesDocument5 pagesExposé - Droits D'auteur Et Supports NumériquesOlga ZatéPas encore d'évaluation
- La Propriété Littéraire Et ArtistiqueDocument10 pagesLa Propriété Littéraire Et ArtistiqueSR 010Pas encore d'évaluation
- Droit D'auteurDocument5 pagesDroit D'auteurCalinePas encore d'évaluation
- Guide pratique des droits et du statut des artistes plasticiensD'EverandGuide pratique des droits et du statut des artistes plasticiensPas encore d'évaluation
- RACONTER UNE JOURNEE A - Quoi - Ca - SertDocument4 pagesRACONTER UNE JOURNEE A - Quoi - Ca - SertGina GheorghițăPas encore d'évaluation
- Renou, Louis - Connexion en Védique, Cause en Bouddhique (Upanisad)Document6 pagesRenou, Louis - Connexion en Védique, Cause en Bouddhique (Upanisad)sweelinck0% (1)
- Leçon Augmentée Sur Limparfait 2015 CE2Document4 pagesLeçon Augmentée Sur Limparfait 2015 CE2Kehrli VanessaPas encore d'évaluation
- Les Arabes Du Maghreb Sont Bel Et Bien Des ArabesDocument7 pagesLes Arabes Du Maghreb Sont Bel Et Bien Des Arabesprince mirouPas encore d'évaluation
- Esi Program CpiDocument71 pagesEsi Program CpiwalidrelupoPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire 3 DVPT 4Document2 pagesLecture Linéaire 3 DVPT 4k64pmbr2p5Pas encore d'évaluation
- Drao (Gil Pavao)Document1 pageDrao (Gil Pavao)Mila ChaubahPas encore d'évaluation
- Du Locuteur Au Sujet Énonciateur-LocuteurDocument24 pagesDu Locuteur Au Sujet Énonciateur-LocuteurSami MabrakPas encore d'évaluation
- Méthodologie de L'essai ArgumenteDocument3 pagesMéthodologie de L'essai ArgumenteFrancisco Javier Sancho PueblaPas encore d'évaluation
- Capes-1as (La Lettre Ouverte)Document21 pagesCapes-1as (La Lettre Ouverte)bellasenoraPas encore d'évaluation
- Parlant Julien - Théâtre Et Verbo-Tonale: Vers Une Approche Intégrée de La ProsodieDocument9 pagesParlant Julien - Théâtre Et Verbo-Tonale: Vers Une Approche Intégrée de La ProsodieJulien ParlantPas encore d'évaluation
- Extrait PDFDocument20 pagesExtrait PDFdimitri sandjoPas encore d'évaluation
- Série Corrigée de Révision Concours - Math Arithmétique - Bac Toutes Sections (2014-2015) MR Amine TOUATIDocument19 pagesSérie Corrigée de Révision Concours - Math Arithmétique - Bac Toutes Sections (2014-2015) MR Amine TOUATIlelibPas encore d'évaluation
- LéditorialDocument3 pagesLéditorialElizabeth Ramírez NietoPas encore d'évaluation
- Les Differentes DicteesDocument17 pagesLes Differentes DicteesMariel SoviPas encore d'évaluation
- Wxtrack FRDocument11 pagesWxtrack FRJose FajardoPas encore d'évaluation
- Exploitation de Texte 1-2Document3 pagesExploitation de Texte 1-2koulaiPas encore d'évaluation
- 6 - Les Pays Et Leurs Nationalités (Avec Corrigés)Document4 pages6 - Les Pays Et Leurs Nationalités (Avec Corrigés)Naomi NicolauPas encore d'évaluation
- EL COMEJEN - Alto Sax.Document3 pagesEL COMEJEN - Alto Sax.leonardo CapinePas encore d'évaluation
- Resume PDFDocument1 pageResume PDFNassima BouPas encore d'évaluation
- 02 TrigonometrieHyperboliqueDocument2 pages02 TrigonometrieHyperboliqueibouPas encore d'évaluation