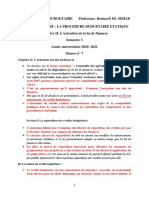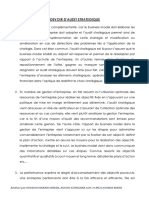Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Contrôle Administratif Juridictionnel Finances Publiques Dioukhane Abdourahmane
Contrôle Administratif Juridictionnel Finances Publiques Dioukhane Abdourahmane
Transféré par
bravorTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Contrôle Administratif Juridictionnel Finances Publiques Dioukhane Abdourahmane
Contrôle Administratif Juridictionnel Finances Publiques Dioukhane Abdourahmane
Transféré par
bravorDroits d'auteur :
Formats disponibles
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.)
Ecole Rgionale Suprieure de la Magistrature
(E.R.SU.MA.)
FORMATION DES MAGISTRATS DES .JURIDICTIONS FINANCIERES
NATIONALES ET REGIONNALES DE L'ESPACE OHADA
Thme : Le contrle administratif et juridictionnel des finances publiques
du 26 au 30 octobre 2009
Par:
M. DIOUKHANE Abdourahmane,
Commissaire du droit prs la Cour des comptes,
Maitre de Confrences la Facult
des Sciences Juridiques et Politiques
de l'Universit Cheick Anta Diop de Dakar,
ERSUMA. 02 B.P 358 Porto-Novo RpubHque du Bnin Tl : {229) 20 24 58 04
Fax. : (229) 20.24-82.82 E-mail: eersuma@yahoo.fr Site Web: http:flwww.ersuma.bj.refer.org
CONTROLE JURIDICTIONNEL
DES FINANCES PUBLIQUES
PLANI
PREMIERE PARTIE : Le contrle des comptes des comptables publics
CHAPITRE 1 : Le contrle des comptes des comptables patents
SECTION 1 : Les contrles pouvant dboucher sur la RPP
SECTION II. La procdure de mise en jeu de la RPP
CHAPITRE II : Le contrle des comptes des comptables de fait
SECTION 1 : La notion de gestion de fait
SECTION II : La procdure de la gestion de fait
SECTION III : L'apurement du compte de la gestion de fait
DEUXIEME PARTIE : Le contrle de la gestion des ordonnateurs
PLAN II
PREMIERE PARTIE : Le contrle des comptes des comptables publics
CHAPITRE 1 : Le contrle des comptes des comptables patents
SECTION 1 : Les contrles pouvant dboucher sur la RPP
Les contrles auxquels les comptables publics sont tenus
A. En matire de dpenses
B. En matire de recettes
,-[2. Les cas d'ouverture de la RPP
A. Les cas objectifs:
B. Un cas subjectif: la faute du comptable
SECTION II. La procdure de mise en jeu de la RPP
,-[1er. Les caractres de la procdure
A. Une procdure
B. Une contradiction crite :
,-[2. Les tapes de la procdure
A. Les tapes pralables la dcision
B. la dcision
CHAPITRE II : Le contrle des comptes des comptables de fait
SECTION 1 : La notion de gestion de fait
,-[1. Les conditions d'tablissements de la gestion de fait
A. Des oprations destines tre effectues par
un comptable public :
B.L'absence d'habilitation lgale
,-[2. Le primtre de la gestion de fait
A. Quant aux personnes
B. Quant au montant et la dure
SECTION II: La procdure de la gestion de fait
L'ouverture de l'instance
2
A. Par rquisitoire du ministre public
B. Par saisine d'office de la juridiction
1J2. La dclaration provisoire de la gestion de fait
~ 3 La dclaration dfinitive de la gestion de fait
A. Les effets
B. L'amende pour gestion de fait
SECTION III : L'apurement du compte de la gestion de fait
~ 1 e r La production du compte
A. Prsentation du compte en la forme
B. Prsentation du compte en la teneur
~ 2 La fixation de la ligne de compte
A. Les oprations retenir
B. La fixation du solde
~ 3 La fin de la procdure
1J4. Les voies de recours
3
INTRODUCTION
CONTROLE JURIDICTIONNEL
DES FINANCES PUBLIQUES
-Contrle administratif au sens de contrle interne 1' Administration
-Contrle juridictionnel : contrle exerc par une juridiction
-Plusieurs juridictions interviennent en matire financire
*Des juridictions occasionnelles :
Le CE l'occasion du contrle exerc sur la juridiction
financire, par la voie de la cassation ~ la juridiction des
comptes= juridiction administrative
Le Conseil constitutionnel 1' occasion du contrle de la
constitutionnalit des LF
*Une juridiction spcialise
-Organisation de la juridiction financire :
*Un juge unique : comptent pour connatre de
1 'ensemble du contentieux financier c'est--dire relatif la phase
adtrive et phase comptable de 1' excution du budget
ex : Cour des comptes du Sngal, du Burkina, etc.
*Un juge clat : ex : France
Cour des comptes : compte de 1 'Etat et des EP nationaux
dots de CP
CRC et CTC : comptes des tollectivits territoriales
CDBF: contrle de la phase additive (sanction des fautes
de gestion)
-Contenu du contrle juridictionnel
*Directive LF (article69) :
Jugement des comptes des comptables publics
Contrle de la gestion (contrle administratif)
Sanction des fautes de gestion
Contrle de l'excution des LF
-Pour la prsente prsentation :
Limiter le contrle juridictionnel aux contrles dont les procdures
dbouchent sur une dcision revtue de l'autorit de la chose
j u g ~
contrle des comptes des comptables publics
contrle de la gestion des ordonnateurs et de la phase
administrative de l'excution de la loi des finances, de
faon gnrale
NB : Ce dernier aspect ne sera pas dvelopp pour des
contraintes de temps, chacun des aspects de contrle peuvent,
lui seul, faire l'objet d'une session de formation.
1
PREMIERE PARTIE : Le contrle des comptes des comptables publics
-2 catgories d'oprations financires excutes par les CP
*Oprations budgtaires
Retraces dans le budget travers 3 comptes
(BG, BA et CST)
Excutes selon une procdure faisant intervenir plusieurs
acteurs:
-les administrateurs des crdits : font des propositions
d'engagement (systme UEMOA, avec exception Mali)
-les ordonnateurs : ont la dcision en matire financire
-les comptables : excutent les oprations
*Oprations de trsorerie
Oprations hors budget (retraces dans des comptes de
trsorerie), soumises des rgles spcifiques (exp le : les
emprunts court terme)
Excutes sous la seule responsabilit du Trsor (pas
d'mission de titre)
-Toutes peuvent engager la responsabilit du CP
-De mme, toute personne qui s'immisce dans l'excution de ces
oprations peut tre appele compter devant le juge des comptes
2
CHAPITRE 1 : Le contrle des comptes des comptables patents
SECTION 1 : Les contrles pouvant dboucher sur la RPP
~ 1 Les contrles auxquels les comptables sont tenus
(art.14 Dir. 06/97)
A. En matire de dpenses
-Transmission ordre de payer par l'ordonnateur
-Vrification pralable par le CP que les oprations effectues par
1' ordonnateur sont rgulires (rle de payeur) avant d' ouvrir sa
caisse (rle de payeur)
Les comptables ne sauraient, sans manquer gravement leurs
obligations, prsumer de la seule mission d'un mandat de
paiement, la rgularit de la dpense
( C. Comptes, arrt du 20 septembre 1973, Cazenave et Mazerolle)
1. Le contrle du comptable payeur
a. Les lments certains
al. La qualit de l'ordonnateur ou de son dlgu
-Contrle de la qualit des signatures des mandats.
-Possibilit pour l'ordonnateur de dlguer
-Refus de payer si, par exemple :
*la dlgation est absente
*elle porte sur une matire qui ne peut tre dlgue
*le dlgataire n'exerce pas personnellement la comptence dlgue
(ex. pice signe par le 1er adjoint alors que le conseil municipal
avait fait dlgation au maire)
a2. L'exacte imputation de la dpense
-Vrifier que l'objet et la nature de la dpense sont conformes
l'intitul de la ligne budgtaire
-Contrle limit l'imputation au niveau du chapitre budgtaire car
c'est l'unit de spcialisation des crdits
(C. comptes, 7 octobre 1993, Ancien trsorier municipal de Marseille).
a3. La disponibilit des crdits
-L'autorisation budgtaire en dpense est assorti d'un plafond, sauf pour
les dpenses couvertes par des crdits valuatifs.
-La disponibilit des crdits s'apprcie au niveau du chapitre
-Avant de payer, le CP doit vrifier que sur le chapitre qui supporte
la dpense, il ya des crdits suffisants ---?
1' ouverture de crdits doit intervenir pralablement la dpense et non
titre de rgularisation
-Quand le dpassement concerne des dpenses d'ordre, la responsabilit
du comptable ne sera pas engage car ce sont des dpenses qui ne
donnent pas lieu dcaissement. Autrement dit, il n'y aurait pas de
dpenses qui auraient t irrgulirement payes
(C. comptes, arrt du 25 octobre 2001, Maison des enfants de Meaux).
3
a4. La validit de la crance :
Comporte:
-La justification du service fait
*le CP ne contrle pas la ralit du service fait
*il s'assure seulement que l'ordonnateur l'a certifi
-L'exactitude des calculs de liquidation
*Objet de la liquidation : vrifier la ralit de la dette et arrter
le montant
*Pas de vrification de la rgularit juridique de l'opration
*On vrifie seulement son exactitude matrielle :
Si la date est correcte
Si l'addition ou la multiplication sont correctes, etc.
-L'intervention pralable des contrles, autorisations, visas, avis, etc:
*Vrifier que le visa du CF est bien oppos sur l'ordonnance
ou le mandat de paiement
*Vrifier que la dcision qui fonde la dpense a t transmise au
contrle de lgalit, comme pour les actes caractre financier
des CL, etc.
-La production des justifications :
*L'inscription d'une dpense au budget d'une collectivit
publique ne vaut pas dispense de produire la pice justificative.
(C. comptes, 3e ch., arrt du 4 dcembre 2000, Institut
de France)
*La pice justificative est la pice qui, selon les nomenclatures
tablies par le ministre charg des finances, doit tre fournie
pour les dpenses d'une catgorie dtermine.
*Quand les nonciations d'une pice justificative paraissent
insuffisantes ou imprcises, le CP doit suspendre le paiement et
demander l'ordonnateur la production d'un CA pour les
complter
*Cas des dpenses payes avant ordonnancement:
*Gain de temps avec suppression de l'intervention
pralable de 1 'ordonnateur
*Mais le CP doit produire les justifications censes exister
au moment du paiement
b. Les lments hypothtiques
bl. La sincrit de la dpense
-Rappel du principe:
*pas de contrle de la ralit du service fait
*mais seulement de sa certification par l'ordonnateur
Raison= les ordonnateurs sont responsables des certifications
qu'ils dlivrent
*c'tait la solution au 19e sicle
-Ds 1907 (arrt Nicolle), le CE met enjeu la responsabilit du CP qui a
4
pay sur pice fausse alors mme que la fausset a t tablie aprs le
paiement.
-Solution actuelle :
*Refus de payer s'il possde la preuve que la certification est inexacte
*ex: Chambre territoriale des comptes de Nouvelle Caldonie,
jugement du 3 septembre 1998, Si vu de la Cte-Ouest
Le comptable aurait d refuser de payer les traitements d'un matre-
nageur ds lors qu'il savait, par le fait qu'il payait les factures de
construction, que la piscine n'tait pas encore en fonctionnement
b2. L'utilit publique de la dpense
-Ce n'est pas l'opportunit
N.B :pour l'opportunit de la dpense, les ministres dpendent
exclusivement du Parlement
-Exemple de cas dans lequel se pose la question de l'utilit (ou du
caractre)
publique de la dpense: frais de transport et de sjour pays l'pouse
d'un maire
-Position de la jurisprudence :
*Il faut que l'absence d'intrt public de la dpense soit manifeste
pour que le comptable puisse refuser de payer
*Plus concrtement: l'objet de la dpense doit tre manifestement
tranger au chapitre d'imputation
(CE, 30 juillet 2003, Marty)
b3. La lgalit de la dpense
-Le principe :
Le comptable payeur n'est pas juge de la lgalit des dcisions
administratives fondant les mandatements
(C. comptes, 28 mai 1952, Commune de Valentigney)
-L'exception:
L'incomptence de l'auteur del 'acte
... s'il n'appartient pas au comptable de se prononcer sur la lgalit de
la dcision ... il lui revenait, en revanche, sans excder les limites de son
propre contrle, de relever que cette dcision tait irrgulire dans la
mesure o elle tait prise par une autorit incomptente
(C; comptes, 23 fvrier 1999, Caisse des Ecoles de Chambois)
c. La sanction du contrle (art. 69 al 2 et suivant)
-Ordre de paiement rgulier : visa bon payer appos par le CP
-Dans le cas contraire :
*Suspension du paiement, motiver
*Possibilit pour l'ordonnateur de le requrir de payer,
motiver aussi
*Des cas dans lesquels la rquisition de paiement ne joue pas :
absence de justification du service fait
indisponibilit des crdits
caractre non libratoire du paiement
5
2. Le contrle du comptable caissier
a. le contrle du caractre libratoire de la dpense
-Paiement non libratoire si le CP paie au profit d'une personne autre que
le vritable crancier ou son reprsentant dment habilit
Ex: on paie X alors qu'on devait y (erreur sur la personne)
Ex: paiement une entreprise d'une facture tablie au nom
d'une autre socit
b. L'existence d'oppositions
-C'est une procdure de recouvrement ;
-Elle est notifie au CP par le titulaire d'une crance sur le crancier de
1' organisme public :
Exl :transport (cession) de crance
Ex2 : saisie-arrt
c. L'application des rgles de la compensation
et de la prescription (art. 53 Dir.06/97)
-Situation correspond la compensation :
*L'organisme public doit un tiers (paiement d'une fourniture par
Exemple)
*Le tiers, en mme temps, lui doit (paiement d'un impt, par
exemple)
-Le CP : obligation de compenser
-Le tiers ne peut pas opposer l'Administration la compensation
-Raison: exclusion des voies d'excution force contre les personnes
Publiques
B. En matire de recettes
1. Le contrle de la mise en recouvrement des crances
-Pas de titre de recette et le CP a connaissance de l'existence d'une
crance publique mettre en recouvrement
-Obligation pour le CP d'alerter l'ordonnateur qu'il ya des recettes
mettre en recouvrement
-C'est une obligation dans la limite des lments dont dispose le CP
Ex 1 : non recouvrement sur des locataires de sommes rsultant
d'un bail: loyers, charges, TOM, etc;
Ex2 : vote de nouveaux droits d'entre au mus non appliqus la
date prvue
-La mise en recouvrement proprement dite incombe l'ordonnateur qui
doit mettre le titre sans lequel le CP ne pourrait agir.
2. Le contrle du recouvrement
a. L'autorisation de percevoir la recette
-Supports de la recette
*les lois (impts, taxes) et les rglements (rmunrations pour
services rendues, taxes parafiscales, etc.)
6
*les dcisions de justice
*les conventions
-Objet du contrle : vrifie que :
*la perception de la recette est autorise par l'autorit comptente et
*dans les formes requises
(C. comptes, 14 et 28 octobre 1971, Cazenare et Mazerolles)
-Limite du contrle :
*pas de contrle du bien-fond d'un titre de recette rgulirement
mis.
b. Le contrle de la liquidation
-Diffrence avec le contrle de la dpense :
Le CP n'est pas expressment responsable de l'exactitude des calculs
de liquidation (art. 14.a
c. Le contrle des rductions et annulations
de recettes
-Ce n'est pas un contrle de fond car:
*il s'agit de remises gracieuses---+
*relvent de l'opportunit
-C'est un contrle de forme:
*S'assurer que la remise n'tait pas prohibe par les textes
*S'assurer de l'existence d'une dlibration de l'instance comptente
pour accorder des rductions ou annulations de recettes
*Du respect par l'ordonnateur des limites de l'habilitation reue de
1 'instance comptente
-Objet:
*Corriger les erreurs d'assiette ou de liquidation
*Constater le caractre ind, total ou partiel, de la crance telle
qu'elle est retrace dans le titre
1f2. Les cas d'ouverture de la RPP (art. 80 Dir. 05/97)
Ce peut tre :
-Du fait du CP lui-mme ou
-Du fait d'autrui :
*Subordonns ou mandataires---+ responsabilit de plein droit
*Comptables secondaires---+ responsabilit dans la limite des
contrles qu'il est tenu d'exercer et de l'exacte centralisation
des oprations
A. Les cas objectifs:
1. En matire de dpenses
-Responsabilit du CP engage en cas de dpense paye irrgulirement
-L'irrgularit s'apprcie la date du paiement---+
Une rgularisation aprs le paiement n'efface pas l'irrgularit
2. En matire de recettes
a. Absence de recouvrement d'une recette ou de
justification de son non-recouvrement
7
-Le titre de recette doit tre pris en charge par le CP pour que sa
responsabilit puisse tre engage
(C. comptes, arrt du 25 mai 1993, AP de Marseille)
-Prise en charge du titre de recette
*Non-recouvrement de la recette engage sa responsabilit
C'est une prsomption de responsabilit
Le CP ne peut dgager sa responsabilit qu'enjustifiant le
non-recouvrement
*Procdure de justification du non-recouvrement d'une recette
prise en charge
Prsentation d'un tat dtaill des RAC.
L'tat des RAC doit tre annot des diligences effectues
pour le recouvrement
-Formes des diligences:
-adquates : adaptes la nature de la crance et aux circonstances
de la cause:
expie: ne pas faire apposition auprs des organismes
dbiteurs des allocations logement servis des
locataires dfaillants
-compltes : utiliser tous les moyens lgaux de recouvrement
expie : ne pas se contenter de commandements interruptifs
de prescription
-rapides :propres parvenir la disparition ou 1 'insolvabilit du
redevable, la prescription de la crance
-En cas d'insuccs des diligences
-le CP peut demander l'admission en non-valeur des crances
concernes
-effet de 1' ANV :
Quand elle est dcide par l'ordonnateur, le CP sort de ses
critures les crances concernes
Mais l' ANV ne lie pas le juge des comptes
b. Le problme de la dtermination du comptable
charg du recouvrement en cas de succession
de comptables
-Problme du fait du jeu des rserve des comptables successifs et de la
date laquelle la crance est devenue irrcouvrable.
-Solutions successives
*Responsabilit solidaire du dfaut de recouvrement
*Imputer la responsabilit un seul comptable en examinant s'il a
fait usage de sa facult d'mettre des rserves sur la gestion de
son prdcesseur
*Partager les responsabilits entre les comptables successifs :
Chacun n'est personnellement responsable que de la gestion
Le juge des comptes procde une tude comparative des
diligences et des effets de leurs ngligences
8
B. Un cas subjectif: la faute du comptable
-Principe classique :
*Le juge des comptes juge les comptes
*Le ministre des finances juge les comptables
-Signification :
*Responsabilit du CP devant le juge des comptes: responsabilit
objective
*Le fait que le CP ait ou non commis une faute n'entre pas enjeu
-Par exception ce principe : responsabilit du CP engage si par sa
faute, 1' organisme public a d indemniser une autre personne
Ex: refus d'un CP de payer un commis d'office obligeant
l'administration d'acquitter cette dette (CRC Lorraine, 18
janvier 2001, Lyce Emest-Brichet)
SECTION II. La procdure de mise en jeu de la RPP
111er. Les caractres de la procdure
A. Une procdure contradictoire
1. La signification
-Prsident Odent :
Dire de la procdure qu'elle est contradictoire signifie que des
juges ne peuvent pas faire intervenir dans leurs dcisions des faits,
des actes ou des renseignements que les personnes directement
intresses n'auraient pas t mises mme de connatre et de
discuter
-Application dans la procdure de contrle des comptes des CP: rgle de
la double dcision :
*une premire dcision provisoire
Si l'instruction rvle des irrgularits ou des omissions-
Une dcision provisoire lui enjoint de fournir les
justifications
La dcision provisoire, notifie au comptable, marque le
dbut de la contradiction
2. Les problmes poss
-Principe du contradictoire
Tous les faits, actes ou renseignements devant intervenir dans la
dcision du juge doivent tre connus et discuts par les parties
-Dans le cas du jugement des comptes des CP :
*L'accs aux pices justificatives produites l'appui du compte de
gestion en jugement ne pose pas de problme de communicabilit
*La communication des rserves faites sur le compte en jugement
par le prdcesseur du comptable qui a rendu le compte :
Elles doivent tre communiques si elles constituent un
lment nouveau dans la procdure
*La communication des rapports d'instruction:
Position du CE franais :
Incommunicabilit car le rapport ne constitue pas une
9
pice de procdure mais participe la fonction de juger
(24 fvrier 2003, Perrin et Deltana)
*La communication des conclusions du Parquet :
Quand le Parquet est partie au procs : indiscutable (en
matire d'amende par retard)
Quand il est magistrat indpendant (il donne un avis)
Position du CE franais
-Le Parquet financier ne dfend pas les intrts de la
collectivit publique
-Ds lors, ses conclusions sont de simples avis.
B. Une contradiction crite :
1. La signification
-A partir de l'arrt provisoire, communication juge/comptable
uniquement par crit.
*Impossibilit pour le CP de venir devant son juge discuter de vive
voix les irrgularits qu'on lui oppose.
*Les plaidoiries ne sont pas caractre secret de la
procdure
2. Les problmes poss
-En l'tat, le caractre crit de la procdure exige que dans sa dcision,
le juge
*Non seulement rponde tous les arguments du CP
*Mais qu'il n'introduise pas d'lments nouveaux dans la dcision
dfinitive ...
-Le fait qu'il n'y a pas le droit audition au profit du CP avant la dcision
dfinitive, le fait que les audiences sont huis clos, posent le problme de
leur conformit avec les exigences d'un procs quitable
Remarque 1:
*Influence de la jurisprudence de la CEDH
*Suppression de beaucoup de rgles de procdure: en France
-Participation du rapporteur au dlibr
-Incommunicabilit des rapports et des conclusions
-Huis clos
-Rgle de la double dcision
-Confusion des fonctions de poursuite et de jugement
Remarque 2:
*Transposabilit de ces volutions dans nos pays
*Fondement: nos constitutions consacrent la notion de procs
quitable car leurs prambules font rfrence la Dclaration
universelle de 1948 qui a pos le principe du procs quitable.
Les tapes de la procdure
A. Les tapes pralables la dcision
1. La production du compte en tat d'examen
-Qui doit produire le compte ?
10
*Question rgle par les rglementations nationales
*Cas du Sngal:
compte tabli par le comptable en fonction la clture de
l'exercice (art. 20 al2 du decret d'application de la loi sur la
CC)
plusieurs CP se sont succd, un compte commun est tabli
est rendu par celui en fonction la clture de l'exercice.
Celui-ci peut faire des rserves sur la gestion de son
prdcesseur
-Un compte en tat d'examen:
*Etabli en forme rgulire
*Et accompagn des pices
gnrales et
justificatives, prvues par les rglementations
-Il y a un dlai rglementaire pour produire le compte en tat d'examen
-Le comptable rendant est passible d'amende
*En cas de retard dans la production de compte
*Et en cas de compte produit dans le dlai mais non en tat
d'examen
-Pour le respect du dlai de dpt, le comptable doit envoyer temps son
compte de gestion l'autorit charge de la mise en tat d'examen.
2. L'instruction
-Examen des comptes et des pices qui 1' accompagnent
-Instruction comporte :
*Des changes de correspondances avec le comptable
*Eventuellement complts par des vrifications et auditions sur
place
-En cas d'entrave l'instruction, possibilit de sanctionner l'auteur
d'amende.
3. La Communication du dossier au ministre public
-Dossier= liasse et rapport
-Vrifier les faits= mais ce n'est pas une contre-instruction
*On n'interroge pas le comptable
*Il n'y a pas de dplacement
*Vrifier seulement que les faits sont correctement poss
-Les problmes juridiques= vrifier
*S'ils sont bien poss
*Et que le droit est bien appliqu
-Rsultat : conclusions
*Porte = simple avis
*Sauf en matire d'amende: les conclusions sont des demandes sur
lesquelles le juge des comptes est oblig de statuer
4. Le contre-rapport
-Gnralement, il n'est connu du juge que sous sa forme orale
-Intrt du CR :
11
*Appartient la formation de jugement ( art.l4 dcret
d'application)
*Il peut provoquer exceptionnellement des mesures
supplmentaires d'instruction.
*Il labore son CR au vu du rapport et des conclusions du
Parquet et les formations de jugement sont souvent trs sensibles
ses arguments
B. la dcision
Aprs instruction, 2
Le juge statue dfinitivement par un
seul arrt ou
Rend un arrt provisoire---1- double arrt
1. Le cas o le juge statue dfinitivement
par un seul arrt
-Hypothse o l'instruction initiale n'a retenu aucune irrgularit
sur le compte----. arrt blanc c'est--dire sans charges.
-Les jugements sans charges supposent, pour assurer la scurit juridique,
la mise en uvre pralable de diligences minimales :
*Etat de mise en examen
*Examen des rserves, etc.
-Dcharge du comptable si :
*Apurement des dbets antrieurs
*Reprise des soldes et fixation de la ligne de compte
2. la double dcision
a. La dcision provisoire
-L'instruction initiale rvle des irrgularits ---1-
-Des charges sont leves contre le comptable :
*des injonctions: on somme le comptable de produire des
justifications, complmentaires ou marquantes
NB :Quand l'irrgularit est mineure ---1- injonction pour l'avenir
sorte d'avertissement
*des rserves : le juge suspend sa dcision jusqu'
l'accomplissement d'une formalit
-Possibilit de plusieurs arrts provisoires
*Hypothse: les rponses du comptable amnent le juge changer
de motifs et formuler une autre injonction
*Justification : exigence respect du contradictoire dfaut, censure
ventuelle du juge de cassation
b. La dcision dfinitive
-Dcharge: conditions
*Le CP a satisfait toutes les charges retenues contre lui
*Le juge a constat l'exacte reprise des soldes en balance d'entre
du compte de 1 'exercice suivant
NB : Dcharge + quitus si, entre temps, le comptable est sorti de
Fonctions
12
-Le juge peut dclarer le comptable en avance
*Hypothse : le CP s'est reconnu tort dbiteur envers le Trsor
*Hypothse trs rare
-Dbet:
*Hypothses :
Le CP ne rpond pas aux injonctions
Il y rpond mais hors dlai
Il y rpond dans le dlai mais ses arguments ne
convainquent pas le juge
*Consquence: mais en dbet du comptable
*Il est constitu dbiteur vis--vis de la collectivit de la
somme gale au manquant en caisse (montant de la dpense
irrgulirement paye, de la recette non recouvre, etc.)
*La dcision est revtue de la formule
En 1' absence de reversement spontan le dbet peut tre
recouvr par toutes les voies de droit.
*Le CP peut obtenir du ministre charg des finances
Soit dcharge de responsabilit, en cas de force
majeure (exples =incendie, vol main arme, guerre)
Soit remise gracieuse du dbet, totale ou partielle
(en tenant compte de la situation patrimoniale ou
d'autres faits, comme la maladie)
-Problme du dlai entre la dcision provisoire et la dcision dfinitive
*Etat actuel du droit :
Il y a un dlai impos au comptable pour le dpt
de son compte de gestion
Mais aucun dlai n'est imparti au juge des comptes pour
le juger
*Nouvelle Directive relative aux lois de finances
Les comptes dposs en tat d'examen doivent tre jugs
dans un dlai de 5 ans
NB: France:
Il est arriv que 10 ans se soient couls entre
l'arrt provisoire et l'arrt
prjudice pour le CP
Solution:
Le CP est automatiquement dcharg de sa
gestion si aucune charge n'est leve contre lui
5 ans aprs le dpt de son compte.
C. Les voies de recours :
Exemple du droit sngalais = 2 cas
1. La rvision
a. La rvision la demande du comptable
-Il doit s'agir d'un arrt dfinitif sur les irrecevabilit des
demandes en rvision portant sur
13
des arrts dfinitifs condamnant le CP l'amende
des dclarations dfinitives de GF
-L'erreur doit tre simplement matrielle:
erreur de fait ou
erreur de calcul
-Les pices justificatives recouvres et produites par le comptable au
soutien de sa demande en rvision
doivent tre antrieures l'arrt contest
et n'avaient pas t produites lors de la premire instance qu'
cause de circonstances de force majeure (sinon caractre prcaire
des dcisions du juge)
-Pour cause
*D'erreur
*Omission
*Faux
b. La rvision hors la demande du comptable
*Double emploi
-D'office par le juge des comptes l'occasion de la vrification des
comptes suivants ou de celle des comptes d'un autre organisme public.
NB : Le juge des comptes peut aussi, en dehors de la procdure de
rvision d'office de ses arrts, procder d'office la
rectification d'erreurs purement matrielles sans rfrence aux
dispositions rgissent la rvision. C'est une procdure qui
existe sans texte et n'est soumise aucun formalisme
(cfC.comptes, 17 fvrier 1999, Receveurs des impts du Var)
-A la demande du ministre charg des finances ou de reprsentants
d'organismes publics.
NB :C'est la formation dlibrment qui a rendu le 1er jugement
qui doit procder sa rectification (Chambre, section de
chambre, etc.)
2. La cassation
-Devant le CE--+ la juridiction des comptes= juridiction administrative
spcialise
-Cassation
*Avec renvoi--+ l'affaire est juge par les CR
*Sans renvoi :
le juge de cassation voque l'affaire
cassation sans renvoi ni vocation : expie : affaire Labor
Mtal juge par le CE
Pas de renvoi car laC. des comptes a t dclare
structurellement partiale
Pas d'vocation : les erreurs de procdures sont telles
que toute la procdure est irrmdiablement vicie
14
CHAPITRE II : Le contrle des comptes des comptables de fait
-Origine jurisprudentielle
* 1871 : incendie des archives de la Cour des comptes
disparition des premiers arrts sur la GF
1er arrt parvenu : 23 aot 1884 relatif la ville de Roubaix
*Construction jurisprudentielle consacre par la suite par des
dispositions lgislatives et rglementaires.
-But: contrepartie au fait que la Cour des comptes n'a pas juridiction sur
les ordonnateurs
par une amende l'immixtion dans les fonctions
de CP
Coloration pnale car souvent la GF : montage pour
des dtournements.
SECTION I : La notion de gestion de fait
1fl. Les conditions d'tablissements de la gestion de fait
A. Des oprations destines tre effectues par
un comptable public :
-Les textes ne font plus rfrence la notion de deniers publics. C'est
1 'exercice des fonctions de CP qui fonde la comptence du juge (art. 88
Dir. 05/97)
-Une GF ne peut porter que sur des deniers c'est--dire des fonds ou
valeurs de portefeuille (ex : titre de crance)
-Exclusion de la procdure les concours non financiers: exple: mise
disposition de locaux ou de personnels
-2 faits gnrateurs d'une gestion de fait
1. L'ingrence dans l'encaissement de recettes publiques
-Fonds encaisss: fonds destins la caisse d'un CP
-Problme des recettes illgalement perues:
*Doctrine classique :
Incomptence du juge des comptes
Fondement: un recouvrement dpourvu de base lgale ne
peut revtir le caractre de deniers publics
*La solution jurisprudence dominante
Position contraire
Fondements :../"'
1 'apparence de rgularit des perceptions
----...... Notion de service public apparent
Application :
-d'abord aux perceptions illgales effectues par les CP
-extension celles effectues par des personnes sans
titre lgal
2. L'extraction irrgulire de fonds de la caisse d'un CP
De cet aspect ont dcoul 2 thories :
-Thorie du mandat fictif :
15
*le mandat existe bel et bien
*la fictivit : les nonciations portes sur le mandat ou les factures
ne correspondent pas la ralit du service fait
le mandat ne correspond pas la dpense
la dpense n'existe mme pas
-Thorie des subventions fallacieuses :
* 1 'association bnficiaire de la subvention manque en ralit
d'autonomie par rapport la collectivit qui a accord la
subvention ~ association transparente ~
*les fonds verss sont utiliss en ralit sur dcision de la
collectivit versante ~ i l ya extraction irrgulire de fonds
publics.
B.L'absence d'habilitation lgale
1. L'habilitation= le titre de comptable public ou
comptable patent (rgulirement nomm)
Cas d'un comptable dont la nomination a t annule par le juge
Administratif
*Perte rtroactive de son titre lgal
*Il a t constitu CF
(Cour des comptes, 25 novembre 1999, Universit franaise
du Pacifique)
2. Les autres habilitations :
a. les mandataires ou subordonns agissant pour
son compte et sous son contrle
b. les comptables intrimaires
c. les rgisseurs
l(f2. Le primtre de la gestion de fait
A. Quant aux personnes
1. Le principe:
Comptence d'ordre p u l i c ~
Comptent pour tous les actes de comptabilit publique,
quel qu'en soit l'auteur
2. L'application du principe : sont concerns :
a. celui qui a mani ou dtenu personnellement
les fonds publics
b. celui qui ordonn ou organis le maniement
c. des tiers :
ex: l'entrepreneur qui dlivre de fausses
factures
d. les personnes bnficiant d'un rgime spcial de
responsabilit : exemple : les ministres
16
e. les personnes morales
B. Quant au montant et la dure
-Condition d'une GF= tablir le maniement ou la dtention de recettes
publiques ___.
*Fixer la date prcise laquelle les recettes publiques sont connues
avec certitude et prcision ___. dclarer la GF partir de cette date
jusqu' la date laquelle les oprations irrgulires ont pris fin.
*Fixer galement le montant de la GF
-Difficult rencontres par le juge, parfois :
*Distinguer dans la masse des recettes, les fonds caractre public
Solution possible : rendre compte de 1' ensemble des oprations
(C. comptes franaise, 26 septembre 1996, Universit Pierre et
Marie Curie (Paris VI)
*Anciennet des faits ___.
Impossibilit de reconstituer les oprations ___.
Solutions possibles
-non-lieu
-limiter la priode la GF
SECTION II : La procdure de la gestion de fait
1Jl er. L'ouverture de l'instance
A. Par rquisitoire du ministre public
-A son initiative ou,
-Sur communication manant de certaines autorits comme :
*Les ministres
*Les reprsentants lgaux des organismes soumis au contrle de la
juridiction financire
*Les autorits de tutelle de ces organismes
-Il n'a pas un pouvoir de classement, sauf concernant les affaires dont il
est saisi et qui sont manifestement trangres au domaine de la GF
(cfNote sous CE, 2 mars 1973, Mass GAFJ, p86, notel)
B. Par saisine d'office de la juridiction
-Occasion : les constatations faites lors de la vrification des comptes
-C'est une obligation pour la juridiction financire de dclarer les
gestions qu'elle dcouvre ou qui lui sont dfres par le ministre public
(cfNote sous Cour des comptes, 30 septembre 1992, Nucci)
-Mais aucune disposition lgislative ou rglementaire ne l'impose quand
la demande de dclaration de GF mane d'un particulier
(cf CE, 20 mai 1979, Guillemin Re. C. comptes p 245)
-Dcouverte de faits prsums constitutifs de GF lors des vrifications=
Le rapporteur propose l'ouverture de la procdure
*Soit dans une observation du rapport
*Soit dans un rapport distinct
1f2. La dclaration provisoire de la gestion de fait
-Dclaration provisoire de la GF et injonction de production du compte de
17
la GF dans un dlai dtermin partir de la notification de la dcision.
-Deux hypothses:
*Production du compte sans rserve:
Acquiescement la qualit de CF
Le juge statue sur le compte titre dfinitif.
*Contestation de la dcision provisoire :
Respect des droits de la dfense
Examen des moyens : 2 hypothses
-dclaration de non-lieu GF
-maintien de la GF
1f3. La dclaration dfinitive de la gestion de fait
A. Les effets
-Cristallisation de la procdure
-Le CF est assimil dsormais un CP
-Mmes obligations et responsabilits
--4 obligation de production d'un compte de la GF
--4 Gestion de fait dfinitivement tablie= possibilit d'une
amende pour GF
B. L'amende pour gestion de fait
-Obstacles au prononc de l'amende:
*Le comptable de fait est dj poursuivi pour les mmes faits au .
pnal (cf, article 25 LOCC du Sngal)
que les poursuites aient ou non dbouch sur une condamnation
(cf Cour des comptes franaise, arrt du 24 octobre 1952, M.
Bazin)
*Le comptable de fait est dj condamn par le juge de la discipline
financire pour les mmes faits
(cf. C. des comptes, arrt du 13 septembre 1991, Frogier)
-Si le prononc de l'amende est possible :
*Le juge des comptes peut ne pas y recourir
*S'il dcide d'y recourir:
L'amende doit tre d'abord fixe titre provisoire (respect
de la contradiction)
Le montant ne peut tre fix au plus tt qu'aprs fixation de
la ligne de compte car il ne peut tre suprieur au total des
sommes indment manies ou dtenues
Pour motiver le montant fix, le juge des comptes prend en
compte certains lments prvus par la loi, comme
1' importance et la dure de 1 'opration
Cette apprciation et insusceptible d'tre discute devant le
juge de cassation (cf franais, arrt du 16 juin 1999, Trucy)
SECTION III : L'apurement du compte de la gestion de fait
-En cas de non production du compte dans le dlai imparti par le juge des
Comptes --4 amende pour retard
18
NB: Diffrente de l'amende pour immixtion dans les fonctions de CP
-Comme pour les comptables patents aussi, possibilit de nommer un
commis d'office en cas d'absence de production persistante
1)'1 er. La production du compte
Ne permet de lever l'injonction de production du compte de la GF que si
le compte est correctement tabli
A. Prsentation du compte en la forme
-Il doit tre unique
-Certifi et sign par l'intress
NB : *Par le reprsentant lgal s'il s'agit d'une personne morale
*Par tous en cas de plusieurs comptables de fait, chacun
s'appropriant la partie du compte qui l'intresse
-Il doit tre accompagn des pices justificatives
B. Prsentation du compte en la teneur
-Il doit faire apparatre distinctement les diffrents types de recettes et de
dpenses
-Il doit faire apparatre le reliquat
-Il doit distinguer les gestions s'il ya plusieurs comptables de fait
1)'2. La fixation de la ligne de compte
-Fixation dfinitive car dans la dcision provisoire, elle a t fixe
provisoirement
A. Les oprations retenir
1. Les recettes
-C'est une comptabilit en encaissements et
*Si le compte retrace des factures impayes, par exemple, le juge
devra le modifier
*Supprimer les sommes reprsentant des biens mobiliers car le
compte ne doit retracer que les oprations ralises en numraire
-Si les sommes ont t places, les intrts produits sont inclus dans les
recettes.
2. Les dpenses
2 conditions pour qu'elles puissent tre alloues
-La reconnaissance de l'utilit publique des dpenses par l'autorit
budgtaire (Parlement en LR s'il s'agit de deniers de l'Etat et autres
assembles dlibrantes)
*Le fondement : objet de la procdure de GF :
Rtablir les formes budgtaires et comptables
Ouvrir de faon rtroactive des crdits pour couvrir les
dpenses effectues
*La porte de l'acte reconnaissant l'utilit publique des dpenses:
Le juge des comptes ne peut allouer que des dpenses dont
1 'utilit publique a t reconnue ;
Mais l'intervention de cette reconnaissance n'a pas pour
effet de le contraindre allouer les dpenses. Il devra
19
vrifier, comme en matire de gestion patente, que les
dpenses ont t rgulirement effectues ainsi que la
prsence et la validit des justificatifs
-La production des pices justificatives
*En cas d'absence des justificatifs, le juge peut mettre le comptable
en dbet
*Mais il peut, pour des considrations d'quit, supplier
l'absence de justificatifs, sauf en cas de mauvaise foi.
B. La fixation du solde
-Dans une GF, les dpenses ne peuvent tre suprieures aux recettes--+
quand les dpenses allgues par le comptable et acceptes par le juge au
vu des justificatifs sont suprieures aux recettes, le juge considre le
surplus comme incontestablement tranger la GF (C. comptes, 7
novembre 1990, Mollard).
Toutefois, dans certains cas, il procde au forcement de recettes
jusqu' atteindre le montant des dpenses allgues quand ces recettes
ont t manifestement sous-values (C. comptes, 27 mai 1991, Muset).
Mais il ne peut accrotre le niveau des dpenses si l'autorit budgtaire
ne s'est pas prononce sur l'utilit publique des dpenses
supplmentaires, sauf si les dpenses sont obligatoires pour la collectivit
publique
-En gnral il y a excdent des recettes par rapport aux dpenses
*Ce excdent constitue le dbet, qui porte intrt.
*Il doit tre revers par le CF ( il doit se vider les mains )
,-r3. La fin de la procdure
-Recouvrement de la somme constituant le montant du dbet et ses
intrts dans la caisse du comptable de 1 'organisme concern
-Paiement de l'amende ventuelle
*Emission d'un titre de recette
*Le CP assignataire doit faire savoir au juge des comptes que le
titre de recette a t apur dans ses critures
-Dcharge et quitus
,-r4. Les voies de recours
Ce sont les mmes que celles relatives aux jugements et arrts rendus par
les juridictions financires (rvisions par la Cour elle-mme, cassation)
20
Sminaire de formation des magistrats des cours/chambres des comptes
Le contrle administratif et juridictionnel des finances publiques
Porto-Novo 26 - 30 octobre 2009
I - Thorie gnrale du contrle
Dfinition et typologique des contrles : distinction des contrles suivant :
1 - la nature du contrle effectu (contrle de lgalit/rgularit et contrle d'opportunit,
d'une part, et contrle a priori- contrle a posteriori, d'autre part) ;
2 -la nature de l'organisme contrleur (contrle interne et contrle externe, d'une part, et
contrle des organes administratifs, dlibrants et juridictionnels, d'autre part).
II- De l'volution des contrles
Du contrle traditionnel (avec ses caractristiques) au contrle moderne (sens de l'volution).
III- Sur le contrle administratif:
Evocation successive des diverses formes de contrle administratif et problmes poss:
1 -le modle courant et ses caractristiques, d'une part;
2 -les modles spcifiques, d'autre part.
IV- Sur le contrle juridictionnel :
1 o -Historique de l'institutionjuridictionnelle de contrle financier;
2 - Situation actuelle : physionomie gnrale, organisation et composition
3- Attributions du juge financier:
Jugement des comptes des comptables publics ; jugement des comptes des ordonnateurs,
rpression des gestions de fait ; contrle budgtaire et de gestion ; informateur des citoyens.
V- Etudes de cas pratiques
Techniques de l'auditeur interne
Techniques d'Audit N.C. HANS-KWETEVIE
Sommaire
t Approche globale 3
1.1. Analyse conomique 3
1.1.1 Dfinition 3
1.1.2 Mise en uvre 3
1.2 Volume et type de transaction 4
1.1.1 Dfinition 4
1.1.2 Mise en uvre 5
1.2 Diagramme de circulation 5
1.2.1 Dfinition 5
1.2.2 Mise en uvre 6
2 Approche par questions 8
2.1 Interview 8
2.1.1 Dfinition 8
2.1.2 Prparation de l'Interview 8
2.1.3 Droulement de l'interview 9
2.1.4 Synthse de l'interview 10
2.1.5 Questionnaires 10
2.1.6 Le Questionnaire de Prise de Connaissance (QPC) 11
2.1. 7 Les questionnaires de Volumes et de Types de Transactions 12
2. 1. 8 Le Questionnaire de Contr61e Interne (QCI) 12
2.1.9 Les questionnaires ferms 14
3. Approche par vrification 15
3.1.1 Observation physique 15
3.1.2 Mise en uvre 15
4. Les procdures de contrle analytiques 16
4.1 Dfinition 16
4. 2 Mise en uvre 16
5. Approche par sondage 17
5.1 Dfinition 17
5.2 Mise en uvre 17
5.3 Les sondages raisonns 18
5.4 Les sondages statistiques 18
5.5 La prparation physique des sondages 19
5.6 Le prlvement de l'chantillon 20
5. 7 Observation des faits et calculs des paramtres de l'chantillon 20
5.8 La formulation du rsultat 20
6 Technique d'Audit Assist par Ordinateur (TAAO) 22
6.1 Extraction et interrogation des fichiers informatiques 22
6.1.1 Dfinition 22
6.1.2 Mise en uvre 22
6.1.3 Utilisation d'outils informatiques pour le traitement et la
manipulation des donnes 22
Techniques d'Audit 1
Introduction
La mthodologie de conduite d'une m1ss1on d'audit interne prsente ci-
avant, utilise des outils et techniques qui constituent les principaux supports
et dispositifs de travail des auditeurs internes.
L'utilisation de ces techniques et outils s'avre utile dans la mesure o ils
permettent une meilleure orientation et organisation de l'intervention des
auditeurs pour la ralisation des travaux d'audit tout au long de la mission
d'audit interne.
Il est important de rappeler, par ailleurs, que ces techniques ne constituent pas
des normes de travail mais plutt des moyens et outils qui permettent
l'auditeur et l'aident raliser ses investigations dans les rgles de l'art.
Les Techniques d'audit que nous prsentons ci-aprs, concourent d'une
manire gnrale et de faon trs objective et efficace, au dveloppement
d'une opinion de l'auditeur pour lui permettre :
de justifier chaque point de son rapport,
d'apporter la preuve des faits constats et d'en valuer
correctement les impacts sur l'activit de l'entit ou fonction
audite.
2
1 Approche globale
1.1. Analyse conomique
1.1.1 Dfinition
L'analyse conomique et financire est un ensemble de travaux
prliminaires d'analyse sur les donnes chiffres de la fonction ou de l'entit
audite qui permet de situer :
l'entit audite et de comprendre son volution et son contexte,
l'importance de la mission d'audit demande en mesurant les
enjeux pour l'entit audite,
les ordres de grandeur, connatre les chiffres significatifs, et
dterminer les seuils de matrialit.
L'analyse conomique et financire est une technique utilise dans la phase
d'tude. La mise en uvre de cette analyse conomique et financire est
gnralement prvue dans le plan d'approche. Cette analyse permet
l'auditeur :
de mieux cerner le thme auditer et de mieux le situer,
d'avoir une vision meilleure quant l'analyse des risques,
de dfinir les seuils de matrialit, seuils au-del desquels une
analyse approfondie devra tre effectue,
de faciliter le dveloppement du programme de vrification (Cf.
Mthodologie d'audit interne - Programme de vrification).
1.1.2 Mise en uvre
D'une manire gnrale, l'analyse conomique permet de :
situer les ordres de grandeur propres la fonction ou entit audite,
reprer les activits concernes,
les classer par ordre d'importance,
et d'en dresser l'volution historique.
Techniques d'Audit
3
Il s'agit ensuite d'apprcier la cohrence de l'ensemble et de se faire une premire
opinion sur l'organisation et les modalits de fonctionnement de l'entit,
fonction ou processus audit.
Les analyses conomiques sont faites globalement et par activit, sur la base
respectivement des donnes du pass et de donnes prvisionnelles futures
pour l'laboration des plans stratgiques.
L'auditeur se doit d'apprcier l'volution des indicateurs qu'il aura dtermins
comme pertinents et surtout il notera ceux qui paraissent en dsquilibre l'un
par rapport l'autre.
1.2 Volume et type de transaction
1.1.1 Dfinition
L'approche volume et types de transaction permet de situer et de dfinir
les enjeux puis de se former une opinion sur un sujet, thme ou fonction par
simple analyse d'lments statistiques.
Parmi les lments statistiques les plus courants, on distingue :
les chiffres bruts (le nombre de march, le nombre de commandes, le
nombre d'ordre de recette mis, le nombre d'articles en stock, les
critures comptables, les transactions informatiques, ... )
et les ratios, (nombre de marchs grs par personne, taille
moyenne d'une commande, nombre d'ordre de recettes par
conventions ... ).
La prise de connaissance de la fonction ou entit audite (collecte
d'informations et de documents ncessaires l'excution des travaux)
comporte deux types d'analyses quantitatives :
une analyse financire et conomique,
une approche volume et types de transactions qui souvent est
programme en dbut de mission afin de permettre l'auditeur de
mieux connatre l'organisation en place, et d'orienter les travaux
de la mission.
4
1.1.2 Mise en uvre
L'auditeur peut utiliser, dans la plupart des cas, les mthodes suivantes qui
ont l'avantage d'tre simples et rapides :
Mthode des comparaisons
Les comparaisons peuvent tre :
-soit chronologiques (volution d'une donne dans le temps),
-soit synoptiques (comparaison entre les directions ou dpartements d'un
mme organisme ou entreprises d'un mme secteur d'activit).
Si ces comparaisons ne peuvent tre faites, l'auditeur doit faire usage de
jugement logique et raisonnable et preuve de bon sens.
. .
Mthode des corrlations
L'auditeur accorde une attention particulire aux grandeurs ralises et qui
sont significatives pour l'entit, fonction ou activit audite (indicateurs de
performances). On citera titre d'exemple, le nombre des ordres de recettes
mis et le montant des recettes qui en dcoulent, les ouvrages produits par
l'atelier de reprographie et les quantits de papiers consomms pour produire
ces ouvrages.
1.2 Diagramme de circulation
1.2.1 Dfinition
Le diagramme de circulation ou flow-chart est un schma que l'auditeur tablit
pour tudier :
la circulation des documents impliqus dans une srie ou une
catgorie d'oprations chronologiques et logiques, entre les
diffrents intervenants et excutants d'un processus (services,
entits et acteurs relatifs un traitement),
la cohrence, la validit, et l'efficacit du contrle interne,
le mode d'enregistrement comptable des oprations.
Le diagramme de circulation permet de reprsenter la circulation des
documents entre les diffrentes fonctions, activitf>-:. et centres de
responsabilit, d'indiquer leur origine et leur destination afin de donner une
vision globale et complte du cheminement des informaticns et de leurs
supports.
Techniques d'Audit
5
Souvent accompagn d'une description narrative, le diagramme de circulation
schmatise le droulement chronologique et logique d'un processus ou une
procdure. L'objectif de cette schmatisation tant d'aider l'auditeur reprer
les principales forces et faiblesses du dispositif de contrle interne (de la
procdure en question).
Le diagramme de circulation est le passage oblig pour connatre et
comprendre l'organisation des services tudis ainsi que les points de contrle
existants dans le cadre des procdures en vigueur.
La schmatisation des diagrammes de flux (d'informations ou de documents)
est utilise pour analyser une procdure donne. Son laboration est
essentiellement base sur l'interview des audits ou sur la base de
procdures crites.
La validation des di.agrammes est une tape importante dans la mesure
o cette schmatisation permet:
de mettre en vidence les incomprhensions relatives un
processus,
d'identifier les discontinuits existant entre les oprations d'un
mme processus, et de faire figurer toutes les transitions logiques
et chronologiques entre les phases et tapes d'un mme
processus,
d'valuer les contrles et d'en juger de leur pertinence,
d'apprcier la sparation des tches mises en valeur par le
diagramme de circulation.
Le diagramme de circulation 'est un outil la disposition de l'auditeur qui
l'amne se poser des questions de type :
Quel est l'metteur d'un document ?
Quels en sont les destinataires?
En combien d'exemplaires le document est-il tabli ?
Etc.
1. 2. 2 Mise en uvre
Les diagrammes de circulation des documents doivent faire ressortir de
manire claire et prcise :
Pour chaque document :
6
- la nature (document tabli en interne ou en externe l'entit,
service ou direction, imprim, tat informatique, ...
- le nombre d'exemplaires (original et copies/ couleurs utilises),
- les intervenants qui utilisent ce document ainsi que les
traitements qu'ils subissent, - la destination du document,
- et enfin le mode de classement (archivage physique/ support
informatique/ ... ).
L'auditeur se procurera un spcimen ainsi qu'une copie non vierge des
documents en vue d'une vision plus prcise sur son utilit.
Pour chaque information :
- l'origine,
- le traitement,
- la destination et l'usage qu'il en est fait.
L'laboration du diagramme de circulation suppose l'utilisation de symboles
prdfinis et le choix d'un mode de prsentation.
D
Document
<>
Test
C)
Attente/dlai
0
Renvoi
D
Traitement
Il Il
Renvoi une
procdure
c
)
Dbut ou fin de
traitement
Techniques d'Audit
0
0
Bande magntique
Disques
magntique ou
disque optique
Transfert
d'information
Transmission
tlphonique
Archivage dfinitif
Archivage
provisoire
Renvoi la page
suivante
7
2 . Approche par questions
2.1 Interview
2.1.1 Dfinition
L'interview est une technique de recueil d'informations qui permet
d'expliquer et de commenter le droulement des oprations affrentes un
processus.
L'interview est utilise divers moments de la mission pour tout diagnostic
rapide et chaque fois que la ncessit se prsente. Elle permet :
l'auditeur de percevoir les nuances dans l'expression de
l'audit,
l'audit de bien comprendre la dmarche et les objectifs de
l'auditeur.
L'interview n'est pas un interrogatoire, elle doit se drouler dans une ambiance
dtendue et reflter une atmosphre de collaboration entre l'auditeur et
l'audit.
2.1.2 Prparation de l'Interview
L'interview ne s'improvise pas. Elle doit toujours tre prpare en :
dfinissant au pralable le sujet de l'interview (les informations et
explications que l'auditeur souhaite recevoir),
essayant d'avoir des informations sur la personne qui va tre
interviewe afin de mieux la cerner (informations relatives aux
responsabilits de l'interview, sa place dans la hirarchie,
informations sur son activit, ses relations avec les
collaborateurs, ... ),
laborant les questions (de prfrence des questions ouvertes).
Toute interview doit tre prpare l'avance tant sur le plan logistique que
sur le plan thmatique, savoir :
le choix de l'auditeur devant superviser l'interview et devant
contacter l'audit interviewer (Il est vident qu'un auditeur
dbutant ne peut seul aller interviewer un audit).
l'organisation de l'interview qui consiste en :
8
-la prise de rendez-vous (heure, lieu, dure prvue),
- la dfinition des objectifs, des thmes et plus prcisment des
points aborder,
-l'tablissement de la liste des documents rclamer. Si
plusieurs auditeurs doivent participer l'interview, il est
indispensable de rpartir les questions poser ainsi que la prise
de notes,
- l'tablissement du guide d'interview ou questionnaire orientant les
diffrents points aborder,
-la communication des thmes aborder l'audit (en vue de lui
donner le temps de prparer les lments de rponses).
2.1.3 Droulement de l'interview
Avant d'entamer son interview et de rentrer dans le vif du sujet, l'auditeur
interne commencera par se prsenter et rappeler les objectifs et le contexte de
la mission ainsi que la finalit de l'interview.
L'auditeur interne prsentera galement la liste des points aborder. Il essaiera
au mieux de mettre l'aise l'interview. Pour cela, il devra s'adapter son
interlocuteur et trouver le ton juste pour anantir les rticences et
apprhensions, dtendre l'atmosphre et surtout montrer son intrt au travail
de l'audit avant d'entamer son questionnement.
Tout au long de l'interview, l'auditeur:
veillera atteindre les objectifs fixs initialement quant la
collecte des informations,
rcapitulera toutes les rponses collectes en vue de s'assurer
qu'il a bien report ce qui lui a t dit,
marquera toutes les questions pour lesquelles il n'a pas eu de
rponses (il reformulera ses questions plus clairement et explicitera
ses propos en vue d'obtenir une rponse),
reviendra l'essentiel si l'audit est trop abondant en informations
(excs par rapport au temps allou, dviation du sujet, ... ).
L'auditeur doit en outre grer la relation avec l'audit et faire en sorte qu'il soit
l'aise lors de l'entrevue. Il doit faire preuve en mme temps de psychologie
et de diplomatie, et ce, en :
grant les prises de paroles, les temps de rflexion et
d'analyse,
Techniques d'Audit
9
identifiant les rponses vasives, imprcises ou ambigus.
A la fin de l'interview, l'auditeur devra :
conclure et procder une rcapitulation puis validation
gnrale de ce qui a t dit,
demander l'audit s'il dsire aborder d'autres points ou si
certains points ont t omis,
demander s'il y a ventuellement d'autres personnes qui
pourraient apporter de plus amples informations.
2.1.4 Synthse de l'interview
L'auditeur doit prendre le temps pour reformuler et synthtiser les points
abords. Il tablira ensuite le compte rendu - clair et prcis - relatif chaque
interview dans les plus brefs dlais. Il ne doit pas ncessairement
reprendre l'ensemble des points abords mais simplement fait ressortir les
points les plus importants et prcisera les points manquants encore ainsi que
les besoins en informations et en documents ncessaires l'audit.
2.1.5 Questionnaires
Le questionnaire peut tre structur sous forme de questions choix multiples
(QCM) ou de questions ouvertes (Q.O) pour lesquelles le choix de rponses
n'est pas limit.
Les questionnaires sont utiliss :
d'abord comme tant un outil d'analyse de l'activit audite en vue
d'identifier les points forts et les points faibles en se basant sur les
questions poses par l'auditeur interne, et sur les rponses de
l'audit,
puis comme outil d'interview, travers les questions prpares
pour orienter et guider l'interview.
L'organisation des questionnaires et leur enrichissement ncessite par ailleurs
une bonne connaissance de l'activit et/ou de la fonction audite.
Il existe deux sortes de questionnaires:
Les Questionnaires de Prise de Connaissance intervenant
lors ~ la phase de prparation.
Les Questionnaires de Contrle Interne intervenant lors de la
phase de ralisation, (Cf. Chapitre outils d'audit).
10
2.1 .6 Le Questionnaire de Prise de Connaissance (QPC)
2. 1. 6.1 Dfinition
La prise de connaissance du domaine ou de l'activit auditer doit tre
prpare et organise. C'est pourquoi l'auditeur va utiliser un questionnaire
dnomm Questionnaire de Prise de Connaissance permettant de
rcapituler les questions importantes dont la rponse doit tre connue si on
veut avoir une bonne comprhension du domaine auditer.
C'est un moyen efficace pour organiser la rflexion et les recherches et surtout
pour:
bien dfinir le champ d'application de sa mission,
prvoir en consquence l'organisation du travail et en
particulier en mesurer l'importance,
prparer l'laboration des Questionnaires de Contrle Interne.
2.1.6.2 Structure
Un Questionnaire de Prise de Connaissance complet doit comprendre trois
parties, selon :
Connaissance du contexte socio-conomique :
- Taille et activit du domaine audit,
- Situation budgtaire,
- Situation commerciale,
- Effectifs et environnement de travail.
Connaissance du contexte organisationnel de l'entit audite :
- Organisation gnrale et structure,
- Organigrammes et relations de pouvoir,
- Environnement informatique.
Connaissance du fonctionnement de l'entit audite :
- Mthodes et procdures,
- Informations rglementaires,
-Organisation spcifique de l'entit,
Techniques d'Audit
11
-Systme d'information,
- Problmes passs ou en cours,
- Rformes en cours ou prvues.
2.1. 7 Les questionnaires de Volumes et de Types de
Transactions
Les questionnaires de Volumes et de Types de Transactions permettent de
recenser des lments statistiques en volume et/ou en valeurs dans l'objectif
de:
connatre les ordres de grandeur des chiffres saillants,
mesurer les volutions d'une priode une autre et de faire des
comparaisons,
mettre en vidence les carts,
identifier des prsomptions d'anomalies.
Cette tape fait partie intgrante de la prise de connaissance, et est
fondamentale lors d'une mission d'audit.
2.1.8 Le Questionnaire de Contrle Interne (QCI)
2.1.8.1 Dfinition
Le Questionnaire de Contrle Interne est un outil indispensable pour concrtiser
la phase de ralisation de la mission d'audit. C'est une grille d'analyse dont la
finalit est de permettre l'auditeur d'apprcier le niveau et d'apporter un
diagnostic sur le dispositif de contrle interne, de l'entit ou de la fonction
audite.
Ces questionnaires permettent l'auditeur de raliser sur chacun des points
soumis son jugement critique, une observation qui soit la plus complte
possible. Pour ce faire, le QCI devra se composer de bonnes questions
poser pour raliser cette observation complte.
Le Questionnaire de Contrle Interne va donc tre le guide de l'auditeur pour
que ce dernier puisse raliser son programme de travail. C'est un vritable outil
mthodologique permettant d'identifier :
les contrles internes mis en place pour se protger contre les
risques et erreurs potentiels,
les objectifs d'audit pour vrifier qu'ils sont bien respects.
12
Les questionnaires de Contrle Interne servent de guide lors
d'un audit interne ; Ils permettent par ailleurs un gain de temps
surtout quand les contrles sont rptitifs.
2.1.8.2 Structure
Le Questionnaire de Contrle Interne va permettre de passer du gnral au
particulier et d'identifier pour chaque fonction quels sont les dispositifs de
contrle essentiels. C'est pourquoi il y a autant de Questionnaire de Contrle
Interne que de missions d'audit.
L'auditeur est aid dans sa dmarche en rpondant aux cinq questions
fondamentales qui regroupent l'ensemble des interrogations concernant les
points de contrle et qui permettent de couvrir tous les aspects:
Qui ? : Questions qui permettent d'identifier l'acteur concern. Pour
rpondre ces questions, l'auditeur utilise organigrammes
hirarchique et fonctionnel, analyses de postes; grills d'analyse de
tches ...
Quoi ? : Questions permettant d'identifier les tches et les oprations
(Nature des tches effectues, Personnes concernes ... ).
O ? : Questions permettant d'identifier le lieu o se droule
l'opration et son emplacement
Quand ? : Questions permettant d'avoir des rponses quant aux
budgets et cycles de temps ncessaires pour la ralisation des
oprations (dbut, fin, dure, planning, ... ).
Comment ? : Questions permettant de dcrire le mode opratoire
des oprations. L'utilisation de la piste d'audit peut tre utile pour
suivre, comprendre et apprcier toute une chane de traitement.
Dans l'laboration des Questionnaire de Contrle Interne, ces 5 questions
fondamentales constituent la trame commune avec laquelle vont se dcliner
les questions spcifiques pour chaque tche lmentaire. Il s'agit, en fait, de
formuler la meilleure question pour savoir si la tche lmentaire est bien faite
et bien matrise.
Ainsi, le Questionnaire de Contrle Interne permet de mettre en uvre les
observations qui vont conduire l'laboration du diagnostic.
Les listes de points examiner qui figurent dans ces questionnaires peuvent
se prsenter sous la forme de questionnaires de type ferms ou de type
ouverts.
Techniques d'Audit
13
2.1.9 Les questionnaires ferms
Les questionnaires ferms sont des questionnaires o les rponses sont
fixes l'avance. On ne peut y rpondre que par des rponses affirmatives ou
ngatives.
Ces questionnaires sont labors de manire ce que les rponses
ngatives fassent apparatre les points faibles des dispositifs de contrle
interne, et inversement, que les rponses positives fassent apparatre les
points forts.
L'exploitation de ces questionnaires consiste pour l'auditeur valuer l'impact
des rponses ngatives et vrifier celui des rponses positives.
Ils seront principalement utiliss pour :
obtenir certains renseignements factuels,
recenser les moyens mis en place afin d'atteindre les objectifs
du contrle interne,
juger de l'approbation ou de la dsapprobation d'une opinion
donne, de la position sur un jugement, ...
L'avantage de ces questionnaires est qu'ils facilitent le dpouillement et, par
consquent, l'analyse. Toutefois, il peut y avoir un risque que la rponse soit
dicte, ce qui fausserait toute l'analyse.
2. 1. 10 Les questionnaires ouverts
Contrairement aux questionnaires ferms, les questionnaires ouverts
n'autorisent pas de rponses succinctes de type OUI/NON. Le choix des
rponses peut tre illimit et les auditeurs sont obligs de faire un effort de
description, de comprhension et de jugement.
Les questionnaires prsentent un intrt particulier dans les audits d'efficacit
ou dans les audits oprationnels ~ n t pour but d'analyser un systme
insatisfaisant et qui doit s'achever sur une mise en place de procdures
efficientes qui amlioreront les performances en termes de coat, de rapidit
ou de fiabilit.
Les questions ouvertes prsentent J'avantage d'obtenir des perspectives de
codage de l'information beaucoup plus grandes. Nanmoins, les
i,formations obtenues peuvent tre trop disperses. C'est pourquoi, il convient
de s'assurer de la qualit des rponses en ciblant prcisment ces dernires.
En raison des inconvnients de ces deux types de questionnaires, il est
prfrable de faire un compromis entre questions ouvertes et questions
fermes.
14
3. Approche par vrification
3.1.1 Observation physique
3.1.1.1 Dfinition
Une observation physique est la constatation de la ralit instantane de
l'existence et du fonctionnement d'un processus, d'un bien, d'une transaction et
d'une valeur.
L'observation physique intervient essentiellement dans le cadre des audits de
rgularit ou de conformit.
Elle peut s'appliquer pour :
les biens immobiliss tangibles : terrains, immeubles,
amnagements, ...
(:"'J
les biens mobiliers tangibles : matriels et quipements de
toute nature, ...
la documentation reprsentative de droits ou de dettes, ....
les processus matriels de contrle et de protection des actifs,
les lments incorporels reprsentatifs de la position de l'entit
concerne.
3.1.2 Mise en uvre
L'observation physique revt les deux formes suivantes :
l'observation directe qui consiste essentiellement en la vrification
dtaille et visuelle d'une structure, fonction, processus,
procdure donns par rapport au processus en vigueur. Ce
processus devant porter les mmes marques d'identification que
sur le bien en question. Elle doit permettre de porter un avis sur
l'tat physique du bien l'instant de l'observation.
l'observation indirecte qui consiste vrifier l'existence d'un
bien au travers de documents authentiques au sens juridique du
terme, ou de documents mis par des tiers lis au sujet par des
relations juridiques prcises et strictes.
Cette observation peut se faire soit par consultation directe des
documents soit par avec le tiers concern (lettre de
confirmation pour la banque et circularisation des tiers en relation avec
l'entit audite).
Techniques d'Audit
15
4. Les procdures de contrle analytiques
4.1 Dfinition
Les procdures de contrles analytiques consistent effectuer des
comparaisons, des calculs, des enqutes, des examens et des observations,
afin d'analyser et de faire le lien entre les donnes financires et les donnes
de gestion.
Lorsque des lments inhabituels ou des variations imprvues et inattendues
sont identifis grce aux contrles analytiques, l'auditeur doit chercher
expliquer leur nature et leur cause.
4. 2 Mise en uvre
Les procdures de contrle analytiques sont souvent efficaces pour les objectifs
d'audit, se rapportant aux :
transactions routinires et aux estimations comptables pour
lesquelles les relations et tendances peuvent tre estimes,
comptes des tats budgtaires et aux catgories de transactions
dont les montants varient relativement peu,
postes des tats budgtaires et aux catgories de transactions pour
lesquels l'examen des transactions individuelles ne permettrait pas
d'identifier des erreurs importantes,
aux comptes des tats budgtaires et aux catgories de
transactions pour lesquels les lments probants sont difficiles
obtenir partir d'autres procdures d'audit, par exemple en
matire d'exhaustivit.
16
5. Approche par sondage
5.1 Dfinition
Le sondage statistique est une technique qui permet, partir d'uh chantillon
prlev alatoirement dans une population de rfrence, d'extrapoler la
population les observations effectues sur un chantillon
Les sondages statistiques sont notamment utiliss lorsque l'objectif de
l'auditeur est d'estimer une grandeur (valeur montaire, frquence, ... ) pour
une population de taille importante.
Souvent, il est trs coteux et voir impossible matriellement d'organiser un
contrle exhaustif de l'ensemble des oprations d'un organisme. L'utilisation
des sondages est une technique courante et ncessaire en audit, qui permet
de se forger une opinion raisonnable et de formuler les recommandations
adquates pour les diligences normales.
5.2 Mise en uvre
Tout sondage statistique doit rpondre aux questions suivantes:
Comment peut-on constituer l'chantillon, et comment procder
pour la slection des individus qui doivent le composer ?
Quelle la taille idale de cet chantillon afin que les contrles
oprs permettent de rpondre aux objectifs de l'investigation ?
Comment analyser les rsultats de l'enqute ?
Comment procder l'induction ou extrapolation correspondante
des rsultats?
Les approches adoptes pour les sondages, peuvent tre soi t:
- empiriques : les chantillons sont constitus en s'appuyant sur
l'exprience et le flair de l'auditeur ; dans ce cas, on parle de
sondage raisonn.
- systmatiques : cette mthode consiste choisir des items en
utilisant un intervalle constant entre deux slections, le
premier intervalle ayant un dpart alatoire. L'intervalle peut
tre bas sur un certain nombre d'items. Lorsque l'auditeur utilise
la mthode systmatique, il doit s'assurer qu'il n'existe pas
d'lment rptitifs l'intrieur de la population qui auraient pour
consquence, soit de slectionner un seul type d'items, soit
d'exclure totalement certains types d'items de cette slection.
Techniques d'Audit
17
- alatoires : les chantillons sont constitus de manire alatoire.
5.3 Les sondages raisonns
L'auditeur utilise des mthodes traditionnelles de slection des items, de
dtermination de la taille de l'chantillon tester et de l'interprtation des
rsultats auxquels il aboutit.
Pour cela, l'auditeur :
fait rfrence l'exprience des examens au cours desquels il a
appris qu'un certain volume de sondage tait suffisant,
peut mettre galement profit sa connaissance effective de
l'entit audite pour choisir les zones de sondages les plus
reprsentatives .. ,
5.4Les sondages statistiques
L'utilisation des techniques statistiques a t envisage en matire d'audit -trs
souvent- par rfrence aux mthodes employes dans le contrle de qualit
en usine. Elles proposent un cadre scientifique l'audit en rsolvant les
problmes suivants :
comment procder une induction ou interprtation de la
population partir d'un chantillon de taille minimale?
quels sont la prcision et le niveau de confiance de l'auditeur
dans cette induction?
Le sondage statistique permet de minimiser les cots du sondage pour un
certain risque quantifi, accept par l'auditeur et pour une prcision exige
dans son contrle.
La mthode des sondages statistiques peut se faire selon les quatre tapes
dcrites ci-dessous.
la prparation physique du sondage,
le prlvement de l'chantillon,
l'observation des faits et calculs,
la formulation des rsultats.
. ..
18
5.5 La prparation physique des sondages
Cette premire tape consiste en la dfinition de :
la population de rfrence,
l'ensemble des items qui la composent,
sa taille,
son effectif (N)
et de la nature du contrle ainsi que le caractre estimer.
La taille d'un chantillon peut tre dtermine de faon empirique ou de faon
statistique. Le choix est fonction de l'objectif de l'audit.
Dans de nombreuses enqutes d'audit, il n'est pas ncessaire de prlever
un chantillon de taille importante ou de faire appel aux statistiques pour sa
slection. Souvent, aprs son enqute pralable, l'auditeur peut avoir t si
bien impressionn par la qualit du systme de contrle, qu'il peut se
contenter de prlever manuellement quelques articles pour s'assurer du bon
fonctionnement du systme.
Dans ce cas, combien d'lments doit-il examiner ? Si le systme est utilis
pour entrainer trois types d'oprations, il peut prlever un chantillon de
chacun de ces trois types d'oprations et examiner dans chaque cas les
points de contrle y affrents. Il peut ainsi juger si le systme dispose
rellement des points de contrle appropris et si ces systmes de contrle
fonctionnent de manire optimale.
Si l'auditeur dsire avoir une assurance pour se convaincre de l'efficacit relle
du systme, quel est le plus petit chantillon qu'il peut prlever pour obtenir
cette certitude. R2pondre cette question demeure difficile surtout si ce
dernier ne cannait ni le systme ni la qualit de la population.
Rappelons cependant, que l'auditeur ne doit pas accorder une confiance qui
ne serait pas justifie un chantillon de moins de trente articles. Ce n'est
qu' partir de cette taille (30 articles) que l'chantillon commence
reprsenter les caractristiques de la population et dans de nombreux cas, un
chantillon de 30 40 articles garantira suffisamment l'efficacit raisonnable du
systme.
Qu'en est-il si l'auditeur dsire mesurer objectivement la confiance que l'on
peut <:tCCorder aux rsultats de son chantillonnage ?
Quand l'auditeur a recours au sondage, il recherche une estimation valable
et non une rponse exacte. Si par exemple un auditeur examine un chantillon
de 1 00 articles sur une population de 1 000 - un chantillon reprsentant le
1/1 ome de la population globale. Si l'auditeur dcouvre 5 erreurs, il peut dire
Techniques d'Audit
19
si sa slection a t faite au hasard, qu'il y a un certain degr de confiance
mathmatique pour que son estimation se trouve l'intrieur d'un intervalle de
tolrance, dtermin pour un pourcentage en plus ou en moins.
5. 6 Le prlvement de l'chantillon
L'chantillon sera constitu de n items prlevs au hasard sur une population
comprenant N items au total.
Il existe diverses manires de prlvement d'un chantillon au hasard dont
notamment l'utilisation de la table de nombres au hasard qui permet de
slectionner rgulirement des items suivant un pas (= N/n) en balayant ainsi
toute la population.
5. 7 Observation des faits et calculs des paramtres de l'chantillon
A partir des non valeurs observes, x 1, x2, x3, ... , Xn, sur la population deN items,
nous calculerons :
Lamoyennem
La dispersion ou cart type s
( 1 ' )
n
s 1
nN
Le demi-intetvalle de confiance a
a.{,;;
avec n
Nn
ttant un paramtre directement li au degr de certitude prcdemment dfini :
La fourchette : F = rn +a
Si P = 90% t = 1.65
SiP=95% t=196
Si P=99% t= 258
Le calcul de la moyenne (rn}, de la dispersion (s) et de la fourchette (rn o a)
constitue le schma directeur du calcul. Le demi-intervalle de confiance (a)
caractrise l'estimation.
5.8 La formulation du rsultat
Il y a P chances sur 1 00 pour que la valeur moyenne relle du caractre sur
la population soit comprise entre (n-a) et (n +a) (estimation du montant
moyen des ordres de recettes).
20
Ou
Il y a P chance sur 1 00 pour que la valeur totale sur la population soit
comprise entre N. (n - a) et N. (n + a) (situation du montant total des
recettes) .
Techniques d'Audit
21
6 Technique d'Audit Assist par Ordinateur (TAAO)
6.1 Extraction et interrogation des fichiers informatiques
6.1.1 Dfinition
Cette pratique consiste extraire selon certains critres et ventuellement
traiter des informations existant sur les supports lectroniques de
l'organisation, fonction ou processus objet de l'audit.
L'interrogation de fichiers informatiques constitue une des directions les plus
prometteuses de l'audit moderne.
Ces techniques amliorent l'efficacit de l'auditeur tant directement comme
outil de recherche et de calcul pour effectuer ses travaux que indirectement
comme familiarisation avec l'informatique.
Elles marquent une rupture avec les technique.s passes o l'auditeur se
devait de procder par sondage pour limiter le cot de son investigation et
lui permet maintenant d'tre exhaustif.
En effet, ces techniques suppriment une partie importante de l'aspect mcanique
du travail de vrification.
L'informatique offre des moyens d'aller chercher des informations parses, de
les rassembler, de les comparer, de les trier et de les mettre en relation avec
d'autres informations.
6.1. 2 Mise en uvre
Lorsque l'auditeur prvoit de recourir aux techniques d'audit assistes par
ordinateur, il doit dterminer ds le dpart si l'entit audite est en mesure de
lui fournir les donnes dont il a besoin, au bon moment et sous une forme qu'il
pourra exploiter avec les logiciels qu'il a sa disposition.
Sans connaissances informatiques ou presque, l'auditeur peut procder seul
l'interrogation des fichiers informatiques lorsque ceux-ci sont correctement
dcrits et organiss en base de donnes.
6.1.3 Utilisation d'outils informatiques pour le
traitement et la manipulation des donnes
Il existe diffrents logiciels bureautiques destins lire les fichiers et les
transfrer sur un micro-ordinateur ou portable. Ils permettent l'auditeur
d'importer aisment des donnes peur ensuite les manipuler sa guise.
Les logiciels "tableurs" comme Excel et Access permettent dans un
environnement trs convivial de procder l'extraction, au traitement et la
manipulation de fichier organis en base de donnes.
22
La dmarche retenue pour I'AICF
Un objectif dcoulant de la mise en uvre de la LOLF
: consolider la qualit comptable
- accompagner la mise en place de la comptabilit
d 'exercice : des comptes rguliers et sincres
- prparer la certification des comptes : des comptes
auditables
- prfigurer 1 'organisation comptable au format LOLF :
une fonction comptable partage avec les gestionnaires
144filrl+llfiFIANAISE
++tM
1
2*E**ti***
L'audit comptable et financier
1- Un primtre d 'audit largi pour 1 'audit interne de la DGFIP
Le comptable public n'est pas le seul producteur des donnes
CO\t1PTI-S Dl L'I-TAl
( 0\lP \HII J IT Hl J)(lll \IR!
IMMM,MliM FlA Il A Ill
M*'i** d**M*
Contr6k
PaJrmcnl
ll
L 'audit comptable et financier
Il- Une mthodologie d'audit adapte \
Une mthodologie s 'inspirant de celle des commissaires aux
comptes
La stratgie d 'audit : une analyse des enjeux financiers et des risques
par cycles, sites et programmes
14MMJMIIMF1tANAISE
*i"++tw'* .
Sites
(ordonnateur)
,
Evaluer le contrle interne
par l'audit comptable et financier
Les audits de procdures par cycles et processus
valuer:
- la qualit du dispositif de contrle interne ...
- ... des composantes comptables d 'un processus (i.e.un
ensemble de procdures) ou d'une partie de processus ...
... avec la perspective d 'auditer 1 'ensemble des processus
selon une programmation pluriannuelle.
Cet audit dbouche sur un rapport, dont les
recommandations viennent enrichir le plan d 'actions ...
IMMitiMipfllAIIAISE
*%'"'* aoo
L'audit c.omptable et financier
Ill- Un renforcement des comptences de l'audit interne
1. Le respect des normes majeures d'audit
MMfMM*jiM{IMM FR AN A 1 5 E
IMMMIIMM!i+++MMIIIM
...
. .
~ ~
Une politique d'offre de service : les
audits partenariaux
' 1
IV- Le partenariat de 1 'audit interne de la DGFIP avec les
corps d 'audit et d 'inspection des ministres
-Un rfrentiel de contrle interne interministriel et partag
- Une programmation d 'audits coordonns par un comit
ministriel d 'audit comptable et financier (Dfense 1 Finances}
- Des missions d 'audit conjointes sur les processus fort
risques et enjeux : quelques donnes chiffres ou exemples d'audits conjoints
(ministres et processus concerns)
AiM1tMM4FIAMAIII
:wewM"*
Des relations formalises avec le certificateur
Dans un c,ontexte international marqu par la volont des
autorits publiques d'amliorer la transparence des
comptes, l'Etat s'engage dans une dmarche de scurisation
de ses processus et financiers travers la mise
en place de dispositifs de contrle et d'audit internes
comptables
.,. Le certificateur value le dispositif de contrle interne, dont 1' audit
interne est partie intgrante
Rapport de la Cout Comptes sur les comptes 2004 :
" le contrle et l'audit internes constituent un domaine
essentiel pour la Cour des comptes " .
.,. Les relations de 1 'Al,avec le certificateur (audit externe) sont
formalises par un protocole
Norme ISA 610 : l C'ertificateur prend en considration
les activits de 1 'AI (organisation de 1 'AI, stratgie
d 'audit, rapports) ainsi que leur incidence sur ses
procdures d 'audit
IMM*UIIM '.ANAIS E
LES CHNIQUES DE
L'AUDIT INTERNE
LES L'AUDITEUR INTERNE
Les techniques d'audit ne sont pas d
plutt des moyens et outils qui perm
rmes de travail mais
l'aident raliser ses investigations dans les
Elles concourent au dveloppement d'une
l'auditeur pour lui permettre :
de justifier chaque point de son rapport,
l'auditeur et
' '
l'art.
d'apporter la preuve des faits constats et d'en
correctement les impacts sur l'activit de l'en
fonction audite.
APP E GLOBALE
Analyse cono
Dfinition
L'analyse conomique et financire est un
travaux prliminaires d'analyse sur les donn
de la fonction ou de l'entit audite qui permet d
l'entit audite et de comprendre son volution
contexte,
l'importance je la mission d'audit demande
mesurant les enjeux pour l'entit audite,
les ordres de grandeur, connatre les chiff
significatifs, et dterminer les seuils de matrialit.
APP E GLOBALE
Cette analyse permet l'auditeur:
de mieux cerner le thme auditer et d
situer,
d'avoir une meilleure vision quant l'analyse
risques,
de dfinir les seuils de matrialit, seuils au del
desquels une analyse approfondie devra tre
effectue,
de faciliter le dveloppement du programme de
vrification
APP E GLOBALE
Mise en uvre
D'une manire gnrale, l'analyse co
de:
ique permet
situer les ordres de grandeur propres la
ou entit audite,
reprer les activits concernes,
les classer par ordre d'importance,
et d'en dresser l'volution historique.
Il s'agit d'apprcier la cohrence de l'ensemble et de s
faire une premire opinion sur l'organisation et les
modalits de fonctionnement de l'entit, fonction ou
processus audit.
APP E GLOBALE
Volume et type de t
Dfinition
L'approche volume et types de transaction
situer et de dfinir les enjeux puis de se for
opinion sur un sujet, thme ou fonction par s
analyse d'lments statistiques.
Parmi les lments statistiques les plus courants
utiliss, on distingue :
Les chiffres bruts
Les ratios,
. -1
APP E GLOBALE
Mise en uvre
L'auditeur peut utiliser, dans la plu pa
mthodes qui ont l'avantage d'tre simp
Mthode des comparaisons
Les comparaisons peuvent tre:
cas,. les 2
rapides:
i 1
soit chronologiques (volution d'une donne
temps),
soit synoptiques (comparaison entre les directio
dpartements d'un mme organisme ou entrep
d'un mme secteur d'activit).
Mthode des corrlations
L'auditeur accorde une attention particulire aux grand
ralises et qui sont significatives pour l'entit, fonction
activit audite (indicateurs de performances),.kuc ..... _ .. .,.ft.,
HE GLOBALE
Diagramme de c ulation
Dfinition
Le diagramme de circulation ou flow-chart
schma que l'auditeur tablit pour tudier :
la circulation des documents impliqus da
srie ou une catgorie d'oprations chronolo
et logiques, entre les diffrents intervena
excutants d'un processus (services, entits
acteurs relatifs un traitement),
la cohrence, la validit, et l'efficacit du contrle
interne,
le mode d'enregistrement comptable des oprations.
Nlku c. nAn.:r-...tn
APP E GLOBALE
Le diagramme de circulation pe de reprsenter la
circulation des documents entre diffrentes
fonctions, activits et centres de nsabilit,
d'indiquer leur origine et leur destination a
une vision globale et complte du chemin
informations et de leurs supports.
La validation des diagrammes permet:
de mettre en vidence les incomprhensi
relatives un processus,
d'identifier les discontinuits existant entre 1
oprations d'un mme processus, et de faire figure
toutes les transitions logiques et chronologiques
entre les phases et tapes d'un mme processus,
APP E GLOBALE
d'valuer les contrles et d'en ju de leur pertinence,
d'apprcier la sparation des tches
par le diagramme de circulation.
Le diagramme de circulation est un outil la dis
l'auditeur qui l'amne se poser des questions d .
i 1
Quel est l'metteur d'un document? !
Quels en sont les destinataires ?
Le document est tabli en combien d'exemplaires?
Etc.
APP E GLOBALE
Mise en uvre
Les diagrammes de circulation des docu
ressortir de manire claire et prcise.
Pour chaque document :
la nature
le nombre d'exemplaires
les intervenants
la destination du document,
doivent faire
le mode de classement (archivage physique/ sup
informatique/ ... ).
APP E GLOBALE
L'auditeur se procurera un spcimen si qu'une copie
non vierge des documents en vue d'une
prcise sur son utilit.
Pour chaque information :
l'origine,
le traitement,
la destination et l'usage qu'il en est fait.
i 1
1
' i
; i
APPROC AR QUESTIONS
lntervie
Dfinition
L'interview est une technique de recueil d'in
qui permet d'expliquer et de commenter le d
des oprations affrentes un processus.
L'interview est utilise divers moments de la m
;
pour tout diagnostic rapide et chaque fois que la
ncessit se prsente.
Elle permet :
l'auditeur de percevoir les nuances dans l'expressio
de l'audit,
l'audit de bien comprendre la dmarche et les
objectifs de l'auditeur.
1
1.
APPROC R QUESTIONS
Prparation de l'Interview
L'interview ne s'improvise pas.
Elle doit toujours tre prpare en :
dfinissant au pralable le sujet de l'interview (1
informations et explications que l'auditeur sou ha
recevoir),
essayant d'avoir des informations sur la personne
tre interviewe afin de mieux la cerner 1
laborant les questions (de prfrence des . quest
ouvertes).
APPROC R QUESTIONS
Toute interview doit tre prpare l' ce tant sur le
plan logistique que sur le plan thmatiqu
le choix de l'auditeur devant superviser l'in
devant contacter l'audit interviewer
(Il est vident qu'un auditeur dbutant ne
aller interviewer un audit).
'1
APPROC R QUESTIONS
l'organisation de l'interview qu1
- la prise de rendez-vous dure
prvue),
- la dfinition des objectifs, des th
prcisment des points aborder,
- l'tablissement de la liste des docu
rclamer.
l'tablissement du guide d'intervieV\
questionnaire orientant les diffrents poi
aborder, li
- la communication des thmes aborder l'au
(en vue de lui donner le temps de prparer
lments de rponses).
APPROCHE QUESTIONS
Droulement de l'interview
Avant d'entamer son interview et de ren
du sujet, l'auditeur interne commence
prsenter et rappeler les objectifs et le con
mission ainsi que la finalit de l'interview.
se
L'auditeur interne prsentera galement la li .
points aborder. Il essaiera au mieux de mettre l'
l'interview. Pour cela, il devra s'adapter :
interlocuteur et trouver le ton juste pour amoindrir 1
rticences et apprhensions, dtendre l'atmosphre
surtout montrer son intrt au travail de l'audit ava
d'entamer son questionnement.
APPROC AR QUESTIONS
Tout au long de l'interview, l'au
veillera atteindre les objectifs
pour la collecte des informations,
rcapitulera toutes les rponses collect
de s'assurer qu'il a bien report ce qui lui a
marquera toutes les questions pour lesquelles
pas eu de rponses (il reformulera ses questio
plus clairement et explicitera ses propos en vue
d'obtenir une rponse),
reviendra l'essentiel si l'audit est trop abondant
en informations (excs par rapport au temps allou,
dviation du sujet, ... ). ,
APPROC AR QUESTIONS
L'auditeur doit grer la relation avec it et faire en
sorte qu'il soit l'aise lors de l'entrevue.
Il doit faire preuve en mme temps de psych
diplomatie, en :
grant les prises de paroles, les temps de rfl
et d'analyse,
identifiant les rponses vasives, imprcises ou
ambigus.
APPROC AR QUESTIONS
A la fin de l'interview, l'auditeur devra :
conclure et procder une rcapitulatio
validation gnrale de ce qui a t dit,
demander l'audit s'il dsire aborder d'au
points ou si certains points ont t omis,
demander s'il y a ventuellement d'autres person
qui pourraient apporter de plus amples informatio
: :.
i.
APPROC AR QUESTIONS
Synthse de l'interview
L'auditeur doit prendre le temps pour 1er et
synthtiser les points abords. Il tablira le
compte rendu - clair et prcis - relatif
interview dans les plus brefs dlais.
Il ne doit pas ncessairement reprendre l'ense
des points abords mais simplement fait ressortir 1
points les plus importants et prcisera les poi
manquants encore ainsi que les besoins e
informations et en documents ncessaires l'aud:it.
1
APPROC R QUESTIONS
Les questionn_._.
Le questionnaire peut tre structur sous
questions choix multiples (QCM) ou de qu
ouvertes (Q.O)
Les questionnaires sont utiliss :
d'abord comme un outil d'analyse de l'activit
en vue d'identifier les points forts et les points fai
puis comme outil d'interview, travers les questio
prpares pour orienter et guider l'interview.
L'organisation des questionnaires et leur enrichisseme
ncessite par ailleurs une bonne connaissance de
l'activit evou de la fonction audite.
1
1 1
APPROC AR QUESTIONS
Il existe deux types de question
Les Questionnaires de Prise de Connaissan
intervenant lors de la phase de prparation.
Les Questionnaires de Contrle Interne intervena
de la phase de ralisation,
1'
APPROC AR QUESTIONS
Le Questionnaire de Prise de Con ssance (QPC)
Dfinition
La prise de connaissance du domaine ou
auditer doit tre prpare.
'
Le Questionnaire de Prise de Connaissance perm
rcapituler les questions importantes dont la rp
permet d'avoir une bonne comprhension du domain
auditer.
APPROC R QUESTIONS
C'est un moyen efficace pour organise
les recherches et surtout pour :
bien dfinir le champ d'application de sa
prvoir en consquence l'organisation du tra
en particulier en mesurer l'importance,
prparer le l'laboration des Questionnaires de
Contrle Interne
1 1
1
APPROC R QUESTIONS
Structure du Questionnaire de Prise de
Un Questionnaire de Prise de Connaissance
comprendre trois parties:
Issa nee \ QPC)
Connaissance du contexte socio-conomique :
-Taille et activit du domaine audit,
-Situation budgtaire,
-Situation commerciale,
- Effectifs et environnement de travail
APPROC AR QUESTIONS
Connaissance du contexte organisatio 1 de l'entit audite :
-Organisation gnrale et structure,
-Organigrammes et relations de pouvoir,
- Environnement informatique.
Connaissance du fonctionnement de l'entit audite
-Mthodes et procdures,
- Informations rglementaires,
-Organisation spcifique de l'entit,
-Systme d'information,
- Problmes passs ou en cours,
- Rformes en cours ou prvues.
PAR QUESTIONS
Les Questionnaires Volumes et
de Types de Transa
Les Questionnaires de Volumes et de Types de
permettent de recenser des lments statistiqu
evou en valeurs dans l'objectif de :
1'
connatre les ordres de grandeur des chiffres sail la
mesurer les volutions d'une priode une autre et
des comparaisons,
mettre en vidence les carts,
identifier des prsomptions d'anomalies.
Cette tape fait partie intgrante de la prise de connaissan
et est fondamentale lors d'une mission d'audit. NlkuC. nAN!i-KVI
PAR QUESTIONS
Le Questionnaire de Con Ale lnternei(QCI)
Dfinition
Le Questionnaire de Contrle Interne
d'analyse dont la finalit est de permettre
d'apprcier le niveau et d'apporter un diagn
dispositif de contrle interne, de l'entit ou
fonction audite.
Ces questionnaires permettent l'auditeur de ral
sur chacun des points soumis son jugement critiq
une observation qui soit la plus complte possible. Po
ce faire, le QCI devra se composer de bonnes questio
poser pour raliser cette observation complte.
PAR QUESTIONS
Outil mthodologique, les Questionn
Interne permettent d'identifier:
les contrles internes mis en place pour
contre les risques et erreurs potentiels,
de Contrle
les objectifs d'audit pour vrifier qu'ils sont bi
respects.
Les Questionnaires de Contrle Interne servent
guide lors d'un audit interne ; Ils permettent par ai lieu
un gain de temps surtout quand les contrles so
rptitifs.
PAR QUESTIONS
Structure du Questionnaire de trle Interne
Le Questionnaire de Contrle Interne
passer du gnral au particulier et d'ide
fonction quels sont les dispositifs de contrl
ettre de
1 i
ur chaque
L'auditeur est aid dans sa dmarche en r
cinq questions fondamentales qui regroupent l'
des interrogations concernant les points de contrl
permettent de couvrir tous les aspects:
els.
Qui ? : Questions qui permettent d'identifier l'a
concern. Pour rpondre ces questions, l'auditeur ut
organigrammes hirarchique et fonctionnel, analyses
postes, grilles d'analyse de tches ...
APPRO PAR QUESTIONS
Quoi? : Questions permettant d'ide ier les tches et les
oprations (Nature des tches effect , Personnes
concernes ... ).
O? : Questions permettant d'identifier le lieu
l'opration et son emplacement
Quand ? : Questions permettant d'avoir des rpons .
1
aux budgets et cycles de temps ncessaires pour: la
ralisation des oprations (dbut, fin, dure, plan,nin
Comment ? : Questions permettant de dcrire le
opratoire des oprations. L'utilisation de la piste d'a
peut tre utile pour suivre, comprendre et apprcier to
une chane de traitement.
APPROC ""'----R QUESTIONS
Dans l'laboration des Questionnaire Contrle Interne,
ces 5 questions fondamentales con t la trame
commune avec laquelle vont se dcliner
spcifiques pour chaque tche lmentaire.
fait, de formuler la meilleure question pour
tche lmentaire est bien faite et bien matrise.
Les listes de points examiner qui figurent da
questionnaires peuvent se prsenter sous la forn1
questionnaires de type ferms ou de type ouverts.
APPROC R QUESTIONS
Les questionnaires ferms
Les questionnaires ferms sont des qu
rponses sont fixes l'avance. On ne p
que par des rponses affirmatives ou ngati
ires o les
Ils seront principalement utiliss pour :
obtenir certains renseignements factuels,
recenser les moyens mis en place afin d'atteindre
objectifs du contrle interne,
nd re
juger de l'approbation ou de la dsapprobation d'un
opinion donne, de la position sur un jugement, ...
APPROCH ........---R QUESTIONS
Les questionnaires ouverts
Les questions ouvertes prsentent l'avan
des perspectives de codage de l'informatio
plus grandes. Nnmoins, les informations
peuvent tre trop disperses.
'obtenir
1
En raison des inconvnients de ces deux types de
questionnaires, il est prfrable de faire un compro
entre questions ouvertes et questions fermes.
up
APPROC R VERIFICATION
Observation p
Dfinition
L'observation physique intervient essentiellem
cadre des audits de rgularit ou de conformit.
Elle peut s'appliquer pour :
les biens immobiliss tangibles :terrains, immeub
amnagements,... . :
les biens mobiliers tangibles : matriels et quipeme
de toute nature, ...
la documentation reprsentative de droits ou de d
les processus matriels de contrle et de protection d
actifs, etc.
APPROCH R VERIFICATION
Mise en uvre
L'observation physique revt les deux fo
l'observation directe qui consiste essentie
vrification dtaille et visuelle d'une
fonction, processus, procdure donns par
processus en vigueur.
l'observation indirecte qui consiste vrifier l ~ , .........
d'un bien au travers de documents authentiqu
sens juridique du terme, ou de documents mis par
tiers lis au sujet par des relations juridiques prc1
et strictes.
APPROCH VERIFICATION
Cette observation peut se faire soit
directe des documents soit par correspon
tiers concern (lettre de confirmation pour la
circularisation des tiers en relation avec
audite).
APPRO AR VERIFICATION
Les procdures de con le analytique
Dfinition
Les procdures de contrles analytiques
effectuer des comparaisons, des calculs, d
des examens et des observations, afin d'anal
faire le lien entre les donnes financires et les
1
de gestion. .
i
1 l
1 1
Les procdures de contrle analytiques sont souvent
efficaces pour les objectifs d'audit, se rapportant1aux:
transactions routinires et aux estimations comptab
pour lesquelles les relations et tendances peuvent "'
estimes,
'
a
APPROCH VERIFICATION
comptes des tats budgtaires et a
transactions dont les montants varient
tgories de
ment peu,
postes des tats budgtaires et aux catgor
transactions pour lesquels l'examen des trans
individuelles ne permettrait pas d'identifier des
importantes,
comptes des tats budgtaires et aux catgo
transactions pour lesquels les lments probants
difficiles obtenir partir d'autres procdures d'audi
exemple en matire d'exhaustivit.
PAR SONDAGE
Dfinition
Le sondage statistique est une techniqu
partir d'un chantillon prlev de mani
dans une population de rfrence, d'extra
population les observations effectues
chantillon
rmet,
.
1re
Les sondages . statistiques sont notamment . utir
lorsque l'objectif de l'auditeur est d'estimer u
grandeur (valeur montaire, frquence, ... ) pour un
population de taille importante.
;.. .
. -:
i i
APPROC AR SONDAGE
Il est souvent coteux et voir impossib
d'organiser un contrle exhaustif de
oprations d'un organisme.
atriellement
ble des
L'utilisation des sondages permet de se fo
opinion raisonnable et de formuler
recommandations adquates pour les dilige
normales.
1 1
PAR SONDAGE
Mise en uvre
Tout sondage statistique doit rpondre
suivantes:
Comment peut-on constituer l'chantillon,
procder pour la slection des individus qui
composer?
Quelle la taille idale de cet chantillon afin que
contrles oprs permettent de rpondre aux obj
l'investigation ?
Comment analyser les rsultats de l'enqute? ,
'
Comment procder l'induction ou extrapolation
correspondante des rsultats?
APPROC AR SONDAGE
Les approches adoptes pour les so
tre soit:
empiriques : les chantillons sont constit
s'appuyant sur l'exprience et le flair de l'a
dans ce cas, on parle de sondage raisonn.
systmatiques
alatoires : les chantillons sont constitus de
manire alatoire
APPROC AR SONDAGE
Les sondages r
L'auditeur utilise des mthodes
slection des items, de dtermination
l'chantillon tester et de l'interprtation
auxquels il aboutit.
de
taille de
Pour cela, l'auditeur:
fait rfrence l'exprience des examens au
desquels il a appris qu'un certain volume de so
tait suffisant,
ltats
peut mettre galement profit sa connaissa
effective de l'entit audite pour choisir les ~ n e s
sondages les plus reprsentatives.
PAR SONDAGE
Les sondages sta
1ques
L'utilisation des techniques statistiques a
matire d'audit -trs souvent- par rfrence
employes dans le contrle de qualit en usine.
. ,
v1sagee en
Elles proposent un cadre scientifique l'audit en
les problmes suivants :
comment procder une induction ou interprtati
la population partir d'un chantillon de taille
minimale?
quels sont la prcision et le niveau de confiance de
l'auditeur dans cette induction?
i 1
odes
APPROC AR SONDAGE:
Le sondage statistique permet de mini r les cots du
sondage pour un certain risque quantifi, par
l'auditeur et pour une prcision exige dans A. le.
La mthode des sondages statistiques peut se
les quatre tapes.
la prparation physique du sondage,
le prlvement de l'chantillon,
l'observation des faits et calculs,
la formulation des rsultats.
1'
APPROC AR SONDAGE
La prparation physique des son
Cette premire tape consiste en la dfinit
la population de rfrence,
l'ensemble des items qui la composent,
sa taille,
son effectif (N)
de la nature du contrle
du caractre estimer.
APPROC AR SONDAGE
La taille d'un ch.antillon peut tre d
empirique ou de faon statistique. Le ch
de l'objectif de l'audit.
l :
ne de faon
fonction
Dans de nombreuses enqutes d'audit, il n
ncessaire de prlever un chantillon taille impo
ou de faire appel aux statistiques pour sa slection.
Quand l'auditeur a recours au sondage, il recherche u
estimation valable et non une rponse exacte.
1 '
APPROC AR SONDAGE
Le prlvement de l'chantillon
L'chantillon sera constitu de n items prl
hasard sur une population comprenant N item
1 1
Il existe diverses manires de prlvement
chantillon au hasard dont notamment l'utilisation
table de nombres au hasard qui permet de slection
rgulirement des items suivant un pas (= N/n)
balayant ainsi toute la population.
APPROC AR SONDAGE
i'
Observation des faits et calculs d
l'chantillon
ra mtres de
Le calcul de la moyenne (rn), de la dispersion (s)
fourchette (rn a) constitue le schma directeur du
Le demi-intervalle de confiance (a) caractrise l'estima
1,
APPROC AR SONDAGE
La formulation du rsultat
Il y a P chances sur 100 pour que la valeur
relle du caractre sur la population soit comp
(n-a) et (n +a) (estimation du montant moyen
ordres de recettes).
Ou
Il y a P chance u ~ 100 pour que la valeur totale sur
population soit comprise entre N. (n -a) et N. (n + a)
(situation du montant total des recettes).
TECHNIQU 'AUDIT ASSISTE PAR
ORDINA (TAAO)
Extraction et interrogatio --,_ fichiers
. informatiques
Dfinition
Cette pratique consiste extraire selon certains cr
ventuellement traiter des informations existant
supports lectroniques de l'organisation, fonctio
processus objet de l'audit.
Ces techniques amliorent l'efficacit de l'auditeur
directement comme outil de recherche et de calcul
effectuer ses travaux que indirectement corn
familiarisation avec l'informatique.
TECHNIQU 'AUDIT ASSISTE PAR
ORDINA (TAAO)
Elles marquent une rupture avec
passes o l'auditeur se devait de
sondage pour limiter le cot de son in
techniques
der par
permet maintenant d'tre exhaustif.
En effet, ces techniques suppriment une partie
importante de l'aspect mcanique du travail de ,
vrification.
et lui
L'informatique offre des moyens d'aller chercher des
Information de les rassembler, de les comparer, de les
trier et de les mettre en relation avec d'autres
informations.
TECHNIQU 'AUDIT ASSISTE PAR
ORDINA (TAAO)
Mise en uvre
Lorsque l'auditeur prvoit de recourir a
d'audit assistes par ordinateur, il doit d
hniques
le dpart si l'entit audite est en mesure de
les donnes dont il a besoin, au bon moment
une forme qu'il pourra exploiter avec les logiciels
sa disposition.
ds
Sans connaissances informatiques ou presq
l'auditeur peut procder seul l'interrogation d
fichiers informatiques lorsque ceux-ci sont correcteme
dcrits et organiss en base de donnes.
TECHNIQU 'AUDIT ASSISTE PAR
ORDINA (TAAO)
Utilisation d'outils informatiques
et la manipulation des donnes
Il existe diffrents logiciels bureautiques d
le traitement
fichiers et les transfrer sur un micro-ord
portable. Ils permettent l'auditeur
des donnes pour ensuite les manipuler sa guise.
Les logiciels "tableurs" comme Excel et Access perm
dans un environnement trs convivial de procd
l'extraction, au traitement et la manipulation de fi
organis en base de donnes.
GUIDE D'AUDIT :OUTILS
Evaluation du systme de contrle interne
Questionnaire d'Evaluation du Systme de Contrle Interne
Notes pour complter le questionnaire
1. Mthodologie d'valuation: J'valuation du contrle interne se fait en deux
tapes. La premire tape requiert des rponses de "OUI" ou "NON": Je OUI
indique que l'lment de contrle interne sous valuation existe tandis que Je
NON indique que l'lment n'existe pas, auquel cas une note de zro est
attribue. La seconde tape value davantage les rponses "OUI" pour
lesquelles une chelle de notation va de 1 3, la note 3 indiquant Je
maximum et la note 1 Je minimum. Ci-aprs sont les significations de ces
notes pour chaque lment de contrle interne valu:
Note 3: signifie Au dessus de la Moyenne. L'lment de contrle interne
est adquat. Toute amlioration n'est pas prioritaire.
Note 2: signifie Moyenne. Quelques amliorations sont ncessaires mais
pas d'importance majeure. L'amlioration est de priorit moyenne.
Note 1: signifie En dessous de la Moyenne. Des amliorations majeures
sont ncessaires et trs prioritaires.
Note 0: signifie que J'lment du contrle interne mangue. Des mesures
correctives sont d'une priorit absolue.
Apres avoir rpondu tout le questionnaire, l'auditeur interne fait le total de
toutes les notes attribues et en fait la moyenne qui doit tre comprise
entre 0 et 3. Cette note moyenne, corrobore si besoin il y a avec les autres
examens de contrles au niveau des transactions, forme le fondement de
l'opinion d'audit sur le systme de contrle interne.
2. Commentaires: L'auditeur interne doit mentionner les observations qui
J'ont pouss attribuer les notes infrieures 3. L'auditeur doit galement
expliquer tout contrle compensatoire qui existe. En plus, l'auditeur doit
indiquer les implications existantes ou potentielles des faiblesses de
contrle interne identifies et proposer des recommandations pour y
remdier.
3. Ce questionnaire est un guide minimal et ne contient pas ncessairement
tous les t s t ~ u n auditeur interne peut effectuer. Ainsi, selon les
spcificits des entits, les auditeurs internes doivent faire preuve de leur
ingniosit et de leur jugement pour raliser des tests additionnels.
1
Evaluation du systme de contrle interne
ELEMENTS DU CONTROLE INTERNE
1. Environnement de contrle
Structure organisationnelle et leadership
(i) Le caractre appropri de la structure
organisationnelle de l'entit en rapport
avec la nature de ses oprations et la
dimension de ses dpartements
lfRfrence: la structure facilite le flux des
processus dans les dpartements et
travers l'entit, les relations hirarchiques sont
clairement dfinies et facilitent la circulation
adquate des informations vers la haute
direction sans devoir recourir la "micro
gestion" des activits.]
ii) La responsabilisation d:s membres du
personnel de l'entit pour qu'ils
accomplissent leurs missions.
[Rfrence: Les responsabilits sont
clairement dfinies et communiqus au
personnel de l'entit. La dlgation des
pouvoirs tient compte des
responsabilits dj assignes et il existe
un systme de rendre compte de ces
responsabilits. Les hauts cadres de
direction sont accessibles par le personnel au
sein de l'entit afin de faciliter le feedback et
le suivi des performances.]
ECHELLE DE
NOTATION
OUI NON
3 2 1 0
Commentaires
(iii) Les effectifs du personnel sont
appropris en
rapport avec Je volume de travail de
l'entit.
[Rfrence: les employs ne doivent pas
travailler en dehors des heures normales de
service pour terminer les tches leur
assignes. Les cadres et responsables ne
doivent pas accomplir les rles des
employs subalternes sauf en cas
de dmonstration.]
iv) Les attributions sont clairement
[Rfrence: Il n'y a pas de duplicits dans
les attributions, chaque employ est au
courant des interrelations entre
responsabilits et celles de
Evaluation du systme de contrle interne
ELEMENTS DU CONTROLE INTERNE
ses collgues, et la dlgation de pouvoirs
et la responsabilit sont clairement dfinies.}
(v) L'attitude des hauts cadres de direction
en ce
qui concerne la rduction des risques,
les contrles internes valides et
l'efficience.
[Rfrence : les hauts cadres. de direction
ne
doivent pas "ngliger' les procdures et
contrles internes approuvs, ils exigent
une analyse pralable des risques pour tous
les programmes et projets nouveaux et
utilisent le mode de gestion base sur les
performances.]
(vi) L'attitude des hauts cadres de directions
en ce
qui concerne la responsabilit et les
rapports financiers.
[Rfrence: les hauts cadres de direction
accordent
une grande importance au travai1 du
comptable et
de l'auditer interne, latenue des systmes
comptables valides dans l'entit, aux
rapports financiers rguliers et s'intressent
eux-mmes aux dtails des rapports
financiers.}
ECHELLE DE
NOTATION
OUI NON
3 2 1 0
Commentaires
(vii) le degr "d'auto valuation" interne du
systme de contrle interne.
[Rfrence: la direction de l'entit exige une
revue interne rgulire du caractre adquat
et de l'efficacit du systme de contrle
interne de l'entit et les faiblesses releves
sont corriges dans les dlais. La frquence
de cette revue est dtermine par l'Arrte
Ministriel relatif aux rglementations sur
l'audit interne et le contrle interne.]
(viii) Le niveau de recherche de comptences.
[Rfrence:la direction de l'entit porte son
attention sur la correspondance
entre connaissances, habilets et
responsabilits tout au long du processus de
recrutement et de placement du personnel.
L'entit encourage le dveloppement
Evaluation du systme de contrle interne
ELEMENTS DU CONTROLE INTERNE
i Comment le Code ou les rgles traitent-t-ils
les
valeurs thiques, l'intgrit, le professionnalisme,
les comportements avoir ou viter sur le
plan moral, la faon d'viter les conflits
d'intrts, etc.?
[Rfrence: les directives comprises dans ce
ma
ii. Comment la direction de l'entit propage-t-elle
le message de promotion de l'thique tout au
long des chelons de l'entit?
[Rfrence: la distribution du Code ou de ces
rgles au sein de l'entit ainsi que la connaissance
du Code et des rgles par chaque membre du
iii. la direction de fentit nourrit la culture des
valeurs thiques, l'intgrit, le
professionnalisme, la faon d'viter les
conflits d'intrts, etc. au sein de l'entit.
[Rfrence: une procdure disciplinaire tabli et
labor qui est mis en uvre de faon objective
et consistante au sein de l'entit contre les
personnes reconnues coupables des violations
du Code et des rgles]
iv. la:tirection de l'entit gre lesressources
publiques avec une trs grande
responsabilit et transparence.
[Rfrence: les rapports financiers sont
crdibles
quant leur contenu et leurs rvlations, ne
contiennent pasd'erreurs et les informations
financires !D7f mises la disposition des
auditeurs.]
ECHELLE DE
NOTATION
OUI NON
3 2 1 0
Commentaires
8
v. 1 existe des efforts dairs pour prvenir
des
tentations aux comportements contraires
l'thique au sein de l'entit.
[Rfrence: les objectifs de performance
sont ralistes et atteignables et les
rmunrations et la promotion sont bases
sur l'valuation objective des performances
du personnel].
-., ...
9
Evaluation du systme de contrle interne
ELEMENTS DU CONTROLE INTERNE
2
Analyse des risques
i. Comment les objectifs et les risques
ventuels de
l'entit sont pris en compte dans le plan
stratgique.
[Rfrence: Le plan stratgique de l'entit est
clair
en ce qui concerne le lien entre les
objectifs de
l'entit, sa mission, ses buts, ses plan
oprationnels, ses risques ventuels, ses
programmes d'activits et ses budgets.
Les employs sont au courant du contenu
du plan stratgique.]
i Le degr d'analyse des risques.
[Rfrence: la mthodologie d'analyse des
risques identifie toutes les sources ventuelles
de risques (internes & externes) vis--vis des
oprations de l'entit, value les probabilits
de survenance du risque, son impact
ventuel (lev, moyen ou bas), et suggre
des mesures correctives appropries. Voir
Chapitre 4 pour d'autres directives d'analyse
des risques.]
3
Contrle des activits
L'entit a mis en place les contrles
spcifiques de ses activits et transactions.
Si oui
i. tat de mise en uvre de ces contrles.
[Rfrence: le personnel de l'entit comprend
ces contrles et leur objet. Des mesures sont
prises temps en vue de corriger toute
dficience dans les contrles, les faiblesses et
limites de mise en uvre, et les controles sont
rgulirement revus. L'tat de mise en uvre de
chaque contrle doit tre valu.]
ECHELLE DE
NOTATION
OUI NON
3 2 1 0
Commentaires
10
4
Information et communication
i. La pertinence et la fiabilit des informations
financires et non financires la disposition
des dirigeants, spcialement en ce qui
concerne les performances oprationnelles
de l'entit, etc.
11
Evaluation du systme de contrle interne
ELEMENTS DU CONTROLE INTERNE
[Rfrence: les rapports d'activits sont corrects
et dlivres temps, sont bases sur les faits
et sont analytiques. Ils contiennent des
informations pertinentes en ce qui concerne
les ralisations en rapport avec les objectifs
prtablis, les facteurs de russite, les
objectifs non atteints ainsi que les raisons,
les dfis et les recommandations pour les
surmonter, les objectifs de la priode
suivante (trimestre par exemple), les
ressources requises, etc.]
ii. L'efficacit de la communication en qui
concerne le contrle interne au sein de l'entit.
[Rfrence:la direction de l'entit dlivre un
message clair travers l'entit en ce qui
concerne les responsabilits de contrle
interne et son importance. Les employs
comprennent les aspects pertinents du
contrle interne ainsi que la faon dont leurs
rles sont intgrs collectivement ou
individuellement. Ils sont informs qu'ils
doivent prendre des initiatives personnelles
pour lutter contre les faiblesses ventuelles afin
de prvenir les prjudices aux oprations de
l'entit. Ils sont au courant des consquences
de la mise en chec des contrles internes
contrles.]
ECHELLE DE
NOTATION
OUI NON
3 2 1 0
Commentaires
iii. L'efficacit de la communication interne en
gnral.
[Rfrence: il existe des voies facilitant un
flux facile d'information vers le haut, vers le
bas et horizontalement, que ce soit
formellement ou
informellement. Il existe un esprit de
volont d'couter de la part des dirigeants.
Ces derniers sont vraiment accessibles par
leurs subordonns. Les employs ne peuvent
pas tre poursuivis pour avoir rvl les
faiblesses oprationnelles ou managriales
de J'entit.]
Efficacit de la communication externe
[Rfrence: il existe des voies pour une
Evaluation du systme de contrle interne
ELEMENTS DU CONTROLE INTERNE
communication ouverte et efficace avec les
fournisseurs, les consultants et partenaires dans
les activits de l'entit. Les fournisseurs
peuvent librement formuler leurs plaintes
sans que cela porte prjudice leurs
relations d'affaires avec l'entit. Les
partenaires externes sont au courant des
nonnes thiques de l'entit et sont infonns
que tout employ reconnu coupable de
tendances de conflits d'intrts est
svrement puni, et que ses complices
externes sont inscrits sur la liste noire.}
5 Suivi
i. Le caractre adquat et l'efficacit du suivi
des contrles internes en cours.
[Rfrence: il existe des mcanismes de
fournir un feedback rgulier sur la perfonnance
des contrles ainsi que le degr de ralisation
des objectifs de contrle. Il existe des
preuves que les rapports financiers et les
rapports d'activits sont vrifis et compars
aux programmes d'activits concerns par
ces rapports. Les rapports doivent tre signes
pour attester la fiabilit des informations
qu'ils contiennent ainsi les responsabilits
de leurs
auteurs sur les erreurs ventuelles qu'ils
pourraient contenir.]
ii. L'efficacit de la mthodologie de suivi.
[Rfrence: la mthodologie assure que les
toutes les procdures soient respectes et
vite qu'elles ne soient ngliges. Par
exemple, la mthodologie implique l'usage
des critres prdtermins, le
questionnaire, la revue Cl'e la conception
des contrles, etc.]
ECHELLE DE
NOTATION
OUI NON
3 2 1 0
Commentaires
iii. L'efficacit des recommandations.
''Rfrence: Les dficiences identifies sont
mmdiatement communiques. Les
recommandations proposes sont discute
values pour s'assurer qu'elles sont
appropries
Les recommandations convenues sont
assignes
.t;_.
Evaluation du systme de contrle interne
ECHELLE DE
NOTATION
OUI NON
ELEMENTS DU CONTROLE INTERNE
3 2 1 0
Commentaires
une priode de mise en uvre. Un suivi
rgulier doit assurer la mise en uvre
effective des recommandations.]
Outils de l'Audit Interne
Niku C. HANS-KWETEVIE
1
Sommaire
1. Outils d'audit interne
1.1 Guide d'valuation du contrle interne
3
4
1.2 Guide d'excution des tests de contrle programme de travail >> 5
2. Tableau des Forces et Faiblesses Apparentes(TFFA) 6
3. B.A.P.S (Budget- Allocation -Planning- Suivi) 7
4. Feuilles 8
4.1 Feuille De Couverture (FOC) 8
4.2 Feuille de Rvlation et d'Analyse de Problme 9
5. Fiches 10
5.1 Fiche de Suivi d'une Recommandation 10
5.2 Fiches d'analyse 11
5.2.1 Fiche d'analyse de la chane de valeur 12
5.2.2 Fiche d'analyse matricielle et par filire d'une structure 13
5.2.3 Fiche d'analyse d'un service 14
5.2.4 Fiche d'analyse de poste de travail 15
5.2.5 Fiche d'analyse de flux d'infonnation 16
5.2.6 Fiche d'analyse du schma de procdure 17
5.2.7 Fiche d'analyse d'un systme d'infonnation 19
5.2.8 Fiche d'analyse d'une application infonnatique 20
5.2.9 Fiche d'analyse des emplois et des ressources humaines 21
Outils de l'Audit Interne
Niku C. HANS-KWETEVIE
2
1. Outils d'audit interne
Le guide d'audit labor pour guider et orienter les travaux des auditeurs
internes est constitu de deux volets :
d'une part des questions relatives l'valuation du contrle interne
et d'autre part, des questions ainsi que des tests de contrle interne
relatant les contrles et vrifications que l'auditeur est tenu de raliser
afin de s'assurer de la bonne application des procdures ainsi que de la
conformit des pratiques quotidiennes par rapport aux textes
rglementaires, normes et lois en vigueur.
Avant le dbut de chaque mission, le responsable de la structure Audit Interne,
en concertation avec le chef de mission dsign, devront revoir et mettre jour
les questionnaires d'audit pour les rendre adapts l'environnement audit.
Ces programmes et questionnaires seront alors, soit approuvs tels quels (s'ils
ne ncessitent pas d'adaptations, en prcisant tout de mme, le nombre
d'oprations vrifier - chantillon retenir selon l'importance de la nature des
oprations, de l'entit ou des objectifs fixs la mission.), soit modifis en
rajoutant ou en supprimant des contrles En effet, il peut tre envisag, dans le
cadre d'une mission rduite, d'effectuer seulement une partie du programme (
prciser par le responsable ou le chef de mission).
Outils de l'Audit Interne
Niku C. HANS-KWETEVIE
3
1.1 Guide d'valuation du contrle interne
Le guide d'valuation de contrle interne est un questionnaire sous forme d'une
grille d'analyse dont la finalit est de permettre l'auditeur d'apprcier le niveau
de fiabilit du dispositif de contrle interne mis en place.
Les questionnaires de contrle interne sont destins dceler d'ventuelles
faiblesses de conception ou d'application des procdures.
Les rponses aux questions peuvent, soit tre apportes suite une
constatation, soit ncessiter un complment de travail (examen de document ou
test de contrle). La rponse NIA (Non applicable) sera valable dans la mesure
o l'entit audite ne traite pas une telle opration.
Le questionnaire de contrle interne est conu de manire ce que les rponses
ngatives dsignent systmatiquement les dfaillances et les points faibles du
dispositif de contrle interne mis en place, et que les rponses positives
indiquent implicitement les points forts.
L'utilisation concrte des questionnaires de contrle interne consiste en
l'valuation de l'impact des points faibles sur l'organisation en place et en la
vrification de la ralit et des points forts.
1.2 Guide d'excution des tests de contrle programme de travail
Le programme de travail est l'outil principal de l'auditeur interne. Il dfinit
l'ensemble des tches et oprations que doit raliser l'auditeur, pour une
procdure, opration ou contrle donns.
Le programme de travail permet l'auditeur interne d'effectuer un certain
nombre de vrifications quant la conformit des pratiques courantes par rapport
aux rglementations et lois en vigueur. Ces vrifications s'appuient sur des tests
de dtails partir d'chantillons slectionns cet effet.
Une fois les travaux effectus et devant chaque tape du guide, l'auditeur devra
indiquer la rfrence aux feuilles de travail et apposer son visa ou ses initiales.
2. Tableau des Forces et Faiblesses Apparentes(TFFA)
Objectifs OPINION
Commentaire
Domaine/ Indicateurs 1 ou Rfrence
Opration
de Risques
Indices Force/ Degr de
contrle
Faiblesse
Consquence
confiance
Issus du plan d'approche Produits par l'analyse des risques
Domaine 1 Opration : thme, lment de la structure Force 1 Faiblesse : par rapport un objectif de contrle interne ou une
rfrence (manuel de procdures, ... ) ou une caractristique assurant le
bon fonctionnement ainsi que l'atteinte d'un rsultat escompt.
Objectifs de contrle : situation thorique, Consquence: degr de gravit, probabilit d'occurrence
caractristiques du bon fonctionnement (par rapport
au rfrentiel).
Un objectif de contrle dfinit de manire synthtique
la situation thorique que l'auditeur devrait
rencontrer pour conclure au bon fonctionnement
d'une entit, d'un systme ou d'oprations.
Risques: consquences ou (vnements) redoutes
Degr de confiance de l'auditeur ce stade (leT. F. f. A sera suivi du
en cas de dysfonctionnement, proccupations
programme de vrification prpar par l'auditeur)
Outils de l'Audit Interne Nlku C. HANS-KWETEVIE
6
3. B.A.P .S (Budget- Allocation - Planning - Suivi)
Semaine du:
...... / ...... / .........
AUDITEUR:
Initiales: ........................
-- .--:----
Code
Rfrence
Code phase L M M J v
Total Phases
Mission Heures et
--
_produits
6
6
---
8
r------
8
-- -----
8
. -
----
G
a
Formation externe
Formation interne
Runions
Jours fris
Maladie
Maternit/ Mariage 1
Dcs
Congs
Total global
Outils de l'Audit Interne Niku C. HANS-KWETEVIE
7
4. Feuilles
4.1 Feuille De Couverture (FOC)
Feuille De Couverture papier de Rfrences FRAP
(FOC) travail
Objectifs des travaux
Modalits d'excution
Conclusion
Outils de l'Audit Interne
8
4.2 Feuille de Rvlation et d'Analyse de Problme
Etablie pa. :
Le .... ./ .... ./ ..... .
Outils de l'Audit Interne
Formulation synthtique, autonome et percutante du
dysfonctionnement (ou anomalie) constat
C'est un dysfonctionnement important qui compromet le ou les
rsultats attendus
L'vnement symptomatique constat (cet vnement se voit et se
constate)
Ce sont les dysfonctionnements qui se manifestent par tels incidents
ou telles anomalies et qui ont t constates
La condition non remplie ou facteur de risque : observe ou dduite,
elle explique la survenance du fait (dysfonctionnement ou anomalie))
Les causes dont la ou les origine(s) sont les mauvaises conditions de
fonctionnement
Elle est constate par l'auditeur et 1 ou l'audit ou supput (risque)
Les consquences ont pour impact certains ou probables une sous
performance ou une perte de valeurs suffisamment importantes
La recommandation propose pour remdier au problme
(dysfonctionnement ou anomalie)
La recommandation ncessite une action prcise visant liminer les
consquences engendres par les causes
Approuv par: Valid e.-,ec :
le ...... / ........ . le ....... / ...... .1 .... .
Niku C. HANS-KWETEVIE
9
5. Fiches
5.1 Fiche de Suivi d'une Recommandation
Fiche remplir et retourner 1... ... au plus tard le ............ ./ ............ ./ ........... .
Recommandation W
Rponse Etablie par : Nom (s) Ralis D
Fonction (s) : Retenue
D
l'tude
D
Refuse
D
Date: ............................................................................................
Dates Plan d'action (dtail concernant la recommandation)
prvues
Raisons pour lesquelles la recommandation est mise l'tude (date de
prise de dcision dfinitive)
Raisons pour lesquelles la recommandation a t refuse
Rponse du responsable de la recommandation
Outils de l'Audit Interne Nlku C. HANS-KWETEVIE
10
5.2 Fiches d'analyse
Les fiches d'analyse sont galement des outils que l'auditeur utilise lors des
missions d'audit interne. Elles permettent de dtailler et d'illustrer les principaux
types d'analyse envisageables que l'auditeur peut utiliser dans sa dmarche
d'audit.
Pour chacun des items, la fiche d'analyse dcrit :
les objectifs,
la dmarche,
et donne un exemple pour l'utilisation pratique de la fiche.
Outils de l'Audit Interne Niku C. HANS-KWETEVIE
11
5.2.1 Fiche d'analyse de la chaine de valeur
L'analyse de la chane de valeur a pour finalit de reprer les sources
et points potentiels d'amlioration des performances de l'organisation
audite, travers l'identification des mcanismes de cration de la
valeur ajoute propre cette organisation, ses activits, et son
environnement.
L'analyse de la chane de valeurs consiste :
Btir le systme de chane de valeur et situer l'organisation audite
entre ses fournisseurs et ses clients 1 usagers
Dcomposer la valeur ajoute selon les diffrentes activits, de
manire distinguer :
- Les activits oprationnelles de base,
- Les activits de support et leur contribution la ralisation des
activits oprationnelles
Identifier les lments et facteurs gnrateurs de contre-
performance ainsi que les potentiels d'amlioration
L'analyse de la chane de valeur ajoute peut de ce fait tre suivie
d'autres travaux plus circonscrits tels que l'analyse du systme
d'information en vigueur.
Outils de l'Audit Interne Niku C. HANS-KWETEVIE
12
5.2.2 Fiche d'analyse matricielle et par filire d'une structure
L'analyse matricielle et par filire d'une structure permet d'apprcier :
la pertinence d'une structure et son adquation par rapport aux
orientations stratgiques et objectifs escompts,
les modalits et qualit de fonctionnement de la structure
(processus de prise de dcision, rpartition des responsables, ... )
Une structure est un agencement particulier de responsabilits visant
un certain quilibre entre l'entit, la spcification des tches, la
circulation des informations dont dpendent la qualit des dcisions
des dirigeants et l'efficacit de l'organisation.
Une filire est la succession des activits assures ventuellement
par diffrents services au sein de la structure, contribuant un mme
produit ou un mme service final offert par l'organisation.
L'analyse matricielle et par filire d'une structure consiste :
laborer une matrice deux axes et indiquant d'une part, les
principales activits (fonctions et oprations) de l'organisation
audite et d'autre part, les diffrentes entits de la structure ;
identifier les filires ;
prciser la contribution de chaque entit chaque filire ;
apprcier la qualit des interfaces entre les diffrentes structures
(en vue d'apprcier la lenteur des circuits administratifs);
identifier les dfaillances et l'inexistence de points de contrle ;
L'analyse matricielle et par filire met en vidence deux types de
dysfonctionnement :
Le dcoupage des attributions accentuant le cloisonnement et la
parcellisation d'un processus ;
La mauvaise communication entre les diffrentes structures
Outils de l'Audit Interne Niku C. HANS-KWETEVIE
~ . ' .
13
5.2.3 Fiche d'analyse d'un service
L'analyse d'un service permet d'identifier :
ses missions et ses responsabilits et de dfinir le rle qui lui est
imparti au sein de l'organisation ;
ses activits et tches, ralises l'aide des moyens qui sont mis
sa disposition pour raliser ses missions ;
ses moyens tant en ce qui concerne ses ressources humaines
ue ses rces matrielles et
Le service est dcrit sous forme de texte narratif, de tableaux et 1 ou
encore de grille d'analyse des tches qui sont renseigns soit par
les auditeurs lors des entretiens de prise de connaissance, soit
directement par les audits.
Le descriptif permet de :
schmatiser l'organigramme de la structure audite ;
dfinir les caractristiques gnrales du service :
- Fonctions, attributions et tches et leurs descriptifs,
- Effectifs,
- Moyens matriels ;
identifier les responsables du service :
Nom,
Grade,
Anciennet dans l'emploi,
Diplmes;
dcrire les principaux indicateurs d'activits,
dcrire les principales informations et procdures relatives au
Outils de l'Audit Interne
service:
Liste des procdures,
Types d'informations et supports d'information,
Frquence de consultation et de mise jour de document,
Rpartition de la charge de travail par poste.
Nlku C. HANS-KWETEVIE
14
5.2.4 Fiche d'analyse de poste de travail
L'analyse d'un poste de travail a pour finalit de vrifier que le
poste examin fournit un cot minimum des prestations de
qualit dans des dlais acceptables.
L'analyse du poste de travail repose sur l'identification des
lments caractristiques des postes dans les fiches de
fonction et les fiches de poste. L'objectif tant de mettre en
vidence des anomalies telles que :
les variations d'activit selon les saisons ;
les turnovers relevs ;
la parcellisation des travaux ;
la non automatisation des tches ;
la lenteur des circuits d'information
Outils de l'Audit Interne
Niku C. HANSKWETEVIE
15
5.2.5 Fiche d'analyse de flux d'information
Le diagramme de circulation de l'information (ou diagramme de flux) permet
de reprsenter la circulation de l'information au sein d'une structure en
identifiant :
les points d'mission de l'information,
les points d'enrichissement et 1 ou de validation de l'information,
les points d'utilisation de l'information (dcision, traitement spcifique ..... )
La circulation de l'information pertinente et dans les dlais requis, au sein
d'une organisation, permet et contribue disposer d'un processus efficace
de prise de dcision.
Les diagrammes de circulation de l'information permettent d'identifier trs
aisment le transit des principales donnes au sein des entits objet de
l'audit. L'objectif tant de pouvoir analyser :
Outils de l'Audit Interne
la nature de l'utilisation pour chaque entit de l'information ;
la qualit des interfaces entre les entits :
- Informations circulant sans difficults,
- Circuits d'informations simples,
- Dlai de circulation de l'information d'une entit vers une autre rapide
Niku C. HANS-KWETEVIE
16
5.2.6 Fiche d'analyse du schma de procdure
La reprsentation schmatique d'une procdure permet de modliser le
droulement des oprations ncessaires l'excution d'un traitement
administratif ou oprationnel en vue d'en analyser la pertinence et
l'efficacit de son fonctionnement.
schmatisation d'un processus ou d'une procdure l'aide de symboles
permet de reprsenter de manire claire les oprations administratives ou
.oprationnelles et d'en faire plus facilement le diagnostic.
La modlisation d'une procdure consiste :
identifier tous les intervenants et acteurs dans cette procdure,
identifier toutes les entres (input) et sorties (output) concernant la
procdure (documents, informations, fichiers ..... ),
dcomposer l'ensemble des traitements en oprations lmentaires
(manuelles ou informatiques),
identifier les conditions et tests qui dterminent la nature des oprations,
et les expliquer,
identifier les oprations rptitives et les expliquer.
Le schma fait ensuite l'objet d'une analyse diagnostique qui rvle :
des taches redondantes, telles que les contrOles en vigueur ;
les tches non automatises;
les dlais d'excution plus ou moins longs ;
le nombre d'intervenants.
Outils de l'Audit Interne Niku C. HANS-KWETEVIE
.. : ..
17
5.2.6.1 Principaux symboles utiliss pour la schmatisation d'une procdure
---------------------------------------------------------------------------------------
'
'
'
: Dcision ou test induisant plusieurs chanes d'oprations dans
l une procdure
'
l--------------------------------------------------------------------------------------
r-------------------------------------------------------------------------------------
'
'
l Flux d'information sur un support physique (papier, magntique)
'
'
~
---------------------------------------------------------------------------------------
'
'
! Tltransmission d'information
'
'
L-------------------------------------------------------------------
~
'
! Mise jour d'un fichier
' .
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
'
! Document papier
'
'
r--------------------------------------------------------------------------------------
! Fichier sur disque magntique
'
'
'
---------------------------------------------------------------------------------------
~
'
! Archivage de document
'
'
i--------------------------------------------------------------------------------------
l Dlai de traitement ou de ralisation d'un opration
'
'
! Dbut 1 Fin d'une procdure
'
'
---------------------------------------------------------------------------------------
'
'
'
! Tche
'
\,. --------------------------------------------------------------------------------------
~ ~ ~
'
'
: Entre manuelle
'
'
---------------------------------------------------------------------------------------
'
'
l Renvoi vers la page suivante
'
L--------------------------------------------------------------------------------------
La schmatisation d'une procdure doit permettre sa lecture rapide et facile.
Les flches prsentant les flux d'information doivent, dans la mesure du possible :
Etre orientes de la gauche vers la droite ou de haut en bas,
Ne pas se croiser pour ne pas rendre la lecture difficile et ne pas induire l'erreur
Outils de l'Audit Interne Niku C. HANS-KWETEVIE
18
5.2.7 Fiche d'analyse d'un systme d'information
Les performances d'une organisation sont trs dpendantes
de la qualit et de la pertinence de son systme
d'information. L'objectif tant de faire la synthse des
caractristiques de ce systme et d'valuer sa contribution et
1 ou son dfaut de contribution la performance de
l'organisation.
L'analyse du systme d'information consiste schmatiser
l'architecture fonctionnelle du -systme d'information,
domaine par domaine, de l'organisme dans l'objectif de
mettre en vidence :
les fonctions automatises et les fonctions manuelles,
les cycles de traitements,
les fonctions critiques,
les principaux fichiers et bases de donnes,
les principaux volumes de transactions,
l'architecture technique du systme :
- matriels,
- logiciels de base, tlcommunications ....
La seconde tape vise valuer le systme selon diffrents
aspects, et tout particulirement :
le degr d'automatisation du systme d'information,
la disponibilit des fonctions essentielles compte tenu de la
stratgie de l'organisme et du degr de satisfaction des
utilisateurs,
l'intgration et la cohrence du systme d'information,
la rapidit et la scurit du systme d'information,
la cohrence et la qualit techniques,
la gestion prvisionnelle du systme d'information:
existence d'un schma directeur informatique, de projets
d'amlioration ..... .
Outils de l'Audit Interne
Niku C. HANS-KWETEVIE
19
5.2.8 Fiche d'analyse d'une application informatique
Une application informatique est un ensemble de traitements
informatiss d'une fonction donne. Son analyse permet
d'identifier les caractristiques fonctionnelles et techniques
essentielles et de vrifier par ailleurs qu'elle :
rpond aux besoins des utilisateurs,
leur facilite le traitement des oprations,
permet de rduire les temps de traitements et donc les
temps de cycle (meilleure performance)
L'analyse d'une application informatique permet de mettre en
vidence ses dfauts ainsi que ses lacunes rpondre aux
besoins de ses utilisateurs. L'objectif tant de rvler :
les manques de fiabilit qui peuvent en rsulter,
les dfauts ou insuffisance d'intgration,
l'obsolescence fonctionnelle : l'application ne correspond
plus aux besoins des utilisateurs qui ont volu depuis la
conception initiale,
l'obsolescence technique qui ne permet plus un
accroissement des capacits de services rendus.
Outils de l'Audit Interne Nlku C. HANS-KWETEV/E
20
5.2.9 Fiche d'analyse des emplois et des ressources humaines
L'analyse des emplois et des ressources humaines permet de :
faire la synthse des caractristiques du personnel de
l'organisation sur la base d'une analyse qualitative et quantitative
du personnel,
faire la synthse des emplois existants au sein de l'organisation,
confronter les ressources humaines et emplois et en tirer les
consquences quant leur adquation et aux mesures mettre en
uvre llier aux ventuels carts et incohrences.
L'analyse des emplois et ressources -humaines consiste mettre en
vidence les caractristiques du personnel de l'organisation en
question. Pour cela, on se base sur les informations disponibles au
niveau de la base de donnes du personnel. A dfaut, on s'attachera
faire reconstituer cette base de donnes aux fins d'une analyse
fiable.
Les informations requises concernent :
des informations sur les individus telles que les comptences, la
qualit du travail, la capacit d'encadrement et d'animation, les
souhaits d'volution,
des informations de synthse sur le personnel telles que:
la pyramide des ges,
la rpartition Homme 1 Femme,
la structure par catgorie,
la structure par qualification,
l'anciennet dans l'organisation par catgorie, par structure,
l'absentisme,
la rotation en interne,
le turnover,
la structure des rmunrations,
le nombre de congs de maladies par structure, par tranche
d'ge et par sexe.
De mme, cette analyse consistera mettre en vidence les
principales particularits qui caractrisent les emplois types de
l'organisation, savoir: les sous et 1 ou surqualifications du
personnel pour chaqe poste, la mobilit du perspnnel en interne, la
politique de rmunration.
Outils de l'Audit Interne Niku C. HANS-KWETEVIE
21
REPUBUQUEDUCAMEROUN
PAIX-TRAVAIL- PA TRIE
_, SEP 2005
r.T 4.ME DA. VID
i _1 2003
FIXANT LES ATTRIBUTIONS, L'ORGANISATION
ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE
DES COMPTES DE LA COUR SUPREME
L'Assemble Nationale a dlibr et adopt,
le Prsident de la Rpublique promulgue la
loi dont la teneur suit :
2
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La prsente loi fixe les attributions, l'organisation et le
fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprme.
ARTICLE 2.- 1) La Chambre des Comptes ontrle et juge les comptes
ou les documents en tenant lieu des comptables publics patents ou de.'
fait:
- de l'Etat et de ses tablissements publics ;
- des collectivits territoriales dcentralises et de leurs
tablissements p u l i c ~ ;
- des entreprises du secteur public et parapublic.
2) Elle statue souverainement sur les dcisions rendues en
dernier ressort par les juridictions infrieures des comptes.
3) Elle connat de toute autre matire qui lui est
expressment attribue par la loi.
ARTICLE 3.- La Chambre des comptes produit annuellement lU
Prsident die la Rpublique, au Prsident de l'Assemble Nationale et au
Prsident du Snat, un rapport exposant le rsultat gnral de ses
travaux et les observations qu'elle estime devoir formuler en vue de la
rforme et de l'amlioration de la tenue des comptes et de la discpline
des comptables. Ce rapport est publi au Journal Officiel de la
Rpublique.
ARTICLE 4 .. - La Chambre des Comptes rend, sur les comptes qu'elle est
appele juger, des arrts qui tablissent si les comptes jugs sont
quittes, en avance ou en dbet.
ARTICLE 5!.- (1) Est comptable public patent au sens de la prsente ioi,
toute personne rgulirement prpose aux comptes et charge du
maniement des deniers ou valeurs ou de la comptabilit matires.
(:2) Sont comptables publics :
- les comptables du Trsor ;
les comptables des domaines ;
- les receveurs municipaux, dans la mesure o les recettes
municipales sont gres par des personnels autres que
les comptables du Trsor ;
3
- comptables-matires, et tous ceux dsigns comme
tels par les dispositions lgislatives ou rglementaires
particulires.
ARTICLE 6.- (1) de fait toute personne qui, n'ayant pas la
qualit de comptable ou n'agiss-a-nt pas en cette qualit, s'ingre dans
les oprations de recettes et de dpenses. de maniement des valeurs,
de deniers publics, ceux rglements ou non rglements, ainsi que
ceux des tablissements publics et des entreprises du secteur public et
parapublic.
(2) Est galement comptable de fait, toute personne qui,
n'ayant pas la qualit de comptable-matires, s'immisce dans les
oprations de recettes, de garde et d'affectation des matires
appartenant une personne morale de droit public ou de droit priv dans
laquelle l'Etat dtient au moins vingt pour cent du capital.
(3) Il en rsulte pour le co'mptable de fait toutes les
obligations d'un comptable patent du point de vue des oprations faites
par lui et de sa responsabilit personnelle et pcuniaire.
TITRE Il
DES ATTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES
ARTICLE 7.- La Chambre des Comptes contrle et juge les comptes des
comptables publics, dclare et apure les comptabilits de fait, prononce
les condamnations l'amende dans les conditions fixes par la prsente
loi et statue souverainement en cassation sur les recours forms contre
les jugements dfinitifs des juridictions infrieures des comptes.
ARTICLE 8.- Le contrle et le jugement de la chambre portent sur :
- les comptes et documents annexes des comptables
publics patents des personnes morales de droit priv dans
lesquelles l'Etat est actionnaire unique ou majoritaire ;
- les comptes des comptables publics patents des
personnes morales dans lesquelles l'Etat et/ou d'autres
personnes morales de droit public dtiennent sparment
ou ensemble plus de la moiti du capital ou des voix dans
les organes dlibrants ;
- les comptes et documents annexes des comptables
publics patents des personnes morales, quel que soit leur
statut juridique, dans lesquelles l'Etat et d'autres
4
personnes morales de droit public dtiennent ensemble le
pouvoir de dcision ou la minorit de blocage ;
- les comptes et documents annexes des comptables
publics patents des personnes morales, quel que soit leur
statut juridique, bnficiant ou percevant des
prfvenients obligatoires tels que ceux de la prvoyance
sociale ou de la .formation professionnelle ;
- les comptes et documents annexes des comptables
publics patents des personnes morales, quel que soit leur
statut juridique, exploitant un service public ou monopole
d'Etat;
- les comptes et documents annexes des comptables.
publics patents de toute personne morale, quel que soit
son statut, qui bnficie d'un concours financier direct ou
indirect de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit
public;
- les comptes des personnes physiques exerant les
fonctions officielles ou ceux des comptables publics
patents des personnes morales investies d'une mission
spcifique et recevant ce titre les fruits de la gnrosit
nationale ou internationale, dans les conditions fixes par
l'acte accordant les concours financiers ci-dessus.
ARTICLE 9.- Outre les attributions vises aux articles 7 et 8 ci-dessus, la
Chambre des comptes connat des recours en cassation des jugements
dfinitifs rendus par les juridictions infrieures des comptes.
ARTICLE 10.- Lorsqu'elle est saisie, la Chambre des Comptes donne
son avis sur toute question relative au contrle et au jugement des
comptes.
ARTICLE 11.- La liste des personnes morales de droit priv dans
lesquelles l'Etat et d'autres personnes morales de droit public dtiennent
sparment ou ensemble soit plus de la moiti du capital, soit une part
du capital, soit le pouvoir de dcision, est notifie la Chambre des
Comptes par le Ministre charg des finances. Cette liste a valeur
nonciat11e. Toute modification est immdiatement porte la
connaissance de la Chambre des Comptes.
ARTICLE 1 z.- Les comptables publics patents sont tenus de se
conformer aux lois et rglements en vigueur sur la conservation des
archives.
5
TITRE Ill
DE L'ORGANISATION
DE LA CHAMBRE DES COMPTES
CHAPITRE 1
DE L'ORGANISATION EN SECTIONS
ARTICLE 13.- (1) La Chambre des Comptes est organise en sections.
Elle comprend :
- la section de contrle et de jugement des comptes des
comptables de l'Etat ;
- la section de contrle et de jugement des comptes des
comptables des collectivits territoriales dcentralises et de
leurs tablissements publics, sous rserve des attributions
dvolues aux juridictions infrieures des comptes ;
- la section de contrle et de jugement des comptes des
comptables des tablissements publics de l'Etat ;
- la section de contrle et de jugement des comptes des
entreprises du secteur public et para public;
la section des pourvois.
(2) Toute autre section peut tre cre, en tant que de
besoin, par dcret du Prsident de la Rpublique.
CHAPITRE Il
DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES COMPTES
ARTICLE 14.- La Chambre des Comptes est compose d'un sige, d'un
ministre public et d'un greffe.
ARTICLE 15.- Le s i ~ de la Chambre des Comptes comprend :
- le Prsiden\/de la Chambre ;
- les Prsidents de Section ;
- les Conseillers ;
- les Conseillers Matres ;
- les Conseillers Rfrendaires ;
-- les Auditeurs et les Auditeurs stagiaires.
ARTICLE 16.- Le Greffe de la Chambre des Comptes comprend:
- le Greffier en chef de la Chambre des Comptes ;
- les Greffiers de Section ;
- les Greffiers.
6
ARTICLE 17.- Les fonctions de ministre public sont exerces par le
Procureur Gnral prs la Cour Suprme.
ARTICLE .18.- (1) Les magistrats du sige d.eJ.a Chambre des Comptes
sont nomms par dcret du Prsident de la Rpublique aprs avis du
Conseil Suprieur de la Magistrature.
(2) Les magistrats du Ministre Public de la Chambre des
Comptes sont nomms par dcret du Prsident de la Rpublique.
(3) Le Greffier en chef de la Chambre des comptes est
nomm par dcret du Prsfdent de la Rpubiique.
ARTICLE 19.- La Chambre des Comptes peut utiliser des fonctionnaires
de catgorie A et les contractuels d'administration de dixime catgorie
au moins, qui lui sont affects.
ARTICLE 20.- (1) Elle peut: galement recourir au service temporaire
ou consultants privs intervenant sous son autorit, dans des
conditions rglementaires ou contractuelles.
(2) Les experts et consultants sont astreints au secret
professionnel.
HAPITRE Ill
DES FORMATIONS AU SEIN DE LA CHAMBRE DES COMPTES
ARTICLE 2.1.- (1) La Chambre des Comptes se runit dans le cadre de
ses sections :
- en audience ordinaire ;
- en sections runies ;
- en chambre de conseil.
(2) Le Prsident de la Chambre des Comptes dtermine par
ordonnance, les matirE$ dont connaissent les diffrentes forrr.dtions.
ARTICLE 22 .. - (1) En cas d'absence ou d'empchement du Prsident de
la Chambre (jes Comptes, il est remplac par le Prsident de Section le
plus ancien dans le grade le plus lev.
7
(2) En cas d'absence ou d'empchement du Prsident de
Section, il est remplac par le Conseiller Matre le plus ancien dans le
grade le plus lev.
ARTICLE 23.- (1) En audience ordinaire, -la Section- se compose:
- du Prsident de Section ;
- de deux Conseillers Matres.
- du Procureur Gnral prs la Cour Suprme.
(2) En cas d'absence ou d'empchement du Prsident
dra Section, il est remplac par le Conseiller le plus ancien dans le grade
Ira plus lev.
ARTICLE 24.- La formation des sections runies se compose du
Prsident de la Chambre des Comptes, des Prsidents de Section et de
deux Conseillers Matres par section dsigns par le Prsident de la
Chambre des Comptes. Elle comprend galement le Procureur Gnral
prs la Cour Suprme.
ARTICLE 25.- La chambre de conseil se compose du Prsident de la
Chambre des Comptes, des Prsidents de Section et des Conseillers
Matres. Elle comprend galement le Procureur Gnral prs la Cour
Suprme.
TITRE IV
DU FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DES COMPTES
CHAPITRE 1
DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT DES COMPTES DES
COMPTABLES PATENTS
ARTICLE 26.- (1) Sans prjudice de certaines spcificits, la procdure
devant la Chambre des Comptes obit aux dispositions de la loi fixant
l'organisation de la Cour Suprme. Elle est crite.
(2) Les Comptes des comptables publics patents, mis en
forme et examins conformment aux textes en vigueur, sont prsents
en vue du jugement la Chambre des Comptes dans les trois (3) mois
suivant la clture de l'exercice budgtaire.
8
(3) Ils sont dposs contre rcpiss ou adresss par lettre
recommande avec accus de rception au greffe de la Chambre des
Comptes, puis enregistrs et dats leur arrive.
(4) Ils -sonttransmis -au greffe de la Chambre des
par le Ministre charg des Finances ou par toute autre autorit habilite.
ARTICLE 27.- (1) L'instruction de chaque compte est confie par le
Prsident de la Section concerne un magistrat rapporteur.
(2) Le magistrat rapporteur examine les comptes et
s'assure de l'existence et de fa valeur probante des pices justificatives
prvues par la rglementation en vigueur.
(3) Le magistrat rapporteur demande aux comptables
toute information complmentaire.
(4) Au terme de son instruction et pour chaque exercice
budgtaire, le magistrat rapporteur rdige un rapport motiv sur les
comptes qui lui ont t confis.
(5) Le rapport contient des observations de deux
natures:
a) les premires concernent la ligne de comptes ;
b) les secondes rsultent de la comparaison de la nature et du
volume des dpenses et des recettes, avec les autorisations qui
figurent dans les comptes administratifs et les budgets d'une part,
et la vrification de la conformit des oprations comptables aux
lois e1t rglements en vigueur d'autre part.
(6) Les vrifications sont effectues par examen
comptes et des pices justificatives. Elles comportent, en tant que de
besoin, toute demande de renseignements, enqutes sur place ou
expertises.
ARTICLE 28.- (1) Aprs examen des comptes, le magistrat rapporteur
transmet son rapport au Prsident de la Section, lequel peut le
transmett;e un autre magistrat qui vrifie le bien-fond des
observations, en qualit de contre-rapporteur.
(2) La suite donne chaque observation fait l'objet
d'une proposition motive.
9
(3) Le rapport et le rapport complmentaire ou contre-rapport
sont transmis au ministre public pour la prsentation de ses
conclusions.
ARTICLE 29.- (1) La Chambre des Comptes, sigeant en formation de
jugement, sttue par arrt compte aprs examen des observations
prsentes par le rapporteur et au vu des conclusions du
public.
(2) L'arrt de compte est dfinitif et certifie la ligne de
compte s'il n'y a pas d'observation.
(3) Dans le ,cas contraire, l'arrt de compte est provisoire
et comprend deux parties :
a) la premire partie est relative la ligne de compte ;
b) la deuxime partie enjoint 'les comptables d'apporter les
pices justificatives manquantes, de procder aux
diligences ncessaires et de fournir toutes explications
utiles.
ARTICLE 30.- (1) L'arrt provisoire de compte est signifi aux
comptables dont ils manent et aux ministres d,ont ils relvent par les
voies de droit.
(2) Les comptables disposent d'un dlai de deux mois
compter de la date de notification de l'arrt provisoire pour satisfaire
aux injonctions qui leurs sont adresses sous peine des sanctions
prvues par la prsente loi.
ARTICLE 31.- En cas de mutation du comptable, le comptable en
exercice est tenu de donner suite aux injonctions adresses son
prdcesseur. Il communique ce dernier une copie de l'arrt ainsi que,
rponses qu'il transmet la Chambre des Comptes aprs
acquiescement du comptable mut.
ARTICLE 32.- Lorsque l'apurement des comptabilits prsente des
difficults particulires, le Ministre charg des finances peut commettre
d'office un autre comptable. Celui-ci donne suite aux injonctions, en lieu
et place du comptable dfaillant.
10
(1) Aprs examen des rponses des comptables et des
conclusions complmentaires du rapporteur, la Chambre des Comptes,
si'geant en formation de jugement, statue par arrt dfinitif de compte.
L'arrt de compte comporte deux parties :
a) .la premire partie certifie la ligne de compte, ventuellement
assortie de redressements ;
b) la deuxime partie prononce soit la rgularit du compte, soit
une avance comptable, soit un dfaut comptable et distingue
ventuellement les priodes respectives d'enregistrement des
oprations.
(2) Le dfaut comptable ou l'avance comptable est, par
dfinition, gal au montant des fonds, valeurs, crances ou dettes dont
la personne publique concerne par le compte aurait dispos, en plus ou
en moins si les lois et rglements budgtaires et comptables avaient t
exactement et intgralement respects.
ARTICLE 34.- (1) L'arrt dfinitif de compte comporte de droit pour le
Trsor Public, privilges sur les biens meubles et hypothque sur les
biens immeubles des comptables, concurrence du dfaut dont chaque
comptable est prsum responsable en application des articles 43 49
ci-dessous.
(2) Avant de se prononcer titre dfinitif, la Chambre des
Comptes peut rendre sur un mme compte plusieurs arrts provisoires
successifs.
ARTICLE 35.- (1) La Chambre des Comptes rend des arrts si les
comptables sont dchargs ou quittes, en avance ou en dbet.
(2) Lorsque les comptables sont dchargs ou quittes, la
chambre prononce leur dcharge dfinitive.
(3) La chambre autorise le remboursement du cautionnement
des comptables dont les fonctions ont pris fin et donne Main leve et
radiations des oppositions et inscriptions hypothcaires mises sur leurs
biens raison de leurs actes.
(4) Lorsque les comptes sont en avance, la Chambre des
'Comptes surseoit la dcharge des comptables dans l'attente d'une
11
rgularisation prvue au cours de l'exercice suivant. Dans ce cas, elle
porte ses rserves sur le compte.
(5) Lorsque les comptes sont en dbet, la Chambre des
Comptes constitue le comptable dbiteur. l:.e Ministre- charg des
finances procde au recouvrement des sommes dues. Les sommes
recouvres sont reverses, le cas chant, la personne morale
concerne.
ARTICLE 36.- (1) L'arrt est notifi :
- aux comptables responsables du compte;
- au Ministre charg des finances ;
- au ministre dont ils relvent ;
- aux ministres de tutelle et ordonnateurs des collectivits
territoriales dcentralises ou des entreprises publiques ou
parapubliques intresses.
(2) La notification .de l'arrt donne Heu dlivrance d'un
accus de rception
ARTICLE 37.- Si l'instruction ou l'examen des comptes fait apparatre
des faits susceptibles de constituer des infractions la loi pnale, le
Procureur Gnral prs la Cour Suprme informe le Ministre char9 des
finances et les Ministres ou autorits de tutelle intresss. Le dossi,er est
transmis au Ministre de la Justice par le Procureur Gnral prs la Cour
Suprme. Cette transmission vaut plainte au nom de l'Etat, ale la
collectivit territoriale dcentralise, de l'entreprise publique ou
parapublique ou de l'tablissement public concern.
ARTICLE 38.- (1) Par drogation aux dispositions qui prcdent, 1'es
comptes des organes constitutionnels sont soumis l'examen d'une
commission compose d'un reprsentant de chaque organe et
par le Prsident de la Chambre des Comptes.
(2) La commission prvue l'alina 1er ci-dessus
examine les comptes ou tout document en tenant lieu et, si ncessaire,
entend le comptable de l'organe constitutionnel concern. Elfe adresse
un rapport confidentiel de ses observations et recommandations au
Prsident de la Rpublique et aux dirigeants des autres Organes
Constitutionnels.
12
CHAPITRE Il
DES COMPTABILITES DE FAIT
_ARTICLE 39.- (1) _ comptabilits _de_ fait sont dcouvertes, soit par
l'administration, soit par n audii Interne 6ii-externe soit par une mission
d'audit de l'Institution Suprieure de Contrle des Finances Publiques.
(2) Dans tous les cas, elles ressortissent la Chambre
des Comptes.
(3) Lorsque des cas de comptabilit de fait sont
dcouverts par l'Administration ou par un audit interne ou externe, ils
sont communiqus l'Institution Suprieure de Contrle par les soins
des structures,qui les ont identifis.
' . -1.
_,. (4) Saisie des cas de comptabilit de fait et des pices
l'Institution Suprieure de Contrle procde sans dlai aux
vrifications ncessaires, et le cas chant, la dclaration de la
. comptabilit de fait. La -dclattTon de-l'Institution Suprieure de Contrle
ne lie pas la Chambre. Celle- ci peut l'infirmer ou la confirmer.
L'Institution Suprieure de Contrle adresse copie du dossier au
Prsident de la Chambre pour comptence. La copie est accompagne
de tous les redressements demands par l'auteur de la dcouverte de l.1
comptabilit de fait.
ARTICLE 40.- (1) La Chambre des Comptes statue sur les conclus-ions
du ministre public sur l'acte introductif d'instance. Elle doit, si son
examen n'aboutit pas une dclaration de comptabilit de fait, rendre un
arrt de non-lieu.
Dans tous les cas, le Prsident de la Chambre des
Comptes peut prescrire une enqute juridictionnelle pralable.
(2) Si l'instruction fait apparatre des actes susceptibles
de constituer des irrgularits comptables, le magistrat rapporteur d-oit
demander le squestre des biens du comptable de fait. Le squestre est
dcid par la formation de jugement. Il est administr et liquid dans iG.s
conditions prvues par la loi.
ARTICLE 41.- (1) La Chambre des Comptes dclare d'abord la
comptabilit de fait par arrt6 provisoire. L'arrt. provisoire enjoint le
comptable de fait de produire son compte. Il lui est imparti un dlai de
..
13
trois mois pour rpondre compter de la notification de celui-
ci.
La Chambre des Comptes mentionne dans son arrt4
provisoire qu'en l'absence de rponse dans le dlai imparti, elle passera
.outre et statuera rlfinitbteme.ntau.ion.d._
(2) _Un arrt de la Chambre des Comptes confirme la
dclaration de comptabilit de fait et statue sur le compte si celui-ci ne
comporte aucune rserve.
(3) En cas de contestation de l'arrt+ provisoire par le
comptable de fait, la Chambre des Comptes examine les moyens
invoqus et, lorsqu'elle maintient titre dfinitif la dclaration de
comptabilit de fait, ritre l'injonction de rendre compte dans un dlai
de trois mois.
(4) Si la Chambre des Comptes ne maintient pas la
dclaration de comptabilit de fait, elle rend un arrt de non-lieu.
ARTICLE 42.- Si, aprs la dclaration dfinitive de comptabilit de fait,
le comptable de fait ne produit pas son compte, la Chambre des
Comptes peut le condamner l'amende prvue par la prsente loi au
titre du retard dans la production du compte. Le retard court compter
de la date d'expiration du dlai imparti pour produire le compte.
En cas de besoin, la Chambre des Comptes peut
commettre d'office un nouveau comptable pour produire le compte en
lieu et place et aux frais du comptable de fait dfaillant.
AHTICLE 43.- Si plusieurs personnes ont particip en mme temps
une comptabilit de fait, elles sont dclares conjointement et
solidairement comptables de fait et ne produisent qu'un seul compte. En
fonction des oprations auxquelles chacune d'elles a pris part, la
solidarit peut porter sur tout ou partie des oprations de comptabilit de
fait.
ARTICLE 44.- (1) Les critures relatives la comptabilit de fait,
transmises la Chambre des Comptes, assorties de pices justificatives,
sont juges suivant les rgles applicables aux comptes des comptables
publics patents.
(2) Hormis le cas de mauvaise foi et de manque de sincrit
du comptable de fait, la Chambre des Comptes peut, pour des
14
considrations d'quit, suppler l'insuffisance des pices justificatives
produites.
CHAPITRE Ill
DU POURVOI EN CASSATION
AR:TICLE 45.- L'instruction des pourvois se fait suivant les dispositions prvues
aux articles 27 37 de la prsente loi.
AHTICLE 46.- Le pourvoi, sauf dispositions spciales contraires doit, peine de
forclusion, tre form dans un dlai de 15 jours compter du lendemain de la
notification du jugement de la juridiction infrieure des comptes.
47.- Les cas d'ouverture pourvoi et les formes de pourvoi sont ceux
observs devant la procdure suivie la Cour Suprme.
TITRE V
DE LA SANCTION DES RESPONSABILITES
DES COMPTABLES PUBLICS
; .. ', 1
.,__ - \
SGTION 1
DE LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 48.- {1) Le comptable public est prsum responsable
personnellement et pcuniairement :
- des dfauts comptables constats dans ses comptes ;
- de l'exercice des contrles prvus par les lois et rglements ;
- du recouvrement des recettes et du paiement des dpenses
rgulirement justifies ;
- de la conservation des fonds et valeurs ;
- du maniement des fonds et mouvements de disponibilits ;
- de la tenue de la comptabilit de son poste.
(2) Le comptable n'est pas responsable ou peut tre dcharg
de s:a responsabilit, en dpit d'une avance ou d'un dfaut comptable :
- s'il a obi une rquisition rgulire de l'ordonnateur ;
15
- si l'exercice des contrles prvus par les lois et rglements ne
pouvait lui permettre de dcouvrir l'irrgularit ;
- s'il apporte la preuve qu'il a fait toute diligence pour assurer le
recouvrement des recettes, procurer des gages au Trsor ou
viter que la responsabilit civile de la personne publique ne
Vis--=Vs
- si une recette t rgulirement admise en non-valeur ;
- si une force majeure l'a empch d'exercer un contrle ou
d'accomplir un acte auquel il tait tenu.
ARTICLE 49.- La responsabilit du comptable ne peut tre mise en jeu
du fait de la gestion de ses prdcesseurs que pour des oprations qu'hl
a prises en rseNe lors de la passation de seNice o_lJ qu'il
n'aurait pas constates dans un dlai de six mois ventuellement
prolong par dcision du Ministre charg des finances.
ARTICLE 50.- (1) Sauf dans les cas o la dcharge aurait t admise
au titre de la prsente loi, la responsabilit pcuniaire du comptable
s'tend effectivement toutes les oprations du poste qu'il dirige, depuis
la date cie son installation jusqu' la date de sa cessation de fonction,
que les oprations retraces dans le compte aient t excutes par lui-
mme, ses mandataires ou ses subordonns.
(2) Dans la mesure o sa responsabilit pcuniaire a t
rgulirement engage la suite d'une faute commise par ses
mandataires ou ses subordonns, le comptable peut intenter contre eux
une action civile rcursoire sans prjudice des poursuites pnales et
disciplinaires susceptibles d'tre engages contre eux.
ARTICLE 51.- (1) A titre subsidiaire, la responsabilit pcuniaire d'un
comptable s'tend aux oprations :
des comptables secondaires et des regtsseurs qui lui sont
rattachs dans la limite des contrles auxquels il est tenu leur
gard; -
- des comptables de fait dont il a connu et tolr les agissements.
(2) Toutefois, l'autorit qui dcide de sa responsabilit
peut faire application de l'un des motifs numrs par la prsente loi, et
reporter par le mme acte tout ou partie de la responsabilit pcuniaire
du comptable sur lesdits comptables secondaires, rgisseurs ou
comptables de fait.
16
ARTICLE 52.- (1) Aucune sanction administrative ne peut tre
prononce contre un comptable s'il a tabli que les rglements ou
instructions qu'il a refus de suivre taient de nature engager sa
responsabilit personnelle et pcuniaire.
Les comptables ne peuve-rit donrier suite aux ordres
ou rquisitions des ordonnateurs que dans les conditions prvues par les
lois et rglements en vigueur.
ARTICLE (1) Les dfauts comptables qui ne sont pas tnis la
charge pcuniaire des comptables sont couverts par le budget de l'Etat
ou par 'Celui de la personne qui a cr ou contribu crer le dfaut
comptable ou les poursues.
- ..
(2) L'Etat dispose en outre d'une action
l'enc,ontre des mandataires et des agents subordonns des comptables
dans la mesure o ceux-ci ont t dchargs de leur responsabilit.
1
CHAPITRE Il
DES SANCTIONS
ARTICLE 54.- Tout comptable qui ne prsente pas son compte dans les
forme et dlai prescrits par les rglements encourt une condamnation
par la Chambre des Comptes une amende d'un montant maximal gal
la moiti de l'indemnit mensuelle de responsabilit du comptable au
moment des faits, et par mois de retard.
ARTICLE 55.- Tout comptable qui ne rpond pas aux injonctions
prononces sur son compte dans le dlai prescrit encourt une
condamnation par la Chambre des Comptes une amende d'un montant
maximal gal au montant de l'indemnit mensuelle de responsabilit au
moment des faits par injonction et par mois de retard, s'il ne fournit
aucune explication recevable au sujet du retard.
ARTICLE 56.- Le comptable commis d'office substitu au comptable
ou ses ayants droit pour prsenter un compte ou satisfaire
aux injonctions, le comptable en exercice charg de prsenter le compte
des oprations effectues par des comptables en fin de fonction ou de
rpondre des injonctions portant sur la gestion de ses prdcesseurs,
sont passibles des :amendes prvues aux articles 54 et 55 ci-dessus,
raison des retards qui leur sont personnellement imputables.
ARTICLE 57.- Dans les cas prvus aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, la
Chambre des Comptes statue d'abord titre provisoire et impartit au
comptable un dlai de deux mois pour faire valoir ses moyens. Elle
17
mentionne dans l'arrt provisoire qu'en l'absence de rponse dans le dlai
imparti, elle statuera de droit, titre dfinitif. Aprs examen des moyens
produits, elle statue titre dfinitif.
-- ----- ------- .. -- - - - - ------- -- -
ARTICLE 58.- Sans prjudice des poursuites pnales, le comptable de fait
peut tre condamn par la Chambre des Comptes une amende calcule
en fonction de sa responsabilit personnelle ou suivant l'importance et la
dure de la dtention ou du maniement des fonds et valeurs, sans
toutefois pouvoir excder le total des sommes indment dtenues ou
manies.
ARTICLE 59.- En ce qui concerne l;rl1erid- prvue l'article 53 ci-
dessus, la Chambre des Comptes, dans son arrt de dclaration
provisoire de comptabilit de fait, sursoit statuer sur l'application de la
pnalit. Elle se rserve d'apprcier le mrite des justifications et
explications que le comptable de fait aurait prsenter au sujet d.e la
pnalit qu'il encourt. Elle statue sur ce point, titre dfinitif, au terme de
l'apurement de la comptabilit de fait.
ARTICLE 60.- Les amendes infliges en vertu des dispositions ci-dessus
sont recouvres par les soins du Trsor Public et reverses dans les
caisses de la personne morale publique concerne. Les infliges
aux comptables des services dots de l'autonomie financire sont
en recettes leur budget.
ARTICLE 61.- Les amendes sont assimiles aux dbets des comptables
publics quant aux modes de recouvrement, de poursuites et de remise.
ARTICLE 62.- Les dcisions de la Chambre des Comptes sont prises
aprs les conclusions crites du ministre public.
TITRE VI
DE L'EXECUTION DES DECISIONS
DE LA CHAMBRE DES COMPTES
CHAPITRE 1
DE LA NOTIFICATION DES ARRETS
ARTICLE (1) Le Greffier en Chef de la Chambre des Comptes notifie
directement aux comptables publics patents ou aux comptables de fait les
arrts rendus leur gard.
1
.. . ... , ......
18
, (2) Le Procureur Gnral prs la Cour suprme notifie
lesdits arrts :
- au Ministre charg des finances en ce qui le
du . _
au comptable suprieur du Trsor, en ce qui concerrie ls
autres comptables ;
- l'ordonnateur principal, secondaire ou dlgu qui a ordonn
les oprations du comptable.
ARTICLE 64.- (1) Les comptables patents ou les comptables de fJit
transmettent directement la Chambre des Comptes leurs rponses au><
arrts provisoires. '
(2) Ils les notifient aux autorits vises l'article 58 ci-
dessus.
'
ARTICLE 65.- (1) Tout comptable en fin de fonction est tenu, jusqu' sa
dcharge dfinitive, de notifier directement son nouveau domicile et tout
changement ultrieur de domicile au Greffier en Chef de la Chambre des
Comptes.
(2) L'obligation de notification vaut galement pour:
- son successeur, s'il s'agit d'un comptable suprieur du Trsor;
- le comptable suprieur comptent dans les autres cas.
comptable.
(3) Les mmes obligations incombent aux ayants droit du
ARTICLE 66.- (1) Si, la suite du refus du comptable public, patent ou
de fait, de celui de son remplaant ou commis d'office, ou pour toute
autre cause, une notification ne peut atteindre son destinataire, le
Procureur Gnral prs la Cour Suprme ou le Prsident de la Chambre
des Comptes transmet l'arrt la mairie ou la sous-prfecture du
dernier domicile connu ou dclar.
Dans ce cas, le rnaire ou le sous-prfet fait notifier l'arrt
contre dcharge.
procs-verbal.
(2) En cas de notification personne, il est dress un
19
Le procs-verbal et la dcharge sont adresss la
Chambre comptes.
ARTICLE 67.-.(1) Si l'agent administratif ne trouve pas le destinataire, il
dpose la notification la mairie ou la sous-prfecture et dresse de
ces faits un la notification. - --
(2) Un avis officiel est alors affich pendant un mois au
lieu de dpt. Cet avis informe le destinataire qu'une notification de la
Chambre des Comptes le concernant dpose la mairie ou la sous-
prfecture lui sera remise contre rcpiss, et que, faute de ce faire
avant l'expiration du dlai d'un mois, la notification sera considre
comme ayant t faite personne avec toutes les consquences de
droit qu'elle comporte.
(3) Le rcpiss et les procs-verbaux prvus par le
prsent article et le cas chant, le certificat des autorits constatant
l'affichage pendant un mois, doivent tre transmis sans dlai au
Prsident de la Chambre des Comptes.
ARTICLE 68.- Si le comptable de fait appartient aux organes excutifs
ou dlibrants d'une collectivit territoriale dcentralise, l'autorit de
tutelle procde, la demande du Prsident de la Chambre des Comptes,
la notification de l'.arrt.
ARTICLE 69.- Toutes les notifications et transmissions sont effectues
avec demande d'accus de rception ou contre dcharge.
ARTICLE 70.- (1) Les arrts de la Chambre des Comptes sont
excutoires.
(2) Le Ministre charg des finances, en ce qui concerne
l'Etat, l'ordonnateur du budget de la personne morale de droit public pour
les budgets dcentraliss, sont chargs de leur excution.
(3) Dans le cas o les arrts ne sont pas excuts dans
les six (6) mois compter de la date de leur notification, le Prsi:idnt de
la Chambre des Comptes en fait rapport au Prsident de la Rpublique
avec copie au Prsident de l'Assemble Nationale et au Prsident du
Snat. Il en est fait publication au Journal Officiel en franais et en
anglais.
20
CHAPITRE Il
DES VOIES DE RECOURS
ARTICLE 71.- Deux voies de recours sont ouvertes contre les arrts de
la Chamhre-d-es Comptes: l'annulation et a-rvls!On. - -- --- -
A) De l'annulation
ARTICLE 72.- (1) Le Procureur Gnral prs la Cour Suprme, d'ordre
du Ministre de la Justice, saisi par le Ministre charg des Finances otu le
Comptable intress ou encore les hritiers de celuici, peut se pourvoir
en annulation devant l'Assemble Plnire de la Cour suprme contre
les arrts dfinitifs de la Chambre des Comptes.
(2) La requte est introduite au greffe de la Cour Suprme.
(3) En cas d'annulation, l'Assemble Plnire de la CClur
Suprme voque et statue nouveau.
(4) Le pourvoi en annulation a un ~ r c t r e suspensif.
B) De la rvision
ARTICLE 73. (1) Nonobstant l'arrt de jugement dfinitif d'un compte, la
Chambre des Comptes peut, suite erreur, omission, faux ou double
emploi dcouverts postrieurement au prononc de l'arrt, procder sa
rvision, la demande soit du comptable, soit du Ministre charg des
finances ou des reprsentants lgaux des personnes morales publiques
concernes, soit du Procureur Gnral prs la Cour Suprme, soit
d'office.
(2) La demande de rev1s1on motive est adresse au
Prsident de la Chambre des Comptes. Elle comporte :
l'expos des faits et moyens invoqus par le requrant,
- la copie de l'arrt dont la rvision est demande,
- les justifications servant de base la requte, ainsi que des
pices tablissant la notification de cette requte aux autres
pa_rties intresses.
ARTICLE 7 4. (1) Si la rvision est juge recevable, la Chambre des
Comptes, statuant toutes sections runies titre dfinitif, admet ou
rejette la demande en rvision, selon qu'elle estime, aprs instruction,
21
que les pices produites permettent ou non d'ouvrir une instance en
rvision,
(2) Lorsque la demande est jug recevable, la Chambre des
C_ompte_s_prend par le_mme arrt, une d_cision_prparatoirede __
tat de rvision du compte et impartit au comptable un dlai de deux
mois pour produire les justifications supplmentaires ventuellement
ncessaires fa rvision lorsque celle-ci est demande par lui, ou faire
valoir ses moyens lorsque la rvision est engage contre lui.
Aprs examen des rponses ou aprs l'expiration du dlai
imparti, la Chambre des statue au fond.
(3) Lorsqu'elle dcide de la rvision titre dfinitif, elle
annule l'arrt incrimin, ordonne au besoin des garanties prendre et
procde au jugement des oprations contestes dans la forme d'une
instance ordinaire.
ARTICLE 75.- Lorsque la Chambre des Comptes agissant d'office
estime, aprs instruction, que les faits dont la preuve est apporte
permettent d'ouvrir une instance en rvision, elle rend un arrt
prparatoire de mise en tat de rvision des comptes et procde
conformment aux rgles prvues l'article prcdent.
ARTICLE 76.- (1) L'exercice d'un recours en rvision doit tre introduit
dans un dlai de six (6) mois compter de la notification de l'arrt au
comptable.
(2) Le recours en rvision n'a pas d'effet suspensif.
CHAPITRE Ill
DE L'AMNISTIE
ARTICLE 77.- Les amendes pour retard ne sont pas amnistiables et ne
sont pas portes au casier judiciaire du comptable condamn. Elles
peuvent faire l'objet de sursis paiement dans les conditions fixes par
voie i eglementaire.
TITRE- VIl
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 78.- (1) La prsente loi s'applique aux comptes des exercices
qui suivront l'anne de sa promulgation.
-----
,
22
(2) Les comptes qui n'entrent pas dans le champ
d'application de la prsente loi sront contrls et apurs dans des
onqition fix$es ~ r v o ~ .rglem.e_atair.e.
ARTICLE 79.- (1) Les comptes pendants devant les organismes chargs
de l'apurement des comptes publics avant la promulgation de la prsente
loi continueront d'tre examins par ceux-ci en attendant la mise en place
effective de la Chambre des Comptes.
(2) Ds la mise en place de la Chambre des Comptes, les
institutions antrieurement 'charges du contrle et de l'apurement des
comptes ainsi que de la sanction des comptables lui transmettent les
dossiers des affaires pendantes devant elles.
(3) La chambre des comptes exerce les attributions des
juridictions infrieures des comptes en attendant leur mise en place.
ARTICLE 80.- L'installation des magistrats de la Chambre des Comptes se
fait en audience solennelle de la Cour Suprme.
ARTICLE 81.- La prsente loi sera enregistre et publie suivant la
procdure d'urgence, puis insre au Journal Officiel en franais et en
anglais./-
c ArkPremir .et deia omptes
fixs par la prsii tO{Oigam}ue. - .c
Le sige de la Cour des est BANGUI.
_TITRE PREMIER
DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE PREMIER
DE LA COMPOSmON DE LA COUR DES COMPTES
art. 2- La Cour des Comptes est place sous l'autorit d'un Premier Prsident.
Art. 3 - Elle est compose de trois Chambres.
Art. 4 - Chaque Chambre est compose de six Juges dont un Prsident de Chambre.
Art. 5 - Le Parquet Gnral comprend un Procureur Gnral et trois Avocats
Gnraux.
Art. 6 - Les Juges la Cour des Comptes sont nomms pour cinq ( 5) ans renouvelable
une fois par Dcret pris en Conseil des Ministres. ils sont indpendants et
inamovibles .
,. -
.- .... ':
.
-. .
leur entre en en dela-Corifds
prside parle Prtident la et les Membres
serment en .. -,:cc:----
.
"
..........
est dirig par des .
0
Secrtaires<d Parquet ; .. ;
Art 9 -Le Greffier en Chef: le Secrtaire en Chef: les GreffiersetSecrtaires de
Parquet sont nomms par Arrt du Ministre de la Justice. Tis prtent serment
d .. bin et fidlement remplir leurs fonctions et d'observer en tout, les devoirs
qu'elles leur imposent. Le serment est reu en audience ordinaire de la Cour
/' des Comptes. ,
Art. 10- Le Greffier en Chef certifie les expditions des arrts et les fait notifier aux
comptables.
ll certifie et dliVre les extraits ou copies des autres actes de la Cour des
Comptes ou des Pices dont elle est dpositaire.
n prpare l'ordre du jour des sances.
n note les dcisions prises.
n tient les rles, les registres et les dossiers.
Le Secrtariat de Parquet, plac sous 1' autorit du Procureur Gnral, assure
les relations entre celui-ci et la Cour d'une part, et les Administrations, d'autre
part.
-
. Le Minist&e ..
dlibrations.
Le Greffier en Chef note les rsultats des dlibrations et en suit 1' excution.
4 ' C4ambre du Conseil sur le rapport de l'excution des lois de
finances, sur la dclaration gnrale de conformit et sur le rapport du public,
concernant un exercice dtermin.
Le Ministre Public peut soumettre la Chambre du Conseil, toutes autres
affaires relevant de sa comptence.
Art. 14 - Les Chambres runies sont composes du Premier Prsident, des Prsidents
de Chambres, d'un Conseiller par Chambre dsign par le Premier Prsident,
sur proposition des Prsidents de Chambres.
Elles ne peuvent siger valablement que si un quorum de cinq ( 5) membres est
atteint. /
Le Ministre Public est exerc par le Procureur Gnral ou un Avocat Gnral.
Le Secrtariat des Chambres runies est assur par le Greffier en Chef.
Les Chambres runies, la demande du Premier Prsident ou sur rquisitions
du Procureur Gnral, examinent les questions de droit sur lesquelles elles
rendent des avis ou statuent sur les affaires renvoyes par le Conseil d'Etat,
aprs cassation.
'l'-
- dclarer et apurer la de Jait ;
- vrifier et juger les comptes des collectivits des organismes
publics et parapublics dont elle se saisit ou dont elle est saisie par le Prsident
de la Rpublique ou par 1' Assemble Nationale ;
- contrler les comptes des entreprises de toute nature, des associations, des
groupements bnficiant des subventions de l'Etat, ainsi que ceux des Partis
. Politiques.
Art. 18 - La Cour des Comptes adresse au Prsident de la Rpublique le rapport public
de l'exercice concern et au Prsident de l'Assemble Nationale, le rapport de
conformit sur les comptes de l'anne soumis au vote de la Loi de rglement.
/
(
-,prside les audiences solennelles, la Chambre du Conseil et les Chainbres
, . . . ; : . : ;;_. ., .
_ reumes;
'
-- sgne les sous sa prsidence et rfrs aux Ministres
intresss ; '
- gre le personnel et le matriel affects la Cour des Comptes et ordonne les
dpenses correspondantes ;
- dsigne, la demande des Prsidents de Chambres, du Conseiller-Rapporteur
ou sur les rquisitions du Ministre Public, un ou plusieurs Experts pour des
investigations dans des affaires prsentant un caractre technique particulier.
Art. 20- En cas d'absence ou d'empchement du Premier Prsident, celui-ci est
suppl par un Prsident de Chambre dans 1' ordre du tableau.
Art 22 - Les Consilleis : .
- assurent les fonctiOns de juges-rapporteurs ;
-:-.... -
- rdigent les rapports contradictoires de dlibrations et les rapports dfinitifs
aux fins d'arrts -
' .
- participent aux dbats et aux dlibrations.
SECUON IV- DES ATilUBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL .
Art. 23 - Le Procureur Gnral :
- exerce le Ministre public par voie de rquisitions ou conclusions ;
.1
- veille la production des comptes dans les d ~ l i s rglementaires et, en cas de
retard, requiert 1' application des amendes prwes par la Loi ;
- Prsente des conclusions crites sur les rapports qui lui sont communiques
avec pices l'appui, tels que les rapports concernant les quitus, les dbets, les
amendes, les gestions de fait, les pouvoirs et les rvisions ;
- requiert en cas de besoin, 1' application des amendes pour immixtion dans les
fonctions de comptable public ;
@
' , . .,
. :_,
ou judiciaires, pour leur
bserva:tillS .. qu'elle lui a
. .;r_:
la:. Troisime Chambre est charge de la vrification de la comptabilit de
. l'Assemble Nationale, . du Conseil .Economique etc Social, des Chambres
Consulaires, des Partis Poltiqnes et des cOllectivits Territoriales autres que
de BANGUI. . .
TITRE IV
DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE PREMIER
\
DE LA SAISINE DE LA COUR DES COMPTES
Art. 25- La cour des Comptes est saisie ou se saisit d'office de toutes-les affaires
relevant de sa comptence.
Le Prsident de la Rpublique ou l'Assemble Nationale peut saisir la Cour
des Comptes d'une demande de vrification de la gestion de certains
services, tablissements ou entreprises.
La saisine rsulte des correspondances manant du Prsident de la
Rpublique ou du Prsident de l'Assemble Nationale ainsi que du dpt au
Greffe des comptes des comptables publics.
. ..
:: Le Premier Prsident communique les rppoits au Procureilr Gnral pour
ses,onclusions crites. ;i,
CHAPITRE ID
DES AUDIENCES DE LA COUR DES COMPTES
Art. 29 - Les audiences de la Cour des Comptes se droulent huis clos.
La Cour peut entendre tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant
d'entreprise publique ou tout membre de corps et institution de contrle.
Les comptables publics sortis de fonction peuvent se faire reprsenter par
leurs successeurs pour rendre compte de leur gestion et rpondre aux
injonctions de la Cour. /
Dans les affaires contentieuses o des considrations juridiques sont
dominantes, les parties peuvent constituer des Avocats pour la prsentation
des mmoires.
Lorsque la Cour relve des omissions, des erreurs ou des irrgularits, les
ordonnateurs, les comptables ou les dirigeants d'entreprises publiques
prsums responsables, doivent tre mis en tat de s'expliquer et de se
justifier.
. . :::... ---
\ ..
erreurs,
.Art 31 - n'a pu J:tablir la situation de son: compte, nijStifier les
irrguiN]ts l'arrt dfinitif le constitue en dbet et ie condamne
solder e dbet avec les intrts de droit au Trsor Public. '
Lorsqu'un comptable a rempli ses obligations, la Cour des Compte rend un
arrt de dcharge ou de quitus suivant qu'il est en fonction ou non.
Art. 32 -La Cour des Comptes peut en outre prononcer :
- des arrts constatant une gestion de fait ;
- des arrts de condamnation l'amende pour retard dans la production des
comptes ou dans la rponse aux injonctions ou pour sanctionner une gestion
de fait. /
Art. 33 - TI est prescrit tout comptable public de produire et de dposer son compte
au Greffe de la Cour au plus tard la fin du 3me trimestre de l'anne
suivant celle de l'exercice clos.
Art. 34- Tout comptable qui, sans motif valable, n'a pas prsent son compte dans les
dlais fixs l'article ci-dessus, peut tre condamn par la Cour des Comptes
une amende dont le montant est fixe 20.000 Frs par mois de retard.
.-. . ...
DU RECOuRs EN REVISION
Art 37 - Tout arrt dfinitif d la Cour des Comptes peut faire l' objefd'une rvision
l demande du comptable qui produit de.s justifications :ncessaires ou sur
rquisition du Ministre Public. Dans tous les cas, aucunrecours en rvision
ne peut intervenir aprs un dlai d'un an compter de la date de la
notification de 1' arrt.
La Chambre comptente pour statuer sur la rvision est celle qui avait rendu
l'arrt attaqu.
La rvision est recevable dans les cas d'erreur, d'omission, de faux ou de
double emploi.
Art. 38 - La Cour des Compte statue sur la recevabilit du recours eiUvision et
ordonne la mise en tat du dossier.
Lorsque la demande en rvision est dclare recevable, l'arrt de recevabilit
est notifi au comptable et aux instances concernes, lesquelles disposent
d'un dlai de quinze jours pour prsenter leurs observations.
L'arrt de rvision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le
Conseil d'Etat.
1
\..
""'...- . .
. '
. .
-- -
de la(Courdes
Comptes; le seront nomms
parmi les Magisufat'S
1
ii dr;r jiidiciir administrtif.
1 . : .: . . . i . . .
Art. 41- Les pem+ntes deYant.la Chambre de la Suprme la
-date de m.tse en de la Cpur des Comptes seront transferees au Greffe de
cette dernire jrui.diction. ' :./ 1
_..,.... .... _... -- . ---- ... . -... .. . - .. '
Art. 42 - En tant que de besoin, des textes ultrietirs complteront les dispositions de
la prsente Loi organique ou en fixeront les modalits d'application.
Art. 43 - La prsente Loi Organique sera publie au Journal Officiel de la Rpublique
Centrafricaine.
ffi..(h,. '
. . .
' .
.... ...
v
'
1
Stphanie DAMAREY ( 1)
Dans son office de jugement des comptes des compta-
bles publics, la Cour des comptes a eu l'occasion d'toffer et
de prciser son office au regard des instruments procduraux
le JUge aes comptes rserve
son jugement dfinitif dans l'attente des rponses formules
par ces comptables la suite des injonctions et rserves
contenues dans les dispositions provisoires des arrts re11dus.
Il s'agit alors, 'r -d.:iflioflctio de sommations faites
au comptable de fo rmr es JUStl tcations manquantes ou de
complter des justifications insuffisantes (2) tandis que les
Jis(ttv permettent de diffrer l'admission de recettes ou
l'llocation de dpenses dont l'omission ou l'irrgularit pour-
rait: engagH la responsabilit du comptable jusqu'aprs l'ach-
vement d'autres procdures (vrification d'autres comptes,
instruction pnale), qui rvleront si ces soupons taient
fonds ou infonds. Le sort des rserves dpend donc non
de justifications produire par le comptable, mais des inves-
tigations ultrieures du juge, qui permettront ce dernier de
lever les rserves ou de les convertir en injonc-
tions (3).
Distinguant l'injonction de la rserve, M. Fabre assimilait
la premire une charge ferme et la seconde char&!,
conditionnelle (4). L'objet de cette . dernire est alors
- d'ajourner l'admission d'une recette ou l'allocation d'une
dpense en attendant l'achvement d'une opration (march
de longue dure, mandat donn pour la ralisation d'un qui-'-
pement public ... ) ou l'aboutissement d'une procdure (admi-
nistrative, civile, pnale ... ) en cours - faute pour le juge de
disposer dans l'immdiat de tous les lments d'apprciation
ncessaires la pris d'une dcision ferme, fut-elle provi-
soire (5) .Apprciant les effets d'une telle rserve, ce mme
auteur constate: une fois que le juge disposera des lments
d'apprciation, qui lui font dfaut, la rserve 'sera leve, si
aucune charge n'apparat devoir tre finalement retenue
l'encontre du comptable. Dans le. cas contraire, la rserve
sera convertie en injonction. C'est pourquoi elle constitue
une charge conditionnelle et fait obstaCle. .la dcharge du
comptable aussi longtemps qu'elle n'est pas leve (6) .
le juge des comptes pourrait prononcer, ces injonctions pour
l'avenir rduisent alors d'aut;tnt le montant du dbet. suscep-
tible d'tre mis la charge du comptable.
Ces prcisions liminaires permettent d'apprcier, par
certains aspects, quelques outils procduraux dont dispose
le juge financier l'occasion de son jugement des .comptes.
Si l'analys juridique s'avre relativement homogne s'agissant
des injonctions fermes et dans une moindre mesure, des
rserves formules par le juge des comptes (8), une certaine
opacit subsiste en matire d'injonctions pour l'avenir. Glo-
balement peu usit, ce type d'injonction bnficie pourtant.
depuis quelques annes, d'un regain d'intrt consquent
auprs de la Cour des comptes. Une situation qui favorise
l'tude d'une notion aux contours juridiques bien imprcis et
qui n'a, jusqu' prsent. que peu retenu l'attention de la
doctrine.
L'injonction pour l'avenir suscite, dans un premier
temps, l'intrt raison de l'htrognit .dont fait preuve
le juge des comptes dans l'utilisation de ce type d'injonction :
une htrognit, source d'interrogation et de confusion.
laquelle il ne peut tre remdi qu'en consacrant la valeur de
simple avertissement de l'injonction prononce.
ailleurs, oin d'tre dnue de vateur
juridique consquences s enten ent, essentiel-
lement, la responsabilit encourue par le comptable public
de la gestton coule.
INJONCTION POUR L'AVENIR,
UN INSTRUMENT AU SERVICE
DU JUGE DES COMPTES __ .
Construction prtorienne par excellence, l'injonction
pour l'avenir tmoigne de la latitude dont le juge des comptes
entend parer ses interventions. Un instrument qu'il utilise
comme boi lui semble, quitte susciter la perplexit. Un
constat qui suggre que l'utilisation de ce type d'injonction
soit, dsormais, unifie et justifie par la vocation principale
qu'a entendu lui accorder le juge des comptes : temprer par
un souci d'quit, la lourde responsabiiit qu'encourt le
comptable public.
( 1) Maitre de confrences 11'universit de Ulle-2. directrice scientifique du GERAP
(Groupe d'tudes et de recherches sur l'administration publique).
(2) J. Magnet. <<La Cour des comptes , BergerLevrault. 1996, p. 181 : O. Il fevner
1985. art. 26, al. 2.
(3) Ibid., p. 182; A. P. de Mirimonde. La Cour des comptes . Sirey 1947. p. 133.
(4) F.J. Fabre, Le jugement des comptes publics ; injonctions et rserves . M
1984. p. 379.
(5) Ibid., p. 381 et s.
(6) Ibid., p. 382.
(7) J. Magnet, op. ciL, p. 182.
(8) C. Oescheemaeker. La Cour des comptes . La Documentation franaise.
2' d .. 1998. p. 69 et s. ; F.J. Fabre. op. cit, p. 379 ; J. Magnet. op. cil. p. 179 et s.
506
_,
,,-
' {
l
-
0'uES
"Y. 1 f ,oN i
1 ,J'A.:
A construction prtorienne,
utilisation prtorienne
Incontestablement, l'injonction pour l'avenir constitue,
pour le juge des comptes, ur instrument essentiel d'adapta-
tion de la jurisprudence f.nancire aux ralits comptables
auxquelles sont confronts les comptables publics. Du moins,
est-ce l, la vocation qui devrait tre celle que le juge des
comptes entend accorder aux injonctions pour l'avenir. Cette
perspective s'entend tout fait de l'utilisation de ce type
d'injonction comme un avertissement pralable l'engage-
ment d'une responsabilit future. Moins judicieuse semble
tre de cet instrument ds lors que le juge des
comptesrlve une irrgularit comptable non sanctionnable
voire l'utilisation comme moyen de pression l'gard du
Gouvernement.
Motivation essentielle du prononc d'injonctions pour
l'avenir, un avertissement qui est adress par le juge des
comptes au comptable public aux fins qu'il soit mis un terme
aux irrgularits constates. Plus droutante est l'utilisation
de ce type d'injonction aux fins de relever des irrgularits
imputables l'ordonnateur.
Un avertissement adress au comptable public
Cible privilgie des injonctions pour l'avenir, le comp-
table public chappe, avec ce type d'injonction, au prononc
d'injonctions fermes voire de rserves.
+ Une injonction pour l'avenir aux lieu et place d'une
injonction ferme
L'avantage pour le comptable public du prononc d'une
injonction pour l'avenir est indniable. Aux lieu et place d'une
injonction ferme qui pourrait aboutir sa mise en dbet,
intervient une injonction pour l'avenir de mettre fin des
irrg1,1larits. constates. Ainsi, la Cour des comptes constate-
t-elle, l'occasion de l'un de ses arrts d'appel, qu'une cham-
rgionale des comptes, bien qu'ayant expressment
relev le caractre irrgulier de paiements oprs par un
comptable public, s'tait limite, par le moyen d'une injonc-
tion pour l'avenir, inviter le comptable dornavant subor-
donner l'ouverture de sa caisse la production pralable
d'une dlibration excutoire du conseil d'administration (9).
Dans le mme esprit, la Cour des comptes rappela un
comptable que les irrgularits commises taient de nature
engager sa responsabilit mais prfra lui enjoindre d'tre
plus' exact l'avenir ( 1 0) .. Une clmence par le
Parquet gnral prs la Cour des comptes, lequ propose
la Cour des comptes, l'occasion de certaines de ses conclu-
sions, et alors mme qu'une irrgularit a t releve, de s'en
tenir une injonction pour l'avenir, justifie par le fait qu'il
s'agit d'un premier contrle de l'tablissement (Il).
Il s'agit alors." comme le souligne la chambre territoriale
des comptes de Nouvelle-Caldonie, d'attirer l'attention du
sur uo problme ( 12). ou- encore, comme le pr=
cisela :lambre rgionale des comptes du Limousin, ,Q_e mettre
. en ga,rde .risques qu'il prendrait en
acceptant de tels rglements, irrguliers, susceptibles d'enga-
ger sa responsabilit personnelle et pcuniaire ( 13). Ainsi, et
alors mme qu'une omission imputable au comptable public
-' '
aurait des consquences prjudiciables quant la responsa-
bilit encourue par ce dernier, le juge des comptes admet de
substituer une injonction ferme une simple injonction pour
l'avenir ( 14).
+ Une injonction pour l'avenir aux lieu et place d'une
rserve
L'injonction pour l'avenir est galement utilise par le
juge des comptes lorsqu'il lui apparat tre dans l'impossibilit
d'exercer ses comptences juridictionnelles. Ainsi, constatant
qu'une comptabilit auxiliaire des fonds particuliers n'avait
pas t produite au juge des comptes et qu'en drogeant ainsi
son obligation lgale de production d'un tel compte, le
comptable public avait priv le juge des comptes de la possi-
bilit d'exercer les comptences qu'il tient de la loi (15), ce
dernier opte pour le prononc d'une injonction pour l'avenir.
De mme, constatant que les comptes financiers ont
t arrts par l'agent comptable des dates de plus en plus
tardives, au point qu'il devenait Impossible que le compte soit
approuv par le conseil d'administration, transmis la trso-
rerie gnrale, puis la Cour des comptes dans les dlais
impartis, cette dernire rprouve cette irrgularit au moyen
d'une injonction pour l'avenir ( 16). Dans le mme esprit, la
Cour des comptes exige du comptable. qu' l'avenir, les dci-
sions d'approbation des comptes financiers par les autorits
de tutelle soient fournies l'appui de la production de ces
comptes ( 17).
Une carence dont le Parquet gnral prs la Cour des
comptes tire toutes les consquences et convient, en der-.
nire analyse, qu' en cas de dfaillance persistante, la Cour
sera(it) fonde prononcer une rserve sur la gestion du
comptable en fonction, jusqu' production de la pice requise,
(l'absence de cette dernire) n'tant pas, par elle-mme, de
nature engager la responsabilit personnelle et pcuniaire
_du comptable ( 18).
Injonction ferme ou pour l'avenir, rserve. autant d'ins-
truments la disposition du juge des comptes aux fins de
stigmatiser, et le cas chant, de remdier 1-UX irrgularits
constates dans les comptabilits publiques et imputables
ces comptables. Dans cette perspective, et quel que soit
l'objectif alors poursuivi par le juge des comptes,la cohrence
demeure, mme si l'utilisation, en la matire;-de l'injonction
(9) C. comptes, 8 f;-rier 1994, Contre hospitalier de Blaye, Rec. p. 1 Il.
( 1 0) C. comptes. 20 septembre 1989, Receveurs des imp6ts des Alpes-Maritimes,
Rec. p. 75.
(Il) Concl. sur les comptes de Mto-France au titre des exercices 1994 .i 1996,
Concl. n 4192 du 19 janvier 1999.
( 12) CTC Nouvelle-Caldonie, Lettre d'observations au maire de Pouebo. 26 aot
1994.
(Il) CRC Limousin, d'observations au maire de la commune de Brive, 25 sep-
tembre 1994.
( 14) CRC PoitouCharent_es, l..ettre d'observations au centre hospitalier rgional
et universitaire de Poitiers. 23 septembre 1994.
(IS) C. comptes. 13 mai 1998, TPG de l'Aveyron. n 19618; C. comptes. 18 man
1999, TPG de la Savoie, n 22349; C. comptes. 14 juin 1999, TPG de Meurthe-et-
Moselle. n 23667.
( 16) C. comptes. 30 septembre 1999, Institut des sciences de la matire et du
rayonnement. n 23891 ; C. comptes, 30 septembre 1999, Universit de Caen, n 23885.
( 17) C. comptes, 19 avril 2000. Fonds solidarit vieillesse. La Revue du Trsor 200 1 ,
p. 205, Chronique de jurisprudence financire, Michel l.ascombe et Xavier
Vandendriessche.
( 18) Concl. sur C. comptes, 30 septembre 1999, Institut des sciences de la matl,..
et du rayonnement. n 23891; v. galement C. comptes. 23 fvrier 1999, Commune
d'Aiguilles.
507
!< {_ \. \_! i:
r r: J r<
'
'
' /""'
l/ '
pour l'avenir peut, parfois, apparatre contestable. MM. Las-
combe et Vandendriessche s'tonnent, juste titre, lorsque
de telles injonctions attirent l'attention du comptable sur
des violations ,graves du droit de la comptabilit publique ou
sur le non-respect de formalits considres par ailleurs
comme substantielles ( 19) .
Une certaine perplexit apparat toutefois lorsque par
sa teneur mme; l'injonction pour l'avenir concerne, en fait,
l'ordonnateur.
Un avertissement adress l'ordonnateur
Sous couvert d'une injonction pour l'avenir introduite
dans les dispositions d'un jugement des comptes d'un comp-
table public, sont. en fait, rprimandes des irrgularits
imputables l'ordonnateur.
Une pratique frquente au sein des chambres rgionales
des comptes, laquelle la Cour des comptes entend mettre
un frein, bien qu'elle ne soit, elle-mme, pas indiffrente
l'utilisation, en ce sens, de ce type d'injonction. Ainsi, eut-elle
l'occasion de constater qu' plusieurs reprises, avait pu tre
relev un usage abusif des procdures de marchs ngocis,
enjoignant pour l'avenir de veiller au strict respect des rgles
de consultation et de passation des marchs publics (20).
Certes, peu de jurisprudences font tat d'une utilisation
de l'injonction pour l'avenir en ce sens. Mais une telle pratique
ne peut toutefois qu'tre dplore car de nature jeter le
trouble sur une notion aux contours juridiques dj bien
incertains. L'injonction pour l'avenir ne saurait tre utilise
aux lieu et place des communications que le juge des comptes
a la possibilit d'adresser dans le cadre d'un contrle de la
gestion._.Dans ce contexte, l'injonction pour l'avenir ne doit
avoir pour seul destinataire que le comptable public et ne
doit pas constituer un moyen de pression indirect l'gard
de l'ordonnateur, d'autant plus que d'autres instruments, plus-
adapts, sont la disposition du juge des comptes.
En revanche, l'injonction pour l'avenir, en tant qu'elfe
attnue la responsabilit encourue par le comptable s'entend
tout fait de circonstances l'occasion desquelles les irr-
gularits comptables constates trouvent leur origine dans un
comportement imputable l'ordonnateur. C'est dans cette
perspective que pourrait s'inscrire le jugement rendu par la
CRC Picardie, laquelle. constatant que le comptable ne pou-
vait tre tenu pour seul responsable d'une situation rsultant
de la volont manifeste de l'ordonnateur de ne pas poursuivre
les dbiteurs dfaillants, limita son action une injonction
pour l'avenir (21 ).
Une Injonction pour l'avenir
pour stigmatiser des irr ularits com tables
non sone 1onna es
Certaines irrgularits comptables pUvent n'emporter
aucune consquence en termes de mise en dbet du comp-
table public concern. Ainsi en va-t-il lorsque, constatant une
augmentation rgulire, au cours d'exercices successifs, du
. solde crditeur .compte d'attente, le juge des comptes
'njoint pour l'avenir au comptable de veiller l'apurement,
en fin d'exercice, .. de_ des c.or:nptes d'imputation
provisoire (22). En effet, et ainsi que la Cour des
comptes, l'occasion d'une autre espce, si des soldes anor-
malement crditeurs ne sauraient attester d'un manquant en
e<Vsse, ils tmoignent toutefois d'un dsordre comptable
avr. Le comptable est charg de la tenue de la comptabilit
du poste qu'il dirige : en application de l'article 49 du rglement
gnral sur la comptabilit publique, la comptabilit a pour
objet la description et le contrle des oprations, ainsi que
l'information des autorits de contrle et de gestion. Or, l'exis-
tence de soldes anormalement crditeurs ne permet pas cet
gard, de rendre compte de faon prcise et rigoureuse des
oprations budgtaires et des oprations de trsorerie (23).
Dans le mme esprit. le juge des comptes enjoint pour
l'avenir, au comptable, de rtablir, pour accrotre la lisibilit
d'un compte, des subdivisions ce dernier (24).
De mme, n'observant aucun manquant, la responsabi-
lit du comptable ne pouvait tre engage mais n'en justifiait
pas moins, selon la Cour. des comptes, la formulation d'une
injonction pour l'avenir de contrler plus systmatiquement
et efficacement les rgies de recettes qui, en l'espce, conser-
vaient trop longtemps les sommes reues en mconnaissance
des dispositions rglementaires et des dcisions internes
fixant leur mode de fonctionnement (25).
Une perspective bien diffrente de celle prcdemment
voque: l'avertissement n'est pas, ici, le matre mot. Et l'on
peut douter, au regard notamment de la nature juridique qu'il
sera possible de reconnatre de telles injonctions (26), de
la pertinence d'utilisation, en la matire, d'une injonction pour
l'avenir.
L'injonction pour l'avenir, moyen de pression
la disposition du juge ds comptes
En d'au.tres circonstances, et certes .plus rarement,
l'injonction pour l'avenir constitue un moyen de pression de
nature engendrer une volution de la rglementation
applicable.
Tel est le rsultat auquel a abouti, bien involontaire-
ment, la Cour des comptes en adressant des injonctions pour
l'avenir raison d'irrgularits constates dans la tenue de
fonds particuliers (27). Un orientation jurisprudentielle dont
l'incidence devait justifier l'interdiction formule par le minis-
tre de l'Economie et des Finances dans un arrt du 2 fvrier
200 1, aux trsoriers-payeurs gnraux de poursuivre leur
activit de service de dpts de fonds (28).
Une perspective dans laquelle s'inscrit une dmarche
parallle utilise par la Cour des comptes, consistant pro-
noncer une injonction ferme ultrieurement leve ds que la
rglementation a t adapte. L'injonction ferme est alors
prononce avec l'esprit d'une injonction pour l'avenir.
( 19) Michel Lascombe et Xavier Vandendriessche, Chronique de jurisprudence
financire, La Revue du Tr!sor 200 1. p. 205.
(20) C. comptes, S septembre 1997, Port autonome de Dunkerque. no 18199.
(21) CRC Picardie, Lettre d'observations au directeur du CCAS d'Amiens, 28 octo
bre 1993,
(22) C. comptes. 5 septembre 1997, Port autonome de Dunkerque, n' 18199.
(23) C. comptes, 26 avril 1999, Ecole nationale d'quitation, La Revue du Trsor
2000, p. 218. Chronique de jurisprudence financire. Michel Lascombe et Xavier
Vandendriessche .
(24) C. comptes. 22juln 1998, Bibliothque nationale et universitaire de Strasbourg.
n 19537.
(25) Concl. sur C. comptes, 28 juin 2000. Ecole nationale de l'aviation civile.
n 26-464.
(26) Cf. m(ro.
(27) C. comptes. 21 dcembre 1994, Dupont. Brocheton et Franois, agents camp
tables centraux du Trsor, Rec. p. 126.
(28) Arrt du 2 fvrier 2001 relatif l'activit de dpts de fonds particulien
exerce par les trsoriers-payeurs gnraux, JO p. 2009.
508
... ,_ .. ,
... 1 ' J '
EljWI?.ES
l i
........ , .. _. .. , " 1
Un moyen de pression que la Cour des comptes avait
dj utilis propos des indemnits de formation continue
verses dans l'enseignement suprieur. Plusieurs injonctions
fermes avaient alors t prononces l'enc:ontre d'agef')ts
comptables d'universit et devaient tre leves postrieure-
ment l'entre en vigueur d'un dcret ado;>te le 18 octobre
1985. Ultrieurement, la Cour des comptes a t amene,
par le biais d'injonctions pour l'avenir, veiller, pour le
paiement des indemnits de direction et de gestion verses
au titre de la formation continue, la stricte application des
dispositions du dcret n 85-1 1 18 du 18 octobre 1985 et de
l'arrt ministriel du mme jour (29) .
Un moyen encore utilis rcemment par la Cour des
comptes afin que soit donn un fondement rglementaire
l'indemnisation des personnels administratifs et techniques
chargs, en dehors de leur activit principale, soit de l'orga-
nisation des oprations effectues dans le cadre de recherche,
soit de leur gestion financire et comptable. Une dmarche
qui devait conduire l'adoption d'un dcret du 4 fvrier
1998 (30) dont la Cour des comptes tira les consquences
en levant par un arrt du 15 octobre (31) de cette mme
anne, l'injonction prcdemment prononce lors d'un arrt
rendu le 17 juillet 1997 (32).
Une dmarche qui prsente un intrt apprciable en
termes d'efficacit mais au prix d'une dformation de la
nature des instruments de contrle dont dispose le juge des
comptes. En ce sens. elle emporte difficilement l'adhsion
d'autant que la Cour des comptes dispose, par ailleurs,
notamment dans le cadre de son contrle de la gestion, d'ins-
truments adquats. La dmarche ne trouve alors une justifi-
cation, et non une absolution, qu' raison du dfaut d'efficacit
prsum de ces derniers.
L'injonction pour l'avenir,
un avertissement de complaisane
Par-del la diversit d'utilisation de l'injonction pour
l'avenir dont tmoigne cette jurisprudence financire, il est
possible de justifier l'injonction pour l'avenir par le souci qu'a
le juge des comptes de signaler au comptable public les irr-
gularits constates afin qu'il y remdie. Un avertissement
par, par certains aspects, de toute la clmence dont le juge
des comptes sait faire preuve au regard d'une lourde respon-
sabilit supporte par les comptables publics. Clmence qui,
loin d'tre isole ce cas de figure, s'entend d'une orientation
jurisprudentielle dsormais traditionnelle chez le juge des
comptes.
L'injonction pour l'avenir
justifie par un souci d'quit
Telle qu'utilise par le juge des compte, l'injonction pour
l'avenir tl"tduit toute la mansutude de ce dernier, dsireux
de ne sanctionner les irrgularits comptables constates que
dans une proportion strictement ncessaire, quitte teinter
d'une certaine subjectivit les dcisions qu'il rend en la
matire. Mme Gisserot, procureur gnral prs la Cour des
comptes devait d'ailleurs, encore rcemment, le relever,
s'interrogeant sur les raisons qui justifient que parfois, le juge
des comptes prfre; au monsdans un p"fmier temps, uti-
liser l'injonction pour l'avenir au lieu de l'injonction ferme et
qu'il lui arrive mme, purement et simplement, de fermer les
\ ......... ..
yeux sur des irrgularits mineures (33). Et le procureur
gnral de prciser qu'une telle orientation jurisprudentielle
ne saurait trouver d'autre explication qu' raison de la
tmo.igne. par le juge des comptes lors de son office, tenant
compte de considrations d'quit dans l'examen
du comportement du comptable a sa part.
Une orientation jurisprudentielle qui nanmoins, intro-
duit une certaine forme d'ingalit ds lors qu' situation
les CRC adoptent parfois une position diffrente,
se contentant de prononcer une injonction pour l'avenir l
o une autre chambre prononcerait une injonction
ferme (34). Mais le pouvoir d'apprciation que s'accorde ainsi
le juge des comptes est ce prix.
Une injonction qui soulve galement l'interrogation
ds lors que sont apprcies les consquences financires de
cette clmence manifeste par le juge des comptes. En effet,
et en diminuant ainsi le montant du dbet mis la charge du
comptable publi, le juge des comptes fonde, manifestement,
l'intrt agir dont pourrait se prvaloir une collectivit
publique dont la caisse n'aurait pas t reconstitue hauteur
des irrgularits commises. Un intrt qui. s'il n'a, jusqu'
prsent, pas fond une action en contestation de la dcision
rendue par le juge des comptes, n'en constitue pas moins un
temprament notoire l'usage de ce type d'injonction (35).
Teinte d'un souci indubitable d'quit, cette jurispru-
dence financire, si elle ne peut qu'tonner ds lors que sont
apprcies les comptences du comptable public, s'inscrit
nanmoins dans une architecture jurisprudentielle patiem-
ment difie par le juge des comptes dont le point d'achop-
pement rside dans une clmence dsormais traditionnelle
chez ce dernier.
Une clmence traditionnelle du juge des comptes
.. -
Si les comptences du juge des comptes peuvent se
rsumer au jugement des comptes des comptables publics, la
perception de ces comptences n'en doit pour autant tre
aussi restrictive. Si le Conseil d'Etat a entendu rappeler au
juge des comptes qu'il ne pouvait se permettre d'apprcier
le comportement personnel du comptable public mais devait
se limiter l'apprciation des lments matriels du compte
soumis son contrle (36), certaines particularits du juge-
ment des comptes suggrent d'largir une. . .conception par
trop restrictive (37).
(29) C. comptes. 24 fvrier 1988, Le Duic et Costa, agents comptables du centre
universitaire de Saint-Denis de la Runion, Rec. p. 20.
(30) Dcret n" 9865 du <1 fvrier 1998 fixant les modalits de rtribution des
personnels des tablissements publics d'enseignement suprieur et de recherche dpen
dant du ministre de l'Education nationale pour services rendus lors de leur participation
a de:> oprations de recherche scientifique prvues dans des contrats ou conventions.
jO p. 1857.
(31) C. comptes. 17 juillet 1997. Umversit Claude-Bernard, Lycn-1, n" 17309.
(32) C. comptes. 15 octobre 1998, Universit Claude-Bernard. Lyon-!. n" 20706.
(33) H. Gisserot. Allocution lors de la sance solennelle de rentre du 25 janvier
2001.
(34) C. comptes, 25 mars 1991. Commune de Cuers, Rec. p. 18.
(35) Un parallle ne peut tre effectu avec les arrts blancs (de dcharge), les
injonctions ayant t leves a raison des justifications apportes par le comptable public
et qui sont de nature rgulariser sa situation comptable.
(36) CE. Ass .. 20 novembre 1981, Rispail. Rec. p . .fl-4; CE, 10 fvrier 1984, Gall.
req. n 45 178. '
(37) H.M. Crucis. Droit des contrles financiers des collectivits territoriales .
le Moniteur 1998. p. 314: S. Damarey. Le juge administratif, juge financier. Dallez
200 l, p. 77 et s. : E. Douat. Les chambres rgionales des comptes et l'ordre juridic-
tionnel administratif, thse. Bordeaux. 1991. p. 360: J. Magnet. Que juge le juge des
comptes 1 . RF (ln. pub/. 1989. n" 28. p. Il 5 : G. Montagnier. Le trsorier-payeur
gnral . thse. Lyon, 1966. p. 275.
\ 1
509
t-- - _
t j 1 '
TDES
1 ..
Ainsi, et comme l'a relev le commissaire du Gouver-
nement--Lamy dans ses conclusions sur l'arrt Barthlmy,
le contrle de la Cour n'est pas, malgr les rappels rgulier.;
(formuls par le Conseil d'Etat) un contrle se cantonnant
aux seuls lments matriels du compte ( ... ). La Cour tient
parfois compte du comportement du comptable. C'est un fait
que (le Conseil d'Etat ne peut) ignorer (38) . Et il s'agit
parfois, pour le juge des comptes, de temprer une respon-
sabilit raison des circonstances de l'espce qui ne sauraient,
en toute quit, justifier l'engagement de la responsabilit
pcuniaire du comptable public, abstraction tant faite, dans
ces cas, du caractre en principe purement objectif du juge-
ment des comptes des comptables publics.
Une orientation jurisprudentielle qui explique, ds lors,
et ainsi que l'a rappel M. Fabre, la possibilit pour le juge
des comptes de prendre une dcision de passer pour ordre
qui constitue alors un moyen discret mais efficace et utilis
assez frquemment. aux dires de cet auteur, pour accorder
en fait, sans le dire, des dcisions de dcharge de responsa-
bilit (39). Un constat qui a galement t formul par Mme
Gisserot s'agissant, dans une autre perspective, d'abstentions
.. dlibres du juge des comptes de pronon_cer un dbetlors-
que l'existence manifeste de circonstances de force majeure
en tablirait par avance le caractre platonique (40).
L'intrt du juge des comptes pour cette procdure
particulire qu'est l'injonction pour l'avenir s'inscrit dans une
semblable perspective. L'injonction pour l'avenir apparat en
effet comme un moyen d'attnuer la responsabilit du comp-
. table public, le juge des comptes tenant en considration des
lments, souvent indpendants de la simple constatation
d'une tenue rgulire ou non des comptes en jugement, pour
carter la responsabilit encourue par le comptable public.
Ainsi apprcies, les modalits d'utilisation de la tech-
nique des injonctions pour l'avenir, telles que pratiques par
le juge des comptes. traduisent la marge de manuvre qu'il
s'est ainsi accord, dans sa construction prtorienne d'une
notion qui ne l'est pas moins. Un outil prcieux, sa dispo-
sition. qui doit demeurer une alternative l'injonction ferme
qu'il serait susceptible de prononcer et emporter toutes les
consquences juridiques qui s'imposent.
.IMPACT
- DE L'INJONCTION POUR L'AVENIR
SUR LA RESPONSABILIT
DU COMPTABLE PUBLIC
Si rgulirement, depuis sa cration, la Cour des
comptes a recours aux injonctions pour l'avenir, ce n'est
qu'au cours de ces dix dernires annes, et la faveur d'un
intrt particulier en constante progression pour ce type
d'injonction, qu'il a t possible de prciser leur rgime juri-
dique. Apprcie au regard de la responsabilit effectivement
encourue par le comptable public, l'injonction pour l'avenir
prsente pour effet immdiat de dcharger le comptable de
toute responsabilit raison des irrgularits releves. Tou-
' tefois, et si ces m.n-:'e.s ir,r:_glllarits en dpit de
l'injontin pour l'avenir ainsi formule, le juge des comptes
serait fond engager la responsabilit du comptable public
raison de la gestion postrieure au prononc de telles
injc>nctions.
'
La comptable
'carte par l'injonction pour l'avenir
Alternative l'injonction ferme, l'injonction pour l'ave-
nir emporte un effet dcisif quant la responsabilit encourue
par le comptable public. .
L'injonction pour l'avenir,
alternative l'injonction ferme
Loin de rpondre au rgime juridique de l'injonction
ferme, l'injonction pour l'avenir n'en constitue pas moins une
disposition dfinitive.
L'injonction pour l'avenir n'est pas une injonction ferme
Lorsque le juge des comptes constate une irrgularit
comptable, il enjoint, en tant que de besoin, au comptable
public concern de produire, dans un certain dlai, toutes
justifications utiles de nature le dcharger de la responsa-
bilit qu'il pourrait encourir. Cette injonction ferme, nces-
sairement provisoire, ne se traduira toutefois par la mise en
dbet du comptable public que si ce dernier ne rpond pas
ou rpond imparfaitement l'injonction qui lui a t adresse.
Une autre possibilit pour le comptable d'viter sa mise en
dbet rside dans le versement, titre de rponse l'injonc-
tion prononce; du montant de l'irrgularit constate dans
les caisses dont il tient la comptabilit.
Une injonction qui sera, en consquence, leve l'occa-
sion de dispositions dfinitives prononces par le juge des
comptes ou confirme et, en tant que telle, transforme en
une disposition de dbet la charge du comptable public
concern.
Ainsi que le prcise M. Fabre, il ne faut pas confondre
l'injonction ferme avec l'injonction pour l'avenir, dont l'objet
est seulement de rappeler le comptable au respect de ses
obligations (41) . La Cour des comptes a ainsi pu prciser
que les injonctions pour l'avenir ne crant aucun lien de droit
et ne pouvant causer aucun prjudice immdiat aux compta-
bles concerns, ces derniers taient mal fonds en faire
l'objet d'un recours en appel (42). Dans le mme esprit. la
Cour des comptes a relev qu'une injonEtion pour l'avenir
ayant, par nature, trait des comptes non encore rendus, sur
des exercices non clos, ne fait pas grief au justiciable, ni obs-
tacle sa dcharge (43). Simple avertissement, l'injonction
pour l'avenir absout le comptable raison des irrgularits
que le juge des comptes a pu constater mais constitue une
menace potentielle, en vue du jugement des prochains
comptes l'occasion desquels le comptable en fonction est
tenu de se conformer aux observations liminairemenc formu-
les par ce mme juge. Ces injonctions apparaissent alors, et
pour le coup, dnues d'un quelconque effet juridique.
Des injonctions qui ne peuvent, ds lors, tre assimiles
des injonctions fermes et que le juge des comptes tente de
(38) Lamy. Cenci. sur CE. sect .. 3 avril 1998, Mme Barthlmy, RFO adm. 1998,
p. 1046.
(39) F.). Fabre. Intervention aux journes Cour des comptes . Unoversit de
Toulouse, 13-14 fvrier .1978. Anno/es de l'universit, p. 395.
(40) H. Gisseroc. O va le juge des comptes ! . Re v. odm. 1998. p. H9.
(41) F.). Fabre. Le jugement des comptes publics: injonctions et reserves. RA
1984, p. 379. noce S.
(42) C. comptes. 29 avril 1884. Commune de Fort-National. Rec. p. 4: C. comptes.
16 juillet 1913. Commune de Chteauneuf. Rec. p. 22.
(43) C. comptes. 1" juillet 1986. Commune de Fraimbois, Rec. p. 228.
... ..i "''" " 510
............
/', "
..
'
- ---------
4 -.
\YDES
(
'
dissocier au mieux. Si les injonctions simples formules par
le juge. des comptes l'occasion de ses jugements provisoires
imposent en tant que de besoin, au comptable de rapporter
dans un dlai fix par la Cour et ne pou" ant infrieur
un mois, toutes les explications ou justifications sa
dcharge (44) , rien de tel lorsque le juge comptes
formule des injonctions pour l'avenir. Ainsi qua pu le rappeler
la Cour des comptes, de telles injonctions n'exigent aucune
rponse du comptable concern et le dfaut de rponse
une telle injonction n'entre donc pas en compte pour le calcul
de l'amende pour retard (45).
La Cour des comptes a par ailleurs relev qu'aprs avoir
formul une injonction pour l'avenir, le juge des comptes ne
pouvait la requalifier en injonction ferme (46) et dans le mme
esprit, elle a soulign que la demande d'un appelant de trans-
former un dbet en une injonction pour l'avenir ne pouvait
tre retenue (47). Il suffit en effet, comme l'a prcis le pro-
cureur gnral l'occasion de cette espce, que le juge des
comptes ait constat qu'une somme a t rgle sans crdit
et donc irrgulirement paye, sans qu'il y ait lieu d'apprcier
les circonstances de fait qu'il appartient au comptable d'invo-
quer le cas chant auprs de l'autorit hirarchique, pour
que le db'et puisse tre prononc (48). L'appelant ne saurait,
par ailleurs, et l'appui de sa demande, arguer du fait qu'
situation identique, certaines CRC se bornent prononcer
des injonctions pour l'avenir (49).
Le contenu des injonctions pour l'avenir ne peut impli-
quer aucune mise en cause de la responsabilit pcuniaire des
comptables, alors mme qu'y aurait t adjointe la mention
sous toutes rserves , celle-ci tant dans ces cas sans
porte (50).
Avertissement qui, s'il ne peut tre assimil une injonc-
tion ferme, soulve nanmoins l'interrogation ds lors qu'il
s'agit d'apprcier les injonctions pour l'avenir au regard des
dispositions provisoires puis dfinitives contenues dans le
jugement des comptes.
L'injonction pour l'avenir est une disposition dfinitive
Trs rvlateur, l'article 26 du dcret du Il fvrier 1985
relatif la Cour des comptes (51) prcise que celle-ci r.end
des arrts par lesquels elle statue titre provisoire ou titre
dfinitif , ne laissant, en la matire, pas de place pour une
troisime catgorie de dispositions (52). Il n'est d'ailleurs pas
de crer une catgorie sui generis, propre aux
seules injonctions pour l'avenir, pour prciser le rgime juri-
dique de telles injonctins. Les diffrentes caractristiques de
ce type d'injonction permettent, en effet, et ainsi qu'il sera
prcis, d'apprcier de telles injonctions en termes de dispo-
sitions dfinitives. Une perspective que ne devait toutefois
pas retenir la Cour des comptes. S'interrogeant sur la nature
de ces injonctions pour l'avenir, la Cour des comptes devait,
l'occasion d'un arrt rendu en 1986, relever que la dispo-
sition du jugement qui prescrit au comptable d'tablir un
compte de gestion pour le bureau d'aide sociale partir de
l'exercice 1986 a expressment le caractre d'une injonction
pour l'avenir, et constitue ds lors, bien que place aprs la
mention statuant dfinitivement , une disposition provi-
soire (53) . L'assimilation ainsi opre par la Cour des
comptes entre et dispositions provi-
soires mentionnes au titre des mentions (( statuant provi-
soirement introduites dans le jugement des comptes. par
opposition aux dispositions dfinitives, ne saurait toutefois
retenir l'assentiment.
Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'injonction pour
l'avenir ne peut tre transforme en injonction ferme (54) et
qu'aucune rponse n'est requise sa suite (55). Dans cette
perspective, l'injonction pour l'avenir apparat beaucoup plus
dfinitive que provisoire, n'emportant pour autant pas les
mmes consquences que les traditionnelles dfi-
nitives, susceptibles, elles, de recours (56).
Percevant la singularit de ce type d'injonctions, la Cour
des comptes adopte une solution de facilit et les place d'ail-
leurs, le plus souvent, part dans ses arrts, ni provisoires
ni dfinitives (57) alors mme qu'aucun obstacle ne s'oppose
ce que les injonctions pour l'avenir figurent, en bonne place,
parmi les dispositions dfinitives formules par le juge des
comptes.
En dernire analyse, et quelle que soit, en fait, la place
accorde par le juge des_ comptes ce type d'injonctions,
cette circonstance n'influe aucunement sur leur nature juri-
dique : dfinitives, les injonctions pour l'avenir emportent de
notables consquences juridiques, tant sur la responsabilit
venir que passe des comptables publics.
L'autorit attache
a'!_X inJonctions pour l'avenir prononces
Revtue d'une vritable autorit de la chose juge,
l'injonction pour l'avenir prononce par le juge des comptes
emporte des effets semblables ceux d'un arrt ou jugement
de dcharge prononc par le juge des comptes.
L'autorit de chose juge attache
aux injonctions pour l'avenir prononces
S'interrogeant sur les effets de telles InJOnctions,
M. Ducher devait relever qu'une injonction pour l'avenir ne
"peut videmment pas tre considre comme faisant grief au
requrant, puisque d'une part, elle n'impose aucune charge
et que d'autre part, elle n'est pas adresse un comptable
nommment dsign, mais au comptable qui sera en fonctions
lorsque l'arrt sera notifi. La Cour a ainsi jug ( ... ) qu'une
injonction pour l'avenir ne peut par sa nature mme revtir un
(44) F.J. Fabre. op. cit, p. 379.
(45) C. comptes. 16 mai 1984. Collges Marcelle et Lanvin, Rec. p. 332 : C. comptes.
4 octobre 1984, Collges Rostand et Les Essarts. Roc. p. 341. Par un arrt d'espce.
ranger.au r.ang anecdotique. la Cour des comptes a nanmoins estim qu'elle se devait
de maintenir une injonction pour l'avenir pour defaut de rponse. C. comptes,
26 dcembre 1894, Commune d'Alais. Rec. 1895, p. 26.
(46) C. comptes. 8 dcembre 1994. Centre hospitalier de Blaye, Rec. p. Ill
(47) C. comptes. 25 mars 1991. Commune de Cuers. _Roc. p. 18.
(48) Cond. sur C. comptes. 25 mars 1991. Commune de Cuers, Rec. p. 18.
(49) C. comptes. 25 mars 1991. Commune de Cuers. Roc. p. 18.
(50) C. comptes, 1-4 janvier 1987. Lyce Lurat. Rec. p. 267.
(51) D. n 85-199 du Il fvrier 1985 relatif la Cour des comptes, JO p. 1959,
art. R. 131-3 du Code des juridictions financiru.
(52) Ancien art. 17, D. n 68-827 du 20 septembre 1968 relatif la Cour des
comptes: v. galement art. 46, D. n 95-9-45 du 23 aot 1995 relatif aux chambres
rgionales des comptes, JO p. 1 2719.
(53) C. comptes. 1 juillet 1986, Commune de Fraimbois. Rec. p. 228.
(54) C. comptes. 8 dcembre 1994, Centre hospitalier de Blaye. Rec. 1895, p. 26.
(55) C. comptes. 16 mai 1984, Collges Marcelle et Lanvin. Rec. p. 332 : C. comptes,
4 octobre 1984. Collges Rostand et Les Euarts. Rec. p. 341.
(56) CE. 20 juillet 1883, Monnier. Rec. p. 673 : CE. S juillet 1953. Hiff. Rec. p. 264:
CE. 8 mars 1968, Ministre du Travail. Roc. p. 173: CE. 12 dcembre 1969, Darrac, Rec.
p. 578 : CE, 6 janvier 1995, Nucci. Roc. p. 6.
(57) Trs rvlateurs : C. cor11ptes. lw juin 1976, Office de HLM du Loiret. /lee.
p. 157 : C. comptes, 16 septembre 1998, TPG de l'Eure-et-Loir, req. n 21478.
5 1 1
'
'\
1' ... '
1 '
caractre puisqu'elle s'applique des comptes non encore
rendus, affrents des exercices non clos, qu'elle ne fait pas grief
au justiciable ni obstacle sa dcharge (58) .
Le constat ne peut toutefois qu'tre nuanc. Lorsque
l'injonction pour l'avenir intervient aux lieu et place d'une
injonction ferme, le juge des comptes, constatant une irrgu-
larit, s'abstient de prononcer une injonction ferme et lui
substitue une injonction pour l'avenir. Loin d'tre dnue
d'un quelconque effet juridique, une telle substitution a pour
effet de dcharger, pour la gestion examine par le juge des
comptes, le comptable de toute responsabilit.
. Apprcie sous cet aspect, l'injonction pour l'avenir
revt ncessairement un caractre dfinitif dont les cons-
quences peuvent tre compares celle d'un arrt ou juge-
ment par lequel le juge des comptes entend dcharger le
comptable public de sa gestion.
Une position d'autant plus radicale que l'injonction pour
l'avenir, ainsi qu'il a t vu, ne peut tre transforme, au cours
de l'examen d'une mme gestion, en injonction ferme (59).
Ainsi, et llne fois prononce, l'injonctic;m pour l'avenir
dcharge le comptable de toute responsabilit raison de
ces irrgularits constates mais non immdiatement repro-
ches, sans qu'il soit possible au juge des comptes de revenir
sur sa dcision. Subsiste nanmoins l'hypothse au terme de
laquelle le juge des comptes aurait la possibilit de transfor-
mer, au cours de l'examen d'une mme gestion, une injonc-
tion pour l'avenir en une injonction ferme raison d'lments
nouveaux dont il n'avait pas eu connaissance lors du prononc
de l'injonction pour l'avenir (60).
L'injonction pour l'avenir
emporte les effets immdiats d'un arrt de dcharge
Ainsi que, souligne M. Magnet, l'arrt de dcharge a
l'autorit le la chose juge entre le comptable et l'organisme
public intress. Il fait obstacle ce que le juge recherche
ultrieurement la responsabilit de ce comptable raison
d'oprations comprises dans la gestion dont celui-ci a obtenu
dchaq_e ( 61) . Ainsi, et sous rserve des voies de recours
ouvertes contre une telle dcision, le comptable public se
voit dcharg de toute responsabilit raison de la gestion
examine par le juge des comptes. Et c'est dans cet esprit
que peut s'inscrire l'injonction pour l'avenir, laquelle emporte
des effets similaires ceux rsultant d'un arrt ou jugement
de dcharge, le comptable concern ne pouvant voir sa res-
ponsabilit engage raison des oprations ayant fait l'objet
d'une injonction pour l'avenir. Cette injonction revt ainsi un
aractre d'autant plus solennel qu'elle ne peut tre trans-
forme en une injonction ferme et emporte, surtout et par
ailleurs, des consquences dcisives quant la responsabilit
encourue par le comptable public.
En accordant au comptable public dcharge de sa res-
ponsabilit, le juge des comptes lui te par ailleurs tout intrt
agir en appel, ou le cas chant, en cassation. Une perspective
qui s'entend galement des injonctions pour l'avenir mais que
la Cour des comptes a d. plusieurs reprises, rappeler
, certains comptables publics. Ne causant aucun prjudice
immdiat aux comptablen:oncerns, ne sauraient ri
. obtenir l'annulation (62). Une position contestable ds lors
qu'elle prjuge, pour l'avenir, d'une responsabilit ventuelle
du comptable public et si, en dfinitive. cette injonction pour
l'avenir s'avre mal fonde.
La responsabilit du comptable
raison du non-respeV
aune lrfonctioipour avenir
,_.____.!-.
Apprcier les consquences du non-respect d'une
injonction pour l'avenir permet d'envisager l'engagement de
la responsabilit encourue par le comptable public dtermi-
ne raison des gestions ultrieures au prononc d'une telle
injonction.
Le non-respect d'une injonction pour l'avenir
devrait entraner la responsabilit
du comptable public
Prcisant les consquences juridiques du non-respect
d'une injonction pour l'avenir, le Parquet prs la Cour des
comptes devait signaler qu'une telle injonction justifierait plei-
si elle n'tait pas suivie d'effet, la mise en jeu de la
responsabilit du_ comptable en fonction lors du prochain
contrle (63), dans l'hypothse, bien sr, o il s'agit d'irr-
gularits -sanction nables.
Si peu d'arrts ou de jugements rendus par le juge des
comptes ont, jusqu' prsent, pu formaliser l'impact juridique
du non-respect d'une injonction pour l'avenir, la lecture de
certaines lettres d'observations mises par des CRC dans le
cadre du contrle de la gestion permet de prciser, utilement.
la valeur juridique de telles injonctions. Ainsi, la CRC Picardie
rappelle-t-elle que la chambre a prfr intervenir par. la
voie d'une injonction pour l'avenir qui, si elle n'est pas suivie
d'effet, donnera lieu sur les comptes ultrieurs la mise en
jeu effective de la responsabilit du comptable (64) .
Si, l'occasion d'une gestion ultrieure, le juge des
comptes constate que le comptable public n'a pas satisfait
l'injonction pour l'avenir formule l'occasion d'un prcdent
exercice, sa responsabilit pourra alors tre engage mais
uniquement raison de la gestion en cours d'examen. Ainsi
qu'a pu le constater la Cour des comptes, il ne parat pas
souhaitable que le juge des comptes ritre une injonction
pour l'avenir dj formule lors du prcdent contrle, et
qui n'a pas t suivie d'effet (65). Nanmoins. et raison
d'une apprciation d'un cas d'espce faisaAt tat de l'ancien-
net de l'arrt antrieur l'occasion duquel avaient t for-
mules des injonctions pour l'avenir et de la modestie des
sommes en cause, le juge des comptes a pu estimer, sur les
conseils du Parquet, que ces circonstances taient de nature
justifier le renouvellement d'une injonction pour l'ave-
nir (66). De mme, et toujours raison des circonstances de
l'espce, la Cour des comptes devait confirmer les injonctions
(58) G. Ducher, La Cour des comptes. juge d'appel >>, Berger-Levrault.
p. 19 ; C. comptes, l" juillet 1986, Commune de Fraimbois. Rec. p. 228.
(59) C. comptes. 8 dcembre 1994. Centre hospitalier de Blaye, Rec. p. Ill.
(60) Ibid.
(61) Jacques Magnet. op. cit, p. 187.
(62) C. comptes. 29 avril 1884, Commune de Fort-National, Rec. p. 4; C. comptes.
16 juillet 1913. Commune de Chteauneuf. Rec. p. 22.
(63) Concl. n 5179 sur C. comptes, 22 juin 2000. Institut national des sciences
appliques de Lyon. n 26322.
(64) CRC Picardie, Lettre d'observations au directeur de la maoson de <etraite et
centre d'hbergement pour personnes ges de Rue. 28 octobre 1993.
(65) C. comptes, rapport sur les comptes et la gestion du centre rgional de la
proprit forestire (CRPF) d'Aquitaine. Concl. n 4511 du 3 juin 1999.
( 66) C. comptes. rapport sur les comptes et la gestion du centre rgional de la
proprit foreStire (CRPF) d'Aquitaine. Cond. n 45 Il du 3 juin 1999 et C. comptes.
29 septembre 1999. Centre rgional de la proprit forestire (CRPF) d'Aqutaone.
n 23845.
512
TUDES
pour l'avenir prononces l'occasion d'un prcdent arrt,
justifiant sa dcision par le fait que le comptable en fonction
n'avait pas t en mesure d'appliquer la totalit des injonc-
tions prcdemment prononces (67).
Une orientation jurisprudentielle qui bien qu'elle soit de
nature semer le doute quant aux consquences avres du
non-respect d'une injonction pour l'avenir, exprime de nou-
veau, mais au cas d'espce, l'quit dont la jurisprudence
financire est empreinte.
Ainsi, et en l'absence de suites donnes aux injonctions
pour l'avenir formules par le juge des comptes, devrait logi-
quement succder l'engagement de la responsabilit du
comptable public concern. Mais l'impact d'une injonction
p>!Jr l'avenir devrait, en termes de procdure, s'achever ici.
L'injonction pour l'avenir ne pourrait, l'occasion d'une ges-
tion ultrieure, que justifier une injonction ferme mais nces-
sairement provisoire, dans le strict respect de la rgle du
double arrt.
" La responsabilit du comptable public serait alors enga-
ge. sans qu'il puisse, en principe, bnficier d'une nouvelle
clmence du juge des comptes, aux termes d'une procdure
classique d'engagement de sa responsabilit. Ainsi apprcie,
en termes de procdure, l'injonction pour l'avenir n'emporte
aucune consquence particulire. Il parat, en effet, difficile,
aiors mme que l'on souhaiterait parer l'injonction pour l'ave-
nir d'une densit juridique accrue, d'admettre que fasse suite
une injonction pour l'avenir non respecte l'occasion de
gestions ultrieures, une disposition dfinitive engageant la res-
ponsabilit du comptable public concern. Le respect de la
rgle du contradictoire exige que la procdure soit initie par
une injonction ncessairement provisoire qui n'engagera la res-
ponsabilit du comptable en fonction qu'en cas de dfaillance
de celui-ci dans les rponses qu'il fournira au juge des comptes.
C'est dans cette perspective que s'inscrit l'arrt par lequel la
Cour des comptes, constatant qu'une injonction pour l'avenir
faisait dj obligation au comptable de produire un tat rca-
pitulatif, statuant provisoirement, rclama au comptable la pro-
duction de cet tat rcapitulatif (68). Une jurisprudence isole
qu'il serait excessif de considrer comme l'illustration de l'effi-
cacit des injonctions pour l'avenir. Une explication plus
convaincante rsulte, en effet, de la prudence manifeste par
le juge des comptes dans l'utilisation de cet instrument juri-
dique :.des injonctions prononces mais pour lesquelles il n'est
pas fait allusion l'injonction pour l'avenir prcdemment for-
mule, afin d'viter qu'un pralable ne
Une responsabilit limite la gestion
postrieure au prononc
de l'injonction pour l'avenir
Une injonction, prononce pour l'avenir, s'impose au
comptable. lequel devra, lors de gestions ultrieures, en tenir
compte dans la tenue de sa comptabilit. A dfaut. la respon-
sabilit du comptable concern, qui peut ne pas tre le comp-
table l'gard duquel l'injonction pour l'avenir avait t pro-
nonce, sera engage. C'est dans cet esprit que la Cour des
comptes avait, par injonction pour l'avenir, rappel un rece-
veur municipal l'obligation qui lui incombait de transmettre
les dlibrations du Conseil municipal portant cration ou
"de_ taxes (69). Le comptable ayant nglig de le
fa1re; la Cour lw a enjoint deproduire toresles librations
de cette nature votes depuis la date de notfflcation de l'arrt
prcdent. Elle l'a: ensuite condamn provisoirement
l'amende pour le retard constat dans la production de ces
dlibrations. Une r:ondamnation rendue dfinitive par un
arrt du 1 1 mai 1978.
La responsabilit du comptable ne sera toutefois pas
engage ds lors que les injonctions pour l'avenir formules
par le juge des comptes l'ont t l'occasion d'exercices ant-
rieurs la priode examine par ce mme juge, mais n'ayant
t portes la connaissance du comptable que postriel.Jre-
ment cette mme priode (70). En l'espce. la Cour des
comptes devait constater que les injonctions pour l'avenir,
formules au titre des exercices 1984 1990, n ont t portes
la connaissance des comptables qu' la fin de l'anne 1994.
DaJ'ls ces conditions, il apparaissait impossible pour les comp-
tables d!en observer les dispositions et de les pren-
dre e'n' compte dans les diffrentes oprations dont ils avaient
la charge, au titre des exercices 1991 1993. La Cour des
comptes devait, en consquence, estimer que le non-respect
ventuel de ces injonctions ne pouvait tre imput aux diff-
rents comptables en fonction durant cette priode.
En se munissant d'un outil tel que l'injonction pour l'ave-
nir, le juge des comptes s'autorise reporter, dans le temps
et le cas chant, les consquences d'une irrgularit dcele
dans la comptabilit examine. Une responsabilit comptable
qu'il se refuse par ailleurs engager, s'en tenant, en certaines
circonstances, au prononc d'une injonction pour l'avenir
dans la mesure o aucune mise en garde n'avait te adresse
au comptable en fonction lors des contrles prcdents (71 ).
Une circonstance qui soulve, par ailleurs, de notables
interrogations quant au rel destinataire de l'injonction pour
l'avenir. Il est de principe de relever. qu'une injonction pOl!r
l'avenir est adresse au comptable en fonction. qui peut tre
diffrent de celui auquel sont imputables les irrgular:ts
comptables constates. Or, la logique mme de ce ;ype
d'injonction suppose que par-del le comptable en foo<::tion,
l'injonction pour l'avenir s'adresse galement au comptable
responsable des irrgularits constates mais non sanction-
nes, avec toutes les consquences juridiques qui ;'y atta-
chent et notamment, la possibilit d'une mise en jeu vitrieure
de sa responsabilit en cas de non-respect des injonctions
formules pour l'avenrr. Ainsi paree d'une nouvelle dimen-
sion, l'injonction pour l'avenir suppose, ncessairement, dans
cette perspective, que le juge des comptes assurer un
suivi des injonctions pour l'avenir prononces.
L'injonction pour l'avenir rsume ainsi parfaitement une
situation dsormais acquise, au terme de laquelle le juge des
comptes n'est plus juge des seuls comptes du ,comptable public.
Confirme dans son rle de simple avertissement, l'injonction
pour l'avenir n'emporte, en dfinitive, de relles consquences
qu' raison des gestions l'occasion desquelles ces injonctions
ont t prononces et invite le juge des comptes un;;: ratio-
nalisation dans l'utilisation de cet instrument afin que l'injonc-
tion pour l'avenir acquire une relle unit juridique.
(67) C. comptes, 19 juin 2000, Caissier genr;;l de la Caisse des dptS et consi-
gnations. n 26719.
(68) C. comptes, 22 fvrier 1989, Ecole polytechnique. Rec. p. 26.
(69) C. comptes, 8 janvier 1975 et 6 mai -1$76, Commune d'Epinay-sur-Seine, Rec.
.
(70) C. compte>. 3 juin 1999. Institut franais d'Athnes. La Revue du Trrisor 2000,
p. 379, Chronique de jurisprudence financire, Michel Lascombe P.t Xavier
Vandendrie.ssche.
(71) C. comptes. 30 septembre .1999, universit de Caen, n" 23885.
;, c' ' . . ;:, ". . ''1
... .. :::_.,.,
513
Dl!:S
.. ;;Qmmission des mthodes
.des d,hambres rgionales
etes comptes
Cellule d'appui
COUR COMPTES RPBC RFFTECH R
0-0321242479 P.02
Paris, le 30 janvier 1997
A l'occasion de sa runion du 17 dcembre 1996, la commission, aprs un examen des
diligences mises en oeuvre par les chambres dans le cadre des vrifications allges, a jug qu'il
serait bon, dans un souci d'hannonisation, de parvenir une dfinition commune des diligences
minimales de contrle. Compte-tenu de leur caractre d'ordre public, elle a considr que cette
dfinition devait s'appliquer prioritairement l'exercice des comptences des chambres en matire
juridictionnelle. Portant sur des vrifications allges, elle a estim, enfin, que cette dfinition
devait tendre avant tout assurer la scurit juridique des jugements sans charge.
Les propositions qui suivent ont t labores, confonnment ces orientations, par le
groupe de travail constitu sur ce thme et runissant 1es conseillers membres de la comrrssion.
Elles bnficient galement de la contribution des conseiJlers comptents des chambres de
Bourgogne et de portes volontaires pour des contacts
sur ce sujet.
Dans une premire partie, une liste motive de diligences minimales en matire
juridictionnelle, issue de cette rflexion collective, est soumise l'apprciation de la conunission.
Quelques questions apparues cene occasion comme relevant de l'apprciation du ministre public
sont regroupes dans une seconde partie. Enfin, les dispositions prendre concernant la
formulation des recommandations de 1a commission et les modalits de la poursuite des travaux
font J'objet d'une troisime partie.
_ _.,._---- ,.-..
Franois CELLIER
l.l IIU!o: CAMBc')N 75100 PA.RI$ RP -riLtPJIONE (l) 4.Z989511A TELtCOr1: (Il 41600159
. '
31-01-1997 06:00 DE
COUR COMPTES RPBC AFFTECH A
0-0321242479 P.03
,
1 Dfinition des diligar-:.es minimales en matire juridictionnelle (propositions)
La recherche des diligences minimales propres rpondre la proccupation de scurit juridique
des jugements sans charge invite un examen de la jurisprudence, particulirement en matire
d'appel.
Pour autant, la notion de diligences minimales ne constitue pas, par elle-mme, une notion
jurisprudentielle, au sens o le non respect de celles-ci pourrait constituer, sans plus de prcision,
un motif suffisant d'annulation dun jugement.
Par ailleurs, on ne saurait prtendre dduire mcaniquement les diligences minimales d'un examen
de la jurisprudence. Fort heureusement, en effet, la scurit juridique recherche est d'ores et dj
bien assure par les diligences mises en oeuvre, d'o, du reste. l'extrme raret des cas rpertoris
de contestations de jugements sans charge.
Dans des cas plus nombreux. d'appel a minima aggravant des charges pesant sur le comptable, la
Cour des Comptes ...a:ea;- totefoi$.l!occasiorti -de rappeler certaines diligences essentielles et de
prciser les conditions sous lesquelles un comptable pouvait tre valablement dcharg. Plus
gnralement, on ne s'interdira pas de puiser largement dans la jurisprudence pour cerner l'tendue
des obligations minimales de contrle en matire juridictionnelle.
n reste que la dfinition de diligences minimales communes suppose aussi de faire la part des
vrifications, qu'il s'agisse de contrles formels et relativement accessoires ou de contrles relevant
d'un examen plus approfondi des comptabilits, ne prsentant pas le mme caractre gnral et
. impratif de l'htrognit des vrlficatio:QS Ae\Ur'Ut.par
ce dernier aspect ne constitue sans doute pas le moindre des appons qui peut tre attendu d'un
effort d'hannonisation .
31-01-1997 05:01 DE
COUR COMPTES RPBC AFFTECH A
0-0321242479 P.04
2
1 ) Forme des comptes-tat d'examen
On ne s'intressera ici qu'aux contrles auxquels iJ parat indispensable que la chambre
procde aprs l'arrive des comptes, nonobstaut les vrifications opres
pralablement_ les comptables centralisateurs -dans Je cadre de la mise en tat
d'examen.
1-1 ) F onne des comptes
signature-procurations du ou des comptables
t'appropriation des comptes, pour la dure de leurs fonctions, par les comptables
responsables revt sans conteste un caractre essentiel.
n n'a pas t trouv d'illustration rcente d'une mconnaissance de ce principe dans la
jurisprudence des chambres. En revanche, il est relever que, dans le cadre d'une
gestion de fait, la CRC d'lle de France a t amene juger que le refus de signature
de l'un des coauteurs de la gestion de fait ne s'opposait pas au jugement du compte,
mais ceci ds lors que les pices du dossier permettaient au juge de dterminer d'office
la recette et la dpense (commune de Breuillet, 12-02-1988), situation qui ne saurait se
rencontrer, il est vrai, pour des comptabilits patentes.
visas du comptable suprieur et de l'orc;lonnatey_r
L'apposition des signature.s et de l'ordonnateur sur le compte
revt galement un caractre essentiel, dns la mesure o celles-ci sont destines
certifier, d'une part que le compte a t mis en tat d'examen. d'autrepart qu'il a t
soumis au vote de l'assemble dlibrante, l'omission de l'une ou l'autre de ces
formalits substantielles tant susceptible de faire encourir l'annulation du jugement
pour vice de forme (sur l'annulation pour vice de Conne, cf. jurisprudence ci-aprs
relative l'absence de certificat libratoire).
Une teUe interprtation n'est pas contradictoire avec ceUe fournie par l'instruction du
17 juin 1985 sur la mise en tat d'examen, laquelle indique que le refus de l'organe
dlibrant d'approuver le compte ne fait pas obstacle son examen par le juge. Encore
convient-il, en effet, que l'organe dlibrant ait t en mesure de statuer.
- ... - ...... ,, ,_
31-01-1997 05:01 DE . COUR COMPTES RPBC AFFTECH A
0-0321242479 P.05
3
conformit du compte avec les nomenclatures et instructions
Sur cet aspect de la rgularit formelle du compte, il semble, en revanche, qu'on puisse
s'interroger sur le fait de savo1r s'il mrite de figurer au nombre des diligences
minimales de contrle, tout au moins en matire juridictionnelle et pour les communes
et groupements.
Certes, dans certains cas extrmes, tel celui prsent par la situation du L.P. F. Leger
d'Argenteuil (Cour des Comptes, arrt d'appel du 11-09-1992) : absence de
comptabilit gnrale, de cahiers de trsorerie et de caisse, la ncessit de sanctionner
le comptable responsable de ces dsordres, en l'espce par une amende pour retard, les
comptes n'ayant pas t produits, parait s'imposer d'elle-mme.
Mais si l'on s'en tient aux communes et groupements, ce type d'anomalies renvoie
plutt des situations, telles que des retards dans la mise en oeuvre des nomenclatures
M4 pour les budgets annexes, pour la solution desquelles une intervention auprs de
l'ordonnateur peut paratre plus approprie qu'un rejet, qui ne pourrait tre que global,
des oprations du comptable.
1-2) Pices gnrales
prsence des pices de mytation et du certificat P61 S {pluralit de comptables)
La ncessit de s'assurer, pralablement au quitus dun comptable, que la collectivit
ou l' n'a a.ucune rclamation prsenter contre lui, a t rappele par la
Cour des Comptes saisi-n appel dun jugement rendu par la CRC d'Tic-de-France
(Collge Paul Fort de Montlhry, 28-04-1993). La Cour a estim, en que le
jugement visant un certificat libratoire qui n'avait pas t rellement dlivr tait
entach d'un vice de forme essentiel et devait tre annul.
On peut penser que la solution serait identique pour un jugement visant des pices de
mutation non valides.
Il doit tre rappel qu'en revanche, tordonnateur, s'il ne s'appuie sur aucun argument
prcis. ne saurait faire obstacle indfiniment la dcharge d'un comptable en refusant
de lui dlivrer le certificat libratoire, ainsi que la Cour en a jug dans son arrt
dfinitif du 19-12-1994 relatif au mme tablissement.
-
J
fJJ {l f) vr ,
P.06
4
prsence des documents
La ncessit de s'assurer de la prsence des documents budgtaires s'impose en
premier lieu pour les comptes administratifs, dans la mesure o l'arrt des comptes
par l'organe dlibrant porte la fois sur les comptes 'idministratifs et de gestion (rejet
d'un compte _Il t mis en concordance avec la dlibration statuant sur le
compte administratif correspondant (CRC de Haute-Nonnandie, perception de
Criquetot, 08-04-1987).
Etant prcis, bien entendu, qu'ainsi que le rappelle l'instruction du 17 juin 1985 sur la
mise en tat d'examen, ces documents budgtaires n'ont pas tre produits lorsqu'il
n'y a eu aucune opration .
. /
' K-prsence des tats de solde
At, b L.tf/ Cette vrification parait s'imposer, dans la mesure o l'absence d'tat de solde ne peut
." 1- L {" qu'entraner la mise en dbet hauteur des difFrences en moins constates (nombreux
exemples de jurisprudence, confirms en appel par la Cour dans le cas de la commune
de Taradeau (Var), arrt du 19-05-1994).
Cette diligence peut tre regroupe avec celle ayant trait la justification des soldes
(traite ci-aprs).
20) Examen des rserves
IJ tf! rclamations de '
i) Les reclamations o!ventu;cs de l'org:;:,e J'encontre du comptable ne
sauraient tre passes sous silience. Ainsi, sur appel du commissaire du gouvernement,
la Cour a t conduite annuler un jugement rendu par la CRC d'Ile-de-France pour
absence de visa des rserves de l'ordonnateur (Rgie d'lectricit de Houilles, 20-01-
1994).
rserves du com9table entnytt
-.-----llo.
- -,1 ........ -
Les considrations qui prcdent paraissent transposables l'examen des rserves du
comptable entrant. Cette question a t souleve en appel pour l'hpital Victor
Dupouy d'Argenteuil (arrt du 28-06-1991). Le parquet gnral avait alors estim
qu'en ne statuant pas sur des rserves expresses du comptable, la juridiction avait
31-01-1997 06:02 DE . COUR COMPTS RPBC:
0-0321242479 P.07
5'
refus de relever des irrgularits patentes et conclu 1\nfirmation du jugement.
Cependant, pour un motif de principe, cet appel a t rejet pour irrecevabilit.
Etant rappel que, si la juridiction tenue d'examiner les rserves, elle n'est pas
tenue en revanche de formuler une injonction. Ainsi, dans le cas dj cit du collge
Paul Fort de Monthlry, la Cour. saisie en a procd l'examen des rserves
mises par le comptable, mais conclu qye n'tait pas tenue de formuler une
injonction, car ces rserves n'taient ni prcises ni motives.
3) Examen des comptes
Le principe tant que, ds lors qu'une charge n'a pas t retenue, il peut tre interjet
appel par toute personne ayant qualit pour agir, il ne saurait y avoir de scurit
juridique absolue.
Le parquet gnral a, en particulier, rappel dans l'affaire dj cite du collge Paul
Fort, qu'aucun texte ne permet de restreindre le droit du ministre public pas plus que
celui de l'ordonnateur de faire appel d'une disposition dfinitive d'un jugement, mme
s'il s'agit d'une absence de charges.
Cependant, ce principe conna1"'t certaines limitations: ds lors qu'un ordonnateur a
dlivr le certificat libratoire un recours ventuel de sa part contre un jugement
conforme ce certificat est irrecevable (Sivom les Essarts le Perray, arrt du 12-10
1995) . .On peut pe:aser q\18, dans les mmes coftditions, le reeoors d'ttn contrie1::1able
agissant atJ UOm d'\me Gemmwte Ae serait Pis da vauflg te 1iahlfb..
Les autres limitations rsultent plutt des usages. En particulier, si rien n'interdit au
ministre public de conclure au sujet de charges non voques dans le rapport, les
appels :forrilS'par l miiifs're publie contre des jugements de dcharge visent plutt
trancher des questions de principe et non sanctionner d'ventuelles lacunes de
l'instruction.
En matire d'examen des comptes certaines diligences paraissent impratives. Ce sont celles qui
permettent de s'assurer de :
l''prment des dbets antsrieurs ventuels -. ,.,. . = r - - -- -- "
<J
Le dbet fait videmment obstacle la dcharge du comptable, ce dernier ne pouvant
,._Ni.,;..,. lA- etrc dcharg qu'aprs que celui-ci aura t apur.
'
\..oUUn. \,.oUI Il 1 g\,;,; nrr- 1 M
e
U onvierit donc, en particulier, de s'assurer qu'aucune sonune ne subsist au compte
419 dficit et dbet, les mouvements sur ce compte tant examiner avec d'autant
plus d'attention qu'ils peuvent masquer de graves irrgularits, telles que le
remboursement un comptable d'un dbet que celui-ci avait antrieurement sold
(CRC Rhne-Alpes, commune de la Baume, 08-11-1994). n est noter que les
sommes inscrites ce compte peuvent galement correspondre l.ln dficit de caisse
imputable un rgisseur (CRC Centre, commune de Bourges, 01-10-1993).
Bien que cette diligence soit moins frquemment mentionne, on peut se demander s'il
ne conviendrait pas de mme de s'assurer de l'apurement des amendes ventuelles.
la reprise des soldes et la fixation de la ligne de comptes (dont valeurs inactives)
Le comptable a l'obligation de justifier de la reprise du rsultat du compte jug au
compte suivant. Cette obligation constitue une charge et le comptable ne peut tre
dcharg s'il n'y a satisfait. Si la Cour dans son avis des chambres runies des 7 et 14
octobre 1996 a apport des novations au dispositif des arrts concernant, en
particulier, la fixation de la ligne de compte, ce dispositif n'a pas t modifi quant
l'obligation de reprise des soldes.
En consquence, la reprise des soldes de clture du bilan en balance d'entre de
l'exercice suivant doit tre vrifie, de mme que l'enchanement des soldes des
valeurs inactives., toute diffrence en moins ne pouvant qu'tre sanctionne par un
dbet.
Jurisprudence : dbets motivs par des diffrences entre solde de clture et balance
d'entre (concernant des lments d'actifs (Cour des comptes, IME de Troissy, 29-06-
1995 ; CH de Blaye, - de_s valeurs inactives (CRC Bretagne, commune de
Saint-Cast, - "'
Bien que ne prsentant pas le mme caractre impratif mais se situant dans le prolongement direct
du contrle de la reprise des soldes, parat galement s'imposer la vrification de:
la justification des soldes : prsence de l'tat et concordance avec le compt..e
.. ...
L'importance de ce contrle des irrgularits comptables en matire d'examen des
comptes est soulign par l Magnet (La Cour des Comptes, p.131).
31-01-1997 06:04 DE COUR COMPTESCRPBC AFFTECH 0-0321 <:!4<:!4' (';1
7
Jurisprudence: l'absence d'tat et/ou la constatation d'une diffrence en moins ne peut
qu'entraner la mise en dbet du comptable (CRC Limousin; =commune de Boussac;,
0 1-02-1996 ; CRC Centre, OPHLM d'Eure-et-Loir, 06-02-1995 ; CRC Basse-
Normandie, OPHLM de la Manche, 20111991 ).
Si le principe de faire figurer cette vrification t:.luelle parmi les diligences minimales
tait retenu, il conviendrait de l'expliciter pour certains soldes, ne seraitce que parce
que lesjtiStifications produire par le comptable peuvent varier selon les cas .
* *
Si les diligences qui prcdent paraissent ncessaires en premire analyse. elles
n'puisent videmment pas la dtection des manquements ventuels du comptable
ses obligations en matire de contrle des recettes et des dpenses. Mais elles semblent
suffisantes pour tayer entirement les nonciations du jugement sans charges (autres
que celles ayant trait la reprise des soldes). Aussi le groupe de travail propose-t,
dans cette approche, de limiter ce qui prcde les diligences minimales.
11 est vrai que l'on peut s'interroger, cet gard, sur le traitement rserver au
contrle des dpassements de crdit (dans la mesure o les budgets sont viss) et
paiements sans fonds disponibles (qui se rattache la vrification des soldes).
Cependant, si sur ces deux points la question de l'engagement de la responsabilit du
comptable a t tranche sans ambigt.'t (Cour des Comptes, BAS de Matour, 04-02
1988 SI des eaux de Maule, 06-07-1989; SITS de Boissise le Roi, 07-12-1989)
7
le
parquet gnral a lui-mme relev la difficult prsente par les dbets ne
correspondant pas un prjudice pour la collectivit et soulign que ceci constituait
une faiblesse du systme de jugement des comptes en vigueur (conclusions de l'arrt
commune de Fontaine le Dun, OS-02-1992). Les interrogations peuvent tre d'autant
plus grandes ce sujet que cette faiblesse parait galement concerner les conditions
d' apurement"'tiTa&ts,-ioiSque ceux--ci ne correspondent pas un prjudice financier
pour la collectivit (cf. ciaprs II) ..
n est certain, par ailleurs, que si la rflexion conduite, fonde sur la notion de scurit
juridique, ne fait pas explicitement rfrence au caractre allg des contrles, celui-ci
est implicite dans une recherche de minimisation des risques de contestation de
jugements de dcharge. Pour une collectivit de grande taille, faisant l'objet d'un
contrle approfondi, ces diligences ne sauraient certainement tre considres comme
regard du temps consacr..-au.cpntrle. ...
tre prise en compte dans une tape ultrieure de rflexion sur les diligences tendues.
8
Il - Questions susceptibles de relever de l'apprciation du ministre public
JO) Rle du ministre public dans les diligences relevant de la mise en tat d'examen
Les propositions de diligences minimales qui prcdent comportent la vrification de la
certification par le comptable suprieur de la mise en tat d'examen .. Malgr cette certification,
certains contrles, bien que faisant partie des oprations de mise en tat d'examen, apparaissent,
nanmoins, devoir tre ritrs par la chambre au regard de l'objectif de scurit juridique (cf.
diligences relatives la forme des comptes et aux pices gnrales).
Ds lors et dans la mesure o, selon une jurisprudence constante, la mise en tat d'examen se
droule l'intrieur du dlai de production du compte, se pose la question de savoir lesquelles de
ces diligences sont suceptibles d'tre mises en oeuvre par le ministre public, d'une-part, et par le
rapporteur, d'autre-part.
Outre un intrt de fond, li aux moyens daction de la juridiction au stade de la production des
comptes (mise en demeure) ou au stade ultrieur (rserves), la rponse cette question prsente
galement un intrt pratique vident du point de we de la complmentarit des contrles.
Aussi serait-il intressant de pouvoir bnficier d'une information et de la position du parquet sur
ce point.
2) Apurement des dbets -. J-; .
La mise en oeuvre de certaines diligences, concernant en particulier les dpassements de crdits et
paiements sans fonds disponibles, soulve la question des dbets ne correspondant pas un
prjudice, qui pourraient en rsulter. Ces interrogations sont renforces par les conditions
d
1
apurement de ces dbets, puisqu'il semblerait qu'il soit fait application en ce cas des dispositions
de l'article 10 du dcret du 29 septembre 1964, lesquelles prvoient qu'en cas d'irrgularits
commises par l'ordonnateur le Ministre des Finances a la facult d'attnuer, voire d'annuler. la
.--ffaetion de ces restant, gracieuses, -""'"'7,!' ... ,
. f TI pourrait tre utile, sur ce point, de pouvoir bnficier des enseignements retirs de l'enqute en
. (/ cours du parquet sur l'apurement des dbets.
--- - -- ...... - ..
06:05 DE couR COMPTES. RPBt RFFTEH :R
ID - Organisation et suite des travaux
r; Forme des recommandations aux chambres- orientations lk travail
1-1) Forme des recommandations
0-0321242479 P.ll
9
Les prsentes propositions relatives aux diligences minimales en matire juridictionnelle ont t
labores en vue de permettre la commission de dgager, parmi les diligences possibles. la liste
de celles qui doivent tre obligatoirement mises en oeuvre. Pour cette raison, il n'a pas paru utile
ce stade d'entrer dans le dtail du contenu des contrles correspondants. En revanche, il
conviendra sans doute, sur la base des recommandations retenues par la commission concernant
ces diligences, d'expliciter en tant que de besoin le contenu de ces contrles.
TI est propos que les recommandations aux chambres que retiendra la commission prennent la
forme d'un document adress l'ensemble des magistrats, comportant quelques rappels de
jurisprudence (en matire d'examen des rserves notamment) ainsi qu'une explicitation du
caractre minimal du champ des diligences retenues (au regard de ce qu'il contient et de ce qu'il
carte), assorti de fiches explicitant brivement sur certains points les contrles oprer.
1-2) Orientations pour la poursuite des travaux
Au cours de sa prcdente sance, la commission a retenu le principe de procder, dans une
premire ta.pe, la dfinition des diligences minimales de contrle dans le cadre des procdures
allges, avant d'envisager, dans une seconde tape, d'largir l'tude des recommandations en
matire de diligences tendues.
Dans l'immdiat la question se pose, donc, de savoir si la dfinition de diligences minimales,
laquelle la commission aura procd en matire juridictionnelle, doit tre complte par un
- exerice similaire des mises en oeuvre par les chambres, sous la forme
d'indicateurs de risques financiers, en matire d'cxen-Cfa
allges.
Si la commission estimait pouvoir retenir cette orientation, des propositions pourraient lui tre
soumises sur ce point lors de sa plus prochaine runion.
........... --
t.
LE CONTROLE DES FINANCES PUBLIQUES PAR UNE JURIDICTION DES
COMPTES : CAS DE LA COUR DES COMPTES DU SENEGAL
La bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques
impliquent un contrle efficace exerc par une institution indpendante, dote de
moyens adquats. C'est cet effet que la Cour des comptes a t cre.
Depuis 1999, anne de sa cration, la Cour des Comptes a pu se forger une place
dans le concert des institutions de la Rpublique. En plus, la confiance et la
considration dont elle jouit ne cesse de crotre auprs des populations et des
partenaires au dveloppement.
Mme si la Cour a su marquer sa prsence parmi les institutions de la Rpublique,
sa mission et ses prrogatives ne sont pas bien connues.
Vous comprendrez donc pour moi l'honneur et le plaisir qui m'est offert de parler de
cette instjtution et de ses procdures.
Pour mieux comprendre les procdures suivies par la Cour des Comptes du
Sngal, il y a lieu nous semble t-il, de faire tat d'abord une prsentation de cette
dernire.
1- PRESENTATION GENERALE DE LA COUR DES COMPTES DU SENEGAL:
1 - Historique
Au Sngal, le rle d'institution suprieure de contrle des finances publiques tait
dvolu ds 1960 une institution du pouvoir judiciaire, la Cour Suprme. A la faveur
de la rforme judiciaire de 1992,. la 3me Section de la Cour Suprme qui faisait
fonction de juridiction des comptes a fait place la 2me Section du Conseil d'Etat
cre en mme temps que le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation, par la
loi Constitutionnelle no 92-22 du 30 mai 1992.
Cette rforme institutionnelle, commande par la ncessit avre de la
spcialisation des magistrats devenue un impratif pour la sauvegarde mme de
l'institution judiciaire, s'est poursuivie par la cration de la Cour des Comptes en lieu
et place de la 2me Section du Conseil d'Etat. C'est l' objet de la loi no 99-02 du 29
janvier 1999 portant rvision de la Constitution.
2- Comptence
Le champ de comptence de la Cour des Comptes est dfini par la loi
constitutionnelle no 99-02 et par la loi organique no 99-70 du 17 fvrier 1999 sur la
Cour des Comptes. En matire juridictionnelle et financire, la Cour des Comptes
juge les comptes des comptables publics dont la loi organique prcite rappelle, en
son article 25, la dfinition : "A l'gard de la Cour des Comptes, est comptable public
tout fonctionnaire ou agent ayant qualit pour excuter au nom d'un organisme public
des oprations de recettes, de dpenses ou de maniement de titres, soit au moyen
des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d'critures, soit par
l l
l'entremise d'autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilits
dont il ordonne ou surveille les mouvements" .
La Cour juge galement les comptes des personnes qu'elle a dclares comptables
de fait, c'est dire celles qui se sont immisces dans les fonctions de comptable
patent ou les comptables patents qd ont abus de leurs fonctions.
Elle s'assure du bon emploi des crdits, fonds et valeur gres par les services de
l'Etat, les collectivits locales et leurs tablissements publics.
La Cour des Comptes assiste le Prsident de la Rpublique, le Gouvernement et le
Parlement dans le contrle de l'excution des lois de finances. Elle effectue toute
enqute complmentaire qui pourrait lui tre demande par le Parlement,
l'occasion de l'examen ou du vote du projet de loi de rglement.
Elle s'assure que l'Etat et ses dmembrements sont en rgle avec les institutions de
scurit sociale.
La Cour peut exercer un contrle du compte d'emploi des ressources collectes
auprs du public dans le cadre de campagnes nationales d'appel la gnrosit
publique.
Constitue en chambre de discipline financire, elle a comptence pour sanctionner
les fautes de gestion et prononcer des amendes contre leurs auteurs.
Enfin, par l'intermdiaire de la Commission de Vrification des Comptes et de
contrle des entreprises publiques (CVCCEP), la Cour des Comptes vrifie les
comptes et contrle la gestion des entreprises du secteur parapublic, des institutions
de scurit sociale et de tout organisme faisant appel la gnrosit publique.
3 - Organisation
La Cour des Comptes est organise en formations que sont l'audience plnire
solennelle, les chambres runies, les chambres permanentes, une chambre non
permanente (la chambre de discipline financire) et deux formations consultatives (
le comit des rapports et programmes, et la confrence des prsidents et du
Commissaire du droit).
Les chambres permanentes sont au nombre de trois :
- la chambre des affaires budgtaires et financires (CABF) charge du contrle
des comptes et de la gestion des services financiers de l'Etat et de leurs
tablissements publics caractre administratif.
- La chambre des affaires administratives et des collectivits locales (CAACL) qui
contrle les comptes et la gestion des autres services de l'Etat, des collectivits
locales et des organismes publics qui leur sont rattachs.
La commission de vrification des comptes et de contrle des entreprises
publiques (CVCCEP), chambre autonome de contrle des entreprises du secteur
1 ) '
parapublic que la loi organique dfinit comme comprenant les tablissements
publics caractre industriel et commercial, les tablissements professionnels,
les tablissements publics de sant, les autres tablissements publics dont la
cration sera dcide ultrieurement. Les socits nationales, les socits
anonymes participation publique majoritaire, les organismes bnficiant de
soutien de la puissance publique, les institutions de scurit sociale, ainsi que
tout organisme faisant appel la gnrosit publiql,:;.
Quant la chambre non permanente, la CDF, elle comprend un prsident, deux
conseiller matres et deux conseillers rfrendaires et juge toute personne investie
d'un mandat public ou assimile ayant en freint l'obligation de respect et de
sauvegarde du bien public. Seuls le Prsident de la Rpublique et les membres du
Gouvernement chappent sa comptence.
Auprs de toutes ces formations, le Commissaire du Droit exerce les fonctions de
ministre public et veille ainsi la bonne application des lois et rglements au sein
de la Cour. Il est nomm par dcret selon le pouvoir discrtionnaire du Prsident de
la Rpublique et n'a pas la qualit de magistrat.
Les formations de la Cour sont animes par des magistrats sous la supervision du
Prsident de la Cour des Comptes.
La Cour dispose d'un greffe central dirig par un greffier en chef, compos des
greffes respectifs des chambres.
Il - LES PROCEDURES DEVANT LA COUR DES COMPTES :
Les procdures applicables au sein de la Cour des Comptes sont dfinies par la loi
organique sur la Cour des Comptes et prcises par le dcret no 99-499 du 8 juin
1999 fixant les modalits d'application de ladite loi organique.
Elles sont crites ;
Elles sont contradictoires.
Toutefois, elles varient suivant le type de contrle et suivant la structure qui l'exerce
au sein de la Cour (chambre).
Deux grands types de contrles sont exercs par la Cour des Comptes. Ce sont le
contrle juridictionnel et le contrle non juridictionnel.
Al Le contrle juridictionnel
Il est exerc en vue du jugement des comptes des comptables publics, en vue de
sanctionner une ou des fautes de gestion, ou en vue de dclarer comptable de fait,
une personne qui manie des deniers publics sans en tre habilite par un texte.
' '
A .1 - La procdure relative au jugement des comptes
On peut dire que la procdure relative au jugement de comptes dbute pour la Cour
avec l'adoption de son programme annuel de vrification qu'elle dfinit en application
de l'article 29 de la loi organiqu& sur la Cour des Comptes. Elle se poursuit par :
1 - La production des comptes : ~ t t obligation incombe aux comptables publics
justiciables de la Cour des Comptes, qui doivent transmettre celle-ci, cinq mois
aprs la clture de chaque gestion, leur compte de gestion appuy des pices
gnrales et des pices justificatives des recettes et des dpenses qu'ils ont
effectues durant la priode coule, sous peine d'une amende de 20 000 F par
mois de retard. Outre les comptables publics, les ordonnateurs transmettent la
Cour leur compte administratif (pour ce qui concerne les collectivits locales).
A l'arrive, les comptes font l'objet d'un enregistrement au bureau du greffe central.
A cette occasion, il est procd la vrification de la conformit de l'envoi des
comptes, avant enregistrement au rle gnral de la Cour, puis au rle particulier de
la Chambre comptente.
2 - L'instruction des affaires : elle est entreprise par un ou plusieurs rapporteurs
dsigns par le prsident de chambre. Selon les dispositions de l'article 36 de la loi
organique sur la Cour des Comptes, "les rapporteurs procdent la vrification des
comptes en se rapportant aux pices de recettes et de dpenses et aux justifications
qui y sont annexes". A l'occasion, ils peuvent entendre tous les acteurs, peuvent
procder des vrifications sur place. Au terme de leurs investigations, ils
prsentent la chambre un rapport fin d'arrt provisoire, enjoignant le cas chant,
au comptable d'apporter des explications ou des justifications aux constatations
valant charges, dans un dlai d'un mois, et dont le non respect peut tre sanctionn
par une amende de 100 000 F au maximum par injonction et par mois de retard
(article 37 de la loi organique).
3 - Le jugement dfinitif des comptes : il intervient "ds que l'affaire est compltement
instruite" (article 38). Il conduit au prononc d'un arrt soit de dcharge, soit de
quitus, soit de dbet. Les arrts dfinitifs de la Cour sont rendus en premier et
dernier ressort, sous rserve de pourvoi en rvision devant elle-mme ou de
cassation devant le Conseil d'Etat (articles 39 et 401 de la loi organique).
A.2 - Procdure relative la gestion de fait
La procdure relative la gestion de fait s'ouvre partir de la constatation de
l'immixtion de toute personne (non habilite) dans les fonctions du comptable patent.
Celui-ci peut galement commettre une gestion de fait en abusant de ses pouvoirs.
"Les gestions de fait entranent les mmes obligations et responsabilits que les
gestions patentes et sont juges comme elles" (article 25, alina 3 de la loi organique
no 99-70 du 17 fvrier 1999 sur la Cour des Comptes). La procdure se droule en
six phases suivant les dispositions des articles 25 34 du dcret no 99-499 du 17
fvrier 1999 sur la Cour des Comptes.
1 - La saisine
"La Cour se saisit d'office des gestions de fait releves par la vrification, ou le
contrle des comptes qui lui sont soumis. Elle est galement saisie par le
Commissaire du Droit de faits prsums constitutifs de gestion de fait".
"Les ministres, les reprsentants lgaux des collectivits locales et des
tablissements publics sont tenus de communiquer la Cour toutes les gestions de
fait qui sont dcouvertes dans leurs services ou organismes. La mme obligation
incombe aux autorits de tutelle de ces collectivits ou tablissements ainsi qu'au
ministre charg de leur tutelle financire pour toutes les gestions de fait dont ils ont
connaissance".
2 - L'instruction
Le prsident de la chambre comptente dsigne par ordonnance un conseiller
rapporteur charg d'instruire l'affaire. A l'issue de l'instruction, le conseiller rapporteur
labore un rapport. Par ce rapport, il propose, s'il y a lieu, la dclaration de gestion
de fait l'encontre des personnes concernes. Le dossier et le rapport sont
communiqus par l'intermdiaire du greffe au Commissaire du Droit, ministre public
prs la Cour. Le Commissaire du Droit formule un avis sur les conditions
d'application des lois et rglements en la cause.
3 - L'examen du rapport
La chambre examine le rapport prsent devant elle par son auteur, au vu du dossier
et de l'avis du Commissaire du Droit. Si elle estime devoir carter la gestion de fait,
elle rend un arrt motiv de non-lieu. Si elle adopte une position contraire, elle
dclare d'abord la gestion de fait par arrt provisoire portant injonction au comptable
de fait de produire son compte accompagn de toutes les pices justificatives dans le
dlai de deux mois suivant la notification de l'arrt.
4 -La dcision dfinitive
Au vu des rponses du comptable de fait, sans aucune rserve, la chambre rend un
arrt confirmant la dclaration de gestion de fait et fixant titre dfinitif la ligne de
compte. "Si l'intress conteste l'arrt provisoire, la chambre examine les moyens
invoqus et les preuves fournies. En cas de maintien de la dclaration de gestion de
fait, elle doit rfuter dans ses motivations tous les arguments prsents par le
comptable et renouveler l'injonction de produire le compte dans le dlai de deux
mois.
Elle mentionne en outre dans le nouvel arrt provisoire qu'en l'absence de rponse,
elle statuera de droit titre dfinitif aprs l'expiration du dlai imparti pour produire".
(article 29 du dcret). Le compte de la gestion de fait doit tre certifi et sign par
l'intress. Il est jug comme les comptes des comptables patents. En cas de
pluralit d'auteurs, la Cour peut les dclarer conjointement et solidairement
comptables de fait.
5 - Les suites
La procdure a notamment pour objet de rtablir les formes budgtaires qui n'ont pas
t respectes". La dclaration de gestion de fait et la fixation de la ligne de compte
ncessitent donc que l'autorit budgtaire comptente reconnaisse que les dpenses
effectues prsentaient bien un caractre d'utilit publique. Elle statue alors sur le
rejet ou l'approbation des oprations en cause, hors la prsence des comptables de
fait. La dcision de l'autorit budgtaire, approuve par l'autorit de tutelle, s'impose
la Cour qui ne peut allouer---la-dcharge du comptable de fait que les dpenses
dont l'utilit publique a t accepte." (article 33 du dcret). Pour le surplus, il y a
prononc de dbet.
6 - L'apurement
"Pour pouvoir apurer une gestion de fait et pour que le comptable puisse obtenir
quitus de sa gestion, la Cour doit s'assurer que le solde entre les dpenses et les
recettes, s'il existe, a t vers la collectivit comptente. Lorsque le paiement du
solde est intervenu, le dbet apur et les amendes verses, la chambre prononce
alors la dcharge et le quitus du comptable comme une gestion patente" (article 34
du dcret).
A.3 - La procdure devant la chambre de discipline financire.
Aux termes de l'article 44 de la loi organique sur la Cour des Comptes, celle-ci
"exerce une fonction juridictionnelle en matire de discipline financire. Cette
attribution s'exerce par la chambre de discipline financire." La procdure devant la
chambre de discipline financire fait l'objet des articles 54 64 et 66 de la loi
organique sur la Cour des Comptes. Les principales tapes sont :
- la saisine : "la chambre ne peut tre saisie quatre annes rvolues aprs le jour
de la dcouverte des faits de nature donner lieu l'application des sanctions
prvues en matire de discipline financire" (article 54 de la loi organique, sur la
Cour des Comptes). La chambre est saisie, sur demande de poursuites adresse
au Commissaire au Droit, par :
- le Prsident de la Rpublique ;
- le Prsident de l' Assemble nationale ;
- le Premier Ministre;
- le Ministre charg des Finances ;
- le Prsident de la Cour des Comptes ;
- le Prsident de la CVCCEP.
La ou les personnes concernes par les demandes de poursuites en sont informes
par le Commissaire du Droit par lettre recommande avec avis de rception, puis
celui-ci transmet le dossier au prsident de la chambre pour dsignation d'un
rapporteur.
..
La ou les personnes concernes par les demandes de poursuites en sont informes
par le Commissaire du Droit par lettre recommande avec avis de rception, puis
celui-ci transmet le dossier au prsident de la chambre pour dsignation d'un
rapporteur.
1 - L'instruction : le conseiller rapporteur dsign par le \le chambre a tous
les pouvoirs d'investigation, sans qu'il puisse lui tre oppos le secret professionnel.
S'il constate qu'une ou plusieurs personnes autres que celles vises par la demande
de poursuite ont commis des faits susceptibles d'tre sanctionns comme fautes de
gestion, il doit communiquer ses constations au Commissaire du Droit. Au terme de
l'instruction, le rapporteur produit son rapport qui est transmis au Commissaire du
Droit pour ses conclusions. Celui-ci peut conclure soit au classement sans suite de
l'affaire et en informe l'autorit qui lui a transmis la demande de poursuites, soit au
renvoi du ou des prvenus devant la chambre de discipline financire pour y tre
jugs. Dans ce cas le ou les prvenus en sont informs et peuvent exercer leur droit
de dfense, en se faisant communiquer leur dossier et en se faisant assister d'un
conseil.
2- Le iuaement : cette phase commence par une ordonnance du prsident de la
chambre ouvrant la session de jugement et fixant le rle des audiences. Le ou les
prvenus sont cits comparatre par le greffier de la chambre. Les audiences de la
chambre de discipline financire ne sont pas publiques. Les dbats sont le plus large
possible ; des questions peuvent tre poses par le prsident , ou avec son
autorisation, par le Commissaire du Droit ou par les membres de la chambre au
prvenu qui doit avoir le dernier la parole.
La chambre sige avec l'assistance du greffier, et en prsence du Commissaire du
Droit ; toutefois, la dlibration a lieu hors la prsence de ce dernier.
3- La dcision: la dcision de la chambre est rendue sous la forme d'un arrt, revtu
de la formule excutoire, elle est non susceptible d'appel. Elle est en revanche
susceptible de pourvoi en rvision devant les chambres runies de la Cour des
Comptes, ou en cassation devant le Conseil d'Etat.
Le rle du greffe central mrite ici d'tre mentionn dans la conduite de la procdure
juridictionnelle. C'est en effet le greffe central qui, en application des dispositions de
l'article 17 du dcret no 99-499 du 8 juin 1999 fixant les modalits d'application de la
loi organique no 90-70 du 17 fvrier 1999 sur la Cour des Comptes,
rceptionne et enregistre les comptes et toutes les pices justificatives qui les
accompagnent ;
enregistre les recours ;
enregistre les rponses des personnes interroges et tous autres documents
transmis ou dposs la Cour ;
- en assure l'archivage et la bonne conservation ;
' '
- notifie les arrts et autres actes de la Cour caractre juridictionnel ;
- en dlivre copies ou extraits aprs certification.
Le greffe central, par l'entremise du greffie. en chef ou des greffiers de chambre,
prpare l'ordre du jour des sances de la Cour (ou des chambres), assiste aux dites
sances, en dresse le procs verbal. Il tient et t,\Jnserve les rles d'audiences.
A .4- Le contrle de l'excution de la loi des finances
La loi organique no 99-70 du 17 fvrier 1999 sur la Cour des Comptes dispose en
son article 2 que la Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrle de l'excution de la loi des finances .Cette formule a t reprise par
le dcret 99-499 du 28 juin 1999 fixant les modalits d'application de la loi organique
sur la Cour des comptes en sa section Ill qui en prcise l'application en dictant que
la Cour tablit chaque vanne un rapport sur l'excution des lois des finances et une
dclaration gnrale de conformit entre les comptes des comptables publics et le
compte gnrale de l'administration des finances.
1- Le rapport sur l'excution des lois de finances : Ce rapport est considr comme
la contribution de la Cour des Comptes au contrle du Parlement sur l'excution des
lois de finances, les parlementaires pouvant comparer eux-mmes les autorisations
budgtaires confres par ces lois avec les oprations effectues.
Ce contrle de la Cour a pour objet de permettre au parlement d'apprcier l'action
du gouvernement en matire de gestion des oprations financires de l'Etat.
Le travail de la Cour consistera donc dterminer et analyser les rsultats des
oprations financires de l'Etat et examiner la rgularit et la sincrit :
- rapprocher les prvisions de recettes inscrites dans les lois de finances des
recettes dfinitives dcrites dans l'tat de dveloppement des recettes ;
- comparer les autorisations de dpenses confres par les lois de finances ,
dtailles dans le dcret de rpartition et modifies par les dcrets d'avance et de
virement et les arrtes de transferts et de reports) avec les situations de
consommations des crdits ;
- analyser les mouvements financiers au regard des rgles budgtaires et celles
relatives l'excution des recettes et des dpenses .
A l'issue du contrle le magistrat rapporteur tablit un rapport provisoire qui est
transmis aux administrations concernes avec un dlai de rponses de quinze jours.
A l'expiration de ce dlai la CABF examine , en prsence des reprsentants des
administrations concernes le rapport et les rponses apportes.
Au terme de cette audition, le chambre dlibre et arrte le rapport de la Cour qui est
soumis pour avis aux chambres runies puis adopt dfinitivement en audience
plnire solennelle.
1 1 '
Ce rapport est enfin dpos par le Prsident de la Cour sur Je bureau de J'assemble
nationale.
2 La dclaration gnrale de conformit : La comptabilit de l'Etat telle qu'elle est
organise est constitue principalement par deux sries d'critures, les unes qui
la mise en recouvrement des recettes et l'ordonnancement des dpenses (
comptabilit administrative) et les autres qui constatent les encaissements et les
dcaissements correspondants -et l'excution des oprations de trsorerie (
comptabilit des comptables publics).
Les oprations de la comptabilit administrative sont prsentes dans le compte
gnral de l'administration des finances labor par les services du ministre de
l'Economie et des Finances.
Les vrifications de la Cour consisteront essentiellement s'assurer que les mmes
oprations se retrouvent, sous une prsentation diffrente, dans Je compte gnral
de J'administration des finances et dans les comptes des comptables soumis sa
juridiction.
L'adoption de la dclaration gnrale de conformit se fait se fait dans les mmes
formes et dlais que le rapport sur l'excution des lois de finances.
Au vu du rapport sur l'excution des lois de finances et de la dclaration gnrale de
conformit, le Parlement vote la loi de rglement.
Ill - LE CONTROLE NON JURIDICTIONNEL :
Le contrle non juridictionnel exerc par la Cour des Comptes est celui qu'elle exerce
dans le cadre de ses attributions fixes aux articles 26 et 27 de la loi organique sur la
Cour des Comptes. Aux termes de l'article 67 de la loi organique, "il vise apprcier
la qualit de la gestion et formuler, ventuellement, des suggestions sur les
moyens susceptibles d'en amliorer les mthodes et d'en accrotre l'efficacit et le
rendement." La procdure suivie est celle prescrite par l'article 73 de la loi organique,
s'agissant des contrles qui sont exerces par la chambre des affaires budgtaires et
financires ou par la Chambre des affaires administratives et des collectivits
locales.
En ce qui concerne cette procdure suivie, deux distinctions doivent tre faites,
s'agissant du cas du Sngal.
1 -La procdure devant les chambres des affaires budgtaires et financires et des
affaires administratives et des collectivits locales.
C'est la procdure dcrite par l'article 73 de la loi organique no 99-70 du 17 fvrier
1999 sur la Cour des Comptes.
Elle se diffrencie trs peu, dans son droulement, de celle suivie en matire de
jugement des comptes :
- un rapporteur est dsign qui procde l'instruction du dossier et tablit un pr-
rapport l'issue de cette instruction ;
J 1 ' '
- le pr-rapport est communiqu par le prsident de chambre aux dirigeants du
service ou organisme contrl pour rponse par mmoire ;
- le mmoire est transmis pour analyse au rapporteur et un contre-rapporteur s'il
y a lieu;
- l'ensemble du dossier est transmis ensuite au Commissaire du Droit pour ses
conclusions; __ .. --- -- ------ ---
- une sance d'audition des parties est ensuite organise par la chambre le cas
chant, l'issue de la quelle la chambre arrte dfinitivement le rapport dans
lequel elle exprime son opinion sur la rgularit et la sincrit des comptes,
propose les redressements, sanctions et modifications ventuels.
Les irrgularits constates, les lacunes de la rglementation releves et les
insuffisances dans l'organisation administrative et comptable des entits contrles
donnent lieu des rfrs du prsident de la Cour adresss aux dirigeants desdites
entits ainsi qu' leurs ministres de tutelle.
Elle fait intervenir le Commissaire du Droit dont les conclusions doivent tre produites
avant que la chambre n'arrte son rapport dfinitif sur l'affaire. Ce dernier peut
conclure un rfr du Prsident de la Cour adress aux "dirigeants des organismes
contrls, aux ministres intresss ou aux autorits de tutelle" en leur demandant "de
faire connatre la Cour les mesures prises en vue de faire cesser les errements
constats".
S'agissant de la CVCCEP, la procdure applicable est dcrite aux articles 8 12 du
dcret no 92-1559 du 6 novembre 1992 fixant ses rgles de fonctionnement. La
CVCCEP procde un contrle non juridictionnel sur les comptes et la gestion des
entreprises du secteur parapublic. La Commission arrte en assemble restreinte
son programme annuel de vrification et le communique pour information au
Prsident de la Rpublique, au Premier Ministre, aux diffrents Ministres concerns,
au Prsident de la Cour des Comptes, l'Inspection Gnrale d'Etat et au Contrleur
financier. Toutefois, la Commission peut tre saisie par le Prsident de la Rpublique
ou le Premier Ministre d'une demande de contrle spcifique. Elle peut enfin
complter si ncessaire son programme annuel par un programme intrimaire. Ses
procdures s'apparentent celles des cabinets d'expertise comptable tout en se
conformant aux dispositions de la loi relative l'organisation et au contrle des
entreprises du secteur parapublic.
Les interventions de la CVCCEP doivent notamment permettre de s'assurer :
- de la rgularit et de la sincrit des comptes ;
- du respect des dispositions lgales et rglementaires par les responsables de
l'entit contrle ;
- du respect des objectifs assigns la structure (efficacit de la gestion);
- de l'optimisation des moyens (efficience de la gestion).
. '
.....- . ' :. . .
Elles dbouchent sur l'tablissement d'un rapport particulier provisoire adress aux
dirigeants des entits contrles et leurs ministres de tutelle pour observations
crites, dans un dlai que leur impartit le Prsident de la CVCCEP.
Au terme de ce dlai, la CVCCEP tient une assemble plnire o les dirigeants des
entits contrles trouvent l'occasion de formuler nouveau et le cas ct:sdnt de
commenter leurs observations, en prsence des reprsentants des autres corps de
contrle et de ceux des ministres-chargs des tutelles technique et financire.
A l'issue de ces assembles plnires, la Commission arrte ses conclusions
dfinitives. Elle les adresse au Prsident de la Rpublique qui peut les transformer
en directives.
Ill - CONCLUSION :
La Cour des Comptes a apport ainsi beaucoup de nouveauts dans l'organisation
judiciaire du Sngal (cration de la magistrature financire) d'une part et d'autre
part dans le systme de contrle des finances publiques.
Les comptences que la loi et le rglement assignent la Cour des Comptes sont
mises en uvre travers des procdures minutieusement dcrites par ces mmes
textes. Elles sont de nature permettre la Cour un exercice complet de ses
attributions, dans un souci de transparence et d'efficacit.
Institution Suprieure de contrle des finances publiques, la Cour des Comptes jouit
d'une grande autonomie dans l'exercice de ses prrogatives ( elle ne dpend
d'aucun ministre) et peut faire connatre directement le rsultat de ses
investigations par la production de son rapport public.
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES FINANCES
ET DU PLAN
Arrt n 289/MF/P
du 31 aot 1995
portant organisation et attributions de
la Direction du Contrle Financier
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU PLAN
VU la Constitution du 26 dcembre 1992 ;
VU l'ordonnance n 85-032 du 14 novembre 1985 instituant un code des marchs publics;
VU le dcret 93-045/PM/MF/P du 12 mars 1993 portant rglement gnral de la comptabilit
publique;
VU le dcret n 95-019/PRN du 21 fvrier 1995 portant nomination du Premier Ministre;
VU le dcret n 95-020/PRN du 25 mars 1995 portant composition du gouvernement ;
VU le dcret no 95-111/PRN/MF/P du 15 juin 1995 dterminant les attributions du Ministre des
Finances et du Plan ;
VU le dcret 95-112/PRN/MF/P du 15 juin 1995 portant organisation du Ministre des Finances
et du Plan;
ARRETE
ARTICLE PREMIER: La Direction du Contrle financier est organise conformment aux
dispositions du prsent arrt.
Article 2 : La direction du Contrle financier comprend :
un Directeur,
le Secrtariat du Directeur,
le Secrtariat Rception- Documentation,
les Services du Contrle financier dconcentr.
Article 3 : Le Directeur du Contrle financier nomm par dcret pris en conseil des ministres est
charg de la coordination des activits des Contrleurs financiers des diffrentes structures de
l'Etat. Dans l'exercice de ses attributions le Directeur du Contrle financier est charg notamment:
d'approuver, par dlgation du Ministre des Finances et du Plan, tous les actes de dpenses
manant des diffrents Ministres et grands services de 1 'Etat et ayant reu pralablement le visa
du Contrleur financier concern ;
de faire rapport mensuel au Ministre des Finances et du Plan des activits de la Direction ainsi
que celles des Contrleurs financiers dconcentrs ;
de suivre au titre de la Direction, avec les Contrleurs financiers chacun en ce qui le concerne,
la prparation et l'excution du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spciaux
du Trsor;
de reprsenter la Direction au sein de tout conseil, comit ou commission ainsi que de toute
autre structure pour lesquels la mission de contrle est normalement requise ;
de reprsenter le Ministre des Finances et du Plan dans toute structure au sein de laquelle il est
expressment dsign par le Ministre des Finances et du Plan ;
de veiller la mise en place et d'assurer le suivi d'une comptabilit matire en rapport avec les
Contrleurs financiers dans toutes les structures de l'Etat.
Article 4 : Le Secrtariat du Directeur assure la rception et la ventilation du courrier de la
Direction. Avec le Secrtariat Rception - Documentation, il participe la mise en place et la
gestion de la base documentaire de la Direction du Contrle financier.
Article 5 : Le Secrtariat Rception - Documentation est charg de fournir des renseignements sur
l'ensemble du courrier de la Direction et gre concurremment avec le Secrtariat du Directeur la
base documentaire de la Direction. Il tient une situation journalire des arrives et dparts de
courrier ainsi que de la dure de sjour des dossiers en vue d'apprcier les performances de la
Direction et de chacun des Contrleurs.
Article 6 : Sur proposition du Directeur du Contrle financier, les Contrleurs financiers des
dpartements ministriels, des rgions et des grands services de 1 'Etat sont nomms par arrt du
Ministre des Finances et du Plan.
Le Contrleur financier exerce la plnitude de ses attributions en matire de contrle a priori des
actes de dpenses ainsi que des actes incidence financire. Ce contrle porte notamment :
sur l'ensemble des dpenses du dpartement ministriel ou du grand service dont il assure le
suivi sans distinction de 1' origine ou de la catgorie des crdits ;
sur les dpenses des tablissements publics et offices dont la tutelle est assure par le Ministre
qu'il suit et dont les ressources proviennent de subventions de l'Etat ou de concours de l'Etat;
sur les dpenses volet Trsor du budget d'investissement des projets relevant du Ministre
considr;
le Contrleur financier tient la comptabilit des dpenses engages et procde leur
margement.
Il assiste au sein du Ministre aux travaux de toute commission charge d'tudier des questions
incidence financire. Il est membre de droit des commissions primaires des marchs.
Le Contrleur financier est en outre charg du contrle sur place et du contrle physique de toute
acquisition importante du ministre. Il assure le suivi de la comptabilit matire de la structure
contrle.
Article 7 : Le Contrleur financier est tenu de faire un compte rendu mensuel au Directeur du
Contrle financier de ses activits.
Il dresse la fin de chaque trimestre un rapport sur l'tat d'excution du budget qu'il suit et un
rapport gnral d'activits la fin de l'anne.
Le rapport annuel doit faire ressortir en particulier les insuffisances constates ainsi que des
propositions concrtes sur la dtermination et la gestion des crdits budgtaires du ministre.
Article 8 : Les modalits d'exercice du contrle financier et de tenue de la comptabilit des
dpenses engages tant pour le niveau central que pour le niveau rgional feront l'objet
d'instruction du ministre charg des Finances.
Article 9 : Le Secrtaire gnral du Ministre des Finances et du Plan et le Directeur du Contrle
financier sont chargs chacun en ce qui le concerne de 1' excution du prsent arrt qui sera publi
au journal officiel de la Rpublique du Niger.
Ampliations
MF/P/CAB
MF/P/SG
MF IP /Inspection
MF /P /Toutes Directions
Tous Ministres
SGG/JORN
ALMOUSTAPHA SOUMAILA
REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DES FINANCES ET DU
PLAN
Dcret n 93-176/PRN/MF/P
du 3 dcembre 1993
portant organisation et attributions du
Contrle Financier
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la Constitution ;
VU l'ordonnance no 85-032 du 14 novembre 1985 instituant un code des marchs publics;
VU le dcret n 60-55/MFP/T du 30 mars 1960 portant rglementation sur la rmunration et les
avantages divers allous aux fonctionnaires des administrations et tablissements publics de
l'Etat et les textes modificatifs subsquents;
VU le dcret no 89-117/PCMS du 27 avril 1989 portant modalits d'application du code des
marchs, modifi par le dcret no 90-11/PRN du 11 janvier 1990 ;
VU le dcret n 92-036/PM/MF du 24 janvier 1992 portant attributions et organisation de la
Direction gnrale du budget ;
VU le dcret n 93-045/PM/MF/P du 12 mars 1993 portant rglement gnral de la comptabilit
publique;
VU le dcret n 93-003/PRN du 17 avril 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le dcret no 93-147/PRN/MF/P du 15 septembre 1993 dterminant les attributions du
Ministre des Finances et du Plan ;
VU le dcret n 93-148/PRN/MF/P du 15 septembre 1993 portant organisation du Ministre des
Finances et du Plan;
SUR Rapport du Ministre des Finances et du Plan;
le conseil des ministres entendu ;
DECRETE
ARTICLE PREMIER : L'exercice du contrle financier est assur par plusieurs contrleurs
financiers choisis parmi les agents de la catgorie A relevant du cadre du Trsor, ou dfaut, du
cadre de 1' administration gnrale ayant une exprience suffisante en matire de finances publiques.
Les Contrleurs financiers sont rattachs la Direction charge du budget.
Article 2 : Telles que dfinies ci-aprs, les attributions du Contrleur financier s'exercent sur
1' ensemble des dpenses du dpartement ministriel dont il assure le suivi, sans distinction de
1 'origine de la catgorie des crdits.
Le Contrleur financier a la plnitude de contrle sur tous les actes de dpense ou les actes
incidence financire relatifs l'utilisation de ces crdits.
A cet effet, il donne un avis motiv sur les projets de loi, dcret, arrt, contrat, mesure ou dcision
comportant des incidences financires et soumis au contre-seing ou 1' avis du Ministre charg des
Finances, ainsi que sur les propositions budgtaires, les virements, les transferts et les demandes de
crdits additionnels de toute autre nature du dpartement ministriel.
Article 3 : Le Contrleur financier assiste au sein du dpartement ministriel dont il a la charge aux
travaux de toute commission charge d'tudier les questions comportant des incidences financires.
Il est membre de droit de la commission paritaire des marchs.
Article 4 : Le Contrleur financier tient la comptabilit des dpenses engages contradictoirement
avec la comptabilit des dpenses engages du dpartement ministriel considr.
Article 5 :tout acte manant d'un ordonnateur ou de son dlgu et ayant pour effet d'engager une
dpense, est soumis au visa pralable du Contrleur financier.
Ce contrle, qui doit intervenir dans un dlai maximum de 48 heures, porte sur :
la qualit de l'administrateur des crdits ou de son supplant et sur l'authenticit de leur
signature;
l'imputation exacte des dpenses aux chapitres et rubriques qu'elles concernent, selon leur
nature ou leur objet;
l'application des dispositions d'ordre financier et fiscal des lois et rglements;
la production et la rgularit des pices justificatives ;
1' valuation de la dpense ;
l'incidence du projet de dpenses sur les finances publiques;
la disponibilit des crdits et le respect de la rgle de 1' annualit budgtaire.
Si une dpense parat 1' vidence anormale, le Contrleur financier doit attirer 1' attention de
l'administrateur de crdits et au besoin en informer l'ordonnateur dlgu ou l'ordonnateur
principal si ces observations ne sont pas prises en compte.
Le Contrleur financier peut procder sur place 1' examen de la conformit des dossiers qui lui
sont soumis.
Lorsque, sans refuser son visa, le Contrleur financier croit devoir l'assortir d'observations, celles-
ci sont notifies l'autorit qui a initi la dpense.
Il ne peut tre pass outre au refus de visa du Contrleur financier que sur dcision formelle du
ministre charg des finances, notifie au Contrleur financier et l'ordonnateur dlgu.
Toutefois, le Contrleur financier doit refuser une dcision de passer outre lorsque son refus tait
motiv par l'insuffisance de crdits disponibles.
Tout acte de dpense pris sans le visa du Contrleur financier entrane la responsabilit personnelle
et civile de son auteur.
Article 6 : Sauf le cas du pass outre rgulirement notifi au Contrleur financier, aucune
ordonnance, aucun mandat ou titre de paiement ne peut tre sign de l'ordonnateur dlgu s'il n'y
est joint l'acte d'engagement de la dpense vis du Contrleur financier, ou si le mandat n'est pas
conforme l'engagement.
Article 7 : Le Contrleur financier cre une base documentaire par type de dpense relative au
ministre dont il assure le suivi.
En vue de la bonne excution de la dpense, il donne son avis sur la mise en place et la tenue d'une
comptabilit. Il contribue galement la formation des fonctionnaires chargs du suivi de
l'excution de la dpense conformment aux principes de l'orthodoxie budgtaire.
Article 8 : Sans prjudice aux rgles d'utilisation des crdits d'origine extrieure, le Contrleur
financier doit veiller au strict respect de la lgislation nationale, notamment les dispositions du code
des marchs publics.
Article 9 : Pour les besoins de la prparation du budget, le Contrleur financier dresse une situation
priodique de consommation des crdits budgtaires. En fin d'exercice, un rapport dtaill est
obligatoirement tabli.
Article 1 0 : Le contrle exerc par le Contrleur financier s'tend aux dpenses des tablissements
publics et offices dont la tutelle est assure par le ministre qu'il suit ainsi que sur les dpenses des
projets relevant du mme dpartement ministriel. A ce titre, il vise en dbut d'anne les
programmes d'emploi des investissements et leurs modifications.
Article Il : Les Contrleurs financiers sont nomms par arrt du ministre charg des finances. Ils
bnficient des mmes avantages que les directeurs nationaux.
Article 12 : Les Trsoriers dpartementaux assurent les fonctions de contrleurs financiers locaux.
A ce titre, ils confirment par leur visa la validit de la dpense.
En attendant le parachvement de la dconcentration et la mise en place effective des trsoreries
dpartementales, toutes les dpenses sur crdits dlgus sont soumises au visa pralable des
payeurs.
Article 13 : Le prsent dcret abroge le dcret n 60-268/MF du 30 dcembre 1960 portant
organisation du contrle financier et le dcret n 90-0 15/PRN/MF du 11 janvier 1990 portant
dconcentration du contrle financier.
Article 14 : Le Ministre des Finances et du Plan est charg de l'excution du prsent dcret qui sera
publi au journal officiel de la Rpublique du Niger.
Le Premier Ministre
MAHAMADOU ISSOUFOU
Pour ampliation
Le Secrtaire Gnral
du Gouvernement
MOUTARI MOUSSA
Fait Niamey, le 3 dcembre 1993
Le Prsident de la Rpublique
MAHAMANE OUSMANE
Le Secrtaire d'Etat au Budget
MOUDY MOHAMED
DECRET N 68-75/MF DU 21 JUIN 1968
FIXANT LES MODALITES D'EXECUTION DES DEPENSES DE L'ETAT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la Constitution ;
VU la loi n 61-32 du 19 juillet 1961 relative aux lois de finances;
VU le dcret n 60-268 du 31 dcembre 1960 organisant le contrle financier ;
VU le dcret n 60-262 du 12 dcembre 1960 relatif la prparation et l'excution du budget
d'quipement et la procdure d'utilisation des fonds d'investissements nationaux;
VU le dcret n 61-174 du 24 aot 1961 portant application du systme de la gestion, ensemble
les textes qui l'ont modifi et notamment le dcret n 66-133 du 11 aot 1966;
VU le dcret n 65-69 du 12 mai 1965 rglementant les rgies de recettes et de dpenses du
budget de l'Etat;
SUR le rapport du ministre des finances ;
le conseil des ministres entendu ;
DECRETE
ARTICLE PREMIER: L'excution et la comptabilit des dpenses publiques imputables au budget
gnral de l'Etat, aux budgets spciaux et annexes, au fonds d'investissements et aux comptes
spciaux du Trsor sont rglements par les dispositions du prsent dcret.
PREMIERE PARTIE- PRINCIPES GENERAUX
Chapitre 1 - Des ordonnateurs et des comptables publics
Article 2 : Les oprations financires et comptables rsultant de 1' excution des budgets incombent
aux ordonnateurs et aux comptables publics.
Elles sont retraces dans des comptabilits tablies selon des normes gnrales et soumises aux
contrles des autorits qualifies.
Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles.
Article 3 : Le Ministre des Finances est ordonnateur principal du budget gnral de l'Etat, des
budgets annexes ou spciaux, des fonds d'investissement nationaux et des comptes spciaux du
Trsor.
Il peut dlguer ses pouvoirs des ordonnateurs dlgus et des sous-ordonnateurs.
Les ordonnateurs-dlgus prescrivent l'excution des dpenses assignes sur le Trsorier-Payeur,
comptable suprieur du Trsor.
Les sous-ordonnateurs prescrivent l'excution des dpenses sur crdits dlgus. Ces dpenses sont
assignes payables sur le comptable du ressort territorial du sous-ordonnateur.
Lorsqu'il n'existe pas de poste comptable du Trsor dans une circonscription administrative, les
fonctions de comptable sont assumes par un agent spcial. Les dpenses sont dans ce cas
prescrites, sous rserve de rgularisation par 1' ordonnateur :
par le prfet dans le ressort territorial de 1' arrondissement central du dpartement,
par le sous-prfet dans le ressort territorial de chacun des autres arrondissements.
Ces autorits prfectorales agissent comme des sous-ordonnateurs. Les dpenses prescrites dans ces
conditions sur crdits dlgus sont assignes sur 1' agent spcial du ressort territorial du prfet ou
du sous-prfet.
Article 4 : Les ordonnateurs dlgus et les sous-ordonnateurs, ainsi que leurs supplants, doivent
tre accrdits auprs des comptables assignataires des dpenses qu'ils prescrivent et doivent
dposer entre leurs mains le spcimen de leur signature.
Article 5 : Les dpenses des administrations de l'Etat doivent tre prvues leur budget et tre
conformes aux lois et rglements.
Aucune dpense ne peut tre paye par un comptable si elle n'a t engages, liquide, et le cas
chant, ordonnance dans les conditions fixes par le prsent dcret.
Chapitre II- De l'engagement des dpenses
Article 6: L'engagement est l'acte par lequel un service cre ou constate l'encontre de l'Etat une
obligation de laquelle rsultera une charge.
Il ne peut tre pris que par l'autorit qualifie agissant en vertu de ses pouvoirs.
Il doit rester dans la limite des crdits budgtaires et des autorisations de programme rgulirement
prvus par les lois de finances et demeurer subordonn aux autorisations, avis et visas prescrits par
les lois et rglements.
Article 7 : Les Ministres et secrtaires d'Etat ont qualit pour grer les crdits budgtaires de leur
dpartement ministriel affects aux dpenses de matriel et assimils. Le mme pouvoir est
confr aux chefs de service rattachs directement la Prsidence de la Rpublique, pour les crdits
de leur service.
Ils dsignent cet effet des administrateurs de crdits dont la signature engage l'Etat, responsables
par ligne budgtaire de 1 'utilisation de ces crdits.
Ils dsignent de la mme manire des administrateurs de crdits dans les circonscriptions
administratives, pour la gestion des crdits qu'ils dlguent. Toutefois, les autorits prfectorales
vises l'article 3 peuvent procder si besoin est ces dsignations titre provisoire.
Les spcimens de signature des administrateurs de crdits dsigns sont dposs chez l'ordonnateur,
le sous-ordonnateur ou l'autorit prfectorale, selon le cas.
Le service affectataire des crdits que gre 1' administrateur dsign est appel service gestionnaire
des crdits.
Article 8 : Tout acte de dpense est matrialis par un document d'engagement tabli par
1' administrateur des crdits de la rubrique concerne, selon les modalits fixes par le Ministre des
Finances.
Article 9 : Les engagements de dpenses sont soumis au contrle pralable de 1' ordonnateur ou de
l'autorit dlgue par lui.
Ce contrle porte sur :
la qualit de 1' administrateur des crdits et 1' authenticit de sa signature ;
l'imputation exacte des dpenses aux chapitres et rubriques qu'elles concernent, selon leur
nature ou leur objet;
l'application des dispositions d'ordre financier des lois et rglements;
la conformit des dpenses aux besoins du service ;
la production et la rgularit des pices justificatives ;
la disponibilit des crdits.
Article 1 0 : Les administrateurs de crdits tiennent, pour chaque rubrique budgtaire qu'ils grent,
la comptabilit des engagements de dpenses. Les administrateurs de crdits dlgus sont tenus
la mme obligation.
Chapitre III - De la liquidation des dpenses
Article 11 : La liquidation a pour objet de vrifier la ralit de la dette de l'Etat aprs excution des
obligations contractes par le crancier et d'arrter le montant de la dpense. Elle est faite au vu des
titres tablissant les droits acquis aux cranciers.
Sous rserve des exception prvues par les lois et rglements, les liquidations ne peuvent intervenir
avant soit l'excution du service, soit la dcision individuelle autorisant la dpense.
Toutefois, des acomptes et avances peuvent tre consentis dans les conditions rglementaires.
En ce qui concerne la validit de la crance, le contrle porte sur :
la justification du service fait et 1 'exactitude des calculs de liquidation ;
l'intervention pralable des contrles rglementaires et de l'engagement comptable.
Article 12 : Les comptables des matires dans chaque service sont responsables de la prise en
charge des matriels et matires qui doivent tre ports en compte l'inventaire.
Ils tiennent cet effet le journal des prises en charge et les documents comptables prvus au dcret
no 64-191/MFAE du 9 octobre 1964.
Les matires consommables, lorsqu'elles sont mises en approvisionnement, sont prises en charge
1' inventaire.
Les matires mises en consommation immdiate ne donnent pas lieu prise en charge.
Article 13 : L'administrateur des crdits atteste le service fait et le cas chant, la rfrence de la
prise en charge.
Il s'assure au pralable de la conformit de la fourniture aux spcifications de la commande et au
dtail de la facturation.
La certification du service fait est appuye, le cas chant, du procs-verbal de rception pour toutes
les fournitures effectues en excution d'un march et pour les matriels devant donner lieu des
essais de fonctionnement lors de la rception.
La certification du service doit, dans tous les autres cas, tre appuye des pices justificatives
complmentaires prvues par les rglements et notamment, pour les achats de vivres mis la
consommation, d'un tat des rationnaires.
Chapitre V- De l'ordonnancement des dpenses
Article 14: L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformment aux rsultats de la
liquidation, l'ordre au comptable de payer la dette de l'Etat.
Il est matrialis par l'mission d'un mandat accompagn d'un titre de paiement. Des procdures
particulires peuvent toutefois remplacer la procdure du mandat lorsque sont utiliss des moyens
mcanographiques. Ces procdures sont dcrites dans la deuxime partie du prsent dcret.
Les titres de paiement mis par l'ordonnateur et assigns sur la caisse du comptable de sa rsidence
sont:
soit des ordres de virement,
soit des bons de caisse payables en espces,
soit des ordres de paiement si la dpense est imputable un compte spcial.
Article 15 : Les dpenses effectues sur crdits dlgus dans les circonscriptions administratives
dpourvues de poste comptable du Trsor, assignes sur un agent spcial, font l'objet d'un
ordonnancement de rgularisation aprs paiement.
Chapitre VI - Du paiement des dpenses
Article 16 : Le paiement est l'acte par lequel l'Etat se libre de sa dette. Il est effectu par le
comptable assignataire.
Article 17 : Le paiement des bons de caisse et ordres de paiement est fait par remise d'espces
contre acquit du bnficiaire.
Les paiements par virement bancaire ou postal sont effectus par remise de chques
l'tablissement payeur. Les comptables du Trsor sont seuls pouvoir utiliser ces procdures de
rglement. Les agents spciaux, agents intermdiaires du Trsor, ne peuvent effectuer de rglements
qu'en espces ou par mandat postal.
Lorsqu'une loi l'autorise, certaines dpenses peuvent tre payes par remise de valeurs publiques,
effets de commerce ou autres moyens.
Des rgisseurs peuvent tre chargs pour le compte de comptables du Trsor, d'oprations de
paiement, au moyen d'avances dont ils ont justifier l'emploi. Les rgies de dpenses fonctionnent
conformment aux rgles fixes par dcret pris en conseil des ministres.
Article 18: Le rglement d'une dpense est libratoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de
rglement prvus 1' article prcdent en faveur du crancier ou de son reprsentant qualifi.
Article 19 : Les titres de paiement sont pays au net, aprs application des prcomptes et
oppositions lgales par le comptable.
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrter un paiement doivent tre faites
entre les mains du comptable assignataire de la dpense.
Article 20 :Le nantissement des marchs publics fait l'objet d'une rglementation particulire.
Article 21 : Lorsque le crancier refuse de recevoir le paiement, la procdure d'offres relles est
excute.
Article 22 : Sont prescrites et dfinitivement teintes au profit de l'Etat, sans prjudice des
dchances prononces par des lois et rglements antrieurs ou consentis par des marchs et
conventions, toutes crances qui, n'ayant pas t acquittes avant la clture de l'exercice auquel
elles appartiennent, n'auraient pu tre liquides, ordonnances ou payes dans un dlai de quatre
annes partir de 1' ouverture de cet exercice.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux crances dont l'ordonnancement et le paiement
n'auraient pu tre effectus dans les dlais dtermins par le fait de l'administration ou par suite de
recours devant une juridiction.
DEUXIEME PARTIE- DEPENSES DES ADMINISTRA TI ONS CENTRALES
Chapitre VII - Engagement
Article 23 : Le Ministre des Finances opre le contrle pralable des engagements par l'organe
spcialis du service du contrle financier. Il dfinit les actes de dpenses qui, en raison de leur
importance, doivent obligatoirement recevoir le visa du contrle sur le document d'engagement.
Le comptable peut tre appel concourir au visa de certains actes de dpenses au stade de
l'engagement, dans les conditions dtermines par instruction du Ministre des Finances.
Article 24 : Les documents d'engagement doivent t ~ appuys de toutes pices justificatives
ncessaires et notamment :
pour les appels d'offres:
avis d'appel d'offres
pour les projets de marchs:
procs-verbal de dpouillement des offres
cahier des charges
bordereau des prix
pour les projets de contrats, convention, bail, etc. :
exemplaires originaux des contrats, conventions ...
fiche valuative des dpenses annuelles
pour les baux et contrats en cours reconduits sur un nouvel exercice :
copie conforme des baux et contrats
fiche valuative des dpenses annuelles
pour les fournitures sur abonnements :
mention de rfrence aux contrats d'abonnements
fiche valuative des dpenses annuelles
pour la constitution des caisses d'avances:
ampliation de l'arrt instituant la rgie
ampliation de l'arrt dsignant le rgisseur.
Article 25 : Aucun engagement de dpense ne peut tre admis s'il est suprieur au montant des
crdits disponibles de la rubrique d'imputation budgtaire.
L'ordonnateur rgle le rythme des engagements de dpenses au cours de l'anne budgtaire.
A cet gard, les actes de dpenses sont classes en :
dpenses provisionnelles ou permanentes
dpenses courantes ou ventuelles
Par dpenses provisionnelles ou permanentes, il faut entendre les dpenses qui donnent lieu
1' engagement en une seule fois des crdits qui leur sont affects pour 1' anne budgtaire. Il en est
ainsi des marchs, des dlgations de crdits, des constitutions d'encaisses de rgies d'avances, des
provisions constitues pour excution de baux, de contrats, de polices d'abonnement, des oprations
relatives la dette publique.
Seules, les dpenses courantes ou ventuelles sont soumises au contrle du rythme de
consommation des crdits.
Les rejet pour absence ou insuffisance de crdits ne peut tre surmont tant qu'un remaniement
budgtaire n'a pas ouvert la rubrique d'imputation des crdits supplmentaires permettant de
couvrir la dpense en cause.
Le rejet pour dpassement du coefficient de consommation des crdits est temporaire. Il est lev
l'expiration du dlai qui permet l'admission de la dpense.
Article 26 : En cas de ncessit, l'ordonnateur procde d'office l'engagement des crdits
ncessaires la couverture d'obligations conventionnelles ou contractuelles ou de dettes se
rapportant des engagements antrieurs ayant donn lieu reports en fin de gestion.
Article 27 : Les actes de dpenses des administrations centrales admis l'engagement donnent lieu
1' mission de documents de confirmation qui sont :
le titre de crance, destin au fournisseur ou bnficiaire ;
le document de certification, destin au service gestionnaire de crdits.
Les marchs, contrats, conventions, etc. et les actes administratifs comportant autorisation de
dpenses doivent obligatoirement tre accompagns de ces documents lorsqu'ils sont soumis
l'autorit habilite les signer.
Le document d'engagement est remis au fournisseur bnficiaire en double exemplaire avec le titre
de crance.
L'Etat n'est engag vis--vis des tiers que par le titre de crance sans lequel aucun rglement ne
sera effectu.
Chapitre VIII - Liquidation
Article 28: La liquidation ne peut intervenir qu'au vu:
de l'original de la facture du fournisseur, ou de toute pice justificative de la dpense (tat,
dcision, etc. ;
d'un exemplaire du document d'engagement, s'il s'agit d'un premier rglement se rapportant
un acte de dpense dtermin ;
du titre de crance vis l'article 27 dment rempli par le fournisseur ou bnficiaire, et qui
constitue la pice comptable par laquelle le titulaire fait valoir ses droits ;
un docment de certification du service fait, dment valid par l'administrateur des crdits.
Aucun rglement ne peut tre effectu en l'absence des documents ci-dessus viss.
Article 29 : Le titre de crance accompagn des pices justificatives dment liquid est soumis au
visa du comptable suprieur, pralablement l'mission du titre de paiement.
Le contrle du comptable porte sur la validit de la crance dans les conditions prvues 1' article
11 et sur le caractre libratoire du rglement.
Lorsque, 1' occasion de 1' exercice de son contrle, le comptable constate des irrgularits ou peut
tablir que les certifications vises l'article 13 sont inexactes, il suspend le visa et en informe
1' ordonnateur.
Article 30: Lorsque le comptable a, conformment aux dispositions de l'article prcdent, suspendu
son vis, l'ordonnateur peut le requrir de payer. Dans ce cas, la responsabilit personnelle de
l'ordonnateur est substitue celle du comptable qui annexe la rquisition au titre de crance.
Toutefois, le comptable doit refuser de dfrer aux ordres de rquisition lorsque la suspension de
paiement est motive par :
l'indisponibilit des crdits ;
1' absence de justification du service fait ;
le caractre non libratoire du rglement.
Chapitre IX- L'ordonnancement et le paiement
Article 31 : Le titre de paiement est tabli au vu du titre de crance dment liquid et vis du
comptable, et qui sert de pice justificative de la dpense.
Article 32 : Les titres de paiement mis sont rcapituls journellement sur des bordereaux de
rglement raison d'un bordereau par mode de rglement et tablissement payeur.
Ils sont reprise sur un bordereau d'mission auquel sont joints les titres de crance et les originaux
des pices justificatives, annexes, raison d'un bordereau par budget ou compte spcial.
Article 33 : L'ordonnateur signe les bordereaux d'mission, les bons de caisse et les ordres de
paiement.
Le comptable suprieur, aprs application sur les titres de paiement des oppositions ventuelles au
paiement prend les bons de caisse et ordres de paiement payables sur sa caisse ou sur la caisse d'un
autre comptable public.
TROISIEME PARTIE- DEPENSES SUR DELEGATION DE CREDITS
Chapitre X- Engagement
Article 34 : Les crdits sont dlgus dans les circonscriptions administratives sous forme
d'autorisation de dpenses tablies par rubrique budgtaire, et destines au service bnficiaire.
Elles sont notifies au prfet, sous-prfet ou sous-ordonnateur concern, ainsi qu'au comptable
assignataire (payeur ou agent spcial).
Un titre de mise en apurement est tabli pour chaque autorisation de dpense. Il est conserv par
1 'ordonnateur pour servir de pice de mandatement des dpenses aprs centralisation et vrification
des pices justificatives des paiements effectus par le comptable assignataire.
Article 35 : Tout acte de dpense imputable sur crdits dlgus est matrialis par un document
d'engagement tabli par l'administrateur des crdits dlgus selon les modalits fixes par le
Ministre des Finances. Ce document doit tre approuv par le sous-ordonnateur ou par 1' autorit
prfectorale habilit conformment aux rgles poses l'article 3, et vis par le comptable
assignataire.
Les engagements doivent tre appuys de toutes les pices justificatives ncessaires produites en
original : devis, tats des salaires, etc. ou de toutes rfrences aux contrats en cours.
Le prfet, sous-prfet, ou sous-ordonnateur, selon le cas, tient la comptabilit des engagements de
dpenses par rubrique budgtaire. Il s'assure, avant de viser le document d'engagement, que 1' acte
de dpense est rgulier et reste dans la limite des disponibilits sur autorisations de dpenses
compte tenu des engagements antrieurs. Le comptable assignataire confirme, par son visa, la
disponibilit des crdits.
L'Etat n'est engag que par le document d'engagement rglementaire tabli et vis dans les
conditions sus-dites sous la responsabilit des fonctionnaires habilits.
Chapitre XI - Liquidation
Article 36: Le duplicata du document d'engagement remis au fournisseur ou bnficiaire constitue
le titre de crance par lequel celui-ci fait valoir ses droits, et sans lequel aucun rglement ne peut
tre effectu.
Il doit tre joint l'appui de la facture originale du fournisseur.
Article 37: Le document d'engagement sus-vis reoit:
la certification du service fait par 1' administrateur des crdits ;
la liquidation de la dpense par le prfet, sous-prfet ou sous-ordonnateur selon le cas.
Chapitre XII - Ordonnancement
Article 3 8 : Dans les centres de sous-ordonnancement, le sous-ordonnateur tablit un mandat et un
titre de paiement au nom du crancier, auquel est joint le document d'engagement vis l'article
prcdent, dment liquid, et la facture du fournisseur ou la pice justificative en original.
Les mandats mis dans une journe par le sous-ordonnateur sont transmis au comptable assignataire
sous bordereau d'mission, accompagns des titres de paiement.
Chapitre XIII - Paiement
Article 39 :Les agents spciaux payent les dpenses effectues sur crdits dlgus au vu:
du document d'engagement dment revtu de la certification du service fait et liquid par
l'autorit prfectorale;
de la facture du fournisseur (ou de toute pice justificative en tenant lieu : feuille de salaire, tat,
etc.).
Article 40 : Avant de procder au paiement, 1' agent spcial contrle la validit de la crance,
conformment aux dispositions de 1' article 11. Son contrle porte galement :
sur la qualit et 1' authenticit des signatures des autorits ayant appos leurs v1sas et
certifications ;
sur l'identit du crancier.
Article 41 : L'agent spcial reoit l'acquit du crancier sur le document d'engagement servant de
titre de crance. En cas de rglement par mandat postal ou par recette de contrepartie, il en fait
mention sur le document d'engagement dans la case rserve cet effet.
Chapitre XIV - Centralisation des dpenses sur crdits dlgus
Article 42 : Les dpenses effectues sur dlgations de crdits sont centralises mensuellement au
Ministre des Finances. Les agents spciaux adressent au comptable suprieur, l'appui de leur
comptabilit mensuelle, les pices de rglement prvues l'article 39 dment liquides et
acquittes, accompagnes des pices justificatives.
Le comptable subordonn du Trsor prs d'un centre de sous-ordonnancement dresse un bordereau
sommaire mensuel par rubrique budgtaire des rglements effectus sur sa caisse. Il transmet
mandats et pices de rglement au comptable suprieur pour tre annexs son compte de gestion.
Article 43 : Les bordereaux sommaires des comptables subordonns sont rattachs au titre de mise
en apurement pour permettre la comptabilisation centrale des oprations qu'ils dcrivent.
Article 44 : Les pices de dpenses des agences spciales sont rattaches au titre de m1se en
apurement, aprs contrle de leur rgularit.
Toute dpense en dpassement des crdits dlgus fait l'objet d'un rejet qui devra tre rgularis
par les formes rglementaires.
Les titres de mise en apurement appuys des pices justificatives constituent les pices de rglement
dfinitif l'ordre du comptable suprieur. Ils sont repris dans les bordereaux d'mission de la
journe et transmis au comptable suprieur pour tre annexs son compte de gestion.
QUATRIEME PARTIE- COMPTABILITE CENTRALE ET DISPOSITIONS FINALES
Article 45 : Les dispositions qui prcdent s'appliquent aux dpenses de matriel et assimiles.
Les crdits affects aux dpenses de solde et accessoires de solde du personnel sont grs par le
Ministre des Finances ou sous son contrle direct.
Les ministres tiennent les tableaux des effectifs des services de leur dpartement ministriel.
Les dpenses relatives la solde s'excutent selon les principes dfinis au prsent dcret. Les
modalits d'excution prvues au prsent dcret reoivent les adaptations ncessites par la nature
particulire de ces dpenses et l'utilisation de moyens mcanographiques appropris.
Article 46 : La comptabilit centrale des oprations budgtaires de dpenses est tenue au Ministre
des Finances au moyen de procds mcanographiques. Elle est commune pour l'ordonnateur et
pour le comptable.
Elle a pour objet la description et le contrle des oprations ainsi que l'information des autorits de
contrle et de gestion.
Elle fait ressortir, par rubrique budgtaire, les crdits ouverts, les engagements de consommation
des crdits.
Elle est tenue par gestion et comprend les oprations rattaches au budget de 1' anne en cause
jusqu' la clture de ce budget.
Article 4 7 : Il est mis mensuellement une situation dtaille de 1' excution des dpenses.
Les comptes budgtaires sont arrts dfinitivement la fin de la priode d'excution du budget,
dans les conditions prvues par la loi.
Article 48 : Le comptable transmet au juge des comptes, 1' appui de son compte de gestion annuel,
les pices justificatives prvues par le prsent dcret.
Article 49 : Le Ministre des Finances fixe, en tant que de besoin, par instructions, les modalits
d'application du prsent dcret, qui prendra effet pour compter du 1er octobre 1967.
Article 50 : Les dispositions rglementaires contraires au prsent dcret sont abroges.
Article 51 : Le Ministre des Finances est charg de 1' excution du prsent dcret qui sera publi par
procdure d'urgence et insr au Journal Officiel de la Rpublique du Niger.
Fait Niamey, le 21 juin 1968
Pour le Prsident de la Rpublique,
Le Ministre de l'Intrieur,
charg de 1' intrim
DIAMBALA Y ANSAMBOU MAI GA
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE .................. .
Direction ....................... .
Service ......................... .
Projet. .......................... .
Exercice ....................... .
FICHE A DE CONTRLE D'EXECUTION DES DEPENSES PUBLIQUES
__ __q!:l __________________________ _
__ __q!:l __________________________ _
__
i Raison sociale i Facture N" ............... du
r-N-u-m-r-<ffi_ri_tftlcatlon-i=Tscae _____________________________________________________________ _______________________ _
i _________________________________________________________________________________________________________________________ __ __________________________________________________________ _
AC CF cc
Oui Non Oui Non Oui Non
Contrle avant engagement
Conformit nature de la dpense l'imputation budgtaire
Disponibilit de crdits
Signature de l'Administrateur de crdits
Exactitude des calculs
Conformit au rpertoire des prix
Conformit au code des marchs publics
Numro d'identification fiscale (NIF)
Visa du contrleur financier
Contrle de liquidation
Conformit bon de commande et facture dfinitive
Conformit livraison et commande
Facture dfinitive certifie du service fait
Bordereau de livraison
Procs verbal de rception
Etat des rationnaires
Liste des bnficiaires
Etat de paiement
Prise en charge en comptabilit matire
Exactitude des calculs de liquidation
Projet de dcision de mandatement
Visa du Contrleur Financier
Observations de l'Administrateur des Crdits (AC)
Observations du Contrleur Financier (CF)
Observations de Chef du Centre Comptable (CC)
EXTRAIT DU DECRET N 93-045/PM/MF/P DU 12 MARS 1993 PORTANT
REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
Article 7 : Les ordonnateurs et le cas chant, les administrateurs de gestion sont
responsables des certifications qu'ils dlivrent.
Article 11 : Les comptables publics sont seuls chargs :
- de la prise en charge et du recouvrement des rles et des ordres de recettes qui leur
sont remis par les ordonnateurs, des crances constates par un contrat, titre de
proprit ou tout autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de
1 'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes sont habilits recevoir ;
- du paiement des dpenses, soit sur ordres manant des ordonnateurs accrdits ;
soit au vu des titres prsents par les cranciers, soit de leur propre initiative, ainsi
que de la suite donner aux oppositions et autres significations ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confis aux
organismes publics ;
- du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilits ;
- de la conservation des pices justificatives des oprations et des documents de
comptabilit ;
- de la tenue de la comptabilit du poste comptable qu'ils dirigent;
- de l'tablissement des comptes de fin d'anne.
Article 12 :Les comptables sont tenus d'exercer: ........................................ ..
B) En matire de dpenses ; le contrle :
- de la qualit de 1' ordonnateur ou de son dlgu, et de 1' administrateur de crdits ;
- de la disponibilit des crdits ;
- de l'exacte imputation des dpenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur
nature ou leur objet ;
- de la validit de la crance dans les conditions prvues l'article 13 ci-aprs;
- du caractre libratoire du rglement ;
2
Article 13 : En ce qui concerne la validit de la crance, le contrle porte sur :
la justification du service fait et 1 'exactitude des calculs de liquidation ;
- 1' intervention pralable des contrles rglementaires et la production des
justifications.
En outre, dans la mesure o les rgles propres chaque organisme public, le
prvoient, les comptables publics vrifient 1 'existence du visa du contrleur financier
sur les engagements mis par les ordonnateurs.
Les comptables publics vrifient galement l'application des rgles de prescriptions
et de dchance.
Article 19 : Les comptables publics sont personnellement et pcuniairement
responsables des oprations dont ils sont chargs au terme de l'article 11 ci-dessus,
ainsi que de l'exercice rgulier des contrles prvus aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Article 28 : Avant d'tre payes par un comptable, les dpenses sont engages,
liquides et, le cas chant ordonnances.
Article 29 : L'engagement comporte deux phase : 1' engagement juridique et
1 'engagement comptable.
- L'engagement juridique est 1' acte par lequel un organisme public cre ou constate
son encontre une obligation de laquelle rsultera une charge.
Il ne peut tre pris que par le reprsentant qualifi de 1' organisme public agissant en
vertu de ses pouvoirs.
Il doit rester dans la limite des autorisations budgtaires et demeurer subordonn aux
autorisations, avis ou visas prvus par les lois, ordonnances ou rglements propres
chaque catgorie d'organismes publics.
- L'engagement comptable est 1' affectation des crdits budgtaires ncessaires la
ralisation d'une dpense donne qui rsulte de l'engagementjuridique.
Article 30 : La liquidation a pour objet de vrifier la ralit de la dette et d'arrter le
montant de la dpense. Elle est faite au vu des titres tablissant les droits acquis aux
cranciers.
Article 31 : L'ordonnancement est 1' acte administratif donnant, conformment aux
rsultats de la liquidation, 1' ordre de payer la dette de 1' organisme public.
3
Article 33 :Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libre de sa dette.
Sous rserve des exceptions prvues par les lois, ordonnances ou rglements, les
paiements ne peuvent intervenir avant, soit 1 'chance de la dette, soit 1 'excution du
service, soit la dcision individuelle d'attribution de subventions ou allocations.
Toutefois, selon les rgles propres chaque catgorie d'organisme public, des
acomptes et avances peuvent tre consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs
fournisseurs et prestataires de service.
Article 34 : Les rglements de dpenses sont faits par remise d'espces, de chques
ou par virement bancaire ou postal.
Toutefois, certaines dpenses peuvent tre rgles par remise de valeurs publiques,
effets de commerce ou autres moyens prvus par les lois, ordonnances ou rglements.
Article 35 : Le rglement d'une dpense est libratoire lorsqu'il est fait selon des
modes de rglement prvus 1' article prcdent au profit du vritable crancier ou de
son reprsentant qualifi.
Les cas dans lesquels les rglements peuvent tre faits entre les mains de personnes
autres que les vritables cranciers sont fixs par arrt du ministre charg des
finances.
Article 37 :Lorsque, l'occasion de l'exercice du contrle prvu l'article 12 (alina
B) ci-dessus, des irrgularits sont constates, les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l'ordonnateur.
Les paiements sont galement suspendus lorsque les comptables publics ont pu
tablir que les certifications mentionnes 1' article 7 ne sont pas conformes la
ralit.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But- Une Foi
COUR DES COMPTES
Arrt no 08 du 22 juin 2005
Affaire no 3/GF/99
Formation
Prsident
M. Moustapha GUEYE, prsident de
chambre;
Conseillers
MM. Vincent GOMIS, conseiller
rfrendaire ;
Hamidou AGNE, conseiller
rfrendaire, rapporteur ;
Joseph NDOUR, conseiller
rfrendaire ;
Mamadou NDONG, conseiller;
Boubacar TRAORE, conseiller ;
Malick L Y, conseiller ;
Amadou BA MBODJI, conseiller;
Ahmadou Lamine KEBE, conseiller ;
Cheikh Issa SALL, conseiller.
Ministre public
M. Abdourahmane DIOUKHANE,
Commissaire du Droit
Greffier
Me Jean DACOSTA
Audience
Du 22 juin 2005
Matire:
Gestion de fait
Organisme:
Commune d'arrondissement de
Grand-Dakar
Gestion : 1999
Nature de l'arrt :
Arrt dfinitif
Dcision:
Non-lieu
CHAMBRE DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET DES
COLLECTIVITES LOCALES
Au nom du Peuple sngalais
L'an deux mille cinq et le vingt deux
juin, l'audience non publique de la
Chambre des Affaires administratives
et des Collectivits locales, statuant en
matire de gestion de fait ;
LA COUR
Vu la loi organique no 96-30 du 21
octobre 1996 sur le Conseil d'Etat
modifie par la loi organique no 99-70
sur la Cour des Comptes et la loi
organique no 99-72 du 17 fvrier 1999
sur le Conseil d'Etat;
Vu la loi organique no 99-70 du 17
fvrier 1999 sur la Cour des Comptes ;
Vu la loi no 96-06 du 22 mars 1996
portant Code des Collectivits locales ;
Vu la loi no 96-09 du 22 mars 1996
fixant l'organisation administrative et
financire de la commune
d'arrondissement et ses rapports avec
la ville;
Vu le dcret no 62-0195 du 17 mai
1962 portant rglementation
concernant les comptables publics ;
Vu le dcret no 66-458 du 17 juin 1966
portant rglement sur la comptabilit
publique de l'Etat, modifi ;
Vu le dcret no 66-510 du 04 juillet
1966 portant rgime financier des
collectivits locales ;
Vu le dcret no 99-499 du 8 juin 1999
fixant les modalits d'application de la
loi organique no 99-70 du 17 fvrier
1999 sur la Cour des Comptes ;
Vu l'arrt provisoire n3/2001 du 26
avril 2001 de la Cour des Comptes ;
Vu l'ordonnance no 0001/CC/CAACL
du 17 fvrier 2003 du Prsident de la
Chambre des Affaires administratives et des Collectivits locales portant nomination
d'un rapporteur en la personne de Monsieur Hamidou AGNE ;
Vu le rapport no 069 du 09 janvier 2004 du conseiller rapporteur ;
Vu les conclusions no 116 du 24 fvrier 2005 du Commissaire du Droit, ministre
public prs la Cour des Comptes ;
Entendu M. Hamidou AGNE, conseiller rfrendaire, en son rapport ;
Entendu M. Abdourahmane DIOUKHANE, Commissaire du Droit, en ses
observations orales ;
Entendu Monsieur Moustapha GUEYE, prsident de chambre, contre- rapporteur,
en ses observations ;
Aprs en avoir dlibr conformment la loi ;
Considrant que par arrt no 3/2001 du 26 avril 2001 la Cour avait dclar la
procdure rgulire ;
Considrant que par le mme arrt, elle avait, titre provisoire, dclar M.
Ahmadou! Mbackiou FAYE et Mmes A'ida FAYE, Fama DIOP et Aminata Diye
SALLA comptables de fait en leur enjoignant de produire dans le dlai de deux mois
suivant la notification de l'arrt un compte d'emploi des sommes indment manies
par eux, avec toutes les pices justificatives utiles sous peine de restitution des
sommes dont l'emploi n'aura pas t justifi;
Considrant que l'article 74 de la loi organique no 99-70 du 17 fvrier 1999 sur la
Cour des Comptes dispose que ... les arrts et actes de la juridiction sont signifis
par exploit d'huissier ... ;
Considrant qu'en application de cette disposition, l'arrt no 3/2001 rendu par la
Chambre des Affaires administratives et des Collectivits locales a t signifi
respectivement M. Ahmadou! Mbackiou FAYE et Mmes A'ida Faye et Fama DIOP,
le 6 aut, le 23 juin et le 25 juin 2003 par Me Yacine NDIAYE SENE, Huissier de
justice, au 88, rue Flix Faure Dakar ;
Qu'en ce qui concerne Mme Aminata Diye SALLA, c'est Me Bernard SAMBOU,
Huissier de justice, au 47, rue El Hadji Mbaye GUEYE ex- rue Sandiniry Dakar,
charg de la signification qui a constat son absence suivant procs-verbal du 10
janvier 2003 ;
Qu'ainsi la preuve de la signification de l'arrt aux personnes concernes, sauf la
dame SALLA, ne souffre d'aucun doute;
Considrant qu'il est tabli que M. FAYE et ses collaboratrices ont irrgulirement
recouvr des recettes pour un montant de 937 500 F tires du placement de tickets
de march l'insu du Receveur municipal ;
Que cependant, il rsulte des pices verses au dossier, en particulier le bordereau
de versement no 003 du 23 fvrier 1999, l'tat de versement sur bulletin de
liquidation de recette et la dclaration de recette no 0066181 du 6 dcembre 2001
dlivre par la Recette Perception municipale de Dakar que Mme Aminata Diye
SALLA, grante de la rgie intermdiaire de recettes, a vers la Recette Perception
municipale de Dakar la somme de 937 500F, en cause;
Qu'en dfinitive, la Commune d'arrondissement de Grand-Dakar n'a subi aucun
prjudice de ce maniement de fonds, dont par ailleurs il n'a pas t prouv qu'il ait
t fait de mauvaise foi ;
Considrant par ailleurs qu'en acceptant de recevoir la somme prcite dans ses
caisses et en lui dlivrant la dclaration de recette correspondante avant l'ouverture
de la procdure et en la prenant en charge dans sa comptabilit, le comptable patent
s'est substitu aux mis en cause et, par ce fait, est seul habilit compter devant la
Cour.;
Qu'il n'y a pas lieu, par consquent, de constituer M. FAYE et autres comptables de
fait;
PAR CES MOTIFS
ARRETE
A titre dfinitif
Article unique : Il n'y a pas lieu de constituer comptables de fait M. Ahmadou!
Mbackiou FAYE, Mmes Aida FAYE, Fama DIOP et Aminata Diye SALLA.
Ainsi fait, jug et prononc les jour, mois et an ci-dessus.
Ont sig:
Prsident
M. Moustapha GUEYE, prsident de chambre ;
Conseillers
MM. Vincent GOMIS, conseiller rfrendaire;
Hamidou AGNE, conseiller rfrendaire, rapporteur ;
Boubacar TRAORE, conseiller ;
Malick L Y, conseiller;
Amadou BA MBODJI, conseiller;
Ahmadou Lamine KEBE, conseiller ;
Cheikh Issa SALL, conseiller.
Avec l'assistance de Matre Jean DACOSTA, greffier.
Le prsent arrt a t sign par le prsident et le greffier.
3
::- REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple- Un But- Une Foi
No CC/CD
------
COUR DES COMPTES Dakar, le
Le Commissaire du Droit
Note sur la question de l'tat d'examen
des comptes de gestion transmis la Cour
La question de l'tat d'examen des comptes de gestion transmis la Cour
a t discute lors de la Confrence des Prsidents et du Commissaire du Droit
du 07 mars 2007.
La 1re chambre et la 2e chambre de la Cour ayant des positions
divergentes sur la question, il apparat ncessaire d'y revenir dans cette prsente
note pour donner des illustrations jurisprudentielles sur certains points avancs
lors de cette rencontre.
La question se pose de la mme faon pour les deux chambres concernes
car il s'agit de comptes dposs mais non appuys de certaines pices gnrales,
de budget ou de compte pour la 2e chambre et de certificats expliquant des
discordances dans la reprise des soldes entre des exercices, pour la 1re chambre.
Si le juge des comptes a parfois rejet des comptes de gestion qui
n'taient pas en tat d'examen (voir, par exemple, CCF, 26 octobre 1999) et si la
d
' . . d . t ' t ' ' ' ' 1 ,...
ec1s10n e re1e n es pas reservee qu aux cas oue compte peut etre
complt par exemple, conclusions sur CRC
Languedoc-Roussillon, jugement n2001-0218 du 19 avril 2001), il fait souvent tl
preuve de beaucoup de souplesse en acceptant d'examiner des comptes non R
appuys de pices gnrales.
A titre d'exemples de pices gnrales dont l'absence n'a pas conduit au
rejet du compte, on peut citer le compte administratif prvu, en France, dans la
liste des pices gnrales, par la Ml4. En rponse au jugement provisoire d'une
CRC qui avait examin un compte non appuy de cette pice, le comptable
concern avait rpondu qu'il sera produit ultrieurement. La Chambre avait
formul une rserve sur sa gestion, lors du jugement dfinitif puisque le compte
administratif n'tait toujours pas produit (CRC de Provence-Alpes-Cte d'Azur,
jugent n2001-1018 du 6 novembre 2001, Commune de Trans-en-Provence).
Il en est de mme des tats de l'actif (voir conclusions sur le jugement
prcit de la CRC de P ACA).
Le juge des comptes adopte la mme dmarche concernant la reprise des
soldes (voir CCF, formation inter chambres d'appel du 29 juin 1995). C'est dire
que 1' attitude -franais consiste maintenant rclamer la
pice par voie d'injonction et formuler une rserve sur la gestion du
1
comptale tanLqQ. a as t produite. Il faut prciser que si la pice
gnrale manquante est produite et que le juge des comptes dcouvre
ultrieurement des irrgularits sur la gestion concerne, il pourra toujours
prononcer des charges l'encontre du comptable (technique des charges dites
tardives ), puisque sa comptence ne s'puise qu'avec la dcharge accorde au
comptable (CCF, arrt n2897526 du avril 2001, Collge Jacques-Prvert
Marseille,).
Il faut aussi prciser que le juge des comptes peut lever la rserve
prononce sur stion d'un comptable, mme si la pice n'est pas produite car
la rce majeure eut expliquer J'impossibilit pour un comptable de produire
----- -----
n ~ t e (Conclusions sur le jugement de la CRC Languedoc-
Rouss' ' ' .
intrt de cette dmarche pour notre Cour des comptes et de perme r 1
de dpasser le stade de rejet systmatique de beaucoup de comptes au niveau de !
la 2e Chambre et de rgler le problme de l'ingalit de traitement entre les i
comptables, la mme situation de fait entranant la mise en route de procdur-es j
d'amendes seulement pour des comptables de la 2e Chambre. __}
~ --------------------------------------....... . ____., __ _
Abdourahmane DIOUKHANE
2
E.R.SU.MA.
FORMATION DES MAGISTRATS DES JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES ET
REGIONNALES DE L'ESPACE OHADA
du 26 au 30 octobre 2009
Thme : Le contrle administratif et juridictionnel des finances publiques
CAS PRATIQUE N1
L'instruction pour un rapport fin d'arrt provisoire d'un dossier relatif un compte de
gestion d'un comptable d'une commune donne les constatations suivantes:
1. le compte de gestion a t renvoy une premire fois pour rgularisation et
qu'il manque toujours le compte administratif du maire l'appui du compte.
A cours de 1' instruction, le comptable dclare que ses dmarches auprs de
1' ordonnateur ont t vaines, ce dernier faisant savoir qu'il est impossible
d'tablir le compte administratif.
2. Un march a t affect en nantissement une institution financire et
1' exemplaire du march appuy de 1' acte de nantissement ont t remis au
comptable qui a directement rgl 1' entreprise adjudicataire du march la
somme de 60 millions de francs.
Au cours de l'instruction, le comptable a justifi ce paiement par le fait qu'il
n'a pas reu de demande manant du crancier nanti et que la commune n'a
pas t amene payer deux fois.
3. Des primes et des indemnits ont t payes des agents qui n'y avaient pas
droit car cela conduisait un cumul avec un avantage dont ils bnficiaient
dj. Durant le droulement de la procdure, la lgislation a chang et le cumul
est dsormais autoris. Le comptable a fait valoir cet argument.
4. Le comptable a pay une facture au taux de 8% de TV A alors que le CGI
prvoyait un taux de 5%. Pour sa dfense il soutient qu'il n'avait fait
qu'appliquer le taux de TV A prvu par le march qui tait excutoire et qu'il
excdait sa comptence d'en discuter la lgalit interne.
5. On relve que :
-x avait un crdit d'impt qu'il dtenait sur la commune;
-le 12 avril1990, il cda une banque une crance correspondant au
montant de ce crdit ;
-le 19 juin 1990, il formula une demande de restitution d'impt;
- le 05 juin 1992, le chef des services fiscaux a mis un ordre de
restitution au profit de X,
- le 11 juin 1992, la somme de 2410 218 F a t vire sur un compte
bancaire que X venait d'ouvrir
- le 14 septembre 1992, la banque fait valoir devant le comptable que X lui
avait cd la crance le 12 avril 1990 et que la somme qui lui avait t
paye devait lui tre restitue.
Pour se justifier le comptable rpondit qu'il ignorait l'existence de ce transport de
crance au moment o il a effectu le paiement
6. Nouvellement affect un autre poste comptable au quel il a t adjoint un
autre poste, malgr 1' insuffisance des moyens et la dfectuosit du systme
1
E.R.SU.MA.
FORMATION DES MAGISTRATS DES .JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES ET
REGIONNALES DE L'ESPACE OHADA
du 26 au 30 octobre 2009
informatique, le comptable a continu, comme son prdcesseur, a pay des
primes. Ces paiements se sont rvls par la suite irrguliers.
Pour sa dfense, le comptable a fait valoir que :
1. c'tait la seule faute qu'il a commise;
2. les difficults du poste ne lui avaient pas permis de s'assurer de la
rgularit des primes dcides antrieurement sa prise de fonction et
qu'il avait alert sa hirarchie sur la ncessit d'obtenir les moyens
matriels ncessaires ;
3. la responsabilit de son prdcesseur n'tait pas recherche
7. Des titres de recettes ont t mis l'encontre d'agents municipaux pour
rcupration de trop-perus sur traitements tablis sur une base rglementaire
errone.
Le comptable sollicite du maire l'autorisation pralable pour recouvrer les
trop-perus sur les traitements ultrieurs. Face au refus du maire, le
comptable prsente les titres en non-valeur et 1' admission en non-valeur est
intervenue par une dlibration du conseil municipal.
Pour le comptable, il n'avait plus, ds lors, rpondre du non-recouvrement
de ces titres.
8. En procs, la commune a fait condamner aux dpens la partie adverse et a
expos les frais de justice. Pour le recouvrement du montant, 1' ordonnateur
n'a pas mis de titre de recette, et par la suite, la crance est devenue
irrcouvrable du fait de l'insolvabilit du dbiteur.
Pour justifier le non-recouvrement de la crance de la Commune, le
comptable dclare qu'il n'a pu obtenir de l'ordonnateur l'mission d'un titre
de recette
Les participants sont rpartis en deux groupes.
Le premier groupe fait office de magistrat instructeur et fait des propositions
motives sur les diffrentes constatations et compte tenu des explications
apportes par le comptable.
Le deuxime groupe joue le rle de formation dlibrante.
2
E.R.SU.MA.
FORMATION DES MAGISTRATS DES JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES ET
REGIONNALES DE L'ESPACE OHADA
du 26 au 30 octobre 2009
CAS PRATIQUE N2
1. Les comptes des exercices 1982 1987 d'une commune sont en jugement. Durant
cette priode, deux comptables se sont succd, le deuxime tait entr en fonction
depuis le 18 septembre 1982 et tait donc rest en poste durant les exercices en
jugement.
En examinant les tats des restes recouvrer de deux comptes de tiers, le
rapporteur constate que :
-pour le premier cas, il y a une diffrence en moins de 800 OOOF sur 1' tat
des restes recouvrir du compte 4689 restes recouvrer sur exercices
antrieurs par rapport au solde en criture au 31 dcembre 1987.
Le comptable en fonction, lors de la prise de service, a fait des rserves
sur les dsordres trs importants et sur l'absence d'tats de dveloppement
des diffrents comptes de tiers
-pour le deuxime cas, les tats de dveloppement des soldes font
apparatre une diffrence en plus par rapport au solde.
En fait, la production des tats a t ralise par le comptable en poste, le
premier tant dcd
3
E.R.SU.MA.
FORMATION DES MAGISTRATS DES .JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES ET
REGIONNALES DE L'ESPACE OHADA
du 26 au 30 octobre 2009
CAS PRATIQUE N3
Un systme de marchs fictifs a t organis par le prsident du conseil municipal et le
maire d'une commune. Le montant cumul de ces marchs estim 80 millions de francs
a servi alimenter une caisse noire. Des prlvements d'un montant de 30 millions, ont
t destins 1' achat d'quipements pour certains services de la commune et
l'amlioration des conditions de voyage et de sjour du maire et du prsident du conseil
municipal, lors de leurs missions 1' tranger.
Le juge des comptes les a dclars, titre provisoire, comptables de fait. Il a fix
provisoirement la ligne de compte 80 millions de francs et leur a fait injonction de
produire la dlibration du conseil municipal reconnaissant 1 'utilit publique des
dpenses allgues. Durant le droulement de la procdure, une instruction judiciaire a
t ouverte sur les mmes faits.
Dans son mmoire en dfense, le maire a mis en cause le comptable de la commune qui
aurait facilit le droulement des oprations irrgulires et a demand au juge des
comptes de surseoir statuer dans l'attente de la dcision du juge pnal au motif qu'une
partie des recettes de la gestion a servi financer des dpenses d'intrt communal.
Aprs avoir examin tous les moyens dvelopps par le maire et le prsident du conseil
municipal et aprs les avoir auditionns, en prsence du comptable qui a reconnu les
allgations formules son encontre, le juge des comptes a dclar, titre dfinitif et
solidairement comptables de fait, le maire, le prsident du conseil municipal et le
comptable.
1. La dclaration dfinitive de gestion vous parat elle fonde ?
2. Dans 1' affirmative et dans 1 'hypothse de la production au juge des comptes
par les comptables de fait du compte de la gestion de fait et de la dlibration
du conseil municipal reconnaissant 1 'utilit publique des dpenses hauteur de
20 millions de francs et de pices justificatives avec des factures sous forme de
duplicata d'un montant cumul de 5 millions de francs, quelle serait la suite de la
procdure?
4
Les dbats qui ont suivi cet expos ont port essentiellement sur le
contrle de la lgalit de la dpense par le comptable, l'institution d'un
dlai pour juger le compte de gestion par la nouvelle directive, les voies
de recours, la thorie des mandats fictifs, le dlai et les modalits de la
prescription, la question de la reconnaissance de l'utilit publique des
dpenses et la production des pices justificatives dans le cas d'un
paiement rgulariser.
Aprs avoir rpondu aux questions poses, M. DIOUKHANE a distribu
des cas pratiques examiner la prochaine sance.
Le rapport des travaux de la journe du mardi 28 octobre 2009 a t,
aprs amendements, adopt par les participants au cours de la mi-
journe.
Les travaux de la journe ont pris fin 16 h 10 mn.
Les participants
4
E
R. S ~ ;U, 'M, A
. : ' ' . ' 1 ; . ..... . .
Ecole Rgionale Suprieure
de la Magistrature
RAPPORT GENERAL DE LA SESSION FORMATION DES
MAGISTRATS DES JURIDICTIONS FINANCIERES NATIONALES
ET REGIONALES
THEME: LE CONTROLE ADMINISTRATIF ET JURIDICTIONNEL
DES FINANCES PUBLIQUES
Porto-Novo, du 26 au 30 octobre 2009
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2009, s'est tenue l'ERSUMA, la
session de formation destine aux magistrats des juridictions financires
nationales et rgionales de l'espace OHADA sur le thme le contrle
administratif et juridictionnel des finances publiques.
Place sous l'gide de l'OHADA, cette rencontre a vu la participation de
magistrats de juridictions financires du Burkina Faso, du Cameroun, du
Centrafrique, du Congo (Brazzaville), du Gabon, du Niger, du Sngal,
du Togo, de l'UEMOA et de la CEMAC.
L'objectif vis tait le renforcement des capacits des participants en
matire de contrle des finances publiques en gnral et, plus
particulirement dans la matrise des procdures applicables au sein
des juridictions financires.
L'ouverture des travaux a t prside par Monsieur Mathias P.
NIAMBEKOUDOUGOU, 'Directeur gnral de l'ERSUMA, assist de
Monsieur Mdard Dsir BACKIDI, Directeur des tudes et des stages et
des deux formateurs, les professeurs Salif YONABA, Agrg des
facults de droit, Professeur l'UFR/Sciences Juridiques et Politiques de
l'Universit de Ouagadougou (Burkina Faso), et Abdourahmane
DIOKHANE, Matre de Confrences la Facult des Sciences Juridiques
et Politiques de l'Universit Cheick Anta DIOP de Dakar, Commissaire
de droit prs la Cour des comptes du Sngal.
1
Dans son mot d'ouverture, Monsieur le Directeur gnral a d'abord
souhait la bienvenue aux participants avant de situer les enjeux du
thme qui ont trait, selon lui, la bonne gouvernance et une exigence
dmocratique dont l'origine remonte au 18me sicle en France.
Pour terminer, il a rappel les diffrents types de contrles et les objectifs
assigns la session.
Aprs le mot d'ouverture, les participants ont t invits par Monsieur le
Directeur des tudes et des stages se prsenter et exprimer leurs
attentes.
Messieurs Abdourahmane GHOUSMANE, Conseiller la Chambre des
comptes et de discipline budgtaire de la Cour suprme du Niger et
Cheikh LEYE, Conseiller la Chambre des affaires budgtaires et
financires de la Cour des comptes du Sngal, ont t dsigns en
qualit de rapporteurs.
Deux (02) sous-thmes ont t abords au cours des travaux, savoir :
- le contrle administratif;
- le contrle juridictionnel.
Au cours de la premire journe, le lundi 26 octobre 2009, le sous-thme
relatif au contrle administratif a t abord par le professeur YONABA
qui a prsent la thorie gnrale du contrle, en dfinissant le concept,
ses objectifs et ses diffrentes acceptions.
Il a ensuite rappel la classification des diffrents types de contrles et
indiqu les diffrents corps et organes de contrles.
Enfin, il a voqu le contrle interne et le contrle externe et a insist sur
les avantages et les inconvnients du contrle a priori et du contrle a
posteriori.
Au deuxime jour de la session, le mardi 27 octobre 2009, le professeur
YONABA, a poursuivi sa communication sur le sous-thme du contrle
administratif. Ill' a abord sous l'angle du contrle administratif interne
exerc par le contrleur financier et les comptables publics.
A la suite des dbats, il est revenu sur les modalits pratiques du
contrle administratif effectu par les inspections.
2
Le deuxime sous-thme relatif au contrle juridictionnel a t introduit
par l'animateur. Il a introduit le deuxime sous-thme qu'il l'examinera
en trois point: l'historique, la situation actuelle et les attributions du juge
des comptes.
Abordant le premier, il a retrac les pripties de la cration des
juridictions financires qui ont t inspir du modle franais.
Leur mise en place a t progressive et souvent difficile. Et aujourd'hui le
contours de leur cadre juridique sont bien cern mais beaucoup reste
faire pour amliorer leur fonctionnement.
Au cours de la troisime journe du mardi 28 octobre 2009, les
formateurs, Professeurs YONABA et DIOUKHANE ont poursuivi leurs
communications sur le sous thme du contrle juridictionnel, en
dbutant par un expos du Professeur YONABA portant sur la situation
actuelle des juridictions financires ainsi que leurs attributions.
Il a prsent les diffrents modles qui existent et dcrit l'organisation et
le fonctionnement de la Cour des comptes du Burkina Faso qui est
compose de magistrats du sige, d'un ministre public et d'un greffe
central.
Selon lui, cette physionomie est commune nos juridictions financires
de l'espace francophone qui runissent les mmes comptences que celle
du Burkina Faso.
S'agissant des attributions du juge des comptes, il relve trois types de
comptences(03) :
- le jugement des comptes des comptables patents et celui des
comptables de fait ;
- l'assistance aux pouvoirs publics;
- l'information des citoyens, par la publication d'un rapport public
annuel.
II conclut en relevant les difficults auxquelles sont confrontes les
juridictions financires, notamment le statut des magistrats financire
peu attractifs et la concurrence des autres institutions de contrle.
Dans tous les cas, le maintien des juridictions financires dans le sillage
du modle franais est une question qui mrite rflexion.
3
Au cours de la quatrime journe le jeudi 29 octobre 2009, le professeur
DIOUKHANE est largement revenu sur le contrle des comptables
patents et celui des comptables de fait.
Il a dvelopp son expos sur les contrles pouvant dboucher sur la
responsabilit personnelle et pcuniaire du comptable patent ainsi que
sur les procdures mises en uvre pour l'engager.
Il a ensuite trait de la gestion de fait en axant sa prsentation sur la
notion de gestion de fait et sur la procdure qui lui est implicable.
Les travaux de la journe du 30 octobre 2009 ont t consacrs:
- d'une part, aux travaux en ateliers et la rsolution d es cas
pratiques qui ont port sur l'ensemble des thmes abords de
manire gnrale et, plus particulirement, sur la responsabilit du
comptable et sur la gestion de fait ;
- d'autre part, l'adoption du rapport des travaux de la journe du
29 octobre 2009 ;
- et, enfin, la crmonie de clture.
Fait Porto-Novo, le 30 octobre 2009
Les participants.
4
Vous aimerez peut-être aussi
- ISO 45001 V 2018 PDFDocument86 pagesISO 45001 V 2018 PDFAbaghough Brahim79% (14)
- Audit Comptable Et Financier Du Cycle Achat Fournisseur - Cas de L'imprimerie Arc en Ciel - Cadre TheoriqueDocument128 pagesAudit Comptable Et Financier Du Cycle Achat Fournisseur - Cas de L'imprimerie Arc en Ciel - Cadre TheoriqueArnaud Nene0% (1)
- Comptabilit - Publique Cours NVDocument89 pagesComptabilit - Publique Cours NVkemmach toufikPas encore d'évaluation
- La - Fongibilié - Des - Crédits FINANCES PUBLIQUESDocument11 pagesLa - Fongibilié - Des - Crédits FINANCES PUBLIQUESYasmine0% (1)
- Analyse Livre Inconnu À Cette Adresse PDFDocument13 pagesAnalyse Livre Inconnu À Cette Adresse PDFMohammed Jabrane100% (2)
- Rapport Definitif PDFDocument45 pagesRapport Definitif PDFMohamed HafnaouiPas encore d'évaluation
- 1-Cadre Général de La Comptabilité PubliqueDocument12 pages1-Cadre Général de La Comptabilité PubliqueAmine Al GoPas encore d'évaluation
- Droit Budgétaire Séance 8Document7 pagesDroit Budgétaire Séance 8Ghamraoui MohamedPas encore d'évaluation
- Budgets Des Collectivités Territoriales: Quels Moyens Pour La Décentralisation Au Maroc ?Document21 pagesBudgets Des Collectivités Territoriales: Quels Moyens Pour La Décentralisation Au Maroc ?timouyassupPas encore d'évaluation
- Titre XII - Comptabilité PubliqueDocument35 pagesTitre XII - Comptabilité Publiquebenyfirst100% (1)
- Droit BudgétaireDocument244 pagesDroit BudgétaireKarimDriouch100% (3)
- LA LA FISCALITE A L'EFC DES CPA - 25 EDITION: Intégrant les attentes reliées à l’EFC 2023D'EverandLA LA FISCALITE A L'EFC DES CPA - 25 EDITION: Intégrant les attentes reliées à l’EFC 2023Pas encore d'évaluation
- Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleD'EverandAspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Mesures d'exécution et procédures collectives: Confrontation des règles de l'exécution et du droit des entreprises en difficultéD'EverandMesures d'exécution et procédures collectives: Confrontation des règles de l'exécution et du droit des entreprises en difficultéPas encore d'évaluation
- Instruction Gnrale de La Dpense PDFDocument279 pagesInstruction Gnrale de La Dpense PDFOlympia EncgaPas encore d'évaluation
- Contrôle de L'exécution BudgétaireDocument33 pagesContrôle de L'exécution BudgétaireDaYa TadmutPas encore d'évaluation
- Le Contrôle Financier Des Comptes PublicsDocument552 pagesLe Contrôle Financier Des Comptes PublicsOthmane FerroukhiPas encore d'évaluation
- Fiche Gestion de Fait PDFDocument7 pagesFiche Gestion de Fait PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Droit Des Finances Publiques 2022-2023Document123 pagesDroit Des Finances Publiques 2022-2023ibaleushindiPas encore d'évaluation
- EG4 Finances Pubiiques 2018 2019 PDFDocument12 pagesEG4 Finances Pubiiques 2018 2019 PDFDiyae AliouanePas encore d'évaluation
- A La Nouvelle Lof Et La GFP RemaDocument13 pagesA La Nouvelle Lof Et La GFP RemaHichamPas encore d'évaluation
- Travaux Sur Les Finances LocalesDocument66 pagesTravaux Sur Les Finances Localesfatiha el yaakoubiPas encore d'évaluation
- Finances Publiques - Raya ChoubaniDocument37 pagesFinances Publiques - Raya Choubaniمنير بعكةPas encore d'évaluation
- La Comptabilité PubliqueDocument187 pagesLa Comptabilité PubliqueNabil Es-slimaniPas encore d'évaluation
- Éxposé de La Procédure de L'éxecution de La Dépense.Document40 pagesÉxposé de La Procédure de L'éxecution de La Dépense.soumaya elhaddadiPas encore d'évaluation
- Finances Des CT Au MarocDocument2 pagesFinances Des CT Au MarocSoukeîna Alaoui67% (3)
- Cours de Finances PubliquesDocument105 pagesCours de Finances PubliquesBouaroudj Soufien100% (1)
- Finances Publiques BruxellesDocument189 pagesFinances Publiques BruxellesCHRISTIAN LAURICPas encore d'évaluation
- La Comptabilité PubliqueDocument2 pagesLa Comptabilité PubliqueZouhir Al Kassimi100% (1)
- Marche PubDocument200 pagesMarche PubيوسفأيهاالصديقPas encore d'évaluation
- Cadre Hormonisé Des Finances Publiques de l'UEMOA PDFDocument121 pagesCadre Hormonisé Des Finances Publiques de l'UEMOA PDFBoubacar TemePas encore d'évaluation
- Lorganisation de La Comptabilité de Letat Au MarocDocument32 pagesLorganisation de La Comptabilité de Letat Au MarocWalid ArhnouchPas encore d'évaluation
- Le Contrôle Juridictionnel Des Finances PubliquesDocument10 pagesLe Contrôle Juridictionnel Des Finances PubliquesAbdellatif100% (1)
- Au Droit Fiscal Général Et À La Théorie de L'impôt: CoursDocument25 pagesAu Droit Fiscal Général Et À La Théorie de L'impôt: CoursSaid BarcelonaPas encore d'évaluation
- Cour Des Comptes Nouveau RoleDocument8 pagesCour Des Comptes Nouveau RoleMahdi TalebPas encore d'évaluation
- Coursdefinancespubliques 1 120817123926 Phpapp01Document24 pagesCoursdefinancespubliques 1 120817123926 Phpapp01perico1962Pas encore d'évaluation
- Droit Budgétaire Séance 7Document11 pagesDroit Budgétaire Séance 7Ghamraoui MohamedPas encore d'évaluation
- Finances Locales Droit Public PDFDocument49 pagesFinances Locales Droit Public PDFAhmed AhmedPas encore d'évaluation
- These Sur Les Systemes Financiers Publics Des Etats Uemoa A L'epreuve de La Bonne Gouvernance de Serge BatononDocument515 pagesThese Sur Les Systemes Financiers Publics Des Etats Uemoa A L'epreuve de La Bonne Gouvernance de Serge Batonongnetofranckolivier25Pas encore d'évaluation
- Rapport Cour Des Comptes 08 - Tome2 - VFRDocument554 pagesRapport Cour Des Comptes 08 - Tome2 - VFRswingo100% (1)
- Cours Compta Pub 1ère PartieDocument20 pagesCours Compta Pub 1ère PartieRAZAFIMAHEFA Lijais TannyPas encore d'évaluation
- Réforme Collectivités TerritorialesDocument9 pagesRéforme Collectivités TerritorialesMarianne MonninPas encore d'évaluation
- 12 - Cours de Finances Publiques - 2017Document56 pages12 - Cours de Finances Publiques - 2017Kouakou Pacome N'guessan100% (2)
- Seminiare Sur La Bonne Gouvernance Des Finances PubliquesDocument4 pagesSeminiare Sur La Bonne Gouvernance Des Finances PubliquesB.IPas encore d'évaluation
- La Gouvernance Financiere Des Collectivite Territoriales Au MarocDocument121 pagesLa Gouvernance Financiere Des Collectivite Territoriales Au MarocLoren FabienPas encore d'évaluation
- Gestion Budgétaire PubliqueDocument14 pagesGestion Budgétaire PubliqueHala RhPas encore d'évaluation
- Module 1 Fiscalite LocaleDocument95 pagesModule 1 Fiscalite Localerakolova100% (1)
- Manuel Procédures Budgétaires Comptables AREF Domaine DépensesDocument146 pagesManuel Procédures Budgétaires Comptables AREF Domaine DépensesMoulay Mohamed BenhnainPas encore d'évaluation
- Recouvrement Des Créances PubliquesDocument9 pagesRecouvrement Des Créances PubliquesasdubalPas encore d'évaluation
- Finances PubliquesDocument16 pagesFinances PubliquesMERIEM MOUNCYF100% (1)
- Finances PubliquesDocument17 pagesFinances PubliquesYoussef Kou50% (2)
- Comptabilité PubliqueDocument56 pagesComptabilité PubliqueFlo KolovitchPas encore d'évaluation
- Dioukhane Finances Pub Dans l'UEMOADocument276 pagesDioukhane Finances Pub Dans l'UEMOAzfm76hvwm7Pas encore d'évaluation
- Depense Pub 20122Document127 pagesDepense Pub 20122narcisse7777Pas encore d'évaluation
- Comptabilite PubliqueDocument170 pagesComptabilite PubliqueNathan FowlerPas encore d'évaluation
- Comptabilite PubliqueDocument134 pagesComptabilite PubliqueAnisPas encore d'évaluation
- FISCALITE FinalDocument43 pagesFISCALITE FinalHAMED JamalPas encore d'évaluation
- Reforme Des Collectivites LocalesDocument174 pagesReforme Des Collectivites Localesahmed21335Pas encore d'évaluation
- Réforme - Controle de La DépenseDocument58 pagesRéforme - Controle de La Dépenseiguidr100% (1)
- Le Contrôle FinancierDocument43 pagesLe Contrôle FinancierAfaf Ismaili100% (1)
- Ena 1005Document40 pagesEna 1005Anass7Pas encore d'évaluation
- Les Ordonnateurs 2022Document21 pagesLes Ordonnateurs 2022chemmakh.dhikraPas encore d'évaluation
- Budget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsD'EverandBudget public et performance: Introduction à la budgétisation axée sur les résultatsPas encore d'évaluation
- Réglementation Marocaine RelativeDocument3 pagesRéglementation Marocaine RelativeMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Eps S4Document69 pagesEps S4Mohammed JabranePas encore d'évaluation
- Essai Sur La Centralisation Et La Decentralisation - Reflexions A Partir de La Theorie de C. EisenmannDocument469 pagesEssai Sur La Centralisation Et La Decentralisation - Reflexions A Partir de La Theorie de C. EisenmannMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Évaluation Partenariale Des Projets D'appuiDocument56 pagesÉvaluation Partenariale Des Projets D'appuiMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Droit Public AppliqueDocument196 pagesDroit Public AppliqueMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Guide Audit Client v12Document18 pagesGuide Audit Client v12Mohammed JabranePas encore d'évaluation
- Cours AthletismeDocument151 pagesCours AthletismeMohammed Jabrane100% (2)
- Roles Collectivités Et Developpement PDFDocument21 pagesRoles Collectivités Et Developpement PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Cours Economie GénéraleDocument540 pagesCours Economie GénéraleMohammed Jabrane86% (7)
- Systeme Danalyse Financiere Et Institutionnelle Des Collectivites LocalesDocument256 pagesSysteme Danalyse Financiere Et Institutionnelle Des Collectivites Localestalaini100% (2)
- Vocabulaire Du Développement DurableDocument324 pagesVocabulaire Du Développement DurableMarc DutreuilPas encore d'évaluation
- TreasureDocument115 pagesTreasureMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Administrations Publiques Theories Nouveau Management Public Marion OttDocument93 pagesAdministrations Publiques Theories Nouveau Management Public Marion OttMohammed JabranePas encore d'évaluation
- 1 - PCA - FS Fac-Simile Nov 2011 PDFDocument64 pages1 - PCA - FS Fac-Simile Nov 2011 PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Le Contentieux Électoral PDFDocument8 pagesLe Contentieux Électoral PDFMohammed Jabrane100% (1)
- Le Maroc en Chiffres, 2006 PDFDocument85 pagesLe Maroc en Chiffres, 2006 PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Conjugaison Activités de Réécriture PDFDocument116 pagesConjugaison Activités de Réécriture PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Le Maroc en Chiffres, 2006 PDFDocument85 pagesLe Maroc en Chiffres, 2006 PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- 1 Audit EnergetiqueDocument63 pages1 Audit EnergetiqueMohammed El Idrissi100% (1)
- DEVOIRDocument4 pagesDEVOIRMarie Vierge Meli JoundaPas encore d'évaluation
- Iso 27001Document2 pagesIso 27001Moustaph mbodjiPas encore d'évaluation
- Memoire Final Onana Assolo CharlesDocument121 pagesMemoire Final Onana Assolo CharlesCharles Onana assoloPas encore d'évaluation
- DSCG 3 - Management Et Contr-le de GestionDocument428 pagesDSCG 3 - Management Et Contr-le de GestionMãnãss Vie TåñdüPas encore d'évaluation
- Recrutement, Accueil, IntégrationDocument75 pagesRecrutement, Accueil, IntégrationlauraPas encore d'évaluation
- PartieDocument104 pagesPartieAmi HBPas encore d'évaluation
- Le Controle Financier Et Son Impact Sur Le Management Et La Bonne Gouvernance Des Etablissements PublicsDocument58 pagesLe Controle Financier Et Son Impact Sur Le Management Et La Bonne Gouvernance Des Etablissements PublicsMeryem ImourigPas encore d'évaluation
- Audit FinancierDocument7 pagesAudit FinancierJamal Meddad0% (1)
- Rap Audit Marches CEA-SMADocument91 pagesRap Audit Marches CEA-SMAسفيانبوطالبPas encore d'évaluation
- Benchmark IFACI CI Thème 2 VFDocument19 pagesBenchmark IFACI CI Thème 2 VFIBOUPas encore d'évaluation
- 9735 Usoap-Cma 4e Edition FRDocument94 pages9735 Usoap-Cma 4e Edition FRPatrick MbunguPas encore d'évaluation
- Présentation - Suivi Et Controle de La Gestion Des Marchés PublicsDocument51 pagesPrésentation - Suivi Et Controle de La Gestion Des Marchés Publicsnadia67% (3)
- 15.1 Annexe 1 Liste de Controle D Audit Interne Preview FRDocument2 pages15.1 Annexe 1 Liste de Controle D Audit Interne Preview FRkaroui sourourPas encore d'évaluation
- Controle de Gestion SocialDocument85 pagesControle de Gestion SocialNISSRINE BENTABETPas encore d'évaluation
- Anelise TalbourdeauDocument9 pagesAnelise TalbourdeauDennis AlexanderPas encore d'évaluation
- Méthode Et Outils D'audit InformatiqueDocument67 pagesMéthode Et Outils D'audit Informatiquebl2010100% (1)
- Presentation Esdco AmgDocument16 pagesPresentation Esdco Amgva15la15Pas encore d'évaluation
- Catalogue ATZ - 2023Document10 pagesCatalogue ATZ - 2023Manong ShegueyPas encore d'évaluation
- Rapport PDFDocument58 pagesRapport PDFBilal Djouhri100% (2)
- Les Supports Et Les Techniques Daudit CoDocument46 pagesLes Supports Et Les Techniques Daudit ComezianiPas encore d'évaluation
- Formulaire Auto Evaluation RSEDocument20 pagesFormulaire Auto Evaluation RSEPatrícia S.Pas encore d'évaluation
- Presentation de FPEDocument31 pagesPresentation de FPETaoufik El HajiPas encore d'évaluation
- Propharma2 PDFDocument228 pagesPropharma2 PDFAl Mahdi BazizouiPas encore d'évaluation
- AuditDocument5 pagesAuditImane khadraPas encore d'évaluation
- EMiOS Manuel QualiteDocument32 pagesEMiOS Manuel QualiteHAMDIPas encore d'évaluation
- L'Impact de La Transformation Digitale Sur L'audit Externe: Nouvelles Perspectives Et Pratiques Émergentes: Revue Systématique de LittératureDocument20 pagesL'Impact de La Transformation Digitale Sur L'audit Externe: Nouvelles Perspectives Et Pratiques Émergentes: Revue Systématique de LittératureKhalil JaberPas encore d'évaluation