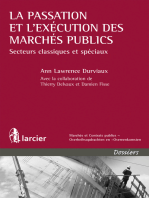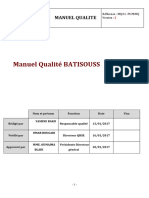Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
RERP
RERP
Transféré par
Abdelhamid Dehayni AL AbdaliCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
RERP
RERP
Transféré par
Abdelhamid Dehayni AL AbdaliDroits d'auteur :
Formats disponibles
I.
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
REMERCIEMENT
Au terme de mon stage dinitiation professionnelle, jetiens exprimer mes
vifs remerciements tous ceux qui ont contribu, de prs ou de loin, la
russite de mon stage.
Je tiens remercier dans un premier temps, MonsieurMountasirBelrazi
directeur de la socit anonyme Al Omrane Mekns, pour son accueil et pour
mavoir garantie les meilleures conditions pour passer ce stage.
Egalement, jadresse mes vifs remerciements Monsieur ELGUENNOUNI
Rachid, mon encadrant du SIP et Mademoiselle Amal BENTABET pour leur
aide et leur soutien tout au long de ma priode de stage afin daccomplir
mon travail et dassurer son bon droulement.
Finalement, je tiens exprimer mes remerciements au corps professoral de
lEMI qui vielle parfaire notre formation dingnieur et mes reconnaissances
envers les ingnieurs, les techniciens et les manuvres pour avoir accept
de minjecter dans le bain, ainsi que pour leur aide et leur soutien. Je les
remercie galement pour leur accueil et leur gnrosit.
SOMMAIRE
Prsentation .2
UJIL REDA
EMI
I.
I.
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Prsentation dAl Omrane2
a. Renseignements juridiques et administratifs..........2
b. Prsentation2
c. Structure de la socit Al Omrane Mekns..7
d. Organigramme de la socit 12
Notions administratives13
a. Les diffrents intervenants dans lacte de btir 13
b. Prestataires14
c. March..16
d. Le CPS17
e. Plans bton arm. .18
f. Foncier.19
Matriels et matriaux 20
a. Matriels utiliss20
b. Matriaux de construction.23
La ralisation du projet Wafae ..28
Prsentation du chantier.28
UJIL REDA
a. Fiche technique du chantier.28
b. Moyens du chantier29
c. Hirarchie du chantier .29
2
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
d. Runions de chantier30
e. Rception provisoire et dfinitive30
Les corps dtat .31
f. Gros uvre.. 31
g. Second uvre. 44
IV.
Conclusion47
PRSENTATION
DAL OMRANE
Renseignements juridiques et administratifs :
Fiche didentit de HAO
Raison Social :Holding dAmnagement Al OMRANE
Forme Juridique :Socit anonyme
UJIL REDA
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Date de cration : 1er Mars 1984
Sige social:Boulevard Annakhil, rue Al Boundok hay Riad Rabat
Boite postal : 4414
Tlphone : +212 037 70 04 86/87
Fax : +212 037 70 04 95
E-mail :dg.alomrane@alomrane.ma
Site Web: www.alomrane.ma
Capital total:394 271 400.00 DH
Fiche didentit de la socit anonyme Al Omrane Mekns :
Date de cration : 2007
Adresse:Rue Ibn Sina, BP 253, Ville Nouvelle
Tlphone :05 35 51 05 55/ 05 35 52 26 27
Fax :05 35 51 04 40
Contact:BOUTAHAR MED.SAID
0651564809
m-boutahar@alomrane.ma
Activits:
Rsorption des bidonvilles et de lhabitat insalubre
Promotion de lhabitat social et partenariat public priv
Dveloppement des activits damnagement foncier
Dveloppement de la matrise douvrage urbaine et sociale
Prsentation :
Le Holding damnagement Al OMRANE est un regroupement de socits
nationales charges de la mise en uvre de la politique de lEtat dans le secteur
de lhabitat, en fait, il est constitu de :
La socit damnagement AL BOUGHAZ.
La socit damnagement AL JANOUB.
La socit damnagement TAMESNA.
La socit damnagement TAMANSOURT.
La socit Al Omrane Beni Mellal.
7 socits constitues par la fusion de la SNEC, lANHI, ATTACHAROUK et
les ERAC.
AL OMRANE Agadir.
AL OMRANE Casablanca.
AL OMRANE Fs.
AL OMRANE Marrakech.
UJIL REDA
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
AL OMRANE Mekns.
AL OMRANE Oujda.
AL OMRANE Rabat.
Le Holding dAmnagement Al Omrane a t cr dans un contexte particulier
marqu par lintrt grandissant port dune manire gnrale la question de
lhabitat depuis quelques annes. En effet, conscient de la gravit de la
prolifration de lhabitat insalubre sous toutes ses formes et son extension dans la
quasi-totalit des agglomrations urbaines, Sa Majest le Roi Mohammed VI, que
Dieu lassiste, a donn ses Hautes Directives dans ce domaine plusieurs
occasions en demandant notamment au Gouvernement dlaborer un programme
national dradication de lhabitat insalubre et de placer la question de lhabitat
social comme lune des priorits de son action.
Lmergence du Holding dAmnagement Al Omrane sest galement opre dans
le cadre de la mise en place de la nouvelle politique gouvernementale en matire
dhabitat qui sest fixe lobjectif d'accrotre le rythme de production de logements
sociaux, lequel objectif traduit une triple proccupation :
Augmenter loffre rglementaire en logements pour rpondre aux besoins
nouveaux , rendre adquate loffre avec la demande et enfin attnuer
progressivement le dficit cumul. Cette nouvelle approche de laction
gouvernementale sest accompagne par un ensemble de mesures, en particulier
la mobilisation des rserves foncires publiques, les incitations fiscales, la mise
contribution de toutes les capacits de production et le dveloppement dun
partenariat entre les oprateurs publics et lespromoteurs immobiliers du secteur
priv.
Cest ainsi que le Holding dAmnagement Al Omrane dveloppe et met en uvre
aujourdhui un ensemble de programmes : Cration de villes nouvelles,
amnagement de ples urbains, radication des bidonvilles dans le cadre du
programme ville sans bidonville , requalification des quartiers sous quips,
mise niveau urbaine des agglomrations, rhabilitation du patrimoine dans les
mdinas et les ksour, confortement des constructions menaant ruine, ainsi que
diverses oprations damnagement foncier et de construction de logements. Face
ces dfis, il tait ncessaire de finaliser la refonte institutionnelle des oprateurs
publics de lhabitat pour donner naissance au Groupe Al Omrane.
Cest dans cette vision que les sept Etablissements Rgionaux dAmnagement et
de Construction (ERAC) ont rejoint en 2007 le Holding dAmnagement Al Omrane
en tant que filiales rgionales, aprs leur transformation en socits anonymes. A
travers cette restructuration, le gouvernement entend accrotre la comptitivit de
laction de lEtat en matire dhabitat, permettre de coordonner et mieux grer
tous les programmes daction, assurer un pilotage homogne et efficace et induire
UJIL REDA
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
une meilleure capitalisation du savoir faire en favorisant la synergie et la
complmentarit des comptences. Ainsi, le Groupe Al Omrane, grce ses
ressources humaines, sa culture dentreprise, la cohrence de ses dmarches
en matire de montage et de mise en uvre de programmes, au partenariat
engag avec les promoteurs immobiliers privs et la coopration dveloppe
avec les institutions internationales, est en mesure de mobiliser, dans les
meilleures conditions, des financements la hauteur des investissements
ncessaires la ralisation de projets denvergure susceptibles de rpondre aux
besoins de la croissance urbaine et du dveloppementhumain.
UJIL REDA
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Structure de la socit Al Omrane Mekns :
Division technique :
Cette division identifie les projets sur le terrain, mne les tudes de faisabilit,
engage la procdure dacquisition des terrains, lance les marchs de travaux et
suit les chantiers jusqu la livraison du produit fini.
Pour se faire la division technique applique des guides techniques quon appelle les
manuelles de procdure.
Elle comporte 4 services :
a- Le service foncier :
Le service foncier doit intervenir pour la ralisation de tout projet dhabitat aussi
bien en amont quen aval. En effet, avant le dmarrage du projet, il doit soccuper
dachat du terrain quil soit un terrain habous,
une terre rcupre, un terrain collectif, un terrain communal ou un terrain priv. A
lachvement dun projet, il doit assurer lclatement des titres fonciers individuels
en faveur de client. Ce service est en contact permanent avec les services des
domaines du cadastre et de la conservation foncire.
UJIL REDA
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
b- Le service des tudes et de programmation :
Il tudie les projets sur les plans techniques et financiers. En effet, il soccupe des
tudes techniques : tudes urbanistiques, tudes architecturales, tudes V.R.D
(voiries et rseaux divers). Il value les cots des projets. Il labore une banque de
projets. Il classe ses projets par ordre de priorit et tablie un planning pour leur
ralisation. Il soccupe des demandes dautorisation de lotir et construire.
c- Le service des marchs :
Il lance les avis dappels doffre dans les journaux, soccupe des ouvertures des
plis, participe la dsignation des entreprises adjudicataires, labore des marchs
de travaux, donne lordre de service aux entrepreneurs pour dmarrer les travaux,
vrifie les dcomptes prsents par les fournisseurs avant leur rglement.
d-Le service de ralisation :
Il suit les travaux dquipements des lotissements et les travaux de construction
pour logements. Il provoque les runions de coordination sur les lieux de chantiers
avec lensemble des intervenants dans lacte de btir et il vrifie les dcomptes
tablis par les entreprises avant de les transmettre au service des marchs. Aprs
lachvement des travaux, le service des ralisations demande aux prsidents des
communes la rception provisoire des travaux, puis la rception dfinitive une
anne aprs lobtention de la rception provisoire. Ce service est form par des
units de gestion de projet UGP. On cite : UGP Ifrane-Hajeb, UGP Rachidia-khenifraMidelt. UGP Mekns Almanzah et UGP Mekns Al-Ismailia.
UJIL REDA
Tche approprie chaque service de la division technique :
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Division commerciale :
La division commerciale est dote de trois services :
a- Le service commercial :
Il soccupe de laccueil des clients. Il les informe sur les produits commercialiser :
lieu, superficie, prix, modalits de paiement etc. Il oriente le client dans le choix
des produits et lassiste obtenir le prt auprs de la CIH, ou tout autres
organismes bancaires. Le service commercial soccupe de la publicit et de la
confection des diffrents matriaux ncessaires cet effet tels que les dpliants,
les prospectus, les annonces dans les journaux et radio.
b- Le service de gestion des dossiers :
UJIL REDA
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Il vrifie les pices constituant le dossier de lattributaire. Il reste en contact avec
le client du 1er jour dattribution jusqu la livraison du produit. Il tablit les
autorisations de recettes et suit la collecte des recettes effectues par le client. Le
bnficiaire dun lots ou logement ne peut tre considr comme attributaire
quaprs avoir payer la 1re avance. Le service de gestion des dossiers tablit les
compromis de vente. Il soccupe aussi des dsistements.
c- Le service de gestion des contrats :
Il tablit les contrats de ventes dfinitives pour lobtention du titre foncier, assiste
le client dans les dmarches administratives. A cet gard, on distingue 2 types de
contrat de vente :
Le contrat par paiement au comptant signer par le vendeur et lacheteur (le
client).
Le contrat par paiement crdit signer par le vendeur, lacheteur(le client) et
lorganisme prteur (CIH ou autres).
Enfin, le service de gestion des contrats adresse une copie de contrat de vente
au service de comptabilit.
Division financire :
Cest la division charnire entre la division commerciale et la division technique.
Elle est charge dtablir et de tenir jour la comptabilit de ltablissement en
vue de suivre lvolution de la trsorerie, dentreprendre toute tudes et
recherches tendant lamlioration de la gestion de ltablissement, de calculer le
cot de revient des diffrents programmes raliss.
Pour accomplir sa tche, la division financire est constitue de trois services :
a- Le service de la comptabilit gnrale :
Il soccupe du traitement de la comptabilit selon les lois et usage du commerce. Il
applique les principes fondamentaux prescrits par le Code Gnral de
Normalisation Comptable (CGNC).
Les oprations comptables sont enregistres selon un enregistrement
chronologique, opration par opration et jour par jour.
Aucune opration ne peut tre dcrite en comptabilit sans quelle soit tablie par
un document.
b- Le service de la comptabilit analytique :
Ce service puise ses informations de la comptabilit gnrale. La comptabilit
analytique permet de calculer le cot de revient et leur dcomposition par activit
(programme de construction ou de lotissement) et par unit produite .
c- Le service informatique :
Ce service a pour mission de grer :
Le rseau dinformation de ltablissement.
Lachat des logiciels (comptabilit, la paie, logiciel de commercialisation en
cour de ralisation.)
Lentretien et la maintenance des ordinateurs.
Toutes ces oprations sont effectues pour faciliter :
La communication interne entre els divisions et le ministre.
La dmarche des oprations de vente.
UJIL REDA
10
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Le service administratif :
Ce service est rattach la direction de ltablissement. Il assure la gestion
administrative de ltablissement et procure la logistique ncessaire son
fonctionnement.
Pour se faire, il labore un budget de fonctionnement et dquipement en fonction
des besoins rels dAl Omrane.
Ce service est compos de deux bureaux :
a- Le bureau du personnel :
Il gre tout ce qui a trait aux ressources humaines ; recrutement des agents en
fonction des profils demands et suit leurs carrire administrative (lavancement
dans la hirarchie, les congs, la paie, les primes ).
b- Le bureau du matriel :
Il gre ce dont a besoin le personnel pour accomplir son travail dans des bonnes
conditions :
Achat de fourniture de bureau (matriaux consommables)
Acquisition du mobilier (bureaux, chaises, armoires,)
Acquisition de matriel roulant (vhicule utilitaires de service)
La suivie de la gestion du stock du magasin, linventaire du mobilier et lentretien
de Parc mobilier.
UJIL REDA
Organigramme de la socit :
11
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
PARTIE
ADMINISTRATIVE
Les diffrents intervenants dans lacte de btir :
UJIL REDA
12
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Lacte de btir implique la prise daction de plusieurs entits et groupes de
personnes des moments donns du processus davant-projet. Voici dcrit le rle
ainsi que lordre dintervention des diffrents acteurs dun projet :
Le matre douvrage doit en premier lieu faire lacquisition dun titre foncier
qui reprsente son droit de proprit dfinitif et inattaquable sur le terrain.
Puis il le remet entre les mains dun gomtre topographe qui dfinit avec
exactitude les bornes du terrain et dlivre lattestation de rtablissement des
bornes.
Par la suite le matre douvrage se met contractuellement daccord avec un
architecte qui proposera sa vision du projet sous forme dun avant projet
sommaire (lAPS, prcisant la conception gnrale du projet) sur la base du
programme du matre duvre et ceci aprs avoir au pralable consult le
plan de bornage et pris connaissance du plan damnagement de la zone
ainsi que la rglementation en vigueur auprs de lagence urbaine (aprs lui
avoir remis le titre foncier).
Larchitecte travaillera de pair avec le bureau dtudes techniques tout au
long du processus de maturation du projet o Le BET se chargera de fournir
les plans bton arm et constituera aux cts de larchitecte la matrise
duvre.
Une fois discut et approuv par la matre douvrage, lAPS est remplac par
lavant projet dfinitif (lAPD, contenant une estimation globale des travaux)
qui sera joint aprs sa signature par ce dernier au dossier de demande de
permis de construire vrifi et valid par lagence urbaine.
Le permis de construire tant accord, larchitecte devra fournir le projet
dexcution (lEP, se composant dun jeu de plans complet et dun planning
pour les travaux).
Ds lors, larchitecte et le bureau dtudes techniques prparent le dossier
dappel doffre destin aux entreprises comptant un cahier de prescriptions
spciales (le CPS), les plans darchitecture et les plans BA. Une ventuelle
insertion de loffre dans les journaux est dusage.
Les entreprises intresses retirent le dossier dappel doffre auprs de la
matrise duvre, ltudient et dposent par la suite leurs offres dans des
enveloppes qui se verront ouvertes et tries par un comit dadjudication.
Le choix de lentreprise, dite adjudicataire, est le plus souvent port sur le
moins disant parmi la concurrence, c'est--dire celle dont la soumission est
plus ou moins 30% de loffre.
Le feu vert est donn lentreprise pour dbuter les travaux en chantier par
une notification (ordre de service) lui tant accorde par le matre douvrage.
UJIL REDA
13
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
La rception des travaux se fait en fin dexcution par le matre douvrage
assist par la matrise duvre qui veille la mise en conformit des
ouvrages raliss avec les plans labors.
Elle dbouchera en labsence de dfauts ou dimperfection sur une
dclaration dachvement rdige par le matre douvrage en faveur de
lentreprise.
Une commission compose principalement de Lagence urbaine, la commune,
la division prfectorale de lurbanisme et la protection civile procde la
rception provisoire du projet et sassure de la conformitdu projet autoris
avec celui qui est ralis et dlivre dans ce sens un certificat de conformit.
Prestataires :
Topographes :
La socit tablit avec un topographe priv un march pour raliser les tudes
topographiques:
par bon de commande
au mtr
de services
Le travail du topographe consiste en calcul de la superficie et la dlimitation de la
parcelle,ltablissement du plan ct et du lev de lexistant
Groupement darchitecte :
Il tablit le plan du projet et le cahier de charges; ceux-ci seront dposs chez la
commune, lagence urbaine et la prfecture pour son autorisation. le maitre
douvrage tablit un contrat avec larchitecte.
Bureaux dEtude Technique :
Le matre douvrage recourt un BET Pour letablissement des etudes
techniques de VRD ou de construction conformement au cahier des charges
du projet Un march alors a lieu entre le matre douvrage et le BET.
Missions du BET :
Concernant les tudes :
Avant projet :
Avant projet sommaire (APS) : esquissesommaire du projet ; plans de principe
de structures, plomberie, lectricit
UJIL REDA
14
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Avant projet dtaill (APD) : aprs lapprobation de lAPS par le matre
douvrage et larchitecte, lAPD comporte un dossier technique plus dtaill
davant mtr et estimation du cout du projet.
Projet dexcution :
Spcifications techniques dtailles (STD)
Plans dexcution des ouvrages (PEO)
Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Comporte deux parties :
Pices qui serviront de base au march : acte dengagement, CPS, bordereau
des prix, dtail estimatif.
Pices facilitant la comprhension du dossier (plans, dessins, autres pices
mentionnes au CPS).
Concernant les travaux :
Contrle gnral des travaux (CGT)
Rception et dcompte des travaux (RDT)
Dossier des ouvrages excuts (DOE)
Rception dfinitive des ouvrages (RDO)
Bureau de contrle :
Il assure le contrle technique de la construction
OPC :
Il a pour objet, de dfinir lordonnancement de lopration et de coordonner les
diffrentes interventions afin de garantir les dlais dexcution et la parfaite
organisation du chantier.
Entrepreneur :
Il excute des travaux de construction sous la direction du matre douvrage et de
la matrise duvre, et diriger le chantier, en plus il doit organiser la coordination
entre les ressources humaines et le matriel de son entreprise pour raliser les
travaux de bonne faon.
Le laboratoire
Dans la plupart des projets, le matre douvrage tablit un march
Par bon de commande
Au mtr
De services
UJIL REDA
15
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Avec un laboratoire qui sera tenu de contrler la qualit et la conformit des
ouvrages.
March :
Le march est un contrat entre le matre douvrage et une ou plusieurs personnes
physiques ou morales. On distingue plusieurs types de march :
Selon les prix :
March prix global (au forfait)
March prix unitaires (au mtr)
March prix mixtes
March comportant des prestations sur dpenses contrles (au
rabais)
Caractre des prix : fermes ou rvisables.
Selon le type de prestation :
March de fournitures
March de travaux
March de services
Selon le mode de passation des marchs :
UJIL REDA
March par appel doffres ouvert :
Une annonce doit tre publie au minimum dans deux journaux diffusion
nationale choisis par le matre douvrage. Lun de ces journaux doit tre en
arabe et lautre en langue trangre.
Aprs 21 jours au moins, on procde louverture des plis dposs par les
concurrents dans une sance publique. Le moins disant (celui qui propose
le prix le moins lev) est choisi pour tablir le march.
March par bon de commande :
Lorsque lestimation du march est infrieure 350000 DHs HT pour les
marchs de fournitures ou de services et 50000 DHs HT pour les marchs
de travaux, le matre douvrage peut envoyer des bons de commande (des
lettres recommandes) un nombre dtermin de concurrents de son
16
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
choix. Louverture des plis procde de la mme manire que lappel
doffres ouvert.
Le CPS
Dans le cas de tous les marchs par appel doffres, le CPS (cahier de prescriptions
spciales) est le document principal qui comporte tous les rglements, les
conditions et les prix du march. Pour les marchs par bon de commande, ce
dernier peut substituer le CPS.
Bas sur le CCAG (cahier des clauses administratives gnrales), document qui
rglemente les marchs du secteur public, le CPS dtermine :
la date de la notification de lapprobation du march par le matre douvrage
(en gnral 60 ou 90 jours) ;
le cautionnement provisoire, somme dargent livre pralablement et
provisoirement au matre douvrage, et fixe par lui-mme ;
le dlai du cautionnement dfinitif, somme dargent gale 3% du montant
initial du march, et qui doit substituer le cautionnement provisoire avant
lexpiration du dlai ; ce dlai est en gnral 30 jours. Le cautionnement
dfinitif nest restitu qu la prononciation de la rception dfinitive (1 an
aprs la rception provisoire) ;
la date de la rception provisoire, date de lachvement de tous les travaux ;
les pnalits (retard, dfaut de nettoyage, absence aux runions) ;
la retenue de garantie, valable uniquement aux marchs de travaux,
plafonne 7% du montant initial du march et restitue lentrepreneur
la rception dfinitive des travaux.
Plans bton arm :
Conus par le bureau dtudes techniques sur la base du jeu de plans
darchitecture, ils sont de deux types :
UJIL REDA
17
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Les plans de coffrage : Contenant le plan de fondation et les planchers
hauts de chaque niveau, ils nous permettent de reprer avec exactitude
lensemble des lments porteurs constituants de la structure (semelles,
poteaux, poutres et planchers), chacun libell par un nom, ainsi que toutes
leurs caractristiques gomtriques (longueur, largeur, hauteur et forme).
Les plans de ferraillage : Reprennent chaque lment porteur en prcisant
son type darmatures (le diamtre des fers) mais galement le faonnage lui
correspondant en fournissant de multiples coupes indicatives.
Foncier
Plusieurs dmarches administratives sont ncessaires pour lacquisition du terrain
et qui sont les suivantes :
Frais dimmatriculation foncire (1% du prix dachat du terrain)
Droits denregistrement (3% du prix dachat du terrain)
Taxe notariale (0,005% du prix dachat du terrain)
Etc.
UJIL REDA
18
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
MATRIELS
ET MATRIAUX
Matriels utiliss
La grue :
Utilis pour le dplacement des charges dans le chantier
UJIL REDA
19
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Btonnire automatique :
Servant malaxer les diffrents constituants du mortier (ciment ou Chaux, sable,
eau) ou du bton.
UJIL REDA
20
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Les plaques de coffrage :
Le coffrage a pour but de raliser des ouvrages aux formes dfinies avec du bton.
Le coffrage est une structure provisoire, utile pour maintenir le matriau en place,
en attendant sa prise puis son durcissement. On peut utiliser des plaques de
coffrage en bois ou en fer.
Pelles hydrauliques
UJIL REDA
21
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Utilis pour les travaux de terrassement, d'assainissement et de fondations
Vibrateur
Appareilservant produiredesvibrations (notamment dans le bton, pour le rendre
plus homogne).
Matriaux de construction
Liants
Pour tous les ouvrages en bton arm (fondation et lvation), le ciment utilis est
le CPJ 45 des usines du Maroc.
UJIL REDA
22
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Sables et agrgats
Les sables et les agrgats sont conformes aux normes prescrites par la DGA.
Pour les sables, le pourcentage en lments de diamtre infrieur 0.08 mm est
au maximum de 4%.
Pour les agrgats, il est possible d'utiliser soit des agrgats rouls, soit des
agrgats concasss; ils devront en tous cas prsenter un bon rapport de formes.
UJIL REDA
23
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Gravette
Sable de
Sable de
concassage
Gravette
Poutrelles
Une poutrelle dsigne un lment porteur d'un plancher bton. Elle est constitue
de bton enrobant une ou plusieurs armatures : torons pour les poutrelles
prcontraintes ou aciers passifs (HA) pour les autres poutrelles.
UJIL REDA
24
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Hourdis
Un hourdis est une couche de remplissage de maonnerie (aussi appel entrevous)
constitue de bton, de terre cuite, de polystyrne (permet une isolation et une
pose avec plus de lgret)
Moellon
Un moellon est une pierre pour la construction, en gnral pierre de calcaire plus
ou moins tendre, taille partiellement ou totalement, avec des dimensions et une
masse qui le rendent maniable par un homme seul.
UJIL REDA
25
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Briques
La brique est un paralllpipde rectangle, en terre cuite au four, utilis comme
matriau de construction.
Bloc de bton
Le bloc de bton ou bloc de bton manufactur (abrg BBM) est un lment de
maonnerie moul. Le bloc de bton est couramment dsign selon les rgions
par : parpaing (abus de langage), agglomr , agglo , plot , plotet ,
moellon , quron , etc.
UJIL REDA
26
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Aciers
Les aciers employs sont de qualit haute adhrence Fe 500.
Les barres daciers devront tre parfaitement propres, sans aucune trace de
rouilles, de peinture ou de graisse.
UJIL REDA
27
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
RALISATION
SUR CHANTIER
Les informations et les documents ci-dessous sont bass sur les travaux de
construction dans leschantiers WAFAE (un projet des logements sociaux, divis en
4 parties I, II, II et IV et chaque partie est divise en 2 tranches) situ Sidi
Bouzekri, Mekns. Une partie entre dans le cadre du programme 6081
Logements faible valeur immobilire totale vendu forfait 140 000 DH, Lautre
comprend 108 logements Plafonns vendus 250 000 DH HT dune superficie
entre 62 et 65 m vendable.
Fiche technique du chantier:
Wafae
II
III
VI
Description
Tranche
Cette partie comporte 16
btiments de R+4 (8 btiments
pour chaque tranche) avec un
total de 280 appartements au
cot de 140 000 DH et 35
magasins.
Archite
cte
BET
Entrepris
e
Cette
partie
comporte
11
btiments de R+4 (5 btiments
pour le lot 1 et 6 pour le lot 2)
avec
un
total
de
188
appartements au cot de 140
000 DH et 21 magasins.
OUAZZA GECIC
NI
AD
TRICHA
GECIC
AD
BERRAD
A
Cette partie comporte 8
btiments de R+4 (4 btiments
pour chaque tranche) avec un
total de 257 appartements au
cot de 140 000 DH et 25
Cette partie comporte 6
btiments de R+4 avec un
total de 108 appartements au
cot de 250 000 DH et 24
magasins.
1
2
ETIJ-TRAD
ETIJ-TRAD
ETIJ-TRAD
FILIAL
ET
BAKA
KIL
FILIAL
ET
BAKA
KIL
BETAC
Lamzouri
BETAC
BAKKALI
Moyens du chantier :
Moyens humains :
UJIL REDA
28
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
La main-duvre qualifie assigne au chantier Al Wafae compte environ 30
travailleurs par partie rpartis en plusieurs quipes ce qui donne un totale de 120
ouvriers sur le chantier. La prsence continue des quipes au complet sur le terrain
nest pas requise tant que la tche laquelle elles ont t assignes na pas
encore dmarre. Une liste de prsence mise jour quotidiennement est tenue par
le comptable du chantier.
Moyens matriels : voire la 2eme partie(Matriels et matriaux).
Hirarchie du chantier :
La main-duvre au sein du chantier obit une stricte hirarchie et une
rpartition rflchie des diffrentes tches qui lui assurent organisation et efficacit
dans lexercice de son travail :
Le chef de chantier : Omniprsent, il veille lexcution convenable des
travaux dAl Wafae, on dnombre 4 chefs de chantier.
Les chefs dquipes :Ils ont pour rle la coordination entre le personnel de
chantier.
Le comptable de chantier : Il tient le journal du chantier qui rpertorie
absolument tout ce qui est relatif au droulement journalier des travaux.
Le chef de matriel :Il est responsable de lintgrit et de la distribution du
matriel au sein du chantier.
Les ouvriers qualifis (malem) : A la tte dun groupe de travailleurs, ils
ont un grand savoir-faire au vu de leur trs grande anciennet dans le mtier.
Les ouvriers non qualifis :Ils sadonnent aux multitudes de tches de
construction, le chantier naurait rien t sans eux.
Runions de chantier
UJIL REDA
Des runions de chantier se font hebdomadairement entre le matre
douvrage, la matrise duvre et lentrepreneur o lon fait le suivi des
travaux ; un PV de chantier numrot sur des manifolds ou des trifolds est
galement dress par le matre douvrage et la matrise duvre. Le PV est
un document contractuelle, il porte la liste des prsent sign prouvant leur
prsence et leur responsabilit. Ce document reporte ltat davancement
29
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
des travaux, des remarques et ventuellement des suggestions. Il est
tablit lors de la runion du chantier, c'est--dire une fois par semaine.
Rception provisoire et dfinitive
Aprs lachvement et le nettoyage des travaux, lentrepreneur
demande la rception des travaux par crit au matre douvrage par
lintermdiaire de la matrise duvre, en prsentant des certificats
conformit technique. En cas dimperfections, il est tenu de les corriger
dans un dlai fix par le matre douvrage et infrieur 3 mois.
Entre la rception provisoire et dfinitive (1 anne), lentrepreneur
demeure responsable des ouvrages.
LES
CORPS DTAT
GROS UVRES
Installation du chantier
Avant le commencement des travaux, lentrepreneur procde linstallation
gnrale du chantier qui comprend :
La mise en place de la clture de protection autour du chantier, il est en mtal, en
brique ou en bois.
La mise en place dun panneau de chantier comportant des informations sur le
projet (matre douvrage, matrise duvre, aperu sur le projet)
UJIL REDA
30
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
La construction dune salle de runion quipe dune table de 2x4 m, avec un
nombre suffisant de chaises et un tableau daffichage
La construction de deux bureaux qui doivent tre quips par des chaises et des
casiers de rangement, ces bureaux sont la disposition du matre douvrage et de
la matrise duvre
Le branchement deau, dlectricit, de tlphone, et des quipements sanitaires.
Implantation
Limplantation dfinitive des btiments seffectue obligatoirement par le
topographe agre par le matre douvrage et la matrise duvre suivant les plans
dexcution tablis par le BET.
Cette implantation est matrialise par :
Des bornes en bton parfaitement stable et places sur les axes principaux de
btiment
UJIL REDA
31
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Des points de blocs placs sur les cotes principaux de btiment construire.
Des chaises en planche (bois, gabariers) comportant les indices des diffrents axes
de btiment.
Terrassement
Le terrassement seffectue suivant les ctes seuils donnes par le topographe.Le
terrassement comprend les fouilles en masse, en rigole et puits dans tout terrain,
le dblai provenant de ces travaux en masse est vacu en dehors du chantier ou
sera rutilis en remblai sur place.
La reconnaissance et le contrle du bon sol seffectue dans la plupart des cas par
le laboratoire agr.
UJIL REDA
32
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Fondation
Les fondations dun ouvrage assurent la transmission et la rpartition des charges
(poids propre et surcharges climatiques et dutilisation) de cet ouvrage sur le sol.
Le mode de fondation sera tabli suivant la capacit portante du sol qui peut avoir
des qualits suffisantes pour y fonder louvrage ou des qualits mdiocres et dans
ce cas le sol ncessitera un renforcement.
Lassise des fondations de la construction doit se trouver sur le bon sol. (Il est
conseill de faire appel un spcialiste, gnralement un gotechnicien).
Le sol de fondations doit tre apte supporter le poids de la construction et ne
pas se dformer, c..d. ne pas tasser sous le poids quil reoit. En gnrale on
met une couche de bton de propret ayant une paisseur de 5 10 cm, variable
UJIL REDA
33
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
selon la nature du sol, sous toute la fondation de btiment. Ce bton a pour but
dempcher les souillures des semelles et de tracer prcisment les axes des
poteaux.
Semelles :
Il existe deux types de semelles :
1. Les semelles isoles : ce sont les fondations des poteaux. Leurs dimensions
de surface sont homothtiques celles du poteau que la fondation supporte
2. Les semelles filantes : ce sont les fondations des voiles.
Chanage et longrine
Chanage : pour ceinturer le btiment. Il est ralis en bton arm et repr sur
plan par des lettres majuscules CH.
Une longrine : cest un lment de structure ayant la forme d'une poutre et
oriente horizontalement, supportant des forces mcaniques importantes. Dans le
btiment, on rencontre plusieurs sortes de longrine :
fondation en radier ou sur pieux
linteau de fentre ou de porte
panne de charpente de toiture
etc.
Les poteaux
lments porteurs monodimensionnels verticaux, raliss en bton arm selon
les plans dexcution tablis par le BET. Leurs fonctions principale est de
concentrer de faon ponctuelle les charges de la superstructure et de les rpartir
vers les infrastructures de cet ouvrage (par exemple les fondations). Ils servent de
chanages verticaux, ils contribuent la stabilit de la construction. Ils servent
supporter les poutres, les planchers. Ils travaillent surtout en compression, mais ils
UJIL REDA
34
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
doivent galement supporter des efforts horizontaux et obliques, donc de travailler
en flexion, cest pourquoi, larmature est compose de barres longitudinales et des
cadres et ventuellement des triers en armature transversale. Le coffrage des
poteaux est une structure provisoire, utile pour maintenir le bton en place, en
attendant sa prise puis son durcissement. On distingue gnralement deux types
de coffrage selon la forme des poteaux : coffrage rectangulaire (dans ce cas il est
appel pilier)et coffrage circulaire(quon appelle colonne)
Les poutres
Une poutre est un lment porteur monodimensionnel horizontal, raliss en
bton arm suivant les plans tablis par le BET. Elle serve reprendre des charges
au dessus du vide, les poids de construction et du mobilier, et les transmettre sur
le ct aux piliers, colonnes ou aux murs sur lesquels elle sappuie. La poutrelle est
une poutre de faible section (moins de 20 cm dme). On peut classer les poutres
selon leur mode de fabrication en deux types :
Poutre prfabrique en atelier :
Dans cette classe on cite :Poutre en bton arm : utilis souvent comme
des poutrelles son avantage est de permettre une excution rapide mais son
inconvnient cest quelle demande une mains duvre qualifie et une
prcision de calcul et de montage surtout dans la vrification;
UJIL REDA
35
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Poutres prfabriques en bton arm utilises comme poutrelles de plancher
Poutre coule sur chantier :
Cest le type prpondrant dans les constructions des btiments, elle est
obtenue par un coffrage en bois dans lequel on place les armatures ncessaires
pour la rsistance -dtermin par les calculs- puis on coule le bton.
Avantages :
Facile dans la construction; Un cot moins lev par rapport
celui des poutres prfabriques
Inconvnients : la construction raliser par ce type de poutre demande un
temps considrable pour le durcissement du bton
Voiles:
UJIL REDA
36
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
lments porteurs bidimensionnels verticaux, raliss en bton arm suivant les
plans tablis par le BET. Ils servent donner la structure une rsistance plus
grande contre les ondes sismiques.
Escalier
Dans cette partie nous allons faire une description gnrale de la construction des
escaliers : Dans un premier temps on trace les positions des escaliers sur les
planches latrales en respectant les mesures du plan darchitecte. Dans un 2 me
temps on place les planches les unes prs des autres pour arriver construire le
socle des escaliers comme le montre la photo ci-dessus. Dans un 3 me temps on
pose le ferraillage et on installe le coffrage des pas des escaliers en se basant sur
le traage dj mentionn dans la 1 re tape. Dans un 3 me temps on pose le
ferraillage et on installe le coffrage des pas des escaliers en se basant sur le
traage dj mentionn dans la 1 re tape. La dernire tape consiste couler le
bton
UJIL REDA
37
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Les dalle:
Dalle creuse
Cest le type le plus frquent dans les constructions des planchers des
btiments. Cette dalle qui est la moins coteuse, est ralise par coulage dune
couche de bton sur un rseau dhourdis et dacier. On ladopte lorsquil y a un bon
emplacement des appuis (poteaux, poutres).
En gnral la porte des dalles creuses ne dpasse pas 5m, et dans ce cas leur
paisseur est 15cm+5cm1. Cependant, si cette porte dpasse 5m tout en restant
infrieur 6m2 on passe au mode 20cm+5cm. Ses avantages cest quelle est
moins coteuse par rapport aux autres types et son poids propre est petit face
une bonne inertie.
Voici une description gnrale de la construction de la dalle creuse :
1) Dposer le chanage sur le mur. On veillera ce qu'il soit pos 3cm du
bord du mur afin que le bton puisse passer correctement pour viter tout
clatement du bton en vieillissant
UJIL REDA
38
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
2) Dposer les poutrelles sur les murs (la poutrelle doit dpasser de 5cm
minimum sur le mur). Elles doivent toutes tre espaces les unes des autres
afin d'y dposer les hourdis entre elles, la distance entre deux poutrelles est
fonctions des hourdis utiliss (hourdi 12 ou 15 ).
3) Sur la bordure des murs dposer, entre les poutrelles, des hourdis ferms
ct mur.
4) Poser ensuite tous les hourdis sur les poutrelles :
UJIL REDA
39
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
5) Dposer le treillis soud sur l'ensemble et l'attacher sur le chanage
Idalement cette tape du plancher, il faut insrer les armatures
mtalliques des poteaux. De cette manire les armatures des murs seront
attaches l'armature du plancher ce qui permet d'amliorer la cohrence
de l'ensemble
6) ensuite couler le plancher. Ce qui masquera tous ces lments.
UJIL REDA
40
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Dalle pleine
Cest une dalle construite, seulement, par coulage du bton sur un rseau dacier.
On lutilise dans le cas o la solution de la dalle creuse ne peut pas tre adopt
vue le manque dappui. Aussi, cest une solution idale pour les lments
dcoratifs gomtrie complique (Exemple : les balcons de forme courb).
La dalle champignon, qui est une des dalles pleines, conue dans le cas de
grandes portes (Elle peut atteindre jusqu 16m).
Murs
Les murs de faade et de pignons forment lextrieur de la construction. Ils sont
raliss soit en briques de 12 trous, soit en agglomres de ciment.
Les murs de cloison, situs lintrieur des locaux ne supportent aucune charge ;
ce sont des cloisons simples creuses en brique de 6 trous.
Linteaux : excuts en bton arm, ils sont poss au dessus des baies.
UJIL REDA
41
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Enduit
Sur les faades, lenduit est ralis suivant les indications des plans dexcution en
deux couches aprs une imbibition correcte de support :
Une couche de dgrossissage impermable.
Une couche de finition au mortier dit FINO .
Aux raccordements entre la maonnerie enduite et le bton arm, il sera plac
sous lenduit une bande de grillage une largeur de 40 cm.
Pour les cloisons intrieures, lenduit est excut en deux couches :
Une premire couche dpaisseur ne dpasse pas 1 cm au mortier.
Une deuxime couche de finition de 0.5 mm dpaisseur dite FINO.
UJIL REDA
42
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Dans tous les angles saillants, il sera plac des bandes mtalliques de protection.
Second uvre
Branchement deau potable et dlectricit
De faon gnrale, lentrepreneur est procd doter chaque btiment par un
rseau deau potable et dlectricit.
Plomberie
La premire tche incombant au plombier son premier passage est la mise en
place de rseaux dalimentation et dvacuation desservant lensemble du
btiment :
Lalimentation : Le plombier installe une nourrice au sein du local technique
au rez-de-chausse. Celle-ci abrite : Une bouteille qui alimente en eau
chaque appartement par des colonnes montantes (traversant les mmes
gaines accueillant lalimentation en lectricit), un robinet darrt, exclusif
UJIL REDA
43
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
la rgie, en amont de la bouteille et plusieurs robinets darrts, relatifs au
propritaire de chaque appartement, sur toutes les colonnes montantes.
Il met en place dans chaque appartement un autre robinet darrt et un
coffret collecteur qui se chargera dacheminer, par le biais de conduites en
retube, leau froide (retube bleu) et leau chaude (retube rouge) vers tous les
points deau du local (leau froide faisant un petit dtour vers le chauffe-eau
avant dtre nouveau collecte par le coffret puis redistribue).
Il entreprend au final un essai de pression pour vrifier ltat de son
installation et dbusquer dventuelles fuites dans les conduites. Ce test
consiste : Boucher les sorties pour robinet, mettre leau sous pression,
patienter 24 48 h et observer le comportement du manomtre (si la valeur
que son aiguille indique varie au cours du temps cest quil y a une fuite au
niveau des conduites).
Lvacuation : Le plombier encastre dans les murs des conduites lgrement
inclines appeles vidanges. Ces dernires relieront directement les futurs
sanitaires aux chutes (ou descentes) qui elles sont verticales, passent le plus
souvent par des gaines daration et dbouchent sur un regard.
La pose des sanitaires, objet du second passage du plombier, dpend de la
nature du sanitaire mettre en place. En effet, tandis que les toilettes turques,
lvier, la douche et la baignoire sont fixs avant le revtement sol, les toilettes
langlaise, le lavabo, le bidet et les vasques sont fixs aprs. Enfin, la robinetterie
est pose immdiatement avant la remise des cls de lappartement son
heureux propritaire.
En rsumant, les travaux raliser comprennent essentiellement :
Lalimentation en eau potable partir du rseau de la ville
Les postes de comptage (nourrices)
La distribution interne deau.
Les vacuations des eaux uses, vannes et pluviales jusquaux regards.
La pose des appareils sanitaires, siphons du sol et des robinets.
Electricit
UJIL REDA
Les travaux excuter comprennent :
Les boites de distribution
La boite de coupure gnrale
44
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
Des tableaux en bois pour le compteur.
N.B : ces travaux sont effectus en coordination avec les agents de la
RADEEM.
Etanchit
Excution des formes de pente.
Application du feutre bitumineux :
On utilise ltanchit multi couches (trois couches), chaque couche comportant du
feutre pos sur le bitume ; le tout sur le bton de forme. Sur les trois couches on
ajoute une dernire couche de bitume seul, pour couvrir ensuite dun bton de
forme pour le revtement.
Revtement
Revtement en granito
Les tapes dexcution du revtement sont comme suit :
Nettoyage du sol.
Bton de forme.
Emplacement des baguettes.
Imbibition par leau.
Bton en gravettes.
Compactage.
Frottement par machine (ponage).
Revtement en carreaux
Contraintes de pose : planitude des carreaux, alignement des joints.
Peinture
Les travaux raliss sont :
-La peinture vinylique sur toutes les faades extrieures.
-La peinture vinylique sur enduit a lintrieur des logements (murs et plafonds).
-La peinture glycrophtalique laque dans les salles deau et les cuisines.
UJIL REDA
45
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
-La peinture glycrophtalique laque sur chutes et conduits apparentes.
-La peinture glycrophtalique laque sur les menuiseries bois et mtalliques.
-La peinture tanche ou dimpermabilisation.
CONCLUSION
Ce stage qui a dur un mois au sein de la societe Holding dAmenagement
Al Omrane Meknesma permis dapprofondir certaines de mes connaissances
et dacqurir dautres expriences notamment en matire dorganisation des
quipes de travail et des modes dexcution des travaux sur chantier.
Mais ces acquis nont pas pu tre raliss sans avoir surmonter des
difficults dont quelques unes sont prsentes dans ce qui suit.
Parmi ces difficults la fatigue cause par la navette. Nous devions
parcourir deux fois par jour une distance aux environsde 10 km pour aller au
chantier. Mais en regardant les choses du ct positif je me rendu compte
quil est intressant davoir eu cet avant-got de mon futur mtier aussi plein
dpuisement.
Mais sans doute la difficult majeure consistait assimiler les nouveaux
termes techniques et comprendre le discours de mes encadrants en
labsence dun bagage technique. En effet, les cours dispenss en 1re
anne ne sont en gnral que des sciences de bases et de prparations
(ncessaires) pour la formation dun futur ingnieur en gnie civil. Pour
surmonter cette difficult, je nai pas hsit demander plus dexplications
UJIL REDA
46
EMI
Rapport de stage dInitiation Professionnelle
Aout 2011
de la part des ingnieurs ou des techniciens et chercher sur le web les
notions qui nous taient trangres.
Mais il faut signaler que certains cours mtaient dune grande utilit
telsque lurbanisme qui ma facilit la lecture des rapports techniques et la
topographie qui ma aid lire et utiliser les cartes et les plans des projets.
UJIL REDA
47
EMI
Vous aimerez peut-être aussi
- Guide Chef de ProjetDocument197 pagesGuide Chef de ProjetMïřå Dąnìa100% (2)
- Rapport Final HAODocument58 pagesRapport Final HAOimac36Pas encore d'évaluation
- Centre National de DocumentationDocument40 pagesCentre National de DocumentationtardawiPas encore d'évaluation
- Reglement Type Des Concours DarchitectureDocument7 pagesReglement Type Des Concours DarchitecturefafaPas encore d'évaluation
- Société Al Omrane OujdaDocument24 pagesSociété Al Omrane OujdaHayate ZaherPas encore d'évaluation
- EmsiDocument28 pagesEmsiMehdi BesriPas encore d'évaluation
- AO - 44 CPS - Etudes & Suiv - VRD Al Andalous PDFDocument30 pagesAO - 44 CPS - Etudes & Suiv - VRD Al Andalous PDFlay thPas encore d'évaluation
- Rapport Du Projet de Fin Détude GC2 2Document69 pagesRapport Du Projet de Fin Détude GC2 2MMAYFDPas encore d'évaluation
- RAPORT AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvDocument31 pagesRAPORT AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvsaif nacer4Pas encore d'évaluation
- Rapport Erraoui MalihDocument35 pagesRapport Erraoui MalihAchraf Boujengout100% (1)
- Stage D'observation KADDocument14 pagesStage D'observation KADKhadija Ait Baba KhaiyPas encore d'évaluation
- Management Des Eses Du BTP - CoursDocument11 pagesManagement Des Eses Du BTP - CoursMouna elhPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage AbbiirDocument66 pagesRapport de Stage AbbiirAmine MedPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Ministère de L'équipement 2020Document32 pagesRapport de Stage Ministère de L'équipement 2020Manal ZahidiPas encore d'évaluation
- Revue 4 C1 Rapport D'anticipation - L - B - STADES - 2019 Avec OS Demarrage REVU LE 26052018Document57 pagesRevue 4 C1 Rapport D'anticipation - L - B - STADES - 2019 Avec OS Demarrage REVU LE 26052018Pascal NzomoPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage CompletDocument12 pagesRapport de Stage CompletHama SlimPas encore d'évaluation
- 03 - Cps - Plateaux de Bureaux - Tarik Elkheir 7 - v2Document118 pages03 - Cps - Plateaux de Bureaux - Tarik Elkheir 7 - v2walidPas encore d'évaluation
- Memoire DIALLO OusmaneDocument30 pagesMemoire DIALLO OusmaneSoumana Abdou100% (1)
- Mon RapportDocument20 pagesMon RapportDjalal BellourPas encore d'évaluation
- Encadrements PFE - Mise À Jour DéfinitiveDocument1 pageEncadrements PFE - Mise À Jour DéfinitiveRajaa KodadPas encore d'évaluation
- Module 3 La Bonne Gouvernance Dans Les Marchés PublicsDocument24 pagesModule 3 La Bonne Gouvernance Dans Les Marchés PublicselhajjabnabilPas encore d'évaluation
- 2 Du Projet Au Chantier de Travaux PublicsDocument29 pages2 Du Projet Au Chantier de Travaux PublicsAmine MakachouPas encore d'évaluation
- R+ - Sum+ - Du Rapport PDFDocument5 pagesR+ - Sum+ - Du Rapport PDFmouhssinePas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 2emeDocument26 pagesRapport de Stage 2emeHamza KahlounPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage BTS R+4Document49 pagesRapport de Stage BTS R+4Othman BeePas encore d'évaluation
- These AbouzahirDocument157 pagesThese AbouzahirAnous AlouliPas encore d'évaluation
- Rapport - Pfe 2020Document203 pagesRapport - Pfe 2020Hanane FathiPas encore d'évaluation
- Examen de Fin de Formation 2009 Pratique Tsgo Gros Oeuvre Variante 16Document4 pagesExamen de Fin de Formation 2009 Pratique Tsgo Gros Oeuvre Variante 16Ahmed MaadoudiPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage OuvrierDocument16 pagesRapport de Stage OuvrierduboisPas encore d'évaluation
- Stage D'initiationDocument22 pagesStage D'initiationEDERRAZ AbdessmadPas encore d'évaluation
- Projet RouteDocument17 pagesProjet RouteMahmoud BouzidPas encore d'évaluation
- Ahmed Azami HassaniDocument27 pagesAhmed Azami HassanisalimPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage CEHDocument46 pagesRapport de Stage CEHHouzad KhaoulaPas encore d'évaluation
- Key Covadis 64bitDocument1 pageKey Covadis 64bitAlmou SlimanePas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Ouvrier 203014Document20 pagesRapport de Stage Ouvrier 203014Brahim Mbarek0% (1)
- DehmiDocument25 pagesDehmiYounes DehmiPas encore d'évaluation
- Suivi Et Contrôle de Chantier D'un ProjetDocument112 pagesSuivi Et Contrôle de Chantier D'un Projetyamyamina701100% (1)
- Soutenance de StageDocument15 pagesSoutenance de StageYassir BennaniPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 2013-2014Document11 pagesRapport de Stage 2013-2014Marouane EzzaimPas encore d'évaluation
- Le Controle de Gestion D Un Projet de Genie CivileDocument82 pagesLe Controle de Gestion D Un Projet de Genie Civilefati100% (2)
- Startimes 2 RAPPORT DE STAGE Esa Fta L MegaDocument37 pagesStartimes 2 RAPPORT DE STAGE Esa Fta L MegaMoulay Nabil EL Baraka100% (1)
- Expose VRD PDFDocument29 pagesExpose VRD PDFGérard Claude Essome100% (1)
- Rapport Stage Ip Dret - Ehtp 12Document49 pagesRapport Stage Ip Dret - Ehtp 12khoudix100% (4)
- Rapport Sado 2Document41 pagesRapport Sado 2Auber CartensenPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage 2017Document26 pagesRapport de Stage 2017el ghaliPas encore d'évaluation
- Aide Au Contrôle de L'exécution Des Marchés PublicsDocument34 pagesAide Au Contrôle de L'exécution Des Marchés PublicsAnonymous RuB6o4Pas encore d'évaluation
- NG - 047 2020 Agadir MobilitéDocument11 pagesNG - 047 2020 Agadir Mobilitécivil ingénieur learningPas encore d'évaluation
- LPEE Mag 63 - 0Document17 pagesLPEE Mag 63 - 0Hicham El BazidiPas encore d'évaluation
- FREDYDocument47 pagesFREDYRicardo Tientcheu100% (1)
- IGAT Seminaire MarocDocument31 pagesIGAT Seminaire MarocRtui MedPas encore d'évaluation
- Rapport-dactivité-2021 - 副本 PDFDocument55 pagesRapport-dactivité-2021 - 副本 PDFPICASSO LINPas encore d'évaluation
- Rapport Stage ADMDocument32 pagesRapport Stage ADMsoukaina boufraPas encore d'évaluation
- Pfe 2020 - Senoussi & RahmounDocument134 pagesPfe 2020 - Senoussi & Rahmounaaer100% (1)
- Rapport de StageDocument33 pagesRapport de StageIswaam EndemiPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument29 pagesRapport de Stageanas ezzariPas encore d'évaluation
- Rapport de ProjetDocument37 pagesRapport de ProjetChatnoir NoirPas encore d'évaluation
- ADMONEO - Accompagnement Pour Des Eěvaluations ImmobilieĚres - Valuation - Deěcembre 2021Document26 pagesADMONEO - Accompagnement Pour Des Eěvaluations ImmobilieĚres - Valuation - Deěcembre 2021bendiPas encore d'évaluation
- Rapport Pfe Final - Khalid FreikechDocument108 pagesRapport Pfe Final - Khalid Freikechoussama zairPas encore d'évaluation
- La Conduite D'Un Projet D'Expertise D'Evaluation Immobiliere Par La QualiteDocument80 pagesLa Conduite D'Un Projet D'Expertise D'Evaluation Immobiliere Par La QualiteHaithem KiassaPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage A&bDocument38 pagesRapport de Stage A&bjihan100% (1)
- La passation et l'exécution des marchés publics: Secteurs classiques et spéciauxD'EverandLa passation et l'exécution des marchés publics: Secteurs classiques et spéciauxPas encore d'évaluation
- Travaux de PlomberieDocument15 pagesTravaux de PlomberieMeryem Ben100% (1)
- Epa Plaine de France Cahier Des ClausesDocument33 pagesEpa Plaine de France Cahier Des ClausesEric VeillonPas encore d'évaluation
- Guide de Passation de MarchésDocument97 pagesGuide de Passation de MarchésDounia ElkPas encore d'évaluation
- UntitledDocument24 pagesUntitledMairie de LannoyPas encore d'évaluation
- Quentin Gaucher - Rapport HMONPDocument32 pagesQuentin Gaucher - Rapport HMONPquentingaucher100% (1)
- Ccap VRD TerrassementDocument29 pagesCcap VRD TerrassementTopina RahimPas encore d'évaluation
- Axigom TubeDocument67 pagesAxigom TubeTwistandflyPas encore d'évaluation
- Stage Fin Détude Architecet InterieurDocument144 pagesStage Fin Détude Architecet InterieurSihem Allaoui KhemiliPas encore d'évaluation
- Guide Pratique Des VRD Et Aménagements Extérieurs, Gérard KARSENTY (Eyrolles)Document19 pagesGuide Pratique Des VRD Et Aménagements Extérieurs, Gérard KARSENTY (Eyrolles)Chaimaa EnnouhiPas encore d'évaluation
- C.C.T.P.Terrassement, Voirie Et Assainissement PDFDocument34 pagesC.C.T.P.Terrassement, Voirie Et Assainissement PDFmolk kallelPas encore d'évaluation
- Manuel QualitéDocument43 pagesManuel Qualitésa50% (2)
- Cahier Des Clauses Administratives Générales (CCAGT)Document47 pagesCahier Des Clauses Administratives Générales (CCAGT)Alawi SanaePas encore d'évaluation
- Cps Old HamdaneDocument50 pagesCps Old HamdaneDounia ElPas encore d'évaluation
- FRDocument41 pagesFRLoubna El MouttaqiPas encore d'évaluation
- Mediapart PPP VinciDocument10 pagesMediapart PPP VinciPhilippe BlandinPas encore d'évaluation
- Cps Etudes Hopital Kser KebirDocument43 pagesCps Etudes Hopital Kser Kebirbaddi_h100% (2)
- Guide Efficacite Energetique Bâtiment Et CollectivitésDocument30 pagesGuide Efficacite Energetique Bâtiment Et CollectivitésComener Eelv100% (3)
- Ccag Emo 2002Document28 pagesCcag Emo 2002Steve StefllerPas encore d'évaluation
- Guide Systèmes PV Sur Toiture-TerrasseDocument52 pagesGuide Systèmes PV Sur Toiture-Terrassesalem BEN MOUSSAPas encore d'évaluation
- TICGPDocument83 pagesTICGPCarlito BaffassePas encore d'évaluation
- 310 - CCTP DPGF Lot 10 e LectriciteDocument34 pages310 - CCTP DPGF Lot 10 e Lectricitemaillon38Pas encore d'évaluation
- Identification Des Parties Prenantes / Stakeholders IdentificationDocument14 pagesIdentification Des Parties Prenantes / Stakeholders Identificationb-adrham6649Pas encore d'évaluation
- Montage D'un ProjetDocument43 pagesMontage D'un ProjetGael BayalaPas encore d'évaluation
- TCHEDRE Abala-TchidjaDocument60 pagesTCHEDRE Abala-TchidjaPolo100% (1)
- Fourniture de Granulats Destines Aux Travaux RoutiersDocument102 pagesFourniture de Granulats Destines Aux Travaux RoutierscherquiPas encore d'évaluation
- Aoo 334 15 PDFDocument190 pagesAoo 334 15 PDFHassan BaddiPas encore d'évaluation