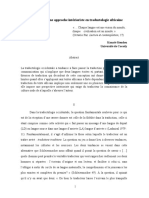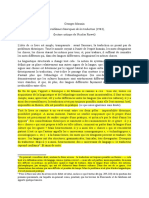Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
BERMAN
BERMAN
Transféré par
Morgana Delle DonneCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
BERMAN
BERMAN
Transféré par
Morgana Delle DonneDroits d'auteur :
Formats disponibles
Berman - Power Point
Francese 5
Lingua Francese
Università degli Studi di Salerno
33 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Sommaire
1. Introduction
2. Traduction ethnocentrique et traduction hypertextuelle
3. Les origines de la Traduction Ethnocentrique
4. Les formes de hypertextualité
5. L’analytique de la traduction et la systématique de la déformation
6. Tendances déformantes
7. L’éthique de la traduction
8. Hölderlin, ou la traduction comme manifestation
9. Les Intensifications
10. Les Modifications
11. Chateaubriand, traducteur de Milton
12. L'Énéide de Klossowski
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
INTRODUCTION
Le texte de Berman est la version remaniée du séminaire déroulé au Collège
International de Philosophie en 1984.
La traduction est sujet et objet d’un savoir propre. Le point de départ est la
traduction en tant qu’expérience des œuvres, des langues, de l’essence de la
traduction.
Qu’est-ce que la traductologie? Méditer sur la totalité des formes existantes de la
traduction
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
TRADUCTION ETHNOCENTRIQUE ET TRADUCTION
HYPERTEXTUELLE
Il faut distinguer entre deux formes traditionnelles de la traduction littéraire, qui
son les plus communes et utilisées depuis des siècles, considérées comme
indépassables. C’est à dire la traduction ethnocentrique et la traduction
hypertextuelle.
Selon Charles-Pierre Colardeau la traduction doit perfectionner l’originale et
l’embellir.
Traduction Ethnocentrique: Tout est lié à sa culture, ses valeurs et normes.
L’étranger est considéré comme négatif ou même positif afin d’enrichir la culture.
Traduction Hypertextuelle: réécriture intentionnelle d’un texte déjà existant.
On fait référence à un texte qui s’engendre par imitation, parodie, adaptation,
plagiat.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
LES ORIGINES DE LA TRADUCTION ETHNOCENTRIQUE
La traduction ethnocentrique est une réalité historique, qui est naît à Rome où
tous les textes grecs étaient traduits et cette entreprise de la traduction est le
vrai sol de la littérature latine et elle s’effectue par l’annexion systématique des
textes, des formes, des terms grecs, tout étant latinisé.
Le syncrétisme, c’est-à-dire une combinaison peu cohérente de doctrines et de
systèmes, caractérise la traduction ethnocentrique et hypertextuelle. Il se
retrouve aussi dans l’art romain.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Cette entreprise de traduction existe grâce à ses théoriciens Cicéron et Horace
mais en particulier grâce à la traduction de la Bible de Saint Jérôme. Il affirme
que la traduction ne doit pas être «mot – à – mot»
mais elle doit exprimer le sens.
Ses principes remontent à:
Saint Paul, qui distingue entre l’esprit et la lettre.
Platon, qui fait une distinction entre «sensible»
et «intelligible», «corps» et «âme».
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Il existe une impulsion à la traduction: à l’impulsion de traduction s’ajoute
l’impulsion du christianisme. Il faut que tous peuvent entendre la parole de
Dieu et donc pour cette raison il est nécessaire de traduire.
On parle de traduction pour et pas de traduction par. C’est une entreprise qui
ne s’est jamais arrêtée.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Il faut distinguer entre:
• Sens: un être en soi, une idéalité invariante qui passe d’une langue à l’autre.
Le but de la traduction est la captation du sens qui doit être détaché de sa
lettre (corps).
• Corps: c’est – à dire le signifiant du texte.
La traduction est le résultat de l’unité des langues. Si on suit la fidélité du sens,
on perd nécessairement la fidélité à la lettre, donc à la forme du texte.
Il faut que le sens soit transmis de la langue de départ (langue-source) à la
langue d’arrivée (langue-cible) parce que cette captation enferme le sens dans
une autre langue.
Cela est l’essence de la traduction ethnocentrique qui considère sa langue
comme supérieure et introduit le sens étranger de façon que le texte traduit ne
semble pas une traduction mais un texte écrit dans sa propre langue.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
La traduction:
doit se faire oublier en faisant disparaitre tous les traces de la langue
d’origine.
doit être écrite dans une langue normative.
ne doit pas heurter les étrangetés lexicales ou syntactiques.
doit assurer que le lecteur d’arrivé et le lecteur d’origine aient la même
impression du texte, donc on doit assurer le même effet en respectant le
texte d’origine.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Il est nécessaire masquer la traduction: une œuvre qui ne sent pas la
traduction a été écrite d’une bonne langue. C’est le point où la traduction
ethnocentrique devient traduction hypertextuelle.
La relation hypertextuelle unit deux textes, l’un antérieur à l’autre: un texte
peut être imité, pastiché, parodié, commenté.
Les exigences de la traduction ethnocentrique conduisent le traducteur à
effectuer des opérations hypertextuelles.
Le traducteur traduit quelquefois littéralement et quelque fois librement,
quelquefois il pastiche ou adapte; toute traduction comporte une part de
transformation hypertextuelle.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Beaucoup de poètes ont traduit d’autres poètes en se prenant des libertés qui ont
donné vie à des traductions qui sont en effet des recréations libres.
Il s’agit de formes hypertextuelles poétiques qui ne doivent pas être confondues
avec des traductions.
Historiquement la poésie est intraduisible donc elle ne peut pas être traduite à
cause du rapport entre le « son » et le « sens ». L’intraduisibilité de la poésie
constitue un valeur. Un poème intraduisible est un poème vrai.
Traduire ne signifie pas créer mais elle est seulement une hypertextualité servile,
en effet si une traduction est plus libre, elle est taxée de trahison. Beaucoup de
traducteurs s’excusent à l’avance pour l’imperfection de leur traduction.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
LES FORMES DE HYPERTEXTUALITÉ
1. Imitation et pastiche: ce sont les formes le plus proches à l’acte de traduire
parce qu’ils créent un nouveau texte sur la base des traits stylistiques d’un texte
d’origine. Le traducteur reproduit le système stylistique d’une œuvre et il utilise
aussi l’accentuation (comme dans le pastiche) de certains éléments afin de
compenser la perte de certains d’autres.
2. Transformation et Adaptation: dont les différences ne sont pas trop nettes.
3. Accommodation: c’est-à-dire la censure, coupure ou déguisement de l’original.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
L’ANALYTIQUE DE LA TRADUCTION ET LA SYSTÉMATIQUE
DE LA DÉFORMATION
Dans toutes les traductions opère un système de déformation des textes.
L’opération qui permet d’examiner cette déformation est appelée analytique
de la traduction :
L’ analyse au sens cartésien: on analyse ce système de déformation partie
par partie.
L’ analyse au sens psychanalytique:
ce système présente des forces qui
dévient la traduction de sa pure
visée.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
TENDANCES DÉFORMANTES
Les tendances déformantes plus communes qui concernent la prose littéraire sont:
1. Rationalisation: déforme l’original en modifiant la structure de la phrase ou des
séquences des phrases pour les arranger dans un ordre différent.
2. Clarification: on tend à clarifié le texte original s’ il résulte être indéfini ou celé.
Donc elle vise à rendre clair ce qui ne l’est pas et ne veut pas l’être dans
l’original.
3. Allongement: quand la traduction est plus longue que l’original c’est
généralement une conséquence des premières deux tendances: rationalisation
et clarification qui exigent un allongement du texte.
4. Ennoblissement: c’est une ré – écriture de l’original, un exercice de style,
parque la traduction est plus belle que l’original d’un point de vue formel et
esthétique, donc on produit des phrases élégantes.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Tendances déformantes
5. Vulgarisation: on vulgarise le texte par exemple en utilisant un langage
parlé.
6. Appauvrissement qualitatif: une perte lexicale parce qu’on a moins de
signifiants dans la traduction par rapport à l’original.
7. Homogénéisation: tendance à unifier, à homogénéiser l’original.
8. Destruction des rythmes: quand la traduction brise la tension rythmique
de l’original.
9. Destruction des réseaux signifiants sous-jacents : la traduction ne transmet
pas les réseaux de signifiants clés sous la surface du texte.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
TENDANCES DÉFORMANTES
10. Destruction des systématismes textuels: la traduction ne respect pas le
systématisme de l’original, par exemple les types de phrases ou les
constructions utilisées, les subordonnées, etc.
11. Destruction des réseaux langagiers vernaculaires: par exemple des diminutifs,
remplacement des verbes actifs par des verbes avec substantifs.
12. Destruction des locutions et idiotismes: utiliser des équivalents d’une locution
ou d’un proverbe mais traduire n’est pas chercher des équivalences.
13. Effacement des superpositions de langues: quand dans le texte original il y a
plusieurs langues mais dans la traduction ce superposition est éliminé.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
L’ÉTHIQUE DE LA TRADUCTION
Avec la théorie de la traduction, on pense généralement à la traduction comme
une transmission de messages d’une langue-source à une langue-cible. On met
sur le même plan la traduction d’un texte technique et celle d’une œuvre, mais
un texte technique transmet des informations, une œuvre ne le fait pas.
On doit analyser le concept de communication:
• Traduction: processus de communication, de transmission de messages
d’une langue de départ (langue source) à une langue d’arrivée (langue-cible).
• Texte technique: message visant à transmettre de manière univoque une
certaine quantité d’information.
• Œuvre: elle ne transmet aucune espèce d’information, même si elle en
contient.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Le traducteur traduit pour un public, mais il est ainsi conduit à la trahison
du texte original et donc il trahit aussi son public parce qu’il présente une
œuvre «arrangée».Il ne pense qu’à la communication, qui devient non-
communication donc l’essentiel de la langue est perdu.
L’écrivain écrit pour un public.
Selon Berman la visée ultime de la traduction est triple: éthique, poétique et
philosophique. En ce qui concerne la visée éthique, on parle d’exactitude et
de fidélité de la traduction.
La langue d’arrivée devient un auberge qui accueille l’œuvre étrangère en
préservant l’étrangeté. Donc, la traduction est animée du «désir d’ouvrir
l’étranger à son propre espace de langue».
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
HÖLDERLIN, OU LA TRADUCTION COMME
MANIFESTATION
Humboldt dans la préface à sa traduction de l’Agamemnon d’Eschyle, déclare que
le texte traduit doit apparaître étranger sans produire un effet d’étrangeté.
Ce principe porte avec lui des limites: on traduit fidèlement sans rendre les
obscénités verbales.
Il modifie le texte d'une façon nouvelle et presque arbitraire: il opère le passage
par l'étranger pour accéder au propre en questionnant le mouvement circulaire de
la Bildung. Il oppose deux mouvements simultanés:
L'épreuve de l'étranger
L'apprentissage du propre
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
L'art grec, pour le poète, a pour élément originel le feu du ciel et pour le
dominer il utilise la maîtrise de son opposé: la clarté de l'exposition, c'est-à-
dire la sobriété, la rationalité du logos, mais ce faisant il renie sa propre origine.
L’art occidental, au contraire, a pour principe la «clarté de l’exposition» et il a
dû conquérir le «feu du ciel» qui est pour lui la dimension la plus étrangère.
Par conséquent, chacun a fini par exceller dans ce qui lui est le plus opposé.
Statut double de la traduction de Hölderlin: il dégage, dans l’œuvre grecque, le
feu du ciel; mais au même temps il la rapproche de nous en la rendant plus
sobre qu’elle ne l’est réellement.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Quatre opérations précises:
Une traduction littérale/étymologisante
Une traduction utilisant le vieil allemand, le souabe, le langage piétiste
Des intensifications de l'original
Des modifications du texte de Sophocle
Au début de la pièce, Ismène interpelle de la sorte Antigone (vers 21):
- τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος
Hölderlin choisit de traduire le verbe καλχαίνω selon son sens premier de « avoir
la couleur de la pourpre », et non selon son sens dérivé « etre sombre,
tourmenté ».
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Cela donne en allemand: Was ist's, du scheinst ein rottes Wort zu färben?
Littéralement: Qu'y a-t-il? Tu semble teindre une rouge parole.
Hölderlin a choisi une hyper-littéralité, une connexion entre s'assombrir et avoir la
teinte de la pourpre. La traduction "archaïsante" du verbe καλχαίνω n'est pas un
point de dètail, car Hölderlin, en choissisant le sens originaire
du mot, dévoile le feu du ciel, l'enthousiasme excentrique,
qui est l'élément celé de la pièce.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
LES INTENSIFICATIONS
Intensification est le terme employé pour décrire les accentuations introduites par
Hölderlin dans la traduction de Sophocle. Il dépasse le texte grec en le rendant
plus violent.
Là où Grosjean traduit: Voilà celle qui a commis le délit. Nous l'avons surprise à
enterrer. Où est Créon? (v.384-385)
L'allemand est nettement plus brutal: Die ists. Die hats gethan. Die griffen wir, da
sie das Grab gemacht, doch wo ist Kreon? (v.400- 401)
Re-traduit en français: C'est elle. C'est elle qui l'a fait. Nous l'avons prise à
fabriquer le tombeau. Mais où est Créon?
Dans le vers, le poète a voulu dégager ce qui, chez Sophocle, renvoie au « feu du
ciel », en accentuant une description qui lui paraissait trop statique ou
conventionnelle.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
LES MODIFICATIONS
Les modifications les plus frappantes sont celles qui regardent les noms des dieux.
Hölderlin les élimine très souvent, en les remplaçant par d'autres nominations:
• Zeus: père de la Terre
• Eros: esprit de l'Amour ou Esprit de la Paix
• Ares: esprit de la Guerre
• Aphrodite: la divine Beautè
• Bacchus: le dieu du Plaisir
Les nouvelles appellations font signe vers l'essence des figures divines dans leur
originalité orientale, mais en rebaptisant les dieux « Esprit », « Père », etc.,
Hölderlin les rapproche de notre mode de représentation, les occidentalise - car
pour nous, la divinité est Esprit.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
CHATEAUBRIAND, TRADUCTEUR DE MILTON
Dans les années 1800 en France, on a un grand mouvement de traduction qui rompt
avec la traduction classique des « belles infidèles » et s'attache aux particularités
des originaux.
Chateaubriand choisit de traduire le Paradise Lost de Milton littéralement, avec une
intense latinisation de l'anglais. Il traduit Milton à partir du modèle des traductions
latines. Il y a une correspondance frappante entre le détour du traducteur et
l’écriture de l'auteur, qui passe par la latinisation de l'anglais.
La littéralité de Chateaubriand n'est pas un « mot à mot » scolaire ou philologique.
Le but c'est de rendre les divers niveaux étayés de l'original et son épaisseur
signifiante.
La traduction de Chateaubriand est en prose, non en vers. Traduire Milton en prose
n'est pas forcément le trahir, mais lui faire subir une transformation, notamment en
ce qui concerne la tension rythmique. C'est une traduction avec une prose poétique.
C’est, en soi, déjà une traduction.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Cette traduction est une re-traduction. Celui qui re-traduit n’a plus affaire à un
seul texte, l’original, mais à deux: l’original et la première traduction.
La traduction littérale est forcément une re-traduction, et vice-versa. Dans
Chateaubriand: la traduction littérale est l’expression d’un certain rapport à la
langue maternelle (qu’elle violente forcément).
Face à l’original et à sa langue, le premier mouvement du traducteur est
d’annexion et le second (la re-traduction) est d’investissement de la langue
maternelle par la langue étrangère.
Dans le seconde livre du Paradis Perdu on trouve la répétition du mot "many" qui
a été traduit par Chateaubriand avec le vieux mot français « maintes », parce qu'il
donne à la fois la traduction littérale et la même consonance.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
« Rocks, caves, lakes, fens, bogs, dens, and shades of death »
« Rocs, grottes, lacs, mares, gouffres, antres et ombres de la mort »
Chateaubriand a essayé de le rendre par les monosyllabes en retranchant les
articles. Le passage rendu de cette manière produit des effets d'harmonie
semblable mais aux dépenses de la syntaxe.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
La traduction littérale est nécessairement néologique. Toute grande traduction se
signale par sa richesse néologique, même quand l'original n'en comporte pas.
Mais la littéralité ne consiste pas seulement à violenter la syntaxe française ou à
néologiser, dans le texte de la traduction elle est aussi le maintien de l'obscurité
inhérente à l'original.
La traduction de Chateaubriand nous suggère qu'il n'opère pas seulement entre
deux langues mais qu'il y a toujours en lui une troisième langue sans laquelle la
traduction ne pourrait pas avoir lieu. Cette troisième langue supérieure et
médiatrice est le latin, qui occupe la position de langue-reine.
Selon Mallarmé, l'anglais a remplacé le latin en tant que langue reine. C’est une
langue qui n’est pas vraiment « étrangère », mais une langue « double » où se
mêlent et se composent les héritages de la langue d’oïl et de l'anglo-saxon, sans
pourtant se confondre.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Chaque traduction a donc tendance à être multilingue et il est essentiel que le
traducteur soit poly-traducteur.
La traduction n’est peut-être pas possible, sous sa figure la plus accomplie, sans
l’opération cachée de cette troisième langue qui vient de médiatiser le rapport
entre deux langues en contact.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
L'ÉNÉIDE DE KLOSSOWSKI
La traduction de l'Énéide de Klossowski (1964) a été bien accueillie par la plupart des
critiques. Ces laudateurs ont salué en elle un évènement marquant dans l’histoire
de la traduction française (et même occidentale):
la « bataille de l’Enéide» qui s’est déroulée autour de la traduction de Klossowski est
la reprise d’une autre « bataille » qui a eu lieu au XVIe siècle autour de la même
œuvre et où le sort de la traduction et de la littérature en France s'est décidée. Un
travail doublement historique.
La traduction de l'Énéide de Klossowski n'est pas mot à mot. La littéralité de l'auteur
est bien plus complexe. Il prend en vue deux caractéristiques structurelles, l'une de
la langue latine et l'autre du dire épique.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
En ce qui concerne la langue latine, Michael Foucault écrit dans un article consacré
à l'Énéide de Klossowski: «La phrase latine [...] peut obéir simultanément à deux
ordonnances: celle de la syntaxe que les déclinaisons rendent sensible; et une
autre, purement plastique, que dévoile un ordre des mots toujours libre mais
jamais gratuit.»
Elle s'oppose évidemment au français:
«[…] la syntaxe prescrit l'ordre, et la succession des mots révèle l'exacte
architecture du régime.» L'ordre des mots donc n'est pas libre en français, et obéit
à des règles déterminées.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
I B TA N T O B S C U R I S O L A S U B N O C T E M P E R U M B R A M
P E R Q U E D O M O S D I T I S U A C U A S E T I N A N I A R E G N A . ( V. 2 6 8 -
269)
E N M O T À M O T: I L S A L L A I E N T O B S C U R S S O L I TA I R E S S O U S
( L A ) N U I T À T R AV E R S ( L ' ) O M B R E E T À T R AV E R S ( L E S )
D E M E U R E S D E D I S V I D E S E T ( L E S ) R O YA U M E S
I N C O N S I S TA N T S .
K L O S S O W S K I T R A D U I T: I L S A L L A I E N T O B S C U R S S O U S L A
D É S O L É E N U I T À T R AV E R S L ' O M B R E , À T R AV E R S L E S
D E M E U R E S D E D I S V A I N E S E T L E S R O YA U M E S D ' I N A N I T É .
SA TRADUCTION DONNE L'IMPRESSION D'ÊTRE LITTÉRALE:
SOLA SUB NOCTEM DEVIENT « SOUS LA DÉSOLÉE NUIT ».
D ' A I L L E U R S , S O L A ( S O L I TA I R E ) E S T R E N D U E PA R D É S O L É E
( P O U R L ' A L L I T É R AT I O N A V E C " D E M E U R E S " E T " D I S " )
U A C U A S ( V I D E S ) E S T R E N D U PA R V A I N E S .
I N A N I A E S T R E N D U PA R I N A N I T É .
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Klossowski opère une forte latinisation du français. Elle s'effectue sans être un
calque, sans violer gratuitement la langue française.
Il s'agit d'implanter en français le caractère "disloqué" de la syntaxe latine,
d'introduire les rejets, les inversions, les déplacements, etc. du latin qui
permettent le jeu des mots dans le dire épique, mais sans les copier "tels
quels".
Voilà pourquoi « Ibtant obscuri sola sub nocte » devient « Ils allaient obscurs
la désolée nuit. »
Il y a une inversion de l'adjectif en français comme en latin, mais le lieu de
l'inversion dans le vers est changé, de manière que le français puisse
l'accepter.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Placer "désolée" avant "sous" est refusé par le français, mais le placer avant
"nuit" est accepté. Le traducteur recherche les points où le français peut
naturellement redevenir latin épique.
La troisième langue dans ce cas est l’allemand. Pour toute traduction littérale
d'un texte antique, l'allemand est la référence absolue. C'est la seule langue
occidentale qui, par les biais de sa poésie et de sa philologie, entretienne un
rapport si intime avec le latin et le grec.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: francesco-cusimano-1 (fra.cusi30@gmail.com)
Vous aimerez peut-être aussi
- Theorie de La Traduction Cours 1 2020-21Document32 pagesTheorie de La Traduction Cours 1 2020-21fifilove1991100% (1)
- Dorina TezaDocument71 pagesDorina TezaLucia_Balanici_9646Pas encore d'évaluation
- La Pratica Della Traduzione - RiassuntoDocument10 pagesLa Pratica Della Traduzione - RiassuntoTessPas encore d'évaluation
- Cioran La Chute Dans Le TempsDocument2 pagesCioran La Chute Dans Le TempsDeligne100% (2)
- 69 65 1 SMDocument8 pages69 65 1 SMvdlPas encore d'évaluation
- Chapitre Quatre - Théories de La Traduction. Dernier.Document14 pagesChapitre Quatre - Théories de La Traduction. Dernier.Isaek Isberabah100% (1)
- Initiationtraductions 3 G1Document31 pagesInitiationtraductions 3 G1ÎmÀd ÀvëïrøPas encore d'évaluation
- تعريف الترجمةوأنواعها وكلماتها المفتاحية توضع في المنصةDocument6 pagesتعريف الترجمةوأنواعها وكلماتها المفتاحية توضع في المنصةHuhuiPas encore d'évaluation
- ترجمهDocument156 pagesترجمهmak068338Pas encore d'évaluation
- Article Rythme Mechonnic-ConvertiDocument17 pagesArticle Rythme Mechonnic-Convertififilove1991Pas encore d'évaluation
- Mauvaise TraductionDocument171 pagesMauvaise TraductionMeissane choukailiPas encore d'évaluation
- Module TRADUCTIONDocument5 pagesModule TRADUCTIONIsaek IsberabahPas encore d'évaluation
- What Is A Translating Translator Doing? by Brian MossopDocument36 pagesWhat Is A Translating Translator Doing? by Brian MossopDonna NoblePas encore d'évaluation
- Cours 1 Définition de La TraductionDocument2 pagesCours 1 Définition de La TraductionVika KorzhenevskayaPas encore d'évaluation
- Initiation À La Traduction Ait Melloul BARRADocument12 pagesInitiation À La Traduction Ait Melloul BARRAHamid EslimaniPas encore d'évaluation
- Initiation A La TraductionDocument19 pagesInitiation A La Traductionbarka bouchra100% (1)
- Antoine BermanDocument3 pagesAntoine BermanMariana Di Ció100% (1)
- Courants Et Approches en TraductologieDocument31 pagesCourants Et Approches en TraductologienikasolaPas encore d'évaluation
- Traduction 2023Document9 pagesTraduction 2023Fati TimaPas encore d'évaluation
- 1976SYNECDOQUEETTRADUCTIONDocument23 pages1976SYNECDOQUEETTRADUCTIONAlonso Oviedo PolleriPas encore d'évaluation
- Grands Courants2008Document156 pagesGrands Courants2008LooLy Yo100% (1)
- Approches de La TraductionDocument13 pagesApproches de La TraductionMokrane ChikhiPas encore d'évaluation
- Jeux de Traduction - SummaryDocument7 pagesJeux de Traduction - SummaryMiriana FaietaPas encore d'évaluation
- Berman DiscoursDocument8 pagesBerman DiscoursLəman ƏliyevaPas encore d'évaluation
- Paul Ricoeur Et Le Deuil de La Traduction Absolue, André DussartDocument2 pagesPaul Ricoeur Et Le Deuil de La Traduction Absolue, André DussartFiorella PatulloPas encore d'évaluation
- TranspDocument123 pagesTranspCroqueMitainePas encore d'évaluation
- MA Class Draft 1Document8 pagesMA Class Draft 1AjayPas encore d'évaluation
- Plaidoyer Pour Une Approche Interioriste PDFDocument13 pagesPlaidoyer Pour Une Approche Interioriste PDFOmar OuchenPas encore d'évaluation
- Glad 1991Document19 pagesGlad 1991Juranny Tabares VélezPas encore d'évaluation
- La Linguistique Textuelle 1Document3 pagesLa Linguistique Textuelle 1Taki HPas encore d'évaluation
- Traduction, Adaptation - Palimpseste - MeshionicDocument7 pagesTraduction, Adaptation - Palimpseste - Meshionic1dennys5Pas encore d'évaluation
- L'évaluation Des Traductions Par L'historien (JEAN DELISLE)Document19 pagesL'évaluation Des Traductions Par L'historien (JEAN DELISLE)billypilgrim_sfePas encore d'évaluation
- Amélie Leconte. Dossier Traductologie.Document53 pagesAmélie Leconte. Dossier Traductologie.Idir MazighPas encore d'évaluation
- Taber, Traduire Le Sens Traduire Le StyleDocument10 pagesTaber, Traduire Le Sens Traduire Le Stylesafia.belabed90Pas encore d'évaluation
- Traductologie Conference 1Document26 pagesTraductologie Conference 1Lamia MESILIPas encore d'évaluation
- Introducción A La TraducciónDocument5 pagesIntroducción A La TraducciónSiju NaraPas encore d'évaluation
- Les Techniques de La Traduction, Notions de BaseDocument25 pagesLes Techniques de La Traduction, Notions de BaseCours UniversitairesPas encore d'évaluation
- Aprecu Des Theories Et Des Methodes de TraductionDocument22 pagesAprecu Des Theories Et Des Methodes de TraductionDenitsa Dimova100% (1)
- RB Hussein TranslitterationDocument38 pagesRB Hussein TranslitterationRima GharbiPas encore d'évaluation
- Le Compte Rendu de L'ouvrage - Les Théories de La Traduction, de Zuzana RakovaDocument3 pagesLe Compte Rendu de L'ouvrage - Les Théories de La Traduction, de Zuzana RakovaMarijaPas encore d'évaluation
- Georges Mounin Les Problèmes Théoriques de La TraductionDocument4 pagesGeorges Mounin Les Problèmes Théoriques de La TraductionÎmÀd ÀvëïrøPas encore d'évaluation
- Approches Et Modèles de La TraductionDocument6 pagesApproches Et Modèles de La TraductionYayaya100% (2)
- 02plugin Toth TraductologieDocument17 pages02plugin Toth TraductologieAnca Toroaba100% (1)
- Durdureanu Pour Une Définition de La Traduction CorrecteDocument14 pagesDurdureanu Pour Une Définition de La Traduction Correctelunatica2384Pas encore d'évaluation
- Article: Intertextualité Et Traduction Geneviève Roux-FaucardDocument22 pagesArticle: Intertextualité Et Traduction Geneviève Roux-FaucardMironescu DanaPas encore d'évaluation
- Article: La Traductologie, La Traduction Naturelle, La Traduction Automatique Et La SémantiqueDocument15 pagesArticle: La Traductologie, La Traduction Naturelle, La Traduction Automatique Et La SémantiquemehdiPas encore d'évaluation
- Pour Une Philosophie de La Traduction PDFDocument19 pagesPour Une Philosophie de La Traduction PDFJamaa AboussaberPas encore d'évaluation
- Fatemeh Mirza Ebrahim Tehrani RetraduireDocument7 pagesFatemeh Mirza Ebrahim Tehrani RetraduireThiago MattosPas encore d'évaluation
- Proces de TraductionDocument42 pagesProces de TraductionBHUMI MALDEPas encore d'évaluation
- Rezumate Atelier de Traduction 30Document11 pagesRezumate Atelier de Traduction 30Vinicius CarneiroPas encore d'évaluation
- Translation Attitudes PDFDocument24 pagesTranslation Attitudes PDFANGELITA A JOCSONPas encore d'évaluation
- L'approche Interpretative Dans La Traduction Vers Une Langue Etrangere, (Mi Kyung Choi)Document16 pagesL'approche Interpretative Dans La Traduction Vers Une Langue Etrangere, (Mi Kyung Choi)КристинаPas encore d'évaluation
- Au Début Était Le Traducteur: Antoine BermanDocument5 pagesAu Début Était Le Traducteur: Antoine BermanKaihong NgPas encore d'évaluation
- Traduction IntersémiotiqueDocument17 pagesTraduction IntersémiotiqueJSPas encore d'évaluation
- M1 Littérature Cours 4 Converti PDFDocument3 pagesM1 Littérature Cours 4 Converti PDFshnapiPas encore d'évaluation
- Clavis Hermeneutica. Sur Traduire Chez Fr. SchleiermacherDocument16 pagesClavis Hermeneutica. Sur Traduire Chez Fr. SchleiermacherflapinniPas encore d'évaluation
- La TraductionDocument12 pagesLa TraductionProdan Mihai FlorinPas encore d'évaluation
- OUSTINOFF - La Traduction PDFDocument91 pagesOUSTINOFF - La Traduction PDFGaya G CoignardPas encore d'évaluation
- Dialnet RemarquesSurLaTraductionLitteraire 2011785Document13 pagesDialnet RemarquesSurLaTraductionLitteraire 2011785Paola DemgnePas encore d'évaluation
- Traductions dans le roman francophone: Pratiques et enjeux identitairesD'EverandTraductions dans le roman francophone: Pratiques et enjeux identitairesÉditions PygmiesPas encore d'évaluation
- Une réforme radicale de l'orthographe française ?: Pourquoi oui ? Comment ? Pourquoi non ?D'EverandUne réforme radicale de l'orthographe française ?: Pourquoi oui ? Comment ? Pourquoi non ?Pas encore d'évaluation
- ÉpilepsieDocument5 pagesÉpilepsiethanhnha2121991Pas encore d'évaluation
- Corrige Exam BDD20082009 GHDocument13 pagesCorrige Exam BDD20082009 GHAsmaa Alaoui100% (1)
- Maurice Magre - Le Livre Des Certitudes AdmirablesDocument199 pagesMaurice Magre - Le Livre Des Certitudes AdmirablesEric ChabertPas encore d'évaluation
- La Longue Histoire Des Transidentités: Constituer Des Archives Trans, Historiciser Le GenreDocument13 pagesLa Longue Histoire Des Transidentités: Constituer Des Archives Trans, Historiciser Le GenreBobPas encore d'évaluation
- Indicateurs de SantéDocument14 pagesIndicateurs de SantéAngel SaraPas encore d'évaluation
- DGEMC - Affaire de Farid Ghilas PlaidoirieDocument2 pagesDGEMC - Affaire de Farid Ghilas PlaidoirieMegane HuetPas encore d'évaluation
- 013 21-09-2018 Depliant en Francais Le Bapteme Al AkikaDocument1 page013 21-09-2018 Depliant en Francais Le Bapteme Al Akikaalmoudou touréPas encore d'évaluation
- Cartier de Activities-Correcciones CompletoDocument59 pagesCartier de Activities-Correcciones Completopandy68Pas encore d'évaluation
- La Gestion de Clients DifficilesDocument21 pagesLa Gestion de Clients DifficilesDenisaNicolescuPas encore d'évaluation
- Rimbaud Ma Bohème QuestionsDocument1 pageRimbaud Ma Bohème Questionslucypruvost0Pas encore d'évaluation
- Les OptionsDocument81 pagesLes OptionsMôlkà TrabelsiPas encore d'évaluation
- Yasmina Reza - Le Dieu Du Carnage - Extrait N°3Document3 pagesYasmina Reza - Le Dieu Du Carnage - Extrait N°3Kévin Dumanoir100% (1)
- Trigo Continuité Limites Et Comportement AsymptotiqueDocument2 pagesTrigo Continuité Limites Et Comportement AsymptotiqueHedi-bkBenKhalifaPas encore d'évaluation
- Capteurs de DébitDocument14 pagesCapteurs de Débitsko88100% (1)
- Naa 210Document18 pagesNaa 210Merouane AllalouPas encore d'évaluation
- TracDocument6 pagesTracJustine ColombanaPas encore d'évaluation
- Normalisation SoudeurDocument3 pagesNormalisation SoudeurMetabulletproofPas encore d'évaluation
- Compléments AlimentairesDocument32 pagesCompléments AlimentairesWilfrid MdtPas encore d'évaluation
- EG6-THEORIE-DES-ORG CH 2 Complet PDFDocument7 pagesEG6-THEORIE-DES-ORG CH 2 Complet PDFbouchra derwichPas encore d'évaluation
- Louis Guillermit - Critique de La Faculte de Juger Esthetique de Kant (1979)Document192 pagesLouis Guillermit - Critique de La Faculte de Juger Esthetique de Kant (1979)garoto36Pas encore d'évaluation
- 7 PrésencedeDieu - 19 22janv2023Document2 pages7 PrésencedeDieu - 19 22janv2023Ange DorionPas encore d'évaluation
- Exercise de FrançaisDocument4 pagesExercise de FrançaiskalutufranckPas encore d'évaluation
- Press Kit LAIDocument10 pagesPress Kit LAIFlorent KirschPas encore d'évaluation
- Anii Livre - ABC - WebDocument44 pagesAnii Livre - ABC - WebDorschner Barinov100% (1)
- IC Risk Assessment Matrix 17198 FRDocument2 pagesIC Risk Assessment Matrix 17198 FRAuditeur MultipackPas encore d'évaluation
- Offline Media ChannelsDocument95 pagesOffline Media ChannelsKilian DuchesnePas encore d'évaluation
- La Révélation Des Pyramides !Document34 pagesLa Révélation Des Pyramides !jacquePas encore d'évaluation
- Questionnaire Ricci & Gagnon: Test D'Auto-Évaluation de L'ActivitéDocument2 pagesQuestionnaire Ricci & Gagnon: Test D'Auto-Évaluation de L'Activitérdy8812Pas encore d'évaluation
- ANTHROPOLOGIE - Frazer, James - Mythes Sur L'Origine Du FeuDocument182 pagesANTHROPOLOGIE - Frazer, James - Mythes Sur L'Origine Du FeuGeorgian IonPas encore d'évaluation