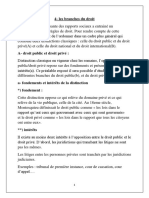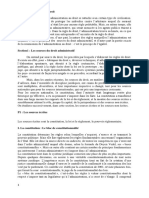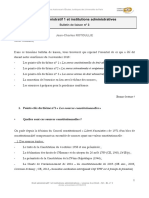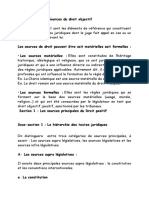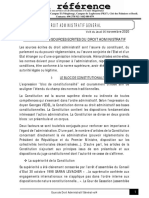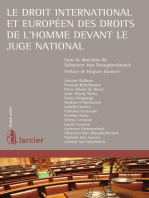Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CM Droit Administratif II (2022)
Transféré par
Fatim SouareCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CM Droit Administratif II (2022)
Transféré par
Fatim SouareDroits d'auteur :
Formats disponibles
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Droit administratif II
Pierre Serrand
Deuxième année de licence – Quatrième semestre
Sommaire
Préambule ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………… Page 02
Partie 1 – La légalité administrative ………………………………………………………………………….. Page 03
Titre 1 – Les sources de la légalité administrative …………….…………………………………………………………….. Page 03
Chapitre 1 – La diversité des sources de la légalité administrative …..…………………………………. Page 04
Chapitre 2 – La hiérarchie des sources de la légalité administrative ….………………………………... Page 18
Titre 2 – Le poids de la légalité administrative …………….………………………………………………………………….. Page 25
Chapitre 3 – Le poids de la légalité et les circonstances .…..………………………………………………… Page 25
Chapitre 4 – Le poids de la légalité et le contrôle du juge …..……………………………………………… Page 31
Partie 2 – La responsabilité administrative ………………………………………………………………… Page 42
Chapitre 5 – Les éléments de la responsabilité administrative ……………………………………………. Page 43
Chapitre 6 – La responsabilité pour faute ……………………………………………………………………………. Page 57
Chapitre 7 – La responsabilité sans faute ……………………………………………………………………………. Page 68
Chapitre 8 – Les régimes législatifs d’indemnisation …………………………………………………………… Page 74
Partie 3 – La justice administrative …………………………………………………………………………… Page 78
Chapitre 9 – L’organisation ……………….………………………………………………………………………………… Page 78
Chapitre 10 – La compétence……………….……………………………………………………………………………… Page 87
Chapitre 11 – Les contentieux (administratifs) …………………………………………………………………….. Page 96
Page 1 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Préambule :
Ce cours nous est présenté par Pierre Serrand. Les séances de travaux dirigés débuteront dès la semaine
prochaine et les fiches de TD seront disponibles sur Celene. Il est recommandé de faire les sujets d’annales
pour se préparer à l’examen, qui sera au passage soit une dissertation, un commentaire d’arrêt ou un
cas pratique comme au semestre précédent. Le manuel recommandé pour ce cours est le tome 2 du Droit
administratif, « Les obligations administratives », PUF troisième édition 022, « Droit fondamental », des
leçons 1 à 4.
Page 2 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Partie 1 – La légalité
administrative
L’administration doit respecter la légalité administrative : elle ne peut agir que sur le fondement d’une
règle de droit ; c’est l’exigence-même d’un État de droit. Chaque justiciable a la possibilité de contester
devant le juge administratif la légalité des actes de l’administration et qui peut par la suite être annulé si
cette contestation est fondée. L’administration doit alors réparer certains dommages, dont ceux qu’elle
cause par sa faute ou lorsqu’elle n’en a pas commis. Le juge administratif est par ailleurs un juge spécial
chargé de juger l’administration. Pendant longtemps, la source principale du droit administratif était la
loi. Mais depuis cinquante ans environs, on assiste à un déclin de la loi qui est concurrencé par les sources
constitutionnelles et conventionnelles, par les engagements internationaux. La légalité administrative
ne fait ainsi pas uniquement référence aux textes législatifs mais à l’ensemble des règles juridiques
qui régissent l’action de l’administration. Elle doit ainsi respecter la légalité, l’exigence principale de
l’État de droit. Cette légalité nous vient de diverses sources.
Titre 1 – Les sources de la lé-
galité administrative
Elles sont diversifiées en deux types : les sources internes et « externes », ou internationales.
- Les sources internes proviennent de l’ordre juridique interne, comme :
o La loi
o Les règles à valeur constitutionnelle
o Les règlements
o La jurisprudence
- Les sources internationales quant à elle relève des conventions internationales, comme :
o Le Droit de l’Union européenne (et sa tendance d’harmonisation entre les États-membres)
o Les Principes Généraux du Droit International
Mais comment faire lorsque ces mêmes règles paraissent contradictoires ? Que les lois internes soient
incompatibles avec les conventions internationales ? C’est l’arrêt Nicolo du Conseil d’État (CE 1989,
Niccolo) qui vient y apporter la réponse : dès qu’une incompatibilité est avérée, c’est la loi qu’il faut
mettre de côté et c’est donc la convention internationale qui prime ; c’est un défaut de base légale de
l’acte administratif. On y applique ainsi la norme du dessus, c’est la hiérarchie des normes.
Page 3 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 1 – La diversité des sources de la lé-
galité administrative
Leçon 1
I] – Les sources internes
A) – Les règles de valeur constitutionnelle
a) Le texte de la Constitution
La Constitution ne régit pas l’administration en elle-même mais uniquement les institutions politiques.
Au sommet de cette hiérarchie administrative se retrouvent les autorités, mais aussi celles qui sont poli-
tiques (car l’administration est subordonnée au pouvoir politique, comme le Président de la République
et le Premier ministre). On retrouve donc dans la Constitution les règles qui régissent l’administration,
aux articles 13 et 21 du texte constitutif :
- L’article 13 dispose que « le Président de la République signe les ordonnances et les décrets dé-
libérés en Conseil des ministres ». Il est ainsi chargé de l’exécution des lois, c’est-à-dire de l’ad-
ministration. Il exerce ainsi le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois de l’État.
- L’article 21 dispose que « le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable
de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article
13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires ». Il fixe ainsi les
ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Dans la Constitution se retrouvent aussi des grands principes dont on peut douter de l’effectivité à
l’égard de l’administration. Le juge peut en tirer certes des conséquences juridiques non-négligeables,
mais on peut toutefois douter de leur invocabilité lors d’un procès :
- Le Conseil constitutionnel fût saisi d’une QPC en 2018, dirigée contre la législation qui inter-
disait aux associations concernées d’apporter une assistance à des migrants et pénalisait ces
associations. QPC n°2018-717 consacre ainsi la fraternité comme principe à valeur constitution-
nelle et implique « la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans considération de l’ir-
régularité de son séjour sur territoire nationale ». Par conséquent, la loi pénalisant l’aide des
associations était désormais contraire à la Constitution.
- Le service public est lui aussi soumis au principe de continuité, et à lui aussi cette valeur consti-
tutionnelle permettant d’encadrer le droit de grève qui est aussi un droit à valeur constitution-
nelle. Ce principe a été déduit de l’article 5 de la Constitution au sujet du fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l’État.
Le texte constitutionnel est par ailleurs précédé d’un préambule, une introduction faisant références :
- À la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
- Au préambule de la Constitution de la IVème République de 1946
- À la Charte de l’Environnement, le tout formant le bloc de constitutionnalité, tous ces textes
bénéficiant d’une valeur constitutionnelle qui sert de fondement au contrôle exercé par le juge.
b) La Déclaration des Droits de l’Homme de 1789
Ce texte historique apporta trois éléments :
Page 4 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- Une affirmation de l’égalité de droit, de l’égalité juridique entre les Hommes. C’est une reven-
dication des révolutionnaires. Cette affirmation ressemble à l’article Ier de la Constitution ; « les
Hommes naissent libres et égaux en droit ». C’est une égalité de droit d’ailleurs, pas de fait. C’est
aussi une égalité devant la loi selon son article 6 : « la Loi est l'expression de la volonté géné-
rale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse », menant
à l’égalité d’accès aux emplois publics.
- Une affirmation de droits naturels : les droits dont chaque Homme dispose en raison de sa nature
humaine ne procèdent pas de la volonté de l’État, ils sont inaliénables et imprescriptibles : ils
ne peuvent pas être cédés ni prescrit. La DDHC dit qu’ils sont sacrés : l’État doit les respecter. Il
s’agit de la liberté, de la propriété, de la sûreté et de la résistance à l’oppression
o L’article 4 rencontre la liberté, et plus précisément celles de l’opinion et de l’expression.
o L’article 17 évoque la liberté de la propriété et de la sûreté, comme le droit de ne pas être
arbitrairement détenu.
- L’importance de la loi réside tant dans le fait que le mot est le plus répété des articles, avec un L
majuscule. La loi garantie les droits. La liberté et les droits ne peuvent être limité que par la loi,
l’expression de la volonté générale. Le juge peut enrichir ce texte par son travail constructif
d’interprétation. Il peut affirmer l’existence de libertés plus précises comme la liberté contrac-
tuelle ou la liberté d’entreprendre. La jurisprudence dit que ce sont des libertés qui disposent
d’une valeur constitutionnelle car ils se rattachent à la liberté en général de l’article 4. Le juge
peut ainsi déduire de formulations très générales des règles assez précises, comme l’article 9
de la DDHC sur la présomption d’innocence au travers de la QPC n°93-326. C’était une décision
conforme qui va déduire les conséquences concrètes du régime juridique de la garde à vue des
mineurs de treize ans. Il va ainsi pouvoir faire peser des conséquences concrètes sur le pouvoir
administratif qui n’apparaît pas immédiatement à la lecture du texte constitutionnel.
c) Le préambule de 1946
1) Les principes politiques, économiques et sociaux nécessaires à notre temps
Le préambule de 1946 vient affirmer seize principes politiques, économiques et sociaux particulièrement
nécessaires à notre temps (ou PPNT). Les droits sociaux par exemple sont ceux du travail comme le droit
syndical, de grève, des moyens convenables existant ainsi que le droit à l’instruction et la garantie de la
santé et de la sécurité matérielle des individus. Ces principes peuvent cependant entraîner des consé-
quences sur l’administration et sur le législateur. La QPC n°93-325 a déduit du dixième alinéa du
Préambule les règles du droit au regroupement familial. Le treizième alinéa quant à lui dispose que « la
nation garantie l’égal accès à l’instruction, à la culture, à la formation […] ». Le Conseil d’État s’est no-
tamment appuyé sur cette disposition pour consacrer le droit pour un enfant souffrant d’un handicap
de bénéficier d’une scolarisation adaptée. C’est une obligation de résultat pour l’État et non de moyen,
avec des conséquences sur l’administration :
- Avec CE 2009, Monsieur et Madame Laruelle
- Avec l’augmentation des droits d’inscription des étudiants en mobilité international à l’uni-
versité des pays hors de l’Union Européenne. La loi était soumise au contrôle du Conseil cons-
titutionnel qui disait qu’en s’appuyant sur cet alinéa du Préambule, cette exigence de gratuité
s’appliquait dans l’enseignement supérieur, mais précisait que les modiques droits d’inscrip-
tion peuvent toutefois être perçus. La QPC fit l’objet d’un recours contentieux en y invoquant la
méconnaissance par le décret dudit alinéa. Le Conseil d’État va alors considérer que ce décret ne
méconnait pas les exigences découlant de l’alinéa, car les frais moyens de la formation d’un étu-
diant étaient de 10 000 € par an pour l’État. Mais jusqu’où le juge acceptera de monter les frais ?
Page 5 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
2) Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
Ils sont notamment reconnus par la décision du Conseil constitutionnel CE 1971, Liberté d’association.
Au début des années 70, le Gouvernement était assez épuisé par la création de multiples associations
gauchistes qui le détraquait. Il a alors adopté une loi qui restreignait leur création alors que cette liberté
était soumise depuis la loi Association 1901 à un régime de déclaration préalable, donc favorable aux
libertés. La nouvelle loi la soumettait à un régime d’autorisation préalable, ce qui était plus liberticide
(la création devait être autorisée par l’administration). Cette loi a alors été soumise aux Sages. Ces der-
niers voulaient censurer cette loi, mais le problème était que la Constitution n’évoquait nullement la loi
1901, donc il n’y avait pas cette liberté d’association. Il a alors trouvé au sein du Préambule un bénéfice
à valeur constitutionnelle, de même que les textes auxquels il fait référence. Le Préambule fait ainsi lui-
même référence aux principes fondamentaux reconnus après les Lois de la (IIIème) République (PFRLR)
qui bénéficient donc d’une valeur constitutionnelle. Parmi ces principes se retrouvent ceux de la liberté
d’association, et pour que le juge applique une loi de la République qui consacre un droit ou une liberté,
il faut qu’il puisse puiser dans des lois adoptées dans des Républiques antérieures à la IVème. Les juges
vont alors puiser dans les grandes lois de la IIIème République – notamment la loi 1901 sur la liberté
relative des associations. Il faut aussi que cette loi de la République soit à l’origine d’un principe fonda-
mental, donc si le principe n’a pas été remis en cause. Dix principes fondamentaux sont alors issus des
lois de la République consacrées par le juge :
- Celui du Conseil constitutionnel, car c’est le juge qui est directement concerné par la norme
constitutionnelle mais qui n’est pas en situation de monopole.
- Ainsi apparaît le Conseil d’État et le juge administratif, qui n’a pas hésité à consacrer pour la
première fois un principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE Ass. 1996,
Koné). Dans cette affaire, un décret d’extradition était contesté devant Conseil d’État. Il va pou-
voir interpréter la convention d’extradition à la lumière d’un principe de valeur constitution-
nelle qu’il va lui-même consacrer, le principe selon lequel l’État doit refuser l’extradition d’un
étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique comme celui de mettre en prison un
opposant politique. C’est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Dix
principes fondamentaux donc, à savoir (pour les plus importants) :
o La liberté d’association
o La liberté de l’enseignement
o Le principe de l’arrêt Koné : le refus d’extradition pour but politique
o Le principe de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur
o Le respect des droits de la défense
o La consécration au niveau constitutionnelle d’une partie de la compétence du juge admi-
nistratif, à savoir le contentieux des Actes Administratifs Unilatéraux
o Le principe qui consacre une compétence à l’autorité judiciaire : le principe de l’autorité
judiciaire gardienne du droit de la propriété immobilière.
d) La Charte de l’environnement
Tous ces principes bénéficient d’une valeur constitutionnelle. Ils font partie du bloc de constitutionna-
lité. La Charte de l’environnement a été adoptée en 2004 et a été mise dans le préambule de 1958 après
une révision constitutionnelle. Cette Charte est susceptible de concerner l’administration car elle con-
sacre différents principes, dont :
- Le principe de prévention : la prévention des risques environnementaux avérés, comme les
marées noires
- Le principe de précaution : le risque éventuel ou le doute scientifique, comme avec la culture
d’OGM, l’implantation des antennes de téléphonie mobiles
Page 6 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- Le principe de responsabilité : il s’agit d’engager la responsabilité de ceux qui portent atteinte
à l’environnement. C’est le principe du « pollueur-payeur », issu du Code de l’environnement.
C’est l’arrêt CAA Bordeaux 2016, SARL Racaud : la pollution causée par cette entreprise était
issue d’un déversement de bitume dans un ruisseau. La société dû ainsi verser une somme égale
au montant de l’intervention des pompiers.
- Les règles dans la Charte bénéficient ainsi d’une valeur constitutionnelle grâce à la décision CE
Ass. 2008, Commune d’Annecy. L’administration doit respecter les dispositions à valeurs cons-
titutionnelles, dont celles de la Charte.
B) – Les lois
a) L’Histoire de la loi
La grande époque de la loi était incontestablement celle de la fin des Lumières et de l’article 6 de la
DDHC : « la loi est l’expression de la volonté générale ». Pour Jean-Jacques Rousseau, l’objet et l’es-
sence de la volonté générale reste le fait qu’elle doit partir de tous et s’appliquer à tous, afin que la loi
exprime la volonté générale ; la règle de droit doit être à portée générale, elle « s’applique à tous » et
chez Rousseau, il n’y a pas de représentation de la volonté générale. Pour que la loi parte de tous, elle
doit être adoptée à l’unanimité. Pour l’auteur, les députés du peuple ne sont pas les représentants qu’il
cherche mais les commissaires. Alors être libre, ce n’est qu’être soumis qu’à sa propre volonté : la loi
doit être votée à l’unanimité. Aujourd’hui, la loi n’est plus l’expression de la raison, ce n’est plus la
pensée des révolutionnaires mais un instrument de politique. Le légicentrisme est ainsi le fait que la loi
soit « l’expression de la raison et exprime une vérité », donc ne pas soumettre la loi au contrôle de
constitutionnelle reviendrait à ne pas soumettre une autre volonté à l’expression de la raison. À la fin
de la Révolution, la loi va progressivement décliner via plusieurs « événements » :
- La loi peut porter atteinte aux libertés et le législateur peut se tromper. La loi du 22 Prairial de
l’An II de la République (ou loi du 10 juin 1794) vint abolir l’instruction du procès lors de la
Terreur (plus de Défense, plus de présomption innocence, plus d’acquittement), tout comme les
lois adoptées sous le Régime de Vichy (déclarées nulles et non-avenues).
- La rationalisation du parlementarisme : la loi n’est plus l’expression de la volonté du peuple
souverain mais celle d’une majorité politique ou qui procède d’un organe exécutif, devenant
l’instrument d’une politique. On peut donc envisager de soumettre la loi au contrôle d’un juge
via le contrôle de la constitutionnalité des lois de 1958, suivi du contrôle de conventionnalité
des lois venant affirmer ce déclin.
b) La définition de la loi
Initialement, la loi était définie de manière matérielle comme un acte général, selon l’article 6 de la DDHC.
C’est la généralité qui fait la loi. Lors de la loi du 13 juillet 1906, Dreyfus fût réintégré dans l’armée. Ce
n’était pas général, mais cela reste quand même une loi puisque c’est un acte voté par le Parlement
selon la procédure législative. C’est là que s’afficha le basculement de la définition matérielle de la loi
à la définition organique et procédurale. La jurisprudence des Sages permet aussi au législateur d’inter-
venir dans le domaine du règlement, donc la loi peut intervenir dans tous les domaines. Il n’y a plus de
domaine hors de la loi, et on ne peut plus se fonder sur l’article 34 de la Constitution pour redonner
une dimension matérielle à l’acte administratif. Aussi, selon CE Ass. 1962, Rubin de Servens, De Gaulle
décida de mettre en application l’article 16 de la Constitution à la suite du coup d’État en Algérie,
venant créer une juridiction d’exception concernant les opposants militaires.
Page 7 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Rubin de Servens va venir contester la réunion des conditions de l’article 16, et le Conseil d’État viendra
dire que la décision de De Gaulle est un acte de gouvernement et refuse de se prononcer dessus, en
plus du fait que les mesures qui sont prises par Président en application de l’article 16 reste dans le
domaine de la loi, comme dans le domaine de l’article 34. La dimension matérielle existe ainsi. Elle est
marginale mais elle existe. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel vient alors redonner sa dimen-
sion matérielle à la loi en condamnant la neutralité législative avec les dispositions non-normatives
contenues dans une loi. Il y dit que cela est contraire à l’article 6 de la Constitution en s’appuyant sur la
définition matérielle pour censurer cela. Par exemple :
- La décision n°2005-512 est une décision conforme venant censurer l’article 7 de la loi sur
l’école. La loi est ainsi une norme juridique adoptée par le pouvoir législatif selon les procé-
dures prévues par la Constitution. Et selon les organes qui exercent ce pouvoir législatif, on y
distingue différents types de lois.
c) La typologie des lois
- Les lois ordinaires sont les lois votées par le Parlement selon la procédure de l’article 45 de la
Constitution.
- Les lois financières, qui sont les lois de finances du budget de l’État et les lois relatives à la
Sécurité sociale sont elles aussi adoptées par le Parlement, cette fois selon la procédure des
articles 47 et 47-1 du texte constitutionnel (cf. CM Finances publiques, 2022).
- Les lois organiques, elles, sont prévues par la Constitution mais adoptées par le Parlement selon
une procédure plus lourde, explicité par l’article 46 car c’est une prise directe sur le texte cons-
titutionnel, avec quinze jours de réflexion et à condition qu’il y ai majorité pour adoption (alors
qu’il nécessite une majorité des représentants pour les lois ordinaires).
- Les lois référendaires (les préférées de De Gaule) relèvent de l’article 11 et sont adoptées par
le peuple, et ne sont pas soumises au contrôle de constitutionnalité.
- Enfin, les lois constitutionnelles permettent la révision de la Constitution, selon l’article 89 et
sont soit adoptées soit par le peuple, soit par congrès (et deux assemblées) et ne sont pas non
plus soumises au contrôle.
C) – Les règlements
Les règlements sont une source doublement interne : ils proviennent de l’ordre juridique interne mais
aussi de l’administration elle-même. Les sources de la légalité administratives proviennent en fait de
l’administration, mais il existe différents types de règlements selon la nature du pouvoir réglementaire
exercé.
a) La nature du pouvoir réglementaire
1) Le règlement d’exécution
C’est le pouvoir administratif traditionnel : il s’agit de prendre les mesures nécessaires pour mettre la
loi en application. C’est le pouvoir d’édicter des règles générales et impersonnelles sur le fondement
d’une loi. Il existe aussi sous la Vème République à l’article 21 que le Premier ministre, chargé de l’exécu-
tion des lois exerce ce pouvoir, tandis qu’à l’article 72, ce sont les collectivités territoriales qui disposent
de ce pouvoir car elles tiennent leurs compétences de la loi (au travers des lois de décentralisation).
2) Le règlement autonome
Page 8 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le pouvoir administratif peut édicter un règlement sans qu’il y ait de loi dans le « silence de la loi », et
apparaît tant dans la Constitution que la jurisprudence. Au sujet des règlements autonomes, ils tirent
leurs vertus de la Constitution aux articles 37 et 34. L’article 34 édicte une liste de matières dans les-
quelles les règles de droit sont posées par la loi. L’article 37 quant à lui évoque les autres matières, avec
une autorité compétente qui est celle du pouvoir réglementaire. Ils vont intervenir dans les domaines
où il n’y a pas de loi, donc la réglementation autonome s’affirme par rapport à la loi. D’après la décision
n°82-143 la Constitution n’a pas, selon le Conseil entendue frapper d’inconstitutionnalité une loi
lorsqu’elle intervient dans le domaine du règlement. Les Sages n’imposent pas aux autorités normatives
de respecter la répartition des compétences entre la loi et les règlements car la loi peut aller plus loin
que son domaine, alors que le règlement doit respecter la loi s’il en rencontre une, puisque la loi se
trouve au-dessus des normes dans la hiérarchie. Si le Gouvernement veut empêcher le législateur dans
son domaine, il devra invoquer l’irrecevabilité. Si le Gouvernement a accepté que loi intervienne dans
son domaine mais qu’il se rétracte, c’est l’article 37 alinéa 2 qui entre en jeu pour modifier les dispo-
sitions (et le gouvernement peut récupérer son bien). Le règlement n’est ainsi jamais à l’abri de la loi
donc il n’y a pas vraiment de règlements autonomes.
Mais d’un point de vue juridique, on ne peut pas assimiler les règlements aux articles 21 et 37. Il existe
en effet des différences de régime, dont :
▪ La possibilité que le législateur ne soit pas intervenu dans le domaine réglementaire, puisque
son pouvoir peut intervenir sur le fondement de l’article 37 en l’absence de loi, ce qui n’est
pas possible pour les règlements qui nécessitent une loi selon l’article 21.
▪ Les règlements qui seraient véritablement autonomes sont légalement pris sur le fondement
de l’article 37, selon CE 2001, Peltier. Les règlements, toujours selon cet article peuvent modifier
une loi voire l’abroger, selon la procédure de délégalisation, où il s’agit pour le gouvernement
de récupérer ce qui lui revient.
▪ CE 1919, Labonne évoque en l’espèce que le Chef de l’État avait édicté une réglementation en
l’absence d’une loi. Labonne s’était alors dit que ce règlement paraissait illégal, mais le Conseil
d’État répondit qu’il appartient au Chef de l’État, en l’absence de toutes délégations législatives
et en vertu de ses propres pouvoirs d’édicter les mesures de polices nécessaires dans l’en-
semble du territoire. Le règlement de police est légal alors même qu’il a été pris en l’absence
d’une loi. Aujourd’hui, c’est le Premier ministre qui est titulaire du pouvoir réglementaire au
niveau national concernant les règlements en matière de police. Le règlement mentionné par
l’arrêt Labonne est alors autonome par rapport à la loi ainsi qu’à l’article 34.
▪ CE Sect. 1936, Jamart racontait en l’espèce que les ministres, comme tous chef de service sont
habilités à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leur service, et dont les
mesures peuvent être individuelles ou encore relatives à l’organisation d’un service public (et
sont pour le coup réglementaire, comme dans TC 1968, Air France c/ Époux Barbier). L’autorité
administrative peut prendre des mesures relatives à l’organisation du service, qui sont ainsi des
mesures réglementaires, pouvant être édictées même en l’absence d’une loi.
▪ CE Ass. 1950, Dehaene raconte que Monsieur Dehaene décida de faire grève alors que le Ministre
en vigueur interdisait ce droit aux agents. En contestant la sanction, Dehaene fit quand même
grève, et le Conseil d’État répondit que l’Intérieur avait pris une mesure relative à l’organisation
de ses services afin d’encadrer le droit de grève pour assurer la continuité du service public,
une mesure prise sur le fondement de la jurisprudence Jamart (en l’absence d’une loi vu que le
législateur n’était pas intervenu).
3) Le règlement pris par ordonnance
Les ordonnances sont prises sur le fondement de l’article 38, ou le Gouvernement dépose un projet
d’habilitation.
Page 9 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il demande au Parlement de prendre quant à lui une ordonnance relative aux mesures relevant du do-
maine de la loi, et fait par la suite valider son ordonnance au Parlement ; c’est le projet de loi de rati-
fication que le Parlement va voter. Selon CE Ass. 2020, CFDT des Finances, « l’habilitation élargit de
façon temporaire le pouvoir réglementaire dont le Gouvernement dispose en l’autorisant à adopter
des mesures qui relèvent du domaine de la loi ». Les ordonnances, tant qu’elles ne sont pas ratifiées
sont des actes administratifs réglementaires. Une fois ratifiées, les ordonnances acquièrent une valeur
législative et deviennent rétroactivement des lois.
b) Les titulaires du pouvoir réglementaire
1) La Constitution
Les autorités administratives peuvent édicter des règlements sur leur fondement constitutionnel. Le
Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire et en est le titulaire de principe. Il prend des décrets
et exerce son pouvoir sur les dispositions de l’article 13 (le tout explicité à l’article 21). Le Président quant
à lui signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres, les ordonnances étant
fondées sur l’article 38 et discutées en Conseil tandis qu’à leur ratification, le Président les signes et en
est juridiquement l’auteur. Les décrets quant à eux sont pris à la fois par le Président et le Premier
ministre et ne sont pas discutés, signés par le Premier ministre puisque le Président signe les auteurs.
Un problème soulevé par Meyet cependant, dans CE 1992, Meyet, le décret avait en l’espèce été délibéré
en Conseil des ministres alors qu’aucun texte n’imposait cette délibération. Ce décret aurait alors dû
être signé par le Premier ministre, et paraît comme entaché d’incompétence. Selon cet arrêt, le Conseil
d’État considère que tous les décrets délibérés en Conseil des ministres doivent être signés par le Pré-
sident qui en devient l’auteur, et rejette de fait le recours de Meyet. Le risque est que le pouvoir régle-
mentaire passe du Premier ministre au Président, donc le Conseil d’État permet en conséquence qu’un
décret soit délibéré en Conseil des ministres alors qu’aucun texte ne l’imposait, mais aussi de prévoir
qu’il pourra être modifié ou abrogé par le Premier ministre : c’est un assouplissement de la règle du
parallélisme des compétences. Enfin, en vertu de l’article 72 de la Constitution, les collectivités terri-
toriales disposent du pouvoir réglementaire. Les règlements sont pris en assemblée délibérante qui
prend ses délibérations tandis que les organes exécutifs prennent des arrêtés. Les règlements peuvent
aussi être édictés par les organes exécutifs comme le maire, qui peut prendre des arrêtés.
2) La loi
Les autorités administratives peuvent disposer par la loi du pouvoir réglementaire.
- Les ministres n’en disposent pas en principe, le Conseil d’État le considérant ainsi. Mais ils peu-
vent finalement en bénéficier par la volonté du législateur, comme à l’article L613-1 du Code de
l’éducation qui reconnaît au Ministre chargé de l’enseignement supérieur le pouvoir de fixer
par arrêtés les conditions d’obtention des diplômes nationaux, il ou bien elle est habilité·e par
la loi. Ils édictent ainsi leurs règlements par voie d’arrêtés – ce sont des arrêtés ministériels. Les
circulaires et les instructions quant à elles expliquent en principe le droit applicable aux agents
des services publics. Si elles innovent, c’est-à-dire qu’elles ajoutent des conditions à une régle-
mentation existante, alors elles sont réglementaires. Elles peuvent aussi imposer une interpré-
tation de la réglementation existante sans être réglementaire.
- Les autorités administratives publiques ou indépendantes, comme l’Autorité de la Sûreté Nu-
cléaire en vertu de l’article L592-20 du Code de l’environnement. Celui-ci habilite l’ASN à pren-
dre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les mesures préexis-
tantes.
- Les établissements et les personnes publiques sui generis comme la Banque de France, selon la
décision n°93-324 du Conseil d’État.
Page 10 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- Les autorités administratives déconcentrées et décentralisées, avec par exemple la possibilité
de prendre des règlements de police. Les dispositions législatives reconnaissent aux maires dans
leurs communes et aux préfets dans leurs départements le pouvoir d’édicter des règlements en
matière de police.
- Les organismes de droit privé – ceux-ci doivent exercer une mission d’intérêt général comme
le Conseil National des Barreaux, à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971. Le législateur
habilite ce Conseil à unifier par la voie de dispositions générales les règles et usages de la
profession d’avocat. Ainsi, CE 2018, Association La conférence des bâtonniers le Conseil Na-
tional des Barreaux est investi par la loi d’un pouvoir réglementaire, comme les fédérations
sportives délégataires, par l’association de la loi de 1901 qui sont en situation de monopole pour
l’organisation des compétitions officielles (selon l’article L131-16 du Code du sport).
3) La jurisprudence
La jurisprudence habilite certaines autorités administratives à édicter des règlements. Trois arrêts sont
à retenir à ce sujet :
- CE 1919, Labonne habilite le Premier ministre à édicter des règlements en matière de police.
- CE Sect. 1936, Jamart vient habiliter les chefs de service, à savoir
o Les ministres
o Les organes exécutifs des autorités territoriales donc
▪ Le maire, à l’égard des agents de la commune et
▪ Les directeurs des établissements publics
à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leur service.
La jurisprudence peut-elle bénéficier aux organismes de droit privé qui gèrent les missions de service
public ? EDF par exemple est une personne morale de droit privé qui gère une mission de service
public, à savoir la production d’énergie via les centrales nucléaires. Si les agents décidaient d’y faire
grève, les organes dirigeants viendraient encadrer à leur tour leur droit de grève. À cette occasion, le
législateur n’est pas intervenu, et c’est sur le fondement de la jurisprudence Jamart que l’autorité
administrative pu décider de limiter l’exercice du droit de grève. C’est une autorité administrative ré-
glementaire.
- CE 2013, Fédération Force Ouvrière Énergie et Mines vient dire que les organes dirigeants de
cette société sont habilités à prendre des règlements contre le droit de grève.
- TC 1968, Compagnie Air France c/ Époux Barbier vient habiliter les organismes de droit privé
qui gère des missions de service public à prendre des mesures relatives à l’organisation du
service public ; ce sont des règlements.
D) – Les règles jurisprudentielles
a) La chose jugée
L’administration doit respecter la chose jugée par le juge administratif. CE Ass. 1962, Bréart de Boi-
sanger où Bréart était un administrateur de la comédie française, et le Gouvernement voulait y nommer
quelqu’un d’autre à sa place. Le Conseil d’État dira que le gouvernement n’en avait pas le droit donc
ce dernier décida de modifier le statut de l’administrateur pour le révoquer. Le Conseil annula ce dé-
cret et dira qu’il est illégal de modifier le statut de l’administrateur, car il méconnaît la chose jugée
par le Conseil d’État. C’est alors une source de la légalité administrative. L’annulation a alors autorité
absolue de la chose jugée : l’acte disparaît à l’égard de tous.
Page 11 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
b) La jurisprudence
TC 1873, Blanco exprime que le juge administratif est compétent pour engager la responsabilité de
l’État et réparer le préjudice subi. S’il n’y a pas de texte, c’est le Conseil d’État qui vient consacrer les
règles du droit administratif. La jurisprudence se manifeste par des formules de principes par les-
quelles le juge pose la règle applicable au litige et aux espèces similaires. Les créations jurispruden-
tielles sont indépendantes des textes.
- CE Ass. 2014, Département de Tarn-et-Garonne ; le Conseil départemental était venu adopter
par délibération une autorisation pour le Président du Conseil départemental à s’offrir des
voitures de fonctions au montant assez, si ce n’est très élevé. L’opposant au Président alla saisir
le juge administratif pour excès de pouvoir, qui saisit à son tour le juge du contrat. Le Conseil
d’État en vint à dire que les tiers au contrat peuvent directement saisir le juge du contrat et
consacre par la même occasion un nouveau recours contentieux : c’est une création jurispru-
dentielle. Il y a toutefois des revirements de jurisprudence, comme l’arrêt Niccolo et les traités,
et ce même si la loi est postérieure au traité.
- Dans le cas du CE 2014, Société Les productions de la plume et Monsieur Dieudonné M’Bala
M’Bala, une ordonnance, alors en vigueur est venue interdire ce spectacle comme dans l’arrêt
Benjamin, la Commune de Morsang-sur-Orge, etc. Tous ces arrêts visent leurs propres déci-
sions de justice, donc c’est bien la preuve que c’est une source de droit.
Autre preuve matérielle : le juge est conscient que la règle de jurisprudence qu’il constate est néces-
sairement rétroactive, et s’applique à l’affaire qui a eu lieu. Cependant, cette application n’est pas
toujours systématique, comme dans l’arrêt Tarn-et-Garonne. Le Conseil d’État y rappelle l’impératif de
la sécurité juridique et la nouvelle jurisprudence ne s’appliquera que postérieurement à l’arrêt, donc
c’est bien une source du droit et de la légalité administrative. La jurisprudence est ainsi un ensemble
des règles de droit consacrées par le juge et susceptible d’être appliquées dans les litiges à venir.
c) Les principes généraux du droit (PGD)
1) La création des principes généraux du droit
C’est le caractère assez créatif de la jurisprudence qui mena à ces principes généraux du droit, indé-
pendants du droit écrit. CE Ass. 1945, Aramu affiche que ces principes généraux sont applicables même
en l’absence de texte, c’est leur objectif-même : s’appliquer en l’absence de texte. Cette création juris-
prudentielle s’est surtout manifestée après la Seconde Guerre mondiale, où la seule source de légalité
était jusqu’alors la loi. Lorsque le législateur n’était pas intervenu, le juge ne voulait pas non plus laisser
l’administration agir arbitrairement, donc il a créé ces principes généraux afin d’encadrer l’action de
l’administration dans le silence de la loi, afin de la soumettre à la légalité. Aujourd’hui, on a surtout
tendance à éviter d’en créer de nouveau si le juge peut s’appuyer sur un texte, qu’il soit constitutionnel
ou conventionnel, alors le recours aux principes généraux du droit est amoindri.
2) Leur champ d’application
Quatre grandes idées viennent rassembler ces principes généraux :
- La liberté, au travers du libre-choix du médecin par son patient et la liberté de prescription du
médecin
- L’égalité
o CE Sect. 1951, Société des concerts du conservatoire
o CE Ass. 1954, Barel et le principe d’égalité d’accès aux emplois publics
Page 12 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Les principes généraux du droit les plus nombreux sont destinés à protéger les administrés :
- Le principe du respect des droits de la défense
o CE Sect. 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier
- Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs
o CE Ass. 1948, Société du journal l’Aurore
- Les acteurs administratifs peuvent désormais faire l’objet d’un Recours pour Excès de Pouvoir
o CE Ass. 1950, Dame Lamotte
- Le principe de la sécurité juridique est désormais affirmé
o CE Ass. 2006, Société KPMG
- L’obligation pour les administrations de ne pas appliquer un règlement illégal et de les abro-
ger le cas échant
- La protection sociale, donc l’interdiction de licencier une employée en état de grossesse
- Le droit de mener une vie familiale normale (au prof des étrangers), venant contribuer au re-
groupement familial (CE Ass. 1978, GISTI). Le Conseil d’État applique désormais la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et son article 8.
d) L’interprétation juridictionnelle
L’interprétation juridictionnelle est celle que les juges donnent aux lois, l’interprète étant celui qui
doit rechercher quel est le sens qui se trouve dans le texte. Une autre manière serait cette de prendre acte
de la volonté et non pas de la connaissance. Il ne s’agit pas de découvrir un sens préexistant dans le
texte, mais de choisir entre les différentes significations possibles du texte en s’appuyant sur ses
propres convictions. CE Ass. 1950, Dame Lamotte évoque que pendant la Seconde Guerre mondiale,
concernant la production de céréales pour la population, un arrêté de concession avait été pris sur le
terrain de Madame Lamotte. Le juge était venu annuler la concession mais le législateur, par la loi du
23 mai 1943 à son article 4 évoque que « l’octroi de la concession ne peut faire l’objet d’aucun recours
administratifs ou judiciaires ». Le Conseil d’État alors dû déterminer si le recours de Madame était
recevable. Appliquer l’article 4 de la loi peut signifier deux choses : ou le recours est irrecevable, ou
« à l’exception du recours pour excès de pouvoir en vertu des principes généraux du droit ». Le Con-
seil d’État est donc venu dire que ce recours était recevable, puisque la règle venait de l’interprétation
par le juge. C’était une interprétation d’une norme qui se situait au même niveau que l’autre dans la
hiérarchie des normes, interprétée par Hobbes.
II] – Les sources internationales
Il y a trois catégories de sources internationales : les conventions internationales, régîtes par le titre
VI de la Constitution « des traités et accords internationaux », le Droit de l’Union Européenne, au titre XV
du texte constitutionnel « de l’Union Européenne » et au quatorzième alinéa du Préambule de 1946
« règles du droit public international ».
A) – Les conventions internationales
a) La Constitution
1) La réciprocité
C’est un contrat conclu par les sujets du droit international, autrement dit les États. Notre Constitution
distingue ainsi les Traités des Accords.
Page 13 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Les Traités sont négociés et ratifiés par le Président de la République, tandis que les Accords sont
négociés et approuvés par le Gouvernement, plus précisément le ministre des Affaires Étrangères.
Cela revient à un consentement pour la France d’être lié par un traité ou un accord. Les conventions
internationales peuvent être bilatérales comme les conventions d’extraditions, multilatérales et vien-
nent ainsi engager plusieurs États, mais aussi humanitaires comme avec la CEDH. Ces conventions
internationales trouvent leur place dans nos sources du droit à l’article 55 de la Constitution : « les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supé-
rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
Une convention internationale trouve à s’appliquer en droit interne seulement si trois conditions exi-
gées par la Constitution sont réunis, en plus d’un supplément de la jurisprudence :
- La régularité de la ratification ou de l’approbation « régulièrement ratifié ou approuvé ». C’est
l’article 53 de la Constitution qui donne une liste des traités ou des accords qui ne peuvent pas
être ou approuvés en vertu d’une loi. Concernant les traités ou accords qui rentrent dans cet
article, le Gouvernement doit déposer un projet de loi autorisant la ratification. CE Ass. 1998,
SARL du parc d'activité de Blotzheim décrit en l’espèce un juge administratif qui décida d’ap-
précier la régularité de la procédure qui conduit à l’approbation d’un accord ou à la ratification
traité.
- Une convention internationale ne peut s’appliquer dans l’ordre interne uniquement si elle a été
publiée. C’est le juge qui contrôle sa régularité de publication. Elle se fait par un décret du
Président en Conseil des ministres, décret qui doit être contresigné par le Premier ministre et
le ministre des Affaires étrangères, puis doit se voir publié au Journal Officiel de la République.
- Il y a aussi la condition de réciprocité d’application – si un traité n’est pas réciproquement
appliqué par un autre État, il n’y a nullement besoin de l’exécuter et pendant longtemps, le
Conseil d’État ne voulait pas se prononcer sur les autres États. Il s’estimait incompétent pour
apprécier la question de la réciprocité, et la renvoyait de fait au ministre des Affaires Étrangères.
C’était le cas jusqu’à ce qu’une affaire éclate, celle d’une ressortissante algérienne ayant obtenu son
diplôme de médecin en Algérie voulait s’en servir en France. Avec une convention passée entre l’Al-
gérie et la France, autorisant cette pratique entre les deux pays, elle invoqua ladite convention pour
pouvoir pratiquer. Mais le Ministre refusa car la convention n’était pas appliquée en Algérie, donc elle
ne s’appliquait pas de base. Le Conseil d’État posa la question aux Affaires étrangères alors-même que
l’État était en même temps partie au litige et devait déterminer la règle applicable. La requérante alla
jusqu’à la CEDH via son droit au procès équitable, et verra la France condamnée en estimant que la
jurisprudence du Conseil d’État place l’administration en qualité de juge et de partie, donc cela porte
atteinte au principe de l’égalité des armes dans le procès. Elle dit aussi que la réponse du Ministre ne
doit être qu’un avis soumis au débat contentieux devant le juge. C’est une condition désormais appré-
ciée par le juge administratif, par CE Ass. 2010, Madame Cheriet-Benseghir et les conditions de l’ap-
plicabilité d’une convention internationale.
b) La jurisprudence
La quatrième condition de la jurisprudence repose dans CE Ass. 2012, – GISTI qui devient le « mode
d’emploi » pour déterminer si les stipulations d’une convention internationale sont d’effets directs.
- Une convention ne crée en principe des droits et des obligations uniquement entre ses auteurs,
et pas sur les tiers. Néanmoins concernant certaines conventions, les États viennent s’accorder
pour reconnaître des droits à leurs ressortissants et sont alors d’effet direct uniquement si elle
crée des droits dans le patrimoine juridique des particuliers. Sinon, elles ne peuvent pas s’en
prévaloir devant le juge administratif.
- La seconde condition pour avoir cet effet direct est le fait que la stipulation conventionnelle
créant ces droits ne nécessite aucun acte interne de transposition pour produire des effets à
Page 14 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
l’égard des particuliers. Elles sont directement applicables (sans lois ou décrets) et sont alors une
source de la légalité administrative.
B) – Le droit de l’Union Européenne
Le droit de l’Union Européenne est consacré par notre droit en tant que source internationale par
l’article 88-1 de la Constitution. Il y a deux composantes au droit de l’Union.
a) Le droit originaire
C’est le droit qui est à l’origine de la Communauté Économique Européenne, aujourd’hui du Droit de
l’Union Européenne. Il est formé par les Traités de :
- Rome, de 1957
- Bruxelles, de 1948
- Maastricht, 1992
- Amsterdam, 1997
- Nice, 2001
Mais aujourd’hui, il est surtout originaire du Traité de Lisbonne de 2007. C’est ici que l’article 55 de la
Constitution s’applique : les traités régulièrement ratifiés sont régulièrement publiés et réciproque-
ment appliqué. Mais pour que cette réciprocité d’application soit de mise, il faut une égalité particu-
lière. Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un État-membre ne peut pas ne pas exécuter le
droit originaire au motif qu’un autre État ne l’exécute pas. Celle-ci apprécie ou non si un État est en
situation de manquement ou non. Cela est différent car le droit de l’Union est une source particulière de
la légalité.
b) Le droit dérivé
C’est le droit qui découle, qui procède des institutions mises en place par les Traités : les commissions,
les parlements et les conseils. Ils sont régis par l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union
Européenne qui consacre l’existence des règlements, des directives et des décisions.
1) Les règlements
Les règlements ont une portée générale et impersonnelle et viennent s’appliquer à des catégories
abstraites de personnes. Ils sont obligatoires dans tous leurs éléments, aussi bien dans leur objet que
dans leurs moyens utilisés pour le réaliser. Ils ne nécessitent aucune mesure de transposition. Les rè-
glements sont aussi directement applicables dans tous les États-membres. Dès lors qu’il est publié au
Journal Officiel de l’Union Européenne, c’est le règlement européen qui s’applique directement. CE
1999, Reducci exprime un acte administratif méconnaissant ce cas de figure, et est donc illégal. Il s’agis-
sait en l’espèce d’un refus de l’administration d’attribuer une prime. Le requérant affirmait que le refus
était illégal car il était contraire à un règlement européen. Le Conseil d’État admit que le requérant s’en
prévalait. C’est une nouvelle source de la légalité administrative.
2) Les directives
C’est l’article 288 du TFUE qui vient fixer l’objectif à atteindre. Il exige des États que l’objectif soit atteint
au terme d’un certain délai : le délai de transposition.
Page 15 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
C’est une instance offerte aux nations libres quant à la forme et aux moyens : soit par l’utilisation de
lois, soit par décret qui viennent transposer les directives de suite ou étapes par étapes. Les relations
entre les directives européennes et les actes administratifs réglementaires se caractérisent par un rè-
glement administratif qui doit respecter les directives. Elles s’imposent ainsi aux actes administratifs
réglementaires, au motif qu’il est incompatible avec les objectifs fixés par les directives. Le Conseil
d’État a commencé par affirmer cela à l’égard des décrets de transposition.
- On peut ainsi contester sa légalité s’il est contraire aux objectifs de la directive. La directive avait
été transposée, mais le gouvernement avait adopté un décret contraire à celle-ci.
CE 1984, Confédération nationale de protection des animaux.
- Il est alors possible de se prévaloir d’une directive européenne pour contester un règlement
pris ultérieurement après la transposition de la directive :
o CE 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature
o CE 1989, Compagnie Alitalia ; une fois le délai de transposition arrivé à son terme, les
autorités administratives doivent abroger les dispositions réglementaires contraires
aux objectifs.
La relation entre la CJUE et le Conseil d’État se caractérise par le fait que ce dernier refusait pendant
longtemps qu’un administré, pour qu’il puisse contester un acte administratif individuel utiliser les ob-
jectifs d’une directive et de son arrêt lui étant associé. Il ne peut pas directement invoquer la directive
contre une autorité administrative indépendante ; il doit passer par son acte de transposition. Mais
celle-ci ne crée pas directement des droits pour ces derniers. Lors de l’affaire Cohn-Bendit de mai 68,
celui-ci ne put invoquer directement la directive à l’encontre de l’autorité administration indépen-
dante et devait passer par l’acte de transposition. CE Ass. 2009, Madame Perreux est venu cependant
remplacer l’arrêt Cohn-Bendit en supprimant la formule de l’arrêt. L’État y était négligeant/défaillant
et son délai de transposition était arrivé à son terme. Il était alors possible d’invoquer les dispositions
de la directive pour cette AAI. Des dispositions précises et inconditionnelles sont d’effets directs.
3) Les décisions
Celles-ci sont évoquées à l’article 288 du TFUE : la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour
les destinataires qu’elle désigne. La CJUE estime même qu’il est possible de contester les mesures na-
tionales dès lors qu’elles sont contraires à une décision. Le Conseil d’État est dans la même position :
les justiciables peuvent se prévaloir d’une décision européenne pour contester la légalité d’un acte
administration, selon CE 2001, Guadeloupe.
c) La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et les Principes
Généraux du Droit de l’Union Européenne
La jurisprudence de la CJUE est désormais une source à part entière de la légalité administrative,
même si le Conseil d’État lui avait opposé quelques résistances, en particulier à l’égard des directives
mais aujourd’hui, il y fait référence dans plusieurs de ses arrêts. Les principes généraux du droit de
l’Union européenne sont ainsi déduits par la Cour de Justice, dont ceux de la sécurité juridique et de
la confiance légitime. Ces principes s’appliquent avec la même valeur juridique que le droit originel.
Le Conseil d’État a jugé que les droits consacrés par la CEDH constituent ce type de principe du Droit
de l’Union Européenne, selon CE Sect. 2008, Conseil National des Barreaux. Le Conseil d’État va lier le
droit de l’Union européenne et celui de la CEDH, donc des droits consacrés par la CEDH sont aussi
protégés en droit de l’Union, en qualité de principes généraux. Ces actes de droit privé doivent ainsi
respecter le droit originaire mais aussi la CEDH.
Page 16 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
C) – Les règles du droit public international
Ce sont les sources externes de la légalité administrative autrement dit. En vertu du Préambule de
1946 à son quatorzième alinéa, « la République française se conforme aux règles du droit public
international ». Il y a ainsi la coutume internationale, que le Conseil d’État vérifie en vérifiant que les
actes administratifs les respectent (CE Ass. 1997, Aquarone). Le Conseil d’État vient contrôler enfin la
régularité des actes administratifs par rapport aux principes généraux du droit international. Mais
comment règle-t-on les conflits de normes ? En y appliquant la norme supérieure. Si l’une est con-
traire à l’autre, c’est la hiérarchie des sources de la légalité administrative.
Page 17 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 2 – La hiérarchie des sources de la
légalité administrative
Leçon 2
La détermination d’une hiérarchie entre deux normes n’est possible que si le juge administratif exerce
un contrôle. Avant l’arrêt Nicolo entre loi et traité, le juge appliquait l’acte le plus récent puisque les
deux avaient la même valeur juridique. Mais depuis, le juge administratif contrôle la conventionnalité
des lois : la loi est compatible avec les traités mais le traité est supérieur à la loi. Le juge exige ainsi que
l’acte qu’il contrôle soit conforme ou compatible avec la norme qui se trouve au-dessus.
- Par rapport à une source interne de la légalité, il contrôlera la conformité de l’acte.
- Sinon, par rapport à la norme internationale, il s’agira de la compatibilité de l’acte.
I] – La primauté de la Constitution
Cette primauté est instituée par un contrôle de constitutionnalité des actes en dessous de la Consti-
tution. Sa primauté se manifeste sur les lois et sur les actes administratifs.
A) – La primauté sur les lois
a) Le contrôle a priori
Ce contrôle de constitutionnalité des lois peut avoir lieu a priori. C’est un contrôle qui s’exerce par le
Conseil constitutionnel avant que la loi ne soit promulguée. Sur le fondement de l’article 61, les lois
sont soumises à un contrôle facultatif lorsqu’il s’agit de lois ordinaires ou financières ou à un contrôle
obligatoire en cas de lois organiques. Le contrôle est toutefois exclu lorsqu’il s’agit des lois référen-
daires, selon CC n°93-313. Si le Conseil acceptait de contrôler les lois exprimant la souveraineté natio-
nale appartenant au peuple, il en deviendrait le souverain. Les lois de révision constitutionnelle en sont
aussi exclues depuis la Décision n°2003-459 : elles ont ainsi une valeur constitutionnelle et ne seraient
contrôlées que s’il y avait supranationalité (avis du Conseil d’État du 30 juillet 2015). Ces lois n’ont
alors pas à respecter la Constitution.
b) Le contrôle a posteriori
C’est le contrôle qui est exercé après que la loi soit entré en application ou lors de son application. Le
juge administratif s’est toujours refusé de l’exercer car cela ne relève pas de notre tradition juridique,
et même chose pour le Conseil d’État. Il n’y a pas de contrôle de la loi mais il veut tout de même la
faire respecter. Mais parfois, il n’est pas loin de l’apparence d’un juge de la loi : il y a abrogation im-
plicite lorsque l’on demande l’application de deux lois inconciliables, puisqu’on se demande laquelle
pourrait être appliqué. Le juge administratif considère en l’espèce que la loi la plus récente a implicitement
abrogée la plus ancienne, et le Conseil d’État accepte cette solution entre les lois ordinaires et les lois
constitutionnelles
- CE Ass. 2005, ministre des Affaires étrangères. Le Conseil d’État accepte de vérifier si deux lois
sont compatibles l’une par rapport à l’autre, entre une loi ordinaire plus ancienne et une loi
constitutionnelle plus récente. Il se place alors dans la position d’un juge contrôlant la consti-
tutionnalité de la loi.
Page 18 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- CE 2005, Mademoiselle Depré exprime que le seul contrôle prévu de la loi par la Constitution
est celui qui relève a priori, celui du Conseil constitutionnel. Il a alors fallu une QPC afin d’intro-
duire le contrôle a posteriori de la loi. Il s’agissait en l’espèce de déterminer si des dispositions
législatives ne méconnaissaient pas des dispositions constitutionnelles. Seules celles qui con-
sacraient des droits ou des libertés garanties par la Constitution servaient au fondement du
contrôle d’une QPC, qui est un mécanisme de protection des droits fondamentaux consacrés
au niveau constitutionnel (et non une technique destinée à assurer la primauté de la Constitu-
tion). Toutes les dispositions législatives se trouvant dans des lois ordinaires ou financières
peuvent faire l’objet de ce contrôle, et même les interprétations que les juges donnent des lois.
Ce sont des dispositions législatives, donc interpréter reviens à déterminer la norme selon les
décisions n°2010-39 et n°2011-120.
Les lois référendaires, ou les lois autorisant la ratification d’un traité ou celles habilitant le gouverne-
ment à prendre des ordonnances de l’article 38 de la Constitution ou de neutralité législative ne
peuvent pas faire l’objet d’une QPC. Les dispositions d’une ordonnance quant à elles le peuvent, car
elles ont valeur de loi. Le juge va contrôler la conformité de certaines dispositions législatives à cer-
taines dispositions constitutionnelles ; c’est aussi une QPC. Il s’agit alors de mettre en perspective les
droits et les libertés garanties par la Constitution et ceux garantis par les conventions internationales,
par exemple CE 2014, M.A où le droit à un recours juridictionnel effectif est garanti à la fois par l’ar-
ticle 6, alinéa 1 de la CEDH mais aussi par l’article 16 de la DDHC. Le requérant peut ainsi soulever
l’incompatibilité de cette loi par rapport à la convention internationale, mais aussi par rapport à la
Constitution. Il y a alors les QPC et QPC, les Questions Prioritaires de Conventionnalité ou de Constitu-
tionnalité. On règle le problème par le caractère prioritaire de la QPC : le juge doit d’abord répondre à
la question constitutionnelle avant celle de la conventionnalité. La CJUE estime d’ailleurs dans l’affaire
Melki que cette QPC n’est pas contraire au droit de l’Union Européenne. Cette question peut être sou-
levée devant toutes les juridictions relevant de l’ordre administratif, et donc du contrôle de cassation
du Conseil d’État et y compris celui du juge des référés. La procédure ne saisit pas directement ce-
pendant les Sages. Ils ne peuvent être saisi que par les juridictions suprêmes des deux ordres : le Conseil
d’État ou la Cour de cassation. C’est un mécanisme de filtrage qui évite d’encombrer le Conseil cons-
titutionnel.
• Le juge saisit doit transmettre la QPC au Conseil d’État si elle n’est pas dépourvue d’un carac-
tère sérieux.
• Le Conseil d’État doit transmettre la QPC au Conseil constitutionnel si elle a un caractère sé-
rieux par un système de filtrage en entonnoir ; le Conseil doit statuer dans un délai de six mois.
o Soit il estime que la disposition législative contestée ne méconnait pas les droits et
libertés garanties par la Constitution, et donc la QPC est rejetée.
o Soit la disposition législative est déclarée contraire à la Constitution et est abrogée à
compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, ou à une date ul-
térieure fixée par le Conseil. Le juge du fond va alors statuer à la lumière de la décision
des Sages.
B) – La primauté sur les actes administratifs
Comment est assuré cette primauté de la Constitution sur les actes administratifs ?
a) Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs
Pour contrôler la loi par rapport à la Constitution, le Conseil constitutionnel se doit d’établir son con-
trôle des actes administratifs par rapport au texte constitutionnel, et c’est le juge administratif qui y
Page 19 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
est compétent. Le Conseil d’État a donc pu annuler des actes administratifs contraires à la Constitution,
à la DDHC, aux principes politiques, économiques et sociaux, aux principes fondamentaux reconnus
par les Lois de la République et à la Charte de l’environnement (donc le bloc de constitutionnalité
finalement). Le juge administratif contrôle la conformité des actes administratifs par rapport à toutes
les règles à valeurs constitutionnelles, en somme.
b) L’écran législatif
La difficulté réside en si l’acte administratif avait été pris ou non en l’application d’une loi. En contrôlant
la constitutionnalité d’un décret, le Conseil d’État va aussi contrôler la constitutionnalité de la loi et il
s’y refuse. La loi fait écran finalement entre l’acte administratif et la Constitution. Dès lors que la mise
d’un acte administratif par rapport à la Constitution conduit le juge à se prononcer sur une loi, celle-ci
fait écran. Elle ne le fait pas cependant si ce qui est contesté dans le décret sont les dispositions qui lui
ont été ajoutées, ce qui ne se trouvera pas dans la loi. Une loi d’habilitation ne fait ainsi pas écran et
la seule forme de contrôle possible reste alors la QPC. Le juge administratif ne contrôle pas la loi. S’il
est saisi d’un recours visant le décret d’application de la loi, il en vient à contrôler le contenu, à inter-
férer sur la loi en cours de promulgation. Chose qu’il ne peut pas (il n’en a pas le droit). Si ce contrôle
de constitutionnalité ne conduit pas le Conseil d’État à se prononcer sur le contenu de la loi, il peut agir
dessus : l’écran législatif est transparent. L’écran législatif permet d’empêcher le juge administratif de
se prononcer sur la constitutionnalité d’un décret d’application d’une loi si ce contrôle le mène à se
prononcer sur le contenu de la loi. Si ce n’est qu’un ajout au décret qui est litigieux, il pourra contrôler
la constitutionnalité sans empiéter sur la loi. La seconde hypothèse concerne les ordonnances de
l’article 38. La loi d’application ne fait pas écran dans ce cas : elle ne fait qu’habiliter et ne fait pas
écran entre la règle de valeur constitutionnelle et l’ordonnance. Le Conseil d’État acceptera alors de
contrôler la constitutionnalité de l’écran (CE 2006, France Nature Environnement). La QPC quant à
elle fait tout simplement dégager l’écran législatif. Pour rappel, c’est la contestation d’un acte admi-
nistratif – il est illégal puisqu’il a été pris en application d’une loi qui porte atteinte aux garanties
portées par la Constitution. Le juge administratif ne va transmettre la question que si celle-ci est perti-
nente et doit pour cela va examiner a priori la loi. La QPC habilite nécessairement le juge à se pronon-
cer sur la constitutionnalité de la loi : l’écran est donc inexistant dans ce cas.
II] – L’autorité des engagements internationaux
Ces sources internationales affichent notamment une hiérarchie entre celles-ci. C’était une idée : les
conventions humanitaires étaient ainsi supérieures aux conventions bilatérales (comme celles d’extra-
dition). Si la convention d’extradition méconnaissait celle qui était humanitaire, l’extradition serait im-
possible. Le Conseil d’État s’est prononcé sur ce point dans CE 2011, Monsieur Kandyrine. Le Conseil
d’État estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de la convention au regard des
autres conventions souscrites par la France. Cela veut dire que la validité d’un traité ne provient pas
de sa conformité avec un autre. Ainsi, il n’y a pas réellement de hiérarchie. Mais quid des contrariétés ?
Le Conseil d’État établit qu’en cas de conflit entre les deux traités, « il conviendrait de les concilier » et
pour cela, il faut se référer aux règles à valeurs constitutionnelles (CE Koné). Lorsqu’il s’agit de l’inter-
prétation des stipulations internationales, il faut les interpréter à la lumière des règles constitution-
nelles, toujours à valeur plus élevée que la règle conventionnelle. Mais que se passe-t-il en cas de con-
ciliation impossible ? Le Conseil d’État doit faire application de la convention internationale ayant servi
de fondement à l’acte contesté. Néanmoins, le caractère d’effet direct de la convention internationale
conditionne son applicabilité dans notre droit.
Page 20 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
A) – La primauté sur les lois
a) Le Conseil constitutionnel
Un engagement international bénéficie d’une supériorité juridique que si un juge contrôle la loi vis-à-
vis de la convention internationale. CE 1989, Niccolo applique ainsi l’acte le plus récent puisqu’alors,
les traités et lois avaient la même valeur juridique. L’article 55 de la Constitution précise que si les
conditions sont réunies, la convention internationale a une autorité supérieure à celle de la loi. C'est le
contrôle de conventionnalité de la loi, examinant ainsi si la loi est compatible avec les conventions. Ce
n’est pas le Conseil constitutionnel qui s’en occupe alors qu’il avait été saisi à l’affaire relative à l’IVG
et la loi Veil de 1975 qui autorise l’avortement. Celle-ci avait été soumise au contrôle de constitution-
nalité (par l’opposition). Les requérants demandaient aux Sages de vérifier si la loi méconnaissait l’ar-
ticle 2 de la CEDH sur le fondement de l’article 55, estimant que cela était contraire au droit européen.
Une loi méconnaissant un traité serait antagoniste à la Constitution.
- Dans sa décision n°7554 du 15 janvier 1975, Décision IVG (conforme) « le contrôle de la cons-
titutionnalité de la loi et le contrôle de la conventionnalité de la loi sont deux contrôles diffé-
rents », et estime que « le seul contrôle relevant de sa (le Conseil constitutionnel) compétence
est le contrôle de constitutionnalité de la loi ». Implicitement, il renvoyait aux juridictions or-
dinaires le soin de se prononcer sur la conventionnalité de la loi.
- Il y affirme « qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel […] d’examiner les stipulations de
la loi face à un traité ou une convention internationale », et l’a reconfirmé plus récemment :
décision n°2014 709 DC.
b) Le juge administratif
C’est par l’arrêt CE 1973, Café Jacques Vabre que la Cassation va accepter de contrôler la convention-
nalité des lois – elle n’appliquera la loi que si elle n’est pas incompatible avec la convention. Et si une
loi postérieure avec un traité est incompatible, la loi n’est pas appliquée. C’est à partir de CE 1989,
Niccolo que le Conseil d’État contrôlera la conventionnalité des lois et n’appliquera plus les lois dites
inconventionnelles. Lors du contrôle d’un acte interne vis-à-vis d’un engagement international, il
examine la compatibilité de l’acte vis-à-vis de l’engagement. Seul le contenu de la loi est contrôlé.
Cette solution a été très rapidement étendue au droit dérivé de l’Union Européenne. Il s’agit de trans-
poser la jurisprudence Niccolo aux règlements européens, le droit dérivé en somme. Le Conseil d’État
a par la suite accepté de le faire pour les lois et les directives européennes (CE 1992, Rockman).
- CE 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique : le contrôle de compatibilité ne
concerne cependant pas toutes les sources internationales de la légalité.
o Les principes généraux (CE 2000, Paulin) et
o La coutume ne sont pas concernés (CE 1997, Aquarone). Ce sont bien des sources de la
légalité administrative mais ils ne sont pas susceptibles de recours vis-à-vis de leur com-
patibilité sauf si la loi fait écran.
B) – La primauté sur les actes administratifs
a) La primauté sur les conventions internationales
Avant l’arrêt Niccolo, le juge administratif acceptait de contrôler la conventionnalité des actes admi-
nistratifs (CE 1952, Madame Kirkwood).
Page 21 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il contrôlait la compatibilité d’un décret d’extradition (l’acte administratif) par rapport à une convention
d’extradition et en cas d’incompatibilité, l’acte était jugé illégal et le juge prononçait son annulation.
Pour l’effet direct, c’est l’arrêt CE 2012, GISTI qui n’était pas compatible en l’espèce avec les stipula-
tions internationales. Mais qu’en est-il si l’acte administratif est pris en l’application d’une loi ? La loi
n’allait pas faire écran parce que le juge contrôlait la conventionnalité des lois, autrement dit CE 1989,
Niccolo. Elle ne met plus à l’abri les sources internationales exceptées les coutumes et les principes
généraux (donc les règlements, les directives, etc).
b) La primauté du droit dérivé de l’Union Européenne
Par principe, les Ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire (CE 1936, Jamart). Lorsqu’une loi
est incompatible avec un engagement international, le ministre peut édicter un règlement qui serait
contraire à la loi. S’il n’en a pas été doté, il ne peut que donner des instructions, rien de plus. Il peut
donner l’ordre à ses services de ne pas appliquer la loi non conventionnelle.
C) – La soumission à la Constitution
Lors de l’arrêt CE Ass. 1998, Sarran, les engagements internationaux se virent conférer une suprématie
certaine sur le fondement de l’article 55, mais qui ne s’appliquait pas dans l’ordre interne vis-à-vis des
dispositions constitutionnelles, plus tard reconfirmé par l’arrêt Cass. 2000, Mademoiselle Fraisse.
- CE 2001, Syndicat Nationale de l’Industrie Pharmaceutique est venu afficher la primauté du
Droit de l’Union Européenne sur le droit interne des États-membres, et cela ne saurait conduire
à la remise en cause de la suprématie de la Constitution, selon la décision n°2004-505.
Le Conseil d’État était venu confirmer cette solution par la suite dans l’arrêt CE 2021, French Data Net-
work, dans lequel une obligation qui venait d’une loi, d’une transposition d’une directive européenne
était contestée, au sujet des sociétés de téléphonie mobiles et leur conservation des données person-
nelles. La loi imposait une conservation dans des conditions contraires à celle du Droit de l’Union
Européenne et les sociétés requérantes invoquaient une incompatibilité entre la loi française et le Droit
de l’Union. Le Conseil d’État estima que le droit européen ne pouvait pas conduire à méconnaître une
exigence constitutionnelle, mais aussi que l’article 88-1 de la Constitution confirme toujours la place
de la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes, donc au-dessus du droit européen. Il est
alors ardu de mettre en place un contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux, car
la Cour de Justice de l’Union Européenne ne cesse d’affirmer qu’un État ne peut pas se prévaloir de
ses propres règles internes et même pour la Constitution, qui conduit à un irrespect du Droit de l’Union
Européenne. La volonté du Conseil constitutionnel a alors été celle de la conciliation des exigences
contradictoire, expliquant ainsi pourquoi le contrôle de constitutionnalité des engagements interna-
tionaux est imparfait. Il faut ainsi le distinguer du contrôle de constitutionnalité du droit dérivé de
l’Union Européenne.
a) Le contrôle de constitutionnalité des conventions internationales
1) L’existence d’un contrôle a priori
C’est un contrôle mis en place a priori et exercé par le Conseil constitutionnel avant que la convention
internationale ne soit ratifiée ou approuvée. Il peut avoir lieu sur le fondement constitutionnel de l’ar-
ticle 54 afin de vérifier si les clauses contenues dans la convention sont contraires ou non à la Consti-
tution.
Page 22 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le contrôle avait été exercé à l’époque pour les Traités de Maastricht et d’Amsterdam, et on était par-
venu à la révision de la Constitution à l’occasion de la ratification de ces traités, car ils comportaient
des clauses contraires aux anciennes versions de la Constitution. Ce contrôle peut aussi être exercé sur
le fondement de l’article 75 de la Constitution car certains traités ne pouvaient être ratifiés qu’en vertu
d’une loi, qui elle-même pouvait être soumise au contrôle de constitutionnalité. Cela permet de vérifier
en même temps la constitutionnalité du Traité. Le contrôle de constitutionnalité du traité a ainsi lieu
indirectement lors du contrôle exercé à l’encontre de la loi. Il y a alors deux possibilités : l’article 54
et l’article 61 de la Constitution. Tous deux disposent respectivement que :
- « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre,
par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a
déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut interve-
nir qu'après la révision de la Constitution ».
- Les lois organiques avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article
11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum et les règlements des assemblées parle-
mentaires avant leur mise en application doivent tous être soumis au Conseil constitutionnel,
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être dé-
férées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation, par le Président de la République,
le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante
députés ou soixante sénateurs ».
2) L’absence de contrôle a posteriori
Le contrôle de la constitutionnalité des conventions internationales est exclusivement a priori, et non
a posteriori. S’il était a posteriori, le juge administratif pourrait, lors de l’application d’une convention
internationale vérifier sa constitutionnalité.
- Lors de CE Ass. 1996, Koné, un décret d’extradition avait été pris en application d’une conven-
tion d’extradition et le Conseil d’État était venu interpréter cette convention à la lumière de la
Constitution, une solution reconfirmée par la suite.
- CE 2010, Fédération Nation de la Libre-Pensée : il y avait eu une proposition d’un rapporteur
public qui contrôlerait la constitutionnalité des conventions internationales lors de leur appli-
cation, mais le Conseil d’État refusa de le suivre : le contrôle a posteriori des conventions du
type n’est sont pas possible, mais il a toutefois accepté de franchir le pas pour le droit dérivé et
arriver à termes à contrôler dans une certaine mesure la « constitution » du droit dérivé.
b) Le contrôle de constitutionnalité du droit dérivé de l’Union Européenne
Les actes de droit dérivé, dans le cadre de l’Union Européenne sont les directives et les règlements
européens en somme. Elles doivent être transposées dans le droit interne soit par des lois, soit par des
décrets. Les lois de transpositions peuvent cependant être soumises au contrôle de constitutionnalité,
tout comme le peuvent les décrets. En les contrôlant, le juge administratif interne peut directement
confronter la directive à la Constitution. On a pu voir cela à l’œuvre dans CE 2007, Arcelor. Normale-
ment, c’est la CJUE qui vient contrôler le droit dérivé par rapport au droit originaire. Il y a alors deux
possibilités :
- Soit la règle constitutionnelle invoquée pour contester la loi de transposition ou le décret se
trouve également dans le droit originaire de l’Union Européenne, et la CJUE va alors protéger
la Constitution.
- Soit le Conseil constitutionnel ou le juge administratif va estimer qu’il n’y a pas de difficultés
et vient rejeter. S’il y a difficulté, le Conseil d’État va venir poser une question officielle à la CJUE,
Page 23 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
qui va venir vérifier si l’acte de droit dérivé respecte ou non notre droit originaire, c’est-à-dire
la Constitution. Deux nouveaux cas de figure :
o Soit la règle constitutionnelle invoquée n’est pas reprise par le droit originaire. Nous
sommes alors en présence d’une « règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitu-
tionnelle de la France », une chose spécifique à la Constitution française. Par exemple,
la laïcité de la République. Le juge interne doit alors contrôler la constitutionnalité de
la loi et du décret afin de protéger cette identité, et va contrôler de fait l’acte de droit
dérivé par le biais de la loi ou du décret, comme dans la CC n°2021-940.
o Soit CE Ass, 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine vient donner un « mode d’em-
ploi » du contrôle exercé sur un décret venant transposer une directive lorsque est in-
voquée l’inconstitutionnalité dudit décret. De même si c’est une loi de transposition
venant adapter le droit interne au règlement européen.
III] – La soumission des actes administratifs
Celle-ci s’effectue à l’égard de toutes les normes se trouvant au-dessus des actes administratifs.
A) – La soumission des actes administratifs aux
normes supérieures
Les actes administratifs sont soumis à la Constitution, alors le juge administratif contrôle leur consti-
tutionnalité sous réserve qu’une loi ne fasse pas écran. Ils sont aussi soumis aux engagements inter-
nationaux de la France, alors le juge vient contrôler leur conventionnalité et accepte de le contrôler
même s’il est pris en application d’une loi.
- La loi ne fait alors plus écran sauf si l’engagement international méconnaît une règle ou un
principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.
- Les actes administratifs doivent aussi respecter les lois : le juge administratif contrôle la légalité
de ces actes sauf si la loi est incompatible avec un engagement international. S’il n’y a pas de
loi, le juge peut aussi contrôler l’acte par rapport aux Principes Généraux du Droit, qui ne
s’imposent pas aux lois qui peuvent y déroger. C’est une valeur supra-décrétale, mais qui reste
infralégislatives. Il existe ainsi une hiérarchie entre les actes administratifs.
B) – La hiérarchie des actes administratifs
Celle-ci procède de la hiérarchie liant les autorités administratives. Ainsi, un arrêté ministériel doit
respecter un décret du Premier ministre et/ou du Président de la République. Un arrêté préfectoral est
donc inférieur à un arrêté ministériel. En cas d’incompatibilité entre deux actes administratifs de
même valeur, comme deux décrets du Premier ministre, il faut tenir compte de la procédure d’élabo-
ration de l’acte.
L’acte adopté selon une procédure solennelle (un avis du Conseil d’État) va s’imposer à un acte adopté
selon une procédure plus simple. Au bas de l’échelle, les actes administratifs individuels doivent res-
pecter les règlements quelle que soit l’autorité administrative qui l’a institué, comme avec le Code de
l’urbanisme par exemple. Un préfet qui prend un acte administratif individuel doit respecter une ré-
glementation prise par une autorité inférieure, car c’est un règlement administratif.
Page 24 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Titre 2 – Le poids de la légalité
administrative
Chapitre 3 – Le poids de la légalité et les cir-
constances
Leçon 3
Le poids de la légalité administrative varie selon le contrôle du juge et les circonstances. Toutes les
sources n’ont ainsi pas le même poids sur l’administration, et celle-ci peut donc faire plus ce qui était
prévu à l’origine : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire en sont de parfait exemple, étant des
régimes de polices spéciales. Il y a donc un allègement de la légalité que Montesquieu évoquait déjà
dans l’Esprit des lois. Quels sont les paramètres du poids de la légalité en période normale ?
I] – Les périodes normales
En période normale, le poids de la légalité varie selon que les règles de droit place l’administration en
situation de pouvoir discrétionnaire ou de compétence liée.
A) – Le pouvoir discrétionnaire
a) Liberté et règle de droit
Le pouvoir discrétionnaire est présent, selon Michou « toutes les fois où une autorité agit librement
sans que la conduite à tenir lui soit dictée à l’avance par une règle de droit ». Le pouvoir de l’adminis-
tration n’est pas déterminé par la règle de droit. Soit il n’y en a pas, soit elle existe mais elle laisse
l’administration agir librement ; elle dispose d’une liberté pour agir et dispose d’un pouvoir d’appré-
ciation, d’une marge de manœuvre. La règle de droit laisse l’administration libre d’agir dans un sens
ou dans un autre. En voici quelques exemples :
- On sait par exemple qu’à la limitation des préfets, totalement dépendants du gouvernement
sont qualifiés « d’emplois à la décision du gouvernement ». Ce qui veut dire que l’exécutif dis-
pose d’une très grande liberté pour nommer (et révoquer) comme il le souhaite les membres
du corps électoral. Il y a très peu de règles qui conditionnent ici le choix de l’administration.
L’alternance politique n’est limitée en rien dans ces décisions discrétionnaires.
- L’attribution des décorations, à comprendre la légion d’honneur affiche aussi une grande li-
berté pour déterminer si les mérites d’une personne justifient ou non l’octroi d’une décoration.
L’autorité administrative est libre de décider et de choisir.
- L’autorité administrative, concernant les services publics peut soit gérer le service en régie (donc
directement), ou en déléguer la gestion en concluant un contrat de concession de service. Là
encore, l’autorité administrative est libre de choisir si elle préfère l’un des deux modes de gestion,
c’est du pouvoir discrétionnaire.
b) Liberté et contrôle du juge
Page 25 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
C’est la situation d’ordre juridique, c’est-à-dire l’agencement de la légalité qui donne naissance à ce
pouvoir discrétionnaire. Mais pour pouvoir le déterminer, il faut toujours se placer en aval du contrôle
juridictionnel, après que le juge ai exercé son contrôle pour une bonne et simple raison. Il arrive parfois
au juge d’interpréter le texte dans un sens qui va limiter la liberté de l’administration. Il arrive même
parfois au juge d’imposer des conditions, des règles nouvelles qui vont venir encadrer sa marge de
manœuvre.
- CE Ass. 1975, Société Rome-Paris Films. Dans cette affaire, les décisions du ministre sont prises
au sein de la police spéciale du cinéma, ou le ministre de la Culture accorde ou non un visa
d’exploitation du film sur l’ensemble du territoire national. Le Conseil d’État exerçait son con-
trôle sur ce pouvoir : « à défaut de toutes dispositions législatives définissant les conditions de
fait auquel est soumise la légalité des faits accordant ou non le visa d’exploitation […] ». Il n’y a ici
aucune limite législative au contrôle de la Culture et des visas le cas échéant. Peut-il faire ce
qu’il veut cependant ? « Les seules restrictions apportées aux pouvoirs du ministre sont celles
qui résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge […]. Il doit
quand même utiliser son pouvoir en conciliant la mission d’intérêt général qu’il poursuit (la
protection du jeune public) et les libertés de chacun (donc il ne pourrait pas interdire Babar, qui
ne risque pas de traumatiser la jeunesse) ». Le juge va encadrer l’action du ministère de la Culture
afin de protéger les libertés, comme dans CE 1933, Benjamin.
- CE 1990, préfet de la Savoie c/ Monsieur Cavdar. Monsieur Cavdar était un ressortissant étran-
ger et était resté en France alors qu’il lui avait été notifié une décision de refus de séjour sur le
territoire national. Il a alors fait une demande d’asile qui avait été refusée et il n’avait fait aucun
recours à ce sujet. Il se trouvait par conséquent susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloi-
gnement. Les textes autorisent le préfet à prendre une mesure nommée à l’époque de « recon-
duite à la frontière ». Le préfet prononce la mesure et c’est à ce moment-là que Cavdar fit un
recours et le Conseil d’État précisa que selon les textes, « le requérant peut faire l’objet d’une
mesure d’éloignement (c’est du pouvoir discrétionnaire). Toutefois, il appartient au préfet,
même dans ce cas de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences
d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familial de l’intéressé ». Il ajoute
ainsi une condition supplémentaire et inconnue jusqu’alors des textes. Il s’agissait ici de son
épouse enceinte et le juge était venu annuler la mesure par son illégalité : la condition posée
par le Conseil d’État n’avait pas été respectée. Ce qui apparaissait comme un pouvoir discré-
tionnaire l’est moins à la lecture de l’arrêt. Il faut donc toujours se placer en aval du contrôle du
juge.
B) – La compétence liée
a) Notion
L’administration est dans cette situation lorsque la règle de droit lui impose d’agir dans un sens ou dans
un autre ; elle n’a pas le choix. Elle est dans cette décision lorsqu’elle effectue un récépissé de la décla-
ration d’une association. Elle doit délivrer ledit récépissé ; cette délivrance est obligatoire. C’est une
garantie de la liberté d’association. Ne pas le délivrer reviendrait à un régime d’autorisation préalable.
b) Situations
Dans une autre situation, CE 2008, ministre de l’Intérieur, l’arrêt concernait un automobiliste flashé avec
un solde de point très faible, bien au-dessus de la limite de vitesse. S’empressant d’effectuer un stage
de récupération de point, il voit lors du dernier jour de son stage une notification à la suite de l’infrac-
tion que son permis est invalidé, puisque son solde de points était nul.
Page 26 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le Conseil d’État répondra que « le préfet est tenu de rejeter toutes demandes de reconstitutions de
points acquis à la suite d’un stage lorsque le conducteur a reçu avant le dernier jour du stage réguliè-
rement une notification de l’Intérieur l’informant que son permis a perdu sa validité à la suite de son
solde désormais inexistant de points ». L’administration est encore dans une situation de compétence
liée en matière d’avancement des fonctionnaires à l’ancienneté. Un fonctionnaire travaillant depuis
trois ans bénéficie automatiquement d’un changement d’échelon. C’est obligatoire, l’administration
n’a pas le choix. De même, elle doit dans un délai raisonnable abroger les éléments illégaux, édicter
les règlements d’application des lois ou encore elle ne doit pas appliquer un règlement illégal. Tout
cela relève de la compétence liée. Ces situations ne sont toutefois jamais totales. Elle ne dispose jamais
d’une compétence totalement liée, il y a toute une gamme possible de compétences liées. Son pouvoir
n’est jamais totalement lié, elle a toujours une possibilité de manœuvrer.
Pour le récépissé de la relevance de déclaration par exemple, elle doit délivrer des documents certes,
mais elle peut très bien décider de les envoyer sur l’instant présent ou à la fin de la semaine. Récipro-
quement, il n’est jamais totalement discrétionnaire (ou alors il serait arbitraire), il est encadré. Dis-
soudre l’Assemblée nationale en tant que Président de la République est possible, il peut donner des
motifs, mais c’est la Constitution qui encadre son pouvoir, cette règle de compétence. Si c’est le Premier
ministre, ce n’est pas possible. Il y a toujours un minimum de règles à respecter, comme un minimum
de marge de manœuvre. Choisir le sujet d’un examen ou d’un concours est possible par le jury, l’auto-
rité administrative. Elle doit choisir le sujet dans le programme, elle y est obligée et c’est de la com-
pétence liée. Mais à l’intérieur du programme, l’autorité administrative est parfaitement libre de choi-
sir l’objet de son sujet, mais cela reste soumis à des règles. Le pouvoir discrétionnaire et la compétence
liée s’entremêlent finalement. Le poids de la légalité en période normale varie selon les normes et les
règles de droit, mais aussi des faits.
II] – Les périodes exceptionnelles
Ces périodes sont à la fois consacrées par les textes législatifs, constitutionnels et jurisprudentiels.
A) – Les textes
a) Les textes législatifs
Il y a deux textes législatifs qui convient de présenter ici : les dispositions de la loi du 3 avril 1955
relatives à l’état d’urgence et les dispositions concernant l’état de siège.
1) L’état d’urgence
Il est régi depuis la loi de 1955, récemment reforgé après les attentats de 2015. L’article 5 dispose que
« l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements
d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-
Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évé-
nements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Ainsi :
- Le décret du 8 novembre 2005 prononça l’état d’urgence sur la base du premier article pour
mettre fin aux émeutes dans les banlieues.
- Le décret du 13 novembre 2015 prononça l’état d’urgence à la suite des attentats de Paris.
C’est le Président de la République qui est habilité à le prononcer par décret en Conseil des
Ministres.
Page 27 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il est ici en situation de pouvoir discrétionnaire, afin d’apprécier les circonstances justifiant la mise en
place de l’état d’urgence. CE 2005, Rollin estimait que la situation des banlieues n’était pas telle que
l’état d’urgence soit déclaré, et le Conseil d’État répondit que « le Président de la République dispose
d’un pouvoir d’appréciation étendue dans le but de déterminer la promulgation ou non de l’état
d’urgence ». Il va déterminer dans quelles circonscriptions il s’étendra ou non, tandis que la promul-
gation de l’état d’urgence au-delà de douze jours doit être autorisé par une loi, donc le législateur
doit se prononcer après la rapide intervention du législateur en début de période. L’état d’urgence
du 13 novembre 2015 a été prolongé par six lois qui se sont succédé jusqu’au 1er novembre 2017. En
conséquence, l’état d’urgence est un régime civil (à la différence du régime militaire qu’est l’état de
siège). Les pouvoirs de polices continuent d’exercer leurs pouvoirs de manière renforcée, tandis que
dans l’autre cas, les pouvoirs de polices sont transférés à l’armée. Durant l’état d’urgence, ce sont le
ministre de l’Intérieur et les préfets qui sont concernés.
- L’article 5 autorise ainsi à interdire la circulation des personnes et véhicules dans les lieux et
heures fixées par arrêtés, mais peuvent aussi interdire le séjour dans une partie du départe-
ment pour une personne à l’égard du territoire.
- L’article 6 autorise à prononcer des assignations à résidence.
o Selon le paragraphe 1 nouvellement ajouté, il est possible de prononcer la dissolution
d’association.
- L’article 8 autorise la fermeture des réunions et y compris des lieux de cultes faisant l’apologie
du terrorisme.
- L’article 10 autorise la réquisition par les pouvoirs de police.
- L’article 11 autorise la perquisition administrative, autorisant les forces de l’ordre à procéder à
des perquisitions dans les domiciles et véhicules que de nuit.
- L’article 14 dispose « qu’à l'exception des peines prévues à l'article 13, les mesures prises sur le
fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les condi-
tions fixées par le Code de justice administrative, notamment son livre V »
— Loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
Le juge administratif peut contrôler son usage, mais c’est le juge des référés-libertés qui est plus sus-
ceptible d’être saisi, comme actuellement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Lorsque le juge
administratif est saisi d’un recours contre une mesure de police prise sur le fondement de l’état d’ur-
gence, il va, selon CE Avis 2016 « vérifier, lorsqu’il contrôle la légalité des mesures de police qu’elles
sont suffisamment motivées, qu’elles indiquent le lieu et le moment de la perquisition administrative
et vérifie également qu’elles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à leur finalité (c’est le pro-
longement de CE 1933, Benjamin, à savoir le maintien de l’ordre).
2) L’état de siège
Ces dispositions législatives sont codifiées au sein du Code de la défense, puisque ce n’est pas un
régime civil mais militaire. En vertu de l’article L2121-1, « l’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas
de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée » ; autrement dit s’il
y a utilisation d’armes de guerre. Il est également décrété en Conseil des ministres par le Président de
la République, et déclarable sur tout ou une partie du territoire nationale, et la promulgation de l’état
de siège au-delà de douze jours doit être autorisée par la loi, avec la présence du pouvoir discrétion-
naire lors de sa promulgation. La nuance avec l’état d’urgence, c’est que l’état de siège est un régime
militaire : les pouvoirs de polices sont transférés aux pouvoirs des forces armées. En outre, la loi élargit
la compétence des tribunaux militaires. Il s’agit d’une juridiction d’exception (on juge vite et fort) et
évidemment, les pouvoirs des autorités de maintien de l’ordre sont renforcés, tandis que les libertés
publiques sont restreintes dans des conditions analogues à l’état d’urgence.
Page 28 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
b) Le texte constitutionnel
Article 16
Lorsque les circonstances sont réunies et que les conditions de l’article sont remplies, le Chef de l’État
peut décider d’utiliser les « pleins-pouvoirs » afin de faire face à une situation exceptionnelle. Cela
n’est arrivé qu’une fois sous la Vème République, à la suite du putsch, du coup d’État en Algérie, à
l’époque française. Ce qui est intéressant du point de vue administratif c’est que la situation provoquée
par le coup d’État a donné lieu à un grand arrêt, CE 1962, Rubin de Servens. Il s’était retrouvé déféré
devant une juridiction militaire d’exception justement mis en place par le Chef de l’État en l’applica-
tion de l’article 16. Ce fameux Rubin venait contester la mesure mettant en place ces juridictions d’ex-
ceptions, estimant notamment qu’au moment où les mesures avaient été prises, les circonstances
n’étaient plus réunies. Le Conseil d’État considéra d’abord que « la décision de mettre en application
l’article 16 de la Constitution a le caractère d’un acte de gouvernement », donc une incompétence du
Conseil d’État en somme mais comme aucune juridiction, pas même les Sages, nous sommes en pré-
sence d’un acte jusqu’alors injusticiable. Cela signifie par conséquent que le Chef de l’État est le seul
juge pour décider de mettre en application l’article 16. La seule possibilité face à un abus du Président
est d’engager sa responsabilité politique (issue d’une décision politique). Toujours selon cet arrêt, le
Conseil d’État va estimer que la mesure litigieuse consistant à créer un nouvel ordre de juridiction avait
été pris dans le domaine de l’article 24 de la Constitution et le Conseil d’État affirme que cette mesure
à le caractère d’un acte législatif, donc d’une loi. Le Conseil étant incompétent en la matière, il se déclare
tel quel. Certains auteurs estiment cependant que si la mesure prise l’avait été dans le domaine du règle-
ment (donc relevant de l’article 37), il aurait été question d’un règlement et le Conseil d’État aurait pu
être compétent. Cette situation d’exception affiche les limites du juge et du droit.
B) – La jurisprudence
a) Les conditions
Bien avant les textes législatifs et constitutionnels, la jurisprudence avait déjà observé la théorie des
circonstances exceptionnelles, une jurisprudence née pendant la Première Guerre mondiale. Le Con-
seil d’État considère ainsi que « l’existence de circonstances exceptionnelles permettent de valider des
actes pris par des autorités, alors-même que ces mêmes actes prit en période normale auraient été dé-
clarés illégaux ». C’est un allègement de la légalité.
- Cette théorie a été appliquée durant la Première Guerre mondiale (CE 1918, Heyriès et CE 1919,
Dames Dol et Laurent) ainsi que durant la Seconde Guerre mondiale. Ces circonstances excep-
tionnelles provoquent un allègement de la légalité, de telle manière que certaines mesures qui
auraient été normalement déclarées illégales soient autorisés, le juge administratif venant
mettre entre parenthèses la légalité, qu’il s’agisse de compétence, de fond ou de procédures.
- La mise de côté de compétence s’est affiché dans CE Sect. 1948, Marion c/ Comme de Saint-
Valéry-sur-Somme. Lors de la fuite de la commune durant la (seconde) guerre, certains adminis-
trés étaient restés et avaient décidé d’administrer la commune en l’absence des autorités com-
pétentes. Ce comité avait pris un certain nombre de mesures afin d’alimenter la commune et de
réquisitionner des denrées alimentaires auprès des commerçants.
b) Les conséquences
Il était clair qu’en période normale, une telle mesure serait tellement illégale que le juge la considérerait
inexistante (c’est la théorie de l’acte inexistant : en la présence d’un acte tellement illégal, celui-ci est
désormais nul et non-avenant, il est inexistant).
Page 29 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le Conseil d’État va consacrer l’existence de l’autorité de fait, qui a légalement pu décider les réquisi-
tions désormais attaquées. Il considère que « les actes litigieux n’étaient pas étrangers aux autorités
municipales. Elles auraient pu exercer un tel pouvoir de réquisition. Dans la mesure où les circons-
tances exceptionnelles nées dans l’invasion qui leur conférait un caractère de nécessité et d’urgence
ils devaient, bien qu’émanant de l’autorité de substitué être considéré non pas comme des actes non-
avenus, mais administratif », donc il s’était bien réalisé.
- CE 1918, Heyriès exprime une atteinte aux règles de procédures. Il avait fait l’objet d’une sanc-
tion et contestait celle-ci en reprochant à l’autorité administrative de ne pas avoir respecté
les « droits de la défense », comme on les surnomme aujourd’hui, consacrés par une loi de 1905
qui imposait, avant de prendre une sanction à l’égard d’un fonctionnaire de lui communiquer
son dossier afin qu’il prenne connaissance de ce qui lui était reproché. C’est ce qu’on appellerait
aujourd’hui une procédure contradictoire, mais la loi de 1905 avait été suspendue en raison des
circonstances de guerre. Le Conseil d’État valide alors la sanction alors que la règle de procé-
dure avait été mis de côté. Hauriou disait au sujet de cet arrêt « qu’en pleine guerre, on ne
s’arrête pas aux simples formalités ».
- Ce sont parfois aussi des règles de fond : CE 1919, Dames Dol et Laurent. Nous sommes à Toulon
et le préfet maritime avait décidé d’interdire aux propriétaires de café, d’hôtels etc. De rece-
voir dans leur établissement des femmes, accompagnées ou non. Il s’agissait de lutter contre
la prostitution, mais surtout d’éviter pendant la guerre la transmission d’informations par des
double-agents féminins. Était invoquée une atteinte à la liberté individuelle ainsi qu’à la liberté
du commerce et de l’industrie, cette dernière étant elle-même invoquée par les tenanciers des
bars. Le Conseil d’État va venir valider la mesure de police. « Alors même qu’en période normale,
de telles mesures auraient été jugées excessives et disproportionnées », il estime en l’espèce
que « les limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de
l’ordre et de la sécurité ne serait les mêmes en temps de guerre ».
En période exceptionnelle, on peut faire plus que ce que l’on peut faire normalement. Il a reconfirmé
cette décision plus récemment dans CE 1983, Rodes, où le préfet avait interdit la circulation sur une
route nationale et l’évacuation totale d’une zone géographique. Il (le préfet) avait interdit de même la
navigation maritime pour faire face au danger représenté par la Soufrière, un volcan de Guadeloupe.
Le Conseil était venu valider les circonstances exceptionnelles et les mesures de l’autorité de police.
Page 30 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 4 – Le poids de la légalité et le con-
trôle du juge
Leçon 4
Le juge doit intervenir pour imposer à l’administration le respect de la légalité. Mais si le juge admi-
nistratif est habilité à un tel contrôle de l’action administrative, il n’est pas le juge de son opportunité.
La légalité est ainsi la conformité au droit et l’opportunité, c’est l’adaptation aux faits. Le juge doit vérifier
si l’action de l’administration est légale, donc conforme au droit, mais il ne doit pas se prononcer sur
l’opportunité de l’administration, car cela relève du décideur public. Lorsque l’administration est en situa-
tion de pouvoir discrétionnaire, la règle de droit lui laisse le champ libre et elle va décider en opportunité.
Mais lorsqu’elle est en situation de compétence liée, la règle va lui imposer d’agir dans un sens ou dans
un autre, et la décision doit être appréciée du point de vue de la légalité car elle n’a plus le choix.
Cela est donc à observer en aval du contrôle du juge.
I] – L’intensité du contrôle du juge
Le poids de la légalité varie en fonction du contrôle du juge et de sa profondeur. Après le contrôle
normal, le juge peut en faire moins, menant au contrôle minimum ou plus que le contrôle normal donc
le contrôle maximum.
A) – Le contrôle normal
Si le contrôle du juge est susceptible de varier, c’est exclusivement à propos de l’appréciation des faits.
L’action de l’administration est toujours justifiée par des considérations de faits. Si elle prend une
sanction à l’égard d’un agent, c’est parce qu’il y avait une faute. L’administration doit donc apprécier
les faits et le juge va porter son contrôle à l’égard de cette même appréciation. En exerçant son con-
trôle normal, le juge administratif va d’abord contrôler la matérialité des faits.
a) Le contrôle de l’exactitude matérielle des faits
C’est le contrôle de l’exactitude matérielle des faits qui a été consacré par le CE 1916, Camino. Avant
celui-ci, cette appréciation était considérée comme une question d’opportunité, permettant à l’adminis-
tration d’inventer certains faits. Dans cette affaire, le préfet avait suspendu le maire de la commune
d’Hendaye. Le préfet disposait alors d’un pouvoir quasi hiérarchique sur celui-ci et l’avait suspendu, aux
motifs que celui-ci aurait manqué de veiller à la décence d’un convoi funèbre lors d’un enterrement. Il
aurait fait construire une tombe trop petite car le maire aurait partagé une inimité avec le défunt.
Camino viendra contester les faits et la légalité de la suspension, tandis que le Conseil d’État va instruire
l’affaire et constater que les faits sont matériellement inexacts. Il va venir estimer que ce contrôle de
la matérialité des faits relève de son office et restituer la réalité. Il dit que « si le Conseil d’État ne peut
apprécier l’opportunité des mesures qui lui sont déférées, il lui appartient de vérifier la matérialité des
faits qui ont motivées ces mesures ». L’appréciation matérielle des faits ne relève plus de l’opportunité
et l’administration ne peut plus qualifier les faits librement et cette qualification fait désormais l’objet
d’un contrôle. L’arrêté préfectoral est alors censuré, au motif « qu’il reposait sur des faits et des alléga-
tions dont les pièces versées au dossier établissent l’inexactitude ».
Page 31 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
b) Le contrôle de la qualification des faits
Cela revient tout simplement à prendre le fait matériellement exact et le faire rentrer dans une caté-
gorie : est-ce une activité de service public ? La réponse obtenue (oui), est-ce un Service Public Admi-
nistratif ou un Service Public Industriel et Commercial ? C’est faire rentrer le fait exact dans une ca-
tégorie, le qualifier, et de là découlera un régime juridique spécifique. Lorsque l’administration ap-
précie les faits. Elle va non seulement en apprécier la matérialité, mais aussi la qualification des faits.
Un fonctionnaire sanctionné pour son retard de dix minutes appréciera deux contrôles :
- Un contrôle matériel : le fonctionnaire était bel et bien en retard de dix minutes.
- Un contrôle de la qualification : le fonctionnaire en retard de dix minutes a commis une faute.
Oui ou non ? C’est là que la qualification se fait, et que le contrôle du juge s’effectuera. Lorsqu’il
exerce son contrôle normal, le juge contrôle la qualification juridique des faits.
Le juge administratif exerce ce contrôle depuis CE 1914, Gomel. En l’espèce, une demande de permis de
construire avait été demandé Place Beauvau sur Paris, proche de l’Intérieur et de l’Élysée. L’adminis-
tration pouvait soit accepter, soit refuser de délivrer le permis pour ne pas porter atteinte à un bien
monumental et le préfet refusa de lui délivrer le permis. Devant le Conseil d’État, Gomel énonça que le
préfet avait « illégalement refusé le permis de construire », estimant que la Place n’était pas à perspec-
tive monumentale et que le cas échant, le bâtiment à construire ne portait pas atteinte à la qualité de
la place. Il décida de saisir le juge pour contrôler la qualification des faits en une place de perspective
monumentale. Le Conseil d’État considère qu’il lui appartient « de vérifier si l’emplacement […] est
compris dans une perspective monumentale », et accepte d’exercer les deux contrôles :
- La place Beauvau est-elle d’une perspective monumentale ? Si oui,
o La construction du bâtiment porte-t-elle atteinte à cette perspective ?
- La place Beauvau n’étant pas de cette perspective,
o La construction est légale et la décision du préfet teinte d’illégalité. Il y a ainsi une partie
irréductible de subjectivité finalement. Toutefois, il peut refuser de se prononcer tota-
lement soit par un contrôle minimum, soit refuser totalement.
B) – Le contrôle minimum
a) L’absence de contrôle des motifs de fait
Il arrive parfois que le juge refuse tout contrôle de qualification des faits, estimant que l’appréciation
de l’administration est pleine d’opportunité et que cela ne relève pas de son contrôle. L’hypothèse de-
vient de plus en plus rare, mais tend à ressurgir à certaines occasions. L’appréciation est alors portée par
l’administration, comme dans un concours sur la prestation des candidats, où la prestation est portée par
un jury sur une copie. Obtenir 5 en pensant avoir 15 peut relever d’une erreur d’appréciation. Le Conseil
d’État refuse en disposant que « c’est un contrôle de pure opportunité », et qu’il ne peut pas la reprendre.
L’appréciation de décoration est aussi d’opportunité. Il a encore jugé dans CE 2000, Association Comité
tous frère la contestation du fleurissement de la tombe du Maréchal Pétain au nom du Président de
la République. Le Conseil d’État estima « qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité visée ».
De même, le choix d’une collectivité publique de choisir une gestion en régie ou non est une question
d’opportunité. Relève encore de l’opportunité le choix du tracé d’une route, d’une ligne électrique, etc.
L’administration n’est pas contrôlable par le juge de la légalité, mais ces appréciations d’opportunités
sont de plus en plus rares. Il exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits exercée par
l’administration, mais il existe un type de contrôle restreint : le contrôle d’erreur manifeste de l’apprécia-
tion.
Page 32 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
b) Le contrôle d’Erreur Manifeste de l’Appréciation (ou MEA)
Dans le cadre du contrôle minimum
C’est un contrôle du type, certes mais restreint. Le juge va censurer non pas l’erreur simple de qualifi-
cation des faits mais une grosse erreur, évidente, manifeste finalement. La formule rendant compte de
ce type d’erreur est « le juge, après avoir précisé que l’administration dispose d’un large pouvoir d’ap-
préciation affirme qu’il lui appartient de censurer celle-là en cas d’erreur de fait ou de droit ou de
détournement de pouvoir ». Le juge effectue un tel contrôle afin de ne pas laisser l’administration
faire ce qu’elle veut. Il ne faut pas qu’elle puisse commettre des erreurs évidentes de qualification.
Par exemple, sanctionner le fonctionnaire d’une minute de retard est une erreur manifeste. Il ne veut
pas se substituer d’un côté à l’administration, mais il ne veut pas de l’autre côté que l’administration
utilise son pouvoir discrétionnaire n’importe comment.
« Ce contrôle de l’erreur manifeste de l’appréciation est un contrôle restreint de la qualification des
faits, autrement dit un filet du même type mais aux mailles plus larges qui ne retiendrait les erreurs
aux indices patents » L’erreur manifeste doit être « grasse, évidente afin qu’elle soit visible même pour
le non-juriste […]. L’erreur manifeste est celle qui ne fait aucun doute pour un esprit éclairé ». Elle
doit être, selon les auteurs, importante. Il y a erreur et erreur, et on peut librement qualifier l’erreur
manifeste ou non, ce qui lui permettrait d’exercer un contrôle non négligeable. Dans certaines affaires,
le rapporteur public peut ne pas être d’accord avec l’existence d’une erreur manifeste. Est-il dans ce
cas-là un non-juriste à l’esprit éteint ? Parfois, les juridictions administratives saisies par des voies de
recours ne sont pas d’accord sur le caractère manifeste de l’erreur :
- Une Cour administrative d’appel peut considérer une sanction entachée d’une erreur mani-
feste
- Le Conseil d’État répondra l’inverse
- Que faire s’ils ne sont pas d’accord ? Officiellement, ils sont minimums mais officieusement,
cela peut aller très loin dans les débats. Son champ d’application va s’exercer dans des domaines
dans lesquels le juge n’a pas envie de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité
administrative.
o C’est le cas dans les matières techniques par exemple. L’administration peut faire rentrer
un vignoble dans une Appellation d’Origine Contrôlée. Pour qu’il puisse en relever, il y
a toutefois un certain nombre de critères à respecter – c’est une appréciation technique
et le juge va limiter son contrôle à l’erreur manifeste.
o Même solution à propos de la radiation d’un médicament de la liste des médicaments
remboursables. L’autorité peut considérer que certains d’entre eux n’ont pas suffisam-
ment d’effets pour en bénéficier, et le juge va aussi limiter son contrôle à l’erreur ma-
nifeste en raison de la technicité de la décision.
o Même choix dans la construction des programmes scolaires : CE 2018, Association pour
la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires ; le
juge y limita son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation.
o Ce contrôle est également exercé pour les fonctionnaires publics et leur notation. Le con-
trôle est aussi celui de l’erreur manifeste.
o En matière de police, l’autorité va prendre des mesures pour restreindre les libertés, et
c’est pour cette raison que les mesures positives de police sont soumises à un contrôle
poussé, qui est celui de la proportionnalité. Il fait une différence entre les mesures néga-
tives et positives de la police.
Dans tous les cas, ce contrôle est destiné à censurer les excès de l’administration. L’administration dis-
pose d’une marge de manœuvre en situation de pouvoir discrétionnaire et est libre d’agir mais pas
de faire n’importe quoi. Il s’agit alors de censurer une erreur évidente de l’administration.
Page 33 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Parfois, ce contrôle n’est pas si loin d’un contrôle d’opportunité : CE 1990, Kiener – Monsieur Kiener
appartenait à la gendarmerie, et celui-ci avait commis un vol dans un supermarché de 143.60 Francs,
à savoir 34,58 €. Le ministre de la Défense avait décidé de le sanctionner d’une sanction grave : il était
radié des cadres, donc démit de ses fonctions. Il Kiener consta la décision et le Conseil d’État considéra
à ce sujet que « eu égard à l’ensemble des données de l’affaire, et notamment en l’absence de toutes
plaintes portées par le directeur du magasin à l’égard de Kiener comme de toutes poursuites pénales,
en la raison que les circonstances se sont produit à une atteinte grave à la représentation de la force
publique vis-à-vis du public puisque monsieur étant en civil ». Habillé en civil, son vol ne porta pas
atteinte à l’image de la police que se donne le public. « N’ayant jamais commis de fait du type, le
Ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation ». La sanction est illégale puisque entachée.
Elle est excessive, inadaptée aux faits.
C) – Le contrôle maximum
C’est un contrôle plus poussé de la qualification des faits, et il en existe deux techniques.
a) Le contrôle de proportionnalité
Exercé sur les mesures positives de police
Il a été introduit en matière de police par CE 1933, Benjamin. En l’espèce, René Benjamin, un royaliste
catholique et intégriste avait souhaité venir à Nevers pour prononcer une conférence. Un certain
nombre de syndicats (dont d’instituteurs) décidèrent d’organiser des manifestations pour s’opposer à
cette venue. Le maire de la commune décida d’utiliser ses pouvoirs de police pour interdire les con-
férences qui risquaient de mener à des troubles de l’ordre public. Saisit par Benjamin, le Conseil d’État
disposa que « s’il incombe au maire de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit
concilier l’exercice de ses pouvoirs avec la liberté de réunion que garantie les lois ». Le contrôle de
proportionnalité s’affiche et s’affirme, alors que le Conseil d’État défend les libertés publiques avant
les Sages. « L’éventualité des troubles ne présentait pas une gravité tel qu’il n’est pas à interdire la
conférence pour maintenir l’ordre public en dictant les mesures de police qu’il lui appartient de pren-
dre », la mesure de police était donc disproportionnée. Le maire aurait dû prendre, à la limite des mesures
encadrant la manifestation. Une mesure de police n’est donc légale que si elle est proportionnée au
trouble qu’elle vise à encadrer.
- CE 1980, Maire de Strasbourg et sa mesure de police – celui-ci avait interdit le commerce du 1er
avril au 30 octobre de 10 h à 20 h sur huit voies et cinq places du secteur réservé aux piétons
aux abords de la Cathédrale de la ville. Le juge est venu exercer son contrôle de proportion-
nalité du fait de la CE 1933, Benjamin, estimant que la mesure était adaptée aux circonstances
de temps et de lieu, la définition-même de l’opportunité finalement. Ce que le juge ne dit pas en
revanche est qu’une mesure de police est légale que si elle est opportune. Le contrôle de pro-
portionnalité traite finalement de l’opportunité.
- CE 2018, Ligue des Droits de l’Homme c/ Commune de Béziers. Le maire de Béziers avait pris
par arrêté une mesure interdisant la circulation des moins de treize ans entre 23 h et 6 h du
matin dans des zones correspondant au centre-ville et aux quartiers dangereux de la ville,
toutes les nuits des vendredis, samedis et dimanches (donc les weekends) et durant les va-
cances scolaires de la zone A de juin à septembre. Le juge est venu la censurer car la mesure
n’était pas justifiée par rapport à la situation de faits.
- Une mesure de police n’est donc légale que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée. Le
Conseil d’État a consacré cette triple nécessité dans une affaire concernant le passeport biomé-
trique le 26 octobre 2011.
Page 34 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
c) Le contrôle d’opportunité
La réponse à cette question dépend de la conception que l’on adopte de l’opportunité. Pour une partie
de la doctrine, dès lors que le juge exerce un contrôle sur une question d’opportunité, la légalité
remplace l’opportunité. Elle est alors définie comme « ce qui échappe au contrôle de légalité ». Par
conséquent, dès lors que le juge contrôle, l’opportunité disparaît. Il n’y a donc jamais de tel contrôle.
Mais on peut également définir l’opportunité, d’ailleurs de manière plus conforme au langage courant
comme « ce qui est adapté aux faits », la légalité étant ce qui est conforme au droit. Il suffit que le juge
considère qu’une décision n’est légale que si elle est adaptée aux faits de l’espèce pour qu’il contrôle
à la fois la légalité et l’opportunité de cette décision.
CE Ass. 2011, Association pour la promotion de l’image vient ainsi consacrer ce que l’on appelle le
« triple test de proportionnalité », qui nous semble l’illustrer. Dans cette affaire, le Conseil d’État devait
se prononcer sur la légalité du décret du 30 avril 2008 qui instituait le passeport biométrique. Ce texte
prévoyait notamment le recueil électronique des empreintes digitales de huit doigts du demandeur.
Après avoir estimé que l’utilité de ce recueil n’était pas établie, le Conseil d’État considéra par la même
occasion que la collecte et la conservation de ces huit empreintes digitales « ne sont ni adéquates, ni
pertinentes et apparaissent excessives au regard des finalités du traitement informatisé ». Il en déduit
que les requérants « sont fondés à soutenir que les mesures prescrites par le décret attaqué ne sont pas
adaptées, nécessaires et proportionnées et à demander la suite l’annulation de cette disposition ». Le
contrôle ici exercé est un contrôle de qualification juridique des faits, puisqu’il s’agit de vérifier si la
mesure de police est « adaptée, nécessaire et proportionnée ». Mais c’est un contrôle particulièrement
approfondi, confinant à l’opportunité.
- En effet, la mesure de police doit être « adaptée », c’est-à-dire pertinente par rapport au but
recherché.
- Elle doit aussi être nécessaire, ce qui signifie à la fois qu’elle ne doit pas excéder ce qu’exige la
réalisation du but poursuivi, et que cet objectif ne pouvait être atteint par d’autres moyens moins
attentatoires à la liberté.
- Elle doit enfin être proportionnée au sens strict, elle « ne doit pas, par les charges qu’elle créée
être hors de proportion avec le but recherché ». Mais n’est-ce pas ici exiger que la mesure de
police soit opportune ? Ce contrôle s’opère en effet en référence à une autre mesure de police
possible, aussi efficace pour assurer le maintien de l’ordre public, mais moins attentatoires aux
libertés. Il semble bien ici que le juge érige des éléments d’opportunité en conditions de léga-
lité.
d) Le contrôle de l’EMA (ou Erreur Manifeste d’Appréciation)
Dans le cadre du contrôle maximum
Alors même que le contrôle de proportionnalité est présenté comme maximum et que le contrôle de
l’erreur manifeste d’appréciation est présenté comme minimum, la distinction entre les deux con-
trôles peut sembler parfois ténue, ce que qu’illustre le contrôle des mesures administratives au regard
du principe d’égalité. Selon le Conseil d’État, « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité
investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle
déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit
pas manifestement disproportionné au regard des différences de situation susceptibles de la justice »
— CE 2019, Fédération française de la coutellerie. C’est ici la disproportion manifeste qui est censurée
par le juge, comme l’illustre CE Sect. 2007, Syndicat des avocats de France.
Page 35 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Dans cette affaire, le Conseil d’État estime que le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu le principe
d’égalité en instituant des règles distinctes d’accès à la profession d’avocat pour les juristes salariés
d’un cabinet d’avocat et les juristes d’une entreprise ou d’une organisation syndicale. Il estime en effet
que « cette différence de traitement n’est pas manifestement disproportionnée au regard des diffé-
rences de situation ». Yann Aguila profita de cette affaire pour « lever une certaine confusion sur la
notion de proportionnalité ». On présente parfois (et même souvent) l’exigence de proportionnalité
comme une question touchant au degré de contrôle du juge. Elle s’insérait dans la gamme des possi-
bilités de contrôle, qui irait du contrôle de l’erreur manifeste (l’hypothèse de contrôle la plus basse)
au contrôle de proportionnalité, l’hypothèse de contrôle maximal. Or avec une telle présentation, la
jurisprudence pourrait laisser perplexe : on introduit un contrôle de proportionnalité et pourtant, le
juge ne censure qu’une erreur manifeste. En réalité, elle montre surtout que l’exigence de proportion-
nalité touche non pas à la question du contrôle du juge mais à celle des règles de fond qui s’imposent
à l’administration. Le juge impose à l’administration une règle, à savoir celle du respect d’une certaine
proportionnalité entre la différence de traitement et la différence de situation. Mais sur cette règle de
droit peut s’exercer différents types de contrôle :
- Soit un contrôle normal, comme dans CE 1933, Benjamin en matière de libertés.
- Soit un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, comme dans
o CE 2002, Villemain
o CE 2002, Duvignères en matière d’égalité.
En effet, l’exigence de proportionnalité renforce la légalité ; elle permet de pallier le silence du
texte. La disposition législative habilitant le pouvoir réglementaire à agir lui laissait dans cette affaire
une grande liberté, puisque l’article 11 de la loi imposait seulement que les personnes susceptibles
de bénéficier de la dispense soient au moins titulaires d’une maîtrise en droit (ou de titres ou de
diplômes reconnus comme équivalents). C’est bien par conséquent l’application par le juge du principe
d’égalité, c’est-à-dire l’exigence de proportionnalité entre la différence de traitement et la différence
de situation qui limite ici la liberté de l’administration. Certes, le contrôle exercé ici est celui de l’erreur
manifeste d’appréciation et non pas celui de la proportionnalité, mais il l’est sur la proportionnalité
de la mesure. L’objectif ici est de censurer les mesures manifestement disproportionnées. Lorsque l’on
sait que les erreurs manifestes ne le sont pas nécessairement in fine, le juge peut censurer les mesures
qu’il estime disproportionnées. Il en arrive donc au même résultat que lorsqu’il exerce son propre
contrôle de proportionnalité.
b) Le contrôle du bilan (ou avantage)
Le contrôle juridictionnel maximum se concrétise également par le contrôle du bilan, qui est apparu
dans
• CE Ass. 1971, Ville Nouvelle Est. Dans cette affaire, l’État avait procédé à des expropriations
pour la réalisation d’une ville nouvelle près de Lille : Villeneuve-d’Ascq. L’expropriation n’était
juridiquement possible que s’il existait un intérêt public. Le Conseil d’État devait donc détermi-
ner si l’opération projetée était ou non d’utilité publique. Il inaugure pour cela son contrôle
du bilan, en mettent en balance les avantages et les inconvénients du projet.
o Si la balance penche du côté des avantages, il y a utilité publique et la décision est légale.
o Si la balance penche du côté des inconvénients, il n’y a pas cette utilité et la décision est
illégale.
• Voici la formule de principe désormais exprimé au travers de ce contrôle : « une opération ne
peut pas être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le
coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation
de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas
excessifs eu égards à l’intérêt qu’elle présente. » — CE 2018, Commune de Mitry-Mory.
Page 36 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il s’agit ici d’opérer un contrôle de qualification juridique des faits puisqu’il s’agit de vérifier si l’opéra-
tion projetée – le fait – est d’utilité publique ou non, à savoir la catégorie juridique. Mais c’est un
contrôle approfondi, car l’opération projetée ne peut être ainsi qualifiée que si ses avantages sont
supérieurs à ses inconvénients. Selon le président Braibant, « l’objectif de ce contrôle est de permettre
de censurer les décisions arbitraires, déraisonnables ou mal étudiées et qui oblige les collectivités à
présenter aux administrés d’abord et ensuite, le cas échéant, au juge des justifications sérieuses et
plausibles de leurs projets ». Ces adjectifs (arbitraires, déraisonnables, mal étudiées, sérieuses, plausibles)
donnent « sans doute la vraie clé de cette jurisprudence », selon Labetoulle. L’objectif est d’en effet faire
échec à des projets déraisonnables ou inutiles, et ainsi éviter que le pouvoir discrétionnaire de l’ad-
ministration ne soit arbitraire. Comme l’avait suggéré le président Braibant dans ses conclusions, cet
objectif « aurait sans doute pu être déjà atteint par le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
car en effet, la décision de réaliser un projet dont le bilan est défavorable est sans doute entachée
d’erreur manifeste ». La différence entre le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et celui du
bilan est donc intellectuellement assez mince.
Cela ne doit pas surprendre, puisqu’il s’agit dans les deux cas de contrôler la qualification juridique des
faits et ce, opéré par l’administration. En outre, le contrôle ici exercé est bien proche du contrôle
d’opportunité. Déterminer les avantages et les inconvénients d’une décision, et ne la prendre que si
les avantages sont supérieurs aux inconvénients revient à prendre une « bonne décision », une déci-
sion avantagée, opportune et adaptée aux circonstances. Le contrôle du bilan se rapproche en cela
de celui de proportionnalité mais dans les deux cas, c’est l’inopportunité que censure le juge, ce que
laisse entendre Mattias Guyomar. « Dans les deux cas (le contrôle des mesures de police et de l’utilité
publique des mesures d’expropriation), les textes sont muets sur le contenu des mesures à prendre.
Mais vous considérez toutefois que l’autorité compétente ne peut décider en face de circonstances
données que des mesures qui leur sont adaptée ». C’est pour cela que ce contrôle de l’une des moda-
lités du contrôle maximum est effectué par le juge administratif. Enfin, ce contrôle est nécessairement
subjectif, car l’appréciation du bilan dépend largement de ceux habilités à l’apprécier.
C’est ainsi que dans CE 2003, Association SOS-Rivières et environnement à propos de la réalisation
d’un projet de barrage-réservoir en Charente-Maritime, le Conseil d’État considéra que, en appliquant
cette théorie du bilan, ce projet était dépourvu d’utilité publique alors que Francis Lamy, dans ses
conclusions sur cet arrêt exprimait ce caractère d’utilité publique en appliquant le même bilan. L’in-
tensité du contrôle du juge est non seulement susceptible de varier, mais elle peut également évoluer
avec le temps.
II] – L’évolution du contrôle du juge
L’évolution du contrôle juridictionnel va toujours dans le même sens : celui de son renforcement. C’est
la logique de l’État de droit. Ce renforcement du contrôle s’est manifesté dans de nombreux domaines.
A) – La police administrative
De l’absence de contrôle au contrôle normal
L’absence du contrôle juridictionnel est d’abord apparue à l’égard de certaines mesures de police qui
n’étaient antérieurement soumises à aucun contrôle de qualification juridique des faits. Ainsi, à propos
des décisions refusant une autorisation de détention d’armes, le Conseil d’État est passé d’un contrôle
limité à la seule exactitude matérielle des faits (CE 1976, Guéril) à un contrôle incluant l’erreur mani-
feste d’appréciation (CE 1987, Melki).
Page 37 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- Dans un domaine analogue, les décisions préfectorales ordonnant aux personnes susceptibles de pré-
senter un danger de remettre leurs armes à l’autorité administrative sont désormais soumises au
contrôle normal, le Conseil d’État estimant qu’il incombe ici au juge « d’exercer un entier contrôle sur
les décisions prises par l’autorité préfectorale » — CE 2015, Monsieur B. A.
- Concernant les autres mesures de police prises à l’égard des ressortissants étrangers, le juge a long-
temps refusé de contrôler l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la menace pour
l’ordre public que pouvait constituer la présence d’un étranger sur le territoire national. Il considérait
alors que « l’opportunité de la mesure d’expulsion » ne pouvait être discutée devant le Conseil d’État,
qui statuait alors au contentieux — CE 1952, Meyer.
- Il a ensuite soumis cette appréciation au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE
1975, Ministre de l’Intérieur c/ Pardov).
- Et désormais, le Conseil d’État considère que lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce
que le maintien d’un étranger sur le territoire national « constitue bel et bien une menace
pour l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisit d’un moyen en ce sens
de rechercher sur les faits qu’elle (l’administration), à cet égard sont de nature à justifier léga-
lement sa décision » — CE 2014, Ministre de l’Intérieur. Cette formulation exprime le contrôle
normal du juge administratif.
- Enfin, ce renforcement du contrôle a encore concerné les décisions de suspension du permis de con-
duire. Longtemps soumises au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE 2016, ministre de
l’Intérieur), les décisions préfectorales prononçant la suspension du permis de conduire sont désor-
mais, tant dans leur principe que dans leur durée soumise au contrôle normal et doivent par conséquent
être légalement justifiée (CE 2019, ministre de l’Intérieur).
B) – La fonction publique
a) L’accès à la fonction publique
De manière traditionnelle, l’autorité administrative est habilitée à arrêter, dans l’intérêt du service la
liste des candidats autorisés à se présenter à un concours d’accès à la fonction public, de manière à
vérifier que les candidats sont présentés indépendamment de leurs compétences professionnelles, et
examiné par le jury du concours, les garanties requises pour l’exercice de leurs fonctions. Considérant
que l’administration disposait en la matière d’un pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a d’abord
initié son contrôle à celui de l’exactitude matérielle des faits, de l’erreur de droit et du détournement
de pouvoir (CE Sect. 1953, Lingois, Rec). Il a ensuite exercé son contrôle minimum de l’erreur manifeste
d’appréciation dans CE 1973, Jacques.
Depuis l’arrêt CE Sect. 1983, Raoult, le Conseil d’État exerce son contrôle normal. En l’espèce, le mi-
nistre de la Justice avait refusé d’inscrire le requérant sur la liste des candidats admis à prendre part
au concours de l’ENA, au motif que compte tenu du contenu de certains passages d’un journal tenu
par lui lorsqu’il était dans l’armée, cette manifestation publique d’opinion était incompatible avec la
réserve et la pondération qui s’imposent à un candidat à l’exercice des fonctions de magistrat. Le
Conseil d’État considéra qu’en refusant pour ce motif l’inscription du requérant, le ministre a « fondé
sa décision sur des faits qui étaient de nature à la justifier légalement ». Comme cela ressort des con-
clusions de Martine Laroque, le renforcement du contrôle s’explique ici par la volonté de renforcer les
droits de ceux postulant à un emploi public : « l’accroissement du nombre et de la diversification des
emplois publics et leur place dans la société d’aujourd’hui doit permettre, sinon d’admettre un droit
Page 38 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
absolu de tous à concourir, du moins d’affirmer que le pouvoir qu’on disait discrétionnaire du Ministre
de fixer la liste des candidats admis à concourir doit s’exercer sous votre entier contrôle ».
b) Les sanctions disciplinaires
- À propos du choix d’une sanction disciplinaire, le juge administratif s’est d’abord refusé à apprécier le
degré de gravité d’une sanction par rapport à la faute commise, car il ne s’estimait pas « juge de
l’opportunité des mesures disciplinaires » — CE 1932, Demoiselle Merlet.
- Il affirmait ainsi dans CE 1947, Sieur Bensmaïn Ghalem Ben Hadj « qu’il n’appartient pas au Conseil
d’État statuant au contentieux d’apprécier si l’importance de la sanction prise par l’autorité adminis-
trative est en rapport avec les faits qui l’ont provoquée ».
- Il a néanmoins fallu attendre CE Sect. 1978, Lebon pour qu’il décide de « faire sortir le choix de la
sanction infligée à un agent public de la sphère de l’opportunité administrative ».
Par cet arrêt, le Conseil d’État décide en effet de soumettre cette appréciation « discrétionnaire (selon
Genevois) de l’administration au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ». Comme l’expliquait
le président Genevois dans ses conclusions sur cette affaire, « en droit, le fait que l’appréciation de
l’importance de la sanction par rapport aux faits qui l’ont provoquée constitue l’exercice d’un pouvoir
discrétionnaire ne vous interdit nullement d’exercer dans ce cas, comme dans toutes les autres hy-
pothèses où il y a exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’administration, le contrôle de l’erreur
manifeste d’appréciation. Sans vous substituer à l’administration, vous serez simplement conduits à
censurer une décision en cas de disproportion évidente entre une sanction grave et une faute légère ».
Désormais, le juge administratif exerce en la matière un contrôle normal.
- Après avoir concerné les sanctions professionnelles (CE Sect. 2007, Monsieur Patrick Arfi)
- Les sanctions infligées aux magistrats du parquet (CE 2009, Hontang)
- Les sanctions sportives prononcées par les fédérations (CE 2010, Fédération française d’athlé-
tisme)
- L’agence française de lutte contre le dopage (CE 2011, Benzoni)
Ce renforcement du contrôle touche en effet les sanctions infligées aux agents publics.
- C’est l’apport de l’arrêt CE Ass. 2013, Monsieur Dahan dans lequel le Conseil d’État considéra
« qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens de rechercher si les
faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des
fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité
de ces fautes ». Puis, exerçant ce contrôle normal à l’égard de la sanction choisie, il estime qu’eu
égard à la nature des faits reprochés, « l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce pris une
sanction disproportionnée en décidant de mettre l’intéressé à la retraite d’office ». Le choix
d’une sanction disciplinaire est désormais soumis à un contrôle normal de l’adéquation de la
sanction aux faits reprochés.
- Le juge censure ainsi les sanctions « hors de proportion avec les fautes » — CE 2020, Monsieur
A, et non pas seulement celles manifestement disproportionnées.
- Cette solution a depuis été étendue aux sanctions infligées aux détenus (CE 2015, Monsieur B)
et aux militaires (CE 2016, Monsieur C).
Le renforcement du contrôle juridictionnel en la matière illustre bien ses conséquences sur la liberté
de l’administration.
- Dans le premier état du droit, sur les onze sanctions actuellement prévues par le statut appli-
cable aux fonctionnaires de l’État (article 66 n°8416 du 11 janvier 1984), l’autorité administrative
était libre de choisir la sanction lui paraissant opportune.
Page 39 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- Dans le deuxième état du droit, cette autorité ne pouvait plus choisir qu’une sanction n’étant
pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ce qui, sur onze sanctions prévues n’en
concernait peut-être que cinq ou six.
Désormais, seules les sanctions proportionnées à la faute peuvent être prises par l’autorité adminis-
trative : sur les onze sanctions prévues à l’origine, elles ne sont peut-être plus que deux ou trois à être
légalement prononçables. Le renforcement du contrôle juridictionnel limite ainsi la liberté de l’ad-
ministration.
C) – Le licenciement des salariés protégés
a) Les autorisations administratives de licenciement
Les décisions de l’inspecteur du travail ou du ministre du Travail autorisant le licenciement de salariés
protégés par les entreprises privées (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise et délé-
gués syndicaux) ont d’abord échappé au contrôle juridictionnel.
- Dans un premier état du droit, le Conseil d’État considérait en effet que l’appréciation portée par
l’autorité administrative sur le comportement du salarié protégé était une appréciation « d’op-
portunité », donc insusceptible d’être discutée devant lui en contentieux
— (CE Sect. 1949, Société nancéienne d’alimentation).
- Puis, le Conseil d’État a décidé d’introduire son contrôle en le limitant au contrôle de l’erreur
manifeste d’appréciation
— CE 1966, Ministre du Travail c/ Bisson.
- Désormais, depuis son arrêt CE Ass. 1976, SAFER d’Auvergne c/ Bernette, le juge administratif
exerce un contrôle normal de qualification juridique, vérifiant que les faits reprochés au sala-
rié sont suffisamment graves pour justifier l’autorisation administrative de licenciement.
b) Les motifs d’intérêt général
Même si les faits sont de nature à justifier le licenciement, l’autorité administrative peut toujours, pour
des motifs d’intérêt général refuser l’autorisation.
- À l’origine, son appréciation des motifs justifiant le refus « n’était pas susceptible d’être discu-
tée au contentieux »
— CE 1968, Manufacture française des pneumatiques Michelin.
- Puis le Conseil d’État précisa que « pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative
a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de
l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des
intérêts en présence (cf. SAFER d’Auvergne). Alors même qu’il estime que l’appréciation de l’ad-
ministration relève de l’opportunité, le juge exerce son contrôle en soupesant les intérêts en
présence et en vérifiant qu’une atteinte excessive ne leur soit pas portée.
- Le Conseil d’État vérifie ainsi que les motifs d’intérêt généraux invoqués sont susceptibles
d’être retenus. La volonté de maintenir une représentation syndicale dans l’entreprise permet
ainsi à l’administration de ne pas autoriser le licenciement d’un salarié fautif
— CE Sect. 2005, Monsieur Marcel.
- Le juge exerce un contrôle normal à la fois sur le motif invoqué et sur le caractère excessif ou
non de l’atteinte portée aux intérêts en présence
— CE 1987, Ghazi.
Page 40 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
c) Le pouvoir discrétionnaire de l’administration procède du contrôle du juge
Pourquoi, dans toutes les hypothèses précédemment envisagées, le contrôle du juge administratif évo-
lue-t-il alors que les textes applicables à l’administration demeurent inchangées ? C’est parce que ce
renforcement s’explique par la volonté du juge de protéger plus efficacement les droits des justi-
ciables. Il illustre ainsi parfaitement le mouvement général du droit administratif, qui est celui d’un
droit tenant de plus en plus compte des administrés. Cela justifie aussi pourquoi le pouvoir discré-
tionnaire dont dispose l’administration, c’est-à-dire la liberté qui est la sienne ne doit pas être appré-
cié en amont, mais en aval du contrôle juridictionnel. Le juge, en décidant de pousser plus ou moins
loin son contrôle laisse en effet une plus ou moins grande liberté à l’autorité administrative. Bref, ce
n’est pas de la distinction entre pouvoir discrétionnaire et compétence liée que procède l’étendue du
contrôle juridictionnel, c’est à l’inverse de l’étendue du contrôle du juge que dépend la situation dis-
crétionnaire ou liée dans laquelle se trouve l’administration. Le respect de la légalité n’est pas la seule
obligation qui pèse sur l’administration. Cette dernière doit réparer certains dommages en engageant
sa responsabilité.
Page 41 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Partie 2 – La responsabilité
administrative
Parce que l’administration est principalement chargée d’accomplir – dans un but d’intérêt général – des
missions administratives, sa responsabilité est, conformément au célèbre TC 1873, Blanco engagée sur
le fondement non pas des règles du droit civil mais celles du droit administratif. Elles sont parfois issues
de textes législatifs, et c’est le cas par exemple de la loi rendant l’État responsable des dommages
causés à l’occasion d’attroupements ou de rassemblements. Mais le plus souvent, les règles du droit
administratif de la responsabilité sont le produit de la jurisprudence, dans la continuité de Blanco. Ce
droit a profondément évolué. Longtemps, et dans l’esprit de la maxime d’Ancien régime, « le roi ne peut
mal faire », et l’État n’était pas responsable des dommages qu’il causait. Puis ce principe d’irresponsa-
bilité de la puissance publique fût abandonné, et ce même si sa responsabilité n’était ni générale, ni
absolue. L’État pouvait et indépendamment de tout texte être tenu pour responsable des dommages
causés aux particuliers « par le fait des personnes qu’il employait dans les services publics », selon
l’arrêt Blanco. Mais assez rapidement, la jurisprudence alla étendre cette responsabilité.
L’extension fût d’abord organique – ce n’était plus seulement la responsabilité de l’État qui pouvait être
engagée mais aussi celle des autres personnes publiques, à commencer par les collectivités territoriales
selon TC 1908, Feutry puis les établissements publics (TC 1908, Jouillié). Enfin, ce fût celles des personnes
privées chargées de la gestion d’un service public à l’occasion d’un dommage qu’elles causent dans
l’accomplissement de leurs prérogatives de puissance public (TC 1978, Bernardi). L’extension fût en-
suite fonctionnelle : ce n’était plus seulement les missions de service public à caractère économique
qui étaient de nature à engager la responsabilité de la puissance publique comme sous l’arrêt Blanco, mais
aussi les missions de police administrative (CE 1905, Tomaso Grecco) ainsi que les autres missions,
notamment, les services publics de santé (CE Sect. 1935, Dame Vion et Dame Philipponeau). Cette
même extension fût enfin couverte d’une dimension matérielle. La responsabilité de l’administration avait
d’abord été engagée pour faute, conformément au droit commun puis sans faute de manière déro-
gatoire au droit commun (CE 1895, Cames). Si le droit administratif de la responsabilité était initialement
exorbitant du droit commun afin de protéger l’administration, il est désormais forgé tel qu’il est en
faveur des victimes du dommage pour favoriser leur indemnisation, tel le courant suivi par la respon-
sabilité civile. Le droit administratif de la responsabilité n’est donc guère éloigné du droit commun et
le rapprochement est d’ailleurs parfois souhaité, espéré par le législateur. La responsabilité médicale
et hospitalière est ainsi régie par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé, qui est pour l’essentiel codifié au sein du Code de santé publique.
Auparavant, les règles différaient selon que le dommage était le fait des hôpitaux publics ou celui des
cliniques privées et des praticiens libéraux. Le législateur considère désormais que les uns et les autres
appartiennent au même système de santé qui doit, sur ce point être régi par les mêmes règles dans
l’intérêt des patients. Enfin, conformément au droit commun, la responsabilité administrative ne peut
être engagée que si plusieurs éléments sont réunis.
Page 42 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 5 – Les éléments de la responsabi-
lité administrative
Leçon 5
Une responsabilité, qu’elle soit administrative ou civile ne peut être engagée que si plusieurs éléments
sont réunis. Il faut tout d’abord un fait générateur imputable à une personne juridique. Ce même fait
doit entraîner un dommage (ou un préjudice), et un lien de causalité doit exister entre les deux, de telle
manière que le fait soit dommageable ou préjudiciable. Enfin, il existe des circonstances exonératoires
qui, même si les éléments précédents sont réunis permettent d’être exonéré de sa responsabilité.
I] – Le préjudice
Pour être indemnisé, un préjudice doit revêtir certaines caractéristiques. D’abord, « l’ouverture du droit
à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués », d’après CE
2016, Commune de Longueville. Ensuite, le préjudice doit être indemnisable.
A) – Le préjudice doit être direct et certain
a) Un préjudice direct ou personnel
Le préjudice doit d’abord être direct ; la jurisprudence parle aussi parfois de préjudice personnel. Cela
signifie qu’il doit y avoir une atteinte portée à un droit propre, et c’est évidemment le cas de la victime
immédiate du dommage, comme l’est la personne blessée dans un accident. Mais c’est également le
cas des victimes indirectes qui sont proches de la personne blessée ou décédée. Que cela soit le conjoint,
les enfants, les parents, les frères ou sœurs. Le Conseil d’État a même jugé que la concubine d’un sapeur-
pompier avait avec lui « une liaison suffisamment stable et continue pour lui donner vocation à obtenir
réparation du préjudice que lui a causé le décès de son compagnon » — CE Ass. 1978, Dame veuve
Muësser. Autrement dit, il faut avoir la qualité d’ayant-droit. Il en va ainsi des héritiers de la victime
décédée, mais également des « proches » de cette victime, c’est-à-dire ceux qui « entretenaient avec elle
des liens étroits » — CE Sect. 2019, Monsieur F. I. et Madame H. I. C’était le cas en l’espèce des nou-
veaux conjoints des parents divorcés d’une jeune fille décédée, car ils avaient « noué des liens affectifs
étroits avec l’adolescente, et avaient été très présents à ses côtés ».
Parfois cependant, le préjudice est trop indirect ou insuffisamment personnel pour pouvoir être réparé.
Ainsi, la victime d’une infraction ne peut pas obtenir réparation du préjudice que lui cause le suicide en
prison de l’auteur de cette même infraction, lequel fait échec à la tenue d’un procès pénal. En effet
« en pareil cas, la victime, qui n’est de ce fait privée d’aucun droit propre, ne peut soutenir que l’impos-
sibilité d’un tel procès puisse se tenir lui causerait un préjudice personnel de nature à ouvrir droit à
indemnité », CE Ass. 2011, Monsieur et Mademoiselle Begnis. L’exigence que le préjudice soit personnel
concerne même le préjudice moral subi par une association ; une association de protection de l’envi-
ronnement ne peut pas obtenir réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait d’un
arrêté préfectoral ayant illégalement fait figurer sur la liste des animaux nuisibles « la corneille noire,
la martre, le putois, la pie bavarde, l’étourneau sansonnet, le pigeon ramier et le corbeau freux », faute de
démontrer « l’existence d’un préjudice direct et certain résultat pour elle de la faute commise par l’État »
— CE 2015, Association pour la protection des animaux sauvages.
Page 43 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
b) Un préjudice certain
Le préjudice doit ensuite être certain ; le préjudice né et actuel l’est évidemment. Il peut s’agir :
- D’un dommage accidentel, comme une jambe cassée ou un bien endommagé.
- D’un dommage permanent, un dommage dont le fait générateur dure dans le temps, comme
le sont les nuisances visuelles et sonores provoquées par une ligne TGV — CE 2015, Réseau ferré
de France.
Le préjudice ne peut apparaître certain que si la victime en apporte la preuve, et elle peut le faire par
tout moyen légal : documents photos, constats d’experts, avis médicaux, témoignages, etc. Le Conseil
d’État est ici assez souple puisqu’il considère qu’une filature opérée par un détective privé est un mode
de preuve licite au soutien de la révocation d’un agent municipal qui, en congé de longue maladie exerçait
irrégulièrement une activité privée (CE Sect. 2014, Monsieur Freddy Ganem). Seul le préjudice certain
peut être indemnisé, et il en va différemment du préjudice éventuel, c’est-à-dire qu’il est hypothétique,
celui dont la victime n’apporte pas la preuve. Ainsi, « la perte de bénéfices ou le manque à gagner
découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis
de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors en principe ouvrir droit à réparation » selon
l’arrêt CE 2016, Commune de Longueville. Le préjudice n’est donc plus considéré comme hypothétique
si la victime apporte des éléments de nature à justifier les profits qu’il aurait pu réaliser. Et afin d’alléger
la charge de la preuve pesant sur la victime, la jurisprudence accepte parfois de présumer le préjudice.
Selon le Code civil, « les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait
connu à un fait inconnu » (article 1349). Cela signifie que certains faits sont normalement considérés
comme préjudiciables. Le Conseil d’État considère ainsi que « la durée excessive d’une procédure ré-
sultant du dépassement du délai raisonnable pour juger l’affaire est présumée entraîner par elle-
même un préjudice moral dépassant les préoccupations habituellement causées par un procès, sauf
circonstances particulières en démontrant l’absence », selon CE Sect. 2009, Ville de Brest.
De même, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus
ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a
subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. Dans ce cas, « il appartient au patient
d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines
dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée
lorsqu’il a découvert sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle,
être présumée » — CE 1016, Monsieur B. De même encore, une atteinte à la dignité humaine résultant
des conditions de détention d’une personne incarcérée « est de nature à engendrer par elle-même,
pour la personne qui en est la victime un préjudice moral qu’il incombe à l’État de réparer » — CE
2017, Monsieur A. B. Une atteinte à la dignité humaine est ainsi présumée dommageable. Dans toutes
ces hypothèses, c’est le préjudice moral qui est présumé, et c’est en effet souvent lui qui est le plus
difficile à prouver.
c) La perte de chance
Si le juge administratif refuse d’indemniser le préjudice éventuel, il accepte cependant d’indemniser
ce que l’on appelle la perte de chance. Celle-ci constitue en effet un préjudice certain si la chance est
sérieuse. La jurisprudence applique cette notion dans trois principaux domaines :
- En matière médicale, en cas de manquement à l’obligation d’information qui pèse sur les pro-
fessionnels et les établissements de santé si « l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le
patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art un dommage en lien avec
la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procé-
dant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard,
Page 44 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération », et il n’en va
autrement que sn même informé des risques, « il aurait consenti l’acte en question » au regard
de sa situation — CE Sect. 2020, Madame B. A.
o La perte de chance de se soustraire ainsi au risque qui s’est réalisé constitue un préjudice
indemnisable correspondant à un pourcentage de l’ensemble du dommage (CE Ass.
2004, Caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France).
o Toujours en matière médicale, la jurisprudence indemnise également la perte de chance
que surviennent un dommage lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le
traitement d’un patient a « compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son
état de santé ou d’échapper à son aggravation » — CE Sect. 2007, Centre hospitalier
de Vienne, où on lui avait fait perdre une chance d’échapper à un aléa thérapeutique qui
s’est réalisé (CE 2001, Oniam).
o Il en va ainsi par exemple en cas de diagnostic tardif, comme dans CE 2007, Centre Hos-
pitalier de Vienne ou en cas de retard dans la prise en charge postopératoire d’un pa-
tient. La réparation du dommage est alors évaluée à une « fraction du dommage corporel
déterminé en fonction de l’ampleur de la chance perdue » — CE 2014, Centre hospitalier
de Dinam. Dans les affaires précitées, cela peut aller de 30 à 80 % de l’ensemble du dom-
mage.
- Dans le domaine de la fonction publique, la théorie de la perte de chance s’applique d’abord aux
agents publics irrégulièrement évincés de l’administration. Ceux-ci ont droit à être indemnisée
de leurs préjudices.
o Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte non
seulement la perte du traitement, mais aussi celles des primes et indemnités dont l’inté-
ressé avait une « chance sérieuse de bénéficier » (CE Sect. 2013, Commune d’Ajaccio).
o Un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une résiliation illégale de son enga-
gement et d’un refus illégal de le réintégrer est en droit de demander à être indemnisé
du préjudice résultant de la chance sérieuse qu’il a perdue pour la période en cause, de
bénéficier de vacations horaires (CE 2014, SDIS de la Loire).
o Cette théorie de la perte de chance s’applique ensuite en cas de refus illégal de promotion
d’un fonctionnaire. Il appartient en effet au juge de rechercher si l’irrégularité d’une
procédure de promotion n’a pas entraîné pour l’agent qui en a été victime une perte
de chance sérieuse d’obtenir cette promotion (CE 2016, Madame B. A).
o La théorie de la perte de chance s’applique enfin aux candidats illégalement empêchés
de participer à un concours d’accès à la fonction publique. En effet, lorsqu’un candidat
n’a pas pu concourir parce que l’administration l’en a empêché illégalement, il a perdu
une chance de réussir le concours. Certes, il n’est pas certain que s’il avait pu se présenter
il l’aurait réussi toutefois, il a quand même perdu une chance et cette perte est constitu-
tive d’un préjudice indemnisable. Cette solution bénéficie aussi aux étudiants s’étant vu
refuser le passage dans l’année supérieure par un jury illégalement composé. Si l’étu-
diant avait une chance sérieuse d’être admis dans l’année supérieure, il peut être in-
demnisé de la perte de chance d’être admis et d’obtenir son diplôme une année plus
tôt (CE 2013, Monsieur B). En l’espèce, le préjudice était évalué à 5 000 € pour un étu-
diant, dont la moyenne était de 9,85/20.
- En matière contractuelle enfin, la théorie de la perte de chance s’applique lorsqu’une illégalité
commise par l’administration a empêché la conclusion d’un contrat administratif. S’il résulte
de l’instruction que le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses de conclure
le contrat, il peut non seulement être indemnisé des frais occasionnés par la présentation de
l’offre, mais également sur le terrain de la perte de chance, de son manque à gagner.
Page 45 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
— CE 2012, Monsieur Simon, lequel dépend du bénéfice net que lui aurait procuré le contrat
s’il avait été conclu. En revanche, le candidat ne peut pas prétendre à une indemnisation de ce
manque à gagner si la personne publique a renoncé à la conclusion du contrat pour un motif
d’intérêt général, ou bien si son offre était irrégulière — CE 2014, SIVOM de Saint-François-
Longchamp.
d) L’exception d’illégitimité
Si l’ouverture du droit à indemnisation est en principe seulement subordonnée au caractère direct et
certain des préjudices invoqués, il existe cependant une exception d’illégitimité. Il ressort en effet de
certains arrêts que la victime qui se trouve lors du dommage dans une situation illégitime – en raison de
son irrégularité – n’a pas le droit à réparation de son préjudice. Ainsi, les occupants sans titre du
domaine public ne sauraient obtenir réparation des dommages consécutifs aux mesures prises en vue
de mettre un terme à leur occupation, même si ces mesures sont elles-mêmes irrégulièrement déci-
dées ou exécutées (CE Sect. 1980, Commune d’Ax-les-Thermes). L’exception d’illégitimité ne joue que
si la cause du dommage et la situation illégale sont suffisamment liées, de telle manière que les dom-
mages « découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime
s’est elle-même placée » — CE 2013, Monsieur Michel Imbert. Ainsi, le dommage subi par un exploitant
de pisciculture, du fait d’une pollution des eaux due à une station d’épuration n’étant pas réparée,
dans la mesure où cet exploitant s’approvisionnait par une prise d’eau illégale qui était directement
liée au dommage (CE 1997, Société Anonyme X). Cette exception d’illégitimité n’est pas sans lien
avec cette circonstance exonératoire qu’est la faute de la victime. Une solution importante en pratique
concerne les dommages causés aux utilisateurs d’un véhicule à moteur du fait d’un défaut d’entretien
normal de la voie publique, et ce alors que cet utilisateur est privé de son permis de conduire. Le juge
administratif considère, à propos d’un tel utilisateur dont le permis était annulé mais qui avait subi un
dommage du fait d’un trou dans la voirie que « l’infraction commise par la victime a nécessairement,
par son contenu-même exposé celui-ci aux conséquences fâcheuses qu’il a dû supporter, ainsi que le
fait valoir la commune défenderesse en opposant l’exception d’illégitimité » — Tribunal administratif
de Marseille 2011, Monsieur P. Cette exception n’est pas non plus sans lien avec la notion de causalité
adéquate.
B) – Le préjudice doit être indemnisable
a) Les préjudices indemnisables
L’indemnisation du préjudice consiste le plus souvent dans le versement d’une somme d’argent, mais
elle peut aussi, lorsqu’il s’agit d’un préjudice matériel consister dans la réalisation de travaux de répa-
ration. Le juge condamne alors l’administration au versement d’une sorte d’argent « si mieux n’aime »
cette même administration à réaliser lesdits travaux (CE 2014, Commune de Garges-lès-Gonesse). Si
le juge laisse ici le choix à l’administration, il peut aussi ne pas lui laisser en lui ordonnant de réaliser
les mesures nécessaires, c’est-à-dire de réaliser elle-même les travaux. Le juge peut en effet, « s’il cons-
tate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abste-
nant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à pallier les effets, la personne publique,
enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures » — CE Sect. 2019, Syndicat des copropriétaires du
Monte-Carlo Hill. Mais il n’en va ainsi que si l’abstention de la personne publique est fautive. Si ce
n’est pas le cas, il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité
dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécutions.
Si une réparation en nature est donc possible, l’indemnisation consiste le plus souvent dans le verse-
ment d’une somme d’argent.
Page 46 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il s’agit généralement d’une somme globale, mais il peut aussi s’agir parfois d’une rente, comme ce peut
être le cas pour indemniser les préjudices corporels subis par les jeunes enfants — CE Sect. 1981, Centre
hospitalier de Lisieux. La majorité des préjudices, parce qu’ils sont évaluables en argent sont indem-
nisables. Il n’y a évidemment pas de difficultés pour les préjudices matériels. Les dommages causés à un
immeuble ou à un véhicule sont ainsi faciles à évaluer. Ces dommages aux biens sont évalués à la date
où, leur cause ayant pris fin et leurs étendues étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés
à les réparer — CE Ass. 1947, Compagnie générale des eaux. L’indemnité ne peut cependant pas dé-
passer la valeur vénale du bien au moment du dommage (CE 2012, SCI La Liberté). Les préjudices
personnels sont aussi indemnisables, et ils sont normalement évalués à la date à laquelle le juge
statue. L’objectif ici est d’assurer à la victime « à la date où intervient la décision l’entière réparation
du préjudice » — CE Ass. 1947, Dame Veuve Aubry. Il en va ainsi des préjudices physiques (CE Sect.
1958, Commune de Grigny) comme l’est celui résultat d’un handicap. Même si l’évaluation est difficile
à réaliser, la jurisprudence accepte d’indemniser la souffrance physique : maux de tête, douleurs di-
verses, etc. Le juge s’appuie ici souvent sur des rapports d’expertise. La jurisprudence répare encore le
préjudice esthétique qui résulte d’une altération de l’apparence physique ainsi que le préjudice
d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives ou de lois. Elle
accepte encore d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence. Cette notion recouvre toutes
les atteintes à la qualité de la vie et peut inclure des préjudices divers que le juge ne tient pas à isoler :
- Troubles ou gênes handicapant la victime (tels que la souffrance physique ou le préjudice es-
thétique)
- Mais aussi le retard dans la scolarité d’un enfant
- Les modifications dans les conditions d’exercice d’une profession
- L’aggravation d’un état dépressif
- Ou encore le temps passé à s’occuper d’une personne dépendante.
Le Conseil d’État juge par exemple que les troubles dans les conditions d’existence subis par une per-
sonne reconnue comme prioritaire dans le cadre du Droit Au Logement Opposable (DALO) et non-
relogée doivent être appréciés en fonction du nombre de personnes composant le foyer pendant la
période de responsabilité, et en tenant compte de l’évolution de la composition du foyer au cours de
cette période (CE 2019, Madame B). Comme, en l’espèce, le nombre de personnes occupant le foyer de
Madame était de sept jusqu’en novembre 2014, de huit de décembre 2014 à avril 2017, de neuf de
mai 2017 à octobre 2018 puis de huit à nouveau depuis novembre 2018 jusqu’à l’arrêt. L’indemnité
due, à raison de 250 € par personnes composant le foyer et par an fût de 11 170 €.
1) La douleur morale
Le Conseil d’État est longtemps resté réticent pour indemniser la douleur morale. Cette réticence s’ex-
pliquait en raison de la difficile évaluation pécuniaire du chagrin et cette attitude de la jurisprudence
administrative fut vivement combattue par la doctrine, d’autant que les juridictions judiciaires accep-
taient, depuis la fin du XIXème siècle de réparer cette souffrance. Le changement d’attitude du Conseil
d’État apparu avec CE Ass. 1961, Consorts Letisserand. En l’espèce, le sieur concerné et son fils furent
tués par un camion des ponts et chaussées. Le Conseil d’État considéra alors que la douleur morale
qui est résulté pour ce dernier – le sieur, le père et le grand-père des victimes – de la disparition pré-
maturée de son fils est par elle-même génératrice d’un préjudice indemnisable. Quelques précisions
doivent ici être données. D’abord, le préjudice moral est assez proche des troubles dans les conditions
d’existence. Dans certaines affaires, le juge les distingue et les répare indépendamment, mais dans
d’autres, il lui arrive d’accorder une indemnité globale. Ensuite, le champ d’application du préjudice
moral est nécessairement limité et ne peut pas concerner que la perte d’un être suffisamment proche.
Il n’y a pas de doute pour la perte d’un enfant, d’un père ou d’une mère, d’un frère ou d’une grande-sœur.
Page 47 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
La jurisprudence admet aussi de réparer la perte d’un grand-parent ou d’un petit-enfant, mais le juge
administration ne va pas aussi loin que le juge judiciaire, qui n’avait pas hésité à réparer le chagrin
causé par la mort d’un cheval de course (Cass. Civ. 1962, Société Hippique des courses de Langon).
Le Conseil d’État a ainsi refusé d’indemniser le préjudice moral d’une femme qui vivait depuis long-
temps séparée de son mari (CE Sect. 1961, Entreprise de travaux publics Daniel) ainsi que celui d’une
belle-mère (CE Sect. 1966, Département de la Vendée). C’est désormais de l’inquiétude morale dont
il s’agit d’indemniser pour le juge, comme celle provoquée par une durée excessive de jugement (CE
2009, Monsieur et Madame Le Helloco), ou celle éprouvée par une personne atteinte d’une maladie
grave (CE 2015, Monsieur A). Le Conseil d’État considère ainsi que « l’existence de préjudice tenant à
l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par la même d’une espérance de
vie diminuée à la suite d’une exposition aux poussières d’amiantes […] est la source d’un préjudice
indemnisable au titre du préjudice moral » — CE 2017, Ministre de la Défense. La douleur morale
subie par une victime est même constitutive d’un préjudice indemnisable pour ses ayants-droits (CE
2008, Monsieur Georges). Les parents d’une fillette décédée, alors qu’elle faisait de la luge lors d’un
accident avec un engin de damage de piste de ski ont ainsi droit à « la réparation de la douleur morale
intense (causée par le décès de leur enfant) par la perspective d’une mort horrible ou de souffrances
considérables » — Tribunal administratif de Pau, 2015. Comment évaluer le préjudice moral ? Quel est
le « prix » du chagrin provoqué par la disparition d’un père ou d’une mère, d’un frère ou d’une sœur ?
Sans qu’il y ait de « barème », des exemples jurisprudentiels peuvent nous aider.
- Le Conseil d’État a ainsi accordé 15 000 € à une mère pour le décès de son fils, militaire âgé de
21 ans et victime d’un accident mortel provoqué par le déclenchement du siège éjectable de
son avion (CE 2005, Brugnot).
- Il a également confirmé l’indemnité de 10 000 € allouée pour réparer la douleur morale subie
par un mari pour le décès de sa femme, victime d’un accident de la circulation « du fait d’une
plaque de verglas provoquée par un système d’arrosage municipal » (CE 2008, Monsieur Hervé
A).
- Plus récemment, il a alloué 15 000 € pour réparer le préjudice moral subi par les parents d’une
jeune fille mineure ayant pu quitter le territoire national pour se rendre en Syrie (CE 2017,
Monsieur et Madame K).
- Quant au préjudice moral lié à une durée excessive de jugement, la tendance du juge est d’ac-
corder 500 € par année d’attente, et non par année de retard. Donc pour un contentieux ayant
duré huit ans, il s’agit d’une indemnité de 4 000 € (cf. Le Helloco).
- Enfin, le préjudice moral lié à l’inquiétude provoquée par la conscience d’être atteint d’une
maladie grave, en l’espèce une contamination posttransfusionnelle par le virus de l’hépatite
C s’élève, pour une période d’environ une année entre la date de la révélation et de la guérison
de la maladie à 1 500 € (cf. Monsieur A).
2) Clarification
Afin de clarifier l’état du droit, le Conseil d’État, dans un avis CE Sect. 2007, Lagier proposa, pour réparer
un dommage corporel de distinguer six postes de préjudices :
1. Les dépenses de santé
2. Les frais liés au handicap
3. Les pertes de revenus
4. Les incidences professionnelles et scolaires du dommage corporel
5. Les autres dépenses liées au dommage corporel, tels que
a. Les frais de conseil et d’assistance
b. Pour les ayants-droits des frais d’obsèques et de sépultures
6. Les préjudices personnels, à savoir
a. Les souffrances physiques
Page 48 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
b. La douleur morale
c. Le préjudice esthétique
d. Les troubles dans les conditions d’existence.
La tendance actuelle du juge administratif semble être d’utiliser la nomenclature Dintilhac, qui est
appliquée par les juridictions judiciaires (CE 2015, Consorts A). Dans tous les cas, la réparation versée
à la victime ne peut jamais dépasser le préjudice subi. Par conséquent, « il appartient au juge admi-
nistratif lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui de prendre, au
besoin d’office les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la
victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pour obtenir en raison des mêmes faits,
une réparation supérieure au préjudice subi » — CE Sect. 2011, Société CREDIPAR.
b) Les préjudices non indemnisables
Si de très nombreux préjudices sont indemnisables, tous ne le sont pas. La jurisprudence l’affirme et le
Conseil d’État considère par exemple que la naissance d’un enfant survenue à la suite d’une IVG prati-
qué sans succès « n’est pas génératrice d’un préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à répa-
ration » (CE Ass. 1982, Mademoiselle R).
- De même en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de
changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques,
soit de la création de voies nouvelles « ne sont pas de nature à ouvrir droit à l’indemnité »
— CE 2015, Madame B.
- De même encore, la récupération d’une somme correspondant à un avantage fiscal déclaré in-
compatible avec le régime des aides d’État « ne peut constituer un préjudice indemnisable
dès lors que l’État est tenu de procéder à la récupération de l’aide
— CE 2017, Société Le Muselet Valentin.
Le législateur confirme que tous les préjudices ne sont pas indemnisables. Pour faire échec à la célèbre
jurisprudence Perruche de la Cassation, selon laquelle « le fait de naître avec un handicap constitue
en lui-même un préjudice indemnisable pour l’enfant », l’article Ier de la loi n°2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que « nul ne peut se
prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance », selon l’article L114-5 du Code de l’action
sociale. Dans un autre domaine (celui de l’urbanisme), le législateur prévoit la non-indemnisation de
certaines servitudes instituées en application du Code de l’urbanisme, notamment celles qui concer-
nant l’utilisation du sol, la hauteur des constructions ou l’interdiction de construire dans certaines
zones et en borde de certaines voies (article L105-1). Cette règle est cependant encadrée par la juris-
prudence du Conseil d’État (CE Sect. 1998, Monsieur Claude Bitouzet).
c) Les prescriptions
Enfin, pour pouvoir être réparé, le préjudice ne doit pas être trop ancien. Les demandes d’indemnisa-
tion se heurtent ici à la prescription quadriennale. En vertu de la loi du 31 décembre 1968, les dettes
des personnes publiques dotées d’un comptable public s’éteignent automatiquement au terme d’un
délai de quatre ans. Cette prescription joue pleinement en matière de responsabilité : les créances sur
les personnes publiques sont prescrites à l’issu d’un délai de quatre ans à compter de la consolidation
du dommage, c’est-à-dire lorsque ce dernier n’évolue plus. Quel que soit le régime de responsabilité
applicable, que le dommage soit accidentel ou permanent, le point de départ du délai de prescription
quadriennale est le premier jour suivant la date à laquelle le dommage a été consolidé (CE Sect.
2014, Consorts D.), c’est-à-dire lorsqu’il a été entièrement révélé.
Page 49 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Ainsi, à propos d’un préjudice subi par les voisins d’une église du fait de sonneries de cloches pendant
la nuit, la délibération du Conseil municipal fixant les horaires des sonneries ayant été prise le 7 oc-
tobre 1997, le dommage a été révélé dans toute son ampleur la même année. Par conséquent, le délai
de la prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 1998 et le recours indemnitaire ayant été
enregistré depuis le 24 mars 2006, la prescription était opposable et le préjudice ne pouvait plus être
indemnisé (Cour administrative d’appel Nancy 2011, Époux Leclercq c/ Commune de Sainte-Ruf-
fine). À ce principe de la prescription quadriennale existe une exception en la matière, à savoir celle de
responsabilité médicale puisqu’une prescription décennale se substitue à la prescription quadrien-
nale. Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des éta-
blissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins
en matière médicale sont en effet prescrites au terme d’un délai de dix ans à compter de la consoli-
dation du dommage, selon l’article L1142-28 du Code de santé publique. C’est une solution ainsi plus
favorable pour les victimes.
II] – Le lien de causalité
Le lien de causalité permet de relier le fait générateur au préjudice et permet ainsi de qualifier ce fait
de préjudiciable.
A) – La causalité prouvée
a) Le caractère direct du lien de causalité
Le lien de causalité doit d’abord être direct et doit faire apparaître que le préjudice est la conséquence
directe du fait générateur. Cela ne présente pas de difficulté lorsque l’appréciation est purement méca-
nique, de telle manière que le préjudice apparaît immédiatement comme la conséquence du fait gé-
nérateur. Un lien direct de causalité est ainsi établi entre le sectionnement d’un câble électrique par
un employé d’une entreprise de travaux publics et le préjudice subi par une société dont l’alimenta-
tion en électricité a été interrompue, car le sectionnement du câble était bien à l’origine de la coupure
d’électricité (CE Sect. 1972, Compagnie générale des travaux hydrauliques). Un lien de causalité est-il
cependant établi entre la réalisation d’un travail public consistant dans le goudronnage d’une partie
d’une place et les dommages provoqués par les taches de goudron ayant maculé les tapis et mo-
quettes d’un cinéma se trouvant à proximité de cette place ? Pour répondre à cette question, le Conseil
d’État (CE Sect. 1969, Établissements Lassailly et Bichebois) précisa tout d’abord que « le passage sur
cette place constituait l’itinéraire normalement emprunté par les piétons pour se rendre au cinéma ».
Il souligne ensuite qu’au lieu de laisser un couloir non goudronné pour permettre l’accès au spectacle,
l’entrepreneur de travaux publics s’est borné à sabler ce couloir après l’avoir goudronné. Il en déduit
que les personnes se rendant audit spectacle ont marché dans un mélange de goudron frais et de sable
qui s’est attaché à leurs chaussures, et qui a provoqué les dommages.
Même s’il apparaît moins direct que dans l’exemple CE Sect. 1972, Compagnie générale des travaux
hydrauliques, le lien de causalité est tout de même établi. Les considérations de temps jouent souvent
un rôle important pour apprécier le caractère direct du lien de causalité. L’arrêt CE 2003, Madame
Chabba l’atteste. Le mari de la requérante avait été placé en détention provisoire pour une durée de
quatre mois. La durée de cette détention a été prolongée sans que Monsieur en soit informé. Il a alors
vivement protesté contre cette détention qui lui apparaissait arbitraire. Il se pend peu de temps après
dans sa cellule.
Page 50 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le suicide est-il la conséquence directe du comportement de l’administration pénitentiaire qui, suc-
cessivement a omis de lui notifier l’ordonnance prolongeant sa détention, s’est abstenue de vérifier
les affirmations de Monsieur Chabba qui se croyait légitimement maintenu en détention sans titre, et
n’a pas pris les mesures de surveillance qui s’imposaient ? La Cour Administrative d’Appel de Paris estimait
qu’il n’y avait pas de lien direct de causalité direct établi entre les faits reprochés à l’administration et
le suicide de Monsieur Chabba. En effet, non seulement il est difficile de savoir pourquoi une personne
met fin à ses jours, mais il ressort des statistiques que la détention provisoire est propice au suicide.
Le Conseil d’État a remis en cause cette appréciation en prenant en considération la proximité dans le
temps du suicide par rapport aux fautes reprochées au service pénitentiaire, ce suicide n’ayant eu lieu
que quelques minutes après la prolongation. Il est probable que si le suicide avait eu lieu quelques
jours plus tard, le lien de causalité n’aurait pas été établi. Ainsi, plus le temps s’écoule entre le fait
générateur et le dommage et moins le lien de causalité apparaît direct. Admettons qu’un détenu
s’évade de prison et commet un double meurtre quarante-huit jours après son évasion. Peut-on con-
sidérer comme établi le lien de causalité entre l’évasion de la prison et le crime ? La jurisprudence ré-
pondit par la négative dans CE 1985, Ramade. Pourtant, il est clair que si le détenu ne s’était pas évadé,
il n’aurait pas pu commettre ces deux crimes. Il apparaît donc qu’un fait n’est pas la cause d’un dom-
mage pour la simple raison que si le fait ne s’était pas produit, le dommage n’aurait pas eu lieu.
Si les considérations du temps sont importantes, les circonstances de l’espèce le sont aussi ; c’est ce qui
ressort de l’arrêt CE Sect. 1987, Garde des Sceaux c/ Banque populaire de la région économique de
Strasbourg. Dans cette affaire, la banque demandait réparation à l’État du dommage causé par un vol
à la main armée commis par des détenus ayant bénéficié de mesure de sortie. Le crime s’était produit
à la prison. Le Conseil d’État estima néanmoins qu’il existait un lien de causalité entre les mesures de
sortie et le dommage, et constate en effet que d’une part, cela est « quelques jours seulement » après
avoir bénéficié des mesures de sortie que les détenus ont constitué entre eux une véritable association
criminelle et que d’autre part, plusieurs agressions avaient été commises entre les mesures de sortie
et le vol à main armée. Le Conseil en déduisit que toutes ces infractions avaient constituées une chaîne
ininterrompue assurant un lien direct entre le vol et les mesures de sortie. Enfin, l’exigence du carac-
tère direct du lien de causalité explique pourquoi, si la responsabilité de l’administration est normale-
ment engagée pour réparer le préjudice subi du fait d’un acte administratif illégal, il en va différem-
ment lorsque l’autorité administrative aurait pu légalement prendre le même acte que celui entaché
d’un vice.
Les décisions du genre (vice de procédure ou de forme) ne peuvent donc normalement pas engager la
responsabilité de l’administration. Ainsi, à propos des décisions ordonnant une perquisition dans le
cadre de l’état d’urgence, « le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le pré-
judice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision ordonnant la perquisition est
seulement entachée d’une irrégularité formelle (ou procédurale) que le juge considère, au vu de l’en-
semble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision ordonnant la perquisition aurait
pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date
à laquelle la perquisition a été ordonnée » CE Ass. Avis 2016. Dans ce prolongement, lorsque l’acte dom-
mageable est entaché d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher si la même
décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par l’autorité compétente ; si c’est le cas,
« le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompé-
tence qui entachait la décision administrative illégale » — CE 2019, EARL Valette. C’est la même lo-
gique s’applique en matière de contrats : « lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public de-
mande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui affecté
la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie de
vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le
candidat demande l’indemnisation ».
Page 51 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Par conséquent, lorsque « l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation n’a pas été la cause
directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de
l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction » — CE 2017, Société
Bancel.
b) Le caractère adéquat du lien de causalité
Le lien de causalité doit non seulement être direct, mais il doit aussi être adéquat. En effet, lorsque
plusieurs faits ont pu concourir à la réalisation d’un dommage, la jurisprudence attribue la réalisation
de celui-ci à des faits dont on peut estimer qu’il avait une vocation particulière à le provoquer, et cela
permet d’identifier le fait générateur du dommage. CE 2003, Monsieur David B. permet de l’illustrer.
Le requérant, élève en classe de seconde avait quitté son lycée sans permission de sortie et accompa-
gné de deux camarades. Il se rendit dans une carrière pour y pratiquer l’escalade, mais y fit une chute
de vingt-cinq mètres et en ressort grièvement blesser. Atteint de graves séquelles, il recherche la
responsabilité de l’administration qu’il estime avoir manqué à ses obligations en n’ayant pas surveillé
la sortie des élèves à une heure non-autorisée. Le lien de causalité entre l’accident et le défaut de
surveillance est-il établi ? Non, selon le Conseil d’État qui considère ce manquement comme « dé-
pourvu de lien de causalité avec l’accident » dans la mesure où, en l’espèce, le dommage procède pour
partie du comportement de la victime. La notion de causalité adéquate n'est donc pas sans lien avec
cette circonstance exonératoire qu’est la faute de la victime. Dans la mesure où le dommage est éga-
lement en partie imputable aux deux camarades ayant accompagné la victime dans son escalade,
elle n’est pas non plus sans lien avec cette autre circonstance qu’est le fait du tiers.
La notion de causalité adéquate a aussi des liens avec l’exception d’illégitimité : l’arrêt CE 2013, Mon-
sieur Michel Imbert l’illustre. En l’espèce, le requérant élevait des sangliers sans autorisation et le pré-
fet le mit en demeure de régulariser sa situation. Faute d’action dans le délai prévu, le préfet prit un
nouvel arrêté ordonnant que les sangliers soient euthanasiés. Le requérant obtenu du juge adminis-
tration l’annulation de cet arrêté illégal, puis il rechercha la responsabilité de l’État. Or, le Conseil
d’État répondit que « la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation
des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité, mais découlent directement et
exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépen-
damment des faits commis par la puissance publique et à laquelle l’administration aurait pu légalement
mettre fin à tout moment ». En regardant si le préjudice se rattache ou non à la situation irrégulière
dans laquelle se trouve la victime, le juge administratif recherche le fait générateur le plus de nature
à avoir provoqué le dommage, c’est-à-dire la causalité adéquate. Si la causalité doit normalement être
prouvée, elle peut aussi être présumée.
B) – La causalité présumée
a) La jurisprudence
La présomption peut d’abord venir de la jurisprudence – le juge va alors tirer des conséquences d’un
fait connu à un fait inconnu. Ainsi, en matière médicale, le Conseil d’État reconnaît un lien de causalité
entre une vaccination obligatoire contre l’hépatite B et une sclérose en plaques (CE 2007, Madame
A), la requérante estimant que cette sclérose dont elle était atteinte était imputable à une vaccination
obligatoire qu’elle avait subie en qualité d’infirmière d’un établissement hospitalier. Selon le Conseil
d’État, « dès lors que les rapports d’expertise, s’ils ne l’ont pas affirmé n’ont pas exclu l’existence d’un
tel lien de causalité, l’imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre Madame A doit,
dans les circonstances particulières de l’espèce être regardée comme établie, eu égard d’une part au
Page 52 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
bref délai ayant séparé l’injection de mars 1991 de l’apparition du premier symptôme cliniquement
constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée, et d’autre part à la bonne santé de
l’intéressée et à l’absence, chez elle de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vac-
cination ». La causalité est bien présumée, et celle-ci dépend d’abord des circonstances particulières
de l’espèce et ensuite du bref délai ayant séparé l’injection du premier symptôme de la maladie, et
enfin du bon état de santé de l’intéressée et de son absence d’antécédents à cette maladie.
b) La loi
La présomption peut aussi venir de la loi, comme l’illustre la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à
l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires. Pour être indemnisée sur ce fondement, la victime
doit souffrir d’une maladie radio-induite et justifier avoir résidé ou séjournée dans une zone d’essais.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’intéressé « bénéficie de la présomption de causalité entre
l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa
maladie » — CE Avis, 2017. Même si le lien de causalité est établi entre le fait générateur et le préjudice
dont la victime apporte la preuve, la responsabilité de l’administration n’est pas engagée s’il existe une
circonstance exonératoire.
III] – Les circonstances exonératoires
Ce sont des circonstances susceptibles d’exonérer partiellement ou totalement l’administration de sa
responsabilité. Elles sont au nombre de quatre :
- Le cas de force majeure
- La faute de la victime
- Le fait du tiers
- Le cas fortuit. Les deux premières circonstances exonératoires jouent dans tous les cas que la
responsabilité de l’administration soit engagée pour faute ou sans faute.
A) – Les circonstances toujours exonératoires
a) Le cas de force majeure
Il y a force majeure lorsque l’événement dommageable remplit trois conditions : il doit être indépen-
dant de l’administration, imprévisible et irrésistible. Le juge admet rarement le cas de force majeure
ce qui est un avantage pour les victimes. Cette théorie ne joue en pratique que pour des catastrophes
écologiques (CE 2000, Commune de Staffelfelden), naturelles (CE 1991, SONEXA) ou climatiques
comme les pluies d’orage (CE 1981, Ville de Vierzon) et les intempéries (CE 2015, Garde des Sceaux)
d’une intensité exceptionnelle. La principale difficulté est de déterminer si l’événement susceptible
d’être regardé comme un cas de force majeure était ou non prévisible.
- Les catastrophes naturelles sont le plus souvent imprévisibles, comme c’est le cas d’un raz-de-
marée provoqué par un important effondrement du sol sous-marin (cf. SONEXA). C’est le plus
délicat pour les conditions climatiques exceptionnelles. Il faut regarder les statistiques météo-
rologiques : s’il y a déjà eu de telles conditions il n’y a pas force majeure et dans le cas contraire,
force majeure il y a.
- Ainsi, à Vierzon, les pluies d’orage à l’origine de l’inondation dommageable ont été regardées
comme un cas de force majeure parce qu’elles étaient « imprévisibles par rapport à tous les
précédents connus dans la région ».
Page 53 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- De même, dans l’arrêt Garde des Sceaux, les intempéries dommageables ayant frappé le dépar-
tement du Var ont également été ainsi qualifiées, car elles ont présenté une « intensité excep-
tionnelle sans précédent dans ce département depuis 1827 ».
- Le cas de force majeure peut également résulter d’une « conjonction exceptionnelle de phéno-
mènes d’une grande intensité » — CE 2017, Société SwissLife Assurances de biens, comme
c’est le cas de précipitations d’une ampleur exceptionnelle associées à une tempête marine. En
effet même si de rares précédents avaient déjà pu être constatés dans le passé, cette conjonction
exceptionnelle de phénomènes « présentait un caractère imprévisible et irrésistible et qui ca-
ractérisait un cas de force majeure ».
b) La faute de la victime
Si la victime a concouru à son propre dommage, cela atténue la responsabilité de l’administration. Le
juge répartit la charge de l’indemnisation au prorata des fautes commises. La faute de la victime peut
exonérer partiellement la responsabilité de la puissance publique.
- Ainsi dans CE 1969, Ministre de l’Équipement et du Logement, le Conseil d’État considéra que
si la responsabilité de l’État était engagée pour réparer le dommage consécutif à un accident
de voiture provoqué par la présence sur la chaussée d’un trou, l’acceptation de la conductrice
de faire asseoir à côté d’elle sur le siège avant deux passagères dans des conditions qui ne lui
permettaient pas d’assurer la maîtrise de son véhicule, constitue une faute de la victime de nature
à atténuer la responsabilité encourue par l’État. Il est ainsi condamné à réparer seulement les
deux tiers des conséquences dommageables de l’accident.
- De même, CE 1987 Ville de Rennes, le Conseil d’État accepta d’engager la responsabilité de la
commune requérante, le maire ayant commis une faute en ne prévenant pas ses administrés
des risques d’inondations d’une rivière en crue alors que la cote d’alerte était dépassée. Tou-
tefois, le Conseil exonère partiellement la responsabilité de la commune en considérant que le
fait de laisser des objets dans un endroit classé dans une zone inondable est une faute de la
victime susceptible d’atténuer la responsabilité de l’administration.
La faute de la victime peut même totalement exonérer la personne publique de sa responsabilité.
L’arrêt CAA Lyon 2007, Monsieur Teyssier en donne un parfait exemple ; le requérant avait été victime
d’un grave accident en plongeant dans la partie d’une piscine municipale où la profondeur n’est que
de 1,20 mètre. Il estime que la commune a commis une faute, car les indications de la profondeur
d’eau étaient effacées La Cour lui répondit que l’accident était « imputable à l’imprudence et à l’inat-
tention de la victime, qui a plongé dans la zone opposée à celle dotée de plots à l’usage des plon-
geurs, en plongeant droit vers le fond et avec élan sans s’assurer que la profondeur de l’eau était suffi-
sante alors même qu’à cet instant, la profondeur d’eau était démontrée par la présence de sa compagne
debout dans l’eau où elle avait largement pied ». Elle en déduit que « cette faute de la victime est de
nature à exonérer la commune de toute responsabilité ». Exceptionnellement, le comportement de la
victime n’est pas de nature à atténuer même partiellement la responsabilité de l’administration. Il en
va ainsi en matière de harcèlement : lorsque celui-ci est établi, le comportement de l’agent qui en est
victime ne peut pas constituer une circonstance exonératoire (CE Sect. 2011, Madame Montaut).
B) – Les circonstances seulement exonératoires en
matière de responsabilité pour faute
a) Le fait du tiers
Page 54 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
S’il existe un coauteur du dommage, il y a partage des responsabilités, ce qui a pour conséquence
d’atténuer la responsabilité de l’administration. Le fait du tiers peut émaner soit d’un administré autre
que la victime, soit d’une collectivité publique autre que celle mise en cause par le requérant. Ce fait du
tiers n’a pas à être fautif et est donc sans conséquence en matière de responsabilité sans faute.
Le juge administratif doit donc rechercher si, et le cas échéant dans quelle mesure le fait du tiers ayant
concouru à la réalisation du dommage est de nature à atténuer la responsabilité de la personne pu-
blique (CE 2017, Commune de Saint-Philippe). En principe, il n’y a pas d’obligation in solidum en droit
administratif, il ne peut donc pas condamner l’administration à réparer l’ensemble du dommage subi
par la victime. L’objectif ici est de protéger l’argent public. Mais il existe néanmoins des exceptions à ce
principe. D’abord, « lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des
personnes différentes ayant agi de façon indépendante portaient chacune en elle normalement ce
dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son pré-
judice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou bien de celles-ci conjointement,
sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux »
— CE 2010, Monsieur Madranges.
Cette situation peut aussi se rencontrer en matière hospitalière notamment, où plusieurs acteurs sont
susceptibles d’intervenir dans l’opération dommageable, la faute pouvant provenir à la fois des mé-
decins, des personnels soignants et des fabricants du matériel médical utilisé. Ensuite, la solidarité
bénéficie à la victime d’un dommage de travaux publics, qui peut demander réparation de l’en-
semble du préjudice à l’un des coauteurs du dommage. La victime peut ainsi demander réparation soit
à l’entrepreneur, soit à la collectivité maîtresse de l’ouvrage, soit à l’un et l’autre solidairement (CE
1971, Société Cracco). L’obligation solidaire s’explique ici en raison de l’imbrication des opérations
nécessaires à la réalisation de travaux publics, ces opérations faisant souvent intervenir plusieurs ac-
teurs : maître de l’ouvrage, maître d’œuvre, architecte, bureau d’étude et entrepreneurs. Dans ces deux
hypothèses, l’administration peut être condamnée à réparer l’ensemble du dommage, et elle pourra en-
suite se retourner contre le coauteur du dommage afin d’obtenir le remboursement des sommes corres-
pondant à la part du dommage qui lui est imputable. C’est là que le droit administratif rejoint le droit civil.
b) Le cas fortuit
Imprévisible et irrésistible, le cas fortuit se distingue de la force majeure par le fait que même si sa
cause est inconnue, il n’est pas extérieur à l’administration, mais cette distinction n’a pas toujours été
effectuée rigoureusement par la jurisprudence. Ainsi, dans la célèbre affaire du cuirassé Iéna, dont
l’explosion le 12 mars 1907 dans le port de Toulon tua un enfant qui se trouvait dans les bras de sa
nourrice, le Conseil d’État considéra que « le décès du fils du requérant doit être attribué à un événe-
ment de force majeure », CE 1912 Ambrosini. Cependant, comme le démontre Hauriou dans sa note, la
responsabilité de l’État aurait dû être engagée car le dommage était imputable non pas à un cas de
force majeure mais à un cas fortuit. En effet, si l’événement dommageable était indépendant de la
volonté des hommes, il n’en était pas moins interne à l’administration. La jurisprudence consacre dé-
sormais cette distinction dans CE 1991, SONEXA souligne en ce sens qu’un raz-de-marée à l’origine
d’une vague de sept mètres ayant détruit un important matériel « est imputable non à des circons-
tances d’origine inconnue qui auraient affecté le terrain d’assiette des travaux entrepris dans le port,
mais à un important effondrement du sol sous-marin qui a eu lieu au large de la côte ». Par consé-
quent, « le phénomène susdécrit est constitutif non […] d’un cas fortuit mais d’un cas de force majeure ».
À l’inverse, le Conseil d’État considère que la rupture du barrage de Malpasset qui, le 2 décembre 1959
provoqua une immense vague qui dévasta la ville de Fréjus avec 423 victimes et des dégâts considé-
rables avait été due à « l’explosion » de la roche à l’aval immédiat de l’ouvrage sous la pression de
l’eau retenue par ce dernier.
Page 55 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il en déduit que dans ces conditions, « la cause de la rupture ne peut être regardée comme extérieure
au barrage ». Cet événement n’a dès lors « pas revêtu le caractère d’un événement de force ma-
jeure mais d’un cas fortuit (CE Ass. 1971, Département du Var) ». Il en va de même d’un incendie dont
la cause est demeurée inconnue (CE 1976, Compagnie Les Assurances Générales de France et ville de
Romans). Le cas fortuit permet d’établir que la personne publique n’a pas commis de faute. Il n’a, par
conséquent un effet exonératoire que lorsque la responsabilité de l’administration est conditionnée
par une faute (CE 1986, Communauté urbaine de Lille). Il est en revanche sans incidence en matière
de responsabilité sans faute, et c’est d’ailleurs ce que souligne implicitement le Conseil d’État dans une
affaire identique à CE Ambrosini, concernant cette fois l’explosion du cuirassé Liberté le 25 septembre
1911 dans le même port, alors même que le dommage avait sans doute été provoqué par un cas fortuit.
Il considère néanmoins que les requérants « sont fondés à soutenir que l’État doit réparer le dommage
causé par cet accident » — CE 1920, Colas. Ce cas fortuit n’était donc pas de nature à exonérer l’État
de sa responsabilité sans faute pour risque anormal de voisinage.
Page 56 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 6 – La responsabilité pour faute
Leçon 6
Lorsque l’administration cause un dommage par sa faute, la règle est qu’elle doit réparer le préjudice
subi par la victime. Le droit administratif rejoint là encore le droit civil. Mais tout d’abord, qu’est-ce
qu’une faute ? Pour reprendre une définition généralement admise, une faute est « un manquement à
une obligation préexistante ». Il peut s’agir de :
- Un manquement à une obligation de moyen : l’administration, pour ne pas commettre une
faute doit mettre en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition. C’est le cas en matière
médicale ou de lutte contre l’incendie.
- Plus rarement, il peut aussi s’agir d’une obligation de résultat. Il en va ainsi
o Des obligations pesant sur l’État en matière de scolarisation des enfants handicapés
CE 2009, Monsieur et Madame Laruelle
o Ou de prise en charge adaptée et pluridisciplinaire des enfants autistes
CE 2011, Madame Beaufils
- Il en va de même en matière de droit au logement — CAA Paris 2012, Monsieur Bel Hyad
- Ou encore à propos de la qualité de l’eau que les communes gestionnaires des services publics
de distribution de l’eau potable doivent fournir aux usagers
Cass civ. I 2012, Madame Mataillet. Dans toutes ces hypothèses, l’administration ne peut pas se
prévaloir de l’insuffisance des moyens dont elle dispose pour échapper à une condamnation,
car elle est tenue à une obligation de résultat. Si la responsabilité pour faute de l’administration
est engagée, cette dernière répond moins de sa faute que d’une faute commise par un de ses
agents.
- Il peut s’agir d’une faute personnelle ou d’une faute de service, selon la distinction posée par le
Tribunal des conflits dans CE 1873, Pelletier.
I] – La responsabilité pour faute personnelle
A) – La notion de faute personnelle
a) Identification
La faute personnelle de l’agent est celle qui n’exprime pas un dysfonctionnement de l’administration
mais la personnalité de son auteur. Elle est suffisamment éloignée du service pour que, dans le respect
du principe de séparation, le juge judiciaire puisse en faire la constatation sans porter une appréciation
sur le fonctionnement de l’administration. En d’autres termes, il y a faute personnelle si l’acte domma-
geable révèle l’homme « avec ses faiblesses, passions et imprudences » — TC 1877, Laumonier-Carriol.
La faute personnelle est cependant indépendante de la faute pénale (TC 1935, Thépaz) de telle manière
qu’un acte constitutif d’une infraction pénale n’est pas nécessairement qualifiable de faute person-
nelle. L’incendie de paillotes par des gendarmes sur ordre du préfet alors même qu’il s’agissait d’une
destruction volontaire de biens d’autrui n’a pas été regardé comme une faute personnelle mais
comme une faute de service, les gendarmes ayant agi sur ordre – dans le cadre de leur fonction – et
sans rechercher un intérêt personnel — Cass. Crim. 2004.
b) Distinctions
La jurisprudence distingue deux catégories de faute personnelle :
Page 57 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- Il y a d’abord la faute personnelle commise par l’agent en dehors du service ; c’est une faute
civile qui se détache matériellement du service. Un accident mortel provoqué par un gardien
de la paix manipulant son pistolet de service à domicile, en dehors de ses fonctions procède
ainsi d’une faute personnelle — CE Ass. 1973, Sadoudi.
- Il y a ensuite la faute personnelle commise à l’occasion du service, mais qui s’en détache psycho-
logiquement ; elle s’en détache « eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels
poursuivis par son auteur » — TC 2014, Madame B. La faute personnelle peut d’abord se déta-
cher psychologiquement du service en raison de sa particulière gravité.
o La conduite en état d’ébriété et pendant le service d’un véhicule ayant provoqué un acci-
dent mortel est ainsi constitutive d’une faute personnelle
CE 1974, Commune de Lusignan.
o Il en va de même de la signature par un maire de fausses attestations établissant la
réalisation de travaux sur la voirie communale ayant permis à une entreprise indélicate
l’obtention d’un prêt bancaire — CE 2007, Société Banque français commerciale de
l’océan Indien.
o Elle peut consister en une imprudence si « elle présente une gravité certaine » comme
l’est celle d’un archéologue ayant fait creuser à la pelleteuse un important trou ayant
provoqué l’effondrement d’une tour datant du XIVème siècle (Cass. Civ. I 1997 — Mon-
sieur X), ou celle d’un agent ayant confié à un jeune mineur son arme de service au cours
d’un exercice de tir (CE 1969, Sieur Houdayer).
o Constituent encore des fautes personnelles les manquements graves aux obligations
déontologiques pesant sur les policiers ou sur les médecins comme le sont des brutalités
policières non-justifiées lors d’un contrôle d’identité (Cass. Crim. 2009, Monsieur C).
o Il en va de même de la faute commise par un médecin qui a gardé le silence sur une
erreur médicale s’étant déroulée dans son service et consistant en l’injection d’une eau
non stérile chez un patient, à l’origine d’une septicémie (CE 2001, Valette).
- La faute personnelle peut ensuite se détacher psychologiquement du service eu égard aux ob-
jectifs purement personnels poursuivis par son auteur, notamment s’ils expriment des mauvaises
intentions.
o Il en va ainsi lorsque l’agent fait preuve d’animosité (TC 1680, Techer c/ Pahon)
o De malveillance — TC 1987, Kessler
o Ou s’il agit par vengeance. Sont par exemple regardés comme des fautes personnelles :
▪ Des actes de violences commis lors de garde à vue et considérés à la fois comme
injustifiés, au regard des pratiques administratives normales et révélant une at-
titude malveillante (Cass. Crim. 2005, Gilles H., Erick L)
▪ Ainsi qu’une tentative d’homicide volontaire causée par vengeance par un gen-
darme mobile avec son pistolet de service (CE 1975, Pothier).
Dans toutes ces hypothèses, le fonctionnaire disparaît complètement derrière l’homme avec ses fai-
blesses, passions et imprudences. Voyons maintenant comment sont réparés les dommages provo-
qués par de telles fautes.
B) – La réparation de la faute personnelle
a) L’engagement de la responsabilité administrative pour faute personnelle
Page 58 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
En principe, la faute personnelle engage la responsabilité civile de l’agent devant le juge judiciaire
(TC 1873, Pelletier) mais il existe des exceptions à ce principe, de telle manière que la responsabilité
administrative peut être engagée du fait d’une faute personnelle d’un agent. Cette possibilité s’explique
par la volonté du juge de protéger les victimes de dommages de l’insolvabilité des agents de l’admi-
nistration, et qui a connu une évolution en trois étapes.
1) Le cumul de fautes
C’est par CE 1991, Anguet que le Conseil d’État a introduit cette théorie. En l’espèce, le requérant qui se
trouvait dans un bureau de poste ayant fermé avant l’heure fut prié de sortir par une autre issue. Il fut
violemment éjecté par deux employés qui le prirent pour un voleur et se cassa la jambe. Il fit une
demande d’indemnisation et le Conseil d’État admit que si la cause directe et matérielle de l’accident
est la faute personnelle des agents, cette faute n’a été rendue possible que par une faute de service ;
le dommage est ainsi le produit de deux fautes. L’une personnelle (la violence des agents) et l’autre de
service, à savoir la fermeture prématurée du bureau de poste. Dans ce cas, la victime a le choix de pour-
suivre soit l’agent devant le juge judiciaire, soit la personne publique devant le juge administratif,
en demandant la réparation totale du préjudice. Cette jurisprudence permet notamment d’indemniser
les conséquences dommageables d’une faute personnelle lorsqu’à cette dernière s’ajoute un défaut
de surveillance de l’administration. Si l’accident provoqué par le conducteur d’une ambulance mili-
taire, qui l’utilisait à des fins personnelles est entièrement imputable à ce conducteur, le défaut de
surveillance du parc automobile où était garé le véhicule constitue une faute du service public, en-
gageant ainsi la responsabilité de l’État — CE 1943, Dame Simon et Société Simon frères.
2) Le cumul de responsabilités
Cette évolution apparaît avec le grand arrêt CE 1918, Époux Lemonnier. Madame fût blessée lors d’une
fête communale à l’occasion d’une attraction consistant à tirer sur des cibles flottantes au milieu
d’une promenade publique. La négligence du maire de la commune était susceptible d’être regardée
à la fois comme une faute personnelle et comme une faute de service. Dans ses conclusions sur cet
arrêt, Léon Blum y affirma que « si en un mot le service a conditionné l’accomplissement de la faute
ou la production de ses conséquences dommageables vis-à-vis d’un individu déterminé, le juge admi-
nistratif peut alors dire que la faute se détache peut-être du service, c’est affaire aux tribunaux d’en
décider. Mais le service ne se détache pas de la faute ». La victime a alors la faculté de poursuivre soit
l’agent devant le juge judiciaire, soit la collectivité publique devant le juge administration ; il serait
alors préférable de parler non pas de cumul de responsabilités mais plutôt de cumul de qualifications.
3) La faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service
C’est le dernier stade de l’évolution, apparaissant avec CE Ass. 1949, Mimeur. En l’espèce, le conducteur
d’un véhicule militaire qui s’était détourné de sa route normale pour visiter sa famille causa un dom-
mage à la requérante. Saisi du litige, le Conseil d’État considéra que la responsabilité de l’administration
peut néanmoins être engagée, car la faute personnelle de l’agent ne peut être regardée comme dé-
pourvue de tout lien avec le service. Cette solution s’applique aux dommages causés en dehors du
service par des policiers, militaires ou douaniers, grâce aux moyens (notamment les armes) que le service
met à leur disposition. Ainsi, dans CE 1973, Sadoudi à propos d’un accident mortel, le Conseil d’État
considéra que « compte tenu des dangers résultant pour les tiers de l’obligation faite aux gardiens de
la paix de Paris de conserver une arme à feu en dehors du service, l’accident ne peut être regardé comme
dépourvu de tout lien avec celui-ci. Il en déduit que « la circonstance que – l’auteur du dommage – ait
commis en l’espèce une faute personnelle ne peut avoir pour conséquence de dégager la ville de Paris
de sa responsabilité vis-à-vis de la victime ».
Page 59 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
En l’espèce, la faute qui consiste à manipuler une arme en ayant laissé une balle dans le canon est une
faute personnelle puisqu’elle est commise en dehors du service, l’agent étant rentré chez lui. Cepen-
dant, cette faute personnelle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service, car c’est ce dernier qui
procure l’arme au policier et qui l’oblige à la conserver chez lui. La victime du dommage peut alors
engager la responsabilité de la puissance publique. Il suffit par conséquent que l’appartenance au service
ne soit pas sans conséquence sur la réalisation du dommage pour que s’applique cette jurisprudence.
Le Conseil d’État avait jugé dans ce sens l’affaire Alain Lamare et cet assassinat d’une autostoppeuse par
le « gendarme-tueur » n’était pas, alors même qu’il avait été commis en dehors des heures de service
et avec une arme personnelle, dépourvue de tout lien avec le service. La responsabilité de l’État était
alors engagée, car ce gendarme « participait aux enquêtes entreprises, était informé de leur progres-
sion et de leurs résultats, en sorte que son appartenance à la gendarmerie a contribué à lui permettre
d’échapper aux recherches et de poursuivre ses activités criminelles pendant une période prolon-
gée » — CE 1988, Ministre de la Défense. Il en va différemment si le dommage résulte « exclusivement
de la faute personnelle de l’agent », comme c’est le cas des blessures par balle infligées avec son arme
de service par un gendarme ayant agi par vengeance. Cette évolution favorable aux victimes n’a qu’un
seul inconvénient : le risque de favoriser le sentiment d’impunité des agents administratifs. Les mé-
canismes de la répartition de la charge indemnitaire finale permettent néanmoins d’éviter ce risque.
b) La répartition de la charge indemnitaire finale
Elle est régie par deux arrêts : CE Ass. 1951, Laruelle et CE Ass. 1951, Delville.
- Dans la première espèce, le sieur Laruelle s’était procuré en fraude et en dehors du service un
véhicule de l’armée, mais avait eu un accident. Il s’agissait d’une faute personnelle non dé-
pourvue de tout lien avec le service permettant à la victime d’engager la responsabilité admi-
nistrative, ce qui fût fait. Par cet arrêt, le Conseil d’État reconnu à l’administration le droit de
réclamer à son agent le remboursement des sommes versés à la victime.
- Dans la seconde espèce, Delville conduisait un camion administratif en état d’ébriété et avait
également eu un accident. Il s’agissait là encore d’une faute personnelle. Toutefois, nous étions
aussi en présence d’une faute de service en raison du mauvais état du système de freinage du
camion et en l’espèce, le Conseil permit à l’agent condamné par les tribunaux judiciaires de réparer
le dommage causé à la victime et d’intenter une action récursoire contre l’administration afin
qu’elle lui rembourse la part du dommage imputable à la faute de service.
Le juge administratif veille ainsi à ce que la contribution finale soit répartie entre le service et l’agent,
compte tenu de l’existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèce. L’ad-
ministration peut donc demander à son agent fautif de lui reverser une partie ou la totalité des in-
demnités en utilisant la procédure unilatérale du titre exécutoire. Réciproquement, l’agent peut de-
mander à l’administration de lui reverser une partie ou la totalité des indemnités en utilisant la pro-
cédure de l’action récursoire et en cas de refus de l’administration, en saisissant le juge. Ce dernier, qui
est compétent est toujours le juge administratif, et ce même si la victime du dommage a obtenu répa-
ration devant le juge judiciaire. Ce mécanisme avait d’ailleurs été appliqué par le Conseil d’État dans
CE Ass. 2002, Papon. Par une décision de la Cour d’assises de la Gironde, Maurice Papon, ancien secré-
taire général de la préfecture de la Gironde entre 1942 et 1944 avait été condamné à une peine de dix
ans d’emprisonnement pour complicité de crime contre l’humanité en raison du concours apporté à
l’arrestation et à l’internement de nombreuses personnes d’origine juive. Statuant sur l’action civile,
cette même Cour avait condamné Papon à verser 750 000 € aux familles des victimes. Estimant que
l’indemnité qu’il avait versée était la conséquence d’une faute de service, Papon demanda à l’État de lui
reverser cette somme, ce que le Ministre refusa. Attaquant ce refus devant le juge administratif, celui-
ci fit partiellement droit à la demande, le Conseil d’État estimant que Maurice Papon avait commis en
raison de la gravité exceptionnelle de son comportement une faute personnelle.
Page 60 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Toutefois, il considéra également qu’en favorisant ces opérations de déportation indépendamment de
l’action de Papon, l’État avait lui aussi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En
présence d’un cumul de fautes, le Conseil d’État estima qu’il convint de répartir la charge indemnitaire
finale pour moitié entre l’État et le criminel, et l’État fût condamné à verser à Papon 360 000 €. Si la
responsabilité de l’administration peut être recherchée pour réparer les dommages provoqués par
une faute personnelle d’un agent, c’est dans la grande majorité des cas pour une faute de service que
l’administration voit sa responsabilité engagée.
II] – La responsabilité pour faute de service
La faute de service est une faute anonyme – même si l’on connaît l’agent qui l’a commise, elle apparaît
comme collective parce qu’elle révèle un dysfonctionnement administratif. En d’autres termes, il y a
faute de service si l’acte dommageable « est impersonnel, s’il révèle un administrateur, un mandataire
de l’État plus ou moins sujet à l’erreur » — TC 1877, Laumonier-Carriol. La faute de service engage la
responsabilité civile de l’agent et la personne publique doit d’ailleurs apporter à son agent sa protec-
tion en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui en raison d’une faute de service
(cf. article 11 loi n°83-634 du 13 juillet 1983). Elle est alors subrogée dans les droits de l’agent pour
obtenir de l’auteur des menaces ou attaques dont cet agent avait été victime de la restitution des
sommes versées (TC 2013, Monsieur M. c/ Commune de Sainte-Colombe). En revanche, lorsque la
faute est personnelle, l’administration peut légalement refuser d’apporter sa protection juridiction-
nelle à l’agent — CE 2009, Monsieur G. Selon le Code civil, « toute faute est de nature à engager la
responsabilité de son auteur », et il en va de même en droit administratif dans la plupart des cas. La
doctrine parle d’ailleurs de « faute simple ».
A) – La responsabilité pour faute
a) Typologie des fautes
1) Faute et acte matériel
La faute peut d’abord résulter d’un acte matériel. Elle a alors son origine dans une opération matérielle
réalisée lors de l’accomplissement d’une mission administrative. Ce n’est pas le cas des opérations mi-
litaires, qui ne sont « par nature, pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’État » — CE 2010,
Société Touax. C’est en revanche le cas des opérations réalisées pour l’accomplissement du service
public hospitalier. Ainsi, des erreurs commises par les médecins lors d’une intervention chirurgicale
« constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité » — CE Ass. 1992, Époux V.
Le législateur le confirme : les professionnels et établissements de santé « ne sont pas responsables
des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de
faute » (cf. article L1142-1 du Code de Santé Publique). Tous ces actes sont des actes matériels. C’est
également le cas des opérations réalisées pour l’accomplissement d’une mission de police adminis-
trative, comme le sont des opérations de surveillance d’installations aéroportuaires (CE 2003, GIP La
Réunion aérienne). La responsabilité pour faute de puissance publique est engagée dès lors que l’opé-
ration matérielle de police ne présente pas de difficultés particulières ; autrement seule une faute
lourde est de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. La faute peut aussi provenir
de l’inaction de l’administration : l’absence d’un médecin lors d’un accouchement difficile est ainsi
« constitutive d’un défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service engageant la respon-
sabilité du service hospitalier » — CE 2005, Monsieur et Madame G.
Page 61 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il en va de même – toujours en matière médicale – si le service s’est abstenu de procéder dans les délais
utiles à une évaluations de l’état d’un patient, susceptible de rendre possible une prise en charge adap-
tée (CAA Marseille, 2013 Centre hospitalier de Digne-les-Bains). De même encore, mais cette fois en
matière de police : l’inaction des forces de l’ordre chargées de surveiller un feu d’artifice commandé
par une commune, qui ne sont pas opposées à l’occupation par certains spectateurs du toit des gui-
chets du stade où avait lieu le tir, constitue une « faute […] de nature à engager la responsabilité de la
commune » — CE 1979, Moisan. Si l’inaction est fautive, elle ne l’est pas toutefois immédiatement.
L’administration dispose toujours d’un certain laps de temps avant d’entreprendre une action maté-
rielle ; cette période est très brève pour les services de secours. Un retard de trente à quarante minutes
dans la mise en marche d’une motopompe est ainsi constitutif d’une faute de nature à engager la
responsabilité des services de lutte contre l’incendie (CE 1998, Commune de Hannappes). Un retard
de dix minutes quant à lui des services scolaires pour appeler les secours à la suite du malaise d’un
enfant est également « constitutif » et constitue donc « une faute tenant à un défaut d’organisation
du service » (CE 2021, Madame D). À l’égard des demandes de concours de la force publique pour
assurer l’exécution d’une décision de justice, l’administration dispose d’un délai de deux mois pour
agir, et ce n’est qu’au terme de celui-ci que l’inaction est de nature à engager sa responsabilité pour
faute — CE 2013, Société OGIF.
2) Faute et acte juridique
La faute peut aussi résulter d’un acte juridique ; seul un tel acte de nature administrative est susceptible
d’engager la responsabilité pour faute de la puissance publique. En effet, à l’égard des actes de gou-
vernement et de droit privé, le juge administratif est incompétent. Si l’acte dommageable est juridic-
tionnel, le juge administratif n’est compétent que si le dommage a été provoqué du fait de l’exercice
de la justice administrative, et seule une faute lourde est en principe de nature à engager la responsa-
bilité de l’État. Enfin, si l’acte dommageable est de nature législative, le Conseil d’État considère que la
responsabilité de l’État du fait des lois est susceptible d’être engagée « en raison des exigences inhé-
rentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application
d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France » — CE Ass.
2019, Société Paris-Clichy. La responsabilité de l’État peut donc être engagée du fait d’une loi domma-
geable contraire à la Constitution ou à un engagement international.
- Dans le premier cas, les Sages doivent avoir déclaré cette disposition « inconstitutionnelle » sur
le fondement de l’article 61-1 lors de l’examen d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité,
ou bien encore sur le fondement de l’article 61, à l’occasion de l’examen de disposition législa-
tives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En outre, « l’engagement de cette
responsabilité est subordonné à la condition que la décision du Conseil constitutionnel, qui déter-
mine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont suscep-
tibles d’être remis en cause, ne s’y oppose pas, soit qu’elle l’exclue expressément, soit qu’elle laisse
subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu’une action indemnitaire équi-
vaudrait à remettre en cause ». Le Conseil constitutionnel peut donc, lorsqu’il répond à une QPC
« s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées in-
constitutionnelles », ou « déterminer les conditions ou les limites particulières » — CC 2018-
828/829.
- Dans le second cas, c’est au juge administratif, compétent pour contrôler la conventionnalité
des lois d’engager la responsabilité de l’État pour « réparer l’ensemble des préjudices résul-
tant de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux
de la France — CE Ass. 2007, Monsieur Gardelieu
Page 62 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Cette responsabilité du fait des lois méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux
est-elle une responsabilité pour faute de l’État ? Le Conseil ne le dit pas. Toutefois, il serait logique de
considérer le non-respect des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes comme un manque-
ment à une obligation, donc une faute. En outre, c’est « l’ensemble des préjudices » qui peut ici être
réparé, c’est le signe d’une responsabilité pour faute car, lorsque c’est la responsabilité sans faute de
l’État qui est engagée, seuls les préjudices ayant un caractère anormal et spécial peuvent l’être. Si cette
responsabilité du fait des lois est rarement mise en œuvre, celle du fait des actes administratifs illégaux
l’est beaucoup plus souvent. C’est une responsabilité pour faute car l’administration doit respecter le
principe de légalité (article L.100-2 du Code des relations entre le public et l’administration).
- L’édiction d’un acte illégal est donc fautive. Les dommages provoqués par la suspension illégale
d’un permis de conduire engagent ainsi la responsabilité pour faute de l’État — CE 2011, Radix.
- De même, « en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique,
[…] un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a
effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre » — CE Sect. 2013,
Commune d’Ajaccio.
- En principe, « toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’en-
gager sa responsabilité » — CE 2013, Monsieur Michel Imbert. Il convient cependant que cette
illégalité soit directement à l’origine du dommage.
b) Faute prouvée et faute présumée
1) Présomption de faute et travaux publics
CE 2019, Paris-Clichy : le Conseil d’État y fait fusionner la responsabilité de l’État du fait des lois, qu’il
s’agisse d’une responsabilité sans faute ou pour le manquement du législateur aux règles, comme les
engagements internationaux. Il est alors possible de réparer le préjudice. Si un acte administratif illégal
est à l’origine d’un dommage, la responsabilité pour faute de la puissance publique est engagée. Le
Conseil d’État estime par ailleurs dans l’arrêt Radix que la suspension illégale d’un permis de conduire
engage la responsabilité pour faute de l’état.
2) Présomption de faute et services publics
Le juge va déduire de certains dommages un dysfonctionnement du service et utilise le service de «
révélation ». C’est la présomption qui concerne tout d’abord le service public hospitalier. Admettons
qu’un individu ressort paralysé d’une opération. Il n’est pas possible de sortir d’une opération bénigne
avec un lourd handicap ; on déduit de l’ampleur du dommage le dysfonctionnement du service, ici de
l’opération aux lourdes conséquences.
- Dans CE 1980 Madame Martines ; la requérante avait subi une perfusion mais ressort avec le
bras paralysé. Là encore, un dysfonctionnement est révélé. Toujours en matière médicale, il pèse
une obligation d’information (conséquences du traitement, de l’intervention etc.) parce qu’il était
souvent difficile d’apporter la preuve du respect de l’obligation, la charge de la preuve est inver-
sée et fait place à une présomption dans L800-2 du Code de la Santé Publique ; le défaut d’in-
formation est présumé. Les présomptions se retrouvent aussi au sein des services publics so-
ciaux :
o CE 2012, Mademoiselle Sophie B. — Celle-ci avait accouchée d’un enfant abandonné,
confié par la suite à l’ASE. Mais voilà que la jeune femme obtient des informations sur la
nouvelle identité de l’enfant et de ses parents adoptifs, alors que cela était sous X. Le
Conseil d’État viendra dire qu’avoir eu connaissance de ces informations « révèle une
faute dans le fonctionnement de l’ASE du département, de nature à engager la respon-
sabilité de ce dernier », sauf si la faute est imputable à un tiers ; la faute est présumée.
Page 63 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
o CAA Douai 2002, ministre de l’Éducation nationale — Une partie des élèves avaient
mangé de la mayonnaise, mais furent intoxiqués à cause de germes de salmonelle, mais
comment apporter la preuve que l’administration a commis une faute ? Comment les
germes se sont retrouvés dans le condiment ? La Cour administrative d’appel nous dit que
s’il y a salmonelle, il y a forcément un dysfonctionnement : « l’intoxication (ici le dom-
mage) révèle, alors-même qu’il n’est pas possible d’en déduire les circonstances exactes
un dysfonctionnement du service public ».
Enfin, au sein du service public pénitentiaire, le Conseil d’État répond dans CE 2007, Monsieur A.B. « des
conditions de détention portant atteinte à la dignité de la personne humaine révèle un dysfonctionne-
ment ». Il y avait déjà une présomption en la matière : le préjudice moral. Dès lors qu’il y a atteinte, ce
préjudice et la faute sont présumés, et il ne reste plus qu’à prouver le lien de causalité. Les présomptions
de fautes se manifestent également dans la fonction publique à propos du harcèlement : c’est un com-
portement qui procède d’intentions inavouées. L’article L.1154-1 du Code du travail dispose ainsi en ce
sens « qu’il appartient à la personne qui se dit victime de harcèlement de prouver des circonstances
de fait qui laissent penser à du harcèlement » : il s’agit de renverser la charge de la preuve, et le tout
a été calqué au sein de la fonction publique. On est dans tous les cas en présence d’une présomption
simple, en faveur des victimes.
B) – La responsabilité pour faute lourde
Ce n’est parfois que dans le cadre d’une faute grave, lourde que la responsabilité de l’administration
est engagée, parce que certaines activités administratives sont trop complexes, difficiles. Les sanctionner
pour de simples fautes serait trop sévère. L’existence d’une activité difficile justifie un droit à l’erreur et
dans ce cas, la responsabilité de la puissance publique ne peut être engagée que pour faute lourde.
a) L’exigence de la faute lourde
1) Faute lourde et police
Elle est exigée tout d’abord en matière de police, exclusivement lorsqu’elle présente des difficultés
particulières, ce qui n’est pas le cas pour les actes juridiques, administratifs de police. Selon la jurispru-
dence, il n’y a pas besoin d’apporter la preuve d’une faute lourde en cas de lésion par un arrêt du type.
CE 2020, Madame C : la responsabilité de l’État était recherchée pour obtenir réparation d’un dommage
issu de l’AFSSPS, une AAI qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique et qui amène à une fonction
de police administrative spéciale, et de prendre dans certains cas les mesures d’interdictions d’un pro-
duit. Le Conseil d’État, lorsque cette agence cause un dommage dans ses fonctions estima que « la res-
ponsabilité peut être recherchée par toute faute commise » ; il n’y a pas de faute lourde requise, alors
quelles sont les activités de police nécessitant une faute lourde ?
- Les activités matérielles, sur le terrain, comme lorsque les forces de l’ordre interviennent pour
disperser une manifestation (CE 1956, Domenech), ou en cas d’inaction des forces de l’ordre :
le préfet avait accepté par un acte juridique de les envoyer, mais celles-ci n’avaient jamais été
envoyées.
- À propos de la non-intervention pour évacuer des grévistes occupant des installations portuaires
(des dockers ici), une faute lourde était nécessaire : CE 1984, Port autonome de Marseille. Si la
carence provient toutefois du refus, elle provient d’un acte juridique. Si le préfet garde le silence,
c’est un acte juridique illégal (inutilité de la faute lourde), mais s’il accepte, c’est l’inaction maté-
rielle qu’il faudra prouver (c’est une faute lourde).
Page 64 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- Si le dommage est causé par la police judiciaire, le juge judiciaire est compétent, et Cass. 1956,
Trésor public c/ Giry affirmait que c’était le juge judiciaire qui était compétent en la matière, et
qui vient appliquer les règles administratives de la responsabilité si l’administration est en cause.
On subit ici un dommage à cause d’une opération matérielle de police judiciaire, laquelle re-
quiert une preuve de la faute lourde. Si elle ne présente aucune difficulté particulière, la juris-
prudence se contente d’une faute non-qualifiée. C’est ce qu’a jugé CE 1979, Moisan.
Il ressort cependant de certains arrêts certaines difficultés :
- CE Madame K., 2016. Le Conseil d’État n’exige pas de faute lourde alors qu’il s’agissait d’une
mesure de police matérielle, ici la police en frontière.
- CE 2016, Avis, concernant l’exécution des perquisitions administratives qui peuvent être or-
données durant l’état d’urgence. Lorsqu’il est déclaré, les autorités de police peuvent y procéder
de jour comme de nuit. L’acte juridique ordonne la perquisition puis la période d’exécution. Le
Conseil d’État nous dit que l’exécution matérielle des perquisitions ordonnées engagent la res-
ponsabilité de l’État pour toutes fautes commises (simples comme lourdes). On peut alors se
dire que la faute lourde a été abandonnée en justice ; enfoncer une porte de personnes soupçon-
nées alors qu’elles sont vierges de toute criminalité, mais non.
- Dans l’affaire CE 2018, Madame N. H., épouse O (une victime de Mohammed Merah), l’épouse
victime rechercha la responsabilité de l’État, où elle estime que la surveillance de Merah avait
été carencée. La Cour administrative d’appel de Marseille estima que seule une faute lourde était
possible pour retenir la faute, mais elle retint aussi la difficulté de l’exercice des services de ren-
seignements, ce que CE 2016, Avis confirma.
2) Faute lourde et justice
L’état du droit y est beaucoup moins incertain. Il s’agit d’y engager la responsabilité de l’État du fait
d’un dysfonctionnement pour les juridictions judiciaires (selon le Code de l’Organisation Judiciaire :
L141-1) et par la jurisprudence du CE Ass 1978, Darmont. Dans les deux cas, la faute lourde est exigée.
On ne peut pas se plaindre d’une décision juridique définitive qui porte atteinte à nos droits (comme
la condamnation pénitentiaire), alors que c’est une décision qui dit le droit. L’exception peut provenir du
Droit de l’Union Européenne ; lorsque le préjudice est imputable au contenu d’une décision de justice,
mais qui est manifestement incompatible avec le droit de l’Union Européenne, la responsabilité de l’État
peut être engagée alors-même que le préjudice peut être imputable de la décision définitive ; c’est la
seule hypothèse. Mais toutes les décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée : les décisions du Juge
des référés ont un caractère provisoire, et si un préjudice est issu de ce genre de décision, la responsa-
bilité de l’État avec une faute lourde peut être engagée. Sinon, face au juge administratif, on peut
obtenir gain de cause lors d’un pourvoi en appel ; on pourrait y chercher aussi cette responsabilité avec
une faute lourde. La décision de justice de premier ressort n’était pas définitive puisqu’elle avait été
réformée en appel.
De même, le dommage peut provenir du comportement du juge ; une faute lourde était nécessaire en
cas de dépassement du délai raisonnable de jugement. Par exemple, si le dossier était oublié pendant
cinq ou six ans, une faute lourde était requise, mais elle a été abandonnée dans ce cas-là. (CE 2002,
Garde des Sceaux c/ Majira). Le Conseil d’État jugera dans cette affaire que le dépassement du délai (en
l’espèce sept ans pour le tribunal administratif de Versailles) et en profitera dans cet arrêt pour dire que
« ce dépassement traduit un fonctionnement défectueux du service public de la justice », ramenant à
l’hypothèse de la présomption, donc de l’abandon de la faute lourde. Toute faute engage la responsa-
bilité de l’État désormais. Mais ce délai est délicat à déterminer puisqu’il tient de chaque dossier et de sa
complexité, mais aussi de l’existence de voie de recours, de l’existence ou non d’une procédure d’ur-
gence en référé, etc.
Page 65 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
CE 2004, Madame Popin – Celle-ci fit l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par l’instance univer-
sitaire (en tant que professeur en université) ; elle prit une sanction et cet organe intervient en tant que
juridiction disciplinaire ; la sanction prise en l’occurrence par l’université avait le caractère d’un jugement.
Le Conseil qui statuait en formation disciplinaire avait le caractère d’une juridiction administrative
spécialisée. Popin fit un recours d’appel auprès du Conseil National de l’Enseignement et de la Recherche,
elle obtint satisfaction : la sanction est annulée, mais elle décide d’engager la responsabilité de la puis-
sance publique, puisque le préjudice moral a été de mise : l’affecta de son image auprès de ses étudiants
et ses collègues. Quelle responsabilité faut-il engager ? Rendue au nom de l’État puisque toutes les
décisions de justice sont prises au nom de l’État, c’est donc sa responsabilité qui est engagée et dans
cette hypothèse, une faute lourde est nécessaire.
3) Faute lourde et activité de contrôle
Ces activités de contrôle peuvent être dirigés par des autorités privées. Des salariés protégés par exemple
ne peuvent être licencié qu’après une autorisation administrative mais pendant longtemps, la faute
lourde était nécessaire jusqu’à l’arrivée de la faute simple — CE Sect. 1995, Lestrit. Si cette faute lourde
est exercée sur des organismes privés, elle est en revanche maintenue pour les organismes de contrôle
s’exerçant sur les activités publiques, comme le contrôle de tutelle exercé sur des organismes publiques
(Caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe-et-Moselle) : seule une faute lourde est de
nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Il en est de même de la tutelle exercée par
le préfet ; il est habilité à déférer aux tribunaux administratifs les actes administratifs qu’ils estiment
illégaux, mais aussi en matière de police, adoucie par la décentralisation. La faute lourde demeure ici en-
gagée : CE 2000, Ministre de l’Intérieur c/ Commune de Saint-Laurent, une commune de Corse. Celle-
ci avait pris en l’espèce une mauvaise décision, qui avait provoqué un préjudice financier ; elle a alors
décidé de rechercher la responsabilité de l’État, au motif qu’il a commis une faute dans l’exercice de
sa tutelle. La Cour administrative d’appel se prétend Conseil d’État et a conscience de l’abandon de la
faute lourde, mais elle décide d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple, tandis que le
(vrai) Conseil d’État est saisi en Cassation et vient censurer la décision d’appel ; les carences de l’État
concernant les actes de collectivités locales uniquement en cas de faute lourde. Seuls ces trois domaines
conservent la faute lourde, mais elle tend à être abandonnée de plus en plus, à commencer par la matière
médicale.
b) L’abandon de la faute lourde
1) En matière médicale
CE Ass. 1992, Époux V. — Il y considère que les erreurs commises lors d’une intervention chirurgicale
« constituent une faute médicale » ; la faute n’est plus qualifiée, donc elle relève de la faute simple. Elle
est très souvent consacrée par des rapports d’expertises. Néanmoins, la faute qualifiée a été remise au
goût du jour par le législateur en réponse aux médecins refusant de pratiquer des échographies préna-
tales, qui risqueraient en cas d’accident de porter préjudice à l’enfant à naître ; cependant, ne pas en
pratiquer ne permet pas de découvrir de possibles handicaps mettant en jeu la responsabilité de
l’État. La loi est intervenue par l’article L114-5 du Code de l’action sociale, qui nécessite une faute
caractérisée qui est, selon le Conseil d’État (CE 2014) est une faute caractérisée en fonction de son in-
tensité et de sa gravité. C’est une réintroduction partielle de la faute lourde concernant les échogra-
phies prénatales.
2) En matière de secours
Page 66 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Pour toutes les activités de secours, pour ces activités difficiles, le Conseil d’État décida d’abandonner
progressivement la faute lourde à commencer par le SAMU (CE Sect.1997, Teux), puis dans le sauve-
tage en mer et pour les urgences in fine.
3) En matière pénitentiaire
À commencer par l’affaire Chabbat, le Conseil d’État considéra qu’une « succession de faute engage la
responsabilité de l’État ». Ce n’est pas parce qu’il y avait plusieurs fautes qu’elles étaient égales. Dans
un arrêt de 2007, le Conseil d’État considéra qu’en principe, en cas de dommage issu du suicide d’un
prisonnier même mineur, celui-ci est de nature à engager la responsabilité de l’État. CE 2008, Garde
des Sceaux c/ Monsieur et Madame Zaouiya. Dans cette affaire, ces détenus brûlèrent leur matelas
contenant une mousse très inflammable mais qui dégageait par la même occasion une fumée extrême-
ment dense et très toxique, et tous les prisonniers moururent intoxiqués. La responsabilité de l’État y
est recherchée, mais comme il y a faute non-qualifié, le Conseil d’État va engager la responsabilité de
l’administration pénitentiaire, au motif que des fautes non-qualités ont été commises (le système
d’évacuation dysfonctionnait et le personnel n’a pas pu agir dans l’urgence).
4) En matière fiscale
Pendant longtemps, pour établir le montant de l’impôt dû par les contribuables et procéder à son
recouvrement, seule une faute lourde pouvait engager la responsabilité de la puissance publique. Dès
lors que l’activité ne présentait pas de difficultés, puis dans CE Sect. 2011, Monsieur Christian Krupa, le
Conseil abandonna la faute lourde en matière fiscale au profit « d’une faute commise » sans qualifier
de faute lourde. Comment comprendre cet abandon ? On ne le peut que si l’on tient en compte un
second paramètre en plus de la difficulté de l’activité ; il faut tenir compte de la nature du préjudice, les
plus graves étant les préjudices corporels (ceux qui sont matériels sont les moins graves). On peut alors
voir que la faute lourde a été abandonnée pour des activités difficiles certes, mais les préjudices vrai-
semblablement causés sont généralement corporels. En revanche, dès lors que le préjudice est seule-
ment matériel, on va seulement tenir compte de la difficulté, expliquant le maintien de la faute lourde
vu ci-précédemment. Deux paramètres sont à prendre en considération pour comprendre l’évolution de
la faute lourde et son abandon progressif.
Page 67 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 7 – La responsabilité sans faute
Leçon 7
C’est une expression jurisprudentielle qui provient de CE 1895, Carmes. On est toujours dans le schéma
de la responsabilité mais ici, il n’est pas constitutif d’une faute et on va donc pouvoir engager la res-
ponsabilité sans avoir rien à lui reprocher, ce qui est plus avantageux pour les victimes. Qu’est-ce qui
permet d’exprimer une responsabilité sans faute ? Il y a deux raisons, deux fondements :
- Le risque. L’administration exerce parfois des activités risquées pour les administrés. S’il se réa-
lise, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée sans l’existence d’une faute.
- Le principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques : l’administration exerce des
missions d’intérêts générales, qui vont parfois causer des victimes de l’intérêt général menant
à une rupture de l’égalité : la majorité qui bénéficie, la minorité qui charge. Cette minorité est
réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute.
Elle est évidemment favorable aux victimes, et ce tout d’abord parce que la preuve n’a pas à être prou-
vée, mais seulement celle d’un fait générateur. En outre, les circonstances exonératoires ne sont pas
toutes de nature (faute de la victime et force majeure), tandis que le cas fortuit n’a pas cette force
exonératoire dans ce cas. Dans le cas du contentieux, « la responsabilité sans faute est d’ordre public » :
le juge doit toujours vérifier si celle-ci ne peut pas être engagée, et ce même si la victime ne l’a pas
demandé puisqu’il est d’ordre public. Seul le préjudice présentant un caractère anormal et spécial
ou grave et spécial peut être indemnisé sur ce terrain de responsabilité.
- Il doit être anormal, excédé la norme, la moyenne de ce que l’on peut supporter et très souvent,
cette condition est liée à sa gravité.
- Il doit être spécial, rattaché à une personne mais il peut être rattaché à plusieurs victimes d’un
même accident ; en cas d’une rupture de canalisation, nous comme nos voisins en sont vic-
times. Si c’est un revirement de route, la nuisance sonore des voitures peut être dédommagée
si on est plus proche de la route que nos voisins, le dommage y est lui aussi spécial. Seul le
dommage anormal et spécial est susceptible d’être réparé sur le terrain de la responsabilité
sans faute ; si le fondement du risque s’applique ou lorsque le dommage est permanent, il
s’applique.
I] – Le fondement du risque
L’administration exerce parfois des activités exerçant un risque. Dans ce cas, sa responsabilité peut être
engagée si le risque est engagé par l’administration, mais aussi s’il est assumé.
A) – Un risque provoqué
Le risque provoqué est tout d’abord professionnel, c’est un risque auquel les agents publics sont con-
frontés ; il a d’abord été consacré au profit des collaborateurs permanents du service public, puis oc-
casionnels.
a) Les collaborateurs permanents du service publics
1) Risque professionnel et collaborateur permanent
Ce sont les agents et les fonctionnaires du service public. C’est à propos de ces collaborateurs perma-
nents que le Conseil (CE 1895, Cames) d’État instaura cette responsabilité.
Page 68 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
L’individu en l’espèce avait perdu l’usage de sa main après un accident et rechercha la responsabilité
de l’État, mais aucun dysfonctionnement du service permettait de la rechercher, alors il l’entreprit de
rechercher la responsabilité sans faute et le Commissaire du gouvernement (l’ancien rapporteur) ex-
primait que cette règle provient de considérations morales qui vinrent justifier cette jurisprudence.
Bénéficie-t-elle toujours aux agents publics ? Les pouvoirs publics sont intervenus pour mettre en place
des pensions ; un blessé de la fonction publique va bénéficier d’une pension d’invalidité s’il venait à
être blessé. Existe alors la règle du forfait de pension : le versement indemnise le préjudice subi par
l’agent dans sa vie professionnelle comme les pertes de revenues consécutives au dommage et au
handicap. La théorie du risque professionnel ne s’applique alors plus aux agents publics ? Non, elle
n’indemnise pas tous les préjudices. Les troubles dans les conditions d’existence ne le sont pas. Un
agent victime d’un accident professionnel, en plus de la pension peut demander l’indemnisation de
ces troubles sur le fondement de la jurisprudence Cames même si son champ d’application est réduit.
— CE 2004, Monsieur D. C.
2) Risque professionnel et collaborateur occasionnel
Elle a surtout bénéficié aux collaborateurs occasionnels, qui viennent apporter leur aide à l’administra-
tion et peuvent subir à cette occasion un dommage ; la responsabilité sans faute de la puissance
publique peut ressortir — CE 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine. En l’espèce, le maire avait
demandé à deux administrés de procéder à un tir de feu d’artifice à l’occasion d’une fête locale, mais
un engin a explosé et les administrés vont être blessé ; on ne peut rien reprocher aux victimes ni à la
commune, alors le Conseil d’État décida de faire bénéficier à ces collaborateurs cette responsabilité
sans faute, les collaborateurs étant les administrés. Il doit concourir à une véritable mission de service
public (une fête locale, la lutte contre l’incendie ou encore le sauvetage en mer). Le collaborateur ne doit
être ni un agent, ni un usager ; c’est un tiers. L’intervention du collaborateur doit être justifiée et en
l’espèce, elle était justifiée puisque le maire demandait.
- Lorsqu’il y a urgence, la participation du collaborateur peut être spontanée : CE 1970, Com-
mune de Batz-sur-Mer ou un père de famille sacrifia sa vie pour sauver une femme et ses
enfants de la noyade en mer. Ce qui justifie ce régime sont ces considérations morales, dans
un arrêt de 1977. Il peut tout à fait être appliqué par le juge judiciaire lorsqu’il concerne une
mesure de police judiciaire.
- Dans CE 1956, Trésor public c/ Giry, deux pêcheurs rentrant à 6 h du matin appelèrent la gendar-
merie face à deux personnes inertes devant leur bar favoris ; il y avait eu un double-homicide,
les gendarmes et les secours arrivèrent et ils appelèrent à leur tour le médecin Giry face à ce
possible double-meurtre. Mais les deux victimes avaient été asphyxiées par une fuite de gaz qui
amena à une explosion blessant Giry. On ne peut reprocher aucunement à l’administration et
celui-ci va rechercher celle de l’État, mais c’est un arrêt de Cassation (donc de l’ordre judiciaire)
ou le juge privé applique les règles de droit public pour pouvoir afficher un risque encouru
par un collaborateur occasionnel, à l’occasion d’une opération de police judiciaire.
b) Le risque anormal de voisinage
1) Les choses dangereuses
L’administration peut parfois exercer des missions faisant courir aux administrés un risque anormal de
voisinage. C’est une théorie consacrée depuis CE 1919, Regnault-Desroziers. Pendant la Première Guerre
mondiale, un dépôt de munitions et/ou armes explosa, et les victimes (indirectes ?) avaient recherché la
responsabilité de l’État. Le Conseil d’État va faire droit aux requêtes, au motif que les opérations effec-
tuées « comportaient des risques ». La responsabilité de l’État était alors engagée sans faute.
Page 69 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le régime juridique de cette responsabilité s’applique lorsque l’administration utilise des choses dan-
gereuses, comme des explosifs, des armes à feu (CE 1949, Consort Lecomte) ou encore des lanceurs de
balles de défense de type flashball, qui sont des choses « dangereuses » selon un tribunal administratif.
Le Conseil d’État a cependant considéré que les grenades lacrymogènes ne sont pas considérées
comme des choses dangereuses.
- Certains ouvrages publics, par exemple les routes en corniche typique de la Réunion (CE 1973,
Dalleau)
- Des produits sanguins contaminés par certains virus (comme le SIDA).
- Ou encore la défaillance d’un respirateur artificiel : CE 2003, APHP, confirmé par la suite dans
CE 2013, Monsieur F une dizaine d’années plus tard à propos cette fois d’une prothèse de ge-
nou. Le Conseil d’État force les catégories pour protéger le justiciable.
2) Les méthodes dangereuses
Cette théorie s’applique aussi aux méthodes dangereuses comme celle de réinsertion dont bénéficient
les malades mentaux, les détenus et les jeunes délinquants : CE 1967, Département de la Moselle. Un
malade mental avait malheureusement tué en l’espèce deux personnes pendant sa sortie d’essai et le
Conseil d’État accepta d’engager la responsabilité sans faute de la puissance publique.
- Cette solution fût étendue aux mesures de libertés conditionnelles dans CE 1987 Garde des
sceaux c/ Banque populaire de la région économique de Strasbourg
- Ou même à propos des mesures de liberté surveillée dont bénéficient les mineurs délinquants
CE 2012, Garde des sceaux. C’est un risque proposé par l’administration qui justifie l’engage-
ment de sa responsabilité sans faute, mais la jurisprudence plus récente a consacré aussi un
risque assumé.
B) – Un risque assumé
a) Une influence judiciaire
C’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui lança cette théorie avec la théorie de la garde. Cass.
Ass. Plénière 1991, Association des centres éducatifs du Limousin : un dommage avait été causé par
un handicapé mental confié à une association qui avait accepté de le prendre en charge. La Cassation
considéra que l’association était donc responsable de plein droit des dommages causés par cette per-
sonne à cause de la notion de garde.
- Dans CE 2005, Compagnie Axa Courtage, il s’agissait en l’espèce de protéger les enfants dans
le cadre de l’assistance éducative. Le Juge des enfants décida de placer l’enfant dans une struc-
ture sociale (ou une famille d’accueil) et le Conseil d’État considéra que cette décision transfert à
la personne qui est chargée de la responsabilité du mineur, de contrôler la vie du mineur, tout
en évitant de mettre en danger et d’éviter le danger pour l’enfant placé. C’est un risque assumé
par l’administration (l’État) qui justifie ce régime de responsabilité sans faute.
b) Un élargissement administratif
Cette jurisprudence judiciaire a néanmoins étendu cette théorie :
- Elle permet désormais de réparer les dommages causés par des mineurs délinquants
CE 2009, Garde des Sceaux c/ Association tutélaire des inadaptés
- Le régime de responsabilité sans faute est désormais appliqué pour réparer les dommages cau-
sés par un mineur qui a volé une voiture, mais qui avait été, à la demande de ses parents confié
Page 70 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le département est donc responsable
des dommages causés par ce mineur, en l’espèce du vol de la voiture.
- Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque, par décision du juge, la garde d’un mineur est con-
fiée à une association : CE 2006, Garde des sceaux c/ MAIF
- (Ou à un membre de sa famille : CE 2007, Garde des sceaux c/ Monsieur et Madame A.).
II] – Le fondement de l'égalité devant les charges
publiques
A) – Les dommages provoqués par des actes juri-
diques réguliers
a) Les actes administratifs
Lorsqu’une autorité administrative édicte un acte administratif illégal, la responsabilité pour faute de
la puissance publique peut être engagée. La responsabilité sans faute de la puissance publique peut
être engagée si cet acte administratif, qui est légal, est tout de même à l’origine d’une rupture d’égalité
devant les charges publiques :
- CE 1963, Commune de Gavarnie. Le maire de la commune y avait décidé de réglementer la
circulation des touristes pour accéder au cirque naturel, mais les marchands de souvenirs ne
voyaient plus de touristes passer devant chez eux. Le maire ne commet aucune illégalité avec
cette mesure de police administrative, mais cet acte est à l'origine d’une rupture d’égalité devant
les charges publiques, à savoir entre les touristes et les marchands. Cette rupture est ainsi répa-
rée par la responsabilité sans faute.
- CE 1995, Lavaud : un pharmacien avait perdu sa clientèle à la suite de la décision de fermeture
d’une dizaine d’immeubles pour cause de rénovation de quartier. Le pharmacien avait perdu
sa clientèle, donc la responsabilité sans faute de la puissance publique était de mise.
- CE 2007, Monsieur Lebergé — Ici, c’est une responsabilité sans faute de l’administration qui
est engagée pour réparer les dommages causés par une mesure de police administrative consis-
tant à la mesure d’un camping. Cette dernière jurisprudence permet d’indemniser les dom-
mages causés par le refus de l’administration de prêter le concours de la force publique. C’est
une hypothèse permettant à l’autorité administrative de refuser le concours de la force publique
si l’envoi des forces de l’ordre risque de causer des troubles à l’ordre public. Dans ce cas, l’auto-
rité administrative peut légalement refuser le concours de la force publique : on va pouvoir
engager la responsabilité sans faute de l’État car cette décision légale est à l’origine d’une rup-
ture d’égalité devant les charges publiques.
b) Les lois
La responsabilité sans faute du fait des lois est ancienne :
- CE 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette ». Le législateur était intervenu à
l’époque pour interdire la fabrication de produits laitiers à partir d’autre chose que du lait. La
société devait donc fermer. Le Conseil d’État a alors accepté d’engager la responsabilité de l’État
sans faute, du fait de cette loi.
- Dans CE Ass. 2019, Société Paris-Clichy, c’est un arrêt qui a étendu la jurisprudence Garde de
Dieu, qui permettait d’engager la responsabilité de l’État du fait d’une loi incompatible avec
un engagement international.
Page 71 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
L’arrêt Paris-Clichy élargit aussi cette hypothèse en permettant d’engager la responsabilité de
l’État du fait d’une loi, cette fois contraire à la Constitution en incluant la responsabilité sans
faute dans deux (nouvelles) hypothèses :
o Une responsabilité sans faute du fait de la loi (cf. jurisprudence « La Fleurette »)
o Une responsabilité de l’État du fait d’une loi incompatible à un engagement internatio-
nal ou contraire à la Constitution.
Même si la responsabilité sans faute du fait de la loi est engagée, seul le préjudice grave et spécial
peut être engagé. Il y a cependant des conditions pour que la responsabilité sans faute de l’État du fait
d’une loi soit possiblement engagée :
- L’indemnisation ne doit pas avoir été exclue par la loi. Le juge recherche toujours l’intention
du législateur si la loi met fin à une activité dangereuse ou s’il est intervenu dans un but d’in-
térêt général évident (CE 1984, Société Claude Publicité). La jurisprudence est venue interpréter
le silence de la loi comme ayant exclu l’indemnisation. Elle est même aller plus loin : si le légi-
slateur n’avait pas prévu l’indemnisation, son silence équivalait toujours à volonté de ne pas
indemniser.
- Le Conseil d’État est cependant intervenu dans CE 2005, Société coopérative Action. Le silence
ne vaut ainsi pas toujours refus d’indemnisation.
- Le préjudice doit aussi revêtir ce caractère anormal, « grave et spécial ». Ce n’est cependant pas
fréquent que les deux conditions soient réunies. Un exemple où elles le sont peut cependant être
CE 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre, où le Conseil
d’État est venu engager la responsabilité de l’État du fait de la loi.
c) Les engagements internationaux
La responsabilité sans faute de l’État peut aussi être engagée du fait des engagements internatio-
naux de la France. Cette avant-dernière hypothèse avait été consacrée par CE Ass. 1966, Compagnie
générale d'énergie radioélectrique. Ce régime de responsabilité sans faute ne s’applique que si trois
conditions sont réunies :
- La convention internationale, de même que la loi qui a éventuellement autorisé sa ratification
ou son approbation ne doivent pas être interprétés comme ayant entendu exclure l’indemni-
sation.
- Le préjudice doit être grave et spécial.
- La convention internationale doit avoir été régulièrement introduite dans l’ordre juridique in-
terne. Cependant, certaines ne peuvent être ratifiées qu’en vertu d’une loi, selon l’article 53 de la
Constitution.
o Par exemple, dans CE 2011, Mademoiselle Isma Susilawati, le Conseil des Prud’hommes
avait condamné un diplomate à payer ce qu’il devait à sa femme de ménage. Mais cet
homme bénéficiait d’une immunité diplomatique selon la convention de Vienne, Donc la
dame rechercha la responsabilité de l’État sans faute et le Conseil d’État accepta. Le Con-
seil d’État a accepté d’étendre cette solution à une règle coutumière du droit national
public.
o Cette règle reconnaît à certains actes accomplis à l’étranger une immunité de juridiction,
comme dans CE 2011, Madame Saleh. C’est la possibilité d’engager la responsabilité
sans faute de l’État du fait de la coutume internationale.
d) La Constitution
La responsabilité sans faute de l’État peut être aussi être engagée du fait d’une loi constitutionnelle,
comme dans CAA Paris 2003, Madame Demaret.
Page 72 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
L’une des révisions constitutionnelles, afin d’appliquer les Accords de Nouméa en Nouvelle-Calédo-
nie priva un certain nombre de ressortissants français du droit de vote car il fallait résider depuis dix
ans là-bas pour participer à l’indépendance du territoire ou non, et Madame Demaret faisait partie de
ces électeurs, et elle a recherché la responsabilité de l’État car elle avait été privée d’un droit fonda-
mental. La Cour administrative d’appel est venue appliquer les conditions de La Fleurette : le préju-
dice n’est toutefois pas anormal et spécial, car près de 10 000 électeurs avaient été privés du droit de
vote, alors que la loi constitutionnelle avait implicitement refusée l’indemnisation car elle était inter-
venue dans un but d’intérêt général évident, à savoir l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. La
Cour administrative d’appel est venue rejeter la requête.
B) – Les dommages de travaux publics causés aux
tiers
C’est le principe d’égalité devant les charges publiques qui peut aussi indemniser les dommages cau-
sés aux tiers. Quand on parle de travaux publics, on parle essentiellement du travail immobilier réalisé
pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale, comme la rénovation d’un
immeuble ou le ravalement d’une façade, la restauration d’un bâtiment historique, etc. Il est cependant
possible de subir un dommage de travaux publics en qualité d’usager. C’est alors le régime de res-
ponsabilité pour faute présumée. Les tiers, qui ne bénéficient pas de l’ouvrage ont un régime de
responsabilité sans faute aux ruptures d’égalité devant les charges publiques. Ce régime de respon-
sabilité sans faute permet de réparer les dommages accidentels de travaux publics.
- CE 1958, Veuve Barbaza. L’époux Barbaza décéda d’une électrocution, il était un tiers par rap-
port à l’ouvrage public qui était le transformateur électrique. Il a ainsi subi un dommage acci-
dentel et la responsabilité de la commune est engagée sans faute à la rupture d’égalité devant
les charges publiques.
Mais il permet aussi d’indemniser un dommage permanent de travaux publics, par exemple une auto-
route construite devant une habitation, induisant un bruit permanent de travaux tout d’abord, puis
de véhicule constamment. Il peut aussi s’agir des travaux d’installation d’une ligne de tramway, con-
duisant à la disparition durable (pendant plusieurs mois) d’une boutique à proximité. Pour cela, il faut
apporter la preuve du caractère grave et spécial du préjudice. Pour les dommages permanents, ce n’est
pas évident à prouver. En reprenant l’exemple de l’autoroute, il n’y a pas qu’une seule personne de
concernée donc il n’y a pas de rupture d’égalité : de même pour le commerçant. Il n’est pas le seul à
avoir subi le préjudice de la clientèle évaporée à cause des travaux, donc il n’y a pas de rupture d’égalité
non plus.
Page 73 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 8 – Les régimes législatifs
d’indemnisation
Leçon 8
L’existence de cette jurisprudence (de responsabilité sans faute) n’a pas pour autant empêché le législa-
teur d’intervenir en instituant certains régimes ponctuels d’indemnisation.
I] – Les régimes d’indemnisation fondés sur l’idée
de responsabilité
A) – Une responsabilité pour faute
a) Les dommages liés à un défaut de surveillance des membres de l’enseignement
public
La responsabilité pour faute de l’État peut tout d’abord être engagée pour réparer les dommages
provoqués par les membres de l’enseignement public. C’est une disposition législative codifiée dans
le Code de l’éducation, à l’article L911-4. Le fait dommageable doit être constitutif d’une faute, no-
tamment d’un défaut de surveillance. La faute peut être de service, personnelle (donc détachable du
service) ou encore pénale (Cass. 2022). Il était question en l’espèce d’un harcèlement moral aggravé
commis par un enseignant sur deux enfants dans l’école. Il faut alors engager la responsabilité de
l’État. La loi elle-même prévoit que c’est la responsabilité de l’État qui doit être engagée. Le dommage
doit concerner un membre de l’enseignement public, un enseignant par exemple.
- Le Tribunal des conflits identifie cette notion en disant, dans CE 2008 Préfet des Alpes Maritimes
c/ Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama que « la qualité de membre d’enseignant
public doit être étendue à toutes les personnes qui participent à mission éducative […] ». Il en
va ainsi des surveillants lorsqu’il s’agit d’accompagner une visite ou un voyage scolaire à but
éducatif. Mais ce n’est pas le cas s’il exerce mission de surveillance à la pause. Il faut regarder la
mission accomplie : s’il s’agit d’une mission éducative ou d’une simple mission de surveillance.
Lorsque les conditions sont réunies, la responsabilité de l’État peut être engagée, elle est subs-
tituée à celle des enseignants pour les dommages causés ou subis par les élèves. Le recours au
contentieux ne peut être engagé que contre l’État. En cas de litige, le tribunal administratif est
compétent mais pendant longtemps, cette action avait été fondée sur l’article 1384 du Code civil
mais désormais, rien ne justifie la compétence du juge judiciaire.
b) Les dommages causés par un véhicule
Lorsqu’un dommage est causé par un accident de véhicule qui concerne un véhicule administratif et
un véhicule privé, le juge administratif, pour juger de la responsabilité de l’État peut dire que le dom-
mage provient d’un litige privé et qu’il faut aller devant le juge judiciaire et inversement. C’est un
problème de compétence juridictionnel depuis la loi du 31 décembre 1957. « Les tribunaux de l’ordre
judiciaire sont ceux compétents pour statuer sur l’action en responsabilité civile ». Si on subit un
dommage causé par un véhicule administratif, on engage cependant la responsabilité de l’État sur le
fondement de cette loi devant le juge judiciaire.
Page 74 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Mais qu’est-ce qu’un véhicule juridiquement parlant ? Qu’en est-il si le dommage est causé par une
pelle mécanique lors de la réalisation de travaux publics ? Le Tribunal des conflits est venu déterminer
ce qu’était un véhicule de manière juridique, déterminant in fine la compétente juridictionnelle. Ainsi,
le Tribunal judiciaire est compétent uniquement si le dommage est causé par un véhicule. Il dit aussi
qu’en l’espèce, la pelleteuse est un véhicule dès lors qu’il y a un mécanisme de déplacement autonome.
Une tondeuse par exemple est un véhicule si elle est montée comme un tracteur. Sinon, si elle est
poussée classiquement, ce n’en est pas un. Le problème, avec un mode autotracté de tondeuse, celle-
ci avance seule mais il faut la freiner pour l’arrêter. Alors, est-ce un véhicule ? En outre, la loi ne va
s’appliquer que dans la mesure où la victime va imputer le dommage subi à l’action d’un véhicule. Ainsi,
le dommage causé à des cultures par un insecticides étalé sur les cultures par un avion est-il imputable
à l’avion, donc est-ce un véhicule ? La jurisprudence est venue dire en l’espèce que non, car le dommage
provient directement non pas du véhicule mais de l’insecticide (sinon l’avion est bien un véhicule). Enfin,
et malheureusement, un jeune se suicidant sous un train n’est pas dû au train comme véhicule mais
d’un défaut d’entretien de la grille protégeant les voies selon la mère du défunt. En se plaçant sur le
terrain du défaut d’entretien normal et donc du dommage public, la loi n’est pas appliquée.
B) – Une responsabilité sans faute
a) Les attroupements ou rassemblements
Il en va ainsi pour les dommages causés lors d’attroupements ou de rassemblements, à l’article L211-10
du Code de la Sécurité Intérieure. Engager la responsabilité de l’État qui est responsable si les dom-
mages ont été commis à force ouverte ou par violence, mais il faut aussi que les membres de l’attrou-
pement aient commis des actes de violence qualifiés de crime ou de délit. Et surtout, il faut que le
dommage soit posé lors d’un attroupement ou d’un rassemblement. Qu’est-ce que c’est ? En vertu de
la jurisprudence, c’est d’abord un regroupement de plusieurs personnes. Par conséquent, pour l’action
d’un individu isolé en marge d’une manifestation, le dommage n’est pas causé par un rassemblement.
La jurisprudence considère aussi que c’est un regroupement spontané et inorganisé. L’action d’un com-
mando de terroristes n’est pas qualifiable d’attroupement ou de rassemblement. Le dommage du fait
de l’action d’un groupe de professionnels en colère ne relève pas non plus de ce cas, puisque leur
manifestation est préméditée.
- En revanche, le Conseil d’État a jugé que « constituait un attroupement/rassemblement un regrou-
pement de jeunes, massé à l’entrée d’une boîte. Deux jeunes sur un scooter avaient été « pris
en charge » par les forces de l’ordre, mais réussirent à s’échapper avant d’avoir un accident avec
le véhicule de police. Les habitants de la cité descendent : c’est bien un attroupement.
— CE 2002, Compagnie d’assurance « Les Lloyd’s de Londres »
b) Les actes de violence commis dans les établissements pénitentiaires
Selon l’article 44 de la loi du 24 novembre 2009, « même en l’absence de faute, l’État est tenu de
réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue commise au sein de l’établissement
pénitentiaire par une autre personne détenue ». Le dommage est donc indemnisé uniquement si la
manifestation de violence a provoqué la mort de la victime et que si le décès a été provoqué par un
autre détenu ; ce sont des conditions très circonscrites.
c) Les détentions non suivies de condamnation
Il est possible d’être placé en détention sans toutefois être condamné à la prison (ou condamné tout
court) par la suite ; on parle du non-lieu, de l’acquittement ou encore de la détention provisoire.
Page 75 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Si tel est le cas, il est possible d’obtenir la réparation du préjudice que constitue la restriction, même
temporaire de nos libertés : c’est de la responsabilité sans faute de l’État, qui peut être engagée par la
volonté du législateur, d’après l’article 49 du Code de procédure pénale. La décision qui va innocenter
cette victime doit l’informer de l’existence de son droit. La réparation est accordée par le Premier
président de la Cour d’appel, qui doit être saisi dans un délai de six mois. Elle peut par la suite être
contestée dans un délai de dix jours par une juridiction spécialisée comme la Commission Nationale
des Réparations des Détentions ; il s’agit bien de rechercher la responsabilité de l’État devant les juri-
dictions civiles.
II] – Les régimes d’indemnisation fondés sur l’idée
de solidarité nationale
Il s’agit de réparer des dommages subis par des victimes qualifiées d’innocentes, comme les victimes
d’actes de terrorisme. Ce n’est pas de la responsabilité car l’administration n’y est pour rien : le fait
générateur ne la concerne pas et ce n’est pas non plus de l’assurance, c’est de la solidarité nationale.
Bénéficient de cette solidarité nationale les victimes de certains actes de violence, à commencer par
celles victimes d’actes de terrorisme.
A) – L’indemnisation des victimes de certains actes
de violence
a) Les actes de terrorisme
À la suite des attentats de Paris de 1986, le législateur est intervenu avec loi du 9 septembre 1986 qui
a créé un fonds de garantie, qui est doté de la personnalité morale. Il s’appelle le « fonds de garantie
des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ». Il est notamment alimenté par un petit prélè-
vement qui est perçu lors de la conclusion des contrats d’assurance. Selon le Code pénal, ce sont les
infractions « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour
but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur […] ». Le fonds indemnise
seulement les dommages corporels et non matériels qui sont laissés aux assurances. Dès lors que le
fonds reçoit la demande d’une victime et la justification de ses préjudices, il doit faire une proposition
d’indemnisation dans un délai de trois mois. Si victime refuse le montant, elle doit saisir le juge civil.
b) Certaines infractions pénales
À savoir deux hypothèses :
- L’article 706-3 du Code de procédure pénale : « toute personne, y compris tout agent public ou
tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le
caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui
résultent des atteintes à la personne […] ».
- L’article 706-14 du Code de procédure pénale : « toute personne qui, victime d'un vol, d'une es-
croquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dé-
gradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quel-
conque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se
trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indem-
nité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses
ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
Page 76 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu,
le cas échéant, de ses charges de famille ».
B) – L’indemnisation des victimes de certains risques
Le législateur a aussi permis d’indemniser les victimes de certains risques au titre de la solidarité natio-
nale.
a) Les victimes du système de santé
C’est la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui a créé un établissement public appelé l’ONIAM. Il indemnise
les dommages subis dans deux séries de cas :
- Une hypothèse générale, qui correspond à l’aléa thérapeutique. En vertu du Code de la santé
publique, un accident médical, une infection iatrogène/nosocomiale (CE 2002, Monsieur D.B).
Une infection nosocomiale par ailleurs est une infection survenant au cours ou au décours de la
prise en charge d’un patient qui n’était pas présente au début de celle-ci.
- Les hypothèses correspondant à des régimes plus spécifiques. L’ONIAM est chargée de réparer
les dommages causés par une vaccination obligatoire, de même que ceux résultant d’une con-
tamination transfusionnelle, le sida comme l’autre. L’ONIAM répare aussi les dommages subis
par les victimes du Médiator et celles de l’hépatite C. Enfin, les Établissement français du Sang
assume la responsabilité des risques encourus par les donneurs de sang.
b) Les victimes de l’amiante
D’après l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de la Loi de financement de la Sécurité sociale,
celle-ci est venue instituer un fonds d'indemnisation des victimes de l’amiante. Ce fonds est un éta-
blissement public administratif de l’État.
c) Les victimes d’essais nucléaires
Permettre l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires est possible depuis la loi du 5 janvier 2010.
Le législateur a mis en place un mécanisme de présomption du lien de causalité : il faut simplement
apporter la preuve du préjudice (un cancer) et le séjour dans une zone d’essai et le lien de causalité
entre les deux est présumé. L’indemnisation est fixée par un comité (une Autorité Administrative Indé-
pendante), à savoir le Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires, sous la forme d’un
capital. Le Conseil d’État considère que l’indemnisation se fait au titre de la solidarité nationale, il n’y
a pas à rechercher la moindre responsabilité.
Page 77 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Partie 3 – La justice
administrative
Le Conseil d’État été institué par la Constitution de 1799, créé comme un organisme consultatif. Il
rendait ainsi des avis. Le juge administratif, lui est délégué par la loi de 1972 et devient la juridiction
administrative suprême en rendant des avis et des arrêts. L’ordre juridictionnel administratif est placé
sous son autorité.
Chapitre 9 – L’organisation administrative
Leçon 9
La justice administrative est rendue par des juridictions administrative qui sont animés par des juges
administratifs.
I] – Les juridictions administratives
Elles sont placées sous l’autorité du Conseil d’État, avec les juridictions administratives générales ou
spéciales, relevant des contentieux administratifs particuliers.
A) – Le Conseil d’État
Le Conseil d’État est une juridiction spécifique au sommet de l’ordre administratif. Il siège à Paris au
Palais royal.
a) Son organisation
Il est structuré en sections, dont six sections administratives qui s’occupent de rendre les avis du Conseil
d’État et ne section unique du contentieux qui va exercer la fonction juridictionnelle impartie au Conseil
d’État. Les arrêts du Conseil d’État (il rend en effet des arrêts) sont normalement rendus par une formation
collégiale. Il y a alors dix chambres dans la section du contentieux, avec :
- La formation de jugement la plus simple, c’est la chambre qui statue seule et qui est composée de
trois magistrats.
- La formation des chambres réunies, avec une chambre d’instruction et une chambre pour juger.
Enfin, il existe deux formations plus solennelles, qui rend les arrêts importants, dont :
- La section du contentieux est composée de 15 conseillers d’État : le président de la section du
contentieux, les 3 présidents adjoints, les 10 présidents de chambre et le rapporteur de l'affaire.
Elle ne peut statuer que si au moins 9 de ses membres sont présents.
- L'Assemblée du contentieux est la formation de jugement la plus solennelle du Conseil d’État, où
sont jugées les affaires dont l'importance est exceptionnelle : la décision qui sera rendue pourra
avoir une grande portée juridique ou remettra en cause une solution juridique adoptée par
Page 78 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
l’Assemblée du contentieux par le passé. L'Assemblée du contentieux comprend 17 conseillers
d’État : le vice-président du Conseil d'État, le président de la section du contentieux, les 5 présidents
des sections consultatives et le président de la section du rapport et des études, les 3 présidents
adjoints de la section du contentieux, le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire
est jugée ou dans certains cas le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement
attribuée, les 4 présidents de chambres les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précé-
dent et le rapporteur de l'affaire.
Mais il y a aussi des juges uniques : lorsqu’ils statuent à juge unique, ils rendent des ordonnances. Le
plus souvent, c’est le juge des référés. Il prend des mesures provisoires dans l’attente d’un jugement
au fond. Mais parfois, le juge unique statue au fond et il devient ardu, cette décision au fond est prise par
une seule personne. Ce cas de figure est possible pour régler des affaires qui ne présentent pas de diffi-
cultés comme rejeter une requête manifestement irrecevable. Le recours à une formation collégiale
est possible si l’affaire présente des difficultés particulières, comme avec l’affaire Vincent Lambert. Le
juge des référés-libertés avait renvoyé l’affaire à une formation collégiale (à savoir l’assemblée du con-
tentieux). Il s’agissait d’un homme paralysé, branché avec une partie de la famille qui voulait interrompre
le traitement et une autre qui souhaitait le maintenir artificiellement en vie. À titre de statistique en 2021,
le Conseil d’État a jugé plus de 11 000 affaires. Le délai moyen de jugement est de sept mois pour juger
une requête.
b) Sa composition
Au 31 décembre 2021, il y avait 239 membres en activité au Conseil d’État (des magistrats). Pour l’es-
sentiel, ils sont recrutés parmi les administrateurs de l’État. Au Conseil d’État, ils sont tout d’abord audi-
teur, puis maître des requêtes puis conseiller d’État. Au niveau des maîtres des requêtes et des con-
seillers d’État, il y a aussi un recrutement aux tours extérieures comme la nomination des préfets. Il
évite ainsi le Conseil d’État pratique le repli sur soi.
B) – Les juridictions administratives générales
En dessous du Conseil d’État, se retrouvent les juridiction administrative générales qui sont les Tribu-
naux administratifs et ensuite, les Cour Administrative d’Appel.
a) Les tribunaux administratifs
Ils ont été institués en 1953. Il y a en 31 en France métropolitaine : chaque tribunal administratif
couvre plusieurs départements. Selon l’importance de leur activité, ils comportent plusieurs
chambres. Le Tribunal administratif de Paris dispose de 18 chambres par exemple. Pour le reste, cela va
d’une chambre à Bastia à une dizaine de chambres en banlieue parisienne de Paris. La règle, c’est que le
tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel à son siège l’autorité
administrative qui a pris la décision d’attaquer l’autre partie. Ainsi, une grande partie de ces autorités
disposent de leur siège à Paris (ou en proche banlieue). Les tribunaux administratifs rendent des juge-
ments qui sont normalement rendus par une formation collégiale, à savoir :
- Une chambre dotée de trois magistrats
- Une formation plus solennelle
- Un juge unique peut toutefois intervenir et le tribunal administratif rendra une ordonnance. Il
intervient en qualité de juge des référés et pour régler les contentieux qui ne présentent pas de
difficultés. Le Code de Justice Administrative, à l’article R222-13 permet de statuer à juge unique
pour régler les litiges de faible importance, comme :
Page 79 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
o Le contentieux des pensions de retraite des agents publics
o Le contentieux du permis de conduire
o Le contentieux de la communication des documents administratifs
o Le contentieux provoqué par les refus de concours de la force publique pour exécuter une
décision de justice
o En matière de responsabilité, le contentieux indemnitaire, lorsque l’indemnité demandée
est inférieure à 10 000 €.
En pratique, 60 % des décisions du tribunal administratif sont rendues à juge unique. Cela permet de
juger plus. Les tribunaux administratifs, en 2021, ont jugé plus de 230 000 affaires avec délai moyen de
jugement de moins de 10 mois.
b) Les Cours Administratives d’Appel (ou CAA)
Elles ont été instituées en 1987, intercalées entre les tribunaux administratifs et le Conseil d’État pour
soulager le Conseil d’État qui était juge d’appel auparavant. Les Cour administrative d’appel sont
actuellement au nombre de neuf sont bien réparties sur le territoire. Elles rendent des arrêts normale-
ment rendus par une formation collégiale, soit
- Par une chambre de trois membres
- Par une formation plus solennelle
- Par un juge unique qui peut intervenir en rendant des ordonnances. Comme le juge des référés
ou pour le règlement au fond des contentieux qui ne présentent pas de difficultés.
En 2021, les Cours administrative d’appel ont jugé plus de 34 000 affaires et disposent d’un délai moyen
de jugement est d’environ 11 mois. Mieux que devant le juge civil, le délai a diminué depuis 50 ans et
la justice administrative fonctionne bien. Les membres des tribunaux administratifs et des cours admi-
nistratives d’appel forment un même corps de magistrats comptant plus de 1200 membres. Plus des
2/3 sont en poste au sein des tribunaux administratifs. Le recrutement se fait par concours : celui de
L’Institution Nationale du Service Public (l’INSP) qui a remplacé l’École Nationale de l’administration (l’ENA),
avec environs une quinzaine de ressortissants par an. Cela ne suffit pas donc pas, donc il y a un recrute-
ment complémentaire par concours, à savoir le concours externe, ouvert aux étudiants et aux internes
(comme les fonctionnaires de catégorie A et aux magistrats judiciaires) tous les ans. Les candidats reçus
font par la suite un stage de huit mois au Conseil d’État. On a, au sein des tribunaux administratifs un
recrutement aux tours extérieures. Les membres des Cour administrative d’appel sont recrutés au
sein des tribunaux administratifs. Le président de la Cour administrative d’appel est nécessairement un
conseiller d’État, formant le lien organique entre Conseil d’État et les cours.
C) – Les juridictions administratives spécialisées
Sous l’autorité du Conseil d’État, il y a aussi des juridictions administratives spécialisées dans un con-
tentieux administratif déterminé.
a) Leur diversité
Il y en a environ une cinquantaine, comme :
- La Cour des comptes, à la fois une administration d’inspection et de contrôle qui rend un rapport
sur les finances publiques et une juridiction administrative spécialisée qui est chargée de juger les
comptes des comptables publics en appliquant les règles de la comptabilité publique.
Page 80 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- La Cour Nationale du Droit d’Asile, ou CNDA. Elle est chargée de juger le contentieux provoqué
par la situation de réfugiés. En 2021, elle a jugé plus de 68 000 affaires (la juridiction avec le +d’af-
faires et à juger le +vite possible).
- Des organismes qui interviennent en matière disciplinaire :
o C’est le cas du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) qui prononce des sanctions à
l’égard des magistrats du siège. Il statue alors en qualité de juridiction, selon CE Ass.
1969, L’Étang.
o Mais aussi du Conseil académique de l’université. Il agit en qualité de juridiction pour
prendre des sanctions vis-à-vis d’enseignants.
C’est donc un système à deux étages, avec un recours en appel possible. Par exemple, les juridiction
ordinales (comme l’ordre des médecins) rendent la justice au nom de l’État. On retrouve en premier
ressort la Chambre disciplinaire de première instance, et en appel, c’est la Chambre disciplinaire na-
tionale, selon le Code de la santé publique, à l’article L242-3. Sinon, c’est l’ordre juridictionnel qui
statue seulement en premier ressort. La Chambre juridictionnelle statue seulement en premier ressort.
Par exemple, la CNDA statue avec seulement un recours en cassation devant le Conseil d’État, de même
pour le CSM avec seulement un recours en cassation devant le Conseil d’État.
b) Leur unité
Il y a cependant deux facteurs d’unité, à savoir :
- Toutes ces juridictions administratives spécialisées statuent au nom de l’État. La justice n’est pas
décentralisée. Ainsi, CE Sect. 2004, Madame Popin avait en l’espèce une professeure d’université
qui avait l’objet d’une sanction par le Conseil académique de l’université. Elle est alors est allée
devant le CNESER (le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) qui est venu
invalider la sanction. De plus, elle a subi un préjudice moral donc il faut engager la responsa-
bilité de l’État pour faute lourde.
- Toutes ces juridictions sont soumises au contrôle de cassation du Conseil d’État sauf le Conseil
des prises maritimes. En période de guerre, il a un droit de prise sur les navires, qui porte sur le
bateau en lui-même et ce qu’il transporte. Elles ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’un jugement.
On peut cependant faire un recours en appel devant le Président du Conseil d’État qui statue en
son Conseil d’État, c’est-à-dire qu’il soumet l’affaire au Conseil d’État pour un avis, mais c’est le
Président qui prend la décision. Ainsi, dans CE 1934, Compagnie marseillaise de navigation à
vapeur Fraissinet, le Président du Conseil d’État est venu rendre un acte juridictionnel, un jugement
qui ne fait pas l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. C’est une survivance
de la justice retenue.
II] – Les juges administratifs
Les membres des Tribunaux et des Cours administratives d’appel sont des magistrats, leur statut étant régi
par le Code de Justice Administrative. Pour garantir l’indépendance de ces membres, le statut laisse ouvert
des incompatibilités, mais aussi des inégibilité (comme se présenter à des élections politiques), mais le
Code cite également le principe d’inamovibilité, on ne peut pas les déplacer même dans le cadre de leur
formation, afin de garantir leur indépendance. Les membres du Conseil d’État n’ont pas officiellement le
rang de magistrat mais de fonctionnaires de l’État, parce que ces membres relèvent à la fois de la Section
du contentieux (donc magistrat) mais aussi d’une formation administrative. Ce ne sont pas des magistrats
qui vont juger mais exercer les fonctions consultatives du Conseil d’État. Un requérant, pour contester
une décision du Conseil a essayé d’aller devant la CEDH, en arguant que l’arrêt rendu par le Conseil d’État
n’a pas été rendu par une véritable juridiction, puisque n’étant pas composé de « réels » magistrats.
Page 81 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
CEDH 2006, Sacilor-Lormines c/ France les observe néanmoins comme de véritables juges en s’appuyant
sur une règle coutumière qui consacre l’indépendance des membres du Conseil d’État. Ils bénéficient
ainsi du principe d’inamovibilité. Enfin, ils doivent prévenir et faire cesser les conflits d’intérêts, définies par
le Code de Justice Administrative comme des « situations d’interférences entre des intérêts publics ou
privés ». Le rapporteur public, anciennement nommé de Commissaire du gouvernement (ce qui ne plaisait
pas à la CEDH) est un magistrat indépendant qui va présenter des conclusions orales à la formation du
jugement ; il va présenter l’affaire et proposer une solution au litige. Très souvent, c’est lui qui va faire
évoluer la jurisprudence. Le Code de Justice Administrative le présente, selon l’article L7 comme « un
membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute
indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions
qu'elles appellent ». On distingue les juges administratifs selon ce que leur demande les requérants et
leurs conclusions (l’annulation d’une décision, le versement d’une indemnité, etc). Le juge administratif va
intervenir soit en la qualité de juge de l’excès de pouvoir, le juge du plein-contentieux ou en juge des
référés.
A) – Le juge de l’excès de pouvoir
C’est un juge de la légalité ; le requérant lui demande d’apprécier la légalité d’un acte administratif et
ce juge va examiner si l’acte administratif en cause respecte ou non la légalité. L’acte est-il conforme à la
loi ? La loi est-elle compatible avec les conventions internationales ? On parle d’un contentieux objectif
en cause. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de conséquences patrimoniales. Un fonctionnaire évincé
de la fonction publique verra sa sanction annuler par le juge de l’excès de pouvoir, ceci alors même que
le fonctionnaire pourra obtenir réparation, en engageant la responsabilité de la personne publique (qui
l’a évincé). Lorsque le juge est saisi pour un Recours pour Excès de Pouvoir ; le requérant va contester l’acte
administratif. Pour apprécier la légalité de l’acte, le juge doit se placer à la date à laquelle la date l’Acte
Administratif Unilatéral est signée, lorsqu’elle débute à exister. On ne pourra pas sanctionner l’adminis-
tration qui méconnaissait par exemple une loi postérieure à l’acte. Il peut en aller différemment toutefois
de certaines décisions de refus. Par exemple, le refus de l’autorité administrative d’abroger un acte régle-
mentaire. L’administration doit abroger les actes illégaux et ne répond pas sous deux mois, donc l’hy-
pothèse de l’implicite refus le 10 mai. Dans ce cas-là, si le juge statue neuf mois plus tard, le 10 février de
l’année suivante, à quelle date le juge doit-il se placer pour apprécier la légalité du rejet.
- S’il se place le 10 mai, à la date de la décision, la légalité a pu évoluer entre le 10 mai et le 10 février.
L’acte est potentiellement devenu illégale entre temps.
- Va-t-il falloir refaire une demande ? NON ? Le juge administratif va se placer à la date à laquelle
il statue (le 10 février) de manière à pouvoir tenir compte d’un éventuellement changement
de circonstances du droit ; l’objectif étant toujours de renforcer la justice administrative. CE
2019, Association des Américains Accidentels.
Le Juge pour Excès de Pouvoir (JEP) est saisi pour deux types de recours :
a) Le Recours pour Excès de Pouvoir (ou REP)
C’est un vieux recours dont l’Union Européenne s’est inspirée, c’est un recours contentieux, une procédure
juridictionnelle par laquelle un requérant demande au juge administratif d’annuler un acte admi-
nistratif au motif que ce motif est illégal. C’est un instrument de lutte pour la légalité. Il permet
d’obtenir la disparition rétroactive de l’acte (il n’a jamais existé). Cette disparition se produit à l’égard de
tous. Il bénéficie de l’autorité absolue de la chose jugée. Le REP est recevable uniquement contre les
Actes Administratifs Unilatéraux (ou AAU). Il est en principe irrecevable contre les contrats, c’est un recours
principal directement dirigé contre l’acte car c’est l’acte qui est attaqué, un procès à l’acte in fine.
Page 82 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le déféré préfectoral quant à lui permet de déférer au Tribunal administratif les actes administratifs dé-
centralisés par lequel le préfet va demander l’annulation de l’acte ; c’est un REP finalement, selon CE 1991,
Comme de Sainte-Marie. Le JEP peut non seulement annuler l’acte administratif illégal mais aussi par la
volonté du législateur qui peut prononcer des injonctions à l’égard d’une administration afin d’en tirer
les conséquences. Le juge d’abroger est illégal donc le juge administratif peut l’annuler. En l’espèce, le juge
estimait qu’il était illégal. Désormais, il peut aussi ordonner à l’administration d’en tirer les conséquences,
donc ordonner d’abroger le règlement ; il peut prononcer une injonction donc il dispose d’un pouvoir
d’annulation et d’injonction, d’après les articles L911-1 et L911-2 du CJA. L’annulation juridictionnelle
impose au juge administratif de se prononcer d’à nouveau annuler. Elle peut seulement lui imposer de
prendre une nouvelle décision (selon L911-2). Dans le cas du refus d’un maire de ne pas délivrer un permis
de construire pour REP, le juge administratif va estimer qu’il est illégal, puisque le refus (donc défavorable)
est illégal pour vices de forme. Est-ce que l’annulation du refus implique nécessairement que le maire
accorde ? Pas forcément ; le maire doit à nouveau se prononcer et prendre une nouvelle décision, dont
l’hypothèse d’un refus, cette fois motivé. Le JEP peut également être saisi pour un recours d’appréciation
de la légalité.
b) Le Recours en Appréciation de la Légalité
Il conduit le JEP à se prononcer sur la légalité d’un acte administratif (c’est toujours un contentieux
objectif). À la différence du REP, le RAL peut être dirigé contre un AAU comme un contrat administratif. Le
recours en appréciation de la légalité ne débouche pas sur l’annulation de l’acte même s’il est illégal,
il va seulement le déclarer illégal, parce qu’à la différence du REP, le RAL n’est pas un recours principal
mais incident, qui découle d’une instance pendante, en cours devant le juge judiciaire (et notamment le
juge civil). Dans l’arrêt Compagnie Air France c/ Époux Barbier, Madame était hôtesse de l’air qui avait
décidée de se marier, mais juste après son mariage, elle est licenciée. La Compagnie applique une mesure
qui prévoit que les femmes se mariant sont considérées comme ayant quitté leur poste. Air France est une
société qui gère un service public à caractère industriel et commercial, donc un SPIC. Dans ce cas-là,
la relation entre Air France et Madame Barbier est agent d’une personne privée : une salariée. Même si
Air France était une personne publique, Barbier serait restée une salariée.
Dans ce cas-là, le juge compétent du litige opposant Madame Barbier à Air France est le juge judiciaire,
ici le Conseil des prud’hommes. Il doit apprécier la légalité de la mesure prise par Air France. Quelle est
sa nature juridique ? Une mesure prise par une personne privée gérant un SPIC relative à une gestion
privée, cependant, il y a le principe de séparation des pouvoirs. Le juge civil ne peut pas apprécier la
légalité des actes administratifs ; c’est une question préjudicielle pour le juge civil, c’est le juge admi-
nistratif qui est compétent. Il faut donc saisir le juge administratif du recours en appréciation de la léga-
lité, un recours-incident qui découle d’une action pendante devant le juge civil. Il ne peut que déclarer
l’acte illégal et le juge judiciaire en tira les conséquences concernant le procès se portant devant lui. Le
licenciement est donc illégal et Madame Barbier touchera des indemnités. Le RAL est posé par le juge
judiciaire au titre de l’article 49 du Code de procédure civile. Enfin, si l’acte administratif est illégal, le juge
comme l’administration ne peut pas l’appliquer voire l’abroger si c’est un acte administratif réglementaire,
mais le juge, dans un RAL ne peut que déclarer. Dans tous les cas, c’est un contentieux objectif.
B) – Le juge du plein-contentieux
a) Le plein-contentieux subjectif
Ce n’est pas un contentieux objectif malgré les exceptions. En principe il est subjectif : le requérant va
estimer une atteinte à ses droits subjectifs et va saisir le juge administratif pour obtenir réparation.
Page 83 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Ce droit subjectif violé peut provenir d’un contrat (donc le contentieux contractuel, un contentieux entre
les parties au contrat). S’il estime que ses droits issus du contrat ont été violés par l’autre contractant (ici
l’administration), cela revient à engager la responsabilité contractuelle de l’administration. On parle
également de contentieux de pleine juridiction. Ce dommage peut aussi être issu d’une relation extra-
contractuelle, comme un dommage subi par des travaux publics ou de l’intervention des forces de l’ordre.
Aucun contrat ne lie le tier à l’administration : c’est la recherche de la responsabilité extracontractuelle,
donc il sera demandé au juge le versement d’une indemnité pour réparer le préjudice subi par l’adminis-
tration. On parle de « contentieux de pleine juridiction » puisqu’il peut faire plus qu’indemniser : il peut
réformer, modifier l’acte contesté. Le juge administratif peut remplacer la décision de l’administration
par sa propre décision.
b) Le plein-contentieux objectif
Le plein-contentieux peut aussi être objectif, il est encore en développement. C’est du plein-contentieux
parce que le juge administratif peut faire plus qu’annuler comme réformer, remplacer la décision atta-
quée. Mais la dimension objective apparaît par la question de légalité.
- Le contentieux électoral relève du juge administratif lorsqu’il s’agit des élections législatives, mu-
nicipales, locales, présidentielles, etc. La question posée au juge est de légalité : le Code électoral
et ses dispositions ont-elles été respectées ? Le juge peut non seulement annuler les élections mais
également réformer les élections : il peut élire un candidat battu aux élections parce qu’il y
a eu vices des élections ; il peut réformer la décision de l’administration.
- Le contentieux fiscal relève aussi du juge ; un requérant peut contester le montant qu’il doit
aux impôts. Il peut demander d’être dédouané de son montant parce que l’administration n’a pas
appliqué admettons une réduction d’impôt. Le juge peut non seulement annuler le montant mais
aussi réformer et remplacer la décision de l’administration fiscale par sa décision en détermi-
nant lui-même le montant que le requérant doit aux impôts.
- Dans le cadre d’une police administrative spéciale relevant du préfet est aussi du plein-con-
tentieux. Il dispose (le juge) d’un pouvoir de réformation ; il peut annuler la décision du préfet et
la modifier, la révision et la remplacer par sa propre décision mais il regarde tout d’abord si le
Code spécial a été respecté. Dans CE Avis 2015, Association Nonant Environnement, le juge admi-
nistratif « a le pouvoir d’annuler la décision […] et, après avoir si nécessaire régularisé ou compléter
la procédure d’apporter lui-même une décision » et venir remplacer l’ancienne décision.
- Dans CE 2014, Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la ré-
gion de Tournan-en-Brie, le Conseil d’État dispose que « Le juge du plein-contentieux des installa-
tions classées dispose donc de pouvoirs qui se situe à mi-chemin de ces solutions. Nous vous pro-
posons de clairement préciser qu'il est le juge de la légalité de la situation de l’exploitant, appréciée
à la date à laquelle il statue, avec deux particularités : la conformité de l’autorisation aux règles de
procédure en vigueur à la date à laquelle elle a été prise clôt le débat de sa régularité ».
- Le contentieux social, provoqué par les requêtes relatives aux allocations et droits attribués au lo-
gement. D’après l’article R772 du Code de justice administrative, le juge peut non seulement con-
tester la décision de refus d’une aide sociale, mais également fixer et obliger l’aide à être versé.
Enfin, dans les contentieux de sanctions administratives (comme le retrait d’un permis à point), le juge va
statuer en qualité du juge de plein-contentieux : il peut faire plus qu’annuler encore une fois mais aussi
réformer la sanction. La décision de suspension de permis et du retrait de points, la suspension est un acte
administratif.
o L’administration procède à une mesure de police administrative ; la suspension a comme
finalité d’empêcher un trouble à l’ordre public donc REP.
Page 84 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
o Le retrait de point est quant à lui une sanction, donc le juge de plein-contentieux va se
prononcer. Le juge peut alors faire plus qu’annuler et réformer la décision, décider du
retrait de deux points uniquement au lieu des quatre. Cette distinction entre le REP et le
plein-contentieux affecte non seulement les pouvoirs du juge, mais elle entraîne également
des conséquences sur la recevabilité de la demande. Le REP n’est pas soumis au « minis-
tère » d’un avocat, tandis que le plein-contentieux requiert la présence d’un avocat.
C) – Le juge des référés
Le juge des référés est un juge qui rend des ordonnances, codifiées au sein du Code de justice admi-
nistrative.
a) Le référé-suspension
Le recours contentieux devant le juge du fond (donc un REP ou un Recours de Plein Contentieux Objectif,
RPCO), entre le moment ou l’acte est pris et le juge statue sur l’acte peut parfois prendre un très grand
laps de temps, permettant à l’acte de produire tous ses effets, tout illégalité qu’il soit. Pour éviter les in-
convénients du caractère non-suspensif du caractère non contentieux de l’exécution d’un AAU (comme
une mairie empiétant sur le jardin d’un citoyen dans son agrandissement), ce premier référé, pour lutter
contre l’inconvénient existant permet de saisir le juge administratif des référé-suspension qui suspend
l’acte administratif unilatéral, via trois conditions décrites dans l’article L521-1 du Code de justice admi-
nistrative :
- Le juge administratif qui va statuer au fond sur la légalité de l’acte et annuler ou réformer l’acte
doit être saisi en même temps que le juge du référé-suspension.
- La demande de suspension de l’exécution de la décision doit être justifiée par l’urgence ; c’est en
effet un référé d’urgence, soumis à une condition d’urgence. Très concrètement, le juge va exami-
ner et regarder si l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences irréversibles
comme la construction aboutie ou l’euthanasie d’un animal. Dès lors que l’exécution de l’acte atta-
qué va avoir de telles conséquences, le juge du référé-suspension va admettre l’urgence de l’acte.
- Lorsqu’il statue en urgence, le juge n’a pas le temps de statuer sur l’intégralité du dossier ; il doit
tout de même observer la légalité de l’acte.
- Enfin, une dernière condition implicite ressortant cette fois de la jurisprudence admet qu’un requé-
rant est « recevable à demander la suspension de l’exécution d’un acte si elle est encore suscep-
tible d’être exécutée », si elle n’a pas totalement abouti.
Lorsqu’il y a suspension, l’acte est suspendu en attendant que le juge du fond se prononce (la cons-
truction ou le laps de temps séparant la décision à l’euthanasie de l’animal est ainsi suspendue dans le
temps).
b) Le référé-liberté
Il a très largement été utilisé durant l’état d’urgence sanitaire : 900 ordonnances en 2021, rien que cela. Il
est régi par l’article L521-2 du Code de justice administrative, et il est destiné à obtenir du juge « toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », c’est donc un instrument de protec-
tion des libertés. Plusieurs conditions là-encore doivent être réunies :
- La mesure demandée doit être justifié par l’urgence ; le juge doit se prononcer dans le délai de 48
heures.
- La condition d’urgence n’est appréciée rigoureusement que dans le référé-suspension : il faudra
peut-être d’abord remplir la notion d’urgence face au juge du référé-suspension.
Page 85 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- L’atteinte doit avoir été portée à une liberté fondamentale. Le plus souvent, ce sont des libertés
comme des droits (que le Conseil d’État assimile l’un à l’autre dans le référé-liberté) : le droit au
logement, la liberté d’expression mais la place du droit ou de la liberté dans la hiérarchie des
normes est un indice fondamental.
- L’atteinte porte doit être grave et illégale ; la jurisprudence tient à distinguer ce qui gêne ou porte
atteinte. Le juge va vérifier s’il s’agit d’une simple gêne ou si c’est une atteinte grave au droit ou à
la liberté ; si l’atteinte est manifeste et évidente, il agira en urgence. Il a ainsi pu intervenir pour
mettre fin à une atteinte portée à la liberté d’expression menée par France Télévision (CE 2019).
Lorsque les conditions sont réunies selon le législateur, le juge peut ordonner « toute mesure destinée à
mettre un terme à l’atteinte ». Il peut normalement prendre des mesures provisoires, comme la suspension
(comme le juge du référé-suspension). Le référé-liberté peut suspendre l’exécution de l’acte portant
atteinte. Si l’atteinte résulte du comportement d’une administration, il peut (le juge) ordonner à l’admi-
nistration de cesser le comportement attentatoire : c’est une injonction.
- Par exemple CE 2021, Ordonnance Madame B. En l’espèce, le juge du référé du Conseil d’État pro-
nonce la suspension de l’exécution d’une recommandation sanitaire qui prescrivait l’interdic-
tion des sortes des résidents des EHPAD alors même que la majorité des résidents avaient
été vaccinées. Le juge suspend l’exécution de cette recommandation.
- Cette fois une injonction : CE Ass. 2016, Madame Gonzales-Gomez. Celle-ci avait souhaité bénéfi-
ciée d’une insémination post-mortem : se faire inséminer concrètement des gamètes de son mari
décédé. Elle souhaitait que l’hôpital français transmette à l’hôpital espagnol les gamètes, et elle
obtint gain de cause.
c) Le référé-provision
L’objectif est d’obtenir une somme d’argent sur une créance lorsque son objet n’est pas contestable. Il est
prévu par une disposition réglementaire (et non pas législative) pour « obtenir une provision », avec
qu’une seule condition à respecter : la créance ne doit pas être sérieusement contestable. Tous les juges
administratifs ne pourront statuer uniquement s’ils sont compétents.
Page 86 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 10 – La compétence
Leçon 10
La règle de la compétence répond au principe de séparation des pouvoirs, qui régit cette répartition des
compétences entre les deux ordres autrement dit le juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une requête doit
d’abord déterminer si l’ordre administratif est bien compétent, avant de déterminer quelle juridiction
administrative est compétente. Le juge judiciaire peut parfois être saisi dans certaines hypothèses, puisque
certaines matières relèvent de l’ordre judiciaire comme la propriété immobilière, la liberté individuelle et
l’état des personnes ; on peut avoir un contentieux qui met en cause l’administration mais dont le juge
judiciaire trouvera sa compétence. Si l’examen est indissociable, c’est au Tribunal des conflits d’en ré-
pondre.
I] – Les règles de répartition des compétences entre
les juridictions administratives et judiciaires
Elles sont normalement fixées par la loi (article 34 de la Constitution), mais la loi doit d’abord examiner un
certain nombre d’exigences constitutionnelles. Mais c’est normalement la loi qui procède à cette réparti-
tion, et qu’elle doit être interprétée par la jurisprudence.
A) – La Constitution
Il n’y a pas un grand nombre de loi qui régissent puisque la Constitution détermine seulement la forme et
la constitution des pouvoirs. On a quand même trois principes, dont deux consacrant la compétence judi-
ciaire et un qui s’attarde sur la compétence administrative.
a) La compétence judiciaire
C’est ici tout d’abord un PFRPLR ; il a été consacré par Décision 89-256 dite conforme considère que « les
PFRPLR consacrent l’importance des attributions confiées à l’autorité judiciaire en matière de la pro-
tection de la propriété immobilière ». Autrement dit, le juge judiciaire est le gardien des droits de pro-
priété sur les (choses) immeubles. Même si l’atteinte provient de l’administration, c’est le juge judiciaire
qui sera compétent. Ce ne sont pas toutes les atteintes mais celles qui sont « particulièrement graves ».
Le Conseil constitutionnel parle de « dépossession », et dans TC 2013, Monsieur et Madame Panizzon c/
Commune de Saint-Palais-sur-Mer parle « d’extinction ». En outre, l’autorité judiciaire n’est compétente
constitutionnelle que pour le contentieux de la réparation. Selon l’article 66 de la Constitution, « nul ne
peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect
de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La question s’est aussi posée concernant les mesures
d’assignation à résidence dans le cadre de l’état d’urgence relevait ou non de l’article 66, en tant que
mesure de police. Cela porte atteinte à la liberté individuelle de l’article, mais est-ce lié à la détention
arbitraire ? Non, selon le Conseil constitutionnel. C’est d’ailleurs pour cela que le juge administratif était
compétent. Une situation qui ne dépasse pas 12 h d’astreinte sur 24 h n’est pas assimilé à une privation
de liberté, selon les Sages. Cette assignation ne doit pas être regardée comme une mesure privative de
liberté.
b) La compétence du juge administratif
Page 87 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Dans CC 86-224 (conforme), les requérants ont estimé que confier certaines sanctions à la juridiction ad-
ministratives méconnaissait la séparation des pouvoirs. Les Sages ont en profité pour admettre un PFRPLR
que l’annulation et la réformation des actes prit sur des PPP les décisions des collectivités territoriales
notamment. Le contentieux d’annulation et de réformation des actes administratifs unilatéraux prit par les
autorités publiques (les organes agissant au nom des personnes publiques) exclue des contentieux les
décisions prises par les organismes de droit privé (les SPA à gestion privée). Une loi désormais ne peut
pas venir affecter ces contentieux en méconnaissant la Constitution. Désormais, les matières réservées
par nature à l’autorité judiciaire sont :
- Le droit de propriété immobilière
- L’état des personnes
- La liberté individuelle.
Ils peuvent être (leur contentieux) confier au juge judiciaire parce que nous sommes dans une matière
judiciaire : la liberté individuelle. Lorsque le contentieux d’une même matière susceptible de relever
des deux ordres, comme le contentieux de la concurrence peut être administratif lorsqu’il s’agit de con-
tester une décision de l’ancienne Autorité de la Concurrence. Et si c’est un abus de position dominant, en
engageant la responsabilité d’une autre entreprise, le législateur pourra confier le contentieux d’une
décision administrative au juge judiciaire.
B) – La loi
Le législateur, dans le respect de ces règles est compétent, d’après l’article 34 de la Constitution. Les règles
de répartition des compétences entre les deux ordres relèvent du législateur avec la Constitution. Il peut
qualifier un établissement public gérant un SPA comme un EPIC, menant à un contentieux judiciaire et
cela par décret, mais ce qui serait contraire à la Constitution ; seul le législateur peut le faire — CE
Ass. 1962, Association Nationale de la Meunerie. La loi, plus ponctuelle est venue préciser la répartition
des compétences et pour occuper le domaine public, il faut une autorisation qui peut être donné par un
AAU, soit par un contrat selon l’article L2031-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques,
qui dispose que « les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection,
de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions légi-
slatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application ». Le législateur est intervenu
cependant pour confier au juge judiciaire le contentieux de certains actes pris par des AAI. Le législateur
peut également intervenir pour confier certains contentieux administratifs en matière de responsabilité.
S’il y a dommage à cause d’un véhicule de l’administration, c’est un contentieux judiciaire parce que le
législateur est intervenu. Le dommage provoqué « par la fourniture de produits sanguins produit par des
établissements publics, ce contentieux relève de la compétence du juge administratif » d’après l’article 15
de l’ordonnance du 1er septembre 2005.
Parfois, c’est même le contentieux de certaines matières qui est confié au juge judiciaire ou administratif.
Par exemple, le contentieux en matière de propriété littéraire et artistique, d’après l’article L « les actions
civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique relèvent du juge judiciaire », les
actions civiles étant les dommages et intérêts. Si la responsabilité d’une personne publique est engagée
afin d’obtenir réparation en cette matière (on estime qu’une personne publique a méconnue les droits
d’auteurs), cette responsabilité est engagée face au juge judicaire : c’est l’application de la loi. Enfin, L242-
8 du Code de la Sécurité sociale indique aussi qu’il s’agit de contentieux judiciaires.
C) – La jurisprudence
Page 88 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Parfois, c’est au juge que revient à déterminer si un contentieux relève ou non de la compétence adminis-
trative ou judiciaire, dans le respect du principe de séparation (loi des 16 et 24 août). Pour y parvenir, il
utilise trois indices qui ne fonctionnent pas à tous les coups, il faut qu’ils convergent :
- L’indice organique
- L’indice fonctionnel
- L’indice matériel.
a) L’indice organique
Si un dommage est produit par une personne morale de droit publique (l’État, les EP, l’autorité publique
indépendante, les groupements publics, les AAI etc.), ce sera le juge administratif qui sera compétent
en principe. Mais si ce sont des personnes privées, physique comme morale, le juge compétent sera judi-
ciaire. Mais s’il s’agit d’une personne publique gérant un SPIC, cela sera quand même la compétence judi-
ciaire.
b) L’indice fonctionnel
Pour déterminer cette répartition, le juge va examiner la nature de la mission qui est à l’origine du litige.
S’il s’agit d’une mission purement privée, ce sera au juge judiciaire que reviendra la compétence. À l’inverse
si elle est administrative (mission de service public ou de police administrative), c’est au juge judiciaire.
1) Les missions de police et de service public
Est-ce une mission de police administrative ou judiciaire ; le critère distinctif est finaliste : si l’opération de
police est destinée à prévenir un trouble à l’ordre public, une opération de police administrative. Si elle
cherche à appréhender une infraction réelle ou supposée, c’est du judiciaire (et donc le juge judicaire). Lors
du suicide d’un jeune placé en cellule car en état d’ébriété et de la demande d’indemnisation de la mère,
l’opération dommageable était la mise en cellule de dégrisement : était-ce pour le punir ou empêcher
qu’il cause d’autres dommages en étant ivre ? L’incarcération est ordonnée par le juge, donc ce n’était pas
une sanction. La compétence juridictionnelle varie en fonction de la finalité des missions de police.
2) Le service public de la justice judiciaire
Si le dommage est provoqué par un SPA : c’est le juge administratif. Sinon, c’est le juge judiciaire avec le
SPIC. Mais concernant le service public de la justice judiciaire, celui-ci relève des deux nomenclatures.
Normalement, c’est devant le juge administratif puisqu’il s’agit d’un SPA, un service public régalien. C’est
pour cela qu’il faut faire une distinction entre les litiges provoqués par l’organisation ou le fonctionne-
ment du service public, en outre le service public de la justice, avec TC 1952, Préfet de la Guyane. Le
contentieux provoqué est ainsi réparti entre les deux ordres ; tout ce qui concerne l’organisation relève
de l’ordre administratif, tandis que tout ce qui concerne le fonctionnement relève de la compétence
judiciaire. TC 2021, la décision litigieuse consistait en l’installation d’une cage en verre, un box au sein
d’une juridiction judiciaire lors d’un procès ; c’est une décision contestée devant le juge judiciaire car elle
relève du fonctionnement du service public. Le deuxième indice est donc celui de la nature litigieuse.
Si les hypothèses divergent, il faut l’indice matériel, la matière, le contenu.
c) L’indice matériel
Le litige a-t-il été produit par une Prérogative de Puissance Publique ? Si tel est le cas, le litige relève du
juge administratif. Sinon, il relèvera de l’ordre judiciaire.
Page 89 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
En matière de responsabilité, si le dommage est causé par un EP qui gère un SPIC, c’est le juge judiciaire
qui s’en occupera sauf s’il y a une PPP (donc l’ordre administratif). Le juge, utilise des indices et le plus
souvent, il n’y a pas de difficulté. Il s’agit souvent d’un contentieux administratif quand l’acte est pris avec
des PPP pour une mission de service public. Les trois indices convergent alors donc le contentieux est bien
administratif. Même s’il s’agit de contester une PPP accomplie par une personne publique pour une mission
pour de service, le juge judiciaire va parfois aussi être compétent car nous seront dans une matière qui
relève de l’autorité judiciaire.
II] – La compétence de la juridiction judiciaire à
l’égard de l’administration
Lors des litiges administratifs, c’est l’ordre administratif qui s’en occupe. Mais certaines matières, certaines
branches du droit, des « domaines » selon le Conseil constitutionnel ou le droit judiciaire est compétent :
le droit immobilier, l’état des personnes et les libertés individuelles et même lorsque le litige est provo-
qué par l’administration, provoqué en fait par une PPP utilisée par une personne publique dans le cadre
de sa mission administrative, dès lors qu’est en cause l’une de ces trois matières, il y a place pour la
compétence judiciaire.
A) – Le droit de propriété (immobilière)
Concernant l’expropriation tout d’abord, il faut suivre une procédure en deux étapes :
- Une première étape, administrative ou il s’agit de déterminer si le projet envisagé est d’utilité pu-
blique, consacré par une déclaration d’utilité publique
- Une seconde étape judiciaire, afin d’assurer cette protection du droit de propriété immobilière.
C’est ainsi que le juge judiciaire est compétent pour prononcer l’ordonnance d’expropriation ; un transfert
de propriété en somme et fixer l’indemnisation. C’est là que s’arrête la capacité judiciaire. Pour les litiges
naissants de cette expropriation, c’est le juge administratif qui en est compétent (d’après la décision Auto-
rité de la concurrence). Par conséquent, l’autorité judiciaire n’est compétente que pour fixer en cas de
litige le montant de l’indemnité à verser à l’exproprié en cas de litige. Il en va de même en matière
réquisitoire et des servitudes d’utilité publique affectant les immeubles. Il s’agit parfois de réquisitionner
l’intégralité de l’immeuble. Une servitude par exemple est l’accueil sur un terrain privé un pylône électrique.
Il y a aussi les propriétés privées qui sont serviées par les axes routiers, de tramways etc et sont indemnisés
en cas de litige par le juge judiciaire. Le juge administratif est compétent pour connaître la légalité de
l’acte administratif, et le juge judiciaire connaît des indemnités pécuniaires en cas d’expropriation ou de
servitudes. L’indemnité en cas d’expropriation est préalable d’ailleurs.
En vertu d’une jurisprudence constante, « les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur
l’existence-même du droit de propriété », pour déterminer qui est le propriétaire d’un bien. Ces ques-
tions de propriété sont des questions préjudicielles. Par exemple, un arrêté municipal pris à l’égard d’un
immeuble en mauvais état (c’est une police spéciale des édifices en ruines), où il peut exiger que des
travaux soient réalisés ou même la démolition de l’immeuble ; c’est un AAU. Il n’y a aucun doute sur la
nature de l’acte. En cas de contestation de la légalité de l’acte, c’est le juge administratif qui est compétent.
Mais contester la propriété du bien devant le juge administratif va revenir à poser la question préjudi-
cielle : qui est le propriétaire ? Seule l’autorité judiciaire est capable de déterminer qui est le proprié-
taire de l’immeuble ? L’autre jurisprudence assure l’emprise irrégulière.
Page 90 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
L’emprise est une atteinte au droit de propriété immobilière et en vertu d’une jurisprudence ancienne,
en cas d’emprise irrégulière, l’autorité judiciaire est compétente pour indemniser les conséquences
dommageables de cette emprise, mais c’est au juge administratif que revient de déterminer l’acte admi-
nistratif à l’origine de cette emprise. C’est pour cette raison que le Tribunal des conflits a permis de
réparer les conséquences dommageables dans la décision TC 2013, Monsieur et Madame Panizzon
c/ Commune de Saint-Palais-sur-Mer. S’il n’y a pas voie de fait, s’il y a seulement cette emprise, le juge
administratif est compétent non seulement pour apprécier la régularité de l’emprise mais aussi réparer
ses conséquences dommageables. On peut considérer, face au Tribunal des conflits silencieux, le juge
judiciaire peut indemniser, mais il est tout à fait possible que le Tribunal mette un terme à cette possibi-
lité, et par la même occasion éteint la théorie de l’emprise irrégulière. Dès lors que l’administration
porte atteinte au droit de propriété sur un immeuble, le juge administratif est compétent pour apprécier
la légalité de l’acte administratif à l’origine de l’atteinte, faire cesser l’acte en question et ordonner à l’ad-
ministration de mettre un terme à l’acte, et il peut lui-même réparer les conséquences dommageables de
l’acte (et de l’emprise).
B) – La liberté individuelle
a) La voie de fait
Le juge administratif en est compétent. Selon la jurisprudence (TC 2013, Monsieur Bergoend c/ Société
ERDF Annecy Léman), la voie de fait est une action de l’administration. Elle peut provenir soit d’une
décision, soit de l’exécution forcée (d’une décision) donc soit dans un acte juridique, soit dans un acte
matériel. Exemple : TC 1935, Société du journal de l’Action française. Deuxième élément : l’action de l’ad-
ministration doit constituer une atteinte aux libertés individuelles, dans le sens de l’article 66 de la Cons-
titution (comme le droit de ne pas être arbitrairement détenu). Si cette atteinte est susceptible de donner
une voie de fait, il faut qu’il y ai une extinction du droit de propriété pour mener les compétences judi-
ciaires et administratives : il faut une dépossession totale et définitive de la propriété. C’est ainsi que
pour réaliser des travaux de voirie, l’administration occupe temporairement un terrain privé pour réaliser
ces travaux, ce n’est pas une voie de fait, il n’y a pas d’extinction du droit de propriété. Enfin, troisième
élément, la voie de fait suppose une illégalité, là où on distingue la voie de fait matérielle ou juridique.
Lors d’un acte matériel, c’est lorsque l’administration pratique une exécution forcée. Dès lors qu’elle utilise
la force, la contrainte irrégulièrement (illégalement), il y a voie de fait. Selon la jurisprudence Saint-Just,
l’administration ne peut utiliser en principe la force que sur autorisation du russe, nous sommes dans un
état de droit mais il existe des exceptions.
- L’administration peut parfois agir d’office sans requérir à l’autorisation du juge lorsque la loi le
prévoit : les forces de l’ordre sont prévues par le Code de la route pour procéder à un contrôle
d’alcoolémie
- L’urgence est une autre exception : on n’attendra pas l’autorisation du juge pour envoyer les pom-
piers.
- Lorsqu’il n’y a pas de répression pénale instituée et qu’il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir l’exécu-
tion de l’acte, l’administration peut procéder à l’exécution forcée sans le juge.
Si l’administration méconnaît cette jurisprudence, cela constitue une voie de fait. Si elle prend sa source
dans une décision cependant, l’irrégularité doit être particulièrement grave. La décision est tellement illé-
gale qu’elle va perdre sa nature administrative : elle perd sa voie de droit au « bénéfice » d’une voie de
fait. Spontanément, un administré qui va subir une atteinte à une liberté individuelle ou une extinction de
son droit de propriété va immédiatement penser au référé-liberté puisque l’administration lui cause un
dommage. Le Conseil d’État a décidé de simplifier la situation du justiciable en 2013, dans CE 2013, Com-
mune de Chirongui.
Page 91 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il y considère que « le juge des référés-libertés peut, en cas d’urgence (si la condition d’urgence est rem-
plie) enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte grave […] de la propriété immobilière
quand bien même il s’agirait d’une voie de fait ». Le justiciable peut désormais plus simplement saisir
le référé-liberté en cas d’atteinte « classique » à son droit de propriété, dans un but de simplification, parce
qu’un justiciable ne peut pas connaître toutes les compétences au sein de l’ordre administratif. Cependant,
la loi exprime que le juge des référés-libertés selon le législateur n’a pas voulu revenir sur la théorie de
la voie de fait, chose que la jurisprudence a contourné par son arrêt, dans un but de simplification.
b) L’hospitalisation des malades mentaux
Le plus souvent, lorsqu’une personne est hospitalisée, c’est à sa demande, sa liberté individuelle est res-
pectée. Mais parfois, la personne peut être hospitalisée sans son consentement soit à la demande d’un
tiers (parent, époux, enfant) soit, en cas de trouble à l’ordre public, il peut être hospitalisé d’office.
Lorsqu’elle est demandée par un tiers, par un proche, c’est le directeur de l’hôpital qui prend la décision.
S’il s’agit d’une hospitalisation d’office, c’est le préfet du département qui prend la décision. Il s’agit
d’une personne publique pour le directeur et une décision au nom de l’État avec le préfet mais l’autorité
judiciaire est compétente :
- Il est compétent pour regarder la légalité de l’hospitalisation, si l’état de la personne justifiait une
telle hospitalisation.
- Mais aussi pour indemniser le cas échéant.
La compétence judiciaire s’étend aux décisions immédiatement prises par les médecins — CE 2012, Centre
Hospitalier Spécialisé Guillaume Régnier. Il s’agissait d’une personne contestant une injection de Ris-
perdal (un neuroleptique prescrit en cas de psychose schizophrénique) de 50 mg tous les quinze jours.
L’individu a contesté cette injection, mais celle-ci est liée à l’hospitalisation d’office. S’il y a un litige pour
les décisions prises par un SPA, ce n’est pas lié à l’hospitalisation : c’est lié au fonctionnement du
service administratif (pour un litige émanant de l’intérieur de l’hôpital). La décision d’un préfet d’abroger
l’arrêté qu’il avait pris ordonnant l’hospitalisation d’office, il peut très bien y avoir un contentieux
émanant cette fois des proches du malade. Dans ce cas, le juge compétent sera déterminé si l’acte d’abro-
gation est attentatoire aux libertés individuelles : non. Elle ne porte pas atteinte à une liberté indivi-
duelle mais fait cesser l’ancienne atteinte, cela relève donc du juge administratif — TC 2006, Président du
Conseil de Paris.
c) Les autres atteintes à la liberté individuelle
C’est l’article 136 du Code de procédure pénal, qui dispose que « il en est de même dans toute instance
civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile
prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité
publique ou contre ses agents ». Ces atteintes sont l’arrestation et la détention arbitraire, ainsi que la
violation de domicile. C’est une atteinte aux libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution.
C) – L’état des personnes
C’est une tradition, l’État est garant de l’état des personnes, donc l’ordre judiciaire est compétent. On
entend l’état de la personne dans la cité, la citoyenneté, dans la famille, par les actes d’état civil et la
capacité juridique de la personne.
a) La citoyenneté
Page 92 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges liés à celle-ci, c’est une question préju-
dicielle : seule l’autorité judiciaire est compétente pour déterminer la nationalité des personnes. Il y
a une précision à apporter cependant : les décrets de nationalisation, qui rapprochent l’état des per-
sonnes. Ce genre de décret (d’apport ou de retrait de nationalisation) est un acte faisant l’objet de con-
tentieux administratif, et en l’espèce puisqu’il s’agit de décret, c’est le Conseil d’État. Autrement, le juge
judiciaire est compétent, y compris des contentieux relevant de l’électorat. Puisque c’est en participant
aux élections que nous sommes citoyens, un contentieux vis-à-vis d’un maire ou d’une erreur, la personne
peut contester et souhaiter des dommages et intérêts : le juge judiciaire est compétent.
b) L’état civil
Il est également compétent des litiges relatifs de l’état civil : article 54 du Code civil.
- Un maire par exemple refuse de célébrer un mariage entre un ressortissant français et étranger.
Il suspecte un mariage blanc et refuse. Les époux contestent, et les futurs mariés décident de
rechercher la responsabilité de la puissance publique : celle de l’État, puisque le maire, officier de
l’état civil agit au nom de l’État. Mais rechercher cette responsabilité se fait devant le juge judi-
ciaire, cela concerne l’état des personnes, et plus précisément l’état civil.
- Un oncle souhaite se marier à sa nièce, consentante mais cela n’est pas possible ; le Code civil
interdit l’inceste. Cependant, il est possible de lever certaines autorisations en demandant l’auto-
risation de se marier au Président de la République. Celui-ci refuse, ils contestent. C’est un acte
du Président mais il n’administre pas, il joue le rôle d’un officier de l’état civil, alors le juge judiciaire
est compétent — CE 2005, Mademoiselle P. et Monsieur S. H.
Toutes ces questions sont préjudicielles.
c) La capacité juridique
L’autorité judiciaire est la seule à se prononcer sur la capacité juridique. Les actes se prononçant sur la
tutelle des mineurs et majeurs protégés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. À l’inverse,
l’agrément qui peut être accordé ou refusé en vue d’une adoption ne concerne pas l’état des personnes
selon la jurisprudence. La contestation du Président du Conseil département relève de la juridiction ad-
ministrative. La question de savoir quel est l’âge de la personne est une question préjudicielle. La ques-
tion peut se poser devant le juge administratif de l’âge du requérant, mais il n’y a aucune difficulté : on
dispose de l’état civil, il s’agit de se renseigner tout simplement, mais la question préjudicielle peut se poser
lorsqu’il s’agit de ressortissant étranger, la question n’est pas inutile, les actes d’état civil peuvent parfois
être faux. Se poser cette question est préjudicielle ; lorsque le juge ne peut pas y répondre, c’est au juge
judiciaire que reviens la compétence. Il peut y avoir également des difficultés à propos de l’application des
règles de répartition des compétences, il peut y avoir des contestations et faire régler celle-ci par les juri-
dictions suprêmes n’était pas possible, remettant en cause ces deux ordres de juridictions. C’est pour cette
raison qu’a été instituée une juridiction spécifique : le Tribunal des conflits.
III] – Le règlement des problèmes de compétences :
le Tribunal des conflits
Il rend aux environs de cinquante décisions par an et la moitié des membres de chacune des juridictions
suprêmes jugent, puis retourne à leurs juridictions.
Page 93 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
A) – Un juge de la compétence
a) Le conflit d’attribution positif
C’est l’arme dont dispose l’administration pour imposer au juge judiciaire le respect du principe de sé-
paration des pouvoirs. Sauf les quelques exceptions connues, le juge judiciaire ne peut pas juger l’admi-
nistration. Elle pourra intervenir par le biais du préfet : c’est lui qui va adresser au Tribunal judiciaire ce
que l’on appelle un déclinatoire de compétence, un acte juridique par lequel il doit décliner sa compé-
tence à l’ordre judiciaire. Une question préjudicielle se posa alors et le juge judiciaire doit se prononcer
sur le déclinatoire de compétence : soit il accepte, soit il refuse, il rejette. Le préfet a la possibilité d’élever
le conflit avec un arrêté de conflit et de saisir le Tribunal des conflits : c’est un conflit entre l’adminis-
tration et le juge judiciaire.
b) Le conflit d’attribution négatif
Il y a tel conflit lorsque les représentants des deux ordres se déclarent tous deux incompétents, au motif
que le conflit relève de l’autre. Par exemple, un dommage subi du fait d’une activité matérielle de police,
une blessure à la suite d’une intervention de police. On va devant le juge administratif parce que le dom-
mage aurait été subi du fait d’une opération de police administrative ; d’où sa compétence. Mais il peut
refuser parce que le dommage relève d’une opération de police judiciaire. Devant le juge civil à la re-
cherche de la responsabilité de l’État, il peut très bien dire que le dommage a été subi lors de l’opération
de police administrative où ils ont essayé d’appréhender quelqu’un mais initialement, c’est adminis-
tratif. Que faire dans ce cas-là ? C’est ici que réside le conflit d’attribution négatif : une juridiction va
déclarer son ordre incompétent au motif que l’autre ordre est compétent, mais l’autre juridiction va en
faire de même. En principe, la seconde juridiction, celle qui va déclencher et provoquer ce conflit doit
saisir le Tribunal des conflits. C’est un mécanisme préventif : « la juridiction saisit en second lieu doit
saisir le Tribunal des conflits ». Mais en cas de négligence, le requérant peut se retrouver coincé, et c’est
lui-même qui va saisir le Tribunal des conflits dans le cadre de ce conflit d’attribution négatif, à
peine un par an. Le Tribunal des conflits, juge de la compétence peut être saisi de manière préventive par
les juridictions des deux ordres, ayant pour objectif d’éviter un tel conflit. Plutôt que d’attendre que le
conflit d’attribution soit constitué, la juridiction elle-même peut saisir le Tribunal des conflits afin qu’il
décide de la compétence, selon le décret de 2015. Le but ici est de régler les problèmes de compétences
en amont, il s’agit ici de favoriser une bonne administration de la justice. Il peut néanmoins statuer au
fond dans certains cas.
B) – Un juge du fond
a) Le règlement des contrariétés de jugements
Il est tout d’abord compétent pour régler les contrariétés de jugement, conformément à l’article 15 du
mai 1872. Il arrive parfois que les juridictions des deux ordres statuent au fond mais que leur jugement
soit contraire ; c’est à l’origine d’un déni de justice. Une telle affaire a suscité une intervention du législa-
teur afin que le Tribunal des conflits puisse se prononcer : c’est l’affaire Rosay, avant la loi de 1957 qui
consacre la compétence judiciaire en matière d’accident de véhicule. Monsieur Rosay est blessé à
l’occasion d’un accident avec un véhicule administratif, dans la voiture d’une connaissance. Il estime que
son préjudice est imputable à l’administration qui était bien compétent, mais le juge administratif répon-
dit que le dommage subi avait été provoqué par le véhicule privé, provoquant un rejet au fond.
Page 94 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Il va alors voir le juge civil, qui répond la même chose mais le dommage aurait été causé par le véhicule
administratif. On a ici deux jugements rendus au fond par les juridictions des deux ordres, il y a bien une
contradiction. C’est l’origine d’un déni de justice : il ne peut pas obtenir réparation. Le législateur est
venu consacrer la compétence du Tribunal des conflits dans une telle hypothèse : le requérant doit
saisir le Tribunal qui va désigner la juridiction du fond. La juridiction engagea non seulement une in-
demnisation de la part de l’État mais aussi la responsabilité civile de l’administration.
b) L’engagement de la responsabilité de l’État
Lorsque la procédure juridictionnelle a été conduite dans les deux ordres et qu’il y a dépassement du
délai raisonnable de jugement, il y a deux cas de figure. Si le délai est dépassé en administration, sa
responsabilité (de l’État) face au Conseil d’État est engagée. Dans CE 2019, Monsieur C., il s’agissait du
licenciement d’un salarié protégé. S’il y a litige, ce sont les Prud’hommes qui sont compétents, mais un tel
licenciement est autorisé par le Code du travail ou le ministre : la mesure peut être à la fois contesté
face au judiciaire comme à l’administration. Dans cette affaire, le litige avait duré presque dix ans. Le
Tribunal des conflits est venu engager la responsabilité de l’État : lorsqu’il s’agit d’un dommage résultant
du dépassement du délai raisonnable de jugement avec les deux ordres, c’est le Tribunal qui est compétent
et en l’espèce, il a condamné l’État à verser 4 000 €. Et si c’était le Tribunal des conflits ? C’est du jamais vu,
il doit juger et statuer vite, et il est souvent saisi d’un conflit d’attribution positif ou d’une question de
compétence, avec un litige qui attend au fond.
Page 95 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Chapitre 11 – Les contentieux (administratifs)
Il y a plusieurs manières de les distinguer, comme un contentieux objectif (de la légalité) ou subjectif (des
droits du sujet). On peut également les classer selon le pouvoir du juge. On va ici distinguer le contentieux
de l’acte administratif unilatéral, du contrat administratif et le contentieux de la responsabilité extracon-
tractuelle de l’administration.
I] – Le contentieux de l’acte administratif unilatéral
L’Acte Administratif Unilatéral peut être contesté directement comme indirectement.
A) – Le contentieux direct
Il s’agit ici d’exercer le recours contentieux directement contre l’AAU. On va saisir ici directement le juge,
le plus souvent pour un Recours pour Excès de Pouvoir (REP) et demander au juge d’annuler l’AU parce
qu’il est illégal, mais on peut aussi le saisir d’un recours de plein-contentieux, et demander au juge de
réformer l’AU s’il est illégal. Le préfet, ici est habilité à déférer au Tribunal administratif les AAU prit par les
autorités décentralisées. La jurisprudence considère que ce déféré préfectoral est un REP. On parlera
désormais ici de recours contentieux, à savoir tous les recours dirigés (REP, plein-contentieux et Déféré
Préfectorale) contre l’administration. Le juge administratif ne peut apprécier la légalité d’un AU qu’il est
compétent et pour cela, il faut en déterminer la nature. Le juge administratif ne sera compétent que s’il
s’agit d’un AAU, mais cela ne suffit pas. Avant d’examiner et d’apprécier le recours au fond, le juge doit
déterminer si le recours est tout d’abord recevable, il y a des règles de recevabilité à respecter : compé-
tence, recevabilité et fond.
a) La recevabilité du recours
Ces règles concernent à la fois l’acte attaqué, le requérant, le délai mais également la requête. On verra
en effet que les textes de la jurisprudence refusent que n’importe qui conteste n’importe quoi n’im-
porte quand, le requérant, la requête et le délai.
1) Les conditions de recevabilité de l’acte attaqué
Quels actes administratifs qui peuvent faire l’objet d’un tel recours ? Essentiellement le REP. CE Sect. 2020,
GISTI rappelle que le Conseil d’État affirme dans cet arrêt que le recours contentieux, en l’espèce le REP est
recevable contre tous les actes administratifs susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou
la situation d’autres personnes chargées, le cas échéant de les mettre en œuvre. Un AAU ne peut faire
l’objet d’un tel recours que s’il fait grief ; s’il n’y a pas de grief il n’y a pas d’action. Un AAU va produire
un grief s’il produit des effets notables, et cela sera le cas s’il s’agit par exemple d’un acte administratif
décisoire, l’acte a un caractère impératif. La règle de droit s’impose en l’espèce à ses destinataires et
peut faire l’objet d’un recours contentieux. Non seulement les actes décisoires peuvent faire l’objet d’un
tel recours, mais également les actes de droit souple. C’est le cas, selon le Conseil d’État en 2020 des lignes
directrices, qui ont remplacés les directives administratives ; elles orientent sans lier, afin d’assurer la co-
hérence lorsque l’administration est en situation de pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, le Recours-Con-
tentieux (RC) est recevable. Il est également recevable contre les circulaires, les recommandations, les ins-
tructions, les présentations et interprétations du droit positif dès lors que celles-ci ont des effets no-
tables, d’après la jurisprudence GISTI.
Page 96 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le Conseil d’État a jugé une recommandation de l’AMF que le RC était recevable contre cette recom-
mandation, qui n’interdisait pas aux investisseurs d’acheter ces produits-là. Le préfet peut même faire
« plus que nous ». Le déféré préfectoral est recevable contre des actes ne pouvant pas faire l’objet de
recours contentieux de la part des administrés. Il est recevable contre :
- Les actes préparatoires — CE 1996, Syndicat CGT des Hospitaliers de ?
- Contre les vœux délibérés par les collectivités territoriales. Précision cependant concernant les
sanctions prises par l’administration : elles peuvent toujours faire l’objet d’un recours conten-
tieux. Ces sanctions vont évidemment griefs. S’il s’agit d’une sanction disciplinaire, à l’encontre
d’un agent, d’un fonctionnaire, il faut faire un REP. S’il s’agit d’une sanction administrative, à l’égard
d’un administré comme le retrait de point, il faut former un recours de plein-contentieux.
2) Les conditions de recevabilité relatives au requérant
Il ne peut saisir le juge que s’il dispose de la capacité à agir. Autrement, le recours est irrecevable. Le jeune
mineur ou le majeur incapable ne peuvent pas saisir le juge. Concernant les personnes morales, on ne
s’attardera qu’à celles de droit public, qui sont exclusivement des personnes morales, le juge ne peut être
saisir que par un organe de cette personne. Concernant l’État, il est représenté en justice par le Ministre
si le litige relève des administrations centrales, et par le préfet si le litige relève des administrations décon-
centrées. Concernant les collectivités territoriales (commune, département et région) de même que les
établissements publics, l’organe habilité à saisir le juge est leur organe exécutif, avec une autorisation de
l’organe délibérant :
- Le maire doit être autorisé par le Conseil municipal
- Si l’université veut saisir le juge, c’est son Président qui va saisir le juge après autorisation du
Conseil d’administration.
Mais le requérant doit également avoir un intérêt à agir : le préfet a en l’espèce toujours un intérêt à agir
puisqu’il agit au nom de l’État et dans le respect de la légalité. Il en va différemment pour les administrés.
On ne peut pas attaquer n’importe quoi ; la jurisprudence n’autorise pas tout et n’importe quoi. La qualité
de citoyen ne permet pas d’attaquer toutes les mesures administratives prises. La qualité de contribuable
de l’État ne donne pas non plus cette qualité d’attaquer un acte qui augmente les dépenses, et donc les
impôts ; c’est une qualité trop générale. En revanche, à l’égard des actes locaux — CE 1901, Casanova, la
« qualité de contribuable local donne intérêt à agir contre toutes les mesures prises par les autorités
locales susceptible d’augmenter les dépenses, donc la fiscalité locale ». CE 1916, Syndicat des proprié-
taires et contribuables du quartier de Croix-de-Seguey-Tivoli. Usager du service public de transport en
commun, on peut contester et formuler un recours-contentieux et même s’il s’agit d’un SPIC, ce sont des
Mesures Administratives Réglementaires. S’il y a modification des horaires ou du tarif du tramway, il y a un
intérêt (économique) à agir. La qualité d’usager potentiel suffit — CE 1958, Sieur Abisset, en l’espèce
une décision prise par le maire interdisant de camper au sein de sa ville. Le campeur, les campeurs sont
concernés, ils sont potentiellement intéressés à camper sur un terrain vert en ville, et cela suffit pour
pouvoir exercer un REP.
Mais est-ce que le recours contentieux peut-il être exercé au nom d’un intérêt collectif, avec une associa-
tion par exemple ? Peut-elle contester un acte administratif qui porte atteinte à son objet social ? Un syn-
dicat peut-il effectuer un tel recours contre un AU qui porterait atteinte à la profession défendue par
ce syndicat ? Oui, totalement. Une association comme un syndicat peut attaquer un AU qui porterait
atteinte à sa situation, à son existence (comme un arrêté prononçant sa dissolution), mais il peut également
agir pour défendre l’intérêt collectif qui est le sien : CE 1916. Le Conseil d’État estime qu’une association
de la loi 1901 a la qualité de rester en justice et est recevable d’exercer un REP en vue de défendre l’intérêt
collectif des usagers du service public. Dans CE 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, le Conseil
d’État étend cette solution aux syndicats.
Page 97 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Encore faut-il que cet intérêt collectif ne soit pas défini trop largement, ou encore CE 1983, Association
SOS-Défense, dont le créateur, Monsieur Bertin avait attaqué un décret affectant les modalités de forma-
tion des avocats en vue de la jurisprudence de 1906, ce que le Conseil d’État refusa. Mais pour apprécier
d’un point de vue pratique, l’intérêt à agir du requérant, il faut déterminer la catégorie d’administré visé
par l’acte, et il faut se présenter comme appartenant à cette catégorie. Un SDF par exemple forme un
recours contentieux en tant que qualité de SDF contre un décret allant à l’encontre des propriétaires de
chien : ce n’est pas sa qualité de sans domicile fixe qui était concernée par l’acte, mais celle de posséder
un chien et il faut se présenter comme tel, appartenant à cette catégorie. Lors d’un recours allant à
l’encontre d’un permis de construire, lorsque le RC est ainsi dirigé, il créé des droits au profit d’un admi-
nistré, la jurisprudence est plus rigoureuse. En l’espèce, le fait d’habiter la même commune que le permis
est trop général. Tout dépend de la taille de la construction comme celle d’un immeuble. Si on est plus ou
moins proche du futur immeuble, cela peut jouer. Ce que le juge regardera précisément sera s’il y a nui-
sance visuelle ou sonore. Autrement, il n’y a pas d’intérêt : le recours est irrecevable.
3) Le délai
On ne peut pas attaquer un décret règlementaire par exemple trois voire quatre ans après sa fixation. Si
ce décret accorde des bourses par exemple, quatre ans après, celles-ci auront été largement versées. La loi
fixe donc le délai de contestation des AAU dans un délai en principe de deux mois à partir du moment
où le délai est déclenché, à savoir la publicité, qui conditionne l’opposabilité de l’acte, alors que la
signature de l’acte qui concrétise l’existence de l’acte. En ce qui concerne les décisions expresses,
implicites elles peuvent être réglementaire par exemple. S’il s’agit d’une décision expresse et réglemen-
taire, la date du déclenchement du délai correspond à la date de la publication. Cette publication se
fait désormais exclusivement par voie électronique d’après le Code des Relations entre le Public et l’ad-
ministration. Cela vaut même pour le Journal Officiel. Concernant les décisions individuelles, le délai ne
va courir qu’à partir de la réception de l’acte et uniquement vis-à-vis de la personne.
Pour les tiers, cette signification fera l’objet d’une publication, comme le permis de construire ou la nomi-
nation des agents publics de manière à faire courir le délai des tiers. Si l’acte n’est pas publié ou si la
publicité n’a pas été réalisée régulièrement, la conséquence est que le délai ne s’en retrouve pas en-
clenché. Par exemple, lorsque l’administration notifie un Acte Administratif Individuel, elle doit notifier les
délais et les voies de recours. Sans cela, le délai ne court pas, incitant l’administration à bien notifier
régulièrement (à comprendre normalement). Mais cela veut-il dire pour autant que l’acte peut être attaqué
à tout moment ? Cela a été le cas pendant un moment, mais ce n’est plus le cas ; le Conseil d’État décidé
de faire bénéficier l’administration du principe de sécurité juridique. Le Conseil d’État a en effet jugé
que malgré la notification irrégulière de l’AAI ne peut pas être attaqué irrégulièrement, mais dans un
délai raisonnable : un an à partir de la connaissance part l’administré de la décision — CE 2016,
Czabaj.
Lors de l’attaque du silence de l’administration à une demande qui lui a été faite, la décision implicite, il y
a beaucoup plus d’exception en principe que le principe général. Il va falloir attaquer ici la décision implicite
le jour de la naissance de cette décision. Il faut déterminer su c’est une décision implicite d’acceptation
(mais surtout) de rejet, tandis que l’administration doit accuser réception des demandes qui lui sont
faites. Cet accusé de réception doit comporter certaines mentions, décrit à l’article R112-5 du Code des
Relations entre le Public et l’administration, qui dispose que « L'accusé de réception prévu par l'article
L112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à
défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. […] 2° La désignation, l'adresse
postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ».
Une fois le délai enclenché, le délai de recours contentieux est en principe de deux mois.
Page 98 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Mais puisqu’il s’agit d’un recours contentieux, il est réellement de deux mois et un jour. Si la décision
implicite arrive le 17 mai (un mois à partir d’aujourd’hui), le recours contentieux est possible jusqu’au 18
juillet (deux mois et un jour) à 23h59. Si c’est le cas, le recours est autorisé jusqu’au dernier jour ou-
vrable : si le 18 juillet est un dimanche, le recours sera accepté jusqu’au lundi 19 juillet à 23h59. Le délai
peut aussi être prorogé, distingué de la prolongation. Si dans le délai du recours contentieux se retrouve
un recours administratif préalable, le délai de recours contentieux repart pour deux mois. Si le recours
contentieux est possible jusqu’au 18 juillet, on peut effectuer un recours administratif préalable le 10
juillet (recours gracieux ou un recours hiérarchique). Sans réponse au bout de deux mois, la décision
implicite de rejet a lieu le 10 septembre, et le recours contentieux est acceptable jusqu’au 12 no-
vembre (un mois et 1 jour, mais le 11 novembre est férié : donc le 12 novembre 23h59). Le préfet quant à
lui peut demander au maire d’une ville de fournir des documents destinés à connaître les informations sur
le trafic routier (c’est le recours administratif préalable) puis de réformer ou non la décision du maire.
4) La requête
Pour être recevable, le recours doit être rédigé en français. Sinon, il doit être traduit : sinon, il est irrece-
vable. En raison de la généralisation des procédures dématérialisées, qui permettent de transmettre la
requête au greffe par voie électronique, il convient de la dactylographier. Il faut y joindre la copie de la
décision attaquée ou de l'accusé de réception en cas de décision implicite. La requête doit comporter des
conclusions. Les conclusions sont ce qui est demandé au juge. La requête doit aussi expliquer les raisons
de fait et de droit qui justifient la demande. Ce sont les moyens. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir,
on les désigne encore comme étant les cas d'ouverture du REP. Seuls des moyens de légalité peuvent être
invoqués, à l'exclusion des moyens d'opportunité. Ces moyens se répartissent en deux causes juridiques :
les moyens de légalité externe, qui concernent l'aspect extérieur de l'acte, et les moyens de légalité interne,
qui concernent l'aspect interne de l'acte.
b) Les moyens du recours
Les moyens de légalité constituent deux poses juridiques. Il y a les moyens de légalité externe comme
interne. Les moyens externes concernent les moyens extérieurs à l’acte.
1) Les moyens de légalité externe
- Il y a tout d’abord l’incompétence. Il l’est lorsque l’autorité administrative n’a pas respecté une
règle de compétence. Une mesure de police qui vise à réduire la nuisance sonore de la cloche
d’une église décidée par le Conseil municipal tient en réalité du maire : c’est un moyen d’ordre
public qui peut être soulevé n’importe quand, que cela soit en appel ou après le délai ; le juge
doit toujours vérifier si l’autorité administrative était bien compétente.
- Ensuite, il y a les vices de procédure lorsque l’administration n’a pas suivi intégralement la procé-
dure à respecter, essentiellement en cas de procédure consultative. L’autorité est obligée de con-
sulter l’organisme consultatif mais n’est pas obligé de le suivre ; s’il n’y a aucune consultation,
l’AU est entaché d’un vice de procédure.
- Le vice de forme. Certains actes administratifs doivent respecter une certaine forme, notamment
certaines décisions administratives qui doivent être motivées, comme les décisions défavorables
ou dérogatoires. Lorsque l’administration prend une sanction administrative, elle doit la motiver.
Si l’administration ne respecte pas cette obligation, ou qu’elle l’a motivé insuffisamment, l’acte
est entaché d’un vice de forme. L’administration doit de même mentionner la signature de
l’auteur mais en dehors, elle doit aussi mention l’auteur de l’acte, son nom, son prénom et sa
qualité.
Page 99 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Ces moyens sont-ils susceptibles pour autant de mener à un recours ? L’incompétence oui évidem-
ment. Mais il y a de plus en plus de règles de procédure et de forme. Admettons que la consultation ai
eu lieu un peu tard ou quelques personnalités étaient absentes. Pour de si petites irrégularités, l’acte
administratif ne tombera pas forcément. Le Conseil d'État estime ainsi que « si les actes administratifs
doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements,
un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire
ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier
qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a
privé les intéressés d'une garantie ». (CE Ass. 2011, Monsieur Danthony).
Les vices de forme et de procédure ne sont donc sanctionnés que s'ils ont été susceptibles d'exercer
une influence sur le sens de la décision prise ou s'ils ont privé les intéressés d'une garantie. L'annu-
lation n'est encourue qu'en cas de privation d'une garantie. Cela signifie là encore qu'il faut un vice
d'une certaine gravité. C'était le cas dans l'affaire Danthony : le défaut de consultation d'un comité
technique paritaire préalablement à la création d'un nouvel établissement public, par fusion de deux
établissements existants avait privé les personnels d'une garantie. De même, l'insuffisance de motiva-
tion de l'avis de la commission cinématographique, à la lumière duquel le ministre accorde le visa d'ex-
ploitation en interdisant éventuellement la diffusion du film à certains publics, « est susceptible d'exer-
cer une influence sur la décision du ministre et de priver les différents intéressés d'une garantie au
regard des limitations à la liberté d'expression que constitue toute mesure restreignant la diffusion
d'une œuvre cinématographique » (CE 2012, Association Promouvoir). Le visa d’exploitation attribué
au film « Antichrist » réalisé par Lars bon Trier, avec interdiction aux mineurs de 16 ans, a ainsi été
annulé.
2) Les moyens de légalité interne
Les moyens de légalité interne critiquent non pas la manière dont l'acte a été pris, mais son contenu.
- Le premier moyen de légalité interne concerne le but de l'acte attaqué. C'est le détournement
de pouvoir. L'autorité administrative commet un détournement de pouvoir lorsqu'elle agit dans
un but différent que celui que lui assigne la règle de droit. Le juge administratif examine ce
moyen depuis CE 1875, Pariset dans lequel le Conseil d'État annule la décision d'un préfet de
fermer la fabrique d'allumettes du requérant, au motif que cette décision n'avait pas eu pour
but les intérêts que les lois et règlements sur les établissements dangereux, incommodes et
insalubres ont pour objet de garantir, mais l'intérêt purement financier de l'État, qui, par cette
fermeture administrative, pouvait acquérir la fabrique d'allumettes à un prix plus bas.
o L'une des modalités du détournement de pouvoir est le détournement de procédure
intentionnel : l'autorité administrative utilise une procédure à la place d'une autre afin
d'atteindre un certain but. C'est ce qu'illustre l'arrêt CE Ass. 1960, Société Frampar.
- Le deuxième moyen de légalité interne concerne le contenu-même de l'acte attaqué. C'est la
violation directe de la règle de droit, encore appelée parfois la violation de la loi. La norme
contenue dans l’acte attaqué est ainsi directement contraire à une norme supérieure.
- Deux autres moyens de légalité interne sont relatifs aux motifs de droit de l'acte. Les motifs
de droit sont les raisons juridiques qui ont justifié l'édiction de l'acte. Ces moyens sont le dé-
faut de base légale et l'erreur de droit.
o Un acte est entaché de défaut de base légale lorsque, pour l'édicter, l'autorité adminis-
trative s'est fondée sur une règle inapplicable. C'est le cas, par exemple, lorsque l'admi-
nistration édicte un acte administratif sur le fondement d'une loi contraire à un enga-
gement international et dès lors inapplicable.
o Un acte est entaché d'erreur de droit lorsque, pour l'édicter, l'autorité administrative s'est
fondée sur la règle applicable, mais l'a mal appliquée.
Page 100 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
- Les moyens de légalité interne peuvent enfin concerner les motifs de fait de l'acte, c'est-à-dire
les faits qui ont justifié son édiction. C'est d'abord le cas de l’erreur de fait.
o Il s'agit d'un vice qui concerne l'exactitude matérielle des faits et que le juge contrôle
depuis CE 1916, Camino.
o C'est ensuite le cas de l’erreur de qualification juridique des faits, qui est censurée par le
juge administratif depuis CE Gomel, 1914.
c) Les effets de recours
Le recours contentieux n'a pas d'effet suspensif : l'acte attaqué demeure exécutoire et continue de
pro dire ses effets. Pour faire échec au caractère exécutoire de l'acte, il faut demander la suspension
de son exécution au juge administratif des référés. Si l'acte est légal, le recours contentieux n'est pas
fondé. Le juge le rejette et l'acte est maintenu. En revanche si l'acte est entaché d'un des vices précé-
demment évoqués, il est annulé par le juge administratif. L'annulation provoque normalement la dis-
parition rétroactive de l'acte illégal, qui est donc réputé n'être jamais intervenu. Conscient que le
caractère rétroactif de l'annulation est susceptible de remettre en cause la stabilité des situations juri-
diques qui se sont constituées, le Conseil d'État a décidé de reconnaître au juge administratif le pouvoir
de moduler dans le temps les effets de l'annulation. C'est l'apport de CE Ass. 2004, Association A.C.
En l'espèce, le Conseil d'État avait été saisi de recours dirigés contre sept arrêtés du ministre des Af-
faires sociales portant agrément d'avenants aux conventions d'assurance chômage des 1er janvier
2001 et 1er janvier 2004. Le Conseil d'Etat ne pouvait que constater l’illégalité de ces arrêtés en raison
du non-respect d'une formalité substantielle : le Comité supérieur de l'emploi avait été consulté ir-
régulièrement.
Le juge devait donc prononcer l'annulation de ces arrêtés. Toutefois, leur disparition rétroactive aurait
risqué de mettre à bas le système d'assurance-chômage. Le Conseil d'État décide donc de remettre en
cause l'effet systématiquement rétroactif de l'annulation. Si le principe du caractère rétroactif de l'an-
nulation demeure, il peut désormais faire l’objet d’une dérogation. Le juge peut décider, si l’intérêt
général l’exige, que certains effets de l’acte qu'il annule ne seront pas remis en cause. Il peut soit
prononcer annulation en limitant ses effets à la date de sa décision (l’abrogation), soit en différer les
effets à une date postérieure à cette décision (l’abrogation différée). L'exercice de ce pouvoir de
modulation dans le temps des effets de l'annulation concerne principalement les actes réglementaires,
car l’annulation rétroactive de ces actes peut avoir de graves conséquences sur les situations juri-
diques constituées sur leur base. Mais il peut aussi concerner des actes individuels. L'annulation de la
nomination d'un magistrat a ainsi été prononcée à l'expiration d'un délai de trois mois, en raison des
conséquences qu'une annulation rétroactive aurait produit sur les jugements et les procédures aux-
quels ce magistrat avait concouru (CE Sect. 2010, Monsieur Marc Robert).
B) – Le contentieux indirect
a) Un contentieux administratif
Le contentieux indirect de l'acte administratif unilatéral est normalement un contentieux relevant de
la compétence du juge administratif de l’excès de pouvoir. Il peut d'abord être provoqué par un recours
en appréciation de légalité. Mais une contestation indirecte de l'acte administratif est également pos-
sible dans le cadre d'une exception d'illégalité. Il faut ici distinguer selon que l'acte est ou non régle-
mentaire.
- Pour l'acte réglementaire, une contestation « peut être formée par voie d'exception à l'appui de
conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de
Page 101 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale » (CE Ass. 2018, Fédération
des finances et affaires économiques de la CFDT).
- « S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque,
même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte » (CE Sect. 2013, Ma-
dame Okosun). L'exception d'illégalité est donc perpétuelle contre un règlement.
- Il est ainsi possible de contester le refus de l'administration d'accorder une bourse universi-
taire en invoquant, par la voie de l'exception, la légalité du décret réglementant les modalités
d'attribution des bourses, même si ce décret a été publié depuis plusieurs années. Ce refus est
alors illégal si le règlement qui lui sert de fondement est lui-même illégal. Le décret est ainsi
contesté indirectement par voie d'exception. Le requérant peut alors obtenir du juge l'annula-
tion du refus, et demander ensuite à l'administration d'abroger le décret qui lui sert de fon-
dement car l'administration est dans l'obligation d'abroger les règlements illégaux (article L
243-2 du CRPA).
Cette contestation indirecte de l'acte réglementaire « peut aussi prendre la forme d'un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l’acte réglementaire » (CE Ass. 2018,
Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT). En effet, dans la mesure ou l’administra-
tion doit abroger les règlements illégaux, il suffit pour un requérant de demander à l'autorité adminis-
trative d'abroger un tel règlement puis, en cas de refus, d'exercer un REP contre cette décision de
refus. Ainsi saisi, le juge annulera cette dernière si le règlement dont l'abrogation a été demandée est
illégal. Cette contestation conduit nécessairement le juge à apprécier indirectement la légalité du rè-
glement. Les moyens de légalité pouvant être invoqués dans de tels contentieux indirects sont-ils les
mêmes que ceux qui peuvent l'être dans un contentieux direct ? La réponse à cette question est néga-
tive : « si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire,
la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement
critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de
procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour
excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai
de recours contentieux ».
Les moyens de légalité externe que sont le vice de procédure et le vice de forme ne peuvent donc pas
être soulevés dans le cadre de la contestation indirecte de l'acte réglementaire. Ainsi, un règlement
en vigueur depuis longtemps ne peut pas tomber sans raison valable, c'est-à-dire pour des raisons de
forme ou de procédure. La contestation indirecte de l'acte non-réglementaire est plus encadrée.
D'abord, l'exception d'illégalité n'est possible que dans le respect de deux conditions.
- La première est commune à l'acte réglementaire : « l'illégalité d'un acte administratif, qu'il
soit ou non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de
conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision
a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale » (CE Sect.
2013, Madame Okosun). Il convient donc que les deux décisions soient liées.
- La seconde condition est particulière à l'acte non-réglementaire : alors que l'exception d'illéga-
lité est perpétuelle contre les règlements, l'acte non-réglementaire ne peut être contesté par
voie d'exception que dans le délai du recours contentieux ouvert contre lui (CE Sect. 2016,
Commune d'Emerainville), et si le délai n'a pas été déclenché car l'acte n'a pas été régulière-
ment notifié, l'exception d'illégalité ne peut être invoquée que dans un délai raisonnable qui
est en principe d'un an à compter de la date à laquelle le requérant a connaissance de l'acte
(CE 2019, Monsieur A.).
« L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non-réglementaire non créateur
de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait posté-
rieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé » (article L243-2, alinéa 2 du CRPA).
Page 102 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Un justiciable a donc la possibilité de demander à l'administration, sur le fondement de cette dispo-
sition d'abroger un acte administratif non-réglementaire non créateur de droits devenu illégal si cette
illégalité perdure. Et il doit pouvoir, si l'administration refuse de faire droit à sa demande, contester
cette décision de refus devant le juge. Ce dernier est alors nécessairement conduit à apprécier indi-
rectement la légalité de l'acte non-réglementaire. Dans toutes les hypothèses précédemment envisa-
gées, la contestation indirecte de l'acte administratif unilatéral a lieu devant le juge administratif de
l'excès de pouvoir. Mais cette contestation est également possible devant le juge administratif du
plein-contentieux. Il en va ainsi lorsqu'un requérant lui demande d'engager la responsabilité pour
faute de l'administration pour réparer les conséquences dommageables d'un acte administratif illégal.
b) Un contentieux judiciaire
1) Le juge civil
Le contentieux indirect de l'acte administratif unilatéral relève exceptionnellement de la compétence
du juge judiciaire. Normalement, dans le respect du principe de séparation des autorités administra-
tives et judiciaires, cet acte ne peut pas être contesté devant lui. Ainsi, lorsque se pose devant le juge
judiciaire la question de savoir si un acte administratif est légal ou illégal, il doit surseoir à statuer et
poser une question préjudicielle au juge administratif. C'est le recours en appréciation de légalité.
L'inconvénient de cette solution est qu'elle provoque inévitablement un allongement de la durée du
procès. Il peut alors être opportun d'appliquer le principe de plénitude de juridiction du tribunal saisi
en permettant à ce dernier d'apprécier l'acte administratif. La question n'est alors plus préjudicielle ;
c’est une question préalable. La compétence du juge judiciaire varie selon que ce juge statue en ma-
tière civile ou en matière pénale. La compétence du juge civil est très limitée, dans la mesure où il ne
peut qu'interpréter l'acte administratif réglementaire (TC 1923, Septfonds). Cela signifie a contrario
qu'il ne peut pas apprécier la légalité d'un acte administratif, qu'il soit réglementaire ou individuel,
et qu'il ne peut pas non plus interpréter un acte administratif individuel. Ce sont pour lui des questions
préjudicielles qu'il doit poser au juge administratif.
Par TC 2011, SCEA du Chéneau c/ INAPORC, le Tribunal des conflits, tout en confirmant le principe
de la jurisprudence Septfonds lui apporte deux dérogations. Il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel de-
vant le juge administratif « lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie que la
contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ». Il n'y a pas non plus lieu à renvoi
préjudiciel devant le juge administratif « lorsque la contestation incidente concerne la conformité
d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ». Spécifique au Droit de l’Union Européenne,
cette seconde dérogation est destinée à assurer la pleine effectivité de ce droit. Parce que la confor-
mité d'un acte administratif au Droit de l’Union Européenne peut donc être appréciée par le juge
administratif – du contentieux direct – et par le juge judiciaire – du contentieux indirect – des divergences
ne sont pas à exclure.
2) Le juge pénal
La compétence du juge pénal est prévue par la loi : « Les juridictions pénales sont compétentes pour
interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité
lorsque, de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis » (article 111-5 du Code
pénal). Le juge pénal peut donc interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs. Il s'agit
souvent d'actes réglementaires, car de tels actes peuvent déterminer des incriminations et des peines.
Mais il peut aussi s'agir d'actes individuels. Il doit également, lorsqu'il est saisi de poursuites dirigées
contre une personne poursuivie pour non-respect de l'assignation à résidence prononcée contre elle,
apprécier la légalité de l'arrêté prononçant cette assignation (Cass. Crim. 2017).
Page 103 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
II] – Le contentieux du contrat administratif
En raison de la nature administrative du contrat, ce contentieux relève de la compétence du juge
administratif. Il peut être provoqué par les parties au contrat ou par les tiers au contrat.
A) – Le contentieux provoqué par les parties au con-
trat
Le contentieux provoqué par les parties au contrat relève du juge du plein-contentieux. C'est le plein-
contentieux contractuel, dont l’évolution a été provoquée à la suite d'un litige ayant opposé les com-
munes de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers. Dans le cadre d'une opération d'extension d'une zone
industrielle intégralement située sur le territoire de Villeneuve-lès-Béziers, les deux communes si-
gnèrent une convention prévoyant que la seconde verserait à la première une fraction des sommes
perçues au titre de la taxe professionnelle, afin de tenir compte de la diminution de recettes entraînée
par la relocalisation dans la nouvelle zone industrielle d'entreprises jusqu'ici implantées sur le terri-
toire de Béziers. Après dix années d'exécution, la commune de Villeneuve-lès Béziers décida de rési-
lier la convention. Saisi par la commune de Béziers d'une demande tendant à ce qu'il condamne la
commune de Villeneuve-lès-Béziers à lui verser une indemnité, le juge administratif, constatant des
irrégularités prononça l'annulation de la convention. Saisi du litige, le Conseil d'État décida, par CE
Ass. 2009, Commune de Béziers – dit Béziers I – de faire évoluer l'office du juge du contrat. Il indique
d'abord que les parties peuvent saisir ce dernier soit pour contester la validité du contrat, soit pour
régler un litige relatif à l'exécution du contrat.
a) Le contentieux de la validité au contrat
Saisi d'un recours de plein-contentieux contestant la validité du contrat, il appartient au juge, « lors-
qu'il constate l'existence d'irrégularités d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir
vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à
l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui » (Béziers I). Ainsi, dans notre
affaire, le Conseil d'État considéra que « les circonstances que la retranscription dans le registre des
délibérations de la délibération autorisant le conseil municipal de Villeneuve-lès-Béziers à signer la
convention litigieuse soit incomplète, que le registre n'ait pas été signé par l'intégralité des conseil-
lers municipaux présents sans qu'il soit fait mention de la cause ayant empêché les autres conseillers
de la signer, que ce registre porte la signature d'un conseiller municipal absent et que le tampon
relatif à l'affichage de l'extrait de registre ne porte pas la signature du maire ne sauraient caractériser
un vice d'une particulière gravité » (CE 2015, Béziers III).
- Si l'illégalité est plus grave, sans qu'elle soit pour autant de nature à remettre en cause le con-
trat, le juge peut autoriser la poursuite de l'exécution du contrat après que des mesures de
régularisation ont été prises.
- Si l'illégalité est encore plus grave, le contrat doit disparaître. Le juge peut prononcer sa rési-
liation, c'est-à-dire sa disparition pour l'avenir, laquelle peut avoir un effet différé. Plus excep-
tionnellement, il doit provoquer la disparition rétroactive du contrat en prononçant son annu-
lation. Il peut également annuler certaines stipulations du contrat lorsqu'elles en sont divisibles.
b) Le contentieux de l’exécution au contrat
Lorsque les parties soumettent au juge du contrat « un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie
», le juge doit en principe faire application du contrat et régler le litige dans le cadre contractuel.
Page 104 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Le juge du contrat doit alors régler le différend entre les parties au regard du contrat qu'elles se sont
données. Voici ce que le requérant peut lui demander.
1) Un contentieux contractuel
1. L’action en dommages et intérêts
Le requérant peut engager devant le juge du contrat la responsabilité contractuelle de son cocon-
tractant en lui demandant de condamner ce dernier à lui verser une somme d'argent. Il peut s'agir
d'une responsabilité contractuelle pour faute, c'est-à-dire pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat. Les conditions de cette responsabilité sont alignées sur celles de la responsabilité extracon-
tractuelle : le demandeur doit établir l'existence d'une faute – que le juge administratif qualifie généra-
lement de « manquement » – d'un préjudice, et d'un lien de causalité. La faute peut venir de l'adminis-
tration. Il peut aussi s'agir d'une responsabilité contractuelle sans faute. C'est d'abord le cas lorsque
joue la théorie du fait du prince. Le fait du prince est en effet un comportement qui, tout en étant
dommageable n'a pas un caractère fautif. C'est également le cas lorsque l'administration modifie ou
résilie un contrat dans un but d'intérêt général.
2. L’action en reprise des relations contractuelles
Longtemps, le juge n'acceptait que de condamner l'administration à verser au cocontractant des dom-
mages et intérêts car il se refusait de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration à
l'encontre de son cocontractant. Cette solution était choquante à l'égard de la décision de résilier le
contrat car cela permettait à l'administration de se défaire, même de manière irrégulière d’un cocon-
tractant dont elle ne voulait plus, à condition d’en payer le prix. Le Conseil d’État a donc décidé, par
son CE Sect. 2011, Commune de Béziers, dit Béziers II d'instituer l'action en reprise des relations
contractuelles. Le Conseil d'État y rappelle d'abord le principe : « le juge du contrat, saisi par une partie
d'un litige relatif à une mesure d’exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si
cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ».
Mais il assortit le principe d'une exception : « toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu
égard à la portée d’une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein-
contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations
contractuelles ». La décision de résilier le contrat est, en raison de sa portée, seule susceptible de voir sa
validité contestée. Ce n'est pas le cas de la décision de non-reconduction d'une convention d'occupa-
tion du domaine public tacitement reconductible et arrivée à échéance, qui ne peut par conséquent
qu'ouvrir droit à une indemnité. En permettant au cocontractant de demander la reprise des relations
contractuelles, le Conseil d'État offre une alternative à l'indemnisation. Le cocontractant peut en effet
préférer la poursuite de l'exécution du contrat, en particulier lorsque l'échéance de ce dernier est éloi-
gnée et porte sur une ressource rare. Il en va souvent ainsi pour les contrats portant occupation du do-
maine public.
3. L’action en rétablissement de l’état antérieur du contrat
Si la contestation de la décision de résilier un contrat ne peut normalement déboucher que sur une
indemnisation, il en va de même en principe si la contestation porte sur la décision de modifier le
contrat. Cette solution s'explique là encore en raison de la portée d'une telle mesure qui, comme la
résiliation ne laisse pas intact le contrat. Elle permet au juge du contrat d'imposer à l'administration
d'exécuter le contrat tel qu'il existait avant d'être modifié.
Page 105 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
La Cour administrative d'appel de Lyon a cependant refusé de faire sienne cette solution puisqu'elle
considère que le juge de l'exécution du contrat, « saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure
d'exécution du contrat autre qu'une résiliation, peut seulement rechercher si cette mesure est inter-
venue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité » (CAA Lyon, 2014). L'état du droit est
donc incertain. Le Conseil d'État devra lever cette incertitude.
2) Un contentieux extracontractuel
Si le contentieux relatif à l'exécution du contrat doit en principe être réglé dans un cadre contractuel,
il en va différemment lorsque le contrat – que le juge doit normalement appliquer – est entaché d'une
irrégularité particulièrement grave. Le juge doit alors annuler le contrat et régler le litige sur un terrain
extracontractuel. C'est ce que souligne le Conseil d'État dans l'arrêt Béziers I : « dans le cas seulement
où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère
illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relative notamment aux condi-
tions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut
régler le litige sur le terrain contractuel ». Le juge doit écarter le contrat dans les deux hypothèses qui
permettent d'obtenir l'annulation du contrat lors d'une contestation de la validité du contrat, avec
ce caractère illicite du contenu du contrat, un vice d'une particulière gravité. À l'inverse, si le contrat
est entaché de l'un des vices mentionnés, il est écarté. Il n'est alors pas possible d'engager la respon-
sabilité contractuelle de l'administration puisque le contrat est considéré comme n'ayant jamais
existé. Le cocontractant peut alors prétendre, « sur un terrain quasi-contractuel au remboursement de
celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé » (CE 2017,
Société Cegelec Perpignan).
Il s'agit d'appliquer la théorie de l'enrichissement sans cause. En outre, lorsque le contrat est écarté en
raison d'une faute de l'administration, le cocontractant peut demander le paiement des sommes cor-
respondant au bénéfice auquel il pouvait prétendre, mais seulement « sous réserve du partage de
responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes », et dans la mesure où « l'indemnité à
laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure
à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ». En principe, seules les parties au contrat peu-
vent saisir le juge du contrat à l'exclusion des tiers. C'est une conséquence du principe de l'effet relatif
des contrats. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Le contentieux du contrat peut donc aussi être
provoqué par les tiers au contrat.
B) – Le contentieux provoqué par les tiers au contrat
a) Devant le juge du plein-contentieux
Certains contrats peuvent avoir des effets sur les tiers. Ces tiers « intéressés » sont d'abord les concur-
rents évincés à l'égard du contrat pour lequel leur candidature n'a pas été retenue. Mais ce sont aussi
les contribuables locaux à l'égard des marchés passés par les collectivités territoriales, ou les associa-
tions de protection de l'environnement à l'égard des contrats susceptibles d’entraîner des consé-
quences environnementales. Ne serait-il pas souhaitable que ces tiers puissent saisir le juge du contrat
? Le Conseil d'État répond affirmativement à cette question. Après avoir adopté cette solution à l'égard
des concurrents évincés de la procédure de passation d'un contrat administratif (CE Ass. 2007, So-
ciété Tropic), puis à l'égard des préfets lorsqu'ils dirigent leur déféré contre un contrat administratif
(CE 2011, Ministre de l'Intérieur), le Conseil d'État l'adopte à l'égard de tous les tiers : « tout tiers à
un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et
certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours
Page 106 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de ses clauses non réglementaires qui en
sont indivisibles » (CE Ass. 2014, Département de Tarn-et-Garonne). Peuvent donc saisir le juge du
contrat non seulement les concurrents évincés ou les préfets, mais aussi les associations, les contri-
buables locaux, les membres des organes délibérants des collectivités territoriales, les consomma-
teurs ou les usagers du service public. Cette voie de recours concerne tous les contrats administratifs,
et notamment les marchés publics et les contrats de concessions, à l'exception des contrats de droit
privé en raison de l'incompétence du juge administratif. Le requérant peut conclure à l'annulation
totale ou partielle du contrat, à sa résiliation ou à la modification de certaines de ses clauses, mais il
peut aussi présenter des conclusions tendant à l'indemnisation de droits lésés.
1) Le recours contestant la validité du contrat
1. La recevabilité
Afin d'éviter que cette incursion des tiers dans le contentieux contractuel ne menace la stabilité des
relations entre les parties au contrat, seuls les tiers susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts « de
façon suffisamment directe et certaine » peuvent saisir le juge. L'objectif est ici de protéger le contrat
de tiers parfois très actifs mais insuffisamment concernés, comme peuvent l’être certaines associations
ou certains contribuables locaux. Le Conseil d'État décide en outre de lier les moyens invocables à
l'intérêt à agir car les tiers au contrat ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt
lésé dont ils se prévalent. Une association de protection de l'environnement ne peut donc pas invoquer
un vice tiré de la procédure de passation du contrat. Il en va différemment pour ces requérants privi-
légiés que sont, d'une part, les membres de l'organe délibérant des collectivités territoriales – il s'agit
souvent en pratique des membres de l'opposition au sein de cet organe, et d'autre part le préfet.
En effet, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge – la défense de l'intérêt de la collectivité
territoriale pour les premiers ; la défense de la légalité pour le second, ces requérants peuvent non
seulement toujours saisir le juge, mais ils peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi
défini. Quel que soit le requérant, ce recours de plein-contentieux doit être exercé « dans le délai de
deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées » (CE Ass. 2014,
Département de Tarn-et-Garonne). Cette publicité peut notamment consister dans la publication d'un
avis faisant état de la signature du contrat et de la possibilité de le consulter dans le respect des
secrets protégés par la loi. Le requérant peut également accompagner le recours contre le contrat
d'une demande de suspension en référé (CE Ass. 2014, Département de Tarn-et-Garonne).
2. L’office du juge
Le juge du contrat dispose des pouvoirs du juge du plein-contentieux, tels qu'ils ont été précisés par
la jurisprudence Béziers I. Selon CE Ass. 2014, Département de Tarn-et-Garonne, il appartient au juge
du contrat, « lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les
conséquences ». Il lui revient alors, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de
décider de la poursuite de l'exécution du contrat, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de
régularisation, soit de résilier ou d'annuler le contrat. Le juge ne peut provoquer la disparition du
contrat qu'en présence d'une irrégularité ne pouvant pas faire l'objet d'une régularisation et ne per-
mettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. Il doit également vérifier que sa décision ne porte
pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Il peut alors prononcer la résiliation du contrat, éven-
tuellement avec un effet différé, ou prononcer la modification de certaines clauses du contrat. Mais
il peut aussi, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice du consentement ou de
tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit relever d'office, prononcer l'annulation to-
tale ou partielle du contrat.
Page 107 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
2) Le recours tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat
Dans le prolongement de la jurisprudence CE Ass. 2014, Département de Tarn-et-Garonne, « un tiers à
un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et
certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat,
est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit
mis fin à l'exécution du contrat » (CE Sect. 2017, Syndicat mixte de promotion de l'activité trans-
manche). Il s'agit ici pour un tiers au contrat, après avoir demandé à l'autorité administrative de rési-
lier un contrat de contester dans le délai de deux mois la décision refusant cette résiliation en formant
devant le juge du contrat un recours de plein-contentieux tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution
de ce contrat. Afin d'éviter une inopportune immixtion des tiers dans les relations entre les parties
au contrat, l'intérêt à agir est apprécié strictement et les moyens susceptibles d'être invoqués sont
limités. En effet et d'une part, le tiers au contrat doit « être lésé dans ses intérêts de façon suffisam-
ment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exé-
cution du contrat ». Cette exigence ne s'applique pas à ces requérants particuliers que sont les
membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriales et le préfet, au regard des intérêts dont
ils ont la charge.
D’autre part, le tiers au contrat ne peut soulever « que les moyens tirés de ce que la personne publique
contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables
aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obs-
tacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la
poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général ». On peut penser,
pour illustrer ces différentes hypothèses à une loi nouvelle venant limiter la durée de contrats en cours,
ou à un contrat dont le contenu est illicite, ou encore à une méconnaissance des obligations contrac-
tuelles portant atteinte au principe de continuité du service public. Le juge dispose d'un pouvoir
d'injonction puisqu'il peut ordonner la résiliation du contrat. Pour éventuellement prononcer cette
mesure, il doit tenir compte de la nature des moyens soulevés, c'est-à-dire des irrégularités commises
et de l'intérêt général qu'il peut y avoir à poursuivre l'exécution du contrat. Il peut, par exemple prendre
en compte la situation financière de la personne publique, le versement d'une indemnité de résilia-
tion pouvant affecter cette situation (CE 2017, Commune de La-Teste-de-Buch).
b) Devant le juge de l’excès de pouvoir
1) La recevabilité du REP contre les actes détachables du contrat
Si le REP est en principe irrecevable contre les contrats, il l'est en revanche lorsqu'il est dirigé par les
tiers contre les actes préalables à la conclusion d'un contrat et qui en sont détachables. Désormais, «
la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la
décision de le signer, ne peut être contestée » par les tiers au contrat que devant le juge du contrat
(CE Ass. 2014, Département de Tarn-et-Garonne). Cela a pour conséquence de leur fermer la voie du
REP contre les actes précités. Toutefois, cette voie de droit n'est pas fermée pour tous les tiers. En
effet, « dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'État dans le département est rece-
vable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion
du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ». Le REP
demeure donc recevable au profit du préfet. Cette voie de droit n'est pas non plus fermée contre tous
les actes relatifs à la conclusion du contrat. En effet, « les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels
l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à con-
tester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du
contrat ».
Page 108 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi d'un recours dirigé contre un acte détachable du con-
trat, il prononce, si le recours est fondé l'annulation de cet acte. C'est alors qu'il « appartient à la
personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge les conséquences à tirer de cette annula-
tion, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte ». Si le REP est dirigé contre un acte
détachable d'un contrat de droit privé conclu par une personne publique et que le juge de l'excès de
pouvoir prononce l’annulation de cet acte, il appartient à l'administration de saisir le juge du contrat,
c'est-à-dire ici le juge judiciaire afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable sur
le contrat lui-même (CE Sect. 1994, Époux Lopez). Le juge administratif peut à cette fin prononcer une
injonction à l'encontre de l'administration, injonction éventuellement assortie d'une astreinte.
2) La recevabilité du REP contre certains contrats
Si le REP est en principe irrecevable contre les contrats administratifs, il existe deux exceptions à ce
principe. D'abord, le REP est recevable lorsqu'il est dirigé contre les clauses réglementaires d'un contrat
administratif. Si le REP est donc parfois possible contre certains contrats, ces contrats doivent néces-
sairement avoir un caractère administratif. Le REP n'est jamais possible contre les contrats de droit
privé même s'ils sont conclus par l'administration, car le juge administratif est ici incompétent. Si le REP
est fondé, le juge prononce l'annulation du contrat ou des dispositions contractuelles illégales.
c) Devant le juge des référés
1) Le référé précontractuel
Les tiers intéressés peuvent aussi saisir le juge administratif des référés. Le Président du tribunal ou
son délégué peut d'abord être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise
en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats administratifs. Ces contrats corres-
pondent pour l'essentiel aux contrats de la commande publique, marchés publics et contrats de con-
cession (article L. 551-1 et 5 du CJA).
1. Recevabilité
Le juge du référé précontractuel peut être saisi par les personnes ayant un intérêt à conclure le contrat
et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que par le représentant de
l'État dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement
public local (article L. 551-10 du CJA). En dehors du préfet, il s'agit donc principalement des candidats
évincés à l'exclusion des organisations professionnelles ou des contribuables. Les concurrents évincés
ne peuvent être lésés que s'ils ont présenté une offre régulière. Statuant en la forme des référés, le
juge « est saisi avant la conclusion du contrat » (article L. 551-1 et 5 du CJA). Cela signifie non seulement
que le juge doit être saisi avant que le contrat ne soit signé, mais aussi que la signature du contrat
met un terme aux pouvoirs du juge, ce qui n'est pas contraire à la Constitution (CE 2013, Société
Novergie). C'est pour cela que cette procédure d'urgence est qualifiée de « précontractuelle ». De ma-
nière à éviter une course à la signature, le contrat ne peut plus être signé à compter de la saisine du
juge et jusqu'à la notification à l'administration de la décision juridictionnelle (article L. 551-4 et 9
du CJA). La suspension est donc automatique.
2. Office du juge
Le juge du référé précontractuel peut « ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses
obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat » ; il
peut en outre « annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les
Page 109 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations
» (article L. 551-2 du CJA). Il exerce ici un « contrôle de pleine juridiction » (CE 2006, SABTP). Le juge
du référé précontractuel peut utiliser ses pouvoirs ultra petita, c'est-à-dire au-delà de la demande. Le
Conseil d'État considère en effet qu'il peut annuler une procédure de passation d'un marché public ou
d'une délégation de service public alors même que le requérant sollicitait seulement sa suspension.
Cette procédure est exclusivement destinée à censurer les illégalités affectant la publicité ou la mise
en concurrence, comme un manquement au principe d'impartialité ou au principe d'égalité entre les
candidats. À l'inverse, le juge ne censure pas l'incompétence de l'organe délibérant pour choisir le
futur cocontractant au terme de la procédure. Si le juge du référé précontractuel ne peut plus utiliser
ses pouvoirs lorsque le contrat est signé, il est en revanche possible de saisir le juge du référé contrac-
tuel.
2) Le référé contractuel
1. Recevabilité
Ce référé est ouvert contre les mêmes contrats et aux mêmes personnes que le référé précontractuel.
Toutefois, à la différence de ce dernier, il est ouvert alors que le contrat a été conclu. Il est complé-
mentaire au référé précontractuel dans la mesure où il ne peut plus être exercé lorsque l'autre l'a
déjà été. Cette procédure est en effet fermée au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel
dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue et s'est conformé à la décision
juridictionnelle rendue. Le juge du référé contractuel doit être saisi au plus tard le trente et unième
jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou la notification de la conclusion du
contrat. Toutefois, si ces formalités – publication et notification – n'ont pas été accomplies, la juridiction
peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la
conclusion du contrat. Avec ce référé, la signature du contrat n'est donc plus un obstacle à ce que
soient immédiatement sanctionnés les manquements les plus graves aux obligations de transpa-
rence et de mise en concurrence. Cependant, le contrat a été signé et la situation n'est donc plus celle
qui existait lorsqu'il s'agissait de statuer dans le cadre du référé précontractuel. Cela n'est pas sans
incidence sur l'office du juge.
2. Office du juge
Le juge du référé contractuel peut d'abord prononcer la suspension de l'exécution du contrat pour la
durée de l'instance (article L551-17 du CJA). Il peut ensuite priver d'effet le contrat en le faisant dis-
paraître, soit rétroactivement en prononçant son annulation (article L551-18 CJA), soit seulement
pour l'avenir en prononçant sa résiliation (article L551-19 CJA). Cette disparition peut même avoir un
effet différé pour laisser le temps à l'administration d'organiser une nouvelle procédure de passation
(CE 2011, Société DPM Protection). Le juge doit notamment prononcer l'annulation du contrat
lorsqu’aucune des mesures de publicité requises n'a été prise ou lorsqu’à été omise une publication,
pourtant nécessaire au Journal officiel de l'Union Européenne (article L551-18 CJA). Si le juge du référé
contractuel doit normalement faire disparaître le contrat, il peut néanmoins maintenir le contrat si
une « impérieuse raison d'intérêt général » le justifie (CE 2011, Société DPM Protection). Il peut alors
prononcer « une sanction de substitution consistant en une sanction financière ou une réduction de la
durée du contrat ». Dans cet arrêt, le juge administratif inflige une pénalité financière de 10 000 € à un
hôpital. Les sanctions financières, qui peuvent s'élever à 20 % du prix HT du montant du contrat
(article L551-22 CJA), sont versées au Trésor public. Pour déterminer la mesure qui s'impose, « le juge
du référé contractuel peut prendre en compte, notamment la nature et l'ampleur de la méconnaissance
constatée, ses conséquences pour l’auteur du recours ainsi que la nature, le montant et la durée du
contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur » (CE 2011, Société DPM Protection).
Page 110 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
III] – Le contentieux de la responsabilité adminis-
trative
A) – La saisine
a) La décision préalable
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » (article R421-
1 du CJA). Si cette règle ne pose pas de problème dans le contentieux de l'excès de pouvoir – et dans
le plein-contentieux objectif – car il s'agit de contester une décision qui existe déjà, il en va différemment
dans le plein-contentieux de la responsabilité. Elle implique que les personnes qui estiment pouvoir
engager la responsabilité de l'administration doivent saisir la personne juridique responsable du
dommage d'une demande tendant au versement d'une indemnité. Le juge administratif ne peut en-
suite être saisi que d'un recours dirigé contre la décision, expresse ou implicite rendue par l'autorité
administrative sur la demande d'indemnisation.
b) Le délai de recours
Le juge administratif doit être saisi dans le délai de deux mois du recours contentieux (article R421-1
du CJA). Le délai est déclenché à la date de la notification de la décision rejetant la demande d'indem-
nisation si cette décision est expresse (CE Avis 2021) et à la date de la naissance de la décision implicite
de rejet, si l'autorité administrative ne répond pas à la demande d'indemnisation. En effet, le silence
gardé par l'administration pendant deux mois vaut rejet de la demande « si la demande présente un
caractère financier sauf en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret » (article L231-4,
3° du CRPA). Si la décision de rejet est expresse, elle doit mentionner les délais et les voies de recours.
Le délai est d'une durée de deux mois francs. Il peut être prolongé ou prorogé dans les conditions
que l'on connaît. Passé le délai, le requérant est forclos. Il doit donc, dans le délai saisir le juge d'une
requête.
B) – La requête
a) Les conclusions
La requête doit d'abord contenir des conclusions. Les conclusions sont ce qui est demandé par le
requérant. Ce dernier demande ici au juge administratif de condamner une personne juridique à lui
verser une indemnité. Le montant de l'indemnité doit être chiffré. La personne visée par la demande
est généralement une personne morale de droit public : État, collectivité territoriale, établissement
public. Mais il peut aussi s'agir d'une personne morale de droit privé : personne privée chargée de
gérer un service public ou entrepreneur de travaux publics. La personne responsable n'est pas tou-
jours facile à identifier. Il peut en aller ainsi lorsqu'un organisme est en situation de dédoublement
fonctionnel. Ainsi, le refus fautif d'un maire d'inscrire deux enfants sur la liste des enfants de la com-
mune soumis à l'obligation scolaire engage la responsabilité de l'État, car le maire agit ici au nom
de l'État. Il peut en aller de même lorsque le service à l'origine du dommage n'est pas doté de la
personnalité juridique, c’est-à-dire s'il s'agit d'un service de l'État ou d'une collectivité territoriale,
car certaines structures administratives sont susceptibles d'agir au nom de ces personnes morales.
Page 111 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Tanguy Chauvin – Droit administratif II, par Pierre Serrand (L2/S4)
Par exemple, pour réparer les dommages consécutifs aux dysfonctionnements d'un foyer d'héberge-
ment pour femmes en détresse, quelle est la collectivité publique responsable, sachant que la création
de ce foyer a été autorisée par un arrêté préfectoral, sa gestion est assurée par un département, son
directeur est nommé par l'État, et son financement procède d'une dotation de l'État ? Le Conseil
d'État estime que c'est la responsabilité du département qui doit être recherchée, car « il appartient
à la personne publique gestionnaire d'un service public non doté de la personnalité morale d'assu-
mer la réparation des conséquences dommageables de carences ou dysfonctionnements de ce ser-
vice » (CE 2008, Madame Marin). Par conséquent, « la responsabilité d'une personne publique qui ne
gère pas le service mais contribue seulement à son financement ou en assure la tutelle ne pourrait
être recherchée qu'à raison des fautes commises dans ses missions de financement et de tutelle » (CE
2008, Madame Marin). Le requérant doit, dans sa requête, fournir au juge administratif tous les élé-
ments permettant d'établir la responsabilité de l'administration et d'apprécier le bien-fondé de la
demande. La requête doit ainsi établir la faute ou, plus généralement, le fait à l'origine du préjudice. Il
est possible de produire des attestations, des photographies ou des constats d'huissiers. La requête
doit aussi établir l'existence et l'étendue du dommage subi. Il est fréquent de produire ici des factures
ou des certificats médicaux. Si les éléments sont insuffisants, il est possible de demander au juge de
prononcer une mesure d'instruction, notamment une expertise, éventuellement par une procédure de
référé. Pour obtenir les intérêts de la somme éventuellement mise à la charge de l'administration, il
faut en faire la demande expresse dans la requête.
b) La cause juridique
La requête doit également contenir une cause juridique. La cause juridique est au recours indemni-
taire de plein-contentieux ce que les moyens de légalité externe et interne sont au REP. Elle peut être
définie comme « le statut juridique sous la protection duquel la victime entend se placer pour engager
la responsabilité de la puissance publique et obtenir réparation du préjudice souffert », selon René
Chapus. Dans le contentieux de la responsabilité extracontractuelle, la jurisprudence distingue deux
principales causes juridiques : la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute.
- La responsabilité sans faute étant d'ordre public, ces règles ne sont pas réversibles. Le requé-
rant peut en effet rechercher la responsabilité sans faute de la puissance publique en tout état
de la procédure. En outre, dans le silence de la requête, le juge doit examiner d'office si cette
responsabilité peut être engagée. Par conséquent, si le juge administratif rejette la requête, il est
supposé avoir considéré que la responsabilité sans faute de l'administration ne pouvait pas
être engagée.
- Le juge peut également estimer que la requête est fondée et condamner l'administration à
réparer le préjudice de la victime. Il peut encore, si le dommage procède d'un comportement
fautif qui perdure, ordonner à l'administration de mettre un terme à ce comportement (CE
2019, Commune de Chambéry). L'administration doit s'exécuter en versant l'indemnité pré-
vue. Si ce n'est pas le cas, le créancier de la personne publique peut utiliser la procédure de
contrainte prévue par l'article Ier de la loi n° 80- 539 du 16 juillet 1980 (article L911-9 du CJA).
- Si l'étude de cette procédure relève du droit du contentieux administratif, elle confirme que le
droit administratif, même dans son aspect contentieux, apparaît de plus en plus comme un droit
protecteur des administrés.
Page 112 – Cliquez ici pour retourner au sommaire
Vous aimerez peut-être aussi
- À la découverte de la justice pénale: Paroles de juristeD'EverandÀ la découverte de la justice pénale: Paroles de juristePas encore d'évaluation
- Introduction Au Droit (Version CDocument10 pagesIntroduction Au Droit (Version CAppia KouablanPas encore d'évaluation
- Cours-Institutions Judiciaires-Assas L1Document49 pagesCours-Institutions Judiciaires-Assas L14w6rwmm8h9Pas encore d'évaluation
- Droit Cours010116 3Document23 pagesDroit Cours010116 3mariezaine217Pas encore d'évaluation
- Cours Examen Intro DroitDocument14 pagesCours Examen Intro DroitIssam DehmaniPas encore d'évaluation
- Droit Cours 1ereDocument26 pagesDroit Cours 1ereElsa MagninPas encore d'évaluation
- Droit Administratif AES L2Document10 pagesDroit Administratif AES L2Mounaoir AbdallahPas encore d'évaluation
- Cours N°4 - Les Sources Du Droit Objectif Algérien.Document5 pagesCours N°4 - Les Sources Du Droit Objectif Algérien.wakil wakilPas encore d'évaluation
- Synthese Droit AdmDocument97 pagesSynthese Droit AdmlahouassaPas encore d'évaluation
- Droit Des TICDocument8 pagesDroit Des TICal.wPas encore d'évaluation
- L2S3 BL Droit Administratif 2018 2019 3Document17 pagesL2S3 BL Droit Administratif 2018 2019 3Anna MPas encore d'évaluation
- Droit Chap 2Document3 pagesDroit Chap 2juliefakraPas encore d'évaluation
- Introduction Au Droit PublicDocument35 pagesIntroduction Au Droit PublicLysaaPas encore d'évaluation
- La Théorie de La Loi-Écran Ou Écran-Législatif - Fiches - CoursDocument9 pagesLa Théorie de La Loi-Écran Ou Écran-Législatif - Fiches - CoursMorriya BodeletPas encore d'évaluation
- Droit-Administratif CompletDocument74 pagesDroit-Administratif CompletAmeziane LachevrePas encore d'évaluation
- Module de Droit Civil 1ere AnneeDocument21 pagesModule de Droit Civil 1ere AnneeYah Daouda DiarraPas encore d'évaluation
- Cours 1ére Année BTS CompletDocument48 pagesCours 1ére Année BTS Completad734749Pas encore d'évaluation
- Contentieux ConstitutionnelDocument17 pagesContentieux ConstitutionnelwyzychuigunsPas encore d'évaluation
- Séance 4 Droit ConstitutionnelDocument9 pagesSéance 4 Droit ConstitutionnelloodgydieudonnePas encore d'évaluation
- Notion DroitDocument6 pagesNotion DroitIlhame HizounePas encore d'évaluation
- Chapitre 2, Les Sources Et L'agencement Des Règles de DroitDocument6 pagesChapitre 2, Les Sources Et L'agencement Des Règles de Droittati0123Pas encore d'évaluation
- Expose de Droit AdministratifDocument9 pagesExpose de Droit AdministratiflesaintsegnorPas encore d'évaluation
- Fiche 1 Les Sources de Droit NationalesDocument6 pagesFiche 1 Les Sources de Droit NationalesketsiaboketshuPas encore d'évaluation
- Droit Civil p1ch1 Section 2 Source de La Règle de DroitDocument12 pagesDroit Civil p1ch1 Section 2 Source de La Règle de Droitenzo ZoestarPas encore d'évaluation
- Legislation ScolaireDocument32 pagesLegislation ScolaireRAHERY HajatianaPas encore d'évaluation
- Les Sources DT ObjDocument10 pagesLes Sources DT ObjHana Ben BrahimPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Les-Wps OfficeDocument7 pagesChapitre 1 - Les-Wps Officetraore0797Pas encore d'évaluation
- Revision Galop D'essaieDocument97 pagesRevision Galop D'essaieferrassofia1Pas encore d'évaluation
- Quest Ce Que La ConstitutionDocument5 pagesQuest Ce Que La ConstitutionVirginie DiaconoPas encore d'évaluation
- Cours 2Document4 pagesCours 2rubencorreia655Pas encore d'évaluation
- Sources de La Règle de DroitDocument27 pagesSources de La Règle de Droitbernadette-cynthia.koutsing-kuitchePas encore d'évaluation
- Résumé Action Administrative S3Document15 pagesRésumé Action Administrative S3sim100% (1)
- Cours de Droit Civil 2021Document64 pagesCours de Droit Civil 2021Kingx EmmvnuelPas encore d'évaluation
- Fondamentaux Du DroitDocument61 pagesFondamentaux Du DroitFrancesco AgassoussiPas encore d'évaluation
- Droit Civil Semestre 1Document55 pagesDroit Civil Semestre 1Justine. jmzPas encore d'évaluation
- Droit s3Document6 pagesDroit s3Mestre Abdelhaq100% (2)
- Droit Constitutionnel - Chap 1.1Document15 pagesDroit Constitutionnel - Chap 1.1EmonacoaPas encore d'évaluation
- Initiation Au Droit 2022 L1 S2 Element N 2eDocument4 pagesInitiation Au Droit 2022 L1 S2 Element N 2eTahiana RazanamiranaPas encore d'évaluation
- Fondamentaux DRT Actu - 2Document57 pagesFondamentaux DRT Actu - 2Matt OvonoPas encore d'évaluation
- Droit Information MasterPro017 DisatnceDocument55 pagesDroit Information MasterPro017 DisatnceMeherzi WalidPas encore d'évaluation
- Introduction A L'Etude Du Droit S3. Prof: Thami BensaidDocument6 pagesIntroduction A L'Etude Du Droit S3. Prof: Thami BensaidLamyâa LahsainiPas encore d'évaluation
- Partie ITitre 2 Les SourcesVODocument84 pagesPartie ITitre 2 Les SourcesVOjmn.elmPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument7 pagesIntroductionAbdlghni RahmouniPas encore d'évaluation
- Résumé D'introductions de Droits PDFDocument25 pagesRésumé D'introductions de Droits PDFA.B SONICPas encore d'évaluation
- Les Sources Modernes de La Règle de DroitDocument12 pagesLes Sources Modernes de La Règle de DroitLoubna OumoussaPas encore d'évaluation
- Chapitre II Les Sources de La Régle de DroitDocument10 pagesChapitre II Les Sources de La Régle de DroitNaoual DoukkaraPas encore d'évaluation
- Document PDFDocument7 pagesDocument PDFDjerougue KennedyPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Esatic LicenceDocument42 pagesCours de Droit Esatic LicenceCoul AdamoPas encore d'évaluation
- Module 7 Introduction Au Droit PDFDocument22 pagesModule 7 Introduction Au Droit PDFArnaud XixonetPas encore d'évaluation
- Cours Droit Complet 2016 (15801)Document28 pagesCours Droit Complet 2016 (15801)Blanche PerrinPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Civil Et ConstitutionnelDocument69 pagesCours de Droit Civil Et Constitutionnelstanymubieme528Pas encore d'évaluation
- Introduction Au DroitDocument4 pagesIntroduction Au DroitYassine IlhamiPas encore d'évaluation
- Dag Vol4Document2 pagesDag Vol4PatienPas encore d'évaluation
- Cours de Droit ENCG-C (S1) 2008-2009: Dossier N°1: La Formation Du Droit de L'entrepriseDocument9 pagesCours de Droit ENCG-C (S1) 2008-2009: Dossier N°1: La Formation Du Droit de L'entrepriseAbderazak KcmPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Administratif (M. Djebbar)Document23 pagesCours de Droit Administratif (M. Djebbar)lahouassaPas encore d'évaluation
- Droit CivilDocument11 pagesDroit Civilayoub khachamePas encore d'évaluation
- Cours 2 - La ConstitutionDocument47 pagesCours 2 - La ConstitutionSamia KarroumiPas encore d'évaluation
- Cours Droit ConstitutionnelDocument33 pagesCours Droit ConstitutionneltitiPas encore d'évaluation
- Le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge nationalD'EverandLe droit international et européen des droits de l'homme devant le juge nationalPas encore d'évaluation
- (Regards Croisés Sur L Économie Vol. 1 Iss. 1) Kolm, Serge-Christophe - Qu'Est-ce Qu'Un Impôt Juste - (2007) (10.3917 - Rce.001.0037) - Libgen - LiDocument15 pages(Regards Croisés Sur L Économie Vol. 1 Iss. 1) Kolm, Serge-Christophe - Qu'Est-ce Qu'Un Impôt Juste - (2007) (10.3917 - Rce.001.0037) - Libgen - Lihamelat benachourPas encore d'évaluation
- Cours de MARD Yaoundé Ebolowa Bertoua 2019 2020Document55 pagesCours de MARD Yaoundé Ebolowa Bertoua 2019 2020AmendaPas encore d'évaluation
- DDHC de 1789Document2 pagesDDHC de 1789Nwyzi.Pas encore d'évaluation
- Droit de L - Homme - Prise de NotesDocument12 pagesDroit de L - Homme - Prise de NotessalaheddinePas encore d'évaluation
- Les Droits de L'enfant: Droit À Une IdentitéDocument2 pagesLes Droits de L'enfant: Droit À Une IdentitéNassim ChraitiPas encore d'évaluation
- Que Sont Les Principes R Publicains Une Contribution Du Conseil Des Sages de La La Cit - Juin 2021 90017Document14 pagesQue Sont Les Principes R Publicains Une Contribution Du Conseil Des Sages de La La Cit - Juin 2021 90017lamiaPas encore d'évaluation
- Le Droit PropriétéDocument19 pagesLe Droit PropriétéTim BonninPas encore d'évaluation
- Droit Administratif GénéralDocument258 pagesDroit Administratif Généralalexia.ifteniePas encore d'évaluation
- Law InterestedDocument53 pagesLaw InterestedAssane DioufPas encore d'évaluation
- TP Structure-1Document7 pagesTP Structure-1patou kapebuPas encore d'évaluation
- Dialnet LasResolucionesJudicialesEnFrancia 4045694Document25 pagesDialnet LasResolucionesJudicialesEnFrancia 4045694Daemia AnubePas encore d'évaluation
- Cours Droit 2021Document180 pagesCours Droit 2021hayhiPas encore d'évaluation
- Etude de DroitDocument1 pageEtude de DroitmohakoPas encore d'évaluation