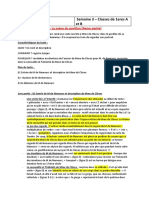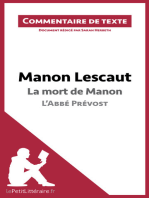Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Fiche de Synthèse de L'aveu, Princesse de Clèves
Fiche de Synthèse de L'aveu, Princesse de Clèves
Transféré par
abdallah amelTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fiche de Synthèse de L'aveu, Princesse de Clèves
Fiche de Synthèse de L'aveu, Princesse de Clèves
Transféré par
abdallah amelDroits d'auteur :
Formats disponibles
Texte N°2 « L’aveu »
Présentation :
Le texte es tiré du roman écrit au XVII eme siècle par Mme de La Fayette en 1678 « Le
Princesse de Clêves ». Il fait partie de ‘objet d’étude « le roman et le récit du Moyen âge au
XXIeme siècle.
Situation :
Le texte est tiré de la troisième partie du roman.
Melle de chartres est une jeune fille de 15 ans venue à Paris pour se marier. Le Prince de
Clêves tombe amoureux d’elle mais ce sentiment n’est pas partagé. Ils se marient. Lors des
fiançailles de la fille du roi, la Princesse de Clêves tombe amoureuse du Duc de Nemours.
Afin d’éviter de tomber dans l’illégitime, la princesse de retire de la cour et se réfugie à la
campagne. Celui-ci la suit et demande les raisons de cela. Elle lui avoue qu’elle aime un autre
homme sans mentionner le nom de cette personne.
Idée générale :
Il s’agit dans ce passage de la scène de l’aveu que la Princesse fait à son époux.
Problématique : Comment l’auteur met-il en scène au travers d’un dialogue argumentatif une
vision malheureuse de la passion amoureuse ?
Ou
En quoi cette scène d’aveu montre-t-elle que Mme de Lafayette et une moraliste.
Mouvements du texte : Cette scène est divisée en 3 parties :
1. L’aveu de La Princesse de Clêves « et bien monsieur … si vous pouvez »
2. Le récit de la réaction de M. de Clêves « M. de Clêves… la relevant »
3. La réponse de Mme de Clèves à la nouvelle qu’il vient d’apprendre.
Mouvement 1, l’aveu de Mme de Clêves :
1. Tout au long de sa prise de parole, Mme de Clêves montre qu’elle reste son époux. →
caractère unique de sa démarche. Elle insiste « aveu » , que l’on n’a jamais fait à son
mari.
→ Ces marques de respect sont exprimées aussi dans la proposition subordonnée
circonstancielle de comparaison : « il faut avoir plus d’amitié et d’estime pour son mari que
l’on est jamais eu » (comparatif de supériorité = démarche unique)
→ Elle valorise également son époux en évoquant son honneur dans l’expression «
pour me conserver digne d’être vous »
2. Mme de Clêves cherche à susciter la pitié de son interlocuteur et à montrer qu’elle est
fragile : « innocence de ma conduite et de mes intentions « ; « les personnes de mon
âge » ; « si j’avais encore Mme de Chartes pour aider à mon conduire » (manque de
soutien).
3. Ambigüité de l’aveu : L’aveu n’est qu’une illusion. Elle promet un aveu mais ne
prononce à aucun moment le nom de celui qu’elle aime.
Cet aveu est davantage une défense que l’aveu d’une culpabilité :
→ Gestuelle « en se jetant à ses genoux »
Elle pose dés le début clairement le sujet du discours : l’aveu.
Elle tente de capter la bienveillance de son mari en donnant une image positive d’elle-même :
champ lexical de l’innocence (âge, pas de soutien) ; champ lexical de la culpabilité.
Elle fait appel à l’émotion de M. de Clêves (mort de sa mère, sa jeunesse et le fait qu’elle
s’inflige elle-même sa peine(le retrait de la cour).
Mouvement 2 :
A l’aveu de la princesse succède un tableau d’une tragédie.
1. Champ lexical de la douleur : « larmes » « mourir de douleur ».
2. La gestuelle est tragique : « la tête appuyée sur ses mains » « … à ses genoux »,
« l’embrassant en la relevant »
Mme de Clêves est bouleversée
Les deux parties de discours (§1, §2) sont comme des répliques de théâtre où les
personnes développent un argumentaire pour se justifier.
Mouvement 3 :
1. Le trouble intérieur de M. de Clêves :
→Champ lexical de la douleur souligne son désarroi « affliction aussi violente » ; « le
plus malheureux homme » ; « vous me rendez malheureux ».
→Vocabulaire tragique accentué par les adverbes intensifs « aussi » ou le superlatif de
supériorité « le plus malheureux homme qui ait jamais été »
→la douleur est réelle que le Prince n’arrive pas à étouffer la jalousie exprimée par
…….. de questions : « Et qui est-il ? Depuis quand vous plait-il ?
2. L grandeur d’âme de M. de Clêves :
→ Il dépasse la jalousie avec grandeur : interrogations.
Il répond de manière ferme par des tournures négatives : « je n’abuserai pas de cet
aveu » → il sort vainqueur.
→Le champ lexical de la vertu dans son discours s’applique à la princesse :
confiance », « sincérité », « prix infini », « manque de fidélité ».
Il semble racheter la Princesse de sa faute.
Les deux personnes sortent ainsi grandes de l’épreuve et dépassent les passions pour
s’élever vers la vertu.
Conclusion :
Cette scène est déterminante dans l’histoire du roman. En effet, un témoin de
cet aveu est caché : M. de Nemours qui se servira de ce qu’il a entendu.
Par ailleurs, nous retrouvons dans cette scène le combat entre la morale et l’amour.
C’est toute la vision que partage Mme de La Fayette dans ses textes: il ne faut pas
succomber à la passion.
Vous aimerez peut-être aussi
- Analyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de ManonDocument4 pagesAnalyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de Manonjunkie20012Pas encore d'évaluation
- Explication Linéaire N°8 - Le Renoncement de La Princesse LPC 3Document4 pagesExplication Linéaire N°8 - Le Renoncement de La Princesse LPC 3blossommadelaine05100% (1)
- Manon Lescaut Première Rencontre Texte CommentaireDocument6 pagesManon Lescaut Première Rencontre Texte Commentaireteste66909Pas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire IDocument3 pagesAnalyse Linéaire Ipaul.pml21100% (1)
- Prevost Manon Lescaut Nous Trouvames Une Miserable CabaneDocument6 pagesPrevost Manon Lescaut Nous Trouvames Une Miserable CabanePatchari DECOCKPas encore d'évaluation
- RESUME Anayse Linéaire La Dernière Entrevue La Princesse de ClèvesDocument2 pagesRESUME Anayse Linéaire La Dernière Entrevue La Princesse de Clèvesloulou100% (2)
- Apollinaire Lettres À Lou'Document570 pagesApollinaire Lettres À Lou'antonio rincon nuñez100% (2)
- PhiloDocument2 pagesPhiloMartin AntechPas encore d'évaluation
- La seconde surprise de l'amour: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLa seconde surprise de l'amour: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Lecture Lineaire 4 La FayetteDocument3 pagesLecture Lineaire 4 La FayetteChrist SarkisPas encore d'évaluation
- LL - L'aveu - PDCDocument5 pagesLL - L'aveu - PDCLaZio Fait Des Jeux VidéosPas encore d'évaluation
- Francais Commentaire RattrapageDocument2 pagesFrancais Commentaire Rattrapage667 X lzPas encore d'évaluation
- Le Monologue IntérieurDocument2 pagesLe Monologue IntérieurAngelo Barroso VazPas encore d'évaluation
- Commentaire AnnaelleDocument4 pagesCommentaire AnnaelleBlanche NeigePas encore d'évaluation
- L'aveu Fiche de FrançaisDocument4 pagesL'aveu Fiche de FrançaisAssilePas encore d'évaluation
- EL8Document4 pagesEL8EmiliePas encore d'évaluation
- Commentaire Texte 4 La Princesse de ClèvesDocument4 pagesCommentaire Texte 4 La Princesse de ClèvesManon MENAGEPas encore d'évaluation
- AdieuDocument3 pagesAdieuhoussen dzoPas encore d'évaluation
- 03 Analyse LineaireDocument4 pages03 Analyse Lineairefifajo5483Pas encore d'évaluation
- EL3 PrincesseDocument11 pagesEL3 PrincesseLil KidPas encore d'évaluation
- Texte 4Document2 pagesTexte 4Mathieu Rakotovao RavahatraPas encore d'évaluation
- La Princesse de Clèves 2Document4 pagesLa Princesse de Clèves 2Adèle DutertrePas encore d'évaluation
- Modele rédigeTEXTE 13 ANALYSE LINÉAIRE Prévost, Manon Lescaut Nous Trouvâmes Une Misérable CabaneDocument8 pagesModele rédigeTEXTE 13 ANALYSE LINÉAIRE Prévost, Manon Lescaut Nous Trouvâmes Une Misérable Cabanea.slaouihabibPas encore d'évaluation
- Clèves-Relecture SC Du RenoncementDocument10 pagesClèves-Relecture SC Du Renoncementleboss23jordanPas encore d'évaluation
- Fiche 2 - Mme de La Fayette Et Bertrand TavernierDocument3 pagesFiche 2 - Mme de La Fayette Et Bertrand TavernierLETUDIANTPas encore d'évaluation
- La Princesse de Clèves LL9Document4 pagesLa Princesse de Clèves LL9Héloïse CampuzanPas encore d'évaluation
- La Princesse de Clèves de Mme de La: Fayette Le Renoncement Au DucDocument4 pagesLa Princesse de Clèves de Mme de La: Fayette Le Renoncement Au DucSanaa MarinaPas encore d'évaluation
- Fiche Dissert LafayetteDocument6 pagesFiche Dissert LafayettecollynenauflePas encore d'évaluation
- 1reT-Texte7-Manon Lescaut-La Rencontre-ExplicationDocument3 pages1reT-Texte7-Manon Lescaut-La Rencontre-Explicationvictor.cisloniePas encore d'évaluation
- La Princesse de Clèves La Scène de L'aveuDocument3 pagesLa Princesse de Clèves La Scène de L'aveuMandresi MorganPas encore d'évaluation
- Texte° 12Document3 pagesTexte° 12monpertuisPas encore d'évaluation
- Dissertation LaPrincesseDeClèves Citation de CamusDocument3 pagesDissertation LaPrincesseDeClèves Citation de CamusmartinPas encore d'évaluation
- Extrait N°3 Commentaire La Princesse de ClèvesDocument4 pagesExtrait N°3 Commentaire La Princesse de ClèvesBelachheb BouchraPas encore d'évaluation
- Étude Linéaire N°3Document3 pagesÉtude Linéaire N°3YAISIEN FatmaPas encore d'évaluation
- Etude Linaire Texte 10 PrincesseDocument14 pagesEtude Linaire Texte 10 PrincessealexiaalmsPas encore d'évaluation
- Document 13Document7 pagesDocument 13Yimko GhomsiPas encore d'évaluation
- Entrainement Dissertation - Manon Lescaut - CorrectionDocument5 pagesEntrainement Dissertation - Manon Lescaut - CorrectionElias GourdinPas encore d'évaluation
- Texte 8 Les Liaisons DangereusesDocument3 pagesTexte 8 Les Liaisons Dangereusesgabrielle.fischercazinPas encore d'évaluation
- Correction Dissertation MLDocument3 pagesCorrection Dissertation MLelissaher07Pas encore d'évaluation
- Explication Linéaire Bac - Manon Lescaut RencontreDocument4 pagesExplication Linéaire Bac - Manon Lescaut Rencontrezhuclement1801Pas encore d'évaluation
- Plan de La DissertationDocument4 pagesPlan de La DissertationAlex MicasPas encore d'évaluation
- LL1 Manon Lescaut Trace EcriteDocument4 pagesLL1 Manon Lescaut Trace EcritefantinemachonPas encore d'évaluation
- 1 Texte 1 La Rencontre Manon Des Grieux AnalyseDocument4 pages1 Texte 1 La Rencontre Manon Des Grieux Analysepaskal.espanaPas encore d'évaluation
- La Rencontre Manon LescautDocument5 pagesLa Rencontre Manon Lescautrim nouriPas encore d'évaluation
- Corrige Semaine 3 Classes de 1ereDocument4 pagesCorrige Semaine 3 Classes de 1ereYnsiaPas encore d'évaluation
- 9326 3 Francais2 Chap2Document56 pages9326 3 Francais2 Chap2Aziz DassilvaPas encore d'évaluation
- Analyse Le Mariage de Figaro 3Document6 pagesAnalyse Le Mariage de Figaro 3sbiryPas encore d'évaluation
- La Scène de L'aveuDocument3 pagesLa Scène de L'aveuMarie BustosPas encore d'évaluation
- Texte FrançaisDocument2 pagesTexte FrançaisInes SlimaniPas encore d'évaluation
- Princesse de MontpensierDocument3 pagesPrincesse de Montpensiersev2.schneiderPas encore d'évaluation
- La RencontreDocument11 pagesLa RencontretompoucewillemPas encore d'évaluation
- La Princesse de Clèves 3Document4 pagesLa Princesse de Clèves 3Adèle DutertrePas encore d'évaluation
- Manon Lescaut de l'Abbé Prévost - La mort de Manon: Commentaire et Analyse de texteD'EverandManon Lescaut de l'Abbé Prévost - La mort de Manon: Commentaire et Analyse de textePas encore d'évaluation
- Fiche LA RENCONTREDocument7 pagesFiche LA RENCONTREAsmaa AssoumaPas encore d'évaluation
- 4 Cercles de Lecture - La FayetteDocument2 pages4 Cercles de Lecture - La FayettelyblancPas encore d'évaluation
- Commentaire Composé - Princesse de ClèvesDocument2 pagesCommentaire Composé - Princesse de ClèvesLeo LarueePas encore d'évaluation
- El3 PalissadesDocument6 pagesEl3 PalissadesChiara StraboniPas encore d'évaluation
- Expli Linéaire Texte 2Document3 pagesExpli Linéaire Texte 2el sezPas encore d'évaluation
- À Savoir: Le Mot Étonnement Possède Un Sens Très Fort Au Xviie Siècle: Il Signifie Ébranlement, Stupeur, ParalysieDocument4 pagesÀ Savoir: Le Mot Étonnement Possède Un Sens Très Fort Au Xviie Siècle: Il Signifie Ébranlement, Stupeur, ParalysieEmiliePas encore d'évaluation
- Texte Et Correction LL1 Manon Lescaut PrévostDocument4 pagesTexte Et Correction LL1 Manon Lescaut Prévostpaulinegrevet23100% (1)
- Lecture Analytique Medee V 2Document6 pagesLecture Analytique Medee V 2andrianarisoaharenafitahinaahaPas encore d'évaluation
- La Fête SurpriseDocument28 pagesLa Fête SurpriseCarte La RepPas encore d'évaluation
- Le-Bourgeois-Gentilhomme-de-Molière-Un-poème-libre - Doc Version 1Document34 pagesLe-Bourgeois-Gentilhomme-de-Molière-Un-poème-libre - Doc Version 1Abdo MelouiPas encore d'évaluation
- Contes Dailleurs JKDocument2 pagesContes Dailleurs JKWerdi RosePas encore d'évaluation
- Synthèse Examen FrançaisDocument6 pagesSynthèse Examen Françaisr26hsp9kjsPas encore d'évaluation
- FR Poesie RomantiqueDocument2 pagesFR Poesie Romantiqueviator P.NPas encore d'évaluation
- Choir - Parlez MoiDocument12 pagesChoir - Parlez MoikpletzPas encore d'évaluation
- Lesthtiquedescho00fauc PDFDocument504 pagesLesthtiquedescho00fauc PDFMeriam Ben AmorPas encore d'évaluation
- LE 3IEM LIVRE D EzraDocument100 pagesLE 3IEM LIVRE D EzraMarcus TremblayPas encore d'évaluation
- Manuels 4eme 2022 2023Document1 pageManuels 4eme 2022 2023lcb dksnglPas encore d'évaluation
- 4 - The Truman ShowDocument3 pages4 - The Truman Showaurelien.dupre79Pas encore d'évaluation
- Agnès DesartheDocument3 pagesAgnès Desartheyannis.adelerPas encore d'évaluation
- Le Dernier Jour D'un Condamné DiapoDocument9 pagesLe Dernier Jour D'un Condamné DiapoEl Bezzari IssamPas encore d'évaluation
- Secret BacDocument58 pagesSecret BacAblaye DiaPas encore d'évaluation
- Ninja Jiraiya Helmet PapercraftDocument11 pagesNinja Jiraiya Helmet PapercraftAlexandre Ribeiro MorelloPas encore d'évaluation
- AnalyseDocument2 pagesAnalyseThéo PhaniePas encore d'évaluation
- Genese Fonction de L'ecritureDocument9 pagesGenese Fonction de L'ecritureHaddadou JugurthaPas encore d'évaluation
- Conjuguez Les Verbes Être Et Avoir Au Futur SimpleDocument2 pagesConjuguez Les Verbes Être Et Avoir Au Futur SimpleOlivier BigirimanaPas encore d'évaluation
- CMT N 20030516140753Document16 pagesCMT N 20030516140753MinhDuckPas encore d'évaluation
- Chrétien de TroyesDocument6 pagesChrétien de TroyesNatalia MejiaRPas encore d'évaluation
- MILCENT 2015 DiffusionDocument443 pagesMILCENT 2015 DiffusionNaciriPas encore d'évaluation
- Les FeesDocument2 pagesLes FeesHocine OttimistaPas encore d'évaluation
- ghr4 GCGC 4Document6 pagesghr4 GCGC 4Ludovic GiraudineauPas encore d'évaluation
- Fiche de Méthode de Dissert HGGSPDocument3 pagesFiche de Méthode de Dissert HGGSPAndréa PHANPas encore d'évaluation
- La Reconstruction de L'adversaire Chez Emmanuel CarrèreDocument3 pagesLa Reconstruction de L'adversaire Chez Emmanuel CarrèreManuel Millán TortosaPas encore d'évaluation
- Le Lait de La Mort (Livre) - YapakaDocument2 pagesLe Lait de La Mort (Livre) - YapakaMalcolm LovePas encore d'évaluation
- Login Dracula - Fiches Pour Leleve - Ed 2014pdfDocument14 pagesLogin Dracula - Fiches Pour Leleve - Ed 2014pdfbdf83600Pas encore d'évaluation
- C10-Le Joueur de Flute de HamelinxDocument1 pageC10-Le Joueur de Flute de HamelinxNermine NasrPas encore d'évaluation
- Pistes Pour RecitsPoliciersDocument8 pagesPistes Pour RecitsPoliciersbousbousPas encore d'évaluation
- Flaubert Éducation SentimentalDocument2 pagesFlaubert Éducation SentimentalokiPas encore d'évaluation