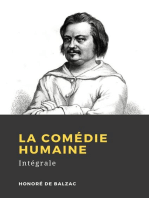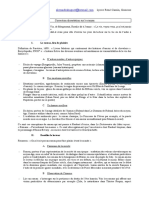Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Fables de La Fontaine: 2eme Partie Oral de Français Au Bac
Les Fables de La Fontaine: 2eme Partie Oral de Français Au Bac
Transféré par
junkie20012Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Fables de La Fontaine: 2eme Partie Oral de Français Au Bac
Les Fables de La Fontaine: 2eme Partie Oral de Français Au Bac
Transféré par
junkie20012Droits d'auteur :
Formats disponibles
Oral de Français
Introduction : Jean de La Fontaine, un célèbre fabuliste du XVIIème siècle, a écrit trois recueils de
fables regroupant deux cent quarante trois fables allégoriques publiées entre 1668 et 1694. La
plupart, inspirées des fables d’Esope, Babrius et Phèdre mettent en scène des animaux
anthropomorphes et contiennent une morale explicite ou implicite. Le second recueil de fables
comprend les livres VII a VIII publiés en 1678 et les livres IX à XI publiés en 1679. Le succès de ce
deuxième recueil a surpassé largement celui du premier. Il a été dédié à Madame de Montespan,
favorite de Louis XIV. Sous le règne de ce souverain, la créativité artistique a émergé. C’est ainsi
qu’est né le classicisme, mouvement artistique respectant des règles afin d’obtenir l’ordre et la
clarté. Ces fables apportent un regard critique et satirique sur l’homme. L’auteur utilise l’animal pour
mettre en exergue les défauts de l’homme. Il se confie aussi au lecteur tout en écrivant ses fables
philosophiques.
Développement : J’ai choisi ce recueil de fables, car il révèle le pouvoir de l’apologue de distraire tout
en faisant passer des messages. C’est un récit assez simple à comprendre et qui cache pourtant une
morale parfois complexe. Jean de la Fontaine et ses contemporains essayent de changer les mœurs,
de rendre l’homme bon notamment grâce à l’idéal de l’honnête homme. Ce concept correspond à un
homme qui saurait se raisonner, qui ne serait pas dans l’excès. Il serait un homme polyvalent, un
idéal de modération et d'équilibre dans l'usage de toutes ses facultés. Selon moi, la fable est un
habile moyen de faire réfléchir le lecteur et le faire se questionner sur son mode de fonctionnement,
ses habitudes et son rapport à autrui. Car, en plus d’apprendre, la fable garde un côté plaisant et
n’ennuie donc pas le lecteur. La fable captive et divertit comme l’illustre ces vers :
« C’est proprement un charme : il rend l’âme attentive,
Ou plutôt il la tient captive ».
Ces vers sont issus de la fable A Madame de Montespan. Il tient aussi ce discours dans la fable Le
Pouvoir des Fables. Cet apologue traite de l’utilité de l’apologue lui-même. Cette fable relate le récit
d’un messager qui, ne parvenant pas à faire entendre son discours a une foule, décide de recourir à
l’apologue pour à se faire entendre.
Cet aspect amusant, facile à comprendre des fables s’explique notamment par le choix d’utilisation
de personnages sens trop de nuance. Les personnages sont des animaux et ont un ou peu de traits
de caractère. Les lieux, les personnages et les actions utilisées par La Fontaine sont tout le temps
différent, afin de ne pas lasser le lecteur. Les fables contiennent également un grand nombre de
styles comiques différents, certaines de l’héroïcomique, comme Les Deux Coqs, certaines
contiennent un comique de situation comme dans La Cour du Lion…
Les fables de la Fontaine qui m’ont le plus marquées sont probablement La Cour du Lion et Les
Animaux malades de la peste car ces fables sont vives, pertinentes et comiques. Leur morale découle
du raisonnement logique du texte. Dans ces deux fables, La Fontaine critique la cour du Roi. Dans La
Cour du Lion, il explique que la cour est un endroit où il faut se servir de ruse pour être accepté. Dans
Les Animaux malades de la peste, il met en exergue la mise au banc de la société des plus faibles.
Conclusion : On peut dire que l’apologue a pour but de faire évoluer la société. Le recueil de fables
de Jean de La Fontaine permet de réfléchir sur l’homme tout en se distrayant, ce qui est, à mon sens
le moyen le plus efficace pour faire comprendre un propos à son public. Si Jean de La Fontaine
semble nous avoir transmis d’innombrables enseignement dans ses fables, il a l’humilité de penser
en avoir oublié et nous invite dans son épilogue à compléter son œuvre dans les termes suivants
« Donnez mainte leçon que j’ai sans doute omise ».
Vous aimerez peut-être aussi
- Dissertation 1Document2 pagesDissertation 1Cé CilPas encore d'évaluation
- LE CONTE ET LA FABLE (Semaine 3)Document33 pagesLE CONTE ET LA FABLE (Semaine 3)sayouri houdaPas encore d'évaluation
- L'adversaire: Emmanuel CarrèreDocument9 pagesL'adversaire: Emmanuel Carrèreikram safaPas encore d'évaluation
- Bac Oral de FrançaisDocument4 pagesBac Oral de FrançaisLucía Segura100% (1)
- Correction Dissertation Sur Le RomanDocument2 pagesCorrection Dissertation Sur Le RomanPapa Sarr100% (5)
- Analyse Linéaire Les Deux CoqsDocument12 pagesAnalyse Linéaire Les Deux CoqsRima SamaraniPas encore d'évaluation
- Cours LaFontaineDocument7 pagesCours LaFontaineAnne-catherine TopouchianPas encore d'évaluation
- Fiche Oral 1bac Le Prologue AntigoneDocument2 pagesFiche Oral 1bac Le Prologue Antigoneahmed100% (2)
- Analyse À L'ombre Des Jeunes Filles en FleursDocument8 pagesAnalyse À L'ombre Des Jeunes Filles en FleursRosana SosaPas encore d'évaluation
- Dissertation Fables de La FontaineDocument4 pagesDissertation Fables de La Fontaineelava33% (3)
- Exposé Les Fables de Jean de La FontaineDocument11 pagesExposé Les Fables de Jean de La FontaineEl hadji Bachir KanePas encore d'évaluation
- Paul ZUMTHOR. OralitéDocument35 pagesPaul ZUMTHOR. OralitéDaniel Ferreira100% (2)
- Dissertation PossiblesDocument15 pagesDissertation PossiblessouihinicolasPas encore d'évaluation
- Dissertation La FontaineDocument3 pagesDissertation La FontaineAnna- CerisePas encore d'évaluation
- Exposé Jean de La Fontaine Les FablesDocument6 pagesExposé Jean de La Fontaine Les FablesIbrahima Sory Sory DialloPas encore d'évaluation
- INTRODUCTION - CopieDocument9 pagesINTRODUCTION - CopieEl hadji Bachir KanePas encore d'évaluation
- Aux Sources Orientales de La Fontaine PWPTDocument16 pagesAux Sources Orientales de La Fontaine PWPTGérard MartinezPas encore d'évaluation
- Le Désir de Plaire/ La Fable Sert À Plaire La FontaineDocument2 pagesLe Désir de Plaire/ La Fable Sert À Plaire La FontaineMakachPas encore d'évaluation
- La Fable - Première - Français - MaxicoursDocument1 pageLa Fable - Première - Français - MaxicoursKhalid OurhiouiPas encore d'évaluation
- FR Biographie EctDocument2 pagesFR Biographie Ectrayan.ribeiroPas encore d'évaluation
- La Fontaine Et La FableDocument2 pagesLa Fontaine Et La FableSlađanaPas encore d'évaluation
- La Leçon Politique Et La Valeur Philosophique Des Fables de La Fontaine-1Document10 pagesLa Leçon Politique Et La Valeur Philosophique Des Fables de La Fontaine-1Vlad DubonPas encore d'évaluation
- PoésiefableDocument38 pagesPoésiefableAziz DassilvaPas encore d'évaluation
- EXPOSE DE Français FontaineDocument8 pagesEXPOSE DE Français Fontainebalotellidiedhiou1995100% (1)
- Fables CoursDocument2 pagesFables CoursYoussoufa TinePas encore d'évaluation
- La FableDocument4 pagesLa FableARiitha CLsyPas encore d'évaluation
- Apologue Définition + CoursDocument2 pagesApologue Définition + CoursHalima El yaakoubiPas encore d'évaluation
- Etude Fables, Livre 1Document3 pagesEtude Fables, Livre 1kathyPas encore d'évaluation
- Dissertation Fables de La FontaineDocument2 pagesDissertation Fables de La FontaineZoé De ToffolPas encore d'évaluation
- RomanDocument6 pagesRomandianeab94Pas encore d'évaluation
- Le Portrait D'une Personnage Sans Limites Dans Don Juan de MolièreDocument18 pagesLe Portrait D'une Personnage Sans Limites Dans Don Juan de Molièresarmad alyaseenPas encore d'évaluation
- Chapitre IDocument6 pagesChapitre Imanel hamzaouiPas encore d'évaluation
- FablesDocument6 pagesFablesrrrsPas encore d'évaluation
- L'art Du Récit 2Document3 pagesL'art Du Récit 2yoan tancelinPas encore d'évaluation
- Commentaire Fable La FontaineDocument5 pagesCommentaire Fable La FontaineLéo NidassePas encore d'évaluation
- BAC Littérature D'idéesDocument17 pagesBAC Littérature D'idéesEvaaa LouPas encore d'évaluation
- Comment Un Recueil Destiné À LDocument5 pagesComment Un Recueil Destiné À LMariele Lucia TortelliPas encore d'évaluation
- 2 PBDocument20 pages2 PBAzaharaPas encore d'évaluation
- Synthése DefDocument24 pagesSynthése Defnw9jcfjqnqPas encore d'évaluation
- Bahati Justin Serres Chaude Pour Une LectureDocument9 pagesBahati Justin Serres Chaude Pour Une LectureBAHATI DIROKPAPas encore d'évaluation
- Recherchessurlesfable ALOUACHE RaniaDocument2 pagesRecherchessurlesfable ALOUACHE RaniaakfkfPas encore d'évaluation
- DFF EsteticahorrorDocument24 pagesDFF EsteticahorrorJohnny Gavlovski EpelboimPas encore d'évaluation
- 2e4 La Fable Pour Contraction de Texte Doc ÉlèveDocument1 page2e4 La Fable Pour Contraction de Texte Doc ÉlèveVirgile BortoluzziPas encore d'évaluation
- Réécriture Petit Chaperon RougeDocument18 pagesRéécriture Petit Chaperon Rougeelisabio78Pas encore d'évaluation
- Study Guide - Candide - VoltaireDocument21 pagesStudy Guide - Candide - Voltairelaura franzoPas encore d'évaluation
- Le Loup Et Le ChienDocument4 pagesLe Loup Et Le ChienFireball44Pas encore d'évaluation
- Le Classicisme - Littérature FrançaiseDocument9 pagesLe Classicisme - Littérature FrançaiseXimo Duval Cano50% (2)
- Esthétique Des GenresDocument5 pagesEsthétique Des GenresPapa SarrPas encore d'évaluation
- Analyse de La Peau de ChagrinDocument4 pagesAnalyse de La Peau de Chagrinlouise demerliacPas encore d'évaluation
- Introduction Aux Grandes Th+®ories Du RomanDocument6 pagesIntroduction Aux Grandes Th+®ories Du RomanmayaguerrandPas encore d'évaluation
- Le RomanDocument1 pageLe RomanMouhamed GayePas encore d'évaluation
- Humata TestDocument3 pagesHumata TestChloé Juanéda-LaboriePas encore d'évaluation
- Sciences Et VieDocument24 pagesSciences Et Vienw9jcfjqnqPas encore d'évaluation
- Balzac Power Point élà VesDocument22 pagesBalzac Power Point élà VeshmdPas encore d'évaluation
- Tle EE Dissert Litt S3 Elaborer Un PlanDocument5 pagesTle EE Dissert Litt S3 Elaborer Un Planharounabamba.hbPas encore d'évaluation
- Les Genres Littéraires - 6e - Cours Français - KartableDocument7 pagesLes Genres Littéraires - 6e - Cours Français - Kartablebasma khiariPas encore d'évaluation
- Le RomanDocument5 pagesLe RomanMohamadou DialloPas encore d'évaluation
- Introduction FrançaisDocument1 pageIntroduction FrançaisMatteo TouzetPas encore d'évaluation
- Le RomanDocument8 pagesLe Romanfatoudionesenegal99Pas encore d'évaluation
- Commentaire Composé 1erg3Document2 pagesCommentaire Composé 1erg3TejenMootinPas encore d'évaluation
- ConteDocument2 pagesConteapi-3834502Pas encore d'évaluation
- Leonard BernsteinDocument1 pageLeonard Bernsteinjunkie20012Pas encore d'évaluation
- PlatonDocument3 pagesPlatonjunkie20012Pas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbé Prévost, Scène de La RencontreDocument4 pagesAnalyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbé Prévost, Scène de La Rencontrejunkie20012100% (1)
- Analyse Linéaire La Femme Gelée, Annie ErnauxDocument4 pagesAnalyse Linéaire La Femme Gelée, Annie Ernauxjunkie20012Pas encore d'évaluation
- Débuts Littéraires de MaupassantDocument2 pagesDébuts Littéraires de MaupassantsaidPas encore d'évaluation
- Sandra Teroni Et Wolfgang Klein - Pour La Défense de La CultureDocument22 pagesSandra Teroni Et Wolfgang Klein - Pour La Défense de La Cultureioio1469Pas encore d'évaluation
- ShééDocument2 pagesShééKatia MakédonskiPas encore d'évaluation
- Le Pari Du Singe Et Du LievreDocument2 pagesLe Pari Du Singe Et Du LievreSarah Tamou-tabéPas encore d'évaluation
- Marguerite DunasDocument16 pagesMarguerite Dunasjoca2008Pas encore d'évaluation
- Text 5 PDFDocument2 pagesText 5 PDFHabib TPas encore d'évaluation
- Séance 2Document2 pagesSéance 2leachampPas encore d'évaluation
- Catégories Du Blog: Recherche Dans Le BlogDocument5 pagesCatégories Du Blog: Recherche Dans Le BlogJoyce OheloPas encore d'évaluation
- Lycée Ibn Badis7Document2 pagesLycée Ibn Badis7Ouali SidaliPas encore d'évaluation
- Tableau Récapitulatif Des Aventures de CandideDocument6 pagesTableau Récapitulatif Des Aventures de CandideCraYzii ImAnPas encore d'évaluation
- BAC Blanc MHDocument3 pagesBAC Blanc MHMUGNIERPas encore d'évaluation
- Comment Analyser Un Texte Littéraire ?Document2 pagesComment Analyser Un Texte Littéraire ?Hind Djelouah100% (1)
- Test Langue 4e 2Document4 pagesTest Langue 4e 2hodaPas encore d'évaluation
- LES PROCÉDÉS LITTÉRAIRES EN PDFDocument4 pagesLES PROCÉDÉS LITTÉRAIRES EN PDFromanedbz7Pas encore d'évaluation
- Exemple de Revue de LittératureDocument2 pagesExemple de Revue de LittératuresettimohammedbadreddinePas encore d'évaluation
- Azis - Feuille de Personnage Dungeons & Dragons - D&D 5Document3 pagesAzis - Feuille de Personnage Dungeons & Dragons - D&D 5TFRMPas encore d'évaluation
- Victor Hugo, Mélancholia, III, 2, Les Contemplations, 1856Document5 pagesVictor Hugo, Mélancholia, III, 2, Les Contemplations, 1856soben2005Pas encore d'évaluation
- D-3 Antigone-Partie 4-Avant l' Affrontement pp45-64Document4 pagesD-3 Antigone-Partie 4-Avant l' Affrontement pp45-64spatio shortPas encore d'évaluation
- Ex-Le Petit Prince (Texte en Ordre)Document3 pagesEx-Le Petit Prince (Texte en Ordre)Irie Fabrice ZRO100% (1)
- Analyse Du Chapitre 1 de La Boîte À MerveillesDocument4 pagesAnalyse Du Chapitre 1 de La Boîte À MerveillesNAJMA CHBALI100% (3)
- Grammaire AlbertaDocument251 pagesGrammaire AlbertahermesPas encore d'évaluation
- Lecteur RéelDocument13 pagesLecteur Réelram100% (1)
- Lettre D'un PuniDocument2 pagesLettre D'un PuniMarie de DobbeleerPas encore d'évaluation
- EcrireDocument6 pagesEcrireGaïa Ait AghilasPas encore d'évaluation
- Sujet Francais LDocument1 pageSujet Francais LJamilo TavarezPas encore d'évaluation
- ORFEO & MAJNUN - Carnet Pedagogique 24p HDDocument24 pagesORFEO & MAJNUN - Carnet Pedagogique 24p HDBrigida MigliorePas encore d'évaluation
- AbeilleDocument2 pagesAbeilleMidjenha MorencyPas encore d'évaluation