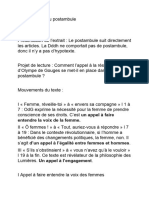Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
7FR16TE0821 Analyse Etats Empires Soleil
7FR16TE0821 Analyse Etats Empires Soleil
Transféré par
Rosa SoleacTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
7FR16TE0821 Analyse Etats Empires Soleil
7FR16TE0821 Analyse Etats Empires Soleil
Transféré par
Rosa SoleacDroits d'auteur :
Formats disponibles
ÉLÉMENTS D’ANALYSE
Extrait de L’Histoire comique des États et Empires du Soleil,
Cyrano de Bergerac, 1662
L’Histoire comique des États et Empires du Soleil est un roman utopique qui critique la société du souverain
du temps de Cyrano (Louis XIV). Celui-ci raconte l’histoire d’un homme qui voyage sur le soleil.
Dans l’extrait que nous allons étudier, le narrateur, qui voyage sur le soleil, découvre la République des
Oiseaux, dont la pie lui explique le fonctionnement.
La phrase nominale « Le gouvernement du bonheur » affiche d’emblée une volonté didactique et
argumentative. On y retrouve deux thématiques qui peuvent sembler antithétiques : la politique avec le
terme gouvernement et les sentiments intimes avec la notion de « bonheur ». Le texte s’ouvre par une
appréciation méliorative du narrateur.
Dès le début du texte, la pie et l’homme dialoguent. C’est une figure de style : la personnification.
La pie parle la même langue que l’homme puisqu’ils dialoguent, celle-ci est donc personnifiée. L’aigle est
également personnifié par le biais du verbe d’action « se vint asseoir ».
Le registre de cet extrait est merveilleux. D’abord l’histoire se déroule dans les « États et Empires du
Soleil », étoile inexplorable du fait de son extrême chaleur, ici plus précisément sur « les rameaux d’un
arbre ». Le narrateur humain est en présence d’une pie et d’un aigle. La pie et l’homme dialoguent. Le
lecteur est donc plongé immédiatement dans la fiction.
L’intention spontanée du narrateur lorsqu’il rencontre l’aigle est de s’agenouiller devant lui. En effet
l’aigle est un symbole traditionnel de l’empire et de la force. Cette intention est exprimée par le verbe
de volonté « je voulus », le narrateur en donne clairement l’explication « croyant que ce fut le roi ». Le
participe présent « croyant » montre d’emblée l’erreur du narrateur.
L’expression « ne m’eut contenu dans mon assiette » signifie « m’a fait rester à ma place »
La présence des guillemets et de l’incise contenant le verbe de déclaration indique que le récit fait place
au discours direct.
En bonne oratrice, la pie attise l’intérêt de son destinataire par le recours à une question rhétorique qui
lui permet de lancer sa longue interprétation. Cette question montre également la surprise de la pie face
au comportement du narrateur.
Le champ lexical de l’erreur de jugement et du manque de lucidité se retrouve dans les termes :
« imagination », « cru » et « jugeant ». En effet la pie répond à sa question rhétorique en affichant
son mépris sans détour : par l’apostrophe « vous autres hommes » qui a une connotation péjorative,
par l’utilisation de l’adverbe insultant « sottement ». Par ailleurs nous pouvons noter que le pronom
personnel ne renvoie plus seulement à Cyrano mais le rend représentatif du genre humain.
Le narrateur critique ensuite explicitement :
— Le roi de France, par la gradation en rythme ternaire constituée de trois superlatifs : « aux plus grands,
aux plus forts, aux plus cruels ». Ce dernier adjectif souligne le manque de justice du gouvernement
français
— L’ethnocentrisme, par l’expression « jugeant de toutes choses par vous »
— La loi du plus fort et de la soumission servile des Hommes, par « que vous vous laissez commander
aux plus grands, aux plus forts et aux plus cruels… »
« Mais », au début du deuxième paragraphe, est une conjonction de coordination. Elle exprime
l’opposition. Elle est employée également pour changer de paragraphe et exprimer une nouvelle idée, un
argument clair : « notre politique est bien autre ».
CNED PREMIÈRE FRANÇAIS 1
Ici la conjonction « Mais » est renforcée par l’utilisation de l’adverbe d’insistance « bien », ce qui
différencie nettement le gouvernement français de celui des États du Soleil. Il s’agit de montrer à quel
point les deux systèmes politiques sont opposés.
Pour mieux opposer les deux systèmes, la pie reprend la même structure de phrase mais remplace
chaque adjectif par son antonyme. Il s’agit ici d’un parallélisme antithétique de la présentation du roi :
d’un côté « plus grands », « plus forts », plus cruels » et de l’autre « plus faible », plus doux », « plus
pacifique ». Le contraste est d’autant plus frappant du fait de la proximité de ces deux propositions.
À noter que « car » annonce l’explication de la cause, de l’origine de cette différence absolue.
Les termes qui soulignent le pouvoir du peuple sont « nous le choisissons », « le changeons nous »,
« nous le prenons ». Même si l’on parle de « roi », on comprend alors qu’il s’agit d’une démocratie
républicaine.
Le mandat de « six mois » du roi est une critique indirecte adressée à la monarchie absolue de droit divin
où le roi ne perd son titre qu’à sa mort.
La pie explique l’adjectif « faible » prévoyant la question du narrateur (ici porte-parole du lecteur étonné)
grâce à la proposition subordonnée circonstancielle de but introduite par « afin que ».
L’explication est surprenante car elle annonce la vulnérabilité du roi, la possibilité de se venger de lui, et
contraste alors avec l’aspect intouchable du roi français. Le droit est donné de se venger qui que nous
soyons (« le moindre ») et quelque minime qu’ait été le mal qu’il a pu commettre (« quelque tort ») qui est
d’ailleurs évoqué au conditionnel passé pour souligner l’hypothèse, l’irréel « aurait fait ».
Il y a deux figures de style dans la fin de la phrase :
— Une métaphore en apposition « canal de toutes les injustices »
— Une hyperbole : « toutes les injustices »
On perçoit d’abord un objectif moral : aucun sentiment négatif ne doit émaner du roi ou être tourné
vers lui. L’objectif premier ici est en réalité « d’éviter la guerre ». L’hyperbole « de toutes les injustices »
relevée précédemment montre un aspect utopique : supprimer la guerre ferait disparaître le moindre
souci d’équité dans le monde. Le pacifisme est donc lié à la justice et crée ainsi un gouvernement idéal.
Le titre « gouvernement du bonheur » trouve ici son explication.
La pie enchaine avec des exemples concrets. Nous sommes en présence d’une structure argumentative
efficace : d’abord elle pose une question rhétorique à laquelle elle apporte une réponse, ensuite une
nouvelle idée est exprimée (changement de paragraphe et emploi du mot de liaison « mais »), puis il y a
un nouveau paragraphe qui présente des exemples concrets pour étayer l’argument précédent.
La pie décrit précisément le fonctionnement du gouvernement. D’abord une assemblée est convoquée
dans la proposition « il tient ses états » (le jugement royal fait donc partie intégrante de la politique
intérieure de la République du Soleil) ainsi que sa périodicité « chaque semaine ». L’importance de
chaque individu est une nouvelle fois mise en valeur par l’expression globalisante « tout le monde » ;
Chaque citoyen a la possibilité de dire ce qu’il pense du roi, très régulièrement. La justice est la même
pour tous, le roi subit la justice également. Il écoute les plaintes et les critiques de tous les citoyens à son
égard.
C’est le système démocratique qui est clairement évoqué ici avec la référence à une « élection ». Sur tout
un peuple, si « trois » sont « mal satisfaits », le roi est « destitué » de son « gouvernement ». Une nouvelle
fois l’accent est mis sur le pouvoir du peuple (désigné ici par le pronom indéfini « on »). La faible marge
d’erreur du roi est présente dans l’adverbe « seulement » et l’adjectif numéral « trois ».
La description du positionnement du roi par les compléments circonstanciels de lieu « au sommet d’un
grand if sur le bord d’un étang » et le complément circonstanciel de manière « les pieds et les ailes liés »
permet de visualiser la scène et nous indique que le roi est privé de liberté du fait de ses liens, il est
exposé au jugement de ses sujets.
2 CNED PREMIÈRE FRANÇAIS
Nous assistons donc ici à la désacralisation de la personne du roi et à la démystification du pouvoir du roi,
qui n’est d’ailleurs jamais désigné avec la majuscule traditionnellement employée pour les monarques
européens.
Un if est un arbre qui peut mesurer jusque 20 m de haut pour les plus grandes espèces.
Le Roi est placé stratégiquement en haut d’un if qui est, pour les Chrétiens, le lien entre le ciel et la terre
du fait notamment de sa longévité.
N’importe quel citoyen peut juger le roi coupable et le mettre à mort immédiatement. L’expression
globalisante « tous les oiseaux » montre une fois encore qu’aucun citoyen n’est mis de côté. C’est une
société ordonnée et respectueuse qui est présentée « l’un après l’autre ». Un seul sujet du royaume peut
accuser le roi du « dernier supplice ».
Il s’agit ici d’une critique implicite du système judiciaire français. L’insistance sur la probité exigée
de tous les juges sous-entend l’arbitraire de la justice contemporaine. Seuls les grands de ce monde
peuvent juger les autres, le peuple ne peut que subir. Les jugements sont souvent liés aux intérêts
personnels et perdent de vue la pure justice.
Le citoyen est soumis à une obligation (« il faut ») de « justifier la raison » de son acte « sur-le-champ ».
Dans le cas contraire, l’injustice du citoyen est punie, il est condamné à une « une mort triste ».
Les juges doivent être justes envers le roi. La justice n’est pas salie par les intérêts personnels. Tous les
citoyens apprennent à être aussi justes et aussi raisonnables que le roi.
Notons que la « mort triste » est une peine inconnue des Hommes et paraît obscure. La « mort triste
semble être un pléonasme qui fait surgir des questions : la mort peut-elle ne pas être triste ?
Y aurait-il des formes de mort plus tristes que les autres ?
L’extrait présenté ici articule l’imaginaire et la réalité, la narration et la réflexion, il a la fonction de
l’apologue : par le détour de la fable, l’auteur rêve à un monde meilleur et critique le monde réel. Cyrano
de Bergerac critique alors le gouvernement de son époque et l’ethnocentrisme. C’est pourquoi il nous
présente l’utopie d’une république où tous les Hommes sont égaux, où chaque citoyen a autant de poids
que le roi.
Nous remarquons que la liberté de pensée et la force contestataire qui passent dans le texte de Cyrano de
e
Bergerac sont celles d’un libertin du XVII siècle, d’un précurseur des Lumières mais qui ne parvint pas à
faire publier ses utopies de son vivant.
Ce recours à des animaux personnifiés afin de critiquer indirectement la société contemporaine, le
pouvoir royal et la justice, fait évidemment penser aux Fables de La Fontaine.
CNED PREMIÈRE FRANÇAIS 3
Vous aimerez peut-être aussi
- Explication Linéaire 1 JUSTE LA FIN DU MONDEDocument5 pagesExplication Linéaire 1 JUSTE LA FIN DU MONDEenora.legrandPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de ManonDocument4 pagesAnalyse Linéaire Manon Lescaut de L'abbée Prévost, La Jalousie de Manonjunkie20012Pas encore d'évaluation
- EL 3 Il Fait Un Temps d' Insectes AffairésDocument3 pagesEL 3 Il Fait Un Temps d' Insectes Affairésanabelle.allard43100% (1)
- OLYMPE de GOUGES - Explication Linéaire - Femme Réveille-Toi - LLélèveDocument11 pagesOLYMPE de GOUGES - Explication Linéaire - Femme Réveille-Toi - LLélèvebehohi6595Pas encore d'évaluation
- Texte 2 Vrilles de La Vigne Jour Gris Lecture LinéaireDocument3 pagesTexte 2 Vrilles de La Vigne Jour Gris Lecture Linéairechiaraguzzo20Pas encore d'évaluation
- 7FR16TE0223 - Texte 2 - Lecture LineaireDocument2 pages7FR16TE0223 - Texte 2 - Lecture Lineairedazaiozamu980Pas encore d'évaluation
- Photofiches Ce1Document23 pagesPhotofiches Ce1Zeineb HammamiPas encore d'évaluation
- TEXTE BAC N°2 Extrait Acte II Scène 8 Le M.I (Molière)Document6 pagesTEXTE BAC N°2 Extrait Acte II Scène 8 Le M.I (Molière)Raiii.78Pas encore d'évaluation
- Catherine Kerbrat-Orecchioni - L'impliciteDocument202 pagesCatherine Kerbrat-Orecchioni - L'impliciteRamón Castilla100% (1)
- Corrigé de L'étude Linéaire N°6Document2 pagesCorrigé de L'étude Linéaire N°6SaraSalandoPas encore d'évaluation
- Cantate Domino - TaizéDocument9 pagesCantate Domino - TaizéEdu FilhoPas encore d'évaluation
- Les Fractions Numerateur DenominateurDocument12 pagesLes Fractions Numerateur DenominateurlauraPas encore d'évaluation
- Histoire Comique Des États Et Empires Du Soleil 2Document3 pagesHistoire Comique Des États Et Empires Du Soleil 2aairouche11100% (1)
- Femme, Réveille-ToiDocument3 pagesFemme, Réveille-ToiMathisPas encore d'évaluation
- Corrigée Lecture-Linéaire N 5Document4 pagesCorrigée Lecture-Linéaire N 5Second accountPas encore d'évaluation
- Un Rêve BACDocument6 pagesUn Rêve BACasma rachidPas encore d'évaluation
- Olymle de GOUGES - PostambuleDocument7 pagesOlymle de GOUGES - PostambuleChiara StraboniPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire - Tu M'accable, Juste À La Fin Du Monde, Jean Luc LagarceDocument6 pagesLecture Linéaire - Tu M'accable, Juste À La Fin Du Monde, Jean Luc LagarceAce151Pas encore d'évaluation
- Le Nègre de Surinam Lecture LinéaireDocument2 pagesLe Nègre de Surinam Lecture LinéaireanneribeyrolPas encore d'évaluation
- M.I. Lecture Linéaire I, 1Document2 pagesM.I. Lecture Linéaire I, 1spidermanflash8Pas encore d'évaluation
- ANALYSE DDFC, Olympe de Gouges, Postambule (Du Début À Qu'à Le Vouloir )Document3 pagesANALYSE DDFC, Olympe de Gouges, Postambule (Du Début À Qu'à Le Vouloir )clairepannier28Pas encore d'évaluation
- Analyse - Le Soliloque D'antoineDocument5 pagesAnalyse - Le Soliloque D'antoineAndrea OrtizPas encore d'évaluation
- Le Gouvernement Du Bonheur Cyrano de Bergerac (1)Document3 pagesLe Gouvernement Du Bonheur Cyrano de Bergerac (1)kennydracius470100% (1)
- Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyenneDocument5 pagesDéclaration Des Droits de La Femme Et de La Citoyennehwjgfd2hcy100% (1)
- Le Soliloque D 2Document2 pagesLe Soliloque D 2aairouche11Pas encore d'évaluation
- Le Malade Imaginaire, Molière, Acte III Scène 10: Analyse LinéaireDocument9 pagesLe Malade Imaginaire, Molière, Acte III Scène 10: Analyse LinéaireInfinityPas encore d'évaluation
- 2 Analyse - Dormeur - Du - ValDocument2 pages2 Analyse - Dormeur - Du - Valeliott.mdc27Pas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire N°8Document4 pagesAnalyse Linéaire N°84ffjybccnrPas encore d'évaluation
- EL #6 Olympe PréambuleDocument2 pagesEL #6 Olympe PréambuleMylo Saint-eloi100% (1)
- Texte 8 COMMENTAIRE Le Malade Imaginaire Acte 3 Scène 14Document3 pagesTexte 8 COMMENTAIRE Le Malade Imaginaire Acte 3 Scène 14mazouna 3Pas encore d'évaluation
- A La Musique Rimbaud AnalyseDocument6 pagesA La Musique Rimbaud AnalyseIrvinPas encore d'évaluation
- Oi1 "Mon Petit Doigt", Acte II, Scène 8 Version 1Document3 pagesOi1 "Mon Petit Doigt", Acte II, Scène 8 Version 1marco samaraniPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire Postambule de La DDFCDocument2 pagesLecture Linéaire Postambule de La DDFClouise.lemeur1100% (1)
- EL N°1 Le Mal Rimbaud 11Document4 pagesEL N°1 Le Mal Rimbaud 11lelgharbiPas encore d'évaluation
- Scene 2 Partie 2 JLDocument3 pagesScene 2 Partie 2 JLdiamantmouanda7Pas encore d'évaluation
- Expl Linéaire "Le Mal" RimbaudDocument2 pagesExpl Linéaire "Le Mal" RimbaudsissosrtPas encore d'évaluation
- Vieux Tahitien Analyse LinéaireDocument4 pagesVieux Tahitien Analyse LinéaireMarie Carpin VelleyenPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire Candide Chapitre 19Document3 pagesLecture Linéaire Candide Chapitre 19Le MeurPas encore d'évaluation
- El Le MalDocument4 pagesEl Le MalZeus100% (1)
- Les Plaintes D Un Aman Manon LescautDocument3 pagesLes Plaintes D Un Aman Manon Lescautrim nouri100% (1)
- Lecture Linéaire 10 BADocument5 pagesLecture Linéaire 10 BAfawemaPas encore d'évaluation
- Marivaux - Le Jeu de L - Amour Et Du HasardDocument3 pagesMarivaux - Le Jeu de L - Amour Et Du HasardChimène Smith0% (1)
- Texte de La Lecture Lineaire N°1Document33 pagesTexte de La Lecture Lineaire N°1soben2005100% (1)
- Explication Linéaire 15 OLYMPE DE GOUGESDocument4 pagesExplication Linéaire 15 OLYMPE DE GOUGESenora.legrand100% (1)
- Etude Linéaire Du PostambuleDocument2 pagesEtude Linéaire Du Postambulemrvwan543frPas encore d'évaluation
- Rimbaud Analyse Venus AnadyomeneDocument4 pagesRimbaud Analyse Venus Anadyomenedjg9pgtnbyPas encore d'évaluation
- Fiche LA RENCONTREDocument7 pagesFiche LA RENCONTREAsmaa AssoumaPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire Préambule de La Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyenneDocument2 pagesLecture Linéaire Préambule de La Déclaration Des Droits de La Femme Et de La CitoyenneLe Meur100% (1)
- Analyse linéaire texte 3Document5 pagesAnalyse linéaire texte 3roulaudthomasPas encore d'évaluation
- LL Mort de ManonDocument4 pagesLL Mort de ManonJaziri MalekePas encore d'évaluation
- Bac Lecture Linéaire, Plan Et CommentaireDocument6 pagesBac Lecture Linéaire, Plan Et CommentaireEmy POTTIERPas encore d'évaluation
- Explication de Texte 1 La TrahisonDocument6 pagesExplication de Texte 1 La TrahisonPrésident ImothepienPas encore d'évaluation
- Fiche Dissert ODGDocument6 pagesFiche Dissert ODGcollynenauflePas encore d'évaluation
- ETUDE LINEAIRE N°7 La Mort de ManonDocument3 pagesETUDE LINEAIRE N°7 La Mort de Manoncmmcpbbw7n100% (1)
- Texte 13 Dispute Antoine Suzanne Scene 9Document5 pagesTexte 13 Dispute Antoine Suzanne Scene 9aPas encore d'évaluation
- Postambule DDFCDocument11 pagesPostambule DDFCleolenne08Pas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire "Ma Bohème"Document2 pagesAnalyse Linéaire "Ma Bohème"esteban.mcloudPas encore d'évaluation
- Le Malade Imaginaire Molière Acte III Scène 10 Analyse LinéaireDocument8 pagesLe Malade Imaginaire Molière Acte III Scène 10 Analyse Linéairekaloy100% (1)
- Séance 6 - LL n5 - Le Postambule Le Tableau Des FemmesDocument4 pagesSéance 6 - LL n5 - Le Postambule Le Tableau Des Femmesshaheermasih100% (1)
- Le Prologue - Etude LineaireDocument3 pagesLe Prologue - Etude LineaireKhagny SyllaPas encore d'évaluation
- Ob - 0d1135 - Corrige de ll2 JLFDMDocument8 pagesOb - 0d1135 - Corrige de ll2 JLFDMMus ArknnPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire Histoire de Gil Blas de SantillaneDocument7 pagesLecture Linéaire Histoire de Gil Blas de Santillaneleo.vhbPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire M.I. N°2 Acte I, 5Document2 pagesLecture Linéaire M.I. N°2 Acte I, 5Aymane JiraouiPas encore d'évaluation
- Cm1-Exercice Langue Et ComDocument7 pagesCm1-Exercice Langue Et Comkhadyfal776148127100% (1)
- p4s1 - Exercices de Synthese Le CoiDocument1 pagep4s1 - Exercices de Synthese Le CoiAdelePas encore d'évaluation
- SubordonnéesDocument5 pagesSubordonnéesMădălina RoşcaPas encore d'évaluation
- Wiwit Aku Isih Bayi - OrganDocument2 pagesWiwit Aku Isih Bayi - OrganAgata RachelPas encore d'évaluation
- À Ton Tour (Guide Pédagogique Niveau 2) - 082009225315 PDFDocument80 pagesÀ Ton Tour (Guide Pédagogique Niveau 2) - 082009225315 PDFAlexia TzPas encore d'évaluation
- Mathématiques 10 - Fondements Et Pré-Calculus 4 Les Racines Et Les PuissancesDocument52 pagesMathématiques 10 - Fondements Et Pré-Calculus 4 Les Racines Et Les PuissancesAbed ItaniPas encore d'évaluation
- Entrainement-16 CLDocument3 pagesEntrainement-16 CLToàn Nguyễn KhánhPas encore d'évaluation
- Exercice Nombres Decimaux 1Document1 pageExercice Nombres Decimaux 1Master GTHPas encore d'évaluation
- ECO C Partie II 2023Document37 pagesECO C Partie II 2023دعاء DOUAPas encore d'évaluation
- Phrase Simple Et Phrase Complexe - Devoir 6CDocument3 pagesPhrase Simple Et Phrase Complexe - Devoir 6CAli BPas encore d'évaluation
- Manzanero. Pero Te Extraño en Mi Menor - Partitura CompletaDocument6 pagesManzanero. Pero Te Extraño en Mi Menor - Partitura CompletaAbraham Alvarado VargasPas encore d'évaluation
- Tema 19, Passe AnterieurDocument2 pagesTema 19, Passe AnterieurMarcela MorariPas encore d'évaluation
- À Quels Temps Verbaux de L'anglais Correspond Le Passé Composé?Document12 pagesÀ Quels Temps Verbaux de L'anglais Correspond Le Passé Composé?Nguyen-Thuc Thanh-TinPas encore d'évaluation
- 62ee387402fb3 - .Enoncé-Etude de Texte.Document5 pages62ee387402fb3 - .Enoncé-Etude de Texte.Ayari MaysaPas encore d'évaluation
- Entrada Vinde, Espírito de Deus - Frei FabrettiDocument2 pagesEntrada Vinde, Espírito de Deus - Frei FabrettipaulinhosvieiraPas encore d'évaluation
- M1 - ANTHROPOLOGIE DE LOCÉANIE - Trame - Sujet - DistancielDocument2 pagesM1 - ANTHROPOLOGIE DE LOCÉANIE - Trame - Sujet - DistancielmonfilsbarrackPas encore d'évaluation
- Devoir Type Brevet 4eme Niv2Document5 pagesDevoir Type Brevet 4eme Niv2Karine WitvitzkyPas encore d'évaluation
- Devoir À La Maion 01-1bac-SMDocument1 pageDevoir À La Maion 01-1bac-SMchachiadnanePas encore d'évaluation
- Creia - Vocal e Piano (Coro Misto)Document11 pagesCreia - Vocal e Piano (Coro Misto)Sarah S. GarciaPas encore d'évaluation
- TECHNIQUES RÉDACTIONNELLES (2) .pdf · إصدار ١Document32 pagesTECHNIQUES RÉDACTIONNELLES (2) .pdf · إصدار ١cheima barirPas encore d'évaluation
- Compléments Circonstanciels de TempsDocument4 pagesCompléments Circonstanciels de TempsStef TipsPas encore d'évaluation
- OPO Orthographe 5 ÈmeDocument20 pagesOPO Orthographe 5 ÈmeAssi FofPas encore d'évaluation
- Cahier de VaccancesDocument10 pagesCahier de Vaccancesvieu2Pas encore d'évaluation
- Ds 1Document3 pagesDs 1Ahmed MabroukiPas encore d'évaluation
- These Sabinev2Document549 pagesThese Sabinev2MAS LiselottePas encore d'évaluation
- Interrogation TCE2Document3 pagesInterrogation TCE2Wahiba AbdounPas encore d'évaluation