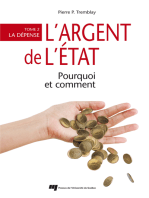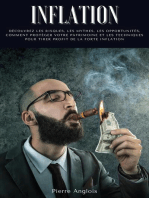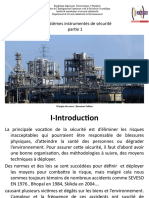Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Croissance Et Developpement Licence AES
Cours Croissance Et Developpement Licence AES
Transféré par
Alex'ninie CarridroitCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Croissance Et Developpement Licence AES
Cours Croissance Et Developpement Licence AES
Transféré par
Alex'ninie CarridroitDroits d'auteur :
Formats disponibles
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Croissance et Dveloppement
Examen : 2 questions sur deux heures. Lune basique et lautre sur une rflexion. Bibliographie : Jean-Claude Vrez, Pauvrets dans le monde , dition ellipses, 2007 Guellec & Ralle, Les nouvelles thories de la croissance , dition La Dcouverte, collection repres www.pnud.com, rapport mondial sur le dveloppement humain.
Plan du cours : Chapitre I : La mesure et les indicateurs de la croissance Chapitre II : Les modles et les facteurs de la croissance Chapitre III : La mesure et les indicateurs du dveloppement Chapitre IV : Les ingalits du dveloppement dans le monde Chapitre V : Les thories du dveloppement
Page | 1
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Chapitre 1 : La mesure et les indicateurs de la croissance
Les premiers conomistes qui se posent la question de la croissance sont les conomistes classiques. Les classiques libraux : Adam Smith, fin 18e sicle. Le libralisme conomique nest pas oppos lEtat. Lopposant aux classiques libraux est Malthus, sa proccupation est le fait que la population croit un rythme suprieur que la croissance de production. Il pense que nous ne sommes pas dans lhypothse des rendements croissants. Plus la croissance dmographique est leve, plus on va vers ltat stationnaire qui va engendrer de la pauprisation. A partir de la moiti du 19e on a dautres classiques qui vont tre opposs aux libraux, se sont des socialistes et le plus clbre dentre eux est Karl Marx. Il considre que le systme capitalisme ne peut pas se passer de la croissance. Il pense que le capitalisme est vou disparaitre. Si la croissance est limite, les profits sont moins nombreux. Sauf que cette logique va amener le capitalisme sa propre mort parce quon narrive pas consommer tout ce qui est produit. Beaucoup plus rcemment les auteurs qui se sont intresss la croissance sont ceux qui suivent Keynes, qui est contemporain de la crise de 1929. La problmatique Keynsienne nest plus la mode aujourdhui mais elle ltait dans les annes 1990. Lide est que pour la croissance soit rgulire, il faut non pas comprimer les dpenses de consommation mais faire en sorte que les mnages consomment, il faut les acclrer pour viter une crise de surproduction. On a les nokeynsiens et les nouveaux classiques. Les nokeynsiens sont pour un tat rgulateur. Ce qui distingue les keynsiens des nokeynsiens ce ne sont pas des conomistes qui accepteraient daller au-del des dpenses actuelles. Les nouveaux keynsiens veulent un tat rgulateur mais il ne doit pas tre trop interventionniste. Courbe de Laffer
Recettes fiscales
0%
100 % Taux dimposition
Page | 2
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
I-
La mesure de la croissance
1- Dfinition
Prcis dconomie international , dition ellipses, ouvrage de Jean-Claude Vrez. Le PIB mesure la somme des valeurs ajoutes pour une conomie nationale au cours dune anne civile. Cest un indicateur statistique. Une partie des valeurs ajoutes nest pas dclare, une partie nest pas quantifie parce quon ne les intgre pas. Il faut prendre en considration les changes qui passent entre les diffrents pays. Toutes les frontires ne sont pas fiables. Il y a des trafics de drogues, darmement et de plus en plus dorganes. Dans les pays dans lesquels les instituts statistiques nexistent pas ou ne sont pas fiables ou sont corrompus, sont problmatiques pour le PIB. Le PNB sont les valeurs ajoutes qui sont cres par les entreprises franaises alors que le PIB cest toutes les entreprises sur le territoire franais. Le taux de croissance dune conomie dpend de deux facteurs. Le premier est le taux daccroissement du nombre dheures travailles. Le second facteur est le taux daccroissement de la production horaire. Autrement dit la productivit de la population active. Le PIB est soit global, soit il est rapport au nombre dhabitants mais quand on prend le PIB par habitant deux problmes se posent. Selon les pays il existe des taux dinflation diffrents. Le PIB par habitant est compar en PPA (Parit du Pouvoir dachat). Cest une technique qui permet de limiter les carts de linflation ou de taux de change entre les pays. 2- Le PIB Mondial Lide est de comparer des indicateurs entre pays avec des taux de change diffrents. Exemple : Un panier de 100 $ aux USA. En 2006, 100 $ = 80 . Sur place on a le taux de change suivant 1 $ = 0,8 . Lamricain achte le mme panier 90 en France. Parce que en tre autre le taux de change nest pas le mme. Taux de PPA 90/100 = 0,9 pour 1 $. Niveau gnral des prix franais est > de 12,5 Indice relatif (90/80) x 100 = 112,5 % %. Pour comparer les prix du mme panier de produits, on va procder la parit de pouvoir dachat et on va dire que le taux de PPA est de 90/100 c'est--dire 0,9 pour 1 $. Si lamricain le paye 90 Paris alors quaux US il paye 80, il le paye plus cher pour un pourcentage de 12,5 %. Cela peut reflter un taux de change diffrent ou tre considr comme le fait que les prix franais sont plus levs que les prix amricains. Exemples de comparaison des PIB et PPA : En 2007 PIB (en milliards de $) 13 750 USA 3 200 Chine
PPA (en milliards de $) 13 750 7 096
Page | 3
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
En 2007, le monde a un PIB de 65 000 milliards de $ en PPA. Les pays de lOCDE (Organisation de coopration et de dveloppement conomique) reprsentant un PIB de 38 500 milliards de $ en PPA. LUE 27 reprsente un peu moins de 15 000 milliards de $ en PPA. Quatre instruments : politiques budgtaire, montaire, fiscale, des revenus (revenus du capital et revenus du travail). La politique conomique est au service de la croissance. Le PIB Franais en de 2 000 milliards $ en PPA. Le mieux pour la France est de suivre une politique conomique europenne plutt que nationale. Lessentiel de la croissance conomique repose sur le capital humain, les dpenses dans lducation, la recherche, le dveloppement La Chine investit dans les dpenses technologiques au point o se demande si lEurope pourra rattraper son retard. Quelques points de repres : La Chine est la 2me puissance mondiale en PPA. Linde est la 4me puissance. LAllemagne arrive aprs. Cinq pays reprsentent la moiti du PIB mondial : les Etats-Unis, la Chine, LInde, le Japon et lAllemagne. Il y a des pays qui pourraient disparaitre a ne changerait rien quant la lecture du PIB. Beaucoup de pays ne reprsentent pas 1 % du PIB. 3- Le PIB par habitant en PPA
Classement des pays :
Le Luxembourg a le PIB par habitant en PPA le plus grand : 79 500 $. Norvge, Singapour, Koweit : 47 800 $ USA : 45 600 $ La France avec 33 600 $ est 15me. La Chine est au 80me rang : 5 383 $ par habitant. LInde : 2 753 $ PIB/Hab Les quinze ou vingt derniers pays ont un PIB infrieur 1 000 $.
II-
Les dterminants de la productivit
Pour le moment, la dmarche nest pas de dveloppement mais de croissance. Quels sont les dterminants de la croissance ? 4 facteurs sont essentiels : Lpargne et linvestissement Lducation et la qualit de la main duvre Lallocation optimale des ressources La recherche et le dveloppement
Page | 4
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
1- Lpargne et linvestissement En macroconomie il y a une quation qui consiste noter I = S. I comme investissement, S comme pargne. Il y a un lien entre I et S. Production par travailleur
Y1 Y0
K0
K1
Biens dquipement par travailleur
Les conomistes disent que sil ny a pas S, on ne peut pas investir. Les pays en dveloppement sont doublement victime, il existe de lpargne mais le taux nest pas lev. Lautre problme est que quelque soit ce niveau dpargne, ce nest pas dpos dans les circuits officiels car il ny a pas de confiance dans ces rseaux. Celui qui veut investir doit dabord au pralable constituer sa propre pargne. Cest un problme institutionnel. La variable qui essaie dquilibrer I = S est le taux dintrt. Qui fixe le taux dintrt ? La banque centrale fixe le taux directeur c'est--dire largent quelle prte aux banques commerciales. Le taux directeur actuellement est bas. Aujourdhui, on peut emprunter autour de 4 %. Est-ce que les dpenses de ltat, son dficit budgtaire, a des consquences sur la capacit dpargne du pays ? Oui, cause des impts. Le taux de fiscalit augmente. Lorsque la fiscalit pse davantages sur les contribuables, les mnages pargnent moins. Les entreprises trouvent des aident plus difficilement. Il ne faudrait pas que lpargne se rarfie avec le taux de chmage, les perspectives de croissance sont de plus en plus rares. Lhypothse de croissance est une hypothse farfe lue. On arrivera jamais avoir du 2,5 de croissance dici 2018. 2- Lducation et la qualit de la main duvre On a dautant plus de chance de pouvoir progresser que si notre main duvre est qualifie. Est-ce que la France accueille des entreprises du monde entier ? Oui, la qualit de la main duvre franaise est un atout. On dit souvent que les franais travaillent peu, mais ils travaillent plus productivement. Cest un atout considrable. La France a la conception. Il est donc important de former la main duvre. Dans les indicateurs du chmage nous sommes le pays o le taux de chmage sur une longue dure est le plus lev. Les personnes non formes sont inemployables. Linvestissement dans lducation de la main duvre est incontournable. Il y a 15 % dillettrs en 6me. Le priv prend le relai pour combler les lacunes. Lide est de tenter de substitu les financements privs des financements publics travers les prts tudiants. Page | 5
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Le dilemme pour les entreprises des hautes technologiques est soit il faut payer les formations et il faut remplacer le salari en formation. Le problme est comment faire pour que la main duvre reste dans le top en termes de qualification ? Soit le salari se forme sur son temps de travail, cest inacceptable pour lentrepreneur, soit il se forme seul, cest inacceptable car il faut travailler en dehors du travail. Le problme de la main duvre persiste et persistera encore longtemps. a pose un problme de financement. 3- Lallocation optimale des ressources On est pass dune conomie agricole une conomie industrielle et une conomie des services. Lagriculture na pas perdu de la productivit malgr la perte de main duvre. Dans lconomie de service il y a des services dits traditionnels (restaurant, coiffeur par exemples), il y a ct les services sophistiqus o on retrouve la programmation informatique, multimdia, les conseils juridiques, lducation et le secteur mdical. Comment rpartir la main duvre puis les investissements pour chacun des secteurs cits ? Est-ce que la France doit moins investir dans lagriculture, dans lindustrie ? Au niveau de lUE, le premier budget est la politique agricole commune. Plus de 4 euros sur 10 concernent lagriculture. La population active agricole reprsente moins de 3 % de la population active totale. Le budget de la politique agricole commune va tre de 30 % (au lieu de 43 %). Est-ce que cest optimal ? Est-ce que le fait dtre plus productif explique la baisse agricole ? Lide de lEurope est de mettre moins dans lagriculture et mettre plus dans lducation. 4- Lvolution des technologies et les dpenses en recherche et dveloppement Ces dpenses en recherche et dveloppement concernent le service public et priv. Il sagit de dpenses pour assurer linnovation. Il y a un accroissement des dpenses parce quil est admis aujourdhui que la croissance conomique repose sur un concept dvelopp par Becker qui est le capital humain qui correspond au stock des connaissances disponibles. Il peut tre aliment par des connaissances nouvelles pour saccroitre. Ces connaissances sont sources dinnovation. La croissance relve des processus de linvestissement dans le capital humain. Quand on parle de connaissance on ne parle pas de formation diplme , de comptences. On parle de lensemble des connaissances. Cette problmatique couvre autant le monde linformation que lentreprise. Ltat peut financer cet accs la connaissance sinon cest lentreprise de payer. Aux Etats-Unis les dpenses de recherche et de dveloppement sont plus assures par le secteur priv. En France par le secteur public. Tout au sommet des connaissances il y a les chercheurs, les processus dinnovations (exemple : lOral). Cette approche pris une ampleur importante dans les annes 1980. On ne parlait pas encore de pays mergents comme aujourdhui. La question qui est pose est que ces dpenses ne sont plus exclusives aux pays industrialiss trs riches. Il y a un contexte qui renforce lide quil faut tre le premier. On peut considrer quil y a une typologie suivante : Les pays crateurs, innovateurs Les pays suiveurs Les pays consommateurs ou importateurs
Page | 6
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Sur lchelle plantaire, la France nest pas leader. On a tendance par tre dpass par des pays asiatiques. Peut-on tre le premier ou innovateur dans tous les domaines ? Si on est un trs grand pays, pourquoi pas ! Pour la France, il est hors de question de pouvoir se spcialiser ou tre innovateur dans tous les secteurs. Est-ce que la difficult est dtre le premier ou dy rester ? La difficult cest dy rester. Une position acquise dans un domaine ne signifie pas que cette position sera garde. La question des contre faons ou la question des brevets est ambigu. A partir du moment o on a un processus de cration, comment rmunrer le crateur ? Quand on a un brevet on est en situation de monopole. Celui qui copie na fait aucun investissement, celui qui a fait un investissement na pas de retour. Il ny a pas de solution puisquil ny a pas de lgislation respecte.
Page | 7
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Chapitre 2 : Les modles de la croissance
A partir des facteurs comment articuler les investissements dans le pays, comment financer ces investissements ? Quel modle de croissance peut-on mettre en place pour avoir une croissance rgulire et leve ? Il y a les modles traditionnels de la croissance et les nouvelles thories de la croissance.
I-
Les thories traditionnelles de la croissance
Pour comprendre ces thories, il faut distinguer les thories post keynsienne et les thories noclassiques1. Dans lunivers post keynsien (postrieur Keynes2). Lconomie capitaliste ne peut se rguler par elle-mme. Dans lunivers Keynsien ce qui est essentiel cest lpargne car elle permet de financer les investissements. Mais en mme temps, chez Keynes lpargne pose un problme majeur parce que ce qui est pargn est consomm par dfinition. Si je pose Y = C + S. Y est un revenu (en 2008, 50 % des franais disposaient de 1580 de revenu par mois). C est la consommation et S lpargne Si je pose 1580 = 1500 + 80. Il faut ramener C/Y et S/Y : propensions moyennes consommer ou pargner. On sait que C/Y + S/Y = 1. Si jai 1000 = 800 = 200, alors 800/1000 = 0,8 (80 % du revenu consomm) 800/1000 + 200/1000 = 0,8 + 0,2 = 1 Or chez Keynes ce qui est essentiel, la demande effective, pour la croissance conomique cest justement la consommation. Si les mnages ne consomment pas alors les entreprises vont voir leurs dbouchs se rtracter, elles vont dcider de moins investir. Si jai des problmes de dbouchs, jinvestis moins et de fait il y a moins de cration demplois. La seule stratgie nest pas de baisser les salaires. Des auteurs qui vont se rclamer de Keynes quon appelle des post Keynsien vont reprendre leur compte la problmatique keynsienne. Il sagit de Harrod et Domar. 1- Le modle Harrod Domar Ces deux auteurs vont dvelopper leur approche partir de trois variables : Le taux de croissance effectif ou taux de croissance rel : cest celui quon constate, le taux de croissance du PIB.
1 2
1870 Britannique, 1929
Page | 8
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Le taux de croissance garantie : celui qui assure lquilibre entre lpargne et linvestissement Le taux de croissance naturel : taux de croissance qui assure le plein emploi Est-ce que ces trois taux de croissance vont tre gaux ? Pour ces auteurs, le fait que les trois taux puissent tre lquilibre relve dune trs faible probabilit. Il ny a pas surprise ce quil y ait des dsquilibres en conomies. Il ny a rien de surprenant ce quil y ait du taux de chmage. S=I Derrires les dpenses dinvestissement on retrouve les entreprises. Derrire les capacits dpargne on retrouve les mnages. Quand les entreprises investissent elles anticipent leurs dbouchs, leur chiffre daffaire. Derrire le salaire, il ny a pas uniquement le prix du travail, cest aussi un revenu qui peut tre pargn ou consomm. Le taux de croissance nest pas forcment garanti, lquilibre S = I nest pas garanti. Si on suppose que les deux taux correspondent, qui nous dit que ces taux permettent dembaucher ceux qui veulent travailler ? Il est plus vraisemblable quil y ait une diffrence entre loffre et la demande. Il y a une partie des salaris qui peuvent ne pas tre satisfaits. Rien ne garanti que les besoins de financement des entreprises soient quilibrs tout comme lpargne. Lidal serait une croissance quilibre mais cest peu probable. Ce modle est donc plutt pessimiste. 2- Le modle de Solow Auteur noclassique. Pour lui la croissance dpend de deux facteurs : La quantit de travail disponible (dimension dmographique importante) Le progrs technique Lhypothse de Solow est quen rgle gnrale les rendements sont dcroissants. Pour contrecarrer les rendements dcroissants la seule solution tait de pouvoir innover, inventer, assurer les progrs techniques. Pour Solow ces progrs techniques simposent aux entreprises. Toutes les entreprises ne crent pas des progrs techniques. Selon lauteur, les progrs techniques sont exognes. Est-ce quil y a une preuve selon laquelle les progrs techniques pourraient trouver des priodes fast ? Non, au fur et mesure que lhumanit avance, les progrs techniques se multiplient. Le modle de Solow est un modle optimiste. Quelle est la condition que la croissance soit maintenue ? La cl est de dire que la croissance peut tre auto entretenue condition que les entreprises investissent toujours plus demain quhier. Investir dans le travail et le capital. LOST puis le travail la chane ont tent de rduire lactivit pour tre plus productif. Cette perspective nest plus de fait. Aujourdhui lide nest pas de dresponsabiliser mais denrichir les tches. Les entreprises doivent investir dans le capital technique, technologique. Il est donc ncessaire quune partie de la population soit tourne vers linnovation pour fabriquer de nouvelles machines, de nouveaux procds, il faut assurer le progrs technique. Pour favoriser les progrs techniques qui sont dans les entreprises il faut des
Page | 9
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
capacits de financement c'est--dire quil faut pouvoir investir. Il faut dgager des capacits dpargne. Il faut des dpenses dans le capital, il faut que les entreprises puissent investir dans des processus de recherche et dveloppement notamment, pour investir il faut des moyens de financement, ces moyens de financements renvoient lpargne.
II-
Les nouvelles thories de la croissance
1- Les hypothses
Romer3 Lucas (SCHUMPETER) On se situe aux dbuts des annes 1980. Les noclassiques sont appels aujourdhui nouveaux libraux. Dans la littrature les nouveaux classiques peuvent apparaitre sous le sigle NEC. Pourquoi passe-t-on des anciennes thories aux nouvelles thories qualifies de croissance endognes ? Les noclassique vont tre confront des critiques de leur niveau de taux croissance pour la raison suivante : si on respecte les mmes conditions (population qualifie, mmes technologies) pourquoi dans un espace la croissance est-elle plus forte que dans un autre espace ? Il ne faut pas regarder du ct exogne mais endogne c'est--dire des facteurs sur lesquels on travaille plus que dautre dun ct. Peut tre que le capital humain est suprieur dun ct un ouvrier qualifi ou un ingnieur na peut tre pas les mmes comptences dans un contexte que dans un autre. Il y a des variables sur lesquelles on peut agir. On travaille sur ces variables. Il y a trois facteurs essentiels : Le capital physique : lun des premiers auteurs tait un conomiste autrichien, Schumpeter. Pour lui, un vrai entrepreneur est un entrepreneur innovateur, celui qui ninnove pas est un entrepreneur suiveur. On peut dpasser lhypothse des rendements dcroissants et lui substituer lhypothse des rendements constants. Il faut un capital physique daujourdhui qui remplace le capital physique dhier. Pourquoi les nouveaux conomistes reviennent sur cette thse et la dveloppent ? Le progrs technique nest plus une donne exogne mais devient une donne endogne. Lun des principaux initiateurs est Paul Romer qui est nouveau keynsien, en face de lui on retrouve Robert Lucas chez les nouveaux classiques. Ils vont endogniser le progrs technique. On peut les provoquer partir des deux autres formes de capital. Le capital public c'est--dire par lappui de lEtat. A ct il y a le capital humain Le capital humain : lauteur de cette approche est Gary Becker qui a dvelopp cette ide ds les annes 1960. En tant que salari on veut tre capable de suivre lvolution technologique. Initialement chez Becker ce capital humain est individuel. Il appartient ou pas la personne dinvestir dans le capital humain. Le financement de linvestissement du capital humain repose sur lindividu, est de nature prive. Le capital public : monopoliser pour financer les dpenses dducation, de formation, de recherche et de dveloppement
3
Learning by doing
Page | 10
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Il y a un dbat de fond entre ceux qui pensent que lEtat peut participer et ceux qui pens e que a relve dun comportement individuel. La tendance europenne est une tendance qui consiste faire reporter les investissements sur les paules individuelles de chacun dentre nous. Partout dans les tats europen on a un tat qui recul. 2- Les sources endognes de la croissance Becker, Barro. Le modle de Romer repose sur laccumulation des connaissances. Cela vient de Arrow qui a dvelopp le Learning By Doing (apprentissage par laction). Cest lide quon apprend avec lexprience. Ce sont la fois les connaissances thoriques et pratiques. Au-del de notre formation initiale il y a la formation professionnelle et il faut agir sur les deux leviers. Et ct agir sur comment capitaliser les expriences et les connaissances. Cette accumulation des connaissances a une productivit prive mais aussi sociale. Cette productivit sociale mrite que lon puisse faciliter, favoriser laccumulation des connaissances. Romer ne fait que rhabiliter le rle de lEtat puisque laccumulation des connaissances une productivit sociale il faut tout faire pour le favoriser. Avec Romer, il y a un retour au rle de lEtat dans la dpense publique. Il est possible quune socit dgage une stratgie collective. Alors il serait possible que la formation soit leve au rang de biens collectifs. Un bien collectif trois caractristiques : Il est non exclusif : tout le monde peut y accder Il est non rival : si je lutilise je nempche quiconque de lutiliser ou de le consommer Il est externalit positive : le fait de consommer de linformation ou de lducation sans poser de problme quelquun, a nengendre pas un aspect ngatif pour la socit. Comment dans une socit peut-on dterminer si oui ou non la formation ou autre a ou pas le caractre dun bien collectif ? LEtat 3- Le rle de lEtat dans la croissance de long terme En rhabilitant le capital public les auteurs de la croissance endogne ont en partie rhabilit le rle de lEtat. Faut-il ou non que lEtat intervienne dans la vie conomique ? Les conomistes acceptent le fait que lEtat puisse intervenir. Le monopole naturel : il sagit dactivits pour lesquelles seul lEtat peut financer les investissements ncessaires. Exemple : les chemins de fer. Aucun entrepreneur dordre priv a la couverture financire pour investir dans un tel rseau. Seul lEtat peut le faire. En termes de dplacement, de transport de marchandises, les axes de communications sont des axes porteurs pour les changes de marchandises et le transport des personnes. Ce type dinvestissement peut tre rattach aux infrastructures publiques, les transports ariens et les infrastructures qui permettent daccder des services. Selon certains auteurs comme Barro, ces infrastructures publiques sont des variables endognes. Le rle de ltat dans le dveloppement des infrastructures est un rle essentiel. La diffrence entre les conomistes comme Barro et certains ex keynsiens, Barro ne dit pas que cela peut tre compatible avec du dficit budgtaire ou de la dette. Il sagit de financer des infrastructures Page | 11
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
utiles la croissance. Si ltat ntait pas intervenu, qui laurait fait ? Il y a derrire presque une contrainte, une obligation lEtat. La seconde catgorie de biens pour lesquels ltat peut intervenir est les biens publics. Qui dtermine quun bien est un bien public ? Ca ne peut pas tre le march. La notion de bien public est indissociable des choix collectifs. Lenvironnement est un bien public. Lducation peut galement tre leve au rang de bien public. Le fait de faire un choix collectif sur un bien public signifie quil faut faire un choix dcroissant : quel est le bien public prioritaire ? Il y a un dbat en France sur le bouclier fiscal, au cours de cette anne le bouclier fiscal a permis de verser 690 millions d. Pour pouvoir financer les biens publics il faut regarder du ct de la fiscalit.
Page | 12
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Chapitre 3 : De la croissance au dveloppement humain et au dveloppement durable
La croissance est analyse travers le PIB. Cest un indicateur utile pour mesurer la croissance mais pas utile pour mesurer le dveloppement dun pays au sens du dveloppement humain (ducation, sant). Deux conomistes, Haq & Sen, se posent la question de la finalit de la croissance conomique. Est-ce que croissance conomique = dveloppement humain au sens accs la sant, lducation ? Non pour les pays en dveloppement. Mais cest plus compliqu. Il ny a que dans ces pays o certains se voient refuser laccs la sant ou lducation. Le problme est le fait quil ny a pas de corrlation gale 1 entre croissance et dveloppement. Nous avancer mais il reste beaucoup de familles qui ny ont pas accs. Malgr ceci globalement on progresse mais il reste 1 milliard environ qui nont pas accs lalphabtisme et mangent leur faim. Cette problmatique a des consquences sur des questions politiques, de rgime politique. Malheureusement ceux qui sont dpourvu daccs la sant sont ceux qui sont le plus dpourvu daccs leurs droits civiques. Il y a galement la problmatique migratoire. Le monde nest pas dvelopp au sens du dveloppement humain mais vient se greffer le dveloppement durable. Comment nourrir ceux qui sont mal nourris, comment faire en sorte que les gens profitent de la sant, de la nourriture ? La croissance se fait aujourdhui en se proccupant de lenvironnement. Il faut trouver les solutions pour satisfaire les questions de dveloppement humain et de dveloppement durable ? Cette problmatique de dveloppement durable et humain ne concerne plus que des pays du Nord ou du Sud, elle concerne les deux espaces. Le dveloppement durable nous concerne tous. Les clivages ne sont plus des clivages Nord-Sud, ce sont des clivages plantaires.
I-
La rpartition des pays selon lindicateur de dveloppement humain
1- Les lments constitutifs de lIDH
Il y en a trois. Un qui concerne la sant, plus prcisment la dure de vie, lindicateur retenu est lesprance de vie la naissance. Le second est un lment qui concerne lducation travers le niveau de linstruction. Ce niveau dinstruction repose sur le taux dalphabtisation des adultes (personnes de 15 ans et +) qui compte dans le niveau dinstruction pour deux tiers, et le dernier tiers repose sur le taux brut de scolarisation combin. Cest le taux brut de scolarisation pour tous les niveaux denseignements (primaire, secondaire, suprieur). Alphabte : tre capable de lire, comprendre et calculer lquivalent dune dizaine de lignes dun magazine banal. Ensuite le troisime lment est le niveau de vie mesur par le PIB par habitant en PPA. Chacun des lments compte pour un tiers, lIDH est la somme de ces trois sommes. Cet indicateur est compris entre 0 et 1. Aucun pays narrive 1, aucun na 0.
Page | 13
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Rapport sur le dveloppement humain 2009 (PNUD) NORVEGE NIGER 0,971 0,340 IDH 80,5 50,8 Esprance de vie Taux dalphabtisation des 99,0 28,7 adultes de 15 ans et plus TB combin de 98,6 27,2 scolarisation PIB par habitant en PPA 53 433 627 (USD) Lintrt de cet indicateur est quil faut dsagrger. Le PNUD a lissue des travaux de Hossein a intgr lindicateur dans ses classements et on peut regrouper les pays selon leur niveau de statut de dveloppement humain. NIVEAU DE DEVELOPPEMENT HUMAIN Faible Moyen Elev Trs lev INTERVALLE IDH 0,340 ; 0,499 0,511 ; 0,798 0,803 ; 0,895 0,902 ; 0,971 NOMBRE DE PAYS 24 74 45 38
RANG DES PAYS 159 182 84 158 39 83 01 38
2- La hirarchie des pays sur la base de lIDH LONU, le 08 septembre 2000, a dfini pour lhorizon 2015 les objectifs du millnaire pour le dveloppement. Il sagit dradiquer la pauvret absolue, promouvoir lducation, raliser des progrs dans lenseignement primaire universelle, promouvoir lgalit des sexes, rduire la mortalit infantile, amliorer la sant, combattre le Sida, combattre le paludisme, assurer la durabilit de lenvironnement est-ce quil a ya de fortes divergences entre le PIB et lIDH ? Oui. Divergences entre revenus et IDH PIB par habitant en PPA ($) 22 935 14 690 11 222 8 135 4 562 2 600
Les Pays LArabie Saoudite Russie Bulgarie Thalande Guatemala Vietnam
IDH 0,843 0,817 0,840 0,783 0,704 0,725
Comment peut-on amliorer les indicateurs ? Quel est le lien entre les trois indicateurs ? Ceux qui sont dtermins sont la sant et lducation. Pour augmenter ces indicateurs que faut-il ? De la croissance. Elle est dautant plus possible quon a une amlioration dans lducation et la sant mais il faut des moyens. On voit mal comment un indicateur peut enclencher les deux Page | 14
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
autres do lappel de lONU qui consiste drainer les moyens pour que les pays les plus pauvres puissent augmenter leurs indicateurs. La croissance repose sur une main duvre peu cher mais comptitive. Comment les pays majoritairement en dveloppement peuvent-ils aller au-del de leurs indicateurs actuels ?
II-
La croissance du PIB induit-elle un meilleur dveloppement humain et durable ?
Pour des conomistes on doit dissocier croissance et dveloppement humain. Ces conomistes sinscrivent dans lconomie du dveloppement en tant que discipline. Il faut dissocier lconomie du dveloppement en tant que discipline ainsi que lconomie de dveloppement comme caractristique dun niveau conomique dun pays X ou Y. 1- La croissance distincte du dveloppement Lun des premiers conomistes qui dveloppe la distinction entre la croissance et le dveloppement est Franois Perroux en 1964. La croissance est laugmentation du niveau de production et de la productivit. Le dveloppement est la combinaison des changements mentaux et sociaux dune population. On peut arriver un troisime concept : la politique de dveloppement. Que signifie la politique de dveloppement et en quoi est-elle efficace ? Pour que toute politique de dveloppement soit efficace elle doit rpondre deux conditions : Acclrer la croissance du PIB De quelle manire ce PIB permet datteindre des objectifs de dveloppement (exemple : comment nourrir convenablement une population ?) La croissance ne parvient pas rgler la question de la pauvret. Comment se fait-il que nous ne soyons pas capables de vivre en dehors de la solitude, isolement, dpendance ? Cela signifie que le fait dtre dans les dix premiers pays internationaux du dveloppement du PIB permet de rpondre la question. La question de la croissance ne suffit pas. Toute la population marginalise, dans une situation dexclusion, de prcarit cette question montre quon narrive atteindre une solution. Les niveaux de richesses peuvent tre compatibles avec les niveaux de pauvret et de facto personne nest labri de ce souci de la pauvret. Il y a un phnomne de pauprisation qui va senclencher avec la nouvelle rforme des retraites. Nous ne sommes pas labri de la prcarit et plus encore de la pauvret. Dans les pays en dveloppement, le problme est de savoir si on peut manger tous les jours. Dun point de vue thorique, il y a un des derniers prix Nobel dconomie, Stiglitz, qui avait dvelopp les questions essentielles pour les conomies en dveloppement en tant que pays et des questions plus gnrales. Il disait en 2002 que dans les dterminants de la croissance deux choses ou trois sont essentielles. Un il faut agir sur linvestissement. Pour investir i l faut de largent, cest le micro crdit. On sest aperu que dans les pays en dveloppement les plus pauvres remboursaient plus rapidement que les autres. Si ces micros crdits sont efficaces. Lpargne modeste doit permettre de faciliter lactivit. Une fois quon a investi il faut tenter Page | 15
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
daccroitre la productivit. Si la productivit est suprieure on entre dans laccumulation du capital. Une partie permet dinvestir dans lactivit. La seconde ide est respecter la stabilit macroconomique. On est dans une conomie en dveloppement et il est ncessaire de respecter les indicateurs macroconomiques. Il faut viter autant que possible linflation. Cest aussi avoir une politique de taux de change qui ne pnalise pas lconomie. La politique montaire ne doit pas tre une politique fantaisiste ou laxiste. Il faut aussi respecter la fiscalit. On se retrouve face un problme entre la fiscalit dclare et la corruption. Tout cela ne doit pas se faire au dpend du capital naturel. Il y a une dimension contraignante supplmentaire. Enfin, la quatrime problmatique est : est-ce quil faut que ltat soit acteur de cette politique ? Oui. Mais quel Etat ? Si cest un tat qui a les cls de la corruption cest une catastrophe. Ltat na pas de lgitimit. On a un problme de gouvernance. Il faut mettre en place des politiques daides qui ne permettent pas la corruption (infrastructures par exemple). Il y a une autre rflexion : la question dmographique. Cest une question culturelle. Le fait ou pas davoir des enfants est une question culturelle. Dans certains pays ne pas avoir denfants cest presque un crime. Lide selon laquelle le nombre denfants est considr comme une richesse mrite de sy arrter. Derrire un enfant il y a une force de travail. Da ns des pays o la force de travail est lessentiel les enfants sont trs importants. Pour autant, il serait important que la croissance dmographique soit encadre. Lune des rgles essentielles est que les femmes pour faire face cette problmatique puissent accder lalphabtisation. Cela offre une position dautorit. Cela permet de mieux faire face des problmes de sant, dalimentation. Cest la problmatique importante de leau. Le rapport entre les acteurs internationaux et les pays en dveloppement. Dans les acteurs internationaux on retrouve les tats, les firmes multinationales qui ont des politiques de marketing extrmement puissantes. Le problme cest que par dfinition elles sont multi et donc pas sous la coupe dune seule nation. Il faudrait avoir une gouvernance mondiale. Il y a des avancs mais il reste de nombreux problmes. 2- Les divergences entre le PIB/habitant, lIDH et lempreinte cologique Quand on traite la question de lempreinte cologique, on voque la notion de dveloppement par les OGM et qui value limpact de la consommation dune population donne selon la surface des sols et des ocans ncessaires pour la produire et pour assimiler les dchets quelle gnre. Lempreinte ainsi dfini peut dpasser la bio capacit c'est--dire la capacit de la terre produire des ressources et absorber ces rejets. Si lempreinte dpasse la bio capacit cela signifie que les capacits rgnratrices de la plante sont dpasses. Il faut 1,3 plante pour absorber limpact des activits humaines.
Page | 16
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Lempreinte cologique en 2006 Pays Chine Inde Russie USA Congo Nouvelle Zlande Kowet Bio capacit 0,85 0,37 6,33 4,43 2,66 12,04 0,52 Dficit ou rserve 0,05, rserve limite - 0,02 1,27 - 0,64 - 0,03 4,91 - 1,07
La Nouvelle Zlande comme la Russie ont une bio capacit leve et une empreinte galement trs leve. Le Kowet a une bio capacit trs limite. Dans lensemble, a part quelques exceptions, les pays en dveloppement sont bien placs quant lempreinte cologique par contre les pays occidentaux et ptroliers ont une trs forte empreinte cologique. Ces pays ont besoin de ressources beaucoup plus importantes pour leur objet de production et les objets de consommation. En 2001, la consommation de ptrole par habitant tait proche de 11 litres par jour aux USA et au Canada. Les autres pays industrialiss 5 litres par jour. La moyenne mondiale est de 2 litres par jour. Pour le reste du monde moins dun litre par jour. Il ya une pression sur la nature diffrente selon les pays. Il y a la ncessit de gestion de lexternalit ngative sur lenvironnement. Forum pour dautres indicateurs de richesses (collectif FAIR) en 2009, 20 % de la population mondiale utilisait 80 % des ressources naturelles. Les missions de CO2 par habitant aux USA sont 12 fois suprieures ce quelles devraient tre pour atteindre un niveau mondial et durable quitable. Enfin, du fait du rchauffement climatique 230 millions de personnes subiront des migrations forces dici 2050. Enfin, lempreinte cologique de la population mondiale dpasserait de 44 % la bio capacit de la plante. Dabord, Ren Dumont a publi en 1973 un ouvrage, Lutopie ou la mort . Il dnonait lagriculture productiviste qui ne protge pas les sols et lenvironnement. Favorable au contrle dmographique. Enfin, il a t favorable aux conomies dnergie. Nous sommes confronts un problme dconomie politique. Il ny a aucune raison que la problmatique se rsout par elle-mme car il faut avoir accs linformation pour que la population donne sa confiance. On entre dans un dbat dconomie public : principe du pollueur payeur, trop de taxe tue la taxe . Trois interrogations : croissance conomique ? Oui, IDH ? Empreinte cologique ? Quels arbitrages ? Thories des Lobby qui dfendent les ides de certaines catgories socio professionnelles et qui empchent la reconversion de certaines professions qui pourraient diminuer la pollution. Dilemme : va-t-on rechercher augmenter notre bien tre matriel sans se soucier du bien tre social et environnemental ?
Page | 17
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
3- Au-del du PIB, mesurer le progrs mais aussi la richesse authentique et le bien tre des Nations Il y a en 2009 un CE, les deux prix Nobel ont rflchit la fois sur les performances conomiques et le progrs social. En quoi cette performance est source de progrs social ? Ils ont propos de nouveaux indicateurs : indice de bien tre, conomique durable (IBED), IBEE (indice bien tre conomique) cest un indice qui repose sur plusieurs variables montaires ou non, exemple : revenu, les ingalits de revenu, chmage, les patrimoines dont culturel, social, naturel.
III-
Lvolution de la typologie des pays
On a des pays du Nord et du Sud, dbat Nord / Sud. Pays du Tiers Monde, pays mergents. LONU lance en 1961 la dcennie du dveloppement car dans les annes 1960 on est dans un contexte de dcolonisation donc il y a des nouveaux pays indpendants. Souvent des pays au Sud. Cest pays cherchent rattraper les pays du Nord. Ils prennent des chemins divers : dveloppement acclr du ct du Sud Est en revanche marginalisation du ct de lAfrique. Dans les annes 1980, certains pays vont subir des crises financires importantes, souvent associes une crise dendettement. On les distingue des crises montaires, des taux de change, bancaire, taux de change monnaie dont le taux de change varie en permanence et la monnaie ne se stabilise pas avec une monnaie extrieure. La crise bancaire et lorsque le systme bancaire ne fait plus face ses devoirs. 1- La typologie actuelle Typologie 4 lments : Les pays dvelopps ou industrialiss : Canada, Etats-Unis, Japon, UE, Core du Sud Les pays mergents : Brsil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud Pays en dveloppement ou sous dvelopps : Amrique du Sud, Asie, Afrique Pays moins avancs : Asie du Sud, Afrique, Amrique du Sud PIB/hab : 1 000 $ Faible niveau de dveloppement du capital humain Faible diversification de la structure conomique Ce sont des petits pays. Il y a eu dans les annes 1960 avec Alfred Sauvy lide de pays du Tiers Monde. Lide de Tiers Monde est une analogie avec le tiers tat au Moyen Age et aprs. La socit franaise avant la rvolution de 1789 comprend la noblesse, le clerg et le tiers tat. Dans les annes 1960, on est en pleine guerre froide entre les Etats-Unis (pays capitalistes) et lURSS et la Chine (pays socialistes). Il y a une troisime catgorie de pays qui ne veulent pas suivre ces schmas, ce sont les pays non aligns. On va les appeler pays du Tiers Monde. Dans un premier temps ces pays vont tre considrs comme des pays du Sud. Nous allons ensuite entrer dans les dbats Nord Sud avec un Nord riche, industrialis et un Sud en Page | 18
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
dveloppement. Lun des pays qui a jou un rle essentiel est Cuba avec Castro mais aussi lEgypte avec Nasser. Dans le cadre de ces pays certains vont commencer sindustrialiser. On va avoir une autre typologie entre pays industrialiss, nouveaux pays industrialiss et pays non industrialiss. Les NPI ne forment pas un groupe homogne. On va y distinguer les dragons asiatiques, les tigres asiatiques et les jaguars. Les dragons sont la Core du Sud, Taiwan, Singapour, Hong-Kong. Les tigres sont la Malaisie, lIndonsie, la Thalande, les Philippines. Les jaguars sont le Mexique et le Brsil. Dans une perspective marxiste on parle du centre et de la priphrie. Le centre tant les pays industrialiss occidentaux, capitalistes et les priphries tant les pays qui sont sous le poids dominant des pays du centre. La thse marxiste est de dire que finalement le capitalisme une contrainte majeure qui est de faire en sorte que tous les pays sont contraints de se diriger vers une conomie de march capitaliste parce quil y a des pressions, des violences fortes mais aussi que la contradiction du capitalisme (tre capable de produire toujours plus) explique la ncessit que tous les autres pays soient leur tout capitalistes. Nous sommes confronts des crises de surproduction car il ny a pas assez de mnages qui peuvent consommer. Jusqu aujourdhui Marx et Lnine ont tort. Avant le capitalisme les crises taient des crises de sous consommation. Ici les biens sont trop nombreux. Les pays passant dun rgime un autre sont des pays en transition. Ce concept depuis la chute du mur de Berlin est un concept dpass . 2- Lactualit des pays mergents Le concept est volutif. On ne peut pas considrer que les pays mergents soit un bloc homogne. Le concept est n dans les annes 1980 au moment o dans les pays en dveloppement on a constat un march boursier mergent. Dans ce march boursier mergent on y trouve des entreprises locales et nationales mais aussi des IDE (une multinationale investit en crant une filiale ltranger et y amne des technologies, de lexprience), des flux dinvestissements en portefeuille (on apporte du capital). Certains pays vont avoir un march boursier qui va exploser dautres non. Ceux qui sont dans ce crneau vont progressivement de venir des pays mergents. On constate une croissance rgulire de leur PIB. Il y a une croissance de leurs exportations de produits manufacturs. On constate des flux internationaux de capitaux. Il y a eu la fin des annes 1990 lArgentine et le Brsil qui ont connu des crises financires importantes suite lmergence de leurs marchs financiers, puis les pays dAsie du Sud Est puis la Turquie (1999 et 2001), la Russie(1998). Les principaux pays mergents du dbut du sicle sont lAfrique du Sud, lArgentine, le Brsil, la Chine, lInde, lIndonsie et la Turquie. Lensemble de ces pays reprsente 50 % de la population mondiale. Mais deux dentre eux forment 40 % de la population mondiale, cest lInde et la Chine. Le PIB par habitant en PPA en 2004 en Inde est de 3 139, en Argentine 13 298.
Page | 19
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Brsil Taux de croissance annuel moyen 1998 2007 (%) Taux dexportation* en 2006 Dette publique en % du PIB Rserve de change (milliards de dollars) 2,7
Russie 5,6
Inde 7
Chine 9,4
15 45 195
20 6 535
23 58 313
40 18 1 842
*Taux dexportation = taux dexportation des marchandises(X) / PIB Taux dimportation = M / PIB Taux douverture = X + M / PIB
IV-
Les carts de pauvret dans le monde
Les pauvrets dans le monde , J.C. Vrez. Quest-ce que la pauvret ? Il y a diffrentes pauvrets. 1- La pauvret montaire dans le monde Diagramme en forme de coupe de champagne . Le haut reprsente les hauts revenus. Pour lanne 2000 le revenu moyen en PPA dans le monde est de 5 333 $, le revenu mdian est de 1 700 $. En 2006 le revenu mdian en France est de 1 560 par mois. En 2000, 80 % de la population mondiale avait un revenu infrieur au revenu moyen ce qui reprsentait 450 $ par mois. Le revenu moyen des 20 % les plus riches est environ 50 fois plus lev que le revenu moyen des 20 % les plus pauvres. Dans les pauvres on distingue les pauvres et les extrmes pauvres. La pauvret correspond 2 $ par jour, lextrme pauvret correspond 1,25 $ par jour. Il y a 2 milliards dindividus dans le monde qui on 2 $ par jour. Les coefficients de GINI mesurent la concentration des revenus (coefficient de 1 100). Quand le coefficient est suprieur 50 on fait parti de la catgorie dingalit des revenus levs. Pour le monde le coefficient de GINI est gal 67. Le record est de 72,2 en Afrique Subsaharienne. Une toute minorit possde la majorit de la richesse. Pour les pays de lOCDE a revenu lev le coefficient de GINI est gal 36,8. A la fin du 20me sicle la banque mondiale avait calcul le nombre de personnes disposant dun dollar par jour pour vivre. En Afrique Subsaharienne il y avait 315 millions de personnes, en Asie de lEst 279 millions, en Asie du Sud 488 millions, Amrique Latine et Carabes 57 millions, Europe centrale et orientale 97 millions, Afrique du Nord et Proche Orient 6 millions. Total 1 milliard 169 millions de personnes en 1999, 2000. Etude en 2005 qui prvoit le nombre dextrmes pauvres en 2015, si la distribution des revenus reste constante il resterait 700 millions dextrmes pauvres. En revanche, si les revenus des pauvres augmentent deux fois Page | 20
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
plus vite que le revenu national en 2015 il y en aurait 440 millions. Le fait dagir sur la problmatique du revenu cest une question traite en France. Une partie de la valeur ajoute va vers le capital et lautre vers le travail. Le bouclier fiscal est un outil en faveur des entreprises qui se dveloppent, font des profits. 2- Les multiples pauvrets Il y a des gens non pauvres dun point de vue montaire mais pauvres dun point de vue capital humain, pas avoir demploi. Analphabtisme, difficults lemploi, privation des droits civiques, non accs la sant, la pauvret sociale ou relationnelle, la pauvret migratoire. Il ny a pas une mais des pauvrets, elles ne sont pas identiques ni travers le temps ni travers lespace, travers les expriences. Il y a des expriences, des reprsentations et des perceptions diverses de la pauvret. On peut avoir des systmes de solidarits. Il y a une reprsentation de la pauvret enfoui par lapproche morale (approche consciente ou non qui inclus des valeurs religieuses). Il y a la problmatique de laltruisme sauf quil y en a du bienveillant et du malveillant (on ne fait pas un geste pour lautre, on attend quelque chose en retour). La pauvret pour lconomiste est la pauvret montaire, la pauvret pour le sociologue est les systmes dassistance aux pauvres. Le psychologue social va sintresser aux reprsentations sociales de la pauvret. Lhistorien va aborder le rapport social de la pauvret. Il y a la pauvret humaine qui est la suite de lIDH, cest lIPH (indicateur de pauvret humaine). Il y a une diffrenciation sur lesprance de vie. Le niveau dinstruction : lanalphabte est priv de tout. Il y a la pauvret sociale ou relationnelle. On a deux types disolement : voulu ou subi. Solitude voulue ou solitude subi. Cette solitude peut amener lexclusion ou la marginalisation. Il y a plusieurs causes : lie la famille (dcs, divorce, parent isol), lie aux conditions naturelles (inondations, cyclones, sismes, tsunamis), les causes politiques (attentats, conflits armes, gnocides). Cette pauvret si elle tait mesure ne serait pas au mme niveau selon les socits. Plus les socits sont riches, plus la rentabilit lisolement augmente. Pauvret des conditions de vie. a concerne les conditions de logement et les conditions relatives au confort du logement (eau chaude, mtre carr par personne). Il y a les quipements (biens durables ou pas), pouvoir recevoir des amis. La pauvret administrative est complmentaire de la pauvret montaire. Concerne les bnficiaires des dispositifs daides sociales. Il y a lobservatoire national de la pauvret et de lexclusion sociale. En 2004 au sens montaire il y a avait 3 millions de franais pauvres et en 2005 3 millions de franais allocataires de minima sociaux. La pauvret migratoire. Cest voyager, circuler.
Conclusion du chapitre : La croissance ne rime pas de fait avec le dveloppement ni humain ni durable. La typologie des pays est volutive et insatisfaisante. La croissance mondiale ne doit pas masquer les pauvrets. Dans une perspective de bien tre, de progrs social, de justice il nest pas acquis que la richesse montaire soit suffisante.
Page | 21
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Chapitre 4 : Les acteurs de lconomie internationale et la problmatique de la gouvernance
Si la croissance ne permet pas le dveloppement, il faut orienter la croissance pour quelle puisse accroitre le dveloppement. Les acteurs cls de lconomie internationale sont les tats des pays riches, des fonds souverains, les firmes multinationales, la socit civile (ceux qui ne relvent pas de la puissance publique, politique et dont lobjectif nest pas lucratif) comme les ONG (les syndicats, communauts, associations, mouvements altermondialistes). Ce sont des acteurs qui psent sur lconomie internationale. Ensuite il y a des acteurs particuliers qui relvent despaces de non gouvernance : les rseaux informels. Si linformel existe, a pose les problmes des prlvements fiscaux et sociaux et surtout ltat na plus de recettes. Le problme cest quand linformel se dplace dans les rseaux clandestins mafieux, a devient a lgal. Entre les deux il y a les paradis fiscaux qui sont ni illgal ni informel mais font parti de la non gouvernance.
I-
Les firmes multinationales
Elles ont un rle essentiel dans les changes internationaux. Elles sont au cur des flux de capitaux et elles ont une mobilit de la main duvre. 1- Le poids croissant des firmes multinationales Une FMN est une entreprise qui possde des filiales quelle contrle compltement ou en partie dans plusieurs pays voire mme lchelle mondial mais dont la gestion et ladministration sont centralises. Elles se forment et croissent par annexion dentreprises, rachat, fusion ou autres alliances stratgiques. Outre des transferts de technologie, elles gnrent des transferts de capitaux. Elles peuvent imposer des prix, exerce du lobbying auprs des gouvernements, reprsenter un contre pouvoir. Parmi les filiales il va y en avoir une holding qui va soccuper de lpargne et de linvestissement et des crdits. Elle le fera pour tout le groupe. Daprs la CNUCED, en 2005, 77 000 entreprises seraient des multi internationale. Dans les 500 premires, 200 sont amricaines, 150 dorigine europenne, 60 dorigine japonaise. Elles contrlent 770 000 filiales. Cest travers leurs IDE que lon mesure leur rle dans lconomie mondiale. En 1982, les IDE entrants taient estims 58 milliards de dollars courants. En 2008, on est pass 1 697 milliards. Les IDE sortants en 1982 27 milliards, en 2008 1 858 milliards. En pourcentage du PIB ces IDE taient de 10 % en 1990, 27 % en 2005. Quelques pays prdominent : Etats-Unis, France, Chine, Allemagne, Royaume-Uni.
Page | 22
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
II-
Les tats, les fonds souverains et les acteurs de la socit civile
1- Les tats
La crise de 2008 a eu lavantage de montrer que les tats ont retrouv un certain rle. Avant, les tats avaient une influence sur lconomie internationale mais ils les dirigent, rgulent difficilement. La mondialisation fait que la comptitivit est difficile. La crise de 2008 a redor le blason des tats car sils navaient pas agit rapidement en concertation et pris les dcisions prises, nous aurions aujourdhui une crise plus importante que la crise de 1929. LEurope a inject 500 milliards deuros, la Chine a relanc son activit avec 460 milliards de dollars et les amricains ont injects 750 milliards de dollars. Ce sont les tats qui ont emprunts pour renflouer les banques qui devaient les rembourser. Aujourdhui ce qui pnalise la plupart des tats sauf la Chine cest le poids des dficits accumuls et donc le poids de la dette. Leur rle consiste limiter le dficit, limiter les dpenses. Les Etats-Unis et la Chine sont les pays qui ont le plus de poids dans le paysage international. Les Etats-Unis restent la premire puissance conomique en termes de PIB. Ensuite, sur les 500 premires FMN, 200 sont amricaines. Dans ces FMN il y a des FMN dans linnovation, dans la haute technologie Ce sont galement une puissance militaire. La banque centrale amricaine cre le dollar qui est impliqu dans 89 % dactions de change alors que leuro est impliqu 37 %. La Chine a une conomie comptitive qui se dveloppe dans un cadre politique particulier qui est le parti communiste chinois. Ce parti a russi sortir une Chine pauvre la Chine daujourdhui. La monnaie chinoise est sous value de 30 voire 40 %. Cela lui permet dtre comptitif. 2- Les fonds souverains Il sagit de fonds c'est--dire de budgets qui sont placs et investis par les tats qui ont la capacit de constituer ces fonds. Ils reoivent des niveaux levs de recettes en matire dexportation ou se sont des tats qui peuvent constituer des fonds souverains car ils ont des excdants budgtaires. Il ne sagit pas des avoirs des banques centrales (rserves dune conomie internationale). Cest une anticipation sur le moyen long terme. Il y en avait 5 en 1970, 75 en 2009. En 2008 leur gestion est estime entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars. A peu prs 50 % de ces fonds viennent du moyen orient, ensuite dAsie Orientale, puis des pays europens. Il y a des fonds financs ou qui proviennent dexcs budgtaires (recettes suprieures aux dpenses). Les rserves en or sont estimes 5 100 milliards. Le PIB mondial en 2007 est de 48 800 milliards de dollars. La capitalisation boursire mondiale est de 50 800 milliards. Une partie des fonds souverains sont originaires des pays musulmans. Certains ont tendance confondre ces fonds souverains avec les finances islamiques. Cette finance islamique est une finance qui doit respecter la tradition musulmane et dans cette tradition lactivit primaire est rgie par les rgles de la sharia. Elle introduit des notions dquits, a ne veut pas dire quil ny a pas les notions defficacit. Des comportements sont interdits : le prt intrt, la thsaurisation (ne pas utiliser son argent), le hasard est condamn, en revanche lesprit de Page | 23
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
lentrepreneur ou le commerce eux sont encourags. Une fois le profit acquis la finance islamique prconise un partage quitable des gains et des risques entre linvestisseur et lentrepreneur. Lensemble du march islamique est estim en 2008 700 milliards de dollars. Sont concerns les pays du golfe Persique et ceux dAsie du sud est (Arabie Saoudite et Malaisie). 3- Les acteurs de la socit civile Les organisations de la socit civile : OSC. Quand on parle de socit civile on parle dun espace qui nest pas celui du parti po litique mais des acteurs individuels ou regroups en associations qui nont pas dobjectif lucratif. Ce qui caractrise le mieux ces acteurs se sont les syndicats et les ONG. Daprs une organisation il y aurait environ 7 300 ONG dans le monde dont certaines sont connus notamment Greenpeace. En quoi les ONG reprsentent-elles un contre pouvoir ? Ils peuvent en reprsenter un qui nest pas balayer. Greenpeace est capable de mener des actions pour que certains tats ne fassent pas nimporte quoi. a peut faire reculer des dcisions politiques. Les acteurs de la socit civile peuvent exercer des pratiques de lobbying. En France il y a un lobby viticole. Les entreprises peuvent financer un parti politique qui va aller dans le sens de nos intrts. Ce nest pas illgal.
III-
Les espaces de non gouvernance
1- Les paradis fiscaux Cest lgal. Il sagit dchapper toute rglementation fiscale, de facto, toutes rglementations souveraines. Ils sont apparus la fin du 19me sicle, on les appelle aussi des places off-shore. Ces paradis fiscaux posent un problme majeur : parmi les capitaux qui circulent rien ne nous interdit de penser que circulent des capitaux provenant dactivits mafieuses. Il y a plusieurs critres et catgories de paradis fiscaux. Critres : taxation faible ou nulle pour les non rsidents (Cuba, Tanger au Maroc, Croatie, Afrique du Sud) ; secret bancaire renforc (Cambodge et Montngro) ; procdure denregistrement relche (Seychelles, Tunisie, Jordanie, Malte) ; libert totale des mouvements de capitaux (Luxembourg) Les sources de profit et les lieux o ils sont placs peuvent tre diffrents. Est-ce que a contribue linstabilit financire internationale ? Oui, car ils ne font lobjet daucune gouvernance. Personne ne peut le rglementer. Ensuite, du fait de labsence de la gouvernance ils ne sont pas surveiller. Personne ninterdit de considrer quils peuvent spculer. Enfin, largent sale peut devenir argent propre sans rglementation, sans surveillance.
Page | 24
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
2- Les fonds alternatifs (Hedge Funds) Ce sont des fonds dinvestissement. Ce sont des fonds de couverture ou des fonds de protection contre des fonds spculatifs. Il sagit de fonds qui utilisent des produits drivs (crdit swaps). La rvolution technologique a modifi ces produits. Ils sont trs diversifis et que leffet boule de neige existe dautant que ils sont conus essentiellement pour des rentabilits leves. 3- Les rseaux informels, clandestins, mafieux ou criminels Les activits informelles ou activits non dclares napparaissent pas dans les statistiques officielles mais elles crent malgr tout de la valeur ajoute. Lconomie au noir (ensemble des activits qui gnrent un revenu non dclar aux autorits publiques) est un lment de ces activits informelles. Il y a lconomie au noir au sens stricte qui est lconomie criminelle. Lconomie au noir au sens stricte est une conomie lgale mais les activits sont dissimules au fisc ainsi quaux organismes sociaux et on y trouve le travail au noir souvent occasionnel, le travail au noir organis et la non dclaration partielle de la production. Lconomie criminelle appartient lunivers illgal. Il y a lconomie de la drogue, la contrebande, les jeux de hasard interdits, la prostitution. Il y a toujours une trace, une possibilit de remonter datteindre des donnes statistiques du fait que ceux qui peroivent des revenus illgaux ou allgaux sont des individus qui consomment. Le produit criminel brut mondial reprsenterait 2,5 5 % du PIB mondial. Des questions vis--vis des responsables ou des partis politiques se posent. Comment financer officiellement les partis politiques ? Est-ce que les organisations sont en hausses ? Peut-tre et certainement oui. Dabord les trafics de drogue se multiplient, il y a de la contrefaon. Ensuite, il y a la criminalit conomique criminalit daffaire. Cette criminalit utilise les nouvelles technologies dinformations. Il y a galement les escroqueries (sur les crdits par exemple). Les facteurs qui favorisent la criminalit organise : la drglementation des marchs financiers laccroissement des flux internationaux de capitaux illicites dans le contexte des nouvelles technologies leffondrement des tats communistes Le crime organis nest pas nouveau mais il a pris une envole. Dernirement on a constat le trafic des organes. Derrire ce trafic il y a les progrs en matire de mdecine sur les questions de procration. Des questions dthique se posent. Laugmentation de la population et une pauvret qui ne recule pas vraiment laissent la porte ouverte ce type dorganisation.
IV-
Quelle gouvernance mondiale ?
Cest compliqu car il y a une pluralit des acteurs. Les mettre daccord nest pas simple. Ensuite certains relvent de la sphre publique, dautres de la sphre prive. Enfin, certains sont lgaux et dautres illgaux. Page | 25
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
1- Les origines de la notion de gouvernance Ce terme remonterait du 13me sicle du ct de la thorie de lentreprise et au sein de cette thorie les rgles qui associent les dirigeants et leurs actionnaires. Cela signifierait laction, la manire ou le fait de gouverner. Beaucoup plus tard, aprs la chute du mur de Berlin, Willy BRANDT cre une commission sur la gouvernance quil dsigne comme la somme des diffrentes faons dont les individus et les institutions (publiques comme prives) grent leurs affaires communes . Vingt ans aprs, GRAZ distingue trois niveaux de transfert dautorit : Celui o prvt la sphre publique Les sphres publiques et prives cohabitent, exemple : les agences prives de notation La sphre prive (club priv, lobby) 2- La gouvernance mondiale relve-t-elle des acteurs privs ? On pourrait dissocier trois catgories dautorits : Les autorits de march : les acteurs stratgiques sont les FMN, les cabinets comptables et les uns comme les autres ont dpass le cadre de la frontire nationale. Il y a une dmarche transnationale. Ces FMN comme ces cabinets comptables savent que des places sont plus privilgies que dautres. On doit dissocier le fait que les lieux de production ne sont plus les lieux de dcision. Les autorits morales : ce sont les mouvements sociaux internationaux dont les ONG qui veulent stopper la prolifration des armes de destruction massives. Cest considr comme une autorit morale. Les autorits illicites : ce sont les mafias qui violent les lois nationales et internationales. Les organisations criminelles sappuient sur des communauts ou diasporas qui sont partout. La gouvernance rclame une rgulation internationale. Le FMI essaye de renforcer la rgulation internationale. Les deux coles de penses restent les mmes. Oui pour certains la rgulation internationale car les acteurs privs ont du poids conomiques. Mais le problme est comment instaurer cette rgularisation. Il ny a pas aujourdhui dinstitution qui peut se prvaloir dtre linstitution rgulant lconomie internationale. Non pour dautres car par principe il y a avant tout des comportements qui tente de satisfaire son propre intrt. Il est impossible davoir un systme de rgulation internationale. La question conomique est comment essayer datteindre le plus de croissance ? Est-ce que la croissance et le dveloppement se portent mieux avec ou sans rgulation ?
Page | 26
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
Chapitre 5 : Les thories du dveloppement
Il y a chez les conomistes des conomistes du dveloppement. Depuis 50 ans, les politiques de dveloppement ne se sont pas amliores.
I-
La pense en conomie du dveloppement
Quatre temps : le temps des fondements (priode de dcolonisation), le projet tiers-mondiste, le libralisme (annes 1980, 1990) cest ce quon appelle le consensus de Washington, le post consensus. 1- La phase daprs guerre Cest une priode de reconstruction. Le contexte du ct des pays du Sud est de colonisation. Les stratgies de dveloppement sappuient sur des politiques interventionnistes de ltat, politiques publiques. Plusieurs pistes sont proposes. Les tapes de la croissance de Rostow, il faut commencer investir dans lagriculture condition que celle-ci dgage un surplus. La main duvre qui ny travaille plus va dans lindustrie. Ce dplacement est possible que ds lorsque lagriculture atteint une certaine productivit. Dans le secteur tertiaire, avec le dveloppement des services, une partie de la main duvre du secteur industriel se dirige dans ce secteur et une partie de la main duvre agricole vient dans les deux autres secteurs. La population active dans les pays industrialiss est infrieure 5 % de la population totale. Rostow considre quil est possible davoir des stratgies de dveloppement qui consistent de passer dun systme lautre. Ce qui peut tre reproch cette approche est dune part son caractre normatif. Les pays comme Singapour, Taiwan nont pas suivit ce dveloppement. Lessentiel de cette priode daprs guerre cest un rle accord ltat et un rle accord aux institutions. Pourquoi ? Les auteurs sont dans une dmarche post-keynsienne. Keynes dmontre que le march nest pas auto rgulateur. Rappel : Classiques : Libraux (Adam SMITH en 1776, RICARDO, SAY) il faut une concurrence pure et parfaite Socialistes (MARX) ne croient pas au march auto rgulateur Noclassiques : En 1870, des auteurs vont fustiger les penses marxistes. (WALRAS) Ltat ne doit pas trop intervenir. Contre son intervention ds lors quon dpasse les fonctions rgaliennes. Il peut intervenir pour combattre les monopoles, pour larme, la justice. Si on respecte on doit avoir Page | 27
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
un quilibre sur les diffrents marchs (biens et services, travail et capitaux). Modle dquilibre gnral par Walras. Keynes : 1929, premire grande crise financire. Parmi les acteurs celui qui peut dpasser les contraintes cest ltat. Une fois sortie de la crise, ltat doit se retirer. Nouvelle cole classique : Ils se rclament des noclassiques. Ils sont contre lintervention de ltat sauf pour justice, police, arme. Nouveaux keynsiens : Ils se rclament de la mouvance keynsienne. Ils restent favorable une intervention de ltat mais limit, encadr. Les stratgies daprs guerre sont des stratgies interventionnistes. On est dans une pense qui sinspire de la rflexion keynsienne. La croissance conomique et le dveloppement ont besoin du rle de ltat. On est dans la pense post keynsienne. Les marchs sont imparfaits, dans nos dcisions il y a des alas, des incertitudes. On peut atteindre le point dquilibre mais cest lexception. Incertitude => risque => instabilit. Il faut donc rechercher des rgles institutionnelles ou institutionnalises. Parmi les institutions il y a la macro institution quest ltat. 2- La phase des annes 1970 - 1980 Dans cette priode le modle de rgulation tatique est remis en cause. On retrouve les principes fondamentaux de lconomie de march. Ces principes vont sincarner travers le consensus de Washington. Ce consensus consiste proposer des stratgies de dveloppement qui sont essentiellement fondes sur le libralisme conomique, le libralisme montaire, le libralisme commercial. Le socle de la stratgie de dveloppement est le libralisme. Les institutions de Bretton Woods qui sont le FMI et la banque mondiale ont t cres dans le cadre de laprs guerre. Le libralisme conomique ce sont les fondamentaux de la pense noclassique. Le libralisme montaire : faire en sorte que dautres monnaies peuvent entrer sur le march national. Le libralisme commercial : ouvrir les frontires sinon on refuse dimporter. Cette priode va aboutir des mesures pour les pays en dficit plutt drastiques : programme dajustement structurel (PAS). Mme sous contrainte on peut faire des choix rationnels. Pour certains pays il faut commencer par rduire les dpenses pour pouvoir se dvelopper. 3- La phase post consensus de Washington Cest une volont de redonner un peu de crdit aux institutions et donc de redonner du crdit aux micros institutions et la macro institution qui est ltat. Cette volont se fait suite la priode prcdente mais aussi la volont de pouvoir octroyer de la part des bailleurs de fond Page | 28
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
des aides si et seulement si ltat et les institutions affichent une bonne gouvernance. Il faut une remise en cause de deux flaux qui sont la corruption et le poids de lconomie informelle. Lconomie informelle est un vritable flau puisque plus elle est prsente moins les recettes fiscales sont leves. La corruption : il y a une volont dinstaurer des institutions garantes de la bonne gouvernance. Il est trs difficile de restaurer une confiance lorsque les gens ont toujours vcu dans la corruption. Toute aide financire passe par un contrat de non corruption.
II-
Les rfrents thoriques en conomie du dveloppement
1- Les questionnements des thories conomiques du dveloppement
Il sagit de rflexions dconomistes qui se disent comment mettre en place une stratgie de dveloppement efficace. Quel type de dveloppement ? Sur quel pilier ? Comment les socits se forment-elles et comment voluent-elles ? La France a t une socit en dveloppement. Ces socits suivent-elles un trend de croissance avec des degrs divers de dveloppement ? Quel est le rle des mentalits et des institutions dans le processus de dveloppement ? La question de la rpartition du revenu. La problmatique se pose a fortiori quand il ny a pas de mcanisme de redistribution. Les carts et les ingalits sont plus forts sans ces mcanismes. Depuis une quinzaine dannes, les thories conomiques du dveloppement sont revenus sur les fondamentaux. Les personnes qui y travaillent reviennent sur des problmatiques comme le commerce international. Il faut rflchir sur la mthode pour sinsrer sur le commerce international. Ensuite, lun des facteurs de la croissance est le facteur du capital humain. Cest source de progrs technique, innovation. Lconomie du dveloppement est donc oblige dy revenir. La question de la maitrise des nouvelles technologies est trs importante. Il faut investir dans les infrastructures pour cela il faut des moyens.
Hypothses ou postulats ?
Comment lconomiste doit-il affronter linterrogation sur le dveloppement ? Doit-il tre dans une dmarche mono ou pluridisciplinaire ? Lconomiste doit tre humble et accepter davoir une dmarche pluridisciplinaire do il doit mettre des hypothses plutt que des postulats.
La porte du terrain et thorie formelle
Si on ne connait pas le terrain cest difficile de faire de lconomie du dveloppement. Il ne faut pas opposer au terrain la thorie formelle qui peut adopter une dmarche dductive. Elle est de lordre de la dmonstration logique, mais la thorie formelle doit tre confronte au terrain. Il faut galement diffrencier croissance et dveloppement.
Page | 29
A.Closse
Croissance et Dveloppement
L3 AES
2- Rationalit substantive, limite ou situe ? En quoi une dcision est rationnelle ? En quoi lacte de corruption est un acte rationnel ? Lauteur de lapproche de la rationalit substantive sappelle SIMON. Il lattribue lanalyse noclassique quil dissocie de la rationalit limite qui concerne davantage les sciences humaines. On peut galement voquer ct de cette rationalit, la rationalit situe ou contextuelle. La rationalit substantive est le principe de la thorie noclassique parce que cest le point de dpart de tous les comportements et des dcisions de lagent individuel ds lors que celui-ci dispose de linformation ncessaire. En fonction de linformation on fait ou pas le choix. Il faut avoir accs linformation et tenter davoir la meilleure information. La rationalit limite au sens de SIMON est limite non par choix mais par contrainte. Ce nest pas non plus le fait quon soit irrationnel. Il sagit dun contexte dans lequel toutes les informations ncessaires ou lments utiles pour prendre la dcision on ne les a pas. La rationalit situe ou contextuelle. Il faut prendre en considration la situation ou le contexte de laction. Par exemple en ASS lacteur est soumis des contraintes communautaires. Ces contraintes se superposent la logique individualiste maximisatrice (sous contrainte je maximise). La dcision ne peut tre prise que dans le contexte on se situe. 3- Le rle des institutions Pourquoi lconomie du dveloppement en a besoin ? Pour rduire lasymtrie dinformation, les incertitudes, les risques on doit recourir aux institutions. Plus loin que lasymtrie dinformation il y a la slection adverse et plus loin de cela il y a lala moral (pouvoir dinfluence). Pour viter ces comportements il faut des sanctions. Pour avoir des sanctions il faut des institutions. Autant lcole que le mariage sont des institutions. Derrire on retrouve la thorie du contrat. Le problme est quil faut faire attention ce que cela ne se transforme pas en bureaucratie tatillonne.
Page | 30
A.Closse
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours Sociologie Du Travail L3 AESDocument29 pagesCours Sociologie Du Travail L3 AESPitchoune6289100% (17)
- Ikea - Gestion de StocksDocument6 pagesIkea - Gestion de StocksRaoufPas encore d'évaluation
- 5083faa3 1608190085656Document5 pages5083faa3 1608190085656max hebertPas encore d'évaluation
- Cours Contentieux Administratif, Licence AESDocument69 pagesCours Contentieux Administratif, Licence AESPitchoune6289100% (8)
- Cours Économie Internationale, Licence 3 AESDocument31 pagesCours Économie Internationale, Licence 3 AESPitchoune628993% (15)
- Cours Économie Internationale, Licence 3 AESDocument31 pagesCours Économie Internationale, Licence 3 AESPitchoune628993% (15)
- Cours Économie D'entreprise, L2 AESDocument54 pagesCours Économie D'entreprise, L2 AESPitchoune6289100% (9)
- Cours Sociologie, L2 AESDocument21 pagesCours Sociologie, L2 AESPitchoune6289100% (3)
- Théorie ComptableDocument313 pagesThéorie ComptableFrancois GregoryPas encore d'évaluation
- Cours Théorie de Développement - 2020-1Document29 pagesCours Théorie de Développement - 2020-1Leonard Ilboudo75% (4)
- L' ARGENT DE L'ETAT : POURQUOI ET COMMENT: Tome 2 : la dépenseD'EverandL' ARGENT DE L'ETAT : POURQUOI ET COMMENT: Tome 2 : la dépensePas encore d'évaluation
- CHAP 1 - 12 - Les Facteurs de La Croissance (Cours Ter) (2012-2013) PDFDocument29 pagesCHAP 1 - 12 - Les Facteurs de La Croissance (Cours Ter) (2012-2013) PDFAhlemPas encore d'évaluation
- TD2 MacroDocument3 pagesTD2 MacroWill Steven50% (2)
- L3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEDocument37 pagesL3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEPitchoune628971% (7)
- Cours Economie Du Travail, L3 AESDocument26 pagesCours Economie Du Travail, L3 AESPitchoune6289100% (8)
- Cours Droit Des Contrats Publics, L2 AESDocument22 pagesCours Droit Des Contrats Publics, L2 AESPitchoune6289100% (1)
- Cours Création D'entreprise, L2 Administration Economique Et SocialeDocument37 pagesCours Création D'entreprise, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (18)
- Cours Droit Administratif, L2 Administration Economique Et SocialeDocument22 pagesCours Droit Administratif, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (3)
- Management de CriseDocument72 pagesManagement de CriseVanderDaikain0% (1)
- Cours Economie de DeveloppementDocument48 pagesCours Economie de DeveloppementAssa Aboa-Cotchie100% (1)
- Croissance Et DéveloppementDocument16 pagesCroissance Et DéveloppementNelsia29Pas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Le Développement ÉconomiqueDocument6 pagesChapitre 2 Le Développement ÉconomiqueChaimae Bouzagane100% (1)
- Thème 111 - Le PIBDocument51 pagesThème 111 - Le PIBMme et Mr Lafon100% (1)
- Fiche 1 - Quelles Sont Les Sources de La Croissance Économique - Le PIB, Un Indicateur Pertinent Et Suffisant Pour Mesurer La CroissanceDocument7 pagesFiche 1 - Quelles Sont Les Sources de La Croissance Économique - Le PIB, Un Indicateur Pertinent Et Suffisant Pour Mesurer La CroissanceMme et Mr Lafon100% (1)
- Inflation: Découvrez les risques, les mythes, les opportunités, comment protéger votre patrimoine et les techniques pour tirer profit de la forte inflationD'EverandInflation: Découvrez les risques, les mythes, les opportunités, comment protéger votre patrimoine et les techniques pour tirer profit de la forte inflationÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- L'OCDE face aux défis de la mondialisation: Organisation de coopération et de développement économiquesD'EverandL'OCDE face aux défis de la mondialisation: Organisation de coopération et de développement économiquesPas encore d'évaluation
- Fiche - Théories de La Croissance ÉconomiqueDocument3 pagesFiche - Théories de La Croissance Économiquemaroine ikhmim100% (2)
- Chapitre Introductif Croissance DéveloppementDocument13 pagesChapitre Introductif Croissance DéveloppementMme et Mr Lafon100% (11)
- Croissance EndogeneDocument14 pagesCroissance EndogeneTony Nativel100% (1)
- La Théorie de La Croissance EndogèneDocument5 pagesLa Théorie de La Croissance EndogèneNouhaila ZaghriPas encore d'évaluation
- Croissance ÉconomiqueDocument2 pagesCroissance ÉconomiqueDaniel Bucur100% (1)
- Exercice de Modele de DeveloppementDocument2 pagesExercice de Modele de DeveloppementGuillaumeKouassi100% (2)
- Fiche 3 À 5 Du Chapitre Croissance Et Développement 2010-2011Document12 pagesFiche 3 À 5 Du Chapitre Croissance Et Développement 2010-2011Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Les Relations Economique InternationalesDocument58 pagesLes Relations Economique InternationalesEvox50% (2)
- Chapitr 1) La Croissance Économique Et Sa Mesure (Résumé)Document3 pagesChapitr 1) La Croissance Économique Et Sa Mesure (Résumé)JASSER200982% (50)
- 2 Problemes Economiques Et SociauxDocument14 pages2 Problemes Economiques Et SociauxmohamedPas encore d'évaluation
- Relation Économique InternationaleDocument22 pagesRelation Économique InternationaleAyoub AdardorPas encore d'évaluation
- TD 2 Methodologie D Ela Dissertation Le Pib Est-Il Un Bon Indicateur de La Croissance Et Du DéveloppementDocument5 pagesTD 2 Methodologie D Ela Dissertation Le Pib Est-Il Un Bon Indicateur de La Croissance Et Du DéveloppementMme et Mr Lafon100% (2)
- Croissance Et DéveloppementDocument3 pagesCroissance Et DéveloppementDesboisPas encore d'évaluation
- La Croissance ÉconomiqueDocument14 pagesLa Croissance ÉconomiqueHicham AtroniPas encore d'évaluation
- Cours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialeDocument35 pagesCours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (9)
- Fiche 311 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableDocument7 pagesFiche 311 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Thème 2 - Les Relations Entre Croissance Et Développement Économique 2009-2010Document36 pagesThème 2 - Les Relations Entre Croissance Et Développement Économique 2009-2010Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Alizée Samantha - Analysez La Relation Entre Croissance Et DéveloppementDocument3 pagesAlizée Samantha - Analysez La Relation Entre Croissance Et DéveloppementMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- 2131 - Comment Définir La MondialisationDocument2 pages2131 - Comment Définir La MondialisationMme et Mr Lafon100% (1)
- Le Concept de Developpement PDFDocument6 pagesLe Concept de Developpement PDFSaad HakawiPas encore d'évaluation
- MondialisationDocument15 pagesMondialisationmassipssaPas encore d'évaluation
- Politique Économique (Résumé)Document3 pagesPolitique Économique (Résumé)MouradBardach100% (1)
- Fiche 311 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableDocument7 pagesFiche 311 - La Croissance Économique Est-Elle Compatible Avec Le Développement DurableMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- La Régulation Par Le MarchéDocument6 pagesLa Régulation Par Le Marchémokademamina67% (3)
- Devoir Comptabilité Nationale 2008 2009Document3 pagesDevoir Comptabilité Nationale 2008 2009Mme et Mr Lafon100% (1)
- L'aide Internationale Est-Elle Suffisante Pour Le Développement Des Pays Du SudDocument22 pagesL'aide Internationale Est-Elle Suffisante Pour Le Développement Des Pays Du SudTanou Balla SakouvoguiPas encore d'évaluation
- Economie Internationale I-1Document13 pagesEconomie Internationale I-1Salma ElkhatebPas encore d'évaluation
- I La MondialisationDocument2 pagesI La Mondialisationyoyo921Pas encore d'évaluation
- Quelles Sont Les Sources de La Croissance ÉconomiqueDocument11 pagesQuelles Sont Les Sources de La Croissance ÉconomiqueYasmine BouddPas encore d'évaluation
- Disertation Economique 2 PDFDocument16 pagesDisertation Economique 2 PDFTayeb BouguedraPas encore d'évaluation
- Croissance Et DeveloppementDocument16 pagesCroissance Et DeveloppementHafssa BENDRISS100% (3)
- Question Corrigé EconomieDocument61 pagesQuestion Corrigé EconomieHatim El Otmani100% (5)
- Chapitre 1 Notions Fondamentales en Économie Et GestionDocument34 pagesChapitre 1 Notions Fondamentales en Économie Et Gestionzainab ben moumenPas encore d'évaluation
- Commerce InternationalDocument15 pagesCommerce InternationalKaneki GoulPas encore d'évaluation
- Correction Devoir Comptabilité NationaleDocument5 pagesCorrection Devoir Comptabilité NationaleMme et Mr Lafon100% (1)
- Chapitre Mondialisation Fiches 2008-2009Document91 pagesChapitre Mondialisation Fiches 2008-2009Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Resumen - Économie Du DéveloppementDocument23 pagesResumen - Économie Du DéveloppementAnaBarahona100% (2)
- Chapitre 1 La Mondialisation Des Échanges PDFDocument2 pagesChapitre 1 La Mondialisation Des Échanges PDFMoussa Idriss AliPas encore d'évaluation
- Cours Economie Internationale Agdal ZouiriDocument124 pagesCours Economie Internationale Agdal ZouiriHicham Ait-bellaPas encore d'évaluation
- TD 1 - La Fonction de La ProductionDocument31 pagesTD 1 - La Fonction de La ProductionMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- R - Sum - PES ' Karim Economiste'Document9 pagesR - Sum - PES ' Karim Economiste'Maro HakPas encore d'évaluation
- Les Facteurs de La Croissance EconomiqueDocument22 pagesLes Facteurs de La Croissance Economiqueaminedabbabi100% (1)
- Croissance Économique ThéorieDocument69 pagesCroissance Économique ThéorieWalid Essafi100% (1)
- Cours Sociologie, L3 AESDocument27 pagesCours Sociologie, L3 AESPitchoune6289100% (1)
- L3 AES, Finances PubliquesDocument74 pagesL3 AES, Finances PubliquesPitchoune628967% (3)
- Cours Démographie, L3 AESDocument21 pagesCours Démographie, L3 AESPitchoune6289100% (3)
- Cours Villes Et Territoires Urbains, L2 AESDocument20 pagesCours Villes Et Territoires Urbains, L2 AESPitchoune6289Pas encore d'évaluation
- Cours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialeDocument35 pagesCours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (9)
- Cours Droit Pénal, L2 AESDocument43 pagesCours Droit Pénal, L2 AESPitchoune62890% (1)
- Cours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialeDocument69 pagesCours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialePitchoune628950% (2)
- Banque Finance D'entrepriseDocument2 pagesBanque Finance D'entrepriseN'GORANPas encore d'évaluation
- Leadrship G31 PDFDocument18 pagesLeadrship G31 PDFMouaad AlouaniPas encore d'évaluation
- Principes Management - Leçon 10Document14 pagesPrincipes Management - Leçon 10Ronnie BibaPas encore d'évaluation
- Gestion FinancièreDocument6 pagesGestion FinancièreHamzaoui Ammar0% (1)
- Mise en Place D Un Tableau de Bord de Gestion ConvertiDocument110 pagesMise en Place D Un Tableau de Bord de Gestion ConvertiSaad Ghoummid100% (1)
- Acteurs Du Droit de ConsommationDocument19 pagesActeurs Du Droit de ConsommationMohammed Amine100% (1)
- Gestion BudgétaireDocument178 pagesGestion Budgétairefouad100% (2)
- Formes Fiscales Orientees Vers La Modernisation Des OutilsDocument12 pagesFormes Fiscales Orientees Vers La Modernisation Des OutilsKarim HaddadiPas encore d'évaluation
- DVPT CorrigéDocument17 pagesDVPT CorrigéVahatra AngelaPas encore d'évaluation
- Nego InternationaleDocument59 pagesNego InternationaleceypekPas encore d'évaluation
- Audit Des Fonctions Et Des Processus 1 PDFDocument81 pagesAudit Des Fonctions Et Des Processus 1 PDFHamza Bettach100% (1)
- Du Tableau de Bord A La Strategie de Financement1Document27 pagesDu Tableau de Bord A La Strategie de Financement1bama_parisPas encore d'évaluation
- Compta Des Sociétés Commerciales PDFDocument97 pagesCompta Des Sociétés Commerciales PDFOuedraogo CherifPas encore d'évaluation
- Contrôle de Gestion S8 AUDIT COURS N°1 PDFDocument26 pagesContrôle de Gestion S8 AUDIT COURS N°1 PDFYASSINE IROUMEN100% (1)
- RSE Et RH PDFDocument4 pagesRSE Et RH PDFHafsa KIASSIPas encore d'évaluation
- StyadiDocument71 pagesStyadisap2000Pas encore d'évaluation
- Trouver Un Emploi en Europe - Guide Du Chercheur D'emploi EuresDocument16 pagesTrouver Un Emploi en Europe - Guide Du Chercheur D'emploi EuresCaroline BaillezPas encore d'évaluation
- CH 3 GRH Et PerformanceDocument14 pagesCH 3 GRH Et Performanceدروس مصباحPas encore d'évaluation
- Note LeanDocument38 pagesNote Leanoualid belouadahPas encore d'évaluation
- CHAPITRE II Expoer 4Document6 pagesCHAPITRE II Expoer 4Soulaiman AmraniPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage ComptabiliteDocument31 pagesRapport de Stage ComptabiliterobbenPas encore d'évaluation
- Dimensions Stratégiques de L'information Dans L'entrepriseDocument7 pagesDimensions Stratégiques de L'information Dans L'entrepriseKarim ElPas encore d'évaluation
- Catalogue Des Masteres ISGT 2021Document34 pagesCatalogue Des Masteres ISGT 2021Yasser HajjejPas encore d'évaluation
- 537 e 03 D 835542Document6 pages537 e 03 D 835542Anass CherrafiPas encore d'évaluation
- Les Systèmes Instrumentés de Sécurité Cours m1SIEDocument137 pagesLes Systèmes Instrumentés de Sécurité Cours m1SIEAmine YamaniPas encore d'évaluation
- Le Management Des Organisations Peut Être Défini CommeDocument20 pagesLe Management Des Organisations Peut Être Défini CommePape Yaba NdiourPas encore d'évaluation