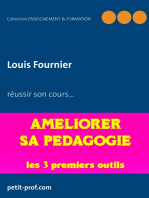Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
4 Didactique Des Disciplines VF Juillet 09
4 Didactique Des Disciplines VF Juillet 09
Transféré par
Mayssa Rjaibia0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
22 vues90 pagesTitre original
188144940 4 Didactique Des Disciplines VF Juillet 09
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
22 vues90 pages4 Didactique Des Disciplines VF Juillet 09
4 Didactique Des Disciplines VF Juillet 09
Transféré par
Mayssa RjaibiaDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 90
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
MINISTERE DE LENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE, DE LELEMENTAIRE,
DU MOYEN SECONDAIRE ET DES LANGUES NATIONALES
DIRECTION
DES
RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION
DE
LENSEIGNEMENT LMENTAIRE
FORMATION CONTINUE DIPLMANTE DES MATRES CONTRACTUELS
FASCICULE
DIDACTIQUE DES DISCIPLINES
LLMENTAIRE
JUILLET 2009
APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER
UNESCO BREDA / GOUVERNEMENT DU JAPON / ACDI CANADA
. .
2
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION
DIDACTIQUE DU FRANAIS ................................................................................. 7
1 LANGAGE........................................................................................................ 8
1.1 Objectifs..................................................................................................... 9
1.2 Principes mthodologiques ........................................................................ 9
1.3 Dmarche base sur la prsentation dnoncs par les lves.................. 9
1.4 Dmarche base sur la prsentation dnoncs par le matre.................. 10
2 EXPRESSION ORALE ................................................................................... 12
2.1 Objectifs................................................................................................... 13
2.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 13
2.3 Dmarche globale.................................................................................... 13
2.3.1 Type de leon : transmission dinformations...................................... 13
2.3.2 Type de leon : changes verbaux ................................................... 15
3 EXPRESSION ECRITE................................................................................... 17
3.1 Objectifs................................................................................................... 18
3.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 18
3.3 Dmarche ................................................................................................ 18
3.3.1 1
er
volet : tude du texte support ....................................................... 18
3.3.2 2
me
volet : tude des disciplines outils........................................... 19
3.3.3 3
me
volet : Rdaction du texte prvu dans le Projet dcriture........... 19
4 LECTURE....................................................................................................... 21
4.1 Objectifs................................................................................................... 22
4.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 22
4.3 Dmarches............................................................................................... 22
5 GRAMMAIRE - CONJUGAISON.................................................................... 26
5.1 Objectifs................................................................................................... 27
5.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 27
5.3 Dmarche ................................................................................................ 27
6 VOCABULAIRE.............................................................................................. 29
6.1 Objectifs................................................................................................... 29
6.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 29
6.3 Dmarche ................................................................................................ 30
7 ORTHOGRAPHE............................................................................................ 31
7.1 Objectifs................................................................................................... 32
7.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 32
7.3 Dmarche ................................................................................................ 33
3
8 ECRITURE - GRAPHISME............................................................................. 35
8.1 Objectifs................................................................................................... 35
8.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 36
8.3 Dmarche ................................................................................................ 36
9 RECITATION.................................................................................................. 37
9.1 Objectifs................................................................................................... 37
9.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 37
9.3 Dmarche ................................................................................................ 38
DIDACTIQUE DES MATHMATIQUES ................................................................ 40
10 ACTIVITES GEOMETRIQUES ....................................................................... 41
10.1 Objectif..................................................................................................... 41
10.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 42
10.3 Dmarche ................................................................................................ 42
11 ACTIVITES DE MESURE............................................................................... 44
11.1 Objectifs................................................................................................... 44
11.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 45
11.3 Dmarche pour ltude des grandeurs ..................................................... 46
12 ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEMES.......................................... 47
12.1 Objectifs................................................................................................... 47
12.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 48
12.3 Dmarche ................................................................................................ 49
13 ACTIVITES NUMERIQUES............................................................................ 50
13.1 Objectifs................................................................................................... 51
13.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 51
13.3 Dmarche ................................................................................................ 52
EDUCATION LA SCIENCE ET LA VIE SOCIALE.......................................... 54
14 HISTOIRE....................................................................................................... 55
14.1 Objectifs................................................................................................... 55
14.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 56
14.3 Dmarche pdagogique........................................................................... 57
15 GOGRAPHIE................................................................................................ 59
15.1 Objectifs................................................................................................... 59
15.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 60
15.3 Dmarche pdagogique........................................................................... 60
16 INITIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE...................................... 62
16.1 Objectifs................................................................................................... 62
16.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 63
16.3 Dmarches pdagogiques ....................................................................... 63
16.4 Dmarche exprimentale ......................................................................... 64
16.5 Dmarche dordre technologique ............................................................. 65
4
17 VIVRE DANS SON MILIEU ............................................................................ 67
17.1 Objectifs................................................................................................... 67
17.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 68
17.3 Dmarches pdagogiques ....................................................................... 68
18 VIVRE ENSEMBLE ........................................................................................ 71
18.1 Objectifs................................................................................................... 72
18.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 72
18.3 Dmarche pdagogique........................................................................... 72
EDUCATION PHYSIQUE, SPORTIVE ET ARTISTIQUE....................................... 75
19 ACTIVITS PHYSIQUES ET SPORTIVES..................................................... 76
19.1 Objectifs................................................................................................... 76
19.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 77
19.3 Dmarches pdagogiques ....................................................................... 77
20 ARTS PLASTIQUES - DESSIN...................................................................... 80
20.1 Objectifs................................................................................................... 80
20.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 81
20.3 Dmarche pdagogique........................................................................... 81
21 EDUCATION MUSICALE - CHANT................................................................ 83
21.1 Objectifs................................................................................................... 83
21.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 84
21.3 Dmarche pdagogique........................................................................... 84
22 ARTS SCENIQUES LE THTRE.............................................................. 86
22.1 Objectifs................................................................................................... 86
22.2 Principes mthodologiques ...................................................................... 87
22.3 Dmarches pdagogiques ....................................................................... 87
VALUATION DE LA FORMATION
5
REMERCIEMENTS
La Direction des Ressources Humaines remercie toutes les personnes qui ont
particip llaboration des fascicules de la FCD, particulirement les rdacteurs, les
membres de lquipe Technique Nationale, les directeurs et formateurs des EFI, qui
en plus de leurs charges au niveau de leur structure, se sont entirement donns
pour la ralisation de ce travail.
Les remerciements sadressent aussi tous les Partenaires Techniques et
Financiers notamment lAgence Canadienne de Dveloppement Internationale
(ACDI), lUNESCO BREDA avec le Gouvernement du Japon.
Une mention particulire Mme Carolle Lvesque, conseillre en ducation de
lACDI, pour sa disponibilit et son accompagnement efficace tout au long du
processus de ralisation des fascicules.
Composition de lquipe de rdacteurs
Sous la conduite de
DIOUF Adama ME/DRH
DIOP MBODJI Khady IDEN/Grand Dakar 2
Avec la participation de
COULIBALY Mamadou PRF/This
DIAKHATE Kaba IDEN/Guinguino
DIONE Franoise Anna ANCTP
FAYE Mamadou EFI/Kaolack
FAYE Talla IDEN/This Commune
FALL Abdou IDEN/Rufisque 1
MBAYE Amadou Sakhir Inspection des Daraa
MBAYE Moussa IDEN/Diourbel
MBENGUE Mandione ME/DEE
NDIAYE DIOP Fatou IDEN/This Dpartement
NDIAYE Oumar IA/Diourbel
KANT Moussa EFI/Kolda
SALL Hameth Inspection des Daraa
SAMB Babacar EFI/This
SARR DIENG Aissatou ME/DPRE
SOW Makhtar ME/DPVE
SOW Mamadou Abdoul ME/CNFIC
SOW Massye IDEN/Goudomp
TINE Bassirou EFI/Diourbel
6
INTRODUCTION
Le fascicule sur la didactique des disciplines se propose de mettre la disposition
des enseignants du prscolaire et de llmentaire des ressources pour : (i) Le
relvement du niveau acadmique et de qualification professionnelle ; (ii) La
prparation des examens professionnels du CEAP et du CAP et (iii) Lamlioration
des rendements scolaires.
Le fascicule sur la didactique des disciplines comporte :
Pour le sous-secteur de lducation prscolaire quatre modules :
o Activits langagires orales (langage et conte)
o Activits langagires crites (graphisme et lecture)
o Eveil au milieu (veil scientifique et technologique, environnement-
citoyennet)
o Education psychomotrice et artistique
Pour le sous-secteur de lenseignement lmentaire quatre composantes :
o Le domaine Franais
o Le domaine Mathmatiques
o Le domaine Education la science et la vie sociale (ESVS)
o Le domaine Education physique sportive et artistique (EPSA)
Le dveloppement de chaque activit disciplinaire respecte le canevas suivant :
o Pr-test ou situation dentre
o Introduction
o Objectifs
o Principes mthodologiques
o Dmarches
o Exercices
o Situations dintgration
o Pour en savoir plus
En guise dvaluation formative, des exercices sont proposs tout au long du
dveloppement de lactivit disciplinaire. Une situation dintgration est prvue la
fin de chaque sous-domaine ou module pour valuer la comptence.
Comme le montre le tableau ci-dessous, 30 des 144 heures prvues pour la
formation prsentielle sont consacres la didactique des disciplines.
Fascicules Heures
Pdagogie gnrale 28
Didactique des disciplines au prscolaire et
Didactique des disciplines llmentaire (Franais,
Mathmatiques, ESVS et EPSA)
30
Elments de psychologie 14
Morale professionnelle et Lgislation 16
Techniques de dissertation littraire - pdagogique et tudes
duvres littraires
28
Analyse de travaux denfants et critique de cahier dlves 14
Techniques dlaboration de fiche argumente 14
Ce fascicule na pas lambition dtre exhaustif. Il sagit de mettre la disposition de
lenseignant (e) un minimum indispensable lexercice de sa profession. Il est de la
responsabilit de chacun dlargir et dapprofondir sa formation par des lectures et
des changes tel que prconis dans la rubrique Pour en savoir plus
7
DIDACTIQUE DU FRANAIS
Pour toutes les disciplines de lducation prscolaire et de lenseignement lmentaire, la
personne forme doit intgrer les principes de psychopdagogie et de didactiques dans des
situations dlaboration de fiches pdagogiques ou de dissertations psychopdagogiques.
COMPTENCE VISE
Pour toutes les composantes du franais lcole lmentaire, la personne forme doit
intgrer les principes de psychopdagogie et de didactiques dans des situations
dlaboration de fiches pdagogiques ou de dissertations psychopdagogiques.
Comptences des sous domaines
Communication orale
En communication orale lcole lmentaire, la cible doit intgrer les principes de
psychopdagogie et de didactiques dans des situations dlaboration de fiches
pdagogiques et de mise en uvre de sances denseignement/ apprentissage ou de
dissertations psychopdagogiques.
Communication crite
En communication crite lcole lmentaire, la cible doit intgrer les principes de
psychopdagogie et de didactiques dans des situations dlaboration de fiches
pdagogiques et de mise en uvre de sances denseignement apprentissage ou de
dissertations psychopdagogiques.
Objectifs pour les activits disciplinaires
COMMUNICATION ORALE
Langage Expression orale
Elaborer des fiches pdagogiques et mettre
en uvre des sances
denseignement/apprentissage en langage
la premire tape de lcole lmentaire
Elaborer des fiches pdagogiques et mettre
en uvre des sances
denseignement/apprentissage en expression
orale aux deuxime et troisime tapes de
lcole lmentaire
COMMUNICATION ECRITE
Lecture Gram. Conj. Ortho. Voc. Rcitation Exp. crite
Elaborer
des fiches
raisonnes
et excuter
des leons
de lecture
lcole
lmentair
e
Elaborer
des fiches
raisonnes
et excuter
des leons
de
grammaire
lcole
lmentair
e
Elaborer
des fiches
raisonnes
et excuter
des leons
de
conjugaiso
n lcole
lmentair
e
Elaborer
des fiches
raisonnes
et excuter
des leons
de
conjugaiso
n lcole
lmentair
e
Elaborer
des fiches
raisonnes
et excuter
des leons
de
vocabulair
e lcole
lmentair
e
Elaborer
des fiches
raisonnes
et excuter
des leons
de
rcitation
lcole
lmentair
e
Elaborer
des fiches
raisonnes
et excuter
des leons
de
production
dcrits
lcole
lmentair
e
8
1 LANGAGE
PR TEST
Dans le fascicule Langage et expression orale de la collection Outils pour les matres, on a
crit ceci : La leon de langage na pas pour objectif de faire apprendre un dialogue par
cur mais daider les lves sexprimer en franais dans une situation de la vie courante.
Nest ce pas un bon sujet de dissertation pdagogique ?
1. Avez-vous des arguments pour traiter ces propos ?
2. Pouvez-vous en tirer des applications pratiques pour laborer et argumenter une
fiche de conduite de classe ?
Essayez dabord de rpondre ces questions. Puis, lisez les informations qui suivent.
Introduction
Dans les reprsentations et la pratique de classe, on remarque encore chez plusieurs
enseignants la tendance assimiler toute leon de langage la comprhension et la
mmorisation dun dialogue. Cette ralit doit tre revisite pour deux raisons au moins.
Dabord, les situations de la vie font appel des narrations, des descriptions, des comptes
rendus, lvocation de situations imaginaires. En somme, communiquer nest pas
synonyme de dialoguer. Le dialogue nest quun outil servant lapprentissage et non une
fin en soi.
Ensuite, mmoriser un dialogue est peut-tre trs rducteur. Pour demander quelquun de
vous prter un crayon par exemple, on peut utiliser plusieurs noncs diffrents : prtez-
moi un crayon, sil vous plat, Voulez-vous me prter un crayon ?, Je vous prie de me
prter un crayon, sil vous plat. Tous ces noncs traduisent parfaitement la mme
intention. En effet, parler une langue, cest tre capable de dire la mme chose de
plusieurs manires.
Il faut dire toutefois que le dialogue a lavantage de prsenter dans une situation dchange,
les structures et le vocabulaire que lon veut faire acqurir.
La langue ayant pour fonction premire la communication, il faut crer des situations de
communication dans la classe, pour un apprentissage plus naturel.
9
1.1 Objectifs
La leon de langage a pour objectif daider les lves faire face des situations de
communication que la vie courante nous impose. Et, pour sexprimer en franais, lenfant en
situation dmetteur doit tre capable demployer :
un vocabulaire suffisamment prcis ;
des structures de phrases correctes ;
une bonne prononciation, une intonation naturelle, des gestes et mimiques
adquats pour lexpression orale.
En situation de rcepteur, il devra tre capable:
de bien couter ;
de prendre des indices pour comprendre son interlocuteur ;
danticiper sur le contenu du message, de deviner la suite du message et ce qui
na pas t dit dans des situations de communication trs concrtes.
1.2 Principes mthodologiques
Cest en parlant quon apprend parler.
Lapprentissage de la langue orale se fait dans des situations de la vie courante
et non par la rptition de phrases vides de sens si nous voulons que les
exercices de langue ne soient pas des exercices de perroquets ? Il faut que les
enfants pensent ce quils disent et pour quils le pensent ? Il faut quils le vivent.
dit Pauline Kergomard.
Le droit lerreur va de soi lors de lapprentissage ; le matre doit tolrer lerreur
et lutiliser pour amliorer les comptences des lves.
Parler une langue, cest tre capable de dire la mme chose de plusieurs
manires.
Lenseignement des autres disciplines concourt la consolidation des acquis
langagiers des lves.
1.3 Dmarche base sur la prsentation dnoncs par les lves
Acquisition
Phontique prventive.
Prsentation de la situation de communication par le matre.
Vrification de la comprhension de la situation de communication.
Prsentation de lintention de communication.
Recherche dnoncs par les lves.
Explication des structures et mots inconnus.
Conjugaison dialogue, en situation de communication.
Production de dialogues, en guise de synthse.
Phontique corrective (si ncessaire).
Conseils pour la phontique
Commencer par prsenter le son en position mdiane (marchandise) puis en finale
(vache, pche), ensuite en position initiale (chameau, chanteur), enfin isoler le son
(ch).
10
Consolidation
Rappel des notions prcdemment acquises.
Fixation des notions.
Conjugaison systmatique.
Phontique corrective (si ncessaire).
Exploitation
Rappel des structures.
Remploi dirig.
Remploi libre.
Phontique corrective (si ncessaire).
La fixation des notions et leur emploi se feront dans le cadre dune expression motive (partir
de situations bases sur le vcu des enfants).
1.4 Dmarche base sur la prsentation dnoncs par le matre
Cette dmarche peut tre utilise en dbut danne de CI, eu gard la faiblesse du bagage
linguistique des enfants.
Moment dacquisition, Phontique prventive, Imprgnation
Explication et comprhension de la situation de communication.
Prsentation du dialogue : prsenter toutes les rpliques du dialogue de rfrence (le
matre).
Analyse
Explication des mots nouveaux et des structures.
Conjugaison dialogue.
Mmorisation des rpliques, Synthse
Rappel du dialogue.
Jeu de dialogue par plusieurs groupes dlves.
Phontique corrective (si ncessaire)
Moment de consolidation
Rappel du dialogue.
Fixation des notions.
Conjugaison dialogue.
Phontique corrective.
Moment de transfert ou dexploitation
Remploi dirig (avec stimuli)
Faire transposer les dialogues dans des situations diffrentes de celles du moment
dacquisition.
Remploi libre (sans stimuli)
Demander aux lves de proposer des situations et de jouer les dialogues (Petite
concertation entre lves).
Enrichir les dialogues en faisant entrer un nouveau personnage.
Phontique corrective
11
EXERCICE
Matrisez-vous les concepts cl de cette discipline ?
A. Rpondez aux questions suivantes et proposez des exemples.
A.1. Que signifie une situation de communication ?
A.2. Quentend-on par intention de communication ?
A.3. Quelle relation y a t-il entre A.1. et A.2. ?
A.4. Quest ce quun nonc ?
A.5. Que veut dire le terme paraphrases ?
B. Vos objectifs de leon sont-ils bien formuls ?
B.1. La leon de langage sintresse plus aux objectifs de communication quau
lexique
Expliquez ces propos et proposez des exemples dO.S.
B.2. La leon de langage permet de bien comprendre les notions de squence et
de sances
Expliquez ces propos et donnez un objectif de squence et les O.S. de ses
diffrentes sances.
C. Votre reprsentation a-t-elle volu ?
Qui va me rappeler le dialogue, disent souvent les matres. Cest une dclaration
problmatique.
Quen pensez-vous ?
Pour en savoir plus
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Fascicule Langage et
expression orale, Collection Outils pour les matres, 1996.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre, EDICEF, 1993.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Guide pdagogique de la premire tape
du Curriculum de lducation de base, 2006.
12
2 EXPRESSION ORALE
PR TEST
Les contraintes ne sont pas les mmes pour un locuteur qui fait un compte rendu dun
vnement que pour celui qui participe un dbat. Je postule, par ailleurs, que dans nos
leons dexpression orale, on demande aux lves de sexprimer mais on ne prvoit pas de
moment pour leur apprendre sexprimer.
1. Discutez ces propos en vous aidant de votre exprience personnelle.
2. Des moments dapprentissage sont-ils prvus dans vos fiches de leons ?
3. Existe-t-il du reste une dmarche standard en expression orale ?
Les informations qui suivent sintressent ces questions.
Introduction
Variante de la leon de langage la 2
me
et 3
me
tapes, cette discipline permet de prendre
en charge un besoin inhrent la vie, celui de sexprimer loral. En effet, dans le
commerce que nous entretenons avec nos semblables, nous avons toujours besoin
dexprimer nos sentiments, de faire part de nos ides et motions, dargumenter, de donner
ou de demander des informations. Pour les activits exploiter dans une leon dexpression
orale, on peut recourir la conversation, au dbat, au compte rendu, aux exposs, aux jeux
dramatiques, aux jeux potiques, aux histoires terminer ou inventer, aux interviews, au
jeu de rle. Nous sommes ainsi dans un domaine o les squences peuvent tre trs
diffrentes les unes des autres.
Dans loptique de disposer dune approche oprationnelle et motivante, il peut tre utile de
classer les activits mener en tenant compte des postures dans lesquelles peuvent se
retrouver locuteurs et interlocuteurs. On peut retenir :
La transmission dinformations
Dans les situations dites de transmission dinformations, llve doit matriser le
langage de lvocation. La structuration du discours est ici dune grande importance.
Les changes verbaux
Pour les changes verbaux, les situations seront essentiellement dialogues,
interactives mme si les changes ne doivent pas tre insignifiants dans leur
contenu.
13
2.1 Objectifs
Activit langagire transversale toutes les disciplines, la pratique de lexpression orale
lcole lmentaire vise essentiellement amener les lves sexprimer correctement de
manire naturelle et spontane. Cette comptence, capitale pour la vie de tous les jours,
contribue la construction de la personnalit de lapprenant, sa capacit de dvelopper
son savoir et dagir sur son milieu.
Les objectifs viser dpendront des types de leons. Ainsi on peut retenir :
Dans la transmission dinformations
Llve doit tre capable de rapporter un vnement, un rcit, une information, de
dcrire et de faire agir en se faisant comprendre.
Dans les changes verbaux
Les lves sauront argumenter, discuter, converser, couter, comprendre et
respecter linterlocuteur. Ainsi, les attitudes de communication seront privilgies.
2.2 Principes mthodologiques
Pour tre dynamique et fonctionnelle, lexpression orale doit sinsrer dans un
processus de prise en compte effective des besoins de llve et de son milieu :
besoin dextrioriser ce quil ressent, besoins ludiques, besoin de se connatre et de
dcouvrir le monde qui lentoure.
Elle doit sinscrire dans un apprentissage continu et intgr des activits
diversifies, bases sur lexploitation de thmes portant sur les ralits de son milieu.
Il faut ainsi viter les situations artificielles dsincarnes.
Il faut viter de se focaliser sur la recherche de phrases correctes du point
syntaxique, mais vides de sens.
Les activits doivent tre finalises : toute activit de communication peut dboucher
sur des rsolutions de problmes.
2.3 Dmarche globale
Etant donn quune leon dexpression orale nest jamais semblable une autre, nous
proposons une dmarche globale expliciter suivant lun ou lautre type. Elle comportera 4
phases : (i) Phase dappropriation et de prparation ; (ii) Production libre des lves ; (iii)
Exploitation et (iv) Evaluation.
Explicitations suivant les types
2.3.1 Type de leon : transmission dinformations
Dmarche possible
Phase dappropriation
Mettre les lves en contact avec le point de dpart de la leon (prtexte), pour en
faciliter la comprhension globale. Le point de dpart servant de prtexte
lexpression peut tre :
14
- lnonc dun thme ;
- une mise en situation orale ;
- un texte dans lequel un sujet est trait ;
- une image dcrivant une situation, des actions, un fait divers ;
- etc.
Activits de production libre des lves
Laisser les lves sexprimer librement sur le prtexte : ils essaient de traduire
lintention de communication que le prtexte suggre.
Activits de production dirige
- analyser les productions libres des lves ;
- dvelopper les lments de contenus constituant lobjet dtude : travailler
systmatiquement les outils linguistiques ncessaires. Il est recommand de
recourir aux exercices structuraux. On appelle exercices structuraux les
exercices de substitution, de transformation, dexpansion qui permettent aux
lves de systmatiser lemploi des structures et du vocabulaire dcouverts.
Lexercice structural repose sur un schma simple :
stimulus rponserenforcement
Exemple : Stimulus (S) : aujourdhui il fait beau et hier. Rponse (R) : hier, il
faisait beau.
Il existe diffrents types dexercices structuraux
- Rptition avec addition
Exemple : Dpart : il va lcole (S) ; tous les matins (R) ; il va lcole tous
les matins (S).
Exemple : Dpart : Jean achet une voiture (S) ; belle (R) ; Jean achet
une belle voiture (S) ; neuve (R) Jean achet une voiture neuve.
- Exercice de substitution
Exemple : Dpart : Il est assis ct de la porte (S) ; je (R) ; je suis assis
ct de la porte (S) ; nous (R) ; nous sommes assis ct de la porte.
Production autonome dun texte oral : narration, description, injonction
Chaque lve produit, avec laide du matre et/ou de ses camarades.
Evaluation
Demander aux lves de produire sans aucune aide.
Remarque
Les diffrentes phases prsentes ci-dessus peuvent donner lieu plusieurs sances.
Exemple :
sance 1 : phase dappropriation et activits de production libre des lves ;
sance 2 : activits de production dirige ;
sance 3 : phase de production autonome et valuation.
15
2.3.2 Type de leon : changes verbaux
Dmarche possible
Prparation
- Choix du thme
Le thme dune leon de conversation ou de dbat pourrait tre en relation
avec un Projet dcriture.
A partir dune question dactualit, dun vnement ou incident, ou travers
ltude dun texte, choisir une question qui requiert les avis de tous pour des
prises de dcisions.
Pour le dbat, le point de dpart doit connatre une autre variante dans la
mesure o le dbat doit tre prpar par les lves. Ceux-ci doivent disposer
dun temps de rflexion et de documentation au cours duquel ils prparent les
bonnes questions ou rassemblent les arguments.
- Fixation des modalits
Le matre expliquera les aspects sur lesquels chacun devra se prononcer. Il
veillera aussi indiquer les rgles du jeu (couter lautre, respecter son
avis) et rappeler les objectifs : la fin de la conversation on prendra des
dcisions excuter.
- Production libre
La conversation ou le dbat pourraient se drouler comme suit :
Mise en situation : rappel du prtexte ou de la question dbattre.
Demander un lve de rappeler brivement ce qui sest pass.
- Prises de parole
En tant quanimateur, le matre structurera le droulement de la conversation.
Pour chaque axe, le matre distribuera la parole aux intervenants et tirera une
conclusion partielle.
- Prise de dcisions : ce sera la conclusion finale.
Exploitation
Cest le moment pour le matre qui a dj relev, au cours de la production libre, les
erreurs les plus significatives, de travailler systmatiquement les aspects relatifs la
correction de la langue, aux comportements verbaux (rires, coupures de paroles,
intolrance, non participation la conversation) ou non verbaux (gestes, posture).
16
EXERCICE
1. Compltez la fiche argumente dexpression orale suivante
Objet : compte rendu de visite
ETAPES MAITRE ELEVES JUSTIFICATIONS
O.S.
Moyens
Principales tapes
de la leon
Evaluation
2. Proposez une introduction et une conclusion au sujet de la dissertation pdagogique
suivant :
Il est inadmissible aujourdhui que les lves parlent pour parler dans une leon
dexpression orale. Discutez cette opinion.
Pour en savoir plus...
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Le fascicule Langage et
expression orale, Collection Outils pour les matres, 1996.
Situations dintgration
Contexte : Dans le cadre de la prparation des valuations finales, le sujet suivant vous est
proposs.
Si vous voulez que les exercices de langue ne soient pas des exercices de perroquets, il
faut que les enfants pensent ce quils disent et pour quils le pensent il faut quils le vivent
de Pauline Kergomard.
Pour le CEAP
Consigne : En vous inspirant de cette affirmation, laborez une fiche argumente
dexpression orale au CE.
Pour le CAP
Consigne : Commentez cette affirmation, en vous appuyant sur des exemples tirs de la
pratique de classe.
17
3 EXPRESSION ECRITE
PR TEST
Les lves sont faibles en expression crite, dit-on. A qui la faute ? Cet tat de fait va
certainement perdurer si :
on continue aligner les leons de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire,
dorthographe de manire formelle ;
on ne prvoit rien au CI/CP ;
on programme des lments tels que la construction de phrases, la remise en ordre
dune phrase au CE.
1. Partagez-vous ce point de vue ?
Aprs avoir discut ces propos, lisez les lignes qui suivent.
Introduction
Attention ! Voici des lments que vous ne pouvez pas ignorer aujourdhui.
Dabord la nature de la discipline. Les activits proposes aux lves sont encore marques
par des exercices tels que : la construction de phrases, lenrichissement dune phrase
donne, le rarrangement des termes dune phrase, la copie dune phrase dun texte et la
transcription dune phrase orale.
Ces exercices, mmes utiles, ne peuvent pas tre appels expression crite. Lexpression
crite suppose un minimum de cration personnelle. Le producteur dcrit doit tre devant
une situation de communication, cest--dire quil doit chercher communiquer quelque
chose par crit. Il y a, de ce point de vue, ncessairement un caractre personnel.
Ensuite la finalisation. Pour crire dans une langue, il faut en connatre les rgles de
fonctionnement. Ainsi, les disciplines bases sur la matrise des rgles de fonctionnement de
la langue (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) ne sont pas tudies pour
elles-mmes. Leur apprentissage nest pas un but en soi.
Lexpression crite commande les autres apprentissages en franais. Il faut finaliser les
apprentissages, leur donner du sens : en programmant les lments de conjugaison, de
vocabulaire, de grammaire et dorthographe en fonction du type de texte produire ; en
choisissant le texte produire en fonction dun projet : pourquoi, pour quoi dois-je crire
cette narration ? Et en sefforant de trouver un destinataire rel (autre que le matre) : pour
qui je vais crire cette description ?
18
Enfin, lintroduction de lexpression crite ds le CI. La ncessit de faire entrer les lves
trs tt dans lcrit est reconnus par des spcialistes. Et, il est parfaitement possible de faire
de lexpression crite au CI/CP.
3.1 Objectifs
La fin vise, cest dapprendre aux lves produire des crits pour rsoudre des
situations de communication. Les situations de la vie font appel des textes diffrents :
produire des affiches pour lutter contre linsalubrit ;
crire une lettre son oncle pour lui demander de vous acheter un vlo ;
crire un texte pour raconter un vnement un ami qui ny a pas assist ;
crire les rgles dun jeu pour permettre des amis de le faire ;
etc.
Faire des sances dexpression crite, cest ainsi apprendre aux lves tre capables de
produire des crits adquats des besoins fonctionnels de la vie.
Cest ce qui a t synthtis en ces termes par Guibert et Verdelhan former des
producteurs dcrits capables de ragir par un texte toutes les formes socialises de
messages.
3.2 Principes mthodologiques
Pour crire un texte donn, il faut dabord lavoir lu.
Puisque tout besoin de produire un texte correspond un type de texte dtermin, il
faut matriser les caractristiques des types de textes.
Matriser la production dun type de texte demande un apprentissage systmatique
en plusieurs essais.
Entre les diffrents essais, lvaluation formative savre capitale.
Le point de dpart des apprentissages, cest le Projet dcriture.
3.3 Dmarche
La production dun type de texte donn doit tre faite, dans le cadre dun Projet dcriture
spcifique, conformment au canevas suivant :
3.3.1 1
er
volet : tude du texte support
Lecture du texte choisi en fonction du Projet dcriture.
Analyse des caractristiques de ce texte pour dcouvrir les lments de vocabulaire,
de grammaire, de conjugaison tudier.
Ltude du texte support doit dboucher sur deux outils permettant llve de sengager
dans la production dun texte du mme type : une fiche de critres de russite et un
rfrentiel.
19
la fiche de critres de russite est un tableau dans lequel on mentionne les conseils
pour russir ce type de texte (ai-je respect la forme ? Ai-je respect les temps
adquats ? Ai-je utilis la ponctuation qui convient ? Etc.)
le rfrentiel est un inventaire de ressources utiles la production du texte (formules
dappel possibles : mon cher ami, trs cher frre, monsieur le directeur Mots liens
possibles : dabord, ensuite, en outre, enfinMots pour dcrire : des adjectifs
qualificatifs, des adverbes).
3.3.2 2
me
volet : tude des disciplines outils
Il sagit de travailler les caractristiques indispensables la rdaction dun texte du mme
type. Ceci permet de donner du sens aux notions de grammaire, orthographe, conjugaison,
vocabulaire. Ces notions sont abordes parce quelles permettent de russir le Projet
dcriture.
Les dmarches pour aborder ces disciplines outils seront prsentes dans les chapitres
suivants.
3.3.3 3
me
volet : Rdaction du texte prvu dans le Projet dcriture
Rdaction du premier jet : travail individuel (les lves ont leur disposition la fiche
de critres et le rfrentiel).
Evaluation formative : les lves relisent leur copie, la font lire par des camarades et
le matre, enregistrent les remarques.
Le matre organise les remdiations sur les erreurs rcurrentes.
Rdaction du deuxime jet, voire du troisime jet.
Evaluation sommative par le matre.
En dautres termes, il sagit de placer les lves dans un chantier dcriture dont la finalit
est de rendre llve comptent produire un type de texte dtermin.
Pour le CI/CP
Les lves de la premire tape peuvent :
Produire avec des tiquettes mots (Choisir des tiquettes mots pour prsenter
quelquun).
Ecrire la lgende dune image, dune scne, dune BD.
Remplir une bulle vide sur un personnage en communication.
Rpondre une question en crivant une phrase.
Produire une deux phrases pour traduire une situation de communication comprise.
Etc.
Il est clair que la matrise des outils de la langue (grammaire, conjugaison, vocabulaire) ne
peut pas tre systmatise cette tape de lcole lmentaire. Il faut cependant organiser
des exercices structuraux pour faire saisir, implicitement, lemploi de certaines notions et
structures.
20
EXERCICE
1. Y a-t-il une diffrence entre les termes rdaction, expression crite et
production dcrits ?
2. Mettez de lordre dans les tapes suivantes, en numrotant, pour produire un texte.
Etapes Numros dordre
choisir le texte qui convient son projet
bnficier dune valuation formative
lire le texte quon veut produire
russir le texte
tudier comment marche ce type de texte
faire dautres essais
Avoir un projet 1
faire un essai
choisir le texte qui convient son projet
Un lve du CP a crit ceci au cours dune recherche action portant sur larticulation
oral/lecture/production dcrits : Dabord jai vers de leau ; ensuite jai balay la chambre,
enfin jai ramass les salets.
3. Comment ferez-vous pour amener vos lves raliser des productions pareilles ?
Indiquez les tapes de votre travail pour cela.
Pour en savoir plus
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Expression crite et
Travail partir dun texte, Tomes 1 et Tome 2, 1996.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Guides pdagogiques du curriculum de
lducation de base, 2006.
Genevive Hindryckx et al. La production crite en questions, Piste de rflexion et daction
pour le cycle 5 8 ans, De Boeck, 2002.
21
4 LECTURE
PR TEST
Un inspecteur dit une institutrice : Dans votre rpartition mensuelle, vous navez
programm que des sons : i o t a - Or, la combinatoire est tout fait inefficace pour la
matrise de la lecture.
1. Exagration ? Provocation ?
2. Donnez votre point de vue sur cette remarque.
Puis, lisez vite les lignes qui suivent !
Introduction
Retenons dabord que sans apprentissage efficace de la lecture tous les enseignements
sont compromis priori. La matrise de la lecture est indispensable pour russir lcole, et
mme dans la vie actuelle. Pourtant, il existe beaucoup de controverses dans la didactique
de cette discipline. En fait, quest-ce que lire ?
Jusquaux annes 80, on a privilgi le dchiffrage (b + a = ba) et loralisation. Cest ainsi
quau Sngal, les Directives de 1983 (INEADE) mettaient laccent sur le son, en indiquant
ceci tude dun son en 8 sances, tale sur deux jours. Ce sont ces directives qui ont
prconis la mthode mixte point de dpart global.
A partir des annes 80, la tendance sest inverse au profit de la construction de sens. Au
Sngal, on changea dorientation. Cest pourquoi, dans lavant propos du livre Sidi et Rama
(INEADE 1990), on peut relever : lire, cest avant tout dcouvrir du sens, ce sens ne se
trouvant que dans des textes (et non dans des sons, des syllabes ou des mots isols.
Il convient aujourdhui de revisiter la place du dchiffrage et damliorer les dmarches
denseignement apprentissage de la lecture. Regardez ceci :
Exemples Questionnement
Les fils du prsident de la Rpublique
prsident des runions sous des fils
lectriques.
Pourquoi les mmes groupes de mots (fils/
fils - prsident / prsident) ne se lisent pas de
la mme manire ?
Etienne et Donatien sont fiers de leur thse.
Comment se comporte ce truc [t] ?
Oumar a pass la nuit avec deux amies sur
le mme lit.
Le e est llment le plus important pour se
faire une ide sur Oumar. Pourquoi ?
22
Conclusion : La combinatoire ne peut pas rgler tous les problmes de la lecture ; cest
plutt le sens qui est dterminant.
Contre exemples Questionnement
Anticonstitutionnellement Comment le jeune lecteur va-t-il lire ce mot
sil ne la pas dj rencontr ?
Le matin le lapin martin
Le pain, le pin
Comment le jeune lecteur peut-il sen sortir
sil ne sait pas que [in] = [ain] ?
Conclusion : le b + a = ba peut quelquefois tre utile.
4.1 Objectifs
Llve doit tre capable :
de savoir donner du sens un crit partir dindices fournis par lmetteur ;
dutiliser sa lecture ;
de se reprer dans le monde des crits ;
de matriser des techniques de lecture pour comprendre tous les types de texte ;
de savoir matriser la combinatoire et connatre un certain nombre de relations entre
les lettres et les sons.
4.2 Principes mthodologiques
Lire, cest comprendre (construire du sens).
La matrise de la combinatoire est importante ; elle est au service de la lecture.
Ds le premier mois du CI, lapprenant doit acqurir globalement un certain nombre
de mots usuels : son prnom et nom, papa, maman, bonjour, voici. Cette acquisition
peut se drouler sur le premier trimestre.
La lecture haute voix relve de la communication. Le matre peut lui rserver des
sances spcifiques pour entraner les lves.
Le matre doit familiariser les lves avec tous les types dcrits.
4.3 Dmarches
Acquisition globale de mots, CI surtout
Premire tape
Dmarche base sur la liaison
langage/lecture
Dmarche non base sur la liaison
langage/lecture
En fin de leon de langage, le matre
choisit au moins un mot utilis dans la
leon et le fait acqurir selon la dmarche
suivante :
a. crire les mots au tableau ;
b. les faire lire ;
c. les faire mmoriser globalement ;
d. les faire transcrire (dessiner) ;
e. les afficher dans la classe ;
Dcouverte des mots
a. identification des mots partir dun
support : objet, image.
Appropriation
b. rptition ;
c. explication ;
d. criture du mot au tableau par le
matre ;
23
f. jouer les reconnatre, les faire
lire rgulirement, pour
renforcement.
e. lecture globale du mot ;
f. dessin du mot par les lves (la
silhouette dabord, puis la graphie).
Renforcement
g. jeux de correspondance mots/images ;
h. jeux de reconnaissance de mots ;
i. lecture de petits textes composs de
mots acquis globalement par les lves.
Construction de sens et matrise de la combinatoire
Premire tape
Dmarche de construction de sens Dmarche pour la combinatoire
Exploitation du texte
Il sagit de lire silencieusement pour reprer
des indices permettant de comprendre le
texte (disposition du texte sur la feuille,
prsence dune illustration, titre du texte, nom
de lauteur, tous les mots connus, majuscules,
ponctuations significatives, chiffres, dates,
heures ou autres units marquantes, mots
lien). Tous ces indices permettent une
identification du type de texte, du thme, cette
activit permet aux lves de formuler des
hypothses sur le sens du texte.
Confrontation des dcouvertes (en
groupes)
Relecture du texte
Comprhension totale
Rflexion sur le texte (les lves donnent
leur avis sur lhistoire, les personnages)
Oralisation du texte
lecture magistrale du texte
lecture haute voix des lves
De la phrase vers la lettre ou du sens au
signe
Choisir dans le texte une phrase comportant
la graphie du son tudier.
Extraire le mot comportant la graphie du
son.
Extraire les syllabes.
Isoler le son et ses diffrentes graphies.
Ecrire le son.
Des lettres, des syllabes, des mots
Recherche de mots contenant le son
(reconnaissance auditive).
Entourer le son dans les mots
(reconnaissance visuelle).
Former des syllabes.
Associer des syllabes pour former des mots.
24
Construction de sens
Deuxime et troisime tapes
Lecture silencieuse
Comprhension gnrale
Les lves observent puis lisent le texte, prennent des indices qui vont les aider
comprendre ce texte. Les indices sont rechercher :
dans la mise en page du texte (observation du texte), un ou plusieurs paragraphes,
alinas, le titre, le nom de lauteur, la typographie, les illustrations, le ou les
destinataires ;
dans le texte (lecture du texte), la ponctuation, les majuscules, les temps employs,
les mots connus, les mots liens ;
Tous ces indices permettent :
didentifier le texte (un rcit, un dialogue, une lettre) ;
de connatre le thme du texte (ide gnrale : cest lhistoire deon parle de) ;
de prendre les informations dont on a besoin.
Analyse des caractristiques du texte
partir dune grille, les lves font un relev des caractristiques du texte :
vocabulaire, temps des verbes, mots liens, etc.
Comprhension dtaille du texte.
Lecture haute voix (si ncessaire).
EXERCICE
Proposez une valuation pour les O.S. suivants :
O.S. 1 : Les lves seront capables de manifester leur comprhension du texte suivant :
Les marchands ambulants
Partout en ville, on rencontre des marchands ambulants. Tous les matins, quil pleuve ou
quil vente, ils sillonnent la ville, parcourent les rues, exhibant devant les passants leurs
diffrentes marchandises.
Tantt ils se faufilent entre les voitures pour tendre un objet aux automobilistes, tantt, ils se
prcipitent vers le trottoir oppos pour courir vers les pitons. Ils les interpellent sur un ton
courtois et leur glissent les articles avec des commentaires accrocheurs. Sans leur donner
le temps de rflchir, ils peuvent leur vendre un produit un prix dfiant toute concurrence.
Quelquefois, ils sattardent la portire dune voiture pour rendre la monnaie un client.
Que de kilomtres parcourus en une journe ! Cette activit leur permet de gagner leur vie
et daider leurs parents
O.S. 2 : Les lves seront capables de lire le son [t] ainsi que des syllabes et des mots le
contenant.
25
O.S. 3 : Les lves seront capables de reconnatre globalement les mots classe, livre,
cole
1. Proposez une dmarche, en lecture haute voix, pour le respect de la ponctuation.
2. Expliquez ces propos dEvelyne Charmeux : Lire cest construire un sens sur un
message dont on a besoin pour faire autre chose que lire.
3. Ne croyez-vous pas que linspecteur (voir pr test) exagre et que lacte de lire a
besoin des processus primaires (identifier ou assembler des lettres ou des
phonmes, reconnatre des formes crites hors contexte) et des processus
suprieurs (raisonner, formuler des hypothses, mobiliser ses connaissances,
utiliser le contexte) ?
Pour en savoir plus
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Fascicules Langage et
expression orale, aux deuxime et troisime tapes et Travail partir dun texte, 1996.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre, EDICEF, 1993.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Guide pdagogique de la premire tape
du Curriculum de lducation de base, 2006.
26
5 GRAMMAIRE - CONJUGAISON
PR TEST
Objectif spcifique
Les lves seront capables didentifier les adjectifs qualificatifs dans un texte.
Droulement
Le matre montre un cartable neuf et demande aux lves : Comment est le cartable
de Casimir ?
Un lve rpond : Le sac de Casimir est trs joli. Cette phrase est crite au tableau.
Analyse
Par un jeu de questions rponses, le matre amne les lves mettre en relief petit,
donner sa nature et la fonction quil joue dans la phrase.
Aprs les exercices de renforcement ?
Il donne un exercice la fin de la leon : Soulignez les adjectifs qualificatifs de ce texte :
Minielle a une belle robe. La classe est propre. Les lves du CI sont petits. Ramata achte
des poissons au march
1. Analysez cette leon et dites ce qui ne va pas !
Introduction
Lenseignement de la grammaire, comme celui de la conjugaison, a pour finalit lexercice
conscient et matris de la communication orale et crite. En clair, il sagit daider les lves
sexprimer correctement.
Cette finalit exclut la simple mmorisation/rcitation des rgles thoriques, de manire
dcontextualise, et met en avant un savoir-faire. En effet, il ne sert rien de connatre la
nature de dont si on nest pas capable de lemployer correctement. De mme il est inutile
de mmoriser les terminaisons verbales du conditionnel si on ne sait pas dans quelles
conditions on doit lemployer.
En tant que disciplines outils, le choix des leons faire doit dpendre du type de texte
concern par le projet dcriture.
Il ne suffit pas de savoir reconnatre un adjectif. Ce dont lindividu a besoin, cest dutiliser
dans sa phrase ladjectif, chaque fois que celui-ci pourrait apporter du sens, prciser, crer
de lmotion Cela ne sapprend pas en soulignant ladjectif dans des phrases o lon sait
quil y en a obligatoirement puisque cest la leon, puis en indiquant son genre et son
nombre.
27
5.1 Objectifs
Ils peuvent tre de deux ordres :
Pratique : matriser la langue afin de pouvoir comprendre et sexprimer dans des
situations de communication.
Thorique : rflchir sur le fonctionnement de la langue et tre capable dune certaine
abstraction.
5.2 Principes mthodologiques
La grammaire et la conjugaison font partie de lenseignement grammatical. La
partie appele conjugaison traite le domaine du verbe que toutes les recherches
rvlent comme constituant les principales difficults rencontres par les lves,
aussi bien dans ses aspects orthographiques que dans ses emplois.
Tout apprentissage se fera en contexte.
Le maniement de la langue doit prcder la rflexion sur la langue. En effet, la
matrise dune langue vivante est plus intuitive que rflexive. Do limportance des
situations de communication dans lesquelles lobjet dtude est manipul
implicitement.
Les conditions demploi des temps en conjugaison sont aussi importantes que leurs
formes verbales.
Ce nest pas en apprenant des rgles quon apprend parler et crire
correctement.
Enseigner une grammaire et une conjugaison pratiques, fonctionnelles,
immdiatement utilisables.
5.3 Dmarche
Etapes Exemples
Elaboration du corpus
A partir dune situation de
communication permettant
de manipuler loral lobjet
dtude, laborer le corpus
crit au tableau.
Etude des pronoms personnels
Une situation : un lve demande lautorisation de sortir
Demander aux lves de raconter ce qui se passe.
Essai 1 : Ibrahima parle avec le matre. Ibrahima
demande au matre lautorisation de sortir. Faire
constater les rptitions.
Essai 2 : Ibrahima parle avec le matre. Il demande au
matre lautorisation de sortir. Encore rptition de
matre.
Essai 3 : Ibrahima parle avec le matre. Il lui demande
lautorisation de sortir. Voil le corpus crire au
tableau
Observation Classement
Par des manipulations
diverses et comparaison, on
fera apparatre les
similitudes et les diffrences
pour permettre aux lves
de procder des
classements. La dcouverte
de la rgle en sera
davantage facilite.
Faire faire des manipulations pareilles, comparer les
diffrents essais, faire mettre en exergue les petits mots et
leur rle dans le discours.
28
Thorisation
Avec la synthse des
observations, on formulera
la rgle, oralement et par
crit, accompagne
dexemples.
La synthse montrera que ces mots qui remplacent les noms
sappellent pronoms personnels, etc.
Donner dautres exemples ?
Exercices de renforcement
Par des exercices oraux et
crits, renforcer la notion
acquise
Proposer des exercices varis.
Evaluation
Proposer un exercice dvaluation.
EXERCICE
1. Analysez et amliorez la leon du pr test
Elments analyser Observations Propositions argumentes
LO.S.
Le point de dpart
La dmarche
Lvaluation
Aprs une leon de conjugaison sur le futur, un matre donne lexercice suivant :
Je mets les verbes entre parenthses au futur simple. Casimir (partir) Oukout la semaine
prochaine. Il (arriver) pendant la nuit. Nous (aller) Brin le mois prochain.
2. Cet exercice ne sintresse quaux terminaisons verbales ! Quen pensez-vous ?
3. Comment peut-on lamliorer ?
4. Sujet de dissertation pdagogique : La grammaire et la conjugaison ne sont pas
enseignes pour elles-mmes. Elles sont, au demeurant, au service de la
communication. Dveloppez ce point de vue.
Pour en savoir plus
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre, EDICEF, 1993.
Pdagogie pour lAfrique Nouvelle, 1980.
29
6 VOCABULAIRE
PR TEST
Le mot est le support de lide. Mais il ne suffit pas de possder des mots pour bien
exprimer ses ides.
1. Expliquez cette opinion et dites ses applications dans une leon de vocabulaire.
Amliorez vos connaissances en lisant ce qui suit.
Introduction
Apprendre le vocabulaire dune langue signifie : (i) apprendre connatre les relations entre
les mots et les choses, cest--dire tre capable de dsigner les objets ou les notions ; (ii)
connatre les relations qui existent entre les mots (mots drivs, synonymes, contraires) ;
(iii) apprendre utiliser les mots selon les circonstances et selon la situation de
communication.
6.1 Objectifs
La leon de vocabulaire a pour objectifs damener les apprenants :
Matriser le sens des mots en remplaant le mot approximatif par le terme prcis par
rapport au contexte de son emploi.
Matriser lenvironnement des mots (composition, famille, synonyme, contraire,
homonyme).
Matriser leur emploi (classe grammaticale, champ lexical, champ smantique).
Utiliser le dictionnaire pour la recherche des sens inconnus.
6.2 Principes mthodologiques
La leon de vocabulaire ne peut se faire qu partir dnoncs en situation. Un mot
na pas de sens, il na que des emplois. Exemple : le mot frais : les frais du
voyage/un vent frais/des nouvelles fraches/du pain frais/des relations fraches
(tendues)/du poisson frais.
Matriser un mot, cest galement matriser son champ lexical et son champ
smantique. Le champ lexical, cest lensemble des mots servant dsigner une
mme ralit, notion ou entit ; par exemple les mots appartenant au champ lexical
cole seraient : lve, tableau, matre, directeur, rcration, ardoise, etc.Le
champ smantique, cest lensemble des contextes dans lesquels le mot peut tre
employ avec des sens plus ou moins diffrents.
Il convient de distinguer le vocabulaire actif et le vocabulaire passif : le vocabulaire
actif est celui dont lenfant se sert ou quil remploie spontanment aprs
apprentissage et le vocabulaire passif est celui que llve comprend bien mais quil
nutilise gure. Le vocabulaire passif est plus important bien sr, et il sagira souvent
30
dans les leons de vocabulaire de faire passer certains mots du vocabulaire passif au
vocabulaire actif.
Lextension est trs importante dans la matrise du mot : synonymes, contraires, mots
de la mme famille le Dcret 791165 conseille dintroduire la synonymie ds le
CE2.
6.3 Dmarche
Le corpus utilis est souvent un texte. Ltude du mot peut suivre les tapes suivantes :
Dcouverte du mot par des questions prcises.
Mise en relief du mot (par soulignement ou criture en couleur).
Fixation graphique (pellation, criture sur les ardoises).
Sens du mot dans le contexte : explication du contexte et recherche du sens du mot
dans le contexte.
Recherche des diffrents sens du mot (champ smantique) : recherche de contextes
et dnoncs dans lesquels le mot aura des sens diffrents et explication des
diffrents sens.
Recherche des synonymes ou dantonymes.
Recherche dhomonymes.
Recherche dexpressions idiomatiques contenant le mot tudi.
Synthse.
Remploi dans des phrases par les lves (crire la meilleure au tableau avec le
nom de lauteur).
Exemple de tableau de synthse
Mot tudi Synonymes Antonymes Homonymes
Expressions
verbales
EXERCICE
1. Les exercices dvaluation les plus courants sont la construction de phrases et le
texte lacunaire (exercices trous). En connaissez-vous dautres ?
2. Expliquez la signification de ces concepts : lexique vocabulaire mot
polysmique homophones homographes ?
3. O et comment peut-on utiliser le tableau suivant dans une leon de vocabulaire ?
r in confort able ment ant Mots
trouvs
Pour en savoir plus
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Travail partir dun texte,
Les tomes 1 et 2, 1996.
31
7 ORTHOGRAPHE
PR TEST
La dicte traditionnelle est davantage un test dvaluation quun moyen dassurer
lapprentissage des complexits du code crit.
1. Expliquez ce point de vue et tirez-en des applications pratiques dans la didactique de
lorthographe.
Attention ce sujet ! Lisez bien ce qui suit !
Introduction
Dfinie comme tant lart dcrire correctement les mots dune langue selon les rgles et
lusage. Les difficults de lorthographe sexpliquent par des raisons diverses. Il y a dabord
labsence de logique de la langue franaise. Prenons quelques exemples :
Dans le mot fume, le e ne reprsente aucun son.
Dans le mot second, la lette c transcrit un autre son, g.
Dans le mot taxi, x sert transcrire deux sons existants, ks.
Ensuite, lorthographe dusage nobit aucune rgle. Il faut juste savoir, par lusage, que
bonhomme prend 2 m et bonhomie 1 seul m.
Il y a enfin, les nombreuses rgles grammaticales et de conjugaison qui impliquent des
difficults particulires.
Devant ces nombreuses difficults, daucuns pensent quil faut faire beaucoup de dictes
pour tre fort en orthographe. Cette option nest pas bonne. En effet, lapprentissage de
lorthographe ne se limite pas la dicte. Dicter un texte pris au hasard, puis le corriger plus
ou moins rapidement et attribuer une mauvaise note llve, nest pas faire apprendre de
lorthographe. Cest dailleurs une meilleure faon de dgoter jamais les lves de la
recherche dune orthographe correcte. Il faut signaler, ici, linjustice qui entoure la correction
de la dicte : 150 mots crits correctement sur 160 et on se retrouve avec0 !
Quelle est dailleurs limportance de respecter lorthographe ? Cest uniquement parce
quelle permet de mieux comprendre les textes produits dans des situations de
communication. Lorsque vous crivez je vous serre un repas rempli de manges et de
poison Je vous sers un repas rempli de mangues et de poissons !
32
Pour ces raisons, lorthographe doit tre enseigne, en situation. Cest en cherchant se
faire comprendre quon fera attention la correction de lorthographe. Il faut donc dune part
placer lorthographe dans le <Projet dcriture> afin de lui enlever lhabitude fcheuse de
considrer que ce quon fait lcole ne sert rien, et dautre part retenir que seuls ceux qui
crivent et lisent souvent comprennent et pratiquent les ncessits de lorthographe. Sur le
plan pratique, nous observons quun lve qui crit beaucoup progresse bien davantage en
orthographe quun lve qui ne fait que des dictes. Les activits orthographiques
systmatiques dpourvues de tout contexte de communication, si elles ne sont pas inutiles,
ne suffisent pas.
7.1 Objectifs
Les objectifs de lenseignement de cette discipline sont dordre pratique, matriser les quatre
types dorthographe partir dobservations concrtes et des exercices varis qui ne se
limitent pas la dicte :
Lorthographe phontique qui permet la transcription graphique des sons.
Lorthographe lexicale ou orthographe dusage qui dtermine lcriture dun mot.
Lorthographe grammaticale qui fait appel diffrentes rgles daccord lintrieur
des groupes grammaticaux (groupe verbal, groupe nominal), de la phrase, de la
proposition.
Lorthographe verbale ou conjugaison (formes des verbes).
Il sagira, dans tous les cas :
De dvelopper le sens de lobservation.
De dvelopper lattention de llve pour lapplication correcte des rgles.
De cultiver la mmoire.
7.2 Principes mthodologiques
Il faut mettre les apprenants devant des situations de communication, pour
dvelopper leur vigilance. Ecrire correctement ncessite une grande vigilance.
Faire produire souvent des textes dveloppe le rflexe de veiller la bonne
orthographe.
Il faut ddramatiser la dicte et valoriser les russites. 10 fautes = 0, signifie que celui
qui a trouv 150 mots sur 160 na rien russi.
Eviter les stigmatisations, les coups et les frustrations qui conduisent des lves
dire je ncris pas car je ne fais que des fautes. Il faut plutt convaincre les
apprenants quils vont y arriver.
Prfrer les explications, les situations daide lacharnement multiplier les dictes.
La dicte est plus une valuation quun apprentissage.
33
7.3 Dmarche
Etapes de la leon
Quelques indications
Contrle des pr-requis Dans une leon o lO.S. est de matriser la graphie des
sons[], [], [] (on, en, in).
Dicte de mots tels que le pont, le savon, les dents, le
rang, du pain, plein + Correction.
Constitution dun corpus Sur un texte appropri, demander aux lves de relever
des mots contenant les sons on, em et in.
Recueillir le corpus au tableau dans un tableau :
[On] [an] [in]
Classement Faire classer les mots :
[on] [in] [an]
On om in im Ain en an em am
Thorisation Faire observer le tableau et faire tirer la rgle : le n change
en m devant p et b.
Exercices de renforcement Dicter un petit texte contenant les diffrents cas de figure et
correction collective.
Evaluation Petite dicte ou texte lacunaire :
En tendt, le s de cloche, les enfts se sont
rassebls devt ler classe. Ils se mettent en rg, en
silce. Etc.
34
EXERCICE
1. Compltez la fiche raisonne !
Objet : les noms fminins en t et ti.
Etapes Activits du matre des
lves
Justifications
O.S :
Contrle des pr-requis
Constitution du corpus
Classement
Thorisation
Renforcement
Evaluation
Voici un sujet de dissertation pdagogique :
Du fait de labsence dune logique dans lorthographe des mots de la langue franaise, les
objectifs en orthographe seront dordre pratique.
2. laborez une introduction, un listing des ides dvelopper et une conclusion.
Pour en savoir plus
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Travail partir dun texte,
Le tome 1, 1996.
35
8 ECRITURE - GRAPHISME
PR TEST
Le terme criture a deux acceptions :
lcriture en tant que geste graphique assurant la lisibilit de lcrit.
lcriture en tant que production dcrit porteur de sens.
1. A quelle discipline dj traite correspond la deuxime acception ?
2. Expliquez la premire acception ?
Lisez ces lignes !
Introduction
Lcriture, forme de graphisme, est une activit trs complexe qui met en jeu non
seulement la main et lil, mais aussi le contrle du mouvement, la prcision du geste,
lorientation dans lespace et le sens du rythme.
Sa matrise passe par une apprhension correcte de la surface de travail (geste ample pour
un grand support tel que le panneau, le tableau, le sol, geste prcis et rduit pour un support
plus petit comme lardoise, la feuille de papier, ou les lignes du cahier). Il est galement
indispensable dadapter son geste loutil utilis.
8.1 Objectifs
Ecrire cest matriser un code trs strict. Pour matriser ce code graphique, llve doit tre
capable de :
Dominer le support, les outils, les gestes de lcriture.
Connatre le sens de lcriture (de la gauche vers la droite).
Reproduire des modles conventionnels : les lettres.
Assembler ces modles selon les normes pour crire des mots, des phrases, des
textes.
Elments de contenus
Les graphismes de base : des ronds, des points, des lignes horizontales, des lignes
verticales, des lignes obliques, des courbes, des boucles, des cannes.
Tracer des combinaisons : ronds/ligne horizontale.
Tracer des combinaisons : ronds/ligne verticale.
Tracer des lignes brises.
Tracer des vagues (succession de courbes).
Les diffrentes lettres minuscules en cursive et scripte.
Les majuscules ( partir du C.E.).
36
8.2 Principes mthodologiques
Pour amener les lves avoir une criture belle et correcte, il y a un certain nombre de
principes respecter :
Donner de bons modles llve.
Eviter la culpabilisation avec les checs invitables.
La rptition est la condition dassimilation dun geste.
8.3 Dmarche
Lapprentissage de lcriture se fait gnralement par reproduction de modles. On peut
retenir deux moments essentiels :
La phase dobservation
Le matre fera observer la forme de la lettre, sa taille, son point de dpart et amener
les lves imaginer les diffrents mouvements ncessaires sa ralisation, ensuite
comparer la lettre avec des lettres dj ralises (ce quelles ont de commun, de
diffrent) et enfin dcomposer le mouvement ncessaire la ralisation de la lettre
gestes plus simples et connus.
La phase de reproduction
Associer tous les mouvements de la main, du poignet pour raliser la lettre en une
seule fois.
Les tapes
Mimer le geste en lair.
Essais sur la table avec le doigt.
Avec lponge mouille sur lardoise.
Avec la craie sur lardoise.
Application dans les cahiers (ou sur feuilles).
EXERCICE
1. Quelle est limportance de ces graphismes de base ?
2. Il faut donner des modles dans les cahiers des lves, jusquauCM 2. Quen
pensez-vous ?
Pour en savoir plus
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide Pratique du Matre, ADICEF, 1993.
La progression complte se trouve aux pages 223 et 224.
37
9 RECITATION
PR TEST
De la musique dabord Je suis loin de croire que lenfant doit apprendre tout ce quil
rcite, il sera pris par lharmonie dabord, couter en soi les belles choses comme une
musique, cest la premire mditation.
Lesthtique est lthique de lavenir.
1. La rcitation vous parat-elle entrer dans les propos dAlain et de
Maxime Gorky.
Introduction
Enseigner la rcitation est loin dtre un exercice facile. Il nest pas en effet ais de fixer dans
la mmoire des enfants des textes qui comportent des nuances de penses dlicates
exprimes surtout dans une langue trangre.
Or, pour lever la pense de lenfant on ne peut pas lui proposer le commun, le vulgaire.
Quelquun disait qu on nlve pas lenfant en lui proposant des modles purils. Une
belle uvre doit solliciter sans cesse lesprit et le cur.
9.1 Objectifs
Les objectifs de la rcitation sont les suivants :
Dun point de vue subjectif, il sagit de rendre lenfant sensible au beau, de lmouvoir
pour favoriser son ducation esthtique.
Dun point de vue objectif, elle cherche rvler lapprenti crivain et lenfant le
modle le plus parfait de la langue adulte ; elle dveloppe la mmoire des
apprenants ; elle renforce la matrise de la langue, gage de russite dans les autres
apprentissages.
9.2 Principes mthodologiques
La comprhension totale du texte ne peut pas tre lobjectif principal de la leon, on
ne peut viser que sa comprhension partielle contrairement la lecture.
En rcitation il faut chercher mouvoir et si lenfant est fortement mu il aimera et
cherchera mieux comprendre le texte. Limportant est de dgager des sonorits, de
soigner lintonation, de bien moduler la voix et dutiliser toutes les ressources
susceptibles damener lenfant avoir lintuition des penses et des sentiments
potiques.
Il faut varier les textes : ils peuvent tre en prose ou en vers.
38
A la premire tape, le rythme est essentiel car lenfant na pas encore le niveau qui
convient la comprhension des mots et lapprhension des nuances de la pense
mais son oreille est dj sensible.
9.3 Dmarche
Activits Phases Dmarches
1
re
tape 2
me
et 3
me
tapes
Rvision Interroger des
lves sur la
dernire leon
Le texte dclam par llve, le matre pose une question
qui le remet en contexte. On profite de la raction pour
revenir sur une partie difficile rendre. Chaque sance,
au lieu dtre une rptition est pour lenfant une occasion
denfoncer le texte dans sa mmoire.
Motivation
/Imprgnation
Faire observer
une image ou
couter une
chanson sur le
thme.
Le matre rcite
le morceau avec
une diction
parfaite en
respectant les
intonations.
Faire observer une image ou couter
une chanson sur le thme.
Lecture silencieuse du texte.
Le matre doit connatre le texte par
cur et parfaitement. Il fait une lecture
magistrale avec une diction parfaite en
respectant les intonations. On parvient
faire des remarques sur le rythme,
marquer des pauses : un trait pour les
petites pauses et des traits doubles
pour les extinctions de voix.
Exemple : un jour/ sur ses longs pieds/
allait je ne sais o, le hron au long
bec/ emmanch dun long cou/
On souligne les mots de valeur, on
note les inflexions de voix montante et
descendantes.
Etude du texte Lide gnrale.
2 ou 3 ides ou sentiments exprims.
Lexplication de quelques mots qui aident la
comprhension de lide gnrale.
Apprentissage Apprentissage par
rptition aprs le
matre, comme en
leon de chant.
Exercice individuel de diction
(rptition vers par vers, rptition de
toute la strophe, rvision de toute la
partie tudie ce jour).
Evaluation Faire rciter
individuellement
des lves.
Diction sur toute la partie tudie par
quelques lves.
Acquisition
nouvelle
Prolongement Les lves recopient le texte quils
vont mmoriser la maison.
39
EXERCICE
1. Comme la leon de chant, la leon de rcitation a pour objectif principal la
formation du got. Que pensez-vous de cette ide ?
2. Choisissez un morceau et laborez une fiche complte de rcitation pour la 2
me
tape.
3. Selon vous, pourquoi passe-t-on par laudition en 1
re
tape ?
Situations dintgration
Contexte : Dans le cadre de la prparation des valuations finales, les sujets suivants vous
sont proposs :
Pour crire un texte donn, il faut dabord lavoir lu.
Puisque tout besoin de produire un texte correspond un type de texte dtermin, il
faut matriser les caractristiques des types de textes.
Matriser la production dun type de texte demande un apprentissage systmatique
en plusieurs essais.
Entre les diffrents essais, lvaluation formative savre capitale.
Le point de dpart des apprentissages, cest le Projet dcriture.
Pour le CEAP
Consigne : En vous inspirant du principe mthodologique selon lequel pour crire un texte
donn, il faut dabord lavoir lu, laborez une fiche argumente pour
lenseignement/apprentissage dun pome.
Pour le CAP
Consigne : La comptence de produire un texte requiert un apprentissage systmatique en
plusieurs essais mais trouve sa motivation dans le projet dcriture. Expliquez ce point de
vue en donnant des illustrations lies la pratique de classe.
Situation dvaluation de la comptence
Contexte : Voici venu le moment de prouver que vous savez tirer profit de vos recherches.
Cest la raison pour laquelle les preuves suivantes vous sont soumises :
Epreuve 1 : Fiche raisonne pour le CEAP
1. laborez une fiche argumente de grammaire.
2. Expliquez en une page au maximum comment votre dmarche peut galement
servir pour la conjugaison ou lorthographe.
Epreuve 2 : Sujet de dissertation pdagogique pour le CAP
Les disciplines telles que la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, lorthographe ne
doivent pas tre enseignes pour elles-mmes. Elles sont, au demeurant, des outils pour la
communication orale et crite.
1. Expliquez cette opinion et montrez comment la mettre en uvre dans la classe.
Consignes : Traitez ces preuves.
Echangez avec des collgues sur leurs productions.
40
DIDACTIQUE DES MATHMATIQUES
COMPTENCE VISE
Pour toutes les composantes des mathmatiques lcole lmentaire, la cible doit intgrer
les principes de psychopdagogie et de didactiques dans des situations dlaboration de
fiches pdagogiques ou de dissertations psychopdagogiques.
Objectifs pour les activits disciplinaires
Gomtriques
Elaborer des fiches pdagogiques et mettre en uvre des sances denseignement
apprentissage en gomtrie.
Mesures
Elaborer des fiches pdagogiques et mettre en uvre des sances denseignement
apprentissage en mesure.
Rsolution de problmes
Elaborer des fiches pdagogiques et mettre en uvre des sances denseignement
apprentissage en activits de rsolution de problmes.
Numriques
Elaborer des fiches pdagogiques et mettre en uvre des sances denseignement
apprentissage en activits numriques.
41
10 ACTIVITES GEOMETRIQUES
PR TEST
Critiquant une certaine conception de lenseignement de la gomtrie un auteur crit : Une
certaine mthode veut quon apprenne connatre les figures de faon descriptive avant
den faire la construction en application et en contrle. Le carr, par exemple, senseigne
souvent au CE en faisant observer un carr tout fait : dnombrement des cts, des angles,
mesure des cts, des angles et pour finir, nonciation de la dfinition en forme de rsum.
Le trac intervient alors seulement en application et, la plupart du temps, en suivant les
lignes du quadrillage.
1. Montrez si cette mthode est cohrente ou non (vraie ou fausse) au regard de
considrations psychologiques et mathmatiques ?
2. Proposez une rponse et confrontez-la aux informations qui vont suivre.
Introduction
Aujourdhui, la gomtrie est dfinie comme la science des relations spatiales et non plus
comme la science de la mesure de la terre. Cest pourquoi les programmes actuels ne
sintressent quaux constructions gomtriques tandis que les lments de calcul de
primtre, de surface et de volume sont rservs la mesure.
10.1 Objectif
Les programmes de gomtrie sont structurs autour de deux catgories : les objets de
lespace que sont les volumes, les plans, les droites ou les points et les actions sur les objets
constitues par les transformations ponctuelles simples (symtrie, agrandissement,
rduction, translation et rotation).
La gomtrie permet ainsi lenfant de structurer lespace et de se familiariser avec
quelques figures gomtriques.
A la premire tape, il sagira daider lenfant pouvoir se situer dan un espace rel
ou reprsent, reprsenter graphiquement des trajectoires simples parcourues ;
A la deuxime tape, les lves devront pouvoir dcouvrir et construire lespace,
tudier les solides et figures gomtriques simples, utiliser bon escient les outils
(rgles, querres, compas) ;
A la troisime tape, ltude sera plus pousse et ira jusquaux transformations
ponctuelles.
42
10.2 Principes mthodologiques
Des tudes psychologiques menes par Piaget ont rvl que la conception de lespace
gomtrique doit soprer contre les tensions mcaniques de la perception. Dans ce cadre,
des enfants pouvant reconnatre et discriminer des ronds, des carrs et des losanges, se
sont trouvs incapables de les reproduire correctement avant 7ans. Do linefficacit de la
mthode dcrie dans le pr test. Dun autre ct, la thorie mathmatique nous apprend
que les figues gomtriques ne sont pas naturelles : elles sont construites.
Lespace mathmatique se construit par lopration, il ne se constate pas. Cest laptitude
et lhabitude du traage et de la construction manuelle qui fondent et enrichissent le concept
gomtrique.
De ce point de vue, la construction du carr est donc psychologiquement et logiquement la
dfinition du carr.
Cest pourquoi, au plan pdagogique, la dmarche est base sur la construction : la leon
de gomtrie doit tre une sance dactivits manuelles durant laquelle lenfant est invit
construire son propre savoir en associant action et rflexion. Toute dfinition abstraite doit
tre une prise de conscience rflchie dune construction pralable.
10.3 Dmarche
Activits Etapes
Matre Elves
Observation Prsente lobjet gomtrique
Observent, manipulent et
identifient des formes
identiques dans
lenvironnement
Construction
libre, puis dirige
Demande aux lves dessayer de
construire lobjet
Apprcie et fait apprcier les
productions partir du modle
Dirige la construction
Sexcutent
Construisent-en suivant les
instructions du matre
Analyse Fait comparer, classer, dcrire les
proprits de la figure construite
Sexcutent
Synthse Fait rappeler les diffrentes tapes de
la construction
(formules, rgles, dfinitions)
Proposent des dfinitions de
lobjet
Rinvestissement Propose des exercices dapplication
Sexcutent
43
EXERCICE
1. Parmi les objets dtudes suivants, notez dans votre cahier ceux qui relvent de la
gomtrie :
- le carr : calcul du ct ;
- lignes droites, lignes brises, lignes courbes ;
- les angles ;
- le pav droit : calcul du volume.
2. Elaborez une fiche de leon portant sur la construction du carr au CE1, en
appliquant trois principes de psychopdagogie que vous jugez dterminants.
3. Choisissez une transformation ponctuelle, ensuite reprsentez-la sur une feuille et
laborez ensuite une fiche pdagogique pour une classe de CM.
Pour en savoir plus
Legrand, Louis, Psychologie applique lducation intellectuelle, Enfants de 6 14 ans,
ditions Fernand Nathan, 1980.
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), 2, Formation,
Constructions gomtriques, Collection Outils pour la Classe, MEN, Dakar, 1997.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Guides pdagogiques, Curriculum de
lducation de Base, lmentaire, 1996.
44
11 ACTIVITES DE MESURE
PR TEST
1. Recopiez le tableau et proposez pour chaque grandeur des activits visant leur
appropriation par les enfants.
2. Inspirez-vous de lexemple donn sur la longueur dans le tableau suivant.
Type de grandeur Activits possibles
Longueur
Activits de comparaison et de rangement
de taille, de longueur dobjets usuels (rgle,
corde, ficelle, etc.) et performances (saut en
longueur, lancer de poids, saut en hauteur,
etc.)
Capacit
Masse
Dure
Monnaie
Aire
Introduction
Lobjet principal de la mesure est constitu par ltude des grandeurs. Mais ce, nest plus
ltude du systme mtrique conu comme le systme dcimal des poids et mesures
ayant pour base le mtre, institu en France le 16 avril 1795. Un enseignement dans ce sens
semble aujourdhui dpass.
Depuis lintroduction des Nouveaux Programmes de 1987, il est question de mesure.
11.1 Objectifs
Son objectif principal nest plus la familiarisation de lenfant avec les units lgales comme
en systme mtrique, mais plutt :
dinitier lenfant la mesure par des activits concrtes effectives ;
de lui apprendre utiliser le systme international de mesure.
Llve va ainsi pouvoir dcouvrir la mesure, mesurer et valuer des grandeurs, organiser
les grandeurs en systmes (longueurs, capacits, masses, aires, volumes, monnaie).
45
Toutes ces activits ressortissant la structuration de lespace et ladaptation au temps
vont contribuer ce que lenfant prenne mieux conscience du monde physique.
11.2 Principes mthodologiques
Une grandeur physique est toute quantit mesurable ou reprable laide dun instrument
arbitraire ou conventionnel. Il est possible de comparer et de mesurer des objets ou des
phnomnes sous certain rapport fix. Mesurer une grandeur, cest lui associer un nombre,
lunit de mesure tant ce quon appelle couramment ltalon qui est choisi suivant certains
critres .Le processus qui associe un nombre tout objet est appel mesurage. Ce sont les
oprations qui permettent :
de dgager le besoin de mesurer ;
de construire ou de choisir les outils et techniques adapts ;
dutiliser ces techniques et outils en vue de dterminer un nombre.
La notion de mesure suppose :
la capacit de considrer des objets sous le rapport dune grandeur particulire ;
linvariance de cette grandeur pour chaque objet quels que soient la disposition,
lloignement, etc. ;
la capacit de comparer deux objets si cest possible (comparaison directe), sinon la
capacit de comparer deux objets un troisime (comparaison indirecte avec un
lment de rfrence arbitraire ou conventionnel) ;
la capacit de reporter cet intermdiaire (unit) ou de le subdiviser (comparaison
indirecte laide dun systme dlments de rfrence non structur ou structur) ;
la capacit dassocier un nombre qui sera la mesure de cet objet par rapport cette
unit.
Il faudra proposer lenfant une suite de situations lissue desquelles il va dcouvrir la
ncessit de passer par des techniques intermdiaires :
Comparaison directe ;
Comparaison indirecte laide dun lment de rfrence arbitraire (empan, pas,
coude, bton) puis conventionnel (m, dm..) ;
Comparaison indirecte laide un systme d lments de rfrence non structur
(une bassine, bouteille, une tasse), puis structur (le litre et ses sous multiples).
Lapprentissage de la mesure repose avant tout sur lhabitude quotidienne de la mesure
effective et sur la constitution, par la mesure effective, des schmes opratoires de la
pense abstraite. Sans cette habitude, lenseignement de la mesure ne saurait que monter
des mcanismes verbaux. Il ne sagit pas de considrer la mesure effective par chaque
lve comme une simple illustration facultative dune leon, mais au contraire de la regarder
comme la substance mme de lapprentissage. Il est indispensable que chaque lve
mesure avec le mtre, le litre, le kilo, leurs multiples et sous-multiples ; il faut quil construise
46
des surfaces, des volumes, quil mesure surfaces et volumes, et cela de faon permanente,
tout au cours de la scolarit. Le matre est appel faire une vritable leon de chose.
Une leon sur les mesures de poids sans balance ni peses ne veut rien dire pour lenfant
Lapprentissage des conversions ne doit tre quune application de cette infrastructure
indispensable.
11.3 Dmarche pour ltude des grandeurs
Activits Etapes
Matre Elves
Mise en Situation
problme
Propose une situation fonctionnelle
amenant les lves prouver le
besoin de mesurer
Explicite la situation
Sapproprient la
situation
Activits libres Donne les consignes de recherches Ttonnements, essais
de rsolution
Communication Organise le compte rendu
Met en vidence les difficults rsultant
de lemploi dtalons non
conventionnels variables
Rendent comptent de
leurs productions
Activits diriges par le
matre
Prsente et fait analyser les units
conventionnelles tudier
Manipulent,
mesurent laide de
la nouvelle unit
Exercices de
renforcement/Evaluation
Propose des situations requrant
lemploi de lunit tudie
Sexcutent
EXERCICE
Observer au cours dune leon unique, puis mcaniser au cours dinnombrables exercices
oraux et crits tels sont les impratifs de la mthode traditionnelle.
1. Illustrez par une fiche pdagogique cette mthode et dire en quoi elle est
inconvenable.
Volume du paralllpipde rectangle = surface de base x hauteur
2. Proposez une fiche pdagogique pour lenseigner des lves du CM2.
Pour en savoir plus
Legrand, Louis, Psychologie applique lducation intellectuelle, Pour les enfants de 6 14
ans, ditions Fernand Nathan, 1980.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Guides pdagogiques Curriculum de
lEducation de Base, lmentaire, 1996.
47
12 ACTIVITES DE RESOLUTION DE PROBLEMES
PR TEST
Soit lnonce suivant : Nous avons tous la mme somme dargent, je te donne 25 francs.
Combien as-tu de plus que moi ?
1. Essayez de rsoudre le problme puis le proposer quelques lves de CP, de CE
et de CM.
2. Faire part par crit des constations et analyses que cette exprience suggre.
Introduction
La rsolution de problme est une discipline au mme titre que larithmtique, la gomtrie,
ou la mesure. Son objet principal est le raisonnement mathmatique.
Un travail systmatique doit tre entrepris sur les donnes des problmes et sur les
conclusions (questions) pour amliorer les comptences des lves en
lecture/comprhension dnoncs. Cette activit systmatise permettra lenseignant(e) de
varier sans cesse les formes dnoncs (avec ou sans question, avec donnes manquantes
ou en surnombre, dans un ordre quelconque). Dans le mme ordre dides,
lenseignant(e) pourra faire inventer et rdiger des noncs correspondant des critures
mathmatiques.
Ces objets portant sur les donnes ou les questions peuvent tre enrichis par des problmes
ouverts qui permettent de sengager dans une procdure, de la remettre en cause, de la
modifier Les caractristiques du problme ouvert sont les suivantes :
lnonc est court, immdiatement comprhensible ;
lnonc ninduit ni la mthode ni la solution (pas de question intermdiaire) ;
le problme se rapporte un domaine conceptuel connu des lves.
Exemple : quelle serait lpaisseur dun livre qui aurait 1 million de pages ?
12.1 Objectifs
Les objectifs de cette discipline sont plus mthodologiques que notionnels Ils permettent de
dvelopper chez les lves un comportement de recherche et des comptences dordre
mthodologique : mettre des hypothses et les tester, faire et grer des essais successifs,
laborer une solution originale et en prouver la validit, argumenter. Ces activits peuvent
enrichir leur reprsentation des mathmatiques, dvelopper leur dsir de chercher, leur
capacit de rsolution et de confiance quils peuvent avoir dans leurs propres moyens
48
Il ne faut pas confondre la rsolution de problmes aux problmes pratiques dont les vises
et les contenus sont diffrents. Dans les Livrets de comptences du CEB, les contenus des
problmes pratiques sont pris en charge soit par la mesure soit par larithmtique.
12.2 Principes mthodologiques
Les lves devront tre habitus comprendre que rsoudre un problme, cest analyser la
situation et les informations donnes, dgager ventuellement les chanes de situations
lmentaires, les schmatiser afin de mettre en vidence les relations mathmatiques,
utiliser ces relations et leurs proprits pour en dduire les renseignements recherchs
Des tudes psychologiques ont rvl que la solution abstraite dun problme est
extrmement tardive. La difficult que lenfant prouve abstraire et se mouvoir dans
labstraction rend difficile lentranement au problme strictement mathmatique.
On peut retenir des expriences menes sur des problmes comme celui des 25F que les
degrs dabstraction dans le raisonnement mathmatique se prsentent comme suit :
au CI/CP, manipulation sans abstraction ;
au CE, manipulation conduisant au schma puis la comprhension abstraite ;
au CM, utilisation du schma conduisant la comprhension abstraite.
La leon qui se dgage de cet tagement est donne par Louis Legrand pour quun
problme soit compris lcole lmentaire, il faut dabord quil soit vcu. Les situations sur
lesquelles portent les problmes peuvent tre ainsi issues de la classe, de la vie courante,
de jeux, etc.
49
12.3 Dmarche
EXERCICE
1. laborez une fiche pdagogique pour faire traiter le problme suivant : Combien de
grains y aurait-il dans un kilogramme de mil ?
2. Parmi les objets dtudes suivants, notez dans votre cahier ceux qui relvent de la
rsolution de problme :
- slectionner les donnes inutiles dun nonc ;
- exploiter les donnes contenues dans un tableau ;
- calculer le prix dachat, le prix de revient et le prix de vente ;
- trouver les questions intermdiaires, la question finale ;
- construire un nonc partir de donnes ;
- construire un nonc partir dune rsolution ;
- reconstituer un nonc en dsordre ;
- calculer le gain, lconomie et la dette ;
- raisonner avec ou sans donnes numriques ;
- trouver lerreur dans une rsolution ;
- calculer des surfaces diminues et des surfaces augmentes.
Pour en savoir plus
Legrand, Louis, Psychologie applique lducation intellectuelle, Pour les enfants de 6 14
ans, ditions Fernand Nathan, 1980.
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), 2, Formation,
Raisonnement mathmatique et Rsolution de problmes, Collection Outils pour la Classe,
MEN, Dakar, 1997.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Guides pdagogiques du Curriculum de
lEducation de Base, lmentaire, 1996.
Activits Etapes
Matre Elves
Prsentation du problme Propose une situation
problme et lexplicite
Sapproprient le problme
Recherche individuelle,
puis en groupes
Prcise les consignes de travail Essaient individuellement puis
changent en groupes
Mise en commun, dbats
et validation
Organise le compte rendu et la
validation par le groupe classe
Participent la validation des
hypothses plausibles
Institutionnalisation
(Analyse devant
dboucher sur une
synthse)
Fait analyser les solutions, tirer
les synthses
Participent
linstitutionnalisation du savoir
dcouvert
Rinvestissement Propose dautres situations Sexcutent
50
13 ACTIVITES NUMERIQUES
PRE TEST
1. Un nouveau matre affect dans une cole prend connaissance du programme de
calcul au CI et sest tout de suite mis au travail. On pouvait les entendre dans toute
lcole rciter la comptine numrique lui et ses lves. A la rcration, il savance,
fier, vers le directeur et lui dit : doyen, mes lves sont trs forts. Ils connaissent
tout le programme. Il y en a qui peuvent mme compter jusqu 100.
2. Pensez-vous que cet enseignant a raison ? Justifiez votre rponse en vous
appuyant sur des considrations dordre psychopdagogiques.
3. Un chercher en didactique des mathmatiques affirme que dans le nombre 425, seul
le 5 ne ment pas. Expliquez comment vous comprenez cette affirmation.
Introduction
La numration est ltude des nombres, cest--dire ltude du systme et des conventions
permettant dcrire, de nommer et deffectuer des calculs sur les nombres. Le nombre entier
naturel se dfinit comme le cardinal dun ensemble fini. Ce cardinal, proprit de lensemble,
est le nombre dlments. Ainsi, le nombre est la proprit commune plusieurs ensembles
ayant le mme cardinal.
Le nombre prsente cinq aspects :
laspect cardinal li la notion de quantit dnombre, compte ;
laspect ordinal li la notion de numrotage, de rang dans une srie ;
laspect groupement ou base de numration qui dtermine la valeur de chaque chiffre
dans un nombre (numration dcimale) ;
laspect symbolique li lcriture en chiffres ;
laspect lecture li lcriture en lettres du nombre.
Ltude des oprations doit articuler deux ples : le sens et la technique. Travailler sur le
sens revient rflchir sur la situation. Travailler sur les techniques quivaut tudier les
proprits, les transformations et les calculs.
Un accent particulier devra tre mis sur la matrise du calcul mental, domaine privilgi des
oprations. En fait, automatis ou rflchi, le calcul mental est indispensable pour les
besoins de la vie quotidienne (que ce soit pour obtenir un rsultat exact ou pour valuer un
ordre de grandeur) et de formation (dveloppement dun certain nombre daptitudes telles
que la mmoire, lintelligence, limagination, le sens critique). La matrise du calcul mental
est galement ncessaire pour comprendre certaines notions mathmatiques notamment la
structure des nombres et les proprits des oprations. Ce double aspect apparat dans les
propos dAlain qui qualifie le calcul mental de calcul royal amenant Matres et lves
51
inventer sans cesse de nouveaux moyens de courir sans se tromper mais (o) la vitesse ne
doit jamais tre spare de la sret.
13.1 Objectifs
Les activits numriques ont pour objectifs :
dinitier lenfant au langage mathmatique ;
de lamener la matrise de la numration dcimale (0 100 pour la 1re tape, 0
100 000 pour la 2me tape avec lintroduction des dcimaux, grands nombres,
nombres dcimaux, nombres fractionnaires et nombres complexes la 3me tape) ;
de lamener la matrise du sens et des techniques opratoires ;
de linitier au calcul mental.
13.2 Principes mthodologiques
Dune manire gnrale, les principes suivants sont prconiss dans les activits
mathmatiques et il convient, donc, den tenir compte.
Le principe dactivit : Cest par sa propre exploration et non par rfrence
lexprience dautrui que lenfant construira la connaissance ;
Le principe de constructivit : Lanalyse et la pense intuitive, prcdant toujours
lanalyse et la pense rflexive, il faut laisser lenfant se heurter la difficult,
procder par essais erreurs et rectifications.
Le principe de variabilit : Il faut par exemple varier le matriel (variabilit
perceptuelle) mais aussi varier les paramtres (variabilit mathmatique) de manire
dcoller le nombre de la chose dnombre en activits numriques. Se dfier de
lapparence, dit Louis Legrand, est la rgle dor en pdagogie des mathmatiques.
Le principe de progression : aller du concret labstrait en passant par le semi
concret
De manire plus prcise et sagissant de ltude du nombre (collection abstraite engendre
et srie), il sagira aussi de sappuyer sur les principes suivants :
Partout lopration manuelle doit prcder lopration arithmtique (premire tape) ;
Labstraction mathmatique se ralisera par laction et non par contemplation ;
Au cours des 2 premires annes, dans le cadre des situations agies dabord, puis
figures schmatiquement, ensuite exprimes symboliquement, les enfants
achveront ltude concrte de la notion de nombre, se familiariseront avec les
structures des nombres les plus simples, sinitieront au sens eu la pratique des
oprations. Dans les 3 annes suivantes, les matres resteront fidles aux mmes
principes, mais ils tiendront videmment compte de la plus grande maturit des
lves. En arithmtique, la reprsentation schmatique prendra le pas sur la
manipulation, le matriel devenant vite encombrant et lenfant matrisant la fonction
symbolique. Les mcanismes seront monts par la rflexion, lexplication et
consolids par de nombreux exercices Instructions officielles (IO) de 1978
52
13.3 Dmarche
Activits Etapes
Matre Elves
Calcul mental
(nouvelle acquisition)
Propose des problmes oraux tirs du
vcu
Fait ttonner pour rsoudre les problmes
Fait tirer la rgle
Propose dautres problmes pour
appliquer la rgle
Sessaient rsoudre les
problmes
Rptent la rgle
Rsolvent mentalement
les problmes
Appropriation du
matriel
Prsente le matriel
Fait observer et manipuler le matriel
Procde une dmonstration au besoin
Observent et manipulent
le matriel
Essayent dutiliser le
nouveau matriel
Activits libres Propose des activits ou situations
Explicite les consignes de travail
Surveille le droulement des activits
Sapproprient la situation
et les consignes
Sexcutent
individuellement et/ou en
groupes
Prennent note sur les
ardoises ou dans les
cahiers
Activits diriges Organise le compte rendu et les
changes
Fait analyser les rsultats et procdures
Procde des renforcements en variant
les supports et synthse
Verbalisent et
schmatisent, au besoin,
les rsultats
Participent llaboration
de la synthse
Evaluation Propose des situations de
rinvestissement immdiat des acquis
Propose des situations de transfert
Sexcutent
individuellement
EXERCICE
1. Indiquez les diffrents aspects du nombre.
2. Soit lcriture suivante 32 (base4) : transformez cette criture en base 5 puis en
base10.
3. Prcisez lintrt pdagogique du principe de variabilit perceptuelle et
mathmatique et donnez un exemple dutilisation de ces principes dans ltude de la
numration.
53
Pour en savoir plus
Legrand, Louis, Psychologie applique lducation intellectuelle, Pour les enfants de 6 14
ans, ditions Fernand Nathan, 1980.
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), 2 Formation, Activits
numriques en grande section et aux CI/CP, Collection Outils pour la Classe, MEN, Dakar,
1997.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Guides pdagogiques, Curriculum de
lEducation de Base, lmentaire, 1996.
Situations dintgration
Dans le cadre de la prparation des valuations du CFS, les sujets suivants vous sont
proposs :
Pour le CEAP
Contexte : Soient les objets dtudes suivants : le primtre du carr, la construction du
losange et les fractions dcimales.
Consigne : Indiquez les principes mthodologiques sur lesquels vous vous appuyez pour
enseigner ces objets et proposez ensuite une fiche pdagogique pour chacun deux.
Pour le CAP
Contexte : Sagissant de lenseignement de la gomtrie, Louis Legrand affirme que toute
dfinition abstraite doit tre la prise de conscience rflchie dune construction pralable.
Consigne : Expliquez cette affirmation en lillustrant par des exemples pratiques.
54
EDUCATION LA SCIENCE ET LA VIE SOCIALE
COMPTENCE VISE
Intgrer des ressources (savoirs, des savoir-faire et des savoir-tre) relatives
la didactique de lducation la science et la vie sociale dans des
situations dlaboration de fiches pdagogiques ou de dissertations
psychopdagogiques.
Comptences des sous domaines
Sous-domaines (SD) Comptences
Dcouverte
du monde (DM)
Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des
situations de traitement dpreuves crites portant sur des
disciplines du sous-domaine Dcouverte du monde.
Dveloppement
Durable (DD)
Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des
situations de traitement dpreuves crites portant sur des
disciplines du sous-domaine Dveloppement durable.
Dveloppement des comptences des sous-domaines
SD
Activits
disciplinaires
Objectifs
Histoire Matriser la didactique de lhistoire lcole lmentaire
Gographie
Matriser la didactique de la gographie lcole
lmentaire DM
Initiation scientifique
et technologique
Matriser la didactique de linitiation scientifique et
technologique lcole lmentaire
Vivre dans son
milieu
Matriser la didactique de vivre dans son milieu lcole
lmentaire
DD
Vivre ensemble
Matriser la didactique de vivre ensemble lcole
lmentaire
55
14 HISTOIRE
Comptence vise: Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Dcouverte du monde.
Objectif : Matriser la didactique de lhistoire lcole lmentaire
PRE-TEST
1. Est-il important denseigner lHistoire lcole lmentaire ? Justifiez votre
rponse.
2. Quelle Histoire doit-on enseigner lcole lmentaire ? Justifiez votre
rponse.
3. Est-il facile denseigner lHistoire lcole lmentaire ? Pourquoi ?
4. Rappelle trois notions cls dont la comprhension facilite ltude de lhistoire.
Prcisez pourquoi ?
Introduction
Lhistoire est dfinie comme tant ltude du pass. Elle sintresse lvolution de
lhomme dans ses relations avec le milieu, avec les phnomnes et avec les
civilisations travers le temps. Ainsi, elle permet lenfant dapprhender les
vnements qui se sont succds, de bien comprendre les transformations pour
mieux envisager le futur.
14.1 Objectifs
De faon gnrale, lapprentissage de lhistoire lcole lmentaire doit aider
lenfant :
Structurer le temps ;
Sapproprier les notions de dure, de progrs, dvolution, de civilisation, de
solidarit, etc. ;
Senraciner dans les valeurs de sa civilisation afin de dvelopper le sentiment
patriotique ;
Rflchir sur le pass pour comprendre le prsent et mieux agir dans le futur ;
Dvelopper la curiosit, le sens de lobservation, lesprit critique, le jugement,
le sens de la relativit des valeurs et des civilisations ;
Dvelopper la sensibilit, limagination, le got du merveilleux ;
Initier aux techniques lmentaires dinvestigation comme lenqute, lanalyse
documentaire ;
Avoir des repres prcis permettant de prendre conscience de son identit
tout en laidant souvrir aux autres cultures.
56
Spcifique la premire tape (CI - CP)
Laccent est mis sur la structuration du temps, conformment lge mental des
enfants. On vise aider les lves :
prendre conscience que le temps scoule (matin, midi, soir / hier, aujourdhui,
demain ;
se rendre compte que le temps sordonne : calendrier, chronologie,
antriorit, simultanit, postriorit) ;
dcouvrir leur pass personnel, le pass de leur environnement local ;
comprendre que le temps se mesure et se reprsente (dure, horloge, jour,
semaine, mois, anne, ligne du temps).
Spcifique la deuxime tape (CE 1 - CE 2)
Il sagit de :
dvelopper la notion de temps historique appliqu aux cadres et espaces
familiers de lenfant (famille, village, quartier) ;
susciter le sentiment patriotique, lide de cohsion nationale et de large
solidarit ;
susciter la curiosit par le dveloppement dun esprit de recherche qui
sappuie sur le milieu proche.
Spcifique la troisime tape (CM1 - CM2)
Lhistoire ltape 3, vise essentiellement :
renforcer et consolider les acquis antrieurs ;
dvelopper la capacit danalyse et dinterprtation des faits et des
documents collects dans le milieu ;
tablir des corrlations entre des faits historiques ;
engager les lves participer des actions de sauvegarde des documents,
objets, sites et monuments historiques de la localit.
EXERCICE
Expliquez trois techniques dinvestigation prconises dans lenseignement de
lhistoire.
14.2 Principes mthodologiques
Il sagira surtout :
dapprendre lenfant situer sur la trame chronologique des faits saillants,
des vnements marquants et de dcouvrir leur interrelation ;
de sattacher aux aspects de la vie en socit, de la civilisation et du progrs
raliss par lhomme ;
la leon dhistoire doit tre vivante, anecdotique et pittoresque (Instructions
Officielles (IO) de 1978);
de ne pas travailler devant les enfants, mais de travailler avec eux.
Enseigner lhistoire, dit Marc Bloc, cest faire un travail dhistorien ;
57
les objectifs mthodologiques (enqute, analyse documentaire, visite de sites,
etc.) lemportent sur les objectifs cognitifs mme si ces derniers continuent de
revtir une importance indniable ;
la dmarche dinvestigation semble bien indique pour atteindre les objectifs
mthodologiques.
14.3 Dmarche pdagogique
Il nexiste pas de dmarche standard. Celle-ci dpend de plusieurs paramtres :
objet dtude, objectifs, cibles, contexte, etc. A titre indicatif, nous proposons une
dmarche couramment utilise par les enseignants.
Etapes Rles du matre Activits des lves
Rvision
- Interroge sur les acquis prcdents
- Interroge sur les pr-requis (ce qui
facilite la comprhension de la leon du
jour)
Rpondent aux
sollicitations du matre
(questions, consignes)
Mise en
situation
- Prsente le fait historique
- Suscite des interrogations
- Fait dgager les axes de recherche
- Sapproprient la situation
- Formulent des
interrogations
- Participent la
formulation des questions
de recherche
Recherche
dinformations
- Oriente vers les sources
dinformations : sites, documents,
bibliothque, etc.
- Aide choisir ou laborer les
techniques et outils de recueil
dinformations : visites, interview,
analyse documentaires, grilles,
questionnaire
- Participent au choix ou
llaboration des
techniques et des outils
- Mnent les activits de
recherche individuelle et en
groupes
Analyse
- Organise la mise en commun dans les
groupes
- Organise la confrontation des
rsultats
- Aide organiser les informations
recueillies
- Apporte les clarifications ncessaires
- Echangent dans les
groupes, harmonisent les
rponses
- Organisent les
informations recueillies
Synthse
/Conclusion
Aide stabiliser les rsultats
retenir (rsum, cartes, frises,
maquettes, etc.)
Participent llaboration
de la synthse.
Evaluation
Propose des exercices de contrle :
activits de ralisation de carte,
remplissage de blason
Sexcutent
58
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche argumente portant sur lenseignement de
lhistoire au CE1
2. De plus en plus denseignants, se plaignant de difficults disposer de
sources documentaires, se contentent en classe de commenter le livre
dhistoire. Ont-ils raison ? Pourquoi ?
3. Enseigner lhistoire, cest faire apprendre lenfant des dates, des batailles,
des guerres. Es-tu de cet avis ? Quelle orientation donnez-vous
lenseignement de lhistoire au CE. Justifiez votre choix.
4. Elaborez une fiche argumente dhistoire portant sur un thme du CM. La
leon partira dune enqute.
Pour en savoir plus
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Fascicule tude
du milieu dominante historique, MEN, Dakar, 1996.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Pdagogie pour lAfrique nouvelle,
EDICEF, 1978.
Ministre de lducation, Guide pdagogique pour les classes pilotes, Dakar, 1987.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre,
EDICEF, 1993.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Curriculum de lEducation de base,
Guides pdagogiques, NAS, 2006.
59
15 GOGRAPHIE
Comptence vise : Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Dcouverte du monde
Objectif : Matriser la didactique de la gographie lcole lmentaire
PRE-TEST
Lenseignement de la gographie participe, d'une part, la construction d'une
identit culturelle et, d'autre part, au dveloppement d'un esprit d'ouverture.
Commentez cette affirmation en illustrant vos propos avec des exemples tirs des
programmes et des activits scolaires.
Introduction
La gographie est une activit disciplinaire qui permet lenfant de se situer, de
situer diffrends milieux dans lespace et de comprendre lorganisation du monde.
Son enseignement dveloppe la conscience nationale et consolide le sentiment
dappartenance un monde unique et interdpendant. Il contribue la prise de
conscience collective et la solution des problmes qui se posent la socit
contemporaine. Ainsi, le rapport du spatial et du social est pos : il sagit de
comprendre les interactions complexes qui existent entre lhomme et son milieu
toutes les chelles dobservation.
En effet, manire dapprhender lespace, la gographie tudie surtout les relations
que la terre, les phnomnes naturels, les hommes et les animaux entretiennent. On
peut retenir quau del dune tude portant sur un espace bien localis, la
gographie est une science de relations. Ce nest pas une description sans vie,
mais une confrontation des faits . Guide pdagogique des classes pilotes
15.1 Objectifs
De manire gnrale, la gographie a pour objectifs de faire dcouvrir :
les caractristiques de lespace naturel et de lespace cr par lhomme
producteur et consommateur
linterdpendance des phnomnes naturels
linterrelation entre lhomme et son milieu
60
Il sagit plus particulirement damener les lves :
structurer lespace (surtout en premire tape)
dvelopper des aptitudes : observer, reconnatre, classer, mettre en relation,
juger, apprcier, savoir reprsenter
matriser un vocabulaire gographique de base
utiliser des techniques simples et des outils dorientation
matriser des techniques de lecture, de traage de plan, de carte, dutilisation
dchelle, etc.
15.2 Principes mthodologiques
Lenseignement de la gographie sera essentiellement fond sur lobservation
attentive et rgulire des phnomnes naturels directement perceptibles ou de leur
reprsentation (gravures, photographies, modles rduits). Observer, localiser,
dcrire, comparer, expliquer, telle sera la dmarche qui devra guider le matre
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), de 1978.
Lintrt et la motivation : pour quune investigation soit fructueuse, elle doit
tre sous-tendue par une vritable motivation ;
La concrtisation : mener lobservation sur le terrain ou dfaut, recourir
des photos, schmas, cartes, maquettes, etc. Lobservation doit ainsi porter
sur le rel ou son substitut ;
La globalit : par respect au syncrtisme enfantin, lon partira toujours du
global vers les lments ;
Lactivit : la leon sera faite avec les lves ; le matre doit tout entreprendre
pour faciliter leur implication (lenqute, la recherche documentaire peuvent
toujours servir).
15.3 Dmarche pdagogique
Etapes
Rles du matre Activits des lves
Rvision
- Interroge sur les acquis prcdents
- Interroge sur les pr-requis (ce qui
facilite la comprhension de la leon
du jour)
Rpondent aux
sollicitations du matre
(questions, consignes)
Observation libre
- Prsente le sujet dtude
- Organise les conditions
dobservation : activits extra muros
pour une observation directe ou mise
en place des substituts
- Donne les consignes dobservation
- Recense les reprsentations des
lves (ides, sentiments)
- Observent le
phnomne
- Notent les ides et
sentiments inspirs par
le fait observ
- Rendent compte de
leurs observations
(synthse de groupes)
Observation
dirige
Fait analyser les productions :
activits de localisation relle ou
- Localisent le fait
gographique
61
reprsente, de description, de
comparaison et dexplication
- Procdent aux
descriptions du fait
- Ralisent des activits
de comparaison et
dexplication
Synthse
- Fait rsumer les ides essentielles
- Fait reprsenter par un plan, une
carte, un graphique, etc.
- Participent
llaboration de la
synthse
- Recopient le rsum
ventuellement
Rinvestissement
Proposent des exercices de
contrle : activits de ralisation de
carte, remplissage de blason, etc.
Sexcutent
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche argumente portant sur lenseignement de la
gographie au CE2.
2. Il nest pas trs profitable denseigner la gographie des enfants de 6 8
ans partir dune carte. Commentez cette affirmation et tirez-en des
consquences pdagogiques pour lenseignement de la gographie aux
CI/CP.
Pour en savoir plus
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Fascicule tude
du milieu a dominante gographique, MEN, Dakar, 1996.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Pdagogie pour lAfrique nouvelle,
EDICEF, 1978.
Ministre de lducation, INEADE, Guide pdagogique pour les classes pilotes,
1987.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre,
EDICEF, 1993.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Curriculum de lEducation de base,
Guides pdagogiques, NAS, 2006.
62
16 INITIATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Comptence vise : Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Dcouverte du monde
Objectif : Matriser la didactique de linitiation scientifique et technologique lcole
lmentaire
PRE-TEST
A partir dexemples simples et en des termes que peut comprendre un lve de
lcole lmentaire expliquez la diffrence entre science et technologie. Quels profits
llve peut-il attendre de lapprentissage de la science et de la technologie ?
Introduction
La science et la technologie sont devenues deux dimensions importantes de lactivit
humaine. Les machines envahissent tous les pays et ne laissent plus lcole
indiffrente. Le Sngal, dans la rforme de son systme ducatif, cherche
revaloriser lenseignement des sciences et de la technologie travers une activit
disciplinaire appele Initiation scientifique et technologique.
16.1 Objectifs
Les objectifs gnraux sont la fois dordre conceptuel et ducatif :
Objectifs conceptuels
acquisition des notions fondamentales de temps, despace, de causalit, de
vie (reproduction, nutrition, croissance, locomotion, adaptation) ;
dcouverte progressive de la notion de loi scientifique ;
dcouverte de la finalit de lobjet technologique, de son fonctionnement et de
ses rgles de construction.
Objectifs ducatifs
aptitudes : affinement sensoriel, habilets gestuelles, observation, capacit
abstraire ;
attitudes : curiosit, objectivit, got de leffort, besoin de vrification, esprit
critique, travail de groupe ;
mthodes : formuler clairement un problme, mettre des hypothses,
exprimenter, sinformer, communiquer, classer et mesurer.
63
Au fur et mesure des progrs de lenfant, les attentes seront plus prcises. Les
objectifs viseront un niveau suprieur dorganisation du temps et de lespace et
demanderont une meilleure capacit dobservation, danalyse et de synthse.
EXERCICE
Le travail de groupe peut-il avoir une influence dans la formation de lesprit
scientifique ?
16.2 Principes mthodologiques
la mthode est concrte, active, fonde sur lobservation, lexprimentation et
linterprtation pour lacquisition dun vritable esprit scientifique ;
le concret nest quun point de dpart qui tient sa valeur de ce quil permet
datteindre lexplication. Les choses ninstruisent pas en elles-mmes ; leur
rle est de provoquer des questions et daider les rsoudre ;
les lieux dinvestigation sont diversifis : classe, cour, jardin scolaire,
poulailler, muse, bergerie, atelier dartisan ;
pour les tres vivants, ltude doit consister mettre en vidence les
problmes dadaptation (relations organes/mode de vie par exemple) ainsi
que les grandes fonctions biologiques (locomotion, nutrition, respiration,
reproduction, etc.) ;
lorsque ltude porte sur des objets technologiques, cest la destination
(usage, utilit), le fonctionnement et les rgles de construction qui doivent
guider lenseignant ;
pour les phnomnes physiques et chimiques, cest la loi qui les explique, qui
commande ce que lon doit chercher redcouvrir ;
les nouvelles acquisitions doivent faire lobjet dun rinvestissement pour
confrer aux acquisitions scientifiques et technologiques leur caractre
pratique et utilitaire.
EXERCICE
Est-il plus facile dobserver un objet naturel (vivant) ou un objet technologique ?
Pourquoi ?
16.3 Dmarches pdagogiques
Selon que lon cherche construire une connaissance scientifique ou que lon veuille
comprendre ou raliser un objet technologique, la dmarche pdagogique va
lgrement varier.
64
16.4 Dmarche exprimentale
Etapes Explications
1. Imprgnation
Cest un moment dobservation libre et de questionnement ; elle
motive et sert de dclencheur lactivit de recherche. Les
lves sont devant une situation qui suscite leur tonnement ;
elle fait natre le dsir de comprendre. Lintrt des lves pour
apprendre sveille. Cette observation est plus fructueuse
lorsquelle est mene en groupe.
2. Formulation
dhypothses
Aprs la collecte dinformations, une ou plusieurs hypothses
sont formules. Cest une anticipation sur le rsultat de
lexprience comme reprsentation de la solution, des
explications ou des rponses possibles. Les changes au sein
du groupe permettent de choisir une ou plusieurs ( limiter)
hypothses exprimenter (la ou les plus vraisemblables).
3. Exprimentation
Un dispositif exprimental est labor et mis en uvre. Il dcrit
les conditions et le droulement des expriences mener. Par
lobservation et la mesure, entre autres, les lves recueillent
des donnes sur lobjet dtude. Lexprimentation permet de
confirmer ou dinfirmer les hypothses choisies.
4. Synthse
Les rsultats obtenus par chaque groupe sous forme
dinterprtations et de conclusions sont communiqus puis
confronts avec ceux des autres groupes pour aboutir une
production commune valide par le matre. Cette phase mne
la mise en vidence des relations, au principe explicatif. En
somme, elle est marque par la mise en cohrence des
connaissances scientifiques retenir.
5. Evaluation
Les activits dvaluation permettent de renforcer et de contrler
les acquis.
6.
Rinvestissement
Les connaissances acquises sont rinvesties dans les
comportements au quotidien. Llve adopte des modes
dexplication plus rationnelle des phnomnes.
65
16.5 Dmarche dordre technologique
Etapes Explications
1. Imprgnation
Elle motive llve et dclenche son intrt pour lobjet
tudier. Cest une phase dauto-apprentissage marque par le
ttonnement exprimental (essai/erreurs), lautonomie et la
recherche active, la formulation dhypothses.
2. Exprimentation
Elle permet de comprendre le fonctionnement de lobjet qui est
dmont, remont. Llve apprend en somme manier lobjet
et lutiliser.
3. Acquisition
Cest la phase de formalisation des acquis notionnels, dapports
dinformations. Elle dpasse le simple apprentissage de
lutilisation de lobjet pour faire dcouvrir son utilit, son
fonctionnement par le dmontage, le remontage et la fabrication.
4. Ralisation
Lobjet technique est ralis par llve (ou le groupe dlves)
en toute autonomie. Cest une phase de cration partir du
connu.
5 Evaluation
Les activits dvaluation permettent de renforcer et de contrler
les acquis.
6.
Rinvestissement
Les savoir-faire acquis sont rinvestis dans les actions au
quotidien.
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche raisonne portant sur lenseignement de
linitiation scientifique et technologique au CM1.
2. La connaissance doit tre construite par lenfant et non apprise. Que veut-on
dire par l ? Expliquez comment vous appliquez ce principe dans linitiation
scientifique et technologique des lves ?
3. Linitiation scientifique et technologique se fait partir de problmes poss
par les activits fonctionnelles de lenfant et lexploration du milieu ; de ce
fait, elle ne peut pas faire lobjet dune planification rigide. Commentez ces
propos et prcisez comment, dans la planification des activits dinitiation
scientifique et technologique vous parvenez concilier les intrts des
lves et les contraintes du programme.
66
Pour en savoir plus
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Pdagogie pour lAfrique nouvelle,
EDICEF, 1978.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre, (4me
partie : Sciences, technologie, initiation lagriculture), EDICEF, 1993.
Legrand, L. Psychologie applique lducation intellectuelle, (Chapitre 13 : La
conception de la nature), Editions Fernand Nathan, 1980.
Programme de dveloppement des ressources humaines (PDRH), Fascicule Etude
du milieu a dominante scientifique, Collection Outils pour les matres, MEN, Dakar,
1996.
Situations dintgration
Pour le CEAP
Contexte : La dsertification est un flau qui menace des socits entires. Elle
ignore les frontires et interpelle toute lhumanit.
Consigne : laborez une fiche pdagogique qui sensibilise sur : les
consquences au niveau local, la responsabilit individuelle et collective et les
actions de lutte contre la dsertification
Pour le CAP
Contexte : <Le milieu cest le rel dans sa plnitude, le rel proche rapport
luniversel>.
Consigne : Expliquez comment vous comprenez cette affirmation en vous
appuyant sur lanalyse des programmes en vigueur.
67
17 VIVRE DANS SON MILIEU
Comptence vise : Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Dveloppement durable.
Objectif : Matriser la didactique de vivre dans son milieu lcole lmentaire
PRE-TEST
La communaut internationale a fini de prendre conscience que lexploitation sans
retenue des matires premires est de nature compromettre la survie mme de
lHumanit. Beaucoup dinitiatives sont lances pour une gestion plus rationnelle des
ressources naturelles.
Quel rle lcole peut-elle jouer dans cette vaste entreprise ?
Comment prparez-vous vos lves tre et devenir des acteurs du
dveloppement durable dans leurs comportements de tous les jours ?
Introduction
Vivre dans son milieu est lune des deux activits disciplinaires du Domaine
Education au dveloppement durable. Le dveloppement durable est une
approche du dveloppement qui rpond aux besoins des gnrations prsentes tout
en prservant et en prparant la capacit des gnrations futures satisfaire leurs
propres besoins. Vivre dans son milieu devient, ainsi, une prparation une
insertion harmonieuse de lenfant dans son milieu sous langle dune gestion
rationnelle des ressources et du respect des quilibres. Il aborde des thmes
majeurs tels que lenvironnement, la population et la sant.
17.1 Objectifs
De manire gnrale, Vivre dans son milieu permet lenfant dapprhender la
complexit du monde dans lequel il vit dans ses dimensions relatives aux questions
denvironnement, de population et de sant tout en le prparant un monde plus
panouissant.
De faon plus spcifique, il sagit pour llve de :
prendre conscience des problmes denvironnement de son milieu et de
dvelopper ses capacits leur trouver des solutions pertinentes et adaptes
(propositions, attitudes ou actions) ;
68
prendre conscience des problmes de population de son milieu et de
dvelopper ses capacits leur trouver des solutions pertinentes et adaptes
(propositions, attitudes ou actions) ;
prendre conscience des problmes de sant de son milieu et de dvelopper
ses capacits leur trouver des solutions pertinentes et adaptes
(propositions, attitudes ou actions).
17.2 Principes mthodologiques
Vivre dans son milieu repose sur les principes mthodologiques suivants :
dmarche participative qui sensibilise sur les problmes denvironnement, de
population et de sant et stimule la rflexion sur la recherche de solutions ;
culture du principe de solidarit dans lespace et dans le temps ;
dveloppement du sens des responsabilits individuelles et collectives ;
visites de sites et tude de cas orientes vers la recherche de solutions des
problmes du milieu ;
organisation de lcole et de la classe dans le sens des objectifs viss.
EXERCICE
1. Le monde, dit-on, est devenu un village plantaire. Dans le cadre dune
ducation au dveloppement durable, comment comprenez-vous les notions
de solidarit dans lespace et de solidarit dans le temps ?
2. Il existe, certainement, des possibilits de changement pour plus de
solidarit avec les gnrations futures. Quels rles lcole peut-elle jouer
pour promouvoir ces changements ?
17.3 Dmarches pdagogiques
Dans le domaine des problmes denvironnement et de sant, il sagit
particulirement dune dmarche de rsolution de problmes qui comporte les
phases suivantes :
Phases Explications
Imprgnation
Llve est mis en contact avec la situation-problme (visite de
site, observation dimages, tude de cas, enqute ou rsultats
denqute, etc.) pour veiller lintrt et amener llve
sinterroger. Cette prise de contact doit tre assez libre ; il faut
accorder suffisamment de temps cette phase.
69
Analyse
A partir dune observation dirige (questions/rponses,
changes entre lves), le matre amne les lves identifier
le problme majeur (absence, dficit, dsquilibre,
dysfonctionnement, etc.). Le problme tudier doit tre
proche du vcu de llve pour lui permettre de mener un
travail danalyse. Les causes et les consquences du problme
sont identifies puis analyses sous diffrents aspects. Des
solutions sont proposes ; les plus pertinentes sont retenues.
Synthse
En collaboration avec les lves, le matre reprend la trame
gnrale des acquisitions pour une rcapitulation et une mise
en cohrence : problme causes consquences
propositions de solutions. Cest aussi un moment de contrle
des apprentissages.
Rinvestissement
Les acquis seront rinvestis dans dautres situations similaires.
Ils devront servir galement de rgles de conduite sous la
surveillance du groupe.
A propos des problmes de population, loption portera sur la dmarche de
clarification des valeurs :
Phases Explications
Imprgnation
Cest un moment dappropriation du problme. Les lves
sont mis en situation. Le prtexte peut porter sur une
situation vcue, une situation simule ou une histoire
narre. Les situations fortuites qui entrent dans le cadre du
programme constituent des occasions privilgies
exploiter. Il convient, toutefois, dviter de choisir des
situations qui, dune manire ou dune autre, peuvent
blesser les lves.
Le matre accompagne les lves dans la comprhension
globale du problme pos.
Analyse
Cest un moment de dbat libre. Le matre organise la
discussion dans les groupes (ou en plnire) pour faire
apparatre tous les points de vue. Ceux-ci sont souvent trs
tranchs et de nature oppose (bien / mal, juste / injuste, vrai /
faux, etc.). Tous les points de vue sont dignes dintrt, donc
de respect. Lessentiel est de fonder son choix dans la limite
des codes moraux qui fondent la vie en communaut. Les
railleries et les chahuts sont bannir. Les lves doivent tre
duqus la tolrance et au respect de lopinion dautrui.
Apprciation et
choix
Reprise systmatique et rflexion critique pour dgager les
avantages et les inconvnients de chaque option. Cette
phase peut amener des lves modifier volontairement
leurs reprsentations du problme pour en avoir eu une
perception plus prcise.
Les lves oprent et expriment librement leur choix qui
sont justifis et arguments
70
Rinvestissement
Les conclusions ou les choix retenus devront inspirer et
clairer les conduites futures des lves.
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche argumente portant sur lenseignement de
vivre dans son milieu au CP.
2. Les activits conomiques et, plus prs des lves, les actions quotidiennes
constituent souvent des atteintes lenvironnement (dchets, pollution,
gaspillage, etc.). Selon vous, comment lcole, dans son organisation
interne, peut-elle dvelopper des comportements favorables
lenvironnement et la prservation des ressources ? Illustrez vos propos
par des exemples tirs de la vie de lcole et des situations denseignement-
apprentissage.
3. Depuis longtemps, le dveloppement de lindividu a t un des objectifs
majeurs de lducation. Le dveloppement durable fait partie des nouvelles
problmatiques contemporaines qui interpellent lcole. Comment est-il
possible, dans les activits scolaires, darticuler ces deux ambitions ?
Pour en savoir plus
Riondet, B, Cls pour une ducation au dveloppement durable, Hachette Livre,
2004.
71
18 VIVRE ENSEMBLE
Comptence vise : Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Dveloppement durable.
Objectif : Matriser la didactique de vivre ensemble lcole lmentaire
PRE-TEST
Voici le rsum du film dune leon de vivre ensemble sur le respect des biens
publics.
Objectif dclar : Les lves devront savoir que les biens publics doivent tre
protgs par tous.
Rvision : 3 lves ont rcit leur leon prcdente. Une question est pose sur le
contenu du rsum.
Leon du jour :
- Le matre pose les questions suivantes : A qui appartient lcole ? Pourquoi est-elle
si dlabre et mal entretenue ?
- Suite aux rponses des lves, le matre dgage la rsolution suivante : Lcole
nous appartient, nous devons la protger.
- Les lves rptent la rsolution et recopient le rsum dans leur cahier.
1. Partagez-vous cet objectif ?
2. Que pensez-vous de la dmarche de ce matre ?
Introduction
Vivre ensemble est la deuxime activit disciplinaire du Domaine Education au
dveloppement durable. Elle reprend les objectifs des anciennes disciplines
dducation civique, morale et sanitaire en mettant en relief des thmes dactualit
relatifs la vie en communaut : problmes de droits, de paix, de citoyennet, de
genre, etc. Il offre, donc, un champ dinvestigation plus large tout en mettant laccent
sur lacquisition dattitudes et de comportements citoyens fonds sur des valeurs
indispensables la vie collective. Il sagit de renforcer lharmonie, la cohsion, lunit
et la solidarit au sein du groupe.
72
18.1 Objectifs
Il sagit, pour une insertion sociale harmonieuse, de :
former lenfant en dveloppant la conscience morale, le sens de la solidarit,
de lamour du prochain, les qualits dhonntet, de sincrit, de respect de
lautre et lamour du travail bien fait ;
former le futur citoyen, en dveloppant le sens des devoirs, des
responsabilits, lesprit patriotique et de participation positive aux affaires de
la socit ;
faire connatre lenfant ses droits, ses devoirs et ceux des autres et de les
lui faire respecter ;
dvelopper chez llve un sentiment dappartenance des valeurs
communes ;
apprendre lenfant rgler les conflits de faon pacifique et loyale ;
apprendre llve exercer un contrle responsable en participant de
manire informe et claire aux prises de dcisions.
18.2 Principes mthodologiques
privilgier linstallation de bons comportements sur le discours ;
saisir toutes les opportunits quoffre la vie de tous les jours, pour faire un
enseignement occasionnel : situations de vie, en relation avec dautres
disciplines ;
organiser la classe et lcole selon les principes enseigns pour que lenfant
ait les vivre et les pratiquer (cooprative scolaire, gouvernement scolaire,
activits par et pri-solaires, etc.) ;
faire de Vivre ensemble une morale du comportement sociale avant dtre
lhistorique ou la description des institutions ;
accompagner lenfant dans les diffrents moments de sa vie en classe
comme lextrieur ;
instaurer un climat dans les changes et un style de vie dans la classe qui
mettent les lves en confiance, dvelopper le sens de la solidarit, de
lentraide, favoriser un quilibre entre le respect des contraintes de la vie de
groupe et un accs progressif lautonomie.
18.3 Dmarche pdagogique
La dmarche sera dynamique. Il sagira de mettre les lves en situation pour les
amener sapproprier les principes de citoyennet, de dmocratie, de paix, de
respect des droits et de la diversit. A titre indicatif, voici une dmarche possible pour
conduire des leons de Vivre ensemble.
Etapes Rles du matre Activits des lves
Rvision
- Interroge sur le bilan des
comportements
- Interroge sur les pr-requis (ce
qui facilite la comprhension de
la leon du jour)
- Font le bilan des
comportements (autocritique,
auto-valuation)
- Rpondent aux sollicitations
du matre (questions,
consignes)
73
Prsentation ou
rappel de la
situation de
dpart
- Fait observer la situation
problme
- Procde aux explications
- Prcise les consignes danalyse
Sapproprient la situation
(individuellement puis en
groupes)
Analyse et
discussions
- Organise la restitution
- Recense les jugements
favorables ou dfavorables
- Organise les changes
- Fait dgager un axe central de
rflexion
- Expriment leurs points de
vue et argumentent
- Echangent entre eux
Synthse
- Stabilise la conclusion ou
solution du problme
- Rappelle les normes, les
principes ou valeurs justifiant les
choix
- Participent la comparaison
entre solution et normes
- Retiennent la conclusion
finale (rsolution, prcepte,
recommandation)
Evaluation
Propose des tudes de cas (faits
divers scolaires ou de socit)
Rsolvent individuellement le
cas
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche argumente portant sur lenseignement de
vivre ensemble au CI.
2. Maintenant que vous en savez un peu plus, amliorez la fiche du matre sur
le respect du bien public.
Items Propositions
Justifications
psychopdagogiques
Objectif
Rvision
Dmarche
Evaluation
3. Avec de limagination, le matre peut saisir les opportunits quoffre la vie
lcole pour mettre en jeu la tolrance, la justice et organiser des dbats o
lon sentranera sexprimer, se respecter mutuellement, sentraider et
cela sans avoir besoin de recourir des leons classiques. Aprs avoir
commentez ces propos, illustrez-les par un exemple concret.
74
Pour en savoir plus
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Guides pdagogiques, Curriculum
de lEducation de Base, (toutes les productions), 2006.
Situations dintgrations
Pour le CEAP
Contexte : A partir des objectifs et principes prsents dans ce module.
Consigne : laborez une fiche argumente pour une activit raliser dans une
classe de votre choix.
Pour le CAP
Contexte : Lactualit est souvent domine par des cas dintolrance
(sectarisme, fanatisme, communautarisme, etc.) qui engendrent une violence
aveugle.
Consigne : Expliquez comment lcole, dans son organisation, son
fonctionnement et ses activits pdagogiques prpare les lves vivre
ensemble dans la paix, la solidarit et lharmonie.
75
EDUCATION PHYSIQUE, SPORTIVE ET ARTISTIQUE
COMPTENCE VISE
Intgrer des ressources (savoirs, des savoir-faire et des savoir-tre) relatives
la didactique de lducation physique, sportive et artistique dans des
situations dlaboration de fiches pdagogiques ou de dissertations
psychopdagogiques.
Comptences des sous domaines
Sous-domaines (SD) Comptences
Education
physique et sportive
(EPS)
Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des
situations de traitement dpreuves crites portant sur des
disciplines du sous-domaine Education physique et
sportive.
Education artistique
(EA)
Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des
situations de traitement dpreuves crites portant sur des
disciplines du sous-domaine Education artistique.
Dveloppement des comptences de sous-domaines
SD
Activits
disciplinaires
Objectifs dapprentissage
EPS Activits physiques
Activits sportives
Matriser la didactique de lducation physique et sportive
lcole lmentaire
EA Arts plastiques
Matriser la didactique des arts plastiques lcole
lmentaire
Education musicale
Matriser la didactique de lducation musicale lcole
lmentaire
Arts scniques
Matriser la didactique des arts scniques lcole
lmentaire
76
19 ACTIVITS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Comptence vise : Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Education physique et sportive.
Objectif : Matriser la didactique de lducation physique et sportive lcole
lmentaire
PRE-TEST
Dgagez les caractristiques de lactivit physique et de lactivit sportive puis
montrez leurs liens de complmentarit. Prcisez comment vous articulez ces deux
activits dans la pratique de classe.
Introduction
Les activits physiques et sportives sont un lment fondamental de lducation, de
la culture et de la vie sociale. Elles constituent un facteur important dquilibre, de
sant et dpanouissement. Lducation physique et sportive agit sur trois
composantes de la personnalit de lenfant :
le savoir : domaine des connaissances intellectuelles ;
le savoir faire : domaine des qualits physiques et techniques ;
le savoir tre : domaine du comportement affectif et social.
19.1 Objectifs
Les objectifs gnraux de lenseignement des activits physiques et sportives
doivent tre orients vers les directions suivantes :
au plan moteur : une bonne maitrise corporelle et gestuelle et un
dveloppement des capacits motrices ;
au plan physiologique : une amlioration des possibilits de lorganisme ;
au plan cognitif : la connaissance du milieu physique, la structuration de
lespace et du temps, la maitrise des notions de distance, de dure, de poids
etc. ;
au plan psychologique : la maitrise des qualits psychologiques individuelles
(joie, confiance en soi, volont) et le dveloppement des qualits sociales :
sens de la coopration, respect des rgles de jeu
De faon spcifique au CI et au CP
initier lenfant au jeu, aux exercices dordre, dattention, de dbrouillardise et
de lui donner les premiers lments dune matrise corporelle.
77
De faon spcifique partir du CE 1
assurer son ducation corporelle en le familiarisant avec le sport par la
pratique des formes adaptes de la comptition.
19.2 Principes mthodologiques
utiliser le plus souvent le jeu et les formes joues ;
respecter les rythmes biologiques en alternant les priodes dactivits et de
repos ;
proscrire les exercices physiques intenses ;
diversifier les rles de llve : acteur, spectateur, officiel ;
proposer des exercices, des jeux et des activits globales et varies (viter
toute forme de spcialisation).
19.3 Dmarches pdagogiques
Une sance dactivits physique et sportive (APS) comprend les parties suivantes :
(i) une mise en train ou chauffement ; (ii) une partie principale ou corps de sance
et (iii) un retour au calme.
La mise en train ou chauffement
Elle constitue une transition entre les positions statiques de la classe et les
activits dynamiques qui doivent suivre. Elle a pour but de produire une
activation gnrale des grandes fonctions de lorganisme.
Le corps de sance
Cest une partie importante de la sance dAPS, tant du point de vue de la
dure que du contenu. Cest ce moment que lenseignant (e) doit mettre en
place les situations pdagogiques qui permettent latteinte des objectifs de la
sance : exercices, jeux, comptition.
Le retour au calme
Il constitue une autre transition entre les activits physiques et le retour en
salle de classe. Il vise calmer lagitation, retrouver lattention et permettre
une recharge dnergie.
78
Voici titre dexemple des dmarches possibles pour des sances dacquisitions
nouvelles.
Activits
Dmarches
Premire tape Deuxime et troisime tapes
Prise en main
- mise en rang
- pas cadences
- chant de marche
- mise en rang
- pas cadences
- chant de marche
Mise en train
- courses et marches
- exercices
dassouplissement
(sautillement, talons au
fesses, lvation de genoux,
gnuflexion, tirement de
bras, saut en extension, etc.)
- courses et marches
- exercices dassouplissement
(sautillement, talons au fesses,
lvation de genoux, gnuflexion,
tirement de bras, saut en
extension, etc.)
NB : adapter aux sports et jeux
prvus dans la sance
Corps de
sance
- annoncer les objectifs par
atelier, noncer les rgles
fondamentales
- exercices physiques
prparatoire lactivit
prvue
- jeux dquipes (ronde,
drapeau, marelle)
- annoncer les objectifs par atelier
- occuper lair du jeu
- dmarrer les comptitions (cf.
rgles de jeu des activits) et
pointer les scores
Retour au
calme
- se relaxer
- expliquer les checs et
russites
- critiquer les comportements
dviants
- proclamer les rsultats
- regroupement des lves +
ronde chante
- se relaxer
- expliquer les checs et russites
- critiquer les comportements
dviants
- proclamer les rsultats
- regroupement des lves
- marche de retour en classe
- hygine
79
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche argumente portant sur lenseignement des
activits physiques et sportives au CE1.
2. Selon vous, doit-on abandonner les activits physiques et sportives lcole
si lon ne dispose pas du matriel adapt, ce qui est souvent le cas ? Donnez
votre avis et faites des suggestions vos collgues qui sont tents de le faire.
3. Certains soutiennent que le temps rserv aux activits physiques et
sportives pourrait tre consacr aux disciplines fondamentales
(Mathmatiques, Franais) ? Contrairement ces propos, montrez la place
des activits physiques et sportives dans une ducation qui vise un
dveloppement intgral et harmonieux de lenfant.
Pour en savoir plus
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Pdagogie pour lAfrique nouvelle,
EDICEF, 1978.
Ministre de lducation, INEADE, Guide pdagogique pour les classes pilotes,
1987.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre,
EDICEF, 1993.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Curriculum de lEducation de base,
Guides pdagogiques, NAS, 2006.
Situation dintgration
Contexte : Les activits physique et sportive, dit-on, agissent sur les trois
composantes de la personnalit de lenfant (savoir, savoir-faire et savoir).
Consigne : Commentez ces propos en les illustrant par des exemples prcis.
80
20 ARTS PLASTIQUES - DESSIN
Comptence vise : Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Education artistique.
Objectif : Matriser la didactique des arts plastiques (le dessin) lcole lmentaire
PRE TEST
1. Quel intrt trouvez-vous organiser des sances de dessin dans votre
classe ?
2. En apprciant un dessin libre, produit par un lve de CP, un maitre crit :
Mauvais dessin . Que pensez-vous de cette apprciation ? Comment
apprciez-vous les dessins denfant. Justifiez votre rponse.
Introduction
Lducation artistique favorise lveil de lactivit, de la curiosit, de la spontanit et
de lexpression personnelle. Les arts plastiques en sont une composante essentielle
qui fdre plusieurs activits dont le dessin, la peinture, le bricolage, le modelage
etc. Le dessin en tant quactivit dveil est un moyen dexpression par lequel lenfant
traduit sa personnalit et apprhende le monde extrieur. Sur le plan historique, les
dessins ont toujours constitu un tmoignage loquent de la vie des peuples, de
leurs croyances, de leurs valeurs et de leur niveau de connaissances. Il y a plusieurs
sortes de dessins :
le dessin dimitation : llve reproduit un modle prsent au tableau ;
le dessin dobservation : lobjet doit tre visible de tous. Le matre attire
lattention des lves sur les dtails importants ;
le dessin de mmoire : reproduction dun objet connu, mais non encore
dessin en classe (donc dessin dobservation diffr) ;
le dessin dimagination : libert dexpression totale ;
les arrangements dcoratifs : alternance de dessins et dactivits manuelles ;
le dessin gomtrique : reprsentation dun objet en le simplifiant, mais en
respectant les formes et les dimensions rduites. Un objet bien reproduit peut
tre dessin par un autre.
20.1 Objectifs
former le got : initiation esthtique ;
dvelopper la facult dobservation ;
fournir lenfant le moyen de traduire ses conceptions ;
faire acqurir une adresse manuelle, une grande prcision dans lobservation
visuelle ;
81
dvelopper la crativit.
20.2 Principes mthodologiques
exiger un ordre et un srieux dans une ambiance dtendue ;
indiquer lemploi du matriel distribu au dbut au fur et mesure des
besoins ;
indiquer comment travailler, mais ne pas excuter soi-mme le dessin au
tableau noir ;
ne donner quune ou deux notions nouvelles par leon ;
varier les exercices pour viter la monotonie ;
seule une observation insistante prcise, aigu, prolonge permet la fixation
des formes dans la mmoire visuelle ;
considrer le dessin de lenfant comme une expression de la subjectivit du
CI au CE ;
avoir une attitude empreinte de respect devant un dessin denfant ;
faire une ou deux corrections importantes ou gnrales, au plus.
20.3 Dmarche pdagogique
Etapes Rles du matre Activits des lves
Rvision
Mise en situation
Prsente le projet pour
motiver les lves
Manifestent leur intrt
raliser le dessin
Observation libre
de lobjet
dessiner
Fait observer et manipuler
librement
Observent et manipulent
Prsentation de
lobjet
Donne des explications
rapides sur les caractres de
lobjet (surface, valeur,
couleur, etc.), la mise en place
du dessin sur la feuille, les
proportions, la direction, la
couleur, les ombres, les
difficults particulires
Observent, posent des
questions, dcrivent oralement
lobjet
Excution de la
premire esquisse
Donne des consignes
Essayent de raliser le dessin
au brouillon
Remdiation
- Organise les changes
- Invite les lves donner
leurs points de vue
- Signale les erreurs, indique
et met en uvre avec les
lves les procdures et
techniques
- Participent
- Apprcient
- Sauto-valuent
Dessin
proprement dit
Donne des consignes Excutent le dessin
Evaluation Apprcie les productions
82
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche argumente portant sur lenseignement du
dessin au CE2.
2. On insiste souvent sur limportance du dessin de mmoire lcole
lmentaire. Pourquoi ? Comment procdez-vous pour dvelopper chez
lenfant laptitude fixer les formes ?
3. Le dessin est bien moins tudi pour lui-mme que pour les fins gnrales
de lducation. Commentez ces propos et montrez la valeur ducative du
dessin lcole lmentaire.
4. Le dessin est un facteur de rvlation de la personnalit de llve.
Dveloppez cette ide et montrez comment, travers le dessin, vous
parvenez percer la personnalit de lenfant.
Pour en savoir plus
Ministre de lducation, Les fascicules produit dans le cadre de la Formation
continue diplmante, premire version, 2007.
Recueil de documents pour la formation des Volontaires de lducation, DPVE,
NAS, dition 2008,
Ministre de lducation, INEADE, Guide pdagogique pour les classes pilotes,
1987.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre,
EDICEF, 1993.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Curriculum de lEducation de base,
Guides pdagogiques, NAS, 2006.
83
21 EDUCATION MUSICALE - CHANT
Comptence vise : Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Education artistique.
Objectif : Matriser la didactique de lducation musicale (le chant) lcole
lmentaire.
PRE-TEST
1. Quelle diffrence faites-vous entre la voix, la mlodie, le rythme ?
2. Lducation musicale est-elle un simple divertissement lcole lmentaire ?
Justifiez votre rponse.
Introduction
La musique est souvent lie la parole et la danse. Cest un facteur
dpanouissement, dintgration sociale et mme de russite professionnelle. Elle se
caractrise par lart de choisir et dorganiser des sons dune manire agrable
loreille et se pratique par plusieurs instruments quil est possible de regrouper par
types :
Les instruments percussion : tambour, cloches, sonnailles, frelots, etc.
Les instruments coude : kora, guitare, violon, harpe
Les instruments vent : flute, trompette, sifflet
La voix, etc.
Malheureusement, le manque dinstruments de musique et de formation des matres
dcourage lenseignement de cette discipline. Le chant, qui drive de la parole, est
lexpression musicale la plus spontane. Mais, trs souvent, il est sacrifi au profit
de disciplines dites fondamentales et juges prioritaires parce quentrant en compte
dans lvaluation terminale des lves.
21.1 Objectifs
Lducation musicale a pour objectif gnral la formation du got.
De faon spcifique, il sagit :
de dvelopper la mmoire, la voix ;
de familiariser avec le patrimoine culturel ;
84
daider au dveloppement sensori-moteur de lenfant : affinement de la
perception auditive, structuration spatio-temporelle, relation entre rythme
propre et le rythme extrieur ;
damliorer la matrise de soi par une rgulation des rythmes biologiques ;
denrichir limagination avec lappel continu la cration et limprovisation.
21.2 Principes mthodologiques
priorit la chanson et la musique ; ltude du code musical viendra aprs ;
beaucoup chanter en classe mais sur des mlodies et des rythmes la
porte des lves ;
priorit la musique de tous les jours : celles des veilles, ftes, crmonies,
etc. ;
apprentissage par imprgnation (comme on apprend la langue maternelle) :
en coutant, en simprgnant, en rptant aprs les adultes, etc. ;
intgrer la musique dans les activits ludiques.
NB : Le matre peut utiliser des instruments de musique.
21.3 Dmarche pdagogique
Etapes Rles du matre Activits des lves
Exercices prparatoires
- Fait excuter des exercices
respiratoires et des vocalises
- Fait chanter un chant dj
appris
- Excutent des
exercices respiratoires et
des vocalises
- Chantent un chant dj
appris
Comprhension
- Chante le morceau et le fait
apprcier
- Lit et fait lire
- Explique lide gnrale et
deux ou trous mots
indispensables la
comprhension
Ecoutent, lisent,
participent aux
explications
Drouillement
- Propose des exercices de
drouillement de la voix et de
vocalises
- Propose un chant connu, de
prfrence proche du nouveau
morceau par sa structure
vocalique
Sexcutent
Schma
dapprentissage :
- Phrase musicale 1
- Phrase musicale 2
- Phrase musicale 1+2
- Phrase musicale 3
- Phrase musicale 2+3
- Phrase musicale
- Chante (modle)
- Chante phrase musicale par
phrase musicale
- Balise la phrase musicale
avec laide des lves
- La fait rpter par le groupe
classe, puis par range, puis
individuellement, enfin retour
- Ecoutent le morceau
- Participent
lapprentissage
85
1+2+3
- Phrase musicale 4
- Phrase musicale 3+4
- Phrase musicale
2+3+4
- Phrase musicale
1+2+3+4
au groupe classe
- Associer progressivement le
nouveau au connu
Evaluation
- Fait chanter en solo et en
groupes la partie programme
- Organise un concours de
chant par range, par lve
Sexcutent
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche argumente portant sur lenseignement du
chant au CM1
2. Comment procdez-vous pour tudier un chant nouveau dans une classe de
votre choix ? Justifiez votre dmarche.
3. Un enseignement thorique et abstrait de la musique ne tarde pas enlever
aux lves la joie quils prouvent chanter. Une mthode plus concrte et
plus vivante dveloppera chez eux le got du chant et lamour de la musique.
Expliquez ce texte. Dgagez-en une mthode vivante pour lenseignement
du chant.
Pour en savoir plus
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Pdagogie pour lAfrique nouvelle,
EDICEF, 1978.
Ministre de lducation, INEADE, Guide pdagogique pour les classes pilotes,
1987.
Institut pdagogique Africain et Malgache (IPAM), Guide pratique du matre,
EDICEF, 1993.
Rpublique du Sngal, Ministre de lducation, Curriculum de lEducation de base,
Guides pdagogiques, NAS, 2006.
86
22 ARTS SCENIQUES LE THTRE
Comptence vise : Intgrer des lments du programme dtude, des donnes
psychologiques et des dmarches mthodologiques dans des situations de
traitement dpreuves crites portant sur des disciplines du sous-domaine
Education artistique.
Objectif : Matriser la didactique des arts scniques (le thtre) lcole lmentaire
PRE-TEST
Les arts scniques entretiennent de nombreux liens avec les autres domaines
dapprentissage (ou activits disciplinaires). Illustrez ces propos en donnant des
exemples prcis de liens entre les arts scniques et des activits disciplinaires
enseignes lcole lmentaire.
Introduction
Llve vit des expriences multiples tant sur le plan affectif, cognitif, psychomoteur,
social questhtique. Les arts scniques lui donnent une occasion dexprimer ses
ides, de prsenter sa vision personnelle sur les faits de socit par la cration et
linterprtation de sayntes dans lesquelles interagissent des personnages. Ainsi,
llve est constamment mis en contact avec de nombreux repres issus de sa
culture ou se rapportant aux uvres quil interprte et apprcie. Il souvre au monde,
en dcouvre les particularits et les diffrences et saisit davantage les lments de
sa propre culture. Cette perception du monde participe la formation de son identit
culturelle et le prpare lexercice de son rle de citoyen.
22.1 Objectifs
De faon gnrale, les arts scniques visent dvelopper la sensibilit artistique de
llve, son potentiel crateur, ses capacits dinterprte et ses habilets
sexprimer, communiquer et apprcier des productions thtrales.
Plus particulirement, le thtre permet llve :
dexercer sa motricit travers des activits de dplacements et de danse ;
de rpondre au besoin et au plaisir de bouger ;
de cultiver et de nourrir ses motions ;
de dcouvrir des lments du langage dramatique, des rgles et des outils
propres lart scnique et des modes de thtralisation ;
dexprimer par la dramatisation des personnages, des images, des
sentiments pour communiquer des ides, des motions ou des sensations ;
dadapter son geste diffrentes contraintes (par rapport des instruments,
des supports, du matriel) ;
87
de dcouvrir les premiers repres dans lunivers de la cration ;
de dcouvrir son univers culturel et de souvrir la diversit artistique ;
dtre attentif ses ractions motives ou esthtiques face une
reprsentation thtrale pour porter sur elle un jugement partir de ses
propres ractions et de critres dtermins.
EXERCICE
Le thtre, dit-on, contribue au renforcement de lidentit culturelle nationale et
favorise la comprhension entre les peuples. Illustrez cette affirmation par des
exemples tirs des activits scolaires.
22.2 Principes mthodologiques
faire des arts scniques un ressort de la motivation dans les apprentissages ;
respecter la sensibilit, la subjectivit, loriginalit ;
tablir des liens avec les apprentissages raliser dans dautres activits
disciplinaires ;
explorer les diffrentes dimensions de la vie sociale et culturelle en
sappuyant sur le vcu de lenfant ;
accorder une attention particulire limaginaire, la spontanit et la
crativit pour favoriser lpanouissement de chacun ;
crer en classe et lcole un environnement capable de stimuler
limagination et la crativit de llve (collection daffiches et dobjets varis,
objets et assortiments de dguisement, etc.) ;
introduire progressivement les techniques, les rgles et les outils de lart
scnique (plus lventail est large plus la crativit peut sexprimer).
22.3 Dmarches pdagogiques
Dmarche dinterprtation
La dmarche adopter varie en fonction du projet de la classe. A titre dexemple, on
peut retenir :
Etapes Explications
Dcouverte de la
situation
Dcouverte par les lves de la situation dramatiser ou sa
prsentation par le matre.
Appropriation de la
situation
Il sagit damener les lves mieux comprendre la situation
travers un change entre le matre et les lves.
Elaboration
Il sagit, travers des rptitions squentielles et progressives
de travailler le scnario, la rpartition des rles, les rpliques, la
gestuelle, la diction, les dplacements, les dguisements, le
dcor, lambiance sonore, etc.
Le matre sera attentif aux diffrentes catgories de savoirs
88
vhiculs et vhiculer.
Rptition
gnrale
Une fois que les diffrents rles sont assimils (dialogue
mmoris, dcor camp, gestuelle et diction matrises,
laccompagnement sonore choisi, etc.), le matre organise une
reprsentation gnrale pour avoir une vue globale de
linterprtation.
Reprsentation
En fonction des situations et du projet de la classe (fte de fin
danne, semaine de lcole de base, journe de
sensibilisation, etc.), la pice peut faire lobjet dune
reprsentation devant un public (dlves, de parents, etc.).
Dmarche de cration
Etapes Explications
Gestation
Une ide de cration est ne partir dune inspiration
individuelle ou sur proposition.
Elaboration
- Lide est dveloppe et mise en forme
- Les lments du langage, les techniques et les outils adapts
sont exploits
- Les choix sont organiss en un scnario complet (dialogue,
dcor, dguisement, etc.).
Mise en
perspective
En fonction du projet, lide est finalise, le scnario mis en
scne, rpt peut faire lobjet dune reprsentation en classe
ou devant un public.
EXERCICE
1. A partir des informations reues et en tenant compte de votre exprience
personnelle, laborez une fiche argumente portant sur lenseignement du
thtre au CM1.
2. Les arts scniques comme dautres formes dart sinspirent des valeurs
culturelles et sociales vhicules dans la vie quotidienne et ils contribuent
leur mutation. Commentez ces propos et dites comment, lcole, travers les
arts scniques, peut contribuer la mutation des valeurs.
89
Pour en savoir plus
Ministre de lducation des Loisirs et du Sport (MELS), Programme de formation de
lcole qubcoise - version approuve, 2001, Chapitre 8 : Domaine des arts.
http://www.mels.gouv.qc.ca.
Situations dintgration
Pour le CEAP
Contexte : Un lve matre vous demande de lui fournir des informations lui
permettant de pratiquer correctement les activits du domaine EPSA.
Consigne : laborez deux fiches argumentes pour deux activits du domaine
raliser dans une classe de votre choix
Pour le CAP
Contexte : Le dessin, dit-on, est tudi moins pour lui-mme que pour ce quil
peut apporter aux autres disciplines.
Consigne : Commentez ces propos et illustrez-les partir dun exemple entre le
dessin et une discipline de votre choix.
Contexte : De nombreuses occasions peuvent se prsenter dintgrer la
musique aux activits de la classe.
Consigne : Donnez quelques exemples qui illustrent le caractre
interdisciplinaire de la musique. Montrez comment vous pratiquez cette
interdisciplinarit dans votre classe.
Contexte : tant donn laffirmation suivante : <Les objets technologiques ont de
tous temps t conus pour rendre lhomme la vie plus facile, lui permettre de
se protger, de satisfaire sa curiosit tout en facilitant lexploration du milieu
mais, le monde moderne nous a amplement prouv que la science et la
technologie peuvent conduire lhumanit sa perte>.
Consigne : Expliquez, commentez et montrez comment lcole, travers
diffrentes activits disciplinaires, prpare les enfants qui sont les adultes de
demain vivre en harmonie.
90
EVALUATION DE LA FORMATION
Deux formes dvaluation sont retenues :
Des valuations formatives suivies de remdiations assures par les
formateurs tout au long de la formation.
Une valuation certificative sur la base dpreuves nationales qui se droulera
le mme jour dans toutes les EFI.
Les preuves du CFS 1 et du CFS 2 sont construite uniquement partir des
comptences dveloppes dans les fascicules de la FCD et elles sont choisies par
une commission convoque par la DEXC, conformment aux dispositions de larrt
en vigueur. Ladministration, lanonymat et la double correction de ces preuves sont
places sous la responsabilit de lIA qui composera les commissions de
surveillance et de correction.
Pour le CFS 1, lpreuve portera sur une dissertation de psychopdagogie ou de
pdagogie gnrale ; elle sera note sur 20 avec un coefficient de 2.
Pour le CFS 2, lpreuve portera sur llaboration dune fiche pdagogique
argumente ; elle sera note sur 20 avec un coefficient de 2.
La moyenne des notes de contrle continu sera affecte du coefficient 1.
Sagissant de loral, les preuves porteront sur la lgislation ou la dontologie et la
critique de cahier aussi bien pour le CFS 1 que le CFS 2 ; la moyenne des deux
notes sur 20 sera affecte du coefficient 2. cet effet, la commission sera compose
dun formateur qui en assure la prsidence, dun directeur dcole et dun instituteur
(pour le CFS 1) ou dun instituteur-adjoint (pour le CFS 2).
Les candidats ayant obtenu la moyenne (notes aux preuves orales et crites et note
de contrle continu) gale ou suprieur 10/20 seront dclars admis. Aucun
repchage nest autoris. Ladmission aux examens est sanctionne par le Certificat
de Fin de Stage 1 (CFS 1) pour le niveau Bac et le Certificat de Fin de Stage 2 (CFS
2) des EFI (1) pour le niveau BFEM.
La dcision dadmission au CFS 1 et CFS 2 est signe par le DEXC. Lobtention de
lun ou lautre de ces diplmes dispense les titulaires, respectivement, des preuves
crites dadmissibilit du CAP et du CEAP.
Vous aimerez peut-être aussi
- Preparation de La ClasseDocument15 pagesPreparation de La ClasseBSF75% (4)
- Buli-FR-print-001-130Document130 pagesBuli-FR-print-001-130sirine & loulouPas encore d'évaluation
- Introduction Au Design Graphique Sur MobileDocument28 pagesIntroduction Au Design Graphique Sur MobileNariz100% (4)
- CM1 - Evaluations Du 1re Trimestre 20-21Document10 pagesCM1 - Evaluations Du 1re Trimestre 20-21Camou Elevage Icam100% (9)
- Didactique Du Français PDFDocument0 pageDidactique Du Français PDFelouadil100% (3)
- Anciens CAP EnseignantsDocument4 pagesAnciens CAP EnseignantsME CISSÉ100% (5)
- Gestion de La ClasseDocument12 pagesGestion de La Classemoha100% (2)
- Didactique Du Français À L - École Primaire PDFDocument55 pagesDidactique Du Français À L - École Primaire PDFسفير الابتسامة100% (1)
- Motiver sa classe par le jeu: Ludification, Gamification d'une séance de cours pour booster la motivation de vos apprenants!D'EverandMotiver sa classe par le jeu: Ludification, Gamification d'une séance de cours pour booster la motivation de vos apprenants!Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cheikhna Cheikh Saadbouh Entre L'espace Et Le Temps PDFDocument5 pagesCheikhna Cheikh Saadbouh Entre L'espace Et Le Temps PDFCamou Elevage Icam100% (1)
- Cheikhna Cheikh Saadbouh Entre L'espace Et Le Temps PDFDocument5 pagesCheikhna Cheikh Saadbouh Entre L'espace Et Le Temps PDFCamou Elevage Icam100% (1)
- Amor Eterno - Full ScoreDocument6 pagesAmor Eterno - Full Scoreapucocha123100% (1)
- Fiche ArgumentéeDocument20 pagesFiche Argumentéepoukoulndao96Pas encore d'évaluation
- Niger Module de Formation Des Enseignants Sur La Remediation Pedagogiqu Relance Pédagogique VFDocument90 pagesNiger Module de Formation Des Enseignants Sur La Remediation Pedagogiqu Relance Pédagogique VFMoussa Zeinabou100% (2)
- DidactiqueDocument6 pagesDidactiquenassima ghallabiPas encore d'évaluation
- Expre Oral CM1Document60 pagesExpre Oral CM1BedaPas encore d'évaluation
- La Pédagogie DifférencieéDocument8 pagesLa Pédagogie DifférencieéAnonymous 1WI50FPfRPas encore d'évaluation
- La Dissertation PedagogiqueDocument16 pagesLa Dissertation PedagogiqueCossi AzoganPas encore d'évaluation
- Aaaaa???Gestion Des Apprentissages Composante 1Document23 pagesAaaaa???Gestion Des Apprentissages Composante 1Dieu Est FidèlePas encore d'évaluation
- Langage CI-1 PDFDocument115 pagesLangage CI-1 PDFcheikh tidianePas encore d'évaluation
- T1 1. Les Theories de L Apprentissage EnseignementDocument5 pagesT1 1. Les Theories de L Apprentissage EnseignementYllane bilal100% (2)
- Didactique - IntroductionDocument7 pagesDidactique - IntroductionAdo MouraPas encore d'évaluation
- Dissertation Psychopedagogique 1 1Document5 pagesDissertation Psychopedagogique 1 1ndao morPas encore d'évaluation
- 7 Caractéristiques Pour Une Pédagogie ActiveDocument10 pages7 Caractéristiques Pour Une Pédagogie ActiveAlbert Gomis100% (4)
- Rôles Et Tâches Du Directeur Et AdjointDocument6 pagesRôles Et Tâches Du Directeur Et AdjointMaman Moutari Illia100% (1)
- Situation ProblèmeDocument26 pagesSituation Problèmebouchta100% (2)
- Décret N° 96-346 Du 8 Mai 1996 Relatif Au CAP-CEAPDocument6 pagesDécret N° 96-346 Du 8 Mai 1996 Relatif Au CAP-CEAPMamadou Lamine Ndiaye0% (1)
- Triangle Didactique Et Différentes Définitions Des Didactiques Des MatiresDocument5 pagesTriangle Didactique Et Différentes Définitions Des Didactiques Des MatiresMouayed MhamdiPas encore d'évaluation
- Didactique Et PedagogieDocument6 pagesDidactique Et PedagogieABDEL MOUNAIM100% (1)
- Contenu Du Cours Introduction Aux Didactiques Des Disciplines1Document25 pagesContenu Du Cours Introduction Aux Didactiques Des Disciplines1Faya GirlPas encore d'évaluation
- Cours 1. Introduction A La PsychopedagogieDocument5 pagesCours 1. Introduction A La PsychopedagogieBOUAZZAPas encore d'évaluation
- Guide Remediation FRDocument27 pagesGuide Remediation FRArabicuser Youcef100% (2)
- La Remediation A L - EcoleDocument28 pagesLa Remediation A L - EcoleMiNa Goldoni100% (6)
- GUIDE Grande Section VFDocument136 pagesGUIDE Grande Section VFBb GueyePas encore d'évaluation
- Pédagogie Et DidactiqueDocument5 pagesPédagogie Et DidactiqueSolo Djeak67% (3)
- Jean Houssaye Triange PedagogiqueDocument18 pagesJean Houssaye Triange PedagogiqueL'As De Pique100% (1)
- La DidactiqueDocument3 pagesLa DidactiqueAlex newsPas encore d'évaluation
- DIDACTIQUE DU FRANçAIS 2020Document26 pagesDIDACTIQUE DU FRANçAIS 2020vision cybercafe100% (4)
- La Pédagogie de L'intégrationDocument29 pagesLa Pédagogie de L'intégrationLARAMI Lazhar60% (5)
- Module Planification TijaniDocument15 pagesModule Planification TijaniHafida Hafida100% (1)
- Cours PsychopedagogieDocument108 pagesCours PsychopedagogieKenz L'Aïd100% (2)
- Méthodologie de Français Centre D Inspection RabatDocument42 pagesMéthodologie de Français Centre D Inspection Rabatmouh100% (2)
- Fiche Pratique de DessinDocument2 pagesFiche Pratique de Dessindarren11250% (2)
- Processus D'enseignement-AppretissageDocument9 pagesProcessus D'enseignement-AppretissageOrjouen TliliPas encore d'évaluation
- Guide Grande Section Bon (8574)Document155 pagesGuide Grande Section Bon (8574)Renndo Cheikh Oumar Tall100% (2)
- GUIDE de REMEDIATION PEDAGOGIQUE Pour L'enseignement Du Français Au Cycle PrimaireDocument83 pagesGUIDE de REMEDIATION PEDAGOGIQUE Pour L'enseignement Du Français Au Cycle PrimaireAbdelhalim Aounali57% (7)
- La Construction D'une Situation DidactiqueDocument11 pagesLa Construction D'une Situation DidactiqueLevel / ليفل100% (1)
- La Pédagogie ActiveDocument33 pagesLa Pédagogie ActiveNadia GuendoulPas encore d'évaluation
- Principaux Concepts Des Didactiques Des DisciplinesDocument5 pagesPrincipaux Concepts Des Didactiques Des DisciplinesMouayed Mhamdi100% (3)
- Triangle Didactique PDFDocument6 pagesTriangle Didactique PDFespoir glaiPas encore d'évaluation
- Ethique Et Deontologie en EducationDocument8 pagesEthique Et Deontologie en EducationkountiyouPas encore d'évaluation
- #8 Pédagogie D IntégrationDocument60 pages#8 Pédagogie D Intégrationibtissam mouman100% (1)
- 11 Module de Formation Relative À La Gestion de La Classe Au PrimaireDocument45 pages11 Module de Formation Relative À La Gestion de La Classe Au PrimaireIbrahim MaiwakePas encore d'évaluation
- Didactique Et Pédagogie Et Triangle DidactiqueDocument22 pagesDidactique Et Pédagogie Et Triangle DidactiqueAttoche OmarPas encore d'évaluation
- Guide Du Professeur AccompagnateurDocument17 pagesGuide Du Professeur Accompagnateurchimene dz100% (4)
- Les Grands Courants de La Pedagogie ModerneDocument83 pagesLes Grands Courants de La Pedagogie Moderneخنتاش فريدPas encore d'évaluation
- PSYCHOPEDAGOGIEDocument21 pagesPSYCHOPEDAGOGIEInza BambaPas encore d'évaluation
- Cours de Pédagogie Générale 1 Les Sciences de L'education PDocument7 pagesCours de Pédagogie Générale 1 Les Sciences de L'education Pصفية سPas encore d'évaluation
- Didactique GeneraleDocument59 pagesDidactique GeneraleSofiane Brdh81% (21)
- Concepts Didactiques PDFDocument4 pagesConcepts Didactiques PDFmajidPas encore d'évaluation
- C N P DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE Présentation1Document31 pagesC N P DIDACTIQUE ET PEDAGOGIE Présentation1billyboyPas encore d'évaluation
- 1 Introduction À La DidactiqueDocument5 pages1 Introduction À La DidactiqueDavid Kientega100% (1)
- Améliorer sa pédagogie: Les 3 premiers outils à utiliserD'EverandAméliorer sa pédagogie: Les 3 premiers outils à utiliserPas encore d'évaluation
- Voies multiples de la didactique du français: Entretiens avec Suzanne-G. Chartrand, Jean-Louis Chiss et Claude GermainD'EverandVoies multiples de la didactique du français: Entretiens avec Suzanne-G. Chartrand, Jean-Louis Chiss et Claude GermainPas encore d'évaluation
- Didactique du français en contextes minoritaires: Entre normes scolaires et plurilinguismesD'EverandDidactique du français en contextes minoritaires: Entre normes scolaires et plurilinguismesJoël ThibeaultPas encore d'évaluation
- L' INTEGRATION DES TIC EN CONTEXTE EDUCATIF: Modèles, réalités et enjeuxD'EverandL' INTEGRATION DES TIC EN CONTEXTE EDUCATIF: Modèles, réalités et enjeuxPas encore d'évaluation
- Les Noms Feminins en ÉeDocument3 pagesLes Noms Feminins en ÉeCamou Elevage Icam0% (1)
- Épreuves CFEE 2021Document11 pagesÉpreuves CFEE 2021Camou Elevage Icam100% (10)
- Les Pronoms Relatifs VariablesDocument2 pagesLes Pronoms Relatifs VariablesCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Etude de Mots Innombrables, Tapissent, NicheDocument1 pageEtude de Mots Innombrables, Tapissent, NicheCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Etude Des Mots Repas Copieux Se Régaler FantastiqueDocument2 pagesEtude Des Mots Repas Copieux Se Régaler FantastiqueCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Etude Des Mots Preparation Et MélangerDocument2 pagesEtude Des Mots Preparation Et MélangerCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Le Choléra Manifestations, Modes de TransmissionDocument2 pagesLe Choléra Manifestations, Modes de TransmissionCamou Elevage Icam100% (1)
- Corrige Cm1Document4 pagesCorrige Cm1Camou Elevage Icam75% (4)
- Législation ScolaireDocument18 pagesLégislation ScolaireCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Emploi Des Mots D'abord EnsuiteDocument2 pagesEmploi Des Mots D'abord EnsuiteCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Le Cholera Mesures PreventivesDocument2 pagesLe Cholera Mesures PreventivesCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Le Conseil RuralDocument2 pagesLe Conseil RuralCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Le Paludisme Manifestations, Modes de TransmissionDocument2 pagesLe Paludisme Manifestations, Modes de TransmissionCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Corrige CM2Document5 pagesCorrige CM2Camou Elevage Icam67% (6)
- Corrige Ce1Document3 pagesCorrige Ce1Camou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Le Paludisme Mesures PreventivesDocument2 pagesLe Paludisme Mesures PreventivesCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Les Modes de Gestion Des DechetsDocument2 pagesLes Modes de Gestion Des DechetsCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Le Conseil RégionalDocument2 pagesLe Conseil RégionalCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Les Problèmes Engendrés Par La Différence D'appartenance 2Document2 pagesLes Problèmes Engendrés Par La Différence D'appartenance 2Camou Elevage Icam100% (1)
- Le Conseil CommunalDocument2 pagesLe Conseil CommunalCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Les Problémes D'opinionDocument2 pagesLes Problémes D'opinionCamou Elevage Icam100% (2)
- Cheikh Sidî Uthmân, Premier Khalif de Cheikhna Muhammad VadalDocument4 pagesCheikh Sidî Uthmân, Premier Khalif de Cheikhna Muhammad VadalCamou Elevage Icam100% (1)
- VarioleDocument2 pagesVarioleCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Le Symbolisme Des Lettres Arabes - Nadjm Oud Dine BammateDocument4 pagesLe Symbolisme Des Lettres Arabes - Nadjm Oud Dine BammateBelhamissi50% (2)
- Shongaloo Ramble Percusion Arreglo - Partitura y PartesDocument16 pagesShongaloo Ramble Percusion Arreglo - Partitura y PartesDavid Pascual OrozcoPas encore d'évaluation
- Cours D'Initiation À La Langue Égyptienne Pharaonique: Yoporeka SOMETDocument12 pagesCours D'Initiation À La Langue Égyptienne Pharaonique: Yoporeka SOMETG HUIT OrganisationPas encore d'évaluation
- École Sainte-ThérèseDocument3 pagesÉcole Sainte-ThérèseMeri VekuaPas encore d'évaluation
- Abeja PapercraftDocument7 pagesAbeja PapercraftJaimarys RuizPas encore d'évaluation
- Liaison Cycle 2 Cycle 3 La LectureDocument Nicole FragaDocument5 pagesLiaison Cycle 2 Cycle 3 La LectureDocument Nicole FragatabitPas encore d'évaluation
- M1 Comparaison Ferreiro FijalkowDocument1 pageM1 Comparaison Ferreiro Fijalkowgaspar 70Pas encore d'évaluation
- Hindi B Paper 2 HL MarkschemeDocument15 pagesHindi B Paper 2 HL MarkschemeZEEL PATELPas encore d'évaluation
- Etat Des Besoins Dans Les Services de La Solde Et Des RequetesDocument2 pagesEtat Des Besoins Dans Les Services de La Solde Et Des RequeteskarlPas encore d'évaluation
- Ihm1 Id 06 ManDocument28 pagesIhm1 Id 06 ManPrêteur Sur GagePas encore d'évaluation
- Codage ArabeDocument29 pagesCodage ArabeModu LoPas encore d'évaluation
- VAL 1 E2 UnlockedDocument5 pagesVAL 1 E2 UnlockedBouraida El Yamouni100% (1)
- Exercices Corrigés Budget VentesDocument17 pagesExercices Corrigés Budget VentesabdssamadPas encore d'évaluation
- Règles de Typographie FrançaiseDocument10 pagesRègles de Typographie FrançaiseHyd BenPas encore d'évaluation
- Verification de BDDocument331 pagesVerification de BDMED HIDANEPas encore d'évaluation
- Histoire de La TypographieDocument10 pagesHistoire de La Typographiehalalcarl3024100% (1)
- Unité Modulaire N 1Document12 pagesUnité Modulaire N 1Omaya NasrPas encore d'évaluation
- Cihm 00889Document993 pagesCihm 00889Branko NikolicPas encore d'évaluation
- Roland Barthes Le Mythe AujourdhuiDocument30 pagesRoland Barthes Le Mythe AujourdhuiFer Durden50% (2)
- Graphemes Phonemes Def Liste FrequenceDocument3 pagesGraphemes Phonemes Def Liste FrequenceFrancivaldo LourençoPas encore d'évaluation
- Fichier Ce1 Semaine 2Document17 pagesFichier Ce1 Semaine 2saelePas encore d'évaluation