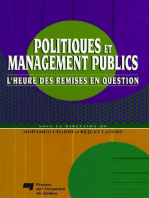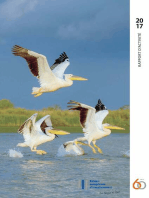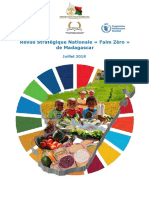Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Analyse Financiere Et Evaluation Des Projets
Analyse Financiere Et Evaluation Des Projets
Transféré par
AbdelhamidOughanem0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
15 vues47 pagesTitre original
146095290 Analyse Financiere Et Evaluation Des Projets
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
15 vues47 pagesAnalyse Financiere Et Evaluation Des Projets
Analyse Financiere Et Evaluation Des Projets
Transféré par
AbdelhamidOughanemDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 47
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Anal yse financire et valuation
des projets
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 1 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3. ANALYSE FINANCIERE ET EVALUATION
DES PROJETS
3.1 INTRODUCTION
3.1.1 Le Manuel des oprations 500 et le Manuel des oprations 600 (section 7.9 du chapitre
consacr sur la gestion des connaissances) portent respectivement sur la prparation des projets et
l valuation des projets. La prparation d un projet est le processus permettant de convertir une ide
de projet en un plan formel, tandis que l valuation dun projet permet la Banque de dterminer (i)
la viabilit du projet en question sur les plans technique, financier et conomique, au regard des
besoins d investissement nationaux, sectoriels et locaux ; (ii) la justesse conomique et financire des
rsultats attendus ; (iii) la durabilit du projet et/ou de l entit ; (iv) le niveau de la contribution du
projet au dveloppement humain et aux progrs technologiques ; et (v) les aspects du projet lis la
gouvernance. L analyse financire est essentielle pour se prononcer sur la viabilit financire d un
projet et sur la base financire de l organe d excution et sa capacit mener bien l excution du
projet.
3.1.2 L investissement dans les projets est un ensemble de processus visant se priver
d avantages conomiques pouvant tre tirs court terme des ressources financires, en investissant
plutt celles-ci dans les terrains, btiments, quipements et autres immobilisations en vue de produire
des articles, biens et services directement ou en investissant dans les valeurs mobilires ou en
accordant des prts directement aux intermdiaires financiers. A cet gard, l objectif vis est de
maximiser les avantages conomiques pendant la dure du placement. La responsabilit de la gestion
et de l excution des projets incombe aux organes d excution et aux agences de mise en uvre.
3.1.3 Les prsentes Directives reconnaissent que l analyse des projets doit tre entreprise selon
une approche intgre reposant notamment sur une valuation complte des caractristiques
physiques, conomiques et financires, ainsi que des aspects lis aux diffrents acteurs et aux risques
de chaque projet, en suivant un mme cadre ou modle. L valuation des caractristiques physiques
du projet est axe sur la dtermination ou l identification de la solution technique la plus abordable
pour raliser l objectif du projet. Quant l analyse conomique, elle est axe sur la contribution du
projet l conomie du pays concern et sur le cot conomique de la production de biens ou services.
Dans le cadre de l valuation intgre, l analyse conomique repose directement sur les flux de
trsorerie concernant le projet. Le traitement conomique des avantages du projet est initialement bas
sur les produits gnrs par le projet et/ou sur la rduction de ses cots, conformment la
mthodologie d valuation financire des produits ou de la rduction des cots. De mme, les cots
directs des projets constituent la base de valorisation des intrants dans l valuation conomique d un
projet. Sur cette base, les cots sociaux ventuels sont valus et inclus dans l analyse conomique.
L analyse portant sur les acteurs vise identifier les principaux acteurs concerns par le projet. Les
dcideurs doivent connatre la valeur actuelle des avantages conomiques nets tirs du projet, ainsi
que les gains raliss et/ou les pertes subies par chaque acteur, du fait du projet. Les dcisions
concernant les diffrences dans la rpartition des avantages conomiques nets et des avantages
financiers nets doivent tre expliques. Enfin, l objectif de l analyse de sensibilit et des risques est
d identifier les risques lis au projet et de dterminer les mesures d attnuation prendre, le cas
chant. Les gestionnaires des projets peuvent matriser certains facteurs de risque, dans une certaine
mesure, mais d autres facteurs de risque ne peuvent tre grs qu au niveau de l organe d excution et
du gouvernement du pays concern. Certains autres facteurs de risque sont des forces totalement
exognes quaucune institution du pays concern ne peut matriser.
3.1.4 Les prsentes Directives couvrent l valuation des projets, dans son ensemble, du point de
vue financier. Elles intgrent l analyse financire des projets dans le cadre financier global et celui de
la gestion financire de l organe d excution. Les implications financires de la solution physique
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 2 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
retenue sont couvertes par l valuation financire du projet concern, tandis que les avantages
financiers nets du projet sont couverts par l analyse de sensibilit et sont discuts dans le rapport
d valuation. Bien que l valuation des aspects conomiques et des caractristiques des diffrents
acteurs des projets soient incluse dans le rapport d valuation, elle chappe au champ d application
des prsentes Directives. Les questions relatives cette valuation sont couvertes par les Directives
pour l analyse conomique et la conception des projets du Groupe de la Banque.
3.1.5 Sous la direction du Dpartement des ressources humaines (CHRM) et la coordination du
Dpartement de la gestion financire (FFMA), la Banque a lanc l Initiative en faveur des projets de
dmonstration (SPI), dans le cadre de ses efforts en cours pour amliorer la qualit des projets ds le
stade initial, en mettant la disposition du personnel les outils ncessaires pour entreprendre une
valuation des projets conforme aux rgles en la matire. Une quipe de consultants de la Queen s
University a aid le personnel de la Banque conduire des valuations amliores de quatre projets
couvrant les secteurs de l nergie, de l agriculture, de l eau et des tlcommunications. Ces
valuations sont devenues des tudes de cas de rfrence pour le Groupe de la Banque (voir la section
7.14 du chapitre consacr la gestion des connaissances).
3.1.6 La prsente section des Directives vise donner aux analystes financiers un aperu complet
de l analyse financire et de l valuation des projets d investissement, sur la base du Manuel des
oprations de la Banque et des documents directifs connexes. Le reste du prsent chapitre s articule
autour des huit sections suivantes :
3.2 Projets d investissement : Cette section discute des projets potentiels gnrateurs
de revenu et non gnrateurs de revenu.
3.3 Listes de contrle en matire d valuation des projets : Cette section discute des
listes de contrle gnriques en matire d valuation des projets. Les listes de
contrle prsentent la squence des activits entreprendre dans le cadre de
l analyse financire des projets.
3.4 Cots estimatifs des projets : Cette section discute de l tablissement des cots
estimatifs des projets.
3.5 Plan de financement : Cette section discute de l identification du plan de
financement d un projet.
3.6 Viabilit financire des projets : Cette section discute des mthodes de
dtermination de la viabilit financire des projets. Elle discute galement de la
ncessit pour les analystes financiers d identifier les principales questions relatives
la politique financire et d en discuter, au regard des considrations de viabilit
financire et des exigences en matire d harmonisation des pratiques des bailleurs
de fonds.
3.7 Objectifs conomiques et financiers: La prsente section discute des objectifs
conomiques et financiers des projets, ainsi que des objectifs des projets en matire
de politiques.
3.8 Prparation des prvisions financires : La prsente section discute des
principales dcisions et hypothses, ainsi que des questions de prsentation que les
analystes financiers doivent prendre en compte dans la prparation des prvisions
financires.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 3 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.9 Avenants financiers : La prsente section discute de la slection et de l application
des indicateurs de performance financire devant faire l objet d avenants aux
accords de prts.
3.2 PROJETS D INVESTISSEMENT
3.2.1 Par sa participation active au Forum de haut niveau de Paris, la Banque s est engage
aligner son appui global (stratgie de pays, dialogue sur les politiques et programmes de coopration
pour le dveloppement) sur les stratgies nationales de dveloppement des PMR et sur les revues
priodiques des progrs raliss dans la mise en uvre de ces stratgies (voir la section 7.3 du
chapitre consacr la gestion des connaissances). L laboration du Document de stratgie de pays ax
sur les rsultats (DSPAR) par la Banque lui permet de dfinir clairement sa propre stratgie, sur la
base de la stratgie nationale de dveloppement du PMR concern. Le DSPAR tabli par la Banque
repose sur les systmes du pays concern et fournit un cadre pour concevoir les stratgies et plans de
mise en uvre en vue de l obtention de rsultats spcifiques mesurables, en plus de promouvoir la
synergie entre les activits de prts et les activits autres que les prts, et de tirer slectivement parti
des opportunits offertes pour maximiser l impact des interventions de la Banque. Les propositions de
projets sont examines individuellement par la Banque la condition qu elles (i) rpondent aux
besoins de dveloppement des PMR ; (ii) remplissent les critres fondamentaux de la Banque en
matire de dveloppement et d investissement ; et (iii) soient la proprit de l emprunteur et des
autres acteurs. Aprs avoir fait l objet d une procdure rigoureuse de validation, conformment aux
exigences du Manuel des oprations 340, les propositions de projets reues par la Banque sont
incluses dans le Programme triennal de prts qui est soumis au Conseil d administration, pour
approbation.
3.2.2 Les deux sections suivantes fournissent des listes indicatives des secteurs, sous-secteurs et
projets gnrateurs et non gnrateurs de revenu, couverts dans un programme triennal typique de
prts. Ces listes ne tiennent pas compte de l assistance technique et doivent tre mises jour sur une
base continuelle.
Projets gnrateurs de revenu
3.2.3 Les projets potentiellement gnrateurs de revenu sont numrs ci-dessous, titre indicatif.
Les dpartements du Complexe des oprations doivent veiller ce qu une expertise financire soit
mise la disposition de ces projets lors des phases d identification, de prparation, d valuation et de
supervision. Les projets concerns couvrent les secteurs suivants : nergie lectrique, gestion des
inondations, productivit des crales, irrigation, microcrdit ; transports routiers, lectrification
rurale, services financiers ruraux, dveloppement des PME, dveloppement urbain (par exemple
l approvisionnement en eau), dveloppement des PME urbaines, ressources en eau.
Projets non gnrateurs de revenu
3.2.4 Les projets potentiellement non gnrateurs de revenu sont numrs ci-dessous, titre
indicatif. Les conseils des analystes financiers pourraient tre utiles pour le recouvrement des cots et
les aspects relatifs l amlioration de l efficacit des projets de cette catgorie. Il importe de noter
qu une expertise en gestion financire est requise au cours de la phase de supervision. Les projets
concerns couvrent les secteurs suivants : vulgarisation agricole, ducation de base, rforme de la
fonction publique, gestion des ressources ctires, cotourisme, services de sant, amlioration des
systmes interrgionaux, gestion des ressources naturelles, ducation informelle, ducation post-
secondaire, infrastructures rurales, rduction de la pauvret, amlioration de la productivit dans les
zones rurales, dveloppement du secteur social, dveloppement urbain (par exemple le drainage),
environnement urbain.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 4 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.3 LISTES DE CONTROLE EN MATIERE D EVALUATION
3.3.1 La section 7.16 du chapitre consacr la gestion des connaissances fournit des listes de
contrle pour l valuation financire des projets non gnrateurs de revenu, des projets gnrateurs de
revenu et des institutions d intermdiation financire. Elle fournit galement une liste de contrle pour
la revue des aspects financiers des rapports d valuation.
3.3.2 Les projets non gnrateurs de revenu que finance la Banque relvent du secteur public,
tandis que les projets gnrateurs de revenu peuvent relever soit du secteur public, soit du secteur
priv
1
. Les intermdiaires financiers varient des grandes institutions fatires qui appuient de
nombreux autres intermdiaires financiers aux intermdiaires financiers spcialiss dans les secteurs
de l industrie et de l agriculture, et aux tablissements de microcrdit. En raison de leurs
caractristiques financires particulires, une liste de contrle distincte est propose pour les
intermdiaires financiers. Les projets diffrent quant leurs objectifs, leur structure sectorielle et
institutionnelle et leur mode de gestion, ainsi que quant leur conception et leur excution. En
consquence, l application des listes de contrle doit se faire d une manire soigneuse.
3.4 COUTS ESTIMATIFS DES PROJETS
Introduction
3.4.1 Un lment cl du contrle pralable diligent par la Banque est l exigence que les
fonctionnaires de la Banque travaillent en collaboration avec leurs homologues des institutions de
l emprunteur, notamment avec les organes d excution, pendant tout le processus d identification, de
prparation et d valuation des projets. Cette collaboration vise donner la Banque l assurance que
tous les efforts raisonnables ont t dploys par l emprunteur pour prparer des prvisions
pertinentes en ce qui concerne les encaissements et les paiements devant garantir l excution efficace
et en temps voulu du projet. Aprs le dbut de l excution d un projet non gnrateur de revenu, la
Banque continue de demander des prvisions actualises et ce jusqu l achvement du projet, afin de
disposer d un systme d alerte prcoce sur les problmes ventuels et de prendre les mesures
correctives qui s imposent. Dans le cas d un projet gnrateur de revenu, l analyste financier convient
avec l organe d excution de la priode de soumission des prvisions actualises. La priode exacte
sera dtermine la discrtion de l analyste financier et ne devra normalement pas se situer au-del de
dix ans, mais plutt rester dans la limite de trois cinq ans, partir de la date d achvement du projet.
3.4.2 Au cours des phases de prparation et d valuation d un projet, les membres du personnel
doivent examiner minutieusement les prvisions en matire d encaissements et de paiements au
comptant en faveur du projet, mais il incombe au Charg de projet de la Banque de veiller ce que les
cots du projet soient ralistes. L emploi du terme membres du personnel ici souligne le fait que
l analyste financier et l ingnieur du projet assument chacun la responsabilit non seulement
d examiner les cots estimatifs en gnral, mais aussi et surtout de veiller ce que les lments inclus
dans les cots estimatifs soient ralistes. En outre, l analyste financier et l ingnieur du projet doivent
veiller ce que les composantes et investissements connexes qui ne sont pas inclus dans les cots
estimatifs du projet, mais dont la nature est potentiellement bnfique, ne soient omis que pour des
raisons techniques, financires et conomiques valables.
1
Le champ d application des prsentes Directives est limit aux oprations du secteur public. Les prts du
guichet du secteur priv de la Banque sont rgis par des politiques et directives distinctes.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 5 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.4.3 Le reste de la prsente section discute de l utilisation du modle informatique du Tableau
standard du cot d un projet (COSTAB
2
) qui prsente les principaux lments des cots estimatifs et
des modalits de leur calcul, y compris les provisions pour alas techniques, financiers et autres
imprvus lis aux risques, de mme que les plans de dcaissement.
Utilisation du COSTAB
3.4.4 Les analystes financiers peuvent utiliser le modle informatique du COSTAB. Le COSTAB
permet de calculer les alas techniques et financiers, les impts et les cots en devises. Il prsente les
donnes sous forme de tableaux de cots dtaills, tableaux rcapitulatifs des cots du projet, plans de
financement, tableaux des achats et tableaux d allocation des ressources des prts. Il convertit
galement les cots financiers en cots conomiques, aux fins de l analyse conomique.
3.4.5 Le programme du logiciel COSTAB peut tre tlcharg l adresse suivante:
http://www.worldbank.org/html/opr/costab/costab.html.
3
Cot estimatif d un projet
3.4.6 Le tableau du cot estimatif d un projet montre le cot total du projet et prsente tous les
lments d une manire la fois explicite et pertinente. Il donne une ide du cot des principales
composantes du projet la date de son valuation. Il fournit galement des informations sur la
matrise du cot du projet par l emprunteur, l organe d excution et la Banque, pendant la phase
d excution du projet.
3.4.7 Le modle de tableau du cot estimatif d un projet, prsent ci-aprs, convient pour le corps
du rapport d valuation. Chaque rubrique peut faire l objet d une ventilation en sous-rubriques
additionnelles. Le logiciel COSTAB permet de fournir des dtails qui peuvent tre adapts pour
figurer dans le corps ou l annexe du rapport d valuation.
2
Le COSTAB est un logiciel mis au point pour amliorer l efficacit et l efficience des activits de la Banque
mondiale et de ses emprunteurs dans le domaine des prts. Il aide les analystes des projets organiser et
analyser les donnes lors des phases de prparation et d valuation des projets
(http://www.worldbank.org/html/opr/costab/contents.html).
3 Le Dpartement de l informatique et des mthodes (CIMM) de la Banque est charg de fournir des copies du
logiciel, de mme qu un manuel de l usager et des services d appui aux usagers du logiciel..
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 6 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
TABLEAU DU COUT ESTIMATIF D UN PROJET
PAYS: XXX
PROJ ET: Titre du projet
En (milliers)/(millions) dUC/devises du prt de la Banque
Cot en
monnaie
locale
% du
cot
total
Cot en
devises
% du cot
total
Cot total
COMPOSANTES ***
Terrains 0,00 0 0,00 0 0,00
Biens dquipement 0,00 0 0,00 0 0,00
Travaux de gnie civil et de construction 0,00 0 0,00 0 0,00
Services de consultants 0,00 0 0,00 0 0,00
Formation 0,00 0 0,00 0 0,00
Cots differentiels administratifs 0,00 0 0,00 0 0,00
Fonds de roulement initial 0,00 0 0,00 0 0,00
Cot de base au (date) 0,00 0 0,00 0 0,00
Provisions pour alas ***
Techniques 0,00 0 0,00 0 0,00
Financiers 0,00 0 0,00 0 0,00
Autres (prciser) 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL PARTIEL
0,00
0
0,00
0
0,00
Frais de financement ***
Intrts pendant la phase de construction 0,00 0 0,00 0 0,00
Autres frais 0,00 0 0,00 0 0,00
COUT TOTAL DU PROJ ET ET FINANCEMENT
NECESSAIRE
0,00
0
0,00
0
0,00
*** Utiliser des notes en bas de page, s il y a lieu, notamment pour expliquer les alas.
Cot estimatif de base
Principales composantes
3.4.8 Les principales composantes qui doivent tre incluses dans le cot de base comprennent
gnralement les cots en monnaie locale et en devises (i) des terrains et emprises ncessaires pour
l excution du projet, encourus aprs la soumission de la demande de prt ; (ii) des biens
d quipement (y compris les exigences initiales en termes d intrants oprationnels tels que les
engrais) ; (iii) des travaux de gnie civil et de construction ; (iv) des services de consultants ; (v) de la
formation ; (vi) des cots diffrentiels administratifs (y compris les cots pour le personnel et l audit,
conformment aux exigences de la Banque), encourus pendant la phase d excution du projet ; (vii)
du fonds de roulement initial ; et (viii) des impts et droits exigibles pour l une ou l autre des
composantes ci-dessus. Le cot des terrains, emprises, impts et droits est incorpor dans le cot de
base d un projet, mme si la Banque ne finance pas ce type de cot.
3.4.9 Normalement, l organe d excution dispose d un personnel comptent dans le domaine de la
conception des projets (ingnieurs, architectes, agronomes, conomistes, etc.), qui est appel
entreprendre une tude de faisabilit de la conception des caractristiques oprationnelles physiques
d un projet et dterminer le cot et les avantages conomiques du projet concern. Le personnel de
conception peut tre le personnel de l organe d excution ou des consultants trangers et locaux, ou
encore une combinaison de ces trois types de personnel. Le cot de l tude de faisabilit peut tre
support partir du produit d un prt au titre de l assistance technique ou partir des ressources
propres de l emprunteur. Normalement, le cot de conception est pris en charge avant l excution du
projet, mais dans certaines circonstances, la conception est finalise pendant que l excution du projet
est en cours et peut donc tre une composante du cot du projet.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 7 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.4.10 Habituellement, les cots de base sont estims dans le cadre de l tude de faisabilit, puis
ajusts pour tenir compte des aspects techniques et d autres dtails concernant la prparation du
projet, jusqu la phase d valuation. Dans le cas de projets complexes et de grande envergure, ou
lorsqu il n y a pas beaucoup d informations sur les achats effectus rcemment dans le cadre des
projets financs par la Banque dans le pays concern, l on peut faire appel aux services de cabinets
spcialiss dans l estimation des cots ou de mtreurs, ou alors consulter des entrepreneurs ou des
industriels, pour confirmation ou modification du cot de base estimatif. Au cours de la phase
d valuation, le cot estimatif doit faire l objet d un ajustement et d une actualisation, afin de tenir
compte des changements intervenus dans les prix pendant la priode comprise entre la date de
prparation du projet et la date de l estimation du cot de base, telle qu indique dans le rapport
d valuation.
3.4.11 Le rle de l analyste financier au cours de la mission d valuation peut varier de (i) la
vrification que les mthodes, donnes et hypothses utilises pour dterminer le cot de base d un
projet sont crdibles et justifiables, (ii) la fourniture d une assistance dans le rassemblement des
donnes fournies par le personnel charg de la conception du projet, en vue de l estimation du cot
estimatif (Manuel des oprations 500). L estimation du cot du projet repose sur l hypothse que la
qualit et la quantit des ouvrages de gnie civil, biens et services, de mme que les prix des intrants
et des produits du projet ont t dtermins avec autant d exactitude que possible, en utilisant, s il y a
lieu, des facteurs connus qui ne changeront pas pendant la phase d excution du projet, et aussi sur
l hypothse que le projet sera excut exactement comme prvu. Les provisions pour alas servent
faire face la possibilit que le cot de base estimatif ne repose pas sur une estimation correcte de la
quantit ou de la qualit des biens et services ncessaires, ou que les prix de ces biens et services
changent aprs la date de dtermination du cot estimatif.
3.4.12 Le cot estimatif de base reflte le meilleur jugement de la mission d valuation quant au
cot estimatif du projet la date indique. La date de dtermination du cot de base estimatif doit tre
indique dans le rapport d valuation et ne doit pas intervenir plus de six mois avant la soumission de
la proposition de prt au Conseil d administration, pour approbation. Si la priode comprise entre
cette date et la soumission de la proposition de prt au Conseil d administration est suprieure six
mois, le cot de base estimatif doit tre rvis par indexation pour la priode coule, concurrence
d un maximum de 12 mois partir de la date de dtermination du cot de base estimatif. Une nouvelle
valuation des cots doit tre faite si la soumission de la proposition de prt au Conseil
d administration intervient plus de 12 mois aprs la date de dtermination du cot de base estimatif.
Financement rtroactif
3.4.13 En rgle gnrale, la Banque ne dcaisse pas des fonds pour couvrir des dpenses encourues
et rgles par un emprunteur ou un bnficiaire pendant ou aprs la phase dvaluation d un projet,
avant l entre en vigueur d un accord de prt ou d un accord d assistance technique de la Banque.
Toutefois, sous rserve d un accord pralable entre la Banque et l emprunteur, une clause autorisant le
financement de dpenses convenues, encourues avant l entre en vigueur du prt, peut tre incluse
dans l accord de prt. Cette clause doit prciser le montant du financement rtroactif, de mme que le
type de dpenses en question et la date laquelle les dpenses concernes peuvent tre encourues.
L analyste financier doit veiller ce que les demandes de financement rtroactif, introduites par un
emprunteur, avec toutes les pices justificatives fournies par un tel emprunteur, soient consignes
dans un aide-mmoire prpar au cours des phases d identification, de prparation et/ou d valuation
du projet, ainsi que dans les rapports y affrents, soumis aprs le retour au Sige.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 8 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Provisions pour alas
Introduction
3.4.14 Le degr de fiabilit du cot de base estimatif dpend de la minutie avec laquelle le travail
de prparation du projet a t fait avant la phase dvaluation. A titre d exemple, pour un grand
rservoir ou pour des installations portuaires de transroulage, les dtails techniques peuvent tre mis
au point avant la phase dvaluation. Dans ce cas, le cot de base estimatif est d un haut degr de
fiabilit. C est le cas galement pour les projets reposant sur l achat d quipements de conception
standard, en quantits bien prcises, par exemple dans le cas des projets d expansion des
tlcommunications.
3.4.15 Certains projets peuvent faire l objet d une valuation, alors que trs peu d informations
dtailles sont disponibles sur les plans techniques ou les quantits. A titre d exemple, dans les projets
relatifs aux soins de sant, les lieux exacts d implantation et les plans techniques des formations
sanitaires peuvent ne pas tre connus au moment de l valuation. Dans ce cas, le cot de base
estimatif peut avoir t tabli sur la base de la population cible desservir, de la dtermination de la
superficie des btiments pour 1.000 habitants, conformment aux normes locales, et de l estimation
des cots en fonction du prix au mtre carr, par rfrence au cot rel des formations sanitaires
locales de type similaire. De mme, dans le cas de certains prts d ajustement sectoriel et projets
agricoles, projets d amnagement des bidonvilles, projets ciblant de petits systmes d adduction d eau
et d assainissement ou de projets d amlioration d axes routiers, les cots de base peuvent tre
dtermins par extrapolation, en utilisant les prix unitaires drivs des spcifications et plans
techniques dtaills pour des zones et installations chantillonnes, reprsentatives des diverses
composantes du projet. Ces mthodes sont acceptables pour la Banque, la condition que l quipe
charge de l valuation s assure de la pertinence et du caractre d actualit des donnes, et que les
provisions appropries pour alas soient prvues, s il y a lieu.
3.4.16 Les provisions pour alas servent faire face la possibilit que des dpenses non prvues
soient encourues ou que les quantits requises et/ou les prix changent au cours de la priode comprise
entre la date de dtermination du cot de base estimatif et la date laquelle sont effectivement
encourues les dpenses, dans le cadre de l excution du projet. Les provisions pour alas doivent tenir
compte des cots des alas techniques et financiers probables, imputables aux risques spciaux, qui
pourraient raisonnablement contribuer l augmentation du cot de base estimatif. Toutefois, les
provisions pour alas ne peuvent pas permettre de faire face aux effets de toutes les circonstances ou
situations adverses ventuelles.
3.4.17 Les provisions pour alas constituent une partie intgrante du cot total d un projet et de son
plan de financement, et sont normalement requises pour toutes les composantes du projet entranant
des dpenses substantielles. Des estimations distinctes doivent tre faite pour les alas techniques et
pour les alas financiers. Les provisions pour alas doivent tre identifies dans le tableau du cot du
projet et tre prsentes comme des rubriques individuelles, distinctes du cot de base estimatif. Pour
les projets ayant plusieurs grandes composantes, il est gnralement prfrable de prsenter
sparment l estimation de ces provisions pour chaque composante et pour l ensemble du projet. Le
texte prsentant le tableau du cot du projet doit discuter des facteurs techniques, des facteurs
financiers et des facteurs de risque susceptibles d avoir un impact sur le cot du projet entre la date de
dtermination du cot de base estimatif et la date d achvement du projet. Tous les aspects spciaux
des provisions pour alas doivent tre expliqus dans le rapport d valuation. Les missions
d valuation doivent confirmer que : (i) les estimations devant figurer dans le rapport d valuation
tiennent compte de tous les alas techniques et financiers, en tant que tels ; (ii) les montants de ces
provisions sont raisonnables ; et (iii) les provisions pour alas ne sont pas incluses dans le cot de
base estimatif.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 9 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.4.18 Dans le cas des prts d ajustement d un secteur ou un sous-secteur o les cibles techniques
ont t dfinies dans leurs grandes lignes, sans que leur porte exacte soit essentielle pour le succs du
projet (par exemple l installation de 500 sites d entretien dans le cadre d un programme de roulement
ou d entretien du matriel roulant dans les ateliers d un chemin de fer), seules les provisions pour
alas financiers doivent tre prises en compte. L impact que pourraient avoir sur de tels projets des
changements dans les prvisions concernant les travaux, biens ou services devrait tre test dans le
cadre de l analyse de sensibilit.
3.4.19 Dans le cas des oprations dassistance technique dont les termes de rfrence sont bien
dfinies et qui sont de dure relativement brve, ainsi que dans le cas des projets de dveloppement
industriel et de crdit agricole, qui sont gnralement des lignes de crdit pour aider financer des
programmes dfinis en termes financiers, sans composantes techniques spcifiques, les provisions
pour alas ne devraient pas tre incluses dans le cot estimatif.
Profil des dcaissements
3.4.20 La Banque a acquis une exprience considrable en ce qui concerne les capacits et les
moyens permettant aux emprunteurs et leurs organes d excution, dans divers secteurs, de se
conformer aux calendriers d excution des projets. Il ressort des tendances des dcaissements des
prts octroys au mme secteur ou au mme emprunteur que les organes d excution se conforment
rarement ces calendriers, et que les dpassements de dlai et de cot sont courants dans bon nombre
d oprations de prts. En consquence, l estimation de la priode d excution des projets doit tenir
compte de l exprience antrieure et ne devrait pas diffrer sensiblement de la dure moyenne de
ralisation des projets dj excuts dans le mme secteur et le mme pays.
3.4.21 Pour tablir un profil raliste des dcaissements, l analyste financier doit travailler en
collaboration avec le dpartement charg des dcaissements au titre des prts, afin d obtenir des
informations utiles sur les dcaissements en faveur du pays et du secteur devant bnficier du prt
envisag. L idal serait que le profil soit tabli sur une priode d environ 12 ans avant l exercice
financier de la Banque en cours. Si les priodes de rfrence sont plus brves, tant pour le profil que
pour la priode de dcaissement propose dans le rapport dvaluation, des explications dtailles
doivent tre fournies sur les facteurs susceptibles de garantir le succs de l excution du projet sur des
priodes plus brves.
3.4.22 L adoption de priodes ralistes pour l excution du projet et les dcaissements, sur la base
du profil des dcaissements en faveur du secteur et du pays concern, doit avoir une incidence sur le
calcul des provisions pour alas, ainsi que sur le calcul du taux de rendement conomique et du taux
de rendement financier interne.
Alas techniques
3.4.23 Les provisions pour alas techniques visent faire face l augmentation anticipe du cot
de base estimatif d un projet, la suite des changements intervenant dans les quantits, les mthodes
et/ou la dure de la priode d excution. Les provisions pour alas techniques doivent tre calcules
pour les cots en devises et en monnaie locale, et doivent tre exprimes en pourcentages des cots de
base en devises et en monnaie locale figurant dans le tableau du cot d un projet. L annexe 3 du
Manuel des oprations 600 fournit des orientations dtailles sur la dtermination, le calcul et
l application des provisions pour alas techniques par rapport aux prix de base. Cette annexe fournit
galement des orientations sur les mthodes d inclusion des provisions pour alas financiers qui
doivent galement s appliquer aux provisions pour alas techniques, ainsi qu aux cots de base.
3.4.24 Les principaux facteurs d incertitude dans l excution des travaux de gnie civil, pour
lesquels des provisions pour alas techniques doivent tre faites, sont les suivants : (i) le type de
terrain o doivent tre excuts les travaux du projet, en particulier (a) les zones prsentant des
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 10 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
difficults gologiques, o des glissements et des boulements peu prvisibles sont frquents, (b) les
zones caractrises par dpais dpts dargile d origine maritime, propices aux inondations, et (c) les
zones frquemment touches par des tremblements de terre ; (ii) les conditions climatiques prvalant
dans la zone du projet, par exemple la probabilit de prcipitations inhabituelles pouvant entraner des
inondations ou des vents forts ; (iii) les difficults d accs au site des travaux, en raison de la longue
distance parcourir ou du mauvais tat des routes ou des voies ferres qui peuvent tre dtruites par
des inondations, des glissements de terrain, etc. ; (iv) la proportion des travaux sur le terrain qui est
acheve, notamment le degr de compltude des forages et sondages, ainsi que les sources et les
essais des matriaux utiliss pour les travaux de construction (gravier, carrires, etc.), tant entendu
que les travaux d exploration de certains projets couvrant une zone vaste ou ncessitant des travaux de
creusement sur des distances trs longues et en profondeur, par exemple le creusement de tunnels,
sont si coteux ou mme impossibles excuter compltement l avance, au point qu il serait
prudent d anticiper certains risques lis aux intempries ; (v) la connaissance, par le consultant, des
ralits locales en ce qui concerne le cot des matriaux et de la main d uvre ; (vi) le degr de
prcision de l estimation des quantits, la possibilit de changements dans les plans techniques au
cours de la phase de construction et d ajouts imprvus ; et (vii) la qualit de la supervision des
travaux.
3.4.25 Au nombre des principaux facteurs d incertitude concernant les composantes relatives aux
matriaux et aux quipements, il y a lieu de citer: (i) le degr de prcision de l estimation des
quantits de matriaux et d quipements ncessaires, y compris les pices de rechange requises ; (ii) le
degr de prcision dans la dfinition des spcifications dtailles des matriaux et des quipements ;
et (iii) la rpartition entre les achats directs dans le commerce et les achats devant faire l objet d une
commande spciale.
3.4.26 Le degr d exactitude et de plnitude dans la dtermination des services l avance est un
facteur majeur d incertitude en ce qui concerne la fourniture des services. Si les services requis ne
peuvent tre dtermins pleinement qu au cours de la phase d excution du projet, des provisions
relativement substantielles pour alas sont alors raisonnables. C est le cas des recherches effectuer
sur le site pour la conception d un projet d irrigation de grande envergure.
3.4.27 La Banque s attend ce que les provisions pour alas techniques se situent normalement
entre 5 et 10% du cot de base. Les niveaux jugs acceptables des provisions pour alas techniques
varient d un secteur l autre, ainsi que pour les diverses composantes d un projet. A titre d exemple,
les provisions pour alas techniques, au titre des travaux de gnie civil d une centrale lectrique, sont
suprieures celles qui sont faites pour l approvisionnement d tablissements scolaires en fournitures
ou matriels. Lorsque les provisions pour alas techniques sont relativement importantes, par exemple
plus de10 15% du cot total, il y aurait lieu de revoir les plans techniques de base et de procder
des recherches additionnelles sur le site, afin de rduire les incertitudes avant la phase d valuation du
projet. Toutefois, il est souvent ncessaire que les provisions pour alas techniques soient plus
substantielles, afin de tenir compte des facteurs extraordinaires d incertitude inhrents aux travaux,
lorsque la rvision des quantits et du cot estimatif se rvle trop coteuse ou peu pratique. A cet
gard, il y a lieu de citer titre d exemple les travaux suivants : les fondations des structures
implanter sur des terrains difficiles, les travaux en mer, le creusement de tunnels, la construction de
barrages, la construction de routes sur des terrains difficiles, l implantation de piles de ponts, et la
rhabilitation des installations existantes. L inclusion de telles provisions substantielles pour alas
techniques doit tre pleinement justifie dans le rapport d valuation.
3.4.28 En tout tat de cause, lorsque les provisions pour alas techniques dpassent 5% du cot de
base estimatif, des explications doivent tre fournies dans l aide-mmoire ou dans les termes de
rfrence au cours de la phase d identification du projet concern (Manuel des oprations 500) et dans
le rapport d valuation (Manuel des oprations 600).
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 11 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Alas financiers
3.4.29 Les provisions pour alas financiers visent faire face l augmentation anticipe du cot de
base et aux alas techniques, la suite des changements intervenant dans le cot/prix unitaire des
diverses composantes et/ou des divers lments du projet concern, aprs la date de dtermination du
cot de base estimatif. Les provisions pour alas financiers doivent tre exprimes sparment en
pourcentages du cot de base et des provisions pour alas techniques, pour les dpenses en monnaie
locale en en devises relatives au projet. L annexe 3 du Manuel des oprations 600 fournit des
orientations dtailles sur le calcul et l application des provisions pour alas financiers. Cette annexe
assigne galement l conomiste-pays la responsabilit de donner des conseils sur les facteurs lis
aux taux d inflation et aux devises, qui sont susceptibles d avoir un impact sur les alas financiers.
3.4.30 L conomiste-pays fournira priodiquement des informations sur les facteurs de rvision des
prix proposs pour les biens et services achets sur le march international. Ces facteurs de rvision
des prix ne doivent pas tre appliqus mcaniquement. S ils sont jugs inadquats ou excessifs, ils
sont remplacs par dautres facteurs plus appropris qui peuvent alors tre appliqus, sous rserve de
l accord du directeur concern. Pour les composantes des cots en monnaie locale, la hausse des prix
anticipe doit tre calcule sur la base du taux d inflation dans le pays emprunteur. L conomiste-pays
procdera priodiquement la mise jour des facteurs de rvision des prix proposs pour l estimation
des cots en monnaie locale.
3.4.31 Dans la dtermination du niveau appropri des provisions pour alas financiers, les facteurs
cls suivants doivent tre pris en considration : (i). la date du dbut des dpenses pour le projet et la
dure totale de la priode d excution du projet ; (ii) en l absence de raisons justifiant la modification
des facteurs de rvision des prix proposs par l conomiste-pays ( expliquer dans les termes de
rfrence lors de la phase d identification et dans le rapport d valuation), les facteurs de rvision des
prix proposs doivent tre appliqus tous les projets excuts dans le pays concern ; (iii) le degr
d alignement des prix en monnaie locale ou en devises de certains types de travaux, biens et services
sur les tendances gnrales de l inflation. A titre d exemple, lorsque l industrie de la construction
connat un grand essor ou un dclin, les prix appliqus par cette industrie ont tendance tre
suprieurs ou infrieurs, selon le cas, au niveau gnral des prix. De mme, l application des progrs
technologiques la production de certains types d quipements a entran une hausse des prix bien
plus faible que la tendance gnrale la hausse des prix ; et (vi) la mesure dans laquelle un projet
d envergure peut entraner une augmentation plus rapide du cot des ressources locales telles que le
sable, la main d uvre et les matires premires, par rapport la tendance gnrale la hausse des
prix.
3.4.32 Les procdures gouvernementales en matire de passation des marchs, qui attribuent les
marchs uniquement des prix fixes, mme lorsque les travaux de construction doivent s taler sur un
certain nombre d annes, ou qui fixent un plafond pour la rvision autorise des prix, doivent tre
ignores dans l estimation du cot des projets financer par la Banque. Les soumissionnaires
s accommodent gnralement de telles pratiques en augmentant le cot de base dans leurs offres, et le
niveau total de leurs offres, y compris les provisions pour alas financiers, ne diffre pas souvent
d une manire significative du cot de base non ajust du projet, y compris les prvisions de rvision
des prix faites par la Banque. En consquence, en utilisant les estimations prpares par les
soumissionnaires, pour tablir le cot de base estimatif vritable, il faudrait prendre soin de dduire
les provisions pour alas financiers incluses dans les offres des soumissionnaires en tant que
composante de leur cot de base.
3.4.33 Si, de l avis de l analyste financier (et/ou de la mission), des distorsions peuvent survenir en
raison de diffrences significatives entre les taux d inflation sur le march national et sur le march
international, ainsi que des ajustements potentiels des taux de change, ces questions devraient tre
soumises, s il y a lieu, au directeur concern, aprs des discussions avec l conomiste-pays. Ce serait
le cas dans les pays pouvant tre soumis des dvaluations frquentes de leur monnaie.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 12 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.4.34 Les provisions pour alas financiers doivent tre calcules par rapport aux dpenses totales
pour chaque anne d excution du projet. Le taux cumul de la hausse des prix pour une anne donne
est calcul en cumulant le taux estimatif de hausse des prix au cours des annes prcdentes et la
moiti du taux de hausse des prix pour l anne au cours de laquelle les achats doivent tre effectus
4
.
Ce taux est appliqu au cot de base estimatif pour les dpenses applicables. Dans l exemple suivant :
(i) l hypothse retenue est que les achats commencent une anne aprs la date de dtermination du
cot de base estimatif ; (ii) les annes 2 6 sont les annes d excution du projet ; et (iii) les tableaux
d intrts composs sont utiliss pour calculer l augmentation des prix au cours des annes prcdant
le dbut des achats, avant d ajouter 50% du facteur de rvision des prix pour l anne au cours de
laquelle les dpenses seront encourues. Lorsque des circonstances particulires expliquent un taux
diffrent de rvision des prix pour des articles spcifiques, les provisions pour alas financiers au titre
de ces articles doivent tre calcules sparment.
Exemple: Calcul des provisions pour alas financiers en vue de l valuation du projet et de
l tablissement des prvisions financires
Anne
Cot de base +
provisions alas
techniques du
tableau du cot
du projet
Taux
d inflation
partir
date
dterminat
-ion cot
de base
estimatif
Calcul
Cot de base
ajust au taux
d inflation +
provisions alas
techniques
Augmentat
-ion due
l inflation
1 0,00 7% Anne ngociations, approbation
du Conseil d administration,
signature, etc.
0,00
0,00
2 50 7% 50 x (1 +0,07) x (1 +0,035) 55,37 5,37
3 100 7,5% 100 x (1 +0,07) x (1 +0,07) x
(1 +0,0375)
118,78
18,78
4 200 8% 200 x (1 +0,07) x (1 +0,07) x
(1 +0,075) x (1 +0,04)
25,00
56,00
5 75 7% 75 x (1 +0,07) x (1 +0,07) x
(1 +0,075) x (1 +0,08) x
(1 +0,035)
103,18
28,18
Total 425 533,33 108,33
Autres alas
3.4.35 L approche standard, pour l estimation du cot d un projet, consiste baser le cot du
terrain, des quipements, des biens et des services sur les prix courants. En outre, des provisions
doivent tre faites pour faire face aux alas techniques qui pourraient entraner une augmentation des
cots, ainsi qu l inflation. Toutefois, lorsque les prix courants ne peuvent pas tre dtermins
jusqu ce que l emprunteur prenne un certain nombre de mesures ou de dcisions, ou jusqu ce que
certains vnements surviennent, il peut s avrer ncessaire d inclure des provisions supplmentaires
au titre des risques. Une autre solution consiste encourager l emprunteur souscrire une assurance
pour les risques, par exemple en recourant l Agence multilatrale de garantie des investissements
(AMGI).
3.4.36 Les provisions au titre des risques ne sont pas frquemment incluses parce que l impact
financier des vnements futurs, le cas chant, doit tre pris en compte dans le cot de base ou dans
les provisions pour alas techniques ou financiers. En consquence, il est ncessaire de justifier
valablement l inclusion dans le tableau du cot estimatif d un projet, en tant que rubrique distincte,
des provisions au titre des risques. Une telle justification consiste expliquer la Direction de la
4
L hypothse retenue est que les dpenses pour l anne en question seront galement rparties sur toute l anne,
d o l application de la moyenne de la hausse des prix sur la moiti de cette anne.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 13 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Banque que les circonstances entourant actuellement le cot de base estimatif du projet rendent peu
fiables les techniques normales d estimation. Cela suffit pour attirer l attention de la Direction de la
Banque sur ce risque et sur son impact potentiel sur le cot du projet. Les provisions pour alas
spciaux ne peuvent tre utilises des fins autres que celles visant faire face au(x) risque(s)
spcifique(s) identifi(s).
3.4.37 Lorsque le personnel de la Banque estime qu il existe certaines conditions d une ampleur
susceptible d entraner des incertitudes concernant l estimation des cots d activits et/ou
d vnements futurs, une provision spciale pour risques, distincte des provisions pour alas
techniques et financiers, doit tre calcule. A titre d exemple, cause des incertitudes dans la
situation politique et conomique d un pays, les entrepreneurs trangers peuvent soumissionner pour
excuter des marchs dans ce pays uniquement des prix incluant une prime pour les risques
inhabituels auxquels ils pourraient faire face. Toute portion des provisions pour risques qui ne serait
pas utilise, par exemple aprs la rception des soumissions, devrait tre annule sans tre vire aux
provisions gnrales. Les provisions pour risques, le cas chant, doivent tre incluses dans le
tableau du cot estimatif du projet en tant que rubrique distincte, et des explications doivent tre
fournies dans le rapport dvaluation et mentionnes dans l accord de prt sur la raison d tre, le
montant et l annulation ventuelle de ces provisions. Celles-ci doivent tre couvertes dans l analyse
de sensibilit financire et conomique. Au lieu d inclure des provisions distinctes au titre des risques,
il peut tre prfrable de demander l emprunteur potentiel de poursuivre le processus d appel
d offres jusqu au stade de l valuation des offres avant que le prt ne soit octroy. Au cas o
l emprunteur recourt l AMGI pour l assurance contre ce type de risque, le cot de la prime
d assurance doit figurer, en tant que rubrique distincte, dans le tableau du cot estimatif du projet.
Frais financiers en cours pendant la phase de construction (FCDC)
3.4.38 Les frais financiers encourus pendant la phase de construction constituent des cots
d excution rels et doivent figurer dans le tableau du cot estimatif du projet. Ces frais couvrent
notamment les commissions d engagement, les intrts et les autres commissions d ouverture. La
mthode de calcul des frais financiers encourus pendant la phase de construction est celle qui est
normalement applique pour le calcul des intrts pays pour les comptes de rsultats et les tats des
flux de trsorerie, dans le cadre de l analyse financire de la performance financire d un organe
d excution. Une annexe du rapport d valuation doit rsumer les raisons avances pour justifier
l inclusion des frais financiers encourus pendant la phase de construction dans le cot du projet, les
critres appliqus et la mthode de calcul utilise. Il faut tablir une ligne de dmarcation nette entre
la fin de la priode de capitalisation des frais financiers et le dbut de la priode d exigibilit des frais
financiers au titre des comptes de rsultats.
3.4.39 Les accords de prt de la Banque prcisent normalement les taux d intrt applicables aux
prts et pouvant tre utiliss pour couvrir les frais financiers encourus pendant la phase de
construction. Toutefois, il est ncessaire de prvoir des provisions lorsque l on s attend une
augmentation des cots de financement d un niveau suprieur celui qui est vis dans l accord de prt
de la Banque. Une telle augmentation anticipe des cots de financement doit tre considre comme
couverte par les provisions pour alas financiers, mais doit tre incluse dans les frais financiers et
prsente dans le rapport d valuation, avec les explications appropries.
3.5 PLAN DE FINANCEMENT
Introduction
3.5.1 Le plan de financement vise dmontrer que les fonds ncessaires au financement de toutes
les composantes du cot estimatif total du projet, y compris les provisions et les rubriques non
couvertes par le financement de la Banque, ont t identifis et mobiliss. Il est indispensable que
l assurance soit donne la Banque que des fonds dautres sources sont mobiliss et qu il n y aura pas
de retard dans l obtention des rsultats conomiques attendus du projet, du fait de l indisponibilit du
financement destin couvrir une partie du cot du projet.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 14 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Rubriques non ligibles au financement de la Banque
3.5.2 La Banque ne finance pas le cot des terrains, emprises, biens et services achets dans les
pays qui ne sont pas membres de la Banque, ni les frais financiers encourus pendant la phase de
construction au titre du financement de sources autres que la Banque, ni les impts et droits pays par
l emprunteur et/ou l organe d excution pour les cots en monnaie locale ou en devises. Il est facile
d identifier le cot des terrains, emprises, biens et services provenant des pays non ligibles, et le
montant des frais financiers encourus pendant la phase de construction au titre du financement de
sources autres que la Banque. En outre, l emprunteur doit couvrir le cot du projet en monnaie locale,
tant donn que la Banque ne finance normalement que la composante du cot en devises. Dans
certaines circonstances particulires, la Banque peut financer une partie du cot en monnaie locale.
Pour les projets financs par le FAD, les politiques de prt des cycles respectifs de reconstitution des
ressources du FAD fournissent une liste des conditions remplir par les projets pour prtendre au
financement du cot en monnaie locale. L conomiste-pays aidera l quipe d valuation prparer
des justifications appropries, inclure dans le rapport d valuation (Manuel des oprations 600).
3.5.3 Le calcul du montant du financement ligible doit tenir compte de l exigence que la Banque
ne finance pas les impts et droits au titre de l achat de biens et services pendant la phase d excution
du projet. L analyste financier doit conseiller l emprunteur et l organe d excution sur cette limite en
matire de financement, ainsi que sur la ncessit pour l emprunteur et/ou l organe d excution de
mobiliser les fonds requis pour honorer de telles obligations. Dans certains cas, les impts et droits
sont clairement indiqus dans les factures, mais dans dautres cas, ils ne sont pas clairement identifis
en tant que tels.
3.5.4 Les impts et droits au titre des cots directs en devises sont faciles identifier dans les
offres/soumissions et les factures. Toutefois, dans certains cas, les impts et droits sont appliqus au
niveau de la vente en gros et n apparaissent pas dans les factures au niveau de la vente en dtail. En
cas d achat indirect de produits soumis un impt substantiel, par exemple les produits ptroliers
destins l industrie de transformation et divers autres procds industriels, il peut tre ncessaire
de dterminer un pourcentage appropri dduire du montant total factur pour le cot des biens ou
services achets par l emprunteur et/ou l organe d excution. Les ajustements effectus au titre des
impts et droits doivent tre pris en compte dans la dtermination du pourcentage des biens ligibles
ou non ligibles au financement de la Banque, par catgories particulires de dcaissement, tel
qu indiqu dans les documents juridiques. Toutefois, il convient de noter que la Banque ne cherche
pas exclure les petits montants d impts ou droits exigibles aux stades secondaire et tertiaire de la
transformation des biens ou de la fourniture des services. A titre d exemple, les impts payables pour
les produits ptroliers destins la fabrication de rcipients en plastique ne seront pas quantifis et
exclus. Toutefois, les impts et droits payables pour les produits ptroliers achets directement par
l organe d excution, pour utilisation pendant la phase de construction du projet, doivent tre ajusts
ou dduits des factures relatives aux produits ptroliers, soumises la Banque pour financement, sous
forme de remboursement.
3.5.5 Dans certains cas, les impts locaux sur les biens et services apparaissent trs clairement.
C est le cas de la taxe sur la valeur ajoute (TVA). Il devrait tre relativement simple de dterminer le
pourcentage de ces biens et services. A titre d exemple, si la TVA est de 15%, ce pourcentage devrait
tre exclu du cot estimatif des biens ou services. Dans d autres cas, le montant des impts locaux
exigs pour les biens et services variera au sein des composantes, et en dterminant le montant
estimatif des impts, l analyste financier doit tenir compte de la ncessit de fournir des mcanismes
pratiques d identification des cots ligibles au financement de la Banque. Pour surmonter les
difficults et rduire le temps d identification de montants varis sur un grand nombre de factures, une
solution pratique consiste parvenir un accord entre l analyste financier, l emprunteur et l quipe
d valuation sur le montant estimatif ou la moyenne pondre des impts, en tant que pourcentage du
cot total, inclus dans une composante de cot en monnaie locale, qui est autrement ligible au
remboursement. De mme, lorsque les factures relatives aux biens et services incluent des impts et
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 15 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
droits (y compris les droits de douane) qui ne sont pas bien dfinis, le montant devant tre financ par
la Banque pour cette catgorie de biens et services doit tre rduit par le pourcentage correspondant
du montant des impts et droits. Le cot de l exclusion des impts et droits doit tre maintenu un
niveau minime. Toute formule qui doit tre utilise devra tre convenue par l organe d excution et la
Banque, et notifie aux vrificateurs externes des comptes conformment aux termes de rfrence des
vrificateurs, afin de permettre aux vrificateurs externes de procder des tests appropris pendant la
vrification des comptes pour confirmer les montants ligibles au financement de la Banque.
3.5.6 Dans certains secteurs, la Banque peut tre invite financer la revalorisation des salaires et
traitements du personnel de l organe d excution ou des autres dpartements et services du
gouvernement ou des collectivits locales. Dans ce cas, le cot de la revalorisation couvre
frquemment les impts sous forme de contribution patronale la caisse de prvoyance sociale, la
scurit sociale et des rgimes similaires de couverture sociale des employs. Ces impts ne sont pas
ligibles au financement de la Banque et devraient tre carts dans le calcul du financement de la
revalorisation des salaires et traitements (ou de toute autre forme de revalorisation) par la Banque. A
cet gard, il est aussi important que l analyste financier travaille en collaboration avec l organe
d excution pour mettre en place un mcanisme de traitement des demandes soumises la Banque
pour le remboursement des dpenses n incluant pas la contribution patronale obligatoire.
3.5.7 La dduction de ces pourcentages doit concerner les catgories de dcaissement prvues
dans les instruments juridiques, ds que la Banque et l emprunteur parviennent un accord ce sujet.
Cela permettra de procder des ajustements appropris de pourcentages dans les demandes de
remboursements soumises par l emprunteur et/ou l organe d excution. Toutefois, si ncessaire, il est
prfrable d encourager les emprunteurs et/ou les organes d excution soumettre des demandes de
remboursements n incluant pas des impts, sur la base des pourcentages convenus, car une telle
approche acclrera le processus de remboursement par la Banque. Il est galement ncessaire que
l analyste financier prcise, dans le plan de financement, la source du financement des rubriques non
ligibles au financement de la Banque, afin de s assurer que le projet dispose des fonds ncessaires
pour achever les investissements prvus et obtenir les avantages conomiques attendus.
Tableau de financement
3.5.8 Le tableau du cot estimatif du projet prsente le financement total ncessaire pour le projet.
Le rapport dvaluation doit contenir une section discutant des moyens de financer les dpenses
totales du projet. Dans le cas d entits but non lucratif, o il y a rarement des sources internes de
fonds, le financement des projets n est gnralement pas li la performance financire future de ces
entits. Dans ce cas, les discussions et les exemples consacrs au plan de financement dans le rapport
d valuation se limitent au projet et constituent normalement un aspect des discussions sur le cot
estimatif. Dans le cas d un projet gnrateur de revenu, un rsum du plan de financement doit
accompagner le tableau du cot estimatif du projet. Conformment l annexe 1 du Manuel des
oprations 600, ce rsum doit indiquer les sources de financement (Groupe de la Banque,
gouvernement, autres co-financiers et bnficiaires, s il y a lieu).
3.5.9 Les discussions et exemples portant sur le plan de financement d un projet devant tre
excut par une entit but lucratif comportent gnralement un rsum, en termes courants dans
chaque cas, des lments suivants : (i) les exigences du plan de financement et les sources externes
des fonds figurant dans le tableau de financement ; (ii) les autres dpenses d investissement et
dpenses marginales au titre du fonds de roulement, encourues pendant la phase de construction du
projet ; (iii) les cots diffrentiels et initiaux d exploitation supporter pendant la phase d excution
et financer soit partir du financement en capital du projet, soit partir d autres sources ; (vi) le
rsultat net des oprations en cours ; et (v) le service de la dette. Les fonds de toutes les principales
sources doivent tre identifis et prsents comme des rubriques du plan de financement. Les sources
de financement doivent tre dtermines, en prenant soin de prciser s il s agit de la monnaie locale
ou des devises, en utilisant la devise du prt de la Banque comme la devise de rfrence, et en
regroupant les sources de fonds selon qu il s agit de la monnaie locale ou des devises, y compris en ce
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 16 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
qui concerne les prts de la Banque, les fonds du FAD et les oprations d assistance technique, ainsi
que les fonds des autres prteurs et bailleurs de fonds trangers, les prts locaux, les apports locaux en
capital, y compris les dons et subventions du gouvernement, et les fonds gnrs au plan interne.
3.5.10 Lorsque l organe d excution conduit des activits d exploitation en cours, par exemple dans
le cas d une entreprise du secteur public, il peut gnrer ou ne pas gnrer des fonds suffisants pour
appuyer ces activits. Il est alors souhaitable d inclure dans le plan de financement soit le financement
net devant tre gnr pendant toute la dure de la priode du plan de financement, soit les besoins en
financement additionnel requis pour l exploitation et la maintenance des installations existantes et
nouvelles. Les sources de financement additionnel telles que les subventions gouvernementales et
autres, doivent tre identifies. Le plan de financement doit contenir une rfrence explicite toute
contribution aux investissements effectuer par l organe d excution pendant la phase d excution, y
compris une rfrence spcifique l acceptabilit, pour la Banque, d une politique de financement du
dficit par le gouvernement, en particulier toute politique qui, de fait, contribue l investissement en
capital de l organe d excution.
3.5.11 Une annexe du rapport d valuation doit tre consacre aux questions suivantes, en
fournissant, s il y a lieu, des explications dtailles : (i) les accords ventuels de co-financement ; (ii)
la disponibilit de fonds internes jugs essentiels pour le tableau de financement ; (iii) le ratio
d autofinancement ; (iv) les apports de capitaux ; (v) les modalits des prts, y compris les taux
d intrt (ou les taux prteurs, s il y a lieu), les dlais de grce, les dlais de remboursement,
l incidence du risque de change, les commissions de garantie et les intrts pendant la phase de
construction ; et (vi) la fiabilit du plan de financement en termes d engagements fermes reus, les
progrs raliss dans les ngociations, lorsque les prts ou les apports de capitaux n ont pas encore t
finaliss, la disponibilit de sources additionnelles de fonds, en cas de dpassement des cots ou de
gnration de fonds internes d un niveau infrieur au niveau attendu, et l analyse de sensibilit
couvrant ces dernires rubriques.
3.5.12 Le rsum du plan de financement doit figurer dans le rapport d valuation, et le plan
dtaill doit tre annex ce rapport. Pour les projets non gnrateurs de revenu, le tableau du cot du
projet (qu il s agisse du rsum ou du plan dtaill) peut tre facilement converti en un plan de
financement, en ajoutant aprs la rubrique cot du projet les sources de fonds qui ont t
identifies comme disponibles pour couvrir ce cot. Il peut y avoir une exception dans le cas d un
projet non gnrateur de revenu lorsque le projet doit devenir directement fonctionnel aprs
l achvement de son excution. Dans ce cas, les cots d exploitation doivent tre prsents pour les
deux trois premires annes, avec indication des sources de financement correspondantes
(habituellement des allocations budgtaires avec peut-tre quelques recettes directes).
3.5.13 Le tableau suivant est un exemple de rsum typique de plan de financement d un projet
gnrateur de revenu. Un plan de financement dtaill est prsent dans la section 7.18 du chapitre
consacr la gestion des connaissances dans les prsentes Directives.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 17 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
PLAN DE FINANCEMENT
(_de___ __)
PAYS: XXX
PROJET: Titre du projet
En (milliers)/(millions) d UC/devise du prt de la Banque
Monnaie
locale Devises
% % Total %
FONDS REQUIS
Projet propos
Dpenses d investissement 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Dpenses d exploitation 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Intrts pendant la phase de
construction 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Autres frais financiers 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTAL DES FONDS REQUIS
POUR LE PROJET 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100%
SOURCES DES FONDS
Prt de la Banque propos 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Autres prts 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Apports de capitaux 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Gouvernement 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Autres sources 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Subventions 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Gnration de fonds internes (le
cas chant) 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTAL TOUTES SOURCES 0,00 100% 0,00 100% 0,00 100%
3.6 VIABILITE FINANCIERE DES PROJETS
Introduction
3.6.1 La Banque exige que des analyses financires et conomiques soient entreprises pour les
projets (Manuel des oprations 600). Bien que les deux types d analyse visent le mme objectif,
savoir dterminer la viabilit de l investissement propos, le concept d analyse financire diffre de
celui de viabilit conomique. Alors que l analyse financire examine l adquation du rendement d un
projet pour l organe d excution et les autres participants au projet, l analyse conomique d un projet
en mesure les effets sur l conomie nationale. L analyse financire et l analyse conomique sont
complmentaires. Si un projet n est pas financirement viable, il ne pourra pas produire des avantages
conomiques.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 18 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Projets non gnrateurs de revenu
3.6.2 Les projets non gnrateurs de revenu ne sont pas soumis un test de viabilit financire
parce que, par dfinition, ils n entranent pas de flux de trsorerie. Il est difficile de quantifier les
avantages montaires des projets ciblant des secteurs tels que la sant, l ducation, l adduction d eau
et l assainissement, etc.. A cet gard, deux approches d valuation sont courantes, savoir l analyse
de la rentabilit et l analyse cot-utilit des projets. Lorsqu il n est pas possible d attribuer des valeurs
montaires des rsultats donns, une approche axe sur la minimisation des cots est alors utilise.
Elle consiste slectionner l option prsentant le plus faible cot pour des rsultats identiques. C est
l essence de l analyse de la rentabilit. L analyse cot-utilit mesure le cot unitaire d un rsultat,
mais l efficacit de ce rsultat est aussi mesure en termes de qualit des avantages. L efficacit des
rsultats repose donc la fois sur leur quantit et leur qualit.
3.6.3 Pour toutes les deux approches, les cots pertinents doivent tre inclus dans les cots directs
et les cots indirects. Les cots directs couvrent les cots en capital et les cots d exploitation. Les
cots indirects concernent les cots rsultants de la participation un vnement, par exemple les
cots des soins domicile associs un traitement particulier. Les cots indirects peuvent tre plus
difficiles dterminer. En outre, tous les cots ou dpenses doivent tre mesurs en termes de prix
conomiques des biens et services, afin de prendre en compte les cots en ressources sur le plan de
l conomie, dans le cadre de l analyse cots-avantages. Quand des dpenses sont tales sur un
certain nombre d annes, la valeur actuelle de ces dpenses doit tre dduite du cot d option
conomique du capital. En consquence, les techniques d valuation des projets non gnrateurs de
revenu reposent sur la viabilit conomique qui est couverte dans les Directives pour l analyse
conomique et la conception des projets du Groupe de la Banque, et non par les prsentes Directives.
Projets gnrateurs de revenu
3.6.4 La viabilit financire des projets gnrateurs de revenu est dtermine sur la base du projet
lui-mme, et non sur la base des activits de l entit qui est le propritaire du projet ou qui en assure
l exploitation. La principale comparaison se fait entre le taux de rentabilit financire (FIRR) qui
reprsente le taux de rendement du projet, et le cot moyen pondr du capital (WACC) du projet. Si
le taux de rendement est suprieur au cot du capital, le projet rpond aux critres de viabilit
financire. Les deux lments de comparaison sont mesures en termes rels, afin d liminer les effets
des variations des prix sur la comparaison. Il faut prendre soin de dterminer si tous les encaissements
et tous les paiements ont t identifis, et si toutes les oprations de caisse sont bases sur les prix
courants du march, en termes rels. Si le projet est jug viable, l on procde au test de sensibilit de
son taux de rentabilit financire par rapport la fiabilit des hypothses et/ou des erreurs possibles
concernant l estimation du taux de rentabilit financire. Toutes les hypothses utilises pour le calcul
du taux de rentabilit financire et du cot moyen pondr du capital doivent tre clairement
indiques.
Flux de trsorerie diffrentiels du projet
3.6.5 Des prvisions doivent tre faites pour dterminer le flux de trsorerie annuel net du projet
pendant toute la dure du cycle du projet. Le flux de trsorerie annuel net est la diffrence entre les
encaissements annuels et les dcaissements annuels. Lorsque les projets prvoient des amnagements
progressifs, par exemple l extension d une centrale lectrique existante, les flux de trsorerie doivent
tre calculs sur la base de diffrents scnarios (par exemple le scnario avec le projet et le
scnario sans le projet). Les encaissements annuels doivent inclure toutes les commissions de
gestion et tous les produits des ventes, ainsi que les subventions reues du gouvernement pour le
projet et la valeur estimative de rcupration ou la valeur marchande de l actif du projet la fin du
cycle du projet. Les dcaissements annuels doivent inclure tous les paiements effectus au titre de la
construction, de l exploitation et de l entretien des installations du projet pendant la dure de vie utile
du projet. Tous les impts et droits tels que les droits de douane et les droits d accise, la taxe sur la
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 19 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
valeur ajoute, les prlvements similaires et l impt sur le revenu, doivent tre inclus. L estimation
de l impt sur le revenu doit tre base sur le bnfice d exploitation (avant dduction des frais
financiers, mais aprs dduction de l amortissement) gnr par le projet, conformment au taux en
vigueur.
3.6.6 Les dcaissements destins couvrir le cot de construction et servant de base au calcul du
taux de rentabilit financire doivent faire l objet d un rapprochement avec le cot estimatif du projet,
c est--dire le cot de base et les provisions pour alas techniques, l exclusion des provisions pour
alas financiers et des frais financiers encourus pendant la phase d excution. Les provisions pour
alas financiers sont exclus parce que le taux de rentabilit financire est calcul en termes rels
(c est--dire sans tenir compte des effets de la rvision des prix et/ou des fluctuations des taux de
change). Les taux de change utiliss pour la conversion des monnaies doivent tre fixs une date
particulire et doivent tre systmatiquement appliqus pendant toute la priode couverte par les
prvisions. Les frais financiers encourus pendant la phase d excution sont exclus pour faire une
distinction entre la dcision d investissement et la dcision de financement, et parce qu ils sont pris en
compte dans le cot moyen pondr du capital (WACC).
3.6.7 Parce que les flux des cots du projet sont calculs en termes rels, la pertinence des
provisions par rapport la viabilit financire du projet dpend de la prise en compte ou non des
ressources relles additionnelles dans les provisions. Les provisions pour alas techniques
reprsentent le cot estimatif des ressources relles additionnelles juges ncessaires et doivent donc
tre incluses dans l analyse de la viabilit financire de tous les projets. Les provisions pour alas
financiers doivent tre exclues de l analyse financire et de l analyse cots-avantages. Les provisions
pour risques doivent tre incluses lorsqu elles reprsentent le cot probable d un risque physique,
mais elles sont exclues lorsqu elles servent couvrir le risque de variation des prix. Toutefois, il
convient de noter que dans la mesure o les provisions pour risques, au titre de la variation des prix
des biens et services, sont souvent retires aprs la rception des soumissions, les rsultats de ces
soumissions peuvent ncessiter une reprise de l analyse de la rentabilit financire.
3.6.8 La priode typique des prvisions l chelle de l entreprise pour la prsentation des tats
financiers n excdera pas cinq ans, partir de la date d achvement du projet, mme si le projet n a
pas encore atteint un niveau oprationnel normal. Cela ne permet pas de disposer d informations
suffisantes pour se prononcer sur la viabilit financire des investissements effectus au titre du projet
sur toute la dure utile de sa vie. Cette lacune peut tre comble en prparant des prvisions du
compte de rsultat du projet, d une manire isole, jusqu l atteinte du niveau oprationnel optimal et
en se basant sur l hypothse que le flux de trsorerie net se maintiendra un niveau constant par la
suite. Si le projet est l un de plusieurs projets excuts par un organe d excution, des projections
distinctes doivent tre prpares.
3.6.9 Dans l exemple suivant qui prsente le mode de calcul des flux de trsorerie nets, les annes
2009 2012 n apparaissent pas.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 20 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
FLUX DE TRESORERIE NETS, 2004 (en milliers $ EU)
2004 2005 2006 2007 2008 2013-2034
Flux de trsorerie d exploitation
Encaissements
Ventes d eau:
Mnages 0 668 1.613 2.922 4.740 14.077
Etablissements publics 0 21 50 80 124 726
Etablissements privs 0 32 76 117 170 997
Total partiel 0 722 1.739 3.119 5.034 15.800
Commissions de branchement 0 2.552 3.067 3.689 4.436 0
Total recettes d exploitation 0 3.273 4.806 6.807 9.470 15.800
Paiements:
Exploitation et entretien 0 (410) (918) (1.534) (2.303) (4.281)
Taxes de vente 0 (84) (109) (142) (183) (139)
Impt sur les socits 0 (100) (100) (100) (100) (100)
Dpenses de branchement 0 (2.424) (2.914) (3.504) (4.214) 0
Total dpenses d exploitation 0 (3.018) (4.041) (5.280) (6.800) (4.520)
Flux de trsorerie nets
d exploitation
0 255 765 1.527 2.670 11.280
Flux de trsorerie d investissement
Investissements (7.184) (43.107) (64.660) (28.738) 0 0
Flux de trsorerie nets
d investissement
(7.184) (43.107) (64.660) (28.738) 0 0
Flux de trsorerie nets (7.184) (42.852) (63.895) (27.211) 2.670 11.280
Cot d opportunit financire du capital (FOCC)
3.6.10 Au cours de la dure de vie d un projet, si le flux de trsorerie net d exploitation est
actualis au cot d opportunit financire du capital (FOCC), le rsultat sera le capital maximum
pouvant tre investi pour que le projet soit l alternative la plus attrayante dont dispose l emprunteur.
La dtermination du FOCC est problmatique parce qu elle ncessite un classement des opportunits
offertes l emprunteur en matire d investissement, afin de dterminer la plus attrayante du point de
vue financier, laquelle l on renonce pour investir plutt dans le projet. Etant donn que le processus
de slection des projets de la Banque est base sur l examen rigoureux des projets inclure dans le
programme triennal des prts de la Banque, l analyste financier peut recourir ce processus pour
s assurer que le projet rpond au critre d investissement prioritaire ncessaire pour raliser les
objectifs nationaux de dveloppement arrts par le gouvernement.
Taux de rentabilit financire
3.6.11 Le taux de rendement d un projet, pour une entit donne, est dtermin par le taux de
rentabilit financire du projet (FIRR). En consquence, le FIRR est aussi le taux d actualisation
auquel la valeur actuelle nette (VAN) des flux de trsorerie nets est gale zro. Le tableau suivant
donne un exemple de calcul du FIRR. Il prsente les recettes et les dpenses relatives au projet, ainsi
que les flux de trsorerie nets sur toute la priode du projet qui est de 30 ans. A titre d illustration,
l hypothse retenue est que les recettes et les dpenses demeureront constantes partir de l anne
2013.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 21 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
ESTIMATION DU FIRR AUX PRIX DE 2004 (en milliers de $ EU)
Anne Dpenses Recettes
Flux de
trsorerie
nets Anne Dpenses Recettes
Flux de
trsorerie
nets
2004 7.184 0 (7.184) 2.020 4.520 15.800 11.280
2005 46.125 3.273 (42.852) 2.021 4.520 15.800 11.280
2006 68.702 4.807 (63.895) 2.022 4.520 15.800 11.280
2007 34.018 6.807 (27.211) 2.023 4.520 15.800 11.280
2008 6.800 9.470 2.670 2.024 4.520 15.800 11.280
2009 2.810 6.306 3.496 2.025 4.520 15.800 11.280
2010 3.193 7.795 4.602 2.026 4.520 15.800 11.280
2011 3.604 9.535 5.931 2.027 4.520 15.800 11.280
2012 4.045 11.568 7.523 2.028 4.520 15.800 11.280
2013 4.520 15.800 11.280 2.029 4.520 15.800 11.280
2014 4.520 15.800 11.280 2.030 4.520 15.800 11.280
2015 4.520 15.800 11.280 2.031 4.520 15.800 11.280
2016 4.520 15.800 11.280 2.032 4.520 15.800 11.280
2017 4.520 15.800 11.280 2.033 4.520 15.800 11.280
2018 4.520 15.800 11.280 2.034 4.520 15.800 11.280
2019 4.520 15.800 11.280
VFAN @4,33% 0
Cot moyen pondr du capital (WACC)
3.6.12 Le cot moyen pondr du capital (WACC) reprsente le cot support par l entit pour
mobiliser le capital ncessaire pour l excution du projet. Etant donn que la plupart des projets
mobilisent le capital auprs de plusieurs sources et que chacune de ces sources peut chercher obtenir
une rmunration diffrente de son capital, il est ncessaire de recourir une moyenne pondre des
diffrentes rmunrations payes ces sources. Le rapport d valuation doit inclure une estimation du
WACC du projet, en termes rels. Le FIRR et le WACC doivent tous les deux tre dtermins aprs la
dduction de l impt sur le revenu.
3.6.13 La section suivante est une illustration de l approche suivre pour le calcul du WACC :
Etape 1: Dtermination des catgories des composantes du financement, tel qu indiqu
dans le tableau ci-dessous. Ces composantes doivent maner du plan de
financement du projet, tant donn que le WACC est calcul uniquement pour le
projet et non pour l ensemble de l entit.
Etape 2: Estimation du cot des ressources. Dtermination des taux prteurs (ou non
prteurs), mme lorsque ceux-ci sont les taux courants sur le march, ainsi que
du cot des apports de capital, dans le cadre du projet. Il convient de noter que
(i) les prts octroys par les gouvernements peuvent prciser ou non un taux
d intrt ; (ii) les allocations budgtaires gouvernementales ne sont pas sans
cot, car elles peuvent servir des fins autres que celles du projet, par exemple
le remboursement de la dette ou d autres investissements, tant entendu que par
souci de simplicit, le cot moyen des fonds gouvernementaux peut tre calcul
en divisant le cot total du financement gouvernemental par le montant total de
la dette publique ; (iii) dans l estimation du cot de l apport de capital, il est
ncessaire de prendre en considration les risques d exploitation (risques
conomiques) et les risques financiers (banqueroute), et d ajouter une prime de
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 22 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
risque approprie au taux crditeur sur le march. Dans la plupart des cas, seul
un petit montant du financement du projet, le cas chant, sera fourni par
l entit. En tant que telle, l estimation du cot de l apport de capital ne devrait
probablement pas affecter indment le WACC. Toutefois, la mthode utilise
pour l estimation doit tre documente.
Etape 3: Ajustement au titre de l impt sur les socits. Dtermination de la possibilit
de dduire ou non les intrts pays pour chaque composante, au titre de l impt
sur les socits, et si oui, le taux applicable pour le paiement de cet impt. A cet
gard, chaque composante doit faire l objet d un ajustement, si ncessaire.
Etape 4: Ajustement au titre de l inflation au niveau national. Les cots estimatifs des
emprunts et des apports de capital doivent tre ajusts pour tenir compte de
l inflation, en vue de dterminer le WACC en termes rels. Il convient de noter
que (i) pour les prts de sources externes, la Banque exige l inclusion d une
prime de risque de change dans le WACC. En revanche, les fonds de sources
trangres doivent faire l objet d un ajustement au titre de l inflation
l tranger, tant entendu que par souci de simplification du calcul du WACC,
l hypothse retenir doit tre que la prime de risque de change compense
exactement le taux d inflation prvalant l tranger, et ainsi, aucun de ces
facteurs n a besoin d tre estim et appliqu ; (ii) le taux d inflation prvu par la
Banque au niveau national doit tre utilis pour les prts et le capital de sources
internes.
Etape 5: Application du taux minimum de test. Pour chaque composante, le cot rel
du capital doit tre d au moins 4%. Dans le cas contraire, il faut remplacer la
valeur obtenue par 4%.
Etape 6: Dtermination du WACC. Application du pourcentage pondr chaque
composante pour dterminer le WACC.
Mthode de calcul du cot moyen pondr du capital (WACC)
Composante du financement
Prt
BAD
Prts de
sources
externes
Prts de
sources
internes
Fonds
gouvernementaux
Apport
de capital
Total
A.
Montant (en milliers
de $ EU)
50.000
5.000
5.000
30.000
10.000
100.000
B. Pondration 50,00% 5,00% 5,00% 30,00% 10,00% 100%
C. Cot nominal 6,70% 6,70% 12,00% 7,00% 10,00%
D. Taux de l impt 40,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00%
E. Cot nominal ajust
de l impt [Cx (1
D)]
4,02%
4,02%
7,20%
7,00%
10,00%
F. Taux d inflation 4,00% 4,00% 4,00%
G.
Cot rel
[(1+E)/(1+F) 1]
4,02%
4,02%
3,08%
2,88%
5,77%
H.
Taux minimum de
test [H=4%]
4,02%
4,02%
4,00%
4,00%
5,77%
I. Composante
pondre du WACC
2,01%
0,20%
0,20%
1,20%
0,58%
4,19%
Cot moyen pondr du capital (en termes rels): 4,19%
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 23 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.6.14 Dans cet exemple: (i) les sources du capital pour le projet sont la Banque, hauteur de 50% ;
les prts octroys par les autres banques trangres, hauteur de 5% ; les prts octroys par les
banques locales, hauteur de 5% ; les dons du gouvernement, hauteur de 30% ; et les fonds propres
de l organe d excution du projet, hauteur de 10% , tant entendu que l hypothse retenue est que
chaque source de fonds a une rmunration nominale diffrente, et que la rmunration pour les
actionnaires du projet sera de 10% ; (ii) les intrts pays pour le prt octroy par la Banque ou les
prts octroys par d autres banques trangres et les prts octroys par les banques locales peuvent
tre dduits du revenu avant impt. Le cot du capital aprs impt pour le projet est donc de 60%. Les
dividendes pays aux actionnaires, le cas chant, ne sont pas soumis l impt sur les socits (bien
qu ils puissent tre soumis l impt sur le revenu personnel dont le cot n est pas support par
l entit) ; et (iii) le WACC, en termes rels, est de 4,19%. C est ce taux d actualisation qui doit tre
utilis pour l analyse de la rentabilit financire du projet, en lieu et place du FOCC.
Comparaison du FIRR et du WACC
3.6.15 Si le FIRR du projet est suprieur son WACC, le projet est considr comme
financirement viable. Si le FIRR est infrieur au WACC, le projet ne peut tre financirement viable
que s il augmente son flux de trsorerie net grce l accroissement des recettes ou la rduction des
cots, ou s il reoit des subventions suffisantes du gouvernement, destines relever suffisamment le
FIRR pour qu il soit suprieur au WACC. Si les capacits du projet mobiliser des recettes, rduire
la pauvret ou raliser d autres objectifs sociaux sont limites, alors que le projet en question
bnficie dj de subventions sans que son FIRR dpasse le WACC, le projet doit rduire ses cots ou
bnficier de subventions plus substantielles, jusqu ce que son FIRR dpasse le WACC. Dans
l exemple ci-dessus, le FIRR de 4,33% est suprieur au WACC de 4,19%, ce qui veut dire que le
projet est financirement viable. Le rapport dvaluation doit prsenter une comparaison du FIRR du
projet avec le WACC. Les analyses y affrentes doivent tre annexes au rapport d valuation.
Test d alternative de la viabilit du projet
3.6.16 Le test d alternative de la viabilit financire d un projet vise dterminer si la valeur
actuelle nette (VAN) du flux de trsorerie net pendant la dure de vie du projet, actualise sur la base
du WACC, est positive. Techniquement, si la VAN est positive, cela veut dire que le FIRR est
suprieur au WACC. Une VAN ngative signifie que le projet ne peut pas avoir un rendement
suffisant permettant d en recouvrer les cots et surtout que le projet doit accrotre ses recettes, rduire
ses cots ou alors solliciter une subvention gouvernementale.
3.6.17 Dans l exemple ci-dessus, le flux de trsorerie net, actualis sur la base du WACC de
4,19%, est de plus 2.560.000 $. Le projet est donc financirement rentable. Si l on utilise un taux
d actualisation de 4,33% (l quivalent du FIRR), la VAN (par dfinition) est gale zro. Cet
exemple montre que si le taux dactualisation utilis (4,19%) est infrieur au FIRR (4,33%), la VAN
est positive.
Analyse de sensibilit
3.6.18 L analyse de la rentabilit financire est base sur les prvisions de variables quantifiables
telles que la demande, les recettes et les cots. Les valeurs de ces variables sont estimes sur la base
des prvisions les plus probables sur une longue priode de temps. Les valeurs de ces variables pour
le scnario le plus probable en matire de rsultat peuvent tre influences par de nombreux facteurs,
et leurs valeurs actuelles peuvent diffrer considrablement des valeurs des prvisions, en fonction
des vnements futurs. Il est donc ncessaire d analyser la sensibilit de la viabilit du projet aux
changements potentiels intervenant dans les principales variables.
3.6.19 La viabilit des projets est value sur la base de la comparaison du FIRR avec le WACC.
Alternativement, un projet est considr comme viable lorsque la VAN est positive, en utilisant le
WACC comme taux d actualisation. Le WACC est habituellement considr comme constant parce
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 24 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
que les ressources du prt et les apports gouvernementaux de capital sont fixes et interviennent au
dbut des flux de trsorerie. Toutefois, une partie du financement peut maner d instruments taux
variable, auquel cas il conviendrait de tester la viabilit du projet en analysant sa sensibilit aux
changements intervenant dans les taux d intrt. Dans l exemple ci-aprs, l hypothse retenue est que
le WACC est constant. L analyse de sensibilit portera donc essentiellement sur l analyse des effets
que les changements intervenant dans les principales variables peuvent avoir sur le FIRR ou la VAN
du projet qui sont les deux indicateurs de viabilit des projets les plus couramment utiliss.
3.6.20 L analyse de sensibilit vise tester l impact des changements intervenant dans les variables
des projets sur le scnario de base (le scnario le plus probable en matire de rsultats). En gnral,
seuls les changements ngatifs sont pris en compte dans l analyse de sensibilit. L analyse de
sensibilit a pour objectifs : (i) d identifier les principales variables ayant une incidence sur le cot et
les avantages du projet ; (ii) de mener des recherches sur les consquences des changements ngatifs
pouvant intervenir dans ces principales variables ; (iii) de dterminer si les dcisions relatives au
projet sont susceptibles ou non d tre affectes par de tels changements ; et (iv) d identifier les actions
susceptibles d attnuer les effets ngatifs potentiels de ces changements sur le projet. L analyse de
sensibilit doit tre entreprise d une manire systmatique. Pour raliser les objectifs ci-dessus, il est
propos de suivre les tapes suivantes :
Etape1: Identifier les principales variables pouvant avoir une incidence sur la viabilit du
projet.
Etape 2: Calculer l effet des changements potentiels intervenant dans ces variables sur le
FIRR ou la VAN du scnario de base, et dfinir un indicateur de sensibilit et/ou
une valeur seuil.
Etape 3: Examiner les combinaisons possibles de variables pouvant changer
simultanment pour prendre une mauvaise tendance.
Etape 4: Analyser la tendance et l chelle des changements susceptibles d intervenir dans
les principales variables identifies, y compris la dtermination des sources de
tels changements.
3.6.21 La section 7.19 du chapitre des prsentes Directives consacr la gestion des connaissances
fournit de plus amples informations sur chacune de ces tapes, dans le contexte d un exemple chiffr.
Les informations gnres peuvent tre prsentes dans un tableau assorti de commentaires et d une
srie de recommandations, comme dans l exemple ci-dessous.
Analyse de sensibilit simple : Prsentation chiffre
Rubrique
Changement VAN FIRR %
IS
(VAN)
VS
(VAN)
Scnario de base 126 13,7
Investissements +10% 70 9,6 13,3 7,5%
Avantages 10% 57 7,8 16,6 6,0%
Cots d exploitation et d entretien +10% 68 12,9 2,3 43,4%
Fluctuations de la monnaie
20% 70 9,6 13,3 7,5%
Retards dans la construction Un an 79 10,8 VAN infrieure 37%
IS =Indicateur de sensibilit ; VS =Valeur seuil
3.6.22 Les tests de sensibilit ne sont pas sans problmes. Les corrlations entre les variables
posent souvent de srieux problmes. La technique usuelle qui consiste varier une seule variable la
fois, en maintenant la valeur attendue des autres un niveau constant, n est justifie que si les
variables concernes n ont pas de corrlations significatives. Dans le cas contraire, les variables
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 25 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
concernes doivent tre varies conjointement. Dans ce cas, la sensibilit des rsultats des projets aux
changements intervenant dans plusieurs combinaisons de variables qui doivent varier ensemble, par
exemple les recettes plutt que les prix et les quantits sparment, doit tre analyse. Toutefois, il
convient de noter que plus le degr d agrgation est lev, moins utiles sont les donnes issues des
tests.
Questions relatives aux politiques
3.6.23 Au nombre des questions de politiques relatives la gestion financire, qui sont souleves
dans les prsentes Directives et qui mriteraient un haut degr d harmonisation et d alignement,
figurent la question du financement du dficit ou des apports de capital en faveur de l organe
d excution, dans le cadre du plan de financement du projet, et la question de la fourniture, par le
gouvernement, de subventions annuelles au titre de l appui l exploitation. Il s agit l de deux
questions qui ont une incidence directe sur la viabilit financire du projet et qui sont prsentes dans
la Dclaration de Paris comme ncessitant des discussions et un accord avec tous les bailleurs de
fonds prsents dans le pays, en particulier ceux qui interviennent dans le secteur concern. Il en est
ainsi parce qu une politique de subventionnement des cots en capital ou des cots d exploitation de
l organe d excution constitue une politique qui s applique tous les investissements effectus en
faveur du dveloppement dans le pays concern. La Dclaration de Paris prvoit des discussions
concertes avec le gouvernement sur sa stratgie de subventionnement pour dterminer (i) si la
politique gouvernementale en la matire est approprie en gnral, et dans ce cas, (ii) si elle doit tre
applique de manire slective des secteurs spcifiques, et si la politique en question et les secteurs
slectionns contribuent appuyer la stratgie gouvernementale de rduction de la pauvret. La
capacit du gouvernement octroyer des subventions et la disposition et le bien-fond des bailleurs de
fonds financer de telles subventions par le biais de l aide au dveloppement sont des questions
ncessitant une harmonisation entre les bailleurs de fonds. Les deux exemples discuts sont courants
pour les projets de dveloppement, en particulier les projets d amnagement des infrastructures et
d autres projets gnrateurs de revenu. Il ne s agit pas des seules questions de gestion financire
bases sur les politiques, qui puissent tre souleves. Les analystes financiers doivent concentrer
l attention sur les questions relatives aux politiques de gestion financire, que soulvent
manifestement tous les projets de dveloppement.
3.6.24 Dans son analyse, l analyste financier peut dterminer si une assistance technique est
ncessaire pour tudier le ciblage des subventions et/ou aider mettre en uvre un programme de
ciblage des subventions en faveur de l organe d excution. L analyste financier doit galement
identifier les questions relatives la gestion financire et dterminer si le traitement de ces questions
par l organe d excution est conforme la stratgie nationale de dveloppement, la stratgie
nationale de rduction de la pauvret et aux documents de stratgies tablis pour des secteurs
spcifiques. Une question connexe concerne l efficacit de la politique de subventionnement qui peut
se manifester dans le ciblage des subventions. En prenant l exemple du subventionnement des cots
en capital du projet ou des subventions octroyes au titre de l exploitation, l analyste financier doit
dterminer (i) si le subventionnement des cots en capital vise appuyer l extension des services dans
des rgions gographiques o rsident des personnes dont le revenu est faible ; (ii) si la quantit et la
qualit des prestations de services rpondent aux besoins des rsidents ; et (iii) si les services en
question sont rentables, par exemple l utilisation de bornes fontaines pour l approvisionnement en eau
potable de rgions densment peuples. Les analystes financiers doivent passer en revue les
subventions octroyes au titre de l exploitation pour dterminer si elles (i) compensent
l approvisionnement d un niveau durable ou d un niveau minimum en nergie ou en eau potable,
moyennant le paiement d une redevance minimale ou nulle pour les services fournis (comme cela est
gnralement le cas dans les systmes tarifs diffrencis) ; (ii) compensent les niveaux levs de
l eau ou de l nergie fournie titre gratuit, en particulier si des compteurs gants permettent
d identifier les pertes leves subies au titre de la fourniture de ces services dans les zones o rsident
des personnes dont le revenu est faible ; (iii) permettent aux familles pauvres de payer les factures en
souffrance ; et (iv) comment l organe d excution tente de mesurer l utilisation des subventions ou de
veiller ce que les subventions atteignent les cibles vises. Les subventions caractre plus gnral
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 26 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
bnficient habituellement aux plus grands utilisateurs des services de l organe d excution. Or, les
plus grands utilisateurs ne sont gnralement pas les pauvres.
3.6.25 La Banque interprte d une faon plutt large le concept de viabilit financire en ce qui
concerne les prts-projets. Elle inclut dans ce concept l utilisation des subventions gouvernementales
pour garantir la viabilit financire de l organe d excution. La revue, par l analyste financier, de la
viabilit financire du projet et de toutes questions de politique telles que les subventions et leur
ciblage, doit aboutir l laboration de clauses financires appropries visant complter la stratgie
gouvernementale en matire de rduction de la pauvret. L assurance doit tre donne que les
subventions juges ncessaires pour garantir la viabilit financire du projet et de l organe
d excution seront payes en temps voulu.
3.7 OBJECTIFS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Introduction
3.7.1 L analyse conomique et l analyse financire des projets sont troitement lies. Dans la
pratique, toutes les deux analyses reposent, entre autres, sur le calcul des taux de rendement interne.
Toutes les deux analyses sont conduites en termes montaires, la principale diffrence se situant au
niveau de la dfinition des cots et des avantages. Il est trs important d entreprendre tant l analyse
conomique que l analyse financire. Il est galement important que les analystes financiers
comprennent les raisons des divergences dans les rsultats de l analyse conomique et de l analyse
financire.
3.7.2 L objectif de l analyse conomique est d valuer un projet sur la base de tous ses effets sur
l conomie
5
. A titre d exemple, l extension d installations portuaires peut entraner une augmentation
significative des exportations de marchandises, produits agricoles et produits manufacturs,
encourageant ainsi l augmentation de la production dans ces secteurs et dans d autres secteurs de
l conomie, de mme que la cration de nombreux nouveaux emplois dans les secteurs concerns et
les secteurs connexes tels que les transports routiers. Tous ces avantages conomiques seront
quantifis dans l analyse conomique du projet. Pour sa part, l analyse financire a pour objectif
d valuer la viabilit commerciale d un projet, du point de vue de l entit charge du projet. En
d autres termes, l analyse financire tient compte uniquement des dpenses effectues dans le cadre
du projet et de ses recettes. Dans le cas du projet portuaire, les seuls avantages financiers mesurs
seraient l augmentation marginale des commissions portuaires payes la suite de l amnagement de
nouvelles installations.
Objectifs conomiques
3.7.3 L allocation efficace des ressources est l objectif fondamental de la planification
conomique. Les dcisions concernant les politiques conomiques sont prises pour mettre en uvre
les plans conomiques. Ces dcisions peuvent avoir un impact financier direct sur les rsidents du
pays, par exemple en termes de politiques de fixation des prix des biens et services fournis par les
entreprises tatiques, ou un impact indirect, par exemple en termes de tarification des importations ou
de dcisions foncires. Dans les autres cas, les dcisions concernant les politiques peuvent prescrire
que certains biens et services fournis par les entreprises tatiques, devraient l tre sans frais pour les
usagers. La Banque considre un projet de ce genre comme un projet non gnrateur de revenu. La
fourniture de biens ou de services titre gratuit a aussi bien un cot conomique qu un cot
financier.
5
Pour de plus amples orientations sur l analyse conomique, bien vouloir consulter les Directives pour
l analyse conomique et la conception des projets du Groupe de la Banque l adresse suivante :
http://intranet/GPA/index.htm.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 27 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.7.4 La thorie conomique veut que l allocation efficace des ressources soit ralise lorsque
l avantage ou le prix des biens ou services est gal au cot diffrentiel de leur fourniture, c est--dire
le montant total du cot de production et de livraison d une unit additionnelle de rendement, dans des
circonstances prcises. La thorie conomique veut galement que l on tienne compte des importantes
divergences entre les cots et les avantages sociaux dun ct, et le prix du march, de l autre (en
raison, par exemple, de facteurs externes), et que l on value les investissements publics en termes
d opportunits d investissement ou de consommation auxquelles l on a renonc dans dautres secteurs
de l conomie. A cet gard, il y a lieu de citer l exemple d un programme de vaccination pour lequel
l exigence de la participation financire des usagers pour couvrir le cot des vaccins peut dcourager
certaines personnes se faire vacciner, en particulier les personnes pauvres qui peuvent pourtant tre
les plus risque, en raison de leurs conditions de vie, alors que le cot conomique de la productivit
perdue du fait d une flambe de maladies peut se rvler trs lev. Telle est la base de la justification
de nombreux projets non gnrateurs de revenus, mais cela ne signifie nullement que l analyse
financire n a pas un rle jouer dans l valuation des projets.
3.7.5 Les entits gouvernementales appeles fournir des biens ou services titre gratuit auront
supporter des cots financiers qui doivent tre identifis par l analyste financier, ce qui suppose
l examen des informations recueillies dans le cadre de la revue des systmes gouvernementaux de
gestion budgtaire et financire. L analyste financier doit identifier tous les cots du projet. Il devra
travailler en collaboration avec l organe d excution pour dterminer l anne au cours de laquelle les
dpenses seront effectues, et les ressources budgtaires additionnelles que devra allouer le
gouvernement pour chaque anne. Cette question peut faire l objet d un ventuel avenant.
3.7.6 L quilibre entre les avantages additionnels et les cots additionnels peut tre tabli par la
fixation de prix d un niveau gal celui du cot diffrentiel de livraison et par le recours aux
consommateurs pour galiser les avantages et les cots. En d autres termes, l analyse de rentabilit est
dcentralise et chaque consommateur dcide lui-mme de la quantit qu il aimerait consommer et de
la priode de consommation. Certains produits d un organe d excution but lucratif sont considrs
comme tant de haute valeur par une majorit de consommateurs, et leur valeur est suprieure aux
cots de livraison. D autres produits ont moins de valeur, et la quantit consomme dpendra du prix
fix par l organe d excution but lucratif. Pour une allocation efficace des rares ressources
disponibles, la consommation doit tre facilite si la valeur accorde ces produits par les
consommateurs est suprieure aux cots cumuls de livraison, mais elle doit tre dcourage lorsque
ce n est pas le cas. Un exemple de ce type de projet pourrait tre un projet d approvisionnement en
eau potable pour lequel tous les consommateurs accordent une grande valeur une quantit minimale
viable d eau potable. Les personnes pauvres peuvent tre prtes sacrifier une partie substantielle de
leurs ressources en termes de main-d uvre pour transporter de l eau sur de longues distances ou
creuser des puits, etc., ou pour effectuer des paiements en espces, le cas chant, pour rpondre aux
besoins essentiels et viter la perte de productivit et d autres cots tels que les cots du traitement
des maladies hydriques. Les personnes plus nanties peuvent ne pas accorder autant de valeur la
consommation de grandes quantits et peuvent ragir en faisant preuve de prudence dans l utilisation
de l eau potable pour l entretien de leurs pelouses ou l alimentation de leurs piscines lorsque la
consommation de grandes quantits est taxe des niveaux bien plus levs que le cot financier de
livraison. Ce concept est la base de la tarification diffrencie de l approvisionnement en eau
potable (gnralement un approvisionnement minimum sans frais, mais avec des tarifs trs levs
pour de plus grands blocs de consommation) et fournit galement un exemple de transfert de
revenus/ressources entre les utilisateurs dont la consommation est leve et ceux dont la
consommation est modeste.
3.7.7 L allocation efficace des ressources est un aspect conomique important prendre en
considration dans les politiques de fixation des prix, en particulier les prix des services offerts par un
organe d excution but lucratif. L analyse financire sert dcrire, prvoir et contrler l impact de
ces politiques.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 28 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Objectifs financiers
3.7.8 L objectif primordial de l analyse financire est de prvoir et/ou de dterminer l impact, la
performance et le statut financiers rels d un projet et, s il y a lieu, de l organe d excution. L analyse
financire permet la Banque de combiner les informations ainsi recueillies avec toutes les autres
donnes pertinentes (donnes techniques, conomiques, sociales, etc.), afin de se prononcer sur la
faisabilit, la viabilit et les avantages conomiques potentiels d une opration de prt propose ou en
cours. Son deuxime objectif est de fournir une assistance technique l emprunteur et/ou l organe
d excution, afin de leur permettre de faire des valuations similaires et d appliquer les mmes
techniques aux autres investissements non financs par la Banque. Son troisime objectif est
d encourager l emprunteur et/ou l organe d excution introduire les changements ncessaires dans
leurs systmes de gestion institutionnelle et financire, afin de faciliter la gnration de donnes
appropries pour appuyer une bonne analyse financire. Ces objectifs visent mesurer le degr de
ralisation des objectifs financiers de l emprunteur, de l organe d excution et du projet, et varient en
fonction de la nature du projet et/ou de l organe d excution, selon qu il s agit d un projet gnrateur
ou non gnrateur de revenu, ou d un organe d excution but lucratif ou but non lucratif.
Projets gnrateurs de revenu
3.7.9 L on prsume que si un gouvernement cre un organe d excution but lucratif, tous les
biens et services fournis au public par un tel organe le seront moyennant le paiement d un tarif ou de
frais, sinon le gouvernement fournirait de tels biens ou services par l intermdiaire de services
gouvernementaux. La fixation du tarif des biens ou services fournis est une dcision de politique et ne
signifie pas ncessairement que l entit vise faire des bnfices, du moins pas ncessairement en
tout temps ou pour tous les biens ou services. Pour les entits du secteur public, il n y a pas de rgle
absolue pour ce qui est du secteur ou du sous-secteur o le recouvrement partiel des cots est
acceptable. La Banque ne dispose pas de politique, ni de directives pour les subventions.
3.7.10 L on prsume en outre qu une entit but lucratif du secteur public couvrira au moins la
majorit des cots de fourniture de ses biens ou services partir du produit de ses ventes ou des
recettes perues au titre du paiement de frais. Les entits gouvernementales qui demandent aux
usagers de payer un montant modeste ou nominale pour les services fournis ne sont gnralement pas
considres comme des organes d excution but lucratif. A cet gard, il y a lieu de citer l exemple
des frais exigs pour obtenir des copies des documents officiels (actes de naissance ou de mariage,
permis de conduire, etc.) ou des droits d entre dans des btiments/tablissements publics tels que les
muses ou les parcs, qui visent recouvrer une partie des cots, mais les entits concernes ne sont
gnralement pas considres comme des entits but lucratif. Le niveau du prix individuel ou
unitaire des biens ou services n est pas considr comme un principe directeur, car dans certains pays,
la poste par exemple est considre comme une entit but lucratif en raison du niveau substantiel de
ses recettes. Le facteur dcisif est plutt l intention de la politique gouvernementale de faire de l entit
concerne une entit but lucratif.
3.7.11 Une des tches initiales de l analyste financier consiste dterminer et documenter les
objectifs de la politique gouvernementale rgissant l organe d excution propos. Le succs de la
gestion financire d un organe d excution doit tre dtermin sur la base de sa capacit raliser les
objectifs de la politique qui la rgit, et non sur la base d ides prconues sur les rsultats qu une
entit d un secteur conomique particulier est capable d obtenir. La Banque peut tre d accord ou ne
pas tre d accord avec les objectifs de la politique rgissant l organe d excution. Si la Banque n est
pas daccord avec les objectifs de la politique gouvernementale rgissant l organe d excution, la
Direction de la Banque confiera la mission la responsabilit d engager le dialogue avec le
gouvernement sur cette politique, dans le cadre de l instruction du projet. De mme, la Banque peut
tre d accord avec la politique de tarification d un organe d excution but lucratif ou accepter une
telle politique dans un pays donn, sans tre dans l obligation d accepter une politique analogue
applique par un organe d excution but lucratif similaire dans un autre pays. A titre d exemple, le
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 29 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
subventionnement des prix d un produit de consommation (par exemple le riz) dans un pays faible
revenu peut tre accept par la Banque, mais des politiques de tarification similaires appliques par un
pays revenu intermdiaire peuvent tre juges inappropries.
3.7.12 D une manire gnrale, un projet gnrateur de revenu doit permettre l organe
d excution de parvenir la viabilit financire. La viabilit financire repose habituellement sur la
capacit gnrer un revenu suffisant pour couvrir les cots d exploitation et d entretien, renouveler
l actif, assurer le service de la dette, payer les dividendes sur les capitaux propres, s il y a lieu, et
financer une portion raisonnable des dpenses d quipement de l organe d excution partir des
fonds gnrs au niveau interne. Cette dfinition permet l organe d excution, en premier lieu, de
devenir autosuffisant et de parvenir une certaine autonomie dans ses activits quotidiennes,
encourageant ainsi l amlioration de la gestion, et en deuxime lieu de dcharger le gouvernement du
fardeau du versement de subventions l organe d excution, partir des rares fonds publics
disponibles, afin de lui permettre de fournir des biens ou services. Le niveau de ralisation de certains
objectifs financiers par un organe d excution but lucratif peut tre considr comme un moyen pour
stimuler l efficacit en matire de gestion. De mme, si la viabilit financire venait tre ignore, la
dynamique en faveur de la matrise des cots pourrait tre affaiblie, et mme disparatre.
3.7.13 Les organes d excution but lucratif doivent parfois gnrer un revenu additionnel pour
complter les ressources nationales destines l investissement. Toutefois, l exprience dans certains
PMR a montr que les pertes financires continuellement subies par de nombreux organes d excution
but lucratif ne font pas de ceux-ci des outils satisfaisants de mobilisation des ressources, sauf si le
gouvernement entend introduire un systme efficace de tarification et de recouvrement des recettes.
Les tarifs appliqus doivent conduire un niveau de performance financire permettant un organe
d excution but lucratif de fonctionner efficacement et de manire continue, sous rserve que le
recouvrement des recettes demeure efficace.
Projets non gnrateurs de revenu
3.7.14 L un des principaux objectifs d un projet non gnrateur de revenu est la ralisation des
objectifs financiers et conomiques fixs par le gouvernement. Ces objectifs sont gnralement de
trois ordres. Le premier vise permettre au projet de fournir les avantages prvus au cot le plus bas
estim lors de l valuation financire et conomique du projet. Le deuxime vise atteindre, dans les
oprations de l organe d excution, un degr d efficacit permettant d amliorer la gestion des phases
de mise en place et d exploitation du projet. Le troisime vise rduire au minimum le cot financier
pour le gouvernement, afin de rduire autant que possible le fardeau financier de la fourniture
continue des rares fonds publics disponibles. Tout comme dans le cas des projets gnrateurs de
revenu, l analyse financire des projets non gnrateurs de revenu est un outil cl de dfinition et de
mesure de la ralisation des buts et objectifs financiers.
3.7.15 Une fois de plus, l une des tches initiales de l analyste financier consiste dterminer et
documenter les objectifs financiers de l organe d excution. L analyste financier doit dterminer les
dossiers financiers tenir par l organe d excution pour faciliter la ralisation des objectifs fixs ou en
faire la dmonstration. Pour de nombreux projets non gnrateurs de revenu, il est ncessaire
d identifier les donnes non financires permettant de se prononcer sur la ralisation efficace des
objectifs du projet. Un exemple cet gard pourrait tre le nombre de personnes vaccines dans le
cadre d une campagne de vaccination. Dans ce cas, l indicateur d efficacit peut tre le cot moyen
par personne de la fourniture des services de vaccination.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 30 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Tarifs et recouvrement des cots
Prambule
3.7.16 Les politiques rgissant les tarifs et le recouvrement des cots reposent sur les plans
conomiques approuvs par le gouvernement. Les cots diffrentiels long terme peuvent tre
utiliss pour la fixation des tarifs, lorsqu il est tabli que le cot de l ajout d une unit additionnelle de
rendement est lev. La fixation des prix en fonction des cots diffrentiels long terme enverra un
signal aux consommateurs sur l augmentation attendue des cots de production et encouragera une
certaine prudence. Quand on continue consommer de grandes quantits des tarifs plus levs, cela
veut dire que les avantages marginaux continuent d tre suprieurs aux tarifs. Par dfinition, les cots
diffrentiels long terme doivent tre suprieurs aux cots du projet en cours. L utilisation de ce
mode de fixation des prix peut donc se rvler problmatique pour la tarification des biens publics. Ce
mode est utilis pour la fixation des prix de produits caractre plus commercial, par exemple le prix
de l nergie lorsque le cot de l extension des capacits de production de l nergie est lev, et les
dlais de construction plutt longs. Une approche plus pratique pourrait consister augmenter les
tarifs au fil du temps en vue d atteindre le niveau des cots diffrentiels long terme, mesure que
les capacits existantes sont pleinement utilises. Cette approche permet la fois de prvenir le
march de l augmentation des cots d extension et de runir des fonds pour contribuer aux cots
d extension des capacits. Une autre proccupation exprime au sujet de la fixation des prix sur la
base des cots diffrentiels long terme est que si les tarifs applicables dans ce cas sont jugs levs
par les consommateurs, ceux-ci peuvent mettre en place leurs propres systmes autonomes, par
exemple en creusant des puits dans leurs concessions pour l approvisionnement en eau ou en
acqurant des groupes lectrognes.
3.7.17 La Banque n a pas de politique, ni de directives en matire de subventions. Elle n a pas non
plus une rgle absolue en ce qui concerne les secteurs ou sous-secteurs o le recouvrement partiel des
cots peut tre acceptable. Toutefois, l objectif implicite de la Banque est de promouvoir l efficacit.
L analyste financier doit veiller ce que le recouvrement des cots repose sur le plus faible cot
conomique et financier permettant de garantir le plus haut niveau d efficacit de la performance.
L approbation d une politique de recouvrement des cots demandant l organe d excution de
recouvrer tous les cots supports pour le projet peut se traduire par des frais d un niveau indu ou peu
raisonnable, en particulier si l organe d excution est dans une situation de monopole. L assurance
doit tre donne que tous les cots sont supports au titre d oprations menes efficacement et que le
recouvrement des cots par le paiement de frais peu raisonnables sera vit.
3.7.18 Ces questions suscitent gnralement et juste titre des proccupations lorsque les
problmes techniques et les cots de mise en place et d exploitation des systmes de tarification
peuvent tre suprieurs aux avantages. L OCDE a publi un document utile concernant les bonnes
pratiques en matire de participation financire des usagers aux services gouvernementaux (section
7.23 du chapitre consacr la gestion des connaissances).
Politique de la Banque sur les tarifs
3.7.19 En 1985, la Banque a publi sa politique sur les tarifs et le recouvrement des cots. Bien des
annes plus tard, la plupart des conseils et orientations sur les tarifs et le recouvrement des cots
demeurent pertinents. L accent est essentiellement mis sur un niveau suffisant des recettes pour
financer les oprations et le service de la dette, sans peut-tre insister suffisamment sur la ncessit
d identifier une mthode de rduction des cots permettant d viter le recours l augmentation des
tarifs et des prix. Par ailleurs, la Banque compte sur les comptences et l exprience de son personnel,
ainsi que sur le recours des consultants expriments pour mettre au point des tarifs appropris
appliquer par des organes d excution but lucratif, et pour prsenter leurs conclusions et
recommandations dans les rapports d valuation.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 31 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Systmes de recouvrement des cots
3.7.20 En gnral, il y a deux options pour le plein recouvrement des cots, savoir la participation
financire des usagers aux produits et services (gnralement sur la base de frais structurs), et le
paiement de taxes sur les avantages directs (si possible) ou indirects par les bnficiaires du projet.
Les taxes sur les vhicules ou le carburant et les taxes foncires sont des taxes qui s appliquent
typiquement aux avantages.
3.7.21 La slection et l utilisation de mcanismes appropris doivent tre une question de
convenance pratique. C est le cas lorsqu on utilise un systme qui est dj en place et qui fonctionne
ou peut fonctionner sous rserve d un investissement minimal, en lieu et place de l application d un
principe. Dans le cas d un systme d approvisionnement en eau, le principe frquent est que les
consommateurs d eau des fins domestiques doivent payer pour l eau en fonction du niveau de leur
consommation. Toutefois, lorsque la pratique locale consiste recourir une taxe d eau sur la base de
la valeur de biens immobiliers et que cela permet de gnrer des recettes suffisantes, cette pratique
peut tre un mcanisme acceptable. Une taxe d eau base sur les biens immobiliers ne limite pas la
consommation d eau. En consquence, en cas de contraintes lies l offre et aux cots diffrentiels
long terme, le mcanisme de recouvrement adopt doit contribuer substantiellement la ralisation
des objectifs de prudence. Dans ce cas, la tarification base sur le niveau de consommation et la
restriction des investissements futurs concernant la consommation peuvent tre diffres. Cette
approche particulire requiert que (i) les systmes de compteurs soient efficaces ; (ii) les
branchements illgaux soient vits ; et (iii) la structure des tarifs limite efficacement les hauts
niveaux de consommation par une tarification plus leve de ceux-ci.
3.7.22 Lorsqu il est difficile de recouvrer pleinement les cots pour une activit telle que les
oprations d assainissement, des liens doivent tre tablis, dans la mesure du possible, entre cette
activit et les activits ou services apparents. Dans le cas de l assainissement, l activit principale est
l vacuation des eaux uses. Des liens peuvent tre tablis directement entre cette activit et la
consommation d eau. Une politique intgre de tarification visant recouvrer les cots de
l approvisionnement en eau et de l assainissement doit donc tre labore pour le plein recouvrement
des cots des deux systmes. Au nombre des autres activits apparentes, figurent les services
d lectrification rurale dans le cadre des systmes d irrigation, dont les cots peuvent tre recouvrs
dans la structure globale des tarifs par le biais des subventions croises, et les routes rurales dont les
cots peuvent tre recouvrs par l ajustement des taxes sur l importation ou l exploitation des
vhicules.
3.7.23 Dans certains cas, la fixation des prix des niveaux ne permettant pas de recouvrer
pleinement les cots, peut avoir des effets indsirables. Dans certains pays, la fixation des prix des
engrais en dessous du niveau permettant d en recouvrer les cots a entran une utilisation excessive
des engrais qui a favoris la pollution des sources d approvisionnement en eau. Cette pollution a cr
des problmes parce qu elle a ajout des cots additionnels au titre du traitement de l eau pour la
dbarrasser des produits chimiques pouvant nuire la sant humaine ou la sant animale, et parce
que les systmes d approvisionnement en eau en milieu rural sont dots de structures minimales de
traitement, compte tenu du fait qu ils taient gnralement implants loin des foyers de pollution
industrielle et que leurs cots taient ainsi abordables pour les consommateurs ruraux.
3.7.24 Les services publics privilgient parfois les prestations en faveur des couches plus nanties de
la population, en partie parce qu ils estiment que celles-ci pourront contribuer plus efficacement au
recouvrement des cots et que ces prestations et les services la clientle domestique sont
gnralement plus simples et plus rentables. Toutefois, les recherches menes sur la question montrent
souvent que les pauvres et les populations mal desservies payent leurs factures et continueront de les
payer, un niveau bien plus lev par litre, au regard des capacits dapprovisionnement en eau en
leur faveur, que cette eau soit fournie sous forme de bouteilles ou de citernes, ou qu elle soit fournie
par des vendeurs, par rapport au niveau support par les couches plus nanties de la population qui
disposent dj (bien qu en quantits insuffisantes) ou disposeront d un approvisionnement en eau
dans le cadre du projet envisag. En consquence, le principe d quit doit tre respect.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 32 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.7.25 Les avantages sociaux ne doivent pas tre sacrifis pour des convenances financires. Une
bonne conception des projets doit se traduire par une rpartition quitable des avantages, y compris
l utilisation des subventions croises, si ncessaire, pour fournir le plus d avantages possibles aux
couches les plus dmunies au sein de la population concerne.
Secteurs et services sociaux
3.7.26 Dans les secteurs fournissant des services sociaux, notamment les services de rduction de la
pauvret, les services de sant, les services d ducation, les services de vulgarisation agricole, etc., le
recouvrement des cots n est pas l objectif normalement vis, parce que ces services sont considrs
comme des services publics financs par les contribuables en gnral. Il est probable que cette
pratique se poursuive pendant de nombreuses annes encore, notamment en faveur des populations les
plus pauvres, mais des pressions accrues sur les budgets nationaux peuvent aboutir l introduction
des nouvelles formes de participation financire des usagers. Certains mcanismes de recouvrement
des cots peuvent tre introduits pour rduire les dficits budgtaires, mais le paiement d autres frais
peut tre institu pour limiter la demande de services superflus ou non indispensables, ou pour
rorienter la demande vers les services d un cot abordable pour une partie de la population.
Toutefois, tant donn que son institution aura probablement pour effet de rduire la demande, la
participation financire des usagers doit tre conue trs soigneusement. A cet gard, des tudes sur le
revenu et des enqutes sociales peuvent s avrer ncessaires pour identifier les lments des services
et les groupes de population cibler.
3.7.27 L valuation de la participation financire des usagers et les mthodes de recouvrement des
recettes doivent tre examines dans la perspective de la faisabilit et des cots des systmes, dans le
cadre des analyses de rentabilit, en vue de la dtermination de la viabilit de ces systmes. La
comparaison de la demande, de l offre et des cots des systmes en place, ainsi que des systmes
parallles installs par le secteur priv pour fournir des services similaires, peut servir de base aux
tests de validit des tudes. A titre d exemple, les tablissements d enseignement du secteur priv, qui
exigent le paiement de frais de scolarit, rivalisent parfois avec ceux du secteur public, qui peuvent
offrir des enseignements de moindre qualit en raison du manque de fonds. L valuation de la
demande probable d tablissements publics de niveau quivalent peut confirmer la faisabilit de
l introduction du paiement de frais de scolarit pour certains services ou l ensemble des services
offerts dans une filire de formation donne, sans trop de problmes, en particulier si les contraintes
portent sur le manque d installations et non sur le caractre limit des ressources des consommateurs.
3.8 PREPARATION DES PREVISIONS FINANCIERES
Introduction
3.8.1 La prparation des prvisions relatives la performance financire est une tche qui n est
pas aise pour l analyste financier. Les dossiers sur la performance financire antrieure peuvent ne
pas tre jour, peuvent ne pas tre fiables ou peuvent ne pas tre du tout disponibles, ce qui rend
difficile l laboration d un modle de prvisions sur la base de la performance financire antrieure.
En dpit de ces difficults, l analyste financier doit produire les informations financires utiles pour le
projet et, s il y a lieu, l organe d excution, sur une priode de temps permettant la Direction de la
Banque et l emprunteur de se prononcer sur la viabilit financire du projet envisag. En prenant
une dcision ce sujet, il peut tre ncessaire de dterminer la performance financire minimale
requise pour garantir la viabilit du projet. Les mesures prendre pour obtenir cette performance
financire minimale devront tre convenues avec l emprunteur et pourront faire l objet d avenants
l accord de prt. Il n est pas de l intrt de l emprunteur, ni de celui de la Banque que l analyste
financier fasse des prvisions attrayantes sur la performance financire en vue de la soumission du
projet au Conseil d administration de la Banque, alors qu il y a des indications qu une telle
performance financire ne sera probablement pas ralise. Des prvisions financires trop optimistes
sont malheureusement trop souvent associes l chec des projets.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 33 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.8.2 Bien qu il soit impossible de savoir avec prcision ce qui va se passer l avenir, il incombe
toujours l analyste financier la responsabilit d anticiper les questions financires, conomiques et
politiques susceptibles d avoir un impact sur la performance du projet. Lorsque la probabilit que les
vnements prvus se produisent effectivement est leve, il est ncessaire que cela soit reflt dans
les prvisions financires et que cela soit expressment indiqu dans les hypothses retenues. Lorsque
cette probabilit est faible, il est ncessaire d en reflter le seuil dans les tats financiers. En tout tat
de cause, l impact potentiel doit tre test dans le cadre de l analyse de sensibilit. En outre, les
mesures d attnuation prendre pour viter ou minimiser l impact ngatif potentiel doivent tre
identifies et mises en place. Si d autres mesures sont ncessaires l avenir, elles doivent faire l objet
d avenants l accord de prt.
Normes de comptabilit financire
3.8.3 Les tats financiers des projets gnrateurs de revenu et des organes d excution but
lucratif, qui sont prsents dans les rapports d valuation tablis par la Banque, doivent tre
confectionns conformment aux Normes internationales en matire d tablissement de rapports
financiers (IFRS) et/ou au Normes comptables internationales (IAS). Toutefois, lorsque les tats
financiers sont tablis sur la base de normes comptables locales, les commentaires ou les notes en bas
de page doivent identifier tout cart par rapport aux IFRS/IAS et indiquer son impact sur les tats
financiers. Les avenants financiers aux accords de prt doivent galement tre normalement bass sur
les IFRS/IAS.
3.8.4 Pour un organe d excution dont les pratiques comptables ne sont pas conformes aux
IFRS/IAS, ni aux pratiques comptables gnralement admises (PCGA) dans un pays, bien que juges
acceptables par la Banque, ou lorsque les PCGA ne conviennent pas pour les besoins de prsentation
de l analyse financire, les donnes disponibles et les prvisions doivent tre prsentes la discrtion
raisonnable du personnel. Lorsque la prsentation s carte des procdures en vigueur de l organe
d excution, le rapport doit expliquer les changements oprs. En cas de recours extensif au
retraitement, il peut se rvler impossible, au cours de la phase de supervision du projet, de comparer
les tats financiers rels avec les prvisions, sans prparer une srie supplmentaire de prvisions
tenant compte des pratiques comptables de l entit concerne. Ces prvisions doivent tre incluses
dans le dossier du projet.
3.8.5 Les normes comptables appliques par les projets non gnrateurs de revenu doivent tre
compares avec les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). Dans la plupart des
cas, la comparaison se fera sur la base de la mthode de la comptabilit de caisse, qui utilise les
IPSAS. Les organes d excution des projets non gnrateurs de revenu doivent tre encourags
indiquer les diffrences entre les normes comptables nationales et les IPSAS, le cas chant, dans les
notes accompagnant les tats financiers.
Dtermination de la couverture de la priode financire
Projets gnrateurs de revenu
3.8.6 Pour les projets gnrateurs de revenu et leurs organes d excution, l analyse financire doit
tre base sur une priode raisonnable permettant de confirmer la situation financire antrieure et la
performance antrieure de l organe d excution en matire d exploitation. La situation et la
performance financires actuelles sont aussi des indicateurs utiles permettant de dterminer l aptitude
et la capacit de l organe d excution excuter le projet. Sur la base des informations recueillies sur
la performance antrieure et actuelle, des prvisions doivent tre prpares sur la situation et la
performance financires probables au cours de la phase d excution du projet et pendant une priode
significative d exploitation aprs la rception du projet. Il devrait particulirement en tre ainsi
lorsque l organe d excution est appel excuter et exploiter le projet tout en poursuivant ses
oprations en cours, par exemple l exploitation d une centrale lectrique existante pour
l approvisionnement en lectricit ou l exploitation d un systme d approvisionnement en eau et
d assainissement.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 34 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.8.7 Il n y a pas de priodes spcifiques pour la mesure de la performance. La priode retenir
pour chaque projet et chaque organe d excution doit tre slectionne sur la base du jugement de
l analyste financier quant la priode (ou aux priodes) susceptible(s) de fournir le plus
d informations pour une justification correcte et fiable du projet. Les prvisions doivent normalement
continuer tre faites jusqu ce que l on atteigne un rgime de croisire qui indique que les
installations du projet sont dj normalement exploites. En rgle gnrale, il est peu probable qu une
priode de moins de deux ans de performance effective (avec audit), incluant la priode prcdant
immdiatement l excution du projet, la priode d excution du projet et une priode de pas moins de
trois ans de pleine exploitation aprs la rception dfinitive du projet, fournisse un chantillon
satisfaisant et fiable. S il est prvu, au cours de la dure du prt, des changements substantiels dans la
performance financire, susceptibles d avoir un grave impact sur le rgime de croisire, le texte
accompagnant les prvisions doit discuter spcifiquement de l impact de tels changements sur la
situation financire de l organe d excution. Si possible, les prvisions doivent tre tendues pour
couvrir les facteurs l origine de ces changements.
3.8.8 Certains projets prsentent de srieux facteurs de risque. Il en est ainsi des projets de forage
pour l exploitation des eaux souterraines ou du ptrole, ou encore du gaz. Ces types de projets
prvoient habituellement une srie de tests importants (tests sismiques ou forage de puits titre
d essai, etc.) qui sont effectus de prfrence avant la fourniture du financement par la Banque.
Toutefois, mme avec de tels tests, le volume d eau disponible ou la taille des gisements de ptrole ou
de gaz peut ne pas tre connu jusqu ce que le programme de forage prvu soit au moins
partiellement achev. Ces types de projets prsentent de hauts niveaux de risque et ncessitent des
tests minutieux de sensibilit concernant les divers produits attendus des dpenses d investissement,
ainsi que des tests de sensibilit concernant les rendements. Inversement, d autres types de projets
peuvent tre rceptionns dans un dlai d un deux ans aprs le dbut de la phase d excution. Il est
habituellement ncessaire de faire des prvisions financires sur le projet achev, sur une priode
incluant au moins trois annes de pleine exploitation du projet. En consquence, la priode faisant
l objet d une analyse dtaille peut s taler sur 10 12 ans et mme plus (y compris deux ans pour la
priode de performance antrieure, l anne en cours, cinq six ans pour l achvement du projet et
trois ans aprs l achvement du projet), jusqu ce que l on atteigne le rgime de croisire.
3.8.9 Certains projets comportent des composantes dont la dure d excution est longue. C est le
cas par exemple des projets de construction de barrages hydrolectriques et des projets forestiers. Pour
de tels projets qui peuvent prendre de nombreuses annes avant d atteindre un niveau normal
d exploitation (par exemple 15 20 ans pour les projets forestiers), il est acceptable de fixer une
limite de deux cinq ans pour la priode des prvisions concernant l ensemble de l entreprise, partir
de l achvement du projet, mme si un niveau normal d exploitation n est pas encore atteint.
Projets non gnrateurs de revenu
3.8.10 Normalement, pour les projets non gnrateurs de revenu, l analyse financire doit porter
uniquement sur les besoins financiers du projet proprement dit. Cette analyse est axe sur le plan de
financement et les cots d exploitation sur une priode d au plus cinq ans aprs l achvement du
projet. A moins que l organe d excution ne soit galement soumis des rformes concernant sa
performance financire, dans le cadre du projet, il n est pas ncessaire de fournir des donnes sur la
performance antrieure, moins que ces donnes ne soient essentielles pour la justification du projet.
De mme, la performance future doit normalement tre axe sur l excution du projet et inclure
uniquement les cots supporter par l organe d excution partir du financement mobiliser, afin de
garantir le succs de l excution du projet. Il n y a pas de prsentation standard de l analyse financire
de la vaste gamme de projets non gnrateurs de revenu et d organes d excution but non lucratif.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 35 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Prix courants, prix rels et prix constants
Prix courants
3.8.11 Les prvisions, sous forme de projections financires annuelles pour la priode d excution
du projet et pour la priode ncessaire pour atteindre le rgime de croisire, doivent tre faites sur la
base des prix historiques (courants). Cela doit tre clairement indiqu dans les tableaux. L anne
d valuation est l anne de base pour les projections. Les prvisions en termes courants sont
gnralement bases sur les mmes hypothses de prix que le cot estimatif du projet, au moins
pendant toute la dure de la phase de construction, dans la mesure o ces hypothses sont pertinentes
pour la main-d uvre, les biens et les services concerns. Les hypothses de prix appropries doivent
tre faites pour les lments non pris en compte dans le cot estimatif du projet ou dont les prix
doivent tre fixs sur des bases diffrentes. Ces prvisions doivent tre faites sur la base des diffrents
scnarios envisags pour illustrer tout un ventail d vnements et d incertitudes pouvant intervenir
l avenir, de mme que les forces qui sont susceptibles de les faonner. Cela est particulirement vrai
pour les projections concernant les recettes, parce que dans certains secteurs industriels : (i) le
rendement est subordonn la concurrence sur le march, et l hypothse que les recettes vont
augmenter d une manire conforme la tendance gnrale de la hausse des prix mrite d tre
examine soigneusement pour des besoins de validit ; (ii) les prix des produits sont rglements par
les pouvoirs publics ou par des organismes publics tels que les socits publiques d lectricit et d eau
ou les autorits portuaires ; et (iii) la hausse des prix peut tre subordonne l approbation des
autorits politiques, par exemple un organe lgislatif, ou tre autrement influence par les autorits
politiques. Plusieurs tests de sensibilit des projections de recettes doivent tre effectus, et les
hypothses retenues doivent tre discutes d une manire approfondie, tandis que des conclusions
doivent tre convenues et des mesures d attnuation prises pour rduire au minimum les risques, si
possible en incluant des avenants spcifiques garantissant un flux suffisant de recettes.
Prix rels
3.8.12 Lorsque l analyse est effectue en termes rels, son utilisation doit tre pleinement justifie.
Les changements relatifs intervenant dans les prix, du fait des effets diffrentiels des changements
intervenant dans les prix et les taux d inflation de certaines rubriques particulires de dpenses et dans
les flux de recettes, peuvent ne pas tre pris en compte lorsque l on utilise les termes rels. Cela peut
entraner des distorsions dans les tats des flux de trsorerie. Par contre, pour les prvisions en termes
courants, l analyste financier doit mettre des jugements spcifiques sur de tels effets. En
consquence, il est prfrable de faire des prvisions en termes de prix courants.
Prix constants
3.8.13 Lorsque l organe d excution opre dans un contexte national caractris par l ajustement
des cots et/ou des recettes en fonction des taux d inflation, ou dans les pays o la fluctuation des
cours et des taux de change des devises est trs irrgulire, des prvisions bases sur les prix constants
peuvent tre utilises, sous rserve que l impact de leur conversion aux prix courants, en particulier en
ce qui concerne les flux de trsorerie, soit dmontr. Chaque fois que les prix constants sont utiliss,
l analyse de sensibilit doit s appliquer aussi bien aux flux de recettes qu aux flux de cots pour ce
qui est de l impact des changements significatifs intervenant dans les prix, notamment lorsque le
projet est redevable d une dette libelle en devises.
Utilisation d une devise stable
3.8.14 Les prvisions doivent normalement tre faites en monnaie locale, sauf lorsque la monnaie
locale est instable, par exemple en raison de niveaux levs et irrguliers des taux d inflation, auquel
cas l utilisation des prix constants peut tre remplace par l utilisation, pour la dtermination des
prvisions, d une monnaie stable sur laquelle reposent systmatiquement les relations du pays
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 36 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
emprunteur concernant le march montaire et le change. Cette autre mthode permet de prparer les
prvisions aux prix courants, sur la base d une monnaie stable, par exemple le dollar des Etats-Unis.
L utilisation de la devise concerne, des taux d inflation dans les pays trangers et des taux de change
appliqus pour convertir les cots locaux sur la base de la devise concerne, doit tre justifie dans le
rapport dvaluation. L analyse de sensibilit portant sur le taux de change utilis et sur les cots
diffrentiels au titre de l inflation doit tre applique et explique.
Rcapitulation des tats financiers
3.8.15 Dans le rapport dvaluation, les projections concernant le bilan, le compte de rsultat et
l tat des flux de trsorerie de l entit charge du projet doivent tre refltes dans les tableaux
rcapitulatifs, afin de permettre une comparaison entre les donnes antrieures et les prvisions et de
faciliter l identification des tendances. Les donnes doivent tre conformes aux prvisions concernant
la demande et les dcaissements, prsentes dans d autres sections du rapport. Etant donn que la
prsentation et l interprtation des chiffres pour les priodes au cours desquelles sont enregistrs des
changements dans les prix et les taux d inflation sont la fois difficiles et risques, le personnel doit
aider les lecteurs, chaque fois que cela est possible, en (i) indiquant les tendances sous-tendant les
donnes, en particulier lorsque ces tendances peuvent tre dissimules par des taux substantiels
d inflation, et en (ii) dcrivant les rsultats de l analyse de sensibilit des tendances sous-jacentes.
3.8.16 Les tableaux rcapitulatifs doivent tre insrs au niveau des sections correspondantes du
rapport d valuation. La performance antrieure, actuelle et future, et les donnes sur la situation qui
prvaut peuvent tre combines dans un mme tableau rcapitulatif. L utilisation de tableaux
rcapitulatifs ne doit pas tre remplace par des tableaux dtaills qui sont annexs au rapport
d valuation, lorsque ces derniers sont ncessaires pour la diffusion d informations importantes pour
appuyer un projet et le prt y affrent. Inversement, la prsentation de longs tableaux rcapitulatifs
dans la section financire du rapport d valuation, tableaux couvrant la performance antrieure et
future sur une priode de nombreuses annes, peut crer une certaine confusion chez les lecteurs. La
prsentation optimale est celle qui fournit le maximum de donnes dans le plus petit espace, sans
cependant sacrifier l exactitude et la comprhension.
3.8.17 La section 7.26 du chapitre des prsentes Directives consacr la gestion des connaissances
fournit des modles de projections financires et de rapports de fin d anne pour les rubriques
suivantes : le compte de rsultat, le bilan et l tat des flux de trsorerie. Ces modles conviennent aux
entits spcialises dans la fourniture des services et aux entits spcialises dans la transformation, et
doivent tre adapts convenablement en fonction de la nature de chaque projet ou de chaque organe
d excution.
Comptes de rsultat
3.8.18 Les questions suivantes doivent tre prises en compte lors de la prparation des comptes
dtaills de rsultats : (i) les donnes pour chaque anne doivent tre rparties entre les donnes
relles et les donnes des prvisions ; (ii) la prsentation doit normalement tre conforme au format
des rapports comptables et financiers, adopt par l organe d excution ; et (iii) la prsentation des
recettes d exploitation et des cots d exploitation varie considrablement en fonction des secteurs,
mais elle doit donner des informations dtailles sur les types de recettes et de cots que l on
rencontre dans le secteur concern.
3.8.19 Au moins les informations et analyses suivantes doivent tre fournies dans le compte de
rsultat :
Le volume unitaire: La base des prvisions concernant le volume doit tre dcrite, et
un lien doit tre tabli entre cette base et la capacit de production de l organe
d excution et la demande sur le march ;
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 37 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Les recettes d exploitation: il convient de dcrire les changements importants
intervenus antrieurement et prvus dans les prix de vente, les tarifs et la
composition du chiffre des ventes ;
Les cots d exploitation: Il est ncessaire d analyser les tendances antrieures et de
prciser les hypothses retenues pour les projections concernant chaque catgorie de
cot d exploitation (par exemple, l examen des effectifs et des comptences du
personnel et des cots unitaires ; les tendances prvues du cot des biens et
services ; ou les pourcentages des recettes ou de l actif, lorsqu ils servent de base
approprie pour les prvisions) ;
Les taux d amortissement: Ces taux peuvent tre considrs comme des
informations utiles pour le bilan ;
La section hors exploitation: Elle dcrit les expriences antrieures significatives et
prsente les hypothses sur lesquelles reposent les prvisions concernant les autres
recettes et dpenses. Elle permet d tablir un lien entre les prvisions concernant le
paiement d intrts et la portion du prt non encore rembourse ;
Les impts sur le revenu: Ils fournissent une base pour les charges fiscales au titre
de l impt sur le revenu. Dans les services publics ou dans d autres secteurs o
l impt sur le revenu est normalement prsent comme un lment des cots
d exploitation, la prsentation du tableau doit en tenir compte ; et
L affectation du rsultat net: Elle fournit la base des affectations antrieures et des
hypothses retenues pour le paiement des dividendes l avenir, etc..
3.8.20 Quelques ratios sont utiles pour analyser les informations fournies dans le compte de
rsultat : les taux de croissance ; la marge bnficiaire brute, en tant que pourcentage des recettes ; le
ratio d exploitation ; le bnfice d exploitation ou le rsultat net, en tant que pourcentage des recettes ;
le rsultat net, en tant que pourcentage des recettes ; et le rendement du capital moyen investi (voir la
section 7.20 du chapitre des prsentes Directives consacr la gestion des connaissances).
Bilans
3.8.21 Les lments suivants doivent tre pris en compte dans la prparation du bilan dtaill :
Les donnes pour chaque anne : Il est ncessaire de prciser s il s agit de donnes
relles ou de prvisions.
L excdent de disponibilits : Lorsque l hypothse retenue est que des montants de
fonds peuvent tre cumuls et servir au financement d autres projets
d investissement ou au paiement de dividendes, le bilan prvisionnel doit prsenter
sparment de telles disponibilits.
Le passif long terme : Il doit tre prsent en dtail, si ncessaire, en faisant une
distinction entre le passif en monnaie locale et le passif en devises. La tranche long
terme exigible court terme doit tre dduite et prsente dans la rubrique du passif
court terme.
L actif et le passif court terme: Le niveau requis pour le fonds de roulement
dpend des pratiques de l entit en la matire, ainsi que de tous changements
imposs par le projet. Le niveau requis pour les disponibilits oprationnelles doit
tre prcis, et des explications doivent tre fournies pour justifier les projections
concernant l excdent ou le dficit de disponibilits.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 38 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
L actif incorporel et les investissements long terme : La base des prvisions doit
tre prcise, en particulier l valuation de l cart d acquisition d autres entits
d excution ou la justification de la ralisation et de l utilisation des investissements
long terme.
Les immobilisations : La base de l estimation des acquisitions venant renforcer les
immobilisations dans le cadre du programme de construction, de la rvaluation de
l actif et de tout rachat prvu de biens, doit tre conforme aux IFRS/IAS, autrement
des explications doivent tre fournies pour justifier cette base. Les transferts des
dpenses d investissement la rubrique installations en cours de construction et
la rubrique installations oprationnelles peuvent tre bass sur l hypothse qu un
certain pourcentage des dpenses d investissement est rserv aux installations
oprationnelles pour chaque anne. Dans certains autres cas, les transferts peuvent
tre bass sur un calendrier dtaill indiquant les dates dachvement de la
construction des diffrents lments de l actif. Il est souvent utile d tablir un
calendrier subsidiaire pour le bilan, calendrier indiquant les transferts des dpenses
d investissement la rubrique des installations en cours de construction et la
rubrique des installations oprationnelles, de mme que la base de ces transferts.
L amortissement cumul : Les taux et les bases de l amortissement doivent tre
indiqus. Sinon, ils peuvent tre prsents dans le compte de rsultat ou dans
l annexe relative aux hypothses retenues. Des explications doivent tre fournies sur
tout changement substantiel dans les montants cumuls (par exemple la suite de la
rvaluation de l actif).
3.8.22 Les ratios ayant trait au bilan sont notamment le ratio de rotation de l actif, les taux de
croissance, le ratio de liquidit relative, le ratio de liquidit gnrale, la dette en tant que pourcentage
de l activation totale, le taux de rendement des immobilisations nettes en exploitation, les comptes
clients exigibles sur une base quotidienne, l inventaire excuter sur une base quotidienne et l actif
corporel en tant que pourcentage du passif long terme (voir la section 7.20 du chapitre des prsentes
Directives consacr la gestion des connaissances).
Etats des flux de trsorerie
3.8.23 Les tats des flux de trsorerie classifient les flux de trsorerie, au cours de la priode
concerne, en tablissant une distinction entre les activits d exploitation, d investissement et de
financement. La Banque prfre que les flux de trsorerie soient prpars en utilisant la mthode
directe
6
. Lorsque cette mthode est utilise, une note rapprochant l excdent net et les flux de
trsorerie nets relatifs l exploitation doit tre prpare.
3.8.24 Au nombre des questions qu il peut se rvler ncessaire de prendre en considration dans la
prparation des tats des flux de trsorerie, figurent notamment les suivantes :
Les donnes pour chaque anne : Il est ncessaire de prciser s il s agit de donnes
relles ou de prvisions.
La colonne des totaux : Afin de rapprocher l tat du plan de financement, une
colonne des totaux doit tre insre pour la prsentation des montants totaux des
flux de trsorerie au cours de la priode d excution du projet.
6
La mthode directe consiste prsenter directement les diffrentes composantes des flux de trsorerie, par
exemple les encaissements et les paiements en faveur du personnel et des fournisseurs, au lieu de les dterminer
sur la base du compte de rsultat et du bilan.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 39 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Les dpenses d investissement : Les rubriques suivantes doivent tre prsentes
sparment : (i) les dpenses totales au titre de l actif ; (ii) les frais financiers
encourus au cours de la phase de construction (FCDC) ; et (iii) le fonds de
roulement, en particulier pour les projets industriels et les projets de transformation
de dmarrage. La distinction entre la rubrique (i) et la rubrique (iii) doit faciliter le
rapprochement entre les montants figurant dans le tableau des cots du projet et les
montants figurant dans le plan de financement prsent dans le rapport d valuation.
Les emprunts : Les donnes relatives aux prts accords par la Banque doivent
figurer dans le(s) tableau(x) des dcaissements prsent(s) dans le rapport
d valuation. L estimation des fonds disponibles auprs dautres sources doit tenir
compte des informations figurant dans les discussions relatives au plan de
financement. Dans le cas d un financement plus complexe, le tableau de
financement doit tre accompagn d un calendrier complmentaire indiquant les
prvisions en matire de dcaissements des autres prts et des autres apports de
capital.
Les prts court terme pour le financement du fonds de roulement : Les niveaux
requis pour le fonds de roulement peuvent tre prsents sans inclure les prts
court terme, auquel cas une note doit tre insre en bas de page pour prciser le
montant du financement court terme attendu. Par contre, un tel financement
court terme peut tre prsent sparment, en tant que source de fonds, en prenant
alors soin d augmenter en consquence les niveaux requis pour le fonds de
roulement.
Le service de la dette : Les prvisions concernant le paiement effectif des intrts et
le remboursement de la dette doivent tre conformes aux conditions de la dette
expliques dans les notes accompagnant le bilan. S il s agit de plusieurs prts, l on
peut recourir un calendrier de paiement des intrts dbiteurs et de remboursement
de la dette. Le paiement d intrts doit se faire sans tenir compte des frais financiers
encourus au cours de la phase de construction (FCDC).
Les apports de capital : Selon les besoins, ces apports doivent tre rpartis en
fonction de leurs sources : les actionnaires, le gouvernement et les consommateurs,
le cas chant. Les sources de mobilisation des ressources destines au projet
comprennent les fonds provenant des bnfices non rpartis.
Les disponibilits: Les disponibilits doivent inclure un montant estimatif pour faire
face aux besoins oprationnels. S il est prvu des excdents de disponibilits, par
exemple la suite d emprunts anticips long terme, les soldes peuvent tre ajouts
la rubrique investissements court terme, afin d tablir une distinction entre les
besoins en disponibilits oprationnelles et les besoins tactiques, caractre plus
financier. Il est conseill de recourir la rubrique des investissements court terme
lorsque les soldes des excdents de disponibilits sont d un niveau important et les
intrts crditeurs substantiels. Les emprunts court terme qui relvent de la
rubrique passif de complment, peuvent tre utiliss lorsque les besoins de
financement sont temporairement suprieurs aux sources de fonds.
3.8.25 Les ratios gnralement associs aux tats des flux de trsorerie sont les suivants : (i) la
couverture du service de la dette ; (ii) les taux de croissance ; et (iii) le pourcentage des dpenses
d investissement financ par des sources internes (voir la section 7.20 du chapitre des prsentes
Directives consacr la gestion des connaissances).
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 40 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Autres hypothses
3.8.26 Pour les prvisions financires, les analystes doivent retenir certaines hypothses, mme si
autant de facteurs que possible, dans une analyse, doivent tre bass sur les donnes issues de la
recherche et les donnes manant de la performance empirique relle. Lorsque le projet est un nouvel
investissement supplmentaire tel que l extension de la capacit de production d une centrale de
production d lectricit qui existe dj, des donnes sont disponibles sur la gestion et les niveaux
d efficacit de la centrale en question. Ces donnes fournissent une base solide pour l hypothse
retenir pour les prvisions. Toutefois, s il s agit d un projet totalement nouveau, plusieurs hypothses
doivent tre retenues lors de la conception et de l analyse de ce projet pour ce qui est du cot, de la
qualit et de la quantit des intrants, pour des raisons lies la fois l investissement et
l exploitation et l entretien. En consquence, il est ncessaire que l analyste financier indique toutes
les hypothses retenues, ainsi que la date des donnes de base. Lorsqu une hypothse donne est
cruciale pour l analyse et peut-tre de nature contentieuse, la base du raisonnement au titre de cette
hypothse doit tre indique, et les raisons ou les bases de son adoption doivent tre prcises dans le
rapport dvaluation. Toutes les hypothses et toutes les sources des donnes doivent faire l objet d un
rsum annex au rapport d valuation, ainsi que d informations dtailles incluses dans le dossier du
projet.
3.9 AVENANTS AUX ACCORDS DE PRETS
Introduction
3.9.1 L entre en vigueur des accords de prts est subordonne la satisfaction, par les
emprunteurs, des dispositions des Conditions gnrales applicables aux accords relatifs aux prts
octroys ou garantis par la Banque. Ces conditions gnrales ont t publies sparment par le
Bureau du Conseiller juridique gnral des services juridiques (GECL) et ne sont pas discutes dans
les prsentes Directives. En plus des conditions gnrales, le GECL traduit les politiques, les buts ou
les objectifs convenus en avenants, sous forme de conditions pralables au premier dcaissement du
prt ou d autres conditions. Les avenants financiers discuts dans les prsentes Directives relvent de
ces deux dernires catgories de conditions.
3.9.2 Pour aider les organes d excution atteindre leurs objectifs financiers et pour raliser les
objectifs conomiques gouvernementaux, notamment en contribuant la stratgie nationale de
dveloppement et la stratgie gouvernementale de rduction de la pauvret, la Banque veut s assurer
que pour les projets qu elle finance grce l octroi de prts, les objectifs oprationnels de l organe
d excution concern, tels que convenus avec l emprunteur, seront effectivement raliss, au moins
pendant la dure de vie du projet. Les avenants visent : (i) amliorer la performance financire de
l entit concerne ; et (ii) garantir l utilisation efficace de l investissement, y compris le produit du
prt octroy par la Banque. Ces avenants, tels que viss dans l accord de prt, sont tablir
conformment aux politiques de la Banque, et leur nature peut varier. Les avenants couvrent souvent
des questions techniques ou des questions lies la performance sociale et conomique, en plus des
questions lies la performance financire.
3.9.3 Dans la Dclaration de Paris sur l efficacit de l aide (section 7.3 du chapitre consacr la
gestion des connaissances), les bailleurs de fonds se sont engags : (i) fixer les conditions, chaque
fois que cela est possible, sur la base de la stratgie nationale de dveloppement d un partenaire ou de
sa revue annuelle des progrs accomplis dans la mise en uvre de cette stratgie, tant entendu que
d autres conditions peuvent tre fixes uniquement lorsqu elles sont dment justifies, auquel cas
elles doivent tre satisfaites dans la transparence et en troite consultation avec les autres bailleurs de
fonds et les autres parties prenantes ; et (ii) associer le financement un cadre unique de conditions
et/ou une srie grable d indicateurs fonds sur la stratgie nationale de dveloppement. Cela ne
veut pas dire que tous les bailleurs de fonds ont des conditions identiques. Les conditions de chaque
bailleur de fonds doivent plutt tre fondes sur un cadre commun intgr visant obtenir des
rsultats durables.
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 41 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
3.9.4 Le processus de slection des avenants appliquer aux accords tablis aprs la publication
de la Dclaration de Paris est ax plus clairement sur la ralisation de la stratgie nationale de
dveloppement ou des objectifs de rduction de la pauvret, et moins sur la viabilit financire des
organes d excution et des projets, pris individuellement, en tant qu objectif en soi. Sans cependant
exclure les avenants relatifs la gestion financire et applicables individuellement un organe
d excution, les questions relatives aux politiques, par exemple la question de la pertinence des
subventions, devraient tre rsolues un niveau sectoriel ou un niveau national, et ne devraient pas
concerner spcifiquement un organe d excution. Les avenants financiers peuvent viser s assurer
que des subventions sont promptement payes et sont prises en compte dans l valuation des
encaissements en vue de la ralisations des autres objectifs fixs dans l avenant financier. Par ailleurs,
il est ncessaire de promouvoir la coordination et la communication avec les autres bailleurs de fonds
intervenant dans le mme secteur, afin de parvenir un accord sur les questions de politiques
applicables l organe d excution concern, ainsi que sur les types d avenants et les dfinitions
applicables ces avenants. Le fait de reconnatre que les avenants de tous les bailleurs de fonds ne
doivent pas ncessairement tre identiques ne signifie pas que les avenants appliqus par les diffrents
bailleurs de fonds peuvent se contredire.
3.9.5 A la suite du Forum de haut niveau de Paris sur le programme d harmonisation, le Groupe
de la Banque a labor le Plan d action sur l harmonisation, l alignement et la gestion axe sur les
rsultats (plan rvis en octobre 2005), dans lequel il s engage collaborer avec les autres BMD,
ainsi qu avec les bailleurs de fonds bilatraux pour simplifier et harmoniser les politiques, les
procdures et les exigences, et pour rduire les cots y affrents par l alignement de l appui sur les
stratgies de rduction de la pauvret, arrtes par les pays eux-mmes, et sur les autres cadres mis en
place au niveau des pays.
3.9.6 Les avenants relatifs la performance financire peuvent tre classs globalement en deux
catgories : les avenants relatifs aux systmes financiers et de gestion, et les avenants relatifs la
performance financire proprement dite. Les avenants relatifs aux systmes financiers et de gestion
couvrent habituellement des questions spcifiques telles que les pratiques en matire de vente et de
commercialisation, le contrle des inventaires, la mise en place et l utilisation de systmes de
comptabilit et de chiffrage, le contrle des cots de la main-d uvre et des matriaux, la
planification stratgique et financire, les systmes de budgtisation, etc.. Pour leur part, les avenants
relatifs la performance financire proprement dite visent :
Appuyer le dveloppement socioconomique ;
Promouvoir la viabilit financire, de mme quune performance financire
satisfaisante et une gestion financire prudente d une entreprise donne ;
Renforcer les capacits locales dans la gestion du projet sans assistance extrieure,
non seulement dans des conditions normales, mais aussi dans un environnement peu
favorable d exploitation ou de commercialisation ;
Servir de base au suivi de la performance financire de l entreprise, assurer par les
autorits de rglementation mises en place par le gouvernement, ainsi que par la
Banque ;
Aider l entreprise atteindre le niveau voulu de solvabilit afin de faciliter son
acceptation sur les marchs financiers ;
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 42 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Protger les intrts financiers de l emprunteur et de la Banque.
3.9.7 Les entreprises du secteur public fournissent souvent des services aux groupes faible
revenu ou un cot infrieur au cot financier ou conomique de tels services, dans le cadre de la
stratgie nationale de rduction de la pauvret. Cela soulve la question de savoir si (i) une entreprise
ou un secteur doit assumer la responsabilit des subventions croises ; (ii) le gouvernement doit
financer les cots par l octroi de subventions l entreprise concerne ou alors directement aux
bnficiaires ; et si (iii) l entreprise en question doit tre autorise fixer des cibles financires
infrieures, en tenant compte de l incapacit de certains usagers faire face aux cots rels et/ou
diffrentiels. Dans ce dernier cas, la fixation de cibles financires infrieures ne doit pas normalement
tre acceptable. Si les cibles financires sont fixes dans cette optique, leur abaissement un niveau
infrieur ne peut que compromettre la capacit future de l entreprise fournir des services ou produits
de qualit tous les consommateurs. Pour qu une entit publique puisse raliser tous les objectifs qui
lui sont assigns, au titre de la stratgie nationale de dveloppement ou de la stratgie de rduction de
la pauvret, elle doit avoir un fonds de roulement lui permettant de maintenir une bonne sant
financire. Le montant des subventions qu un gouvernement souhaite octroyer directement ou
indirectement (par exemple par l intermdiaire des entreprises publiques) en faveur de ses citoyens
faible revenu, afin de leur permettre de bnficier des biens ou des services des entreprises publiques,
doit tre prvu dans le budget gouvernemental, et il convient de mettre l actif du gouvernement
concern la valeur relle de l assistance que ces entreprises fournissent dans le cadre de la mise en
uvre de la stratgie de rduction de la pauvret. Une faon transparente de raliser les objectifs
susmentionns consiste pour le gouvernement verser l entreprise publique concerne l intgralit
du montant correspondant la valeur des biens ou services en question, dans des circonstances de
tarification normales. Ces questions doivent tre rsolues dans le cadre de la prparation du projet et
faire l objet de discussions dans le rapport d valuation du projet. Etant donn que les indicateurs de
performance financire servent de base l valuation de ce qui prcde, il est essentiel de slectionner
l indicateur (ou les indicateurs) le(s) plus appropri(s) pour chaque avenant relatif chaque projet et
chaque entreprise.
3.9.8 La mission d valuation doit veiller ce que, dans la mesure du possible, les avenants
relatifs aux systmes financiers et les avenants relatifs la performance financire soient
complmentaires. Ces deux types d avenants doivent tre considrs comme un paquet global visant
permettre la direction de l entreprise de raliser une bonne performance financire intgre. Le
rapport d valuation doit identifier et proposer les avenants relatifs la performance financire, aprs
les avoir soumis une analyse de sensibilit. Avant la formulation dfinitive des exigences concernant
la performance financire et les avenants connexes, la mission d valuation doit tudier
soigneusement le poids de leurs effets sur le recouvrement appropri des cots, l amlioration de
l efficacit, la gestion financire et la distribution. Une telle tude permet de s assurer que les
exigences en matire de performance financire sont conformes aux objectifs socioconomiques du
gouvernement. En outre, en choisissant les avenants pertinents, les analystes financiers doivent veiller
inclure l exigence qu une revue soit entreprise au plus tard la fin du premier trimestre de chaque
exercice financier. Une telle revue doit concerner l exercice financier au cours duquel elle est
entreprise et doit couvrir l examen des budgets ou des prvisions pour l exercice suivant.
3.9.9 La section 7.27 du chapitre des prsentes Directives consacr la gestion des connaissances
discute de manire exhaustive les questions relatives aux avenants financiers.
Avenants relatifs l exploitation
3.9.10 Pour aider les gouvernements des PMR grer efficacement les rares ressources disponibles
et aussi mobiliser le revenu et l pargne, la Banque recommande aux emprunteurs que leurs
entreprises but lucratif du secteur public satisfassent une portion raisonnable des exigences en
matire d investissement partir des fonds gnrs sur le plan interne. La dfinition de l expression
portion raisonnable varie selon les pays et les secteurs, mais elle dpend souvent de la politique
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 43 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
gouvernementale rgissant les organes d excution du secteur public. Elle dpend galement de la
performance la plus rcente de l organe d excution concern, notamment lorsque la performance
financire actuelle de ce dernier est insuffisante pour lui permettre de financer ses activits
d exploitation et lorsqu il est ncessaire d augmenter substantiellement le niveau de la portion
raisonnable, au-del du niveau de la performance actuelle de l organe d excution.
3.9.11 Le principal avenant utilis par la Banque pour garantir la performance financire d une
entreprise but lucratif est un de plusieurs avenants relatifs l exploitation possibles. Les deux
principaux types d avenants relatifs l exploitation que l on utilise le plus frquemment sont les
avenants concernant le taux de rendement et les avenants concernant les ratios d autofinancement.
Chaque type dtermine la performance financire minimale annuelle que doit raliser une entreprise
du secteur public, soit en termes de taux de rendement du capital investi, soit en termes de
contribution la satisfaction des exigences en matire d investissement, que doivent gnrer les
activits d exploitation de l entreprise.
3.9.12 La concurrence est habituellement limite sur le(s) march(s) sur lequel (lesquels) oprent
les entreprises publiques. Les niveaux des prix des produits peuvent tre ajusts par le conseil
d administration de l entreprise (par exemple le conseil d administration d une socit d lectricit)
ou alors le gouvernement peut se charger du contrle ou de la rglementation des tarifs et des frais,
par l intermdiaire du ministre sectoriel concern, du ministre des finances ou de la prsidence.
Dans ce cas, les avenants relatifs l exploitation servent s assurer que le conseil d administration ou
le gouvernement autorise des tarifs et prix permettant l organe d excution ou l entreprise d avoir
une performance financire satisfaisante. Lorsqu une autorit indpendante est charge de la
rgulation du secteur, l entreprise et/ou le gouvernement peuvent ne pas avoir les mmes pouvoirs
discrtionnaires en matire d ajustement des prix ou tarifs et frais exigibles pour les produits. Dans ce
cas, les avenants relatifs l exploitation servent aux mmes fins, mais il est possible que l entreprise
soit amene prendre d autres mesures (telles que le renforcement du contrle des dpenses
d exploitation), afin de se conformer l avenant pertinent, en plus de demander l autorit de
rgulation de relever le niveau des tarifs et frais.
3.9.13 Lorsque la performance financire d un organe d excution est juge trs peu satisfaisante,
les types d avenants relatifs l exploitation utiliss comprennent l avenant relatif au ratio
d exploitation ou l avenant relatif au seuil de rentabilit. Selon le ratio retenu, les avenants relatifs
l exploitation peuvent servir la ralisation de divers objectifs financiers, mais ils sont habituellement
limits dans leur application, par exemple ils peuvent viser s assurer que les recettes permettent au
moins de recouvrer les dpenses d exploitation, y compris l amortissement, et si possible le service de
la dette, en sus de l amortissement. L avenant relatif au seuil de rentabilit vise galement des
objectifs limits tels le maintien, en permanence, des capacits d exploitation, de la solvabilit et de la
viabilit financire de l entreprise du secteur public. L on recourt ce type d avenant lorsque l on
s attend ce que les fonds gnrs sur le plan interne ne contribuent pas substantiellement
l investissement. Ces types d avenants doivent tre considrs comme des mesures visant amliorer
la performance financire de l entreprise publique, afin de s assurer que celle-ci est en mesure de
raliser ses autres objectifs, au titre de la stratgie nationale de dveloppement ou de la stratgie de
rduction de la pauvret.
3.9.14 Les avenants relatifs l exploitation doivent prvoir des revues priodiques, par l entreprise,
des actions ncessaires pour se conformer aux diffrentes exigences. Ils doivent aussi prvoir la
communication des rsultats de ces revues la Banque. Les revues doivent tre effectues au moins
sur une base annuelle, avant le dbut de l exercice financier, afin de permettre l entreprise
d entreprendre temps les actions recommandes. Dans certains cas, lorsque les informations
financires tardent tre disponibles, les revues devront tre effectues sur la base d estimations. Note
doit tre prise des prvisions spcifiques en vue de leur rvision lorsque les donnes dfinitives seront
disponibles. Dans les conomies soumises un fort taux d inflation, il peut s avrer ncessaire
d effectuer des revues sur une priodicit plus frquente (par exemple sur une base trimestrielle).
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 44 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
Avenants relatifs la structure du capital
3.9.15 La Banque utilise quatre avenants relatifs la structure du capital : (i) le ratio de couverture
du service de la dette ; (ii) le ratio d endettement ; (iii) la limitation absolue de la dette ; et (iv) le
coefficient de suffisance du capital. Ces avenants dterminent la structure du capital en limitant la
dette pouvant tre contracte par rapport aux flux de trsorerie annuels, au montant des fonds propres
ou au montant annuel absolu.
3.9.16 L avenant relatif au coefficient de suffisance du capital vise s assurer que les fonds propres
d une institution financire seront au moins suffisants pour compenser les pertes. Un certain type
d avenant relatif la limitation de la dette, gnralement soit la couverture du service de la dette, soit
le ratio d endettement, doit tre utilis pour les projets concernant les entits but lucratif. L avenant
relatif la limitation de la dette complte l avenant relatif l exploitation pour s assurer que les
obligations fixes en matire de service de la dette n augmenteront pas d une manire significative
lorsque les objectifs financiers plus larges de l avenant relatif l exploitation ne sont pas raliss.
Lorsqu un avenant relatif l exploitation n est pas appropri, l avenant relatif la limitation de la
dette sert d avenant principal pour promouvoir la viabilit financire. L on s attend recourir tous
les deux types d avenants lorsqu une entit est finance essentiellement par les emprunts, et lorsqu on
estime raisonnablement que les recettes seront toujours d un niveau suffisant pour honorer les
obligations au titre du service de la dette. C est le cas lorsqu un projet ciblant les services publics,
habituellement dans le secteur de l adduction d eau ou de l assainissement, finance pratiquement tous
ses besoins en capital par le biais d emprunts, et que sa performance financire est rgule par un
avenant relatif au seuil de rentabilit. Lorsqu on traite avec des entits qui sont susceptibles de payer
des dividendes, il peut tre souhaitable d utiliser un avenant relatif la limitation des dividendes pour
complter l avenant relatif la limitation de la dette.
3.9.17 Les avenants relatifs la structure du capital servent garantir la solvabilit et la viabilit
financire continues des entreprises but lucratif, en imposant certaines limites dictes par la
prudence sur les emprunts long terme. Si un organe d excution ne contracte pas des dettes aprs
avoir sign un tel avenant ou s abstient d emprunter de nouveau aprs l expiration de la priode au
cours de laquelle il est tenu de se conformer l avenant, bien que les critres de performance
convenus aux termes de l avenant pour la priode subsquente puissent ne pas tre remplis (par
exemple si le ratio de couverture du service de la dette est infrieur 1), l organe d excution ne
manque pas ses engagements, tant qu il ne contracte pas de nouvelles dettes. Les limites imposes
par un avenant doivent tre fixes de manire s assurer que les obligations au titre du service de la
dette continuent d tre honores, que le climat des affaires soit favorable ou dfavorable, en tenant
compte des risques conomiques et financiers.
3.9.18 La distinction entre la dette et les fonds propres n est pas toujours claire. A titre d exemple,
les actions privilgies prsentent de nombreuses caractristiques de la dette, tandis que les
obligations convertibles peuvent tre assimiles des fonds propres. En outre, les instruments drivs
et autres instruments financiers ajoutent d autres niveaux de complexit. En consquence, aux fins de
formulation des avenants, il convient d adopter une approche prudente, en incluant dans la dfinition
de la dette tout instrument difficile classifier.
Traitement de la dette court terme
3.9.19 Dans le cadre de la conception des avenants relatifs la structure du capital, la Banque
dfinit le terme dette comme tout endettement contract par l emprunteur et venant chance plus
d un an aprs la date laquelle il a t initialement contract, conformment ses modalits et
conditions. Cette dfinition limite l application de l avenant ce que l on appelle gnralement dans
un bilan une dette long terme, et exclut la dette court terme figurant habituellement, dans un bilan,
la rubrique du passif court terme. Une telle exclusion est justifie lorsqu une dette court terme
est contracte pour servir de sources de fonds de roulement, tant donn que toute limitation d une
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 45 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
telle utilisation juge ncessaire peut tre couverte par un avenant relatif aux liquidits. Toutefois,
lorsque la portion exigible d une dette long terme (prsente comme un passif court terme) est
couverte dans la dfinition de la dette long terme, aux fins d un avenant relatif la structure du
capital, cette portion doit toujours tre considre comme un passif court terme, aux fins d un
avenant relatif aux liquidits.
3.9.20 L attention voulue doit tre accorde la ncessit d affiner la dfinition du terme dette
ou de recourir un avenant complmentaire pour couvrir certains prts court terme qui sont : (i)
continuellement reconduits, ou (ii) utiliss en tant que fonds-relais, en attendant l encaissement du
produit de la vente des fonds propres ou de la dette long terme. Dans le premier cas, s il est probable
que les montants concerns soient significatifs, ceux-ci doivent tre couverts dans la dfinition de la
dette aux fins de l avenant ou de la limitation complmentaire de la dette court terme. Dans le
deuxime cas, la ncessit de couvrir ces montants dans la dfinition de la dette dpendra de l opinion
mise sur la probabilit et l opportunit de leur remplacement par la dette long terme ou les fonds
propres. En cas de doute, l objectif globalement vis doit servir de guide. A titre d exemple, si le
recours la dette long terme par l emprunteur doit tre limit, aucune autre facilit ne doit tre
admise sous forme de dette court terme, moins qu elle fasse l objet d une dfinition et d une
catgorisation appropries, et qu elle ne soit prise en compte, en partie ou en totalit, en tant que dette
long terme, aux fins de l avenant.
Traitement des contrats de location-acquisition
3.9.21 Certaines institutions ont recours aux contrats de location-acquisition pour pouvoir utiliser
l actif, tant entendu que la proprit dfinitive de l actif dpend des modalits de la location. Un
contrat de location-acquisition fait courir tous les risques au locataire. Il est donc raisonnable de
considrer l existence d un tel contrat et les loyers pays aux termes de ce contrat comme une dette et
un service de la dette, respectivement, aux fins de la structure du capital des organes d excution. En
consquence, lorsqu un organe d excution a conclu ou se propose de conclure un accord de location-
acquisition, la valeur de la location et des loyers annuels pays doit tre incluse dans la structure du
capital et dans les obligations en matire de service de la dette de l organe d excution, aux fins des
avenants aux accords de prts.
Restrictions en matire d utilisation du produit des prts
3.9.22 Les avenants relatifs la structure du capital comportent des limitations inhrentes qui font
que mme si ces avenants visent essentiellement limiter les montants des emprunts, ils ne rgissent
pas l utilisation du produit des emprunts autoriss (tout comme ils ne garantissent pas que les
obligations au titre du service de la dette seront honores si de nouveaux emprunts sont contracts).
De mme, la planification et l excution de nouveaux projets comportant des exigences substantielles
en matire de service de la dette, retardent parfois l achvement des projets en cours, par la
premption de l utilisation des rares ressources manant des prts. Lorsqu il existe des proccupations
relles qu une entit but lucratif s engage probablement dans des projets additionnels aux mrites
contestables, un avenant pertinent peut se rvler ncessaire pour limiter le champ d action de
l entreprise aux investissements qui sont conomiquement justifis et financirement indiqus.
Toutefois, de telles limitations ne sont gnralement ni ncessaires, ni souhaitables. L on ne devrait y
recourir qu titre exceptionnel et habituellement uniquement pendant la phase d excution du projet.
Avenants relatifs aux liquidits
3.9.23 La plupart des indicateurs d exploitation et de suffisance du capital sont labors sur la base
des informations accumules, ce qui signifie que ces indicateurs peuvent ne pas reflter adquatement
la situation des liquidits (disponibilits relles) de l organe d excution. Les avenants relatifs aux
liquidits visent s assurer qu une entreprise maintient un fonds de roulement suffisant (par exemple
un excdent de l actif court terme par rapport au passif court terme) lui permettant d honorer ses
Analyse financire et valuation des projets Chapitre 3, page 46 de 59
Directives pour la gestion financire et l analyse financire des projets du Groupe de la Banque africaine de dveloppement
obligations actuelles temps et de mener efficacement ses oprations, sans contraintes financires.
L exprience de la Banque montre que le manque ou l insuffisance de liquidits est une cause majeure
de la mauvaise performance des organes d excution. En consquence, un indicateur de liquidits, de
prfrence le ratio de liquidit relative ou indice de liquidit relative, doit tre fourni pour chaque
projet. Les limites d un tel indicateur sont que les donnes utilises pour dterminer le ratio sont des
chiffres instantans, gnralement tels qu ils se prsentent la clture d un exercice financier. En
tant que tels, ces chiffres peuvent tre sujets manipulation. Les problmes associs aux
instantans peuvent tre parfaitement rsolus par la soumission de rapports priodiques, afin
d tablir un tableau des rsultats mensuels pour la dtermination du ratio de liquidit relative au cours
des 12 mois prcdents (ou sur toute autre priode juge approprie).
3.9.24 L on recourt gnralement ces avenants uniquement lorsque les besoins en fonds de
roulement sont significatifs, comme dans le cas de la plupart des projets industriels ou agro-industriels
pour lesquels la direction de l entreprise peut utiliser les ressources limites disponibles pour financer
les dpenses d investissement, au dtriment des dpenses d exploitation. Par contre, ces avenants ne
sont normalement pas ncessaires pour les projets dont les besoins en fonds de roulement peuvent tre
relativement modestes, par exemple les projets ciblant les services publics et les chemins de fer. Pour
de tels projets, les besoins en liquidits sont adquatement couverts par les avenants relatifs
l exploitation qui peuvent tre complts, si ncessaire, par d autres avenants couvrant les questions
relatives au fonds de roulement, par exemple le recouvrement temps des comptes clients.
3.9.25 Les avenants relatifs au ratio de liquidit gnrale et au ratio de liquidit relative requirent
que l emprunteur maintienne un ratio de liquidit minimum dtermin et s engage prendre des
mesures correctives si le ratio rel tombe en dessous du niveau minimum prescrit. L avenant relatif au
ratio de liquidit relative exclut le cot des inventaires la date du bilan.
Vous aimerez peut-être aussi
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- Audit Des Projets Module 4Document73 pagesAudit Des Projets Module 4Hassan MhtPas encore d'évaluation
- La LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmeD'EverandLa LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmePas encore d'évaluation
- Politiques et management publics: L'heure des remises en questionD'EverandPolitiques et management publics: L'heure des remises en questionPas encore d'évaluation
- Guide D Audit Des Si v1-2Document118 pagesGuide D Audit Des Si v1-2AnaruzSadkiPas encore d'évaluation
- Métier de gestionnaire public: Nouveaux rôles, nouvelles fonctions, nouveaux profilsD'EverandMétier de gestionnaire public: Nouveaux rôles, nouvelles fonctions, nouveaux profilsPas encore d'évaluation
- Management International (L Essentiel)Document26 pagesManagement International (L Essentiel)Samy ChaouchPas encore d'évaluation
- Comment Identifier Les Bons Indicateurs Clés de Performance (KPI) - QuotientDocument12 pagesComment Identifier Les Bons Indicateurs Clés de Performance (KPI) - Quotientlara2005Pas encore d'évaluation
- UntitledDocument169 pagesUntitledkrea vesmarPas encore d'évaluation
- A La Planification Strategique PPT 5Document47 pagesA La Planification Strategique PPT 5Hind MalaininePas encore d'évaluation
- Analyse d’impact réglementaire (AIR): Balises méthodologiques pour mieux évaluer les réglementationsD'EverandAnalyse d’impact réglementaire (AIR): Balises méthodologiques pour mieux évaluer les réglementationsPas encore d'évaluation
- Stratégies D'internationalisationDocument531 pagesStratégies D'internationalisationjean100% (1)
- Support de Cours Management de ProjetDocument17 pagesSupport de Cours Management de ProjetBBoyLiltricksPas encore d'évaluation
- Gestion BudgétaireDocument154 pagesGestion BudgétaireWadifi HoussinePas encore d'évaluation
- La Gestion de Projet Par Étapes, D'hugues MarchatDocument3 pagesLa Gestion de Projet Par Étapes, D'hugues MarchatAmine DiabyPas encore d'évaluation
- Rapport de Projet PDFDocument12 pagesRapport de Projet PDFYOUNESS IDHMADPas encore d'évaluation
- L InflationDocument2 pagesL Inflationالتهامي التهاميPas encore d'évaluation
- Performance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsD'EverandPerformance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsPas encore d'évaluation
- Sujet Suivi Et Evaluation - CopieDocument1 pageSujet Suivi Et Evaluation - CopieGuillaumeKouassiPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges EcommerceDocument6 pagesCahier Des Charges EcommerceMireille NGALEPas encore d'évaluation
- Management DES ORGANISATIONS PubliquesDocument42 pagesManagement DES ORGANISATIONS PubliquesRandom AccountPas encore d'évaluation
- COURS Management de ProjetDocument9 pagesCOURS Management de ProjetKhawla AtPas encore d'évaluation
- 00000000coursABGP Miage 1112 4p1 MACSI PDFDocument55 pages00000000coursABGP Miage 1112 4p1 MACSI PDFKITSONPas encore d'évaluation
- L'Évaluation Financière Des Projets Et Son Impact Sur Le Choix D'investissement OpportunDocument20 pagesL'Évaluation Financière Des Projets Et Son Impact Sur Le Choix D'investissement OpportunSaïdi SamiraPas encore d'évaluation
- Guide de Planification Stratégique Et OrganisationnelleDocument44 pagesGuide de Planification Stratégique Et Organisationnellekansie_sam100% (2)
- Coursgestionfinancire 170829214504 PDFDocument121 pagesCoursgestionfinancire 170829214504 PDFRéda TsouliPas encore d'évaluation
- Le Tableau de Bord ProspectifsDocument2 pagesLe Tableau de Bord ProspectifsheryPas encore d'évaluation
- Manuel de Procédures Administratives Et FinancièresDocument40 pagesManuel de Procédures Administratives Et Financièresmaxhaf100% (1)
- Management StratégiqueDocument61 pagesManagement StratégiqueMaxan Eripsa100% (1)
- La Recherche en Management de ProjetLa Recherche en Management de Projet PDFDocument48 pagesLa Recherche en Management de ProjetLa Recherche en Management de Projet PDFKima GmairiPas encore d'évaluation
- CDR Audit Versement Subventions Associations Web PDFDocument52 pagesCDR Audit Versement Subventions Associations Web PDFFbel XNONPas encore d'évaluation
- Methode de PlanificationDocument8 pagesMethode de PlanificationAmir BakarPas encore d'évaluation
- La Politique de Taux de ChangeDocument20 pagesLa Politique de Taux de ChangeMarouane BelhatPas encore d'évaluation
- Classification des documents numériques dans les organismes: Impact des pratiques classificatoires personnelles sur le repérageD'EverandClassification des documents numériques dans les organismes: Impact des pratiques classificatoires personnelles sur le repéragePas encore d'évaluation
- Management Des Risques Du Projet.Document197 pagesManagement Des Risques Du Projet.Paula LeaoPas encore d'évaluation
- Amf - Course-V1 FIRST-FINANCE+227+2022 - 235115Document24 pagesAmf - Course-V1 FIRST-FINANCE+227+2022 - 235115K. Giorgio100% (1)
- Evaluation Et Économique Et FinancièreDocument36 pagesEvaluation Et Économique Et FinancièrevenceslasdjihouenouPas encore d'évaluation
- Alignement StratégiqueDocument21 pagesAlignement StratégiqueHamza MoutiaPas encore d'évaluation
- Planification Stratégique en Contexte CommunautaireDocument26 pagesPlanification Stratégique en Contexte Communautairekouahoun100% (3)
- Formation en Montage de ProjetDocument10 pagesFormation en Montage de ProjetKadiatou SyllaPas encore d'évaluation
- Projet & Planification FinancièreDocument21 pagesProjet & Planification Financièreseka_dalle100% (1)
- SEP - Collecte Et Analyse - SupportDocument58 pagesSEP - Collecte Et Analyse - SupportK-Abel YaoPas encore d'évaluation
- Gestion de ProjetDocument22 pagesGestion de Projetsakho1Pas encore d'évaluation
- Suivi EvaluationDocument28 pagesSuivi EvaluationDhot100% (1)
- 9 Financement de Projet Et Collecte de FondsDocument24 pages9 Financement de Projet Et Collecte de FondsDjibril SyPas encore d'évaluation
- BAD en BrefDocument38 pagesBAD en BrefElijah WardPas encore d'évaluation
- Mémoire 2Document89 pagesMémoire 2selma.Pas encore d'évaluation
- Regles Et Procedures Nationales Du Burkina Faso en Matiere de GPDocument136 pagesRegles Et Procedures Nationales Du Burkina Faso en Matiere de GPDaoudygp7Pas encore d'évaluation
- Budget Des VentesDocument39 pagesBudget Des VentesWissâl ÉlPas encore d'évaluation
- Intelligence Economique 2019-2020Document56 pagesIntelligence Economique 2019-2020Derka coulPas encore d'évaluation
- Rapport D'évaluation de L'université Des Antilles Et de La GuyaneDocument44 pagesRapport D'évaluation de L'université Des Antilles Et de La GuyaneUniversité des AntillesPas encore d'évaluation
- VersionFr PDFDocument48 pagesVersionFr PDFOdilon KyoPas encore d'évaluation
- Support Cours Initiation A La Gestion Des ProjetsDocument20 pagesSupport Cours Initiation A La Gestion Des ProjetsTodd Pepin KazePas encore d'évaluation
- GRH & Manag ParticipatifDocument31 pagesGRH & Manag Participatiftchetcho1100% (1)
- Méthodologie D'une Mission D'audit InterneDocument8 pagesMéthodologie D'une Mission D'audit InterneKouakouPas encore d'évaluation
- Gestion de Risque ProjetDocument22 pagesGestion de Risque ProjetDODOHICHAM100% (1)
- FR Ebook IT-Audit-Readiness 12-18Document22 pagesFR Ebook IT-Audit-Readiness 12-18Ndeffo Patrick100% (1)
- Annexes Montage Et Financement de ProjetDocument2 pagesAnnexes Montage Et Financement de ProjetmarouaPas encore d'évaluation
- Management Des OperationsDocument66 pagesManagement Des OperationsRavvad BitPas encore d'évaluation
- GRH - DafDocument28 pagesGRH - DafIsmail AmraniPas encore d'évaluation
- Gestion de Projets de Developpement PDFDocument4 pagesGestion de Projets de Developpement PDFidrissasaPas encore d'évaluation
- Introduction à la modélisation d'équations structurelles: AMOS dans la recherche en gestionD'EverandIntroduction à la modélisation d'équations structurelles: AMOS dans la recherche en gestionPas encore d'évaluation
- Rapport d'activité 2017 de la Banque européenne d'investissement: Un impact qui façonne l'avenirD'EverandRapport d'activité 2017 de la Banque européenne d'investissement: Un impact qui façonne l'avenirPas encore d'évaluation
- 633-Texte de L'article-1904-1-10-20220417Document45 pages633-Texte de L'article-1904-1-10-20220417KatyPas encore d'évaluation
- Le contrôle de gestion dans la grande distribution- 2023Document90 pagesLe contrôle de gestion dans la grande distribution- 2023alexis.carlierPas encore d'évaluation
- Ijias 18 203 24Document13 pagesIjias 18 203 24Lyne AlexandraPas encore d'évaluation
- AtlasMagazine 2022-02 FRDocument48 pagesAtlasMagazine 2022-02 FRrita tamohPas encore d'évaluation
- Analyse Des Facteurs Determinants La Variation Des Prix Des Denrees Alimentaires Pendant La Covid-19Document59 pagesAnalyse Des Facteurs Determinants La Variation Des Prix Des Denrees Alimentaires Pendant La Covid-19Pause MatPas encore d'évaluation
- Politique MonétaireDocument18 pagesPolitique MonétairedayangPas encore d'évaluation
- #7e MAGAZINE ECOSYSTEME ENTREPRENEURIAL CONGOLAISDocument21 pages#7e MAGAZINE ECOSYSTEME ENTREPRENEURIAL CONGOLAISsebien nazardPas encore d'évaluation
- Cas Ribou 1Document36 pagesCas Ribou 1christophe.bardy100% (6)
- 1DIS48 2 Maroquinerie en FranceDocument6 pages1DIS48 2 Maroquinerie en Francemaison_d_hotesPas encore d'évaluation
- La Stratégie Et La CroissanceDocument4 pagesLa Stratégie Et La CroissanceBajouri ZinebPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Les MercantilistesDocument21 pagesChapitre 1 Les MercantilistesDomey TugPas encore d'évaluation
- Rapport Le Marchã© Des ObligationsDocument33 pagesRapport Le Marchã© Des ObligationsMounir AakibPas encore d'évaluation
- Cours Eco Mon s3Document208 pagesCours Eco Mon s3laila.20042506Pas encore d'évaluation
- Cours Module E.M.M.F Section A 2eme Annee Se PDFDocument5 pagesCours Module E.M.M.F Section A 2eme Annee Se PDFABRAHAM NENEPas encore d'évaluation
- Caisse de Compensation - Intro Et Passages - MesuresDocument4 pagesCaisse de Compensation - Intro Et Passages - MesuresBrahim SamirPas encore d'évaluation
- La Pensee Economique PDFDocument65 pagesLa Pensee Economique PDFSaid RudaniPas encore d'évaluation
- R - Sum - de TH - Orie - Conomique ContemporaineDocument22 pagesR - Sum - de TH - Orie - Conomique ContemporaineMed Elbatani100% (1)
- Courant MonetaristeDocument8 pagesCourant Monetaristeeya elkamelPas encore d'évaluation
- Monnaie Et FianancementDocument33 pagesMonnaie Et FianancementKinda AugustinPas encore d'évaluation
- Rapport Annuel Wafa Assurance 2016Document104 pagesRapport Annuel Wafa Assurance 2016Maar Baasin NjaayPas encore d'évaluation
- Expose Anglais!!!Document12 pagesExpose Anglais!!!remy_bacuePas encore d'évaluation
- Prob Soci - Econo.part2Document12 pagesProb Soci - Econo.part2alo alhianePas encore d'évaluation
- TD PesDocument4 pagesTD Pesy.bendaoud2003Pas encore d'évaluation
- Econews 33 June 2014Document20 pagesEconews 33 June 2014Mohammad HijaziPas encore d'évaluation
- Revue Stratégique Nationale Faim Zéro de Madagascar Juillet 2018Document97 pagesRevue Stratégique Nationale Faim Zéro de Madagascar Juillet 2018Ababacar FallPas encore d'évaluation
- Corrige DCG Mai 2023 Ue5 VFDocument22 pagesCorrige DCG Mai 2023 Ue5 VFsapire3769Pas encore d'évaluation