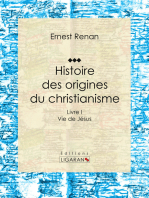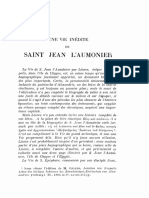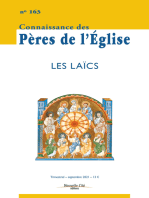Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Christianisme Dans L'empire Perse - Labourt (1907)
Transféré par
Babilonia CruzTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Christianisme Dans L'empire Perse - Labourt (1907)
Transféré par
Babilonia CruzDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bibliothque
de l'enseignement de l'histoire ecclsiastique
LE
DANS
L'EMPIRE PERSE
SOUS LA DYNASTIE SASSANIDE
(224-632)
M ~ M E LIBRAIRIE
De Timotheo 1, Nestorianorum patriarcha
(728-823) et Christianorum orientalium condicione sub
Chaliphis Abbasidis; accedunt XCTX eiusdem Timothei
definitiones canonic e textu syriaco inedito, nunc pri-
mum latine redditre. Thesim Facultati litterarum pari-
siensi proponebat HIERONnms LABOURT, ejusdem Fa-
cultatis quondam alumnus, societatis asiaticre sodalis,
1 vol. in-8. Pl"ix . . . . . . . . . . . . . . . . 4 fr.
Bibliothque de l'enseignement de l'hi&toire ecclsiastique
LE CHRISTIANISME
D.t.IU
L'EMPIRE PERSE
SOUS LA DYNASTIE SASSANIDE
(224-632)
PAR
J. LABOURT
DOCTEUR EN THOLOGIE, DOCTEL'R :s LETTRES
DEUXIME ~ D I T I O N
PARIS
LIBRAIRIE VICTOR LECOFFRE
RUE BONAPARTE, 90
190!
Sur le tmoignage favorable de l'examinateur,
Nous permettons l'impression.
Paris, le 13 Juin 1904.
G. LEFEBVRE,
Vic. gn.
113430
DEC 17 1907
D"Db35
L Il
A MES MAITRES
MM. IGNAZIO GUIDI
Professeur de langues smitiques l'Universit Romaine,
Correspondant de l'Institut de France,
ET
RUBENS DUVAL
Professeur de Langue et Littrature aramennes
au Collge de F1ance,
HOMMAGE
DE RESPECTUEUSE RECONNAISS!NCE
(/,
PRFACE
Les chrtients de l'Orient Romain attirent
depuis plusieurs sicles dj et n'ont pas cess
de retenir l'attention des rudits. On ne saurait en
dire autant des glises fondes par del les fron-
tires de l'Osrhone, dans les contres fameuses
de l'Assyrie, de la Babylonie, de la Susiane et
de l'Iran persique. C'est peine si les historiens
mentionnent l'existence de ces centres religieux,
propos de la perscution de Sapor II, narre
par Sozomne, ou de l'hrsie nestorienne, qui,
chasse de l'empire romain, aurait cherch un
tnbreux refuge dans les provinces soumises
aux rois Sassanides. Et pourtant, remarque trs
justement Mgr Duchesne 1, (( ce n'tait pas un
mdiocre domaine que celui du catholicos de
Sleucie. Par l'tendue de sa juridiction, ce haut
dignitaire fait au moins la mme figure que les
plus grands patriarches byzantins. On pourrait
mme aller plus loin : pour autant que l'empire
t. glises spares, p. 24.
XH
PRFACE.
perse est comparable l'empire romain, l'glise
de Perse forme le pendant de l'ensemble ecclsias-
tique du grand tat occidental.
Au commencement du xvm sicle, Joseph Si-
mon Assemani t, le clbre auteur de la Biblio-
theca Orientalis, a compos une copieuse disser-
tation sur les Syriens nestoriens qui remplit,
elle seule, le dernier volume de son ouvrage.
Ce n'est pas diminuer le mrite incontestable de
cette uvre, que de constater qu'elle est aujour-
d'hui suranne, au double point de vue documen-
taire et critique. Les historiens qui ont suivi, se sont
contents d'emprunter ses conclusions l'illustre
maronite; aucun d'eux n'a tent de renouveler
une entreprise, qui n'est pas, du reste, sans pr-
senter ds l'abord des difficults considrables.
Les documents qui intressent l'glise de
Perse sont, en effet, pour la majeure partie,
crits dans l'idiome syriaque, qui a t de tout
temps la langue officielle de cette glise; quel-
ques-uns seulement ont t traduits. Un grand
nombre de textes, insuffisamment connus jusque-
l, ont t dits dans les dix annes qui vien-
nent de s'couler; plusieurs, et non des moins im-
portants, sont demeurs indits jusqu' ce jour.
Il nous a paru que nous ferions uvre utile,
1. Sur les Assemani, cf. les articles dJl Dom Parisot dans le Dic
tionnaire de thologie catholique, fase. VIII, et de Nestle dans la
Herzog's Realencyklopadie, 3 d., vol. II, p. 1 4 ~ .
PRFACE. Xlii
si nous rendions plus facile au public lettr
l'accs d'une province recule et, pour ainsi dire,
perdue de l'histoire ecclsiastique, en essayant
de retracer l vie de cette glise de Perse, qui
comptait, au moment de l'invasion musulmane,
sept provinces mtropolitaines et plus de quatre-
vingts vchs, chelonns depuis les montagnes
de l'Armnie jusqu'aux rivages de l'Inde mridio-
nale.
Le plan de notre livre nous tait dict par le
dsir que nous avions de composer une mono-
graphie qui, tout en groupant les rsultats acquis,
pt servir de point de dpart commode pour des
recherches ultrieures. Dans notre premire par-
tie, nous avons rapport, en ordre chronologique,
les vnements saillants qui ont marqu l'histoire
de l'glise syrienne orientale depuis la chute des
Arsacides jusqu' l'invasion de la Chalde par
les Arabes. Dans une seconde partie, nous nous
sommes appliqu dcrire, avec plus de dtails,
la constitution intime de l'glise de Perse, et tout
particulirement, le dveloppement de la dogma-
tique nestorienne, si mal connu et si peu tudi
jusqu' prsent.
Nous avons pu, il y a deux ans, noncer les
principales conclusions de nos tudes, dans la
Revue d'histoire et de littrature religieuses 1.
t, T. VIl, n. 2 et 3.
..
XIV
PREFACE.
L'accueil bienveillant qui a t fait nos arti-
cles par les savants comptents, notamment par
MM. Th. Noeldeke, Ignazio Guidi et Rubens
Duval, nous permet d'esprer qu'on voudra bien
traiter le prsent ouvrage avec la mme faveur.
BIBLIOGRAPHIE
A. DOCUMENTS ORIGINAUX
1
1. HISTOIRE GNRALE, CHRONOLOGIE
'A.Im, v. Liber Turris.
AssEl!AXI. - Bibliotheca orientalis Clementi no- Vaticana. 4 vol.,
particulirement t. III; pars I : De Scriptoribus Syl'is nesto-
rianis; pars II : De Syris nestorianis. Rome, 1719-1728.
BARHBRAEUS (Grgoire Abu'l-Faradj dit). - Chronicon Eccle-
siasticum, pars II, d. Abbeloos-Lamy. Louvain, 1874.
Ch1onique d'desse, d. Ilallier dans : Texte und Untersuchungen
de Gebhart-Harnack, t. IX, fasc. I. Leipzig, 1894. Nouvelle di-
tion de l\1. Guidi dans le Corpus Scriptorum Christianorum
Orientalium, et version latine. Paris, 1903.
LIE DE NISIBE. - Chronologie, d. Lamy. Bruxelles, 1888.
Liber Turris. Recensions de MARI IBN SoLEUIAN, 'AMR IIJN MATTA
et SLIBA dans : Maris, Amri et Slibae, de Patriarchis Nesto-
rianorum commentaria, d. Gismondi. - I. Amri et Slibae
textus. Rome, 1896, versio lat(na. Rome, 1897; - II. l\Iaris
textus arabicus et versio latina. Rome, 1899. Cf. R. DuVAL,
Littrature syriaque, p. 211.
MAnE, v. Liber Turris.
TABARI. - Geschichte der Perser und Amber zm ZeU der Sas-
saniden aus der ambischen Chronik des Tabari, d. Teodor
Noeldeke. Leyde, 1879.
Un nuovo testa siriaco sulla stol'ia degli ultimi Sassanidi, d.
Guidi. Leyde, 1891 (extrait des actes du VIII Congrs des Orien-
talistes Stockholm, 1889).
i. Pour la critique des sources nous renvoyons la Littrature sy-
riaque, de M. Rubens Duval.
XVI BIBLIOGRAPHIE.
Cf. NoELDEKE, Die von Guidi herausgegebene syrische Chtonik
uebersetzt und commentiert. Vienne, 1893. Nouvelle dition de
M. Guidi dans le Corpus Scriptorum Christianorum Orienta-
lium, et version latine. Paris, 1903.
II. SOURCES SPCIALES
i.- Hagiographie
Acta Sanctorum Martyrum, d. Evode AssEMANI (texte syriaque
et version latine), t. I. Rome, 1748.
Acta Martyrum et Sanctorum, d. P. BEDJAli (texte syriaque),
t. II, III et IV. Leipzig, 1890-1895.
AI,lUDEMMEH (Vie de Mat), British :Museum, ms. add. 12.172.
Auszge aus syrischen Akten persischer d. Georg
HoFFMANN. Leipzig, 1886 (Fragments de Passions indites tra-
duites en allmand, et accompagns de notes historiques et
gographiques).
Book of Governors (the Book of Governors, being the llistoria
monastica of Thomas bishop of Marga
1
A. D. 840), d. BuDGE.
Londres, 1893. 2 vol. (texte syriaque et traduction anglaise).
Bienheureux orien/am; (Vies des), d. Lancl. Anecdota syriaca,
t. II (texte syriaque).
Chastet (Livre de la), compos par J!lsuDENAH, vque de Basrah,
d. Chabot. Rome, 1891.
Histotia monastica, v. Book of Governors.
lAHBALAHA (Vie de labalaha, de trois aut1es patriarches et de quel-
ques laques nestoriens), d. Bedjan. Leipzig, 1893 (texte sy-
riaque).
lso'YAHB III, d'Adiabne, patriarche nestorien au vn sicle.
Lettres (en ms.) (cf. DuvAL, Litt. Syr., p. 372).
11/artyrius-Sahdona's Leben und fVerke, d. Goussen. Leipzig, 1897
(textes de SAIIDONA, prcds d'une Introduction).
MARUTA. - Vie de lifar 11/aruta, premier mafriano jacobite, ms.
communiqu par l\1. l'abb Nau. British :Museum, add. 12.172.
2. - Thologie
AFRAAT. - Les 22 premires Dmonstrations, d. Parisot, dans
Patrologia syriaca, t. I, Paris, 1894; la 23, d. Wright, Lon-
dres, 1869. Traduction allemande de Bert dans Texte und
Untersuchungen de Gcbhart-Harnack, t. III, Leipzig, 1888.
- '
BIBLIOGRAPHIE. XVII
Traduction latine de Dom Parisot, op. cil. Cf. R. DuvAL, Lill.
syr., p. 226, n. 1.
BABA LE GRAND.- Le livre de l'Union, trait complet de thologie
nestorienne (fin du n sicle), ms. communiqu par 111. l'abb
Chabot.
-,tNARSS. - Homlie sur les l!ois docteurs nestoriens, d. Franois
Martin (texte syriaque et traduction franaise), tirage part
extrait du Journal de la Socit Asiatique (1899).
THEODOR! 1\loPSt;ESTE!H.- Commentarius in Evangelium sancti Jo
hannis, d. Chabot (texte syriaque). Paris, 1897.
TuoJI.o\E EDESSENI. - Tracta/us de Nativitate D. N. lesu Christi,
d. Simon-Joseph Carr (texte syriaque et traduction latine).
Rome, 1898.
,II'IMOTHE 1, pattiarche nestotien au vm sicle, lettres et traits
thologiques (ms. du .Muse Borgia, K. vi, 3). Cf. ma thse :
De Timotheo I Nestorianorum patriarcha. Paris, 1904.
3. - Droit canonique
De sancta Nicaena Synodo, textes canoniques attribus 1\IAnr;TA
DE MAIPHERQAT, d. Braun dans Ki1chengeschichtliche Studien.
Mnster, 1898.
PAPAS (Der Briefwechsel des Katlwlikos) : Correspondance apo-
cryphe de cet vque, d. Braun dans Zeitschl'i(t (r katho-
lische Theologie, 1894 (traduction allemande).
Regulae monasticae ab ABRAHAliO ct DADJEsu conditae, d. Cha-
bot (texte syriaque et traduction latine) dans Rendiconti della
R. Accademia dei Lincei. Rome, 1898.
Scuola di Nisibi (GU statuti della), d. Guidi (texte syriaque);
Giornale della Societ Asiatica ItaUana, vol. IV, p. 1&>-195.
Synodicon orientale. Recueil des Actes synodaux de l'glise de
Perse, d. Chabot dans : Notices et Exllaits des manusc1ih,
t. XXXVII. Cf. R. DuvAL, Litt. sy1., p. 177.
B. OUVRAGES ET ARTiCLES CONSULTS
,tBATII'FOL. - Les Homlies de Nestorius ... Revue biblique, 1901,
(Tirage part.)
BAUMSTARK.- Die nestorianischen Schriften : De causis festo::
rum (01"iens chdstianus, 1' anne, fasc. Il). Home, 1901.
BRAUM. - Das Buch Synhados. Stuttgart, 1900,
XVIII BIBLIOGRAPHIE.
CuABOT.- L'cole de Nisibc. Son histoire, ses statuts . Journal
de la Socit Asiatique, 1896. (Tirage part.)
DIEHL. - Justinien. Paris, 1901.
Dt:CHESSE. - glises separes. Paris, 1896.
DuvAL (H.). - Histoire d'desse. Paris, 18!.)2.
Littrature syl'iaque. Paris, ISW.
IIAR:IACK (Ao.). - Lehrbuch det Dogmengeschichte, 3 d. Fri-
bourg, 1894, t. II.
IIEFELE. -Histoire des Conciles, tra<l. Delarc, t. II, III et IV. Paris,
1870.
- Theodor von Alopsuestia und Junilius Africanus als
E.Tegeten. Fribourg, 1886.
1\lunALT. -Essai de chronographie bylantine, t. 1, 1855.
TILLF.MO:IT. - Mmoires pour servir l'histoire ecclsiastique
des six ptemiers sicles, 16 vol., - en particulier le VII'.
VASCHALDE. - Three letters of Philoxenus. Rome, 1902. (L'intro-
duction contient un bon expos de la doctrine monophysite.)
WESTPIIAL. - Untersuchungen ber die Quellen und die Glaubwr-
digkeit der Patriarchalchroniken des ibn Sulaimn, 'A mt
ibn Matai und Saliba ibn Jol)annan. Thse de doctorat de
Strasbourg, 1901
1
\VRIGHT. - A short Ilistory of syriac Literature. Londres, 18!H.
Les abrviations que nous avons le plus ordinairement en>-
ployes sont les suivantes :
BEDJ. =Acta Martyrum et Sanctotmn, d. P. Bedjan.
B. H. = Barhbraeus, Chronicum Ecclesiasticum, pars II.
B. O. ou Bibl. orient. = 'Bibliatheca orientalis.
IIOFFM. = Hoffmann : Auszge aus syrischen Aklen.
Litt. syr. = H. Duval : LUtratute syt'iaqtte.
J/. O. = Ev. Assemani : Acta A!artyrum ol'ientalium, t. I.
Syn. otient. = Synodicon orientale, d. Chabot.
TAu. = Tabari, traduction de 111. Noeldeke.
Nos rfrences pour les Chroniqueurs, la Bibliothque orientale,
les Actes des l\Iartyrs et le Synodicon orientale renvoient
d'ordinaire aux traductions. Elles seront ainsi plus facilement
contrles. Il est inutile d'ajouter que nous nous sommes per-
sonnellement rapport aux textes originaux, auxquels nous ren-
1. Je n'al eu connaissance de cette excellente Thse qu'au moment
o Je prsent travail tait achev, et je n'al pu l'utiliser que pour les
notes.
BIBLIOGRAPHIE. XIX
voyons chaque fois que les traductions nous ont semble insuf-
fisantes ou fautives. Dans la transcription des noms syriaques,
nous nous sommes attach reproduire exactement les conson-
nes; mais nous avons cru pouvoir ngliger la notation des semi-
voyelles ou des adoucissements que subissent certaines con-
sonnes. Afin d'viter toute confusion, nous avons constamment
rendu le son ou par la voyelle u.
Nous nous sommes abstenu dessein de multiplier les notes
historiques et gographiques. On voudra bien se repm-ter aux
ouvrages de :M. Noeldeke cits plus haut, aux Aus;iige de
l\1. Hoffmann, et l'excellent lexique qui termine l'dition du
Synodicon Orientale de 1\1. l'abb Chabot.
41.' '*
LE CHRISTIANISME
DANS
L'EMPIRE PERSE
CHAPITRE PREMIER
LES ORIGINES. DU CHRISTIANISME EN PERSE .
S i. - L'Empire des Sassanides. - Son organisation
intrieure. - Races et religions.
Le 28 avril 224, le dernier des rois arsacides, Ar-
taban, livrait et perdait une bataille dcisive
1
Depuis
douze ans dj, le monarque parthe voyait s'tendre
de proche en proche le foyer d'une insurrection qui
avait clat dans l'Iran, et tous ses efforts le cir-
conscrire taient demeurs infructueux. Ardasir, des-
cendant de Sassan, avait group autour de lui, de gr
ou de force, les principicules demi indpendants qui
occupaient les pres montagnes de la Perse propre.
Comme aux temps hroques des premiers Achm-
nides, les rudes guerriers d'lstahr et de Perspolis
l'assaut des rgions plus fertiles du
t. cr. NoBLDEU, Au(sdtze .zur persischen Guchichte, p. 87 et sui v.-
Tuuu, p. t-!13.
LR CHRISTIANISME,
2 LES ORIGINES DU CHRISTIANISME EN PERSE.
midi, habites par des populations indolentes, dont
l'habitude vingt fois sculaire de l'esclavage faisait
une proie facile des envahisseurs dtermins. La
dynastie arsacide, affaiblie par les divisions intes-
tines, dconsidre par ses nombreux checs dans
les luttes contre Rome, l'ennemi hrditaire, mal
soutenue par les grands vassaux plus soucieux de
maintenir leur position personnelle que de venir en
aide au Roi des Rois, fit. une dfense laborieuse et
obstine, et disputa pied pied ses provinces l'usur-
pateur. Mais l'imptuosit des Sassanides brisa tous
les obstacles. Artaban succomba. Les restes de sa li-
gne se rfugirent dans les districts inaccessibles de
l'Armnie, abandonnant aux conqurants la Chalde
et la Msopotamie, grenier et trsor de l'Empire, et
l'immense agglomration urbaine de Sleucie-Ctsi-
phon, fonde par les Sleucides, agrandie et embellie
par les Parthes.
Les successeurs d'Ardasir 1, et surtout Sapor 1,
poursuivirent ses conqutes et reculrent les limites
de l'empire des Sassanides. Jamais pourtant, mme
l'poque de sa plus grande extension, leur domaine
ne fut aussi vaste que celui des anciens Achmnides.
A l'ouest, en effet, les lgions camprent jusqu'au
milieu du .v" sicle sur les rives du Tigre. A l'est, la
Bactriane et les pays adjacents taient. constitus en
principauts indpendantes qui subsistaient encore au
v1 sicle. Au nord-ouest, l'Armnie, vassale autrefois
des Arsacides, chappa la domination de leurs hri-
tiers. Elle sera l'enjeu sans cesse disput des guerres
perptuelles qui mettront aux prises Byzantins et
Persans, jusqu' l'avnement de l'Islam.
Restait aux Sassanides le vaste plateau iranien,
inpuisable ppinire de guerriers, avec les marches
L'EMPffiE DES SASSANIDES. 3
du Dlm et du Gurgn - l'ancienne Hyrcanie -
dont les peuplades barbares aux armes
persanes d'intrpides auxiliaires; l'Assyrie, la Baby-
Ionie et la Chalde, rgions fameuses o s'taient di-
fis autrefois de puissants empires, maintenant asser-
vies, et regorgeant de richesses agricoles. Les
populations sdentaires des bords du golfe Persique
et des Iles qui monopolisaient alors le commerce des
perles prcieuses taient soumises au Roi des Rois.
Dans l'intrieur de la pninsule arabique, plusieurs
tribus reconnaissaient la suzerainet des Sassanides.
Les Lakhmides de IJira formaient, lors des guerres
contre Rome, un contingent considrable de cavaliers
agiles et pillards, qui mirent plus d'une fois feu et
sang les plaines de l'Osrhone et de la Syrie, se
repliant avant mme d'avoir t signals aux gnraux
romains.
Tout cet norme territoire comprenait au moins
2.500.000 kilomtres carrs, habits par une popula-
tion trs dense dans les valles et sur les ctes, plus
clairseme sur les hauts plateaux. Comme tendue
et comme richesse, l'Empire des Sassanides pouvait
donc rivaliser, sinon avec l'Empire romain tout en-
tier, du moins avec les deux fractions orientales de
la ttrarchie diocltienne. Mais le rgime intrieur
des deux tats tait, comme on peut le penser, bien
Le gnie oriental n'aurait pu concevoir les formes
rigoureuses de l'administration romaine. Au reste un
principe absolument inconnu des Romains dominait
l'organisation politique de l'Empire perse : le prin-
cipe de l'hrdit. Immdiatement au-dessous du Roi
t. TABARJ, p. et sni v.
~ LES ORIGINES DU CHRISTIANISME EN PERSE.
des Rois, ou, plus justement, ct de lui, les plus
vieilles familles d'extraction iranienne occupaient les
principales charges de l'tat, et se partageaient le
commandement des grandes circonscriptions territo-
riales ou des forces militaires masses sur les fron-
tires de l'Empire
1
Les districts moins tendus taient
administrs par des rads, qui, souvent, appartenaient
l'aristocratie locale. Intermdiaires entre le peuple
et les fonctionnaires, les propritaires terriens jouis-
saient d'une large indpendance
2
Diviss en castes
hirarchiquement subordonnes, les sahrikans et les
dihkans, ils exploitaient leurs biens-fonds, et, l'occa-
sion, dfendaient les paysans ou les bergers contre les
exactions des agents fiscaux, seuls reprsentants di-
rects, proprement parler, des princes Sassanides.
Les valles du Tigre et de l'Euphrate, et la Susiane,
taient seules entirement soumises l'autorit du Roi
des Rois. Quant aux contres plus loignes, et parti-
culirement au Khorasan et aux districts limitrophes
de l'Armnie, leurs gouverneurs, alors mme qu'ils se
rattachaient nominalement la hirarchie adminis-
trative, agissaient plus souvent en vassaux rebelles
qu'en loyaux et fidles sujets. Aussi l'organisation
d'une expdition militaire, par exemple, constituait-
elle, la plupart du temps, une opration longue et
difficile. Les leves d'argent et d'hommes s'effectuaient
sans rgularit, et presque au hasard des circons-
tances. Seuls, des monarques nergiques commeChos-
rau 1, Sapor II ou Chosrau II pouvaient affirmer leur
i. Ces grands officiers s"appelaient Marzbam, c'est--dire : comman
dants de frontires. Le nom de marzban qui se rencontre trs fr
quemment dans les documents chrtiens, correspond peu prs ce
lui de satrape chez les anciens Perses. V. TABARJ, p. iot, n. i.
il. TABAR!, p. 446--'t7
L'EMPIRE DES SASSANIDES. 5
autorit au dedans et combattre avec quelque clat les
ennemis du dehors.
Plus puissant que la noblesse, et parfois que la
royaut elle-mme, le clerg zoroastrien jouit, sous
la dynastie Sassanide,. d'une prpondrance incontes-
te. Suprieurs aux rvolutions politiques, les ma-
ges , ainsi que les appellellt les sources chrtiennes,
formaient la caste la plus stable, et, partant, la plus
influente de toutes. Il serait inexact de prtendre que
les Arsacides s'taient montrs assez mdiocrement
zls l'gard de la religion et des traditions natio-
nales; mais on doit admettre que leurs successeurs,
originaires de la Perse propre, se montrrent des
champions plus nergiques de la doctrine de Zoroas-
tre. Aussi les prtres du feu jouirent-ils d'une autorit
sans gale la cour des Sassanides, particulirement
jusqu'au milieu du v1e sicle.
Leur hirarchie, puissamment organise, tendait
ses rameaux jusque dans les plus petites bourgades
de l'Empire perse. Les humbles desservants des mo-
destes pyres taient troitement rattachs aux mo-
beas, sorte d'vques qui exeraient leur juridiction
sur une province, et dpendaient d'un mobed sup-
rieur, ou mobedan mobed, qui prenait rang parmi
les plus hauts dignitaires de l'tat.
<< Ce clerg, crit M. Noeldeke \ tait aussi puissant
que n'importe quel clerg chrtien, et ne le cdait
personne pour son ardeur perscutrice, comme le prou-
vent notamment les Actes des martyrs. Dans ces r-
cits, les mobeds apparaissent souvent comme dten-
teurs d'un vaste pouvoir excutif. Cependant nous
voyons, d'aprs des renseignements plus complets,
i. TABAR!, p . .Wt et suiv.
6 LES ORIGINES DU CHRISTIANISME EN PERSE.
qu'il s'agit le plus souvent, dans les procdures contre
les chrtiens, de commissions mixtes, composes de
dignitaires ecclsiastiques et lares; ceux-l donc n'au-
raient eu le pouvoir excutif qu'indirectement, ou en
vertu d'une dlgation particulire. Ils taient du reste
aussi des juges proprement dits. D'ailleurs, dans
l'Iran actuel, le clerg possde une influence consid-
rable sur le peuple, bien que l'Islam soit peu favora-
ble la formation d'une caste sacerdotale proprement
dite. Mais dans une religion entirement nationale
(comme l'tait le Mazdisme), dont les seuls reprsen-
tants taient les prtres, ce dut tre le cas dans une
bien plus large mesure. Ils ont ainsi, unis la haute
noblesse, fait la vie dure plus d'un roi. Leur pou-
voir tait toutefois limit par ce fait que, dans les pro-
vinces smitiques riveraines du Tigre, les plus riches de
toutes, o les rois avaient coutume d'habiter, la grande
majorit des habitants, en dpit de tous leurs efforts,
resta attache une autre foi.
C'est parmi les adeptes de ces vieux cultes de l'Assy-
rie et de la Chalde que le christianisme conquit d'a-
bord le plus d'adhrents. Aussi serions-nous heureux
de possder des renseignements prcis sur ces reli-
gions, drives de celles qui nous ont lgu, pour
une priode plus ancienne, de si nombreux et si pr-
cieux documents. Malheureusement aucun tmoignage
contemporain, crit ou traditionnel, n'est parvenu jus-
qu' nous. Force nous est donc de nous contenter
d'une brve et sche mention. Au reste, nous croyons
avoir quelques raisons de conjecturer qu'il n'y avait
plus dans la valle du Tigre, au m sicle, qu'une
poussire de cultes locaux, groups, parfois arbitraire-
ment, en un de ces syncrtismes religieux dont la
Chalde est la patrie d'lection.
L'EMPIRE DES SASSANIDES. 7
Nous sommes fort heureusement mieux informs
par les Talmuds sur l'tat des communauts juives
qui, depuis la dportation gnrale du vu sicle
avant notre re, avaient subsist en territoire perse,
partout o les relations commerciales avaient permis
aux Isralites l'tablissement d'une colonie ou d'un
comptoir.
Sous la dnomination de Babel, les Talmuds com-
prennent toutes les contres arroses par le Tigre et
l'Euphrate, toute la Msopotamie, une partie de la
Grande Armnie, et quelques pays limitrophes l'est
du Tigre. Mais, dans sa plus troite acception, ce
terme gographique reprsente un territoire situ
l'est de l'Euphrate, et se dveloppant depuis Nehardea
au nord, jusqu' Sora au sud, sur une longueur d'en-
viron vingt-deux parasanges (124 kilomtres)
1
Cette rgion tait subdivise en plusieurs districts
qui portaient le nom de leur chef-lieu. Les centres
principaux taient Nehardea, exclusivement peuple de
Juifs, Prozsabur, Pumbadita, Sora, et Ma}:lz (S-
leucie) situe sur les rives du Tigre trois milles de
Ctsiphon. cc Les Judens de la Babylonie, crit Graetz
2
,
taient adonns l'agriculture et toutes sortes de
mtiers. Par suite de leur importance numrique, ils
vivaient en Babylonie presque aussi indpendants que
dans leur propre tat
3
Leur vassalit envers les sei-
gneurs du pays consistait payer certains impts, la
taxe personnelle et l'impt foncier ... Les Judens
1. NEUBAUER, Gographie du Talmud, p. 320. Gnurz, Histoire dea
Jui{1, trad. Bloch, t888, Ill, p. tOI et sui v.
!!. Gnun:, op. cit., p. 1611.
3. Les Juifs de Babylonie passaient pour tre de race plus pure que
ceux de Palestine : Tous les pays sont comme de la pte relative
ment la Palestine, mals ce pays l'est relativement la Babylonie .
T Ull. BAB., trait Qiddulfn, ci l par NEUBAUER, op. laud., p. 3t0.
8 LES ORIGINES DU CHRISTIANISME EN PERSE.
avaient leur chef politique, le prince de l'exil >>, qui
tait un des hauts fonctionnaires de l'Empire perse,
et occupait, dans la hirarchie des dignitaires, le qua-
trime rang aprs le souverain
1
Les exilarques des-
cendaient de la famille de David. Le Resch Galutha
tait, en quelque sorte, un vassal de la couronne de
Perse, le monarque ne le nommait pas lui-mme, il
confirmait son lection. ,,
De tout temps, l'tude de la Loi avait t en hon-
neur parmi les Juifs de Babylonie. Mais, au dbut
du m sicle, des docteurs, instruits dans les coles de
la Galile, fondrent l'cole (sidra) de Sora, qui resta
pendant huit sicles le sanctuaire le plus important
de la science judaque. L'influence de cette cole se fit
bientt sentir; les observances lgales furent l'objet
d'une casuistique et d'une application plus minutieuses;
il parat aussi que le niveau moral des communauts
babyloniennes devint plus lev. A ct de l ' ~ o l e de
Sora brillrent d'un clat moins vif les coles de Nehar-
dea, de Pumbadita et de Mal:u)z.
Les Juifs avaient joui sous les Arsacides d'une large
tolrance. Mais ils furent inquits par Ardasir, lb
fondateur de la dynastie Sassal).ide. Ce zlateur du
culte du feu, irrit sans doute de l'appui que les Isra-
lites avaient donn aux Parthes, dont les troupes, sui-
vant le docteur Levi ben-Sissi, ressemblaient aux
armes du roi David
2
, ne leur pargna point les
vexations et les livra aux perscutions des mages.
Grce des concessions mutuelles, la bonne harmonie
fut bientt rtablie. Mar Samuel, chef de l'cole de
Nehardea, se distingua par son attitude conciliante.
t. M. Noeldeke, TABAR!, p. 68, n.t, considre comme invraisemblable
celte assertion de Griltz.
1. GRAETZ, o p ~ cit., p. 177.
TRADITIONS LEGENDAIRES.
9
Moyennant quelques sacrifices, dont plusieurs durent
paratre bien coteux aux orthodoxes, les Juifs vcu-
rent en paix sous Sapor 1 et ses successeurs.
S 2. -Traditions lgendaires concernant l'introduction
du christianisme en Perse.
Aucun sentiment n'est plus profondment enracin
dans la conscience de l'Eglise chrtienne que celui
de continuer travers les ges la doctrine, la mis-
sion et la personne mme de son fondateur. Telle est
l'importance qui s'attacha de tout temps cette sorte
de lgitimit que, de trs bonne heure, on re-
cueillit avec un soin jaloux tous les indices qui per-
mettaieni aux groupements chrtiens de remonter
jusqu'aux aptres, et, par eux, jusqu' Jsus-Christ.
Les grands siges d'Orient et d'Occident possdaient
des fastes piscopaux plus ou moins complets, et, par
leur intermdiaire, les communauts moins consid-
rables, ou plus rcemment fondes, se reliaient au
collge apostolique.
Ds le haut moyen ce lien purement moral parut
trop lche. On sentit le besoin de matrialiser, pour
ainsi dire, l'ide de l'apostolicit des
glises; et, dans ce dessein, se formrent de toutes
parts des lgendes isoles ou cycliques, dont les
unes embellirent et transfigurrent des vnements,
des situations, des personnages rellement historiques,
ou les reculrent dans le pass; les autres crrent
de toutes pices leurs hros et les gestes de ces hros.
Il n'est, on le sait, presque pas d'glise franaise qui
i. Ainsi les Juifs prirent quelquefois part aux repas des Perses, et
acceptrent de fournir du cbarbon pour le service des pyres.
1.
iO LES ORIGINES OU CHRISTIANISME EN PERSE.
ne se soit ainsi, du rx au xvre sicle, forg une
tradition qui lui permt d'attribuer sa fondation
quelque disciple des Aptres.
L'glise syrienne orientale ne devait pas chapper
la loi commune. Elle le pouvait d'autant moins, qu'
l'poque o elle prit pleine conscience de son autono-
mie, c'est--dire vers la fin du v" sicle , elle se trouva
en conflit de juridiction d'abord, et bientt de doc-
trine, avec d'autres groupements syriens qui se rat-
tachaient par les titres les plus vnrables et les plus
indiscuts la mtropole de l'Osrhone : desse, et
par del au sige patriarcal d'Antioche, rig par
saint Pierre lui-mme. Il devint ncessaire, pour lutter
armes gales, de justifier d'une antiquit au moins
gale celle des glises melkites et monophysites.
C'est quoi s'essaya l'ingniosit des historiographes
et des canonistes nestoriens; et de leurs efforts est
ne une triple srie de documents ou de rcits intres-
sant les origines de l'glise persane.
La thse la plus simple et la plus radicale est celle
de Timothe I, patriarche nestorien de la fin du vm
sicle. Il l'expose en plusieurs endroits de ses crits,
et notamment dans sa longue lettre aux moines maro-
nites
2
Le christianisme, dit-il, tait tabli chez nous
environ cinq cents ans (!) avant Nestorius, et vingt
ans aprs l'Ascension de Notre-Seigneur. Un peu
plus haut, il prtend mme que les Mages ont, ds
leur retour, prch le Messie dans l'Empire perse.
A ces affirmations un peu sommaires, des chroni-
queurs plus avertis substituaient ou peut-tre superpo-
saient une autre thorie. Ils se contentaient de rat-
tacher le sige de Sleucie-Ctsiphon l'aptre saint
1. V. cl-dessous, ch. v.
2. Indite, Ms. Bor!fia, K. VI, " p. a:;a.
TRADITIONS LGENDAIRES. tt
Thomas par une suite ininterrompue de
Ce procd a t adopt par les compilateurs du Livre
de la Tour et par le Jacobite Barhbraeus lui-mme.
La plus ancienne liste qui nous soit parvenue est
celle d'lie de Damas (vers 890) : Addai, Mari, Abrs,
Abraham, Jacob, Al:_ladabuhi, Tomarf;!a, Papa
1
Mare ibn Suleyman (xu sicle) la reproduit en la
modifiant quelque peu: Nathanal, Adda, Agga, Mari,
Abrs, Abraham, Jacob, Al:_ladabuhi, Sal:_llufa, Papa
2
Salomon de Baljlra
3
et (xm sicle)
ainsi que les abrviateurs Amr et (xrv sicle
ont copi Mare ibn Suleyman.
Parmi ces premiers vques de Sleucie, les uns
sont donns comme parents de Jsus (Abraham,
Jacob), les autres (Addai, Mari, Agga) sont les aptres
d'desse ou leurs disciples; enfin Al:_ladabuhi et Abrs
auraient t ordonns vques Antioche. Mais ici
se prsentait une difficult considrable. Si le catho-
licat de Sleucie n'tait qu'une dlgation du patriarcat
d'Antioche, comment le mettre de pair avec ce sige
illustre, comme les Persans, ds le v sicle , en
mirent la prtention ?
Aussi produisait-on une lettre des Pres occiden-
taux , c'est--dire des vques syriens dpendant du
patriarcat d'Antioche, date du commencement du
n sicle. Cette lettre, dont l'authenticit a t admise
galement par les nestoriens et les jacobites, et, aprs
eux, par Assemani
5
, assurait au catholicos de Sleucie
une autonomie absolue, et, en raison des difficults des
temps, lui permettait de recevoir, en territoire arsa-
t. Bibl. orient., t. 11, p. 392.
!. MARE, p. 1 et suiv.
3. Livre de !"abeille, cit dans Bibl. orient., t. II, p. 387
4. Chron. eccl., II, col. H et suiv.
5. Bibl. orient., t. III, p. 51 et sui v.
1.2 LES ORIGINES DU CHRISTIANISME EN PERSE.
cide, la conscration patriarcale, sans tre oblig de
faire le voyage d'Antioche. On racontait ce propos
1
que AJ:.tadabuhi, lorsqu'il vint se faire ordonner dans
la mtropole de l'Orient romain, s'tait fait escorter
d'un certain Qamiso ou lahbiso'. Les soldats imp-
riaux se saisirent de ce Qamiso<, prtendirent qu'il
espionnait pour le compte du roi de Perse, et le cru-
cifirent la porte de la Grande glise d'Antioche.
AJ:.tadabhi ne dut son salut qu' une fuite prcipite.
Pour prvenir de semblables catastrophes, les Pres
occidentaux auraient promulgu l'exemption que
nous avons signale plus haut. Les chronographes
nestoriens savent encore le nom du porteur de la mis-
sive : Agapet, vque de Beit Lapat. Comme cet Aga-
pet est un des orateurs du synode tenu par Dadiso en
424
2
, nos bons annalistes commettent un modeste
anachronisme de plus de deux sicles.
Enfin un troisime systme rattachait directement
la fondation de l'glise persane l'origine mme
de l'glise syrienne d'desse. Adda, dont on faisait
un des soixante-douze disciples, aurait, d'aprs un
texte de la dclaration des vques nestoriens Chos-
rau II (612)3, vanglis lui-mme la valle du Tigre,
avec l'aide de deux disciplf)s: Agga et Mari.
Une pice hagiographique, dite sous le titre .
d'Acta Maris
4
, attribue exclusivement ce dernier
personnage la fondation de l'glise de Perse. Aprs
la mort d'Adda, dit ce document, Mari quitte desse
pour se rendre Nisibe, o il renverse les idoles
et btit plusieurs glises et monastres. De l il se
t. MARE, p. Il. 'Alla, p. 4. B&nBBIIAEUs, Chron. eccl., IJ, p. '16.
i. Syn. orient., p. !194.
3, Syn. orient, , p. 58t.
4. Acta Maf'is, d. Abbeloos. Louvain, t88S.
CRITIQUE DE CES TRADITIONS.
t3
dirige vers le nord Arzun, accompagn du prtre
Onsime et de quelques disciples : Tomis, Philippe,
Malkiso et Ada. Il dtache Philippe Qardu, et des-
cend lui-mme le Tigre. Il prche l'vangile Arbel
et sur les rives du grand Zab, dans les provinces
d'Atur et de Ninive, et les rgions circonvoisines. To-
mis se spare de son mattre, et pntre dans les
hautes valles du Dasen, et jusque dans les monta-
gnes du Kurdistan et de la Mdie. Il meurt martyr
Gawar, prs du lac d'Ourmiah.
Cependant, Mari poursuit sa route vers le sud. Il
convertit le Beit Garma, et le Beit Aramay, c'est-
-dire le district avoisinant la capitale, et fonde deux
rsidences Dar-Qni sur le Tigre et Kk
1
Aprs
une course apostolique en Susiane et en Perse, il
revient Dar-Qni o il meurt en paix, aprs avoir
sacr son successeur, l'vque de Sleucie Papa.
S 3. - Critique. de ces traditions.
Ni l'un ni l'autre des deux premiers systmes ne sau-
rait tre admis par la critique historique. Nous en avons
dj signal le caractre artificiel et tendancieux. Mais
ce qui les frappe d'une condamnation sans appel, c'est
qu'ils n'apparaissent qu'au IX" sicle, c'est--dire une
poque trs tardive. Ni les Actes des Conciles orien-
taux, ni les Passions des Martyrs persans, ni aucune
autre pice hagiographique ou canonique antrieure
la chute de l'empire sassanide, ne concorde avec les
documents que nous avons sommairement analyss
2
i. L'ancien nom de Sleucie. Syn. orient., p. !!611, n. i.
i. A peine pourrait-on mentionner le passage des Actes de D a d l ~ o
Syn. orient., p. !IIH, o Il est dit que Papa sera proclam dans les dip
tyquea avant ae8 prdceaseur&.
i4: LES ORIGINES DU CHRISTIA."'l'ISME EN PERSE.
A premire vue, on serait tent de formuler une
apprciation beaucoup plus favorable sur les Acta
Jlaris, qui prtendent donner un rcit complet et cir-
constanci de l'vanglisation de la Perse par les dis-
ciples de l'dessnien Adda. Mais M. Duval a montr
que cette relation est dpourvue de toute valeur. On
n'y surprend, crit-il
1
, aucun souvenir prcis des temps
paens; les populations que I'!iptre convertit adorent
des dmons habitant des arbres ou des pierres; c'est
peine s'il est fait allusion au culte des astres en Ba-
bylonie ou au culte du feu en Perse. Les miracles que
l'aptre accomplit n'ont aucun caractre original; ce
sont des arrangements de miracles connus par ailleurs,
notamment par le livre de D ~ n i e l . Et il conclut que
la rdaction de ces actes n'est pas antrieure au
v1 sicle.
A ces critiques, nous pourrions en ajouter d'autres.
Ainsi, l'anonyme auteur des Acta Maris fait vang-
liser par les disciples de son hros des rgions mon-
tagneuses o le christianisme n'a pntr que vers
la fin du v sicle
2
L'importance donne la fondation de l'glise de
Dar-Qni est non moins surprenante. En effet, cette
insignifiante localit n'est mentionne qu'une seule fois
dans les actes synodaux
3
; aucun historien antrieur au
1x sicle ne la signale comme centre ecclsiastique
ou monastique. Ce silence s'expliquerait-il si, comme
le veulent les Acta Maris, cette obscure bourgade
avait pu, ds les temps anciens, se glorifier de pos-
sder et la chaire piscopale et le spulcre vnr _du
premier aptre de la Perse?
1. Litt. syriaque, p. H8.
!1. Vie de Saba, le convertisseur de paens. HoFFMANN, Amzge, p. 68
et suiv. v. cl-dessous, ch. vi, p. 151!.
3. Syn. orient., p. !187.
LES JUDO-CHRTIENS. 15
Ce sont l de graves objections qui militent contre
l'antiquit de la lgende de Mari, et nous portent lui
dnier toute valeur historique. Les Acta Maris sont,
croyons-nous, une pice assez tardive, compose dans
le but de rehausser l'importance du modeste village
de DarQni, et d'en faire un lieu de plerinage pour
tous les chrtiens orientaux. Secondairement, l'hagio-
graphe anonyme se proposait de revendiquer, au profit
des Nestoriens, le nom 'et la doctrine d'Adda dont
les Monophysites se prvalaient hautement. D'autres
compilateurs firent venir en Chalde Adda lui-mme,
accompagn de ses disciples Agga et Mari. Plus
rserv, notre rdacteur se borne faire parcourir tout
le domaine de l'glise persane par les compagnons
de l'illustre aptre d'desse.
Malgr ces difficults, il est, croyons-nous, possible
d'admettre la ralit du personnage de Mari. En effet,
l'Histoire de Beit Slokh, antrieure au moins d'un sicle
nos Actes, le mentionne comme collaborateur du
saint aptre Adda dans l'vanglisation de la pro-
vince de Beit Garma . Le contexte a, il est vrai, une
savettr incontestablement lgendaire. Aussi est-ce
sous les plus expresses rserves que nous retiendrons
les informations qu'il nous. fournit.
S4:. -La chrtient d'Orient avant le milieu du m sicle.
A ces documents sans grande valeur, il ne nous est
malheureusement pas permis de substituer des don-
nes de bon aloi, touchant les origines du christia-
nisme dans l'Empire perse. A peine pouvons-nous
avancer quelques timides conjectures.
i. HorrliiANN, Au&zge, p. 4ts.
i6 LES ORIGINES DU CHRISTIANISME EN PERSE.
Le christianisme a probablement pntr en Baby-
Ionie et en Chalde ds l'poque de sa fondation. Les
Actes des Aptres mentionnent, parmi les tmoins
oculaires du prodige de la Pentecte, des Parthes,
des Mdes, des lamites et des habitants de la Mso-
potamie : ll!lp6o1 xl M1j8o1 x\ 'Elrtf1--rl, x\ ot x-rot-
xovn Maao7to-rrtf1olrtv Ce texte atteste, pour le moins,
que vers l'an 80, les glises du monde grco-romain
connaissaient l'existence de communauts chrtiennes
dans les lointaines contres de l'Orient
2
Il est vraisemblable que l'activit missionnaire de
ces premiers chrtiens se restreignit aux colonies
juives, si florissantes en Babylonie. Mais leur apos-
tolat n'obtint qu'un mdiocre succs. C'est ce que nous
estimons pouvoir dduire d'un court rcit qui nous a
t conserv par le Talmud de Jrusalem. On raconte
que Hananie, un neveu de Joshua, s'tait affili la
communaut chrtienne de Capharnam. Son oncle,
qui naturellement blmait cet acte, le contraignit
cesser toute relation avec les chrtiens, et, pour le
soustraire leur influence, l'envoya en Babylonie
3
"
Peut-tre les judo-chrtiens furent-ils exclus des
synagogues et contraints, par suite, d'en-
trer en relations avec les paens, mais ce point est
fort douteux. Cependant les Mandens, derniers repr-
i. Act., n, 9.
!. La tradition unanime des glises syriennes veut que saint Tho-
mas ait t l'aptre des populations aramennes. Mais cette attribution
qu'a enregistre Eusbe de Csare (Rist. eccl., 1, i3) est peut-tre l-
gendaire (HARNACK, Die Mission und Ausbreitung des Chri&tentums,
p. 440).
D'aprs MARE (p. !), trois aptres auraient concouru l'vanglisation
del'glise orientale: Nathanal-Barthlemy, Thadde-Lebbe etThomas.
Cf. pour ce dernier, les Acta Thomae, dits par WRIGHT: Apocryphal
act& of the Apostles, et critiqus par LtPSJus: Die apokryphen Apoltel-
geschichten, J, p. \liS et sul v. Le texte grec a t dit par Mu BONNET,
Acta Thomae, Leipzig, i883. v. Litt. 1yriaque, p. 98 et soiv.
3. Cit dans GRAETZ, Biatoire des Jui(l, t. III, p. ISt.
LES JUDO-CHRETIENS. ti
sentants du vieux paganisme chalden, paraissent
avoir connu et estim les Nazarens , bien que le
nom de Jsus ne se rencontre pas dans leurs crits
les plus anciens. Au reste, nous connaissons trop im-
parfaitement les gnoses babyloniennes et chaldo-
perses, comme le mandasme et le manichisme, pour
pouvoir essayer, avec quelque succs, de dterminer
les rapports, d'ailleurs problmatiques, du christia-
nisme avec ces tentatives de syncrtisme religieux et
philosophique .
Quoi qu'il en soit, le judo-christianisme n'a laiss
aucunes traces. Tout nous porte croire qu'avant
!;avnement de la dynastie sassanide, l'Empire perse
ne contenait pas de communauts chrtiennes organi-
ses. Ce n'est gure que vers 250 que le christianisme
catholique , issu des grandes luttes qui divisrent
au ne sicle les glises du monde grco-romain, avec
ses dogmes nettement dfinis, et sa hirarchie rigou-
reusement constitue, put tendre ses conqutes jus-
qu'aux rives du Tigre
2
i. Voir sur ce sujet BRANDT, Die mandiiische Religion, ihre Entwicke
lung und gelchichtliche Bedeutung, t889, p. UO-t.W.
Ce chapitre tait depuis longtemps termin, lorsque j'ai eu connais-
sance de la thse de M. Westphal : Unter&uchungen ber die Quellen
und die Glaubwrdigkeit der potriarchal Chroniken. M. w. discute et
critique les rcits de Mare, de 'Amr et de l'interpolateur de ce dernier
Sallba ibn Jol}annan, jusque dans leurs derniers dtails. Je suis heu-
reux de constater que ses conclusions concordent presque partout avec
les miennes. Il crit notamment, p. 3t : Ces arguments attestent tout
au plus l'existence de l'vanglisateur Mari , et p. 43, propos de Abrs
Abraham et Jacques: Dans l'histoire de la vie des trois vques persans
nomms en dernier lieu, tout est silrement lgendaire. On avait besoin
de quelques hommes pour combler une lacune entre Mari et Papa.
Il admet cependant qu'Abrs, et Sal)lufa ont t des per-
sonnages historiques, prdcesseurs de Papa, qui toutefois n'ont eu
qu'une action assez restreinte (p. 44). Nous avons not que le synode
de Dadii!!o' suppose Papa des prdcesseurs, dont il ignore du reste les
noms. Mals l'autorit de nos listes piscopales est nulle, et l'on ne voit
pas sur quel critrium se fonderait l'historien pour leur emprunter tel
11om plutt que tel autre.
CHAPITRE II
L'ORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE
AU COMMENCEMENT DU JV
0
SICLE
S 1. - L'uvre de Papa : ses luttes pour tablir la
primaut du sige de Sleucie-Ctsiphon.
Sozomne
1
, si bien inform des choses d'Orient,
attribue la fondation des chrtients persanes aux
dessniens et aux Armniens. Force est l'historien
de se contenter de ce renseignement sommaire. Les
Armniens, dont la conversion au christianisme date
du commencement du IV
0
sicle, ne purent gure,
avant cette poque, exercer une influence srieuse sur
les provinces limitrophes de l'Arzanne et de l'Adur-
baidjan. desse fut, au contraire, ds le dbut du
111
8
sicle
2
, un centre de missions des plus actifs
pour tous les pays de langue et de population ara-
menne. Les lgendes relatives l'aspostolat de Mari
et d ses disciples que nous avons dd rejeter attestent
t. Ilist. eccl., II, 8. MIGNE, Patr. Graec., t. LXVll, col. 956: xcxl Ilepawv
-ri)v clpX'/IV Tjyo!'CXI llao1 'rij 'rij; 'Oapo'/lv&iv
xcxl W e!xo, cx-r661 livpcXaiY wp.O.'/I<rCIY
xl 'rij cxT&iv pe'tij; .,;e1pli6'11acxv.
2. Cf. LIPSIUS, Die edessinische Abgarsage, t880. TIXERONT, Lu Origines
de l'glise d'desse, {888. R. DUVAL, Histoire d'de11e, t891. HARNACK,
Die Mission und Ambreitung de& Christentums, t903, p. 4t0 et suiv.
L'UVRE DE PAPA. i9
d'avoir t ere et organise par des missionnaires
d essniens'
Les habitants des provinces romaines cis-euphrati-
ques durent aux dportations ordonnes par Sapor 1
et ses successeurs de collaborer galement l'vang-
lisation de la Perse. Reprenant l'antique tradition des
Achmnides, les rois Sassanides, au cours de leurs ex-
pditions en Syrie, dpeuplaient des districts entiers au
profit de la Babylonie, de la Mdie et surtout de la Su-
siane. S'il est difficile d'admettre que la grande ville du
Huzistan, GundSabur(BeitLapat),futbtie et colonise
uniquement par les captifs romains, il est incontes-
table qu'un grand nombre d'entre eux furent employs
la construction d'importants ouvrages hydrauliques
2
dont les ruines subsistent encore. Or la Clsyrie,
pays d'origine de ces industrieux prisonniers, tait, au
m sicle, presque moiti chrtienne
3
, et il n'est pas
tmraire de penser que plusieurs bourgs chrtiens,
avec leurs vques, furent dports en terre persane,
et y constiturent des diocses
Une lgende sans grande autorit veut mme que
l'vque d'Antioche, Demetrianos, emmen en capti-
vit avec l'empereur Valrien, ait ainsi fond le sige
du moins. que la chrtient persane avait conscience
:1. M. HARNACK (Die Mission und Ausbreilung des Christentums in
den ersten drei Jahrhunderten, p. 441 et sui v.) a runi les textes des
Pres relatirs l'extension du Christianisme en Msopotamie et dans
J'empire perse. Denys d'Alexandrie cit dans Eusbe (Rist. eccl., VII, 5)
cannait des glises chtiennes en Msopotamie et sait qu'elles sont en
relation avec les autres glises. Le mme Eusbe (Praepar. ev., VI, :10,
46) cite les chrtients de Parthie, de Mdie, de Perse, de Bactriane, et
du pays des Gles. Cf. Vita Con&tantini, IV, 8 et 43.
!il. TA BARI, p. 33, n. !il et 3!1, n. :1 et t sur la dportation des habitants
d'Antioche.
3. HARNACK, op. cit., p. t37 et sui v.
t. cr. par exemple, la dportation des habitants de Phoenek (M. O.,
p. :lM). Cette dportation fut d'ailleurs ordonne par Sapor 11.
20 ORGANISATION DE L'EGLISE AU IV
8
SICLE.
de Beit Lapat, aux environs de l'an 260
4
L'Histoire
de Beit Slokh ~ attribue un nom grec : Thocrate ou
Thocrite, au premier vque de cette ville. Nous ajou-
terons que si, comme l'ont cru saint Jrme, Socrate et
tous les annalistes et hrsiologues de l'antiquit, d'a-
prs les Acta Archelai cum Manete, et avec eux le
plus moderne historien de Mani, M. Kessler
3
, des po-
lmiques entre chrtiens et manichens eurent relle-
ment lieu vers 270 dans le district de l:1ralvou Xilp,
le nom traditionnel d'Archelas donn l'vque de
Kaskar n'est pas inadmissible.
Quant au sige de Sleucie-Ctsiphon, nous le voyons
occup dans le dernier quart du me sicle, par un
Aramen : Papa bar Aggai
4
, dont la tradition du
moyen Age fait un disciple de Mari.
Aucun lien ne rattachait ces glises les unes aux
autres. Les circonscriptions diocsaines taient assez
vaguement dlimites. Une mme ville pouvait poss-
der la fois plusieurs vques. C'tait, mme aux envi-
rons de 340, le cas de Beit Lapat dont les deux pas-
teurs, Gadiab et Sabina, subirent ensemble le martyre
5
Au commencement du 1v sicle
6
, Papa bar Aggai
t. MARE (p. 7) rapporte que les captifs romains de Gundesabur au-
raient dit au patriarche dport Demetrianos : Tu es patriarche d'An-
tioche, garde ton titre, et dirige les captifs qui sont avec toi. Deme-
trianos rpondit : Dieu me garde de faire ce qui ne m'est pas
permis. Alors le catholicos Papa lui permit de garder le titre de
patriarche comme Antioche, et de rester le chef des chrtiens captifs;
mais il s'en dfendit. Papa le cra mtropolite de Gunde!\abur, et lui
donna le premier rang l'ordination du catholicos. Ce rcit fourmille
d'invraisemblances et d'anachronismes. Cf. WESTPBAL, op. cit., p. Gi.
2. HOFFH.l!IN, Auszge, p. 46. BEDJ., Il, p. 5t3.
3. M.l!IJ, p. 88 et suiv. Il est sur ce point en conformit avec MARE,
Cf. l'art. Mani dans HERzoc's Realencykl., t. Xli.
4. Syn. orient., p. ll89.- AssEMAIII, M. 0., p.7ll.- MARE, p. 7,- 'AMR,
p. 8. B. H., col. !7 et suiv.
5. M. O., p. A.t, n. !4.
6. Il serait intressant de connaltre le nombre exact des vchs fon-
-
L'UVRE DE PAPA
1
2i
forma le dessein de fdrer toutes les chrtients per-
. sanes sous l'hgmonie de l'vque des Villes Royales :
Sleucie-Ctsiphon, agissant comme dlgu gnral,
pour l'empire sassanide, des pres occidentaux ,
c'est--dire des vques de la Msopotamie et de la
Syrie euphratsienne.
Son projet souleva les plus vives oppositions l. Si les
renseignements contenus dans la correspondance apo-
cryphe de Papa mritent quelque considration, les
principaux adversaires de l'vque de Sleucie furent
Aqbalaha
2
, IJabib, Mils et Simon Les
ds dans l'empire perse ceLte poque. Malheureusement nous n'en
possdons pas de liste complte.
Les Actes des martyrs ou Je Catalogue anonyme de tt, publi par le
R. P. van den Gbeyn, auestent pour Je milieu du v sicle: dans le Nord,
les vchs de BI!:ITZABDE (M. O., p. i34), (M. 0., p. Sj), ARBEL
(M. O., passim, et Calai.); dans le Centre : les vcbs de KAIIKA DE BEIT
SLOIW (M. o., m, !30, Calai. Hist. de Beit S/okh), SABRQ!RT (Catal. Hist.
de Beit Slokh), BEIT NIQTOR (M. 0., p. !iBO), KAS &AR (Ca tai. M. 0., p. illi).
MASKEl'IA (Catal.); dans le Sud : les vchs de PERAT DE M.I.IA.I.K (M. 0.,
p. M, 83.Calal.),BEIT LAPAT (M. O., p. 80. Cala).), SUSE(M. 0., p.St. Catal.),
HORIIIZDAnnAAm (catal.). Sur le plateau iranien : les vchs de REWAR
D.I.SIR (CataJ.), et de IJOLWA!f (CataJ.). ).'vch de NISIRE fut fond en 300/i
par Babu. Ce prlat mourut en 309, et eut pour successeur le clbre
Jacques. (LIE DE NISlBE, Cit dans B. II., col 3i n. i .)
i. M. BIUUN a tudi avec soin les sources de ce con Dit. Ce sont les
annalistes, le synode de Dadiso' (Syn. orient., p. !90 et suiv.),les Actes de
Mlls (M. 0., p. 7!!) et une correspondance apocryphe du catholicos
Papa : Der Brie{wechsel dea Katholikos Papa von Seleucia (Litt. syr.,
p. 136, n.t). Nous ne pouvons admettre, comme le fait Braun, qu'il y
ait dans eette correspondance des parties apocryphes et des parties au-
thentiques. Si le dossier primitif avait exist et s'tait partiellement con-
serv, comment comprendre que le morceau capital, la lettre des Pres
occidentaux, ait t gar, et reconstitu depuis par un faussaire?
Quant l'origine du dossier, Barhbraeus (Chron. eccl., Il, col. 3i) la
faisait remonter au catbolicos Joseph 1. Si les Actes de Dadiso' sont au-
lbentiques, comme on l'admet gnralement, il faut en conclure qu'au
v sicle on connaissait dj une lettre des Occidentaux (apocryphe, bien
entendu). Autour de celle pice fausse, mais qui jouissait dans son temps
de l'autorit canonique, Joseph aura pu, au v1 sicle, grouper de pr-
tendues lettres de Papa. La question est loin, du reste, d'tre tire au
clair. ,
!Il. Sans doute l'vque de Karka dont il est question dans l'Histoire
de Beit Slokh. HOFF.HA!fl'l, Amzge, p. 48, BEDJ., II, p. 575. - f.labib est
22 ORGANISATION DE L'GLISE AU IV SICLE.
deux derniers sont mentionns dans deux documents
du v sicle : les Actes du synode de Dadiso, et la
Passion de Mils attribue Maruta. Mils reprsen-
tait les collgues de Papa, et Simon les propres clercs
du fils d'.Aggai, mcontents de leur chef.
Les conjurs rpandent des libelles contre Papa; ils
l'accusent de murs honteuses
1
A cette imputation
invraisemblable contre un vieillard ils ajoutent d'autres
griefs : son orgueil intolrable
2
, son peu de respect
pour le droit ecclsiastique : il aurait ordonn deux
vques pour un seul sige
3
Un synode se runit, o
les coaliss s'taient assurs la majorit. L'vque de
Sleucie, prvoyant sa dfaite, s'irrite, il prend le livre
des vangiles tmoin de son droit. Mais la violence
de son indignation lui cause une attaque de
l'quivalent aramen du grec Agapet. Ce nom fut port par plusieurs
vques de Be il Lapat, notamment par un des orateurs principaux du
synode de Dadiso', en 424 (Syn. orient., p. i89 et sui v.). Mils est le fa-
meux vque martyr de ce nom (M. O., p. 66 et suiv.). Simon est l'ar-
chidiacre (?) de Papa qui devint son successeur (M. O., p. tiS et suiv.
!IAnE, p. 9. Syn. orient., loc. cit.).
t. Chron. eccl., II, p. 30.
!1. Acta Milis, AsSEIIAIII, M. O., p. 711.
3. MARE, p. 7.
4. Nous possdons de cet vnement deux versions, l'une favorable
la primaut du sige de Sleucie, l'autre ses adversaires. Nous
lisons la premire dans les Actes du synode de Dadiso', la seconde dans
les actes du martyr Mils. Toutes deux attestent nettement le fait prin-
cipal. Synode de Dadilo' (ms., p. 46; trad., p. 1190): De ces rebelles,
les uns s'taient faits accusateurs, les autres tmoins; et Mar Mils avec
les vertueux vques comme lui reut les tmoignages de ces re-
belles en qualit de juges. Alors qu'ils n'avaient pas le droit de se faire
juges, ils prononcrent la dposition et la destitution de Mar Papa.
&!ar Papa, voyant que la justice s'en tait alle de cette assemble ...
et apercevant l'vangile plac au milieu, alors qu'Il n'y avait point de
juste discussion entre lui et l'assemble, s'irrita dans une grande colre
et frappa l'vangile en lui disant: Parle, parle, vangile! Quoi! tu es
plac comme un juge au milieu, tu vols que la vrit s'est loigne des
vques honntes, aussi bien que des pervertis, et tu ne cries pas ven-
geance pour la justice! Mais comme il ne s'tait pas approch de
l'vangile avec crainte et respect, et n'avait pas plac la main dessus
L'UVRE DE PAPA.. 23
Le rsultat du synode fut sans doute la dposition
de Papa
4
, et la conscration sa place de Simon Bar-
~ a b b a . Le vaincu recourut aux Pres occidentaux,
nous ignorons par quelle voie. Les termes de la r-
ponse de ces vques ne nous sont pas connus . Peut-
tre dputrent-ils un envoy, comme plus tard Maruta
et Acace
3
, pour examiner la question et la trancher
sur place. Quelque forme qu'ait revtue l'intervention
des prlats syriens, elle fut dcisive en faveur de leur
comme un homme qui cherche du secours, Mar Papa fut sur-Ie-champ
frapp de chtiment dans son corps.
Acte& de S. Mile (M. o., p. 72; BEDJAII, 11, p. !:166 et sui v.) : 1 Il descendit
(lllils) au Beit Aramay. Il y rencontra une grande discorde au sujet de
l'vque de Sleucie-Ctsiphon, qui s'appelait Papa, fils d"Aggai. Il vit qu'il
ddaignaltlesvques des provinces quiB'taient runis l pour le juger,
et qu'il mprisait les prtres et les diacres de sa ville. Connaissant l'or-
gueil de l'homme et sa chute loin de Dieu, il se leva au milieu d'eux; ill ut
dit: Pourquoi oses-tu t'lever au-dessus de tes pres et de tes membres
(collgues) et les envies-tu vainement et sans cause, comme un homme
sans Dieu? N'est-il pas crit : Celui qui est votre chef doit tre votre es-
clave? Papa lui dit: Fou, c'est toi qui va m'apprendre ces choses? comme
si je les ignorais! Alors Mils tira l'vangile de sa besace etle plaa
devant lui sur un coussin, et lui dit : Si tu ne veux pas tre instruit par
moi qui ne suis qu'un boinme, sols jug par l'vangile du Seigneur que
j'ai plac devant tes yeux extrieurs, puisque tu ne vois pas son ordre
par l'il cach de ta conscience. Papa, saisi d'une violente colre, lve
sa main, dans sa fureur, et en frappe l'vangile, en disant : 1 Parle,
vangile, parle! Saint Mils fut mu; il courut prendre l'vangile, ille
baisa, et le mit sur ses yeux. Puis, levant la voix, de faon tre en-
tendu de toute l'assistance, il dit : Puisque dans ta superbe tu as os
attenter aux paroles vivantes de Notre-Seigneur, son ange va venir te
frapper sur ton ct et le desscher, et la crainte et la terreur envahi-
ront beaucoup d'hommes. Tu ne mourras pas sur-Ie-champ, mais tu
resteras comme signe et prodige. Aussitt, il (l'ange) descendit du ciel
comme la foudre, ille frappa et desscha son ct. Il (Papa) tomba sur
son ct avec une douleur indicible, et [y demeura] pendant douze an-
nes.
Ces deux versions ne sont ni l'une ni l'autre originales. Mais elles d-
pendent d'une tradition commune qu'il n'y a pas lieu de suspecter.
t. BAIIBBRUus (col. 30) rapporte une tradition d'aprs laquelle Papa
n'aurait pas t dpos, les vques estimant que son attaque de pa-
ralysie constituait un chtiment suffisant.
2. Celle que transcrit AssEIIANI d'aprs 'Abdio' (Bibl. orient., 111, p,ISil
el sni v.) est videmment apocryphe. v. ci-dessus, p. tt.
3. Voir ci-dessous, ch. v.
ORGANISATION DE L'GLISE AU IV" SICLE.
collgue de Sleucie-Ctsiphon. Les Actes de Dadiso'
nous apprennent que toute la procdure contre Papa
fut annule. Les fauteurs du schisme furent excommu-
nis et privs de leurs dignits ecclsiastiques, sauf
quelques-uns dont on admit les excuses et les rtrac-
tations. Simon en particulier put prouver
qu'on l'avait contraint de recevoir l'piscopat, et fut
maintenu au rang d'archidiacre, avec future succes-
sion. Cette sorte de compromis semble indiquer que
la vertu et la bonne foi ne furent pas les seules raisons
qui empchrent certains adversaires de Papa d'tre
dposs. Les excutions ne furent pas aveugles, et
l'on prit tche de mnager l'opposition qui parat
avoir t trs puissante.
Telle est la premire crise intrieure de l'glise de
Perse dont l'histoire nous ait transmis le rcit. Elle
devait tre suivie de beaucoup d'autres, causes soit
par l'ambition des mtropolitains provinciaux, soit par
les dissensions intestines du clerg de la capitale.
La perscution mme fut impuissante supprimer
les abus et les comptitions. Dans sa x1v homlie
4
crite en 344, c'est--dire plusieurs annes aprs la
promulgation de l'dit de perscution gnrale, le
Sage Perse , Afraat, trace un tableau peu flatteur de
l'glise de Sleucie. Les orgueilleux, les avares, les
envieux, les simoniaques taient nombreux parmi les
clercs de cette mtropole : << Quand les hommes reoi-
vent de nous l'imposition des mains, ils ne font atten-
tion qu' cette imposition. De notre temps, on ne
trouve pas facilement quelqu'un qui demande: Qui
craint Dieu? mais plutt: << Qui est le doyen d'ordi-
i. Sur les homlies ou dmomtrations d'Afraat, v. Litt. syr., p. m
et suiv., et ci-dessous, p. 3>1, n. i.
li. AFR.t.AT, d. Parisot, col. 677.
.s:u.cz .
L'UVRE DE PAPA.
25
nation? Et ds qu'on a rpondu : C'est un tel, ils
lui disent : u Tu dois occuper la premire place .
On remarquait leur tte un vque, notre frre,
orn de la tiare
2
; mal vu de ses compatriotes, il alla
chercher d'autres rois loigns, et leur demanda des
chanes et des liens qu'il distribua dans son pays et
dans sa ville. Il aurait dt\ plutt, ce roi, orn de la
tiare, demander aux rois ses collgues des cadeaux,
qu'il aurait distribus aux princes et aux citoyens de
son pays et de sa ville, au lieu de chanes et de liens. ,,
Il lanait des excommunications ses ennemis et tol-
rait chez ses partisans une conduite scandaleuse : Si
quelqu'un fait le mal, mais a l'heur de plaire aux
directeurs de la prison, ils le dlivreront de ses chai-
nes et lui diront : Dieu est misricordieux; il te remet
tes pchs, entre, viens prendre part la prire. Mais
si on leur a dplu, mme lgrement, ils lui disent :
Tu es li et anathmatis par le ciel et par la terre.
Malheur aussi qui lui adresse la parole
3
!
La sagacit des critiques s'est exerce sur ces textes;
et l'on a cherch qui dsignaient ces allusions, sans
doute transparentes pour les contemporains. M. Be1t
1
a pens qu'il tait question d'un satrape chrtien qui
aurait maltrait ses concitoyens au lieu de les gagner
par la douceur de son administration. Cette hypothse
n'est pas vraisemblable. Il est vident que l'homlie
tout entire tend remdier aux dsordres qui s'-
taient introduits dans la socit chrtienne, et, plus
spcialement, dans le corps ecclsiastique. Le tyran
qui excommunie , qui bouleverse les familles et les
t. Col. 633.
i. Col. 1187.
3. Col. 708.
4. Texle und Untersuchungen, t. JJI, p. llH, n. !il.
2
26 ORGANISATION DE L'GLISE AU IV SICLE.
cloitres, c'est un vque, et la suscription de l'ho-
mlie permet d'ajouter que c'est un vque de Sleu-
cie. Cet est sans doute mort, car la lettre est
adresse une assemble d'vques, de prtres, de
diacres et de fidles runie Sleucie, et non pas au
titulaire de ce sige. Peut-tre cette runion avait-
elle pour objet le choix d'un nouveau prlat. Dans le
pays d'Afraat se tenait un autre synode, et c'est au nom
de ce synode que le u Sage Perse crit son exhor-
tation.
On a estim que le tyran vis par Afraat pourrait
bien tre Papa. Certaines donnes de la dmonstra-
tion XIV conviennent, en effet, au cas de ce clbre
vque. Le roi qui va demander aux rois loigns
des chanes et des liens dont il charge ses compa-
triotes coupables de ne pas tre d'accord avec lui
reprsenterait assez exactement Papa recourant aux
Pres occidentaux pour en obtenir l'annulation de
la procdure institue contre lui par ses collgues
de Perse.
Cette identification souffre toutefois plus d'une diffi-
cult. D'abord, le concile dirig contre Papa s'est
vraisemblablement runi avant 325
1
; l'homlie -x1v est
crite plus de vingt ans aprs. Or les faits qui y sont
rapports semblent assez rcents, et l'impression
1. Je renonce, pour ma part, essayer de dterminer la date de ces
vnements en coordonnant les renseignements fournis par des anna-
listes dont aucun n'est antrieur au x11 sicle. M. WESTPHAL (op. cit.,
p. 8:il-84) a cru pouvoir assigner la date de 313/4 au synode de Papa.
Ilia calcule en fonction du martyre de Simon le successeur
de Papa, et d'une donne de la Passion de Mils suivant laquelle l'-
vque de Sleucie aurait survecu douze ans son attaque de para-
lysie. (Cite ici mme, p. ti, n. 4.)
Cette dernire information est sujette caution, cause du carac-
tre tendancieux des Acta Milis qui diminue singulirement leur
valeur historique. A mon avis, Il est imposalble d'etablir une cbrono-
logla solide pour les annes qui ont prcd la perscution de Sapor 11.
L'UVRE DE PAPA. 27
qu'Afraat en a reue parait encore trs vive. En effet
dans sa x
8
homlie sur les Pasteurs crite en 33617,
le Sage Perse traite ex professo d'un sujet analogue
celui de l'homlie xiv. Il y est galement question des
devoirs qui lcombent aux vques et des qualits
requises pour Occuper les prlatures. Or, notre au-
teur se borne a. considrations gnrales, et ne se
dpartit aucun mo111lent du calme qui convient l'ex-
position mthodique ae la doctrine spirituelle. Dans
l'homlie xrv, au contraire, il se montre passionn,
parfois violent. On peut doDe penser qu'il se rfre
des vnements qui se seraiellt produits dans l'in-
tervalle de sept annes qui spare ces deux homlies.
Rien n'empche, par consquent, de supposer qu'A-
fraat dsigne non point Papa, mais l'un de ses succes-
seurs immdiats, Simon Bar::;abba ou Sahdost. Nous
proposerions, mais sous rserves, d'admettre que la
dmonstration XIV vise plutt Simon. En voici les mo-
tifs. Deux traits, dans cette dmonstration, nous sem-
blent se rapporter trs spcialement ce prlat. Mraat
dit que les chrtiens sont dpouills et vexs de toutes
manires : Ceux qui n'taient pas ports la gnro-
sit ont exig de nous que nous leur donnions outre me-
sure
1
>> Plus loin, il semble indiquer que le tyran dont
il est question se glorifiait de sa taille avantageuse et
de sa beaut, et il rpond : Considrons-nous sa haute
stature, pareille celle de Sal, ou son visage agrable,
semblable celui d'liab, ou sa remarquable beaut
qui rappelle celle d'Absalon ? Mais le Seigneur ne se
complatt pas dans l'agrment du visage, et il n'aime
ni les superbes ni les glorieux
2
Or les Passions de Simon Bar::;abba nous informent
t. Col. liSt.
~ . Col. MS.
28 ORGANISATION DE L'GLISE AU IV SICLE.
que Sapor l'invita tout d'abord percevoir une capi-
tation double sur les chrtiens. Elles nous apprennent
galement qu'il avait un extrieur agrable et impo-
sant
4
, et que, pour ce motif, le roi hsita longtemps .
le condamner mort. N'y a-t-il pas, dans ce double
renseignement, un paralllisme significatif avec les
passages d'Afraat que nous avons signals?
A la vrit, les chronographes ne nous rapportent
pas que Simon ait d solliciter l'appui des Pres
occidentaux ; mais un pareil recours semble moins
improbable si l'on admet, avec le concile de Dadiso'
2
,
que ces Pres, en rintgrant Papa dans sa dignit,
avaient dsign Simon pour lui succder. Par un juste
retour des choses, Simon aurait subi les preuves qu'il
parait n'avoir pas pargnes son prdcesseur, et il
en serait sorti victorieux par le mme moyen. Quel-
que jugement, d'ailleurs, que l'on rserve notre
hypothse, il ressort de l'homlie xtv d'Afraat que la
perscution n'avait pas rtabli l'union entre les chr-
tiens, et qu'on ambitionnait ardemment un sige pis-
copal qui pouvait cependant cotter la vie son
titulaire
3
S 2. - L'institution monastique.
L'institut monastique devait tre assez florissant en
1. cr. par exemple M. o., 1, p. !U.
11. Loc. &up. ci t.
3. Je ne me dissimule pas que la thorie propose ici ne rsout pas
toutes les objections. Certaines difficults subsistent, de celles surtout
qui sont d'ordre chronologique. En effet la dmonstration XIV est
crite en 344. Or Simon tait mort en Mi et Sahdost en 341!. Les clercs
de Sleucie taient donc runis pour choisir le successeur de ce der-
nier, qui devait tre Barba' sem in <t 3t6). Mais si les faits auxquels Afraat
se rfre ne peuvent pas tre trs anciens, il ne suit pas de l qu'ils
aient d se passer dans l'anne mme o fut compose l'homlie x1v.
Trois ans aprs son supplice, le souvenir de Simon B a r ~ a b b a ' pouvait
tre assez vivace dans les cercles ecclsiastiques.
~ ..
L'INSTITUTION MONASTIQUE. 29
Perse au 1v
8
sicle; c'est le sentiment que suggre
la v1
8
.dmonstration
1
qui lui est consacre.
Les Actes des martyrs nous ont conserv les noms de
plusieurs moines : Barsabia et ses dix compagnons;
Papa, Wales, Abdiso, Paqida, Samuel, Abdiso
2
, mar-
tyriss avec les vques Abda et Abdiso; Badema et
ses sept disciples
3
Nous ignorons s'il y avait ds ce moment des ermites
proprement dits en Orient. Le mot il).iday, soli-
taires , qui se rencontre dans peut trs bien
convenir aux cnobites. La distinction des moines
d'avec le clerg n'est pas non plus trs nette. Le nom
de benai qiam qui les dsigne ordinairement con-
vient galement aux uns et aux autres. Il est fort
possible que l'on ne considrt comme clercs
que les vques, les prtres et les diacres, et qu'
cette poque, des cnobites fussent chargs du service
infrieur de l'glise
5
Ons 'expliquerait alors plus facile-
ment qu' semble avoir t la fois vque et
chef de monastre; son correspondant parat avoir
galement cumul ces deux fonctions. Dans la dmons-
tration x
6
, aprs avoir rsum la premire partie de la
collection, crit en effet son ami : << Lis et tu-
die, toi et tes frres, les fils du pacte, et les fils de notre
foi , et ailleurs : cc Instruis-toi, et, ton tour, ins-
truis tes frres, fils de ton glise
7
.
Il y aurait ainsi d'un ct les fils de la foi et les
cc fils de l'glise qui taientles simples fidles; de l'autre,
f. AFR.UT, d. Parisot, p. Lxv. Cf. THODORET, Ri&t. rel., ch. 1.
2. M. O., p. t'" et sulv.
3. Ibid., p. t65 et sui v.
du pacte ou de la rgle.
11. Sauf, bien entendu, ceux qui n'taient pas encore baptiss. Dem.
\'ll, 10, col. 345.
6.
7. Dem. xn, col. 1133.
2.
30 ORGANISATION DE L'GLISE AU IV SICLE.
les fils du pacte ou de la rgle, qui avaient fait des
vux spciaux
4
Ils taient astreints certaines absti-
nences et des jetlnes frquents. Ils s'adonnaient la
prire, la lecture, l'tude, aux veilles, au silence.
On leur recommande le travail, l'humilit, la patience,
la concorde, le srieux, l'esprit pacifique. Ils s'enga-
geaient observer la continence et la pauvret. Cette
vie austre leur valait le nom de pleurants , abl,
mais aussi de bienheureux
1
tuban.
t. Voici quelques remarques subsidiaires qui ajoutent, croyons-nous,
quelque force cette thorie. Dans tous les Actes des martyrs, les fils
et les filles du pacte sont mentionns la suite des vques, des
prtres et des diacres. Par exemple Acta Scahdwtta, M. O., p. 89
(texte syriaque) : On prit avec lui, de ces Villes [Sleucie-Ctsiphon]
et des bourgs et districts environnants, des prtres, des diacres, des fils
du pacte et des filles du pacte, dont le nombre tait de cent vingt-huit.
Cf. aussi le titre des Actes d"Abdiso et ses compagnons (M. O., p. H4).
Comparer un passage de la dmonstration x d'Afraat(col.4117) o l'auteur
crit que l'vque doit surveiller, corriger, et encourager les vierges .,
par o il faut sans doute entendre les personnes consacres Dieu.
- Dans la dmonstration vu, Sur les Pnitents, c'est au chef de la com-
munaut chrtienne qu'il adresse ses avis sur la pnitence des vous.,
col. 3156 . Je t'ai crit toutes ces choses, mon ami, parce que, de notre
temps, il y en a qui choisissent d'tre solitaires, fils du pacte et saints.
Or, nous combattons contre notre ennemi, et eet ennemi lutte contre
nous pour nous persuader de retourner l'tat que nous avons libre-
ment quitt. Et il y en a qui sont vaincus et frapps, et qui, ainsi cou
pables, se justifient eux-mmes. Nous connaissons leurs pchs, mals
ils se cantonnent dans leur obstination et ne veulent pas de pnitence ...
et, d'autres qui confessent leurs pchs, on n'accorde pas la pni-
tence Cette pnitence parait tre d'ailleurs tout autre chose que la
pnitence canonique. 11 n'est question Ici ni de fautes graves, ni d'ac-
cusations obligatoires, ni de l'exclusion de l'glise laquelle Afraat
fait pourtant allusion dans la dmonstration XVI. C'est une pnitence
conseille, et de perfection
11 n'en est pas moins retenir que c'est au chef de l'glise que les
llls du pacte doivent s'adresser. Nous croyons donc que, dans les
villes piscopales tout au moins, l'vque tait le chef du clerg officiel:
prtres et diacres, et des vous volontaires : fila et filles du pacte, qui
vivaient ensemble autour de l'gllae, ou en petite groupes dana des
maisons particulires comme les p.ovcitovnc du monde grco-romain
la fin du v sicle. A la campagne, ou dans les villes qui ne pos-
sdaient pas d'vque, le suprieur des fils du pacte parait noir
exerc le ministre ecclsiastique; ainsi BarSabia Istahr (M. O., p. 93)
et Badema M a ~ G z ~ d'ArwAo (Al. O., p. t65).
LE DOGME ET LA DISCIPLINE.
3i
Il y avait aussi des filles du pacte , c'est--dire
des vierges consacres Dieu. Elles vivaient en com-
mun, soit dans des maisons particulires, soit, plus ra-
rement sans doute, dans des lieux rguliers. Afraat in-
terdit svrement la cohabitation des o: fils et des filles
du pacte
1
. Les Actes des martyrs du Iv" sicle con-
tiennent les Passions d'un certain nombre de ces reli-
gieuses. Nous citerons les noms de Tarbo et de sa sur,
et de leur servante
2
, de la vierge W arda
3
, de Thcle,
Marie, Marthe, Marie, Ami , de Marie, Tata, Ama,
Adrani, Marna, Marie et M a r a ~
5
, de Thcle, Danaq,
Taton, Marna, Mazkia, Ana, Abiat, IJatai et Mamlaka
6
L'institution clrico-monastique semble s'tre dve-
loppe en dehors de toute influence trangre. La Pas-
sion de Mils assure, il est vrai, que cet vque a t
en gypte visiter Ammonios, disciple d'Antoine
7
Mais
l'hagiographe commet ainsi un anachronisme grossier,
et, par consquent, son information est sans valeur.
Nous verrons plus loin
8
que les mthodes de l'asc-
tisme gyptien ne furent pas introduites en Perse avant
la fin du vi sicle.
S 3. - Le dogme et la disoipUne.
Un seul document, trs prcieux il est vrai, nous
fournit des informations prcises sur le dogme et la
discipline des glises persanes au Iv" sicle. C'est la
f. Cet abus devait tre assez frquent, tant donnes les murs
penanes.
!1. M. O., p. lit.
a. Ibid., p. t.
t. Ibid., p. t!il3.
5, Ibid., p. t#,
6. Ibid., p. t00-101.
7. M. O., p. 7t.
8. Ch. Xl.
32 ORGANISATION DE L'GLISE AU IV SICLE.
collection des homlies d'Afraat, laquelle dj nous
avons fait de larges emprunts f. D'aprs cette source,
la dogmatique orientale nous apparatt dgage de toute
influence nicenne. C'est l un fait digne de remarque,
car l'activit littraire d'Afraat s'est exerce entre les
annes 337 et 346, soit quinze ans environ aprs la ru-
nion du concile de Nice. Ce concile paratt donc avoir
t ignor des Persans
2
Maruta, le premier, le leur
fit connattre
3
, ou du moins en rendit les conclusions
obligatohes au concile de Sleucie en 4f0.
Dans l'uvre d'Afraat, la doctrine trinitaire n'est
qu'bauche. Les doxoJogies et les confessions de foi
qu'elle renferme mentionnent, comme toutes celles qui
sont postrieures au n sicle, les noms du Pre, du
Fils et du Saint-Esprit; mais Afraat n'a fait sur ces
donnes, qui lui taient fournies par la tradition eccl-
siastique la plus ancienne, aucune rflexion mtaphysi-
que. La distinction des Personnes divines, leur galit
et leur consubstantialit ne font pas partie de son
enseignement. La dmonstration xvn ne laisse aucun
doute ce sujet.
Il s'agit de prouver contre les Juifs que les appella-
tions de Dieu et de Fils de Dieu, appliques Jsus-
1. Depuis leur publication par Wright, ces homlies ont t dpouil-
les par MM. SASSE, Prolegomena in Aphraatis Sapientis Per1ae aermo-
ne.t homileticos, Leipzig, t879; FORGET, De Vi ta et Scriptis Aphraatir,
Louvain, 188!1; G. BERT, Aphrahat's des persischen Weisen Homilien,
aus dem Syrischen bersetzt und erlautert, dans GERHARDT-HARNACK,
Tea:te und Untersuchungen, vol. III, rase. III, Leipzig, 1888, et en der-
nier lieu (1894) par Dom PARISOT, dans la prface dont il a fait prcder
son dition d'Arraat (notamment p. XLI-xLvn). Pour l'identit mystrieuse
du Sage Perse , cf. Litt.syr., p. 226, et l'article de NESTLE,dans HEazoo's
Realencykl. Cf. BURKIT, Early Christianity outside the Roman Empire,
cambridge, 1899, Lect. II et III.
2. Aucun vque de Perse n'y prit part. Jean de nom
se trouve dans quelques listes syriaques est probablement une mauvaise
lecture ou plutOt une falsification du nom de Jean, vque de Perrhae.
3. BRAUN, De Sancta Nicaena Synodo, prface.
LE DOGME ET LA DISCIPLINE. 33
Christ, ne sont pas fncompatibles avec l'unit de Dieu.
Vous adorez et rvrez un homme engendr-, un
homme crucifi, et vous appelez Dieu un homme; et,
bien que Dieu n'ait pas de fils, vous l'appelez Fils de
Dieu . Telle tait l'objection juive. Afraat proteste
d'abord de son adhsion aux formules ecclsiastiques :
Jsus, Notre-Seigneur, est bien le Fils de Dieu, le
roi, fils du roi, lumire de lumire, crateur, conseiller,
chef, voie, sauveur, pasteur, congrgateur, porte, perle,
lumire)) ; mais ensuite il s'applique dmontrer que les
noms de Fils de Dieu et de Dieu mme sont appliqus
par l'criture Mose et d'autres justes, le nom de
Roi des Rois Nabuchodonosor, et qu'ainsi, lorsque
ces appellations s'adressent au Christ, on ne doit pas
leur attribuer une valeur insolite.
" Nous adorons nos suprieurs, dit encore Afraat,
ceux mmes qui sont paens; combien plus ne devons-
nous pas adorer et rvrer Jsus-Christ qui nous a ar-
rachs aux vaines superstitions, et nous a appris
adorer, rvrer et servir le Dieu unique, notre Pre et
notre Crateur
3
On ne saurait disconvenir que c'est
l une argumentation u ad hominem . La contexture
n'en est pas moins singulire. En outre Afraat pense
bien ne faire aucune concession aux Juifs quand il
numre les titres donns au Christ dans l'un et l'au-
tre Testament. Or, il ne fonde aucun argument sur les
titres de Logos et de Sagesse qui, dans le dveloppe-
ment de la thologie trinitaire, en Occident, prirent
une si exceptionnelle importance.
La Pneumatologie d'Afraat est encore plus rudi-
mentaire. L'Esprit-Saint ne semble pas avoir de sub-
t. Col. 785.
3. Col. 788. Col. 8t3, il ajoute: vigne, poux, semeur.
3. Col. SOt. cr. aussi col. t41l.
34. ORGANISATION DE L'GLISE AU IV SICLE.
si stance propre; en tout cas, il ne possde pas d'hypo-
stase distincte de celles du Pre et du Fils. C'est plutt
une proprit divine qui se communique d'une faon
minente au Fils, et que le Pre et le Fils communi-
quent aux chrtiens. En un curieux passage , le Saint-
Esprit est donn pour le principe fminin
2
de la vie
chrtienne : Nous avons appris de la Loi : L'homme
quittera son pre et sa mre pour s'attacher sa femme,
et ils seront une seule chair. Vraiment, c'est l une grande
et insigne prophtie. Mais qui donc quitte son pre et
sa mre quand il a pris femme? Le sens est donc :
l'homme tant qu'il n'a pas pris femme aime et honore
Dieu son Pre et l'Esprit-Saint sa mre, et il n'a pas
d'autre affection. Mais lorsque l'homme a pris femme,
il quitte son pre et sa mre, je veux dire ceux que j'ai
mentionns ci-dessus ; son esprit est saisi par ce
monde, etc ...
Le Saint-Esprit rpond donc, dans la dogmatique
d' Afraat, ce que nous appelons aujourd'hui la grce. Et
c'est pourquoi il est, si je puis dire, essentiellement mo-
bile. De mme que tous les hommes reoivent en nais-
sant l'esprit animal , ainsi, leur seconde nais-
sance, les baptiss reoivent << l'esprit cleste , ou
l' esprit saint. S'ils sont fidles leurs engagements,
l'Esprit demeure en eux. S'ils pchent, l'Esprit retourne
celui qui l'a envoy. Aprs la mort l'me vivante
(l'esprit animal) retourne la terre. Elle est ensevelie
avec le corps ; dpourvue de sentiment, elle tombe dans
une sorte de sommeil. L' esprit cleste > retourne au
Christ, et, en prsence de Dieu, sollicite la rsurrec-
1. Dem. xvm, col. 840.
!il. En syriaque, comme dans les autres langues smitiques, t.-o;
entendu dans son sens propre de vent ou de souffie, est du genre fml
nin. Mais il est trait comme un nom masculin quand il dsigne la troi
sime personne de la sainte Trinit.
---; .. ~ ..
LE DOGME ET LA DISCIPLINE.
35
tion du corps auquel il a t uni. Notre foi, dit f r a a ~ ,
enseigne que les hommes sont de telle sorte assoupis
qu'ils ne peuvent distinguer le bien du mal. Les justes
ne recevront point leur rcompense, ni les mchants
'leur terrible chtiment, jusqu' ce que vienne le Juge,
qui les sparera, sa droite ou sa gauche
2
.
La confession de foi de l'glise persane est indpen-
dante des formules hellniques contemporaines
3
Celles-
ci taient divises en trois parties, qui reprsentaient en
quelque sorte la Trinit du Dieu unique; celle que nou11
lisons dans Afraat est au contraire divise en sept arti-
cles : Il faut croire en Dieu, le matre de tout, qui a
fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment.
- Il a fait l'homme son image, - il a donn la loi
Mose, - il a envoy de son esprit dans les prophtes,
- et ensuite il a envoy son Christ dans le monde. -
Il faut croire en la rsurrection des morts. - Il faut
croire au mystre du baptme. Telle est la foi de l'-
glise de Dieu.
Et voici les uvres de la foi : Ne pas observer les
heures, les semaines, les mois, les temps, les no-
mnies, les ftes annuelles, la magie chaldenne et la
sorcellerie. S'abstenir de la fornication, de la posie,
des sciences illicites qui sont les instruments du malin,
des sductions d'un doux langage, du blasphme et de
l'adultre. Ne pas dire de faux tmoignage, ne pas
tenir un langage double. Telles sont les uvres de la
foi, assise sur la pierre ferme qui est le Christ sur le-
quel est lev tout l'difice ~ .
Ce symbole a une saveur trs antique. Ainsi que le
l. Dem. vm, col. 397.
!. cr. prf!lce, p. LVI.
3. cr. BERT, op. cit., p. t7, en note.
1. d. Parisot, col. H et !tl.i,
36 ORGANISATION DE L'GLISE AU IV SICLE.
fait justement remarquer M. Bert , il n'est nullement
apparent la confession de foi que saint Irne nous
dit avoir t rpandue de son temps jusqu'aux confins
de l'Orient. On peut penser. avec le mme savant que les
prescriptions morales qui suivent la regula fidei sont
prsentes par Afraat sous une forme symbolique ,et
qu'elles faisaient partie intgrante de la confession de
f
. li
01
La discipline pascale des chrtients persanes m-
rite galement de retenir notre attention
3
Elle diffre
de la discipline romaine et tout autant de la discipline
asiatique. Afraat combat avec vigueur ceux qui s'at-
tachent exclusivement la date du 14 Nisan et au jour
du vendredi. On voit que selon notre auteur la solen-
nit pascale a pour objet principal de commmorer
la passion de Jsus-Christ et non sa
Elle est en ralit la continuation de la Pque juive
dans la communaut chrtienne, la rptition de la der-
nire Pque, que Jsus a clbre avec ses disciples
avant son crucifiement
11
Les Juifs, dit Afraat, ne
peuvent plus lgalement clbrer la Pque, puisque
l'Agneau devait tre immol dans le Temple qui est
dtruit. Les chrtiens se sont substitus eux, car
le vritable Agneau pascal c'est notre Sauveur, dont
i. Op. cit., p. i6, n. t.
2. )1. Bert les a rapproches avec raison des passages remarquable
ment parallles de la m, 4 : Mon fils, ne sols pas olwvoaxoxo;,
car cela conduit l'idoltrie, ne sois pas chanteur, ni mathmatrcien,
ni ne regarde pas mme ces choses, car de toutes nait
l'idoltrie ; u, 34 : Tu ne jureras pas, tu ne diras pas de faux tmoi-
gnage, tu ne seras pas double de pense ou de langue, car la duplicit
de langue est le sceau de la mort . cr. le mme ouvrage p. 18, n. 11, et
p. 19, n. i, et l'article de Ao. HARNACK: Apostolisches Symbolum dans
HERzoc's Realencykl.3, p. 741 et suiv.
3. Dem. Xli, Cf. BERT, op. cit., p. t79, n. t.
-' llciax atet11pwaq1.ov et non miax d:vat<Xatp.ov.
;;, cr. BERT, op. cit., p. iSO.
-........ . - - . - ~ . = -
LE DOGME ET LA DISCIPLINE 37
le sacrifice, figur dans la dernire Cne et accom-
pli sur la croix, a aboli les sacrifices prescrits par
l'ancienne Loi. Mais la date de la Pque chrtienne ne
concide pas avec celle de la Pque juive. En effet, sui-
vant le Diatessaron
4
, toute divergence entre les synop-
tiques et le quatrime vangile est supprime. Jsus-
Christ a fait la dernire Pque en mme temps que
tous les Juifs, le soir du 13 Nisan, c'est--dire dans la
nuit qui inaugure le 14 Nisan. Et il est mort le 14 Ni-
san, avant le commencement du 15 Nisan. Quant aux
chrtiens, ils ftent le souvenir de cette mort le 15 Ni-
san, sa nuit et son jour
2
S'agit-il de compter les trois jours qui sparent la
mort de la rsurrection? Afraat les fera commencer
aprs la mort mystique de la Cne, car, dit-il, celui
qui a mang son corps et bu son sang doit tre con-
sidr comme mort. Or le Seigneur a de ses propres
mains donn son corps manger et son sang boire
avant d'tre crucifi
3
.Mais ce comput spcial ne s'ap-
plique pas la fixation de la solennit pascale, qui ne
doit en aucun cas concider avec celle des Juifs. Jsus,
le vritable Agneau pascal, est mort dans l'aprs-midi
du 14 Nisan; donc en commenant la fte avec le 15 Ni-
san (c'est--dire le soir conscutif au 14), on comm-
more l'heure exacte du sacrifice sanglant de Notre-Sei-
gneur.
La Pque chrtienne dure, comme celle des Juifs, une
semaine entire, et le point culminant de la fte est
le vendredi de cette semaine. La prire et l'office di-
i. Afraat, comme S. Ephrem, lisait l'vangile dans le Diatessaron
de Tatien. C'est ce qul rsulte principalement du long passage de l'ho-
mlie u o Arraat esquisse grands traits la doctrine et la vie de Jsus-
Christ. cr. ZAuN, Tat. Diat., p. S0-84, cit dans BERT, op. cit., p. M, n. 3.
2. Col. 521.
3. Col. MS.
LE CIIRISTIANISIIIE. 3
3 ~ ORGANISATION DE L'GLISE AU IV SICLE.
vin, mais plus particulirement le jene, sanctifient
cette priode. Si donc le 15 Nisan concidait avec le di-
manche, il faudrait commencer la semaine pascale le
lendemain seulement, car le dimanche n'est pas jour
dejene.
La solennit majeure est inaugure, comme l'a t la
Passion dont elle est l'anniversaire, par l'administra-
tion du baptme. Afraat voit en effet dans le lavement
des pieds qui prcda la dernire Cne l'image du sacre-
ment baptismal. Le baptme se confrait donc dans
l'glise persane, non pas le Samedi saint, mais le pre-
mier soir de la Pque ; il tait suivi de la Messe et de
la communion.
Cet ordre paratra insolite, ainsi que la pratique du
jene, alors que dans les autres glises cet exercice
de pnitence tait interrompu pendant les solennits
pascales. Tout s'explique si l'on admet que deux prin-
cipes prsidaient l'conomie de la Pque chez les
Syriens orientaux. Premirement : les prescriptions de
la loi mosaque concernant la Pque sont encore en
vigueur. Deuximement : on les modifiera cependant
de manire reproduire le plus fidlement possible,
et dans leur succession chronologique, les piso-
des qui ont marqu les tapes du sacrifice de Jsus-
Christ.
Il faut donc rapporter la tradition du jene pascal
cette ide exprime par Afraat
2
: << Que ceux qui
disputent au sujet de ces jours sachent que le Sei-
gneur a clbr la Pque et mang et bu avec ses
disciples au crpuscule du 14. Mais depuis l'heure o
le coq chanta, il ne mangea plus, ni ne but, parce que
les Juifs l'avaient saisi et commenc le juger, et
L Col. 1137.
2. Col. 1136 et 1137.
.;, v ...
LES ADVERSAIRES DU CHRISTIANISME. :!9
comme je te l'ai montr plus haut, il a pass chez les
morts le quinzime jour tout entier, la nuit et le jour
1
''
S 4. - Les adversaires du christianisme : juifs,
mages, hrtiques.
Ce souci de concilier les observances lgales du
Judasme avec les traditions chrtiennes est un des
traits caractristiques de l'Eglise persane au v sicle.
Il ne convient point de s'en puisque l'Assyrie
et la Babylonie renfermaient, comme nous l'avons in-
diqu plus haut, une trs importante colonie d'Israli-
tes. En revanche, la polmique des chrtiens contre
les Juifs fut, pour des motifs analogues, plus ardente,
et peut-tre plus srieuse dans ces contres que dans
l'empire romain.
Sur les vingt-trois homlies d'Afraat, neuf sont con-
sacres la controverse antijudaque. Ce sont les ho-
mlies : XI sur la Circoncision, - xn sur la Pque, -
xm sur le Sabbat, - xv sur les aliments, - xvi sur la
vocation des Gentils, - xvu sur le Christ, Fils de Dieu,
- xvm sur la Virginit, - XIX contre la prtention des
Juifs d'tre de nouveau runis,- xxi sur la Perscution.
Si l'on en excepte la dernire qui est un crit de circon-
stance, les huit autres d:10nstrations nous donnent
une juste ide de l'objet et de la mthode de l'argu-
mentation chrtienne.
On cherchait prouver aux Juifs qu'ils n'taient plus
le peuple de Dieu et que leur hritage avait t trans-
mis aux glises du monde paen
2
Il fallait ensuite
1. cr. BERT, op. cit., p. 18-i, en note.
!!. Cette tche tait bien difficile, car les esprances messianiques
talent encore vivaces dans les cercles juifs. Nous savons, tant par les
homlies d'Afraat que par les Actes des martyrs et les historiens du
temps, que les Isralites rpandus en nabylonie et dans l'Empire ro
40 ORGANISATION DE L'EGLISE AU lV SICLE.
montrer que certaines prescriptions lgales taient
abolies ou qu'elles n'avaient par elles-mmes aucune
valeur, mais seulement en tant que symboles d'une
ide religieuse que le Christianisme s'tait approprie.
Enfin on devait lgitimer des pratiques inconnues
l'ancienne Loi et spcifiquement chrtiennes, comme
l'observance de la Virginit, ou concilier les doctrines
christologiques avec le monothisme. L'argumentation
s'appuyait uniquement sur des textes de l'Ancien Tes-
tament, choisis dans la Thora ou dans les crits des
prophtes, et traits suivant les mthodes de l'herm-
neutique talmudique.
Afraat dploie dns cette joute intellectuelle une sa-
gacit et une subtilit trs remarquables. Il possde
fond non seulement les textes inspirs, mais encore les
gloses traditionnelles, dont un petit nombre seule-
ment devait, son poque, tre fix par l'criture.
Le Sage Perse >> n'a pas crit contre les paens
de trait analogue ses dmonstrations contre les
Juifs. N'en soyons pas surpris. A la diffrence du
Judasme, les vieux cultes babyloniens se perptuaient
moins par la chaire ou par le livre que par le prestige
mystrieux de la sorcellerie et des incantations, en
vertu. d'une tradition superstitieuse trente fois sculaire.
Quant au culte de Zoroastre, il tait plac, par la
politique des rois et l'intolrance des mages, en dehors
et au-dessus de toute discussion publique. Les Actes
des martyrs peuvent toutefois nous renseigner sur les
polmiques entre les chrtiens d'une part, les paens
et les mages de l'autre l, Les interrogatoires des hros,
main s'attendaient 6tre d'un jour J'autre rassembls par le Li-
brateur promis. La dmonstration xix est tout entire consacre leur
montrer l'inanit de cette attente.
t. Voir ch. m, " ct lire en particulier la Passion de s. Simon nar-
sabba' (M. o., p. 311 etsuiv.).
a .. a _ac u .. --.
LES ADVERSAIRES DU CHRISTIANISME. 41
bien qu'ils soient amplifis par leurs pieux rdacteurs,
sont, cet gard du moins, une source d'informations
assez prcieuse. Autant que nous pouvons en juger, le
principal argument des chrtiens tait le suivant :
Vous qui tes des tres vivants, vous adorez dPs
cratures prives de vie! L'adversaire rpondait :
Mais le soleil est vivant : c'est lui qui ''ivifie tout;
le feu est vivant, puisqu'il peut consumer tous les
tres. Et le chrtien reprenait: <<Non, le feu n'est pas
vivant, puisqu'il suffit d'une petite pluie pour l'tein-
dre. Le soleil n'est pas vivant, puisqu'il cde la place
la nuit. Nous n'adorons pas les cratures, nous ado-
rons Dieu qui a fait le soleil et le feu, la terre, la
mer et tout ce qu'ils renferment. ,, - '' 1\lais vous adorez
un homme mort, qui a expir sur une croix. Vous
dites que le crucifi est Dieu. ,, Alors le chrtien en-
treprenait l'apologie du christianisme et exposait son
interlocuteur l'conomie des mystres de l'Incarnation
et de la Rdemption. Souvent, d'aprs les pieux r-
dacteurs des Actes, des prodiges clestes que les ad-
versaires attribuaient la magie venaient autoriser
la parole des martyrs.
Tel est le schma gnral de l'apologtique chrtienne
contre les paens. li est reproduit, avec des variantes
insignifiantes, dans la majeure partie des textes hagio-
graphiques.
Les seules hrsies que connaisse Afraat sont, outre
le Manichisme, doctrine indigne, les erreurs de Va-
lentin et de Marcion qui, au u sicle, divisaient les
chrtients du monde romain
1
'' Qui donc, crit-il,
donnera une rcompense Marcion qui ne confesse pas
la bont de notre Crateur? et qui rcompensera le jene
t. AFIIilT, col. U6.
42 ORGANISATION DE L'GLISE AU IVe SICLE.
de Valentin qui prche la multiplicit de ses crateurs
et dit que le Dieu parfait ne peut tre prononc avec
la bouche et que la raison ne peut l'atteindre? Et qui
donnera une rcompense aux fils de ces tnbres
qu'est la doctrine de Mani l'ill\pie. Ils habitent dans
les tnbres, comme les serpents; ils pratiquent le
Chaldisme, la doctrine de Babel. Tous ceux-l je-
nent, mais leur jene n'est pas agrable Dieu .
Le Catalogue des hrsies attribu Maruta t donne
une liste plus complte : Sabbatiens, Simoniens, Mar-
cionites, Pauliniens, Manichens, Photiniens, Bor-
boriens, Qoqiens, Dai:;;anites, Ariminites, Eunomiens
et Macdoniens, Montanistes, Timothens, Cathares
(Novatiens). Quoi qu'on doive penser de l'antiquit et
de l'origine de ce document, il est vident que plusieurs
des hrsies mentionnes, celles surtout qui se rappor-
tent la formation du dogme trinitaire, ne se sont dve-
loppes que dans l'Empire romain. Les autres (Bor-
boriens, Qoqiens, Dai:;;anites) appartiennent plus sp-
cialement la Msopotamie et l'Osrhone
2
, Rien ne
nous permet d'affirmer ou de nier qu'elles aient eu, au
1v sicle, des ramifications dans les provinces syria-
ques soumises aux Sassanides.
i. Bn.\Ull, De Sancta Nicaena Sy1lodo, p. 46 ct sui v.
2. Ces trois hrsies sont cites dans le Testament de S. Ephrem, d.
DUVAL, :l90t, p. 33 dU tirage part. - Cf. l'EXCUfS !i de HOFFMANN, op.
cil., p. t!il!, Zadduqaj: 'Audaje? Borborianer?- et HAnliACK, Der Ketzer-
Katalog de& Bischofs Maruta dans Texte und Untersuchungen, N. F.Iv.
t, 1899. v. aussi ch. m, p. tiS, n. !il.
CHAPITRE III
LA PERSCUTION DE SAPOII II (339/40-379)
S 1. - Les Chrtiens et le pouvoir royal. Causes de
la perscution gnrale.
Bien que les rois de Perse fussent plus fermement
attachs au mazdisme que les Parthes, leurs prd-
cesseurs, ils ne semblent pas avoir t pousss per-
scuter les adeptes des autres cultes par des motifs
exclusivement religieux. Si Mani fut saisi et excut
par les ordres de Bahrm 1, c'est que son enseigne-
ment tait immoral et antisocial, et qu'il le prsentait
comme une rforme du mazdisme t. Si les Juifs furent
soumis de frquentes vexations, c'est, au jugement
de M. Noeldeke
2
, parce qu'ils dployaient trop d'ing-
niosit frauder le fisc, et s'acquittaient avec un zle
mdiocre de leurs obligations en matire d'impt.
Quant aux chrtiens, sauf de rares exceptions, les Sas-
sanides ne les inquitrent pas tant que l'Empire ro-
main demeura fidle au paganisme, ni mme dans les
premires annes qui suivirent la conversion clatante
de Constantin au christianisme.
Eusbe
3
rapporte une lettre de cet empereur dans
l. TA BARI, p. 47,
~ . TUARI, p. 68, D. 1.
3. Vie de Constantin, IV, 8 et 9.- cr. SOZOMNE, Hist. cccl., Il, w. -
TBODORET, Hist. eccl., 1, 2 ~ . Le premier de ces deux auteurs veut que
44 LA PERSCUTION DE SAPOR II.
laquelle il flicitait Sapor de la bienveillance qu'il tmoi-
gnait aux chrtiens, et se rjouissait de la prosprit des
glises persanes et de leur accroissement continu.
Alors que cette lettre serait amplifie par le pangy-
riste ou mme suppose, elle prouverait du moins que
1 'vque de Csare, si exactement inform des choses
d'Orient, considrait les rapports des chrtiens avec le
Roi des Rois, aux environs de 330, comme des plus
satisfaisants.
La situation changea quand Sapor II se jugea suf-
fisamment fort pour reprendre la lutte traditionnelle
contre Rome, et fit exiger par ses ambassadeurs la
restitution des cinq provinces cdes autrefois Ga-
lre. Ds le dbut, les hostilits revtirent le caractre
d'une guerre de religion. Constantin, crit Tille-
mor;tt
1
, se prpara cette guerre non seulement comme
un empereur, en assemblant de grandes armes,
quoi la paix dont tout le reste de l'Empire jouissait
lui donnait beaucoup de facjlit, mais encore en chr-
tien. Car il pria quelques vques de le vouloir accom-
pagner dans cette expdition pour l'assister de leurs
prires; et eux le lui ayant promis sans peine, il en eut
une extrme joie. Il fit aussi dresser une tente en
forme d'glise portative, orne trs magnifiquement,
afin d'y faire ses prires avec les vques, quand il
serait en campagne.
L'Empereur mourut avant les premiers engage-
ments, le 22 mai 337. Constance, son successeur,
quitta, peu de temps aprs son avnement, la Pannonie
o il confrait avec ses frres du partage de l'empire,
Constantin ait crit Sapor pour lui persuader de cesser de perscuter
les chrtiens. Il y a l un anachronisme manifeste. Constantin est mort
trois ans avant le commencement de la perscution gnrale.
t. Histoire des Empereurs, t. lV, p. 265.
,.
LES CHRTIENS ET LE POUVOIR ROYAL. 4a
pour venir dfendre l'Orient contre la redoutable
offensive de Sapor. Ce monarque, profitant de l'indci-
sion des Romains et du dsarroi occasionn par le chan-
gement de rgne, avait attaqu Nisibe qui rsista
soixante-trois jours. Mais lorsqu'il eut t inform
de l'arrive imminente de l'empereur, il se replia
derrire ses frontires; et l'on attribua cette retraite,
qui parat avoir t dsastreuse, aux prires de saint
Jacques, vque de Nisibe. Tel fut le dbut de cette
guerre qui dura autant que le rgne de Constance et
que celui de Julien
1
A la suite de cet insuccs, Sapor II mobilisa, pour
ainsi dire, toutes les forces de l'empire perse. Il pres-
crivit des leves extraordinaires de soldats. Or les
finances de l'tat taient assez obres. Les malver-
sations des grands officiers, l'absence de toute rgu-
larit dans la gestion des biens de la couronne ne
contribuaient pas enrichir le trsor royal. Ds qu'une
expdition se prparait, il fallait percevoir des taxes
supplmentaires. Et tandis que le fardeau du service
militaire pesait plus spcialement sur les habitants
de l'Iran, celui des impts retombait, comme naturelle-
ment, sur les populations de la riche Babylonie.
Le Roi des Rois donna des instructions con-
formes aux collecteurs du pays de Beit Aramay. C-
dons la parole au rdacteur anonyme de la Passion
de saint Simon
2
: De Beit Huzzay il
(le roi) crivit une missive aux princes du pays des
Aramens. Elle tait ainsi conue : Ds que vous aurez
pris connaissance du prsent ordre de nous autres
t. Nous ne pouvons songer en retracer les pripties. Nous ren-
nos lecteurs l'Histoire des Empereurs, de TILLEIIONT (t. IV),
o les sources contemporaines sont analyses et critiques avec beau
coup de sagacit.
!1. BEOJ., Il, p. 136.
3.
46 LA PEHSCUTION llE SAPOR Il.
dieux, qui est contenu dans le pli expdi par nous,
vous arrterez Simon, le chef des Nazarens. Vous ne
le relcherez pas tant qu'il n'aura pas sign ce docu-
ment et n'aura pas consenti recueillir, pour nous les
verser, une capitati9n double et un double tribut pour
tout le peuple des Nazarens qui se trouve dans le pays
de notre divinit, et qui habite notre territoire. Car
nous autres dieux, nous n'avons que les ennuis de la
guerre et eux n'ont que repos et plaisirs! Ils habitent
notre territoire et partagent les sentiments de Csar,
notre ennemi ! >>
Cette dernire accusation fut un des principaux mo-
tifs de la perscution. C'est ce que le rdacteur de
notre Passion, qui, sur ce point, est le tmoin d'une
tradition trs ancienne et peut-tre primitive, met fort
bien en relief. Quand Sapor II reut la rponse nga-
tive du catholicos, << il se mit dans une violente colre,
grina des dents et se frappa les mains l'une contre
l'autre en disant : Simon veut exciter ses disciples et
son peuple la rbellion contre mon empire. Il veut
en faire les esclaves de Csar, leur coreligionnaire :
voil pourquoi il n'obit pas mes ordres l >>. Et les
courtisans de faire ,cho aux paroles du roi : Si toi,
qui es le Roi des Rois et le matre de toute la terre, tu
envoyais des lettres magnifiques et gnrales de ta Ma-
jest, des dons prcieux et des prsents superbes ...
Csar, il n'en tiendrait aucun compte; si, par contre,
Simon lui adressait un petit bout de lettre, Csar se
lverait, se prosternerait, la recevrait de ses propres
mains et accomplirait ses ordres avec empressement.
Avec cela, point de secret que Simon n'crive C-
sar pour le lui faire connatre
2
>>. Et l'on doit dire que
i. !tf. o., p . ~ .
2. BEDI., op. cit., p. H3.
LES CHRTIENS ET LE POUVOIR ROYAL. 47
ces soupons n'taient pas sans quelque fondement.
Pressurs par les Perses, considrs comme apparte-
nant une caste ne pour la servitude, taillables et cor-
vables la merci d'administrateurs sans scrupules, les
chrtiens de la Chalde et de la Msopotamie en-
viaient leurs voisins rgis par la lgislation romaine
infiniment moins arbitraire. Ils pouvaient ambition-
ner de cesser d'tre des deminuti capite pour deve-
nir des citoyens soumis non plus au caprice des
exacteurs, mais des rgles administratives nettement
dtermines. Ajoutez cela le prestige de la civilisation
occidentale, le rayonnement de la grande mtropole
d'Antioche, vers qui, depuis six sicles, les Aramens
ne cessaient de fixer leurs regards, enfin la renomme
presque lgendaire de l'ancienne Rome et de la nou-
velle, dont les marchands ou les lgionnaires prison-
niers ne se lassaient pas de dcrire et de vanter les
merveilles; par-dessus tout, le dsir de vivre en pays
chrtien, sous l'gide des Csars chrtiens, aussi sou-
cieux de la puret de la foi que de la prosprit mat-
rielle de l'empire. Constantin avait fait une place dans
ses conseils aux vques, et cette place tait prpond-
rante. Constance, son successeur, tait encore plus
pieux que son pre, et rformait le vieux code d'aprs
les principes de l'vangile. C'en tait assez pour que les
communauts chrtiennes, et surtout leurs chefs, aspi-
rassent tre dlivrs du joug impie des paens et
se mettre sous la protection de la Croix ds qu'elle
ferait son apparition dans la valle du Tigre, prc-
dant les lgions victorieuses.
Or, aux yeux des chrtiens persans la victoire des
lgions n'tait pas douteuse. Afraat la prdit ses
coreligionnaires, et il autorise ses prvisions par des
textes de l'vangile et une exgse passablement rab-
48 J.A PERSECUTION DE SAPOR II.
binique de la vision de Daniel
4
Voici ce qu'il crit en
337 u mystrieusement cause du malheur des
temps:
Le peuple de Dieu (les Romains) a reu ~ a pros-
prit, et le succs attend l'homme qui a t l'instru-
ment de cette prosprit. Mais le malheur menace
l'arme qui a t rassemble par les soins d'un m-
chant et d'un orgueilleux gonfl de vanit, et dans
l'autre monde la maldiction est rserve celui qui
est la cause du mal. Cependant, mon ami, ne te plains
pas du mchant qui a caus la malheur d'un grand
nombre, car les temps sont prvus et ordonns, et voici
le moment de leur accomplissement.
Et plus loin, il explique que l'hritage d'sa a t
donn Jacob. Mais Jacob en a msus. En cons-
quence Dieu l'a rendu sa. Or Esa, ou dom, c'est
pour notre auteur comme pour les talmudistes le peu-
ple romain !1 . Aussi leur empire (celui des Romains)
ne sera pas vaincu; n'en doute pas, car le hros qui a
nom Jsus vient avec sa puissance, et son armure sou-
tient toute l'arme de l'empire. Considre qu'il est mme
inscrit parmi eux pour le recensement, et comme il est
inscrit parmi eux pour le recensement
3
, il vient aussi
leur aide. Son signe s'est multipli dans leur pays. Ils
ont revtu son armure et ils sont invincibles .
Afraat, il est vrai, ajoute avec modestie qu'il n'est
pas prophte; c'est la mditation des critures et
spcialement du passage : <c Quiconque s'exalte
sera humili , qui l'a amen ces conclusions. D'ail-
leurs, dit-il en terminant sa dmonstration : <c Si
ces troupes (les troupes persanes) sont victorieuses,
i. Dmonstr. v. Cf surtoutS t et !!4. Cf. TADARI, p. 68, n.t et 50t.
2. Arnur, d. Parisot, prface, p. xux.
3 ~ Allusion saint Luc, 111, 3.
LES CHRTIENS ET LE POUVOIR ROYAL. 49
sache que c'est une punition inflige par Dieu ..... ,
mais souviens-toi que la bte doit tre tue en son
.
Les chrtiens se gardaient bien, on le conoit ais-
ment. de rendre publics les sentiments dont ils taient
anims l'gard du Roi des Rois. Simon
au cours de son interrogatoire, proteste contre des al-
lgations calomnieuses qui tendraient mettre en doute
son loyalisme
2
L'eunuque Gustahazad conduit au supplice adresse
une dernire prire Sapor II : Que ta clmence
ordonne que le crieur public monte sur la muraille, en
fasse le tour en roulant du tambour et publie cette
proclamation : << Gustahazad va tre mis mort, non
pour avoir divulgu les secrets du royaume ou pour
avoir commis un autre crime puni par les lois : il est
mis mort parce qu'il est chrtien
3
>>.
Malgr ces protestations, qui peut-tre n'taient pas
toutes galement sincres, les chrtiens de Perse taient
t. AFRAAT, Dem. V, col. 237. J.a btc de l'Apocalypse, ce sont les
Perses. Les Romains n'ont fait jusqu'ici que la dompter sans la tuer,
parce qu"ils n'taient pas encore chrtiens.
!!. ces protestations ne sont peut-tre que l'uvre d'un crivain pos-
trieur qui, crivant en pleine paix et lorsque l'glise orientale entre-
tenait des rapports normaux avec le Roi, aura voulu montrer que, mme
en temps de perscution, les chrtients de Perse demeureraient fidles
au prince. On les lit dans la recension dite parle P. BEDJAN (Acta MM.
et SS., t. Il, p. 159). Elles ne se retrouvent pas dans la Passion du
mme martyr publie par Assemanl.
3. BEDJAN, op. cit., Il, p. 113. M. 0., p. 27. Il parait toutefois que le
loyalisme des Iraniens n'tait pas toute preuve. On le vit bien lors-
qu'un dynaste de l'Adiabne, profitant de l'aversion que professaient
l'gard de Sapor II les chrtiens fort nombreux dans celle rgion, se-
eona le joug du Roi des Rois. Si le succs de Qardagh fut phmre, sa
renomme se rpandit dans toute !"glise persane. Mar Qardagh fut
honor par elle comme un martyr. Cf. FE IGE, Die Geschichte de&
Abdhd und seine& Jngers Mar Qardagh, Kiel, 1889; AnnELoos, Acta
Mar Qardaghi Auyriae prae(ecti, Bruxelles, 1890; BEDJAN, Acta Marty-
rum et Sanctorum, Il, p. t42-006. Litt. syr ., p. 137.
--
LA PERSCUTION DE SAPOR II.
dans leur ensemble nettement hostiles Sapor II. Ce
prince ne manquait donc pas de raisons pour s'en dfier
et, au besoin, les empcher de lui nuire. Mais la bar-
barie de ces temps peut seule expliquer, sans l'excu-
ser, l'impitoyable rpression qu'ordonna le monarque
en l'anne 339-340 l. Jusqu' sa mort, qui survint le
19 aot 379, la perscution svit presque sans inter-
ruption dans toutes les provinces de l'empire Sassa-
nide
2
t. Ce n'est pas dire qu'il n'y eut pas avant 339 des cas isols de
perscution. Le mauvais vouloir des mages l'endroit des chrtiens se
manifestait, l'occasion, par des vexations d3 tout genre, et mme des
excutions. Les sectateurs du mazdisme qui se convertissaient au
christianisme et surtout ceux qui appartenaient la noblesse taient
plus particulirement exposs. C'est ainsi que, pour le dbut du rgne
de Sapor 11, nous trouvons les martyrs de la montagne de Dra'in non loin
de Karka de Deit Slokh (HOFFMANN, Ausziige, p. 9; BEDJ., Il, p. t-lS6),
Adurparwa, Mihrnars et leur sur )lahdukht (318). Plus tard, en 3!17
(ASSEMANI, Mart. orient., I, p. t3-l et su iv.) eut lieu le martyre de onze
confesseurs dans la province d'Arzanne (V. ci-dessous p. 78). Ils su-
birent probablement le supplice au cours d'une incursion des Per-
ses, car, cette date, I'Arzanne devait appartenir aux Romains en
vertu de la convention conclue entre Narss et Galre (TILLE MONT, Hist.
des Empereurs, IV, p. 40). Cela tendrait prouver que la trve de qua-
rante ans ne fut pas aussi strictement observe que le pense l'mi-
nent historien. Ce qu'il dit, d'aprs Nazarius le pangyriste (p. t80),
que vers 320 les Prses implorrent l'amiti de Constantin semble tre
un pur dveloppement de rhtorique. Nous croirions plus volontiers,
sur l'autorit de Liban lus (cit p. !W:i), que, durant ces quarante annes,
ils n'avaient entretenu la paix que pour se mieux prparer la guerre
Et rien n'empche d'admettre que Sapor 11, dont l'histoire et la lgende
s'accordent nous dire la bravoure et le caractre belliqueux, prlu-
dait par des razzias une rupture qui devint dfinitive, lors de l'ex-
piration du traite.
2. M. Noeldeke, TAnAm, p. 4t0, 4tl, n. t, et 4t7, 4t8, a dtermin la
date du commencement de la perscution en fonction des donnes
contenues dans les Acta Martyrum (p. t5, 45, 47, 2011) et dans AI'RAAT
(Dem. xXIn, ed. Wright, p. 1107). La concordance de ces documents con-
temporains des faits dispense de tenir compte des renseignements
contradictoires fournis par les sources plus modernes (cf. AssE11.un,
M. O., prface, p. LXXI-Lxxxv). Il faut distinguer, croyons-nous, le dbut
de la perscution (3t anne de Sapor), et la destruction des glises
(3!1 anne. AFnuT, loc. cit., M. 0., p. 4/i). Nous ne savom pas en quel
mois commenait la premire de ces deux res. La deuxime partait
CRITIQUE DES SOURCES HAGIOGRAPHIQUES. 5t
S 2. - Critique des sources hagiographiques.
Parmi les historiens grecs du v sicle, Sozomne,
seul, raconte la perscution de Sapor. Il a consacr
plusieurs chapitres du livre II de son Histoire eccl-
siastique dcrire cette importante crise traverse par
l'glise de Perse. Ses informations sont prcises, mais
assez sommaires. Dans le domaine de la littrature
byzantine, les pices hagiographiques contenues dans
les Mnes, les divers synaxaires et les mnologes, per-
mettraient de contrler et de complter les rensei-
gnements fournis par Sozomne . Contrle prcaire
et complments sujets caution, ces morceaux tant
tous des traductions, et parfois des traductions de tra-
probablement du printemps. Nous ne pouvons donc dterminer, un
chiffre prs, l'anne de l're chrtienne laquelle correspondent les
dates indiques dans nos documents.
Exemple : Passion de Jacques et Marie (M. 0., p. tft). Ils sont saisis
dans la septime anne de la perscution et mis mort la mme
anne le 17 Adar lunaire Cette septime anne concide avec la 37
du rgne de Sapor (du ;; septembre 346 au 5 septembre M7), ou plu tOt
commence certainement un fDOment fixer entre ces deux dates.
Supposons que ce soit, par exemple, en octobre; la 7 anne de laper-
scution s'tendra d'octobre MG octobre 3\7, et le martyre de Jac-
ques devra tre assign l'anne M7. Si, au contraire, c'est au mois
de Nisan que commence J'anne de la perscution ., elle s'tendra
d'avril347 avril 3l8, et Je martyre de Jacques qui tombe en Adar (c'est-
-dire approximativement en mars) devra tre report l'anne de
l're chrtienne MS. -J'inclinerais penser d'aprs M. O., p.ll8 et 47,
que l're de la perscution partait du printemps de 340.
t. La plupart de ces documents byzantins sont cits et analyss par
TILLEHONT, Mmoires pour servir r Hist. eccls., t. VIl, p. 76-101, et i36
2 l ~ . E,. AssE MANI en a transcrit de copieux extraits dans les prfaces
dont il a fait prcder chacune des Passions qu'il a publies. Le P. DE
LEBATE, bollandiste, numre dans la preface de S. Sadoth cpiscopi Se-
lev.ciae et Ctesiphontis Acta Graeca (Analecta Bollandiana, t. XXI, fasc. II)
les traductions grecques des actes primitifs qui se rencontrent dans
les mnologes. Nous croyons sa,oir qu'il prpuc une dition com-
plte de ces pices.
52 LA PERSECUTION DE SAPOR Il.
ductions, remanies, amplifies, ou altres au gr
des mtaphrastes et des copistes.
Aussi la collection publie par Assemani des Actes
syriaques des Martyrs orientaux
4
est-elle, pour l'his-
torien, d'une importance capitale, parce que seule
elle contient des Passions originales, dont plusieurs
ont pu servir de sources Sozomne lui-mme.
Faut-il, comme le pense Assemani, attribuer un
auteur unique les pices qui composent ce recueil, et
cet auteur serait-il le fameux Maruta, vque de Mai-
pherqat qui, au commencement du v sicle, prsida
la reconstitution de l'glise persane?
Cette hypothse qui a t jusqu'ici gnralement
admise ne repose pas sur un fondement bien solide.
Assemani
2
l'taie de deux arguments principaux : le
premier, c'est le tmoignage de l'glise nestorienne
reprsente principalement par <Abdisoc de Nisibe qui,
dans son Catalogue, attribue Maruta
3
un cc Livre des
Martyrs et des posies en leur honneur. L'autorit
d'un auteur du xiv" sicle en matire d'authenticit
n'est pas irrfragable, mme si on la fortifie d'un texte
de Timothe 1, le grand catholicos du v1u" sicle, qui
invite ses correspondants maronites compulser les
de Maruta
4
Au reste les chronographes
nestoriens attribuaient galement au catholicos Al:,la,
successeur d'Isaac {410-415), une collection de Passions
des martyrs persans
5
,
i. Acta MM. orientalium, t. 1, Rome, i748, d'aprs deux manuscriiS
trs anciens rapports de Notre-Dame de Ni trie par J, s. AssEHA.NI. Ces
ms. portent aujourd'hui les cotes Vat. t60 ct t6t. Sur ces Actes et sur
leur valeur historique, cf. R. DcVAL, Litt. syr., p. t30-H3.
i, Prface, p. XLVII.
3. B. O., III, p. 73.
4. Ms. Borgia, K. VI, 3, p. 656.
li. p. 29. 'AMR, p. ta. v. ci-dessous, ch. IV, p. 99.
CRITIQUE DES SOURCES HAGIOGRAPHIQUES. 53
Le second argument n'est pas meilleur. Assemani
convie tous ceux qui connaissent fond l'idiome
syriaque comparer les Actes qu'il publie avec des
ouvrages qui portent certainement le nom de Maruta :
savoir une Anaphora et des Commentaires sur les
vangiles. La similitude de style est, dit-il, parfaite,
d'o il faut conclure l'unit d'auteur l. Fort heureu-
sement, il n'en est rien. Autrement nous devrions re-
porter au commencement du vu sicle la date de nos
documents, car l'Anaphora et les Commentaires sont
l'uvre de Maruta de Tag1it, premier mafriano des
Jacobites
2
, qu'Assemani a confondu avec son illustre
homonyme du v sicle.
Le silence de Sozomne, qui pourtant connat bien
Maruta par Socrate, n'est pas pour renforcer la thse
d'Assemani. L'historien byzantin sait que les Actes des
martyrs orientaux ont t recueillis avec soin par << des
Persans, des Syriens et des habitants d'desse
3
,
C'tait le lieu de nommer l'vque de Maipherqat, au
moins pour nous apprendre qu'il avait constitu une
collection de documents martyrologiques.
Cette collection -qu'elle ait t ou non connue de
Sozomne sous sa forme actuelle, et qu'elle ait eu
ou non Maruta pour auteur - exista cependant ds
le v sicle. L'auteur de la Passion d"Aqebsema ex-
cuta, cette poque, un semblable travail, dont il
nous indique les lments
4
Personnellement il a vu et
connu les derniers martyrs de la perscution de Sapor.
Pour les autres, il s'en est rapport de vnrables
vques ou prtres, et a transcrit les renseignements
t. Prface, p. Lxv.
i. Voir ci-dessous, cb. vm, p. !!18 et 240.
3. Hist. eccl., 11, 14.
t, M. O., p. 20H03.
LA PERSCUTION DE SAPOR II.
-...---.....
1
qu'il tenait de leur bouche. Parmi les '' histoires
et les homlies des Pres (madras), il a fait un choix.
Puis il a dcor des artifices d'un style noble et dfus
ce qui avait t crit simplement et sans distinction
par les anciens. L'ouvrage entier comprenait deux
parties (mmr), et narrait l'ensemble de la perscution
de Sapor, depuis le supplice de Simon B a r ~ a b b a '
jusqu' celui d'cAqebsema.
Si le texte que nous possdons est bien celui du rdac-
teur primitif, il faut lui savoir gr d'avoir respect les
caractres spcifiques des documents qu'il compilait,
et de ne leur avoir pas impos un fusionnement arbi-
traire.
Plusieurs, comme s'ils constituaient eux seuls un
cycle ferm, sont prcds de prologues qui atteignent
aux proportions d'un discours. Les hagiographes y
expriment leur crainte d'aborder un sujet si fort au-
dessus de leur mrite. Ils regrettent de ne pas pouvoir
mettre au service des martyrs un style plus affin,
une rhtorique plus ingnieuse. Quelques-uns des
auteurs de ces dissertations s'excusent de leur jeunesse,
et leurs procds littraires sont en effet dignes de dbu-
tants. D'autres, au contraire, sont des crivains graves
et de bonne tenue, bien que prolixes l'infini comme
tous les Syriens. Tel historien, comme celui de Simon
Bar!_;abba ', ne rehausse pas de miracles la vie et la
mort de son hros; tel autre, comme celui de Mils,
conduit ses lecteurs de prodige en prodige. Tel crit
desse, et tel en Perse, et l'on pourrait sans trop de
peine distinguer deux recensions, l'une occidentale et
l'autre orientale, de certains Actes
1
1. Il nous est impossible pour le moment de prciser davantage cette
tborie. Bien des questions se posent au sujet des Acta Martyrum qui
ml'ritent une tude critique approfondie. Mais l'tude dont nous par-
CRITIQUE DES SOURCES HAGIOGRAPHIQUES. 55
Il est naturel que les Passions primitives aient t,
par la pit des crivains postrieurs, enrichies et em-
bellies de miracles ou de discours. Cependant, dans les
textes que nous possdons, l'anne, la date du martyre,
les noms des confesseurs et trs souvent celui de leurs
perscuteurs sont enregistrs avec soin. Les notations
gographiques sont excellentes.
Parfois, nos Actes sont groups en petites collec-
tions autour d'un martyrium, ou d'un sige piscopal.
C'est ainsi qu'un moine du VI" sicle crivit l'His-
toire de la ville de Beit Slokh
4
Pour la perscution
qui nous occupe, des rdacteurs anonymes compi-
lrent le cycle des martyrs de Sleucie, ou de Susiane,
ou celui des martyrs d'Arbel
2
Nos Passions ont
donc une grande valeur historique, bien qu'elles doi-
vent tre contrles les unes par les autres, et com-
pares avec les documents parallles qui nous sont
parvenus
3
lons ne pourrait s'appuyer que sur des textes soigneusement tablis.
Or, en collationnant pour la Passion de B a r ~ a b b a ' le manuscrit i60 du
Vatican dont s'est servi Assemani, nous avons constat que la trans-
cription mme de cet auteur est des plus imparfaites. Le P. BEDJAII
(Acta J.f!tf. et SS., t.II) a donn une dition dont le texte est parfois dilf
rent de celui d'Assemani, mais le choix des variantes est si arbitraire
et l'appareil critique si insuffisant que cette pIblication est d'une uti
lit trs restreinte au point de vue de la comparaison des textes. Nous
avons donc dti nous contenter de noter ici brivement les quel
ques rsultats de notre enqute qui nous ont paru dOnitifs, nous
abstenant dessein de dveloppements et de dtails critiques dont
l'expos, dans l'tat actuel de nos textes imprims, ne saurait tre
que prmatur. cr. WESTPn.u., Untersuchungen, p. S!J et sui v.
1. HornuNN, Auszge, p. 48 et sui v. BEDJAN, Il, p. 507-1l35.
;!, BEDJAN, IV, p. i!!S-i4t.
3. tn document exceptionnellement prcieux, mais malheureusement
trs sommaire, est celui qui a te publi par Wright et reproduit par
les diteurs du Martyrologium Hieronymianum, d. De Rossi et Du
chesne dans Acta SS. novembris (t. 11, pars 1, p. LXIII). C'est une liste
des vques, des prtres et des diacres qui ont soulfert le martyre sous
8apor Il. Cette liste n'est probablement pas complte, mais elle est
d'une authenticit indiscutable, car le manuscrit qui nous l'a transmise
56 LA PERSCUTION DE SAPOR II.
S 3.- Caractres gnraux de la perscution de Sapor.
Ainsi que nous l'avons indiqu plus haut, la reprise
de la lutte contre Rome changea en hostilit dclare.
l'attitude bienveillante ou, pour-le moins, neutre que
Sapor avait observe l'gard des chrtiens. D'aprs
les Actes des martyrs
4
, il promulgua alors plusieurs
dcrets. Le premier semble avoir eu pour objet d'exiger
des chrtiens une double capitation; l'autre, d'ordonner
la dsaffectation des glises, ou leur destruction en cas
de rsistance. Lorsque, aprs une longue dtention,
l'vque de Sleucie, Simon pour avoir
refus dfinitivement et la leve d'un nouvel impt et
l'apostasie, eut t condamn au dernier supplice,
Sapor publia un dit gnral de perscution contre les
chrtiens. Mais, pouvant du massacre qui suivit, et
surtout afflig de la mort d'un de ses eunuques favoris,
Azad, qui avait t confondu dans la foule des victimes,
Sapor prescrivit une procdure plus rgulire
2
Que penser de l'authenticit de ces deux dits? Nous
inclinerions, pour notre part, y voir uniquement la
mise en uvre de donnes rellement historiques, et
la traduction, en style pistolaire, des motifs et des
porte la date de 412. Si l'on veut admettre, avec la tradilion (MARE,
p. 26, MNES au 14 fvrier, cites par TILLEKONT, Hist. eccl., VII, p. 97),
que occup de recueillir les corps des martyrs perses dont
il enrichit sa ville piscopale (Martyropolis) et qu'il a fait diligenc
pour conserver leur souvenir, et au besoin contribuer le fixer dans
les chrtients persanes, on peut lui attribuer la confection de cette
liste, et penser qu'elle put tre annexe aux Actes officiels du concile
de 410.
1. M. O., p. 15. R. DuVAL, Litt. syriaque, p. 135.
2. M. O., p . .w. D'autres dits sont mentionns dans certaines Pas-
sions, par exemple dans celle d''AqebSema (M. O., p. 178, texte S)T.), et
de Barba'i!emin (p. H6).
CARACTRES GNRAUX DE LA 5:
considrants qui portrent le roi ou ses ministres d'a-
bord perscuter les chrtiens, ensuite modrer le
zle des excuteurs.
Les pieux auteurs des Passions, dont plusieurs vi-
vaient sur le territoire romain, et qui tous connais-
saientl'histoire et la lgende des perscutions romaines
et en particulier de la perscution de ont eu
une tendance gnrale introduire dans leurs rcits, en
manire de dveloppement, des procdures spcifique-
ment romaines. En Perse il suilisait d'un ordre direct
du roi, et point n'tait besoin de donner une apparence
lgale aux mesures dictes par lui, quelque radicales
qu'elles pussent paratre. Sapor et ses officiers pou-
vaient d'un mot dcrter la destruction des glises,
l'emprisonnement et le supplice des chrtiens. Nul code,
nulle jurisprudence ne s'opposaient l'excution de
leurs volonts.
Si, d'une part, il tait prilleux pour les chrtiens
d'tre livrs l'arbitraire et au bon plaisir d'un des-
pote, d'autre part l'absence de promulgation lgale
de la volont royale fut peut-tre ce qui les sauva
d'une ruine dfinitive. Aux pays o l'on ne connat
d'autre loi que le caprice du matre, la soumission
qu'on lui tmoigne quand il est prsent n'a d'gale
que le peu de souci qu'on prend de ses ordres quand
il n'est pas l pour en surveiller l'accomplissement.
Dans un empire savamment hirarchis comme
l'tait la ttrarchie de Diocltien, des provinces entires
purent tre soustraites l'application des dits pros-
cripteurs. Dans l'empire des Sassanides la perscution
fut, galement et plus forte raison, localise. Dans les
rsidences de Sleucie, de Ledan ou de Beit Lapat, et
i. cr. AFRur, cit plus bas, p. 81.
58 LA PERSCUTION DE SAPOR Il.
sur le parcours des armes royales, on poursuivait les
chrtiens. Ailleurs on les laissait en repos.
La procdure suivie contre eux n'tait ni constante,
ni rgulire. Souvent les martyrs taient dnoncs
aux officiers royaux. Les Juifs ne furent pas trangers
l'arrestation de Simon Barl?ahha'
4
lls passaient
pour avoir pareillement trahi sa sur Tarbo et ses
compagnes religieuses
2
Parfois aussi des chrtiens
se vengeaient ainsi de leurs ennemis. 'Ahdiso, vque
d'un bourg voisin de Kaskar, est signal au roi par
i. 111. O., p. i9 (texte syr.:.
2. M. O., p. !i-l. Ce serait le lieu de rechercher si, comme le disent
clairement ces Actes, les Juifs poussrent le roi de Perse perscuter
les chrtiens. -Cf. aussi SozOIINE, Hist. eccl., Il, 9; Patr. Graec., LXVII,
col. 955. - D'une part ils taient en faveur auprs de la reine lira Hor-
mizd; d'autre part ils dtestaient cordialement les chrtiens, d'autant
plus que Constantin n'usait gure de tolrance l'gard de leurs co
religionnaires de Palestine. Aussi M. NOELDEKE (TABAR!, p. 68, n. i)
estime-t-il l'accusation de nos hagiographes tout fait vraisemblable.
M. Duval, au contraire, rserve son jugement (Litt. ay1., p. t:U).
Une chose est du moins au-dessus de toute contestation; c'est que
les Juifs, autant que les paens, se rjouirent des dsastres que la
cruaut de Sapor infiigea aux glises chrtiennes. Voici comment s'ex-
prime Afraat au dbut de sa dmonstration xxi (d. Parisot, col. 932 et
933) : J'ai entendu des moqueries qui m'ont vivement afflig. Les paens
disent qu'il n'y a pas de Dieu pour ce peuple qui est runi d'entre
toutes les nations. Ces impies parlent de la sorte : S'ils ont un Dieu,
pourquoi ne venge-t-il pas son peuple? Mais j'ai t assombri par un
nuage de tristesse, parce que les Juifs, eux aussi, nous raillent et
s'lvent au-dessus des enfants de notre peuple.
Un certain jour, je rencontrai un homme rpute savant parmi les
Juifs. Il m'interrogea ainsi : Jsus que vous appelez votre docteur
vous a crit :S'il y avait en vous de la fol comme un grain de snev,
vous diriez cette montagne: Va-t'en, et elle s'en irait de devant vous,
ou bien qu'elle soit enleve et tombe dans la mer, et elle vous obi-
rait. Il n'y a donc pas dans tout ' 'otre peuple un seul sage dont la
prire soit exauce, et qui demande Dieu de faire cesser toutes vos
perscutions, puisqu'il est ainsi crit : Il n'y aura rien d'impossible
pour vous. Dans la recension de la passion de Simon, publie par Je
p, BEDJAN, 11, p. i50, les Manichens, les Marcionites, les Glay, les Man
qr (ou Mei,Jadray), les K a n t a y ~ et les Mayday (Mabday) sont signals
comme dnonciateurs des chrtiens. De mme dans J'Histoire de Karka
de Beit Slokh, BEDJ., II, p. M3, pour les Manichens.
CARACTRES GNRAUX DE LA PERSCUTION. 59
un diacre, son neveu. Celui-ci, qui avait t interdit
pour ses dportements, se rendit la Porte Royale,
dans la ville de Ledan, obtint l'emprisonnement et
la condamnation de son oncle
4
Mais le plus gnralement ce furent les fonction-
naires de tout ordre qui prirent l'initiative des pour-
suites. Satrapes ou marzbans, rads ou simples chefs
de villages, chacun s'arrogeait le droit d'incarcrer
sa guise les clercs et les fidles. Entre tous, les pr
tres mazdens se distingurent par leur zle, pouss
jusqu'au fanatisme. Les mobeds infrieurs et surtout
les grands mobeds semblent avoir t commis offi-
ciellement la recherche et la punition des chr-
tiens.
Les accuss taient soumis une prison prven-
tive qui pouvait durer plusieurs mois ~ ou plusieurs
annes au gr des perscuteurs. Le roi, les gnraux
et les mobeds tranaient ainsi leur suite des trou-
pes de prisonniers qu'ils interrogeaient quand bon
leur semblait.
Ainsi qu' Rome, les juges usaient de la question.
Plusieurs des renseignements que nous fournissent les
Actes concernant les tortures subies par les martyrs
sont d'ailleurs sujets caution. Cependant les ha-
giographes persans usent en gnral de ces pouvan-
tables descriptions avec une louable sobrit.
Tandis que les conteurs latins ou les mtaphrastes
grecs croient difier leurs lecteurs en accumulant
dans leurs rcits les prodiges et les miracles les plus
invraisemblables, les Orientaux, avec plus de rai-
son, prfrent placer dans la bouche des confesseurs
des mots historiques ou de longs dveloppe-
t. M. O., p. fS!il. .
2. Barba'semin fut emprisonn onze mois. v. ci-dessous, p. 7!1.
60 LA PERSCUTION DE SAPOR II.
ments homiltiques. C'tait en somme une ide juste
et fconde que de cder la parole des prdicateurs
aussi autoriss, et de donner ainsi plus de valeur aux
lieux communs de l'apologtique, de la morale ou
de la dogmatique. La vraisemblance tait du reste le
moindre souci de nos rdacteurs et, sans doute, du
public auquel ils s'adressaient.
On ne peut donc faire aucun fonds sur les interro-
gatoires des martyrs persans tels qu'ils sont rap-
ports dans les Passions. Nous savons seulement que
l'on s'efforait par tous les moyens d'obtenir l'apostasie
de l'accus. Si un magistrat chouait dans cette en-
treprise, il remettait souvent le confesseur aux mains
d'un autre juge. -
C'est ainsi que l'vque Abdiso', arrt dans les cir-
constances que nous avons dites, comparut avec ses
compagnons d'abord devant Ardasir, roi d'Adia-
bne, puis devant le mobedan mobed de Ledan,
assist de deux mages, enfin devant le chef des eunu-
ques, matre de tous les lphants du royaume, qui,
dsesprant de le rduire, le fit enfin excuter'. L'inter-
vention de trois personnages remplissant des charges
si diffrentes confirme ce que nous avancions plus haut
au sujet de la confusion des juridictions.
Les chrtiens de Perse secouraient avec un pieux
empressement leurs frres emprisonns. L'histoire a
retenu le nom d'une pieuse femme originaire d'Ar-
bles, lazdundokht, qui joa pendant la perscution de
Sapor le rle que les passionnaires latins prtent
la lgendaire Lucine
2
Iazdundokht nourrit de ses
biens les martyrs de Dieu, pendant tout le temps.
qu'ils furent emprisonns ; elle leur procurait tout ce
t. M. O., p. Hill et suiv.
Il. CXX Martyrs. ASSEIIANI, M. 0., p. 106-108.
CARACTRES GNRAUX DE LA PERSCUTION. 61
qui leur tait ncessaire et ne permettait pas que
personne l'aidt. .. Quand vint le jour du dpart du roi,
un eunuque son ami dit en secret cette fidle que,
le lendemain matin, les saints martyrs seraient tus.
Elle leur fit faire un repas, leur lava les pieds, leur
distribua des habits neufs et tout blancs, et leur pro-
digua ses encouragements, en ayant soin de ne pas
les prvenir de leur supplice . Malgr ses charitables
rticences, les martyrs comprirent que leur excu
ti on tait imminente, ils l'interrogrent, mais elle leur
rpondit vasivement : Pourquoi m'interrogez-vous 't
croyez que je vous ai simplement rendu les services
que je vous dois . Le lendemain, elle les avertit, les
encouragea et se recommanda leurs prires.
Le supplice suivait, en gnral, immdiatement le
dernier interrogatoire. Le plus souvent, les martyrs p-
rissaient par le glaive, ou taient lapids. Mais l'ing-
niosit orientale ,inventait parfois des tourments plus
raffins. Tantt, comme Pusak, le martyr tait gorg
de manire ce qu'on pt retirer sa langue par la bles-
sure
4
Tantt, comme Tarbo, il tait coup en e u x ~ , ou
bien on lui brisait les articulations. Cette pouvan-
table torture tait parfois dose avec mthode. L'ing-
nieuse cruaut des bourreaux avait invent le supplice
des neuf morts . Le voici tel qu'il est dcrit dans
la Passion de Jacques, une des plus sincres et des
plus authentiques
3
: On coupe d'abord les doigts des
mains, puis les orteils, puis le carpe, puis les chevilles.
Ensuite les bras au-dessus du coude, les genoux,
les oreilles, les narines, et enfin la tte.
Certains juges forcrent des chrtiens excuter
1. M. O., p. 35 (texte syr.).
!1. M. O., p. 118.
3. B&DJAN, IV, p. 197.
"
I.A PERSCUTION DE SAPOR II.
leurs frres en leur promettant ce prix la libert et
la restitution de leurs biens. Deux satrapes de
l'Adiabne, Ardasir et Narss Tamsabur, paraissent
s'tre complu ajouter cette torture morale aux
souffrances physiques des martyrs. Les nobles de
Karka de Beit Slokh lapident Isaac ; un prtre, War-
tran, tue Gustahazad
2
; un autre, Paul, dont les ri-
chesses avaient t confisques, gorge quatre reli-
gieuses
3
Le chef de la ville d'Arewan, qai avait
jusque-l rsist aux promesses et aux menaces, cde
enfin et accepte de trancher la tte du moine Badema
pour acheter sa dlivrance
4
De si regrettables dfections taient compenses par
de beaux traits de courage. L'hrosme des martyrs
tait souvent contagieux. Tandis qu'on conduisait
Barsabia au supplice, un mage se mle aux rangs des
condamns et demande partager leur sort glorieux
5
Le chef des artisans royaux, Pusak, exhorte la per-
svrance un martyr qui faiblissait et est aussitt
puni de mort.
En dpit de nombreuses apostasies, l'glise per-
sane continua en somme la tradition glorieuse des
glises du monde romain. De fait, la question des
apostats et de leur rconciliation ne parat pas s'tre
pose en Perse, lorsque les communauts chrtiennes
se rorganisrent avec la permission du Roi des Rois.
Les corps des martyrs taient, suivant la coutume
persane, abandonns aux btes sauvages. Parfois, lors-
que la victime tait plus connue, des gardes veil-
t. Ill. 0., p. 99 (texte).
!!. M. O., p. tOO.
3. M. O., p. t2.'1.
-l. M. O., p. t67.
:;. M. o.,p.9-l.
ANALYSE DES PRINCIPALES PASSIONS. 63
laient autour de sa dpouille pour empcher que les
chrtiens ne s'en emparassent. Hormis ces cas excep-
tionnels, les martyrs taient pieusement recueillis par
leurs frres. La Passion des CXX martyrs nous montre
Iazdundokht ensevelissant dans des linceuls les ca-
davres des hros, puis les disposant cinq par cinq
dans des tombes prpares en dehors de la ville.
Mme lorsque les ordres des magistrats taient for-
mels, les chrtiens s'ingniaient sduire et cor-
rompre les gardes. C'est ainsi, par exemple, qu'un
fidle achte les corps des martyrs Berikiso' et Y onan
pour 500 drachmes et trois vtements de soie
2
Les mar-
ty ria levs pendant la perscution taient naturelle-
ment trs modestes en raison de leur caractre clan-
destin. Mais ds que la mort de Sapor II donna quelque
rpit l'glise, et surtout lorsque, par les soins d'Isaac
et de 1\laruta, elle eut conclu avec les monarques
Sassanides une sorte de concordat, de somptueux
difices et des monastres magnifiques s'levrent sur
les tombes des glorieux confesseurs de la foi
3
S 4.. - Analyse des principales Passions.
Au premier rang, par ordre de date et d'importance,
se place la Passion de l'vque des Villes Royales : S-
Simon (c'est--dire fils des teinturiers)
est somm par le roi de Perse de payer un impt double
pour subvenir aux frais de la guerre contre les Romains.
1. M. O., p. 108-109.
i.M.O.,p.m.
3. HOFFIIANl'l, Amzge, p. "7.
" Ev. AsSEIIANI, M. 0., 1, p. tll-40. BEDJ., Il, p. i3H!08. SOZOMNE, H. E.,
II, 9 et 10.
LA PERSCUTJON DE SAPOR IL
L'vque s'excuse de ne pouvoir percevoir une capita-
tion supplmentaire. Sa communaut est pauvre. D'ail-
leurs le rle d'un vque n'est pas de pressurer ses
peuples, mais bien de les gouverner avec mansutude.
Sapor, irrit, excit par les ternels ennemis des chr-
tiens, les Juifs, ordonne de chtier les prtres et les
lvites, de confisquer et de souiller les glises et les
objets du culte. On enchane Simon et deux prtres
choisis parmi les plus gs des douze qui formaient le
collge presbytral, 'Abdhaikla et ljanania l. Tandis
qu'on les tranait par les rues de la ville, ils approch-
rent de leur ancienne cathdrale. L'vque pria les
gardes de modifier leur itinraire. n voulait s'pargner
la douleur de passer devant son glise qui, peu de
jours auparavant, avait t change en synagogue.
A marches forces, presss par les satellites, les cap
tifs parviennent la ville royale : Karka de Ledan. Le
grand mobed avertit le prince que le chef des sor-
ciers estarriv . Le roi le fait introduire, mais Simon
ne l'honore pas des prostrations protocolaires.
Elles sont donc vraies, s'crie le prince courrouc,
les accusations qu'on a portes contre toi. Tu te pros-
ternais devant moi, auparavant, et maintenant tu re-
fuses de te prosterner .
Simon rpond: C'est la premire fois que je te ren
contre, tant captif, et je n'ai jamais t sollicit aupa
ravant de renier Dieu >>.
Les mages reprennent : Qui douterait, roi, qu'il
machine une conspiration contre ta Majest, puisqu'il
refuse de payer tribut?
i. I.e martyrologe de U2 nous a conserv le nom de tous les mem-
bres du presbyterium: 'Abdhaikla, Qayoma, Badbui (Al;lada
bu hi?), Paul, Ziza, Paul (dittographie?), Naqlb, Ad na, Isaac, Hormizd,
lahbalaha, Badema, les douze prtres de Sleucie-Ctsiphon, villes de
Beit Arama!.
.
.....,.
ANALYSE DES PRINCIPALES PASSIO:"l'S. 65
" Il ne vous suffit pas, dit Simon, hommes impies,
d'tre loigns de Dieu et d'en loigner Sa Majest,
vous voulez encore me convertir vos impits!
Le roi se rassrne et lui promet la vie, s'il adore
le soleil.
S.- Je ne voudrais pas t'adorer, et cependant tu es
plus excellent que le soleil, puisque tu es dou d'intel-
ligence et de raisonnement. Or le soleil est inintelli-
gent, puisqu'on ne peut pas deviner s'il te favorise, toi
son adorateur, et s'il me punit, moi qui l'insulte. Il n'y
a qu'un seul Dieu : Jsus-Christ, mort sur la croix.
R.- Si tu adorais un Dieu vivant, j'excuserais ta
sottise, mais tu viens de m'affirmer que ton Dieu est
mort suspendu un bois infme. Allons! Adore le so-
leil par la vertu de qui tout subsiste.
S. - Le soleil a pris le deuil quand son Crateur
est mort, comme le fait un esclave quand meurt son
matre.
R.- Tu as tort; il n'est pas raisonnable de vouer
la mort un grand nombre d'hommes, pour le plaisir
de garder ton opinion.
S. - La mort sera pour eux et pour moi un bien-
fait. Quant cette vie fragile, elle est en ton pouvoir,
te-la-moi.
R. -Ton insolence est cause que je te ferai mourir
pour prserver tes compagnons en les terrifiant par
ton supplice.
S. -Je ne crains rien. Dieu nous couronnera.
R. - Demain, je te ferai mourir si tu n'adores le so-
leil.
Sapor le fait emprisonner jusqu'au lendemain pour
hri laisser le temps de rflchir et de changer d'avis.
Cependant un vieil eunuque, nourricier du roi, avait
abjur le christianisme. Comme Simon se prsentait la
4.
66
LA PERSCUTION DE SAPOR II.
Porte Royale, ille salua respectueusement, mais l'v-
que dtourna son visage. Cette attitude le fit rentrer en
lui-mme. Il retourna chez lui, dpouilla ses vtements
luxueux et .revint la Porte, vtu d'habits de deuiL
Le roi lui fait demander la raison de cette dmarche
insolite. L'eunuque avoue sa conversion et se dclare
prt mourir
1
Sapor, pensant effrayer les chrtiens
et amener des apostasies, dcide son excution. Gus-
tahazad subit le martyre le jeudi de la semaine des
Azymes.
Simon se rjouit du triomphe de la grce et prie
Dieu de hter son propre supplice. Cependant, le len-
demain, vendredi de la semaine des Azymes, il est
conduit devant le roi qui essaye de le sduire en di-
sant : u Adore une fois seulement le soleil, et tu ne
l'adoreras plus ensuite; ainsi tu chapperas aux
embches de tes ennemis . L'vque rpond que ses
ennemis triompheront plutt et se rjouiront de ce que
Simon a faibli au dernier moment et prfr une
vaine idole au vrai Dieu. En vain le roi fait appel
leur ancienne amiti, et l'invite ne pas abandonner
a ~ bourreau son corps si imposant et si remarquable.
Simon demeure inflexible, Sapor l'envoie la mort.
Une centaine d'vques, prtres ou diacres taient
entasss dans les prisons de la ville. Les vques
taient originaires de la Susiane et de la Mesne. C'-
taient : Gadiahb et Sabina, vques de Beit La pat;
Jean, vque d'Hormizd-Ardasir; Bolida', vque
de Prat; Jean, vque de Karka de Maisan
2
Le grand
mobed les fait extraire tous ensemble de leur cachot.
Il leur promet la vie sauve s'ils renient Jsus-Christ.
i. Voir .ci-dessus, p. 49.
2. Cits par le codex Nltriensis II (M. o., p . .u, n. !ii') et le martyrologe-
de 4U.
. --,.-...-.. , .
ANALYSE DES PRINCIPALES PASSIONS. 67
Tous s'y refusent, et sont condamns subir le dernier
supplice en mme temps que l'vque de Sleucie
et ses deux compagnons, Abdhaikla et I;Ianania.
Cependant, dans l'espoir d'branler enfin la cons-
tance de Simon, le roi a ordonn qu'on massacrt
.tous ses compagnons devant lui. Peut-tre le noble
vieillard sera-t-il pouvant et consentira-t-il apos-
tasier, et sans doute aussi percevoir cette double
capitation si utile aux entreprises royales. Simon
trompe son attente. Comme jadis la mre des Maccha-
bes, il exhorte et encourage ceux dont le supplice
aurait d le frapper de terreur. Toutefois, au moment
suprme, le prtre I;Iapania semble hsiter. A la vue
du glaive qui va le frapper, il s'meut, il va flchir.
Alors un cc grand homme , le Qarugbed
1
, prfet
des ouvriers royaux, s'crie du milieu de la foule :
cc Dpose toute crainte, I;Ianania, ferme un peu les yeux
jusqu' ce que tu sois en possession de la lumire
du Christ >>. A peine eut-il prononc ces paroles que
Pusak
2
est tran par les gardes la Porte Royale.
Sapor, irrit de l'intervention du gnreux chrtien,
effray peut-tre de se voir entour d'officiers gagns
la nouvelle doctrine, qui pourraient venger sur saper-
sonne la mort de leurs coreligionnaires, l'apostrophe du-
rement: cc Ne t'ai-je pas donn une charge, ne t'ai-je pas
commis ton ouvrage? pourquoi mprises-tu mes
ordres et restes-tu regarder le supplice de ces pa-
resseux
3
,, Pusak rpondit : cc Plt1t Dieu que mon
i. Sur ce mot et sa signification, v. TAnARI, p. 502.
2. Appel aussi Pusa ouPusak (avec le k persan). SozoMNE, H. E., Il,
il : Jlouantij;.
3. ou hommes de rien; il y a ici un jeu de mots. M. O., p. 30. Le P.
Bedjan a publi une recension plus dveloppe du martyre de Pusa
et de sa fille, qui est donn le nom de Marthe (Acta MM. et SS., t. II,
p. 208-W et 233240).
68 LA PERSCUTION DE SAPOR II.
travail s'augmente de leur fainantise, et que ma vie
soit change pour leur mort. Quant l'emploi que tu
m'as donn, je le mprise, parce qu'il est plein de
soucis, et j'apprcie le supplice auquel tu les a con-
damns, parce qu'il est plein de joie. Insens, re-
prend le roi, tu demandes la mort au lieu de ton emploi,
tu veux tre trait comme eux? >> Le Bienheureux
dit : << Je suis chrtien, et je crois en leur Dieu. C'est
pourquoi j'envie leurs supplices et je mprise ta
dignit . Violemment irrit, le roi s'cria : '' Qu'il ne
meure pas comme tous les hommes. Mais, parce qu'il
a mpris ma Majest et parl avec moi comme avec
un gal, arrachez, dracinez sa langue au t1"avers de
son cou, afin que ceux qui sont encore vivants me
redoutent cause de lui >>. On accomplit l'ordre du
roi et Pusak mourut-sur-le champ. On tua aussi sa
fille, qui tait religieuse. Enfin, le dernier de tous, Si-
mon B a r ~ a b b a e prit. C'tait le vendredi de la semaine
des Azymes, jour anniversaire de la mort du Seigneur.
Exaspr par la constance des martyrs, Sapor or-
donna une perscution gnrale. Pendant dix jours
on massacra les chrtiens de Ledan, de Beit Lapat et
des contres voisines. Les paens profitrent de l'em-
portement du roi pour assouvir leur haine religieuse
ou pour satisfaire des rancunes personnelles. Le glaive
frappa l'aveugle. Parmi les martyrs se trouvrent
deux vques, Amria et Meqima, et un prtre de Suster
qui taient captifs dans les prisons de la ville. Un
des eunuques favoris du roi, nomm Azad, fut con-
fondu avec les autres victimes et prit avec elles. Sapor
se prit alors regretter d'avoir supprim jusqu'
l'apparence d'un.e procdure rgulire. Il commanda
qu'on. pargnt dsormais les chrtiens qui n'taient
ni vques ni prtres. Mais, dit l'auteur anonyme dit
ANALYSE DES PRINCIPALES P A S S I O ~ S . 69
par Asse mani l, u quant aux noms des hommes, des
femmes et des enfants qui ont t tus pendant cette
perscution, except pour ceux qui taient originaires
de la ville (de Ledan), on ne les connat pas. Nom-
breux furent ceux dont on ne sut pas les noms, parce
que, pour la plupart, ils avaient t amens des rgions
trangres. Et des laques, et des soldats du roi,
un grand nombre furent tus pour avoir confess notre
Dieu, et furent glorifis .
La sur de Simon, Tarbo, fut saisie quelque temps
aprs Sleucie
2
La reine tant tombe malade, les
Juifs lui persuadrent que sa maladie tait due aux sorti-
lges d'es chrtiens et particulirement des surs de
Simon qui vengeaient ainsi la mort de leur frre. Elle
accueillit cette dnonciation, et fit amener la Porte
Royale Tarbo, sa sur religieuse
3
et sa servante gale-
ment chrtienne. Le grand mobed, assist de deux
autres dignitaires, fut commis leur interrogatoire.
Les juges, san.s couter les protestations des inculpes,
les dclarrent coupables de malfices t les condam-
nrent la prison. Mais, disent les sources anciennes
4
,
ces impies. s'taient pris de la beaut de Tarbo et ils
allrent, chacun sparment, lui proposer de la sauver,
si elle se rendait leurs dsirs. Tarbo repoussa leurs
offres. Ce rcit, visiblement inspir par les passages
analogues de l'histoire de Suzanne, est d'ailleurs in-
vraisemblable,. si l'on admet avec le rdacteur de la
Passion de Simon que l'vque de Sleucie, frre de
Tarbo, tait fort avanc en ge. Quoi qu'il en soit de
f. M. O., 1, p. ;;o. SozOKNE, H. E., Il, H.
2.. Ev. AssEMANI, M. O., p. 5l-09. BEDJ., II, p. 2.'H-260. SozoMNE, H. E.,
II, t2.
3. M qaddai;ta. Cf. les mqaddeS dont il est question au canon vm
du concile d'lsaac. Syn. orient., p. 265 et la n. 7.
-l. M. 0., p. 56. SOZOHNE, loc. sup. cil.
70 LA PERSCUTION DE SAPOR Il.
ce dtail, les trois chrtiennes furent condamnes
mort. Sur le conseil des accusateurs on les coupa en
morceaux, et la reine fut porte en litire parmi leurs
cadavres, afin de conjurer leurs prtendus malfices.
Mils, vque de Suse t, dont nous avons parl
dessus, souffrit le martyre lamme anne le 13 novem-
bre. Il tait originaire du pays de Raziq
2
Comme il
vanglisait les environs de Suse et l'lam, Gadiahb,
vque de Beit Lapat, le consacra vque. Son apos-
tolat ne fut pas des plus aiss ni des plus fconds.
Maltrait par les paens, il quitta Suse, non sans avoir
appel sur cette cit la colre divine. Ses menaces ne
furent pas vaines. Trois mois aprs, la suite d'une
conspiration, le roi envoya trois cents lphants et fit
dtruire la ville de fond en comble. Entre temps, Mils
tait all en plerinage Jrusalem, et ensuite
Alexandrie pour visiter Ammonios, disciple de saint
Antoine. De retour en lam, il devint compagnon de
cellule d'un moine. Tous deux eurent lutter contre
le dragon Nuspha, long de trente-deux coudes, qui
voulait entrer dans leur retraite. Mils, par ses prires,
le fit prir. Son compagnon lui reprocha. cette vic-
toire comme un crime. Le dragon, dit-il, tait appri-
vois et accoutum loger avec lui (!). Mais Mils
rpliqua que Dieu avait enjoint l'homme de lutter
contre le serpent sans trve ni merci. Le moine, irrit?
quitta sa cellule, laissant Mils matre de la place.
, Cependant notre hros se rend Nisibe o il trouve
l'vque Jacques occup b.tir une glise. Il s'arrte
quelque temps auprs de lui, puis redescend la valle du
Tigre, et arrive Sleucie o Papa, fils d,.Agga, oppri-
t. M. 0., p. 66-79. BEDJ., II, 260-!St. SOZOliNE, H. E., Il, 14.
2. c'est--dire la portion de la dont Thran est actuel-
lement la capitale.
ANALYSE DES PRINCIPALES PASSIONS. 7i
mait le clerg et les fidles ; nous avons vu plus haut
quelle part importante Mils prit la condamnation
de l'vque des Villes Royales. Son uvre accomplie, il
redescend en Msne, puis revient dans son pays d'ori-
gine. Les miracles se multiplient sur ses pas. Un jour,
accompagn de deux moines, il passe pied sec un
fleuve en fureur.
Mais il parat s'tre tout spcialement complu au rle
de flau de Dieu. Nous avons dit comment il traita les
citoyens de Suse. Dans l'assemble de Sleucie,
peine a-t-il prononc l'anathme, que Papa est
frapp de paralysie. Plus tard il donne la lpre un
voleur. Enfin, il reprend un diacre incestueux et
lui interdit le ministre. Le clerc se prtend calomni
t veut poursuivre son office. Mais, tandis qu'il ose
entonner un psaume, il meurt subitement. Mils exera
aussi contre ses juges son redoutable pouvoir. Le
gouverneur local du pays de Raziq, Hormizd Gu-
friz, le fit saisir et emmener au chef-lieu
1
avec les
prtres Aborsam et Sina. Au cours de l'interrogatoire,
Hormizd et son frre Narss, irrits par les audacieuses
invectives de Mils, se prcipitent sur lui et le tuent.
Mais, en mourant, il leur prdit que, le lendemain, pa-
reille heure, ils s'entre-tueront. Les chiens viendront
lcher leur sang, les oiseaux dchireront leurs cada-
vres. Le lendemain, en effet, les deux juges s'entre-tuent
la chasse et la prophtie de Mils est pleinement ra-
lise. Cependant le corps du martyr fut port Malqan,
avec les reliques d'Aborsam et de Sina qui avaient t
lapids, et dsormais ce bourg fut protg contre les
attaques des Sabens
2
i. ; ~ ~ - , p. 76. Je ne sais comment identifier cette localit dont
le nom est certainement altr.
2. Cette lgende de !lils est visiblement fantaisiste. Plusieurs per
72 LA PERSCUTION DE SAPOR II.
l
En 342, Sahdost, successeur de saint Simon, est 1
mis mort
1
Il avait t arrt l'automne prcdent
Sleucie, pendant le sjour du roi, avec cent vingt-
huit prtres, diacres, religieux et religieuses de la ville, 1
des faubourgs ou des localits environnantes. Les com-
pagnons de l'vque furent martyriss le 20 fvrier,
aprs cinq mois de dtention, mais lui-mme fut conduit
Beit Lapat la suite de Sapor, et on lui trancha la tte,
probablement au cours de l't.
Barba'semin de saint Simon et successeur de
Sahaost, fut saisi avec seize clercs dans sa ville pis-
aonnages rels ou lgendaires sont confondus dans un mme rcit dont
Je folk-lore du Raziq a pu fournir la trame. On doit au moins distin-
guer un moine et un Mils vque de Suse, qui est peut-tre le
seul historique. Au reste, nous n'avons donn l'analyse de ces Actes.
anciens d'ailleurs, que pour appuyer ce que nous disions plus haut
des diffrences de valeur de nos sources. Le martyrologe de U! cite en
tte de liste : Milos, vque, Aborsam et Sina, confesseurs primitifs .
Il est donc fort possible que leur martyre soit antrieur la perscu
tion de Sapor.
Le !10 fvrier lunaire, le prtre Daniel et la religieuse Warda souffrent
le martyre dans le pays de Raziq, deux ans aprs Mils (M. O., p. tM).
Un peu plus tot (M. 0., p. 93 et suiv.), dans le mme temps o fut mar-
tyris le B. Mils , un cnobiarque de la province de Fars, qui s'appelait
Bari;abia, vivait en communaut avec dix de ses disciples. On J'accusa
devant le mobed d'Istahr qui le fit saisir, charger de chanes et conduire
au supplice. Un mage, touch de voir ces hros s'avancer en chantant,
et apercevant une croix de feu au-dessus des cadavres de ceux qui
avaient dj subi Je martyre, saute bas de son cheval, revt les habits
de son esclave et supplie Barsabia de l'admettre en sa compagnie. Les
bourreaux le mirent mort sans J'avoir reconnu, et ainsi, ditl'hagio-
graphe, fut parfait le nombre de douze martyrs Leurs ttes furent por-
tes en ville et suspendues dans le temple de Nahit, desse des Perses
Mais la famille du mage se convertit et plusieurs Persans avec elle.
Ces deux courtes Passions sont relies celle de Mils et forment
avec elle un cycle isol.
t. M. 0., 88-9t. BEDJ. II, 1176280. SOZOMNE, H. E., TI, t3, aurait coup
en deux le nom de Sahdost, pour en faire deux martyrs distincts 'Ialix
et Actua&, (WESTPHAL, Untersuch., p. 9t). v. cependant ci-dessous, p. 78.
li. M. O.,tH-H7. BEDJ., 11,1196-303. SOZOMNE, loc. sup. cit., Betp6etaV!Ll);.
WESTPHAL, op. cil., p.t03, explique ainsi son nom d'aprs une inscription
nabatenne : rowl1J,J = rowSl1J,J, le llls du Baal des cieux.
ANALYSE DES PRINCIPALES PASSIONS. 73
copale, puis retenu en prison depuis le mois de fvrier
345 jusqu'au 9 janvier 346, c'est--dire onze mois. Le
roi manda les prisonniers Ledan pour les interroger
lui-mme et, ne pouvant branler leur constance, il
les fit mettre mort. Le sige de Sleucie demeura
vingt ans vacant aprs le supplice de Barba'semin l.
L'anne prcdente (345), pendant un autre sjour du
monarque Sleucie, cent vingt membres du clerg
avaient t arrts, mis aux fers pendant six mois et
supplicis le 6 avril
2
Nous avons cit plus haut le beau
trait de dvouement de lazdundokht qui les secourut
dans leur prison.
A partir de 343, la perscution svit presque conti-
nuellement dans les provinces du Nord, le Beit Garma
et l'Adiabne. La prsence des armes royales y tait
commande par la guerre contre les Romains
3
En 343, Narss, vque de la ville de Sahrgerd, alors
mtropole du Beit Garmai, fut arrt, puis dcapit avec
son disciple Joseph, le 10 novembre. Assemani a pu-
bli un Catalogue des martyrs de la mme province qui
souffrirent sous [le roi d'Adiabne Ardasir et sous le
mobed Adargusnasp, mais le nom des confesseurs et la
localit o ils ont t mis mort sont seuls mentionns.
Nous y relevons les noms de Jean, Sapor et Isaac, v-
ques de Beit Slokh; d'Isaac et de Papa, prtres; d'A-
braham, moine, de Gustahazad, eunuque, de Sawsan,
Mare, Tima, Zerun, lacs de Lasom, qui furent em-
mens Beit Lapat pour y tre massacrs, de Ba'uta,
i. Ce chiffre n'est qu'approximatif. v. le ch. suivant.
ASSEIIIANI, M. 0., p. 105 et SUiV,
3. IJ.ayot -rt xal pxt!Jo<lyot IJtpawv y;;v, lm!J.Eii
xaxo.Spyow -ro t'lttax6Tcov xl 'ltpEallv-rpav;, IJ.ata-ra li xa-rt rl)v
JCWpetv X!!J.Ct li; 'tO'tO IJEpatxov, w 7r!'ltaV
SoZOIIINE, H. E., II, H. Patr. Graec. t. LXVII, col. 965.
4. ASSEIIIA!'II, M. 0., 97-101,
LE CBRISTIANISIIIE.
..; -
i4 LA PERSCUTION DE SAPOR II.
femme noble, et de quatre religieuses. La plus grande
incertitude rgne d'ailleurs sur la vritable date de ces
martyres. En effet, l'anonyme dessnien, publi ga-
lement par As sem ani
1
, place dans la trentime anne
de Sapor le supplice de Ma na. Abraham, Simon, et
des deux vques Sapor de Beit Niqtor et Isaac
de Karka de Beit Slokh. L'Histoire de Beit Slokh
2
ignore l'existence de Sapor. Elle nomme un certain
Mana, inconnu aux deux autres catalogues, vque de
Beit Slokh et prdcesseur d'Isaac. Pour ce dernier,
elle est d'accord avec les deux autres documents. Mais
elle lui donne pour successeur un vque Jean, qui au-
rait pris part au concile de Nice (!). Quant Mana,
Abraham et Simon ainsi qu'un autre Ma na, ils auraient,
d'aprs cette source, souffert le martyre pendant la
perscution d'lazdgerd II (446).
Nous connaissons mieux la chronologie des martyrs
de l'Adiabne proprement dite. En 343, Jean, vque
d'Arbel, surnomm Bar Mariam, est arrt avec le
prtre Jacques, surnomm le Zlote, et emprisonn
dans une citadelle par l'ordre de Peroz Tamsabur. II
y fut dtenu un an. Jean, craignant que la perscu-
tion ne l'pargnt, avait pri Dieu de lui accorder la
grce du martyre. Il vit en songe un satellite qui
tenait une pe o tait enfile une couronne d'or. Le
satellite courut vers lui, lui plaa la couronne sur la
tte et lui dit : << Jouis de ce que tu as demand,
acquiers ce que tu as souhait . Sept jours aprs, il
tait arrt et misen prison. Il y demeura un.an, puis
le mobed d'Adiab"ne le fit condqire la Porte Royale,
Beit Lapat. Jean et son prtre furent dcapits le
t. M. O., p. 226-1!1!9.
~ 2. BEDI., Il, p. 515, 51!6. HOFFMAN:-1, Ausztige, p. 51!. Cf. R. DuVA.L, Litt.
syriaque, p. 131-t3!1 et 137.
ANALYSE DES PASSIONS. 75
1 Tesri II lunairet qui correspond peu prs au mois
de novembre.
Le 5 fvrier de l'anne suivante, Abraham, le suc-
cesseur de Jean sur le sige d'Arbel, comparut de-
vant le grand mobed d'Adiabne, Adurpareh. Rou
de coups, il refusa d'apostasier. Il eut enfin la tte
tranche au bourg de
2
En 345, le lac J.Ianania est saisi Arbel par les
ordres du mobed Adursag
3
Il est soumis la torture
des peignes de fer et laiss pour mort. Les chrtiens
l'enlvent et le portent dans sa maison, o l'vque et
les fidles se rendent, pour ainsi dire, en plerinage.
Le martyr reprend connaissance et leur exprime son
espoir et sa foi. Il meurt presque aussitt le 12 Ka-
noun lunaire (dcembre-janvier).
Le 17 mars 347 moururent Jacques, prtre du bourg
de Tella Salila, et sa sur religieuse, nomme
Narss Tamsabur qui les avait fait arrter voulait les
forcer manger du sang. N'y parvenant pas, il les fit
excuter par un noble apostat du nom de Mihdad au
bourg de Tell-Dara, sur les bords du grand fleuve .
Parles ordres du mme Narss Tamsaburprirentaussi
cinq religieuses, Thcle, Marie, Marthe, Marie et Ami
5
Le perscuteur les fit massacrer par un prtre apostat
du bourg de Bakasa, Paul, auquel il avait promis de
rendre ses richesses confisques. En vain Paul se prte-
t-il ses -desseins. Narss, voulant retenir les biens
qujil s'tait appropris, et craignant que le rengat ne
lui intentt un procs, le fit trangler par ses satellites.
l. BEDu:-;, Acta MM. et SS., IV, p. H8-t30.
9. Op. cit., p. tao.
3. Op. cit., p. t3t-t33.
4. M. O., p. 1>12.
M. O., p. t!!-3-127.
i6
LA PERSCUTION DE SAPOR II.
Un autre satrape d'Adiabne, Sapor Tamsabur l, fit
arrter diacre d' Arbel
2
Il voulut le con-
traindre adorer le feu et l'eau, ou au moins manger
du sang. Comme Barl;ladbesabba s'y refusait, Sapor le
fit excuter en dehors de la ville par un apostat du
bourg de Tal;lal nomm Gagai. Deux clercs essaient de
corrompre les gardes qui veillaient auprs du cadavre
de la glorieuse victime. N'y pouvant parvenir, ils leur
font violence et s'emparent des reliques du saint qu'ils
cachent soigneusement. Le martyre de
fut consomm le 20 Tammz (juillet) 354.
L'anne suivante, le 16 Kanoun (dcembre-janvier),
prirent Aitalaha et J.Iafsa
3
Aitalaha, prtre de
Sarbil, desse d'Arbel, souffrait d'un flux de sang.
Malgr les prires qu'il adressait son idole, sa ma-
ladie ne faisait qu'empirer. Il se rendit alors auprs de
l'vque qui le gurit. Pour le soustraire aux emM-
ches des paen.s, les chrtiens l'envoyrent Mal;loz
de Arwan o il fut catchis et baptis. Plein d'ar-
deur, il revint ensuite dans son pays d'origine pour y
prcher la religion qu'il venait d'embrasser. Or,
cause de la perscution, tous les chrtiens dsertaient
Arbel. Aitalaha essaie de les suivre, mais il est oblig
de s'arrter peu de distance de la ville et ne r-
siste pas la tentation d'y retourner. On le reconnat,
on l'enchane, on l'emmne la citadelle de J.Iazza.
Sapor Tamsabur l'interroge et le condamne assister
au supplice de Barl;ladbesabba, esprant ainsi l'amener
rsipiscence. Comme on le conduisait hors de la
cit, il aperoit le cadavre du saint diacre qui venait
1. Ce Sapor Tamsabur est peut-tre le mme que Narss Tamsabur.
Sur les perscuteurs des chrtiens d'Adiabne, et en particulier sur
Ardasir, frre de Sapor 11, cr. TADARr, p. 70, n. t.
2. ASSEMUI, M. 0., p. 129-131.
3. BEDUN
1
lV, p. t33-t37.
ANALYSE DES PRINCIPALES PASSIONS. 7i
d'tre excut, se jette sur lui, le couvre de baisers,
recueille le sang du martyr et demande partager son
sort. On lui fait couper l'oreille par un rengat et on
le reconduit en prison, o vient le rejoindre J.lafsa,
diacre de Mata de 'Arbay.
Tous deux comparaissent devant le mobed d'Adia
bne qui dcide de les envoyer la Porte Royale. Aprs
un jour de marche, il leur propose de les relcher. Ils
refusent. Arrivs Beit Lapat, ils comparaissent de-
vant le roi qui ordonne leur excution.
Les noms du prtre Jacques et du diacre Azad cl
turent la liste des martyrs de Ils sont
saisis en 372 par l'ordre de Kurkasid, mobed de cette
province. On les met en prison o ils restent sept mois,
pendant lesquels ils subissent diverses tortures. Enfin,
le 14 avril, ils sont condamns et excuts sur une col-
line situe au sud de la ville. En vain, dit leur historio-
graphe, le bourreau voulut-il laver son pe dans une
source abondante qui alimentait une partie de la ville.
La source bouillonna, se troubla, mit du sang pendant
un mois et tarit soudain. Les ingnieurs essayrent d'y
ramener de l'eau, DJ.ais la source se refusa la contenir,
sans doute par crainte qu'on n'y revnt laver une
telle pe )) .
Si les provinces du Nord eurent souffrir d'une
perscution presque continuelle cause des frquents
sjours qu'y faisaient le roi ou ses grands officiers,
plus forte raison les pays frQntires des deux em-
pires Romain et Perse durent-ils tre prouvs. Bien
que nous ne possdions qu'une faible partie des Passions
de ces contres, nous pouvons en conclure que les
chrtiens y furent constamment en butte l'hostilit
i. BEDJAN, IV, p. i37-Ht.
78 LA PERSCUTION DE SAPOR II.
des commandants perses, soit avant, soit surtout aprs
la promulgation de l'dit de perscution gnrale. La
premire excution dont nous ayons connaissance se
place en Arzanne le 24 dcembre de l'an 327
1
Onze
martyrs succombrent. C'taient Zebina, Lazare, Ma-
rut, Narsa, lie, Mahri, I;Iabib, Saba, Sembaiteh,
Yonan et Berikiso. Les deux derniers qui avaient
encourag les autres subirent des tortures effrayantes.
Enfin les juges Hormizdasir (?) et Mihrnarsa les con-
damnrent mort. Leur Passion fut rdige d'aprs
la bouche des tmoins par Isae, fils de I;Iadabu, d'Ar-
zon, un des cavaliers du roi, mais sans doute copieuse-
ment remanie par un compilateur plus moderne :a.
En 360, Phenek, place forte du Beit-Zabd, fut
prise par Sapor. Deux ans aprs, la suite peut-tre
d'une rvolte des habitants, neuf mille d'entre eux
furent dports en Perse
3
Avec eux partirent l'v-
que Hliodore, les prtres Dausa et Mariahb, de
i. ASSEMANI, M. 0., p. llill22,,
2. En 31it, dix-huit auxiliaires Gles qui servaient dans l'arme per-
sane subirent le martyre sur les bords de l'Euphrate le jeudi t2 avril,
avec deux femmes et leurs enfants. Voici ceux dont les noms nous ont
t conservs : Berikiso' et 'Abdiso', Sabur, Sanatruq, Hormizd, Adarsa-
bur, Halpid, Aitalaha, 1Ieqima. Les deux femmes se nommaient Halma-
dur et Phoeb. 11 est regrettable que le dbut seul de leur histoire
nous soit parvenu (BEDJAN,IV, p. t66-t70). Je ne crois pas cependant qu'on
y et trouv des renseignements intressants sur l'tablissement du
christianisme dans le pays des Gles. Cette contre semble n'avoir t
convertie que bien plus tard. Quant nos martyrs, ils ont pu tre instruits
au cours de leurs expditions en pays romain. Le lieu de leur supplice
invite le penser. On remarquera aussi les noms grecs, Elpidios (Halpid)
et Phoeb. Nos Actes confirment l'existence d'une campagne de Sapor
en Msopotamie et jusqu'aux portes d'Antioche en 3/lt, que les sources
romaines et grecques permettent seulement de souponner {TILLE
llO NT, Hist. des Emp., t. IV, p. 369). C'est cette campagne, entreprise tan-
dis que Constance s'employait rduire Magnence, qui amena l'l-
vation de Gallus la dignit de Csar le ill mars 31i1, peu de jours
avant la mort des martyrs Gles.
3. M. O., p. t3H39. Cf. DEnJ., II, p. 3t6-3!U, contient la lin de cette
passion incomplte dans Assemaui. Cf. SOZOMbE, }list. cccl., li, f3,
ANALYSE DES PRINCIPALES PASSIONS. 19
nombreux membres du clerg et des religieux. Tous
furent dirigs la suite de l'arme royale vers le Hu-
zistan. Arriv au bourg de Dastgerd, Hliodore tombe
malade et meurt aprs avoir consacr vque son
prtre Dausa. Les mages, inquiets de cette affluence
de chrtiens, font part de leurs craintes au grand
mobed Adurpareh. Celui-ci va trouver le roi pour lui
signaler le pril. Sapor commande au mobed d'isoler
les principaux prisonniers afin de rduire ensuite plus
aisment les autres. On en choisit trois cents. On les
conduit prs _d'une colline trs fertile, dont on leur
promet la concession, s'ils consentent renier Jsus-
Christ et abandonner la religion de Csar pour em-
brasser celle du Roi des Rois. Encourags par leur v-
que, les chrtiens refusent d'apostasier. Deux cent
soixante-quinze subissent le dernier supplice; les
vingt-cinq autres faiblissent. Cependant un diacre,
nomm 'Abdiso', survcut ses blessures et parvint
se rfugier dans le bourg voisin chez un pauvre qui le
cacha dans sa chaumire. Lorsqu'il fut guri, il prit
soin de la spulture des martyrs, avec l'aide de son
hte, et demeura l pour les honorer. Mais, un mois
aprs, le chef du village, craignant son proslytisme,
l'emprisonna et le mit mort. C'tait en la 53e anne
de Sapor (362)
1
1. Silcs Actes de Mar Saba (BEDJ., IV, p. !U et sui v.) ont quelque valeur,
historique, il faudrait en conclure que d'autres chrtiens purent libre-
ment btir une glise dans l'endroit o ils avaient t dports. Zamasp
qui partageait avec Adur Afrozgerd (le mme qu'Adurpareh du rcit
prcdent?) le commandement de la frontire, le leur avait permis, aprs
avoir vainement essay de les faire apostasier. Un jeune captif, Anastase
convertit le fils de Zamasp: Saba Pirgusnasp. Anastase fut mis mort
l'instigation du mage Kuba. Pirgusnasp qui re rusa de renier Jsus-Christ
fut excut aprs avoir subi d'effroyables tortures.
Outre cette Passion, nous possdons celles de Bassus, de Behnam et
de Sara qui se rattachent la perscution du Beit Zabd (Litt. syr.,
p.Hl).
80
LA PERSCUTION DE SAPOR II.
En la 36 anne de la perscution (374/5), Abdiso,
vque de la banlieue de Kaskar, fut accus par son
neveu, un diacre incestueux qu'il avait interdit, de cor-
respondre avec Csar et de trahir les secrets du roi
1
Sapor accueille favorablement la dnonciation et trans-
met la cause Ardasir, roi d'Adiabne, qui fait arrter
Abdiso, son prtre Abdalaha, et avec eux l'vque
de la ville de Kaskar Abda, ainsi que vingt-huit lacs
et sept vierges, et les conduit en Huzistan, Beit
Lapat. Aprs divers interrogatoires, ils sont mis
mort le 15 de la lune de mai. Deux chrtiens du pays,
et Samuel, demandent partager leur
sort. Les vierges subirent le martyre huit jours aprs.
Tous furent ensevelis par des chrtiens d'origine ro-
maine.
La mme anne, Bade ma
2
, suprieur d'un monastre
de de Arwan, en Beit Garma, est incarcr
avec sept de ses moines. On les dtient quatre mois en
prison. Enfin, Badema est mis mort par l'apostat
Narss. Quant ses compagnons, ils attendirent en
prison la mort de Sapor II, et furent ensuite dlivrs,
aprs une dtention de quatre annes.
La dernire Passion du recueil attribu Maruta
est celle d'.Aqebsema, vque de I;Ienaita, originaire
du bourg de Pekaa
3
Ce confesseur, g de plus de
quatre-vingts ans, fut amen Arbel avec le prtre
Joseph et le diacre Aitalaha. Le prfet Adarkarkasar
les interrogea, les mit aux fers et les trana sa suite
en Mdie. Trois ans aprs, ils comparurent devant le
mobedan mobed Adarsabur, qui fit prir Aqebsema,
1. M. 0., p. 144160. BEDJ., Il, p. 32o347,
i, M. 0., p. 1fla.167. BEDJ., II, p. 347301.
3. M. 0., p. 171203. BEDJ., II, p. 351-397.
l. = Adarkurkasid?
ANALYSE DES PRINCIPALES PASSIONS. Si
le 10 de la lune d'octobre (378). Le corps du martyr
fut soustrait la vigilance des soldats par la fille du
roi d'Armnie qui vivait comme otage dans une for-
teresse de Mdie.
Adarsabur, ne pouvant vaincre la rsistance de Jo-
seph et d'Aitalaha, fit rappeler Adar Karkasar, mobed
d' Adiabne, et lui ordonna de faire tuer coups de
pierres les deux confesseurs par leurs coreligionnaires.
Aprs diverses pripties, et de nouveaux interroga-
toires dirigs par Zaraust et '.famsabur, Joseph est ra-
men Arbel et lapid. Une noble femme de cette cit,
qui avait refus de participer son excution, prit
avec lui, le vendredi de la premire semaine de la
Pentecte.
'.famsabur emmenaAitalaha jusqu' la ville de Dast-
gerd, chef-lieu du Beit Nuhadra, et le fit galement
lapider par des rengats , au nombre desquels se
trouvaient le chef de la province (?) et plusieurs no-
bles. Aitalaha fut supplici le mercredi de la dernire
semaine de la Pentecte (379).
AqebSema et ses compagnons furent les dernires
victimes de cette terrible perscution de quarante
annes. Combien de martyrs avaient succomb avant
eux? Sozomne affirme que le nombre de ceux dont les
noms purent tre recueillis se monta 16.000
4
Ce
chiffre est peut-tre quelque peu exagr. Toutefois, ds
le dbut de la crise, A f r a a ~ , tmoin oculaire, crivait,
faisant allusion la perscution de Diocltien : << Les
glises furent renverses et dtruites jusqu'aux fon-
dements; des confesseurs et des martyrs en grand nom-
bre ont tmoign de leur foi , puis il ajoutait : De
notre temps, cause de nos pchs, les mmes cala-
t, Hilt. eccl., JI, H; P. G., t. LXVII, col. 009.
6.
82 LA PERSCUTION DE SAPOR II.
mits ont t suspendues au-dessus de nos ttes
1
,
On peut donc conclure que la perscution de Sapor II
ne le cda ni en dure ni en intensit celles qu'a-
vaient subies les glises du monde romain. C'est le
grand honneur des chrtients persanes d'avoir sup-
port, sans sombrer, une aussi pouvantable tempte.
t. d. Parisot, col. 989.
CHAPITRE IV
LA RORGANISATION DE L'GLISE DE PBRSE
S 1. - L'tat des chrtients persanes depuis la mort
de Sapor Il jusqu' l'avnement de lazdgerd 1
(379-399).
Tandis que la perscution dcimait cruellement les
chrtiens de Perse, les hostilits se poursuivaient, sans
interruption notable, entre les Romains et Sapor II.
On sait l'histoire de l'invasion de Julien et son issue
malheureuse. Jovien parvint grand'peine sauver
les dbris de l'arme romaine. Il conclut un trait aux
termes duquel les provinces conquises en 297 taient
rtrocdes l'empire perse. Nisibe cessa d'tre ro-
maine. C'tait un centre chrtien fort important, qui
devint la mtropole de la province ecclsiastique de
Beit 'Arbay, et, ds le milieu du v sicle, le sige pis-
eopal le plus en vue de tout l'Orient, aprs celui de
Sleucie-Ctsiphon.
Le successeur de Jovien, Valens, prpara une expdi-
tion contre les Perses (372) pour prvenir une invasion
que mditait Sapor II, irrit des progrs du parti ro-
main en Armnie. Trajan, son gnral, remporta
l'anne suivante un important succs. Sapor II demanda
une trve et se retira Ctsiphon (373). Mais en 377,
Valens, rappel en Thrace, dut conclure un trait de
84, LA REORGANISATION DE L'GLISE m: PERSE.
l
paix qui ne paratt pas avoir t fort avantageux pour
. les Romains. Les Goths menaaient Constantinople, et
l'empereur retira ses troupes de l'Armnie. Avec ces
renforts, il se crut en tat de repousser les envahis-
seurs germains ; il leur livra une grande bataille sous
les murs d'Andrinople, mais fut battu et tu, le 9 aot
378. Sapor Il ne put profiter de ces conjonctures si d-
favorables la puissance romaine. Il tait dj atteint
de la maladie qui le conduisit au tombeau (379), aprs
un rgne de soixante-dix ans
1
Son frre Ardasir II lui succda. Il observa, proba-
blement, l'gard des Romains et des chrtiens une
attitude franchement hostile. Il avait t, en effet, ml
aux entreprises militaires de son prdcesseur contre
Rome, et, tandis qu'il commandait les troupes runies
en Adiabne et en Beit Garma, ils' tait montr acharn
excuter les dits de perscution
2
Mais la mort d'Ardasir amena sur le trne de Perse
Sapor III (18 aot 383). Ce prince adopta une politique
pacifique. Ds le dbut de son rgne, il entra en rela-
tions avec Thodose 1 et cultiva son amiti en lui
envoyant des ambassadeurs, et en lui faisant des pr-
sents de perles, de soie, et d'animaux pour traner son
char de triomphe a .
L'alliance se resserra encore l'avnement de Bah-
rm IV Kermansah (16 aot 388). Loin de diriger au-
cune expdition contre l'Occident, Bahrm conclut
un trait de paix, dont Stilicon fut un des principaux
ngociateurs. Une invasion des Huns Blancs, vers 395,
retint d'ailleurs sur les frontires du Nord les forces
des deux empires. Les chrtiens persans durent bn-
t. TiLLEIIONT, Hist. Emp., v, p. i04 et H!!.
!!. Voir ci-dessus, ch. m, p. 80. cr. T.t.o.t.nl, p. 70, n. L
3. TILLEIIIO!'iT, Hist. Emp., \',p. j39, d'aprs le Pangyrique de Pacatus.
L'TAT DES CHRTIENTS PERSANES. 85
ficier de cette dtente. Pourtant Barhbraeus
1
prtend
qu' la mort du catholicos Tamoza, aucun vque ne
voulut lui succder, car Bahram, fils de Sapor, tait
enn'mi des chrtiens . Il se peut que le chroniqueur
ait confondu Bahram IV avec Bahram V qui, nous le
verrons plus loin, prit l'initiative d'une nouvelle per-
scution.
Au reste, l'histoire de cette poque est pour nous
fort obscure. Si nous pouvons "conjecturer avec quel-
que vraisemblance que les glises de Perse virent
leur condition s'amliorer progressivement, nous ne
saurions dire en quoi prcisment consista cette am-
lioration. La perscution fut certainement suspendue;
mais la rorganisation de la hirarchie dut subir encore
bien des entraves. En dehors de l'opinion de Barh-
braeus que nous venons de rapporter, un autre chro-
nographe ancien, lie de Nisibe nous informe que
ds l'avnement de Sapor III, les chrtiens se choisirent
un chef suprme : le problmatique Tomarfi!a-Tamoza
3
cit galement par les autres Nestoriens et par Barh-
braeus. Quelle est la valeur de ce renseignement, pour
lequel nous n'avons pas d'attestation antrieure l'po-
que d'ISo'dena}:t (1x-x sicle), le garant d'lie de Ni-
sibe? Nous laissons de plus habiles le soin d'en d-
t. Chron. eccl., Il, col. 65.
!!. Cit dans Chron. eccl., 11, p. u, n. 2.
3. MARE, p. 24; 'AMR, p. Hl; BARnBRAEUS, p. 42. Cf. HOFFMANN, Auszge,
p. !!t.
4. Les chroniqueurs mentionnent deux prdcesseurs d'Isaac sur les
quels nous n'avons que des renseignements assez suspecls :
(11ARE, p. !!t j 'AIIR, p. 12) que BARBtBRAEUS (CO!. 42) appelle Tamuza, et
Qayoma qui dmissionna en faveur d'Isaac.- A supposer que
soit le chef que les chrtiens purentse choisir l'avnement de Sapor Ill,
il rgna 7 ans et 1JUelques mois d'aprs MARE, 8 ans et quelques mols
d"aprs 'AIIR, 8 ans d'aprs B.t.RBEDRAF.us, soit environ de 384 3/3. Il
y aurait eu ensuite une vacance de 2 ans; puis Qayoma aurait rgn 4
86 LA RORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE.
Un fait est du moins certain. Les Actes du concile
de Sleucie tenu en 410 supposent la plupart des siges
piscopaux pourvus de titulaires. Quelques-uns mme
taient disputs par plusieurs comptiteurs. Il semble
donc que la paix rgnt depuis un assez grand nombre
d'annes, puisque les chrtients persanes avaient pu,
dans une large mesure, rparer les dsastres que leur
avait causs la longue perscution de Sapor. Mais cette
paix demeura ncessairement prcaire, tant qu'elle ne
fut pas consacre par un accord public entre l'glise
et le Roi des Rois.
ou 5 ans, jusqu'en 399, date de l'avnement d'Jazdgerd. A ce moment
Isaac monta sur le trne de Sleucie.
Seule, cette dernire date nous parait assure. Puisque les chroni-
queurs sont d'accord pour assigner onze ans de rgne ce catholicos,
et que, d'autre part, 'Alla et LIE DE NtsiBE (cit dans B. H., col .. n, n.t) le
font mourir dans la ti anne d'Iazdgerd (MAnE, fautivement, dans la H),
il faut qu'il ait t lu en 399.
Quant aux gestes de et de Qayoma, et leur existence mme,
ils nous semblent problmatiques. Nous lisons en effet dans les Actes
de Dadiso' (Syn. orient., p. !!!li) propos d'Isaac que par ses mains
fut restaur, aprs avoir vaqu pendant ti ans, le principat du suprme
sacerdoce sur le peuple chrtien , et qu'il a exalt l'glise par la
reconstitution du principat, grce la faveur que Dieu lui a donne au-
prs du roi Cela ,-eut dire, tout le moins, que les pouvoirs de ses
prdcesseurs- q n'il s'agisse ou non de et de Qayoma- talent
restreints aux limites du diocse de Sleucie. Parmi les listes patriar-
cales, celle d'lie de Damas, la plus ancienne (Bibl. Orient., 11, p. 391),
place ces deux personnages avant Papa, c'est--dire l'poque lgendaire.
Si nous n'osons faire fonds sur les informations que nous fournissent
les annalistes pour la priode qui s'tend entre l'avnement de Sapor III
et celui d'lazdgerd 1, plus forte raison nous abstiendrons-nous de
chercher combler la lacune qui existe dans les fastes piscopaux de
Sleucie entre la mot de Barba' sernin et l'anne 383. Les diteurs de
Barhbraeus (col. 4t, n.t) ont suggr le nom d'un de Sleucie qui,
suivant Photius (BmL., cod. r;i), prit part au synode de Si de (383} avec
Flavien d'Antioche et Maruta. Outre que le nom de n'est ni ara-
men, ni persan, il est difficile d'admettre que le chef des chrtients
de Perse ait particip un condlergional assezinsigniOant. La Sleucie
dont parle Photius doit tre cherche en Cilicie ou en Syrie, plutt que
suries rives du Tigre. cr. WEsTPHAL, Untersuchungen, p. ttii-120ettii-t!5.
LES NGOCIATEURS DE LA PAIX RELIGIEUSE. 87
S 2. -Les ngociateurs de la paix religieuse : Maruta,
Isaac et Iazdgerd 1"'.
La prparation et la conclusion de cet accord fu-
rent l'uvre de trois personnages principaux: Maruta,
vque de Maipherqat, l'archevque Isaac de Sleucie,
le Roi des Rois Iazdgerd 1.
Les ambassades que les empereurs romains en-
voyaient en Perse taient confies aux plus hauts digni-
taires de l'empire
1
Nous savons par Thodoret
2
que
l'une d'elles fut dirige par Anthmius, plus tard ma-
gister officiorum et prfet d'Orient. Et de mme que
les vques accompagnaient les armes romaines pour
attirer sur elles les bndictions divines, ainsi on en
dsignait toujours quelqu'un pour escorter les am-
bassadeurs prs la Porte du Roi des Rois. On choisis-
sait de prfrence des vques de Msopotamie. Leur
connaissance des affaires persanes, due aux rapports
presque quotidiens des glises syriennes occidentale et
orientale, les rendait plus propres cette mission.
Parlant la mme langue , ils pouvaient entrer plus
aisment en communication avec leurs coreligionnaires
aramens, entendre leurs dolances, et aussi en ob-
tenir de prcieux renseignements sur les agissements
et les intentions du prince Sassanide. C'est ainsi que
Maruta, vque de Maipherqat
3
, fut adjoint plusieurs
des dputations romaines qui se rendirent auprs
d' lazdgerd.
L'origine de ce prlat et sa carrire sont assez im-
i. SOCIUTE, Ht. el., VII, 8.
!!. TBioDORET, Hist. relig., ch. vm. Cette ambassade est antrieure
1100. (TILLDOIIT, Hist. des Emp., t. VI, p. !!.)
3. Aujourd'hui Mayafareqin, la llartyropolis des auteurs byzantins.
88 LA RORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE.
parfaitement connues
1
Il sjourna diverses reprises
Antioche, en Asie Mineure et Constantinople, et
prit part un concile rgional dirig contre les Mes-
saliens : le synode de Side (383)
2
Socrate
3
et So-
zoinne
4
nous apprennent qu'il fut ml aux querelles
de Thophile d'Alexandrie et saint Jean Chrysostome.
Il est assez malais de dterminer le nombre de ses
missions en Perse et leur date
5
Maruta se trouvait
i. v. BRJ.UN, De sancta Nicaena Synodo, Mnster, i898, p. 7 et suiv.
2. PHOTIUS, Bibl., 5!!, P. G., CUI, 88. Suivant 'AIIR (p. H), Maruta aurait
assist au concile de Constantinople en 38t. D'aprs BARBIIIIAEUS (c. ~ : .
il en aurait fait seulement adopter les conclusions, c'est--dire la con-
damnation de Macdonius, au concile de Sleucie. Il est vident que
le chroniqueur jacobite confond le concile de 38t avec celui de 360,
tenu galement Constantinople, o fut dpos Macdonius.
3. Hist. eccl., VI, 15.
4. Hist. eccl., VIII, 16.
5. MARE (p. !!Il) et 'AMR (p. 14) rattachent l'ambassad de Maruta l'a-
vnement de Iazdgerd et d'Isaac (399). Les Actes des synodes d'Isaac et
d'Iahbalaha (Syn. orient., p. 255 et 29!!) supposent que non seulement
il prsidait le concile de Sleucie, mais qu'JI avait, antrieurement
cette runion, pacifi l'glise de Perse. SoCRATE (Rist. eccl., vu. 8)
semble ne connaltre qu'une seule mission de l'vque de Maipherqa!.
En ralit les deux anecdotes qu'il raconte ce propos ne sauraient
se rapporter qu' deux ambassades diffrentes, dont la seconde peut
avoir eu lieu, mon avis, aprs .tto. J'admettrais donc, pour ma part,
deux voyae-es de Maruta en Perse antrieurement .tto : le premier
vers 399, le second vers 408.
D'aprs TILLEMONT (Hist. eccl., t. XI, p. 28i-!18i), Maruta en aurait fait
un autre entre 403 et 404. En 403, en effet, il prit part aux assembles
que Thophile d'Alexandrie tint contre saint Jean Chrysostome Chal
cdoine et sans doute aussi au conciliabule du Chne. En .tOI, nous
le retrouvons Constantinople : saint Jean Chrysostome, peut-tre
dj parti pour l'exil, lui fait tenir deux lettres par Olympias (Patr. Gr.,
t. Lll, col. 6t8) et prie cette grande dame d'essayer de dtacher Marula
du parti de Thophile, parce qu'il avait, dit-il, grand besoin de lui
pour les affaires de Perse. Il lui recommande aussi de savoir de lui la
cause de son voyage constantinople, et s'il avait eu quelque heureux '
succs dans la Perse, ou s'il esprait de pouvoir faire quelque chose
dans un second voyage Je ne sais s'il est ncessaire de supposer que
ce voyage de Maruta ait eu lieu en 403-40<l. Il est peut-tre plus naturel
de penser que Maruta s'tait arrt Chalcdoine son retour d'Orient.
qu'il s'tait ml aux discussions du moment, et qu'il avait ensuite tra
vers le Bosphore pour confrer avec l'empereur des affaires persanes.
cr. Syn. orient., p. !!57, n. 5. WESTPBAL, op. cit., p. t!!i et t30.
LES NGOCIATEURS DE LA PAIX RELIGIEUSE. 89
probablement Sleucie-Ctsiphon en 399, lors de
l'accession au trne d'Iazdgerd [et de l'lection d'Isaac
comme vque des Villes Royales. Il s'y rendit certai-
nement vers 408, soit pour notifier Iazdgerd l'avne-
ment de Thodose II, soit pour pacifier l'glise per-
sane, divise par l'ambition de ses pasteurs
1
C'estalors
qu'avec l'aide du roi il mena bien l'uvre de rorga-
nisation qu'il avait entreprise, et dirigea le concile de
Sleucie ( 410) 2.
Son sjour en Babylonie dura sans doute environ trois
ans. Il employa, dit-on, les loisirs que lui laissrent
les ngociations recueillir pieusement les Actes des
martyrs et surtout leurs ossements sacrs. Les M-
nes
3
prtendent qu'il rapporta ces prcieuses reliques
dans sa ville piscopale qu'il rebtit (ou embellit)
l'aide des munificences de Thodose. Maipherqat se
nomma dans la suite Martyropolis : la ville des martyrs.
Il mourut probablement avant 420, puisque c'est
Acace d'Amid qui reprsenta les ((Pres occidentaux
4
au synode tenu par lahbalaha
5
_
Le succs de ses entreprises tenait la fois son
caractre d'envoy romain et au crdit personnel dont
il jouissait auprs du roi lazdgerd. Il devait la faveur
royale sa dignit de vie, son habilet et aussi sa
science mdicale
6
Socrate
7
rapporte qu'il gurit Iazdgerd d'un mal de
t. Syn. orient., p. 293.
11. Syn. orient., p. 1100, et sui v. MARE, p.ll5, 26; 'AMR, JI t3.
3. Cites par TILLEIIONT, Hist. eccls., XI, p. !84. cr. Al AllE, JI 26; 'A lin,
p.U.
" Syn. orient., p. 277.
5. !liais aprs 4t8, puisque d'aprs la Passion de Perllz, il accompa-
gnait Iabbalaba, lorsque ce catbolicos revint en Perse aprs avoir ac-
compli sa mission Constantinople. Voir ci-dessous, p. 90, n. t.
6. Suivant MARE (p. iN), Iazdgerd, raisant la paix avec Rome, demanda
un mdecin l'empereur qui lui dputa Maruta.
7. Hist. eccles., VU, 9.
90 LA RORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE.
tte opinitre, dont les mages ne l'avaient pas pu d-
livrer. Plus tard, ceux-ci, jaloux de voir que Ma-
ruta Ct si bien dans l'esprit du roi, firent entendre
une voix lorsque ce prince venait adQrer le feu per-
ptuel dont ils faisaient leur divinit, et cette voix,
qui semblait sortir du feu, disait qu'il fallait chasser
le roi du temple comme un impie cause qu'il r-
vrait un Pontife des chrtiens . Mais Maruta sut
djouer leur imposture et pria le roi, lorsqu'il en-
tendrait encore cette voix, de faire creuser l'endroit
d'o elle venait. lazdgerd le fit, et trouva que ce n'tait
point le feu qui lui parlait, mais un homme que l'on
avait cach dans un caveau. Cela le mit si fort en co-
lre qu'il fit dcimer la race des mages, et, au lieu de
chasser Maruta, il lui permit de btir des glises o il
voudrait. Les mages s'avisrent d'autres subterfuges,
mais en vain. l\Iaruta passait aussi pour avoir dlivr
par ses prires, unies celles d'un autre prlat
1
, le fils
d'lazdgerd possd du dmon.
L'vque de Sleucie, Isaac, tait, d'aprs les chrono-
graphes, originaire de Kaskar, et parent du probl-
matique catholicos Tomar\'la
2
Barhbraeus dit que,
cinq ans aprs l'ordination de Qayoma, le prtendu
successeur de Tomar\'la, la paix fut conclue entre Arca-
dius et lazdgerd qui perscutait les chrtiens. Maruta
fut envoy en Perse comme ambassadeur, et, son
i. Cet vque l!lit Iahbalaha et non 'Abda, comme le croit TILLEMO!IT
(Hist. Eccl., t. XI, p. 287), car (p. !!8) dit que Iahbalaha ressuscita la
fille du roi en prsence rle Maruta qui en crivit aux OCcidentaux.
B..I.RHBRAEUS (c. 44) attribue Iahbalaha un semblable miracle, dont aurait
bnfici le fils du roi. 'AIIR (p. 18) parle d'une maladie du roi lui-mme.
Il est clair que ce sont l des dformations d'une mme tradition an-
cienne dont socrate est Je meilleur tmoin. On remrquera que Ablaatos.
leon qui doit tre, mon 'avis, prfre Anldas, est plus voisin du
nom syriaque Iahbalaha. (P. G., t. !,XVII, col. 74 et la n.)
1!. dit qu'il tait parent de p. 26. 'Atm, p. 13,14. BARHBR.,
col. 47-5!!. Syn. orient., p. !!5, n. i; m. Voir ci-dessus p. 85, n. 4.
. , ~ ~ . . . - . - , .... ._--.
LES NGOCIATEURS DE LA. PAIX RELIGIEUSE. 9i
arrive, la paix fut rendue aux fidles. Alors Qayoma
assembla tous les vques persans en prsence de
Maruta et il leur persuada de le dposer cause de sa
faiblesse. Ils refusrent d'abord, mais se laissrent
enfin toucher et acceptrent sa dmission. On lut
Isaac sa place, et Isaac le traita avec honneur et
l'entoura d'gards jusqu' sa mort.
Une donne plus prcieuse nous est fournie par les
Actes synodaux de lJadiso'. Aux termes de l'allocution
que l'on prte Dadiso' et de celle que l'on met dans la
bouche d'Agapet, Isaac aurait restaur le suprme
principat aprs une vacance de vingt-deux ans, grce
au crdit dont il jouissait auprs du roi. Mais, par la
suite, les vques s'insurgrent contre lui et firent appel
aux autorits persanes. Isaac, odieusement calomni,
fut mis en prison. L'intervention des << Pres occi-
dentaux et de Maruta est rattache cette aventure
1
Maruta aurait ngoci la libration d'Isaac et con-
voqu le concile gnral de l'glise persane pour
juger et condamner les rvolts, et consacrer ainsi le
triomphe d'Isaac sur les schismatiques, avec le con-
cours et l'appui officiel du Roi des Rois.
lazdgerd 1 le pcheur
2
inaugurait de la sorte une
politique qui, aprs bien des hsitations, finit par pr-
valoir parmi les rois Sassanides. Ami de la paix ext
rieure et soucieux de la tranquillit du dedans, il se
refusa traiter en trangers et en ennemis les nombreux
chrtiens qui habitaient son vaste empire. Les mages
et les nobles lui en surent le plus mauvais gr, et les
traditions persanes le reprsentent comme un abomi-
nable tyran. Il est possible, d'ailleurs, comme le dit
Socrate, qu'il ait fort maltrait le clerg zoroastrien
i. Syn. orient., p. 292.
2. TADARI, p. 72.
92 LA REORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE.
quand celui-ci eut manifest d'une manire dplace
son peu d'inclination approuver la nouvelle poli
tique.
Mais les sources chrtiennes
1
louent unanimement
le roi de sa bont, de sa douceur et de sa munificence.
Socrate prtend que Iazdgerd fut sur le point de se con-
vertir au christianisme, mais qu'il fut prvenu par la
mort avant de s'y tre tout fait rsolu
2
La vrit est
sans doute entre ces deux extrmes, et M. Noeldeke
3
a,
croyons-nous, bien jug Iazdgerd, quand il en a fait
avant tout un politique avis, inclin naturellement
vers les solutions pacifiques, mais, en mme temps, un
despote aussi capricieusement tyrannique que les autres
princes Sassanides. Nous verrons en effet que cet in-
signe protecteur des chrtiens n'hsita pas, sur la fin
de sa vie, les perscuter, lorsque leur influence lui
parut trop grande, et leur hardiesse capable de d-
chaner contre lui la haine toujours redoutable des
mages et des grands.
Mais, en 410, les chrtiens purent croire que Jazdgerd
allait reprendre son compte le rle que, cent ans plus
tt, Constantin avait jou dans l'Empire Romain.
S 3. - Le concile de Sleucie (4:10).
Iazdgerd, disent les Actes du concile de Sleucie ,
(( ordonna que dans tout son empire les temples dtruits
i. Syn. orient., p. !!118-276. MARE, p. !!a. 'AliR, p. 14. SOcRATE, H. E.,
VII, 8.
!il. Loc. sup. cit. L'anonyme syrien publi par Land : Anecdota, l, 8,
loue la bont et la misricorde d'Iazdgerd et l'appelle tout uniment
chrtien, et bni entre tous les rois
3. TADARI, p. n, n. 3.
4. Syn. orient., p. 2M.
LE CONCILE DE SLEUCIE. 93
par ses pres fussent magnifiquement reconstruits,
que tous ceux qui avaient t prouvs pour Dieu
fussent remis en libert, que les prtres, les chefs et
le clerg circulassent en libert et sans crainte .
Ce fut comme l'dit de Milan de l'glise persane.
Nous ignorons le dtail des ngociations qui prc-
drent cette dclaration officielle. Nous avons dj dit
que Maruta y eut la plus grande part. Il tait porteur
de trois lettres des Pres occidentaux : la premire
l'accrditait personnellement auprs d'lazdgerd et des
vques, la seconde tait destine 6tre lue devant le
roi de Perse; la troisime contenait des instructions
spcialement adresses Isaac . Ces lettres taient
signes des plus illustres vques de la Syrie et de la
Msopotamie. A leur tte paraissait l'vque de la grande
mtropole, Porphyrios d'Antioche. Acace d'Alep
2
,
Paqida d'desse, Eusbe de Tella, Acace d'Amid s'-
taient joints lui pour autoriser davantage cette
solennelle dmarche. Maruta dut tre galement as-
sist de la diplomatie impriale. Il sut convaincre le
monarque, et le dcida provoquer une runion g-
nrale des prlats orientaux, qui pt tre pour les
chrtients persanes ce qu'avait t le concile de Nice
pour les glises du monde romain. Le roi enjoignit
que des ordres fussent ports par des courriers rapides
de la Porte aux marzbans des divers lieux, pour qu'ils
envoyassent Sleucie les vques des provinces de
Nisibe, de l;ledayab (Adiabne), de Beit Garma, de
Beit Huzay, de MaiSan, et de Ka;kar
3
.
Tous firent diligence et, au mois de janvier, en la
i. M. Braun pense que c'est celle-l mme dont il a publi la traduc-
tion : De sancta Nicaena Synoo, p. 34 et sui v.
!!. Le clbre Acace de Dre {Alep) qui joua un rle fort important
au moment du concile d'phse. Voir Syn. orient., p. 2:itl, n. 3, 4, 5, 6.
3. Syn. orient., p. !!:6.
94 LA RORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE.
solennit de l'piphanie, les vques se runirent
dans la grande glise pour entendre la lecture de la
lettre des Pres occidentaux. Le concile proprement
dit s'ouvrit le 1 fvrier. On y adopta les canons
de Nice, et les autres canons rgulateurs , puis,
quelques jours aprs, deux officiers dlgus par le
roi confirmrent l'dit librateur, dcrtrent qu'Isaac
devait tre reconnu comme primat, et mirent le bras
sculier au service d'Isaac et de Maruta pour faire
excuter les dcisions du concile. Enfin les prlats se
sparrent aprs avoir rendu grces au roi et ordonn
des prires publiques dans tout l'empire.
Nous voudrions connatre avec certitude l'ordre et
le nombre des sessions conciliaires, mais les Actes du
synode d'Isaac sont fort peu explicites sur ce sujet
1
M. Braun
2
distingue trois sessions : Premire ses-
sion (1er fvrier 410) :Lecture de la lettre des Pres
occidentaux , puis du concile de Nice. Les vques
souscrivent ces pices canoniques. - Deuxime ses-
sion, quelques jours aprs : Isaac est reconnu offi-
ciellement comme chef des chrtiens par les deux
grands officiers. - Troisime session : on rdige les
canons du concile proprement dit, et on porte contre
les dissidents des peines disciplinaires.
t. Le nombre des vques qui y prirent part n'est pas plus certain.
La lettre de convocation donne le chiffre de quarante (p. !157). D'autre
part, la liste des vchs contient seulement vingt-six noms, et celle
des souscripteurs trente-sept. Je crois: 1 que la liste des vchs ne
contient que ceux dont les titulaires taient prsents Sleucie : les
pays lointains, ou n'taient pas reprsents, ou n'talent pas groups
sous une juridiction mtropolitaine; de plus il y avait deux ou trois
comptiteurs pour certains siges; !i en ajoutant les noms de Batai de,
Mesamblg et de Daniel qui taient prsents au concile, mais ne furent
pas admis souscrire, on atteint le chiffre de 39 ou 40, qui est celui de
la convocation. Voir, pour une autre explication, la note de M. Chabot,
Syn. orient., p. 6t6.
2. Das Buch der Synhados, p. 7.
LE CONCILE DE SLEUCIE. 95
Cette division, notre avis, soulve quelques objec-
tions. Tout d'abord une lettre des Pres occidentaux n
semble avoir t lue dans la runion prparatoire
tenue le jour de l'piphanie
1
Ensuite, on ne peut gure
appeler session conciliaire la runion qui eut lieu la
Porte Royale sous la prsidence des officiers d'lazd-
gerd. Cette runion fut en tout cas la dernire, puis-
que les officiers royaux y confirmrent la procdure
du concile, et que les vques prescrivirent des actions
de grces et des prires publiques dans tout l'empire,
ce qu'ils ne purent faire qu'au moment de la spa-
ration dfinitive.
Voici comment nous nous imaginerions la suite de
ce concile. Au mois de janvier, le jour de l'piphanie,
runion des vques dans la grande glise, sur
l'ordre du roi. lazdgerd leur fait lire la lettre des << Pres
Occidentaux >>, celle sans doute qui avait t adresse
lui-mme. Elle contenait, croyons-nous, entre autres
choses, la condamnation des ennemis d'Isaac. En
effet, ds le 1er fvrier, Isaac apparat comme le chef
reconnu des vques persans. L'anarchie avait donc
cess. Il est assez vraisemblable que l'assemble pr-
paratoire eut pour objet principal de porter la con-
naissance de tous les intresss la dcision des prlats
syriens, confirme par le Roi des Rois.
Le mardi ir fvrier, inauguration du concile pro-
prement dit. On commence par des prires solennelles
pour le monarque. Puis on donne lecture d'une se-
conde lettre des vques msopotamiens, celle-l des-
tine Maruta. Le prologue des Actes synodaux nous
en a conserv une partie. Cette ptre servait d'intro-
duction une collection dogmatique et canonique qui
i. Syn. orient., p. iti7.
96 LA HORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE.
avait pour base les Actes du concile de Nice. cc Au
cas o il plairait Notre-Seigneur, et o le Roi des
Rois victorieux couterait notre requte .et permettrait
que les vques se rassemblent et qu'il y ait un synode,
nous t'envoyons maintenant tous les canons rgula-
teurs tablis dans le grand synode, tenu dans la ville
de Nice
1
Isaac fit apporter le volume; aprs en avoir entendu
la lecture publique, les vques s'engagrent sous peine
d'anathme y adhrer. Maruta et Isaac les firent alors
souscrire et signer. Ensuite les prlats rglrent entre
eux certaines questions plus importantes. Ils dcidrent
qu'il n'y aurait qu'un vque par ville, que les nou-
veaux vques devraient tre institus par trois autres
et confirms par le mtropolitain, mme si les vchs
taient trs loigns les uns des autres; qu'on solenni-
serait partout en mme temps les grandes ftes et le
jetne solennel du carme, qu'on n'offrirait plus le saint
sacrifice que sur un seul autel. Ces dcisions furent
prises conformment aux canons contenus dans le
recueil des Pres occidentaux . Un rsum en fut
fait, sans doute celui qui nous est parvenu. Il est divis
en trois articles
2
Lorsque ces rsultats furent acquis, et peu de
temps aprs le ter fvrier, Maruta et Isaac se rendirent
la Porte Royale et sollicitrent une entrevue du Roi
des Rois. Ils lui rendirent compte de la session coule,
et de la faon dont ils avaient rempli le mandat qu'il
leur avait confi. Le roi dcida de sanctionner l'uvre
du concile, et de manifester de nouveau publiquement
ses bonnes dispositions l'endroit de l'glise chr-
tienne.
t. Syn. orient., p. 259.
2. Sy 11. orient., p. !!:i8 et 259.
LE CONCILE DE SLEUCIE.
97
Il dputa cet effet deux nobles : Chosrau lazdgerd
et Mihrsabur
1
Ces deux personnages taient les plus
hauts dignitaires de la cour : le premier avait la
charge de huzurgframadar, c'est--dire grand vizir
2
Le second tait arghed, c'.est--dire membre de la
famille royale
3
Les deux officiers royaux convoqurent
les vques la Porte et les harangurent au nom
de lazdgerd. Ils promulgurent une fois de plus que
toute libert tait donne aux chrtiens de pratiquer
leur religion et de construire des glises. Ils in-
sinurent que la reconnaissance officielle de la religion
chrtienne tait due aux dmarches d'Isaac, cc que le
roi, qui il est agrable, a tabli chef des chrtiens de
tout l'Orient , et surtout l'intervention de Maruta.
Ils terminrent en dclarant que le bras sculier puni-
rait impitoyablement toute opposition Isaac et
Maruta, et se retirrent parmi les cris d'allgresse et
les acclamations des vques.
Ainsi se cl6tura le grand concile de Sleucie. Sa
dure semble avoir t courte. Les vques regagn-
rent au plus tt leurs diocses respectifs pour faire
connatre les dcisions qu'ils venaient de prendre, et
annoncer aux fid!es la fin de leurs angoisses et de
leurs tourments.
Peu de ftes, sans doute, furent plus brillantes et
plus joyeuses que les solennits pascales de l'an-
ne 410, dans l'empire de Perse. Maruta pouvait tre
fier de l'uvre immense accomplie en si peu de
temps. L'glise, hier encore disperse par la pers-
cution et mine par le schisme, tait maintenant offi-
ciellement reconnue et protge par le Roi des Rois.
1. Syn. orient., p. 260.
~ . Syn. orient., p. 260, n. 2
.a. Syn. orient., p. 260, n. 3, et 261, n. 1.
6
_,_...._......
98 LA RORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE.
Une hirarchie mthodiquement organise appliquait
par tout l'empire des rgles uniformes que l'exprience
presque sculaire des chrtients du monde romain
avait consacres et, pour ainsi dire, canonises. La
foi de Nice devenait l'unique symbole de toutes les
glises syriennes.
Plus de liturgie prive dans les maisons des fidles.
Une seule glise dans la paroisse, un seul vque dans
le diocse, un seul mtropolitain dans la province ;
et, la tte de tous, l'vque des Villes Royales : Sleu-
cie-Ctsiphon. << Le premier et principal sige est
celui de Sleucie-Ctsiphon. L'vque qui l'occupe est
le grand mtropolitain et le chef de tous les vques.
L'vque de Kaskar est compris dans la juridiction de
ce mtropolitain. Il est son bras droit, et son ministre.
Il gouverne son diocse aprs sa mort
1
Au-dessous du grand mtropolitain cinq mtropo-
litains, rigoureusement hirarchiss, tablis dans les
villes << capitales des provinces . C'taient les
vques de Beit Lapat (en Huzistan), de Nisibe, de
Prat de Maisan, d'Arbel (pour le J;Iedayab) et de
Karka de Beit Slokh (pour le Beit Garma). Trente
vques environ, dont la juridiction avait t soigneu-
sement dfinie, taient soumis l'autorit des mtro-
politains. Seules, quelques chrtients, isoles ou
lointaines, en Mdie, en Razicne, dans la Perse
propre et dans les tles du golfe Persique ne paraissent
pas avoir t ds ce moment constitues en groupe
provincial
2
Ainsi, tout schisme tait aboli. Parmi les dissidents,
ceux qui taient notoirement tars, comme Batai de
! Can. xxi; Syn. orient., p. 272. Voir aussi les canons xvii XXI.
2. Syn. orient., p. 273.
.-. :-.r .. ...- ,-
LES SUCCESSEURS D'ISAAC.
99
Mesamhig et Daniel, furent dposs et
En Susiane- la situation tait plus embrouille. Les
concurrents, soutenus peut-tre par des personnages
influents la cour, demeurrent matres de leurs posi-
tions. Ils taient au nombre de quatre : Agapet, Mare,
Barsabta et Sila
2
Chacun d'eux resta la tte du
troupeau qu'il s'tait form; mais il leur fut interdit
de perptuer la division en ordonnant des clercs, et,
- leur mort, la nomination de leur successeur tait r-
serve au catholicos
3
S 4. - Les successeurs d'Isaac : AJ;ta et Iahbalaha
(410-420).
Isaac mourut bientt, dans la douzime anne du
rgne de lazdgerd 1 (410). Al_la lui succda. Sur l'ori-
gine et les antcdents de cet vque, les Annalistes
ne nous fournissent que des renseignements sans
valeur. Barhbraeus, dans sa Chronique donne
son nom une tymologie parfaitement purile. Mare
3
et Amr
6
veulent qu'avant son lection au catholicat,
il ait t moine, et disciple du lgendaire Abdiso.
Nous ignorons de mme quels vnements signa-
lrent son pontificat. Seul Amr nous apprend qu'il
tait fort bien en cour. Il se serait mme entremis avec
succs pour apaiser des dissentiments qui auraient
clat entre Iazdgerd et son frre Behwar (?), << roi
e Perse . C'est au cours du voyage qu'il aurait en-
trepris dans ce but que aurait visit les martyria
i. Syr. orJent., p. j'73.
2. Auxquels il faut peut-tre ajouter Yazdaidad (Syn. orient., p. 274).
3. Syn. orient., p. .
.t. Col. 52.
5. P. 27.
6. P. t5.
100 LA RORGANISATION DE L'GLISE DE PERSE.
de l'empire perse; son retour, il aurait consign dans
un volume les traditions recueillies par lui sur les
martyrs qui avaient souffert sous Sapor II. Il nous
est impossible de discerner ce qu'il peut y avoir de
fond dans cette lgende. Nous ne pouvons pas davan-
tage prciser la date de la mort
1
Son successeur, Iahbalaha, tait, parat-il, disciple
d''Abda qui lui aurait confi une mission dans le pays
de Daskart. Mare
2
sait mme qu'aprs avoir russi
convertir les paens de ce pays, il construisit un
couvent sur les bords de l'Euphrate, s'y retira et y
organisa la psalmodie perptuelle.
Il fut choisi comme catholicos avec le consentement
du roi, ou plutt grce la faveur dont il jouissait
auprs de lui
3
Dans la dix-neuvime anne de Iazd-
gerd (417/8), il fut envoy comme ambassadeur auprs
de Thodose II pour la paix et la rconciliation des
deux . Sa foi, nous disent les chroniqueurs
5
,
fut approuve Constantinople, et il rapporta en Perse
des cadeaux nombreux l'aide desquels il restaura
l'glise de Sleucie-Ctsiphon et en btit une autre
trs considrable
6
t. Nous conjecturons seulement que la vacance du sige ne fut pas
longue, tant donne la bienveillance de Iazdgerd pour l'glise. Orlabba-
laha fut lu au commencement de 415, puisque les Actes de son synode
font concider la troisime anne de son catholicat ayec la dixneu
vlme anne du rgne de Iazdgerd (417/8). M. Westphal, Unlerluchun-
gen, p. t37, a calcul que rgna de la lin de .tto au commencement
de 415. chronologie s'accorde bien avec le renseignement fourni
par LIE DENISIBE(Cit dans l'dition de B,\RUBRAEUS, CO!. 51,n. t), suivant
lequel Al;lai aurait occup le sige de Sleucie pendant 4 ans et 1) mois
(Cf. Syn. orient., p. !176, n. 4).
2.
a. v. plus haut le miracle qu'il aurait opr en collaboration avec
Maruta, et ci-dessous n. 6.
4. Syn. orient., p. 277.
5, p. 28. 'AHR, p. 16.
6. S'il faut en croire le rdacteur des Actes de Pr6z (HOFFHAII:!I,
LES SUCCESSEURS D'ISAAC.
tOt
En419f20, Acace,vque d'Amid,futdputpar l'em
pereur pour le reprsenter auprs du Roi des Rois l,
De concert avec lui, Iahbalaha runit cette mme
anne un synode dont les Actes nous sont par-
venus.
D'aprs les Actes de DadiSo cette intervention
de l'vque d'Amid fut ncessite par un schisme
qui menaait la primaut de Iahbalaha. Mais le procs-
verbal du concile de 420 est muet sur ce chapitre. En
apparence, tout s'est pass avec la plus grande rgu-
larit 3.
Tandis que les deux pontifes, lahbalaha et Acace,
se trouvaient auprs du roi Beit Ardasir, les vques
s'y donnrent rendez-vous pour les saluer et leur
crivirent une lettre pour les prier de raire approuver
en synode les dcrets des conciles romains. Onze v-
Auuge, p. 4t; BEDUN, t. IV, p. i:Ml), Iahbalaha aurait t, son retour,
accompagn de Maruta. C'est peut-tre ce moment qu'il faudrait
placer le miracle que nous avons mentionn plus haut.
i. cr. Syn. orient., p. !177, n. !. 11. Chabot, et aussi M. westphal
(Untersuchungen, p. t-'2) identifient cette mission d'Acace a,ec celle que
SocRATE (Hist. eccl., 1. VII, ch. xx1) place en 4ti sous le rgne de
Bahrm, et dont nous dirons plus loin l'objet et le motif. Nous ne
voyons pas de raison suffisante pour modilier la date donne par
Socrate. Cet historien ne dit nullement que d'A mid n'tait
jamais all en Perse, mais seulement que Bahrm, touch de la gn-
rosit dont il avait fait preuve en rachetant 7.000 captifs que les
Romains avaient faits en Arzanne, dsira s'entretenir avec lui. La
gnrosit de l'vque d'Am id n'aurait d'ailleurs pas eu lieu de s'exer-
cer antrieurement 420, puisque cette date les hostilits n'avaient
pas recommenc. On comprend mieux qu'il ait consenti des sacriftces
hroques pour racheter les prisonniers persans, si l'on admet qu'a la
suite d'une premire ambassade, il s'intressait aux glises de Perse, et
pensait qu'en considration de son acte charitable, Bahrm l'autorise-
rait plaider la cause des chrtients prouves par la perscution.
!. Syn. orient., p. !!87, !193.
3. Le catholicos se pare de tous ses titres protocolaires; il se dit ca-
tholicos de Beit Lapat, de Nisibe, de Perse, d'Armnie, de Prat de
Maisan, de I;ledayab, de Beit Garma, de Gurzan, etc ... (Syn. Ol'itmt.,
p. !76).
6.
102 LA DE L'GLISE DE PERSE.
ques signrent cette supplique : parmi eux le mtro-
politain de Beit Lapat, Agapet, celui de Nisibe, Ose,
celui de Karka de Ledan, les vques de Suse,
de Suster et quatre vques sans sige:
Mais si l'on y regarde de plus prs, on se rend
compte que l'tat intrieur de l'glise persane n'tait
pas des plus florissants. Dans leur adresse au catholi-
cos, les vques disent clairement l que l'uvre d'Isaac
n'avait pas t durable : Les Pres de Sleucie ne .con-
naissaient pas bien les canons et l'ensemble des conciles,
ni les traditions; plusieurs d'entre eux taient trs gs
et moururent peu de temps aprs le synode; leur succes-
sion donna lieu de nombreuses et ardentes compti-
tions. lahbalaha, rpondant ses collgues
2
, se flicita
de les avoir trouvs, ds le dbut de son rgne, bien
intentionns son gard. N'tait-ce pas indiquer que
d'autres prlats avaient pris un parti tout diffrent? Il
critiqua son tour l'uvre d'Isaac, et en expliqua l'in-
suffisance par l'absence de circonstances favorables. Il
conclut, d'accord avec Acace, que bien loin d'abroger
les sanctions portes par le concile de Sleucie, il conve-
nait plutt de les fortifier, et de rendre plus rqinutieuses
les rgles canoniques, en faisant adopter, outre les
canons de Nice et de Sleucie, ceux d'Ancyre, de
Nocsare, de Gangres, d'Antioche (in Encaeniis) et
de Laodice.
Nous voudrions connaitre les rsultats de ce synode.
Le dsarroi que signalent les Actes de Dadiso (424) a
ne permet pas de penser que Acace et lahbalaha russi-
rent pleinement dans la tche qu'ils s'taient assigne.
i. Syn. O!'ient., p. !!80.
2. Syn. orient., p. !!Si.
3. Syn. orient., p. !!8!1.
LES SUCCESSEURS D'ISAAC.
Le catholicos mourut du reste peu de temps aprs,
au commencement de l'anne 420
1
t. 1\IARE (p. 28) rattache la mort de Jahbalaha la tenue du synode.
Ma 'na, mtropolitain de Perse, aurait conseill au catholicos de ne pas
promulguer de nouveaux canons. Iahbalaha ddaigna cet avis et fut
frapp d'apoplexie. Il mourut presque aussitt. Cette concidence attira
l"attention des vques sur }Ja 'na, qui fut lu catholicos.
CHAPITRE V
LES PERSCUTIONS DU CINQUIME SICLE
Si.- La perscution de Iazdge;rd I et de BahrAm V.
Au rapport des chronographes nestoriens
1
, Iahba-
laha, sentant que la situation des chrtiens n'tait pas
aussi sOre qu'elle pouvait le paratre, et prvoyant
une nouvelle perscution, demanda Dieu de lui par-
gner cette douleur. Sa prire fut exauce. Quand le
patriarche mourut, l'glise de Perse tait en paix avec
l'tat. On pouvait cependant pressentir que cette paix
n'tait pas durable. Quelque excellentes que fussent les
dispositions de lazdgerd, elles taient la merci d'un
revirement de sa politique. Pour entretenir d'amicales
relations avec les Romains, le roi avait couvert de
sa protection officielle ses sujets chrtiens. Il n'avait
pu le faire sans s'attirer l'animadversion des prtres
mazdens si puissants et si intolrants, et de l'aristo-
cratie iranienne toujours prte se jeter dans l'oppo-
sition. Un Sassanide ne pouvait pousser trop loin cette
lutte contre les castes suprieures sans risquer de
compromettre, non seulement la tranquillit de son
empire, mais son trne mme, et peut-tre sa vie.
t. MARE, p. !ill. 'AMR, p. 16. B. 0., III, p. 376 et suiv.
LA PERSCUTION DE IAZDGERD I ET DE BAHRAM V. iO
De leur ct, Jes chrtiens donnaient libre carrire
leur ardent proslytisme. L'"glise s'tait propage
depuis 410 avec une rapidit singulire. Maintenant que
les fidles n'taient plus menacs de terminer leur vie
par le martyre, leur nombre s'accroissait prodigieuse-
ment; on dut crer de nouveaux vchs
1
, peut-tre de
nouvelles provinces. Mais ce qui, par dessus tout, por-
tait ombrage aux mazdens, c'tait l'adhsion la re-
ligion nouvelle d'un plus grand nombre de hauts fonc-
tionnaires de J'tat, dont quelques-uns ~ appartenaient
aux plus nobles familles de l'Iran.
Iazdgerd lui-mme s'mut de cet tat de choses.
Avant qu'il songet perscuter les chrtiens, il cher-
cha faire apostasier les nobles qui s'taient con
vertis. C'est du moins ce qui semble ressortir de la
Passion de Mihrsabur
3
Il ne se serait sans doute pas
dcid revenir sur les engagements solennels pris au
concile de 410, s'il n'y avait t provoqu par l'audace
imprudente et le zle intempestif de quelques chr
tiens.
A Hormizdardasir, ville du Huzistan, un prtre du
nom de Hasu dtruisit, avec ou sans l'aveu de l'
vque Abd, un pyre contigu l'glise, qui cons-
tituait pour les chrtiens un voisinage fort incommode_..
Cette entreprise tmraire souleva les colres des ado-
rateurs du fe1,1. Iazdgerd convoqua les dignitaires de sa
cour, et, sur leur conseil, prit les mesures les plus
nergiques pour punir cette insulte inoue la religion
t. Syn. orientale, p. !176, mentionne les nou,eaux siges de Perse,
d'Armnie, de Gurzan, de Sabur-Kuast, d'Ardasir Farid, etc. cr. Bibl.
orient., t. III, p. 345.
~ llihrAabur. AsSEHANI, Martyr. orient .. , 1, p. 234. Prilz, HOFFJU.NN,
Auszge, p. 39 et suiv. BEDJAII, Acta MM. et SS., IV, p. !!;;3-i62.
3. M. O., p. 234.
4. BEDIAN, IV, p. 250-253. HOFF:II1NN, Ausz!ge, p. 3i.
--
i 06 LES PERSECUTIONS DU CINQUIME SICLE.
nationale. Au dbut de l'anne 420, le vieux roi fit ame-
ner la cour l'vque 'Abda, les prtres Hasu et
Isaac, le scribe Ephrem, le sous-diacre Papa, les lacs
Daduq et Durtan, et le frre de l'vque, nomm Papa.
Les prisonniers comparurent devant le prince qui
leur reprocha violemment leur acte de rbellion.
D'aprs la Passion d"Abda
1
, l'vque, prvoyant les fu-
nestes consquences que pourrait avoir une attitude
provocatrice, plaida non coupable et se plaignit d'avoir
t calomni auprs du monarque. Hormizdardasir tait
liSsez loign de Sleucie, et le roi avait pu tre mal
inform par les ternels ennemis du nom chrtien. Mais
lazdgerd lui opposa les rsultats d'une enqute offi-
cielle faite par les commissaires royaux. Alors le prtre
Hasu s'emporta en d'insolentes protestations contre la
religion mazdenne et le culte du feu, et dclara qu'il
avait lui-mme dtruit le pyre.
Les Actes syriaques s'arrtent ici. Mais les sources
grecques nous permettent de les complter
2
Le roi
invita 'Abda reconstruire le pyre, le menaant, en
cas de refus, d'exercer <le terribles reprsailles contre
les chrtiens. L'vque demeura inflexible. Il fut con-
damn mort et excut presque aussitt, peut-tre le
31 mars, jour o l'glise grecque fait sa mmoire avec
celle des autres martyrs de la mme perscution.
Pour moi, dit Thodoret
3
, j'avoue que la dmoli-
tion du pyre tait tout fait hors de saison. Quand saint
Paul vint Athnes, il n'y renversa aucun des autels
qu'il vit si rvrs dans cette ville livre aux supersti-
tions de l'idoltrie. II se contenta d'y dcouvrir l'erreur
et de prcher la vrit. Mais je ne puis qu'admirer et
1. HOFFMANN, Auszge, p. 3:i.
2. TIIODORET, Rist. eccl., 1. V, ch. xxxvm; TiLLF.MONT, Rist. eccl., XII,
p. 3;)6 et sui v.
3. Loc. cil., Pair. Gaec., t. LXXXII, col. Hi2.
LA PERSCUTION DE IAZDGERD 1 ET DEBAHRAM V. 107
louer la gnrosit d'.Abda qui aima mieux mourir que
de relever le pyre aprs l'avoir renvers, et je ne vois
point de couronnes qu'elle ne mrite. En effet, lever
un temple en l'honneur du feu est, ce me semble, la
mme chose que de l'adorer. On ne peut que souscrire
ce jugement.
Vers le mme temps eut lieu le martyre
1
du clerc (ou
moine) Narsa, dont le cas est particulirement intres-
sant. Narsa, originaire du Beit Raziqay, avait pour
ami un prtre nomm Sapor. Ce prtre avait converti
un noble persan du nom d'Adarparwa, qui l'avait
invit l'accompagner dans son bourg et y cons-
truire une glise. Mais Sapor se conduisit avec pru-
dence, et ne btit l'glise que lorsque Adarparwa lui
eut remis un titre de proprit en bonne et due forme.
Or un mobed, nomm Adarboz, vint se plaindre au-
prs de lazdgerd de ce que les nobles se convertis-
saient du magisme au christianisme. Le roi, se
rendant ses observations, lui permit d'user de tels
moyens qu'il jugerait utiles pour faire apostasier Adar-
parwa. Adarboz russit dans son entreprise, et le
noble persan redemanda Sapor son titre de proprit.
Sur le conseil de Narsa, le prtre refusa et quitta le
pays en emportant son titre. Il pensait pouvoir attaquer
en justice Adarparwa l'apostat, et gagner sa cause.
Telle tait la confiance qu'inspirait aux chrtiens la
bienveillance de Iazdgerd! Cependant le mobed local
s'empara de l'glise et la convertit en pyre.
Narsa revient dans le bourg, ouvre l'glise comme
l'ordinaire. Tout tonn d'y trouver les appareils appro-
pris au culte du feu, et ignorant sans doute l'interven-
tion officielle du mobed, il teint le feu, fait place
l, HOFFIIIAN!I
1
p. 36, BEDIAN, IV, p, t70-t81,
t08 LES PERSCUTIONS DU SICLE.
nette, remet en ordre le mobilier de l'glise et y c-
lbre l'office divin. Le mobed en faisant sa tourne
constate les dgts, ameute la population, charge
Narsa de chanes et l'expdie Sleucie-Ctsiphon.
Narsa comparat devant Adarbz, le chef des
mages >>. Celui-ci le condamne rebtir le pyre.
Comme Narsa s'y refuse, il est jet en prison o il
reste neuf mois, l'hiver entier et la moiti de l't.
Le moment tant venu o le roi quittait Sleucie
pour des climats plus temprs, les chrtiens donnent
400 pices d'argent aux gardiens et en obtiennent la
libration conditionnelle de Narsa. Un laque de S-
leucie s'offre comme rpondant du clerc qui s'engage,
par crit, se constituer prisonnier la premire r-
quisition, et se retire dans un clotre voisin des Villes
Royales. Sur un ordre du roi, il comparat un peu plus
tard devant le marzban de Beit Aramay
1
Ce haut
fonctionnaire l'interroge, et Narsa se rfre aux dcla-
rations dj faites devant Adarbz. Le marzban le
condamne rapporter le feu sacr dans le pyre qu'il
avait viol. Narsa refuse et est mis mort, par un
satellite rengat, au milieu d'un grand concours de
peuple, en un lieu appel SJq l,lerubta. Il est enterr
dans un martyrium que Maruta avait construit, avec la
permission du roi, sur le lieu de supplice des CXVIII
martyrs qui avaient souffert sous la perscution de
Sapor
2
Cette Passion est une des meilleures pices hagio-
t. Si le Narsa, martyr, dont il est question dans la Passion de lllibrsa-
bur (M. O., 1, p. W) est le ntre, ce magistrat s'appelait Hormizdadur.
2. Il s'agit, croyons-nous, de Sabdost etde ses compagnons. Voir ci-
dessus, ch. m, p. 72. Il faudrait peut-tre lire, dans la passion de Narsa,
us et non HS (BEDJ.t.N, IV, p. t80). Ce martyrium avait t construit
par le compagnon des martyrs Mar Maruta, vque de Sof (:&111:p2V71V'j)
... en vertu d'un dit royal BEDJAN, ibid.
..... ' . -
LA DE IAZOGERD 1 ET DE BAHHAM V. t9
graphiques que contienne la littrature syriaque. La
date du supplice n'est malheureusement pas trs pr-
cise. Si l'on veut le placer en 420, il faut admettre que
le martyre de Narsa est en corrlation avec celui
d'.Abdii., ce qui n'a rien d'invraisemblable. Il aurait eu
lieu toutefois quelques jours plus tard. On devrait
aussi supposer que Iazdgerd ne prit point contre les
chrtiens de mesure gnrale et se contenta de svir
contre les particuliers, et de se montrer moins tol-
rant. Et c'est ainsi, croyons-nous, que les choses se
passrent
1
Du reste, s'il est vrai que lazdgerd pro-
mulgua un dit de perscution, il fut empch de le
mettre excution par la mort qui le frappa l'au-
tomne de l'anne 420, peut-tre dans le Khorasan
2
Plusieurs comptiteurs se disputrent sa succession,
notamment un de ses fils, Sapor, roi d'Armnie 3, qui
fut tu par les grands Sleucie, et un nomm Chos-
rau qui parait avoir t le candidat de l'aristocratie et
des prtres mazdens. Grce l'intervention efficace du
clbre roi des Arabes Mundir, ce fut un autre fils
de lazdgerd, Bahrii.m V surnomm Gor
4
, qui l'emporta.
Il ne continua pas la politique de son pre. lu
1. Ainsi s'expliquerait le passage de Socrate (Hist. Eccl., VII, 18)
o cet auteur soutient que Iazdgerd ne perscuta jamais les chr-
tiens. Toutefois la Passion de PrOz (BEDJAft, IV, p. iS3; HorrAftll,
p. 39) dit nettement que Iazdgerd devint perscuteur. Bahr4m avait
reu ce mauvais hritage de son pere (p. qui, la llo de sa
vie, gAta tout ce qu'Il avait fait de bien (ibid.). I.e martyre du do-
mestique Tataq lBEDJu, IV, p.t81) et celui des nobles du Be il Garm:.
(ibid., p. 184-188) sont egalement dats du rgne de Iazdgerd 1. Il faut
joindre ces tmoignages presque contemporains celui de Thodore!
(loc. "'P cit.) elles affirmations de MARli, p. 28, et d" AMR, p. 16, qui s'ap-
puient sur des sources anciennes. on pourrait donc, la rigueur, n-
gliger absolument l'information discordante de socrate. Cet auteur qui
volt en lazdgerd une sorte d'mule de Constantin n'aura pu concevoir
que son hros ait suivi les errements de Sapor 11.
T.t.BARI, p. 77
1
n. {,
3. T.lBARI, 91, n. 4
.t. Ane sauvage. TABAR!, p. 90, n. l. ce surnom n'a rien de mprisant.
LI CIIRI8TJ.\NI8!1E. 7
HO LES PERSCUTIONS DU CINQUIME SICLE.
eontre le gr des Perses, il ne pouvait sans imprudence
se passer de leur concours et se contenter de celui
.le Mundir, appui trs fragile et sans doute fort
eo-tlteux. Il suivit donc les conseils de son entourage,
peut-tre ceux du grand vizir Mihrnars
1
, en tout cas
eeux d'un chef des mages, nomm Mihrsabur
2
, et
mit la puissance royale au service du fanatisme des pr-
tres du feu
3
Une perscution effroyable se dchana
dans l'empire perse.
Voici comment la dcrit Thodoret, vque de Cyr :
Il n'est pas ais de reprsenter les nouveaux genres
de supplices que les Perses inventrent pour
les chrtiens. Il y en eut dont ils corchrent les mains,
et d'autres dont ils corchrent le dos. Ils arrachrent
quelques-uns la peau du visage, depuis le front jus-
qu'au menton. On en environnait d'autres de roseaux
briss en deux qu'on serrait troitement avec des liens,
et qu'on retirait ensuite avec force, ce qui leur dchirait
tout le corps et leur causait des douleurs extrmes. On
fit des fosses o, aprs y avoir amass quantit de rats
et de souris, on enferma des chrtiens qui on avait
li les pieds et les mains, afin qu'ils ne pussent chasser
et loigner d'eux ces btes, qui, presses de la faim,
dvoraient ces saints martyrs par un long et cruel sup'!
pliee
5
.
i. }.[. o., p. tia.
!li. Passion de Jacques le Notaire. t. IV, p. t89-!10t, passim. Pas-
sion de Prllz, HorriiANN, Auszge, p. 39, . Passion des to martyrs du
Beit Garma. BEDJAII, IV, p. t85. C'est sans doute le mobed dont il est
question dans la Passion du domestique Tafaq. BEDUN, IV, p. 18t-
t84. Mais ces deux dernires passions se placent sous le rgne de lazd-
gerd I, comme nous l'avons dit plus haut.
3. TAB.\RI, p. 98, Il. t.
4. Hist. eccl., V, a8. Patr. Gr., t. LXXXII, coL tJ72 et t9'I3. Cf. TrLLE-
IIIONT, Hist. eccl., Xli, p. 358.
5. Un auteur, trs voisin des vnements, sinon tmoiq oculaire, l'ano-
nyme de la Passion de Prllz, fait le tableau suivant de la perscution de
-.....
LA PERSECUTIO:'i DE IAZDGERD 1 ET DE BAHRAM V. tU
L'historien grec cite en particulier les noms de trois
martyrs : Hormizdas, Sun(;l et Benjamin.
Les deux premiers taient nobles. Le roi de Perse
destitua Hormizdas de toutes ses dignits et le rduisit
conduire les chameaux de l'arme. Quelques jours
aprs, il vit cet homme d'une naissance illustre vtu
de mchants habits, couvert de poussire ct tout brl
du soleil, et, l'ayant envoy qurir, il lui fit mettre une
tunique de lin. Alors, croyantqu'ilseraitun peu adouci,
tant par ce bon traitement que par les peines qu'il avait
endures, il lui dit : Ne soyez pas si opinitre, et re-
noncez enfin au fils du charpentier. Hormizdas, trans-
port de zle, dchire en prsence du roi la tunique
qu'il lui avait donne, et lui dit: Si vous croyez que j'a-
bandonnerai la pit pour cela, gardez votre prsent
avec votre impit. Le roi, ayant vu cette action gn-
reuse, le fit chasser du palais tout nu
1
Sune fut dpouill de tous ses biens, qui taient
fort considrables, et oblig d'obir au plus mchant
de ses esclaves, qui mme il dut abandonner sa
femme. Il demeura nanmoins inbranlable.
nahrm : Il [Bahrm] ordonna que les grands qui professaient la re-
ligion de Dieu fussent expulss de leur province, que leurs maisons
fussent pilles et qu'ils fussent dpouills de tout ce qu'ils poss-
daient; et il les envoyait en des provinces lointaines, a On qu'ils fussent
accabls de vexations par suite des malheurs et des guerres, et qu'ainsi
fussent perscuts tous ceux qui professaient le christianisme jusqu'
ce qu'ils renient leur religion et qu'ils retournent la religion du
culte de nous autres dieux (c'est--dire celui que nous professons). On
s'attaqua aussi aux biens d'2glise et mme aux diOces religieux et au
mobilier liturgique. Les matriaux furent utiliss pour des constructions
profanes, par pour la construction de ponts sur les canaux. Les
mtaux prcieux furent conOsqus au profit des magasins royaux. Le
chroniqueur dplore, en particulier, la ruine de l'glise des caravanes
Meska (Maske!la) qui avait t difie par Acace, au nom de l'empe-
reur romain, et dote d'un mobilier merveilleux (BEDIAll, IV, p. j00-!57;
HOFFIIA!Ill, Auszge, p. 40).
i. op. cit. p. 359, ne sait pas dcider s'il consomma son
martyre.
H2 LES PERSCUTIONS DU CINQUIEME SICLE.
Le martyre du diacre Benjamin eut lieu sans doute
aprs la conclusion de la paix.
Les sources syriaques nous font connatre plusieurs
autres martyrs, dont les plus clbres sont Mihrsa-
bur, Jacques l'Intercis, un autre Jacques, le notaire,
et Proz, de Beit Lapat.
Mihr;abur
1
, emprisonn par Hormizdadur, qui avait
dj mis mort'' Narsa et son compagnon Sebokht ,
resta trois ans dans les fers et subit pendant ce temps
divers supplices. Enfin, au mois d'aot de la deuxime
anne de Bahriim, Hormizdadur le fit jeter dans une
citerne dont on mura l'entre, o l'on plaa des gar-
diens. Le 10 de Tesri 1 de la mme anne, on rouvrit la
fosse et l'on constata la mort du martyr (octobre 421).
L'histoire de saint Jacques l'In tercis est, parmi les
lgendes analogues, l'une des plus populaires. Un di-
gnitaire chrtien de la cour persane, nomm Jacques,
apostasie pour complaire au roi. Il retourne chez
lui. Mais les membres de sa famille, sa mre et son
pouse mme, refusent de le reconnatre et se dtour-
nent de lui avec dgot. Cette attitude porte Jacques
apprcier svrement sa lche conduite. '' Si ma
mre et mon pouse me traitent de la sorte, se dit-il,
combien sera terrible l'abord du Juge suprme, quand
je comparatrai devant lui . Il se prsente nouveau
devant le roi, dclare son reniement non avenu, et se
proclame hautement chrtien. Le monarque irrit le
livre aux bourreaux qui tranchent ses membres l'un
aprs l'autre; d'o le surnom d'lntercis.
Les Actes syriaques de Jacques ne sont qu'une
longue homlie, qui contient fort peu de dtails histo-
riques. Nous savons seulement que le hros tait ori-
t. AsSEKANI, Mart. orient., J, p. 3 ~ el sui v.
.. -......... -, ...
LA PERSECUTION DE IAZDGERD 1 ET UE BAHRA:\1 V. H3
ginaire de Beit et qu'il souffrit le martyre le 2i
novembre, suivant le comput des Grecs
1
.M. Noel-
deke a tudi la double datation de ces Actes et place
le supplice de Jacques dans la deuxime anne de
Babram
La mme anne, mais un peu plus tt. " le 5 lul
d'aprs le comput des Grecs
1
5 septembre 421, P-
roz, originaire de Beit La pat, homme riche et de noble
ligne, avait subi le dernier supplice. Jet en prison
quelque temps auparavant, avec d'autres chrtiens,
il avait reni Jsus-Christ pour chapper au supplice.
Mais, comme ses parents et son pouse mme le re-
poussaient avec horreur, il rsolut de revenir la reli-
gion qu'il avait lchement abandonne et fit de nou-
veau profession de christianisme. Dnonc par le chef
des mages, Mihrsabur, grand ennemi des chrtiens,
il fut amen Siarzur o rsidait le roi; puis, aprs
avoir comparu devant Bahram et refus d'apostasier
une seconde fois, il fut dcapit
3
Plus intressante encore, au point de vue historique,
est la Passion de Jacques le notaire
4
Comme elle est
peu connue, nous en donnerons une analyse dtaille.
Jacques tait originaire d'une ville nomme Karka
de Ersa
5
A l'ge de vingt ans, il est mis en prison
avec quinze de ses collgues, connue lui serviteurs
du roi; on les menaa de confisquer leurs biens s'ils n'a-
1. M. O., 1, p. 256.
!!. TABARI, p. UO.
3. BEDJAN, IV, p. HOFFIIANN, Auszge, p. 39-43.
4. BEDU"', Acta MM. et SS., t. IV, p. 189-201 : ou le garde. !liais le
mot syriaque lfbGJ ne se prte qu' la premire interprtation. Il
est la transcription <Ju latin notarim par l'intermdiaire du byzantin
Il semble que la cour de Iazdgerd et de Babram ait t orga-
nise la romaine. Un autre officier Tataq (v. ci-dessus p. 109, n. 1) est
qualiO de domesticus.
5. Cf. Honu., 1303? Voir aussi plus bas, p. tt7, n. 1.
H4 LES PERSCUTIO:"'S DU CINQUIME SICLE.
postasiaient. Comme ils s'y refusaient, ils furent con-
damns soigner les lphants durant tout l'hiver.
Aprs les Azymes
1
, comme le roi, suivant l'usage, se
rendait dans des pays moins chauds, les captifs furent
employs tracer la route royale pendant l't, coupant
les arbres, brisant les rochers. De temps en temps, le
roi les raillait de leur sottise, mais les confesseurs r-
pondaient : Tout ce qui nous vient de ta Majest est
un honneur pour nous, sauf l'apostasie . Quand les
tesris qui annoncent l'hiver furent arrivs
2
, Bahram
se mit en marche pour retourner Ctsiphon. On ap-
prochait des montagnes trs sauvages du pays de Be-
lesfar. Mihrsabur vint dclarer au roi que la constance
de ces confesseurs encourageait les autres chrtiens et
les empchait de dserter leur foi. Bahram lui rpon-
dit : Que leur ferais-je de plus? Leurs biens sont
confisqus, leurs maisons sous les scells, eux-mmes
subissent ces tortures! L'impie Mihrsabur dit au roi :
<< Que Sa Majest me commande de les faire apostasier
sans coups et sans meurtre . Le roi les abandonna
sa discrtion avec dfense, toutefois, de les mettre
mort.
Mihrsabur les fit mettre nu, sans souliers, les
mains lies derrire le dos, et ordonna qu'on les con-
duist chaque nuit dans la montagne, dans un lieu d-
sert, qu'on les coucht sur le dos, tout ligots, et qu'on
leur mesurt parcimonieusement le pain et l'eau.
Aprs qu'ils eurent subi ces tortures durant une semaine
entire, Mihrsabur appela le gardien et lui dit: << O en
sont ces misrables Nazarens?>> Le gardien rpondit:
Seigneur, ils sont peu loigns de la mort. - Va
t. C'est--dire les ftes de P:\ques.
!!, Les mois de Tesri 1 et Il qui correspondent peu prs octobre
et novembre.
LA PERSECUTIO:"i DE IAZDGERD lET DE B A H R A ~ I V. HS
et dis-leur : Le roi vous ordonne de faire sa volont et
d'adorer le soleil. Sinon, je mets des cordes vos
pieds, et je vous fais traner par toute la montagne
jusqu' ce que votre chair se spare de vos os, que
vos corps restent parmi les pierres, et qu'il n'en de-
meure plus que le tendon attach la corde. ,, Le
satellite fit la commission. Plusieurs ne l'entendirent
pas, parce qu'ils avaient perdu connaissance. Les
autres, vaincus par la douleur, faiblirent. Le gou
verneur les fit relcher sans les contraindre adorer le
soleil ou le feu, et conduire Sleucie. L, quand ils fu-
rent remis de leurs blessures, ils jenrent, prirent
et pleurrent leur apparente dfection.
Or Jacques tait demeur ferme dans la foi, << car il
tait d'extraction romaine ,,_ Il rapportait aux vques
runis la Porte du Roi pendant cette perscution ce
qui se disait chez Bahriim, et ce qu'il mditait contre les
chrtiens et leurs glises. Il les encourageait et les
rconfortait, et les vn1ables prlats l'avaient pris en
amiti. Quand il eut appris qu'on le considrait la
Cour comme ayant apostasi ainsi que ses collgues,
il rentra dans la ville, revtit un sac, couvrit sa tte
de cendres et se livra aux exercices de la pnitence.
Un de ses serviteurs le trahit (il l'avait vu lire le livre
des vangiles). Mihrsabur convoqua alors les seize
notaires. Interrogeant les quinze premiers, il leur
dit : << N'avez-vous pas reni et excut les volonts
du roi? Ils lui rpondirent : Nous avons perdu la
vie une fois, que nous demandes-tu? Exiges-tu que
nous apostasiions une seconde fois? ,, Il les relcha
et les renvoya chez eux.
Puis il prit Jacques part et lui dit : Et toi, tu ne
renies pas la foi des chrtiens? ,, - Je n'ai pas reni
la foi des chrtiens, et ne suis pas dispos la renier ...
-
1 t 6 LES PERSCUTIONS DU CINQUIEME SICLE.
c'est la foi de mes pres! Ils engagent ensuite une
controverse. Jacques est renvoy au tribunal du roi.
Il lui rappelle que son pre Iazdgerd a rgn vingt et
un ans dans la paix et dans la prosprit. Tous ses
ennemis le servaient et lui taient soumis, car il aimait
les chrtiens, difiait et pacifiait les glises. A la fin
de sa vie, il changea ses bonnes dispositions, devint
perscuteur des fidles et versa leur sang innocent.
Et tu sais comment il est mort, abandonn de tous,
et son cadavre n'a pas reu de spulture. Bahriim
irrit condamna Jacques au supplice des<< neuf morts
4
.
Malgr la dfense des autorits, les chrtiens recueil-
lirent les restes prcieux du martyr, except sa tte,
car l'hyparque avait donn l'ordre de la laisser
manger aux btes.
<< Et nous, dit l'hagiographe, nous tions dans la
ville, parce qu'on nous avait chasss de nos cits res-
pectives par ordre du roi. Vinrent aussi des marchands
compatriotes de Jacques, qui, s'adressantau narrateur,
lui dirent: Si tu nous affirmes qu'il n'y a pas de pch,
nous revtirons l'habit des mages, nous irons vers les
satellites et nous leur dirons : L'hyparque nous a
ordonn de vous surveiller, pour que vous ne vendiez
pas le corps de cet homme aux Nazarens ses coreli-
gionnaires. Je leur dis: Il n'y aura pas de pch, car
Dieu voit vos intentions .
Ainsi fut fait; les marchands donnrent dix pices
d'argent aux gardes et purent enlever le chef du mar-
tyr. Ils cachrent ensuite toutes ses reliques dans un
manteau et les portrent au monastre de Slq l:te-
rubta. Quelques jours aprs, ils remontrent le Tigre
avec leur prcieux fardeau et le ramenrent sa ville
i. Voirci-desaus, p. 61,ladescription de ce supplice.
LA PERSCUTION DE IAZDGERD 1 ET DE BAHRAM V. H7
natale
4
, o la mre de Jacques et l'vque ~ a u m a se
livrrent aux plus vives dmonstrations d'allgresse et
ensevelirent le saint dans un magnifique martyrium
2
Tous les chrtiens n'imitrent pas le courage de ces
hros. Il y eut, disent les Actes de Dadiso, beau-
coup d'apostasies, peu de confessions; beaucoup s'en-
fuirent ou restrent cachs
3
Les habitants des terri-
toires limitrophes de l'empire romain franchissaient en
foule les frontires
4
Les mages les faisaient harceler
par les nomades sujets du roi de Perse qui en turent
un grand nombre. Tillemont dit, d"aprs les Analecta
graeca, que l'un des princes arabes chargs de ce ser-
vice, nomm Aspbte
5
, refusa de seconder plus long-
temps les vengeances des mages, et qu'au lieu d'ar-
rter les fuyards, il les assistait de tout son pouvoir.
Dnonc pour ce fait auprs du roi et craignant pour
lui-mme, il se rfugia en terre romaine auprs du
patrice Anatolius, commandant de l'arme d'Orient, qui
le prposa aux Sarrasins soumis l'empire. Le phylar-
que, dont le fils avait t miraculeusement guri par
i. Peut-tre Karka de Beit Slokh, plutt que de Ledan (CRABOT,
Syn. orient., p. 283). Cf. HOFFHAN:-1, p. 39.
i. Je souponne que les Actes de saint Jacques l'Intercis que j'ai
rapports plus haut sont le produit d'une fusion opre par un hagio
graphe de la Msopotamie romaine entre les Actes de Jacques le no-
taire et ceux de PerOz. L'histoire de l'apostat reni par sa mre et sa
femme serait emprunte la passion de Perliz (d'ailleurs Jacques etait,
lui aussi, en quelque manire apostat). I.e nom, la fonction et le genre
de supplice du martyr auraient t extraits de la passion de Jacques.
Quant la date du !il7 novembre, ce peut tre celle de la passion de
Jacques qui ne nous a pas t conserve par les manuscrits. En elfe!, le
roi se trouvait certainement cette date Scleucie pour l'hivernage.
3. Syn. orient., p. 288; texte, p. 4.'5.
4. Cf. l'impression de saint Augustin : Quid modo in Perside? nonne
in christianos ferbuit persecutio si tamen iam quievit, ut fugientes non
nulli, usque ad Romana ovpida pcrvenerunt. De civ. Dei, XVIII, ~ i .
5. TILLEIIOliT, Hist. eccl., t. XII, p. 360. Cf. SOCRATE, Hill. eccl., VII, 1M.
Ce nom d'Aspbte rappelle singulirement celui d'une charge persane :
spabbedh; Cf. TARARI, p. 4-H.
7.
t t8 LES PERSCUTIONS DU CINQUIME SICLE.
les prires de saint Euthyme, se convertit, par la
suite, avec toute sa famille. Il reut le nom de Pierre
au baptme, fut consacr vque des Sarrasins avec
le titre de et assista en cette qualit au
conci1e d'phse de 431.
Cependant les Perses ne craignirent pas de deman-
der aux Romains de leur remettre les fugitifs.
L'empereur tait d'autant plus loign de rendre
les transfuges qu'il avait de son ct de nombreux
griefs contre le Roi Sassanide. Il dclara donc la guerre
en 421
1
Ardabure envahit l'Arzanne et dboucha dans la
valle du Tigre. Mihrnars marcha sa rencontre et
fut compltement battu. Enfin, aprs des vicissitudes
diverses, qui, dans l'ensemble, paraissent avoir t fa-
vorables aux Romains, Thodose II proposa Bahrii.m
de ngocier la paix. Et l'on conclut en effet un trait
qui devait durer cent ans (422). La libert de con-
science tait garantie aux chrtiens dans l'empire perse,
aux mazdens dans l'empire romain. Les Romains
toutefois devaient payer aux Perses des annuits pour
la garde des passes du Caucase et ne ralisaient aucune
acquisition territoriale. Ainsi leur victoire n'tait pas
complte, et la situation des chrtiens orientaux s'en
ressentit. La perscution officielle cessa, mais aprs
l'anne 422 il y eut encore de nombreux martyrs
2
i. TILLEIIOliT, Hist. Emp., VI, p. 40. TARARI, p. :1.08, n. 2.
i. Parmi lesquels peut-tre Benjamin qui avait t une premire fois
relch aprs deuJo: ans de dtention, la prire d'un ambassadeur
romain (TILLF.IIOIIT, XII, p. 36.1). Aussi l'auteur de la passion de PrOz
dit il quo la perscution dura cinq ans (HoFnnNII, p. 39).
---.--.-
LE GATHOLIGAT DE DADISO'. H9
2.- Le catholicat de Dadiio' (4.2i-4.!56).
Ainsi qu'il arrive d'ordinaire, les troubles du dehors
avaient eu une funeste rpercussion dans la vie int-
rieure de l'glise. Trois personnages brigurent pres-
que en mme temps la charge de catholicos: Ma'na,
Farbokt et Dadiso'.
Ma'na
4
,mtropolitain de Perse, fut, suivant les chro-
niqueurs, lu patriarche grce l'intervention du chef
de la milice (sans doute Mihrnars), puis dpos et re-
lgu dans son pays d'origine par le roi lazdgerd, avec
dfense de gouverner l'glise
2
Farbokt
3
aurait t galement appuy par un chef
militaire, aprs avoir promis de suivre les usages des
mages ~ . Mais les vques auraient ensuite obtenu du
monarque la permission de le dposer. C'est sans
t. MARE, p. !8. 'AMR, p. 16. BARRBRAEUS, COl. 53 et SUIV. LIE DE NISIDE,
ibid., col. 53, n. !1.
!!.. La carrire de Ma'na est fort obscure. D'aprs LIE, )fAnE, 'AMR et BAR
BBRAEUS (loc. 1up. cit.), il fut lu sous Iazdgerd et dpos du vivant de
ce prince. Marc et lie de Ni si be expliquent ainsi cette dposition: Ma'na
se serait refus dsavouer l'acte d'audace de l'vque de Hormizdarda-
sir, 'Abda (V. ci!dessus, p. tO:I). Banni en Perse, il aurait persist, malgr
la dfense formelle du roi, exercer la charge de catholicos, et, de ce
chef, fut incarcr. Il fut libr par la suite (probablement sous le
rgne de Bahrlim) la requte de quelques vques. sous la condition
expresse que personne ne lui donnerait le titre de catholicos, soit de
son vivant, soit mme aprs sa mort. - Barbbraeus attribue les d-
boires de Ma'na ce qu'il professait l'hrsie nestorienne. C'est l un
anacbronismegrossler. Le chroniqueur jacobite a confondu ce catbolicos
avec un homonyme, ancien lve de l'cole d'desse, et mtropolitain
de Rewardallir vers 480 (Cf. WESTPHAL, Unlersuchungen, p. 149-152).
Voir aussi, pour une autre explication possible de la dposition de
Ma'na, ci-dessous, p. :lili, n. :1..
3. Appel aussi, mais tort, Qarabokt et Marabokt. MARE, 3t. 'AMR,
p. :1.6, BARBBRAECS, COl. 57 et SUi V. I.IE DE NISIDII:, ibid., COl 53, n. !1, le
nommeFarukbokt. C'est la forme qu'aadopte M. Westphal (loc.sup. cil.).
4. C'est--dire probablement de prendre femme. Ce prince de la mi-
lice, d'aprs LIE DE NISIDE,loc. 1up. cil., tait le fameux Mibrsabur.
i20 LES PERSCUTIONS DU CINQUIME SICLE.
doute le mme personnage qui est mentionn dans
les actes de Dadiso' comme rebelle au catholicos l-
gitime, sous le nom de Farbokt d'Ardasir Kurrah
1
Ni Ma'na ni Farbokt n'ont pris place dans les dipty-
ques de l'glise nestorienne
2
Le troisime comptiteur, Dadiso', fut lu en 421 ou
au commencement de 422
3
D'aprs les chroniqueurs
nestoriens
4
, ce fut Samuel, vque de Tus
5
qui inter-
cda auprs du roi pour en obtenir la permission
d'lire un patriarche. Ce prlat avait des titres indis-
cutables la bienveillance de Bahram. Il avait dfendu
le Khorasan contre les incursions des barbares. Peut-
tre la runion des vques d'o sortit l'lection de
Dadiso' est-elle celle-l mme laquelle fait allusion
la Passion de Jacques le notaire
6
Des dissidents, dirigs par un certain Batai,
d'Hormizdardasir
7
, contestaient la primaut du sige
t. Synodicon orientale, p. 287.
!!. seul, Salomon de mentionne Ma'nadans son Catalogue. Bibl.
orient, Il, p. 388.
3. Nous savons, par lie dtl Ni si be (cit dans l'dition de BARutnnAEus,
col., 119 et 60), et 'AMR p. t7, que le rgne de Dadiso' dura 35 ans, et qne
l'lection de son successeur est antrieure la mort de l'empereur
Marcien (-'1>'7). Comme d'autre part, le patriarche fut emprisonn peu de
temps aprs son lection, mais dlhr gr.ice l'intervention des am-
bassadeurs romains ds 4!!!!, il faut qu'il ait t lu tout fait au dbut
de l'anne Ut et plus probablement ds 4!!1. l.'ordre des faits serait
ainsilesuivant: Mort de lahbalaha, commencement de4!!0; mort de lazd-
gerd 1 et avnement de Bah1am, aot 41!0; lection et dposition de
Ma 'na, entre le commencement de 4!!0 et la mort de Jazdgerd; lection
de Dadiso', 41!1; il est emprisonn presque aussitt et de livr en 4-ti
(entre temps : Intrusion de farbokt, sa dposition). 41!3: Dadii;o' se
retire au couvent de l'Arche; 4iU : il tient son synode Alarkabta de
'fayyay (Cf. WESTPUAL, Op. Cit., p. 159-160).
4. MARE, p. 31; 'Am, p. n. Syn. orient., p. 1!86, n. 2.
li. En Khorasan. Syn., orient., p. 68t.
6. BEDJAN, Acta MM. el SS., t. IV, p. 191!.
7. En voici la liste : Datai de Hormizd-Ardasir, Bar8abta de Suse,
lebida de Zab, Qisa de Q6ni, Sarbil de Dasqarta de Malka, Abner de
Kaskar, Salomon de Nuhadra, Bar J.lail de Tal_lal, Berikoi de Belesfar,
LE CATHOLICAT DE DADISO'. :12:1
de Sleucie et refusaient de se soumettre la dposition
prononce ou renouvele contre eux par Dadiso' ds
le dbut de son rgne. Ils avaient form une sorte
d' appel comme d'abus , non pas auprs des Pres
occidentaux , mais auprs d' trangers puissants,
c'est--dire des dignitaires de la Porte Royale. Puis,
usant de reprsailles, ils censurrent Dadiso' et le pro-
clamrent dchu. Ils contestrent la validit de son or-
dination, le dclarrent dbauch, simoniaque, igno-
rant, usurier, et prtendirent mme qu'il avait excit les
mages perscuter les chrtiens. Enfin ils l'accusaient
d'apostasie : Il a sign auprs des mages : Moi, je ne
suis pas le chef des chrtiens, je ne ferai ni vque, ni
prtre, ni diacre. 11 a sign qu'il honorait le feu et
l'eau.
4
Ils mirent les Perses dans leur parti, et Dadiso'
fut incarcr par l'ordre du roi.
Grce aux bons offices des ambassadeurs de Tho-
dose II
2
, il fut remis en libert, mais, dcourag et
dsabus, il renona conduire son troupeau rebelle et
annona son dessein de se retiret dans le couvent de
l'Arche
3
prs de Qardu, monastre construit par
Jacques de Nisibe et consacr par cet illustre vque.
Les prlats les plus considrables et les plus in-
fluents refusrent sa dmission. Comprenant qu'avec
l'autorit du pasteur suprme, celle de tous les pas-
teurs tait mise en question, ils se grouprent autour
de l'archevque de Sleucie et tentrent auprs de lui une
Farbokt Izedbilzed de Darabgerd. Syn. ori1ntale,
p. !181.
t. Syn. orient., p. !!88.
i. Ceux-l sans doute qui firent relcher le diacre Benjamin; voir plus
baut, p. H8, n. i.
3. Ce renseignement n'est sans doute pas de premire valeur. MARE,
p. 31. 'Alla, p. n. Sur ce eouventde l'Arche et sa lgende, v. AssEMANI, Bibl.
orient., IV, p. 865, et 11, p. H3.
122 LES PERSCUTIONS DU CINQUIME SICLE.
dmarche solennelle
1
Trente-six vques se runirent
dans une ville des Arabes
2
A leur tte : les mtropoli-
tains Agapit, de Beit La pat; Ose, de Nisibe-; Zabda,
de Maisan: Daniel, d'Arbel, 'Aqbalaha, de Karka de
Beit Slokh, et Yazdad, de Rewardasir.
Parmi les autres pontifes, plusieurs taient venus
des extrmits de l'empire : de Merw, de Herat, d'Is-
pahan, de Mazon (Oman) a.
Agapit traita au long la question de la primaut du
sige de Sleucie. Il demanda d'abord la permission
de relire les canons des synodes. Puis, remontant le
cours de l'histoire, il redit la querelle fameuse de Pa pa
et des vques dissidents. Nous avons rapport plus
haut son tmoignage. Il conclut que l'on ne peut tenir
de synode contre le patriarche ~ , mais seulement lui
adresser des suppliques et des remontrances respec-
tueuses.
Agapit rappela ensuite
5
qu'Isaac, le restaurateur du
patriarcat, avait t en butte aux attaques de ses col-
lgues. Les rebelles taient parvenus le faire empri-
sonner, mais les " Pres occidentaux obtinrent sa
dlivrance par l'intermdiaire de Maruta, et lazdgerd
promulgua la condamnation des schismatiques au-concile
de Sleucie. Les mmes faits se reproduisirent sous
lahbalaha, et ce fut Acace d'Amid qui intervint au nom
i. En la 4 anne de Babrm (4!M). V. Syn. orient., p. i85.
2 . Markabta de Tayyay. v. Syn. orient., p. 676.
a. A noter les signatures de deux vques prposs un centre de
dportation : Domitien, vque de la captivit de Gurzan;
Atius (?), vque de la captivit de BeleSfar. Les noms de ces v-
ques indiquent que les dports taient Romains. Il se pourrait que
ces signatures n'appartiennent pas l'poque qui nous occupe, car
elles conviennent beaucoup mieux celle de Chosrau 1 qui emmena
en Orient un nombre inlini de captifs.
4. Il faut induire de ce passage, croyons-nous, que les rvolts avaient
form un concile contre DadiSo'.
5. Syn. orient., p. 292.
LE CATHOLICAT DE DAI.HSO'. t23
des vques de Msopotamie. Chaque fois
1
que le
schisme et la discorde ont exist chez nous, les Pres
occidentaux ont t les soutiens et les auxiliaires de
cette Paternit dont nous sommes tous les disciples et
les enfants... Ils nous ont aussi dlivrs et librs
des perscutions excites contre nos Pres et contre
nous par les mages, grce aux ambassadeurs qu'ils
envoyrent en notre faveur diverses poques. Mais,
maintenant que la perscution et l'angoisse se sont
tellement appesanties sur nous, le temps ne leur per-
met pas de s'occuper de nous comme auparavant. >> Il
faut donc que les Persans s'aident eux-mmes et sup-
plient Dadiso', qui est pour nous le Pierre, chef
de notre assemble ecclsiastique , de retirer sa d-
missitm.
Ose de Nisibe s'associe ces paroles. Il interpelle
les vques encore hsitants et s'crie
2
: Pourquoi vous
taisez-vous et sigez-vous avec ces rprouvs et ces
dposs? Son intervention russit faire l'union.
Tous les vques se jettent aux pieds du catholicos, en
lui promettant de voter l'excommunication, la dposi-
tion et la dgradation des rebelles. Ils dfinissent que
" les Orientaux ne pourront se plaindre devant les pa-
triarches occidentaux de leur patriarche ; et que toute
cause qui ne pourra tre porte en prsence de celui-ci
se1d rserve au tribunal du Christ .
Dadiso' les invite se relever
3
, accepte leurs proposi-
tions, confirme les sentences portes contre les meneurs
de la rbellion et pardonne ceux qui se sont laiss
entratner par eux. Ainsi se termina ce synode, dont
l'importance est capitale :l'autonomie de l'glise per-
t. Syn. orient., p. !!93.
i, Syn. orient., p. i!lt.
3. Syn. orient., p. 11!17.
f2-i LES PERSCUTIONS DU CINQUIME SICLE.
sane est dfinitivement proclame, le protectorat des
Pres occidentaux )) n'est plus admis.
Nous avons quelque peine comprendre la dcision
des prlats et surtout les motifs qui en sont allgus.
Les << Pres occidentaux )) , dit-on, ne peuvent plus
s"occuper de nous et nous aider. Comment concilier
cette assertion avec le fait, rcent encore, de l'inter-
vention des Romains dans le trait de paix qui mit
fin la priode aigu de la perscution de Bahram?
Acace d'Amid, qui dj avait t dlgu au synode
de lahbalaha, venait de gagner aux chrtiens l'estime
du roi de Perse, en rachetant, au prix des vases
sacrs de son glise, sept mille prisonniers que les
armes impriales tranaient leur suite, et en les
renvoyant leur souverain aprs les avoir nourris quel-
que temps et leur avoir fourni des vivres pour la
route. Bahram, dit Socrate
1
, dsira voir l'auteur de cet
acte si gnreux et si charitable, et l'Empereur per-
mit ce voyage. Et Tillemont
2
remarque avec raison
que Acace n'a pu entreprendre ce voyage qu'aprs la
conclusion de la paix, ou au plus tt pendant les ngo-
ciations prliminaires. Il se trouvait donc probablement
la Porte Royale tandis que Dadiso' tenait son concile
chez les Arabes. Cette concidence est surprenante,
et rend encore plus invraisemblable le motif avanc
par les orateurs du synode.
Nous croyons donc que ce motif n'est qu'un prtexte.
En ralit Dadiso' voulait tout prix se soustraire
l'ingrence des << Pres occidentaux n. Il est fort pos-
sible que les dissidents en aient appel A ca ce d'A mid
et que celui-ci se soit prononc en leur faveur. On
1. Rist. eccl., VII, 21.
2. Hist. Emp., VI, p. 46.
LE CATHOLICAT DE DADISO'. 125
pourrait expliquer par l pourquoi le synode de
Dadiso ne s'est pas tenu Sleucie, mais dans une
ville assez loigne et politiquement demi indpen-
dante.
A ces raisons toutes personnelles, il est probable que
Dadiso en joignit d'autres d'un ordre suprieur. Il
pensait peut-tre, en dcrtant l'indpendance absolue
de l'glise syrienne orientale, anantir un prjug vi-
vace et qui avait coll t trs cher ses coreligionnaires :
que les chrtiens de Perse taient les allis naturels
des Romains, et les ennemis jurs du Roi des Rois.
C'est dans le mme esprit que, plus tard, Acace et
Bar::;auma accenturent la scission entre l'glise oc-
cidentale des Cyrilliens et les Persans fidles
Nestorius. La politique de Dadiso porta d'ailleurs
ses fruits. Si de nombreux actes de perscution
ensanglantrent la fin du rgne de Bahram et celui
de Iazdgerd II, il semble toutefois qu'il n'y eut plus de
perscution gnrale analogue celle de Sapor II. La
guerre contre les chrtiens ne concida plus
rement avec la guerre contre Rome
1
t. Je ne puis me dfendre de concevoir des doutes assez graves sur
l'authenticit des actes de DadiSo ' (Syn. orient., p. 285-!!99), au moins
en ce qui concerne la partie o sont rapportes les allocutions des
mtropolitains Agapit et Ose, ainsi que l'histoire de Papa et de Mils.
Ces doutes sont partags par M. Westphal (op. cil., p. 16:!), qui trouve
les discours composs sur un plan bien artificiel. Ils sont fortifis par
la considration du singulier paralllisme qui existe entre la situa-
tion de Iahbalaha et de Ma 'na, telle qu'elle ressort du texte de Mare
que nousavonsrapportplus baut (p.t03, n.t), et celle de Papa et deMils.
Papa et Iahbalaba sont vques de Sleucie; Ma 'na et Mits, vques de
Perse. Ma 'na et Mils font, en synode, des remontrances Iabbalaha
et Papa. Pour avoir ddaign ces observations, l'vque de Sleucie
est, dans les deux cas, foudroy par un mal subit. Il fait appel, dans
les deux cas, aux Pres occidentaux (Acace d'Amid). Les Pres occi
dentaux dposent les adversaires de Papa. De mme les vques dont
nous avons rapport les noms n. 7) ont t dposs par Iahbalaba et
Acaee, puis de nouveau par DadiSo' (et Acace?). Est-il tmraire de
penser que Dadiso', pour les besoins de sa cause, favorisa l'closion
t26 LES PERSCUTIONS DU CINQUIME SICLE.
s' 3. - La perscution de Iazdgerd II. Le catholicat
de Babowa (4.56-485).
En 438, Iazdgerd II succda son pre Bahrm; d'a-
prs l'Histoire de Beit Slokh
1
, il se montra d'abord
favorable aux chrtiens 2.
Les bonnes dispositions du prince firent bientt
place une haine implacable. Nous ignorons les rai-
sons de ce changement d'attitude. L'Histoire de Beit
Slokh rapporte que, dans la huitime anne de son
rgne (445/6), il tua sa fille, qui tait aussi sa femme,
et les grands du royaume; puis, qu'au retour d'une
expdition heureuse au pays de T sol
3
, il chassa les chr-
tiens de son arme et ordonna un de ses grands offi
ciers, 'fohm lazdgerd, qui commandait Nisibe, de se
transporter Karka de Beit Slokh avec Adurafroz-
gerd, p1fet de l'Arzanne, et Suren, prfet d'Adiabne
et de Beit Garma. On runit dans cette ville des chr-
tiens des quatre provinces mentionnes ci-dessus. Le
le mtropolitain fut jet en prison et, avec
d'une littrature apocryphe, et en 6t lire un rsum dans le synode de
1 Autre concidence, non moins singulire : D'aprs le Brie(wech&el
des Katholikos Papa, dit par Braun, et la lettre des occidentaux.
publie par 'Abd iso' tColl. can., Tr., IX, ch. v), la missive est apporte
aux orientaux par ijabib-Agapet. et dans.le Synodicon, c'est Agapit de
Beit Lapat qui est cens dfendre, en vertu des dcisions antrieures
des directeurs de l'Occident , la primaut du sige de Sleucie. La
que$tion est, cependant, loin d'tre tire au clair. Si Dadiso' invoque la
dcision des Occidentaux intervenue en fayeur de son prdcsseur
Iahbalaha, pour<tuoi fait-il interdire, par les vques de son synode,
tout recours ulterieur ces mmes Occidentaux et dcider qu'on ne
pourra en appeler du tribunal du catholicos qu' celui de Dieu mme?
t. HOFFMAN!I,Auszge, p. 49 ct sui v. BEDJAN,ActaAfM. etSS.,t. II, p. ISiS
etsuiv.
2. Cependant, il avait attaqu les Romains ds le dbut de son rgne.
Mais la guerre avait t de courte dure (TAnA tu, p. tu, n. 1) et ne parait
pas avoir eu de rpercussion sur la situation de l'glise persane.
3, HOFFIUIIII, Excurs !!0, p. T8ol est un district de J'Hyrcanie.
Il avait crit au patriarche d'Antioche au sujet de la perscution.
LA PERSCUTION DE IAZDGERD II. t 2
lui, dix reprsentants des plus illustres familles du
pays; leur tte, Isaac, Ardasir et Abraham. Le m-
tropolitain d'Arbel et cinq autres vques, avec un
nombre considrable de fidles, vinrent bientt grossir
la troupe glorieuse des confesseurs. La plupart refu-
srent d'apostasier. Isaac fut martyris Beit Titta
1
,
localit dj illustre par les martyrs de la perscution
de Sapor. Le mtropolite Jean et trente et un notables,
dont trois prtres, furent massacrs au mme endroit
le 24 aot 446.
Le lendemain, de nombreux prisonniers, originaires
de la villt, furent mis mort. Les clercs, parmi lesquels
les prtres Isaac et tienne, furent lapids ; deux reli-
gieuses, crucifies et lapides sur leur croix. Les
autres condamns, vques, clercs et lacs, subirent
des tortures plus raffines. Enfin les satellites de
Tohm lazdgerd dcapitrent une chrtienne de la cam-
pagne, nomme Sirin, qui n'avait pas craint de re-
procher au prfet sa cruaut. Les deux fils de la
martyre partagrent son sort. Leur courageuse atti-
tude s'imposa l'admiration du perscuteur. Il tou-
cha du doigt la criminelle lchet de sa conduite
et confessa hardiment Jsus-Christ. Irrit de cette
conversion si imprvue, Iazdgerd li essaya de ramener
son lieutenant la religion officielle. Les promesses,
les menaces, les tortures mmes ne parvinrent pas
branler sa constance. Le roi le fit crucifier le lundi
25 septembre.
L'anne suivante, neuvime du rgne de lazdgerd,
le 25 Tesri l (octobre 447), fut mis mort le clbre
martyr Pethion
2
Ce chrtien s'tait vou l'vang-
Donc, au moins aux yeux de certains vques, Je patriarche d'Antioche
devait tre tenu au courant des choses de Perse. cr. ci-dessus, p. t!U.
t. J.e lieu du figuier
i. HOFFIUNll, AtlszQge, p.Gt et SUV. REDJAN, 1. IJ, p. l)ijf)-583.
f28 LES PERSCUTIONS DU CINQUIME SICLE .
lisation des contres montagneuses qui s'tendent
entre la Mdie et la valle du Tigre, de BeleSfar
Beit Daraye. Il parcourait ces pres pays tout entiers
paens pendant la belle saison, et en hiver il prchait
Jsus-Christ dans la Msne et les pays circonvoisins.
Il obtenait partout des succs considrables, btissant
des glises, et convertissant des adeptes de la religion
de Zoroastre. Des dignitaires de l'empire, comme le
rad Nahormazd, le chef de la police Sahn, un corn
mandant militaire, '.fohmin, taient ses disciples, en
secret seulement, par crainte des autorits suprieures.
Le grand mobed qui a fait emprisonner Pethion
trouve leur concours si peu efficace qti 'il destitue le rad
et commet un officier spcial, Mihrburzin, pour procder
l'excution du martyr. Les interrogatoires et les tor-
tures se prolongrent pendant plusieurs jours. Enfin
Pethion fut dcapit, et sa tte expose sur un rocher
qui dominait la route du Grand Roi
1
Cette scne se
passait sans doute non loin de la ville de I;Iolwan en
Mdie.
Tels sont les deux pisodes de la perscution de Iazd-
gerd II qui nous sont connus. Ils ne sont pas suffisants
pour nous permettre d'en apprcier exactement l'in-
tensit. Il est, toutefois, assez probable
2
qu'un peu
avant 450 elle svissait encore dans l'empire perse.
Les auteurs armniens font de lazdgerd II un ennemi
acharn des chrtiens
3
; et il faut admettre avec
M. Noeldeke que le fanatisme religieux, et non pas seu-
lement des motifs politiques, inspirrent sa conduite.
C'est ainsi qu'en 454/5 il interdit aux Juifs la clbra-
tion du sabbat. lazdgerd II mourut le 30 juillet 457.
t. Cette route conduisait Ile Sleucie aux extrmits de l'empire, du
ct du Kborasan.
2. ASSEIUNJ, M. o., p. 233.
3. TA.R\Rt, p. iH, n. 1.
LE CATHOLICOS BABOW A. t29
Le catholicos Dadiso' termina vers le mme temps
un pontificat constamment troubl par les perscu-
tions du dehors et par les luttes intestines. Sa vie nous
est assez peu connue; nous ignorons, par exemple,
quelle part il prit aux discussions thologiques qui pas-
sionnaient alors le monde grco-romain. Suivit-il le
parti des Nestoriens, ou bien la proclamation d'ind-
pendance par laquelle il avait inaugur son rgne lui
permit-elle de rester neutre? Nous essaierons plus loin
d'claircir cette question fort embrouille
4
L'histoire du successeur de Dadiso', Babowa 2,
est, elle aussi, pleine d'obscurits. Ce prlat, originaire
de Tella, prs du fleuve ! ? e r ~ e r , tait un converti
3
Le
roi Proz, qui, aprs le rgne phmre de son frre
Hormizd, avait succd Iazdgerd II, perscutait les
Juifs et les chrtiens
4
Le catholicos fut mis en prison,
sur l'ordre du monarque, soit pour avoir abandonn
la religion des mages, soit pour d'autres motifs igno-
rs de nous, et il y demeura deux ans, suivant Mare
4
,
jusqu'au trait de paix que conclut le Roi des Rois
avec l'empereur Lon (464)
5
t. Yoir eh. 111 et ci-dessous, p. t33, n. 6.
~ BnabaAEUs l'appelle Babuyah. J'al adopt l'orthographe prconise
par M. Hoffmann, Ausziige, Jl. t;S.
3. Il fut lu sous le rgne de Marcien, d'aprs lie de Nisibe. Buutaa.,
Chron. eccl., Il, col. 60, n. !, Cf. MARE, p. 311; 'AIIR, p. t7; BARIIBR., COL
60 et suiv.
4. TAnARo, p. US, n. 4. Il est fait allusion cette perscution dans la
vie de Saba (HorrMAN!I, Auszge, p. 7t).
s. La Passion de l!abowai(Bt:DIA!I, II,p.63t) dit: de longues annes
Barbbraeus (col. 6t) semble avoir calcul les sept annes de captivit
que, d'aprs lui, aurait subies Babowai, de 4117 ~ . Mare prtend que
PrOz ayant interdit la nomination d'un catholicos, Babowa se lit lire
malgr cette dfense, et fut ensuite poursuivi pour avoir contrevenu
aux ordres du roi. Voici comment nous imaginerions l'ordre des faits :
son retour de l'e1il, Prz fit mettre mort les principaux partisans de
son frre, ou du moins les emprisonna. Il dut aussi dployer un grand
zle l'endroit du mazdisme pour se concilier .l'appui de l'aristocra-
tie et du sacerdoce. Si l'on admet que Babowai ait t lu sous
.,..
t30 LES PERSCUTIONS DU CINQU!iE SICLE.
Il se considrait, par la suite, comme un confesseur
de la foi, et, ce titre, se faisait combler de louanges
par son entourage; cependant, il aimait l'argent et
laissait se relcher la discipline ecclsiastique.
ll termina sa vie de la faon la plus tragique. Un
espion ayant surpris une lettre que Babowa adres-
sait l'empereur Znon pour l'informer de la situation
prcaire des chrtiens de Perse, Prz fit pendre le
catholicos par l'annulaire ( 484)
1
Les chroniqueurs
rapportent la mort du patriarche peu prs de la
mme manire; mais ils se divisent, quand ils cher-
chent dterminer la part que vque de
Nisibe, prit cet vnement. Avant de discuter ce
point particulier, nous devons tudier le caractre de
Bar:;;auma et apprcier son action politique et reli-
gieuse, dont les luttes qu'il soutint contre Babowa
et son successeur Acace ne sont qu'un pisode
2
Hormizd lll, et sans doute avec son assentiment, on conclura que
PrOz ne manquait pas de motifs pour Incarcrer le catholicos. Noua
savons d'autre part {TILLEYOST, Hi&t. Emp. , VI, p. 38f, d'aprs Priscus)
que le roi dea Perses se plaignait que les empereurs tourmentaient
les mages qui demeuraient sur les terres de l'empire, ne leur laissant
pas l'usage libre de leur religion et de leurs lois, et ne soulfrant pas
qu'Ils entretinssent le feu ternel Prclz, en guise de reprsailles,
a pu perscuter les chrtiens et leur chef. {Mare raconte qu'il les for-
ait couper du bois pour l'entretien du feu sacr.)
t. Cette excution eut lieu entre le concile de Beit Lapaf, avril .
et le dpart de Prclz pour la guerre contre les Huns, an commence-
ment de l't de la mme anne.
!:!. En dehors des vnements que nous venons de mentionner, un
seul fait du rgne de Babowai est parvenu notre connaissance. C'est
la tenue d'un synode auquel prirent part les vques du Beit Garmai
et de l'Adiabne. On y dcrta que tous les prlats de l'parchie de
Karka devraient assister la commmoraison solennelle des martyn
de la perscution de lazdgerd Il. L'Histoire de Beit Slokh a conserv le
texte de ce canon. HOFFIIAIIN, p, 118. BEDIAII, t. II, p. 1131.
CHAPITRE VI
LB TRIOJIIPHE DB LA DOCTRINE NESTORIENNE
S t. - Bartauma de Nisibe. Ses luttes contre
les monophysites.
Bar!?auma tait originaire des provinces du Nord.
On peut admettre, avec Simon de Beit Arsam
1
, qu'il
avait t le serviteur d'un certain Mari de Beit
Qardu
2
Nous ignorons la date de sa naissance. On doit
sans doute la placer vers 415-420.
Nous le retrouvons desse, l'cole des Perses
3
Cette cole fameuse avait t, croit-on, fonde par saint
phrem lors de la cession de Nisibe aux Sassanides
( 363) ~ . Elle attirait elle les Syriens orientaux, avides
t. B. O., 1, p. 346 et sui v., surtout partir de la p. 349.
!!. C'est--dire probablement qu'il tait n sur ses terres.
s. v. R. Dvvu, Hi&toire d'Bde11e, p. H5, tn et sui v.
4. Nous ne savons si, comme le pense M. R. DuvAL, p. t77, l'mi
gratlon des docteurs nisibites fit natre dans la ville un antagonisme
entre les anciens habitants et les nouveaux venus qui restrent isols
et reurent le nom de Perses C'est peut-tre, crit encore M. Duval,
la faveur de cette rivalit que le nestorianisme qui n'eut pas de racines
profondes en Syrie ni desse mme s'implanta facilement dans l'cole
des Perses. Rabbula, qui tait Syien d'origine, lutta contre l'hrsie
naissante, mais Hibha qui avait profess l'cole des Perses lui fut
favorable Il faut observer toutefois que Hibha {Ibas) tait d'origine sy-
rienne aussi bien que Rabbula. S'il accepta de professer l'cole des
Perses, c'est qu'il n'existait pas, ce moment, d'antagonisme radical
entre Syriens occidentaux et orientaux. Le prtre dessnlen Marun
Elita tait aussi lecteur de l'cole des Perses Quma et Probus, les
traducteurs d'Aristote mentionns par'Abdiso', semblent tre des Syriens
t32 LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
d'rudition thologique et exgtique. Comment, en
effet, tudier dans l'empire des Perses, alors que la
perscution plus ou moins latente, mais toujours prte
clater, pouvait interrompre les paisibles labeurs de
l'cole? D'ailleurs, aprs le concile de Sleucie, les
chrtiens de Perse s'attachrent avec plus de fermet
aux doctrines de l'Occident dont ils avaient adopt le
dogme et la discipline. Or, nulle part mieux qu'
desse on ne pouvait s'initier la culture hellnique.
La ville bnie de Dieu tait l'intermdiaire naturelle
entre la mtropole d'Antioche et les glises per-
sanes.
B a r ~ a u m a fit partie de cette pliade de jeunes Per-
sans qui reurent l'enseignement d'lbas et restrent
fidles leur matre t. Les principaux taient Acace
de Beit Aramay surnomm l'trangleur d'oboles,
Mana de Beit Ardasir surnomm buveur de lessive,
Absota de Ninive, qui avait un surnom qu'on ne
peut crire dcemment , Jean de Beit Garmai dit
le petit cochon, Miche dit Dagon, Paul fils de Qaqai
de Beit Huzzay surnomm le faiseur de haricots,
Abraham le Mde dit le chauffeur de fours, Narss le
Lpreux, et Ezalia du monastre de Kefar Mari li. Si-
mon de Beit Arsam qui nous a transmis ces sobriquets
nous apprend que B a r ~ a u m a portait celui de nageur
entre les nids (ou peut-tre : entre les roseaux).
Il y avait cependant, dans l'cole mme, une mino-
rit rsolue d'adversaires d'lbas, parmi lesquels nous
connaissons Papa de Beit Lapat, Xen11ia de Tal}al (le
clbre Philoxne de Mabbug), son frre Adda, un
occidentaux (B. o., JII, p. 85). J:identit de ce Probus est d'ailleurs assez
mystrieuse (Litt. syr., p. 2.'>4). -
t. Lettre de Simon de Beit Ari;am, B. O., 1, p. 35t. Cf. Histoire ti E-
desse, p. t78.
2. Il faut y ajouter Iazidad (R. Dt:\"AL, Litt. syr., p. 348).
DE NISIBE. i33
certain BarlJadbesabba de Qardu et Benjamin, origi-
naire du Beit Aramay .
se distingua tellement par son attache-
ment au Nestorianisme qu'il mrita que les vques du
deuxime synode d'phse (latrocinium) demandassent
son expulsion (449)
2
S'il se soumit cet arrt, il dut
revenir desse lorsque son matre eut t rhabilit
par les conciles de Tyr et de Beyrout et enfin par celui:
de Chalcdoine. Mais lorsque lbas mourut (457), une
violente raction monophysite se produisit : tous les
Perses furent expulss d'desse, avec le reste des lee
teurs d'desse qui taient de leur parti. Et ceux qui
avaient t chasss d'desse descendirent dans lP
pays des Perses, et parmi eux il y en eut qui furent
vques dans les villes des Perses : Acace Beit
Aramay, l'impur Nisibe, Ma'na Beit
Ardasir3, Jean Karka de Beit en Beit Garma,
Paul fils de Qaqa Karka de Ledan en Beit Huzzay,
Pusai fils de Qurti Suster, ville des Huzzay, Abra-
ham Beit Maday; Narss le Lpreux fut docteur
Nisibe
5
.
Ainsi, d'aprs Simon, pendant le rgne du catho-
licos Babowa, les anciens disciples d'lbas furent d-
signs pour occuper les siges principaux. On est
donc induit penser que les tudiants d'Edessc taient
toujours rests en communaut d'ides avec les auto-
rits ecclsiastiques de leur pays
6
!, SJMtOII DE BEIT ARSA!II, loc. cit.
Il. P. MARTI!i, Acte& du Brigandaye d' Ephse, Paris, t8i4, p. 31,
3. Corr. : Rew-ArdaMr.
Corr. : Beit Slokh.
5. Ces renseignements sont con Orms par les souscriptions du synode
d'Acace (4M). Syn. orient., p. 300 et 301.
6. Si nous con11aissions l'identite de )laris le Persan ou de Beit A rd asir
qui lbas adresse sa lettre sur les controverses christologiqucs ()JANsJ,
t. VII, p. W et sui v.; v. ci-dessous, ch. IX, p. !!al), nous serions mieux
8
i3i LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
Lorsqu'ils arrivrent au pouvoir, ils se bornrent
consolider des positions depuis longtemps acquises et
expulser les perturbateurs. Ce Cut principalement
l'uvre de Il l'accomplit dans plusieurs sy-
nodes, tenus en l'an 484, vingt-septime anne du roi
Proz.
L'histoire de ces raits est assez peu claire et mme
parfaitement incomprhensible, si l'on s'en tient
Assemani Cet minent auteur canonise, pour ainsi
parler, Simon de Beit Ar8am et le suit aveuglment
dans ses affirmations. Ce qui est pire encore, c'est qu'il
s'attache aux traditions de Barhbraeus, auquel il em-
prunte, n somme, la trame de sa narration.
renseigns sur les rapports des lves persans d'desse avec leurs com-
patriotes. Simeon de Beit Arsam (loc. cit.) dit simplement : un homme
du nom de Mari de Beit Ardasir . Le correspondant d'Ibas pourrait
donc tre un laie. Cette hypothse n'est gure vraisemblable. La lettre
d'Jbas contient des rormules qui ne s'adressent correctement qu' un
vque (tri! liytoauvll). Le docteur d'desse charge Mari d'annoncer
tous nos Pres que la paix est conclue entre les partisans de Jean
d'Antioche et ceux de saint Cyrille. }lari est donc probablement un
vque, et un vque trs !nOuent.
Le nom de son sige est Beit Ardasir; or Beit Ardasir est l'appella-
tion omcielle de Sleucie (T.I.n.I.RI, p. i6, n. t). Ainsi Mari se trouverait
avoir t catholicos de Sleucie, et la manire dont Ibas s'adresse lui
serait pleinement justifiee. }lais le catholicos qui rgissait l'glise de
Perse cette poque s'appelait Dadiso' (ch. v, p. t20).
Il y a l une dimcult prsentement insoluble. Supposons touterois
que Je titre original de la lettre d'lbas crite naturellement en syriaque
ait t ;...a!l .l!o....:o! .;. M l'vque de Beit Ardasir, il a
pu tre transcrit en grec tl; Mciptv in(axonov B'l)6a.plla.atP1JV<iiv par exem
pie, et le litre d'honneur syriaque Mr(i) a pu tre pris pour le nom propre
du correspondant d'Ibas. A supposer de nouveau que le nom de Da-
diso' ait t inscrit en toutes lettres, la dirlicult de le transcrire en
grec expliquerait sumsamment son omission. EnOn le titre de l'un des
exemplaires a pu tre ainsi libell : .l!o....:o! >
M l'vque des Persans. Ainsi s'expliquerait l'pithte de Persan g-
nralement donne Maris. 'Abd iso' (B. o., Ill, p. nt et !t4) attribue
gaiement Maris et Dadiso' un commentaire sur Daniel. Serait-ce
que la tradition nestorienne idenliOait ces deux personnages?
t. Bibl. orient., Jll, p. 66-70, 393; Il, p. 403; IV, p. 7879.
L'EXPULSION DES MONOPHYSITES. !35
Or, pour Barhbraeus
4
, voici comment se rsument
l: faits : de Nisibe, Ma'ana mtropolitain de
Perse
2
, et le docteur Narss prchaient le nestorianisme
et conseillaient aux vques d'avoir des concubines.
Pour il vivait dans sa cellule avec une femme
qu'il appelai( son pouse lgitime, disant qu'il tait
mieux de prendre femme que de brler des feux de la
chair. Les vques occidentaux crivirent Babowa
pour protester. Celui-ci leur rpondit : Comme nous
sommes asservis un gouvernement impie, nous
sommes impuissants svir contre les coupables;
bien des abus se sont-ils introduits malgr nous
t contrairement aux canons . intercepta la
lettre, la transmit Prz et accusa le catholicos de
correspondre avec les Grecs. Prz se fit traduire le
message l'improviste, et le lecteur ne put modifier
temps le sens du passage incrimin. Le roi fit saisir le
catholicos, puis le condamna tre crucifi, suspendu
par l'annulaire et flagell jusqu' la mort.
Alors dit Proz : Si nous ne proclamons
pas _en Orient un dogme diffrent de celui de l' empe-
reur romain, jamais tes sujets chrtiens ne te seront
sincrement attachs. Donne-moi donc des troupes et
je rendrai Nestoriens tous les chrtiens de ton empire.
De la sorte, ils haront les Romains, ct les Romains les
dtesteront. "
avec des soldats perses, sortit de Sleucie
et alla en Beit Garmai o il perscuta les orthodoxes.
Mais il fut chass de Tagrit et de toute la rgion. Il
se rendit Arbel dont le mtropolitain sc rfugia
au monastre de Mar Mattai. l'y poursuivit,
saisit Barsahd, mtropolitain du couvent, avec douze
t. Col. 63-78.
:1. Qui, d'aprs lui, serait le catholicos du mme nom, dpos vers 420.
t36 LE TRIOMPHE DE LA DOCTRI:\'E :"lESTORIENNE.
moines qui n'avaient pas russi s'enfuir, et les mit
en prison chez un Juif; puis il descendit Ninive, et
tua quatre-vingt-dix prtres au monastre de Bi-
zonita, et un grand nombre d'autres dans la rgion
voisine.
De l il se dirigea vers Beit N uhadra et tint un synode
Beit Adrai; puis deux autres Ctsiphon et Karka de
Beit Slokh, dans la maison du collecteur d'impts Y azdin,
et fit des canons que Xenaas (Philoxne de Mabbug)
rfuta en deux livres. Barhbraeus dit que Bar::;auma,
qu'il appelle par drision JloJ le fils de la
semelle, massacra en tout 7700 orthodoxes. Il allait
poursuivre son uvre en Armnie; mais l'attitude des
vques et des nobles de cette contre l'en empcha.
Il revint alors N isibe et continua la perscution dans
les provinces aramennes. Les vques qui avaient
pu lui chapper se runirent Sleucie et lirent
Acace. Mais et Maana menacrent de le
tuer comme son prdcesseur. Terrifi, Acace tint
un synode o il confessa l'erreur de Nestorius et au-
torisa la fornication.
Ainsi, d'aprs Barhbraeus, et ses parti-
sans sont reprsents comme les seuls tenants du nes-
torianisme, qu'ils auraient impos par la force au
catholicos Acace, aprs avoir fait mourir Babowa
qui s'opposait leurs desseins
1
i. M. l'abb Chabot a l'oiJligeance de me communiquer un passage
(encore indit) de la Chronique de Michelle Syrien (lhre Xl, ch.Ix; ms.,
p. t23t1117) d'o Barhhraeus a copi presque mot pour mot les rensei-
gnements qu'il insre dans sa propre chronique. Le titre du chapitre est
celui-ci : Chapitre dans lequel&e trouvent la lettre du patriarche Mar
.Tean Marouta, mtropolitain de Tagrit, et celle de Marouta Jean.
qui expo&e la per&cution excite autrefois contre les fidle& par Bar-
auma de Nisibe. II suit de l que l'histoire de l'introduction du nes-
torianisme en Perse la manire monophysite remonte au premier
quart du vn sicle (Voir plus loin, ch. vm). Mais l'autorit en est bien
L'EXPULSION DES MONOPHYSITES. t37
C'est l une confusion regrettable, et qui n'a pas
peu contribu rpandre des ides inexactes sur
l'introduction du nestorianisme en Perse.
Double est l'uvre de : une uvre per-
sonnelle, satisfaire son ambition et se rendre ind-
pendant des patriarches; une uvre proprement eccl-
siastique, lutter contre le monophysisme et lgifrer
sur le mariage des clercs. Quand il poursuivit la ra-
lisation de ses convoitises, il se trouva en conflit avec
les vques de Sleucie; mais il n'eut pas d'auxiliaire
plus dtermin que Acace, quand il travailla main-
tenir dans l'glise persane l'unit doctrinale, com-
promise par les menes des partisans de Philoxne.
Comment et pourquoi cette lutte dogmatique con-
cida-t-elle avec la lutte purement politique engage
par contre le primat de Sleucie au point
d'avoir pu tre confondue avec elle, c'est ce qu'il im-
porte d'exposer brivement.
A la mort d'Ibas (457), les plus clbres des lee-
diminue par l'aveu dnu d'artifice que fait Maruta son correspon
dant: Ensuite, puisque vous nous avez demand le rcit de la perscu-
tion de sache, 0 prince des princes, que toutes les histoires
antrieures qui taient dans le couvent (de Mar Maltai) ont t brles
en mme temps que le couvent par cet impur ;Et cette histoire
ne Je trouve nulle part, parce que les hommes lnstrnils et les crivains
ont t couronns du martyre cette t'poque; mais pour ne pas frustrer
le dsir de Votre Batitude, nous crivons rapidement ce que nous avons
appris de vive voix de vieillards vridiques, qui avaient reu ces choses
de leurs pres (Ms., p. U4).
La lettre de Marula attribue Je supplice de Bahowai lui-
mme. dit Baba : Accepte la doctrine de Nestorius, et
demeure la de ton glise. Le saint rpondit : Que ta puissance
s'en aille avec toi la perdition; pour mol, j'anathmatise Nestorius et
quiconque pense comme lui. L'impie chercha effrayer le vieillard
par les supplices de la mort. Le saint dit: 0 ennemi de la justice, nou-
veau Judas! Qu'as-tu de plus dur que la mort? je mourrai des myriades
de morts, plutOt que de changer ma vrit. ordonna de lui
couper la .langue, sous prtexte qu'il avait outrag le roi, puis lui fit cou-
per la tte. Quant Acace, c'est " le cur bris qu'il accepta le nestoria-
nisme par crainte de la mort (lis., p. 4;,G).
8.
138 LE TRIOMPHE DE LA DOCTIUNE NESTORIENNE.
teurs de l'cole des Perses durent, comme nous
l'avons dit plus haut, quitter desse du fait de l'vque
Nonnus
1
, mais il ne parat pas que l'cole ait t ce
moment dfinitivement ferme. Le parti monophysite
n'tait pas encore prpondrant dans la Syrie byzan-
tine. Au contraire, l'empereur Lon et son successeur
Znon se montrrent favorables l'orthodoxie chal-
cdonienne, le second surtout qui avait eu surmon-
ter un comptiteur, Basilisque, lequel s'appuyait ou-
vertement sur les dissidents
2
Mais, l'instigation d'Acace de Constantinople,
Znon avait fait volte-face, promulgu l'Hnotique
en 482 et inaugur une politique en apparence ortho-
doxe, en ralit monophysite. Les adversaires du Tome
de J,on triomphrent et dnoncrent comme nesto-
riens les tenants de la vieille tradition antiochienne.
Calandion, patriarche d'Antioche, pourtant une cra-
ture d'Acace, tait attaqu, en attendant d'tre dpos,
pour avoir refus de se sparer de la communion du
pape Flix II.
Cette recrudescence du monophysisme inquita les
Persans, et les anciens lecteurs d'desse, Bar'ilauma
leur tte, condamnrent l'hrsie au synode de
Beit La pat tenu en avril 484
3
Les conclusions du
1. I.ettre de Simon de Beit Ari;am (Bibl. orient., t. 1, p. 353). Cet auteur
semble indiquer que l'vque Cyrus prit contre les nestoriens cette
mesure de rigueur. Il confond l'expulsion de BaJ'!iauma et de ses com-
pagnons, avec la fermeture de l'cole. Cette dernire eut lieu en o\89
(Thodore le Lecteur, H. E., 1. II. P. G., t. LXXXVI, col. t81;. - Chroni-
que d'desse, n LXXlll :Anno 800 Persarum schola ex urbe Edessae excisa
est. d. Guidi, trad., p. 8). Mais cette date les lecteurs d'desse dont parle
Simon avaient depuis longtemps quitt l'cole, la plupart d'entre eux
apposrent leur signature au synode de o\86 (Syn. orient., p. !2911, 300, 301 ).
2. KRllGER, art. Monophysiten dans HERZOG'S Realencykl. 3, t. XIII,
p. 379-381.
3. Ce concile fut annul, comme schismatique (Syn. orient., p. 53-\) et
c'est pour cette raison qu'il n'a pas pris place dans la collection gnrale
des synodes orientaux (Synod. orient., p. 308). 11 jouit cependant d'une
~
L'EXPULSION DES MONOPHYSITES; f3!J
synode furent adoptes par le catholicos Acace au col-
loque de Beit Adrai(aot 485), dans un autre petit con-
cile ~ , et enfin dans le synode gnral de fvrier 486
dont les Actes sont parvenus jusqu' nous
2
Bar;;auma se chargea de faire excuter les dcisions
de ces assembles. Il tait fort bien en cour, et, suivant
une tradition, Babowa lui-mme l'avait dsign
Proz comme l'hommP. le plus capable de le renseigner
sur les affaires des Romains
3
La confiance du roi et
celle du catholicos le firent la fois mtropolitain de
Nisibe et inspecteur des troupes de la frontire. Il fit
mme partie d'une commission pour la dlimitation
des frontires avec le marzban Qardag Nakwergan,
le dux romain et le roi des Arabes ~ . Les quelques
lettres de lui qui nous ont t conserves nous le mon-
trent aussi soucieux des intrts du monarque que de
ceux de l'glise s.
Serviteur zl, il persuada Proz que la cause du
monophysisme se confondait avec celle de Znon et
que les chrtiens de Perse seraient plus fidles au roi
s'ils se rattachaient tous l'orthodoxie dyophysite. Il
disait vrai, et gagna aisment P:r:oz, d'ailleurs assez
peu sympathique aux chrtiens. On chassa donc les
grande autorit au point de vue canonique et dogmatique. Il est cit
dans le concile de Grgoire 1 (Syno. orient., p. 475) et par les juristes
lie de Nisibe et 'Abdiso' (op. cil., p. 6tt-6i5). Il n'y a pas de doute que,
comme l'insinue le prologue du concile d'Acace,les conclusions de celui
de Banjauma aient t adoptes d'abord Beit 'Adra, ensuite Sleucie
en .u!G, sauf pour les psrties attentatoires la primaut du catholicos.
t. Peut-tre celui qui, d'aprs Barhbraeus,se lint Karkade Bcit Slokh,
dans la maison de Yazd in (col. 7t). Le chroniqueur jacobite ne commet-
il pss ici un anachronisme, et le Yazd in dont il parle, ne serait-il pas
l'argentier de Chosrau Il, dfenseur zl du nestorianisme? Voir cl-
dessous, ch. vm, p. !i30.
!1. Syn. orient., p. !199-300.
3. MuE, p. 37.
4. Syn. orient, p. 53!1, 536.
r;. Syn. orient., p. 531-539. Cf. par exemple lettre Ill, p. :saa.
1.40 LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
monophysites qui durent s'exiler en terre romaine.
Il est possible qu'il y ait eu quelque sang vers;
mais il ne faudrait pas admettre les chiffres fantaisistes
de Barhbraeus. En terre aramenne la ville de Tagrit,
seule, resta acquise aux Philoxniens. Mais, comme le
dit Barhbraeus, le succs de fut moin-
dre en Armnie. En 491, le catholicos Babken, en-
tour des vques de l'Albanie et de l'Ibrie, condam-
nait V alarsapat le concile de Chalcdoine, le tome
de Lon et
1
Celui-ci vcut peut-tre assez
longtemps pour tre inform de cet anathme.
L'vque de Nisibe fit mieux que d'appeler le bras
sculier au secours du nestorianisme. II comprit
qu'une oppression passagre ne pourrait que temporai-
rement faire pencher la balance en sa faveur, si ses
adversaires s'assuraient le monopole de. la formation
thologique et profitaient seuls des ressources inpui-
sablesde la pense grecque. Et ce danger tait craindre.
Bien que les crivains postrieurs
2
connaissent une
cole de Sleucie o Acace lui-mme aurait profess
avant d'tre lev au catholicat, il n'y avait alors,
croyons-nous, dans l'glise de Perse, aucun centre
intellectuel capable de rivaliser avec ceux de l'empire
romain.
Les circonstances vinrent en aide Bart?auma. En
489, l'empe.reur Znon, poursuivant sa politique anti-
chalcdonienne, ordonna l'vque d'desse, Cyrus,
de purger sa ville piscopale du venin de l'hrsie
nestorienne. Cyrus ferma l'cole des Perses, expulsa
les lves et consacra dans le repaire mme du dyo-
physisme un sanctuaire la 8EoToxo
3
On peut avancer
1. HERZOG, Rea/encykl., t. Il, p.
!:!. MARE, p. 37. 'AMR, p. 20.
3. V. ci-dessus, p. 138, n. i.
LES DMLES DE BAR$AIDIA AVEC BABOWA'i. til
sans tmrit que Philoxne de Mabug ne fut pas
tranger cette excution qui put lui apparatre comme
une agrable et dcisive revanche.
Matres et disciples prirent alors le chemin de la
Perse sans espoir de retour. A la premire tape,
les arrta. Il fonda Nisibe une cole qui
devint rapidement clbre. Il y groupa les fugitifs et
quelques-uns des lecteurs " les plus en vue de l'-
glise orientale. Il prit soin de promulguer lui-mme
un rglement, calqu sans doute sur celui de l'an-
cienne cole des Perses, et dsigna comme grand-
matre de !"Universit le clbre docteur Narss,
surnomm le Lpreux par ses ennemis, mais dcor
par l'enthousiasme de ses partisans du titre de harpe
du Saint-Esprit
1
. Nous verrons plus loin combien
brillante fut la destine de l'cole de Nisibe
2
En la
crant, avait bien mrit de ses coreligion-
naires. La grande Universit fut, ds l'origine, comme
le boulevard du nestorianisme, dont elle devait assurer
le succs en Perse, et propager les doctrines jusque
dans l'empire romain, comme l'atteste l'historien mo-
nophysite Jean d'phse
3
2. - Les dmls de Barljlauma avec les catholicos
Baho"Wa et Acace.
Nous avons eu l'occasion de constater plusieurs fois
dj que la primaut du sige de Sleucie tait l'objet
de perptuelles contestations. Ds les temps reculs de
t. R. Litt. syr., p. Bibl. orient., t. III, p. 63-66. D'ailleurs
Narss avait quitt desse ds 457 et se trouvait en Perse depuis cette
poque.
!!. Ch. 11.
3. Vie de Simon de Beit Ariam, Land, de Bcatis Orientalibus, t. 11,
p. 77 ; trad. lat., p. at.
f42 LE TRIOMPHE LIE LA DOCTRINE l'STORIENNE.
Papa, plusieurs vques s'taient insurgs contre l'au-
torit du catholicos. Isaac et Dadiso'
1
eurent aussi
beaucoup souffrir de leurs comptiteurs. Il ne faut
donc pas s'tonner que Barfi!auma ait cru pouvoir lever
l'tendard de la rvolte contre Babowa. Celui-ci,
d'ailleurs, aurait, par son mauvais gouvernement, prt
le flanc la critique
2
Les mtropolitains les plus qua-
lifis, et, leur tte, les anciens lecteurs >> d'desse
se dclarrent contre le catholicos. Jean (de Beit Slokh),
Ma'na de Rewardasir, Abraham, Paul de Ledan et
quelques autres, reprsentant les parchies de Pars,
de Beit Garma, de Maisan et d'lam, se grouprent
autour de Barfi!auma de et tinrent un concile
Beit Lapat, la mtropole du Huzistan, en avril
484
3
Ce concile prsid par et Nana de
Prat publia un dcret schismatique et pronona la d-
chance du patriarche. La dclaration contenait, dit
Barfi!auma lui-mme \ cc des murmures, des blmes ..
et des tmoignages contre le bienheureux Babowa,
catholicos ''.
Celui-ci riposta en convoquant quelques vques et
en anathmatisant Barf;!auma et ses partisans. Les
prlats demeurs fidles au catholicos sont sans doute
ceux de la province patriarcale auxquels Barfi!auma
adresse sa premire lettre de rtractation : Mihrnarse
de Zab, Simon de l:lira, Mose de Prozsabur, lazd-
gerd de Beit Daray, Daniel de Karm
5
L'arrestation de Babowa et son supplice donnrent
pour un temps la victoire aux partisans de Barfi!auma
6
1. Cb. n, p. 91; ch. v, p. t!ll.
V. plus baut, cb. v, p. 130. Cf. :liAnE, p. 36.
3. Voir ci-dessus, p. 138, n. 3.
" Syn. orient., p.
ti. Syn. orient., p. 113t.
6. Il est fort difficile de savoir quelle part prit cette ex-
LES DMLS DE BAR!iiAUMA AVEC BABOWA. i43
Malheureusement pour l'vque de Nisibe, son pro-
tecteur Proz mourut, pendant l't de 484
4
, au cours
d'une expdition contre les Huns, et Balas, qui n'avait
pas eu le temps d'apprcier les services du prlat-
gouverneur, se montra sans doute moins soucieux de
soutenir ss ambitieuses revendications.
Les gens de Sleucie purent donc procder librement
l'lection d'un catholicos, et ils choisirent un parent
cution, et, nous l'avons dit plus haut, les chronographes ne s'accordent
pas sur r.e point. Il faut, hien entendu, mettre hors de cause Barh-
braeus, dont l'animosil pour Bal'ljauma se donne libre carrire. Mare
accuse le traducteur de la lettre, un certain Isae que Babowai aurait
expuls, d'avoir altr le sens de la missive, etl'annaliste ajoute que
protesta contre la traduction fautive d'Isae et essaya d'arra-
cher le cathollcos au supplice. Ainsi prsents, les faits sont sans doute
inexacts. Le bon vouloir de l'crivain nestorien pour l'intrpide cham-
pion de sa cause l'a transform en apologiste. (AIARE, p. 37.)
Le rcit qui nous parait mieux rendre compte des faits est celui qui
est rapport dans BEDIAN, Acta MM. et SS., Il, p. 63t et su iv. Ce frag-
ment anonyme, dont nous ne voudrions pas garantir la haute antiquit,
bien qu naturellement plus favorable Babowai, ne se prononce
qu'avec timidit contre Aprs avoir rapport que l'envoy
de Babowai fut arrt Nisibe et qu'on lui enleva sa lettre, l'anonyme
poursuit: Il yen a qui dise nt que Bal'ljauma ayant appris sonarrive, Je
fit venir, et le traita avec honneur et lui donna manger, puis il Je
questionna et celui-ci lui montra la lettre. la prit et J'envoya
Prllz, pour accuser Babowai. Ces JeUres furent lues devant le roi, qui
ordonna l'un de ses grands de les communiquer Babowa en lui
montrant seulement le sceau, et en lui demandant si ce sceau tait bien
lui, ou non .. Babowai ne put nier, mais il avoua que c'tait son
sceau. On le lit connaitre au roi qui fit lire la lettre devant tous les
chrtiens ... Les chrtiens se mirent en devoir de traduire la lettre mot
mol en persan : Dieu nous a livrs une royaut qui n'est pas chr-
tienne , car c'tait crit ainsi et non pas : une royaut impie Et
aprs qu'ils eurent prsent beaucoup d'excuses, le roi ne les admit pas,
mais il ordonna que l'on cruci6l Babowai par le doigt mme qui por-
tail l'anneau et qu'on le laisst jusqu' ce qu'il mourt. Ainsi lirentles
mages. Il fut inscrit dans le livre de vie parmi les catholicos martyrs,
car il avait lti crucifi cause de la haine des mages et des fils de soo
peuple. Ses ossements sont vnrs dans le pays de Tirhan (HOFfKANII,
Auszge, p. t89. Bibl. orient., t. III, p. M3).
Telle est peut-tre la vrit historique. On peut penser, en tout ens
que Bal'ljauma ne fut pas autrement afDig de ce tragique dnouement,
et qu'il crut loucher au but qu'il avait rv.
t. TAB.\RI, p. fiG et SUi V.
iU LE TRIOMPHE DE L\. DOCTRINE NESTORNNE.
du martyr Babowa, leur compatriote Acace
1
, ancien
lve d'Edesse et condisciple de Bari?auma. Celui-ci
ne dsarma pas, et l'on prtend qu'il dirigea contre
Acace des insinuations assez malveillantes dont le ca-
tholicos se dfendit d'une manire aussi premptoire
qu'originale
2
Confondu, se serait, d'aprs
les annalistes, excus et rapproch de son rival
3
Le patriarche, de son ct, fut enchant de pouvoir
traiter avec son redoutable collgue. Les tentatives de
rapprochement eurent lieu dans une localit du Nord;
Beit 'Adrai
4
(aot 485). Le colloque dura longtemps.
Enfin fit sa soumission. On dcida de con-
voquer pour l'anne suivante un synode gnral S-
leucie pour effacer jusqu'au souvenir d'un schisme si
prjudiciable aux intrts de la chrtient persane.
Bar:;;auma jugea-t-il l'humiliation suffisante, ou fut-
il vraiment retenu dans sa mtropole par des affaires
pressantes? Toujours est-il qu'il acccumula les pr-
textes les plus ingnieux, et sut s'viter de paratre au
.concile gnral. .
Dans sa lettre deuxime, il reprsente au catholicos
que, depuis deux ans, les provinces du Nord souffrent
i. 'ua, p. 20. )lARE, p. 38. BARHnnAErs, col. ii.
2. )(ARE, loc. cil.
3. Je crois plus simple d'admettre que jugeant la continua-
tion de la lutte impossible avec son ancien condisciple, entra dans la
voie des accommodements. Il se peut galement que l'vque de Nisibe
ait estim son attitude inopportune en prsence du danger que le mono-
physisme crait pour l'glise orientale, et qu'il ne voulut pas, en con-
tinuant le schisme, diviser les rorces de l'orthodoxie, dont Acace lui
semblait devoir tre le 6dle tenant. On peut penser aussi, et la lettre
troisime de Ba!"llauma (Syn. orient., p. 535) nous inclinerait vers ee
dernier sentiment, que le mtropolitain de Nisibe se sentait menac
dans sa ville mme par les monophysites, secrtement soudoys par By-
zance, et qu'il avait besoin, pour rester matre de la situation, de se
prnloir de l'appui du catho.licos.
4. Yillage d'Adiabne, au N.-E. de )lossoul (Syn. orient., p. 300, 308,
tJ.
BAR$AUMA ET ACACE. 14,5
de la famine. D'ailleurs les nomades au service des
Perses ont opr des razzias sur le territoire romain, et
les Romains ont menac d'envahir la Perse. Ils prten-
daient avoir t tratreusement attirs dans une em-
buscade.
conseille donc Acace de ne pas convo-
quer les vques cette anne-l, cause de la misre
gnrale, mais de remettre l'assemble son retour
de Constantinople, o le roi Balas l'envoyait sans
doute pour y annoncer son avnement
1
Acace, qui ces atermoiements ne prsageaient rien
de bon, crivit son condisciple pour le persuader
d'assister au concile, ainsi qu'ils en taient convenus2.
s'excuse de nouveau
3
Il reconnat qu'il a
autrefois excit les vques contre Babowar, mais il
ajoute qu'eux aussi le poussrent la rvolte, et lui
conseillrent bien des choses trangres la conduite
chrtienne et au droit canon. Il dsavoue le synode de
Beit Lapat et confesse que ce qui s'y fit fut contraire
au christianisme . Il l'anathmatise formellement :
Personne ne doit faire usage de ses canons. >> Il a par
deux fois dj adress au catholicos une rtractation de
l'anticoncile qui est oppos aux conciles des Pres. S'il
survit Acace, il sera soumis son successeur, car,
dit-il, mon exprience m'a appris que, << toutes les fois
que Nisibe n'obit pas au directeur qui est assis sur le
sige de la sainte glise de Sleucie, il y a en Orient
de graves dommages et de grandes .
Il termine en avouant Acace que sa propre situa-
tion Nisihe est prcaire. Si le catholicos n'crit une
1. Syn. orient., p. 113!-53'.
2.. Syn. orient., p. 536.
a. Syn. orient., p. 534-536.
4. Syn. orient.,. p. 5i8. v. ci-dessous, p. 11>1, n. 2.
LE CBRISTIANISIIE.
!)
i46 LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
lettre d'excommunication, B a r ~ a u m a ne pourra pas
rester davantage la tte de cette glise. Nisibe n'est
pas fidle au roi. Les premiers symptmes de rbel-
lion se sont manifests ds le temps o B a r ~ a u m a
luttait contre Acace. Le marzban local, jaloux du
crdit de l'vque, encourage la rbellion, parce qu'il
ne se rfnd pas compte du but rel que poursuivent les
rvolts. B a r ~ a u m a n'ose prendre sur lui de les d-
noncer Balati, de peur d'amener une perscution
gnrale contre les chrtiens. Que Acace adresse
donc une lettre d'excommunication aux Nisibites, et
qu'il menace les rfractaires de les signaler au roi
s'ils ne se soumettent leur pasteur lgitime.
Entre temps, B a r ~ a u m a a reu du monarque, peut-
tre aprs l'avoir provoqu lui-mme, un rescrit qui
l'oblige demeurer Nisibe pour le rglement des
frontires
4
Il remercie donc Acace d'avoir mis ordre
t. Lettre IV. Syn. orient., p. 536. Les deux autres lettres de B a r ~ a u m a
(lettres V et n, Syn. orient., p. :sas et 539, n. !i) ont d tre crites
avant le concile gnral. Dans la premire, il supplie Acace de rece-
voir composition Paul, fils de Qaqa, originaire de Ledan et v-
que de cette ville, et d'apaiser les difft'rends qui se sont levs entre
ce prlat et son peuple. La deuxime accompagnait un prsent que
Ma 'na, vque de Rewardasir, devait transmettre Acace de la part
de B a r ~ u m a : cent dariques, environ tO.OOO francs. B a r ~ a u m a dit
qu'aprs le synode de Beit 'Adrai, Ma'na entretint B a r ~ a u m a du zle
d'Acace pour l'orthodoxie et de l'activit qu'Il dployait pour la cause
de l'glise. En consquence, B a r ~ a u m a lui envoie sa cotisa lion. Il pro-
met mme que, si cette affaire que les ennemis veulent dcider contre
lui, se dcide en sa faveur, il envetra au catholicos une contribution
annuelle de cinquante dariques (lettre VI, Syn. orient., p. 539).
Si la date que nous assignons cette lettre est correcte, nous en in-
frerons <tue B a r ~ a u m a devait beaucoup redouter le concile gnral.
Sans doute un parti s'tait form, qui rclamait d'Acace la dl'position
du perturbateur et de ses principaux adhrents, dont Paul de Ledan.
B a r ~ a u m a , bien dtermin ne pas paraitre en personne au concile, devait
donc tout prix se mnager l'appui du catholicos.
Nous croyons entrevoir galement que &la'na, le mtropolitain de
newardaSir, s'entremit pour mnager la rconciliation de Barsauma et
d'Acace. Nul n'tait mieux qualifi que lui pOUl' rappl'Ocher ses deux
anciens coudlsciples d'desse. Peut-tre insista-t-il sur le danger que
ET ACACE.
aux troubles et dissensions excits en divers lieux,
mais l'avertit de ne pas compter sur sa prsence, non
plus que sur celle des vques de l'parchie de Beit
Arbay.
En raison de ces abstentions, l'assemble gnrale
prside par le catholicos ne runit que douze vques.
C'taient le mtropolitain de Beit Garma, l'vque de
Kaskar et les suffragants directs du patriarche, puis
quelques autres dont certains taient venus de fort
loin, comme Gabriel de Hrat.
On leur signale, disent les Actes
1
, des hommes qui,
vtus de l'habit des ermites, mais loin d'avoir les
vertus que suppose cet habit, circulent en divers lieux
et trompent les esprits simples . Ils blasphment
contre Notre-Seigneur et les aptres, << interdisent le
mariage, prohibent les lments que Dieu a crs pour
tre employs avec reconnaissance par ceux qui croient
et connaissent la vrit . << Du conseil et de l'avis de
tous, nous avons pens, selon le pacte que nous avons
fait ... dans l'Adiabne
2
, crire dans ce livre ce qui
regarde la stabilit de la foi et la correction des
murs.
Le premier canon concerne donc l'orthodoxie et
oppose aux monophysites le passage suivant: <<Notre
foi doit tre, en ce qui concerne l'Incarnation du Christ,
dans la confession des deux natures de la divinit et
de l'humanit. Nul de nous ne doit introduire le m-
lange, la commixtion ou la confusion entre les diver-
sits de ces deux natures; mais la divinit demeurant
et persistant dans ses proprits, et l'humanit dans
leur division faisait courir l'orthodoxie nestorienne dont il semble
avoir t un des champions les plus savants et les plus inOuents.
1. Syn. orient., p. 301.
:!. C'est--dire au colloque de Beit 'Ad rai; voir ci-dessus, p. H4.
HS LE TRIOMPI\f: DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
les siennes, nous runissons en une seule majest et
une seule adoration les divergences des natures,
cause de l'union parfaite et indissoluble de la divinit
avec l'humanit. Et si quelqu'un pense ou enseigne aux
autres que la passion ou le changement est inhrent
la divinit de Notre-Seigneur, et s'il ne conserve pas,
relativement l'unit de personne de Notre-Seigneur,
la confession d'un Dieu parfait et d'un homme parfait,
qu'il soit anathme .
Le deuxime canon
4
interdit aux moines de pntrer
dans.les villes et les bourgs o se trouvent dj ins-
talls des membres du clerg. Ils n'y doivent point
remplir des, fonctions rserves aux ecclsiastiques,
comme la clbration de la liturgie ou l'administration
des sacrements. Ils sont obligs de se confiner dans
leurs couvents ou dans le dsert, et de se soumettre
l'autorit des vques, des prtres et des visiteurs .
Le troisime canon
2
, renouvel d'un de ceux de l'anti-
concile de Beit Lapat, concerne le mariage des clercs.
Le clibat n'est permis qu'aux religieux cloitres, mais
qu'aucun vque ne fasse faire ce vu dans son
clerg, ou parmi les prtres de son village, et les r-
guliers soumis son autorit . Bien mieux, on don
nera aux diacres la facult de se marier s'ils ne le sont
pas encore, et, l'avenir, on n'ordonnera plus que des
diacres lgitimement maris et ayant des enfants. En-
fin il sera loisible aux prtres, comme tous les fid-
les, de convoler en secondes noces.
La verve railleuse de Barhbraeus
3
s'est exerce li-
brement aux dpens des Pres du concile de Sleucie.
Il va jusqu' dire que Acacedut construire des orpheli-
i. Syn. orient., p. a.
2. Syn. orient., p. 303.
3. Chron. eccl., II, col. 75.
BAR$AUMA ET ACACE. 149
nats pour les btards dont le nombre s'accrut grande-
ment, et il formule d'autres accusations que nous ne
pouvons transcrire. Bien entendu, Bar!?auma fut, sui-
vant le chroniqueur jacobite, l'auteur responsable de
cette dpravation gnrale, qui, fort heureusement
pour l'apologtique monophysite, concide avec les
conciles nestoriens de Beit et de Sleucie.
Chose curieuse! Simon de Beit Arsam, dans la
lettre que nous avons cite plus haut, ne fait aucune
allusion l'immoralit de non plus d'ail-
leurs qu' sa participation au meurtre de Babowa.
Comment penser que ce controversiste passionn se
serait refus user de tels arguments en faveur de sa
doctrine s'illes avait connus, ou qu'il n'aurait pas eu con-
naissance de faits aussi publics, tant presque contem-
porain de Bar!?auma, et ayant pass une bonne partie
de sa vie sur le territoire de l'Eglise nestorienne?
Il est certain toutefois que Bar!?auma se maria aprs
le concile de Beit ou qu'il fit dfinir le canon dont
nous parlons pour justifier le fait accompli. Mare
1
s'accorde avec Barhbraeus pour nous apprendre
que l'vque de Nisibe pousa la moniale Mamo. Et
il donne plusieurs raisons assez plausibles de cette
union.
Tout d'abord le roi Proz, tenant Bar!?auma en singu-
lire amiti, lui aurait demand, comme nouvelle
preuve de fidlit, de se marier comme tous les Per-
sans. Et Bar1;1auma n'avait pas os se refuser cet acte
de loyalisme. Le chronographe ajoute que Hormizd III,
fils de Bahram V, aurait exig du catholicos Ba-
bowa la mme marque d'attachement. Babowa
aurait accept de la main du roi une pouse remarqua-
t. MARE, p. 37, 39.
!50 LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
blement belle qu'il aurait renvoye secrtement ses
parents.
Mare
4
dit encore que Peroz ayant dcrt que les
femmes clibataires seraient prives de leurs biens,
et sollicitant Bar\'auma de se marier, le mtropo-
litain pour empcher que les biens de Mamo ne
passassent dans le trsor royal, au lieu d'entrer dans.
celui de l'glise, l'auait pouse lgalement; mais
d'un commun accord l ' e ~ e et la moniale se se-
raient abstenus d'user du mariage. Ce dernier trait
concorde assez peu avec ce que nous apprend, d'ail-
leurs, le mme historien : qu'une brouille passagre
aurait clat entre Bar\'auma et le clbre docteur Nar-
ss au sujet de la religieuse.
Un point est du moins assur : c'est que le chroni-
queur nestorien cherche justifier Bar\'auma, non d'a-
voir viol les lois du clibat ecclsiastique qui n'exis-
taient pas en Orient, mais d'avoir encouru une sorte
d'irrgularit en se mariant aprs la conscration pis-
copale.
Il n'est pas contestable n o ~ plus que le concile d'A-
cace, en renouvelant les prescriptions de celui de Beit
Lapat, se soit inspir d'ides leves. La coutume
ancienne, disent les Pres
2
, cause du relchement et
des dbauches, est blme et tourne en drision par
es gens du dehors >>, c'est--dire par les Persans. Ils
ont conscience de remplir un devoir sacr et de faire
un acte de courage : Nous tous, avec un esprit vigou-
reux, mprisant la vaine gloire ...
3
>>. Ils veulent rendre
la chrtient son bon renom en face des paens, et
supprimer les dsordres qui avaient dconsidr le
i. Loc. cit. Cf. BARRDR., col. 711.
!!. Syn. orient., p. 304 et n. 3.
3. Syn.,._wient., p. 30:;,
BAR$AUMA ET ACACE. tM
clerg aux yeux des mages, et des fidles eux-mmes.
Ces dispositions ne furent jamais rapportes, et si
bientt on revit sur le trne de Sleucie des prlats
clibataires, c'est parce qu'ils avaient embrass dans
leur la profession monastique.
Telle fut l'uvre lgislative du concile de Sleucie.
Russit-il rtablir l'union des vques sous l'autorit
du catholicos? Il semble bien que non, ou du moins que
l'accord intervenu entre Bar::;auma et Acace n'ait t
qu'phmre. Il parat que ce dernier, lors de son am-
bassade auprs de l'empereur romain, dut excommu-
nier Bar::;auma pour tre lui-mme admis la com-
munion par le patriarche de Constantinople. et qu'
son retour il apaisa les Nisibites qui lui demandaient
la dposition de leur vque en les sommant de lui pr-
senter un candidat prfrable, et surtout en leur faisant
savoir que Barf?auma, fort bien en cour, tait l'abri des
anathmes du catholicos
1
Tout cela est d'ailleurs loin
d'tre clair. Nous savons seulement, d'aprs les Actes
du synode de Baba
2
, que la lutte recommena entre le
t. Cette ambassade, laquelle fait allusion (lettre II, Syn.
orient., p. 533, et n. 6) doit sans doute se placer entre le concile de
Sleucie (.t86) et la mort de Balas (488). C'est par une de ces erreurs
chronologiques dont ils sont coutumiers que les annalistes disent que
Acace fut envoy Znon par le roi Prilz. (liA RE, p. 38 et 40. p. 21.
BARBBR., COl. 75.)
2. Syn. orient., p. 312.
On mit par l combien sincre tait la protestation de fidlit <rue
l'vque de Nisibe adressait au catholicos dans sa troisime lettre
(Syn. orient., p. 535) : Tant que je vivrai, et alors mme que Votre
Paternit aurait quitt le labeur de cette vie pour gagner le lieu de
repos o habitent toutes les mes de tous les Pres, si ma faiblesse se
trouve encore dans cette vie temporelle, je serai Je disciple et !P. servi-
teur de celui que la grce appellera vous succder. J'ai appris, en
effet, par les choses mmes qui me sont arrives que, tant que Nisibe
ne sera pas sous l'obissance et la direction de celui qui sige sur le trne
de la sainte glise de Sleucie-Ctsiphon, la rgion orientale prouvera
des dommages et de graves calamits.
t52 -LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
mtropolitain de Nisibe et le patriarche, durant.Ja qua-
trime anne de Qawad (491/2).
Barlj!auma mourut entre 492 et 495
1
Acace le suivit
de prs dans la tombe, aprs un rgne de onze ans
2
Les dissensions intestines et les conflits ambitieux des
princes de l'glise n'entravrent pas la propagation
du christianisme. La foi progressait chaque jour da-
vantage parmi les populations des hauts plateaux de
l'Iran propre, et parmi les Kurdes. Pethion
3
, la
gnration prcdente, avait entrepris dans ces monta-
gneuses rgions un apostolat fcond, couronn par le
martyre. L'histoire nous a conserv le nom et les
gestes d'un de ses mules, Saba, le docteur des
paens
4
>>.
Ce saint homme tait originaire de BeleSfar en Mdie
et issu d'une famille de l'aristocratie iranienne. Son
pre se nommait Sahrn, de la maison de Mihran; sa
mre s'appelait Radanos. Le premier tait fort zl
pour le mazdisme; Radanos, au contraire, tait favo-
rable aux chrtiens, et, quand elle eut donn le jour
son fils Gusniazdad, elle le confia une nourrice
chrtienne qui l'leva dans sa religion. Comme son
pre dut s'loigner pour occuper un poste de gouver-
neur dans le Beit Daray au pays des Cossens
5
, Gus-
niazdad en profita pour suivre l'enseignement cat-
chtique l'glise au lieu de frquenter des
1. En effet, en 496, le successeur de Ose, promulguait un
rglement pour l'cole de Nisibe: Gli statuti della Scuola i Nisibi, p. 9.
i. D'aprs AMR, p. ii. Il faudrait supposer une vacance d'un an
entre la mort d'Acace et l'avnement de Babai qui eut certainement
lieu en 497 d'aprs le mme chroniqueur. MARE (p. 40) attribue tort
quinze ans de rgne Acace.
3. v. ci-dessus, ch. v, p. 11!7.
4. BEDJAN, Il, p. 635-680. HOFFIIU!Ill, Auszge, p. 68-78.
11. Rgion intermdiaire entre la plaine chaldenne et les montagnes
de ijolwan.
SABA, LE DOCTEUR DES PAENS. 153
mages. Il demanda mme et obtint le baptme. Il y
reut le nom de Saba.
Son pre mourut. Alors un de ses oncles, nomm
Gusnaspir, le somma de remplir ses devoirs de chef de
famille et de se prsenter au jour du sacrifice, au lieu
et place de Sahrn. Saba refusa et fut mis en prison,
mais bientt dlivr. A ta mort de son oncle, il dis-
tribua ses biens aux pauvres et persuada sa mre
de se faire baptiser et de se retirer dans un clotre.
Inspir par un moine du nom de Keliliso'
1
, Saba com-
mence prcher le christianisme dans les environs de
la ville de l;lal, o il opre de nombreuses conversions.
L'vque Mika de Lasom, avec ses disciples Simon et
Sahrig, vient le trouver et l'ordonne prtre. Saba
et Sahrig (Bsahrig) baptisent la ville. toute entire et
le mobed lui-mme, et ils construisent une glise o ils
organisent le culte divin. Aprs plusieurs courses apos-
toliques entreprises dans les environs et couronnes
d'un semblable succs, Saba pntre avec ses compa-
gnons dans la montagne, parmi les Kurdes adorateurs
du soleil. Les missionnaires sont emprisonns et gards
vue sous une tente. Mais leur loquence appuye de
nombreux miracles amne la conversion de ces Kurdes
et de Sadducens
2
qui habitaient un village voisin.
Saba fonda en ce lieu sauvage une communaut chr-
tienne et y prposa un prtre du nom de Sub\lalemaran
qui, par la suite, construisit un monastre. Pour lui, il
redescendit dans la plaine, dtruisant les temples paens
sur son passage, et btissant des glises et des clotres.
Il mourut dans. une cellule qu'il s'tait construite
t. Peut-tre le mme qui donna son nom un monastre de Bagdad,
construit sous Timothe 1.
~ . ct. HorrM.lNN, Excur, II, p. 122. Cette secte chrtienne tait assez
voisine des Audiens. Elle semblerait, comme les Sadducens juirs, avoir
ni la rsurrection des corps et le jugement dernier.
9.
!5i LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
prs de Nahr Zawar, dans le Beit Aramay, aprs y
avoir sjourn trois ans et demi, en compagnie de B-
tiahrig. C'tait en l'anne 487
1
S 3. - La dcadence de l'glise de Perse , depuis
l'avnement de Baha jusqu' celui de Maraha
(497-540).
Baba, fils d'Hormizd, secrtaire du marzban de Beit
Aramay, Zabergan, fut lu patriarche en 497
2
Il tait
mari. Sa science tait fort mdiocre, s'il faut en croire
Barhbraeus, et cependant il semble avoir dirig l'-
glise de Perse avec sagesse et fermet.
Les conjonctures taient assez critiques. A la v-
rit, les pouvoirs publics taient plutt favorables aux
chrtiens. Balati, ami et admirateur des Romains, avait
inaugur en Armnie un rgime de tolrance reli-
gieuse, et l'imposait sans doute aux mages dans le
reste de ses tats
3
Qawad (488) suivit la mme poli-
tique. Toutefois son adhsion aux doctrines de Mazdak
dut causer aux chrtiens bien des
Ce Mazdak
3
prchait la communaut des biens et des
femmes. Le roi, trouvant dans le doctrinaire un pr-
cieux auxiliaire pour ruiner l'influence de la noblesse
en diminuant ses richesses et en rendant impossible
la constitution d'arbres gnalogiques incontestables,
t. 799 des Grecs, i!Gt des Perses.
2. D'aprs 'Alla, p. :11, et lie de Damas, Bibl. orient., III, "311, qui con-
corde avec les Actes du concile. Cf. MARE, p . .W, et BuutBR.IEUs, col. 796.
Le concile ayant eu lieu en novembre 497 (Syn. orient., p. 3tO), il faut
admettre que l'lection de Baba doit se placer quelque temps aupara-
vant, peut-tre en octobre.
3. TAB.IRI, p. 13,, n.t et 5.
, 4. Les chrtiens opposrent sans doute de leur cOt une nergique
rsistance aux entreprises de Mazdak et du monarque, dont l'influence
se fit sentir plus particulirement dans l'Iraq. l'histoire ne nous a
conserv le souvenir d'aucune perscution.
5. Voir l'tude de M. :soeldeke dans TADARI, p.
LA DCADENCE DE L'GLISE OE PERSE. t;5
le soutint avec la plus grande nergie. Mais, l'instiga-
tion du grand mobed et des dignitaires du royaume,
Qawad lui-mme frit dpos en 496.
Zamasp, fils de Proz, qui remplaa son frre Qa-
wad, se montra, lui aussi, bien dispos en faveur du
christianisme
1
, et il adressa Bab a un dit " pour que
les vques soumis son autorit se runissent prs
de lui et tablissent une rforme relativement au ma-
riage lgitime et la procration des enfants pour tous
les clercs en tous pays 2 ,,
Ce rescrit trahit les proccupations du monarque.
L'orthodoxie mazdenne comptait s'appuyer sur les
chrtiens pour combattre les hardis novateurs, dont
la propagande tait des plus dangereuses. Aussi, au
mois de Te sri II de la 2" anne de Zamasp
3
, les vques
s'assemblrent auprs du catholicos et s'empressrent
de renouveler les canons du concile de Beit Lapat,
tenu en la 27" anne de Peroz , et le trait commenc
Beit 'Adrai en la 2 anne de Balas, du temps de
Mar Acace
5
, et achev dans le Beit Aramaye
6
, au
sujet du mariage des clercs. Et nous tous vques,
disent les membres de l'assemble, nous avons fait
les rformes qui conviennent notre peuple ... Nous
avons permis que, depuis le patriarche jusqu'au der-
nier de la hirarchie, chacun puisse contracter un ma-
riage chaste avec une seule femme, pour engendrer
des enfants, et en user
7
>>
Les Pres ne se bornrent pas .formuler ces pres-
t. MARE, p. 41, et 'A:wn, p. 21, rapportent que ce prince eut avec Baha
une discussion amicale au sujet de la vnration des reliques.
2. Syn. orient., p. 312.
3. Novembre 497.
4. Avril 484.
;;. Aot 485.
6. Fvrier 486.
7. Syn. orient., p. 312.
!56 LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
criptions canoniques. Un autre danger menaait l'-
glise persane. Depuis la 4" anne de Qawad (ou sa
septime)
1
, B a r ~ t ~ a u m a s'tait, comme nous l'avons in-
diqu plus haut, insurg de nouveau contre l'autorit
d'Aca'ce. Il avait sans doute ni encore une fois la
primaut du sige de Sleucie, et, si nous comprenons
bien le texte du synode, refus de prendre part au
concile gnral qui, suivant le droit canonique, devait
se tenir Sleucie tous les deux ans.
Des anathmes avaient t changs entre les deux
partis, jusqu'en la deuxime anne de Zamasp (497).
Mais enfin Ose de Nisibe et Baba s'taient rcon-
cilis, non sans que le catholicos eftt consenti d'impor-
tantes concessions.
Ainsi il demeura dcid que le synode gnral ne
serait plus convoqu que tous les quatre ans, sauf, bien
entendu, le cas de ncessit urgente. De plus, certai-
nes lections piscopales qui avaient eu lieu pendant
la querelle furent valides par le patriarche. Tout
vque qui, pendant le temps de la dispute, c'est--
dire depuis la septime anne de Qawad jusqu' pr-
sent, a t choisi lgitimement par l'lection du clerg
et de toute la ville sera reu par nous dans la cha-
rit, l'honneur et le rang de son ministre piscopal.
Mais celui qui, pendant le schisme et la discorde,
sans l'lection du clerg et du peuple des fidles de sa
ville, a vol et ravi le titre d'vque, nous le rejetons,
quel qu'il soit, selon le prcepte des canons ecclsias-
tiques et nous nous loignons de toute participation
avec lui 2.
Si nous pouvions trouver une explication satis-
faisante de la multiplicit des listes de souscription
t. Voir, propos de celle divergence, Syn. orient., p. au, n. i.
2. Syn. orient., p. 315.
LA DCADENCE DE L'GLISE DE PERSE. t57
ce synode et de leurs divergences
1
, nous saurions
qui pouvait s'appliquer cette condamnation. Nous ne
connaissons d'une manire certaine qu'un seul de ces
excommunis. C'est un certain Yazdad de Rewar-
dasir qui l'on accorde un dlai d'un an pour v-
nrer et saluer notre pre Mar Baba catholicos et
" adhrer dans une charit sincre et un consente-
ment parfait tout ce que nous avons mis dans cet
crit
2
.
De leur ct, les monophysites, momentanment
dcourags par l'offensive vigoureuse de
relevaient la tte. Non seulement Tagrit, mais dans
les autres provinces persanes, leurs partisans pr-
chaient les doctrines de Philoxne avec un renouveau
d'ardeur
3
Papa, vque(?) de Beit Lapat, l'ancien
lve de l'cole d'desse, tait sans doute au nombre
de ces propagandistes. Le synode de Baba menace,
en effet, de le dposer, si, dans le dlai d'un an, il
n'adhre cc la foi orthodoxe de l'glise
4
.
Le catholicos, conseill par Mari de
un corn-
1. Voir Syn. orient., p. 310, 3H, 31;;, et la note de CHABOT, p. l.
'i. Syn. orient., p. 3U.
3. L'avnement d'Anastase en <l91 avait ranim les esprances du
parti monophysite dont il tait le protecteur dclar. De hardis mission-
naires cherchaient faire pntrer en Perse la doctrine officiellement
accepte par le monde byzantin tout entier. Ils durent sans doute at-
tendre la mort de pour oprer dcouvert. Acace tait un
moins redoutable adversaire, et l'on racontait peut-tre dj que le
catholicos, au cours d'une ambassade en Occident, avait anathmatise
Nestorius et l'vque de Nisibe.
4. Syn. orient., p. 314 et la n. 2.
s. Voici les paroles de Simon de Beit Arsam dans sa lettre sur le
Nestorianisme laquelle nous avons fait dj plusieurs emprunts:
Nous anathmatisons la foi et les canons, et tout ce qui provient d'A-
cace, de de Narss, de leurs compagnons hrtiques, et tous
ceux qui pensent ou qui penseront comme eux. Nous anathmatisons
encore Mari de Tal)al, le maitre du catholicos Babai, qui de son temps
a t le docteur de l'hrsie de Paul de Samosate et de Diodore (c'est--
dire du Nestorianisme) en Beit Aramay. C'est de lui qu'a reu l'ensei-
158 LE TIUOMPHE DE LA DOCTRI:SE NESTORIENNE.
patriote de Philoxne, rsista nergiquement. Il rus-
sit s'assurer, pour cette campagne, l'appui du bras
sculier. D'ailleurs la guerre qui clata bientt entre
les Perses et les Romains ne dut pas faciliter l'apos-
tolat des coreligionnaires d'Anastase. Le Roi des Rois
les traqua sans merci, et Simon de Beit Ar8am
1
, le
plus intrpide de leurs chefs, dut chercher un refuge
dans l'empire byzantin.
En 498, l'usurpateur Zamasp avait cd la place
gnement Baba le catholicos, fils d'Hormizd, qui tait scribe de Zaber-
gan, marzban de Beit Aramay (Bibl. orient., t. I, p. 358).
1. R. Duvu, Litt. syriaque, p. 148-t5:!, t6! et 360. Le plus connu des
Aptres du monophysisme en Perse est Simon de Beit ArSam, le
controversiste persan D'aprs son historien, Jean d'phse, Simon
tait Persan. Il parcourut bien des fois les provinces orientales pour
contrebalancer l'inDuence des Nestoriens. Il exera d'abord son mi-
nistre lJira, o il convertit des nobles et btit des glises. Puis il
se rendit la Porte du Royaume. Il gagna sa doctrine des hrti-
ques, et des mages. Le roi somma ceux-ci de renier le christianisme.
Ils refusrent et furent dcapits dix jours aprs leur baptme.
Alarms des sucees de Simon, les 'ques nestoriens persuadent au
roi que leurs rivaux trahissent la Perse au profit de Rome. Le roi or-
donne de perscuter et de traquer partout les monophysites.
Averti par Simon, l'empereur Anastase envole des ambassadeurs,
car on tait en temps de paix. Ces envoys obtiennent une lettre du
roi qui interdit les disputes entre chrtiens. Cette interdiction n'-
tait sans doute pas absolue, puisque Simon, controversiste infatiga-
ble, se multipliait sur tous les points du territoire, partout o il y
avait une discussion religieuse. A la suite d'un succs clatant rem-
port par Simon sur plusieurs vques nestoriens et sur le catho-
licos Baba, il fut consacr vque et mtropolitain de B e i ~ Arsam, un
bourg voisin de Sleucie.
A cette sorte de dfi, les Nestoriens rpondirent en renouvelant leurs
dnonciations. Le roi de Perse fit saisir tous les vques et suprieurs
de monastres monophysites. Les suspects furent emprisonns Ni-
sibe. Simon lui-mme y fut dtenu pendant sept ans, et ne sortit de
prison que grce l'intervention du mi de Kus (thiopie) qui dputa
une ambassade auprs de la Porte (c'est--dire moyennant l'inter-
vention des lgats thiopiens qui se trouvaient en Perse ce moment). A
la mort de Qawad, Simon retourna en Occident, pour attirer l'attention
de l'impratrice Thodora sur les affaires d'Arabie, de Perse et d'thio-
pie, et mourut Constantinople vers i;:!l!j3. JEAN n'PHSE, De beatis
orientalibus dans L.,xn, Anecdota syriaca, t. II, p. i6-88. Cf. B. H.,
col. 85.
LA DCADENCE DE L'GLISE DE PERSE. Hi9
son prdcesseur Qawad '. Rendu plus prudent par
l'adversit, celui-ci se rconcilia avec la noblesse et le
clerg mazden, et, sans doute pour faire oublier le
pass et reconqurir dfinitivement l'affection de ses
peuples, il lana ses troupes contre l'empire byzantin.
Cette guerre dont le nous a conserv
les dtails commena le 22 aot 501. Les Perses et leurs
auxiliaires arabes ruinrent la Msopotamie romaine.
Thodosiopolis (Res'ana), puis Amid tombrent entre
leurs mains. Des razzias formidables dpeuplrent les
contres riveraines du Tigre et de l'Euphrate. Enfin
Anastase conclut la paix avec Qawad en l'anne 506.
Le roi de Perse, rappel dans ses domaines par la
guerre contre les Huns Hephtalites, accepta une trve
de sept ans qui dura jusqu'au milieu du rgne de
Justin 1.
Baba mourut vers ce temps, aprs un rgne de
cinq annes
3
Sa mort inaugura une priode d'anarchie.
Sila, archidiacre de Baba et qui avait souscrit sa
place au synode patriarcal
1
, succda au catholicos
5
t. TABARI, p. t.:i, n. Il.
!!. Chronique de Joau le Stylite, d. Martin; cf. Duvu, Litt. syr.,
p.t87t89. TJ.BUI
1
p. H6, n.t.
3. MARS, p. 4t. 'AIIR, p. l'i. BARIIi:nnAF.US, col. 81,
.t. Syn. orient., p. 315.
Il. Nous ne saurions dcider si la vacance du sige dura un temps
notable. Toutefois, si nous admettions que J'lection ne se Ot pas imm-
diatement, nous obtiendrions une chronologie plus satisfaisante. Une
date est certaine : celle de l'lection de )lara ba, r;w; celle de la mort
de Baba l'est galement : 50!!, ou, la rigueur, commencement de
503. Comme le rgne de Paul, prdcesseur de )Jaraba, a dur environ un
an, Je schisme de Narss et lise environ quinze ans (Syn. orient.,
p. 33-l), et Je rgne de Bila environ dixhuit ans, nous arriverions une
suite assez acceptable : Sila ll035!ilt{:;, comptitions :aajHi39, Paul
:139-S<lO. Il conviendrait donc d'admettre un intervalle entre la mort de
Baba et celle de l!iia. Il n'a rien d'invraisemblable et peut s'expliquer
convenablement par l'absence de Qawad, occup guerroyer contre
les Romains. D'ailleurs, 'Amr, dont la chronologie est dsormais assez
sre, place l'lection de SUa dans la dix-huiticme anne de Qawad,
anne 816 des Grecs (501>) (p. fl). cr. Syn. orient., p. 321, n. t.
-
i60 LE TRIOl\IPIIE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
Il tait, nous disent les chroniqueurs
1
, fort instruit,
mais de murs peu recommandables, et assez enclin
au npotisme. Mare prtend qu'il alina le mobilier de
l'glise en faveur de son fils. Un prtre, du nom de
Mari, peut-tre le Mari de TaQ.al dont se plaignait Si-
mon de Beit Arsam, s'insurgea contre l'autorit de
ce mauvais vque. Mais Buzaq
2
, vque de Hormiz-
dardasir1 qui jouissait d'un grand crdit auprs de
Qawad, prit le parti du catholicos, qui triompha ainsi
de ses ennemis. Sila vcut donc en parfaite intelligence
avec le Roi des Rois. En bon pre de famille, il dsi-
gna comme successeur son gendre, le mdecin lise.
Les vques jugrent le candidat trop peu recom-
mandable
3
Jacques, mtropolitain d'lam; Tama,
mtropolitain de Maisan; Kusa, mtropolitain de Ni-
sibe; Paul, mtropolitain d'Arbel; Jean, vque de
Karka de Maisan; Samuel, vque de Kaskar; Narss,
vque de l;lira; Josu, vque de Ziib, et David d'An-
bar, lirent Narss (l'vque de l;lira
4
?) et le consa-
crrent Sleucie. Buzaq demanda au roi les
autorisations ncessaires
5
Les partisans d'lise
levrent des protestations contre l'intronisation de
t. )lARE, p. -\1. 'AMR, p. :!2. 8.\RHBRAErS, COl. 8{.
:!. Il faut lire dans le texte arabe (MARE, p. 37, 1. ts et 'AMR, p. 37,
1. t3) 0 jY. et non 0 jY.
3, MARE, p. U. 'AMR, p. ti. BARHBRAErS, COl. 81.
" D'aprs 'AMn (p. :!3), c'tait un scribe instruit du Huzistan.
5. Il avait donc chang de parti. D'aprs un renseignement fourni
par'AKR (p. ti), un certain nombre de prlats ne se prononcrent ni
pour Narss, ni pour lise. Il cite parmi eux Jacques, mtropolitain de
Gondef;abur, Samuel de Kaskar (Syn. orient., p. 3it), et Paul le futnr
catholicos qui aurait dj succd son maitre Buzaq, en qualit d'
vque d'Hormizdardasir. D'autre part, MARE (p. 43) fait de Buzaq le patron
le Narss. Il est possible de concilier les deux informations, en disant
que, tout d'abord, Buzaq, Paul et Jacques tinrent le parti de Narss. Us
s'en sparrent par la suite, mais sans se rallier lise. 'AMR (loc. cil.)
sait galement qu'entre la mort de Sila et l'lection de Narss, dix mois
entiers s'coulrent.
~ ..... - "\
LA DCADENCE DE L'GLISE DE PERSE. t6t
Narss, et sacrrent Ctsiphon le gendre de Sila,
grce l'appui de personnages influents la cour, et
sans attendre l'issue du procs canonique intent
son concurrent.
Les deux rivaux ordonnrent chacun des vques
pour toutes les villes de leur ressort, et la confusion
devint inexprimable. lise surtout, qui peut-tre
avait les titres les plus contestables, parcourait le
pays en tous sens pour se recruter des partisans.
Narss mourut le premier
1
lise crut que ses
ambitions allaient se raliser, et que, dlivr fort
opportunment de son comptiteur, il rgirait seul,
sans contestation, toute l'glise orientale.
Mais le scandale de ses murs tait trop notoire,
et il avait mcontent trop d'vques par ses procds
arbitraires. Les prlats persans s'entendirent pour le
dposer et rayer son nom des diptyques , ainsi que
celui de Narss
2
, et ils choisirent Paul, dont les
Nestoriens
3
font l'archidiacre et le successeur de Bu-
zaq sur le sige de Hormizdardasir, et que Barhbraeus
appelle archidiacre de Sleucie. Chosrau 1 Anosarwan
lui tmoignait de la faveur
4
, parce qu'en 533/4 il
s'tait rencontr point pour ravitailler d'eau l'arme
royale qui souffrait de la soif.
Le nouvel lu dploya un zle mritoire. Mais il
tait trs avanc en ge, et mourut bientt, aprs un
an, ou peut-tre seulement deux mois de rgne, sans
avoir pu achever l'uvre rparatrice rendue indispen-
t. MARE, p. o\3. D'aprs 'A111n, Narss mourut hl ans aprs son lotro
nisation, soit vers 535.
i. Dans sa quatrime lettre, Maraba a conserv le sens et peut-tre
le texte mme de la dcision des vques et des considrants qui la
prcdaient. (Syn. orient., p. MO ct 3tt ; cit plus loin, ch. vm, p. i70.)
3. MAllE, p. o\3. 'AKR, p. !13. Cf. BARUBRAEIJS, Col. 89.
4. Cc prince avait succd son pre Qawad en tl3t. Sur l'attitude
de Cbosrau 1 envers les chrtiens, cf. TA BARI, p. t60, n. 3.
162 LE TRIOMPHE DE LA DOCTRINE NESTORIENNE.
sable par les dportements de Narss et d'lise
1
Ce
soin incomba au successeur de Paul, Maraba 1. Ce
prlat, l'un des plus distingus parmi les patriarches
orientaux, ne fut pas infrieur sa tche difficile.
t. Il mourut, d'aprs 'AHR (p. 23), en la sixime anne de Chosrau,
an des Grecs Ma (537). Cette date ne concorde pas avec la chronolo-
gie que nous avons adopte plus haut. Elle nous parait fausse. Pour
l'accepter, en ell'et, il faudrait admettre gratuitement une vacance de
trois ans entre la mort de Paul et l'lection de ~ l a r a ba. (Cf. IliA RE, p. -h'l.
BAnutunuus, col. 89.)
CHAPITRE VII
LA RFORME DU Vl
0
SICLE
f.- Le rgne de :Maraha. Chosrau I et les chrtiens
(540-552). .
Maraba' tait originaire de la contre qui s'tend sur
la rive droite du Tigre en face de IJale, chef-lieu du
district de Radan
2
Bien que Saba et vers 480
vanglios ce pays
3
, beaucoup d'habitants tient de-
meurs fidles la religion officielle. Le futur patriar-
che naquit dans une famille mazdiste, et parat avoi1
t fort attach dans sa jeunesse la doctrine de Zoroas-
tre. Il entra dans la carrire administrative et fut
nomm, dit le rdacteur anonyme de sa Vie, arzbed
de son bourg, puis assesseur du secrtaire du hamma-
gerd de Beit Aramaye.
Rien ne semblait prsager sa conversion au christia-
nisme, lorsqu'il fit, dans des circonstances assez im-
prvues, la rencontre d'un tudiant de Nisibe:; qui
remplissait dans le district les fonctions de catchiste,
Joseph surnomm Mose. Comme il se disposait tra-
i. Les sources de la Vic de Maraba sont: Histoire deMarIa-
balaha, etc.; Vie de !t1araba, p. 20627'; "Avn, p. 23; }fAnE, p. 4346;
BARBBIUEllS, Chron. eccl., Il, col. 89-96. Cr. ASSElUNI, Bibl. orient., III,
p. 75-80; DunL, Littrature syriaque, p. llt8, 440; Synodicon orientale,
p. 3t8-35t et 540-562.
Il. Vie, p. 2ft.
3. HOFFJIUIIII, p. 7t, n. 634, et ci-dessus, p. t52.
4. Vie, p. i!tO et su iv.; cr. Syn. orient., p. 329, n. 2.
5. !"" Vie, p.!ut.
t6i- LA RFORME DU YI SICLE.
verser le Tigre en bac
1
, Maraba y trouve install le
catchiste, revtu de l'habit monastique. Ne pouvant
supporter un tel voisinage, le scribe paen expulse son
malchanceux compagnon et fait dposer son bagage
sur la rive. Mais une tempte s'lve, qui s'apaise seu-
lement lorsque l'tudiant a t enfin admis dans le bac.
Maraba supplie alors Joseph de lui pardonner. Celui-ci
lui rpond qu'un disciple de Jsus-Christ ne doit pas
garder rancune. Frapp de cette mansutude, Maraba
poursuit l'entretien et dcide de se convertir. De re-
tour Ctsiphon, il se fait instruire-
2
, renonce l'ad-
ministration, malgr les instances de ses suprieurs
hirarchiques, et reoit le baptme
3
L'cole de Nisibe le compta bientt au nombre de
ses disciples; il y manifesta les qualits d'un esprit
exceptionnel. Il s'attacha tout spcialement un des
professeurs de 1 'cole, Ma 'na, qui devint plus tard v-
que d'Arzun
4
Quand ce prlat prit possession de son
diocse, Maraba le suivit, peut-tre en qualit de syn-
celle, et convertit beaucoup de paens et d'hrtiques
5
Puis il retourna Nisibe pour complter ses tudes.
Mais son ambition n'tait pas satisfaite. Beaucoup
d'coliers se rendaient alors en terre romaine pour y
perfectionner leur instruction thologique. Depuis l'a-
vnement de Justin, la dfaveur impriale tait rserve
aux monophysites, et les chrtiens persans circulaient
t. p. 23.
:!. A l'glise de pltre,
3. Au bourg d"Akda,d'apre sa Vie, p. :!tt; d'aprs MAn&, p. .
-l. La mention de ce personnage, inconnu d'ailleurs, et l'pithte de
...., qui accompagne son nom (Vie, p. 217) semblent prouver que
l'auteur de l'Histoire de Maraba tait rellement, comme il le prtend,
u '' disciple du catltolicoa.
a, En vertu de sa charge de ou catchiste. Ces fonctions
taient souvent confies temporairement dea tudiants de Nisibe, qui
o:ompltaient ainsi, par des exercices pratiques, l.eur instruction thori-
que. cr. J.-B. CII4BOT, L'cole de. Nisibe, p. 30 du tirage part.
LE RG:'IE DE l\IARABA. t65
plus librement sur le territoire de l'empereur ortho-
doxe. Maraba y fut attir, nous dit son biographe
4
, par
le dsir de visiter les Saints Lieux, et aussi par celui de
disputer avec Sergius, cc un arien fortement teint de
paganisme, pour le convertir la vraie
Il rencontra desse un Syrien nomm Thomas,
probablement un peu moins g que lui. Les deux tu-
diants se lirent d'une troite amiti
3
, et Thomas ap-
prit le grec son compagnon. Puis ils entreprirent de
concert la visite de la Palestine <lt se rendirent ensuite
en gypte. Maraba y aurait interprt les saintes
critures Alexandrie, en langue grecque
Il ne manqua pas de faire un pieux plerinage dans
ces solitudes fameuses o des milliers de moines s'exer-
aient la vie asctique, suivant les vnrables tra-
ditions des cc Pres du dsert . Puis il gagna Corin-
the et Athnes, et enfin Constantinople
5
Son sjour
dans la ville impriale est attest par l'crivain by-
zantin Cosmas Indicopleustes
6
Voici comme il s'ex-
t. JI ie, p. !t7-8.
!. ce sergius est le clbre mdecin-philosophe, originaire de Res-
aina, le plus savant personnage de son temps, dont l'influence sur la
culture littraire syriaque fut considrable (R. Dvvu, Litt. syr., p. :U9) .
.tgalement vers dans la connaissance du grec et dans celle de l'ara-
men, il traduisit un grand nombre de traits de thologie, de philoso-
phie, d'astronomie et de mdecine. Thodore, plus tard vque de
er-Rud, fut un de ses disciples de prdilecUon.
3. Vie, p. !18.
-' Cela signifie sans doute qu'il suivit les cours de la clbre Univer-
sit, o Sergius lui-mme avait fait ses premires etudes. Il peut aussi
avoir compos Alexandrie cette traduction de l'criture dont parle
'Abdi5o< dans son Catalogue. Bibl. orient., Ill, p. 75. BARDBR., Chron.
eccl., Il, col. 89.
5. Vie, p. !19-!iJIO.
6. cosmas composa, vers 547, son ouvrage sur la Topographie chr-
tienne Mais ses voyages avaient t effectus entre 5to et 5il. La rela-
tion qu'il en donne nous fournit des renseignements prcieux sur l'ex-
tension de l'glise de Perse cette poque (P. G., LXXXVIII, col. t69). Il a
visit dans l'ile de Taprobane (Ceylan) une chrtient; il ignore s'il n'y
en a pas au del. A sur la cOte du Poivre, et Calllana (Quilen), il a
i66 LA RFOmiE DU VI SICLE.
prime dans sa Topographie chrtienne: <<Je les ai reus
[ces renseignements] de l'homme trs divin et du grand
docteur Patrikios
1
Celui-ci, suivant l'exemple d'A-
braham, tait venu de chez les Chaldens avec Thomas
d'desse, alors tudiant en thologie, qui l'accompa
gnait partout et qui maintenant, par la volont de Dieu,
est mort Byzance. Il m'a fait part de sa pit et de
sa science trs vridique, et c'est lui qui maintenant,
par la grce de Dieu, a t lev au trne sublime et
archipiscopal de toute la Perse, ayant t institu l
mme vque catholicos
2
Le voyage de Maraba Constantinople doit se
placer entre les annes 525 et 533. A cette poque,
d'autres docteurs orientaux se trouvaient dans la ville
impriale. Le plus connu est Paul le Perse
3
Un
travail rcent de M. Mercati a montr, croyons-nous,
que ce personnage n'est autre que Paul de
mtropolitain de Nisibe sous le catholicos Joseph.
Nous lui attribuerions volontiers et la traduction de
aussi rencontr des chrtiens. Dans cette dernire ville, il y a mme
un vque consacr en Perse. JI en dit autant des clercs de l'ile
Socotora. Voici ce texte trs important : v xa.l in!axon:o
ianv .no llspalllo JC.SipoTovoup.evo O!J.olw xa.l v 'tlJ vijaq> t'fi xa./.ou-
!LV'll xa.T<X to a.'to 'lvlltxov nl.a.yo, lv6a. xa.l ot na.pot-
'E).l'I)Vtatl ).a.).oilat .. xa.l xl'l)ptxo! alaw x 1IEpa!llo X,<tpc.-ro-
vou!J.EVOt xa.i 'll!J.'IIOIJ.EVOt V 'tO a.v't66t, xa.l Xptana.vwv .....
op.o!w ll xa.l nl Btixtpot xa.l Ovwot xa.l llpaa.t, xa.l o(not 'hlloT,
xa.l Hepaa.pp.Evtllt xa.l Mijllot xa.l 'E).a.!J.(ta:t, xa.l n<iCTO TY,j J(Wptf llap-
alllo, xa:l XK'I)ata.t xa.l Xptana.vol ).a.ol xa.l !J.tip-
't'Upe 'IIO).Ot, xa:l i}a\JX,a.ata:t
1. Le grec lla.Tp!xto est l'quivalent grec du syriaque Mar Aba. On
pourrait en conclure que le vritable nom du patriarche tait Aba =
pre, mals ce point n'est pas sr.
2. P. G., LXXXVIH, c. 73.
3. Per la vila e gli scritti di Paolo il Persiano, Rome, t899, p. 3, n. 2;
p. t5, p. 16, n. 2. Cf. KmN, Theodor von Mop3uestia und Junilius A{ri-
canus, Jl 263, 26-t, 337-343; Duv.u, Litt. syr., p. 256-7; WRIGHT, Syriac
Lit., P tti-3.
LE RGNE DE MARABA. i67
la logique ddie Chosrau 1 et publiP- par Land
1
,
et les lnstituta regularia divinae legis
2
, et cette
controverse avec les Manichens , laquelle font sans
doute allusion l'extrait cit par Assemani
3
et la no-
tice du Catalogue d"Abdisoq. La dispute entre Paul
le Perse et Photin le Manichen eut lieu par ordre
des empereurs Justin et Justinien,
5
, par con-
squent entre le 1 avril et le 1 aot 527 sous la
prsidence du prfet Thodore Teganistes
6
Paul le
Perse tait donc ce moment dans les bonnes grces
de la cour, et c'est pour cette raison qu'il put donner des
leons d'exgse quelques hauts personnages, parmi
lesquels un quaestor sacri palatii, l'africain Junilius.
Maraba n'atteignit pas sans doute une telle re:..
nomme, bien qu'il ait paru, lui aussi, la cour de l'em-
pereur. Son sjour Constantinople semble mme
avoir t assez bref. Il ne dura qu'une anne, suivant
son biographe anonyme
7
Mare
8
nous apprend que
Maraba et son disciple furent invits anathmatiser
Thodore de Mopsueste et les docteurs nestoriens. Sur
leur refus, ils faillirent tre mis mort. Ils parvinrent
toutefois s'chapper, et s'empressrent de mettre les
frontires de la Perse entre eux et leurs inquisiteurs.
Cette tradition nous semble de bon aloi. A la suite
du colloque de Constantinople qui eut lieu en 531
9
,
1. A necdota syriaca, IV, p. t 30.
!1. Ed. KIBN, lmtituta regularia divinae legis, dans Theodor von J,Jo-
pauestia und Juniliua A{ricanus als Exegeten, p. 465-528.
3. Bibl. orient., 111, p. 632, d'aprs la Declaratio o{{1ciorum d'Abulba-
rakar.
4. Bibl. orient., DI, p. 88.
5. MERCATI, Op. laud., p. t7,
6. Op. laud., p. !6.
7. BEDJAN, Vie de Maraba, p. 221-112.
8. P. M.
!J. DIEUHP, Die Origenistischen Streitigkeiten im 6. Jahrhundert,
)Joster, 1899; M.t.Nsi, Coll. conciliorum, VIII, p. 817 et sui v. De plus, les
.. _.,.,.
f.68
LA RFORME DU VI SICLE.
Justinien favorisa quelque temps les monophysites
1
En 535 l'un d'entre eux, Anthime, fut nomn;t patriarche
de Constantinople. Svre d'Antioche, rappel d'exil,
fit une entre triomphale dans la capitale de l'empire.
On peut penser que le parti vainqueur se livra des
reprsailles.
S'ils furent obligs de tolrer les moines dyophysites
de la capitale, les Svriens taient tenus moins de
mnagements l'gard des trangers. Il est assez
vraisemblable que Paul le Perse, Maraba, Thomas,
et les autres Syriens qui rsidaient Constantinople
durent opter entre le bannissement et le dsaveu des
doctrines de Thodore. Ajouterons-nous que, de re-
tour dans le patriarcat d'Antioche, ils avertirent l'-
vque de cette ville, phrem, du danger que courait
l'orthodoxie dyophysite? Ce n'est l sans doute qu'une
conjecture, mais qui nous semble assez fonde. Ser-
gius de Resainii, dit M. Duval
2
, se rendit en 535
Antioche pour se plaindre des mauvais traitements
de l'vque Asylus. phrem, apprciant ses qualits
diplomatiques, le charge d'une mission pour le pape
Agapet. L'intrigant mdecin s'embarque pour Rome,
accompagn d'un jeune architecte du nom d'Eusta-
thius. Il ramne Agapet Constantinople et, avec son
aide, le pape obtient l'expulsion de cette ville des mo-
nophysites
3
. Si l'on rflchit que Sergius tait le
matre de Maraba (et peut-tre celui de Paul le Perse),
on pensera que les fugitifs purent lui faire part des
Orignistes furent condamns ce colloque. Or, plusieurs des partisans
de Thodore de Mopsueste taient alors accuss d'orignisme. L'accu-
sation n'tait certainement pas sans fondement, comme Je prouve la
fondation, en Perse, du parti J1enanien. cr. ch. rx, p. !!79.
i. Cu. DIEHL, JUIItinien, p. 3t4 et suh.
2. Duv .u., Litt. syriaque, p. 300.
3. En a3G. DIEUIIP
1
op. cit., p. 36 .
LE RGNE DE .MARABA. !69
mauvais traitements qu'ils avaient endurs dans la
ville impriale. Il est, en outre, possible que Thomas
d'desse ait accompagn Sergius dans son am-
bassade Constantinople et se soit fix ensuite dans la
grande cit, o il mourut quelques annes plus tard,
suivant Cosmas Indicopleustes
1
, trs probablement
avant 543, date du premier dit contre les Trois Cha-
pitres.
Maraba retourna :Nisibe
2
Sa joie de se retrouver
au milieu de ses coreligionnaires fut bientt tem-
pre par le spectacle des dchirements intrieurs
de l'glise nestorienne. Dsabus, il voulut se retirer
au dsert, pour y reproduire dans quelque grotte
ignore les prodiges d'asctisme qu'il avait
dans les laures ,, de Palestine ou les monastres d'E-
gypte. Mais, dit son biographe, quand les vques
de l'parchie l'eurent appris, il fut dcid qu'on ne
lui permettrait pas de s'y rendre, et il passa un
certain temps dans l'enseignement
3
n
i. P. G., LXXXVIII, col . 73.
i. Vie, p. m.
3. ce texte ne permet pas de dcider si enseigna Nisibe ou
Sleucie, comme le veut !lare (p. 44), qui lui rapporte la fondation de
l'cole de cette ville. Ce fut sans doute pendant ce temps qu'il composa
ou acheva ses commentaires sur !"criture sainte. Il avait aussi rap-
port d'Occident une traduction de Thodore de Mopsueste faite avec
l'aide de Thomas d'desse (MuE, loc. cit., B. O. Ill, p. 86, n. i). 'Amr
(p. U) numre parmi ses disciples: Narss, vque d'Anbar, Jacques,
mtropolitain de Beit Garma, Paul, mtropolitain de Nisibe (qui fut
plutot son condisciple), Ezcbiel, vque de zaM, qui devint catho
licos, Ramiw' et Isae qui lui succdrent dans la direction de l'cole
de Sleucie, Mose, vque de Karka de Ledan (Syn. orient., p. 368),
Bariabta, vque de Sahrqart (ibid.), David, mtropolitain de llerw (d
pos par Maraba), Subl}alemaran, vque de Kaiikar (Syn. orient.,
p. 366), sergius, qui enseigna Arbel un certain Jacques, Thomas
d'desse (mais celui-ci tait vraisemblablement retourn Conslanti
nople), et Qayura qui prit soin du maitre, l'assista ses derniers
moments et le fit ensevelir Hira.
L'existence de l'cole de Slevcie cette poque me semble problma-
tique. sa fondation par Maraba s'accorde mal avec ce que nous lisons
10
liO LA RFOIUIE DU VIe SICLE.
La science profonde et varie dont il y fit preuve,
et une austrit de vie qui ne se dmentit jamais
accrurent sa renomme dj fort grande. Lorsque le
le vieux catholicos Paul descendit dans la tombe, tous
les suffrages se runirent sur la tte de Maraha avec
l'agrment du _roi
4
On vit alors cette chose inoue jus-
que-l dans l'Eglise nestorienne: un catholicos nomm
sans brigue et sans fraude, et qu'il fallut arracher de
sa cellule pour l'asseoir de force sur le sige prima-
tial de l'Orient. C'tait en la neuvime anne de
Chosrau Anosarwan, vers le mois de fvrier 540
2
Le nouvel lu se mit courageusement la tche; il en-
treprit de corriger les dsordres causs dans l'glise
orientale par les discussions de ses chefs, et, comme
le dit lie de Damas, il y russit au del de toute
esprance
3
. Dj, avec l'aide de Chosrau, Paul
avait rtabli l'unit et dcid qu' aucun des comp-
titeurs on ne pourrait donner le nom de catholicos
4
.
Il avait jug que a ni lise ni Narss n'avaient reu
constitutionnellement l'ordination du patriarcat. En
effet, la cause de Mar Narss qui avait t lu d'p.bord
n'tait pas encore juge quand lise se mit lui-mme
faire opposition, et il posa ainsi la premire base
de la perturbation. De plus, la chose n'tant pas
dans sa Vie : que lorsqu'il fut lu catholicos, les vques envoyrent
une petite Oottille de barques pour le chercher. Il n'tait donc pas ce
moment Sleucie. Quoi qu'il en soit, sa carrire de professeur dut tre
assez courte: cinq ou six ans environ.
t. Vie, p. H-i. Il fut choisi pour le grand gouvernement du catho-
Jicat par tous les mtropolitains et vques, et par tous les clercs et
fidles qui se trouvaient dans les villes, sans qu'il le sL Ils envoyrent
sa recherche des barques de la part du Roi ries Rois.
!1. MARE, p. 4-t. 'AIIR, p. !il-'. BARUBRUUS, COl. 89, dit tort que Maraba
fut consacr dans la G' anne de Chosrau; cr. Syn. orient., p. 318, n.
t et 3.
3. Bibl. orient., III, p. 78.
4. Syn. orient., p. 3!!0.
LE RGNE DE MARABA. 171
encore juge, Narss, de son ct, s'empara prcipi-
tamment de l'autorit, irrgulirement, alors qu'on ne
savait pas encore lequel des deux triompherait
1
.
Mais il tait rserv Maraba de tirer les cons-
quences du principe nonc par son prdcesseur,
On statua que si, dans un seul sige, il n'y a
qu'un vque institu avant la dualit, il reste l-
gitime. S'il y en a deux, on choisira le plus vertueux,
et l'autre le servira comme prtre. Que si tous deux
sont galement vertueux et orthodoxes, celui qui a t
institu le premier sera confirm dans l'piscopat.
L'autre renoncera aux fonctions piscopales, mais sera
dsign comme successeur. Si tous deux sont indignes,
ils doivent tre dposs et servir dans l'ordre qu'ils
avaient auparavant 2.
Telles furent les dcisions prises dans le synode
tenu, suivant l'usage, par le nouveau patriarche im-
mdiatement aprs son lection. li restait les faire
excuter. Il semble que, dans le Nord, la rforme se
soit accomplie sans difficult, soit parce que les dr-
glements y taient moins grands, soit cause du pres-
tige personnel de Maraba et des mtropolitains qui
s'associrent son uvre
3
Mais la Basse-Chalde, la
Susiane et la Perse propre, terre classique des schismes
et des rvoltes, rclamaient des soins particuliers.
Non seulement les deux comptiteurs avaient pourvu
de candidats les siges piscopaux de ces contres,
mais, comme nous l'avons vu plus haut, certains v-
ques s'taient proclams indpendants de l'un et l'autre
catholicos. Enfin de simples intrigants, Tama ~ , dans
t. Loc. cit.
i. Syn. orient., p. 3!11.
3. Toutefois, quelques annt'es plus tard, la discorde rgnait Nisibe
(Syn. orient., p. 3!19).
4. Syn. orient., p. 3ti, 325, 326, 32i.
LA. RFORME DU VI SICLE.
la Msne, Abraham fils d'Audmihr
4
, dans la Su-
siane, s'emparaient des glises et consacraient, moyen-
nant finances, quiconque aspirait l'piscopat.
Maraba rsolut de visiter en personne ces rgions
si troubles, et de s'y faire accompagner des clercs de
son glise patriarcale, des mtropolitains et des v-
ques de son obdience. Le Synodicon a enregistr le
compte rendu officiel de ce voyage
2
Maraba alla d'abord
Prozsabur
3
, puis dans le pays de Kaskar o le rejoi-
gnirent Paul, mtropolitain de Beit Lapat, Salma de
Ledan, Mihrnars de Zab, Silade Hormizdardasir, li-
se de Suster, Chosraude Suse. Ils choisirent un vque
pour le sige de Kaskar, aprs avoir dpos deux concur-
rents indignes. Accompagns du prlat lgitime, Sa-
muel, ils se rendirent en Msne, dposrent de l'pisco-
pat et interdirent temporairement de toute fonction
presbytrale ou diaconale, et mme de la communion
laque, l'intrus Tama. Ils installrent sa place sur le
sige de Prat l'vque Jean. Le synode ambulant se
dirigea vers Hormizdardasir, d'o, aprs avoir rgl
quelques diffrends, on monta vers la Perse propre. A
Rewardasir, on dposa deux usurpateurs, et, aprs
avoir revalid les ordinations faites par eux, on choisit
Mana comme
Celui-ci se joignit ses collgues et l'on redescendit
dans le Huzistan. lise de Suster fut dlivr d'un com-
ptiteur
5
, et de l les vques se dirigrent vers Beit
1. Syn. orient., p. 3it, 3;15, 326, 3i8, 330.
Il. Syn. orient., p. 321 ct sui v.
3. Anbar, sur l'Euphrate, qui est appele ici ville des Arabes comme
dans la Passion contemporaine de Grgoire (HOFFJUNN, Auszge, p. 83).
-l. L aussi, sans doute d'accord avec les vques du Sud-Est, le pa
triarche rgla la situation des lointaines glises du Sgestan o il ne pou-
vait songer se rendre en personne. Syn. orient., p. 3!1:> et 343.
Simon de Nisibe. JI se soumit, conserva ses fonctions ecclsiasti-
'
1
LE RGNE DE MARABA. t73
Lapat. La grande mtropole tait en pleine rvolte
contre son chef lgitime, l'vque Paul
1
Abraham
fils d'Audmihr, aprs s'tre fait consacrer contraire-
ment tous les canons, s'tait d'abord soumis au mois
de de la neuvime anne de Chosrau (fvrier
540), c'est--dire trs peu de temps aprs l'lection de
Maraba, et sans doute dans le sein mme de l'assem-
ble qui avait lu le catholicos
2
Mais il s'enfuit prcipitamment de la province pa-
triarcale, et, profitant sans doute de l'absence de Paul
qui avait rejoint le catholicos au dbut de son voyage,
il souleva de nouveau Beit Lapat et se recruta un parti
parmi les fidles les moins recommandables. Il se
saisit d'une glise de la ville avec la complicit de quel-
ques nobles
3
Cette glise portait le nom de Mihrbuzid
et parat avoir appartenu une riche famille du lieu
Les vques, les mtropolitains et le patriarche
rent une action en restitution et gagnrent leur procs
devant toutes les juridictions
5
,et enfin devant les grands
officiers du Huzistan, dont plusieurs cependant avaient
ques et donna sa signature l'assemble de Beit Lapat (Syn. orient..,
p. 33t, n t!l). .
t. Qu'il ne faut pas confondre, comme )lARE (p. 43), avec son homo-
nvme le catbolicos.
-!!. C'est du moins ce que je crois pouvoir induire des signatures
(Syn. orient., p.3\!8; cf. aussi p. 3!17), o se rencontrent les noms de vingt
prtres et de douze diacres, membres du clerg de Sleucie-Ctsiphon,
et ceux de trois vques : f1enana, mtropolilain d' Adiabne, David.
vque de Mazon, et Jean, de Paidangaran, peut-tre les cooscrateurs
de llaraba (p. 3i8). - Abraham avait dj t condamn par Paul
(Syn. orient., p. 3iti et 3!16) avet ses conscrateurs Taimai, l'intrus de
)Jsne, Ba:rsabd et Berikmarh; il se soumet au synode patriarcal, se
rvolte de nouveau, encourt une peine affiictive et infamante devant les
tribunaux du Huzistan, et eri6n l'excommunication dfinitive Beit
Lapat. On peut juger par l de son opinitret.
3. Syn. orient., p. 3i8. ,
4. Nous ne connaissons pas, en effet, de martyr de ce nom qui p!
lre le titulaire de l'glise.
5. Syn. orient., p. 3!!9, n.t, 2, 3, 4.
10.
i74- LA RFORME DU VI" SICLE.
t les patrons et les fauteurs d'Abraham. Celui-ci fut
ras et condamn la prison perptuelle. Grce " de
hautes complicits, il russit s'chapper, laissant
d'obscurs comparses le soin de purger leur peine. Sans
doute, les autorits civiles ne prtrent, en cette occa-
sion, au patriarche qu'un concours mdiocrement em-
press. Maraba dut se borner porter de nouveau
contre l'insaisissable rvolt une terrible sentence :
non seulement Abraham fut dclar suspens de tout
ordre ecclsiastique, comme Sleucie, mais on lui
interdit encore l'entre de l'glise, lui laissant seule-
ment esprer la communion laque, s'il venait rsi-
piscence.
Ce pacte solennel, par lequel les pasteurs lgitimes
abolissaient le schisme des provinces mridionales
1
, fut
sign du catholicos, des mtropolitains du Huzistan et
du Farsistan, de huit vques, de trente prtres, des-
servants de quatre glises, enfin d'un grand nombre
de dlgus laques de Karka de Ledan, de Beit Lapat,
d'Hormizdardasir et de Suster
2
Le voyage du catholicos se termina officiellement
Beit La pat
3
L'acte qui en fut dress porte, dans le
i. La pacification du Huzistan ne fut qu'apparente. Le mtropolitain
Paul mourut bien tOt et Maraba, alors en exil, fut oblig de se r ~ e " e r ex-
pressment la nomination de son successeur en vue de prevenir des
lroubles (Syn. orient., p. 319350}.
!1. Ces signatures de laquessont trs intressantes. Elles montrent que
ds cette poque les chtiens occupaient des situations trs en vue,
surtout dans le monde commercial. Parmi ceux de BeitLapat. par exem
pie, nous relevons les noms du prsident des marchands, du prsident
des argentiers, du chef des orfvres et du chef des tameurs (p. 33i). A
noter les signatures de Wardayb, qarugbed (chef des ouvrlers},Abraham
dit Al!ouhi, artastansalar de Irankourrah Khosrau (p. 33t; cr. TABAtll,
p. 58, n t), et Koudboudad, rihanoular (?).Si l'interprtation propose
par M. Chabot du titre d'Abraham est exacte (p. 33t, n. 3), d'importsnts
oommandements militaires auraient t confis des chrtiens. Mais la
lecture du texte est incertaine et la restitution peu sre.
3. C'est probablement pendant son sjour Beit Lapat qu'il visita les
LE RGNE DE 1\IARABA. i7'5
Synodicon, le titre de Pragmatique des rformes
provinciales .
Avant de se sparer de ses collgues, l\laraba rso-
lut d'adresser une encyclique aux amis de Dieu, les
mtropolitains et les vques, et tout le clerg des
chrtiens de l'Orient. Maintenant, crit-il
2
, que, par
la grce de Dieu, et par le soin du Roi des Rois Chos-
rau ... , la dualit du principat a cess, que l'unit du
gouvernement du sige catholique est consolide et
que la plupart des provinces sont rformes
3
et pacifies,
il nous a paru ncessaire que les rangs des fidles s-
culiers soient rforms, comme l'ont t les ordres des
directeurs (c'est--dire le clerg).>> Des abus considra-
bles s'taient produits pendant la priode du schisme.
A l'exemple des Perses, les chrtiens s'taient allis
des femmes, leurs proches parentes, et, comme le dit la
lettre I I I ~ , << la femme de leur pre ou du frre de leur
pre, leur tante, sur, bru, fille, tante, belle-fille, ou,
l'exemple des juifs et des paens, leur belle-sur .
Ces infractions aux canons ecclsiastiques sont svre-
ment rprimes. Aux clercs le catholicos accorde un
dlai de deux mois, ou au plus d'un an, pour se sou-
mettre et se sparer de leur compagne illgitime, sous
peine d'tre interdits et privs de la communion laque.
bourgs de la Susiane auxquels est adresse sa deuxime lettre. Syn.
orient., p. 551.
t. Syn. orient., p. 3i0.
2. Syn. orient., p. 33:11, 3 3 ~ .
3. Il ne semble pas que, pendant son voya1,e, }faraba se soit appli-
qu spcialement rformer la doctrine thologique. Toutefois, sa
deuxime lettre, adresse des glisea de Susiane, renferme un abrg
de christologie. Il est assez difficile de dterminer quelle sorte d'er-
reur le patriarche entendait s'opposer. On peut penser que c'est un
nestorianisme trop rigide: Le Christ n'est pas un homme simple, ui
Dieu dpouill du vtement de l'humaDit dans lequel il s'est montr ...
Que quiconque introduit une quaternit dans la Trinit sainte et im-
muable soit anathme! (Syn. orient., p. 553.)
4. Syn. orient., p. 335 et suiv.
i76 LA DU VI SlltCLE.
Aux laques, que l'ignorance de l'criture rend plus
excusables, Maraba permet de garder leur femme, s'il
leur semble trop dur de la quitter, moyennant la p-
nitence canonique d'un an de jene, accompagne de
larges aumnes. Mais si, aprs la promulgation de la
loi, de nouveaux abus se produisent, il n'y aura pas de
peines assez svres contre les dlinquants. Ils seront
interdits et privs mme de la spulture ecclsiastique :
Qu'ils aient la spulture d'un ne, comme les btes
dont ils ont imit la vie!
Ces rgles promulgues, Maraba revint Sleucie
1
,
probablement en janvier-fvrier 541. Il retourna
son trne, critle rdacteur de sa Vie
2
, etaux villes de
son sige, consacrant ses nuits rpondre, par des let-
tres qu'il envoyait dans les provinces, au sujet du gou-
vernement ecclsiastique, et ses journes l'interpr-
tation des critures divines jusqu' la quatrime heure,
et de la quatrime heure jusqu'au soir juger les pro-
cs et dnouer les querelles des fidles entre eux et
des paens avec les fidles, et les glises taient floris-
santes dans toutes les provinces de sa juridiction pa-
triarcale.
Cette prosprit devait tre de courte dure
3
Quel-
ques mois encore, et la haine des mages dchanera une
nouvelle perscution, concidant avec la reprise des
hostilits entre Byzantins et Perses.
t. D'aprs la Vie (p. 2i5), Maraba, sitt les vques congdis.
monta la rencontre du Roi des Rois, entra en sa prsence et fut reu
par lui , avant de revenir Sleucie. cette expression monter si
gnifierait que le roi sc trouvait alors dans ses quartiers d't du ct
de la Mdie. &lais, en 5-W, Chosrau prparait sa campagne contre les
llyzantins. Il se peut donc qu'il ne faille pas trop prendre la lettre
l'expression de l'hagiographe.
3. Dans la Passion de Grgoire, HOFFM.\NII, Auszge, p. 71 et 81, l'hagio-
graphe anonyme dit que les chrtiens jouirent d'une paix profonde de
puis la mort de Prtlz jusqu' la dixime anne de Chosrau (48\-510).
...
f
LE RGNE DE MARABA. t77
Les historiens grecs ont conserv le souvenir de cette
guerre atroce auprs de laquelle les campagnes de
Qawad ou les incursions des Arabes {527-531) ne sont
que des escarmouches. Profitant des embarras de Jus-
tinien, dont la politique italienne absorbait les meil-
leures ressources, et prtextant, non sans fondement
peut-tre, que l'empereur byzantin sollicitait les Huns
Blancs la rvolte, Chosros
1
se jeta sur la Syrie et la
mit feu et sang, ranonnant les villes, pour la plu-
part incapables de rsister, emportant par la force les
places qui osrent se dfendre, massacrant les habitants
ou les emmenant en esclavage. Il poussa ainsi, pillant
et ruinant tout sur sa route, jusque devantAntioche,la
plus belle, la plus riche de toutes les villes de l'Orient
romain, et cette capitale de la Syrie, tombe, aprs une
courte rsistance, au pouvoir du vainqueur, connut tou-
tes les misres et toutes les horreurs de la guerre : ses
glises furent dpouilles, ses difices brls, sa popu-
lation - du moins ce qui avait chapp la tuerie -
transporte tout entire en captivit au del de l'Eu-
phrate
2
; et, pendant que, s'avanantjusqu'la Mditer-
rane, Chosros en prenait en quelque sorte une sym-
bolique possession, les gnraux impriaux assistaient
impuissants ces dsastres .
De 540 545 les armes persanes attaqurent sans r-
pit laLazique {541), la Comagne (542),l'Armnie (543),
la Msopotamie (544).
Les chrtiens de Perse subirent le contre-coup de
ces luttes. Ils n'taient plus, comme au temps d'Anas-
tase, protgs par les dissidences thologiques, qui, en
i. DIEUL, Juatinien, p. !ilt5.
2, Sur la fondation de la Nouvelle-Antioche, cf. HOFFMANN, n. 83-\
TUARI, p. 165, n. 4. Le synode de Joseph contient la signature d'un
Claudianos, mtropolitain de Mal;toz J:!edata. Il n'est pas bien sr qu'il
s'agisse de la NoU\elle-Antioche (Syn. orient., p. 366 et 676).
:178 LA RFORME DU VIc SICLE.
apposant l'orthodoxie pe-rsane au monophysisme de
l'empereur byzantin, garantissaient aux yeux du Roi
des Rois la fidlit de ses sujets chrtiens.
Lors donc que, dans la dixime anne de son rgne,
Chosrau quitta sa rsidence pour aller guerroyer contre
les Lazes, les mages purent donner libre carrire leur
zle religieux. La Vie de Maraba nomme leur chef:
le grand mobed Dadhormizd
4
La perscution n'atteignit pas les proportions gi-
gantesques de celle de Sapor. La Passion de Grgoire
1a caractrise en disant que l o les chrtiens taient
en minorit, on dtruisit les glises et surtout les clo-
tres
2
On arrta aussi les nobles persans qui avaient
embrass le christianisme; parmi eux : Pirangusnasp,
qui avait pris le nom de Grgoire, et Iazdpanah, dont
les actes nous ont t conservs
3
Le premier s'tait converti dans la trentime anne
du rgne de Qawad (518) et dut, pour ce fait; s'en-
fuir et se cacher, abandonnant le commandement
militaire des pays de Gurzan et Arran que le roi lui
avait confi. Mais lorsque, en 522, la guerre clata dans
ces rgions entre les Romains et les Perses, Qawad
rintgra Grgoire dans sa charge. Celui-ci fut mal-
heureux la guerre; les Romains s'emparrent de
lui et le conduisirent Justin qui se l'attacha en le
comblant d'honneurs et de prsents. En 533, Zabergan
vint Constantinople pour conclure une trve, la
suite des brillants faits d'armes de Blisaire. L'ambas-
sadeur persan donna un sauf-conduit son compatriote
et le ramena dans son pays, o Chosrau lui confia le
t. P. ti6.
2. HOFFMANN, Auszge, p. 78.
3. HOFFMANN, loc. cit., et p. 81. BEDJAN, Vie de Iahbalaha, de trois autres
atriarches et de quelques laques nestoriens, p. M7 et 39-t.
. .,
LE RGNE DE MARABA. i79
mme commandement qu'autrefois
1
Mais les intrigues
des mages le firent de nouveau destituer et emprison-
ner, la requte d'un de ses parents nomm Mihran
2
Grgoire, charg de fers, fut amen dans un bourg
voisin de Sleucie, pour y tre gard vue. Sa d-
tention dura tout l'hiver, depuis le mois de novembre
jusqu'au dpart de Chosrau pour son expdition contre
la Comagne (541/2). Mais la perscution ne ralentit
pas son zle, il convertit ses codtenus, et, parmi eux, des
dignitaires du royaume
2
La fureur des mages s'en ac-
crut. Chosrau s'tait mis en marche dans la direction
de Prozsabur dont il voulait faire sa base d'oprations
pour ravager la valle de l'Euphrate. Mihran l'y rejoi-
gnit et requit impitoyablement la mort de son cousin.
Ses instances eurent raison des hsitations du roi, et
Grgoire fut mis mort le vendredi de la sixime se-
maine de Carme, dans un chteau fort situ aux envi-
rons de Prozsabur (542)
3
lazdpanah ~ tait un noble persan des environs de
Karka de Ledan, chef-lieu de la Susiane. Converti par
des moines, il rsista toutes les sollicitations et aux
promesses qu'on lui fit de lui donner la charge de grand
mobed, s'il consentait renier Jsus-Christ. Il tait
emprisonn depuis cinq ans lorsque mourut Grgoire
Les mages l'emmenrent Sleucie, puis Prozsa-
bur, o se tenait le roi. Une sorte de concile maz-
diste
6
se runit sous la prsidence du mobed su-
i. Ce dtail me semble sujet caution.
2. Commandant des armes persanes en Lazique et en Ibrie. HoFF-
JIANll, Auszge, p. Sj.
3. DANARHIT? peut-tre Hit. HOFFIIA!Ill, Auszge, p. 85, n. 76t.
4. HOFFIIANlY, Auszge, p. 87 et suiv. BEDJAN, p. 394-H6.
5. Il faut donc qu'on ait commenc inquiter les chrtiens de Su-
siane vers 537/8.
6. Sur ces conciles, cf. Vie de Maraba, p. 2i8 et suiv. et Acta S. Sirac
dans Acta SS., i8 maji, IV, 181, ch. xxm.
iSO LA RFORME DU VI SIECLE.
prme et l'on donna Iazdpanah le choix entre les
honneurs s'il apostasiait, et la mort s'il refusait d'o-
bir. Il parat que lazdpanah attaqua, en plein concile,
la religion de Zoroastre. Les mages, qui craignaient
que les chrtiens, apparemment fort nombreux dans
la rgion, ne dlivrassent par la force lear coreli-
gionnaire, le firent dcapiter sur la route de Sleucie.
Trois ans plus tard (545)
4
, un autre converti, Awida,
originaire de Beit Kussay, district peu loign de S-
leucie, fut galement condamn mort. Mais sa cons-
tance toucha tellement les bourreaux qu'ils se conten-
trent de lui couper l'extrmit du nez et des oreilles.
La perscution s'arrta sans doute cette anne mme,
cause de la conclusion d'une trve avec Justinien qui
stipula pour les chrtiens de Perse la libert religieuse.
Elle s'tait tendue non seulement aux lacs qui
avaient abandonn la religion officielle, mais aux
membres du clerg et aux vques, ceux surtout dont
le zle et l'intelligente habilet multipliaient les con-
versions parmi les mazdens. La Passion de Grgoire
2
nous rapporte que, ds le dbut de la tourmente, plu-
sieurs prlats accoururent la Porte pour se plaindre des
mauvais traitements dont ils taient l'objet, et prsenter
des rclamations au sujet des dgts matriels, des-
tructions d'glises et de clotres, dont ils taient victi-
mes. Mais les temps taient changs. Au lieu de leur
faire justice, on les emprisonna avec les prtres et
les diacres qui les accompagnaient. Un grand nombre
d'autres furent incarcrs sur l'ordre direct des gou-
verneurs de province. Nous connaissons les noms de
deux de ces confesseurs : Salma, vque de Ledan, et
Mihrnars, vque de Zab, dans l'parchie patriar-
t. HOFFMANN, Auszge, p. 91. BEDJAN, p. 414, crit tort !;.m..
2. HOFFIIANN, A uszge, p. 8!!.
LE RGNE DE MARABA. t81
cale, mais nous ignorons leur sort dfinitif. Tout
porte crohe qu'ils furent librs, aprs une assez
longue dtention.
Le chef des chrtiens d'Orient, l'illustre catholicos
Maraba, eut, lui aussi, beaucoup souffrir de la
haine des mages
4
S'il ne versa point son sang pour
la cause chrtienne, il mrita bien, par les tourments
qu'il subit au cours d'une captivit qui dura presque
autant que sa vie, Je titre glorieux de martyr que
lui dcerna la pit de ses disciples.
A peine de retour des lointaines contres o il avait
t abolir les suites du dplorable schisme de l'glise
orientale, 1\Iaraba fut.somm de comparatre devant
le concile des mages du Beit Aramay a. Le catholicos
comparut libre, ce qu'il semble. Le mobed suprme,
Dadhormizd, prsidait l'assemble. Deux hauts per-
sonnages, le (( sahrdawar
3
Adurpareh et le rad de
Perse, accusrent l'vque d'avoir profit de son
voyage sur le versant mridional du plateau iranien
pour convertir des mazdistes et pour interdire aux
chrtiens, sous peine des censures ecclsiastiques, de
continuer certaines pratiques paennes, comme de
manger la chair des animaux sur lesquels les mages
avaient prononc leurs incantations. A prs un simulacre
d'interrogatoire, Dadhormizd se prsenta devant le roi
et en obtint la permission de livrer Maraba au pasaniqa
rusphan \ c'est--dire au directeur des prisons. Nous
i. Les controverses christologiques sont trangres cette perscu-
tion. Barhbraeus, qui dit le contraire, a sans doute confondu Cbosrau 1
et Chosrau JI, Chron. eccl., 11, col. 9t.
2. Br.na11, Histoire ... , p. !!26. Ce concile ne doit pas tre confondu
avec celui dont il est parl plus haut dans la Passion de Grgoire et qui
eut lieu en 542. Celui-ci doit plac un an plus tt.
3. Ce terme est traduit par M. Hoffmann (Auszge, p. 65) : Reichs-
sekretii.r. Le sahrdawartait probablement le chef suprme des scribes.
4 . ._g.-o; ou :
LE CHRISTIANISME,
tt
f82 LA RFORME DU VI SICLE.
infrons de ce passage que le mobed suprme, aprs
l'avoir fait saisir Sleucie ou dans les environs,
l'avait entran sa suite dans les rangs de l'arme
royale qui s'acheminait vers le nord de l'Empire
(hiver 540/1).
Mais l'excution du catholicos fut diffre. Sans
doute, les mages n'osrent pas abuser de leur victoire.
Ils craignaient que le roi ne leur st quelque jour
mauvais gr d'un zle trop htif. C'tait chose grave
que de mettre mort le chef des innombrables chr-
tiens de la Perse, au risque de provoquer une rvolte,
alors que Chosrau n'avait pas trop de toutes ses forces
pour soutenir l'effort des lgions byzantines. C'est
peut-tre ce que se chargea d'expliquer un notable
chrtien de Sleucie, 'Ahrodaq
1
En tout cas, son
intervention dans le procs de Maraba fut des plus
dsagrables aux mages auxquels il ne mnagea pas
les reparties malicieuses. Il assura mme Dadhormizd
que, s'il voulait s'instruire l'cole du catholicos, il
demanderait sous peu le baptme. L'ironie parut trop
amre, et les mages cherchrent tuer l'audacieux
interrupteur. Mais les obligtions de la charge publique
qu'il exerait l'avaient fort opportunment rappel
Ctsiphon.
L'escorte royale poursuivait lentement sa route vers
le Nord, et, sur leur passage, les dignitaires mazdistes
recueillaient les accusations plus ou moins fondes
que les fonctionnaires de tout ordre et des chrtiens
rengats
2
formulaient contre le patriarche. Le rad et
le mobed de Beit Aramay se joignirent leurs coll-
i. HOFFHA!IN, op. cil. , p. 89, n. 8tO. La conjecture qu'il propose est
vrifie par l'orthographe toJ:),o;:ol de notre Vie.
2. Notamment un certain beudad de Samarra. BEDIAN, Vie ... , p. ilU
et suiv.
........
LE RGNE DE MARABA. t83
gues de la province de Pars. Ils reprochaient au pr-
lat de soustraire leur juridiction les procs que les
fidles avaient engags entre eux; c'tait tarir une
source assure de profits. Crime irrmissible, en
vrit. Les rglementations de Maraba au sujet du
mariage des chrtiens drangeaient aussi leurs calculs
intresss. Sentant qu'il n'obtiendrait pas de l'vque
de Sleucie une rvocation pure et simple de ses
ordonnances canoniques
1
, Dadhormizd se contenta
d'exiger une concession : ne pourrait-on pas laisser
en l'tat les unions contractes avant l'accession de
Maraba la dignit patriarcale? Tout fut inutile.
En vain les mages se retranchrent-ils derrire une
prtendue injonction du roi. Maraba se refusa tous
les compromis. Il se sentait fort de sa conscience, et
aussi de la faveur
2
de Chosrau, qui, lorsqu'il rencon-
trait le catholicos, le saluait amicalement et s'en-
tretenait familirement avec lui.
Les mages trouvrent enfin le moyen si longtemps
cherch de rduire l'intrpide patriarche. L'un d'entre
eux dcouvrit que Maraba tait un Zoroastrien con-
verti
3
Il suffirait pour le perdre de le dnoncer au
roi. Les dignitaires mazdistes lui proposrent toutefois
de le laisser libre, s'il consentait retirer ses ordon-
nances et renoncer convertir les paens au christia-
nisme. Maraba refusa. On voulut l'emprisonner. Les
clameurs menaantes des chrtiens runis la Porte
Royale firent abandonner ce projet et on le confia la
garde du rad d'Adurbaidjan, nomm Dadin, qui, sur
l'ordre des mages, le relgua dans une bourgade situe
au milieu des montagnes, o, s'il faut en croire l'his-
1. Vie, p. 136.
i. Faveur toute relative, du reste, comme on le verra plus loin.
3. Vie, p. ~ 8 .
i8i LA RFORME DU VI SICLE.
torien de Maraba, se trouvait une sorte d'cole nor-
male des mages
1
En tout cas, il n'y avait pas dans
cette rgion d'autres chrtiens que le catholicos et
les clercs de sa suite.
Maraba se concilia bientt l'estime et l'admiration
des fonctionnaires prposs sa garde et du rad
lui-mme qui passait pourtant pour farouche et cruel.
Les chrtiens apprirent vite le chemin de ce lieu de
dtention; de toutes les provinces de l'empire afflu-
rent vers le catholicos vques, prtres et fidles, avi-
des d'entendre ses instructions et de s'difier au spec-
de ses vertus. Ce pays perdu devint, pendant
sept annes, la capitale religieuse des chrtiens de
Perse. Des provinces se rassemblaient les mtro-
politains, les vques, les prtres et les diacres, les
fidles, hommes et femmes, pour y prier et tre bnis
par lui. Plusieurs, cause de leurs pchs, se
sa porte dans le sac et la cendre, puis il leur par-
donnait. D'autres taient bnis pour la charge spiri-
tuelle de l'piscopat, d'autres pour la dignit de la
prtrise ou du diaconat; il confrait galement les au-
tres ordres ecclsiastiques ... Des troupes d'vques
se runissaient avec leurs collgues, et ils faisaient
entendre des hymnes inspires du Saint-Esprit; des
lgions de prtres taient reus dans le camp de leurs
collgues, et ils se racontaient les grandes merveilles
qu'ils voyaient et entendaient. Les montagnes et les
hauteurs de l'Adurbaidjan semblaient aplanies sous
les pas des saints
2
Ces expressions du biographe anonyme font allu-
i. Maraba dut tre relgu dans les environs du fameux temple du
feu Adargusasp, dans la rgion de Ganzak. Le nom du village o il fut
conduit: SRSdes-Mages, peut tre rapproch du mot pehlvi sros ==ange.
TADARI, d. Noeldeke, p. 100, n. {;el p. 6, n. i.
2. Vie, p. 2t7.
LE REGNE OE MARABA. !Sa
!)ion la tenue du synode de Maraba, ou, pour parler
avec plus d'exactitude, la runion d'vques
1
la
suite de laquelle le patriarche jugea bon de former une
collection des principales constitutions qu'il avait r-
diges touchant la rforme du clerg et des fidles. Ces
constitutions sont au nombre de six : 1" Le synode
orthodoxe des rformes provinciales;- 2 la lettre qui
concerne l'orthodoxie de la foi et en a procur l'int-
grit; - 3 du rglement des murs vertueuses; -
4 celle qui fait connatre la dposition des deux per-
sonnes qui introduisirent la dualit, ainsi que les con-
cessions et les sanctions relatives ceux qui avaient
t tablis par ces personnes; - 5" celle qui concerne
les dfinitions et les canons relatifs la distribution
du gouvernement ecclsiastique;- 6"la Practica qui
renferme la majeure partie de ces choses et ajoute
l'explication de chacune d'elles.
Nous avons ci-dessus mentionn et comment bri-
vement les quatre premires pices, crites avant la
captivit de Maraba. La cinquime adresse aux
quatre mtropolitains de 1\laisan, d'Adiabne, de Beit
Garma et de Perse et aux vques de toutes les par-
chies rserve formellement au catholicos le droit de
pourvoir la vacance des siges de Beit L a p a ~ et de
Nisibe
3
Maraba regrette d'tre contraint de prendre
une si importante dcision sans le concours de ses col-
lgues. Mais, dit-il, le moment prsent qui est rem-
pli de grandes difficults ne nous permet pas... de
vous convoquer tous prs de nous pour tenir un synode
au sujet des choses qu'il faudrait faire. En attendant
que Notre-Seigneur nous vienne en aide et qu'un sy-
t. Au mois de l!ahrir de la t3 anne de Chosrau, dcembre janvier
M3/4. Syn. orient . p. 3i9.
:il. Syn. orient., p. 3 ~ 9 .
!86 LA R ~ ' O R M E DU VI SIECLE.
node puisse avoir lieu, pour l'utilit de tous les chr-
tiens, afin de ne pas donner l'ennemi une occasion
opportune de jeter le trouble Beit Lapat ou Nisibe,
comme cela a eu lieu en Perse o certains se sont au-
trefois empars de l'autorit mtropolitaine sans le
consentement du catholicos, de sorte que tous les
gens de ce pays furent troubls et tombrent dans
des difficults et des calamits telles qu'elles ont
peine cess lorsque nous nous sommes runis l avec
les mtropolitains et les vques d'entre vous, il nous
a paru bon et ncessaire de faire et d'envoyer votre
charit divine ces crits dans lesquels nous dcrtons
et dfinissons, de votre consentement, au nom de
Notre-Seigneur Jsus-Christ, par la volont de son
Pre et l'opration de son Esprit-Saint : qu'il ne sera
permis, soit Beit Lapat, soit Nisibe, soit en quel
que autre lieu, ni aux vques de la province, ni aux
vques ou au mtropolitain d'une autre province, d'or-
donner un vque mtropolitain, ou d'introniser un
vque dj ordonn, ou excommuni, sur le sige de
Beit Lapat, de Nisibe ou de quelque autre lieu que
ce soit, sans notre autorisation, notre prsence ou nos
lettres.
1
De la sixime lettre : Practica, nous ne possdons
qu'un fragment
2
Elle rgle la succession du patriarche
lui-mme. Lors de la vacance du sige, les vques
de la province du trne apostolique se mettront
d'accord avec 11 les deux Villes - c'est--dire avec
le clerg et les laques de Sleucie-Ctsiphon - sur
le nom d'un candidat. Puis ils 11 enverront chercher
t. Parmi les di1t-buit signatures de cette encyclique, nous relevons
celle de Mibrnars, vque de Zab. On peut donc supposer que la cons-
titution a t compose avant Mil, date de l'emprisonnement da ce
prlat. .
11. Syn. orient., p. 5114.
LE REGNE DE MARABA.
t87
le mtropolitain de Beit Lapat, s'il a t institu
canoniquement et de notre consentement, avant notre
mort, et celui de Prat de Maisan, et celui d'Arbel,
et celui de Beit Slokh. Ils viendront aux Villes, tous
les quatre, ou au moins trois d'entre eux, avec chacun
trois vques de chacune des quatre provinces nu-
mres . Le choix du nouveau catholicos tant ar-
rt, u ils l'ordonneront dans l'glise de Kok, selon la
tradition des saints Pres, et ils l'installeront sur
le sige catholique pour prendre notre place ". La
lecture de ce document suggre l'impression que
Maraba s'attendait d'un moment l'autre subir
la peine capitale
1
, et ses craintes n'taient que trop
fondes. Cependant trois annes s'coulrent encore
aprs cette runion synodale, sans que la vie du pa-
triarche ft plus srieusement menace
2
Vers 548
3
, un rengat que le catholicos avait excom-
muni pour ses crimes intrigua auprs du roi et en ob-
tint, nous ne savons comment, la permission de d-
poser Maraba et d'annuler les ordinations qu'il avait
faites. Pierre Gurganara , ainsi se nommait le tratre,
avait t autrefois pasteur spirituel , c'eflt--dire
prtre ou plus probablement vque. Il se rendit
promptement en Adurbaidjan pour satisfaire sa ven-
t. Dans le court fragment qui nous a !t conserv le mot de mort
est rpt jusqu' cinq fois.
~ . Je ne crois pas l'authenticite! des Canons de Mar A ba 1, dits
par M. CHABOT la suite du Synodicon orientale, p. :s;;:; et suiv. En
effet, to) danR la liste complte des pices canoniques runies par
Jllaraba en M3f4, il n'est nullement question de ces canons. ~ ) Chacune
des pices mentionnes dans la liste nous est parvenue, au moins l'-
tat fragmentaire. Il est donc impossible d'y ajouter quoi que ce soit.
3) Aucun de ces canons n'est original. Cette collection assez htroclite
rappelle le pseudo-concile de Sleucie publi par LAMY el n'a pas plu
de chance d'tre authentique. 4) La seule mention du concile de Chal-
cdoine dans le titre suffit renJrc la collection des plus suspectes.
3. Vie, p. ~ , 9 .
4. Originaire du Gurgan?
t88 LA RFORME DU VI SICLE.
geance. Toutefois les ordres du roi n'taient pas des
plus explicites. Les mages, qui, pourtant, avaient bien
des raisons de har Maraba, ne trouvrent pas suffi-
santes les instructions dont Pierre tait porteur et
refusrent de les sanctionner de leur autorit. Le re-
ngat recourut la violence et essaya une attaque
nocturne contre le lieu de dtention du catholicos.
Mais le propritaire de la maison et les habitants du
bourg prirent la dfense de leur hte et dispersrent
les assaillants
1
Cette alerte mit en garde le patriarche. Une autre
agression pouvait russir. Sur le conseil et avec l'aide
de Jean, vque d'Adurbaidjan, il s'enfuit avec un
disciple nomm Jacques, et traversant incognito l'A-
diabne et le Beit Garma, il se prsenta inopinment
la cour du roi qui, pour lors, rsidait Sleucie.
Son apparition, d'autant plus inattendue qu'on tait
en hiver, causa un vif moi dans les Villes Royales :
les mages se rjouirent et les chrtiens tremblrent
2
Comment Chosrau allait-il punir une transgression
formelle ses ordres? Le roi fut clment. Il dpcha
un de ses officiers
3
vers le patriarche pour lui de-
mander raison de sa dsobissance. Celui-ci se dis-
culpa en disant qu'il consentait tre mis mort
publiquement si telle tait la volont royale, mais non
pas prir obscurment, dans un coin de montagne,
sous les coups d'un rengat.
Chosrau admit cette excuse et pensa mme faire
relcher Maraba. Mais les mages lui reprsentrent
que le catholicos tait un transfuge de leur religion et
t. Vie, p. 251.
2. Vie, p. 252.
3. Farruchdad Hormizd de Zadagu, peut-tre le Zado dont il est
question dam1 TAnARI, p. W2.
LE RGNE DE MARABA.
189
demandrent sa mort. Un dignitaire de la cour mit
l'avis qu'il serait dangereux de supplicier le chef des
chrtiens, et les mages virent une fois encore avorter
leur projet. L'vque fut seulement enchan et gard
dans les prisons de la Porte Royale. Quand vint le mo-
ment o la cour s'acheminait vers les pays du Nord
1
,
le martyr dut faire partie du cortge. Il revint aussi,
la suite du roi, Sleucie. Pendant ce temps, il con-
tinua de grer les affaires du patriarcat, et il ordonna
mme un vque pour les lointaines tribus de l'Oxus
2
,
sur la demande de leur chef.
Enfin, un vnement singulier vint hter la dli-
vrance de Maraba. En l'anne 551, Anosazad
3
,fils de
Chosrau 1 et d'une chrtienne, qui avait t banni par
son pre Beit Lapat, la suite de quelque tragdie
de srail, leva l'tendard de la rvolte. Il groupa au-
tour de lui avec les mcontents, toujours nombreux, les
chrtiens fort puissants dans ces rgions, et marcha
sur Sleucie. Ds que le roi fut averti de l'insurrection
et de la part qu'y prenaient les chrtiens, son premier
mouvement fut de faire excuter Maraba
1
Mais il sc
i. Peut-tre pour l'expdition de Lazique qui eut lieu en t>\9. Dr EUI.,
Justinien, p. 217.
2. Hephtaray. JI s'agit des Haill, grec : ce sont
les Huns Blancs qui occupaient la Bactriane et les rgions voisines de
l'Oxus. A partir du v sicle, les rois de Perse soutinrent contre eux de
rudes guerres. L'empire des Huns Blancs fut dtruit environ vingt
ans plus tard :les Turcs dominrent au Nord de l'Oxus, et les Perses au
Rud de ce Oeuve. Le christianisme dut tre introduit dans ces rgions des
le v sicle, mais ne s'y organisa que sous le rgne de Maraba.
a. Jlie, p. !!60 et sui v. cr. TABARI, p. 467-474.
" Vie de Maraba, p. 2M: Les mages excitrent du tumulte devant
le roi cause du Bienheureux, en disant : Si le catholicos l'avair
voulu, la rbellion n'eut pas eu lieu Aussitt ils le firent attacher par
une lourde chaine au cou d'un satellite et le conduisirent la Porte
du Roi des Rois. Le Roi des Rois fut troubl de l'accusation des mages,
et il lui lit dire, par l'intermdiaire de son fidle Zad agu : Tu es contre
Notre Majest, et, cause de toi, les chrtiens se sont soulevs. Dans
beaucoup de provinces et de villes, les chrtiens se sont levs contre
. 11.
!90 LA RFORME DU VI SICLE.
ravisa, et invita le catholicos dtacher ses coreli-
gionnaires du parti d'Anosazad. En mme temps, il
dlivra Maraba de ses chanes et le confia la garde
d'un satellite. C'est ce moment, semble-t-il, qu'un
prtre envoy par le chef des Haitl vint solliciter
du catholicos la conscration piscopale. Le respect
du roi pour son prisonnier s'en accrut, et il envoya
Maraba dans le Huzistan pour lui permettre de com-
plter par sa prsence l'uvre pacificatrice qu'il avait
commence par ses lettres
1
L'vque russit dans sa
mission. Autant que les armes royales,l'autorit du ca-
tholicos contribua ruiner les esprances de l'usrpa-
teur. A son retour, le patriarche fut trs bien accueilli
par le monarque qui lui rendit sa complte libert
2
Maraba n'en jouit pas longtemps. Les souffrances
de tout genre qu'il avait endures avaient profond-
ment altr sa constitution
3
Il mourut, le 29 fvrier 552,
Sleucie, prs de l'glise de Beit o il avait
fix sa demeure
5
La dernire anne de sa vie avait t
les mages et les magistrats, les ont frapps et pills, et maintenant ils
organisent une rvolte. Pour toi, tandis que tu es en prison, tu consa-
cres des vques et des prtres, tu les envoies dans les provinces et tu
ne nous considres en rien. A cause de cela, je vais Immdiatement
donner l'ordre qu'on te crve les yeux, qu'on te jette dans une fosse et
que tu y meures
t. D'aprs MARE, p. 4t, Maraba crivit aux rvolts de Beit Lapat pour
les inviter se soumettre. La ville fut ensuite prise par Chosrau, et ce
roi menaa le patriarche de renverser les glises, s'il ne lui donnait de
l'argent. Craignant le sort de Simon ', Maraba til rassembler
de fortes sommes et les offrit au prince, mais en vain; car celui-ci le
laissa la discrtion de ses Si ce renseignement a de la
valeur, il faut plutt placer cette demande de subsides avant qu'aprs la
campagne contre cr. p .S, une autre anecdote d'un
ton tout diffrent propos du mme fait.
2. La captivit de lllaraba aurait dur en tout neuf ans (Vie, p. 1!67-272).
3. Vie, p. 1!70.
4. Saint Narcisse?
a. J,a chronologie de Maraba s'tablit donc de la sorte :
Election : janvier-fvrier 1140;
LE RGNE DE MARABA. !9l
consacre l'enseignement de son peuple et la con-
version des hrtiques. Il ramena au dyophysisme
l'entourage du roi des Arabes qui tait venu rendre
hommage Chosrau, son souverain. C'est pour cette
raison, peut-tre, que les chroniqueurs postrieurs
le font mourir ljirii
1
Le peuple des Villes Royales fit son pontife des
funrailles triomphales
2
Les mages avaient, parait-il,
song satisfaire sur le cadavre de l'vque les pro-
jets de vengeance qu'ils avaient d tant de fois ajour-
ner. Ils durent se retirer devant l'attitude menaante
de la foule. Enfin, aprs la reconnaissance officielle du
cadavre par les fonctionnaires royaux, les restes du
catholicos furent ports en grande pompe au monas-
tre de Sleucie.
Ainsi finit ce glorieux confesseur de la foi, la lumire
de l'glise de Perse, laquelle il lguait le double
trsor d'un enseignement irrprochable et d'une vie
exemplaire. L'uvre de Maraba lui survcut. Grce
ses efforts, continus par ses successeurs, la disci-
pline canonique se maintint dans son intgrit
3
; les
chrtients persanes purent traverser, sans subir de
dommages irrparables, les redoutables preuves que
leur rservait la malveillance de Chosrau II.
Voyage dans le Sud : fvrier-octobre 1HO;
Captivit en Adurbaidjan : 5.U-M8/9 (hiver);
Dtention la Porte Royale : MS/9, printemps 551;
voyage en Huzistan, et retour : t-automne 551 ;
Mort : !19 fvrier 1152.
t. MARE, p. 5; 'AIIR, p. !M.
2. Vie, p. !171.
3. Parmi les rformes dont il fut le promoteur, ~ U . R E (p. U) signale
qu'il interdit au patriarche d'tre mari. D'aprs 'Alla. (p. !M), cette
interdiction aurait t tendue aux vques. Les uvres de Maraba que
nous possdons ne nous permettent pas de contrler la valeur deces
informations.
!92 LA RFORME DU VIe SICLE.
S 2. -Le catholicos Joseph. Sa dposition (552-567).
Le roi ne permit pas que les prlats procdassent
rgulirement l'lection d'un catholicos. Il nomma
directement le successeur de Maraba, et les vques
durent s'incliner. Le bnficiaire de la faveur royale
tait un mdecin, Joseph, qui avait trait Chosrau
avec succs. Joseph avait fait ses tudes mdicales
dans l'Empire byzantin
1
, et, de retour Nisibe, avait
embrass la vie monastique. Tout porte croire qu'il
tait vers dans les sciences religieuses. En tout cas,
il s'y appliqua ds sa promotion au catholicat
2
, qui
eut lieu en mai 552
3
Mais il ne se crut pas oblig de suivre la tradition
canonique de ses prdcesseurs. Il commena par
ajourner le synode gnral qui suivait ordinairement
de prs la nomination du patriarche. Il dclara tout net
aux vques assembls Sleucie, moins pour faire un
choix que pour canoniser celui de Chosrau, que les
circonstances ne lui paraissaient pas favorables la
tenue d'un synode. L'anne suivante, les vques insis-
tent. Nouveau refus du catholicos. Des causes ur-
gentes et des affaires nous retinrent, dit-il, nous prou-
vmes des difficults, et il nous a sembl ... qu'il tait
inutile d'crire avant que toutes les affaires qui pr-
sentaient des difficults eussent reu une ''
Nous ignorons en quoi consistaient prcisment ces
difficults qui retardaient la convocation du concile. Il
1. Peut-tre sous la direction de Sergius. AMR (p. 2l) dit que Joseph
passa la plus grande partie de sa vie en Occident.
2. MAllE, p . .W. 'AMR, p. !M. BARHBRAEUS, Chron. eccl., 95 et sui v. Syn.
orient., p. 35'!-367.
3. Syn. orient., p. 353.
4. Syn. orient., p. 35t.
LE CATHOLICOS JOSEPH.
193
nous est possible d'en dterminer quelques-unes, par
conjecture. L'animadversion du Roi et des mages
l'endroit de Maraba avait sans doute amen une
trange confusion dans les affaires ecclsiastiques. Les
grands officiers, suivant l'exemple du prince, s'in-
graient dans le gouvernement intrieur de l'glise.
Le canon rv du synode de Joseph
1
rprouve les coali-
tions qui se formaient entre clercs et lacs pour in-
fluencer l'lection des vques, et le canon IX
2
nous
apprend que plusieurs prtres aspiraient l'pis-
copat sans autre titre que le crdit de leurs patrons.
Des vques ou des prtres interdits faisaient interve-
nir des lacs notables pour obtenir leur pardon sans
accomplir la pnitence canonique
3
Enfin des scu-
liers qui ne sont pas mme dignes de la communion
et de la paix de l'glise osaient siger dans les syno-
des .t, y occuper les premires places et se faire juges
des clercs et des vques.
Le catholicos lui-mme agissait comme les fonction-
naires royaux. Il entendait tre omnipotent et se passer
du concours des vques pour diriger l'glise orien-
tale. Seulement, il proposait leur signature les d-
cisions qu'il avait prises leur insu ou contre leur
gr, exigeait des blancs-seings, et, en cas de refus,
anathmatisait, dposait et suscitait des ennuis .
Euphmisme agrable qui dguise des vexations de
tout genre
5
Joseph ne put pas diffrer indfiniment la tenue de son
synode gnral. Ille runit Sleucie en janvier 554. Le
concile ouvrit ses travaux par une profession solennelle
t. Syn. orient., p. 357.
2. Syn. orient., p. 3119.
3. Syn. orient., p. 360.
"' canon xm, Syn. orient., p. 36i.
5. Canon vu, p. 358.
......
LA REFORME DU VI SIECLE.
de la foi orthodoxe dirige contre les monophysites.
Les Pres affirmrent leur croyance la dualit de
natures en Jsus-Christ, mais repoussrent avec ner-
gie l'imputation calomnieuse des Svriens qui pr-
tendaient qu'en divisant les natures, les Orientaux in-
troduisaient un quatrime terme dans la Trinit
1
Puis
ils composrent vingt-trois canons, pour rgler les
affaires pendantes et renouveler les dcisions de Ma-
raba touchant le mariage et la fornication. Les ca-
nons vu, xiv, xv, xvm et xxi dterminent le mode
d'lection et les limites de la juridiction du pa-
triarche.
Joseph souscrivit, avec quatre mtropolitains et
treize vques. Deux autres mtropolitains et seize
vques adhrrent plus tard -au synode. Parmi les
Pres de ce concile, on remarquait Paul, mtropolitain
de Nisibe, le controversiste Simon d'Anbar qui eut plus
tard des dmls avec le patriarche, et l'vque de la
Nouvelle- Antioche fonde par Chosrau 1, Clau-
dianos
2
On pouvait penser que le synode gnral pacifierait
l'glise persane et rfrnerait dfinitivement l'auda-
cieuse imptuosit du catholicos. Il n'en fut rien.
Appuy sur le Roi des Rois dont la faveur ne se d-
mentait pas, qu'avait-il craindre de ses suffragants?
Il semble avoir svi particulirement contre les vques
de son parchie. Il dposa Malka de Darabgerd et l'v-
que de Zab, protgs cependant par Chosrau
3
Il s'acharna surtout contre Simon d'Anbar, qui
peut-tre tait en contre lui, comme il l'avait
t. Syn. orient., p. 31l5.
2. Ce point toutefois n'est pas certain. Cf. art. lllal;loz J}edata. Syn.
orient., p. 676,
3. M!RE, p. 4,7.
LE CATHOLICOS JOSEPH. 195
t contre Maraba
1
; il le fit incarcrer avec l'aide
du marzban de Beit Aramay. Simon avait, suivant
l'usage, dress un autel dans la prison o il tait consi-
gn2 et clbrait la liturgie avec ses clercs. Joseph y
pntra un jour, et, dans sa fureur, renversa l'autel
etfoula aux pieds les oblats. Simon mourut sur ces
entrefaites
3
Les vques se plaignirent enfin et adressrent au
catholicos une ptre collective. Il n'en tint pas compte.
Un synode se runit et pronona sa dposition. Il con-
tinua nanmoins de procder aux ordinations et de
faire des actes de juridiction patriarcale.
Mais enfin les plaignants levrent la voix assez haut
pour tre entendus la Porte Royale. Il n'est pas t-
mraire de penser que des prsents adroitement dis-
tribus contriburent mettre en balance le crdit du
tyrannique patriarche. Peut-tre aussi Joseph ne rus-
sissait-il plus avec le mme bonheur prserver la
sant royale. Un mdecin de Nisibe, nomm Mose, sui-
vant les uns, et Narss, suivant les autres, parvint
transmettre au prince les dolances des chrtiens op-
prims. D'aprs les annalistes\ il usa d'un ingnieux
apologue. Un pauvre, dit-il, tait entr dans la cour
du roi. Le roi l'aima et lui donna un grand lphant.
Tandis qu'ille conduisait chez lui, le pauvre se disait
en lui-mme, assez perplexe : La porte de ma maison
est trop troite pour donner accs l'animal, et ma
maison ne pourra le contenir, mme si je dtruis la
i. Syn. Of'ient., p. 366, n. 3.
1. C'tait vraisemblablement une maison prticulire.
3. MARE, p. 46-7. Al!la, p. !15. Les annalistesrapportent d'aufi'es traits
surprenants de l'arrogance de Joseph. li parait qu'il ne craignit pas de
faire attacher la mangeoire de ses curies, comme des animaux, des
fidles et des prtres qui avaient affaire lui.
t. MARE et 'Al!ln, loc. cil. Cf. Syn. orient., p. 352, n. t.
i!l6
LA RFORME DU VI SIECLE.
porte. Du reste, je ne pourrai jamais nourrir la bte.
Il reconduisit l'lphant chez le roi et le supplia en ces
termes : Je t'en prie, par Dieu, aie piti de moi, re-
prends-moi cet lphant que je ne puis garder ni nourrir,
et que ma maison ne saurait contenir. Chosrau com-
prit et dit au mdecin : Que voulez-vous donc que je
fasse? - Eh bien, reprit l'orateur, retire-nous ton
lphant.
Alors les vques se runirent, destiturent Joseph
et le rduisirent la communion laque. Nous ne sau-
rions dire au juste en quelle anne se produisit cet
heureux vnement, car la chronologie de Joseph est
assez incertaine. On peut accepter comme assez vrai-
semblable la date de 567, propose par l'annaliste
Mare
1
Toutefois, Joseph tait si bien en cour qu'on n'osa
t. P. n. voudrions tre mieux renseigns sur l'attitude qu'obsena
Chosrau 1 vis--vis des chrtiens sous le rgne du catbolicos Joseph.
Il est probable que depuis la mort de Maraha, la perscution ne svis-
sait que par intermittences. J.es nobles d'extraction iranienne taient
peut-tre seuls inquiets. Nous possdons en grec les Actes d'une
martyre, sainte parente d'une sainte ro>.1voux. Cette sainte, dont
le nom persan tait sans doute Sirin, naquit Karka de Beit Slokh de
parents mazdistes. Baptise par l'vque Jean, elle fut dnonce au rad
local, puis conduite auprs du roi l;lolwan et trane sa suite de pro-
vince en province. Elle prit trangle Sleucie le t8 Peritios de
l'an 870 (!!!!fevrier 559). Ses reliques furent transportes chez un cer-
tain Bata de J.asom. Plusieurs autres confesseurs dont l'hagiographe
ne sait pas les noms avaient souffert avec sainte Sira. L'auteur se donne
comme contemporain des faits qu'il raconte. Acta SS., t8 maji, IV,
p. i70-182. La situation des chrtiens persans s'amliora srement
lorsque la trve propose en 555 par Chosrau Justinien se transforma
en 562 en un trait dfinitif. La paix tait conclue pour cinquante ans,
et les Perses consentaient vacuer la Lazique; mais l'empereur
achetait chrement cet avantage. 11 promettait de payer annuellement
la Perse un tribut de 30.000 aurei, et d'un seul coup il acquittait par
a vance ce tribut pour les sept premires annes; par une convention
annexe, Justinien obtenait pleine tolrance religieuse pour les chrtiens
qui habitaient en Perse, mais sous la condition expresse de n'y point
faire de propagande religieuse. DIEIIL, Justinien, p. 217, d'aprs ME
NANDRE, d. de Bonn, p. 359-64.
LE CATHOLICOS ZCHIEL. i97
pas lui choisir un successeur. Le patriarche dpos
soutint sa cause avec une nergie bien conforme son
caractre. Ds qu'il se sentit menac, il rdigea divers
crits, tous destins affirmer la primaut absolue du
sige de Sleucie et l'universelle et suprme juridic-
tion de son titulaire. D'aprs lie Djauhari
1
, il composa
un Catalogue des patriarches qui, sans doute, tendait
dmontrer l'apostolicit du sige de Sleucie. Barh
braeus
2
lui attribue la paternit du recueil apocryphe
qui nous est parvenu sous le nom de Papa. Il augmenta
du moins ce dossier dont certaines pices existaient
avant lui. Mais ses efforts furent vains. Aprs sa mort,
son nom fut ray des diptyques de l'Eglise nesto-
rienne
3
S 3. - Les ponWicats d'zchiel et d'ISo 'yahb I
(567-585).
La succession de Joseph fut dvolue, avec l'appro-
bation du r o i ~ , zchiel
5
, vque de Zab et disciple
de Maraba
6
La personne de ce patriarche nous est fort mal
connue. Barhbraeus
7
dit qu'il tait gendre du catho-
licos Paul. Les chroniqueurs nestoriens prtendent, au
contraire, qu'il avait t le serviteur de Maraba et son
t- Cit dans ASSEIIAIII, Bibl. orient., Ill, p. ~ 3 5 ,
2. Chron. eccl., 11, col. 31.
3- Il fut enseveli Pr6zsabur ('AMR, p. !.>;)
.t- 'AMR, p. 25; MARE, p. 47. BARUBRAEUS, Chron. eccl., II, col. 97. Syn.
orient., P- 368-389- Aprs une vacance dont nous ne pouvons dtermi-
ner la dure, trois ans d'aprs B!RHBRAI!!Us, loc. cit.
a. Suivant liA RE (p. 48), zchiel aurait vinc un docteur de Sleucie,
nomm Mar.
6. Voici ci-dessus, p. t69, n. 3.
7. Loc. cit. B. o., 111, p. 43:1.
198 LA RFORME DU VIe SICLE.
boulanger, et que plusieurs s'tonnaient qu'il
nomm vque de Zab
1
~ l
et t '
Nous ne connaissons d'une manire certaine que
deux vnements de la vie d'zchiel : un voyage
qu'il fit Nisibe la suite de Chosrau I en 573,
l'occasion de la reprise des hostilits contre les
Romains, et le synode qu'il tint, au mois de fvrier
576
2
, assist de trois mtropolitains et de vingt-sept
vques.
Ce synode adopta trente-neuf canons qui consti-
tuent eux seuls comme un code du droit eccl-
siastique. Mais ils ne refltent que peu ou point l'tat
actuel de l'glise persane. A peine un rappel, dans le
prologue, des tentatives de schisme qui s'taient pro-
duites sous Joseph et des dissidences qui avaient pr-
cd et peut-tre suivi l'lection d'zchiel. Seul, le
canon I, dirig contre les Met;;alliens
3
, revtus de
l'habit trompeur des asctes, dcle l'inquitude des
prlats nestoriens devant la propagande secrte, mais
d'autant plus active, des moines monophysites.
L'intrpide Jacques Barade
4
, le restaurateur du
monophysisme, n'avait pas lui-mme pntr dans
l'empire perse. Mais, ds 559, il avait ordonn, comme
vque de Tagrit, Al;mdemmeh
5
, homme galement
i. Nous ne sommes pas mieux. renseigns sur la dure de son rgne
et sur les vnements qui le signalrent. Son successeur ISo'yahb 1 fut
lu en SSi/3, puisque sa quatrime anne concide avec la huitime
anne du roi Hormizd. Mais cette lection ne fut-elle pas prcde
d'une vacance? Nous ne saurions le dire. Nous avons, d'autre part, adopt
ci-dessus la date de 567 comme celle de la dposition de Joseph. Si l'on
accepte la tradition de BAautaaAEus sur la vacance du catholicat, d'une
part, et, de l'autre, les renseignements de MARE (p. 48 et t9) sur la dure
du rgne d'zchiel, on doit adopter pour son lection la date de 570/1
et pour sa mort celle de SSOft. cr. Syn. o1ient., p. 370, n. i.
2. Synod. orient., 368.
a. Syn. orient., p. an.
t. R. DuvAL, Litt. syriaque, p. 36!.
5. Sa Vie, extraite d'un ms. de Londres, m'a t communique obli-
~ - . .;;
LE CATHOLICOS ZECHIEL. i911
considr pour sa science et pour la puret de ses
murs. Ce prlat mena une campagne hardie en
faveur de sa doctrine, lui recruta des adhrents jusque
dans la famille royale et, pour avoir baptis un des
fils de Chosrau Ir, auquel il donna le nom de Georges,
fut excut dans sa prison, en 575.
Plus efficace encore tait l'action des prdicateurs
insaisissables qui, partant du Tur 'Abd in, acquis en ma
jeure partie aux Jacobites, ou parcourant les routes
commerciales du dsert sous la protection des Ghassa-
nides, allaient rveiller les enthousiasmes un peu en-
dormis des captifs romains et syriens qui peuplaient la
Msopotamie et la Chalde. On sait combien large-
ment Chosrau Ir avait us du systme de la dporta-
tion. Chaque convoi de prisonniers qui descendait
le Tigre ou l'Euphrate venait grossir les rangs des
Jacobites. La sympathie du gouvernement de Byzance,
depuis l'volution de Justinien vers les partisans de
Svre jusqu' l'avnement de Maurice, ne leur fit pas
dfaut. Le moment approchait, o une des favorites
d'un roi de Perse allait mettre sa grande influence
au service des monophysites et branler la situation,
en apparence inattaquable, de la hirarchie nesto-
rienne1.
Ce fut le mrite d'zchiel d'avoir pressenti le dan-
ger. Il ne put cependant le prvenir, et ses succes-
seurs durent poursuivre la lutte. Sur la fin de ses
jours, il fut frapp de ccit, en punition, disent les
annalistes, de la svrit excessive avec laquelle il trai-
tait ses collgues dans l'piscopat
2
geamment par M. l'abb Nau. WRIGHT,Catal. Add. t2t72. Cf. BARHBRAECS,
col. 99 et Bibl. orient., Il, p. U6 el sui v., Ill, p. t ~ et sui v.
t. Voir ci-dessous, ch. vm, p. met suiv.
2. 'AIIR, p. 26; MARE, p. 48.11ARBBR., col. 91. Bibl. orient., Ill, p. 436.
200 1.< REFORME DU VI SIECLE.
Cependant Chosrau I tait mort en 579, aprs avoir '
rgn quarante-huit ans
1
Son fils Hormizd IV lui succda. Ce prince reprit la
guerre contre Byzance, et la continua durant tout son
rgne, avec des alternatives de succs et de revers.
Aucun vnement important ne signala cette longue
lutte. On aurait pu penser que les chrtiens en subi-
raient le contre-coup. Il n'en fut rien. Contrairement
son pre
2
, le nouveau roi ne s'appuya pour gouverner
ni sur les nobles ni sur le clerg. Peut-tre ces deux
castes avaient-elles acquis, grce au grand ge de
Chosrau Anosarwan, une influence trop prpond-
rante, dont un prince dsireux d'exercer son pouvoir
personnel ne pouvait que prendre ombrage. Hormizd
fut donc amen, comme Iazdgerd 1 et pour des raisons
analogues; se montrer favorable aux chrtiens.
Tabari
3
nous a conserv la rponse qu'il fit aux mages
un jour que ceux-ci se plaignaient de la propa-
gande chrtienne et demandaient des mesures restric-
tives : De mme que notre trne royal ne peut se
tenir sur ses deux pieds de devant, s'il ne s'appuie
galement sur les deux de derrire, ainsi notre gou-
vernement ne peut tre stable et assur si nous fai-
sons rvolter contre nous les chrtiens et les secta-
teurs des religions trangres notre foi. Cessez
donc de vous lever contre les chrtiens, mais effor-
cez-vous avec zle de faire de bonnes uvres, la vue
Il fut enseveli Sleucie suivant MARE, l;lira suivant 'AMR. Sous son
rgne cessa une effroyable pidmie de peste bubonique qui avait d-
sol la Perse pendant une dizaine d'annes. A l'occasion de ce Oau fut
institu dans l'glise nestorienne le jene des Ninivites , dont la
tradition s'est continue jusqu' notre poque. 'AMR, p. 25. p. n.
Cf. Syn. orient., p. 370, n. 2.
l. TABAR!, p.
2. TABAR!, p. 26l, n. 5.
3. P. !168. Cf. MARE, p. 48.
LE CATHOLICOS I. 201
desquelles les chrtiens et les sectateurs des autres
religions vous loueront et se sentiront attirs votre
religion >>. La scne, telle que la raconte l'annaliste
persan, peut bien n'tre pas historique. Mais elle d-
peint avec exactitude la situation des chrtiens sous
le rgne d'Hormizd, et se trouve en parfait accord
avec nos sources nestoriennes
1
Aussi, lorsque zchiel mourut, la transmission des
pouvoirs parat s'tre effectue sans difficult et sans
trop de dlais. Malgr les prtentions d'un docteur de
Sleucie, Job, parent du clbre Narss
2
(?), Iso'yahb,
vque d'Arzun
3
, fut lu avec le consentement, et peut-
tre sur la dsignation du Roi des Rois (582/3). On
dit que la faveur dont il jouissait auprs d'Hormizd
tait due aux services qu'il avait rendus aux armes
royales, en les renseignant sur les mouvements des
Romains. Nous n'avons aucun motif de rejeter cette
explication. Au contraire, il est naturel de penser que,
de sa ville piscopale, situe aux confins de l'empire
romain et de la Persarmnie, il pouvait aisment se
procurer d'utiles indications sur les prparatifs de
guerre et les combinaisons stratgiques des gnraux
byzantins
1. l.a J'ie de Sabri!o ',cite plus bas, p. 11111, parle de qu<iques glises
qui auraient t dtruites sous Je rgne d'llormizd. Ce renseignement
ne saurait in6rmer l'apprciation gnrale que nous venons de for-
muler. Il ne raut pas oublier que, sous les rois les plus favorables aux
chrtiens, ceuxci furent souvent maltraits par les mages, surtout
dans les provinces loignes oll dominaient les sectateurs du culte du
reu.
Il. MARE, p. 49. 'AIIR, p. 116.
3. ASSEIIANI, Bibl. orient.,ll, p. 215; lll, p. 1081H; DARORRAECS, Chron.
eccl., Il, 105; M&RE, p. 49; 'AIIR
1
p. 26; Syn. orient., p. 3!KH56. R. DHAL,
Litt. syriaque, p. 3!H.
4. Les annalistes MARE ct Aun (loc. &up. cit.) disent que le roi de
Perse dputa lso'yahb comme ambassadeur auprs de Maurice. L'em
pereur !Jyzantin aurait ravoralllement accueilli le catholicos, et sur la
202 LA RFORME DU VI SICLE.
Iso'yahb tait originaire de la province de Beit
Arbay. Il avait tudi Nisibe sous la direction du
docteur Abraham. La clbre cole tait alors trs
florissante, et le futur catholicos s'y instruisit des
matires canoniques et liturgiques, sur lesquelles il
composa, peut-tre tandis qu'il occupait le' sige d'Ar-
zun, un commentaire auquel il renvoie ses correspon-
dants. La lettre trs tendue qu'il crivit Jean de
Dara nous donne une haute ide de son savoir. C'est
bon droit qu'elle a t insre dans le Synodicon
1
Dans la quatrime anne de son pontificat, huitime
du rgne d'Hormizd
2
(585), il tint un synode gnral
Sleucie, assist de deux mtropolitains et de vingt
vques.
Simon de Nisibe et les vques de son parchie,
ainsi que Grgoire de Rewardasir et ses suffragants,
avaient refus de rpondre la convocation qu'Iso'yahb
avait pourtant ritre. Le premier tait sans doute un
partisan de IJenana
3
qui fut condamn au concile. Le
second s'abstint pour des raisons demeures incon-
nues, simplement peut-tre en vertu de la tendnce
qui portait les vques de l'lam et du Pars se pro-
clamer indpendants de l'vque de Sleucie.
Les trente et un canons de ce concile sont trs impor-
tants pour l'tude du droit canon oriental.
prsentation de sa profession de foi, aurait communiqu avec lui in
sacris. M. Chabot (Syn. orient., p. 45!1, n. 3) a relev quelques-unes des
inexactitudes qui se rencontrent dans les rcits de nos chroniqueurs.
J'ajouterai que Cyriaque, qui, selon 'Amr (p. !i7), occupait alors le sige
de constantinople, ne fut lu patriarche qu'aprs la mort d'JSc>'yahb,
puisqu'il rgna de 590 606. Je crains que. les chronographes nestoriens,
ou leurs sources, n'aient tout simplement attribu, par suite d'une
grossire mprise, le rle que joua rellement lso'yahb 11, accrdit
par Boran auprs d'Hraclius, son homonyme lso'yahb 1.
1. P. -i!U.
2. Syn. orient., p. 392.
3. Voir sur les J,lenanlens et leur doctrine, les ch. vm et IX.
LE CATHOLICOS ISO'YAHB 1. 203
Le canon 1 est dirig contre les monophysites
1
et con-
tient une exposition trs soigne et trs serre de l'or-
thodoxie dyophysite. Le canon 11 vise des ennemis
intrieurs, ces perturbateurs de l'orthodoxie>> qui,
la suite du docteur ljenana de Nisibe, refusaient de
tenir pour canonique et obligatoire l'exgse de Tho-
dore de Mopsueste. Des bgues et des importuns
s'attaquent lui comme des scarabes et des grillons
sortant des ravins ou des fosses de l'erreur. >> Sur
l'initiative le concile frappe d'excommuni-
cation les imprudents novateurs et leur chef. Nous
dfinissons donc
2
qu'il n'est permis aucun homme ...
de blmer ce docteur de l'glise en secret ou en pu-
blic, de rejeter ses saints crits ou d'accepter cet autre
commentaire qui est tranger la vrit et a t inter-
prt, ainsi que nous l'avons dit, par un homme ami des
fictions, ami de l'lgance du langage contraire la v-
rit, semblable aux prostitues qui aiment une parure
provocatrice.
Cette condamnation, . si elle ne mit pas fin .aux dis-
sensions intestines de l'Eglise orientale, contribua, du
moins, en attnuer l'effet; mais plus encore que les
anathmes les calamits qui assailliront l'-
glise de Perse, lorsque la bienveillance de Chosrau II
se sera change en mauvais vouloir, puis en hostilit
dclare, dcideront de l'union de tous les Nestoriens
contre le Jacobitisme, menaant d'abord, puis prpon-
drant la cour et oppresseur de l'orthodoxie dyo-
physite.
Le rgne d'Hormizd se termina brusquement par
une de ces tragdies de palais frquentes dans l'his-
1. Syn. orient., p. 393.
11. Syn. orient., p. 4uo.
204- LA RFORME DU VI SICLE.
toire des Sassanides
1
Un haut dignitaire de l'empire,
Bahrii.m obin, originaire de Ra, commandait les con-
fins militaires de l'Hyrcanie et du Khorasan. Au lieu
de dfendre les frontires contre les incursions des
Turcs, il rassembla toutes les troupes dont il pouvait
disposer et marcha dans la direction de Sleucie pour
s'emparer du pouvoir. Les grands du royaume qui d-
testaient cordialement Hormizd, mais entendaient res-
ter fidles la dynastie sassanide, prvinrent l'usur-
pateur. Ils dtrnrent le prince, lui crevrent les
yeux; mais ils proclamrent immdiatement l'avne-
ment de Chosrau, fils du monarque dpos.
Bahrm, dont cette prompte dcision rendait les es-
prances illusoires, ne reconnut pas le nouveau roi et
continua sa marche en avant. Chosrau, n'ayant pas le
temps de grouper autour de lui une arme suffisante,
s'enfuit, par la voie royale de Sleucie l'Euphrate,
la ville de Perozsabur. Il ne s'y sentit pas en sret, et,
s'engageant, comme fugitif, sur une route que les
armes persanes avaient coutume de suivre lorsqu'elles
envahissaient la Syrie romaine, il remonta le cours
de l'Euphrate et arriva Kirkesion, puis Antioche,
o il confia son sort la gnrosit de l'empereur
byzantin. Maurice connaissait la Perse contre laquelle
il avait guerroy avec succs sous Tibre. Il saisit
avec empressement l'occasion qui s'offrait lui de s'im-
miscer dans les affaires intrieures du grand empire
rival, et s'rigea de suite en champion de la lgitimit
sassanide.
Il donna Chosrau des troupes romaines
2
Bahrm
t. TABARI, p. 370 et ~ 0 - 3 t . Gum1, Un nuovo testo sulla storia degli
Sassanidi, nouvelle dition ; Chronicon anonymum, dans Chronica
minora, Paris, t903. Version latine, p. ta. Nous citerons d'ordinaire
d'aprs cette version.
2. Commandes par Narss assist de plusieurs diplomates. Le nom
LE CATHOLICOS IsoYAHB 1. 205
ne put tenir contre les partisans de la dynastie sassa-
nide que les renforts byzantins avaient groups autour
de Chosrau, sous la conduite des deux frres Bindo et
Bistiim et de l'Armnien Musel. Il s'enfuit dans l'Adur-
baidjan pour se mettre en situation, sans doute, de
faire appel de nouveaux contingents turcs. Les deux
armes s'y rencontrrent et Bahriim fut vaincu. Il put
toutefois s'enfuir chez ses allis, de l'autre ct de la
mer Caspienne.
Une seconde rvolte menaa le trne peine affermi
de Chosrau II. Ses plus chauds partisans, les deux
frres Bindo et Bistiim
4
, qui d'ailleurs lui taient unis
par les liens du sang, levrent l'tendard de la rvolte.
Chosrau avait confi Bistiim le commandement de
la frontire turque, pour s'assurer contre un retour
possible de Bahriim. Bindo, qui avait se plaindre
du jeune roi, voulut aller rejoindre son frre. Le marz-
ban d'Adurbaidjan l'arrta au passage et le renvoya
Sleucie. Dj Bistiim, la tte des auxiliaires du
Turkestan et du Giliin, se disposait envahir la valle
du Tigre. Mais un de ses mercenaires turcs lui coupa
la tte qu'il expdia Chosrau. Bindo et les autres
rebelles furent traits avec la rigueur coutumire, et
Chosrau II Parwz devint le matre incontest de
l'empire des Sassanides.
Son triomple dfinitif amena, parmi beaucoup d'au-
tres rsultats, la fuite du catholicos rsoyahb 1
2
Ce pr-
lat, soucieux avant tout de l'intrt de son glise, avait
vit de se compromettre avec les comptiteurs qui se
de l'un d'entre eux, Georges, prfet du prtoire, qui accompagnait peut-
tre ou reprsentait le jeune Thodose, nous a t conserv par la Yie
de S a b r i ~ , p. 305. Cf. TABARJ, p. 28!!, n. t, 284 et n. t.
t. Gcmt, Chronicon an!ln., p. t6; et la traduction allemande de Noel-
deke, p. 7. TABARI, p. 478-187.
2. GuiDI, Chronicon auon., p. t5 et t6; traduction Noeldeke, p. 9.
12
206 LA RFORME DU VI SICLE.
disputaient la succession de Hormizd. S'il n'avait pas
conspir avec Bahrm, il ne s'tait pas non plus pro-
nonc nettement en faveur du roi lgitime. Non seule-
ment il n'avait pas voulu l'accompagner dans son exil,
mais, lorsque Chosrau tait rentr en vainqueur la
tte des lgions byzantines, le patriarche n'tait pas
all au-devant de lui. Il se rencontra des rivaux et des
envieux, parmi lesquels l'architre Timothe de Nisibe,
pour dcrier ISo'yahb. Chosrau n'avait sans doute pas
besoin d'tre excit la vengeance. L'attitude du ca-
tholicos avait failli nuire au succs de ses ngociations
avec l'empereur Maurice, s'il faut en croire le Nestorien
anonyme publi par M. Guidi
4
Un seul parti restait prendre pour le catholicos :
se soustraire au ressentiment du Roi des Rois. Iso'yahb
quitta Sleucie et se rfugia auprs du prince des
Arabes, Nu'man, qui avait tout rcemment demand
le baptme. Il tomba malade dans les environs de J..Iira
et y mourut (594/5). La sur
2
de Nu'man, Hind la
jeune
3
, lui fit faire de solennelles funrailles et l'inhuma
dans un clotre qu'elle venait de faire
L Loc. cil.
!1. Et non sa fille. Chronique de Guidi, trad. Noeldeke, p. 9, n.
Corriger ainsi Bnotaa.u:us, Chronicon, col. tOII.
3. TAB.I.RI, p. 3-l7 et !W),
Ce serait le lieu de dire quelques mots de l'introduction du chris-
tianisme chez les Arabes soumis l'empire perse. l;flra, s'il faut en
croire le Synodicon orientale (p. !17:S), possdait un vque ds tto.
Les chrtiens de cette ville taient appels '/bad, c'est--dire : serviteurs
(sans doute serviteurs de Dieu, par opposition aux paens ;Tn.uu, p. !IJ,
n. > Au commencement du vt sicle, les Nestoriens et les monophysites
conduits par Simon de Beit Arsam (cr. ci-dessus, p. t:SS. n. t) s'y dis-
putrent la prpondrance. Les Nestoriens finirent par l'emporter. Mais
les princes de Vira restrent attachs au paganisme jusqu'au milieu
du v1 sicle. Le farouche Moundhir ibn Amralqais offrait la desse
Ouzza des victimes humaines.
Il comptait cependant, parmi ses pouses, une chrtienne, Hind (l'an-
cienne), appartenant la ramille des Ghassanides. Cette princesse amena
son fils Amr ibn Moundhir au christianisme, comme Je prouve l'inscription
LE CATHOLICOS 1. 207
ddicatoire du monastre qu'elle fit construire J.!ira : cette glise a t
bAtie par Hlnd, lille de Hrith Ibn 'Amr ibn Hodjr, la reine fille des rois et
mre du roi 'Amr ibn Moundhir, la servante du Christ, mre de son servi-
teur et fille de ses serviteurs, sous le rgne du roi des Rois Chosrau Anou-
scharwn, au temps de l'vque Mar phram. Que le Dieu pour lequel elle
a bti ce monastre lui pardonne ses fautes, qu'il ait piti d'elle et de son
fils, qu'ill'accueilleet la fasse rsider dans son sjour de paix et de vrit
et que Dieu soit avec elle et avec son fils dans les sicles des sicles!
(YaqoOt, 11, 709, cit par Duc&ESIIE, Lu aparea, p. 550). Aprs le
rgne d" Amr (554-569), son frre Ka bous ou du moins son autre frre, suc-
cesseur de Kabous, Moundhir ibn lloundhirrevint au paganisme. Nu'man,
qui rgna aprs lUJ, pratiqua l'idoltrie et les sacriftces humains. Il se
convertit par les soins d'15o'yahb et de Sabrii\o'. cr. DucoESl'IE, La gli
11e1 &parea, ch. vu : Les missions chrtiennes au Sud de l'empire ro
main, les Arabes , p. 337-351, et les citations qui y sont allgues
TABARt, p. 3!19, n. 1; an, n.t et348, n. t.
CHAPITRE VIII
CBOSRAU Il ET LES CHRTIENS
S 1. - L'avnement de Chosrau II. - Catholicat de
SabriAo'.
L'attitude indcise et le loyalisme douteux d'lso'yahb
ne produisirent pas alors tous les mauvais effets qu'on
et pu en attendre. En d'autres temps, les chrtiens
eussent subi une violente perscution. Mais les cir-
constances ne le permirent pas. La reconnaissance que
Chosrau devait l'empereur Maurice lui imposait une
attitude tolrante et mme favorable l'gard des
chrtiens persans.
Ce fut mme, semble-t-il, le seul bnfice rel que
Maurice voult retirer de sa gnreuse intervention,
car il ne rclama aucun avantage territorial ; la con-
tribution que versa Chosrau pour subvenir aux frais de
la campagne, consistait sans doute, comme le remarque
M. Noeldeke
4
, en la remise des arrrages dus par les
Romains aux Perses, en vertu des conventions ant-
rieures.
Chosrau proclama donc la libert de conscience dans
ses tats, sans permettre, bien entendu, que le pros-
t. T.I.BARI, \187, n.t, Cf; p.ll84
1
D, l et 3.
L'AVENEMENT DE CHOSRAU II. 209
lytisme chrtien s'tendt aux adeptes de la religion
officielle
1
A l'instigation de ses pouses chrtiennes,
l'Aramenne Sirin et la Romaine Marie
2
, il fit des
libralits aux glises. Il manifesta une dvotion sp-
ciale au martyr Sergius, lui btit plusieurs martyria
en territoire persan et ddia une croix d'or dans l'glise
de Sergiopolis en Syrie (Rer:>af). On racontait que
Sergius avait combattu pour Chosrau la tte de
l'arme byzantine, et la tradition populaire a pieuse-
ment enregistr cette lgende. Mais il ne fut pas le
seul prter un concours miraculeux au Sassanide.
C'tait un saint de Syrie, partant plutt monophysite.
I.es Nestoriens tinrent honneur de paratre, aprs
coup, aussi loyalistes que leurs ennemis.
Le bruit courut que, lors du retour de Chosrau dans
ses tats, un vieillard lui apparut, tenant la bride de
son cheval et l'exhortant marcher hardiment au com-
bat. Aprs la victoire, Chosrau fit part de sa vision
son pouse Sirin. Celle-ci, qui n'tait pas encore
convertie au monophysisme, ne resta pas court
d'explications. Elle affirma au Roi que ce vieillard
n'tait autre que le vertueux vque nestorien de La-
som, Sabriso' a.
Quand Iso'yahb mourut, le synode gnral sc runit
sur le dsir exprim par le roi, pour choisir un ca tho-
li o s ~ . Cependant, si l'on accepte les dates fournies par
lie de Nisibe
5
, la vacance du sige dura un peu plus
{, TABARI, p. 287, n, 3.
2. Gmm, Chron. anon., p. t6 ; trad. Noeldeke, p. to, n. 2. 'fADARJ,
loc. sup. cit., p. 28-t, n. t ; 283, n. !!.
3. GUIDJ, Chron. anon., p. t5. MARE (p. ISO) et 'AMR (p. 29) rattachent
cet incident la campagne de Chosrau contre Bistam .
.t. Syn. orient., p. 4 ~ et la n. !!.
:S. Cit dans BARUBRAEts, Chron. eccl., 11, col. 106, n. 3. cr. Chron.
anon., p. 16, 1. 29.
12.
210 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
d'un an. Quelles intrigues furent la cause de ce retard,
nous l'ignorons
1
La volont royale y mit enfin un
terme. Chosrau dsigna Sabriso' aux suffrages des
vques. Ceux-ci s'empressrent de dfrer ses or-
dres. Et, le 19 avril 596, jour de Pques, l'vque de
Lasom fut intronis Sleucie.
Nous avons la bonne fortune de possder une Vie de
Sabriso', compose par un contemporain, le solitaire
Pierre
2
Si le bon moine, qui, toutjeune, avait t guri
par le futur patriarche, s'est attach principalement '
ne rien omettre des miracles et prophties de l'homme
de Dieu, il nous a conserv galement de prcieuses
informations historiques.
Sabriso' tait originaire du bourg de Perozabad,
dans le district montagneux de Siarzur
3
, qui relevait
de la province de Beit Garma. Il exerait la profes-
sion de berger, et dj il se signalait par son zle
contre les hrtiques. Sa ferveur le conduisit em-
brasser la vie monastique, sous la direction d'un vieux
prtre nomm Jean. Il apprit le psautier par cur,
suivant l'usage du temps, et bientt se rendit l'cole
de Nisibe pour s'y perfectionner dans la connaissance
des critures. Son ardeur au trayail n'eut d'gale que la
duret avec laquelle il traitait son corps. Ses jet\nes
taient presque continuels : il ne mangeait que le di-
manche.
Ses tudes terminees, Sabriso' se rendit dans le
district de Qardu pour s'exercer la pratique de l'as-
i. D'aprs MARE (p. 5t) et 'AIIR (p. !19), le peuple et les vques avaient
prsent cinq candidats. Sabriso' n'tait pas du nombre. Chosrau en
demanda la raison. On lui rpondit que l'vque de Lasom tait trop
g. Le prtexte lui parut sans valeur.
!!. Publie par le P. BEDJAft dans le Recueil dont est extraite la Vie
de ltfaraba, p. 1!88 et sui v. Elle a t utilise par les chroniqueurs MAR&
et 'AMR.
3. v. NoELDEKE, Die von Guidi heramgeg. syr. Chronik, p. t7, n. "
LE CATHOLICOS SABRISO'. 2il
ctisme. Neuf ans aprs, il se rapprocha de son pays
d'origine, et se btit une cellule dans la montagne de
Sa'ran, o un disciple du nom de Job se mit son
cole. Sa renomme se rpandit bientt dans les r-
gions environnantes. Il usa de son prestige pour pro-
pager le christianisme dans les rgions de Radan, de
Belesfar et de Siarzur, o l'on comptait encore beau-
coup de paens, surtout parmi les tribus nomades
et demi insoumises qui parcouraient le pays.
Sa propagande trs nergique et trs fructueuse in-
quita les mages. Ils le dnoncrent aux fonctionnaires
royaux. Aprs diverses conjonctures, il fut, par ordre
du mobed local, envoy Karka de Beit Slokh, pour y
tre intern quelque temps. Saba, vque de Lasom,
mourut sur ses entrefaites. Sabriso' fut lu sa place.
Le pieux chroniqueur raconte que son hros avait pro-
phtis l'vnement ses disciples. A peine la prdic-
tion taitelle formule que le mtropolitain de Beit
Garma, Boktiso', se prsenta la porte de sa maison
avec plusieurs vques, et le consacra malgr lui
1
lev l'piscopat, Sabriso' continua ses pratiques
austres, dont il ne se relcha mme pas quand il fut
nomm catholicos. Attirs par l'clat de ses vertus, les
fidles accouraient Lasom comme au lieu de la
prcieuse Passion de notre Sauveur
2
. Les plus grands
personnages de la Perse et le roi Hormizd lui-mme
dsirrent jouir de sa prsence vnrable. L'empereur
byzantin Maurice se recommanda ses prires et lui
fit parvenir par ses ambassadeurs des cadeaux pr-
cieux
3
Cependant Sabriso' sans se lasser parcourait
1. Vie de Sabriio', p. 300.
'!. Op. cit, p. aot.
a. suivant MARE, p. 5!1, il ne rauut rien moins que l'intervention de
Chosrau pour que le catbolicos permit aux envoys de Maurice de faire
raire son portrait. Le mme annaliste raconte qu'un vque syrien ayanL
2!2 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
les provinces orientales pour y prcher Jsus-Christ.
Sa Vie nous le montre voyageant peut-tre jusque dans
la Perse propre, srement jusqu' l;lira o il fut, avec
l'vque de la ville, Simon, l'artisan de la conversion
du roi Nu'man
1
lu patriarche, Sabriso' usa de la faveur dont il
jouissait la cour pour faire reconstruire des glises
dtruites par les mages sous le rgne d'Hormizd et
pour dlivrer de nombreux prisonniers. La reine Sirin
lui btit mme un monastre
2
; il faut, sans doute, en-
tendre par l le clotre de saint Sergius, situ non loin
de la contre dont Sabriso' tait originaire, qui devint,
un peu plus tard, l'enjeu de la lutte entre les nestoriens
et les monophysites
3
Enfin, lorsque Chosrau reprit en 603/4 les hostilits
contre Rome, Sabriso' accompagna l'arme royale.
Mais ses infirmits et son grand ge - il avait plus de
quatre-vingts ans - le retinrent Nisibe, o il mourut
pendant le sige de Dara (604) Il fut enseveli, suivant
les uns, dans son clotre du Beit Garma; suivant
Salomon de Ba!?ra, dans la ville de l;lira. Le rensei-
gnement de ce dernier auteur ne semble pas exact,
moins qu'il ne s'agisse d'une translation ultrieure.
Le vieux catholicos lguait son successeur une si-
t envoy comme ambassadeur auprs du roi, dsira visiter le pa-
triarche. Un dignitaire persan, deux veques, Thodore de Ka!lkar et
Maraba, vque de Beit Daray, et Boktiso recteur de l'cole de Sleucie
lui firent cortge. L'vque ambassadeur pensait trouver le catholi-
cos richement habill comme ses collgues byzantins. Il vit un homme
misrablement vtu, et se retira grandement tonn et difi.
:1. v. ci-dessus, p. 206, n. 4.
Il. Cf. THOMAS DE Histoire monastique, 1. 1, Ch. XXIII j d. Budge,
t. Il, p. 80, n. 5. Vie de Sabri8o', p. 306.
3. Voir ci-dessous, p. 2118.
4. Un dimanche du mois d'aot d'aprs cit par lie de JSisibe.
B!RBBRAEUS, Chronicon, col. :108, n. 2. cr. 'AMR, p. 30. MARE, p. 53. GUIDI,
Chron. anon., p. :19. Bibl. orient., 111, p. U3. Hi&t monast., d. Budge, 11,
p. 86, n. 7.
LE CATHOUCOS SABRISO'. 2t3
tuation passablement embrouille. Son principat avait
t troubl par des luttes intestines dont l'pret, conte-
nue peut-tre par le respect dont sa personne tait en-
toure, ne fit que redoubler quand il eut disparu. L'or-
thodoxie nestorienne courut, ce moment, un triple
danger de la part des des l;lenaniens et des
monophysites. Nous rservant d'insister plus loin
4
sur
les manifestations purement dogmatiques de la polmi-
que, nous indiquerons ici les phases de la lutte et les
principaux vnements qui la marqurent. C'est la
trame mme de l'histoire de l'glise persane entre les
annes. 570 et 630 que nous nous proposons de recons-
tituer.
Les nous sont assez peu connus. Leur nom
signifie les priants
2
et correspond au grec ti'.O!'Evot
(tx_hru). Ils se recrutaient surtout parmi les religieux.
Si nous comprenons bien les dcisions canoniques qui
les concernent, c'taient des moines gyrovagues et in-
dpendants, des ermites ambulants sans suprieur res-
ponsable qui se rpandaieQt par tout le pays, comme les
t. Ch. n, p. 278 et sui v.
Syr. Sur celte secte qui infesta l'Orient tout entier du tv
au xu sicle, voir TILLEIIOin, Hisl. eccls., t. VIII, p. ffltitl, et l'article
de Herzog'& Realencykl. : Massalianer Pour leur action au sein de
l'glise nestorienne, v. Syn. orient,. p. 3H, <161 et sui v. HorriiANN, A us-
zge, p. :10-l, :121, tti. Ba ba le Grand, archimandrite d'Izla, les combattit
nergiquement (Hisl. monast., 1. 1, ch. xx vu). il rfuta souvent leur doc
trine dans ses ouvrages, notamment dans son Commentaire sur les
Centuries d'Evagrius, conserv dans le !Ils. S)'f. Vat. 176. D'aprs ce Com-
mentaire, p. ti3, les mprisaient et rejetaient le baptme;
ils soutenaient que la prire suffit procurer la grce de l'Esprit-Saint,
que nous pouvons tre parfaits ds cette vie, en On que les sacrements
n'ont point d'efficacit. Je dois la communication de ce ms. l'obli-
geance de M. le D'Braun. - Voir pour le vm sicle, le tmoignage de
l'hrsiologue TntonoRE BAR KnouNJ, cit par Pognon : Inscriptions man-
dai tes des coupes de Kho-uabir, p. t39, et la rtractation que Timothe 1
exigea de Nestorius de Beit Nuhadra dans ma thse : De Timotheo 1
Nestorianorum patriarcha, cb. n, p. 22. v. aussi Bun GE, Hist. monast.,
t.. 11, p. 9t, n. 3.
2t4 CHOSRAU ll ET LES CHRTIENS.
faqirs du monde musulman, mendiant leur nourriture
et au besoin la volant, dissimulant sous une austrit
apparente des murs fort dissolues, pntrant, grce
. leur profession extrieure, dans les maisons chr-
tiennes et s'y livrant toutes sortes d'excs. On leur
attribuait aussi des pratiques de sorcellerie, qui pou-
vaient tre fort lucratives. Leur orthodoxie tait, bon
droit, suspecte. Ces irrguliers paraissent avoir t
fort nombreux en Adiabne et surtout dans les mon-
tagnes de Siggar, situes entre le Tigre et l'Euphrate,
au sud de Nisibe.
Le catholicos SabriSo eut le bonheur d'en rduire
un certain nombre une observance plus rigoureuse.
Nous avons conserv le pacte que signrent ces moines
au mois Adar de la huitime anne de Chosrau
(mars 598)
1
Ces religieux promettaient d' " honorer
les Pres gyptiens et tous les Pres qui ont perfec-
tionn notre genre de vie ; ils s'engageaient la
rsidence et s'interdisaient de circuler dans les villes
et les villages. Enfin ils un clotre Bar-
qaiti et en faisaient un centre de vie cnobitique o
l'on instituait la psalmodie canoniale. Sabriso leur
donna un chef unique sous l'obdience duquel il groupa
toutes les laures de la montagne et du dsert de Sig-
gar.
Les l;lenaniens formaient un parti plus redoutable
encore. Au point de vue dogmatique, ils se rattachaient
l'orthodoxie chalcdonienne et confessaient en Jsus-
Christ une personne, une hypostase et deux natures
2
Influencs probablement par l'issue de la querelle des
Trois Chapitres dans le monde byzantin, 'attachaient
plutt l'exgse de saint Chrysostome qu' celle de
i. Syn. orient., p. 46!-465.
2. Voir ch.lx, p. !80, HOFFIIANN, A mzge, p. H6. Syn. p.6t6-&.19.
LE CATHOLICOS SABRISO'. 2{5
Thodore de Mopsueste l'Interprte . En
quence, Baba le Grand, leur ennemi, les traite d'ori-
gnistes, de panthistes et surtout de fatalistes
1
, par
o il faut entendre sans doute qu'ils rejetaient le
rationalisme plagien de Thodore.
Le chef reconnu de l'cole tait l;lenana
nien, grand maitre de l'Universit de Nisibe. Il groupa
autour de lui un parti trs considrable, surtout Nisibe
mme, dont l'vque Simon se dclara en sa
malgr les dcisions contraires du synode d'lso'yahb
d'Arzun. Sans l'nergique opposition des suprieurs du
mont lzla, Abraham, Dadiso'
3
, et de leurs disciples dont
les plus clbres sont Georges le martyr et Babai le
Grand, les Henaniens auraient sans doute fait prva-
loir leur docrine dans l'glise de Perse.
Sabriso' se pronona cependant contre eux dans
le synode gnral qu'il tint au mois d'Yar de la sixime
anne de Chosrau (mai 596), c'est--dire immdiate-
ment aprs son intronisation . Les Pres du concile
ne dsignrent pas nommment l;lenana, soit que ce
dernier ft dj mort, soit que sa situation ft telle-
ment tablie Nisibe qu'on ,ft oblig d'user de
gements son gard pour ne pas provoquer un schisme.
Cette dernire explication est toutefois la moins
hable, puisque les Pres dposrent
5
Gabriel, fils de
Rufin, qui avait pris la succession de Simon, et en-
voyrent sa place Grgoire de Kaskar, qui dut
recourir la force pour prendre possession de son
sige.
Ce Grgoire agit avec une vigueur mritoire, mais
1. ComlnentairessurEV!lJrius, ms. cit plus haut, p. tillet 111.
2. Gcmr, Chron. anon., p. n.
3. v. cb. x1, p. 316 et sui v.
4. Syn. orient., p. 457-461.
ti. Pour cause d'astrologie. GUIDI, Chron. anon., p. t6.
216 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
excessive. Les notables de la ville, presque tous par-
tisans de IJenana, protestrent contre les agissements
de leur nouvel vque
1
Le roi le fit emprisonner, puis
lui ordonna de se rendre dans le clottre de Sahdost.
Chose trange et qui peint bien cette poque si trou-
ble : Sabriso seconda les IJenaniens dans cette af-
faire. Il dtestait Grgoire, nous ne savons pour quel
motif, peut-tre parce qu'il l'avait eu pour concur-
rent au patriarcat. Au risque de faire prvaloir les
doctrines du docteur de Nisibe, le catholicos entrava de
mille manires l'action de son rival
2
Il parla mme
de le dposer la suite des plaintes adresses Chos-
rau par les Nisibites.
Les autres vques n'entrrent pas dans ses vues,
et le trop ardent zlateur de l'orthodoxie, le martyr
vivant
3
, comme s'exprime Baba, put, aprs un
court sjour dans le cloitre o le roi l'avait relgu, se
retirer tranquillement dans son pays d'origine o il se
btit un monastre.
Les Nestoriens avancs ont fait un hros de ce cham-
pion malheureux et maladroit. Dieu mme, les en
croire, aurait pris soin de venger son martyr. Ds
la renonciation de Grgoire, Sabriso' perdit le don
des miracles dont il avait joui Quant aux
t. C'est peut-tre tte poque que se place la rvolution Intrieure
de J'cole la suite de laquelle trois cents tudiants antil.tenanien
1, parmi eux, le futur catholicos ISo'yahb Il durent s'exiler. 'AIIR, p. 30.
cr. norriiANN, A uszuge, p. tot. MARE, p. 48, 1,1enana aurait eu
jusqu' huit cents lves.
11. C'est lui qu'il visa, croyons-nous, lorsque, par sa lettre aux
moines de Bar Qaiti, il rattacha leurs monastres au sige patriarcal,
interdisant au mtropolitain de J'parchie de !liggar, c'est--dire au
mtropolitain de Nisibe, tout acte de juridiction sur les nouveaux con
vertis. Syn. orient., p. 469.
3. Passion de Georges: HOFFIIA!IIN, Auszge, p.
4. Gutnl, Chron. anon., p. t7. Cf. Hist. monast., 1. r, ch. xxv; d. nu dg,
JI, p. 87.
LES PROGRS DES JACOBITES EN PERSE. 217
.Nisibites, ils se rvoltrent contre Chosrau nous ne
savons quelle occasion. Une arme royale marcha
contre eux, sous la conduite de Nakwergan. Ils rsis-
trent d'abord, mais sur l'invitation de Sabriso<, et sur
la promesse formelle d'un traitement favorable, ils
.se rendirent aux assigeants. En dpit de son ser-
ment, N akwergan livra la ville au pillage et en mas-
sacra les notables. Ainsi, conclut l'anonyme de Guidi,
.s'accomplit sur eux la maldiction de Grgoire, et Mar
Sabriso' en fut tmoin .
S 2. - Les progrs des Jacobites en Perse : Gabriel
de iggar. Le catholicos Grgoire.Interrgne.Yazdin
l'Argentier.
Tandis que le schisme I;Ienanien divisait les forces
nestoriennes, les Jacobites tentaient avec succs l'in-
vasion des provinces orientales. Malgr les excutions
conduites par Bar!?auma, le monophysisme n'avait pas
t compltement extirp de l'empire perse. La ville de
Tagrit sur le Tigre lui tait reste fidle. On a vu plus
haut
2
que la prdication de Simon de Beit Arsam
avait obtenu un succs rel, quoique phmre. Nous
avons galement racont les efforts que tenta, dans
le mme sens, l'instigation de Jacques Barade,
.l'vque Al.mdemmeh. Le supplice de ce prlat eut
lieu le 2 aot 575, dans les circonstances que nous
avons indiques
3
, et la perscution qui suivit empcha
les Jacobites de lui choisir un successeur avant la mort
de Chosrau Anosarwan. En 579, ils lirent un certain
Qamiso', << docteur de la nouvelle glise difie aux
t. Ibid.
:a. cr. cidessus, ch. vr, p. W7.
3. Ch. VIl, p. 198.
I.E CURJSTIAIIIS!IE, 13
218 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
orthodoxes prs du palais royal , ainsi que s'exprime
Barhbraeus
1
Il ordonna des vques l o le besoin s'en fit sentir,
car, dit le mme auteur, en ce temps-l, les ortho-
doxes taient rares '' Nous ignorons malheureusement
le nom des siges nouvellement crs. li se peut bien
que la plupart des prlats, d'ailleurs peu nombreux
sans doute, aient t des vques rgionnaires sans
rsidence fixe. A part la mtropole de Tagrit, nous
ne connaissons de faon certaine, pour cette poque,
que l'vch dont le titulaire rsidait au clbre mo-
nastre de Mar Matta
2
L'origine de ce monastre
est rattache par la lgende l'apostolat d'un certain
Matta qui convertit le martyr Behnam et sa sur, au
temps de Julien l'Apostat
3
A l'poque que nous tu-
dions, l'vque de ce grand diocse, ordonn par
Qamiso', se nommait Tubana.
De Tagrit et de Mar Matta les missionnaires mono-
physites rayonnaient dans toutes les directions. Ils
comptaient dj de nombreux adeptes parmi les Arabes
Scnites, mais ils ne russirent pas convertir Nu-
man leur doctrine. Dans le Nord leur activit fut plus
fconde encore. L'Adiabne et le Beit Arbay devinrent
un foyer intense de propagande antinestorienne, sur-
tout aprs que le moine Maruta eut pris la direction
de ce L'Armnie, toute dvoue au
i, BARHBRAEUS, Chron. eccl., Il, COl. :10:1,
2. Op. cit., col. :103.
3. HOFFMANN, Auszge, p. ij et SUiV,
4. Maruta, originaire de bourg du Beit Nuhadra, s'exera
aux vertus monastiques d.ans les couvents de ce pays. Puis il alla en
Syrie pour y complter ses tudes, et sjourna dans divers monastres
aux environs de Callinique et d'desse. Enfin il rentra en Perse vers
605 et se fixa Mar Matta d'o il rayonna dans toute la valle du Tigre.
Vers 6111, il se rendit Tagrit, puis la Porte Royale, o il s'insinua
fort avant dans la confiance du mtropolite jacobite Samuel et du
drustbed Gabriel. Il fit aux Nestoriens une guerre acharne et composa
LES PROGRS DES JACOBITES EN PERSE. 219
monophysisme, le mont lzla, peupl d'ardents Jaco-
bites, alimentaient par un apport continu les forces de
l'hrsie dans les rgions limitrophes.
Il fallut que les Nestoriens se proccupassent de
cette situation. Fort heureusement pour eux, le voi-
sinage de l'cole de Nisibe leur permit d'organiser
solidement la dfense religieuse. << Dans chacun de
leurs bourgs, pour ainsi dire, ils avaient pris soin de
fonder des coles, >> dit le biographe de Maruta
1
Ils
avaient aussi compos des cantiques qu'ils faisaient
rpter tous leurs disciples. Mais les monophysites
se piqurent d'mulation et << se mirent fonder de
belles coles, premirement dans la rgion de Beit Nu-
hadra , ainsi que de nombreux monastres.
Telle tait, cependant, la puissance de l'glise nesto-
rienne qu'ils fussent difficilement parvenus l'entamer,
s'ils n'avaient gagn leur cause le puissant con-
cours d'un dignitaire de la cour dont le nom domine
toute cette priode de l'histoire ecclsiastique, Gabriel
de Siggar, drustbed ou architre de Chosrau II. Les
mdecins furent toujours et partout influents auprs
des monarques orientaux, et des rois Sassanides en
particulier. Mais Gabriel semble avoir joui d'un cr-
dit extraordinaire. Il le devait, parait-il, une heu-
reuse saigne la suite de laquelle la favorite Sirin,
jusque-l strile, avait donn naissance un fils, nomm
Merdansah
2
D'aprs les sources grecques
3
, Chosrau
plusieurs ouvrages pour rfuter leur doctrine. Nous verrons plus loin
qu'il fut comme chef suprme des monophysites persans.
BARBtBRAEUS, Chi-on. eccl., col. Hf. Vi ta Marutae (indite). C'est la
Vie de ce personnage crite par son successeur Denl)a. British Mus.,
ms. Add. La photographie m'en a t obligeamment communi-
que par M. Nau.
i. Vita Marutae, p. i99, v. b.
Gt:IDJ, Chron. anon., p. 18.
a. Cites dans GUIDI, Chron.; trad. NOELDEKE, p. 13, n. 3.
220 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
attribua cette miraculeuse gurison l'intervention
du martyr Sergius, pour lequel, nous l'avons dit plus
haut, il professait une dvotion spciale
1
L'habile mdecin mit son influence au service du
parti jacobite. Il parat qu'il avait appartenu ds son
enfance cette glise. L'hypothse est assez vraisem-
blable, car Siggar tait un centre monophysite. Mais
il se convertit d'assez bonne heure au nestorianisme,
sans doute en vue de son mariage avec une nophyte de
grande race, ou encore pour plaire la cour, o le
yophysisme tait considr comme la religion offi-
cielle des chrtiens persans
2
Pourquoi abandonna-t-il
les Nestoriens pour se ranger de nouveau parmi leurs
adversaires? Ce point d'histoire demeure obscur.
Les monophysites, ma connaissance du moins, se
contentent de mentionner le fait sans en rechercher
les causes
3
Les Nestoriens sont, comme on peut le
penser, trs partiaux. L'anonyme de Guidi allgue,
cependant, de la conversion du drustbed un motif
trs plausible : Gabriel aurait rpudi sa femme lgi-
time et pris deux femmes paennes dont il usait la
manire paenne
4
" Le catholicos Sabriso lui aurait
rappel les prescriptions canoniques, et, comme Ga-
briel ne tenait aucun compte de ses avis, il l'aurait
excommuni. Par esprit de vengeance, le mdecin se
serait retourn vers ses anciens coreligionnaires
5
1. Comme le remarque justement M. NoELDEKE (loc. cil.), les deux
renseignements peuvent trs bien s'accorder. Gabriel se donnait seule-
ment pour l'intermdiaire visible du martyr syrien.
2. HOFFIIANN, Auu!ige, p. tt8-t2(),
3. BARBEBRAEUS, Chron. eccl., U, col. t09.
4. GUJDI, Chron. anon., p. ts.
tl. Il n'est pas toutefois ncessaire d'admettre, avec les Nestoriens, que
Gabriel ment une vie de dbauche. Sa haute situation la cour exigeait
peuttre qu'il vcQt la Perse On sait que les rois imposrent
plusieurs fois cette condition qui les approchait (cf. ci-dessus ch. \1,
p. H9). Ce que nous connaissons du caractre de Sabriso' est bien
LES PROGRS DES JACOBITES EN PERSE. 22i
Quoi qu'il en soit, les Jacobites furent moins exi-
geants ou plus habiles que leurs adversaires et ils ne son-
grent qu' profiter du surcrot inespr de pouvoir
que leur apportait la prcieuse adhsion de Gabriel et
celle de la favorite Sirin qui en fut la consquence
1
Le drustbed se borna d'abord faire donner par
Chosrau au catholicos Sabriso l'ordre de lever l'ex-
communication qui pesait sur lui. Le vieux patriarche
refusa d'y consentir, et la mort vint opportuhment le
dlivrer de ce souci
2
La vacance du sige ne fut pas longue. Ds que
Chosrau, aprs la prise de Dara, fut revenu dans ses
tats, il permit la convocation d'un synode gnral
pour nommer un catholicos. Si nous comprenons bien
le protocole de ce synode, la promptitude du roi sur-
prit agrablement les vques
3
Il a fait pour nous
des choses admirables, et qui n'ont jamais eu de pa-
reilles. Il commanda ... que les vques de tous les
diocses qui sont loigns viendraient sur les btes du
Roi, avec honneur, et aux frais du royaume, la v-
nrable Porte du Roi des Rois ; et il a pris soin que
ceux qui sont prs parviennent promptement la
Porte, pour y choisir le chef et le gouverneur de l'-
conforme avec la dcision qu'il prit, prfrant l'observance des saints
canons aux avantages qu'il pouvait retirer de l'appui de Gabriel. Enfin
la conversion de ce dernier au monophysisme devient trs comprhen-
sible, si l'on admet que le drustbed ne s'tait fait nestorien que pour
des raisons politiques ou utilitaires.
t. La conversion de cette reine est plus surprenante. Ne Prat
de Maisan (GDIDI, Chron. anon., p. \!0), dans un pays tout nestorien, elle
avait donn des marques de fidlit sa foi, en particulier lors de
l'lection de Sabriso (V. p. !109). On peut croire que cette Odlit tait su-
perficielle; quand le mdecin qui elle devait tant la pressa de le
seconder dans sa lutte contre l'ltglise tablie, elle ne dut pas hsiter
longtemps, et ne comprit peut-tre pas la porte de ses intrigues. On
n'tait pas grand clerc en thologie dans le srail du Roi des Rois.
Il. GuJDJ, Chron. anon., p. t9.
3. Syn. orient., p. 47t et suiv.
222 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
glise catholique. Au mois d'avril 605, on choisit, sur
l'ordre de Sa Majest, le vnrable, saint, excellent par
sa science claire et ses uvres glorieuses et divines,
Grgoire, docteur et interprte des Livres saints .
La nomination de ce Grgoire, originaire de Tell
Besm, disciple d'un docteur nomm Iso et professeur
l'cole de Sleucie, tait, on le voit, impose aux
Pres. Le peuple, les vques et le roi lui-mme,
d'aprs tous les annalistes
4
, auraient prfr Grgoire
de Kaskar, l'vque de Nisibe, dont nous avons dit plus
haut l'insuccs. Mais les monophysites et les IJena-
niens redoutaient l'activit et l'nergie d'un tel adver-
saire, qui, sur le trne patriarcal, se souviendrait sans
doute des avanies subies par le mtropolitain. Ne pou-
vant faire lire un candidat de leur opinion, ils se
contentrent d'liminer leur plus irrconciliable en-
nemi, grAce l'intervention de la reine Sirin. Celle-ci
proposa et fit adopter par Chosrau la candidature du
docteur de Sleucie, originaire, comme elle, de la
Msne
2
Le nouveau catholicos fit renouveler par son concile
les anathmes dj ports du temps de Sabriso
3
On
affirma une fois de plus l'autorit canonique de l'ex-
gse de Thodore de Mopsueste, en se rfrant au
synode tenu Beit Lapat en avril 484 par Barljlauma
et Nana de Prat. Le zle orthodoxe des Pres les
porta galement rendre obligatoires trois h y m n e s ~
t. GVIDI, Chron. anon., p. iO. 'AIIR, p. 30; MARE, p. 51!. D'aprs ces deux
annalistes Sabriso' aurait souhait avoir pour successeur Barl)adbeSabba,
moine du couvent qu'il avait fond au mont Sa'ran. THOMAs DE MARGA,
Rist. monast., d. Budge, II, p. Sll-90 et p. 85, n. t. BARHBRAEus, Chron.
eccl., II, col. t07.
Il. Suivant MARE (loc. cit.), le roi ne s'aperut pas tout d'abord de la
substitution de Grgoire de Prat Grgoire de Kaskar. Quand il en fut
inform, il s'en montra trs irrit.
3. Syn. orient., p. 4n et sui v.
4. Syn. orient., p. 477.
LE CATHOLICOS GRGOIRE. 223
o la doctrine nestorienne tait nettement exprime, et
frapper d'anathme les moines qui ne les accepte-
raient pas et les vques qui hsiteraient excommu-
nier les rfractaires. Enfin de nouvelles condamnations
furent dcernes contre les moines et les moniales
gyrovagues, atteignant ainsi les et, der-
rire eux, les monophysites.
Les principaux signataires de ce concile sont
mtropolitains Joseph de Prat, Jonadab d'Arbel, Bok-
tiso de Beit Garma et vingt-six autres vques don't
trois sont connus d'ailleurs : Thodore
BarQadbesabba de I;Iolwan, crivain distingu l, et Ga-
briel de Nhar Gl qui un r61e importnt comme
controversiste 2.
Grgoire de Prat tint la conduite qu'on pouvait
attendre d'un prlat courtisan. Les quatre annes de
son principat furent dsastreuses pour l'glise de
Perse. Son avarice demeura lgendaire. Thomas de
Marga raconte
3
qu'on faisait circuler_ unE' caricature
qui reprsentait le catholicos palpant une poule pour
savoir si elle tait grasse. Autour de lui taient rangs
les vques dans une attitude indescriptible.
Il ne jouit pas longtemps du fruit de ses rapines, et,
quand il mourut, en 609l, le trsor royal confisqua ses
richesses
5
Chosrau ne permit pas qu'on lui donnt de succes-
seur6. On voit quel progrs avait fait, en quatre ans, le
f. Cet vque est peut-tre celui que Sabriso' avait dsign pour
lui succder. v. p. m, n. t. ,
!1. Syn. orient., p. 478, et la note !1.
3. Hist. monastica, l. 1, ch. xxv; d. Budge, n, p. 88. BAn&tuanus,
Chron. eccl., n, p. t07.
4. Plus e"tactement, entre octobre 608 et609. Syn. orient., p. 47!1, n.t.
5. THOMAS DE M.t.RGA, Hist. monal!., J, 1, ch. XXVI; d. Budge, Ir, p. 89.
6. BARBtnuEus, Chron. ectl.,II, col. t09. L'archidiacre Maraba,. homme
vertueux et sage , administra 1'glise de Sleucie (GuiDI, Chron. anon.,
p, !0. p. 54; 'AIIR, p. 30).
224 CHOSRAU Il ET LES CHRTIENS.
parti monophysite. En 605, Gabriel ne pouvait qu'em-
pcher la nomination d'un adversaire; en 609, il privait.
de chef l'glise orthodoxe et se flattait, sans doute, de
lui imposer quelque jour un catholicos jacobite.
Le zle imprudent de quelques prlats nestoriens
avait servi les menes de leurs rivaux. Un rad ayant.
dtruit l'glise de Siarzr, l'vque Nathaniel s'in-
surgea contre lui, ameuta les chrtiens et le fit chasser
du district. Le rad se plaignit Chosrau et lui dit :
<< Tu combats pour des chrtiens - il entendait par l
le jeune fils de Maurice - et moi je suis chass par
eux . Chosrau fit emprisonner l'vque, sans autre
enqute, probablement l'issue du synode de 605, et,
aprs une dtention de six ans, le fit crucifier
1
Au mme moment, Jonadab, mtropolitain d'Adia-
bne, parvint, nous ne savons comment, se procurer
une lettre du roi lui donnant tout pouvoir sur la rgion
montagneuse o les moines jacobites avaient lu domi-
cile, et en particulier sur le fameux clotre de Mar
Matta
2
On imagine facilement dans quel sens se
serait exerce l'autorit de Jonadab. Mais Gabriel
veillait : il fit avorter le projet. Lui-mme se donna la
satisfaction d'user de reprsailles. Il confisqua aux
Nestoriens le cloitre de Mar Pethion
3
et celui de Sirin
dans le voisinage de I;Iolwan.
Les vques dyophysites, jugeant que la situation
s'aggravait de plus en plus, rsolurent de tenter, en
612, une dernire et plus solennelle dmarche auprs
du roi pour obtenir la permission de se choisir un chef
suprme. Si mauvaises taient les dispositions de la
t. GuJnJ, Chron. anan., p. t9.
!!. GVIDJ, Chron. anan., p. !10. BARHBRAEVS, Chron. eccl., II, col. tH.
3. Probablement celui de l;lolwan. Cf. NoELDEKE, Chronique de Gui di,
trad., p. t9, n. 6.
=
LA VACANCE DU SIGE DE SLEUCIE. 225
cour qu'ils n'osrent s'y prsenter sans avoir aupara-
vant reconnu le terrain.
Ils chargrent de ce soin un moine du couvent fond
par Abraham de Kaskar
1
(t 586) sur le mont Izla, et
dirig prsentement par son successeur Dadiso'
2
Ce religieux tait le fils d'un haut fonctionnaire du
royaume et se nommait Mihramgusnasp
3
Instruit et
baptis, puis ordonn pr-tre par Simon de l;lira, il prit
le nom de Georges. Sa sur Hazarowa fu! convertie
un peu plus tard et baptise par le catholicos Sabriso'.
Elle reut le nom de Marie. Tous deux rsolurent de
mener la vie cnobitique, et auparavant firent un ple-
rinage la sainte montagne d'lzla. Ils redescendirent
Nisibe, et tandis que Marie s'y enfermait dans un
clotre, Georges tudia la clbre cole de cette ville.
Sur les conseils de l'archimandrite Dadiso', il s'attacha
fermement la plus rigoureuse orthodoxie et com-
battit les I;Ienaniens.
L'vque de l;lira, Simon, vint passer par Nisibe,
se rendant Constantinople; Georges partit avec lui.
Quand ils furent de retour, Georges accomplit son
vu et fit profession au Grand Monastre.
C'est l que vint le trouver une lettre collective des
vques, le suppliant de les aider de ses lumires ct
de mettre au service de la cause orthodoxe les rela-
tions que sa haute naissance lui assurait la cour. Il
accepta cette mission et partit, accompagn des prtres
Andr et Michel, et de deux diacres. Arriv la rsi-
i. V. Ch. XI, p. 3i6. THOMAS DE )f.t.RGA, Rist. mona8t., d. Budge, Il,
p. 37 et suiv.
!1. Hi8t. monast., d. Budge, Il, p. 42.
3. Histoire de notre pre illustre et trs saint Mar Georges, prtre,
moine, confesseur (converti) et martyr, compose par saint Rabban Afar
Baba archimandrite du mont lzla. HOFFMANN, Auszge, p. 9t et suiv.
BEDJAN, Hi1toire de Mar Jabalaha, etc., p. 4i6 et sui v. Un important
fragment de cette passion a t traduit dans Syn. orient., p. 6211-63\.
13.
226 CHOSRA U II ET LES CHRTIENS.
denee royale, il se mit en rapport avec les prlats qui
l'avaient mand. Puis, par l'intermdiaire d'un digni-
taire nomm Farrukhan l, il fit pressentir le monarque
pour savoir s'il accepterait qu'on lui prsentt la sup-
plique des vques. Le roi, sous l'influence de Gabriel
ct de Sirin, fit rpondre aux Nestoriens que, avant
d'obtenir la permission de se choisir un chef, ils de-
vraient prouver leur orthodoxie.
La suite de l'histoire est moins claire. D'aprs
Baba
2
, Farrukhan aurait propos une discussion
publique; d'aprs d'autres auteurs, notamment la
Chronique de Gui di
3
, c'est Gabriel qui aurait dfi les
Nestoriens comme en un combat singulier. Ceux-ci
auraient accept la rencontre propose et, comme il
n'y avait pas de catholicos , dsign comme champions
les mtropolitains d'Adiabne et de Beit Garma, Jona-
dab et Subl,la-le-Maran, le moine Georges et les vques
de Nhar Gl et Tell Pal,ll.lar. Georges et I;Ienaniso
furent chargs par les vques de dresser une profes-
sion de foi (612).
Cette apologie nous a t fort heureusement con-
serve dans le Synodicon
4
Elle dbute par un prambule
qui ne laisse pas que d'tonner ceux-l mmes qui
sont accoutums la servilit orientale : Quand nous
nous comparons avec tous les hommes depuis Adam
jusqu'au dernier, nous nous estimons heureux de
vivre sous l'admirable puissance de votre empire >>.
Les suppliants louent ensuite le zle de ce roi bon
et bienfaisant, qui s'occupe non seulement de la vie
corporelle, mais encore de la vie spirituelle de ses su-
i, TABARI, p. i!li et !!99.
!. Passion de Georges : HOFFliAXN, Amzge, p. {07 et suiv.
3. Chron. anon., p. 20.
~ . P. 580 et suiv.
LA VACANCE DU SIGE DE SLEUCIE. 227
jets, et cherche discerner quelle croyance est la
vraie. Suit une exposition ample et dtaille de la foi
nestorienne
1
Elle se termine par quelques paroles
qui, trs habilement, rappellent que cette foi est, pour
ainsi dire, la foi nationale des chrtiens persans, tandis
que les doctrines svriennes ou thopaschites sont
d'importation romaine. Les auteurs expriment l'espoir
que Chosrau, vainqueur des Romains, anantira l'h-
rsie romaine.
Vient ensuite la trs humble et trs humilie suppli-
que desvques
2
: Depuis nombre d'annes, nous n'a-
vons plus de chef suprme et l'glise souffre de grands
dommages ... Ne considrez pas notre indignit, mais
bien votre misricorde accoutume, accordez-nous un
chef suprme , et jamais nous rendrons grce
-Votre glorieuse Majest . Ce n'tait pas tout. Le roi
avait propos trois questions qu'il supposait embarras-
santes pour les Nestoriens : 1) Quelle est la foi qu'ont
prche les aptres? - 2) Qui est Marie, la mre de
Dieu ou de l'Homme? - 3) Y a-t-il eu, avant Nesto-
rius, un docteur qui ait attribu au Christ deux na-
tures et deux hypostases? Si nous ne nous trompons,
les deux premires questions avaient t suggres
surtout par les monophysites, la dernire par leurs al-
lis, les IJenaniens. - Les Pres rpondirent en six
articles o ils rfutent successivement les monophy-
sites, les thopaschites, les thotokistes et ceux qui
accusaient les Nestoriens, soit d'introduire un qua-
trime terme dans la Trinit, soit de confesser deux
Fils , soit de s'tre carts du fondement de la foi
enseigne par les Pres. A ce sixime article est an-
nexe une liste de citations, apocryphes pour ]a plu-
i. Syn. orient., p. 118i.
~ . Syn. orient., p. 1185.
228 CHOSRAU li ET LES CHRETIENS.
part, attribues aux Pres les plus orthodoxes : saint
Chrysostome, saint Athanase, Amphiloque d'lconium,
saint Ambroise et mme saint Cyrille
4
Chosrau II ne prit aucune dcision immdiate, et les
choses demeurrent en l'tat. Quand fut venue la
saison d't, le roi se dirigea vers la Mdie, et les
tenants des deux partis l'y accompagnrent.
Tout d'abord, un certain temps s'coula, o per-
sonne, la Porte, ne s'entretint des affaires ecclsias-
tiques. Mais un incidet raviva les disputes
2
On s'tait
arrt auprs du clotre de saint Sergius, l'un de
ceux que Sirin avait, comme nous l'avons dit plus haut,
ddis au martyr syrien. Les Nestoriens l'avaient pri-
mitivement desservi, mais Gabriel le leur avait enlev
pour le donner aux monophysites qui s'en rservaient
la jouissance exclusive. Georges et ljenaniso contes-
trent la lgitimit de ce transfert. Leur zle les porta
quelque excs de parole, et peut-tre quelques
voies de fait a.
Le rus Siggarien saisit l'occasion de triompher dfi-
nitivement de ses Il accusa Subl).a-le-Maran
d'avoir voulu le tuer, et Georges d'tre un rengat du
magisme. Le rsultat tait facile prvoir. L'une et
l'autre accusation furent favorablement accueillies et
le roi commit un haut dignitaire de la cour, nomm
Darmekhan, l'examen des griefs allgus par Ga-
t. Ces citations rappellent les -rciiv Ux-rpoov en usage parmi
les thologiens byzantins.
2. Passion de Georges : HOFFIIIANN, Amzge, p. 107.
3. Sur les conseils de Maruta le monastre de Sirin fut enlev aux
dyophysites; jusque-l le drustbed tolrait que les chrtiens, sans
distinction de confession, pussent s'y 3pprocher des sacrements. Le
mtropolite Samuel, qui en 6t4 avait recueilli la succession de QamiAo'
aprs une vacance de cinq annes, et les autres vques monophysites
acceptaient cette situation ambigu. L'intransigeance de Maruta y mit
bon ordre. Vie de Maruta, ms. f. 205, r.
4. Loc. cit., et GUIDI, Chron. anon., p. 21.
LE MARTYRE DU MOr1E GEORGES. 229
briel. Nous ignorons le sort qui fut rserv Subl.la-le-
Maran. Quant Georges, le roi lui-mme se souvint
de l'avoir connu avant sa conversion. Loin de nier les
faits, Georges se fit gloire de son changement de reli-
gion et argumenta contre le rad qui l'interrogeait.
Lorsque le roi Chosrau redescendit vers les Villes
Royales pour l'hivernage, Georges fut incarcr dans
une forteresse voisine, appele Akrii de Kok. Aprs
huit mois de prison, il fut condamn tre crucifi, et
les soldats l'achevrent coups de flches Sleucie,
sur le march au foin
1
Son corps, recueilli par ses
compagnons, les diacres Gausiso' et Timothe, fut ense-
veli dans une glise ddie saint Sergius, Mabrakta,
localit proche de Sleucie
3
Terrifis par son excu-
tion, que suivit de prs le supplice de quelques autres
martyrs, les vques ne songrent plus solliciter
d'un prince aussi mal dispos la permission de se
choisir un catholicos.
Puisque le gouvernement de l'glise nestorienne
ne pouvait tre confi un chef unique, chaque mtro-
politain prit la responsabilit de son parchie, et la di-
rection de l'glise de Sleucie incomba l'archidiacre
Maraba, << homme plein de vertu et de sagesse
3
)) Dans
les provinces du Nord, un moine d'lzla, suprieur
du Grand Monastre d'Abraham, joua un rle pr-
pondrant. Baba \ que la reconnaissance de l'glise
i. Le H kanun 11 de J'an 9i6, 25 anne de Chosrau : H janvier 615.
!il. Guror, Chron. anon., p. !i!t. &1. Hoffmann, Au8zge, n. i03i, re
marque qu'il ne faut pas confondre ce martyrium de saint Sergius, situ
non loin des rives du Tigre, avec celui dont il tait question plus haut,
qui se trouvait prs de tfolwan, dans les montagnes de Mdie.
3. GUIDI, Chron. anon., p. !i!O. MARE, p. M. 'AIIIR, p. 30.
4. Gumi, Chron. anon., p. !1!1. TooH&S DE &IARGA, Hist. mona8t., 1. 1.
Ch. VII, XI, XXVIIXXX, XXXV; d. BUDGE, II, p. 46et suiv., 90 et SUiV., 116,
et n. 3. Bibl. orient., t. III, p. 8897. HOFFMANN, Amzge p. H71!i!O. JI
tait originaire de Beit 'Aintli, dans le district de BeltZabd. Y. BttDGE,
op. cit, 11, p. 46, n. :s.
230 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
persane a surnomm le Grand, rendit aux Nesto-
riens d'inapprciables services. Sans autre titre officiel
que celui d'inspecteur des monastres que lui avait
confr la confiance des mtropolitains du Nord : Jo-
nadab d'Adiabne, Cyriaque de Nisibe et Gabriel de
Karka, le successeur de Subl}.a-le-Maran, Baba par-
courut tout le pays, soutenant les courages, affermis-
sant les nergies dfaillantes.
Il fut, par-dessus tout, le gardien vigilant de l'or-
thodoxie, recherchant les hrtiques jusque dans les
couvents les plus loigns et s'opposant de toutes ses
forces leur propagande sournoise dans les environs
de Mar Matta, de Beit Nuhadra et d'Arbel.
Pour combattre les IJenaniens, les Mel(lalliens et
les Monophysites, il s'appuya plus d'une fois sur les
offieiers chrtiens de la Porte Royale, avec qui il entre-
tenait d'troites relations. Son autorit semble avoir
t inconteste parmi ses coreligionnaires. Toutefois,
l'anonyme de Guidi
1
nous a transmis le souvenir de
disputes qui auraient eu lieu entre Baba le Grand
et un autre Baba dit le Petit. Mais le renseigne-
ment est trop laconique pour qu'il nous soit possible
d'en apprcier la porte. Quoi qu'il en soit, les crits
de l'archimandrite d'lzla
2
contriburent par leur large
diffusion au triomphe de la dogmatique officielle.
Gabriel mourut peu de temps aprs le supplice de
Georges, et les Nestoriens virent leur situation s'am-
liorer quelque peu.
En effet, partir de cette poque un personnage trs
zl pour le Nestorianisme, Yazdn
3
, grand argen-
1. P. lU.
!. DUVAL, Litt. syriaque, p. tit-51, et Bibl. otient., lll, p. H4.
a. cr. TAo.uu, p. am, n. 4; et 383, n. 3. Hist. monast., d. Budge, 11,
p. 81, n. 4. Bibl. orient., 1, p. 39!!. BARHDRAEUs, Chron. eccl., col. 71.
YAZOI.t'l L'ARGENTIER. 23i
tier du royaume, exera pendant quelques annes une
influence prpondrante la cour de Chosrau. Ce per-
sonnage se rattachait par ses anctres au clbre martyr
Pethion. Il tait originaire de Karkade Beit Slokh o sa
famille possdait d'immenses proprits. Le roi lui
avait afferm la recette gnrale de la dtme, et les an-
nalistes nous le montrent marchant la suite des ar-
mes persanes pour rgler le pillage et fixer les con-
tributions de guerre. L'Anonyme de Gui di
1
prtend
que Yazdn versait chaque matin au trsor royal
mille pices d'or.
Il ne manquait aucune occasion de relever, par des
cadeaux ingnieux, la monotonie de son tribut jour-
nalier. Lors de la reddition d'Alexandrie (614), il fi tf or-
ger des clefs d'or, s-ur le modle de celles que les gyp-
tiens venaient de lui remettre, et les offrit Chosrau.
Il ne ngligeait pas non plus, comme bien on pense, le
souci de sa fortune personnelle, qu'il alimentait, la
mode orientale, par des arbitraires. Aprs
l'incendie de Jrusalem, que les Juifs avaient, dit-on,
conseill aux Perses, Y azdn confisqua leurs richesses,
sans doute pour venger les chrtiens
2
Mais le Roi des Rois ne s'inquitait pas de ces
concussions. Ses guerres avec Rome lui cotaient fort
cher, et nul concours ne lui tait plus prcieux que
celui du fermier gnral. Ainsi s'explique le crdit
considrable que Yazdn mit au service de ses core-
ligionnaires. Il fut, toutefois, impuissant leur obtenir
du monarque l'autorisation d'lire un catholicos. Le
sige de Sleucie demeura vacant depuis la mort de
Grgoire (609) jusqu' celle de Chosrau II (628).
i. P. !!3.
Ibid.
232 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
S 3. - L'invasion des Perses dans l'Empire byzantin;
Revanche d'Hraclius. Chosrau I perscute tous
les chrtiens. Sa mort.
Dans la dernire anne du pontificat de Sabriso' (604),
Chosrau II avait la guerre aux Romains, pour
venger, disait-il, l'empereur Maurice mis mort par
l'usurpateur Phocas. Sous couleur de rendre au jeune
fils du basileus, Thodose, les services qu'il avait re-
us de son pre, il le fit couronner par le catholicos
1
,
la manire byzantine, et, sans se borner cette ma-
nifestation platonique, il l'appuya d'une arme d'in-
vasion. Ce fut le signal d'une lutte gigantesque qui,
pendant plus de vingt annes, mit aux prises les deux
empires rivaux.
Elle par le sige et la prise de Dara
2
La
perte de cette grande place de guerre laissait la merci
des envahisseurs perses la Msopotamie, la Syrie
et la Palestine. En 609, desse, jusque-l inviole, fut
enleve d'assaut.
La mort de Phocas et l'avnement d'Hraclius ne
suspendirent pas les hostilits. En 611, les armes per-
sanes camprent Csare de Cappadoce, en 613
Damas, enfin, pendant l't de 614, conduites par
leur gnral Sahrbaraz, elles entrrent par la brche
dans Jrusalem et la livrrent au pillage
3
Le patriarche
Zacharie, les notables de la ville furent emmens en
captivit. Mais ce qui blessa plus profondment les cons-
ciences chrtiennes, ce fut l'incendie de la basilique de
t. Guror, Chron. anon., p. 19.
i. GUIDI
1
Chron. anon., trad. NOLDEKE
1
p. t7, n. 2.
3. GUIDI, Chton. anon., trad. NOELDEKE, p. 114, n. 4. T.lBARI, p. !I!JI et i!lt,
n.ll.
L'INVASION DES PERSES DAl'\S L'EMPIRE BYZANTIN. 233
l'Anastasis, et surtout l'enlvement de la Vraie Croix.
L'anonyme de Guidi
4
nous apprend que cette insi-
gne relique fut sauve de la destruction par le dvoue-
ment clair du banquier Yazdn, grand argentier
du roi. Mais elle fut bientt ravie aux chrtiens, et
alla rejoindre les autres pices du butin dans un trsor
que Chosrau fit amnager pour mettre en sret les
richesses incalculables amasses au cours de cette
norme razzia
2
Alexandrie, grce la ruse d'un
chrtien de Qatar, tomba entre les mains des gn-
raux de Chosrau
3
; et, comme au temps de Cambyse,
les armes persanes camprent sur les rives du Nil.
Les campagnes suivantes menrent les soldats du
Roi des Rois jusqu'aux rives de Un effort
suprme, combin avec une invasion des Avares, allait
anantir l'empire romain d'Orient. L'nergie et l'ha-
bilet d'Hraclius surent parer au danger imminent.
Il porta hardiment la guerre au cur de l'Armnie
persane.
Surprises par cette attaque imprvue, les armes
de Chosrau vacurent l'Anatolie. Au printemps sui-
vant, nouvelle incursion d'Hraclius, pareillement cou-
ronne de succs. Enfin, en 627 et 628, les Byzan-
tins frapprent des coups dcisifs
5
Ils entrrent
rsolument dans la valle du Tigre, occuprent l'Adia-
bne et le Beit Garma, puis s'emparrent de Dast-
gerd
6
, la rsidence favorite du monarque.
t. P. 22.
2. cr. GGIDI, Chron. anan., trad. NOELDEKE, p. 211, n. t.
3. Gumi, Chron. anan., loc. sup. cil.
4. TABARI, p. 292, n. 3.
5. A cette campagne se rattache le supplice du martyr saint Anastase,
ancien soldat persan, conYerti au 'Christianisme au cours de l'expdi-
tjon de Syrie. Acta SS., Il fut mis mo le !1! dcembre &17.
6. TABARI, p. 2115, n. t; 196, n. {.
._;,... ..... -.,
CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
Tant que les armes persanes avaient t victorieuses
des Romains, Chosrau avait observ vis--vis des
chrtiens une neutralit assez malveillante. Mais quand
les soldats d'Hraclius, recruts avec l'or des glises
byzantines, envahirent le domaine des Sassanides,
son attitude se modifia et fit place une hostilit
dclare.
Monophysites et Nestoriens furent galement mo-
lests . Maruta dut quitter Tagrit et se rfugier dans
les grottes de Rabban Sabur prs d,.Aqola
2
Il ne re-
parut qu'aprs la mort de Chosrau et l'avnement de
son fils. Yazdn lui-mme fut saisi et supplici par
ordre du monarque. Conspirait-il avec les Romains, ou
Chosrau souhaita-t-il simplement s'approprier les
richesses du fermier gnral? L'une et l'autre hypo-
thse sont galement plausibles.
Aprs sa. mort, ses biens furent confisqus, et sa
t. C'est vers ce mme temps que le martyr Jso'sabran fut mis
mort aprs quinze ans de dtention, sur les limites du Beit Garma et
du pays de Belesfar, c'est--dire non loin d'une des rsidences d't
de Chosrau. Ce martyr tait un converti. Avant Je baptme, il s'appelait
Mal)anus. Ds que les parents de Mal)anus apprirent qu'il s'tait fait
chrtien, ils le poursuivirent en justice, dans le dsir de s'approprier
ses biens. Le juge le fit emprisonner l;lazza prs d'Arbel, en atten-
dant la sentence que devait sans doute prononcer une juridiction sup
rieure. Mais Yazdin tant venu l;lazza intervint auprs des autorits,
bien qu'il et pu agir de lui-mme, et le lit dlivrer. ISo'sabran s'exera
ds lors aux vertus monastiques. JI fut dnonc de nouveau, vers 005,
auprs du rad de IJazza, puis conduit en prison o il demeura quinze
annes, pendant lesquelles il fut visit par de nombreux chrtiens qu'il
exhortait la vie parfaite. En la trentime anne de Chosrau, il
fut lir de sa prison pour tre conduit la Porte avec plusieurs per-
sonnages du Beit Garmai et crucifi. Yazd ln n'avait rien pu ou rien voulu
faire pour le sauver cette fois. (Vie deJsu.tabran,J .B. CHABOT, Paris, t896,
prface.)
2. Vie e A-Iarula, p. v. BARHBRAEus, Chron. eccl, col. t.H. Les
toriens et les sont d'accord pour affirmer que la mort de
Chosrau Il fut un vnement heureux pour les chrtiens; Gumi, Chron.
anan., l> !15;- IIIARE, p. li4; - 'AIIR, p. 30; - BARHBIIAEUS, Chron.
. coi.H7.
MORT DE CHOSRAU ll. 235
femme soumise la torture pour rvler les trsors
qu'on la souponnait de dissimuler
1
Cet acte de ty-
rannie cota cher au vieux monarque. Samta et N-
hormizd
2
, fils de l'argentier
3
, se voyant privs de leur
fortune et craignant pour leur vie, levrent l'tendard
de la rvolte, proclamrent la dchance de Chosrau et
l'avnement de son fils Sro (Qawad Il). Abandonnde
tous ses nobles qu'il s'tait alins par ses exactions
et ses cruauts, Chosrau quitta prcipitamment sa rsi-
dence
4
et chercha son salut dans la fuite. Il tait trop
tard. Les missaires des conjurs le rejoignirent bien-
tt, se saisirent de lui et l'enfermrent dans la demeure
d'un homme nomm Mraspend, o on ne lui donnait
comme nourriture qu'un peu de pain pour l'empcher
de succomber s.
Cette vengeance ne suffit pas aux fils de Y azdtn. Ils
arrachrent Sro l'autorisation de tuer le monarque
dchu. Ils pntrrent dans le lieu o tait dtenu Chos-
rau. Sam ta tira son pe pour frapper. Chosrau, fondant
en larmes, lui dit: En quoi ai-je pch contre toi pour
que tu veuilles me tuer? mu de piti, Sam ta recula,
mais Nhormizd, n'coutant que sa colre, s'avana
son tour et, brandissant une hache, mit mort le meur-
trier de son pre. Telle fut la fin de ce prince dont les
armes avaient, pour un instant, reconquis le domaine
immense des vieux Achmnides.
Les fils de Yazdn voulurent pousser plus loin leurs
avantages
6
Se coalisant avec les grands du royaume,
L Gutoi, Chron. anon., p. !15.
!. Appel aussi Kurta.
3. THOIIAS DE IIARG.t., Hist, monastica, l. 1, Cb. XXV; d. Budge, Il, p. 81,
cf. p. H!-H6, TAB.lRI, p. 357, n. 3; 3113, n. 3
T.I.BARI, p. 35! et SUV,
5. GUIDJ, Chfon. anon., p. !14. T.IBARI, p. 356 et suiv.
6. GUIDI, Chron. anon., p. 25.
236 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
ils turent tous les fils de Chosrau, et, parmi eux,
Merdansah, le fils de Sirin, la reine monophysite. Peut-
tre avaient-ils conu de plus hautes ambitions, et
songeaient-ils, comme on les en accusa auprs de
Sro, fonder une dynastie royale. La prsence des
armes byzantines les encourageait sans doute pour-
suivre ce but. Hraclius et t fort heureux, on n'en
doute pas, de voir monter sur le trne des Sassanides
un prince chrtien, ncessairement vassal ou protg
des Romains.
Sro ne laissa pas l'orage qui }e menaait le
temps de se former. Il se saisit de Sam ta. Celuici
russit s'enfuir et se rfugia J:Iira. Le temps n'tait
plus o cette ville arabe, demi indpendante, pou-
vait assurer aux ennemis du Roi des Rois un asile
inviolable
1
Sro atteignit son adversaire, lui fit couper
la main droite et le jeta dans un cachot
2
, ainsi que
son frre Nhormizd.
S 4:. - L'avnement d'ISo'yahb II (628). L'organisation
de l'glise jacobite en Perse. Chute de l'empire
des Sassanides.
Les victoires d'Hraclius et la fin tragique de Chos-
rau II eurent, pour les chrtiens de Perse, de trs heu-
reuses consquences
2
Sro leur rendit une complte
libert autant par reconnaissance personnelle que par
crainte des Romains, et les traita mme avec faveur.
t. Sur la suppression du royaume arabe de J:!ira, et ses consquences
funestes pour l'Empire des Sassanides, voir .Gtanr, Chron. anan., p. tS,
et trad. NOELDEKE, p. i3 et. SUi V.; p. t5, n. 2. TUA RI, p. 3!5 et SUi V.;
p. 3!9, n. ! et 331, n. 1. MLLER, Der Illam in Morgen und Abendland,
1, p. !1!3.
!. Gutoi, Chron. anan., p. ~ .
"l
L'AVNEMEl'IT D'ISO'YAHB II. 237
Les Nestoriens procdrent l'lection d'un catholicos.
Baba le Grand tait prsent ce concile
1
Les vques,
au dire de Thomas de Marga
2
, le supplirent d'accep-
ter le catholicat. Baba refusa cette lourde charge,
prfrant, dit son pangyriste, achever sa vie dans une
.cellule de son monastre. Les Pres choisirent donc
un des leurs, ISo'yahb de Gdala, vque de Balad
3
(628).
Ce prlat s'tait fait connatre, dans sa jeunesse,
pour son zle en faveur de l'orthodoxie. Il avait quitt
l'cole de Nisibe plutt que de pactiser avec les par-
tisans de I;Ienana et avait compos un ouvrage pour
rfuter le clbre professeur. Cette courageuse attitude
lui avait valu le sige de Balad, bien qu'il ft mari,
dit l'Anonyme de Guidi \marquant ainsi qu' cette
poque, l'glise nestorienne n'levait gure que des
clibataires aux prlatures ecclsiastiques.
Son premier acte fut de tmoigner Baba le res-
pect et la reconnaissance que professaient son en-
droit les prlats orthodoxes. A la tte d'un certain
nombre d'vques, il tint le reconduire jusqu'au
couvent d'lzla o le vieux lutteur acheva sa vie dans
les exercices de l'ascse monastique. Un apologue,
rapport par Thomas de Mar ga
5
, exprime bien, sous
de gracieux symboles, le rle important que joua
Baba dans l'glise nestorienne, en des temps dif-
ficiles. Quand les Pres se furent salus mutuelle-
L Il n'est pins question de l'archidiacre Maraba. Il tait sans doute
mort celte date.
!. Rist. monast., 1. 1, ch. xxxv; d. Budge, p. 1 t6.
3. GUIDI, Chron. anon., p. 25; trad. NOELDEKE, p. 30, n. 5 et 34, n. 8.
lii!RE, p. M; 'A11n, p. 30. B.I.RBBR.I.Evs, Chron. eccl.,co!. H3 et suiv.Bib!.
orient., 1. Ill, p. to:s et suiv. Cf. Hist. monast., d. Budge, II, p. 61, n. 3
et t!3, n. 4, et R. DuvAL, Litt. syriaque, p. 89 et 371. Il rgna 19 ans :
628-17.
4. Gmnr, Chron. anon., loc. cit.
li. Hist. monastica, 1. 1, ch. xxxv; d. Budge, t. 11, p. 115 et H6.
238
CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
ment et mis en route pour s'loigner, aussitt apparut
Mar Baba un saint ange de Dieu sous l'apparence
d'un conducteur de char ~ , portant un glaive de feu et
mont sur un cheval blanc. Se tenant dans la cour de
sa cellule, il lui dit : Puisque tu as refus le patriarcat
et qu'on en a choisi un autre, permets-moi d'aller le
trouver. Mar Baba lui dit : Qui es-tu? Il lui dit : Je suis
l'ange qui le Dieu tout-puissant a command d'exercer
un ministre auprs du trne patriarcal de l'Orient,
et, tout le temps que tu remplaais le catholicos, du
premier jour celui-ci, je ne me suis pas loign de
toi. Maintenant, je suis oblig d'aller servir celui qui a
accept cette charge. Notre matre lui dit : Si j'avais
su que tu tais avec moi, j'aurais cote que cote
entrepris cette grande uvre. V a donc en paix et prie
pour moi. Et l'ange disparut de la vue de notre
matre.
Nous ne pouvons nous dfendre d'apercevoir dans
ce document traditionnel quelques traces du regret
qu'aurait plus tard manifest Baba de ne pas avoir
accept l'honneur suprme qu'on voulait lui dfrer.
Nous pensons aussi que cette proposition si honorable ne
lui fut faite que pour la forme. L'archimandrite d'lzla
tait un homme trs nergique, mais aussi trs in-
transigeant. Aux heures de lutte, ce sont l de prcieu-
ses qualits ; quand la paix est conclue avec les ennemis
du dehors, ces qualits peuvent se tourner en dfauts.
Tel, dont le caractre intrpide ct absolu a fait face
aux plus violents assauts, peut susciter, parmi ses
frres, des brouilles et des divisions fort prjudiciables
ii la prosprit commune. Au reste, Baba avait assez
mdiocrement russi dans la direction de son propre
ORGANISATION. DE L'GLISE JACOBITE. 239
couvent, comme nous le montrerons plus loin . Nous
comprenons que les vques ne se soient pas soucis
d'largir son champ d'expriences.
Les jacobites, de leur ct, s'organisrent. Nous
avons vu plus haut que Maruta avait d se retirer
dans les dserts entre le Tigre et l'Euphrate, lors de
l'invasion des Romains. Un ordre du patriarche mono-
physite d'Antioche, Athanase le Chamelier, l'appela
en Occident, avec les autres vques de la Perse, pour
concerter ensemble les mesures prendre afin de pro-
pager leur doctrine dans le domaine de l'glise nesto-
rienne
2
Cinq vques monophysites se rendirent en terre
romaine : c'taient le successeur de Samuel, Chris-
tophe, mtropolitain, qui rsidait au clotre de Mar
Matta; Georges de Siggar, Daniel de Beit Nuhadra,
Grgoire de Beit Ramman et Iazdpanah de Siar-
zur. Ils emmenrent avec eux trois moines qu'ils
jugeaient dignes de l'piscopat : Maruta, Aitalaha et
A ~ a . Ils allrent trouver Athanase et lui demand-
rent d'ordonner des vques pour la rgion orien-
tale. Athanase s'y refusa, cause du dcret du
concile de Nice , dit Barhbraeus. Le patriarche
d'Antioche entendait par l rserver l'indpendance de
l'glise de Perse. Cette indpendance tait sanctionne
par des dcrets conciliaires que l'on croyait alors au-
thentiques. De plus, il importait de ne pas priver les
Svriens des avantages nombreux que les Nestoriens
i, Ch. XI. Cf, Hist, monast., 1. 1, ch. XII, Xlii, XtV; d. Budge, Il, p, 59
et suiv.
2. BARHBR.u:us, Chron. eccl., II, col. H9, place cet vnement aprs la
conclusion de la paix entre les Perses et les Romains. Il dit que, parmi
les ambassadeurs, se trouvait Jean diacre de Beit Eiaya qui demanda
Sro les autorisations ncessaires. Ces dtails concordent parfaitement
avec la Vie de Maruta, crite par Den !,la, son successeur (f. !!06, r.).
. ~
2-iO CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
avaient retirs de leur autonomie. Nul, ce moment,
11e pouvait souponner la chute imminente de l'em-
pire des Sassanides. Et si les jacobites de Perse s'-
taient rattachs un chef suprme rsidant en terri-
toire romain, leurs adversaires auraient eu beau jeu de
les dnoncer auprs des princes sassanides comme
des espions de Byzance; accusation particulirement
spcieuse cette poque, o les gnraux de Chosrau II
venaient de dporter en Perse, et spcialement dans le
Sgestan et le Khorasan, une foule norme de monophy-
sites dessniens, Syriens, Pales tiniens et gyptiens.
Les vques dcidrent aussi de dplacer le sige du
mtropolitain. Celui-ci, depuis Al;mdemmeh, rsidait
Mar Matta. On transfra cet honneur la ville de Ta-
grit la Bnie '' Sans doute on voulait ainsi rcom-
penser la fidlit inbranlable de ses habitants la
i
doctrine monophysite. Mais, de plus, le voisinage de
Sleucie permettait d'esprer qu'un jour ou l'autre il
serait facile de transporter le sige du grand mtropo-
litain dans la Ville Royale, quand le nestorianisme en
aurait t dfinitivement expuls. On conserva cepen-
ant l'vque de Mar Matta le titre de mtropolitain,
mais il n'eut juridiction que sur les environs de Ninive'.
Le premier grand mtropolitain des Jacobites fut
Maruta. Il devait cet honneur son activit infati-
gable et aux succs qui avaient couronn son apostolat.
Il aurait eu sous ses ordres, d'aprs Barthbraeus, douze
vques dont les siges furent : 1 Le Beit Arbay;
2 Siggar; 3 Ma calta; 4 Arzun; 5 Gmel, dans la
haute valle de Marga; 6 Beit Ramman ou Beit Wa-
ziq; 7 Karm; s L'le de Qardu; 9" Beit Nuhadra;
10 Przsabur; 11 Siarzur; 12" Les Arabes Scnites
i. BARUBRAEus, Chron. eccl., col. Hl et sui v.
ORGANISATION DE L'GLISE JACOBITE. 241
appels Taglibi. Plus tard, Maruta aurait cr trois
autres vchs en Sgestan, H rat ct en Adurbaidjan
1
Cette liste est beaucoup trop longue pour le vu sicle.
Le titre de mafriano qui fut plus tard donn aux
chefs des monophysites de Perse n'est pas certifi pour
notre poque. ISodenal}., cit dans lie de Nisibe, ne le
mentionne pas, non plus que la vie de Maruta. Cepen-
dant, nous croyons que le grand mtropolitain de Ta-
grit fut honor de cette pithte, sinon dans les proto-
coles officiels, du moins dans le langage officieux de
l'poque. Denl}.a consacre, en effet, d'assez longs dve-
loppements montrer comment Tagrit, mise en u-
vre par Maruta, devint un sol fertile, portant des fruits
abondants. C'est cette mtaphore que le nom de
mafriano dut _probablement son origine
2
Le rgne de Se roe
3
fut de courte dure
4
Tandis qu'il
se rendait en Mdie, suivant l'usage, pour y passer
l't, il tomba malade et mourut sa rsidence de Das-
tgerd (septembre 628). Son fils Ardasir
5
, un enfant en
bas ge, fut proclam sa place. A cette nouvelle, un
dignitaire de l'arme persane qui s'tait attach H-
i. D'aprs BARHBRAEUs, Chron. eccl., col. H9, c'est en 940 ( l l ~ / 9 ) qu'il
convient de placer la rorganisation de l'glise monophysite en Perse.
lie, citant ISo'DENAI;I (Chron. eccles., p. Ut, n. 1), mtropolitain de Ni-
sibe, l'anne troisime de l'hgire, dit: Cette anne-l, les Jacobites
de l'empire perse se runirent au monastre de Mar Mattadans la rgion
de Ninive, et, du consentement du patriarche Athanase, ils constiturent
Marnta Tagrit comme premier mtropolitain, subordonnant di1 v-
ques sa juridiction. Ensuite leur nombre s'est lev douze aprs
l'rection des siges de Bagdad et de Gozarta (Qardu) Nous ne pou-
vons juger de l'e1actitude de ces renseignements, en ce qui concerne Je
nombre des siges piscopaux crs cette poque. Mais la date nous
semble inexacte. Quelle que soit l'autorit d'lie en matire chrono-
logique, nous lui prfrerons ici BARUBRAErs, avec lequel la Vie de
lllaruta concorde exactement. (Vie de Maruta, p. 206, r. a.)
!!. 1;..9 ~ ~ . j.s..;9..>o
3. TABAIII, p. 361, n. 2.
Huit mois, d'aprs Gumt, Chron. anon., p. 25
.5. TABARI, p. 386 et sui v. Gmot, Chron. anan., loc, cit.
_
'P41 }l)i_fi
242 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
radius, Farrukhn- le mme peut-tre qui avait pris
autrefois le parti des Nestoriens contre Gabriel de
Siggar, en tout cas le clbre conqurant de Jrusalem,
plus connu sous le nom de Sahrbaraz, - marcha contre
Sleucie la tte de soldats romains et persans, prit
la ville et tua Ardasir.
Son premier soin fut d'extraire Samta, fils de Yaz-
dn, de la prison o l'avait enferm Ser, et de le cru-
cifier la porte de l'glise de Beit Narqos, pour venger
une injure personnelle . Ensuite, pour remercier Hra-
clius de son concours, ou du moins de sa bienveillance,
il lui rendit le bois de la Vraie Croix et y joignit des
prsents magnifiques
2
Le patriarche Zacharie avait
sans doute t dlivr auparavant.
Farrukhn monta sur le trne le 27 630
3
Mais
il ne jouit pas longtemps du fruit de sa trahison. Aprs
un rgne de quarante jours, il fut tu par un de ses
gardes et son cor.ps fut mis en pices par le peuple.
Bran
4
, la sur, et peut-tre la veuve de Sr
5
,
fut appele lui succder. Elle gouverna sagement
ses sujets et s'employa trs activement conclure
avec les Romains une paix dfinitive. Elle envoya
Hraclius une solennelle ambassade
6
, la tte de
laquelle elle plaa le catholicos Iso'yahb. Celui-ci se
fit accompagner des mtropolitains Cyriaque de Nisibe
t. NoELDEKE (Chronique de Gmor, trad., p. 3t, n. 5) croit que l'ex-
cution eut lieu en Adurbaidjan. Nous connaissons, par la Vie de Maraba,
cite ch. nn, p. t90, une glise de Beit Narqos, voisine de Sleucie. Or,
d'aprs le rcit du Chronicon anonymum, il semble que samta, arrt
J:lira fut incarcr Sleucie. Il n'est pas ncessaire de supposer que
Samta ait t supplici non loin de ses proprits de l'Adurbaidjan
(TABAR!, p. 384, en note).
!1. V. TABARI, p. 39i, n. t,
3. Gumr, Chron. anon., p. !15. TABAR!, p. 388.
4, T !BARI, p. 390, D.
5. GUID1
1
Chron. anon., p. trad. NOELDEKE, p. n. 5,
6. sur cette ambassade, voir TABAR!, p. 39i, n. t.
----
L'AliBASSADE D'ISO'YAHB II. 24:3
et Gabriel de Karka, de Paul d'Adiabnc et de quel-
ques vques de la rgion, parmi lesquels ISo'yahb
d'Adiabne, le futur catholicos, et Sahdona, plus tard
vque de Mal_J.oz de Arewii.n. L'empereur Hraclius se
trouvait alors Alep
4
Les envoys de la reine y furent
accueillis, dit Thomas de Marga
2
, comme des anges de
Dieu; ils russirent :pleinement dans leur mission. Cette
lgation eut pour l'Eglise nestorienne de graves con-
squences. Pour joindre l'empereur, il fallut traverser
toute la Syrie monophysite. Parvenus la cour, les
dputs subirent, d'aprs les annalistes
3
, un vri-
table interrogatoire sur leur doctrine. Le trs ortho-
doxe et trs pieux Hraclius exigea du catholicos nes-
torien une profession de foi conforme la doctrine
byzantine et l'admit ensuite sa communion. lso'yahb
dut fournir des explications ce sujet son retour en
Perse. Un vque, Barr:>auma de Suse, attaqua vio-
lemment le catholicos : (( Si tu n'avais pas condamn
les trois lumires de l'glise : Diodore, Thodore et
Nestorius, si tu n'avais prononc ces mots : Marie,
mre de Dieu, jamais les Grecs ne t'auraient permis
de clbrer les saints mystres sur leurs autels! >>
Les intransigeants allrent jusqu' effacer son nom
des diptyques. lso'yahb se dfendit comme il et la
reine, satisfaite de ses succs diplomatiques, interdit la
continuation de la polmique. Le catholicos ne fut pas
puni de sa tideur.
t. Ce dtail, ainsi que quelques autres donns par Thomas de Marga
qui crivait deux sicles aprs les vnements, est sujet caution.
!1. Hist. monast., t. 11, p. t!l7 et U5, n. 2.
3. MARE, p. M. 'AIIR, p. :if. Cf. BARBBR.lEUS, col. U3 et SUiV.
Son symbole que nous avons lu dans le ms. du muse Borgia K. VI,
4, p. est parfaitement orthodoxe au point de vue nestorien mo-
dr. Il dclare nettement (p. 597) que les Chalcdoniens sont hrti-
ques, bien qu'il ne sache pas s'il doit les placer dans son catalogue
d'hrsies ct de Pau de Samosate ou ct de Svre d'Antioche.
~ - - - - - - ,
2i-.} CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
Tandis que le patriarche faisait aux prlats de la
cour impriale ces concessions commandes par les
circonstances, lsoyahb d'Adiabne et Sahdona eurent
occasion de sjourner quelque temps Apame dans la
valle de l'Oronte. Ils se mirent en rapport avec un cer
tain Jean, vque des Nestoriens qui taient disperss
dans la Damascne, et parcoururent le pays en sa com-
pagnie. Ils arrivrent un jour dans un couvent melchite
et argumentrent avec succs contre les moines. Ceux-
ci appelrent leur aide un vieillard, dont le nom ne
nous a pas t conserv, qui passait pour tre dans ces
rgions le docteur de l'orthodoxie. Le vieillard dsira
voir les trois missionnaires nestoriens et disputer avec
eux. Jean de Damas et Iso 'yahb de Ninive se rcusrent:
les vrais croyants doivent viter la compagnie des hr-
tiques. Ils avaient d'pilleurs de bonnes raisons pour se
dfier de leur adversaire. Sahdona seul accepta la ren-
contre, '' plein de confiance dans son rudition et son in-
telligence , dit Thomas de Marga
1
, curieux, croyons-
nous plutt, de connatre fond cette doctrine galement
oppose au nestorianisme et au monophysisme dont,
contraint et forc, le catholicos des chrtiens persans
venait de faire une profession publique. V ain cu par les
arguments du vieillard, Sahdona adhera la croyance
melchite.
De retour dans son pays, ilia propagea avec zle et la
dfendit contre les attaques des Nestoriens intransi-
geants. Quand son compagnon de voyage Isoyahb de-
vint catholicos, Sahdona, rejet de l'glise, dpos de
l'piscopat, dut s'enfuir desse o il prit le nom grec
de Martyrius, quivalent au sien. Le rcit dtaill de ces
1. THOMAS DE MARGA, Hisl. monast., 1. , cb. XXXIV, d. Budge, Il p. HO
et sui v.; 1. II, ch. VI, d. Budge, Il, p.i!!!l-131.
L'INV ASlON MUSULMAJ."'E. 215
aventures n'appartient pas l'poque qui nous occupe
1
La reine Boran mourut peu de temps aprs le re-
tour de cette solennelle ambassade qui scellait la r-
conciliation des deux grands empires rivaux. L'anar-
chie la plus complte succda son rgne rparateur.
Des comptiteurs nombreux se disputrent sa succes-
sion dans les diverses rgions de l'empire. Enfin, en
632, les habitants d'lstahr proclamrent roi lazd-
gerd 111
2
Mais l'empire des Sassanides n'avait plus que quel-
ques mois vivre. Ds l'anne 633, Khalid envahit 1'1.
raq et porta des coups dcisifs la domination persane
3
Presque partout les chrtiens observrent une neutra-
lit plutt favorable aux envahisseurs. Les annalistes
monophysites et nestoriens sont d'accord pour affirmer
que le patriarche Isoyahb, en particulier, ne ngligea
rien pour s'assurer la bienveillance des nouveaux ma-
tres
4
Barhbraeus n o u s apprend qu'un prince chrtien
du Nedjran, Sad, s'entremit en faveur de ses coreli-
gionnaires. Le renseignement a sa valeur. Quant au
trait dont le mme chroniqueur croit connatre les
articles, nous craignons qu'il n'ait t rvl bien plus
tard un crivain chrtien dsireux de prouver aux
1. Voir la prface l'dition de Sahdona du P. BEDJAN (1903); M. BuDGE,
op. cit., p. 138, n. 3; t53, n. 1, et les lettres d'Jso'yahb 111, concernant
cette allaire, qu'il a publies p. 13!!-1-'7.
i. TABARI, p. 397, D. 3 et 5.
3. En 633, occupation de Bal;lran (Qatar), de la Msne, de Vira et
d'Anbar. Tout le territoire situ l'Ouest de l'Euphrate tombe aux mains
des musulmans. 637 : bataille de Kadesia et prise de Sleucie-Ctsi-
phon. Iazdgerd III s'enfuit en Mdie. 638 : Invasion du Huzistan et de la
Susiane. 6to : les Arabes envahissent le plateau iranien. Mi : bataille
de Nhawend; Iazdgerd se rfugie la frontire turque. 648 : prise
d'Istahr : 6Mf!l. Iazdgerd est assassin. Les Parsis font commencer leur
re au t6 juin 63!!, date de l'avnement de lazdgerd Ill {MLLER, De1
Islam in Morgen- un Abendlan, I, p. !126-i\8).
-1. MARE, p. 5-l. 'AMR, p. 3t. 8.\RUBR.I.EUS, Chfon. eccl., Il, col.lt5 et sui V.
5. Loc. cit.
14.
246 CHOSRAU II ET LES CHRTIENS.
musulmans que les croyants de l'ge hroque avaient
accord auxNestoriens un traitementdefaveur.L'Ano
nyme de Gui di
4
rapporte plus simplement que, lorsque
le catholicos lso'yahb eut vu que Mal}.oz avait t
dvaste par les Arabes et que ses portes avaient t
transportes 'Aqla, il s'enfuit Karka de Beit
Slokh pour viter la famine. Son prtendu trait avec
les Arabes n'tait donc autre chose qu'une soumission
trs humble rendue obligatoire par les circonstances.
Le monophysite Maruta agit de mme. Pour viter
les horreurs d'une prise d'assaut, il ouvrit lui-mme, dit
Barhbraeus, la citadelle de Tagrit aux fils d'lsmal
2
On ne s'tonnera pas que les chrtiens n'aient pres-
que rien tent pour aider les Perses rsister leurs
adversaires. Les populations aramennes taient depuis
douze sicles accoutumes subir la loi du plus fort.
Les Achmnides, les Sleucides, les Parthes et les Sas-
sanides les avaient successivement exploites et pres-
sures sans merci. Les Arabes continueraient la r a d i ~
tion. Il importe peu l'esclave de servir tel ou tel matre.
i. P. !16.
2. Chron. eccl., Il, col. t2:S.
.oc
CHAPITRE IX
LE DVELOPPEMENT DE LA THOLOGIE NESTORIENNE
L'empire perse est la terre d'lection du nestoria-
nisme. Mais cette doctrine ne s'y est pas dveloppe
comme en vase clos, l'abri de toute influence tran-
gre. Elle a, au contraire, subi les contre-coups dell
variations de la thologie byzantine, du v au vu si-
cle. C'est pourquoi nous ne pouvons partager le senti-
ment de M. Harnack qui estime que l'histoire du nesto-
rianisme, aprs le concile de Chalcdoine, n'offre plus
d'intrt pour l'histoire gnrale des La vrit
est que le dveloppement de la dogmatique nestorienne
en terre persane ne pouvait tre, faute de documents,
tudie srieusement jusqu' ces dernires annes. Nous
essaierons de combler cette lacune de notre mieux, sans
nous dissimuler d'ailleurs le caractre hypothtique de
quelques-uns des rsultats de notre enqute.
Nous distinguerons trois phases principales dans
l'volution de cette thologie : 1 La formation de la
christologie nestorienne, depuis les origines jusqu'au
premier licenciement de l'cole des Perses desse;
2 la fixation de l'orthodoxie persane depuis le licen-
ciement de l'cole des Perses jusqu' la Querelle des
:1. Dogmenge&chichte, II, p. au, n. 2.
-
2-iS LA THOLOGIE l'STORIENNE.
Trois Chapitres; 3o la rpercussion de la controverse
Trois Chapitres et de la Querelle origniste dans
l'Eglise de Perse. Nons terminerons cette tude par
l'expos de la doctrine nestorienne officielle au com-
mencement du vu sicle.
S t. - Formation de la christologie nestorienne depuis
les origines jusqu'au licenciement de l'cole des
Perses (428-4:57).
Les thories christologiques qui portent le nom de
l'hrsiarque Nestorius, taient, comme on sait,
communes toute une cole de thologiens groups
autour de la grande mtropole chrtienne de l'Orient :
Antioche.
Aprs Diodore de Tarse, qui nous est malheureu-
sement trop peu connu, Thodore de Mopsueste fut
le chef rel de ce parti
1
Par raction contre l'apollina-
risme, il fut amen prciser, en plusieurs endroits de
ses uvres, et en particulier dans son grand Trait de
l'Incarnation, une doctrine o la perfection de l'huma-
nit du Christ tait nergiquement affirme. Apollinaire
avait enseign que le Verbe avait tenu lieu l'huma-
nit de Jsus d'me raisonnable. Thodore dclara
que la nature humaine de Jsus est complte et se
suffit elle-mme. L'me humaine du Christ a choisi
librement entre le hien et le mal, bien qu'elle ait tou-
jours vit le pch
2
C'est par sa persvrance qu'elle
a mrit sa glorification dfinitive. Cette vertu tout
t. Sur Thodore de Mopsueste, cf. BATIFFOL, Histoire de la Littrature
chrtienne grecque, p. i72 et su lv. SWETE, Dictionary of Christian Bio-
graphy, art. : Theodorus of Mopsuestia. Dogmengeschichte, Il,
p. 322 et suiv.
:il. P. G., t. LXVI, col. 991-2.
FORMATION DE LA CHRISTOLOGIE NESTORIENNE. 21-9
exceptionnelle tenait deux causes : d'abord la Con-
ception miraculeuse qui fit chapper le Christ la loi
de la concupiscence, ensuite et surtout son union
singulire avec le Dieu Verbe
1
Cette union lui fut
accorde cause de ses mrites prvus par Dieu. Mais
elle ragit son tour sur l'homme qui fut uni au
Verbe. Elle le rendit impeccable, et, aprs la rsurrec-
tion et l'ascension, le fit bnficier de la gloire divine.
On le voit, le Verbe est uni l'homme d'une manire
morale et non physique, x"t' &8ox(v et non xu' oa(v
2
Cependant, on ne peut pas dire que cette union ne
soit pas diffrente de celle que les chrtiens ont avec
Dieu, ni que le Christ soit, par consquent, un plll'
homme ( flv6pw1to Ce serait l'erreur de Paul de Sa-
mosate que Thodore rejeta de toutes ses forces. An-
gelus diaboli est Samosatenus Paulus, qui purum
hominem dicere praesumpsit dominum lesum Chri-
stum
3
)) L'Homme-Christ, lors de son baptme, devienl
fils adoptif de Dieu, c'est l son onction )), Cette
filiation adoptive est un privilge unique qui n'appar-
tient qu' Jsus.
D'ailleurs, ce n'est pas au baptme que Thodore
place le point de dpart de l'conomie en vertu de la-
quelle le Verbe est uni l'humanit. L'union s'accom-
plit en effet ds le message de l'Ange
4
Par quelles formules exprimer la fois l'unit cl
la dualit? Thodore dclare qu'il n'y a pas deux fils,
mais un seul Fils : Btio xup{ou :;
1. col. 917.
i. Cf. la Confession de foi de Thodore; IV, p. 13\i et sui\'.
P. G., LXVI, col. 1015-101!1, !176, 1011.
3. Theoclori Mops. in epp. B. Pauli commentarii, d- SwETE, t. JI,
p. 33i. cr. P. G., col. 776.
-' P. G., t. LXVI, col. 994, 1013.
11. Col. 1017.
250
LA THOLOG,IE NESTORIENNE.
Mais il y a deux natures : 6f1-ooy!iTatt l1tEt1tEp
-roov cpvcnwv 8t(pE<nc &vyx(wc dcp!1!t
4
; le mode
d'union est proprement dsign par le terme de auvrlcpEtiX
(par opposition r(e,c, xp<nc, avyxpatc). Ce mot exprime
l'union, mais exclut la compntration; en manire
de commentaire et de mtaphore, Thodore dit que
!"humanit du Christ est, par rapport au Dieu Verbe,
son temple, son vtement, sa maison, son organe
(voc, o1xoc, lfJ-Ii-rtov, d'o les expressions tvolx1}<nc,
lv8uatc, iv'l.ll4tc, lvlpyu, synonymes d'olxovofl-(,
"111j<fl;).
Cette adhsion (auvt.lcpEtat) est, du reste, dfinitive et
indestructible (lix_wpta-roc auvticpEtat) et c'est pourquoi elle
peut bien tre appele union : rvwnc
2
Ce terme toute-
fois veut tre prcis. Cette union ne peut tre ni
essentielle, ni physique, sous peine d'exprimer la con-
fusion des deux natures. Elle sera donc figurative ou
prosopique
3
TO 1tpOGW1tOU par opposition
rvwatc fvwatc Thodore la compare
l'union de l'homme et de la femme, et quelquefois
aussi celle de l'me et du corps.
On ne peut nier que cette union ne soit principale-
ment extrieure. Vus du dedans, si je puis m'exprimer
ainsi, le Verbe et l'Homme sont deux. Vus du dehors,
par ceux qui doivent les honorer et les adorer, ou
mme par les deux autres personnes . de la Trinit,
ils ne sont qu'un. Si donc il est ais de parler de
l'unique filiation et de l'unique domination
xupto-rf,c), il est fort embarrassant de prciser ce qu'on
i. col. 985 et iOta.
2. Col. 9811, i013 et i0i7.
3. Il faut noter que cette unit de 7tp6aw7tov n'existe que si l'on se
place au point de vue de l'union. Car autrement l'humanit a son
7tp6aw7tov parfait et la divinit le sien. Il y aurait donc deux oztpoaoollll
(cf. HARNACK, Dogmeng., JI, p. 339, note 2).
FORMATION DE LA CHRISTOLOGIE NESTORIENNE. 21H
entend par le 7tpOaw'ltov unique, ou plutt ce qu'il y a
derrire ce 7tpoaoo'ltov.
La question se posait surtout propos de la naissance
du Christ. Sans doute l'homme adhrait au Verbe ds
le dbut de sa conception, mais la Vierge elle-mme
tait-elle tivOpoo7toToxo ou 0EoToxoc? Suivant Thodore, les
deux expressions sont acceptables ; mais la premire
seule est strictement vraie, la seconde ne l'est que par
infrence ('r!j
1
Il ne semble pas qu'il ait propos
lui-mme l'expression de x_ptaToToxoc.
Nestorius
2
donna cette thorie l'appui de sa
brillante loquence. Comme Thodore, il repoussait
la doctrine de Paul de Samosate. Comme lui, et plus
que lui peut-tre, il insistait sur l'union des deux
natures dans la personne du Christ. Mais il ne pouvait
souscrire la doctrine du OaoToxo, parce que ce vo-
cable signifiait pour lui : unit physique, substantielle,
et communication des idiomes.
Il reconnaissait bien que cette expression tait ca-
pable d'un sens orthodoxe : Dixi iam saepius si quis
inter pos simplicior, sipe inter quoscumque alios
Poce hac OaoToxoc gaudet, apud me nulla de Poce in-
Pidia, tantum ne Virginem faciat Deam
3
Filius na-
tus est Deus Verhum et Homo, ergo quae peperit prop-
ter unitatem dicatur Dei genetrix, id est 0EoToxo ,, Et
il pouvait crire au pape Clestin : Ego et hanc qui-
dem pocem quae est 0EoToxo, nisi secundum Apolli-
i. P. G., t. J,XVI, col. 991.
les sermons de Nestorius, consulter l'tude de }!"' P. BATIFFOL
dans la Revue biblique (i!JOO), t. IX, p. 329-353. Voir sur Nestorius, l'ar-
ticle de LooFs dans l'encyclopdie de Herzog, t. XIII, p. 736-7-l9 et la
Prface que le P. Garnier a mise en tte de son dition de Marius Mer-
cator. MIGNE, P. L., t. XLVIII.
3. Sermon VI, n. L., XLVIII, col. 786.
Sermon XII, n. col. 859.
.,.._...,
LA THOLOGIE NESTORIENNE.
naris et Arii furorem ad confusionem naturarum
proferatur, volentihus di cere non resisto
1
Mais trop de questions personnelles se mlaient
ces problmes doctrinaux. L'arrogant patriarche de
Constantinople n'tait pas homme capituler devant
tl.es menaces. Quand Jean d'Antioche lui crivit
2
: Si
tu penses et sens la mme chose que les saints Pres
et les docteurs de l'glise (et c'est ce que nous avons
appris de toi), pourquoi ne te dclares-tu pas haute-
ment? il aurait pu rpondre qu'il ne voulait pas
s'humilier devant le pape de Rome et le Pharaon
J'gypte. Ses compatriotes, qui d'ailleurs taient en
majorit partisans de sa christologie, le soutinrent
avec ardeur. Ils firent tous leurs efforts pour rendre
vaine l'uvre du concile d'phse prsid par saint
Cyrille.
Leur nergique opposition fut vaincue par les ordres
de la cour, et, dit-on, par les eulogies du patriarche
d'Alexandrie. Jean d'Antioche convoqua un concile du
diocse d'Orient Bre (432). Les mtropolitains
taient tous prsents l'exception de Rabbula d'desse
pass au parti de Cyrille. Thodoret s'abstint d'y
paratre. On convint de sacrifier la personne de Nes-
torius et ses anathmatismes contre saint Cyrille.
En revanche, les gyptiens durent signer un symbole
d'union, celui-l mme que les Orientaux ayaient com-
pos phse dans l'anticoncile. Ce symbole tait
conforme la doctrine de Thodore et de Nestorius
3
On n'y parlait point, il est vrai, de auvofipEIIX, et on
acceptait les termes d'lvwat et de Mais nous
!.. Lettre III, n. !!, col. 8t2.
:!. Concil. Ephes., pars I, ch. ill. MA!ISJ, t. IV, col. t064.
3. )IANSI, t. V, p. 783, 29t, 303. Cf. Harnack, Dogmengeschichte, t. Il,
p. au, n.t.
FOI\1\IATION DE LA CHRISTOLOGIE NESTORIENNE. 253
avons vu que ces mots taient amphibologiques.
Par contre, il tait question de deux natures, de 1tpOO'w-
1tov unique, et l'on restreignait la communication des
idiomes, sans d'ailleurs en formuler explicitement les
lois.
En vrit, c'tait une victoire pour la doctrine d'An-
tioche. Les Nestoriens avancs ne s'en contentrent
pas. Andr de Samosate
1
, Mltios de Mopsueste,
Alexandre de Hirapolis dclarrent que le 6EoToxo
tait une expression hrtique. Ils se sparrent de la
communion du patriarche Jean.
Thodoret n'osa pas se compromettre aussi ouver-
tement. Il convoqua Zeugma un synode, o l'on
dcida de ne pas anathmatiser Cyrille, mais o l'on
refusa de condamner Ainsi le diocse d'O-
rient se trouvait divis en quatre factions : les Cyril-
liens acharns avec Rabbula et Acace de Mlitne,
les politiques avec Jean d'Antioche, les Nestoriens
modrs avec Thodoret et le synode de Zeugma, les
Nestoriens avancs avec Alexandre de Hirapolis et
le synode d'Anazarbe.
D'accord avec les officiers impriaux, Jean d'Antioche
agit avec vigueur. Aprs quelques vellits de rsis-
tance, les schismatiques cdrent. Quelques irrducti-
bles furent condamns l'exil. Nestorius, retir An-
tioche depuis432, fut relgu Oasis
3
Thodoret signa
le symbole d'union, mais fut laiss libre de ne pas
L M. Baumstark a signal rcemment une lettre d'Andr de Samosate
Rabbula contenue dans le ms. du muse Borgia K. vi, "p.
Andr y professe sa fol en un '1tp6aw'l'l:ov, deux natures et une hypostase.
Faute de connatre Je texte complet de ce document, nous renonons
en tirer parti pour cette tude (Or.ien& Chriatianu&, 1'" anne, n i,
p.180. Rome, t90t).
1. HI!FELE, Histoire des Concile&, t. 11, p . .W9 et sulv., trad. Delarc.
IIA!ISI, t. V, H6i. .
3. EV.lGBIUS, Hist. eccl., J, 7. 1'. G., t. LXXXVI, col. 2i38.
LE CBRISTIAI'IISME.
15
'
'1
25i LA THOLOGIE NESTORIENNE.
contresigner la dposition de Nestorius. En somme,
l'union tait scelle entre les gyptiens et les Orien-
taux : union purement extrieure, politique, et repo-
sant sur des concessions de forme. Chacun campait
sur ses positions. L'vque de Cyr pouvait crire
Alexandre d'Hirapolis qu'en vue de la rconciliation il
n'avait que la personne de Nestorius, et non
pas son dogme
4
On le vit bien. Cyrille, ayant appris que quelques
Orientaux acceptaient le et anathmatisaient
Nestorius sans pour cela rejeter le nestorianisme,
voulut leur imposer une nouvelle formule l, Mais le
patriarche d'Antioche repoussa catgoriquement ses
ouvertures. Cyrille
3
dut se borner obtenir par l'inter-
mdiaire du tribun Aristolaos l'adhsion crite de tous
les Orientaux au flaoToxo et ces deux formules bien
anodines: il n'y a pas deux Christ; -le Logos, qui,
de sa nature, ne peut souffrir, a souffert dans sa chair.
C'est ce moment prcis qu'lbas, docteurde l'cole
des Perses desse, informe son correspondant Mari
de Beit Ardasir de l'tat des esprits dans le diocse
d'Orient. lbas avait t un Nestorien militant, ou plu-
tt un partisan dtermin de la christologie antio-
chienne. Personnellement, il avait souffert pour la
cause. Rabbula, le tyran de notre ville ,comme ill'ap
pelle, l'avait perscut, non sans raison peut-tre,
car on lui attribuait un propos pour le moins hasard :
<< Je ne suis pas jaloux du Christ, aurait-il dit, de ce
qu'il est devenu Dieu, car je puis le devenir si je
veux . Il protesta, il est vrai, aux conciles de Tyr et
t, P. G., LXXXIII, col. cf. Hn.
!. HEFELE, II, p. 467.
3. Voir sa lettre LXII[, P. G., t. LXXVII, col. 3!7.
Musr, t. VII, p. ! et suiv. HEULE, III, p. 81 et suiv. Cf. ci-dessus,
ch. vr, p. t3!, n. 6. P. MARTIII, Acte& du Brigandage trEphse, p. 56, 60, 71.
FORMATION DE LA CHRISTOLOGIE NESTORIENNE. 255
de Bryte qu'il tait victime d'une odieuse calomnie.
Ce pouvait tre exact. Mais Ibas ne se refusait jamais
dsavouer un document compromettant. Il prtendit
mme au concile de Chalcdoine que la lett.re Mari
tait suppose ou au moins interpole. Quoi qu'il en
soit, on n'aurait pu lui attribuer cette formule s'il n'a-
vait t universellement connu pour tre un anticyril-
lien convaincu.
Aprs avoir rappel la tyrannie de Rabbula qui a
perscut non seulement les vivants, mais encore les
morts))' c'est--dire qui a cherch faire condamner
les crits de Diodore de Tarse et de Thodore de Mop-
sueste, Ibas informe son correspondant que toute que-
relle est termine. L'union est faite par l'entremise
de Paul d'mse. Le docteur d'desse envoie, l'ap-
pui de ses dires, la correspondance change entre
Jean et Cyrille, afin que tu voies toi-mme et que tu
annonces tous que le dbat est fini... et que ceux
qui ont poursuivi d'une faon irrgulire les vivants
et les morts doivent tre couverts d'ignominie. Ils doi-
vent maintenant avouer leurs fautes et enseigner le
contraire de ce qu'ils ont enseign auparavant, car .
nul ne peut dire maintenant que la divinit et l'hu-
manit ne sont qu'une seule nature; il y a unanimit
dans la foi au temple et celui qui l'habite, comme
tant un seul Fils, Jsus-Christ>>.
On le voit, lbas se tient sur le terrain trs solide du
symbole d'union. Avec presque tous les Syriens il a
compris que laformule adopte sous la prsidenced'A-
cace de Bre, et peut-tre rdige par lui, consacrait
l'orthodoxie de la christologie d'Antioche. A ce prix,
il convient que Nestorius a err. Il en dit d'ailleurs au-
tant de Cyrille, et conclut que <d'glise a toujours ensei-
gn depuis le commencement jusqu' nos jours: deux
256 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
natures, une force, une personne qui est le seul Fils
de Dieu .
Le nestorianisme persan , nous voulons dire celui
des symboles officiels antrieurs au vu sicle, a tou-
jours maintenu ces positions : affirmation des deux
natures et de la personne unique, silence sur Nestorius
et sur Cyrille, silence sur la formule controverse
du 6EO't0XO,
lbas et ses collgues de l'cole des Perses ne s'en-
dormirent point sur leurs succs. Ils traduisirent en
syriaque les uvres des docteurs d'Antioche, surtout de
Diodore, de Thodore, de Thodoret ainsi que des v-
ques sous le nom desquels circulaient les crits prohi-
bs de Nestorius : Basile de Cilicie et Amphilochius
d'lconium.
Leur activit littraire dut tre alors considrable
et redoubler encore lorsqu'en 435, Rabbula tant mort,
Ibas lui succda sur le sige d'desse. Jusqu'en 448,
les Antiochiens vcurent en paix dans leur domaine
propre qui s'tendait des bords de la Mditerrane
ceux du golfe Persique.
Thodoret lui-mme crivit, en ce temps-l, des ou-
vrages de cont1overse nettement dyophysites, en par-
ticulier ses trois dialogues intituls Eranistes ou Po-
lymorphus
1
Sauf en ce qui concernait la personne de
Nestorius, d'ailleurs oubli- dans son lointain exil,
l'uvre du concile d'phse et de Cyrille tait donc rui-
ne.
Dioscore, le nouveau patriarche d'Alexandrie, reprit
la lutte, l'occasion de la condamnation d'Eutychs
par l' Antiochien Flavien, patriarche de Constantino-
ple (448). L'ordre de bataille tait le mme qu'en 431.
t. P. G., t. LXXXIII, col. 3t-3t8.
FORl\IATION DE LA CHRISTOLOGIE NESTORIENNE. 257
D'une part, Antioche et Constantinople; de l:autre,
Alexandrie. Mais l'influence du patriarche d'Egypte
tait bien plus considrable que celle de son prd-
cesseur. Il imposa son formulaire au deuxime con-
cile d'phse (latrocinium Ephesinum ). L'autorit
mme du pape Lon 1 ne put contre-balancer la sienne.
Il ne permit pas qu'on lt le clbre tome apport
par les lgats. Domnus d'Antioche faiblit sous les
menaces. On rhabilita Eutychs. On n'osa pas con-
damner Lon, mais on le traita comme une quantit
ngligeable.
Les Antiochiens furent dposs, tant les plus ar-
dents que les plus timides : Flavius de Constantino
ple et le faible Domnus d'Antioche furent sacrifis,
lbas expuls de son sige et Thodoret dpos. lbas
avait t accus par ses clercs : << Ce n'est que lors-
qu'on a critiqu son orthodoxie, disent-ils, ce n'est
que lorsque nous avons eu constat la justesse de ces
accusations par des crits envoys en Perse dont il
ne saurait renier la paternit, que nous avons refus
de le recevoir. Nous tenons conserver la foi que nous
avons eue ds le principe, et nous savons que les
crits d'lbas lui ont caus de notables prjudices chez
les P e r s e s ~ 11. Avec l'vque d'desse, on exila comme
perturbateurs les Persans Baba, Bar!?auma, le futur
vque de Nisibe, et Balas.
Le concile de Chalcdoine remit toutes choses en
ordre. C'est une question longuement controverse de
savoir en quel sens furent prises les dcisions dogma-
tiques de cette assemble. M. Harnack
2
a pens que la
majorit avait entendu se prononcer dans le sens de saint
f. liARTill, Actes du Brigandage d'phse, p. 26.
!!. HARNACK, Dogmengeschichte, p. 368. Cf. ERliONI, De Leontio Byzan-
tino, p. 35.
258 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
Cyrille et du premier concile d'phse. Nous ne pouvons
souscrire ce jugement. Que la majorit ft attache
l'opinion cyrillienne et mme au monophysisme, nous
n'y contredirons pas. L'vnement le montra bien. Mais
qu'elle se soit dclare en faveur des opinions qu'elle
professait, c'est ce que nous ne saurions admettre
1
La majorit a adhr au tome de Lon sur l'invita-
tion des commissaires impriaux, quoi qu'aient pu
penser et dire Anatolius de Constantinople et ses par-
tisans. Or, le tome>> de Lon condamne Nestorius au
mme titre qu'Eutychs et prescrit l'adhsion au
6eoToxo; mais sa christologie est aussi nettement dyo-
physite que la christologie antiochienne; elle l'est
presque davantage.
Un fait bien significatif est l'expulsion de Dioscore
qui n'tait pas eutychien, mais cyrillien. Surtout il
faut accorder une grande importance la rception de
Thodoret et d'lbas. C'est dans ces circonstances que
se vrifie la conjecture que nous proposons plus haut.
La majorit veut d'abord exclure l'vque de Cyr.
Les lgats insistent pour qu'on le reoive : il en a ap-
pel saint Lon et saint Lon a proclam son ortho-
doxie. On l'introduit. Mais les Orientaux exigent qu'il
condamne ouvertement Nestorius. On espre qu'il n'y
consentira pas et qu'il sera dpos. Thodoret, invit
prononcer l'anathme, cherche chapper au pige
t. Que l'on pse des expressions comme celles-ci, empruntes au tome
de Lon t. VI, 96! et sui v.): Salva igitur proprietate utriusque
naturae et substantiae et in unam coeunte personam suscepta est a
maiestate humilitas , mediator Dei et hominum lu>mo Christus Je-
sus (col. 971), et celle-ci qui rduit au minimum la communicr..tion
des idiomes : Agit utraque forma cum alterius communione, quod
proprium est, verbo scilicet operante quod verbi est et carne exse-
quente. quod carnisest (ch. ry). Nous ne mconnaissons pas d'ailleurs que
la christologie romaine tait tout fait indpendante de celle d'An-
tioche, mais elle se rencontre avec elle pour aflirmer vigoureusement
la sparation des natures, qualifies en mme temps de substances.
FORMATION DE LA. CHRISTOLOGIE NESTORIENNE. 259
qu'on lui a tendu
1
Il proteste de sa perptuelle ortho-
doxie, puis veut exposer sa foi. Les gyptiens, les
Palestiniens et les Illyriens manifestent leur impa-
tience : C'est un hrtique, disent-ils, c'est un Nesto-
rien, qu'on le chasse! Alors Thodoret prononce :
<< Anathme Nestorius et quiconque n'appelle pas
la Vierge Marie Mre de Dieu et qui divise en deux
Fils le Fils unique; j'ai souscrit comme les autres la
dfinition de foi du synode et la lettre de Lon )) .
lbas
2
fut admis par la suite aprs avoir, il est vrai,
anathmatis << dix mille fois
3
Nestorius. Et non
seulement il fut admis, mais on lui rendit sa charge ..
Nonnus qui lui avait t substitu desse conserva
la dignit piscopale, mais fut priv de toute juridiction.
Thodoret et lbas taient donc entirement rhabilits
par les soins des lgats. Nous ajouterons que des
monophysites comme Dioscore se rencontrrent avec
des Nestoriens avancs comme Jean d'ge pour voir
dans le concile de Chalcdoine la revanche du parti
no-nestorien.
La profession de foi de Chalcdoine confirme-t-elle
ce jugement? Aprs avoir rprouv d'un ct ceux qui
rejettent l'expression 6Eotoxo, elle condamne ceux qui
. parlent de confusion et de mlange des natures
et les Thopaschites .. Puis ceux qui, admettant
les deux natures avant l'union, n'en admettent qu'une
seule aprs l'union. Le passage saillant est celui-ci_:
[
' - l " 1 ' ' x ' 1 " , ,
<>(A.OIIO'(OVfUV 'tOV IXV'tOV pttnov..,.oV OUO IXauy-
;(<hw, cltp1ttw, clot1Xtptw, oOIX(A.OU
'tlj twv tiX<popi clv!iP'IJfit) tat t't.v vwatv,
fA.Ciov rij tto't'l)to bottpcx cpocnw;, xcxl El 1tpoaw1tov
t. MANsr, t. vu, col. t87 et sui v. Hr.rr.LE, t. Jll, p. 7t et sui v.
2. MANS!, t. VII, col. 21i5-270. HEFELE, t. III, p. 6t,
3, MANS!, t. VU, p. 267,
260
LA THOLOGIE NESTORIENNE.
xll\ f&lllv fmoa-tllatv auv'tpax.ouCJ1l, ox El uo 1tpoaw'ltiX
l''"ov t1XtpOuf&EVOY
1
li/.).at fviX XIX\ 'tOY IX'tOV utov XIX\
llaov >.oyov
Parce qu'il reposait sur des quivoques, l'accord si
vivement dsir par Marcien ne fut qu'phmre, si
tant est qu'il ait jamais t ralis
2
L'opposition des
deux partis en prsence, Antiochiens et Cyrilliens,
s'accentua d'autant plus vivement qu'ils avaient d se
faire une plus grande violence pour aboutir un rap-
prochement apparent, grce des concessions mu-
tuelles pniblement consenties aux exigences de l'em-
pereur. Les Cyrilliens surtout, entrans par l'aile
gauche du parti qui se dclarait franchement pour le
monophysisme, protestrent contre le concile de Chal-
cdoine et le tome de Lon. En un moment, l'gypte,
la Palestine et la Syrie se rvoltrent; les empereurs
ne purent gure assurer aux orthodoxes que la pos-
session des grands siges, et encore d'une manire
prcaire. Le mouvement monophysite gagna mme
la Syrie euphratsienne et l'Osrhone, autrefois le
boulevard du dyophysisme. Quand Thodoret et lbas
disparurent (457), la cause antiochienne ne trouva
plus de champion dans ces provinces. Nonnus, le suc-
i. MAN SI, t. VIl, col. Hi.
2 Il serait intressant de savoir si le concile de Chalcdoine fut reu
dans l'empire perse. A la vrit Maraba insre dans son concile (Syn.
orient., p. 5:>6) un dcret disciplinaire de Chalcdoine. Mais ce n'est
pas une raison snrtisante pour penser que le tv synode cumnique
prit place dans le droit canon oriental (V. ci-dessus ch. '"' p. t87, n. !il).
En sens contraire, on pourrait allguer que les protocoles synodaux
ne parlent jamais que du concile des 3t8 Pres et du concile des f50,
c'est--dire des premier et deuxime conciles gnraux. Quant aux
dcisions dogmatiques, on s'en tieut la terminologie du symbole
d'union de 433. Chose curieuse et digne de remarque, Je terme d'hypos-
tase (syr. 1->oOJ.O) n'est pas employ avant le vu sicle, dans les dfi-
nitions officielles. A tout le moins, le concile de Chalcdoine ne fut
pas rejet explicitement par les thologiensofficielsdei'glise de Perse.
FORMATION DE LA CHRISTOLOGIE NESTORIENNE. 261
cesseur d'lbas, chassa les Persans d'desse, en haine
de son ancien comptiteur plus encore peut-tre que
par zle pour la doctrine, car il parat avoir t pour
son propre compte un Antiochien modr.
Le rsultat de cette perscution fut celui qu'on pou-
vait attendre. De mme qu'aprs Chalcdoine les
monophysites vaincus se fortifirent dans leur oppo-
sition et accenturent l'affirmation de leur doctrine,
ainsi les Nestoriens, obligs de regagner la Perse, ne
se crurent plus tenus aucun mnagement.
Ils reprirent hautement les positions qu'ils avaient
abandonnes en Occident et arborrent en guise de
drapeau le nom de Nestorius, autour duquel on avait
fait le silence depuis 433. Il ne fut plus question en re-
vanche de la llEotoxo, et l'on parla plus nettement de
la dualit des hypostases. Nous ne pouvons pas malheu-
reusement prciser la date laquelle s'accomplit cette
volution vers le nestorianisme plus rigide. Elle se
dessina certainement entre 457 et 482, et fut consomme
en 489, lors de la dfinitive, par le mono-
physite Cyrus, de l'Ecole des Perses Edesse, suivie
de la cration de l'cole de Nisibe .
S 2.- Fixation de l'orthodoxie persane (457-553).
Nous avons not plus haut
2
la significative concor-
dance de dates qui existe entre l'action antimono-
physite de et cette demi-victoire monophy-
site ou plutt antichalcdonienne que fut l'Hnotique
de Znon. C'est cet acte imprial que rpondit,
t. Voir ci-dessus, ch. VI, p. 138 et HO.
!:1. Ch. VI, p. tas.
15.
262 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
croyons-nous, le synode d'Acace en affirmant nette-
ment le dyophysisme et en rejetant l'addition de Pierre
le Foulon au Trisagion (&yto 6 Oso, &yto toxupo, &yto
liOclviX'I"O, 6 a'\"1Xupw6&! et l'interprtation plus
bnigne de Znon : y&p ElviXt cp11[J.h -rel n xt
T& "ltcX!l-tj &7tep boualw fml[J.m& a11pxl t.
Nous enseignons et nous avertissons toute la corn
munaut des fidles, dit le canon 1 du synode d'Acace
2
,
que notre foi doit tre, en ce qui concerne l'Incarna-
tion du Christ, dans la confession des deux natures
de la divinit et de l'humanit. Personne de nous ne
doit oser introduire le mlange, la communication ou la
confusion entre les diversits de ces deux natures;
mais la divinit demeurant et persistant dans ses pro-
prits et l'humanit dans les siennes, nous runis-
sons en une seule majest et en une seule adoration
les diversits des natures, cause de la cohsion par-
faite et indissoluble de la divinit avec l'humanit.
Et si quelqu'un pense ou enseigne aux autres que la
passion ou le changement est inhrent la divinit de
Notre-Seigneur, et s'il ne conserve pas, relativement
l'unit de personne (1tpoaw1tov) de notre Sauveur, la
confession d'un Dieu parfait et d'un homme parfait,
que celui-l soit anathme! >>
On se demandera peut-tre en quoi cette dclara-
tion : nous runissons en une seule majest et en
une seule adoration les diversits des natures s'op-
posait celle de Znon cite plus haut. Nous rpon-
drons que des formules trs voisines, voire identiques
en apparence, peuvent masquer des tendances diver-
gentes et contradict'oires. Znon aurait pu, semble-t-il,
signer ladclaration d'Acace, et Acace celle de Znon.
1. EV.I.GRIUS, H. E., Ill, H.
2. Syn. orient., p. 302,
FIXATION DE L'ORTHODOXIE PERSANE. 263
Entre eux toutefois, subsistait un dissentiment essentiel
et irrductible. Acace repousse nergiquement toute
communication des idiomes. Il consent parler d'une
'' seule majest et d'une seule adoration 11 (gr. xupto-
-tl], oi-tpet1X), mais jamais il n'acceptera d'accoler un
nom convenant la nature humaine un prdicat appar-
tenant la nature divine. Znon, au contraire, ne sous-
crit pas pleinement l'addition de Pierre le Foulon,
parce que la formule ainsi complte a une saveur
incontestablement sabellienne et patripassienne; mais
il incline au monophysisme, parce qu'il admet avec
toutes ses consquences la communication des idio-
mes. Quand Lonce de Byzance aura russi donner
la formule orthodoxe de Chalcdoine une teinte mono-
physite, les thologiens impriaux n'hsiteront plus;
ils iront jusqu' l'affirmation du Deus passus, ainsi
que nous le montrerons plus loin.
On aura remarqu qu'aucun nom propre n'est pro-
nonc dans le canon d'Acace. Les condamnations sont
impersonnelles
1
Saint Cyrille n'est pas anathmatis,
Nestorius n'est pas lou. On s'abuserait si l'on jugeait
de la polmique nestorienne par ce morceau de tho-
logie officielle. Fort heureusement, M. l'abb Martin
a rcemment publi un document de haute importance,
parce qu'il mane du grand thologien Narss
2
C'est
t. L'anticoncile de Beit Lapat, tenu en 48\ par les partisans de Bar-
~ a u m a sous la prsidence de Nana de Prat, porta, au sujet de Tho-
dore de Mopsueste, la dlhiilion suivante (Syn. orient., p. 711) : A
cause des bruits malveillants rpandus contre lui par les hrtiques
en divers lieux, personne de nous ne doil concevoir de doutes au sujet
de ce saint homme .. ses livres et ses commentaires conservent la foi
immacule ... ils dtruisent et rfutent toutes les doctrines opposes
la Providence manifeste par les Prophtes, ou la prdication de l'
vangile par les Aptres
!!. Homlie sur les trois docteurs nestoriens. Journal asiatique (juillet
i900).
264,
LA THOLOGIE NESTORIENNE.
une homlie en l'honneur des trois docteurs Diodore,
Thodore et Nestorius
1
L'auteur expose la doctrine
nestorienne dans toute sa puret : Jsus-Christ en
deux natures, deux hypostases et une personne
2
Il
fait l'loge des Commentaires de Thodore, cet homme
u dont l'il s'obscurcit dans l'tude des critures
sans arrt et sans interruption
3
. u Les lecteurs des
Livres saints mditaient dans l'ignorance jusqu' ce
qu'ils eurent lu ses livres; alors ils comprirent. Il
convient d'appeler docteur des docteurs l'esprit exerc
sans lequel il n'y aurait pas de docteur qui donnt
un bon enseignement. Par le trsor de ses crits
se sont enrichis tous ceux qui possdent, et, par ses
Commentaires, ils ont acquis la facult d'interpr-
t. Cette rhabilitation des trois docteurs tait peut-tre ncessite
par les attaques de Pbiloxne (p . .tn) : A cette heure mme, il [le dia-
ble] a vu trois bommes qui enseignaient bien Narss est un Nestorien
rigide. JI rejette absolument la communication des idiomes {p. 1107) :
Une violente colre avaient les sots contre les doctes, parce que ceux-
ci distinguent les proprits natureiles du Verbe et do Corps. Le Cra-
teur, Verbe du Pre, a pris un corps humain et il l'a appel, dans son
amour, Fils de Dieu, selon son rang. JI ae l'est donn lui-mme, alors
qu'il n'avait besoin de rien de ce qui existe, car il n'est pas dans sa
nature qu'il subisse une diminution ou une augmentation. Sa nature
est au-dessus des vicissitudes et les proprits de la nature humaine
lui sont trangres. A la nature humaine s'attachent les misres de la
nature humaine, mais non la nature leve, place au-dessus des
souffrances. A J'homme appartient tout ce qui .est crit du Fils de
J'homme : la conception, la naissance, la croissance et la mort Le
Cantique {p.llt5) contient une intressante discussion scripturaire entre
les Cyrilliens et les dyophysites. Mais le docteur de Nisibe a surtout
confiance dans les anathmes {p. 5tO): JI n'y a assurment pas d'autre
remde contre J'ignorance des ignorants que la dcision, qui tranche
le procs, de la parole de Notre-Seigneur. La parole de Notre-Seigneur
les retranche de l'glise et les condamne l'exil avec les infidles. Il
nous a ordonn de les considrer comme des paens et de ne pas nous
mler des pratiques odieuses Cette homlie doit avoir t crite
entre et 490.
!. Dans les textes syriaques : = = int6-
a<!Xa!,, lBI61'JlTE,, lSif;,I/ATIX.
Il_, = p.O(lcp'Jl.
3. journal asiatique, p. W9.
FIXATION DE L'ORTHODOXIE PERSA.J."'E. 265
ter. C'est son cole que, moi aussi, j'ai appris bal-
butier, et, dans son commerce, j'ai acquis l'habitude
de la mditation des paroles divines
1
Mais ce qu'il
dit de Nestorius est particulirement intressant.
Cette homlie de Narss est, en effet, le plus ancien
document persan qui concerne l'hrsiarque. Cinquante
ans aprs les faits, on ne connaissait plus que trs im-
parfaitement la querelle proprement nestorienne. L'-
nergique Nestorius
2
administra les habitants de By-
zance et leur apprit soutenir en face les luttes contre
les hrsies. La Ville Royale chut au fort charg de la
diriger ... Il construisit sagement et consolida la parole
de vrit, afin qu'elle ne ftlt pas branle par les
souffles perturbateurs des hrtiques... Des prtres
frauduleux stipendirent des femmes pour un jugement
falsifi et ils en firent des avocats de mensonge. Pour
de l'or, ils vendirent la vrit pure. C'est une maligne
allusion aux dmarches de saint Cyrille auprs de
Pulchrie et des fonctionnaires de Thodose II.
Aprs avoir marqu que Nestorius fut condamn par
le chef d'gypte , parce qu'il distinguait l'image
du serviteur et celle du Crateur >> et qu'il se refusait
appeler Marie Mre de Dieu, Narss stigmatise le
concile d'phse qui dposa Nestorius, et aussi le sym-
bole d'union de 433, qui, d'aprs lui, cra dans les es-
prits une confusion inextricable
3
t. P. 505 et suiv.
91. P .t87 et suiv.
3. Jusqu'ici, le docteur de Nisibe relate assez exactement l'histoire
des faits dont il fut peul-tre tmoin. Il y mle toutefois des erreurs
lorsque, par exemple, pour prouver !"injustice de la condamnation
d'phse, il affirme que Nestorius mourut avant d'avoir comparu devant
aes juges (p. 493 et 9 1 ) . Atil confondu le concile d'phse et celui
de Chalcdoine o l'on ritra la condamnation de Nestorius? ou bien
simplement voulu charger les traits de son tableau? Nous ne saurions
le dire.
Il est probable que Nestorius tait personnellement peu connu dans
'!"*:LWJ D,..Sf?C
1
266 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
On le voit, Narss tait un Nestorien rigide. Mais les
ncessits de la polmique avec des Monophysites
comme Simon de Beit Arsam, amenrent peu peu les
docteurs persans des opinions moins absolues. Le mo-
nophysisme au v1
8
sicle s'affina singulirement, au
point qu'il devint difficile de le distinguer de l'orthodoxie
autrement que par le refus d'admettre le concile de
Chalcdoine et le tome de Lon. Le nestorianisme
accomplit une semblable volution, et la doctrine de
Maraba n'est pas trs loigne de la foi byzan-
tine.
Nous avons dit plus haut
1
qu' partir de l'avne-
ment de Justin (519), plusieurs Persans se rendirent
dans l'empire romain pour y visiter les saints Lieux.
Il est bien probable qu'ils communiquaient in sacris
avec les orthodoxes; parmi lesquels un grand nombre
demeuraient acquis la vieille thorie antiochienne.
Nous ne pouvons pas nous expliquer autrement la po-
lmique trs vive des no-cyrilliens dfenseurs du con-
cile de Chalcdoine,comme Lonce de Byzance, contre
les Nestoriens . On n'argumente pas avec tant de
vigueur contre des ennemis crass depuis prs d'un
sicle. Du moment que le nom de Nestorius n'tait pas
prononc, les Occidentaux et les habitants de Cons-
tantinople, ainsi que de nombreux Orientaux, devaient
tre tout disposs accueillir comme des compagnons
la Msopotamie et l'cole d'desse, puisque l'opinion que se for-
maientde sa vie, au v1 sicle, les lves de l'cole des Perses tait si peu
conforme l'histoire. Si nous trouvons d'autres rcits dans les annalistes
posterieurs, ils ne contiennent pas d'informations originales, mais sont
le produit d'une compilation dont les auteurs seraient rechercher. MARE,
d. Gismondi, p. 30 et suiv.; GOELLER, Ein nestorianisches Bruchstcl;.
zur Kirchengescbichte , Oriens Christianus, fascicule 1, p. 80 et sui v.
Rome,t90!!;-BRAUN, Z.D.M.G., LIV, n. 3; la lettre publie par M. Braun
serait, parait-il, contemporaine de Nestorius.
i. Ch. vn, p. t64.
FIXATION DE L'ORTHODOXIE PERSANE. 267
d'armes les adversaires irrductibles de la thologie
alexandrine.
La doctrine du catholicos Maraba nous est connue
par sa profession de foi crite en l'anne 540, lors du
voyage circulaire qu'il entreprit pour rformer les
glises du sud de la Chalde et de la Perse propre.
Elle parat avoir t conue dans le dessein de con-
damner tout ensemble le nestorianisme rigide et le
monophysisme. <<Dieu, dit-il
1
, parla avec nous par son
Fils, qu'il a tabli hritier de toutes choses et qui est
le Christ Notre-Seigneur. >> Puis, aprs avoir attribu
ce Christ unique tant la Passion que les miracles, il
poursuit li: Ils (les disciples) apprirent de l'Esprit-Saint
que le Christ n'est pas un homme simple, ni Dieu d-
pouill du vtement de l'humanit dans lequel il s'est
montr, mais que le Christ est Dieu et homme, c'est--
dire l'humanit ointe et la divinit qui l'a ointe
3
Et il
conclut par ces anathmes qui marquent bien son dsir
de rpondre par avance la principale objection qu'op-
posaient aux Nestoriens chalcdoniens et monophy-
sites, celle de diviser le Christ et d'introduire ainsi une
quatrime personne dans la Trinit : u Que quiconque
introduit une quaternit dans la Trinit sainte et im-
muable soit anathme! - Que quiconque ne confesse
pas qu' la fin le Fils unique de Dieu, qui est le Christ
Notre-Seigneur, est apparu dans la chair soit ana-
thme ! - Que quiconque ne confesse pas la Passion et
la mort de l'humanit du Christ et l'impassibilit de
sa divinit soit anathme! - Que celui qui conclut la
prire au nom du Pre, du Fils et de l'Esprit-Saint, et
1. Syn. orient., p. SI.
Syn. orient., p. 1153.
3. Il faut sans doute suppler dans le texte (p. ta2, 1. 23).
au lieu de
, ... ~ - ~
268 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
compte quelque autre avec eux, ou qui ne croit pas que
l'appellation de Fils signifie la fois la divinit et
l'humanit du Christ, ou qui conclut la prire au nom
du Christ sans confesser la Trinit, que celui-l soit
anathme ! >>
Un prcieux tmoin de la mme doctrine est le dis-
cours de Thomas d'desse
1
, l'lve de Maraba, sur la
Nativit. Les ides et jusqu'aux expressions
2
semblent
empruntes au symbole du patriarche d'Orient; elles
sont toutefois plus prcises. La doctrine antiochienne du
second Adam tait toujours en honneur parmi les tho-
logiens de cette cole
3
Cependant, ce n'est plus par
ses efforts personnels, mais en vertu de la grce di-
vine; que Jsus, le second Adam, a t prserv de tout
p c h ~ . C'est l une importante mitigation apporte
la doctrine de Thodore de Mopsueste. Pas plus dans
Maraba que dans Thomas, il n'est question de la dua-
lit des hypostases, mais seulement de la dualit des
natures. Nous n'accordons pas d'ailleurs une extrme
importance cette constatation, car ce que nous pos-
sdons des traits de ces deux thologiens est trop peu
considrable pour nous permettre de porter un juge-
ment dfinitif sur tous les dtails de leur doctrine.
D'autre part, le mot d'hypostase n'avait pas encore pris
l'importance capitale qu'il devait bientt acqurir.
Enfin, il est prsumer que Maraba et Thomas fai-
saient, comme tous les controversistes, l'exception des
thologiens de la cour impriale, concider le concept
d'hypostase avec celui de nature.
En rsum, la doctrine nestorienne est, chez nos deux
docteurs, singulirement attnue. Ils insistent sur l'u-
i. Thomae Ede88eni tract. de Nativitate D. N. C., d. CARR.
2. Trad., p. 40.
3. Trad., p. 311.
4. Texte, p. " 1. 7.
LA QllERELLE DES TROIS CHAPITRES. 269
nion intime des deux natures en une seule personne,
en vitant d'introduire la quaternit dans la Trinit.
La thologie persane suivra dsormais ce courant.
Les plus rigoureux parmi les docteurs de l'ge sui-
vant ne pourront, ni peut-tre ne voudront revenir en
arrire.
S 3. - La Querelle des Trois Chapitres et les contro-
verses orignistes. - Leur rpercussion en Perse.
A ce moment, arrivait son terme un mouvement
thologique qui se dessinait depuis une vingtaine d'an-
nes dans les milieux orthodoxes de l'empire byzantin.
Il s'agissait d'oprer la runion des monophysites mo-
drs - les plus nombreux - tout en sauvegardant
l'autorit du concile de Chalcdoine et du Pape saint
Lon, dont Justin, aprs avoir fait cesser le schisme
de Constantinople, s'tait constitu le dfenseur. On
recourut, pour cela, la mtaphysique aristotlicienne.
Lonce de Byzance, dont le rle considrable a t r-
cemment mis en pleine lumire
1
, fut le plus ardent
promoteur de la nouvelle thorie. Il prcisa la no-
tion d'hypostase, et s'en servit comme d'un moyen
terme qui permettrait de tenir entre les deux extrmes
une position philosophiquement dfendable. Avant lui,
on associait troitement les termes et en
sorte qu'il fallait tre monophysite ou dyophysite,
gyptien ou antiochien, et que la formule de Chalc-
doine apparaissait comme un essai de conciliation b-
tard et mal venu.
Lonce convint avec les thologiens qui l'avaient pr-
cd que l'hypostase signifiait la nature individue ''
i. Loors, Leon ti us von Byzanz, 1887; ERMONI, De Leontio Byzantino,
t895.
;q $1
270 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
par les notes distinctives : '' l'habit, la couleur, la
grandeur, le temps, le lieu, les parents, la condition,
la conduite, dont l'ensemble ne peut convenir relle-
ment aucun autre individu
4
>>. Il admit aussi que la
nature et l'hypostase sont entre elles comme le com-
mun >> et le propre Mais il refusa d'en conclure que
l'hypostase ftt ncessairement une chose parfaite :
fmoauat oz cbtw 1tp07)"(0U[J.VW TO TUOV 7)oi,
cil).&. To x6' otuTo 67tclpzov, euTpw To Tuov
3
r'ltoaTotat
est premirement ce qui subsiste en soi, secondaire-
ment ce qui est parfait. Donc, ce qui est parfait n'est
pas ncessairement hypostase. La nature peut tre
parfaite sans tre hypostatiquement, sans subsister
par soi-mme. Il y a, et c'est la trouvaille de Lonce,
un milieu entre et civu'ltoa't7jvott: c'est tre vumi-
aTotTov, c'est--dire subsister en un autre sujet.
On rservera donc le nom d'hypostase aux tres
substantiels qui subsistent en eux-mmes et ne peu-
vent entrer en composition avec un autre tre. La
nature pourra subsister, non pas seulement dans son
hypostase connaturelle - ses exigences ne vont pas
jusque-l, - mais dans une hypostase autre que son
hypostase connaturelle, o elle trouvera sa subsistance.
Dans 1 'conomie de l'Incarnation. il y aura deux
TEtot : la nature du Verbe et la nature humaine. La
premire sera soutenue par son hypostase connatu-
relle, qui est l'hypostase de la seconde Personne de la
Trinit.
Mais quel sort sera rserv la nature humaine?
Bien qu'elle soit parfaite, elle ne postule pas de sub-
sister en soi ni d'tre soutenue par son hypostase con-
t. P. G., LXXXVI, col. t9W.
!!. XXX Cap., cap. !!4.
3. Col. 19!5.
LA QUERELLE DES TROIS CHAPITRES. 271
naturelle. Sera-t-elle donc sans hypostase? Quid
&vu1toa-r-rov? Non, pour viter l'eutychianisme, l'apol-
linarisme et le doctisme. Mais elle subsistera en
l'hypostase du Verbe, elle sera quid lvu1toa-r-rov.
Si donc on exprime le mode de l'conomie par le
mot d'lvwar, on ne lui donnera pas le qualificatif de
!puant-,) puisque les deux natures subsistent aprs comme
avant l'union, ni celui de 1tpoa!ll1tlx-,), comme si chaque
nature avait son hypostase propre, mais l'union sera
dite &1ton-r1x-,), c'est--dire ni x-r& cpuaiV ni x-r& 1tpoaw1tov,
mais bien xO' &1t<)a-ralv.
Jusqu'ici Lonce se tient dans le juste milieu. Voici
o commencent ses concessions aux monophysites :
Les attributs de chaque nature (1tolo'r7)n) n'existent pas
en eux-mmes; ce ne sont pas des substances, mais des
accidents, par consquent ils doivent tre enhypostati-
ques, tre rapports l'hypostase et lui appartenir,
que cette hypostase soit simple ou compose ( d 1 t ~ ,
auvOe-ro).
Donc la communication des idiomes se fait de telle
sorte que tous les prdicats, qu'ils conviennent une
nature ou une autre, peuvent qualifier l'hypostase.
A la vrit, ces prdicats ne se rapportent pas au sujet
hypostatique de la mme faon, ni sous le mme point
de vue, et ils ne peuvent pas tre donns indiffrem-
ment comme qualificatifs l'une ou l'autre des deux
natures. On ne peut pas dire : La divinit est passible,
l'humanit est ternelle.
Ces restrictions poses, les idiomes des deux na-
tures appartiennent l'hypostase commune : le V er be
a souffert pour nous, a t crucifi, et l'addition au
trisagion est lgitime si elle ne s'adresse qu' la per-
sonne (hypostase) du V er be en qui subsiste la nature
humaine.
272 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
On pensa ainsi rduire Svre d'Antioche et ses
partisans; mais en vain Justinien
1
fit-il tenir un
colloque en 533 sous la direction du savant et habile
Hypatius d'phse. Les Svriens refusrent d'adhrer
au concile de Chalcdoine, parce qu'il avait reu
Thodoret et lbas. En vain, dans un dit de la mme
anne, et malgr l'avis des moines Acmtes, Justi-
nien insista-t-il sur ce point que <<le Seigneur qui avait
souffert sur la Croix faisait partie de la Trinit
2
et fit-il approuver ses paroles par le pape Jean Il
3
,
les monophysites furent irrductibles. A la suite de
la visite du pape Agapet Constantinople, et aprs sa
mort (536), l'empereur dut svir et condamner l'exil
les principaux opposants : Anthime, Svre, Pierre
d'Apame, Zooras.
Sur la querelle christologique vint se greffer la
controverse origniste Aprs des vicissitudes diverses
qu'il ne nous appartient pas de rapporter ici, Justinien
promulgua en 542 un dit contre les Orignistes o il
condamna dix propositions, parmi lesquelles la pr-
existence des mes, et, en particulier, de l'me humaine
du Sauveur
5
Il dfendit d'enseigner<< qu' la rsur-
rection les corps des hommes ressusciteraient sph-
riques (lv -r!j rlvata-rcfau a'Pattpouolj -rbiv .Xv6pto'm11lv lyE(-
pea6att awfA-atu) (Proposition 5"), ou que les astres taient
anims et avaient une action directe sur notre monde
(opatvov xatl xatt xl &tx& ilv{
-rtvat ou qu'il y aurait une ou plusieurs
ri1tOXOtTOt<J'tcl<JEI.
1. Sur la politique religieuse de Justinien, cf. DIEHL, Justinien,
ch. vn, p. 331 et suiv.
2. HEFELE, t. Ill, p. 31i1i.
3. MANSI, t. VIII, 700.
4. DIEIUIIP, Die Origeni&tischen Streitigkeiten im 6. Jahrhundert,
t900.
Il. llfA!ISI, t. IX, p. a:l\. Cf. p. 367375. HEFELE, t. Ill, p. Ct SUV.
LA QUERELLE DES TROIS CHAPITRES. 273
Plus Justinien s'appliquait pacifier les esprits, plus
il parvenait les diviser. Les Orignistes qui comp-
taient plusieurs reprsentants dans le parti no-chal-
cdonien (Lonce de Byzance tait sans doute un des
leurs) cherchrent prendre leur revanche sur les nesto-
riens, soit parce que Thodore de Mopsueste avait crit
contre Origne, soit simplement pour faire diversion.
Thodore Askidas, le favori de l'impratrice Thodora,
. reprit son compte une rclamation depuis longtemps
formule par les monophysites. Il persuada l'empereur
que les Svriens ne refusaient d'admettre le concile de
Chalcdoine que parce que Thodoret et lbas avaient
t reus; et, en effet, c'tait un des prtextes qu'ils
mettaient en avant pour justifier leur opinitre oppo-
sition. Donc, si l'on condamnait Thodoret et Ibas,
qui taient des Nestoriens honteux, et surtout Tho-
dore de Mopsueste qui avait t le matre de l'hr-
siarque, on arriverait l'union tant dsire.
On sait de quelles rsistances dut triompher Justi-
nien
4
Il atteignit cependant son but. Il fit porter par
le cinquime concile cumnique des anathmes qui
devaient anantir les derniers restes du nestorianisme
et donner, croyait-il, toute satisfaction aux monophy-
sites les plus exigeants. Ce concile se borna pour ainsi
dire enregistrer un dit imprial rendu un peulllupa-
ravant2. L'empereur y dclarait que, dans l'Incarnation,
on doit confesser l'union hypostatique. Il acceptait
mme la formule cyrillienne 1'-( cpuat -ro' Oso' Myou asap-
XblfJ-tv'l}, parce que, toutes les fois que saint Cyrille s'est
servi de cette formule, il a entendu cpuat dans le sens
d'fmatat. De plus, il expliquait qu'on ne peut pas
t. DucUESIIE, Vigile et Plage , Rev. des Questions historiques,
i884, Il.
2. MAlis!, t. IX, p. 559 et sui v.
.......
27<t LA THOLOGIE NESTORIENNE.
croire qu'avantl'union il ait exist deux natures, car la
nature humaine du Christ n'a jamais eu de personna- .
lit ni de subsistance distincte.
Le deuxime anathme ordonne de confesser la
double naissance du Christ. Le quatrime condamne
tous les subterfuges employs par les Nestoriens pour
viter de parler d'union hypostatique. On ne doit pas
dire que l'union s'est faite xT& x.optv xu'
xT' XatT' laOTtfLtatv, x-r' Man(v, <iVipOpotv,
aX,ttS!V 8UVCX!A.IV
1
,, xatll' b!A.WYU!A.(v, ni XatT' a08ox(cxv, SUi
vant l'opinion de << Thodore l'hrtique >>.
Le cinquime anathme est dirig contre ceux qui
prtendent que la sainte Vierge n'est pas proprement
appele Mre de Dieu, mais par catachrse : ef xrxT&
tlvatipop&v OaOToxov tyn &ylrxv riat-
'lttJpOivov l\locp(v, )(ptaToToxov ..... til.>.&
..trxl Xtx't' OaoToxov liv&Or!J.rx la-rw.
Le sixime vise ceux qui, n'admettant pas la com-
munication des idiomes, ne veulent pas << confesser
que :Notre-Seigneur Jsus-Christ crucifi dans sa chair
est le vrai Dieu et le Seigneur de la gloire>), Dans le
septime anathme, il fltrit ceux qui prtendent,
la suite de Thodore et de Nestorius, que les natures
sont spares et t8toma-rotTou, au lieu de croire en une
seule hypostase compose
Les autres anathmes
1
rprouvent plusieurs proposi-
tions de Thodore, les crits de Thodoret contre saint
Cyrille et le et la conclusion de la lettre d'lbas
Maris. L'dit stigmatise l'hypocrisie des Nestoriens qui
n'osent se dclarer ouvertement. Quand Ibas a parl
de deux natures et d'une seule force (8ovrxfLt), il se
prononait en ralit, dit Justinien, pour la thorie des
t. liiANsl, t. IX, p. 563 et sui v.
LA QUERELLE DES TROIS CHAPITRES. 275
deux hypostases et du 'ltpoaro"Jtov honorifique, comme
1 'avait fait Nestorius
1
Personne n'ignore quel tumulte suscitrent en Afri-
que et en Italie l'dit de Justinien et sa confirmation
par le concile cumnique
2
.l\lais si l'motion fut telle
dans des contres o les auteurs des Trois Chapitres
taient personnellement peu connus, on s'imaginera
facilement quelle elle dut tre dans la Syrie orientale.
C'tait frapper au cur l'glise persane que de dnon-
cer comme hrtiques les docteurs antiochiens, mais
surtoutl'illustre Thodore le Commentateur.
Le synode de Joseph (554) ne contient pas d'allu-
sion aux controverses du moment. Il ne convient
pas de s'en tonner. Trop peu de temps s'tait coul
entre la clture du cinquime concile cumnique et
la convocation du synode patriarcal. Les vques
taient, du reste, absorbs par leurs dissensions int-
rieures. Aussi la profession de foi
3
est-elle brve, et
trs semblable, pour les termes, celle de Maraba :
Nous gardons la confession orthodoxe des deux na-
tures dans le Christ, c'est--dire de sa divinit et de
son humanit; nous gardons les proprits des na-
tures et nous rpudions en elles toute espce de con-
fusion, de trouble, de mutation ou de changement.
Nous conservons aussi le nombre des trois personnes
de la Trinit, et, dans une seule unit vraie et ineffa-
ble, nous confessons un seul Fils vritable d'un seul
Dieu, Pre de vrit. Quiconque dit ou pense qu'il y
a deux Christ ou deux Fils, et, pour quelque raison
ou en quelque manire, introduit une quaternit, nous
l'avons anathmatis et l'anathmatisons.
t. HEFELI
1
t.III, P 4116.
i. DIEBL, Jmtinien, p. 36i el sui v.
3. Syn. orient., p. 3511.
- . ...,. .if??'
26 LA THEOLOGIE NESTORIENNE.
11 en fut de mme - et la chose est plus surprenante
-au synode tenu par zchiel en 576
1
Le patriar
che renouvelle la confession de ses prdcesseurs et
fltrit, dans le mme style et presque avec les mmes
expressions, les sectateurs d'Arius, d'Eunomius,
' Apollinaire et des autres hrtiques leurs partisans,
qui blasphment contre le Pre, font passible la divi-
nit du Fils, vilipendent l'Esprit-Saint et jettent la
confusion dans l'galit de la Trinit sainte ll.
Au contraire, dans le synode de Isoyahb 1 (585) et dans
ceux de Sabriso et de Grgoire, l'attitude des vques
a chang. Ils ne se dfendent plus seulement contre les
ennemis du dehors, mais encore contre ceux du dedans.
Aussi les professions de foi, surtout celles d'lsoyahb,
sont-elles plus prcises et plus minutieuses. Le patriar-
che argumente contre tous les partisans byzantins ou
persans du cinquime concile cumnique : Ces h-
rtiques qui, dans leur absurdit, osent attribuer la
nature et I:hypostase de la divinit et de l'essence
du V er be les proprits et les passions de la nature
humaine du Christ qui, parfois, cause de l'union par
faite entre l'humanit du Christ et sa divinit, sont
attribues Dieu conomiquement mais non naturelle-
ment
2
>> Les Jacobites semblent plus directement viss
et le sont en effet, mais ceux qui attribuent les << pro-
prits et les passions de la nature humaine du Christ ll,
non pas, la vrit, la nature divine, mais l'hypos-
tase du Verbe, ce sont les orthodoxes, favoris de Jus-
tinien.
D'ailleurs ISoyahb, surtout dans son deuxime sym-
bole
3
, se rfre videmment aux expressions du cin-
i. Syn. orient., p. 37!1 et sui v.
2. Syn. orient., p. 398.
a. &.Jn. orient., p . .:;1 et sui v. Il est possible qu cette seconde con-
-, -
LA QUERELLE DES TROIS CHAPITRES. 277
quime concile, et lui concde tout ce qu'il peut lui
accorder : la double naissance du Christ, et mme,
bien qu'avec des circonlocutions :le<< Unus de Trinitate
passus est carne . Voici deux textes qui nous semblent
trs explicites, si on les compare aux anathmes cor-
respondants de Justinien et de son concile: Notre-Sei-
gneur Dieu Jsus-Christ, qui est engendr du Pre,avant
tous les mondes, dans sa divinit, est n dans la chair
de Marie toujours Vierge, dans les derniers temps, le
mme, mais non de mme
4
.(Anathmes 2et 3 de l'dit.)
<< Jsus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu au-dessus de tout,
engendr ternellement dans sa divinit par le Pre,
sans mre, et engendr, le mme, mais non de mme,
dans son humanit, d'une mre, sans pre, dans les
derniers temps. Il a souffert dans la chair, il a t
crucifi, il est mort, il a t enseveli ... Le Christ, Fils
de Dieu, le mme, a souffert dans la chair, mais, dans
la nature de sa divinit, le Christ Fils de Dieu tait
au-dessus des passions: impassible et passible. Jsus-
Christ, crateur des mondes et subissant des souf-
frances, ... Dieu le V er be a support l'humiliation des
souffrances dans le temple de son corps, conomique-
ment, par l'union suprme et indissoluble. Le catholi-
cos refuse seulement de dire que le V er be est mort, et il
invoque , pour lgitimer son refus , le tmoignage de
saint phrem, et mme celui de Svre. Ainsi, lso'yahb
se rapprochait le plus possible de l'orthodoxie by-
zantine, mais il ne confessait ni le Oro-roxo, ni l'union
hypostatique; au contraire, il parle dans le mme
symbole d' <<union prosopique
2
Cession de foi soit celle qu'il prsenta, suivant les annalistes, l'empe-
reur byzantin. Cela expliquerait pourquoi les professions de foi de sa-
brisa et de Grgoire sont moins explicites. v. ch. vn, p. !!01, n. 5.
1. Syn. orient., p ..:;,,
!!, Syn. orient., p. 455.
16
28 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
Non seulementles nouveaux adversaires s'attaquaient
la vieille christologie nestorienne, mais ils ne crai-
gnaient pas de porter une main audacieuse sur les
vnrables crits de Thodore de Mopsueste, de critiquer
son exgse et de lui prfrer celle de saint Jean
Chrysostome. Chose plus grave, ils n'acceptaient pas
les conclusions de Thodore sur la formation du canon
de l'Ancien Testament; ils rhabilitaient par exemple
le livre de Job, assez malmen par l'Interprte, et pr-
tendaient que le vritable auteur de cet ouvrage tait
Mose lui-mme.
Le catholicos s'mut. Depuis le concile de Beit Lapat
(484), les crits du Commentateur taient reus de
tous, et, pour ainsi dire, canoniss en Perse. Il fallait
raffermir la colonne mattresse de la thologie nesto-
rienne. lso'yahb s'y employa avec tout son zle, et,
aprs lui, ses successeurs, Sabriso' et Grgoire.
Mais qui taient ces bgues et ces imposteurs
s'attaquant Thodore comme des scarabes et des
grillons sortant des recoins ou des trous de l'erreur ,
comme s'exprime le catholicos avec un ddain trop
visiblement affect pour tre sincre
1
? C'taient
les partisans de I;Ienana d'Adiabne,, ce docteur de
Nisibc, qui suscita, au sein de l'Eglise persane,
une si redoutable tempte, cause, dit son an-
tagoniste Baba le Grand, de nos pchs, cause
des pasteurs faibles qui s'aimaient eux-mmes plus que
la vrit et la charit du Christ 2 .Nous avons vu plus
haut quels dveloppements prit ce schisme, avec la
complicit des professeurs de Nisibe et de l'vque
Simon. Aussi, tandis qu'ISo'yahb traite en 585 les I;Ie-
naniens de grillons et de scarabes, Baba, quelques
t. Syn. orient., p. 400.
!li. De Unione, ms., r. t88 B.
LA QUERELLE DES TROIS CHAPITRES. 2i9
annes plus tard, les appelle maudits, brutes, fils
du mchant et qualifie leur doctrine de lie et de
cloaque de toutes les hrsies l .
Au rapport de ce thologien
2
, l'htrodoxie de I;Ienana
tait triple : il tait chalden, origniste et hrtique
(au point de vue de 1 'Incarnation). L'accusation de chal-
dasme ou de magie entrane celle de fatalisme .
.IJenana rprouvait en effet les opinions plagiennes
de Thodore de Mopsueste sur le libre arbitre.
C'est contre lui que fut dirig l'anathme de Sabriso:
<< Nous repoussons et loignons de toute participation
avec nous quiconque admet et dit que le pch est
plac dans la nature et que l'homme pche involontai-
rement, et quiconque dit que la nature d'Adam a t
cre immortelle ds l'origine3 .,,
Est-ce calomnieusement que Baba attribue l;le-
nana l'opinion suivante : << Le sort et la fatalit sont
cause de tout et tout est conduit par les toiles,,'( Nous
ne saurions le dire. Cette imputation n'est cependant
pas invraisemblable. - J}enana croyait avec Origne
que les toiles taient des tres vivants et anims
et il leur attribuait une action intelligente.
Il professait encore, avec le mme docteur, d'autres
doctrines non moins suspectes. Il niait << la rsurrection
des corps et n'admettait le salut que pour les mes. Il
t. Cette doctrine tait jusqu' prsent fort mal connue. Des docu-
ments rcemment publis nous permettent de la prciser davantage.
Ce sont la Passion du prtre Georges rdige par Daba, et l'exposition
de la foi faite au roi Chosrau en 6t2. Syn. orient., p. aS0-598 et 625-GM.
Grce l'obligeance de M. Chabot, nous sommes en mesure d'adjoindre
ces textes un trait indit de Da ba sur l'Incarnation (De unione), qui
nous faitconnaltre, dans les derniers dtails, les objections que rencon-
trait la thorie nestorienne rigide, et contient un expos complet de
cette dogmatique.
'l. Syn. orient., p. 6il6 et suiv.
3. Syn. orient., p.
ii. Syn. orient., p. 6!!6.
28 1
t n-
:\ lais
dnwl-
ha
1
,
ll llllC
1";\nw
la
1:\Ud,
!lOU>'
c l
celle
11101'1 ,
Il C(Ul'
1 lll-
\ init
perdu
llt' IH'
Il ;li i 1 t"
,,.
111\-
l!l i Oil
l[i o) ll ,
deux
10 1'1 ,
Jl'le,
ni lu
que
280 LA THOLOGIE NESTORIENNE.
n'y aura pas de jugement ni de chtiment. Le forni-
cateur ou l'adultre ne pche pas, parce qu'il est ainsi
dtermin ds sa naissance. Enfin tous les hommes
participent la nature de Dieu
1
. On reconnat l les
.doctrines condamnes par Justinien en 542
2
Comme les Orignistes de l'empire byzantin, auprs
desquels il tudia probablement en Syrie ou en Pales-
tine, l;lenana enseignait la doctrine de l'union hypos-
tatique. Il admettait galement le o ~ o ~ o x o et la commu-
nication des idiomes. Aussi Baba accole-t-il son nom
abhorr ceux de Cyrille " l'gyptien et de Jus-
tinien, l'empereur impie''
4.- La dogmatique officielle au dbut du VII sicle.
La ncessit o se trouvrent les thologiens officiels
de lutter contre les Jacobites et les partisans de IJ.e-
nana les conduisit adoucir, autant que possible, la
doctrine dyophysite et prciser certains points de-
meurs un peu obscurs : les relations rciproques des
deux natures en Jsus-Christ, la distinction de la per-
sonne, de la nature et de l'hypostase, enfin la qualifi-
cation du mode d'union des natures.
C'est dfinir ces questions si controverses que Ba-
ba le Grand a consacr la majeure partie de son
Trait De Unione. Nous ne saurions mieux faire pour
nous reprsenter exactement les conceptions dogma-
tiques du nestorianisme orthodoxe que d'emprunter
t. Ibid.
11. D'aprs le trait De Unione, !Jenana admettait que le corps du Christ
ressuscit et ceux des fidles aprs le Jugement dernier, taient CJfl
poEIBjj (ms., p. 126). Ainsi il n'y avait pas de vritable rsurrection des
corps la fin du monde, comme on le voit d'aprs l'anathme qui con-
clut le cb. x1x de l'ouvrage de Baba auquel nous nous rrrons.
LA DOGMATIQUE OFFICIELLE AU VII" SICLE. 281
les propres expressions d'un docteur aussi autoris.
Les avons-nous dit, rejetaient l'expres-
-sion : communication des idiomes, comme devant n-
eessairement entratner la confusion des natures. Mais
pour maintenir la ralit de l'union, il leur fallut admet-
tre l'change des noms .
Dans l'union naturelle du corps et de l'me, crit Baba
1
,
1es noms naturels s'changent rciproquement2, comme
si l'me tait enchane au corps. On ne nomme pas l'me
Iisolment] comme si elle n'tait pas emprisonne dans la
chair et dans le sang-.'Nous disons: ... J'ai froid, j'ai chaud,
je sais, je comprends, un tel est mort, fils d'un tel, et nous
savons bien que tels attributs appartiennent au corps, et
tels autres l'me. De mme, quand nous parlons de cette
union [de l'Incarnation], nous disons : Le Christ est mort,
le Fils est mort, par le Fils tout a t cr et fait, bien que
nous comprenions que tels attributs appartiennent l'hu-
manit qui a reu la mort, ... et tels autres la divinit
par qui tout a t cr et fait, et les natures n'ont pas perdu
leurs idiomes cause de l'union. Car le Dieu Verbe ne
possde pas de limitation, n'a pas perdu sa spiritualit
pour devenir homme par nature. L'Homme ne possde pas
dans sa nature l'ternit, l'infinit, il n'est pas l'esprit invi-
sible, ni le Fils connaturel au Pre, mais, en vertu de l'union
avec le Dieu Verbe, il est Fils dans une seule appellation,
domination, adoration et honneur, quoique non pns dans une
seule nature, en sorte qu'il n'y a pas deux Fils ou deux
Fils du Trs-Haut. n
Plus loin, prcisant sa pense, il ajoute
3
:
Quand nous disons qu'un homme a t crucifi et est mort,
nous ne disons pas que son me a t crucifie et est morte,
ear elle est immortelle; mais, cause du 7tp6awxov de l'unit
naturelle, et d'une appellation commune, nous disons que
t. De Unione, ms., f. t09 A et B.
i, Litt. : dantur et assumuntur.
3. De Unione, f. 12il B.
16.
282
LA THOLOGIE NESTORIENNE.
l'homme a t crucifi. Ici aussi, de mme, nous-disons que
le Christ a t crucifi, que le Christ est mort et est res-
suscit, mais nous ne disons pas que Dieu a t crucifi
et est mort. Nous disons que le Fils de Dieu a t livr
pour nous et cela cause du 1rp6GW1to'l de l'union, mais non
que la divinit a souffert ou est morte, elle qui a ressus-
cit et parachev son temple unique. Mais nous ne disons
pas simplement : L'homme est mort, pour ne pas tre
comme les Pauliniens l, qui nient sa Divinit. Nous ne disons
pas que Dieu a t crucifi pour ne pas tre comme les
Manichens qui nient l'humanit du chef de notre race, ou
comme ceux qui introduisent la cration et le change-
ment [dans la Trinit]; mais nous disons que le Christ est
crucifi, sachant bien qu'il a t crucifi et est mort dans
son humanit, non dans sa divinit, mais sans tre loign
d'elle; unie avec elle, il a souffert tout ce qui convenait
sa nature.
On fera donc l'change des noms qui appartiennent
chacune des natures, en vertu de l'union prosopique.
Mais ces noms eux-mmes seront dtermins d'aprs
les saintes critures, et diviss en deux classes : pre-
mirement les noms qui appartenaient la divinit
avant son union avec l'humanit, deuximement soit
ceux qui appartiennent au Christ
2
:
cc A partir de l'conomie corporelle et la suite, tant
ceux de la divinit suivant l'union que ceux de l'humanit.
par suite de l'unique t p o a w 1 t o ~ de l'conomie adorable, en l'ad-
hsion des deux natures qui gardent leurs idiomes dans le
7tpoaw71"ov unique d'un seul Fils.
La premire classe comprend les noms de Fils, Verbe,
Dieu, Seigneur, Unique, Lumire, Rayon, Image, Vie,
i. C'est--dire : les partisans de Paul de Samosate.
!1. De Unione, f. 139 B. Je restitue ce passage altr.
~ -
LA. DOGMA.TIQUE OFFICIELLE AU vue SICLE. 283
Ressemblance de Dieu, Roi, Saint. La deuxime classe
renferme les noms de :
Jsus-Christ, embryon, premier-n de Marie, Emmanuel,
enfant, homme, fils de l'Homme, fils du Trs-Haut, premiel'
n de toutes les cratures, premier n d'entre les morts,
prtre, fils de David, roi, seigneur, prophte, Adam,
image du Dieu invisible, juste, saint, rocher, pain, vigne,
voie, porte, agneau, pasteur, sceptre, et le reste.
Aprs avoir longuement expliqu chacun de ces
noms, Baba donne un exemple de la communica-
tion des noms , en appliquant l'hypostase divine le
texte : Jesus Christus heri, hodie, ipse et in saecula,
et l'hypostase humaine les termes de Fils unique,
et de Seigneur de Gloire
1
Son refus d'admettre l'union hypostatique se fonde
sur des considrations philosophiques. Il ne convient
pas de rapprocher le concept d'hypostase de celui de
personne, comme font les thologiens de Justinien,
mais, au contraire, du concept de nature, ce qui est, il
faut en convenir, plus conforme l'ancienne tradition.
Baba critique vivement la notion d'hypostase com-
pose (auvOe-ro) que Lonce avait introduite dans la dog-
matique byzantine.
Comme la thorie de l'hypostase et de la personne
est le centre de la dogmatique nestorienne et qu'elle
est jusqu' prsent trs imparfaitement connue, nous
croyons utile de donner de copieux extraits du cha-
pitre xvii du De Unione, o la question est traite
ave_c l'ampleur dsirable. Voici donc les dfinitions
que donne Baba de l'hypostase et de la personne :
On appelle hypostase la substance (oQa() singulire, sub-
t. De Unione, ch. xx.
281. LA THOLOGIE NESTORIENNE.
sistant dans son tre unique, numriquement une, et
spare de beaucoup [d'autres], non en tant qu'indivi-
duante, mais en tant qu'elle reoit, chez les tres crs,
raisonnables et libres, des accidents varis, de vertu ou
de crime, de science ou d'ignorance, et, chez les tres
privs de raison, galement des accidents varis, par suite
de tempraments contradictoires, ou de tout autre faon ..
L'hypostase est fixe dans sa naturation et sous son espce
(E'loo), car la nature de l'hypostase lui est commune avec
toutes les hypostases semblables. Mais elle se distingue
des hypostases ses semblables par la proprit indivi-
duelle, qui est possde par la personne : Gabriel n'est
pas Michel, Paul n'est pas Pierre. Mais dans chacune de
ces hypostases, la nature universelle se manifeste, et
le raisonnement fait connatre quelle est la nature unique
qui comprend universellement les hypostases
1
, que ce .
soit celle des hommes, ou quelqu'une des autres. Mais
l'hypostase ne comprend pas l'universalit
1
Quant la personne, c'est cette proprit de l'hypostase
qui la distingue des autres. L'hypostase de Paul n'est pas,
en effet, celle de Pierre. Sous le rapport de la nature et de
l'hypostase, ils sont gaux, car tous deux ont un corps et
une me, sont vivants, raisonnables et corporels; mais
par la personne, ils se distinguent l'un de l'autre, en
vertu de la singularit particulire que chacun possde,
soit pour la sagesse, soit pour la force, soit pour la taille,
soit pour l'aspect ou le temprament, soit pour la pater
nit ou la filiation, soit par le sexe masculin ou le sexe
fminin, ou en n'importe quelle manire qui distingue et
rvle la proprit particulire, et [manifeste] que celui-ci
n'est pas celui-l et celui-l n'est pas celui-ci, bien que,
sous le rapport de la nature, ils soient gaux. Et, parce
que la proprit singulire que possde l'hypostase n"est
i. C'est-dire qui est la notion universelle commune toutes les
hypostases.
i. C'est--dire :n'est pas une notion universelle.
....
LA DOGMATIQUE OFFICIELLE AU VII SICLE. 28a
pas l'hypostase elle-mime, on [appellel personne (np6<rw
r.ov) ce qui distingue 4. >>
Du domaine philosophique, Baba s'lve au domaine
thologique. Il explique que l'on ne peut distinguer les
trois hypostases de la Trinit que par leurs notions et
proprits particulires : gnration, filiation, etc ...
D' ailleurs ces hypostases divines sont incommunicables
et ne peuvent se compntrer. De la mme manire,
on ne peut pas dire que l'hypostase du Verbe puisse se
communiquer une autre hypostase, ou l'assumer.
Plusieurs exemples emprunts l'observation de la na
ture appuient et confirment ces thories.
Ces principes poss, restait qualifier le mode de
l'union des deux natures. Cette union ne peut pas tre
dite hypostatique, puisque l'hypostase est incommuni
cable. C'est donc une union prosopique ou personnelle;
mais par quels termes la caractriser? Il faut viter
tous les mots qui impliquent l'ide de changement, de
mlange et de confusion; on choisira prfrablement
les vocables de la thologie traditionnelle d'Antioche:
assomption, habitation, temple, vtement, adhsion
( dv<X>.'l'l<Jit, lvolx'llcn, vocO, l[lo!Xnov, auv!Xip&IOI ).
Mais ces expres.sions prises isolment sont, Baba en
inexactesetinsuffisantes. Au vue sicle, la con
troverse contre les Monophysites a contraint les Nesto-
riens resserrer les liens qui unissent les deux natures.
On ne dit pas, crit Baba2, d'un homme qui revt sa
ct. C'est--dire: l'ensemble de ces marques distinctives, de ces acci-
dents dont l'hypostase est le sub1tratum. Un peu plus loin, Babai
donne l' exemple suivant : Quand deux hommes viennent au loin, nous
savons que ce sont deux hypostases, mais quel est celui-ci ou celui-l,
nous l'ignorons encore.
!!. De Unione, r. tt8 et sui v.
286
LA THOLOGIE NESTORIENNE.
tunique qu'il y habite, ni des poissons qui sont dans l'eau
que c'est leur temple. De mme, adhsion n'est pas union:
les poissons adhrent l'eau et n'y sont pas unis. Au con-
traire, il y a des unions qui ne sont pas des adhsions, par
exemple des unions morales, telles que celles des chrtiens
entre eux. Ainsi on doit parler la fois d'habitation.
d'adhsion unitive et prosopique. Cette union ineffable se
fait suivant tous ces modes et au-dessus d'eux.
Ainsi l'union morale l'union x01-r& x.llptv et
x01-r' e8oxl11v sont nettement exclues.
Baba
1
ne veut pas davantage que l'on appelle l'hu-
manit de Jsus fils de grce , parce que, sans cela,
il y aurait deux Fils, l'un par nature, l'autre par grce.
Il admet, la vrit, l'union volontaire , mais
dans ce sens que le V er ben' tait nullement contraint de
prendre (assumere) l'humanit de Jsus, et non dans le
sens o l'entendait Thodore de Mopsueste. Et il en
donne une raison premptoire : l'union du V er be et de
l'humanit a eu lieu au commencement de la concep-
tion, au moment mme de l'Annonciation. Or, ce
moment, l'humanit du Christ tait incapable de pen-
ser par elle-mme et de discerner le bien et le mal.
Nous arrterons ici cet expos. Nous ne l'avons
fait aussi dtaill qu'en raison de la nouveaut et de
l'importance des documents que nous avons pu utiliser.
Il n'entre pas dans notre plan de relater les vicissitu-
des diverses de la thologie nestorienne aprs la chute
de l'empire Sassanide
2
Du reste, aucun principe nou-
veau ne fut pos, aucune donne vraiment originale
introduite dans les dbats. Ds le dbut du vn si-
cle, la dogmatique persane est dfinitivement fix,
t. De Unione, f. n, A.
2. Voir notre thse De Timotheo 1, Nesto1ianorum palliarcha, ch. m.
""'""''
LA DOGMATIQUE OFFICIELLE AU VII SICLE. 287
aussi bien en ce qui concerne la doctrine officielle
qu'en ce qui regarde les coles dissidentes
1
t. On serait tent, premire vue, de faire une exception en faveur
de Sahdona, qui, en 630, se convertit au catholicisme byzantin, lors
d'un sjour en Syrie. Mais la conversion de cet vque est un fait isol.
C'est tort, sans doute, que M. (Martyrius-Sahd.ona's Leben
und Werke, p. t3, n. t) y voit l'aboutissant d'un courant orthodoxe
qui aurait exist d'une faon continue, bien que latente, dans l'glise
de Perse. sahdona ne parait pas avoir t l,lenanien, car sa doctrine
n recle aucun ferment d'orignisme. Il n'eut pas de disciples en
Perse. Le futur patriarche Iso'yahb 111, compagnon de voyage du con-
verti, prit soin de faire expulser celui-ci du sige piscopal de Mal,loz
de Arwan auquel il avait t promu, et soumit ses livres une
svre et efficace censure (voir l'dition des uvres de Sahdona donne
par le P. BEDJAII (Leipzig, t903) et la Prface de M. R. DUVAL. Cf. ci-des-
sus, Ch. VIU, p. !44,
CHAPITRE X
LES COLES NESTORIENNES
~ i. - Les coles de Sleucie et de Nisibe
Dans toutes les parties de l'univers chrtien, des
coles s'levaient l'ombre des glises. Partout les
vques avaient cur la formation doctrinale des
clercs et des moines. Mais nulle part, peut-tre, les
coles ne furent plus nombreuses et plus florissantes
que dans le monde syrien. Aux v et vi" sicles, cet
ge d'or des controverses religieuses, les divers partis
en prsence n'pargnrent aucun moyen de promou-
voir leur influence et de propager leurs ides. Les
chefs intriguaient la cour, et se proccupaient
d'enrler sous leur tendard les personnages les plus
haut placs. Mais ils comprenaient que cette tactique
excellente n'avait de chances srieuses de succs que
si l'on prenait soin, en mme temps, de masser der-
rire les capitaines une arme de simples soldats
nombreux et convaincus. Grce cette mthode,les
Jacobites purent conqurir la Msopotamie et la Syrie
euphratsienne, pour ne pas parler de l'gypte, en
dpit de la pression officielle exerce par l'adminis
tration impriale en faveur de l'glise orthodoxe.
1. ASSEII.UII, B. 0., IV, p. 9U et suiv.
LES COLES DE SLEUCIE ET DE NISIBE. 2.89
Les vques nestoriens saisirent, eux aussi, l'im-
portance de la vulgarisation de l'enseignement reli-
gieux. La plupart d'entre eux, ds la seconde moi-
ti du v sicle, taient des hommes fort instruits :
et Acace taient, nous l'avons dit, d'anciens
lves de la vieille cole d'desse
1
; plusieurs de leurs
condisciples sigeaient avec eux dans les conseils
ecclsiastiques. Mais de 510 550, les coles fondes
par ces prlats dclinrent, et la culture thologique
subit le contre-coup de la dcadence gnrale.
Sous le rgne de Maraba au contraire, et surtout
sous celui d'zchiel, la ncessit de lutter contre
l'envahissement du Jacobitisme fit clore partout, et
particulirement dans les provinces du Nord les plus
directement menaces , une prodigieuse floraison
d'coles de village. Chaque glise, chaque monastre
devint un centre actif d'enseignement religieux. Le
mafriano jacobite Den}:ta, dans sa Vie de Maruta
2
,
constate qu'en Adiahne, dans chacun de leurs
bourgs, pour ainsi dire, les Nestoriens avaient pris
soin de fonder des coles o ils enseignaient des hymnes
(Ji=), des cantiques des rpons des chants
(JJ.;wo
1
), que, d'un commun accord, on pt rpter dans
toutes leurs provinces. C'tait un moyen trs efficace
de propagande. On ne pouvait songer initier le.vul-
gaire aux mystres de l'criture et aux rgles de la
communication des idiomes. Mais on mettait dans sa
bouche des chants orthodoxes, et on prohibait avec
svrit les hymnes hrtiques, comme le prouv.entles
canons de Sabriso< et de Grgoire
3
Le cantique tait
i. Voir ch. vr.
!!, Vita Marutae, ms., r. t99, v. b.
3. Nous avons appris qu'il en est qui suppriment ces proclamations
liturgiques: Nous tous, dans la crainte et la glorification, de mme que
LE CDRISTIAIHSME. 17
290 LES COLES NESTORIENNES.
le signe distinctif du vrai croyant. Trois sicles aupara-
vant, Arius avait enseign sa doctrine aux matelots
d'Alexandrie en imitant les rythmes sotadiques. Au-
jourd'hui encore, la foi du musulman tient tout entire
dans une formule bien connue.
Mais, pour les lettrs et les ecclsiastiques, cette
formation rudimentaire tait insuffisante. De tous
temps, les vques et les clercs instruits virent se for-
mer autour d'eux un cercle plus ou moins large d'au-
diteurs avides de recueillir leurs enseignements. Peut
tre dans chacune des mtropoles provinciales eut-on
des matres d'criture Sainte et de Thologie. Les
textes ne paraissent pas cependant suggrer cette ide.
De mme que, dans l'Orient romain, Thodoret, v-
que d'une obscure cit perdue dans les montagnes, et,
avant lui, Thodore, chef d'une minuscule glise de
Cilicie, exercrent autour d'eux une influence extraor-
dinaire, ainsi, en Perse, autour de deux vques de
la petite ville de Lasom
1
, Mika, au v sicle, et Sa-
briso , au v1, se runirent de nombreux disciples. P"()ur
l'poque que nous tudions, deux glises seulement
semblent avoir t dotes d'un tablissement perma-
nent d'enseignement, et, comme nous dirions aujour-
d'hui, d'une Universit : l'glise patriarcale de S-
leucie-Ctsiphon et la grande mtropole du Nord,
Nisibe.
Encore l'existence de l'cole de Sleucie n'est-elle
bien atteste qu' partir du v1 sicle. Les. annalistes
nestoriens!! en placent les origines au tv sicle. Mais
celle-ci : Louange au {Dieu) bon, et : La lumire de l'apparition du
Christ, qui enseignent clairement la dualitt' des natures du Fils ..... S'ils
persistent et n'obissent pas, nous leur interdirons l'glise et la rcep-
tion des saints mystres. Syn. orient., p. t00; cr. p. t'77.
t. cr. HoFFMANN, Awzge, p. !!7t. Syn. orient., p. !l99 et 306.
2. ASSEMAIIJ, B. 0., IV, p. 9i!), MARE, p. 24. 'Alla, p. t2.
l
J
.....
LES COLES DE SLEUCIE ET DE 291
ce qu'ils nous racontent d''Abda, d"Abdiso et de leurs
disciples est videmment fabuleux. A la fin du v si-
cle, Acace, le futur catholicos, aurait t professeur
Sleucie
1
En ralit Maraba nous parat tre le
vrai fondateur de l'cole. Nous savons les noms de
quelques-uns de ses successeurs : Isae, Ramiso',
Qayura, Mar, qui futle concurrent d'zchiel au catho-
licat, et le patriarche Grgoire. L'histoire intrieure
de cette cole nous est mal connue. Elle resta tou-
joul:'s trs modeste, au moins avant la chute des Sas-
sanides, en dpit de l'attraction que devait exercer la
capitale. Ni pour la clbrit des matres, ni pour le
nombre et la valeur des tudiants, elle ne put rivali-
ser avec son ane, la glorieuse cole de Nisibe.
Nous avons dit plus haut
3
comment l'cole des
Perses desse ayant t dfinitivement ferme par
l'empereur Znon en 489, l'instigation du chien
enrag et du<< docteur en mensonge
4
, l'vque Cyrus,
recueillit dans sa ville piscopale les plus
marquants des rfugis et y constitua une cole sur
le modle de celle o lui-mme avait tudi, l'poque
dj lointaine o Ibas y interprtait les critures. Les
statuts dont il dota sa nouvelle fondation ne sont pas
parvenus jusqu' nous. Il parat qu'une main perfide
les avait malignement soustraits .et qu'il fut impossi-
ble d'en retrouver un seul exemplaire la biblioth-
que de l'cole
5
Ces rgles ne pchaient sans doute pas
par excs de douceur. A la tte de l'Universit nouvelle,
t. lbRE, p. 37 : Acaeius ... Edessa discessit Madainam contendens.
obi doctoris munus exercuit toto tempore praefecturae Babuaci. Cf.
'AMR, p.
!il, MAnE, p. olS. 'Alla, p. !il3 et i-l. B. 0., III, p. 86. V. plus haut, p. t69,
n.3.
3. Ch, YI.
4. Gli Statuti della Scuola di Nisibi, p. to du tirage part.
a. Gli Statuti, p. !l,
292 LES COLES NESTORIENNES.
il plaa son ancien condisciple et ami Narss le Doc-
teur admirable, la Langue de l'Orient, le Pote de la
religion chrtienne, la Harpe de '' Ce
grand homme assit pour jamais la de l'cole
qu'il dirigeait. Son uvre immense, dont nous ne
connaissons que quelques fragments, forma le trait
d'union entre les docteurs du nestorianisme hellni-
que et les thologiens de la Syrie orientale. Il mou-
rut probablement dans les vingt premires annes du
v1 sicle. Son neveu Abraham lui succda
2
A la mort
de celui-ci, on dsigna aprs lui deux autres disciples de
Narss, Jean de Nisibe et Joseph Huzaya, c'est--dire
originaire du Huzistan. Ce dernier mourut vers 575.
Il est impossible, dans l'tat actuel de la science,
de dterminer avec exactitude la chronologie de ces di-
recteurs. Nous ne pouvons pas mme assurer qu'ils
se soient succd dans l'ordre que nous indiquons.
Nous connaissons mieux quelques-uns des professeurs
et des lves de cette poque : Paul mtropolitain de
Nisibe, que nous avons identifi plus haut avec Paul
de et avec Paul le Perse, l'auteur de la con-
troverse contre les Manichens signale par M. Mer-
cati
3
, le catholicos Maraba, qui tudia Nisibe avant
son voyage en Occident et y professa quelque temps
son retour; Abraham bar Qardal;t (fils des forge-
rons); l'introducteur en Orient du cnobitisme pac-
mien, Abraham de Kaskar, enfin les patriarches
Isoyahb 1 et Sabriso.
La prosprit de l'cole allait toujours grandissant.
Sous le successeur de Joseph Huzaya, ij:enana d'Adia-
bne, elle compta, s'il faut en croire Mare, jusqu' huit
t. MARI!, p. 38. R. DUVAL, Litt. syr., p. 346.
!il. MARI!, P 39 et .S.
3. V. eh. VI, p. {66.
......
LE RGLEMENT INTRIEUR DE L'COLE DE NISIBE. 293
cents tudiants
4
Le chiffre, si lev qu'il paraisse,
n'est pourtant pas invraisemblable, car nous savons,
d'ailleurs
2
, que lorsque Grgoire de Kaskar dut renon-
cer l'vch de Nisibe, un certain nombre d'tu-
diants, trois cents environ, se sparrent des I;Iena-
niens, et, pour protester, quittrent l'Ecole. C'est ce
moment sans doute que Baba le Grand fut docteur
Nisibe dans le xenodochion , aprs avoir tudi,
pendant quinze ans, la doctrine et les commentaires
3
Les controverses et les dissensions de l'cole, au com-
mencement du vn sicle, appartiennent l'histoire
gnrale
4
Il nous suffit de rappeler qu'elles eurent
pour rsultat la cration d'coles plus orthodoxes au
grand monastre d'Abraham
5
, tout d'abord, et ensuite
au couvent Beit 'Ab; elles n'atteignirent jamais
la notorit de l'cole de Nisibe. Celle-ci fut d'ailleurs
bientt reconquise au nestorianisme rigide par ses an-
ciens lves, Iso'yahb II et Iso'yahb III, et redevint,
comme au temps de Bariilauma, l'invincible rempart
de l'orthodoxie la plus autorise.
S 2. - Le rglement intrieur de l'cole de Nisibe,
l'organisation des tudes s.
L'cole de Nisibe tait, la fois, comme on dirait en
1. L'Anonyme, auteur de la Vie de Sabrio, appelle Nisibe la mre
des sciences, la ville intellectuelle Vie de Sabrilo', d. BEDJAN, p. i!lt,
1. H. B. 0., IV, p. 9i7. M.t.RE, p. 48.
!ii. AMR, p. 30. cr. GUIDI, Chron. anon., p. 16.
a. Livre de la Chaatet, n. 39.
4. Voir ci-dessus, le cb. vrn.
lS. P a & ~ i o n de Georges: HOFFIIUNN, Auszflge, p. tOi et sui v. Syn. orient.,
p. 6!!6.
6. Par une singulire bonne fortune, les rglements intrieurs de
l'cole de Nlslbe nous ont t conservs. M. Guldi les a publis en 1890
et M. l'abb Chabot en a donn rrem1pentun commentaire des plus ln-
294-
LES COLES NESTORIENNES.
Allemagne, Universit et con vi Elle se rapprochait,
en somme, du type actuel de nos sminaires franais.
C'tait un c coenobium et l'on y vivait sous un r-
gime quasi monastique. Non que tous les tudiants
fussent moines ou se destinassent la vie monastique
(il y avait parmi eux des prtres et des laques, qui
conservaient la proprit de leurs biens), mais parce
que la vie commune appelle ncessairement une rgle-
mentation quasi monacale.
Les lves, venus de toutes les provinces de l'glise
de Perse, devaient premirement solliciter leur ad-
mission, prendre connaissance des statuts et jurer d'ob-
server le clibat (1, 1)
2
Ils contractaient trois obliga-
tions principales : la rgularit, la rsidence, le travail.
Sur le premier chapitre, le majordome
3
et le conseil
tressants : Gumr,Gli Statuti della Scuola di Nisibi, dans Giornale della
Societ asiatica italiana, vol. IV, p. t65-i95. J.-B. CHABOT, L'cole de
Nisibe, son histoire, ses statuts. Journal de la Socit asiatique, tSOO,
9 srie, t. VIII, p. 43 et suiv. (je cite d'aprs le tirage part).
Ces statuts forment une double srie, la premire promulgue le ii oc-
tobre496par le mtropolitain Ose ou lise de Nisibe, et renouvele sous
le rgne de Chosrau I, le lecteur de l'cole tant le diacre Narsai; la
seconde srie contient les rglements dicts sous la direction de f.le-
nana par le mtropolitain Simon de Nisibe en 590. Les deux sries furent
runies par les soins du successeur de Grgoire : (G). Les
collecteurs les firent prcder d'une Introduction historique dont quel-
ques renseignements sont peut-tre sujets caution. Nous ne pensons
pas, par exemple, que le renouvellement des statuts d'Ose ait eu lieu
en 530, la premire anne de Chosrau. Si le mtropolitsin Paul dont il
estquestion est Paul cet vquenefut mtropolitain deNisibe
qu' la fin du rgne de Maraba.
1. A sa tte, un suprieur, appel Rabban, notre maitre (CHABOT,
p. 21il, titre qui tait aussi donn aux docteurs parmi lesquels le
suprieur tait choisi (I, 1), et principalement l'Interprte, sans doute
parce que ce dernier tsit le plus souvent appel remplir les fonc-
tions de suprieur.
\!. Les chiffres romains se rapportent l'une ou l'autre srie des sta
tuts.
3. L'administration tait confie un majordome, rab baita(CHABOT,
p. tait tout la fois ce que nous appellerions aujourd'hui l'-
conome, le prfet de discipline et le bibliothcaire de l'cole. Il tait
LE REGLEMENT INTRIEUR DE L'COLE DE NISIBE. 295
des pres dployaient une grande svrit. Tout est
minutieusement prvu, jusqu' l'habillement et la
coiffure (Il, 17). Et des pnalits savamment gradues
4
,
de l'amende l'exclusion, taient prononces par l'au-
torit suprieure sans qu'il fdt permis de recourir
des influences trangres, fdt-ce celle du clerg de la
ville, et peut-tre mme de l'vque (1, 21). La rsi-
dence devait tre scrupuleusement observe : interdic-
tion de quitter la ville, sans la permission du suprieur
et du majordome. L'article 4 du premier Rglement
dfend, par-dessus tout, de franchir la frontire toute
proche de l'empire romain, soit pour trafiquer, soit
mme pour vnrer les Lieux saints ou frquenter
quelque docteur renomm. On ne sortait gure de
Nisibe qu' l'poque des vacances, du commencement
d'aodt la fin d'octobre, ou bien, sur l'ordre du sup-
rieur, pour aller faire l'cole dans les bourgades envi-
ronnantes, obligation laquelle on ne pouvait se
soustraire sous aucun prtexte. Il tait interdit de
manger dans les boutiques et les auberges, de prendre
ses repas dans les jardins et les vergers, de visiter les
monastres de femmes situs l'intrieur des murs
2
On ne pouvait loger au dehors, moins qu'il n'y edt
plus de place dans les btiments de l'cole. Ces bti-
ments taient diviss en une srie de petits apparte-
ments o habitaient ensemble huit ou dix lves sous
la responsabilit d'un surveillant ou chef de cellule.
Les habitants d'une cellule, ou plutt d'une camerata,
lu pour un an par l'assemble des Pres . D'ailleurs, il ne pouvait
rien faire d'important sans l'assentiment d'un conseil compos du su-
prieur et des principaux Pres.
1. La coulpe tait de rgle, mais les dnonciations calomnieuses
taient svrement punies (1, 18; 1, 16).
i. Cf. HOFFIIAID, Auszge, p. 103, O il est question du cloitre de Nar-
sowai Nlsibe. La sur du martyr Georges, Hazarowai-Mariam, s'y re-
tira.
..... --;),. ........... ,. A
296
LES COLES NESTORIENNES.
comme on dirait Rome, prenaient ensemble leurs re-
pas, dans leur local; mais il semble, si nous comprenons
bien l'article 9 du premier Rglement, que ces locaux,
probablement exigus, ne servaient gure que de r-
fectoire et de dortoir; le reste du temps se passait
l'tude ou l'glise. D'ailleurs, ls tudiants trouvaient,
dans l'intrieur de l'cole, de quoi subvenir tous
leurs besoins, mme en cas de maladie
4
La prire et surtout le travail occupaient la plus
grande partie de la journe (1, 8 et 9). Les chefs de
cellules surveillaient leurs condisciples et stimulaient
leur activit. A la diffrence des moines, les tudiants
ne se livraient pas au travail manuel. Il n'tait permis
que pendant le temps des vacances aux coliers peu
fortuns, qui n'auraient pu, sans cela, subvenir aux
frais de leur entretien et de leur nourriture. Les plus
riches pouvaient prter sur leur superflu, sans toute-
fois faire fructifier leur argent la manire des usu-
riers. Le taux tait fix un pour cent par an.
Ainsi l'cole de Nisibe constituait une vritable
congrgation, jouissant de la personnalit civile, ca-
pable de possder et d'acqurir
2
, investie de certains
pouvoirs judiciaires et pouvant ester en justice au
nom de ses membres, indpendante du clerg local et
peut-tre du mtropolitain lui-mme. Mais ce dtail
n'est pas bien stlr, au moins pour notre poque, car
les rglements successifs semblent avoir toujours t
approuvs et sanctionns par les vques de Nisibe.
Et cette congrgation s'appuyait au dehors sur ses
anciens membres, dont un grand nombre avaient t
promus aux plus hautes dignits ecclsiastiques. Toute
t. cr. le canon xv du concile d'Iso'yahb. Syn. orient., p. "ti.
!!. Les moribonds devaient faire leur testament en prsence du ma-
jordome, sous peine de confiscation (1, i7).
LE RGLEMENX INTRIEUR DE L'COLE DE NISIBE. 297
proportion garde, on peut dire que l'cole de Ni-
sibe tait entoure, dans l'Orient nestorien, du mme
prestige dont jouirent plus tard, en Occident, les
grandes Universit. du moyen ge.
Nous voudrions tre exactement renseigns sur l'or-
ganisation des tudes Nisibe. Malheureusement nous
en sommes rduits aux hypothses. M. Chabott con-
jecture qu'au-dessous du suprieur, il devait y avoir
deux docteurs principaux : l'Interprte, mfasqana,
et le maitre de lecture , maqriana. On pourrait y
joindre le safra ou scribe, charg sans doute d'ensei-
gner l'criture. Quant aux mhaggian et aux haduq,
il nous faut renoncer dterminer leurs fonctions. La
similitude de nom d'un accent massortique a port
M. Chabot penser que le mhaggiana tait peut-tre
eharg d'apprendre aux dbutants lire correctement.
Un passage du Nomocanon d"Abdiso'
2
nous fait con-
naitre que les cours de l'cole de Nisibe au x1v sicle
se rpartissaient entre trois annes. Il semble aussi que
la base de ces cours ftlt la transcription de la sainte
criture et de la Liturgie qu'expliquaient ensuite les
professeurs. D'aprs ce texte, le programme de la pre-
mire anne comprenait la premire partie du Br-
viaire
3
, les ptres de saint Paul 4, et le Pentateuque.
La deuxime anne, on copiait la deuxime partie
du Brviaire, le Psautier et les Prophtes, ainsi que
les hymnes des Sacrements; la troisime anne, le
Nouveau Testament et les Rpons de l'office. Rien
ne nous gar&ntit, d'ailleurs, que ces programmes fus-
1. L'cole de !iisibe, p. !5.
2. Cit par Assemani, B. O., IV, p. 939.
3. Sur la composition du Brviaire nestorien et ses divisions, voir
AssEII.t.IU, B. 0., III, p. !192 et sui v,
A moins que ce ne soient les crits philosophiques de Paul le
Perse. "
17.
... ....
298 LES COLES NESTORIENNES.
sent en vigueur l'poque dont nous crivons l'histoire.
Nous serions plutt inclin penser, d'aprs de nom-
breuses indications hagiographiques t, que le cycle
scolaire s'ouvrait par la et l'tude de
<<David, c'est--dire du Psautier.
A ce travail de copie on joignait l'interprtation de
l'criture. On s'attachait surtout expliquer les Com-
mentaires de Thodore de Mopsueste, traduits ds le
temps d'lbas et modifis peut-tre suivant le sens de
Thodoret, au moins en ce qui concerne le Livl'e de Job
et le Cantique des cantiques. On sait quels orages sus-
cita ljenana
2
quand il osa prtendre que Thodore n'tait
pas infaillible, qu'en tout cas on pouvait s'inspirer d'au-
tres Commentaires que des siens. Saint Chrysostome
ne parvint pas supplanter le docteur de Mopsueste,
qui continua d'tre appel, chez les Nestoriens, le Com-
mentateur >> par antonomase. Ce serait toutefois une
erreur de penser que l'tude des grands thologiens
grecs autres que Thodore n'tait pas en honneur
dans les coles persanes. Presque tous avaient t
traduits en syriaque soit par les disciples d'lbas, soit
par ceux de Maraba.
Enfin les professeurs devaient parfois dicter leurs
cours; telle est sans doute l'origine d'un grand nombre
de traits nestoriens. Un spcimen trs ancien et peut-
tre unique pour son poque nous en est parvenu. Ce
sont les lnstituta regularia divinae Legis
3
, de Paul de
t. Cf., par exemple, la Vie de Maraba cite plus haut, auich. vn, et
aussi le canon x vi du concile d'Isaac: Celui qui est pauvre en science
et ne peut rciter David par cur ne peut pas mme devenir sous-
diacre. Qu'il soit rejet jusqu' ce qu'il ait appris rciter par cur
David en entier Syn. orient., p. 269. on peut joindre ces textes,
pour une poque postrieure, les constitutions de Sabriso' 11, de Tho-
dose et d'Abraham, cites par Assemani, B. O., IV, p. 960, 9.
i. Voir ch. IX, p. !78, et Syn. orient., p. 400. Cf. B. 0., III, p. St.
3. MIGNE, P. L., LXVIII, col. Nouvelle dition dans KmN, Theodor
von Mopsuestia und Junilius A(ricanus als Exegeten, p. 465 et su iv.
LE RGLEMENT INTRIEUR DE L'COLE DE NISIBE. 2Q9
Nisibe, que le quaestor sacri palatii Junilius fit tra-
duire Constantinople en 551 l'usage de l'vque
Primasius d'Adrumte.
Les lnstituta regularia sont trs prcieux comme
tmoins de la mthode exgtique en honneur Nisibe.
M. Kihn
1
a bien dgag l'esprit foncirement aristot-
licien de cette mthode. A propos de chacun des livres
de l'criture, Paul en examine successivement le but,
l'utilit, l'authenticit, l'ordre, le titre et sa raison
d'tre, la division en chapitres, et la tendance : xom),
'rO
-r!let, ltf ' i'ltl'fp<p;j, 4j d -rat X8!p!l-
8rcdpaar, x\ fmo 1toiov dv!lya-rcct. Ces termes sont tous
emprunts au 1tap\
Le texte est tudi au point de vue grammatical,
suivant les 1tvn fWVl de l'lsagoge de Porphyre : le
genre, l'espce, la diffrence, la proprit, l'accident:
yvo, al8o, t!pop&., ftov, O"U(I-6&6'1}xo.
Le canon biblique est dress selon les prceptes
de Thodore, c'est--dire d'aprs les lois d'une criti-
que rigoureusement scrupuleuse en matire historique.
Les livres de la Bible sont partags en livres perfectae
auctoritatis, mediae auctoritatis, nullius auctoritatis.
Ces derniers sont ce que nous appelons les Apocry-
phes
2
Pour les livres mediae auctoritatis, ce sont les
d'aprs la critique personnelle de l'vque
de Mopsueste, savoir : Job, Tobie, 1 Esdras, Judith,
Esther, II Macchabes, l'Apocalypse, la Sagesse, le
Cantique des cantiques, l'ptre de saint Jacques, la
deuxime de saint Pierre, celle de saint Jude, la
deuxime de saint Jean. Outre ces nomenclatures,
les lnstituta contiennent encore la solution de ques-
t. KrBII, Theodor tJon Mop1uheatia und Juniliul .A{ricanu1 als Exe-
geten, p. !!7!1 et sulv.
!1. Dans le canon de l'glise catbolique.
300 LES COLES NESTORIENNES.
tions scripturaires importantes et difficiles, touchant,
par exemple, le sens messianique de quelques passages
de l'ancienne Loi. Ce petit Manuel Biblique mri-
tait, en somme, de devmir classique chez les Nesto-
riens t, et d'entrer, grce la traduction de Junilius,
dans le patrimoine des thologiens latins du moyen
ge.
La logique et la rhtorique taient-elles enseignes
l'cole de Nisibe? Nous ne le croyons pas. L'Ecole
de Nisibe semble avoir t exclusivement une cole de
thologie
2
Les termes que Junilius emploie dans sa
Prface nous inclinent ce sentiment
3
: Tu
dit-il Primasius, more illo tuo nihil ante quaesis
quam si quis esset qui inter Graecos divinorum lihro-
rum studio intellegentiaque flagraret. Ad haec ego
respondi vidisse me quemdam Paulum nomine, Per-
sam genere, qui Syrorum schola in Nisihi urhe est
edoctus, uhi divina lex per magistros puhlicos, sicut
apud nos in mundanis studiis grammatica et rheto-
ordine ac regulariter traditur . Mais ce qui
achve de nous dcider, c'est le texte des canons xix et
t. B. 0., Ill, p. 87.
!1. Cependant des grammairiens lui furent certainement attachs. M. Cha-
bot (p. !lt) a remarqu que Joseph Huzaya, le prdcesseur de l}enana,
n'a laiss aucun ouvrage d'exgse proprement dite. En revanche, on
lui attribue un Trait de grammaire, le plus ancien dont il soit ques-
tion dans l'histoire de la littrature syriaque, et un livre sur les mots
quivoques , c'est--dire qui s'crivent avec les mmes lettres tout en
ayant un sens diffrent. Il est aussi prsent comme l'inventeur du
systme de ponctuation et de vocalisation en usage chez les Nestoriens
labor l'Instar des signes massortiques, et peut-tre avec l'aide ou
les conseils des Juifs qui avaient aussi cette poque une cole il
Nisibe. Nous en conclurons que si les sciences profanes furent tu-
dies Nlslbe, ce ne fut que dans leurs rapports avec la science sacre
et comme disciplines auxiliaires de la thologie, ... la diffrence
d'autres coles syriennes, particulirement des coles jacobites, o l'on
donnait une plus large part aux tudes profanes, principalement la
philosophie pripatticienne (p. !17).
3. Km:., op. ct., p. 467.
LE RGLEMENT INTRIEUR DE L'COLE DE NISIBE. 30i
xx de la deuxime srie des statuts qui interdisent tout
commerce avec les mdecins, parce qu'il ne convient
pas d'tudier les livres des sciences humaines .en mme
temps que les Livres saints n. Cette prohibition peut,
d'ailleurs, n'avoir t en vigueur qu'au vu sicle, et il
est possible que, du temps de Paul, les sciences profanes
fussent enseignes l'cole. Nous pensons toutefois que
s'il en et t ainsi, ces cours auraient pris une trs
large extension, loin de disparaitre au sicle suivant
sans laisser de traces. Il est plus probable que, vers
530, la logique et la rhtorique, ou du moins les pro-
fesseurs de logique et de rhtorique n'taient pas en
faveur dans les cercles ecclsiastiques. Les paens
chasss d'Athnes par Justinien eL rfugis auprs de
Chosrau 1 ne devaient inspirer qu'une confiance des
plus limites aux docteurs orthodoxes de Nisibe.
Quoi qu'il en soit, la grande mtropole nestorienne
vit natre dans ses murs la premire Universit tholo-
gique, les premiers cours publics de thologie. Ce
phnomne qui excitait l'admiration et l'tonnement
du quaestor sacri palatii de Justinien ne peut que nous
donner une ide avantageuse de la culture du clerg
nestorien cette poque de son histoire.
- ~ "'!' .. A
CHAPITRE XI
L
1
1NSTITUTION MONASTIQUE
i.-Saint Eugne et les traditions lgendaires
sur l'origine du monachisme.
Nous avons essay ci-dessus
1
de montrer comment,
ds la premire moiti du Iv" sicle, la vie cnobitique
et rmitique tait en honneur dans les provinces
persanes. Nous marquions que cette institution des
u fils et des filles du pacte pouvait tre autochtone,
et qu'il tait, en tout cas, impossible de remonter jus-
qu' ses origines pour en fixer la date. Il nous reste
examiner dans quelles circonstances, une fois l'hell-
nisation de l'glise syrienne orientale accomplie, les
mthodes asctiques de l'Occident furent introduites
dans l'empire des Perses.
Nous nous trouvons tout d'abord en prsence d'une
tradition de l''fglise nestorienne qu' Assemani avait
dj recueillie
2
D'aprs cette tradition, un moine gyp-
tien, originaire de Clysma
3
, nomm Awgin, c'est--dire
Eugne, aurait import dans le Tur 'Abdin les prati-
ques des moines de saint Antoine et de saint Pacme.
Autour de lui se seraient groups un certain nombre
1. Ch. 111.
2. D1s. de Syris Nestoranis, B. O., IV, p. DCCCLXII et suiv.
3. Prs de Suez. Le rdacteur de la Vie d'Eugne qualifie d'ile 1 ~ ter
ritoire de Clysma.
-.
SAINT EUGNE ET LES TRADITIONS LGENDAIRES. 303
de disciples, pour la plupart originaires de l'empire
romain. Plusieurs de ces disciples auraient essaim et
fond des monastres dans diverses rgions de l'em-
pire sassanide. Les historiens modernes, et, en parti-
culier, M. Budge dans la savante Introduction dont il
a fait prcder l'dition du Livre des Suprieurs par
Thomas de Marga
1
, ont accept cette tradition en la-
guant, bien entendu, certains dveloppements fabuleux
transmis par leshagiographes
2
J'ai moi-mmeadopt
l'opinion commune
3
, non sans faire d'expresses r-
serves. Mais un examen plus attentif de la question
m'a port accentuer mes doutes, et je ne serais pas
loign de refuser toute crance la tradition nesto-
rienne concernant la venue de l'gyptien Eugne au
IVe sicle et la fondation par lui d'un florissant monas-
tre.
Cette tradition a pour elle : 1 o les annalistes
4
; 2o, un
document hagiographique rcemment publi par le
P. Bedjan, la Vie d'Eugne
5
; 3 le Livre de la Chastet
d'lsodenal;l, dit par M. Chabot
6
Nous ngligerons
le tmoignage des annalistes. Mare et Amr s'inspirent
ici des deux autres documents, auxquels ils ajou-
1. The Book ofGoveNIQrB (Hiatoria monaatica), d. BUDGE, t.l, p. ex vi
et suiv.
!1. It is a notorious fact tbat Christian monasticism was flrst intro-
duced into Mesopotamia by Mar Augln the Egyptian. BuDGE, The Book
of Gov., t. 1, p. XLIV; cf. R. DUVAL, Litt. syr., p. 180.
3. Revue d'hi&toire et de litt. religiemes, 190!1, p. 33 dn tirage
part.
4. MARE, ln Vila Papae, d. Glsmondi, trad., p. 8;- AIIIR, p. 9;-
BARBBR.uus, Chron. eccle&., 1, col. 85 et 88.
5. Acta Martyrum et Sanctorum, t.lll, p. 576-480. Le jugement svre
que M. Westpbal, Untersuchungen, p. 69, a port sur la valeur morale et
esthtique de cette pice hagiographique n'est que trop justifi. Voir
dans le travail que nous venons de citer, l'analyse des renseignements
fournis par Mare et 'Amr sur les fondations monastiques attribues aux
disciples d'Eugne (p. 109H3).
6. Livre de la Chastet, notice 1.
304,
L'INSTITUTION MONASTIQUE.
tent, de leur cru, quelques anachronismes grossiers.
La Vie d'Eugne a la prtention de nous offrir un
rcit suivi et complet des gestes du saint fondateur
du monachisme. Eugne exerait la . profession de
pcheur de perles. Il rut favoris de diverses appa-
ritions et du don des miracles : il apaisait les
temptes et sauvait les marins du naufrage. Aprs
vingt-cinq ans d'exercice, il se retira au monastre de
Saint-Pacme o on lui attribua l'emploi de boulanger.
Il stupfia ses compagnons, en se mettant en prires
au milieu d'un four embras. Embarrass de la cl-
brit qu'il avait acquise, il se rendit en gypte, c'est-
-dire sans doute Nitrie. Et, parmi les moines qui,
avertis par un miracle, s'taient rendus sa rencontre,
il choisit soixante-dix compagnons, la tte desquels
il alla vangliser Nisibe. Aprs un court sjour sur
les bords de la rivire Masak
4
, et toujours pour se sous-
traire l'admiration publique excite par sa thauma-
turgie, Eugne se retira sur le mont Izla. Autour
lui se runirent trois cent cinquante disciples, venus
de tous les points de l'Orient romain.
La deuxime partie de l'histoire est consacre d-
crire les rapports de Mar Awgln avec l'illustre saint J ac-
ques de Nisibe, le martyr Mils
2
et le roi Sapor II. Le
moine met tout son crdit au !lervice de l'vque de Ni-
sibe. Le gouverneur de la ville, dont Eugne avait res-
suscit le fils, fait part Constantin de ce prodige. Le
pieux empereur, dans sa rponse, compare Eugne
saint Antoine et saint Hilarion. Le rdacteur de la Vie
n'ose pas son hros la dcouverte de l'Arche
t. AU sud de Nisibe. HOFFIIAKII, Amzge, p. t7t; M. BIIDGE (The Book
of Gouernors, p. cxxVI) l'identifle avec Je Ma:ax de Xnophon.
it. Ou plutOt Mar Milos, de Jrusalem, qui contribua pour trois cents
dinars.(?) la construction de l'glise du monastre.
,.,
SAINT EUGNe ET LES TRADITIONS LGENDAffiES. 30a
.de No, qui passait pour un des plus insignes miracles
de saint Jacques de Nisibe. Mais, du moins, Eugne
prdit le succs des recherches entreprises et, en re-
connaissance, saint Jacques lui envoya un morceau du
bois de l'Arche. Lors de l'inauguration du couvent que
btit saint Jacques dans la montagne de Qardu, sur
l'emplacement mme du prcieux gisement, Eugne
et sa congrgation furent invits. Eugne entra gale-
ment en relations avec Jovien au moment o l'empe-
reur Julien envahit le territoire des Sassanides, et lui
annona par avance la mort de l'Apostat. Enfin, lors-
que Nisibe eut t cde aux Perses, Sapor II dsira
voir le thaumaturge et l'accueillit avec beaucoup de
respect. Mais les mages voulurent disputer avec lui.
Eugne leur proposa l'preuve du feu qui tourna leur
confusion. Il dlivra du dmon un des deux fils de Sa-
p o r ~ .En retour, il demanda au roi la permission d'aller
btir des monastres dans la rgion du Beit Huzzay.
Le roi dfra son dsir, dota mme son couvent du
mont Izla
2
, et lui dlivra des lettres patentes en vertu
desquelles les moines de son obdience pouvaient aller
s'tablir, leur gr, dans toutes les provinces de l'em-
pire perse. Aussitt les soizante-douze disciples se
rassemblrent, demandrent la bndiction de leur
Pre spirituel, puis, s'armant d'une croix, partirent
pour aller fonder chacun un monastre. D'aprs ce
vridique rcit, compos par Mar Michel, compagnon
de Mar A wgn, ce moine serait mort le 21 Nisan
1. Par l cette lgende est en connexion avec les autres pices hagio-
graphiques qui louent la pit de Sapor et mentionnent la conversion
de ses enfants : Actes de Gubarlaha et de Kazo (BEDJ.UC, t. IV, p. Ul et
218); histoire de Mar Behnam (HorniANN, Ausziige, p. n et sui v.) et des
martyrs de Tur Bra'in (op. cit., p. 9 el suiv.). Voir Litt. 1yriaque,
p. 141143.
!Il. D'une terre nomme Hidgan. BuoGE, t. 1, p. cxxx. Voir ci-dessous,
p. 31!1.
306 L'INSTITUTION MONASTIQUE.
674 de l're des Grecs, c'est--dire en avril 363.
Les Nestoriens possdaient tout un cycle de rcits
eugniens qui disaient la vie merveilleuse des disciples
du saint. Nous connaissons les Vies de Sallita, de
Y onan, de Daniel le mdecin et de Mi:ka. Sallita
1
aurait quitt l'gypte la suite d'Awgn, puis se serait
fix Nisibe, et ensuite Kewela avec saint Jacques
et Awgn. Abandonnant dfinitivement le mont lzla, il
serait all dans le Beit Zabda, au bourg de Beit Ma-
wila
2
, et y serait mort un ge trs avanc.
Y onan
3
, l'anachorte d'Anbar, serait Cypriote d'ori-
gine. S'il faut en croire l'hagiographe Zado, prtre
et solitaire, chef du monastre de Saint-Thomas dans
le pays de l'Inde, dont le sige est fix sous le pays des
Qatray, Ceylan, l'le noire , et qui se donne comme
contemporain de Mar Y onan, ce saint moine avait
rencontr Mar Awgn en gypte. Lors de la disper-
sion des disciples, il alla dans le dsert de Proz-
sabur o il fut nourri miraculeusement pendant vingt
annes. Il se rendit de l << notre saint monastre
pour y voir le saint abb Pln qui avait pri Dieu de
lui montrer un saint de la compagnie de Mar Awgn.
(L'auteur prtend avoir reu lui-mme Yonan et un
autre pre tranger du nom de Papa.) Enfin Yonii.n re-
tourna son monastre d'Anbar et y mourut.
Daniel le mdecin
4
est, d'aprs son historien, un
moine de Thbade. Il assiste tous les miracles
d'Awgn et la gurison des deux fils de Sapor que
Mani avait livrs au dmon
5
Daniel quitte le mont Izla
avec Michel, le prtendu auteur de la Vie d'Eugne
i. BEDJAN, t. 1, 4!U et suiv. Livre de la Chastet, n.i et a.
2. Le Livre de la Chastet dit : au village de la Chastet.
3. BEDJAN, Acta MM. et SS., t. 1, p. 466 et suiv.
4. BEDJAN, Acta MM. et SS., Ill, p. 481 et suiv.
5. On notera l'emhellissemeot de la lgende.
SAINT EUGNE ET LES TRADITIONS LGENDAIRES. 307
qui l'indigent narrateur de la vie de Daniel emprunte lar-
gement, comme un frre. Ils parcourent la province
d'Atur, sjournent ljesna 'Ebraya (Mossul), prs d'un
bourg du pays de Ma 'alta
4
, dit Beit Qayta, et dans le
Beit Nuhadra. A ils convertissent des milliers
d'idoltres: Le roi du pays veut leur offrir son royaume.
Ils se contentent d'une glise et de ses dpendances
qu'ils font btir en dix mois. Nos hros se rencontrent
avec le fameux Mils que, pour les besoins de la cause,
un anonyme patriarche cre vque de Beit Nuhadra
et de Enfin Daniel succombe, on ne nous dit
pas en quelle anne.
Mka
2
, originaire de Beit Nuhadra, resta fidle
Awgn, lorsque la perscution de Julien eut dispers
ses collgues. Puis il alla Jrusalem, o il fut, mal-
gr lui, ordonn vque de Tarse par le patriarche
d'Antioche Flavien. Il s'chappa et se rendit au Sina,
puis Sct et il s'enfona dans le dsert intrieur''
Il retourne ensuite Alqos, la patrie du prophte
Nahum; il y construit un monastre, l'est du village,
avec les contributions volontaires des gens de Ma'alta.
Le monastre fut richement dot et on y adjoignit des
coles qui furent trs frquentes. Aprs avoir t
averti par une vision, il mourut le premier vendredi du
mois de Tesr II (novembre), l'ge de cent vingtans
3
t. Sur le pays de leit Nuhadra et de Ma'alta, v. Aus-
zge, E:xcurs n. t2, p. 1108-216.
!il. BEDJAN, Acta MM. et SS., t. lll, p. GtO et sui v.
a. A ces Histoires nous en joindrons, pour mmoire, trois autres qui
n'appartiennent pas au mme cycle, mals prtendent dcrire des faits
contemporains : l'Histoire de Zi'a (BEDJAN, Acta MM. et SS., 1, p. 398 et
sui v.) qui cra des monastres dans le pays de Gi!lu; du solitaire gyp-
tien Bisu (BEDJAN, Acta MM. et SS., III, p. 1172 et suiv.) et de 'Abdlso',
le convertisseur de Qardagh, fondateur du couvent de Mar prs
du lleuve Ce Ma1 'Abd iso' tait disciple d'un certain Mar 'Abda qui
fut aussi, d'aprs les annalistes, le maitre du cathollcos Iahbalaha. Je
n'entreprendrai pas de critiquer ces informations manlfestementfausses.
308 L'INSTITUTION MONASTIQUE.
La troisime relation de ]a Vie d'Eugne se rencon-
tre dans le Livre de la Chastet, no 1. C'est un rsum
de la premire des pices ci-dessus analyses. L'auteur,
ISo'denal;t, numre quatorze disciples d'Eugne, dont
ses deux surs. Suivent, dans le cours de l'ouvrage,
les noms de huit disciples du mme moine qui auraient
fond des monastres en divers lieux.
A cet ensemble de documents, qui n'est pas trs im-
posant d'ailleurs, s'opposent plusieurs difficults trs
graves. Supposons, provisoirement, que le Livre de la
Chastet, trs sobre de dtails, soit la meilleure pice
de toute la collection .. Ce Catalogue de moines illus-
tres date, au plus tt, du xe sicle
4
Il cntient en
effet, la mention d'une translation d'un corps saint
faite en l'an troisime du rgne de Dja'far, fils de
Mo'taem, roi des Arabes
2
, c'est--dire sous le ca-
lifat de Mutawaqqil en 849f50. Rien ne permet de penser
que l'auteur crivait peu de temps aprs cet vnement.
Le texte produit plutt l'impression toute contraire. Et
je placerais, pour ma part, la composition du mtro-
politain de B a ~ r a vers 900. C'est donc au xe sicle
seulement qu'apparatt notre hros. Auparavant, si-
lence absolu sur son compte. Ni Thodoret ni Sozo-
mne, dont les Histoires contiennent de prcieuses in-
formations sur le monachisme en Msopotamie
3
, ne
nous donnent son nom. Aucun concile n'en parle, non
plus que les rgles monastiques du VI
8
sicle ~ . Ph-
Voir FBIGE, Die Geschichte des Mar Abdhi&hd und aeines Jngers Mdr
Qardagh, Kiel, 1889. ABBELOOs, Acta Mar Qardaghi, ABByriae Prae-
fecti, qui sub Sapore II martyr occubuit, Bruxelles, 1890. BEDJ.t.N, Acta
MM. et SS., t. II, p. 44!1-006. Cf.' MARE, P t8. Cf. 'Alla, p. 111. Wur-
PHAL, Unter1uchungen, p. t!IO.
t. Cf. R. DuVAL, Litt. syr., p. !MIS.
il. Notice n. 47.
3. v. ci-dessous, p. 3HI.
4. Dans la prface de son Trait de l'Incarnation, Ba ba appelle Abra-
--
SAINT EUGNN ET LES TRADITIONS LGENDAIRES. 309
nomne plus significatif encore, Thomas de Marga,
qui crit entre 832 et 850, ignore absolument l'exis-
tence de saint Eugne. On pourrait objecter que Tho-
mas, se proposant d'crire l'histoire du monastre de
Beit Ab et non pas celle des couvents du mont Izla a
pu ngliger l'histoire d'Awgn. Cette objection est
sans valeur. Le chapitre m du livre 1
1
contient, par
manire d'Introduction, un loge des vertus monasti-
ques et la mention des personnages qui ont le plus
minemment pratiqu la vie parfaite : Mose au mont
Sina, lie au mont Carmel, lise, les fils des pro-
phtes, saint Jean au dsert, ceux qui taient avec
Simon au mont Thabor, le Seigneur des prophtes, au
temps de son jenP. dans le dsert, ... puis l'abb Paul,
l'abb Antoine, l'abb PambO, l'abb Silvanus, l'abb
Ssi.s, l'abb Nastr, l'abb Arsne . Il raconte, im-
mdiatement aprs, la vie d'Abraham, le fondateur du
Grand Monastre. Si Thomas a omis de mentionner
Mar Awgn, le fondateur prsum des monastres
persans, c'est donc qu'il en a ignor l'existence.
Par consquent, c'est entre l'Histoire monasti-
que et le Livre de la Chastet qu'on doit placer la
formation de l'Histoire d'Eugne, ou du moins sa
vulgarisation.
Essayons maintenant de pntrer plus avant et d'exa-
miner les caractres internes de cette lgende. Nous
tablirons trois propositions : 1 ) Nous possdons les
traces de trois recensions au moins de la Vie de
Mar Awgn; 2)le monastre d'Awgn n'apparat dans
l'histoire qu'au 1x sicle; 3) le monastre et sa l-
gende sont peut-tre d'origine monophysite.
ham le Pre des moines De mme, dans sa Vie u Georges,
martyr, HOFFIIANII, Auszge, p. iOi.
i. T. 1, p.
3f.O
L'INSTITUTION MONASTIQUE.
La preuve de la premire proposition se trouve dans
la comparaison des listes des disciples d'Eugne, con-
tenues dans le Livre de la Chastet et dans les deux
manuscrits de Londres et de Berlin que le P. Bedjan a
utiliss pour sa publication de la Vie d'Eugne. Le ms.
de Londres (add.12174), copi par M. l'abb Chabot
1
,
donne les noms suivants : Thomas, Guria, Grgoire,
Qdala, Taba, lahb, Iwanis (?), lise, Srapion et
Thcle, sur de Mar Awgn. Le Livre de la Chas-
tet
2
a en moins les noms de Qdala et de lahb, mais
contient en plus ceux de Jean, de Sallita, de Stratonice,
autre sur de Mar Eugne ,, , de Jean, de Schri
3
,
de Mar Mikal. Le texte de la Vie d'Eugne, emprunt
au ms. de Berlin, contient la liste soixante-douze
disciples
4
Elle est, bien entendu, sans aucune valeur.
t. Acta MM. el SS., 111, p. n, n. t.
11. Notice t.
a. Qui devient dans Je ms. de Berlin: Schzi, par suite du change-
ment de' en'
4. Acta MM. et SS., t. Ill, p. 47!-473. Voici ces noms : Mar Thomas,
Mar Gury , Mar Battala, Mar Georges, Mar Qedhala, Mar Dadba, MarTabha,
Mar Jean, Mar lise, Mar Srapion, Mar Grgoire, Mar Yaho, Mar Iahb,
Simon Je Stylite, Abba Simon de Beit Huzzay, Olog, Mar Jo
saphat Je martyr, Mar Milinos le martyr, Mar Ola, Mar Joseph Busnaya,
Mar Busnaya, Mar Daniel, Mar Gabrona, Mar Isaac, Mar Schzl, Mar Bar
Mar f.labiba, Gula, Moyse, Mar llar !Jadbesabha-yamina, Mar
Silvanus, Mar Titus, Mar Andr, Mar Ubil bar Ba' us, Mar Benjamin, Mar
Schabb, Mar Jean d'Apame, Mar Jean de Nel}al, Mar Jean de Daliata,
lfar Jean l'Arabe, Mar Geor;.;es de Tubam, Mar tienne, Mar Malka, Mar
Isae, Mar Phines, Mar Al}a, Mar Jean le Petit, Mar Jean de Kemula, Mar
Merola, )Jar Mikka, Mar Papa, Rabban Salara, Abba Mika, Mar Qawna,
Qayoma, Mar Abraham, Mar Andr, Ab ba Pola, Mar Ukama, Mar Sa-
lomon, Mar AmOn, Mar Luc, Mar Geniba, Mar Babai Je scribe, Sergius
Doda, Mar Sallita, Mar Abdiso, Mar Jean bar Kaldun, Mar Salo, Mar
Abhun, Mar Jonas; Thcle et Stratonice, surs d' Awgln. Il est superOu
de noter les anachronismes normes qui caractrisent cette liste. Il est
intressant de constater que, si elle ne contient le nom d'aucun des
grands moines orthodoxes des vn et vui sicles, comme Dadisa, Ba-
ha le Grand, Jacques de Beit 'Ab, etc .. , elle mentionne un certain
nombre de monophysites, ou au moins d'abbs fort suspects, tel que
Jean d'Apamc, Jean de Daliata, Sergius Doria et nabai le scribe.
SAL.''H' EUGNE ET LES TRADITIONS LGENDAIRES. 3H
Nous pouvons affirmer de plus qu'elle n'est pas ant-
rieure au x1 sicle, puisqu'on y rencontre, avec le
nom de Busnaya (t 979}, celui de son historiographe
Jean bar Kaldun. Le ms. 12174 contient donc la recen-
sion la plus ancienne, antrieure au x sicle. Timi-
dement, d'abord, puis sans aucune restriction, on a
rattach Eugne la fondation de tous les monastres
de l'Orient. Au moment o bar Kaldun crivait la Vie
de Busnaya
4
, la lgende tait sur le point d'atteindre
son complet dveloppement. Il parle tout uniment des
saints compagnons de Mar Awgn et de Mar Abraham
le Grand
2
, de la congrgation bnie de Beit Mar
Awgn et de Mar Abraham. Un autre problme se pose:
Le ms. 12174 est-il la source du Livre de la Chas-
tet, ou les deux ouvrages sont-ils indpendants? Nous
inclinons croire que le Livre de la Chastet a connu
la Vie d'Eugne. C'est ainsi que nous expliquons
l'existence, dans la liste de Mar Mikhal,
le disciple d'Eugne et l'auteur prtendu de sa Vie,
d'aprs le ms. de Londres
3
Le mtropolitain de ra
a connu aussi d'autres pices hagiographiques du
cycle eugnien, par exemple les Vies d'Y onan et de
Sallita. Nous mettrions volontiers cent ans au moins
d'intervalle entre la recension de la Vie d'Eugne con-
tenue dans la ms. 12174 et la rdaction du Livre de
la Chastet. La recension du ms. de Berlin serait no-
tablement postrieure.
Mais quelle est l'origine historique du cycle eug-
nien ? Le Livre de la Chastet nous permet de r-
soudre ce deuxime problme. La notice n 106 nous
i. Vie de Rabban Joseph Bmnaya, d. CHABOT, p. Hi6-il7, et R. DUV.IL,
Litt. 8yr., p. tii. ,
2. Loc. cit. Il a l'air de les croire contemporains.
3. BEDJAN, Acta MM. et SS., III, p. 376, n. t.
3!2 L'INSTITUTION MONASTIQUE.
apprend qu'un certain Mar Abraham, originaire du
village de Maar
4
, rebtit les ruines du couvent de
saint Eugne et groupa autour de lui une cinquan-
taine d'hommes n. Point de date. Mais le successeur
de cet Abraham nous est connu : c'est Ruzbhan,.le
futur mtropolitain de Nisihe
2
Ce personnage reut
l'habit monastique au petit monastre de Mar Mikhal,
de Mossoul, des mainsd'lsoyahb, suprieur du monas-
tre, neveu par sa mre du catholicos Mar .
Ce renseignement nous fournit les limites approxima-
tives de la carrire monastique de Ruzbhiin au mont
Izla. mourut en 728. Donc Ruzbhan put
entrer vers cette poque au monastre de Mar Awgn.
C'est tort, probablement, que Mare le fait consacrer
vque par !;)libazeka. Ruzhhan fut le bienfaiteur du mo-
nastre, qu'il dota des revenus d'un village voisin
3
Une
fois devenu mtropolitain, il prit soin de faire connatre
son monastre, d'assurer le recrutement des moines et
leur subsistance. Les religieux de Mar Awgn essaim-
rent et emportrent avec eux leur lgende". Thomas de
Marga, leur contemporain, ne la connut pas, ou la
ngligea, mais la gnration suivante l'adopta et Iso-
denaQ. la canonisa dans son Catalogue.
Une dernire question reste rsoudre. Qu'tait ce
monastre de saint Eugne que rebtit le prdces-
seur de Ruzbhan? Nous n'y rpondrons que dans la
mesure o ille faudra pour montrer qu'on n'est nulle-
ment oblig d'inscrire saint Eugne au frontispice de la
liste des moines d'Orient. Du reste, une solution dfi-
nitive devrait se fonder sur une tude topographique
Sur Ma'ar, localit du Tur 'Abdln, cr. HOrFIIAIIII, Awzge, p. nt.
2. Notice' n. t07.
3. Vie d'Eugne, p. 4,74: Hdgan; Livre de la Ch., Hizgan.
4. cr. par exemple notice too.
SAINT EUGNE ET LES TRADITIONS LGENDAIRES. 3i3
et historique du 'fur Abdn, que nous ne pouvons
songer entreprendre ici
1
On pourrait tout d'abord se demander si la recons-
truction du couvent par Ruzbhiin n'est pas tout simple-
ment une fondation. Mais il n'est pas besoin de recourir
cette hypothse hardie. La Vie d'Eugne, dans la re-
cension de Londres, nous fournit des indices qui nous
permettent de conjecturer que le monastre de saint
Eugne avait t primitivement fond par des mono-
physites. Relevons-en quelques-uns. Tout d'abord le
nom de Lazare, un des miraculs, que le prtendu
auteur de la Vie dit tre son pre, est aussi le nom
d'un martyr monophysite trs honor dans le pays de
Nuhadra ~ . Ensuite le ms. de Londres contient une
clausule monophysite et une invocation Marie
" Mre de Dieu
3
>>. Enfin les prtendus compagnons
d'Eugne portent des noms rpandus dans la Syrie
occidentale et plus rares ou mme inusits en Orient :
par exemple, les noms de Guria , de Srapion et de
Thcle. Nous savons par le Livre de la Chastet que
Grgoire tudia desse et vcut Chypre (notice 12).
En revanche Iso'denal,l, qui donne comme fondateurs
de monastres les moines dont les noms se rencon-
trent dans le ms. 12174, est bien empch de nous
apprendre quels couvents ils ont bien pu crer dans
les domaines de l'glise persane.
La partie du 'fur Abdn o se trouvait le fameux
monastre d'Eugne tait occupe par les monophysi-
tes. Le couvent de zafaran leur appartenait srement,
1. HOFF!I.lftN, Amzge, p. t67 et sni v. et surtout p. t7t.
2. BEDJAN, III, p. m. Le ms. est d'ailleurs en entier jacobite.
3. Ce ms. contient l'autographe du fameux patriarche Jacobite Michel
le Syrien. WRIGHT, Catalogue, Il, 808.
Toutefois, dans Thomas de Marga, il est question d'un Guria, sucees
seur de Baba le jeune (Il, pp. 303, MS, M6).
18
314 L'INSTITUTION MONASTIQUE.
et celui de Mar Y o}:tanna probablement, bien que la
lgende du fondateur se rencontre dans le Livre de la
Chastet (notice no 46). Le Grand Monastre des
Nestoriens
4
se trouvait assez loin de l, dans la direction
de la valle. On ne s'tonnera pas, d'ailleurs, que des
Nestoriens aient pu coloniser un monastre fond par
les monophysites et abandonn par eux. A partir du
vm sicle, les domaines des deux confessions s'-
taient cortpntrs. Le Tur Abdn, en particulier, et
ses environs avaient reu des missionnaires nestoriens.
La notice n 32 du Livre de la Chastet nous a conserv
le souvenir d'un de ces propagandistes.
Pour rsumer cette tude, nous conclurons donc
que: 1) saint Eugne peut avoir exist comme fonda-
teur, ou au moins comme titulaire d'un couvent du 'fur
Abdn, probablement monophysite, antrieurement
au vm
6
sicle; 2) ce monastre tait pourvu d'une
lgende monophysite; 3) entre 750 et 800, ce monas-
tre a t roccup par les Nestoriens et dot par
Ruzbihan, mtropolitain de Nisibe; 4) sa lgende, en
se popularisant, a t amplifie, et corrige au point
de vue orthodoxe; 5) la clbrit du monastre et la
.large diffusion de sa lgende furent cause que beau-
coup de couvents de la rgion du Nord, et mme, plus
tard, des provinces mridionales (Anbar, BeitHuzzaye),
voulurent faire remonter leur origine l'apostolat des
disciples d'Eugne; 6o) vers le commencement du x1
sicle, Eugne tait considr universellement comme
le premier introducteur de la vie monastique en Perse.
Ces conclusions, qui pourront tre prcises davan-
tage si l'on dcouvre de nouvelles pices hagiogra-
phiques, nous induisent penser qu'on peut, sans
1. Celui d'Abrabam le Grand. Voir plus bas, p. 3:17,
ABRAHAM LE GRAND. 3i5
inconvnient aucun, rayer le nom d'Eugne des fastes
monastiques primitifs. Nous nous sommes attard
les justifier parce que, si elles sont adoptes, nous au-
rons, pour ainsi dire, dblay l'histoire du monachisme
oriental d'une lgende fort mal documente et trs
difficilement conciliable avec le silence des sources les
plus autorises.
Ainsi donc, les mthodes de l'asctisme gyptien
n'ont pas t introduites brusquement en Perse, vers le
temps de la perscution de Sapor. Aones et ses com-
pagnons que nous fait connattre Sozomne t, ont vcu
dans la Syrie occidentale et ne s'inspiraient pas des
rgles du cnobitisme pacmien. Il faut en dire autant
de Batta, Eusbe, Bargs, Alas, Abbos (?), Lazare,
Abdalaha, Znon et Hliodore le vieillard ou Saba, qui
vivaient la montagne de Siggar. Saint piphane
2
reproche tous ces solitaires de porter les cheveux
longs, la manire des femmes, et de faire une pro-
fession trop exagre de pnitence. Il devait y avoir,
parmi eux, un grand nombre de ces Me!;!alliens
3
dont
la race ne s'est jamais perdue en Orient.
2.- Abraham de Kaikar.- Le grand monastre
Lors de la reconstitution de l'glise de Perse au
concile de Sleucie, il ne fut pas spcialement ques-
tion des moines. La distinction des religieux et du
clerg proprement dit tait encore inconnue ou assez
peu nettement marque. au v sicle. Thodoret, si
t. SOZOIIIIE, Hist. eccl., VI, 33. TlLLEIIONT, Mmoires, VIII, p. ll9i et
sui v.
i. Panarion, LXXX, 6, P. G., XLII, col. 700.
3. TILLEIIOIIT, t. VIII, p. 5!1'7. Sur les v. plus haut, ch. vu,
p. t98; ch. vm, p. it3.
316 L'INSTITUTION MONASTIQUE.
bien inform d'ailleurs, ne connart point d'ermites
persans. La perscution presque continuelle ne favo-
risait gure le dveloppement de la vie religieuse.
Nous savons toutefois, par les Vies de Pethion et de
Saba
4
, le convertisseur de paens, qu'on rencontrait
des ermites au moins dans les rgions montagneuses
situes entre la Mdie et la valle du Tigre. On leur
dut mme la conversion d'une bonne partie des no-
mades qui parcouraient ces rgions
2
Le concile d'Acace
3
, en abolissant le clibat pour
tous les ordres du clerg, ordonna que ceux qui vou-
laient garder la continence se rfugiassent dans des
monastres. Cette prohibition et cette sorte de sus-
picion officiellement jete sur la chastet clricale
devaient atteindre par contre-coup la chastet monasti-
que. Pendant les premires annes du vr sicle, les
moines furent peu nombreux et exercrent une trs
faible influence sur les destines de l'glise si divise
et si dprave. La courageuse raction qu'entreprit
Maraba ne semble pas s'tre tendue jusqu'aux mo
nastres persans.
Heureusement, vers le milieu du vx sicle, un homme
tenta, pour rorganiser la vie monastique, un effort ana-
logue celui du grand patriarche pour rformer l'-
glise officielle. Ce fut Abraham de Kaskar, dit le Grand.
Nous ne possdons plus de Vie dveloppe de ce saint
personnage. Mais la notice de Thomas de Marga nous
en fournit les traits principaux -4. Abraham naquit en
491/2 au pays de Kaskar
5
JI aurait reu le baptme en
i. HoFFMANN, Auszge, p. 6t et suiv.; 68 et suiv.
i. Voir plus haut, ch. v et vt.
3. Concile d'Acace, canon u. Syn. orient., p. SOi.
4. Hist. monastica, 1. 1, cb. tv; t'd. Bonas : The Book of Govertior1,
1. 1, p. fi et sui v. Pour la Rgle qu'il composa, voir cl-dessoua, p. 3it.
li. Il vcut 811 ans d'aprs le LifJf'e de la Cha1tet. Il aerait donc n
ABRAHAM LE GRAND,
~ i 7
502. Il alla tudier l'cole de Nisibe sous la direction
d'un homonyme : Abraham, neveu du grand docteut>
Narss. Aprs avoir consacr quelque temps aux la-
beurs apostoliques dans la rgion de IJira, il se rendit
au dsert de Sct o il tudia longuement les prati-
ques des anachortes. Puis, aprs un sjour au mont
Sina, et sans doute aux Lieux saints, il revinten Orient
et se retira au mont lzla dans le dessein trs arrt d'in-
troduire dans sa patrie les mthodes gyptiennes. Ce
n'est pas, nous l'avons dj dit, qu'il n'y etlt pas d'er-
mites en Perse antrieurement cette poque. Cosmas
lndicopleustes, qui crit vers ce temps, sait qu'il existe
en Perse des moines et des hsychastes t. Toute-
fois, par ses vertus et par la fcondit de ses exemples,
Abraham de Kaskar mrite bien les titres de Grand >>
et de << Pre des moines que lui a dperns la reconnais-
sance de l'glise nestorienne. Quand il mourut, en 586,
le 8 janvier, mardi aprs l'piphanie, l'ge de 95 ans
2
,
il avait group autour de lui une pliade de moines
minents qui propagrent ses mthodes asctiques dans
toutes les provinces persanes. Son couvent devint, si
l'on nous permet l'expression, comme une cole d'appli-
cation o vinrent se former presque tous les asctes du
vue sicle. Comme autrefois, dit Thomas de Marga
3
,
tous ceux qui dsiraient tudier la philosophie profane
des Grecs et s'en rendre matres allaient Athnes, la
cit fameuse des philosophes, ainsi tous ceux qui dsi-
raient s'instruire dans la philosophie spirituelle se ren-
en Wtf!. Mais nous pensons qu'il y a l une erreur de copiste, el nous
nous en tenons l'indication du ms. d"Abdiso'. Voir la note ci-aprs.
t. Top. Christ., P. G., LXXXVIJI, col. 73.
Il. Cette datation prcise se trouve dans un ms. dHAbdiSo apparte-
nantM. l'abb Chabot. On notera le synchronisme qui l'accompagne
(8"' anned'Hormizd,899 des Grecs). Ms., f.32,A(en marge).
3. L. 1, ch. IV; d. BUDGE
1
1
1
p. 23,
18.
3!8 L'INSTITUTION MONASTIQUE.
dirent au saint monastre de Rabban Abraham.
Le Livre de la Chastet
4
donne une liste assez longue
des fils spirituels d'Abraham qui fondrent des monas-
tres. Il nous apprend galement les noms de quelques
autres cnobites contemporains: Abraham de Nethpar
en Adiabne (le mme peut-tre que l'Abraham de
Kaskar qui vcut IJazza)
2
, Job (notice 44), et tienne
(notice 69), le directeur du couvent de Risa
3
, au pays
de Marga, qui, au dire de Thomas
4
, tait fameux et
renomm dans tout l'Orient.
A Abraham succda Dadiso
5
, originaire du Beit
Ariimiiy, d'abord disciple d'tienne, qui s'attacha
par la suite au fondateur du Grand Monastre. Il tait,
semble-t-il, absent du couvent d'lzla lors de la mort
d'Abraham. Peut-tre s'tait-il retir depuis plusieurs
annes dans la montagne d'Adiabne pour y mener la
vie rmitique. On raconte qu'Abraham prdit son
retour et le dsigna comme son successeur. Au
moment o Mar Abraham tait sur le point de quitter
ce monde, rapporte lsodenal_l, ses disciples lui dirent :
0 notre Pre, qui laisses-tu le couvent? Et il
leur rpondit : Dadiso viendra de la montagne
d'Adiabne et prendra la direction du couvent. Ne
vous inquitez point
6
Trois mois aprs la mort du
vieillard, Mar Dadiso arriva et dirigea le couvent
d'une manire prospre. Il s'appliqua, enefTet, avec
succs au maintien de la discipline monastique ; nous
avons les rgles qu'il promulgua; elles ne sont
1. Notice n. 1-l.
!il. BUDGE, t. II,p. 37, n. i.
3. HOFFMANN, .Auszge, D. tiSO. BUDGE, t. II, p. 43, D, i.
4. THOMAS DE MARG.I., 1. 1, Ch. V; d. BUDGE, t. II, p. 48.
5. Cf. Passion de Georges, HOFFMANN, p. tOO. Tu. DE MARGA, J. J ch. V
Livre de la Chastet, notice 38.
6. Livre de la Chastet, loc. cit.
ABRAHAM LE GRAND. 3i9
du reste qu'une revision des rgles primitives d'Abra-
ham. Il se distingua aussi par son zle pour l'ortho-
doxie la plus stricte. Ancien lve de l'cole de Nisibe,
il tait trs inform des questions thologiques. Il lutta
contre les nouvelles tendances qui prvalaient dans la
mtropole intellectuelle du Nord et fit afficher la porte
de son glise conventuelle un anathme solennel contre
les Thopaschites et leur alli I;Ienana le maudit .
Il mourut g de soixante-quinze ans, probablement
entre 615 et 620.
De son successeur, Baba le Grand, nous avons lon-
guement parl ci-dessus
4
, et nous avons essay de
montrer quel fut son rle dans l'glise orientale. Comme
moine, le couvent de Mar Abraham lui dut beaucoup
2
Il traduisit ou commenta les Centuries d'vagrius, et
composa nombre d'ouvrages de thologie asctique.
Mais, dit Thomas de Marga, il tait prcipit dans
son langage et dur dans son commandement
3
)) Ce que
nous savons de son action extrieure nous montre qu'il
tait, en effet, d'un caractre absolu. Son nergie, si
utile au maintien de l'orthodoxie et de la discipline dans
les provinces persanes, se manifestait de faon exces-
sive dans la direction intrieure de son couvent. Ses
frquentes absences permettaient d'ailleurs aux abus
de s'introduire parmi les moines; ensuite ill es rprimait
avec une rigueur excessive, et parfois sans discerne-
ment. Aussi fut-il cause qu'un grand nombre de ses
sujets, et des meilleurs, durent se sparer de lui
4
Le
1. Ch. vnr.
2. TIIOHAS DE MARGA, H1st. monast., L. 1, Ch. VI, VIl et Xl, Xli, Xlii, XIV.
3. Hiat. monast., 1. 1, ch. VII; d. Budge, t. 1, p. 26.
4. Voici les paroles de Thomas (1. 1, ch. XIV, t. 1, p. 3'1 et 38) :
Peu d'annes aprs (la mort de Dadiso') ..... quand survint entre eux
cette perturbation, Rabban Mar Ella et Mar J}enani!!o', le fils de sa
sur, vinrent Ninive, auprs du bni AbbaJean Saba ou l'Ancien, qui
y avait t envoy par Rabban Mar Abraham, et tous les trois btirent ce
320
L'INSTITUTION MONASTIQUE.
plus connu d'entre eux est Jacques, fondateur du cou-
vent de Beit Ab, dans la Haute-Adiabne
1
Entre 610 et 630, les provinces du Nord se peupl-
rent d'ermites et de cnobites. Nous ne pouvons songer
donner une liste complte des fondations de cette
poque, nos deux sources principales, le Livre des
Suprieurs et le Livre de la Chastet, tant trs sobres
d'indications chronologiques. Nous croyons pouvoir
dire qu'au moment de l'invasion musulmane, il y avait
dans l'glise de Perse environ une soixantaine de mo-
nastres, rforms suivant les mthodes d'Abraham le
Ils taient ingalement rpartis entre les di-
verses provinces, le Sud en tant moins pourvu que
le Nord. Le mont Izla et la province contigu de Beit
Zabd, les montagnes d' Arzun, le massif qui domine le
saint monastre. Et, de mme,Abba Benjamin, et Pierre, et Paul, et Jean,
et Adada et Isae vinrent au monastre de Beit Ab. Un autre Abba
Jacques alla auprs d'Abba J}ebisa, Abba Jean Ukbama, et Sebokt
Beit Zabd, Abbaahrowai lArzun o il btit un monastre; Rabban
Sabriso' au monastre d'Ab ba apptr, Abba Jean de Adbarmah Dasen,
et Ab ba ZekalSO . et Rab ban Abraham Dasen. Eux et beaucoup d'autres
btirent des monastres en divers endroits,et ainsi, par la puissance divine
qui tes aida, le dpart et la dispersion qui extrieurement apporta la
souft'rance et le dchirement leurs entrailles tourna, la fin, en paci
firation et en runion. Et ils remplirent le pays d'Orient de monastres,
de couvents et d'habitations de moines .....
La chronique publie par M. Guidi mentionne, pour l'poque qui noua
occupe, outre Baba d'Izla, beaucoup de frres laborieux qui sortirent
de ce monastre; je veux dire Mar Jacques qui fonda le monastre de
neil <Ab, et Mar lias qui btit un monastre sur les bords du Tigre
vers J}esna 'Ebraya, et Mar Ba ba bar bnaye ... et le reste. Chro-
nicon anonymum, p. !ilt.
t. Je doute que la date de fondation de Belt 'Ab soit l :; de
Cbosrau. Il faut plutt lire tt;. cr. BunGE, op. cit., p. xLvn. Si cependant on
admettait la premire date, qui se recommande de l'unanimit des cbro
niqueurs: Iso'zeka, Bar'idta et Thomas, on devrait en conclure que Da-
disa' tait mort vers 1192 au plus tard, puisque l'migration de Jacques
aurait eu lieu en 591lf6.
11. A ct des fondateurs dont nous avons dj parl, il faut citer
pour la gnration suivante, les noms de de Nisibe(qu'il ne faut
pas confondre avec Babai le Grand), de Khudowa, d'lie le Zlote, de
Hormizd le Grand, illustre entre les pl us illustres.
LA RGLE MONASTIQUE. 32i
Tigre la hauteur de Mossoul, les collines du Beit
Nuhadra, les hauts plateaux du Beit Garma, et sur-
tout les districts de Marga et de Dasen, dans la haute
valle du Zab suprieur, furent les centres du mona-
chisme nestorien rform.
S 3. - La rgle monastique.
M. Budgc a, dans son Introduction l'Histoire mo-
nastique de Thomas de Mar ga
1
, trs bien tudi le
genre de vie des disciples d'Abraham. Nous ne pouvons
que renvoyer ce remarquable travail.
La rgle des moines persans n'tait qu'une adapta-
tion syrienne des mthodes du cnobitisme pacmien li.
Il y avait, comme en gypte, deux tages, pour ainsi
dire, dans les pratiques monastiques. On dbutait par
la vie cnobitique, la seule permise aux femmes. Pen-
dant trois ans, il fallait vivre en commun, sous la direc-
tion de l'abb, qui exerait un contrle trs svre et
rprimait avec rigueur les moindres manquements.
Les moines taient vtus avec la plus grande simplicit.
Ils possdaient une tunique, une ceinture, un manteau,
un capuchon pour se protger la tte, des sandales,
une croix et un bton. Leur signe distinctif tait la
tonsure. Les Nestoriens la portaient en forme de croix
pour se distinguer des Jacobites. An dire de Thomas
de Marga, c'est Abraham lui-mme qu'il faut faire
remonter cette innovation.
La prire tait le devoir capital des moines. A l'ori-
1. T. 1, p. CLVII et SUV.
!:1. J.es Rgles d'Abraham et de Dadli\o' ont t publies par M. CHABOT :
Regulae monasticae ab Abraham et Dajesu conitae, Rome, 11198; cf.
R. DuvAL, Litt. syr., p. t80. La rgle d'Abraham est date du mols de
juin 571, celle de D a d i ~ o de janvier 1188.
322
L'INSTITUTION MONASTIQUE.
gine les cnobites priaient sept fois par jour. Mais gra-
duellement l'usage s'introduisit de prier seulement
quatre fois par jour, en commun t.
Les moines se livraient au travail manuel, et ceux
d'entre eux qtii en taient capables au travail de copie
et de transcription des livres. En t, le moine travail-
lait depuis l'aurore jusqu' la grande chaleur, c'est--
dire jusqu' neuf heures du matin. Il lisait ou mditait
jusqu' la sixime heure. Le repas avait lieu ce mo-
ment, suivi de la sieste. Puis, de la neuvime heure
jusqu'au soir, on se remettait au travail. En hiver,
l'horaire tait modifi conformment aux exigences de
la saison. Les dimanches, vigiles et jours de ftes, tout
labeur tait suspendu. La tAche des moines consistait
premirement dans le service intrieur du monastre,
o des officiers spcialement dsigns s'occupaient de
la cuisson des aliments et du pain. En Perse comme en
gypte, les religieux se consacraient l'agriculture,
soit sur les terres du monastre, soit au dehors, par
exemple l'poque de la vendange ou de la moisson.
Il parat qu'ils obtenaient assez aisment la facult
de sortir du couvent avec la permission de l'abb, pour
tudier ou pour prcher : la lutte contre les Jacobites
rendit sans doute ncessaire cet adoucissement aux r-
gles primitives.
Les trois ans de probation accomplis, les moines pou-
vaient, avec l'autorisation du suprieur, se retirer dans la
montagne pour vaquer exclusivement l'oraison et la
contemplation
2
Ils y menaient une vie trs rude, et
quelques-uns poussaient l'austrit jusqu' ses der-
nires limites. Parfois ils s'loignaient pour toujours
t. Cf. la description que donne M. BuocE du monastre de Beit Ab
et de son glise, op. cit., t. 1, p. LX-LXV.
2. Vie de Georgeg : HoFFIU.NN, Auszge, p. t03. Regul. monaat., p .tt.
LA RGLE MONASTIQUE. 323
du monastre dont ils relevaient, et s'en allaient au loin
chercher une solitude plus profonde, dans des lieux o
ils taient inconnus. Bientt se groupaient autour d'eux
quelques disciples avides de recevoir leurs enseigne-
ments et de profiter de leurs exemples. Peu peu, leur
renomme s'tendait, et leur cellule devenait un lieu de
plerinage. Les pieux voyageurs sollicitaient des bn-
dictions et des gurisons miraculeuses. Ils s'en retour-
naient consols, difis, souvent guris, et remportaient
des dserts sacrs, comme de la tombe des martyrs,
des flenana qui tiraient de la bndiction des Pres une
double efficacit
1
Comme tmoignage de leur dification et de leur
reconnaissance, les visiteurs faisaient aux monastres
des dons prcieux. Sam ta, fils de Yazdn, donna au fon-
dateur de Beit Ab des livres liturgiques qu'il avait
soustraits au pillage d'desse
2
On fut amen faire
aux couvents des donations territoriales plus ou moins
considrables. Il semble que, dans les monastres de
stricte observance comme Beit Ab, au temps de Jac-
ques, son premier suprieur, il n'y et pas de proprit
foncire individuelle ou collective
3
Cependant les ca-
n o n s ~ prescrivent qu'un patron ne pourra fonder d'-
glise ou de couvent sans y annexer des revenus suffi-
sants. Du reste, la proprit monastique demeura
oujours sous le contrle immdiat des autorits eccl-
siastiques 5.
t. BUDGE, op. cit., Il, p. 600, n. t. B. 0., IV, p. 278; MAI, Scriptorum
tJeterum notJa collectio, t. V, p. 21. Le [lenana tait une mixture de
poussire ramasse au:r tombeaux des martyrs ou aux Lieux Saints,
puis dlaye dans de l'huile. Les Syriens attribuaient cette sorte de
relique une vertu curative.
2. TnOMAS DE MARGA, Hist. monast., 1. 1, ch. XXXII; d. Budge, t. II,
p. 81, 82.
3. 8UDGE, op. cil., t. 1, p. LXV.
4. Syn. orient., p. 386 et 408.
1>. Syn. orient., 303, 363, 'l83. Le contrle pouvait, d'ailleurs, tre r
L'INSTITUTION MONASTIQUE.
Cette soumission absolue l'piscopat est un des
traits caractristiques du monachisme oriental. Elle
pennit l'institution monastique de porter tous ses
fruits sans jamais entraver l'action plus rgulire du
clerg officiel. Aussi l'glise nestorienne, comme sa
rivale l'glise monophysite, doit-elle aux moines d'avoir
pu si longtemps rsister aux assauts de l'Islam. Les
contres mridionales de l'empiPe perse, assez pauvres
en couvents, passrent bientt l'ennemi. Dans le Nord,
au contraire, et spcialement dans l'Adiabne, le chris-
tianisme lutta longtemps avec succs. L'action des
moines fut aussi des plus efficaces pour le maintien de
la dogmatique orthodoxe ; nous ne pensons pas que
l'glise nestorienne aurait pu survivre l'invasion mo-
nophysite, et l'hrsie l ~ e n a n i e n n e , sans l'appoint
des successeurs d'Abraham le Grand et de leurs dis-
ciples.
serv au patriarche dans certains cas. Pour l'poque qui nous occupe,
nous ne connaissons que deux cas d'exemption : celui des moines de
Bar Qaiti cr par Sabriso' (Syn. orient., p. 469), et celui de Beit 'A.b
cr par lso'yabb 11 (BuooE, t. 11, p. it, n. !1).
CHAPITRE XII
LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE
Les conciles grecs formrent le noyau de la lgis-
lation de l'glise persane
1
telle qu'elle fut reconstitue
en 410. C'taient ceux d'Ancyre, de Nocsare, de
Nice, de Gangres, d'Antioche, de Laodice, de Cons-
tantinople
2
Mais, comme le remarque avec justesse M. l'abb
Chabot
3
, la discipline rgle par les premiers conciles
grecs devint bientt impraticable et tomba peu peu
en dsutude. Elle fut remplace ou modifie par d'au-
tres dcisions que les archevques de Sleucie, aprs
avoir pris le titre de cc patriarches de l'Orient , port-
rent en diffrentes circonstances dans des synodes tenus
avec le concours des vques soumis leur juridic-
tion . La prsente tude ne tiendra corn pte que de
cette collection canonique, propre l'glise de Perse.
Comme le texte et la traduction viennent d'en tre
donns au public, nous nous bornerons noter les
points les plus caractristiques du droit nestorien, ren-
voyant pour le reste l'excellente publication de
1. Sur les collections canoniques de l'glise nestorienne, cf. CHABOT,
Syn. orient., Appendice, p. 609.
i. Abdil!o' de Nlsibe ajoute aux conciles susnomms le synode de
Chalcdoine. Il est possible que Maraba en ait fait usage, mais nous
Ignorons s'il l'incorpora dans la collection des conciles admis avant lui,
Voir ci-dessus ch. vu, p. t87, n. !!.
3. Introduction au Synodicon, p. !!.
LE CHRlSTlANlSliE. 19
326 LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
M. Chabot
1
Pour plus de clart nous adopterons la
division en trois parties, classique parmi les canonis-
tes : les personnes, les choses, les jugements.
t. - La hirarchie.
L's-lise de Perse tait aussi fortement hirarchise
que byzantine sa voisine. Nous avons dit plus
haut
2
comment Isaac et Maruta avaient partag le pays
soumis aux Sassanides en provinces ecclsiastiques
subdivises chacune en un certain nombre d'vchs.
Les provinces ecclsiastiques correspondaient aux
grandes divisions territoriales, les circonscriptions
piscopales aux districts et judiciaires.
Sans compter le diocse patriarcal, les mtropoles
taient, en 410, au nombre de cinq : Beit Lapat, Ni-
sibe, Prat, Arbel, Karka de Beit Slokh, prsidant
aux provinces de Beit Huzzaye, de Beit Arbaye, de
Maisan, d'Adiabne et de Beit Garma
3
Dans la se-
conde moiti du vi" sicle, la liste du synode de Joseph
4
comprend deux autres mtropoles : celle de Rew Ar-
dasir (Perse propre) et de Merw (Khorasan)
Quant au nombre des diocses, nous ne pouvons le
connatre qu'approximativement. La liste d'Isaac n'est
complte que pour les vchs groups sous la juridic-
tion d'un mtropolitain
6
Les siges qui se trouvaient
dans les provinces plus loignes, comme la Perse
1. J.-B. C1unoT, Synodicon orientale, ou Recueil de synodes nesto-
riens. Paris, 1903.
2. Ch, IV.
3. Concile d'Isaac, canon xx1. Syn. orient., p. 272.
Syn. orient., p. 366.
:>. Syn. orient., p. !iSS. La premire apparait ds le synode de Dadii\o
(i24).
6. v. Syn. orient., p. 616.
LA HIRARCHIE. 327
propre, les iles du golfe Persique et le Khorasan, ne
sont pas numrs en dtail. On peut penser aussi
qu'il a exist plsieurs vchs dont les titulaires
n'ont jamais paru aux synodes gnraux et cela est
certainement vrai des vques de l'Inde, de l'ile So-
cotora
1
et de la Bactriane. Enfin les circonscriptions
diocsaines ont t souvent remanies soit cause
de l'augmentation du nombre des chrtiens, soit par
suite de dissensions intestines
2
Ces rserves faites,
le Synodicon nous fournit les noms d'environ quatre-
vingts vchs dont une vingtaine n'apparaissent qu'au
vi" sicle et se trouvent, pour la plupart, dans la direc-
tion du lac d'Ourmiah, de la mer Caspienne et du To-
charestan, rgions o, sous l'impulsion de Maraba
3
, le
nombre des fidles s'accrut dans des proportions con-
sidrables. On ne doit pas tre loin de la vrit en
disant que les siges piscopaux rpartis entre la cir-
conscription patriarcale et les sept parchies provin-
ciales devait tre, en 630, au nombre d'une centaine.
Le premier de tous ces diocses, par ordre. de di-
gnit, sinon d'anciennet, tait le sige patriarcal
tabli dans la grande glise de Kk, dans les Villes
Royales de Sleucie-Ctsiphon . Son chef tait le chef
suprme de toute l'glise chrtienne constitue dans la
rgion orientale
4
.
Il porta d'abord le titre d'archevque (c'est ainsi
que Sozomne qualifie saint Simon)
5
, puis de grand
mtropolitain
6
A partir de Dadiso, l'vque de Sleu-
1. Attests par Cosmas Indicopleustes. Voir ch. vn.
2. .Par exemple Syn. orient., p. 342 et suiv.
3. cr. ch. vn.
4. Canon xxi d'Isaac, op. cit., p. 212.
Nous avons montr, dans notre premire partie, combien cette su
prmatie fut discute.
Il. Ri&t. eccl., vn, 9.
6. Syn. orient., p. 263.
328 LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
cie se nomme presque exclusivement catholicos, pour
marquer son indpendance absolue de toute juridic-
tion trangre. A dater de 424, le chef de l'glise
de Perse rpudie toute intervention du dehors; on sait
par quel subterfuge Dadiso et ses partisans mi-
rent dans la bouche des << Pres occidentaux eux-
mmes la renonciation au droit de contrle et de sur-
veillance qu'ils avaient exerc jusque-l
1
Pour rendre
dsormais impossible tout recours tribunaux du
dehors, Dadiso prend le titre de patriarche
2
et se pro-
clame ainsi l'gal des vques de Rome, d'Alexandrie
et d'Antioche.
Il est le reprsentant immdiat et le vicaire de
Jsus-Christ, le seul qui jouisse de la paternit spi-
rituelle
3
, c'est--dire qui soit le principe et la source
cre toute juridition, le seul << conome fidle, qui est
le chef, le directeur et le procureur de ses frres , en
vertu du sacerdoce suprme qu'il a reu, comme
Pierre, le chef des aptres . En consquence de cette
primaut, tous doivent excuter ses dcisions. Son
nom doit tre proclam dans toutes les glises.
<< Puisque le nom de patriarche est interprt pre de
la principaut, que sous lui sont toutes les autorits
ecclsiastiques et qu'elles reoivent de lui le pouvoir
et l'autorit pour rgir et gouverner, il convient que
son nom soit proclam dans les proclamations de l'of-
fice, dans toutes les glises du territoire de. ce royaume
sublime et glorieux de notre matre le victorieux Chos-
rau, Roi des Rois , crit Lui seul peut, dans
des cas dtermins, exercer une juridiction ordinaire
1. Voir ci-dessus, ch. n.
11. Syn. orient., p. 1!96.
3. Syn. orient., p. 1!911.
4. zcmEr., canon xrv; Syn. orient., p. 380.
LA HIRARCHIE.
329
dans un diocse autre que le sien, et dlguer ce pou-
voir aux mtropolitains et aux vques f. Ce canon
abrogeait sans doute la dcision du synode de Joseph
2
qui interdisait tous les vques et mme au pa-
triarche d'ordonner des prtres pour un diocse tran-
ger. Cette limitation des prrogatives patriarcales
tait probablement une disposition particulire et tran-
sitoire prise en vue de rfrner la fougue de l'imp-
rieux catholicos
3
On peut dire la mme chose du
canon vn du ll}me c o n c i l e ~ qui prescrit au patriarche
de faire tout ce qu'il fait avec le conseil de la com-
munaut... Si l'urgence de l'affaire ne donne pas le
temps de runir les vques ... que rien ne soit fait
dans ces cas d'urgence, sans la prsence d'au moins
trois vques . Quoi qu'il en soit de ce pqint de droit,
le catholicos devait prendre les avis des vques de
l'parchie patriarcale, qui, dans les synodes, sigeaient
aprs les mtropolitains et avant tous les autres
vques.
L'vque de Kaskar, la principale cit dpendante
de la grande mtropole, peut-tre le plus ancien
centre chrtien de la Chalde, est qualifi par le synode
d'Isaac
5
, de fils de la droite et fils du ministre
du catholicos, et charg d'administrer le diocse pa-
triarcal sede vacante. Cette disposition est renouve
le dans le synode de Joseph (c. xx1). L'vque de
Kaskar doit aussi convoquer le collge lectoral qui
nommera le patriarche. cc Quand celui qui est patriar-
che meurt, que celui qui est confi l'piscopat de
Kaskar vienne sans retard, ds qu'il l'apprend ou
t. ZCHIEL, canon XXII; Syn. orient., p. 383.
!li. Syn. orient., p. 35S et 356.
3. ,Voir ch. vn, p. 193.
-l. Syn. orient., p. 359.
5. Syn. orient., p. 27i!.
330 LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
qu'on le lui fait savoir par lettre, aux Villes Royales
de Sleucie .et Ctsiphon, et qu'avec la diligence qui
lui incombe plus qu' tous ses frres les vques
de la province patriarcale, comme tant le second
et l'assistant du trne patriarcal, il adresse des let-
tres aux mtropolitains et aux vques ses frres,
pour les inviter venir, afin que par eux se fassent
l'lection et l'ordination de la personne qui sera
choisie pour le patriarcat l.
La prompte lection d'un catholicos importait souve
rainement au bien de la chrtient. C'tait assez que
le mauvais vouloir des rois et des grands officiers
retardt souvent le choix du patriarche. Il fallait du
moins que, dans les rangs du clerg, personne n'y mt
obstacle, et que, par sa publicit et sa solennit, l'-
lection ft place au-dessus de toute contestation.
Si, en effet, le choix des vques n'tait pas agr
de leurs collgues, le nouveau patriarche se voyait
disputer le rang suprme par des comptiteurs am-
bitieux, toujours srs de trouver un appui la cour
ou parmi les notables chrtiens, et de pouvoir rveiller
la jalousie, peine assoupie, des grandes mtropoles
rivales de celle de Sleucie. Aprs avoir fait la triste
exprience des maux que peut engendrer un schisme
prolong, les vques persans rsolurent de les pr-
venir, et Maraba, la suite de son concile, rgla les
conditions de l'lection du patriarche.
Il dcrte, dans sa lettre vi ', qu'aprs sa mort les
vques de la grande parchie devront envoyer cher-
cher le mtropolitain de Beit La pat... et celui de
Prat de Maisan, et celui d'Arbel et celui de Beit
Slokh. Ils viendront aux Villes, tous les quatre ou au
i. Syn. oraent., p. 365.
2. Syn. orient., p. :;:a.
LA HIERAHCHIE. 331
moins trois d'entre eux, avec chacun trois vques de
chacune des provinces numres , et, aprs avoir
choisi un candidat recommandable, ils l'ordonneront
dans l'glise de Kok, selon la tradition des saints
Pres, et l'installeront sur le sige catholique . Peu
de temps aprs, Joseph (c. x1v)
1
dclare qu'il << con-
vient que tous les mtropolitains participent l'-
lection, soit par crit, soit par l'imposition des mains .
Si les circonstances ne sont pas favorables, que le
clerg et les fidles de Sleucie et de Ctsiphon li-
sent un chef, avec les vques de la province de ce
sige, du consentement de deux mtropolitains .
Iso'yahb 1 reprend et prcise. ces dispositions; il
indique de plus que l'lection sera faite en assem-
ble gnrale des prtres et des fidles des villes
de Mal}.oz, en prsence des vques de la grande
province . Le droit du clerg et des notables
de Ctsiphon de choisir leur vque est donc sanc-
tionn; il semble mme que le personnage dsign
par leur suffrage devait tre simplement prsent aux
mtropolitains pour en recevoir la conscration.
Le mtropolitain est, en quelque sorte, le dlgu r-
gional du catholicos, qui le nomme ou, du moins, con-
sent sa nomination. Il doit
2
crire au grand mtro-
politain et l'avertir. de tout ce qui arrive parmi les
vques... placs sous sa juridiction . Il peut inter-
venir dans les contestations qui surviennent entre les
vques, entre un prtre ou un diacre et son vque,
et reprendre ses collgues qui n'observeraient pas
fidlement les saints canons
3
Mais, pour les causes
plus graves, il doit en rfrer au patriarche.Car il ne
i. Syn. orient., Jl 36i.
2. Syn. orient. (IIIo'YAun, canon xx1x), p. 420.
3. Syn. orient. (\SAAC, c. XVIII), Jl 270.
332 LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
possde pas, comme lui, la juridiction ordinaire dans
toute l'tendue de sa province. Il ne peut rien exiger
par contrainte
1
, et sa primaut est surtout une pri-
maut d'honneur. Dans un seul cas, lorsqu'un vque
de son parchie est mort, le mtropolitain administre
provisoirement le diocse du dfunt. Il doit, du reste,
runir dans un dlai de quatre mois ses collgues de
la province pour faire cesser la vacance, consacrer
l'lu choisi par le peuple, et le dpcher au catholicos
pour la u perfectionnement . L'vque,
en effet, ne peut tre cr par un seul de ses collgues,
pas mme par le mtropolitain ou par son prdcesseur
mourant, ni par deux vques seulement. A moins que
le catholicos ne fasse lui-mme la nomination, la pr-
sence de trois ou de cinq vques est exigible. De plus,
il faut que le patriarche ou le mtropolitain assistent
la conscration, ou y soient reprsents par des
qu'ils enverront cet effet, et qui, pendant la
crmonie, seront places au milieu , l'endroit
qu'aurait occup leur auteur
3
Il ne doit y avoir qu'un seul vque dans chaque
ville
4
, et, une fois nomm, il ne peut, de lui-mme,
quitter son glise pour une autre, ni, plus forte raison,
ravir un collgue le sige que celui-ci possdait. Il
n'a aucune juridiction en dehors .:les limites de son
diocse et ne peut validement ordonner des prtres
pour les districts voisins. Ces rgles ne souffrent
aucune exception. Dans le cas de schisme, s'il y a
pour une mme ville deux prlats galement recom-
mandables, l'un d'eux seulement pourrait remplir les
i. Syn. orient., p. !i71.
2. Syn. orient., p. !158.
3. ZCHIEL, c. XIx, Syn. orient., p. 38i.
Syn. orient., p. !158.
LA. HIRARCHIE. 333
fonctions piscopales. L'autre conserverait sa dignit,
avec promesse de succder son collgue
1
L'vque est matre absolu dans les limites de son
diocse. Les biens ecclsiastiques et les proprits
des monastres relvent de lui. S'il lui est recom-
mand de ne pas en assumer personnellement l'admi-
nistration, il doit toutefois la surveiller et la diriger
2
On aura remarqu la prcision avec laquelle sont
dtermins les rapports mutuels du patriarche, du m-
tropolitain et de l'vque. L'glise nestorienne a d sa
persistance et son clat cette solide organisation hi-
rarchique. Elle y mettait le sceau par une pratique
qui lui est particulire. Quand l'vque ou le mtropo-
litain avaient t consacrs, ils devaient aller promp-
tement vnrer et visiter le patriarche pour tre
confirms par lui3 >>. C'est ce qu'on appelait le perfec-
tionnement , ou la confirmation . Le nouvel lu,
muni de ses lettres d'ordination, se prsentait Sleu-
cie, prenait rang parmi les simples clercs, et le catho-
licos rptait sur lui quelques parties de la crmonie
conscratoire ~ , pour bien marquer que toute juri-
diction procdait de sa suprme et unique cc paternit
spirituelle >>.
Cette autorit absolue tait limite, thoriquement du
moins, par les synodes. En conformit avec le canon v
de Nice, Isaac avait dcid <<que, tous les deux ans une
fois, tandis que le roi est Sleucie et Ctsiphon
5
,
c'est--dire en hiver, le patriarche convoquerait ses
collgues pour leur communiquer ses dcisions. Baba
6
i. Syn. orient., p. 34:1.
i. Syn. orient., p. 38.\ et sui v.
a. Syn. orient., p. 38i.
" AsSEIIIANI, B. 0., IV, p. 702.
a. Syn. orient., p. !iflt.
6. Syn. orient., p. 3t3.
Hl.
33ft LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
modifia cette loi qui tait sans doute tombe en dsu-
tude, et stipula que la runion gnrale aurait lieu
tous les quatre ans seulement au mois de Tesri 1
(octobre), qui tait l'poque du retour du roi en Chal-
de. zchiel reporta le concile un peu plus tard,
avant le grand jene ,, l. Tous les vques taient,
sous les peines les plus svres, tenus de rpondre
la convocation du catholicos. En cas d'empchement,
ils devaient se faire reprsenter et donner leur repr-
sentant mandat de souscrire aux dcisions du concile.
Chaque mtropolitain d'abord, et plus tard chaque
vque, dut possder chez lui un exemplaire des dfini-
tions canoniques. De plus, toutes les fois que, dans l'in-
tervalle des sessions rglementaires, le catholicos ju-
geait devoir, en raison des circonstances, runir un
synode gnral, ceux qu'il convoquait avaient l'obli-
gation de s'y rendre
2
Pour assurer l'observation des rsolutions prises en
assemble gnrale, le mtropolitain runissait deux
fois par an les vques de sa province
3
Cette runion
avait surtout pour objet de rgler les litiges entre v-
ques. zchiel statua que le synode provincial se tien:..
drait dans la ville mtropolitaine une fois par an seu-
lement, en septembre
4
L'assistance ce synode tait
obligatoire. L'vque qui ddaignait d'y assister, ou
qui se retirait avant la clture de la session, ou bien
qui, tant lgitimement empch, ngligeait d'envoyer
son adhsion, tait blm par le synde, parfois mme
interdit et dpos par le mtropolitain et ses collgues.
Dans l'administration de son diocse, l'vque tait
i. Syn. orient. (c. xv), p. 380.
2. Syn. orient., p. 313.
3. Ibid.
4. Syn. orient., p. 381.
LA HIRARCHIE. 335
assist d'un chorvque qui dirigeait les paroisses ru ..
raies. Le concile d'Isaac statue qu'il n'y aura, par dio-
cse, qu'un seul chorvque. A l'poque que nous
tudions, il y avait, au-dessous du chorvque, et
distinct de lui, un ou plusieurs visiteurs ou prio-
deutes
1
Plus tard, au tmoignage d"Abdiso', les p-
riodeutes prirent la place des chorvques. Mais, la
fin du v1e sicle, les deux fonctions existaient spar-
ment et sont mentionnes dans leur ordre hirarchique
par le canon xxix d'Iso 'yahb 1
2
Certains vchs avaient
un territoire trs tendu, et, sans doute, comprenaient
un grand nombre de paroisses rurales et de monastres
loigns des centres populeux. Plusieurs visiteurs
y taient donc ncessaires.
Au-dessus du clerg rural se plaait le clerg ur-
bain, l'entourage immdiat de l'vque. L'archidiacre
en tait le personnage principal. En vertu de sa charge,
il devait << prendre soin des pauvres, s'occuper des
trangers, rgler et diriger toutes choses convenable-
ment dans le ministre de l'glise
3
A lui de disposer
dans l'glise les exorcistes et les lecteurs, de distribuer
les semaines << aux prtres, aux diacres, aux sous-
diacres, pour qu'ils confrent le baptme, qu'ils servent
l'autel, qu'ils veillent sur le temple et son ornemen-
tation . A lui de connatre des diffrends qui peuvent
s'lever entre les ministres infrieurs, entre les lacs et
les ecclsiastiques. Il tait, en un mot, << le bras et la
langue de l'vque .
Les prtres et les diacres devaient remplir avec zle
les fonctions liturgiques et vaquer aux devoirs de leur
ministre, en particulier recevoir avec bont les p-
1. Syn. orient., p. !167, n. 2.
2. Syn. orient., p. uo.
3. Syn. orient., p. !!67 et 4H.
336 LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PEHSE.
nitents et les instruire . Les prtres n'taient jamais
ordonns avant l'Age de trente ans, et la crmonie de
l'ordination avait lieu dans l'glise, l'exclusion des
endroits profanes
2
Les canons exigeaient du clerg infrieur une grande
dignit de vie. La frquentation des auberges leur tait
interdite, et aussi la participation aux banquets fun-
bres. On leur recommande de ne point se mler aux
affaires des sculiers, de ne pas prter intrt et de
ne pas accepter d'tre intendants, procureurs ou avo-
cats. Le canon xv1 d'Isaac
3
dclare qu'on n'admettra
pas au diaconat et au sacerdoce des jeunes gens qui
ignorent la doctrine des critures )). Celui qui est in-
capable de rciter les psaumes de David par cur << ne
peut mme pas devenir sous-diacre )) .
A la suite du concile d'Acace, tous les clercs, avant
de recevoir l'ordination du diaconat, durent se marier -t.
Cette rgle, nous l'avons dit, s'tendait jusqu'aux v-
ques et aux patriarches. Peu peu, elle tomba en d-
sutude pour les hauts dignitaires de l'glise dont
la plupart avaient embrass la profession monastique.
Mais elle se maintint pour les clercs infrieurs. Acace
voulut mme que les prtres et les diacres pussent
convoler en secondes noces. En revanche, il punit trs
svrement l'adultre et la fornication. On dcida plus
tard que les clercs n'auraient pas le droit d'pouser
des paennes ni des femmes rpudies. L'alliance,
certains degrs d'affinit ou de consanguinit, permise
aux simples fidles, leur tait rigoureusement inter-
dite.
i. Syn. orient., p. 434.
!!. Syn. orient., p. 430.
3. Syn. orient., p. !169.
4. Syn. orient., p. 303.
LA HIRARCHIE. 337
Au-dessous des prtres et des diacres, l'glise
orientale connaissait les sous-diacres appels exor-
cistes au temps d'Isaac
1
, qui l'emplissaient aussi les
fonctions de portiers, et les lecteurs. Les sanctifis
dont parle le canon vm d'Isaac
2
taient sans doute des
lacs plus assidus aux offices de l'glise, et, comme
nous dirions aujourd'hui, des membres de confrries,
analogues peut-tre aux des glises de 1'()..
rient romain.
Les biens ecclsiastiques taient, nous l'avons vu,
placs sous le contrle de l'vque. Ils n'taient pas di-
rectement administrs par lui, mais par des conomes,
ordinairement lacs. Ainsi les biens personnels de l'v-
que et des clercs taient nettement distingus des pro-
prits de l'glise dont les titres taient renferms dans
des archives spciales. Les conomes taient choisis
par l'vque parmi les notables de la ville, et il pou-
vait les rvoquer. Mais, le sige vacant, ces notables
devenaient administrateurs suprmes jusqu' la nomi-
nation d'un nouvel vque. Aussi la fonction de l'co-
nome tait-elle trs honore. Pour lui faire mieux
apprcier l'tendue et la gravit de ses responsabilits,
Isaac avait prescrit une crmonie spciale (c. xv).
<< Les clefs de l'conomat, dit-il, seront places sur
l'autel, et celui qui deviendra conome les prendra sur
l'autel; quand il abandonnera l'conomat ou quand
l'vque voudra qu'il le quitte, il ira placer les clefs
sur l'autel, comme mritant de recevoir sa rtribution,
bonne ou mauvaise, du saint autel
3
. Les biens relevant de la mense piscopale taient
souvent trs considrables. Une cathdrale nestorienne
1. Syn. orient., p. 264, !i!6'7.
2. Syn. orient., p. 26ti.
3, Syn. orient., p. 268.
338 LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
tait toujours entoure d'coles, de bibliothques et
d'hpitaux. De plus, sauf de trs rares exceptions, les
monastres ressortissaient l'ordinaire du lieu, qui
devait veiller ce qu'ils fussent convenablement ren-
ts
1
Les fonds ncessaires l'entretien de ces pieux
instituts provenaient en partie de sources rgulires :
collectes la clbration de la liturgie, dmes et pr-
mices, mais aussi et surtout de la gnrosit prive :
fondations, offrandes ou legs.
Le lgislateur s'employait protger ces donations
contre la rapacit des hritiers et l'indlicatesse des
i. Les moines, d'aprs le concile d' Acace (p. 301), ne peuvent pas s'tablir
dans les villes ou dans les environs des villes. Mais, au synode de Joseph
(p. 364), quelques vques Orent observer que cette pense tait con
traire au christianisme et que les paens et les Juifs se rjouissaient
de ce que la chrtient ne se dveloppait pas et que la louange de Dieu
ne s'accroissait pas Le patriarche permit donc et encouragea la con-
struction d'gliselil, de monastres, de temples et de martyria dans les
villes et leurs environs, mais la condition qu
1
on n'y administrerait
point ordinairement le baptme et qu'on n'y clbrerait pas les saints
mystres. ISo'yahb 1 (c. IX, p. 407)veut mme que les Odles ne s'y rendent
pas led imanche pour y faire leurs offrandes, mais seulement en semaine.
L'vque, nous l'avons dit, est le chef suprme des monastres. Il y
exerce sa juridiction ordinaire. Il surveille la gestion de leurs biens,
preside l'entretien des btiments et leur restauration, pourvoit, en
un mot, tous leurs besoins. Il fait excuter les canons concernant la
residence laquelle sont tenus les moines. La gyrovagie tait rigouren
se ment interdite. Que ceux qui ont revtu l'habit religieux, dit le canon
vm d'H!o'yahb(p. 406), et veulent vivrechastementetpauvrement aient une
habitation spciale dans la demeure de leurs parents, ou avec les clercs
dans l'glise, ou ave'c les moines dans un monastre. Si l'amour de la
doctrine les porte aller l o on trouve une meilleure instruction des
Uvres saints, qu'ils se munissent de lettres pacifiques de l'vque de
leur pays ... , qu'ils soient soumis ou, comme clercs, au chef des clercs
ou, comme disciples, au chef des disciples, ou qu'ils vivent d'un mtier
respectable ou d'un travail honorable.
Pour les femmes, les rglements sont encore plus svres. Elles ne
peuvent pas habiter Isolment (p. 407) soit dans un monastre, soit
dans une cellule. " S'il est possible, qu'il n'y ait aucun couvent de fem-
mes; s'il y en a ou si l'on en fonde, elles habiteront plusieurs ensemble
dans un m!me monastre, c'est--dire au moins quatre ou cinq. Ces
monastres doivent tre soigneusement clos; l'accs en est svrement
interdit aux hommes.
.... -
LES SACREMENTS. 339
personnes attaches au service de l'glise. lSo'yahb 1
dota le code ecclsiastique de minutieuses prescrip-
tions sur ce chapitre . Le mme patriarche blme et
raille les fidles qui, au lieu de contribuer l'entretien
de leur glise paroissiale ou des monastres voisins.
allaient au loin porter leurs aumnes quelque cou-
vent renomm. Ils prennent leur argent, et, comme
au son de la trompette, ils le montrent la face du so-
leil et de la lune
2
Ils circulent de ct et d'autre,
comme des gens qui ont perdu leur Dieu, ne sachant
o ils le trouveront ni o il les coutera ... Ce sont des
malades qui ont besoin de la sant ... Ils ne craignent
pas de dsobir formellement leurs suprieurs lgi-
times. Ils sont ainsi acphales et autocphales , et
comparables au cancer qui n'a pas de tte a.
S 2. - Les sacrements.
Il serait intressant d'exposer les prescriptions du
droit canonique touchant l'administration des sacre-
ments. La collection des synodes nestoriens ne contient
gure malheureusement, pour l'administration du bap-
tme et de 1' eucharistie, que des rgles liturgiques que
notre plan ne nous permet pas d'tudier. Pour la p-
nitence, nous ne possdons que des renseignements .
assez sommaires. Ils nous invitent distinguer trois
sortes de pnitences : la pnitence canonique, la pni-
tence prive, la pnitence monastique.
La pnitence canonique proprement dite est impose
pour des manquements publics aux lois ecclsiastiques.
t. Syn. orient., p. 404 et sui v
2. Syn. orient., p. 409.
a. Syn. o1ient., p. 4V ..
.. ~ - -
3i-O LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
Nous en connaissons deux exemples. Le premier est
tir du concile de Maraba
1
Il s'agit des fidles scu-
liers qui ont pous la femme de leur frre. On les
engage s'en sparer. S'il leur est difficile, s'ils ne
peuvent laisser leur femme .... nous dcidons qu'ils
jeneront tous les deux- je veux dire celui qui a pris
la femme de son frre et celle qui s'est unie son beau-
frre - pendant un an, galement; ils prieront et
supplieront Dieu cause de leurs fautes, et, comme
rachat de leur pch, ils donneront aux pauvres et
aux malheureux de l'glise de leur ville ou de leur vil-
lage une partie convenable, selon leur position, de
l'hritage qu'ils possdent, et on leur donnera l'absolu-
tion. L'autre exemple se rencontre dans le canon 1
d'zchiel qui traite de la rconciliation des M e ~ a l
liens
3
On impose aux prtres hrtiques une anne
de pnitence pour la rception des saints mys-
tres et la communion avec les fidles. Pour les moines
et les clercs infrieurs, ainsi que les simples lacs, qu'on
leur impose une pnitence de six mois et qu'ils parti-
cipent ensuite [aux sacrements] avec les fidles.
La pnitence prive est d'un tout autre caractre.
Elle a trait non pl us aux irrgularits extrieures, mais
aux pchs secrets. Isoyahbi, dans son canon vi adress
Jean, vque de Dara
3
, traite longuement de celui
qui a pch secrtement et se repent en secret, mais
craint de se dvoiler de peur d'tre dcouvert et d'avoir
souffrir la violence et le mpris des cruels et des mo-
queurs, et ne pourra-t-il, de quelque manire, se corri-
ger, trouver sa gurison et viter de prir . Mais,
quelque important que soit ce texte, il est unique, et,
l. Syn. orient., p. 337.
2. Syn. orient., p. 375.
3. Syn. orient., p. 433.
LES SACREMENTS.
par consquent, il est ditncile d'en extraire une thorie
parfaitement solide de la pnitence prive (sacramen-
telle) chez les Nestoriens. Si nous l'avons bien compris,
le problme se pose ainsi : il faut se repentir de ses
pchs pour en obtenir le pardon. Le moyen le plus
simple est d'aller les rvler au prtre et d'en obtenir
l'absoluiion. Cependant, ce moyen n'est pas la porte
de tous, parce que beaucoup de prtres sont sans pres-
tige, sans science, sans misricorde, et que plusieurs ne
savent pas garder les secrets qui leur ont t ainsi
confis. Isoyahb fait observer aux fidles qu'il ne faut
pas se laisser dtourner de la pnitence par des consid-
rations de cette nature.<< Si le pcheur, dit-il, craint de
manifester ses souillures, parce qu'on ne trouve pas par-
tout des prtres justes et prudents, que ce pcheur
prenne la peine d'aller l o sont des prtres prudents
et misricordieux. Il ajoute, d'ailleurs, qu'on peut ob-
tenir le pardon de Dieu, sans l'intermdiaire des prtres.
Nous en connaissons d'autres qui, seuls en prsence
de Dieu, ont trs laborieusement et patiemment guri
leurs blessures, parce qu'ils n'avaient confiance en per-
sonne. Tmoin ce bienheureux vque, qui, contraint
par la violence, apostasia et sacrifia aux idoles; s'tant
ensuite chapp, il cracha la face du monde et il s'en
loigna totalement; il demeura en un certain lieu sans
voir personne ni tre vu de personne, pendant trente-
sept ans. Il lui fut dit dans une rvlation : Mainte-
nant, ta pnitence a t accepte. Jusqu' prsent
tu as t pnitent; tu as fait pnitence laborieusement
et consciencieusement pour ta rconciliation; main-
tenant et dsormais, pendant ce qui te reste de vie,
travaille ta sanctification .
Il ressort de ce texte, 1 ) que la pni
tence prive ne ncessitait pas rigoureusement l'inter-
342 LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
mdiaire du prtre; 2") que la confession faite au prtre,
la pnitence et les conseils qu'on en reoit sont le
moyen le plus ordinaire, le plus facile et le plus effi-
cace d'obtenir la rmission des pchs; 3) que les fidles
devront faire toute diligence pour employer ce moyen;
les prtres de leur ct s'appliqueront les y encou-
rager en se montrant accueillants, misricordieux, et
<< en plaant des portes et des verrous leurs lvres,
pour ne pas violer et disperser les secrets des paroles
des fidles .
La pnitence monastique dont il est question dans le
pacte des moines de Bar Qaiti avec Sabriso' est une
pnitence d'ordre la fois priv et disciplinaire t. Elle
s'tendait aux pchs contre Dieu etaux manquements
la rgle; elle tenait de la coulpe et de la pnitence
sacramentelle. Elle nous rappelle assez bien la pni-
tence dont Afraat a fait le sujet d'une de ses' hom-
lies
2
Le mariage a t, de tout temps et dans toutes les
provinces ecclsiastiques, l'objet d'une rglementation
minutieuse et pressante. Mais une semblable l_gisla-
tion n'tait nulle part plus ncessaire que dans l'Eglise
nestorienne. Les murs des Persans taient, en effet,
fort dpraves, et la notion mme de l'inceste p a ~ a t
leur avoir t absolument inconnue.
C'est Marabaque revient l'honneur d'avoir formul
avec prcision les rgles du mariage chrtien
3
Ses suc-
cesseurs ne firent gure que reproduire et commenter
ses canons. La bigamie est svrement interdite. De
mme, le catholicos condamne ceux qui ont oss' appro-
cher de la femme de leur pre, ou de la femme de leur
1. P. 464.
2. Voir plus haut, ch: n.
3.P.335 et suiv.
LE POUVOIR JUDICIAIRE. 343
oncle, frre de leur pre, ou de la femme de leur oncle,
frre de leur mre, ou de leur tante, sur de leur pre,
ou de leur tante, sur de leur mre, ou de leur sur,
ou de leur belle-fille, ou de leur fille, ou de la fille de
leur femme, ou de la fille de leur fils, ou de la fille de
leur fille, ou de la petite-fille de leur femme, comme
les mages; ou de la femme de leur frre, comme les
Juifs, ou d'une infidle, comme les paens . Aussi
les mariages mixtes taient svrement prohibs. De
pareilles unions sont illgitimes et doivent tre dis-
soutes dans un laps de temps d'un, de deux, tout au
plus de trois mois ou d'un an . Ce dlai est accord
pour faciliter le rglement des affaires en cours. Maraba
tolre, pour les lacs, non pour les clercs, que celui
qui aurait pous la femme de son frre et qui verrait
trop d'inconvnients s'en sparer, puisse se racheter
par une pnitence convenable.
S 3. - Le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire tant le corollaire naturel du
pouvoir de juridiction, il est pareillement hirarchis. Il
tait svrement interdit un clerc infrieur de se cons-
tituerlejuge de son suprieur. Si l'infrieur croit avoir
t condamn injustement, il ne peut pas se rvolter ni
mettre en jeu des influences trangres, mais il doit for-
mer un recours devant le mtropolitain et son synode
provincial, si le jugement a t port par l'vque; de-
vant le synode gnral et le patriarche, si le jugement
a t port par un mtropolitain. Cet appel n'est nul-
lement suspensif, il est seulement dvolutif. Ainsi en
a dcid Maraba dans son canon xxxrx : Quand un
diacre est censur par un prtre, ou un prtre par son
. ...,..-
3U LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
visiteur, ou le visiteur par l'vque, ou l'vque par le
mtropolitain, ou le mtropolitain par le patriarche,
alors mme qu'on dirait que celui qui a t interdit l'a
t injustement, cependant l'interdit doit tre observ
avec yigilance et celui qui a t interdit doit demeurer
sous sa censure; celui qui a t censur demandera
justice contre celui qui l'a censur dans l'assemble
gnrale, et, ds que la chose aura t examine dans
l'assemble, leur jugement sera accompli comme le
prescrit la justice
1
,
Les censures ecclsiastiques taient en Orient, comme
dans le reste de l'glise, l'excommunication ou ana-
thme, l'interdit et la suspense. L'excommunication
pouvait tre perptuelle. Dans certains cas, elle tait
absolument irrvocable
2
Nul, pas mme le patriarche,
ne pouvait remettre la peine porte (il s'agissait vi-
demment de manquements trs graves ayant entran
la dposition). Il tait alors dfendu de prendre le
parti des excommunis et de se porter leur secours.
Mais il y avait des excommunications mineures, des
anathmes que formulaient les uns contre les autres
les ecclsiastiques appartenant des factions oppo-
ses. Quelques-uns avaient mme pris l'habitude de
s'anathmatiser eux-mmes, non seulement par ma-
nire de juron, mais encore par crit sign et scell.
Isoyahb J
3
critique cette pratique, mais en des termes
adoucis, qui nous laissent souponner que personne
n'y attachait d'importance.
Il faut en dire autant des usages mentionn.s dans
t. Syn. orient., p. 56t. SI l'on partage les doutes que nous avons
exprims plus haut (p. t87, n. \!)touchant l'authenticit de ces canons, on
se reportera au canon xxm de Joseph (p. 361i) qui est rdig dans des
termes presque identiques.
2. P. 413.
3. P. 430.
LE POUVOIR JUDICIAIRE. 3{.5
le canon Ix Jean de Dara
1
Les fidles vertueux
considraient que le prtre avait entendu pronon-
cer un anathme quand il disait : Ne fais pas telle
chose, ne dis pas telle chose , Le patriarche statue
que cette formule est insuffisante. Il faut dire : << Il
ne t'est pas permis et ajouter : Par la parole de
Dieu . Nous apprenons, par le mme canon, que les
prtres usaient frquemment de l'anathme pour faire
avorter les procs et mettre fin aux contestations.
L'interdit fut soigneusement rglement par le mme
catholicos 1So'yahb
2
Il faut en user trs sobrement. On
ne peut s'interdire de collgue collgue, mme s'il
s'agit de deux vques ou de deux mtropolitains, sans
l'assentiment crit du patriarche. Les suprieurs eux-
mmes ne pouvaient prononcer l'interdit contre un
infrieur sans beaucoup de circonspection. Le mtro-
politain ne peut interdire un vque de sa province
qu'avec l'approbation de la majorit du synode provin-
cial. Le patriarche ne peut, sans des raisons trs gra-
ves, interdire un mtropolitain ou un vque qu'en
compagnie et en prsence d'un vque.
L'vque doit toujours faire connaitre au prtre qu'il
censure la raison de l'interdit qu'il a prononc
3
Le
patriarche, si des dnonciations contre un mtropo-
litain lui parviennent, doit commettre l'examen de la
cause au mtropolitain et aux vques de l'parchie
voisine, et, s'ille peut facilement, voquer l'affaire son
propre tribunal et convoquer en sa prsence accusateurs
et accus. Si l'on songe que les recours en appel taient
facilits par la frquence des runions synodales, on
conclura que la lgislation judiciaire de l'glise nesto-
t. Syn, orient., p. 437.
!. Syn. orient., p. l'.ll.
3. Ibid.
346 LE DROIT CANONIQUE DE L'GLISE DE PERSE.
rienne tait assez librale, malgr son apparente ri-
gueur.
La suspense et la rduction la communion laque
taient prononces surtout contre les clercs infrieurs,
contre ceux, en particulier, qui contrevenaient la
discipline matrimoniale. La suspense devait tre pro-
nonce et observe, d'aprs des rgles analogues
celles qui rgissaient l'interdit.
Un dernier problme se pose au sujet des pnalits
canoniques. taient-elles sanctionnes par le bras scu-
lier? On ne peut pas donner cette question de rponse
gnrale. Les rapports de la justice ecclsiastique et de
la justice royale variaient l'infini suivant les personnes
et les circonstances. Si le monarque tait favorable au
patriarche, ou si les juges canoniques trouvaient d'assez
puissants intercesseurs, les fonctionnaires royaux se
mettaient la disposition des suprieurs ecclsias-
tiques. C'est ce qui advint lors du concile d'Isaac et de
Maruta, comme nous l'avons expos en son lieu. Pour
le v1 sicle nous citerons, entre plusieurs autres,
le cas d'Abraham, fils d'Audmhr. Cet vque intrus,
reconnu coupable devant toutes les juridictions scu-
lires, fut condamn par elles tre ras, barbouill
de suie, tortur et emprisonn perptuit.
~ Voir l'acte de dposition de cet Audmtbr, Syn. orient., p. 3!!6.
CONCLUSION
Si l'on veut, au terme de cette tude, dgas-er quel-
quesuns des caractres qui distinguent l'Eglise de
Perse des autres glises autonomes du haut moyen ge,
une observation s'impose tout d'abord : seule entre
toutes, elle n'a jamais joui de la protection officielle de
l'autorit sculire.
D e ~ u i s l'origine de leur dynastie jusqu' son dclin,
les rOis Sassanides, par ncessit politique autant que
par inclination personnelle, demeurrent fermement
attachs la religion nationale des Iraniens : le maz-
disme. Quand Constantin eut solennellement abjur
le paganisme, Sapor II fut conduit considrer ses
sujets chrtiens comme des auxiliaires ventuels des
Romains, ces ternels rivaux des Perses : d'o la san
-glante perscution qui dcima si cruellement les jeu
nes chrtients de l'Assyrie et de la Chalde. La situa-
tion de ces glises s'amliora notablement lorsque la
sollicitation des ambassadeurs byzantins, et la faveur
d'une trve phmre conclue entre les deux empires,
lazdgerd 1 eut permis et encourag la rorganisation
de la hirarchie; mais surtout quand, la fin du v si-
cle, par suite du triomphe du nestorianisme dans les
contres soumises aux Sassanides, un foss infranchis-
3i8
sable se fut creus entre les deux grandes fractions
de la Syrie chrtienne.
Elle n'en demeura pas moins toujours prcaire, par-
fois critique. Si le dernier supplice ne menaa plus
gure que les transfuges du mazdisme, quand ils
taient dnoncs aux magistrats par le clerg zoroas-
trien, trop souvent, dans les districts loigns de la
capitale, les glises furent pilles ou dtruites au gr
des mages ou des fonctionnaires provinciaux; trop
souvent aussi l'lection des vques, et celle mme
du catholicos, fut entrave ou retarde par le mauvais
vouloir du prince, ou les cabales de ses favoris. Sous
le rgne de Chosrau II, les intrigues du srail eurent
une fcheuse rpercussion jusque dans les assembles
synodales et les colloques des controversistes.
Si l'on songe, toutefois, aux tranges .bouleverse-
ments que causa la politique religieuse des Csars
chrtiens, celle d'un Constance ou d'un Justinien, par
exemple, on est amen se demander si le rgime
persan, en apparence si dfavorable, ne fut pas plus
propice que la tutelle byzantjne au dveloppement nor
mal de l'glise et l'efficacit de sa propagande, biens
plus prcieux pour elle que les privilges qu'a pu lui
valoir le patronage des gouvernements les plus ortho-
doxes.
Quoi qu'il en soit, ds le dbut du vu sicle, l'-
glise persane pouvait aisment soutenir la compa-
raison avec les autres groupements autocphales, tant
pour son expansion territoriale que pour le nombre de
ses fidles et la vitalit de ses institutions. A la vrit,
la chrtient nestorienne ne saurait se glorifier d'a-
voir produit des thologiens, des orateurs ou des po-
lmistes comparables Origne, saint Jean Chrysos-
tome, ou saint Athanase, mais elle a connu des
COI:'\CLUSION. 34:9
rformateurs comme Maraba ou Abraham cc le pre
des moines , des hommes d'action comme
de Nisibe ou Baba le Grand. Il est juste d'ajouter que
si notre culture esthtique tait moins loigne de
celle des vieux Syriens, peut-tre nous associerions-
nous aux loges emphatiques que les Orientaux dcer-
naient au mrite littraire d'un Narss.
L'invasion de l'Islamisme, outre les meurtres et les
dprdations insparables d'un pareil mouvement,
amena parmi les chrtiens de nombreuses dfections,
particulirement chez ceux de la pninsule arabique et
des provinces mridionales de l'Iran. Mais lorsque
vnement de la dynastie Abbaside eut mis fin aux
dissensions intestines des conqurants arabes et as-
sur la paix et la prosprit dans toute l'tendue de
l'empire musulman, l'Eglise nestorienne acquit un
prestige et une influence qu'elle n'avait sans doute
point connus sous la domination des Sassanides. Le
catholicos, qui avait d depuis longtemps abandonner
Sleucie, dpeuple et ruine, sint se fixer Bagdad,
la nouvelle mtropole de l'Islam. Les annalistes signa-
lent, il est vrai, pour le IX
8
sicle, quelques perscu-
tions de courte dure sous les c.alifes Harun ar-Ra-
schid et Mutawaqqil; ce n'taient l que des orages
passagers, et sans lendemain.
Les chrtiens occupaient les plus hautes charges de
la cour, soit comme mdecins des califes, soit comme
secrtaires des mirs. Ils initirent alors leurs matres,
jusque-l rudes et ignorants, la philosophie, l'as-
tronomie, la physique et la mdecine des Grecs, et
traduisirent en arabe les traits d'Aristote, d'Euclide,
de Ptolme, d'Hippocrate, de Galien et de Diosco-
ride. Gabriel et Georges Boktiso<, et ljonein ibn-lsl.1aq,
pour ne mentionner que les plus connus, appartenaient
20
350 CONCLUSION.
la communaut nestorienne. Ils furent._ en un sens
trs vrai,les prcurseurs de ces grands aristotliciens
dont les ouvrages, rpandus et vulgariss dans l'occi-
dent latin, y provoqurent, au xm
8
sicle, une fconde
mais trop brve renaissance philosophique.
La conqute de Bagdad par les Mongols ( 1258} ne
porta aucun prjudice l'Eglise. Les vainqueurs u ~
grent utile de s'appuyer sur les populations chr-
tiennes pour achever la dbcle de l'empire Abbaside.
D'importantes missions politiques furent alors confies
des vques. Le catholicos Iahbalaha III, un Chi-
nois, envoya au pape Nicolas IV, au nom du roi Ar-
gun, une ambassade pour ngocier l'alliance des
Francs avec les Mongols, en vue d'anantir dfiniti-
vement l'Islam (1288). A ce moment, l'glise nesto-
rienne atteignit sa plus grande expansion territoriale.
L'Inde mridionale, la Chine o d'importantes co-
lonies chrtiennes existrent ds le vm sicle, le
Turkestan dont la plupart des tribus taient conver-
ties depuis longtemps et avaient leur tte des princes
chrtiens, comprenaient, en y joignant le.s provinces
qui constituaient le domaine propre du catholicos,
environ une centaine de diocses, groups en vingt-
cinq circonscriptions mtropolitaines.
Lorsque les khans Mongols furent devenus maho-
mtans, cette brillante prosprit dclina rapidement.
Le fameux Timour perscuta les chrtiens, ou plutt
les engloba dans les massacres effroyables qu'il ordon-
nait sur le passage de ses hordes. De son rgne
date la ruine et la dsolation de l'Asie antrieure.
Les Turcs suivirent les mmes errements ; les guerres
interminables qu'ils soutinrent contre les chiites de
Perse ont chang en dsert les contres autrefois
les plus peuples -et les plus riches du monde.
CONCLUSION. 351
Ds le xv sicle, on ne trouvait plus gure de chr-
tiens au sud de Bagdad ; dans les autres vilayets de
la Msopotamie leur disparition fut moins prompte et
moins radicale. Au milieu du xvx sicle ( 1551), lors d'une
vacance du sige patriarcal, la hirarchie comprenait.
un seul mtropolitain, et trois vques. Mcontents
du nouveau catholicos lu, ou, pour mieux dire, impos
par le mtropolitain, les vgues se sparrent de sa
communion et s'unirent l'Eglise romaine; le pape
Jules III consacra leur candidat Jean Sulaka, abb du
clotre de Rabban Hormizd, en qualit de << patriarche
des Chaldens . La communaut des << Chaldens
unis a subsist depuis cette poque. Elle compte
plus de 30.000 membres groups pour la plupart dans
les districts qui avoisinent Mossoul.
Dans le massif montagneux du Kurdistan, entre le
lac de Van et le Grand Zab, vgtent 70.000 Nesto-
riens qui gardent jalousement comme un patrimoine
national les traditions, les coutumes et, malgr de gra-
ves altrations, la langue de leurs anctres. L'Europe
apprendra quelque jour qu'ils se sont rallis leurs
compatriotes catholiques, moins que ce ne soit aux
orthodoxes russes ou aux anglicans de la mission
amricaine d'Ourmiah, pour des motifs dont les plus
convaincants, peut-tre, seront trangers la tho-
logie. Dplorables hritiers d'une Eglise qui pendant
onze sicles a t, pour les populations de l'Asie an-
trieure et de l'Extrme-Orient, la dispensatrice de
la civilisation et de la culture chrtienne !
TABLE SYNCHRONIQUE
DES ROIS DE PERSE ET DES PATRIARCHES;
PATRIARCHES
250-300 vanglisation de la
Perse.
Vers 310 : Papa.
341 t &imon
342 t Sahdost.
346 t Barba'semin.
346-383. Vacance.
383-399
Isaac 39'J-410.
Aha410-415.
Iahbalaha 415-420.
Ma'na (420) [Farbokt].
Dadiso' 421-456.
Babowa 457-184.
Acace 485-495/6.
Baba 497-502/3.
ROIS 1
Ardasil 226-241.
Sapor 1., 241-272.
Bahrm l" 272-273.
Bahrm II 273-276.
Bahtm Ill 276-293.
N ars 293-3o-2.
Hormizd li 302-309.
Sapor II 309-379.
Ardasir II 379-383.
Sapor III 383-388.
Bahrm IV 388-399.
Iazdgcrd l" 399-420.
Bahrm V 420-438.
lazdgerd II 438-457.
(Hormizd III) Prz 457 (459)-
484.
Balas 484-488.
Qawd 1 488-531.
(Zamasp 496-498.)
1. La liste des rois Sassanides par ordre chronologique est emprunte
NOELDEKE, Geschichte der Perser und Araber (TAB.!.RI), p. 435.
20.
TABLE SYNCHRONIQUE.
PATIUARCHES
s il a. W.rfi23.
~ a r s s et lise 524-:f..l.
Paul 5.'39 .
.\laraba 540-552 .
. Joseph 552-567.
zchiel 57(1..581.
ISo'yahb 1 582-595.
8abriso' 596-GO 1.
l_j,l'goire 600-/6-608/0.
G08J!)-28 Vacailce.
lso'yahb II 628-&13.
ROIS
Chosraui Anosarwn 531-578.
Hormizd IV 579-590.
Chosrau Il Parwz 590-628.
De la mort de Chosrau II l'a-
vnement de Iazdge1d Ill628-
63'>
DES NOMS PROPRES
A
Abba llebiiia, 319, n. 4.
Abba Sappir, 319, n. 11.
Abbasides, 34!1, 350.
Abbos, 319.
'Abba, v. de Hormizdardasir, 90, n.
1, 105, 106, 107, 109, 119, n. 2.
'Abba, mall1e de 'AbdiSo', 100, 291,
307, n. 3.
A!Jdalaha, prtre, 80.
'Abdhaikla, 64, 67.
'Abd iso , diacre, 79.
'A!Jdilio ',vque, 29, 30, 58, 60, 80.
'Abdiso , moine, 29.
'Abdiso', moine fabuleux, 99, 291,
307, n. 3.
'Abdiso', moine, compagnon d'Aw-
gln. 310, u. 11.
'Abdiiio ', soldat, 78, n. 2.
Abhnn, 310, n. 4.
Abia!, 31.
Abner, 120, n. 7.
Aborsam, 71, 72.
Abraham, catholicos, 298, n. 2.
Abraham, pseudo-catholicos, 11,17,
n. 2.
Abraham, vque d'Arbel, 75.
Abraham, martyr, 127.
Abraham, moine, 73, 74.
Abraham, moine, 310, n. 4.
Abraham, neveu de Narss, 202,.
292, 317.
Abraham Bar Qardal,J, 292.
Abraham de Dasen, 319, o, 11.
Abraham de Ma 'are, M2.
Abraham de Nethpar, 318.
Abraham, dit Atmhi, 174.
Abraham, llls d'Audmlhr, 172-174.
Abraham Je Grand, 215, 225, 229,
292, 308, o. 4, 309, 311, 316-318,
319, 320, 321, 3 ~ 9 .
Abraham Je Mde, 132, 1S3, 142.
Abrl!s, 11, 17, n. 2.
'Abrodaq, 182.
'AbSota, 132.
Acace, catholicos, 125, 130, 132, 133,
136, 137, 139, 140, 143-147, 151,
155, 156, 262, 263, 289, 291, 316,
336, 338, n. 1.
Acacc d'Amid, 23, 89, 93, 101, 102,
110, n. 5, 122, 124, 125, o. 1.
Acace de Bre, 93, 255.
Acace de Constantinople, 138.
Acace de Mt'litoc, 253.
Acrmi-tes (Moines), 272.
Ada, 13.
Adada, 319, n. 11.
Adnrbozi, 107, 108.
Adargusasp. 184, o. 1.
Adarguimasp, 73.
Adarkarkasar, 80, 81.
Adarparwa, 107.
Adarsabur, graod-mobcd, 80, 81.
Adari\abur, soldat, 78, n. 2.
Adda, J'aptrc, 11, 12, 14, 15.
Adda, frre de Philoxne de Mabug,
1S2.
Adiabne, 49, o. 3, 73, 74, 77, 81, 8'1,
126, 130, n. 2, 144, n. 4, 1111, 185,
214, 218, 2;!
1
1, 226, 230, 233, 289,
318, 326.
356 INDEX DES NOMS PROPRES.
Adna, 611, n. t.
Adranl, St.
Adurafrozgerd, 79, n. 1.
Adurafrozgerd, t26.
Adurbaidjan, 18, 185, 1811, 187, 188,
20:, 2111, 242, n. t.
Adurpareb, 7:. 79.
Adurpareb, 181.
Adurparwa, 50, n. 1.
Ai!lius 1 122, n. 3.
Afraat, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32-42,
117, 4!1, :0, n. t, 8t, M2.
Afrique, 27:>.
Agapet, vque de Beit-Lapat, 12,
91, 99, 122-124, 12:;, n. t.
Agapet, pape, 168, 272.
'Aggai, 11, 12, 1:>.
A!.Ja, moine monophysite, 239.
moine nestorien, 310, n. 4.
Al}adabuhi, v. de Nisibe, 293, n. 6.
pseudo-catbolicos, 11,
12.
A ha, catholicos, 52, 99, 100.
A6udemmeb, 198, 217, 240.
Ailalaba, diacre, 80.
Aitalaba, martyr, 76.
Ailalaha, moine, 239.
Aitalaba, soldat, 78, a. 2.
'Aii.da, t611, n. 3.
Akra de Kiik, 229.
'Alas, 315.
Albanie, t'IO.
Alep,
Alexandre de llit
1
rapolls, 253, 254.
Alexandrie, 165, 231, 232, 2:17, 290,
328.
Alqos, 307.
Ama, 31.
Ambroise (S'), 228.
Ami, 31, 7:.
Amid, 1:9.
Ammonios, 31, 70.
Amn, 310, n. 4.
Amphiloque d'lconium, 228, 256.
'Amr ibn Moundhir, 206, n. 4.
Amria, 68.
Ana, 31.
Anastase, captif, 79, n. 1.
Anastase, empereur, 1:>7, n. 3, tas,
1:>9, 177.
Anastase, martyr, 233, n. 5.
Anatolius, patrice, 117.
Anatolius de Constantinople, 258.
Anazarbe, 253.
Anbar, 160, 169, n. 3, 172, 179, t911.
197, n. 3, 20/a, 24t, 24:, n. 3, 306,
314 (v. Priiz8abur).
Ancyre, 102, 32f.
Andr, moine, 310, n. 4.
Andr, prtre, 22:.
Andr de Samosate, 2:;3.
Andrinople, 811.
Ano8azad, 189, 190.
Anthmios, 87.
Antbime, 168, 272.
Antioche, 10, tt, 12, 19, 47, 78, n. 2,
88, 102, 126, n. la, 132, 138, 177,
204, 239, 248, 253, 2!):;, 256, 2:;7,
as:;, 32:;, 328.
Antioche (Nouvelle-), 177, n. 2, 1911.
Antoine (S'), 31, 70, 302, 399.
Aones, 315.
Apame, 244.
Apollinaire, 248, 276.
'Aqbalaha, 2t, 120.
'Aqebsema, 53, 54, 81, 82.
'Aqla, 234, 246, n. 3.
Arabes, 139.
Arabie, tM, n. 1.
Arbel, 13, 20, n. 6, 55, 74, 75, 76, 77,
80, 81, 92, 122, 127, tM, 160, 169,
n. 3, 187, 223, 230, 2M, n. t, 326,
330.
Arcadius, 90.
Arche (couvent de 1'), 121.
Archelas, 20.
Ardabnre, 118.
A rda sir t, t, 2, 8.
Ardai!;ir Il, 60, 62, 73, 76, 80, 84.
Ardasir, fils de Sr, 24t, 2'12.
Ardasir, martyr, 126.
105, o. 1.
Ardasir-Kurrah, 120, 121.
Arwfin, 62 (v. MaJ.toz de Arwn).
Argun, 350.
Ariminites, 42.
Aristolaos, 254.
Aristote, 349.
Arius, 276, 290.
Armnie, 2, 83, 84, 101, n. 3, t36,
140, 1:>4, 177, 2t8.
Arran, 178.
Arsne, 309.
Artaban, t, 2.
Arzanne, 18, 50, n. 1, 78, 101, o. 1,
118,126.
INDEX DES NOMS PROPRES.
357
Arzun, 13, 1611, 201, 202, 240, 320.
Aspbte, 117.
Asylus, 168.
Athanase (S'), 228,
Athanase Je Chamelier, 239,241, n.t.
Athnes 161i, 301.
Atur, 13, 307.
Audiens, 153, n. 2.
Awgln, 300-315.
'Awida, 180.
Azad, 56, 68.
B
Baba, catbolicos, tM-160, 333.
Baba, tudiant d'desse, 257.
Babai le Grand, 213, n. 2, 215, 216,
225, n. 3, 226, 229, 230, 237, 238,
279, 280-287' 293, 319,
Babai le Petit, 230.
Baba Je Scribe, 310, n. 4.
Babel, 7.
Babken, 140.
Babowai, 129-131, 133, 135, 136, 139,
141-144, 149.
Babuyah, 129, n. 2.
Bactriane, 19, n. 1, 189, n. 2, 327.
Badbui, 64, n. 1.
Badema, moine, 29, 30, 62, 80.
Badema, prtre, 611, n. 1.
Bagdad, 153, n. 1, 241, n. 1, 349, 350,
351.
Dahrm J, la3.
Dohrm IV, 84, 85.
Bahrm V, 85, 124, 125, tra9.
Bakasa, 75.
Balad, 237.
Balai;, tudiant d'desse, 257.
Balai\, roi, 143, 145, 146, 151, n. 1,
154, 155.
Barba 'sernin, 28
1
59, n. 2, 72, 73, 85,
n. 4.
Bargs, 315.
de Qardu, 133.
diacre d' Arbel, 76.
de SabriSo',
222, n. 1.
BartJadbci!abba de IJolwan, 223.
Bari}.adbe!\abba, lac de Kaikar, 80.
Bar!)adbesabba-Yamina, 310, n. 4.
Barttail, 120, n. 7.
Bar Qati, 216, n. 2, 323, n. 5.
342.
Barsabia, 29, 30, 62, 72.
Bar8abta, v. de Suse, 120, n. 7.
Barsabta, v. de 1\abrqart, 169, n. 3,
Bar8abta, intrus, 99.
Barsabd, intrus, 173, n. 2.
Rarsahd, moine, 135.
Beit Lapa!, 12, 19, 20, 66, 68, 72, 73,
74, 77, 80, 98, 101, n. 3, 102, 112,
113, 122, 125, n. 4, 130, n. 1, 138,
142, 145, 148, 149, tl>O, 157, 172,
174, 173, 185, 186, 187, 189, 190,
n. 1, 222, 263, n. 1, 278, 32G, 330.
Beit Narqoa, 190, 242.
Beit Niqtor, 20, n. 6.
Beit Nubadra, 81,120, n. 7, 136,213 1
n. 2, 218, n. 4, 230, 239, 240, 307,
314, 3:u.
Beit Qatray, 306.
Beit Qayta, 307.
Beit Ramman, 239, 240.
Beit Titta, 127.
Beit Waziq, 240.
Beit Zabd, 20, n. 6, 78, 79, n. 1,
229, n. 4, 319, n. 4, 320.
BeleSfar, 114, 120, n. 7, 122, n. 3,
128, 152, 2Jl, 234, n. 1.
Blisaire, 178.
Benjamin de Beit Aramay,133.
Benjamin, diacre, 112, 118, n. 2, 121,
n. 2.
Benjamin, moine, 310, n. 4.
Benjamin, moine, 319, n. 4.
Berikiso ', 63, 78.
Berikmareb, 173, n. 2.
Beriko, 120, n. 7.
Bryte, 254 (v. Beyrout).
Bsahrig (v. Sabrlg).
Beyrout, 133.
Bindo,
Bistam, 205, 209, n. 3.
v. de Nisibc, 125, 130-
149153, 156, 157, 217, 222,
2a7, 261, 289, 291, 293, 349.
v. de Suse, 243.
Barsemcs, 310, n, 1<.
Barthlemy, 16, n. 2.
Basile de Cilicie, 256.
Basilisque, 138.
Bassus, 79, n. 1.
Ba tai, v. de llormizdardosir, 120.
B'*'i, v. de )lei!amhig, n. 1, 98
358
INDEX DES NOMS PROPRES.
Ba tai, lac de Laom, 196, n. 1.
Datai, moine, 31!i.
Battala, 310, o. 4.
Ba'uta, 73.
Behnam, 79, o. t, 2t8, 305, o. t.
Behwar, 99.
Bell 'Ab, 293, ll09, 322, o. 1, 323.
Beit 'Adra, t36, 138, o. li, 139, 1411,
146, o. 1, 147, n. 2, 155.
Beit 'Ainata, 229, n. 4.
Bell Aramay, U, !4, 108, tll3, 151,
t55, t57, 162, t82, 195, 3t8.
Bell 'Arbay, 83, 1'7, 202,218, 240.
Beit Ardasir, tot, t33, o. 6.
Beit Ar5am,158.
Beit Darayi', 128, 142, t52. 211, n. 3,
Beit Garma, 13, 15., 73, 84, 9:1, 98,
109, o. 1, 126, 130, o. 2, 135, 1'12'
147, 169, o. 3, t85, 210, 211, 212
223, 226, 233, 23!1, o. t, 32t, 326.
Beit Huzaye, 45,93 (voyezlluzistan).
Bell Kussay, 180.
Biim, 307, o. 3.
85, n.4.
Bizonita, 136.
BoktBo ', 211, 223.
Bolida', 66.
Briin, 242, 245.
Rorboriens, 42.
Buzoq, 160.
Byzance, 144, o. li (v. Constantino-
ple).
c
Calandion, 138.
Calliniquc, 2t8, n. 4.
Capharnam, 16.
Caspienne (mer), 327.
Cathares, 42.
Clestin, pape, 251.
Clsyrie, 19.
C<'sare de Cappadoce, 232.
Ceylan, 165, n. 6, 306.
Chalcdoine, 88, n: 5, 133, 140, 187,
o. 2, 247, 25!i, 257, 258, 259, 260,
261, 263, 285, n. 3, 266, 268, 272,
273, 32!i, n. 2.
Chne (Conciliabule du); 88, n. ;,,
Chine, 350.
Chosrau I, r., 122, o. 3, 166, 162, n.
t,l67, 170, 17!>, 176, o, 1, 177,178,
182, 188, t89, 190, n. 1, 191, 192,
196, 198, 199, 200, 207, 217, 293, n.
6, 301, 328.
Chosrau Il, 4, 12, 139, n. 1, 191, 203,
204, 205, 20&, 208, 209-216, 217.
219, 22&, 228, 229, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 240, 348.
Chosrau, comptiteur de Bahrm V,
109.
Chosrau lazdgerd, 97.
Cbri!tophe, 239,
Chrysostome (S' Jean), 88, 215, 228,
278, 298, 3!18.
Chypre, 3t3.
Claudianos, 177, n. 2, 1911.
Ciysma, 302.
Comagne, 177, 179.
Constanct, 45, 1<7, 78, o. 2, 3!18.
Constantin, l<ll, 41<, 1<7, 50, n. 1, 3!17.
Constantinople, sr., 88, 11<5, t51, t58,
n. 1, t85, 1&6, 169, 178, 200, 225,
21<0, 257' 285, 266, 269, 272, 299,
325.
Corinthe, 165.
Cosmas Indicopleustes, 185.
Cossens, 152.
Ctsiphon, 1tl1 (v. Sleucie).
Cyr, 254,
Cyriaque, 230, 242.
Cyrille (S'), 133, o. 6, 228, 252, 253,
254,2!">5,
CynJs, d'Messe, 138, n. f, 140,
261, 2lll.
D
Dadha, 310, n. r..
Dadhormizd, 178, 181, 182, 183.
Dodin, 18.,.
Dadiso', catholicos, 12, t7, o. 2, 21,
n. t, 91, 120-127, 133, n. 6, 142, ll2'i,
328.
Dadii;o', moine, 21!>, 225, 318, 319.
Daduq, t06.
Daisanites, 1<2.
Danias, 232.
Danaq, 31.
Daniel, de Beit Nuhadra, 239.
Dnnicl, v, d'Arbel, t22.
INDEX DES NOMS PROPRES. 359
Daniel, v. de Kal'm, 142.
Daniel, intrus, 911, n. t, 98.
Daniel, moine, 306, 307.
Daniel, prtre, 72,
Dara, 212, 221.
Darabgerd, 120, n. 7.
Dara, 202.
Darmekhan, 228.
Oar-Qni, 13, 14, 15, 120, n. 7.
Dasen, 13, 319, n. 321.
Daskart, 100.
Dasqarta de Malka, 120, n. 7.
Dastgerd, 79, 81, 233, 241.
Dansa, 78.
David, v. d'Anbar, 160.
David, v. de Mazou, t 73, n. 2.
David, v. de Merw,169, n. 3.
Dlam, 3.
Demetrianos, 19, 20, n. t.
Dendad, 182, n. 2.
Dcnl;la, 239, n. 2, 241, 289.
Diodore de Tarse, 157, 255,
256,264.
Dioscore d'Alexandrie, 256,258, 259.
Dioscoride, M9.
Dja 'far, llls de 1\lo 'taem (Mutawaq-
qil), 308.
Domitien, 122, n. 3.
Domnus, 257.
Dnrtan, 106.
E
desse, 10, 12, 18, 53, M, 130, 133,
158, 142, 144, t57, 165, 21s,
n. 4, 232, 247, 252, 254, 256, 257,
261, 266, 289, 291, 313, 323.
gypte, 165.
lam, 142.
lie le Zlote, 320, n. 2.
lie, martyr, 78.
lie, moine, 319, n. 4.
lise, catholicos, 159, n. a, 160,
161,162, 170.
lise de Suster, 172.
F:Iise, moine, 310.
phse, 93, n. 2, 133, 256, 257, 258,
265.
phrem(S'), 37, n.t, 277.
phrem d'Antioche, 168.
phrem, v. de !Jira, 207.
phrem, scribe, 106.
thiopie, 158, n. 1.
f:tieune, archimandrite, 318.
tienne, prtre, 127.
tienne, moine, 310, n. 11.
Euclide, M9.
Eugne (S') (v. Awgin).
Eunomiens, 42.
Eunomius, 276.
Eusbe de Tella, 93.
Eusbe, moine, 315.
Eustathiua, 168.
Euthyme (S'), 118.
Eutychs, 256, 257, 258.
Ezalia de Kerar-Mari, 132.
zchiel, catholicos, 169, 197-199.
201, 276, 291, 328, 3:YtJ
F
Farbokt, 119, 120.
Farruchdad Hormizd de Zadagu,
tss; u. 3, 189, n. r,,
Farrukhan, 226, 242.
Fars, Farsislan (v. Perse propre) ._
Farukbokt, 119, n. 3, 120.
Flix Il, 158.
Flavien d'Antioche, 307.
Flavien de Constantinople, 256, 257.
G
Gabriel, v. de Hrat, 147.
Gabriel, v. de Kark9 de Beit Slokh,
230,
Gabriel, v. de Nhar Gl, 223, 226.
Gabriel, fils de Rufin, 215.
Gabriel de !liggar, 219, 220, 221.
224, 226, 228, 229, 230, 2;2.
Gabriel Boktiso , 249.
Gabrona, 310, n.
Gadiahb, 20, 66, 70.
Gagai, 76.
Galre, :;o, n. 1.
Galien, 349.
Gallus, 78, o. 2.
Gangres, 102, 325.
Ganzak, 184, n. 1.
Gauslso , 229.
Gawar,13.
360
INDEX DES NOMS PROPRES.
Gdala, 237.
19, n.t, 78, n. 2.
Gl'lu, 307, n.ll.
Geniba, 310, n.
Georges, de liggar, 239.
Georges le martyr, 21:;, 22!>-230.
Georges, moine, 310, n.
Georges, prfet du prtoire, 2M,
n. 2.
(;eorges BoktiAo ', M9.
George de Tubam, 310, n.
(;bassanldes, 199,206, n.
Gitan, 205.
Golindukh (S'), t96, n. t.
Goths, ill.
Gomel,
Gozarta, (v. Qardu).
Grgoire, catholicos, 222-223, 231,
276, 278, 289, 29t.
Grgoire de Beit-Ramman, 239.
Grgoire, '". de Nisibe, 2t5, 2t6,
217, 222, 293.
Grgoire, v. de Rew ArdaMr, 202.
Grgoire, moine, 3t0, 3t3.
Grgoire Pirangusnasp, 178-179.
Gubarlaba, 305, n. t.
Gula, 3tO, n.
Gundgabur, 19, 20, n. t. (v. Deit
Lapa!).
Gurgn, 3.
Guria, moine, 310.
Guria, 3t3.
Gurzan, tot, n. 3, t05, n. t, t22,
n. 3, 178.
Gusnaspir, 153.
Gusniazdad, t52.
Gustahazad, eunuque de Deit LapaJ,
'9.
Guiitahazad, eunuque de Karka de
Deit Slokh, 62, 73.
II
J.labib, 21 (v. Agapet de Beit LapaJ).
l_fabib, martyr, 78.
l_fabiba, 310, n. 11.
J.lafsai, 76, 77.
llaitl (v. Huns).
l_fah', 163.
Halmadur, 78, n. 2.
llalpid, 78, n. 2.
llananie, 16.
laie, 75.
!jana nia, prtre, M, 67.
Jjrith ibn 'Amr ibn Hodjr, 207.
Harun ar-Raschid, M9.
lldu, 105, 106.
l;latai, :u.
Hazarowai-Marie, 225, 295, n. 2.
J;lana, 76, 2M, n. t, 3t8.
J;ledayab, 93, 98, tOI, n. 3 (v. Adia-
bne).
Hliodore, 78.
Hliodore Saba, 3t5.
Henaita, 20, n. 6, 80.
l;lenana, mtrop. d'Adiabne, t 73,
n. 2.
J.lenana d'Adiabine, 202, 203, 2t!>,
2t6, 237, 278, 279, 280, 292. 293,
n. t, 298, 3t9.
ljenanli;o , moine, 226, 228, 3t9, n.
l_fephtalites (v. Huns).
Hraclius, 232, 233, 2M, 2.,.;,
Hrat, 122,
J.lesna 'Ebraya, 307.
Hidgan, 305, n. 2, 3t2, n. 3.
Hilarion (S'),
Hind la jeune, 206.
Hippocrate, Mil.
IJira, 3, 158, n.t, 160, tM, n. 3,
169, n. 3, 191, 199, n. 2, 206 et n.
2t2, 236, n. t, n. 3,
317.
Hit, 179, n. 3.
l.folwan, 20, n. 6, 128, 223, 229, n. 2.
ijonein ibn lsJ;taq, Mil.
Hormizd Ill, t29,
Uormizd IV, 200, 201, 203, 2M, 206,
211, 2t2.
Hormizd, moine, 320, n. 2.
Hormizd, pre de Ba ba, tM, t5i,
n. 5.
Hormizd, prtre, M, n. t.
Hormizd (monastre de Rabban-),
351.
Hormizd, soldat, 78, n. 2.
Hormizd Gufriz, 7t.
Uormizdardasir, 20, n. 6, 66, 105,
106, 160,161, 172,
Hormizdas, fU.
llormizdaiir, 78.
Huns blancs (llephtalltes), 811, 143,
159, t77, 189, n. 2, 190.
INDEX DES NOMS PROPRES. 361
Huzistan, 19, 79, 80, 98, 105, 1112,
172, 173, 174, 190, 245, n. 3, 305,
314.
Hypatius, 278.
llyrcnnie, 204 (\". Gurg;1n).
lahb, 310.
tahbalaha 1, catholiws, 80, 90, n. 1,
100, 101, 102, 103, 104, 120, n. 3,
122, 124, 125, n.t.
lahbalaba Ill, cntholicos, 350.
labbalnha, pr:tre <le 64,
n. 1.
Iahbiso ', 12.
lazdgerdl, s:;, n. 11, 87, 88, 89, 90,91,
92, 95, 99, 104, 105, 107, 109, 113,
n. 4, 116, 119, 120, n. 3, 122, 200,
3117.
latdgerd Il, 74, 12;;130.
Iazdgerd, v. de Beit 1112.
lazdpanah de Siarzur, 239.
Iazdpanah, martyr, 178, 179, 180.
lazduodokht, 60, 63, 73.
Iazidad, 132, n. 2.
Jbas, 131, n. 4, 132, 133, 1311, 137,
254, 255, 257, 25H, 259, 260, 261,
273, 274, 291' 298.
Ibrie, 1110.
lude, 165, n. 6, 327, 3;,o.
Isaac, calholicos, H:l, 63, 8!",, 87, 88,
89, 90, 91, 93, 94, 95, U6, 97, 122,
326, 329, 333, 335, 336, 337,
346.
Isaac, v. de de llcit Slokh,
62, 73.
lsanc, martyr. 127.
Isaac, moine, 310, n.
Isaac, pr. de Sleucie, 611 , o. 1.
Isaac, pt. et martyr, 127.
Isae, flls de f:ladallu, 78.
!sale, lac, 142, n. 6.
Isae, moine, 310, n. ra.
Isae, moine, 319, n. 4.
Isae, professeur de Sleucie, 169
1
n. 3, 291.
Iso', 222.
ISo 'sabran, 234, n. 1.
Iso "yahb 1, 19R, n. 1, 201-207, 208,
209, 276, 277' 278, 292, 331' 335,
339, 340, 3111, 3115.
LE CUIIISTIA:XISJIE,
ISo'yahb 11, 216, n. 1, 237, 242-246,
293, 323, n. 5.
IAo'yabb III, 243, 2M, 2'15, n. 1, 287,
n. 1, 295.
bo 'yahb, moine, 310.
Ispahan, 122.
Istahr, 1, 30, 72, 2115,
Italie, 275.
lwanis, 310.
lzedbzed, 120, n. 7.
lzla (M'), 213, n. 2, 219,225, 229,237,
304, 305, 307, 317, 320.
J
Jacob, calholicos fabuleux, 11, 17,
o. 2.
Jacobites, 199,217-221,227, 23', 239,
240, 241' 276.
Jacques de Beit 'Ab, 320, 323.
Jacques de l'iisibe (S'), 45, 70, 121,
304, 305, 306.
Jacques, disciple <le Maraba, 169,
n. 3, 188.
Jacques, dit le Zlote, 74.
Jacques, v. de Bcit Lapa!, 160.
Jacques, v. de Karka de Beit Slokh,
169, Il. 3.
Jacques le Notaire, 61, 113,114, 115-
117.
Jacques l'lntcrcis, 112, 113.
Jacques, pr. de Tellai;alila, 50, n. 2,75.
Jacques, moine, 319, o. 4.
Jacques, Barndc, 1