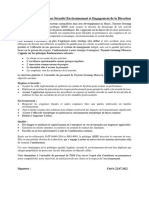Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Mémoire PFE - SPETTEL GC5 PDF
Mémoire PFE - SPETTEL GC5 PDF
Transféré par
Mohamed OuladTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Mémoire PFE - SPETTEL GC5 PDF
Mémoire PFE - SPETTEL GC5 PDF
Transféré par
Mohamed OuladDroits d'auteur :
Formats disponibles
Maison Parisot
7, Boulevard Thiers
52000 Chaumont
Projet de fin dtudes Rapport final
INSA de Strasbourg Spcialit Gnie Civil
_____________________________________________
Amlioration du systme de management qualit existant et
prparation la certification ISO 9001
Etudiant
Pierre-Axel SPETTEL Elve ingnieur en 5me anne Spcialit gnie civil
Tuteur entreprise
Jean-Philippe DENIZET Manager projet Grant de la socit
Tuteur INSA
Pierre REGENASS Professeur ENSAM de gnie civil Juin 2001
Pierre-Axel SPETTEL 1/52 Juin 2011
Pierre-Axel SPETTEL 2/52 Juin 2011
Remerciements
Avant daborder le cur de mon projet de fin dtudes, je souhaite remercier lensemble des
collaborateurs de lentreprise Maison Parisot et de lagence Parisot Projet avec lesquels jai eu le
plaisir de travailler durant ces quelques mois, et qui mont rserv un accueil convivial et chaleureux.
En particulier, je remercie :
Jean-Philippe Denizet, grant de lentreprise et manager projet, qui a accept de maccueillir
Chaumont en tant le tuteur entreprise de ce projet, qui ma apport tant son soutien que
son exprience dans les missions de pilotage des projets qui mont t confies
Nicolas Ginter, responsable de lagence de Strasbourg et manager projet, sans qui ce projet
naurait pas vu le jour, pour ses conseils sur les diffrentes tapes de mon projet de fin
dtudes
Mathilde Mehlinger et Marion Engrand, assistantes, ainsi que Vanessa Bensallah, apprentie,
et Jolle Denizet, comptable, pour laide quelles mont apport durant mes missions de
pilotage de projets
Joanna Durlet et Caroline Dupuy, managers projet, ainsi quElodie Ortega, assistante, et
Jennifer Masson, apprentie, pour laide quelles mont apport dans la mise en place des
outils qui seront dcrits dans ce rapport
Lensemble des quipes travaux Maison Parisot, pour leurs connaissances techniques et
laide quelles mont apport sur le terrain
Enfin, Pierre Regenass, professeur de gotechnique lINSA de Strasbourg, pour avoir
accept de suivre ce projet et pour ses conseils sur son avancement.
Pierre-Axel SPETTEL 3/52 Juin 2011
Rsum
Lentreprise Maison Parisot, la base entreprise de peinture et de dcoration cre en 1830
Chaumont, sest dveloppe pour aujourdhui devenir une entreprise gnrale grant des projets de
rnovation de btiments commerciaux (principalement Poste et LCL), puis plus rcemment des
projets de construction de btiments industriels et commerciaux. Une rcente filiale a t ouverte
Strasbourg en 2008.
Pour faire face sa croissance rapide, Maison Parisot se doit de se moderniser. Ainsi, lentreprise a
dcid de mettre en place un systme de management Qualit, dont lobjectif sera dans un premier
temps de permettre lamlioration de la qualit des prestations fournies au client. Dans un second
temps, il sera dobtenir la certification ISO 9001, qui est un gage de confiance considrable pour les
partenaires de lentreprise, et notamment ses clients, qui sont de grosses structures et donc
sensibiliss ces thmatiques.
Ce travail a dj t abord par de prcdents stagiaires. La mission qui ma donc t confie lors de
ce projet de fin dtudes a t dans un premier temps deffectuer un tat des lieux des pratiques de
lentreprise concernant le management de la qualit, puis de mettre en place des outils permettant
de lamliorer.
Mots-cls : systme de management, qualit, ISO 9001, entreprise gnrale, pilotage de projets
Abstract
Maison Parisot, a company founded in 1830 in Chaumont, was at first specialized in painting and
decoration. Nowadays, it has developed to become a general building company managing renovation
projects of company such as La Poste or LCL, and more recently projects of industrial buildings. In
2008, a second agency opened in Strasbourg.
To face its fast growing, Maison Parisot has to modernize. As a consequence, the aim of the company
is to create its own management system of quality. The objectives of this management system are at
first to enable the increase of the general quality that the company provides to its customers.
Secondly, the company wishes to obtain the ISO 9001 label, which is a huge added value for business
partners and customers.
That work has already been touched on during two former internships. The mission which was given
to me, and the main purpose of my internship during these few months was at first to do an analysis
of the existing management system, and then to design and develop new tools that will increase the
quality provided by the company.
Key words : system of management, quality, ISO 9001, projects management
Pierre-Axel SPETTEL 4/52 Juin 2011
Table des figures
Figure 1.1.1. : Organigramme
Figure 1.2.1. : Les missions
Figure 1.4.1. : Droulement dune opration
Figure 2.1.1. : Tryptique Qualit
Figure 2.1.2. : Hirarchie documentaire
Figure 2.2.1. : Systme de management intgr
Figure 2.2.2. : Dynamique PDCA
Figure 2.2.3. : Mthode des 5S
Figure 2.2.4. : Mthode QQOCQP
Figure 2.2.5. : Cartographie des processus
Figure 3.1.1. : Droulement dune opration
Figure 4.6.1. : Logiciel MAEVA BTP
Figure 4.6.2. : Identification des dangers
Figure 4.6.3. : Identification des dangers
Figure 4.6.4. : Estimation du risque
Figure 4.6.5. : Evaluation du risque
Figure 4.6.6. : Plan daction
Figure 5.4.1. : Indicateur de satisfaction
Pierre-Axel SPETTEL 5/52 Juin 2011
Sommaire
Remerciements ....................................................................................................................................... 3
Rsum.................................................................................................................................................... 4
Abstract ................................................................................................................................................... 4
Table des figures ..................................................................................................................................... 5
Introduction ............................................................................................................................................ 8
1. Prsentation de lentreprise........................................................................................................... 9
1.1. Historique ................................................................................................................................ 9
1.2. Les missions ........................................................................................................................... 10
1.3. Prsentation du client principal La Poste ........................................................................... 12
1.3.1. Le contrat cadre............................................................................................................. 12
1.3.2. Les fonds de prquation .............................................................................................. 12
1.3.3. La modernisation des espaces publics .......................................................................... 13
1.3.4. Les optimisations ........................................................................................................... 13
1.4. Droulement dune opration .............................................................................................. 14
2. Description du systme de management existant ...................................................................... 17
2.1. Le concept qualit Introduction ......................................................................................... 17
2.2. Etat des lieux ......................................................................................................................... 19
2.2.1. Le systme de management intgr ............................................................................. 19
2.2.2. Systme de management de la qualit ......................................................................... 23
2.2.3. Problmatique Objectifs ............................................................................................. 26
3. Analyse du Systme de Management Qualit existant .............................................................. 27
3.1. Analyse de lexistant .............................................................................................................. 27
3.2. Analyse de la norme ISO 9001............................................................................................... 32
3.2.1. Introduction ................................................................................................................... 32
3.2.2. Exigences de la norme ................................................................................................... 32
4. Elments mis en place .................................................................................................................. 33
4.1. Indicateur dvaluation des sous-traitants............................................................................ 33
4.2. Questionnaire de satisfaction client...................................................................................... 34
4.3. Indicateur de satisfaction client ............................................................................................ 34
4.4. Indicateur rserves ................................................................................................................ 35
4.5. Indicateur efficacit............................................................................................................... 35
4.6. Document unique Prsentation du logiciel MAEVA BTP .................................................... 36
Pierre-Axel SPETTEL 6/52 Juin 2011
4.6.1. Introduction ................................................................................................................... 36
4.6.2. Lexique prliminaire ...................................................................................................... 37
4.6.3. Cration du Document Unique...................................................................................... 38
5. Amlioration continue.................................................................................................................. 45
5.1. Introduction ........................................................................................................................... 45
5.2. Analyse point par point ......................................................................................................... 45
5.3. Analyse globale des rsultats et conclusion .......................................................................... 46
5.4. Indicateur de satisfaction ...................................................................................................... 48
6. Respect du planning et des objectifs ........................................................................................... 49
Conclusion ............................................................................................................................................. 51
Conclusion gnrale .......................................................................................................................... 51
Exprience personnelle ..................................................................................................................... 51
Laprs PFE......................................................................................................................................... 52
Pierre-Axel SPETTEL 7/52 Juin 2011
Introduction
Ce rapport a pour objectif de prsenter le travail accompli durant mon projet de fin dtudes,
qui a port sur lamlioration du systme qualit existant en vue dune prparation la certification
ISO 9001.
Jai t accueilli par lentreprise Maison Parisot, situe Chaumont dans le dpartement de
la Haute-Marne. Entreprise de peinture lorigine, elle a su se dvelopper pour devenir entreprise
gnrale, pilotant des projets de rnovation de btiments commerciaux, notamment avec La Poste et
LCL. Une prsentation rapide de lentreprise sera faite dans la premire partie de ce rapport.
En plus de mavoir permis dapprendre le mtier de manager projet, par les diffrentes
affaires de pilotage qui mont t confies, lobjectif de mon projet de fin dtudes a t de
reprendre et de complter le travail effectu par de prcdents stagiaires. En effet, lentreprise
souhaite tre certifie qualit, scurit, environnement. Ces certifications prsentent un gage de
confiance pour les clients, qui sont principalement de grosses structures (La Poste, LCL), et qui
sintressent ces problmatiques, qui valorisent le travail de lentreprise.
Dans un premier temps, jai effectu une analyse du travail fourni par les deux prcdents
stagiaires qui se sont penchs sur cette problmatique. Leur travail a t ax sur la cration de
documents structurant la dmarche qualit de lentreprise, ce qui est la premire tape du travail.
Cette documentation tait prsente de manire presque exhaustive avant mon arrive, mon travail
concernant cette partie fut donc dajuster lexistant, cr sans recul du travail de manager
proprement parler.
Jai ensuite approfondi mes connaissances sur le sujet par une analyse attentive de la norme
ISO 9001, qui donne les exigences relatives la certification qualit. Grce cette analyse et la
structure documentaire prsente dans lentreprise, jai mis en place certains outils permettant une
valuation continue du travail fourni.
Aprs une prsentation sommaire de lentreprise qui ma accueilli, de ses missions et du
client principal, je prsenterai une description puis une analyse du systme de management qualit
existant ainsi que de la norme ISO 9001, puis je prsenterai les lments mis en place dans les
domaines de la qualit et de la scurit, pour finalement effectuer une analyse des lments mis en
place concernant lamlioration continue.
Pierre-Axel SPETTEL 8/52 Juin 2011
1. Prsentation de lentreprise
1.1. Historique
Lentreprise Maison Parisot a t cre en 1830. A la base entreprise spcialise en peinture et en
restauration dart, elle sest dveloppe pour aujourdhui devenir une entreprise gnrale grant des
projets cl en main, en se spcialisant dans la rnovation de btiment commerciaux, et plus
rcemment dans la construction de btiments commerciaux et industriels.
En 2008, elle a cr une filiale, Parisot Projet dont les objectifs sont concentrs sur les missions de
management de projet, dentreprise gnrale et de contractant gnral.
Aprs une courte priode dimmersion de 2 semaines dans la filiale de Strasbourg, o jai pu me
familiariser avec la nomenclature des systmes de management intgrs et faire un tat des lieux du
travail effectu dans ce domaine, ma mission au sein de lentreprise et damliorer le systme de
management existant en vue de prparer lentreprise aux certifications QSE.
Ci-dessous, un organigramme rsumant lorganisation de lentreprise :
Jean Philippe Denizet
Grant de lentreprise
Nicolas Ginter Jean-Philippe Denizet
Responsable de lagence Responsable de lagence
Manager de projet Manager de projet
Joanna Durlet Caroline Dupuy Mathilde Mehlinger Marion Engrand Jolle Denizet
Manager de projet Manager de projet Assistante Assistante Comptable
Elodie Ortega
Assistante Pierre-Axel SPETTEL
Stagiaire QSE
Management de projet
Jennifer Masson
Apprentie
Vanessa Bensallah
Apprentie
PARISOT PROJET Fig. 1.1.1. : Organigramme
MAISON PARISOT
Pierre-Axel SPETTEL 9/52 Juin 2011
De plus, lentreprise regroupe galement des quipes travaux propres, constitues de chefs dquipe
et dapprentis, constituant un personnel travaux denviron 25 personnes.
Lentreprise Parisot est une PME qui connait une croissance importante depuis une dizaine danne.
En 1994, elle connaissait un chiffre daffaire denviron 300.000, qui a t port 6.600.000 en
2010.
Les objectifs financiers actuels de lentreprise sont damliorer le chiffre daffaire de 5% par an, et de
diversifier la clientle.
1.2. Les missions
Les missions ralises par Maison Parisot et Parisot Projet sont multiples. Le schma ci-dessous les
rcapitule :
PILOTER & RALISER PRENNISER
Contractant gnral Diagnostic
Entreprise Gnrale Petits travaux
Assistance et matrise douvrage Dcoration, relooking
Matrise duvre de la conception Revitalisation, rafrachissement
Ralisation de chantiers en entreprise gnrale
CONCEVOIR
Audit, tudes
Dfinitions de concepts
Ingnierie, plans
Etude de faisabilit
Proposition de solutions
Ralisation de plans existants et projets
Fig. 1.2.1. : Les missions
La principale mission est celle dEntreprise Gnrale. Elle consiste en lexcution de lensemble des
travaux ainsi que de la gestion du projet, en gnral la demande du matre d'ouvrage. LEntreprise
Gnrale doit coordonner les diffrents acteurs d'un projet aussi bien sur un plan logistique que
financier. Il se doit de respecter la demande du matre d'ouvrage en termes de cot, de rsultats et
de dlais et dorganiser le planning pour mener bien le projet. Enfin, lEntreprise Gnrale assure
Pierre-Axel SPETTEL 10/52 Juin 2011
une gestion simplifie du projet du point de vue client d la prsence dun interlocuteur unique
soccupant de la gestion de tous les lots techniques du projet.
La mission de Contractant Gnral est galement effectue par Parisot Projet (sous un contrat cadre
avec La Poste). Les responsabilits sont identiques celles de la situation en Entreprise Gnrale
mais avec la charge de la phase tude en addition.
Pierre-Axel SPETTEL 11/52 Juin 2011
1.3. Prsentation du client principal La Poste
1.3.1. Le contrat cadre
Le groupe La Poste est le client principal de Parisot Projet, client avec lequel les deux agences
ralisent environ 70% de leur chiffre daffaire.
Le partenariat entre Parisot Projet et le groupe La Poste est rgi par un contrat-cadre, dont lobjectif
est de fixer les conditions gnrales de la coopration des deux entreprises pour les diffrentes
oprations raliser.
Ces contrats-cadre sinscrivent dans un vaste programme du groupe La Poste intitul ERA pour
Entretenir, Rnover, Amnager qui planifie lentretien, la rnovation et lamnagement des locaux
dont La Poste est propritaire.
Le programme ERA dfinit ainsi 3 types de projets dont les objectifs diffrent :
Les fonds de prquation
La modernisation des espaces publics
Les optimisations
Ces trois types de projet sont dcrits exhaustivement ci-aprs.
Dans tous les cas, les objectifs du contrat-cadre sont de dfinir de manire claire les procdures qui
interviennent entre les diffrents intervenants de la maitrise douvrage, de la maitrise duvre et de
lentreprise gnrale.
Dautre part, ce contrat dfinit un bordereau des prix unitaires, propos par lentreprise gnrale et
valid par La Poste, qui cadre les prestations de base redondantes tous les projets et qui est la base
des devis adresss par lentreprise gnrale la maitrise douvrage et la maitrise duvre.
1.3.2. Les fonds de prquation
Les projets dcrits dans le cadre des fonds de prquation concernent en gnral des travaux de
faible envergure, classs en diffrents programmes :
Renouvellement immobilier des bureaux
Amnagement et cheminement daccs pour les personnes mobilit rduite (PMR)
Dlocalisations de bureaux de poste
Mise niveau de la signaltique externe des bureaux de poste
La remise niveau des espaces publics
Pierre-Axel SPETTEL 12/52 Juin 2011
Ces programmes proviennent dun accord entre les mairies, lEtat et La Poste, qui prvoit daffecter
une part des fonds de prquation au financement des dpenses damnagement et dquipements
ncessaires la rnovation des bureaux de poste.
1.3.3. La modernisation des espaces publics
Les projets dcrits dans le cadre de la modernisation des espaces publics (ou modernisation et projet
Espace Service Client ESC) concernent des travaux lourds allant jusqu la rfection complte de
lenseigne. Ces travaux comprennent :
Travaux de cloisonnement
Rfection des sols
Nouvel amnagement des guichets
Travaux de faades
Etc
Le but de ces projets et doffrir aux clients de La Poste un espace daccueil dot dune organisation et
dun visuel revu et standardis .
1.3.4. Les optimisations
Dans le cadre de sa nouvelle stratgie immobilire, La Poste souhaite se sparer dun maximum de
ses biens immobiliers. Les projets dOptimisations sinscrivent dans cette stratgie en prvoyant la
sparation physique du bureau de poste et des parties cdes (qui peuvent comprendre des anciens
logements de fonction, des bureaux inoccups, des sous-sols, etc), La Poste pouvant soit rester
propritaire de ses surfaces (contrat de proprit) ou devenant locataire.
Les travaux prvus dans ces Optimisations comprennent le plus souvent :
Des travaux de sparation physique entre les parties cdes et conserves (cloisonnements
divers, )
Des travaux de sparations des consommations deau, dlectricit, de chauffage, etc
Des travaux disolation coupe-feu
Pierre-Axel SPETTEL 13/52 Juin 2011
1.4. Droulement dune opration
La frise suivante reprend et dtaille les diffrentes tapes du droulement dune opration.
Le client exprime un besoin et le traduit dans un cahier des
Expression du
charges.
besoin
Le programme est consultable suite un appel doffre par les
Appel doffre
entreprises disposant des autorisations ncessaires (contrat cadre,
rfrencement) ou via une consultation du client.
Ces entreprises se lancent dans des recherches dappels doffres et
valuent leur capacit rpondre ou non aux besoins formuls. Si
Recherche leur capacit est juge bonne alors ces entreprises candidatent (si
dappel doffre une candidature est mise en place). Si leur candidature est juge
recevable par le client, alors ces entreprises disposent du DCE pour
tablir leur proposition. Le DCE est directement accessible dans le
cas o une phase de candidature nest pas organise.
Recherche Une recherche des partenaires est indispensable car peu dentreprise
partenaires et disposent de lensemble des services ncessaires la ralisation des
sous-traitants besoins du DCE (quipe travaux selon diffrents lots, bureaux
dtudes). Ces partenaires seront pilotes par lentreprise en
contractant gnral.
Etudes Dans le cas o Parisot Projet est Contractant Gnral, la mission de
conception et dtudes est aussi sous sa responsabilit.
La phase doffre se caractrise par lvaluation (plus ou moins prcise
dans un premier temps) des cots dcoulant des besoins formuls
dans le DCE. Cette valuation est appele DPGF (Dcomposition du
Prix Global et Forfaitaire) et retranscris lensemble des diffrentes
Devis actions accomplir pour satisfaire le client. Chaque action est
value financirement.
Cette offre (ou devis) est remise au client. Il choisit loffre qui lui
convient le mieux selon ses propres critres ou ngocie des
modifications apporter loffre si lentreprise est en contrat cadre
(lentreprise na pas candidater mais doit assurer des missions
obligatoires auxquelles elle naurait peut-tre pas candidat ; par
exemple Parisot Projet est en contrat cadre avec La Poste).
Une fois loffre accepte, la phase travaux est lance. Lentreprise
Phase travaux envoie ses bons de commande aux partenaires pour leur indiquer
lexacte tche accomplir.
Pierre-Axel SPETTEL 14/52 Juin 2011
Les partenaires sengagent excuter les missions stipules
dans les bons de commande et lentreprise soccupe du pilotage
des travaux, planning et suivi de chantier ainsi que de la gestion
financire.
Une fois les travaux excuts et rceptionns par
Factures ST lentreprise, cette dernire sengage payer les prestations
accomplies par les partenaires selon les factures ou confie le
paiement des partenaires directement au client (paiement direct).
Une fois lensemble des rceptions des partenaires,
Rception lentreprise propose (selon les dlais tablis dans la commande) la
rception pour le client.
Une fois la rception accepte (aprs leve de rserves
Facture CLIENT possibles) par la signature dun procs-verbal, une facture est
envoye au client afin que ce dernier sengage payer
lentreprise les prestations commandes dans loffre.
La traabilit de toutes ces tapes se fait sur plusieurs
Enregistrement niveaux. La matrise des enregistrements est la preuve des rsultats
obtenus et des tches effectues.
Satisfaction
Fig. 1.4.1. : Droulement dune opration
Cette analyse du droulement dune opration fait entirement partie de la dmarche qualit. En
effet, elle permet de mettre en avant naturellement les diffrents processus et procdures quil
faudra ensuite formaliser. Ce schma a servi de base pour la cartographie des processus qui tisse
lensemble des liens entre les diffrents processus afin de garantir la satisfaction du CLIENT selon ses
attentes. Comme nous allons voir plus loin dans ce rapport, il est important de formaliser cette
cartographie pour viter loubli de processus ou dtape dans le droulement dune opration.
N.B. : alternativement au processus de candidatures, il existe galement un autre type de contrat dit
contrats cadre. Comme nous lavons en voquant le client principal de lentreprise, La Poste, un
contrat-cadre est un type de contrat qui fixe les rgles des relations futures entre les parties, soit les
conditions dans lesquelles de futurs contrats entre les parties seront fixs. La spcificit d'un contrat
cadre rside dans la dtermination du prix de la prestation. Cest--dire que Maison Parisot se voit
Pierre-Axel SPETTEL 15/52 Juin 2011
confi un ensemble de projets venir de manire confirme (la candidature est court-circuite).
Cependant, Parisot Projet sengage satisfaire tous les projets venir sans rellement connaitre les
dtails de ces futurs projets. Il est alors possible (et courant) dhriter de projets auxquels
lentreprise naurait pas pos candidature en temps normal (petits travaux pour de grands
dplacement), ce qui nest pas
Pierre-Axel SPETTEL 16/52 Juin 2011
2. Description du systme de management existant
2.1. Le concept qualit Introduction
La qualit est lensemble des caractristiques dune entit qui lui confrent laptitude satisfaire des
besoins exprims ou implicites, daprs la norme ISO 8402. En dautres mots, la qualit est la
conformit dun produit par rapport aux exigences du client apporte par le fournisseur.
Il sagit de la maitrise (connaissance des entrants-sortants de ltat du service en plusieurs points ...)
des missions effectues au sein de lentreprise dans le but de rpondre des besoins formuls par le
client en incluant les facteurs dlai et cots.
La mise en place dun systme qualit apporte de
nombreux bnfices lentreprise tels que :
Fig. 2.1.1. : Tryptique Qualit
Amlioration des rsultats conomiques de Personnel plus responsabilis, se sentant mieux
l'entreprise reconnu et plus motiv
Amlioration de la satisfaction des clients Modes de fonctionnement interne simplifis et plus
Meilleure connaissance des besoins des clients et efficaces
une meilleure anticipation de leurs futurs besoins Diminution des erreurs par des systmes de boucles
Meilleure image de l'entreprise correctives
Plus grande rigueur dans les mthodes Baisse des cots de non-qualit qui sont souvent
Des processus simplifis, mieux formaliss et levs et cachs
matriss Meilleure prise en compte des questions de scurit et
d'environnement
La version en vigueur de la norme ISO 9001 est la version date de novembre 2008. Les exigences y
sont relatives quatre grands domaines :
1. Responsabilit de la direction : exigences d'actes de la part de la direction en tant que
premier acteur et permanent de la dmarche.
2. Systme qualit : exigences administratives permettant la sauvegarde des acquis. Exigence
de prise en compte de la notion de systme.
3. Processus : exigences relatives l'identification et la gestion des processus contribuant la
satisfaction des parties intresses.
4. Amlioration continue : exigences de mesure et enregistrement de la performance tous les
niveaux utiles ainsi que d'engagement d'actions de progrs efficaces.
Pierre-Axel SPETTEL 17/52 Juin 2011
La version 2008 de cette norme vise mettre en uvre dans l'entreprise un systme de
management de la qualit orient client et fond sur les notions d'efficacit des processus et
d'amlioration continue. Ce systme, impliquant l'ensemble du personnel dans la matrise des
activits et l'atteinte de rsultats - dont la satisfaction du client - est un excellent outil pour favoriser
la performance de l'entreprise et la durabilit. Mettre en uvre un systme de management de la
qualit selon les exigences de la norme ISO 9001 : 2008 c'est : Dmontrer laptitude fournir
rgulirement un produit conforme aux exigences du client et de mettre en uvre un processus
damlioration continue .
Le Systme de Management de la Qualit est la mise en uvre des actions planifies (documentes,
systmatises) et des techniques d'organisation qui permettent lentreprise de s'engager dans un
cycle d'amlioration continue, selon le schma ci-dessous :
Fig. 2.1.2. : Hirarchie documentaire
Le manuel unique QSE dfinit la politique qualit de lentreprise en termes de systme de
management intgr (qualit, scurit, environnement). Concernant la qualit, il dfinit une
cartographie des processus (dcrite ci-aprs).
Une fois cette cartographie tablie, les fiches de dfinition des processus dfinissent une
documentation utiliser pour chaque tape du droulement dune opration.
Cette documentation permet enfin de mettre en place tous les lments ncessaires lamlioration
continue (enregistrements, indicateurs, bases de donnes)
Pierre-Axel SPETTEL 18/52 Juin 2011
2.2. Etat des lieux
A mon arrive dans lentreprise, un certain nombre de points avaient dj t traits par deux
prcdents stagiaires, en 2009 et 2010.
Leur travail a notamment t ax sur la description exhaustive des processus rgissant le
droulement dune affaire au sein de lentreprise, et dans une certaine mesure, la cration
documentaire dicte par ces processus.
Ce travail de base est ncessaire pour comprendre la logique intrinsque des diffrentes actions qui
rgissent lorganisation des projets, et permettre ainsi de mettre en uvre des outils visant
amliorer chaque tape la qualit du travail fourni.
Il permet en effet de suivre minutieusement le droulement dune opration, et didentifier les
points cls permettant de mettre en place des outils visant lamlioration continue.
Le systme de management de lentreprise sarticule autour dun document unique : le manuel QSE
(pour Qualit Scurit Environnement).
Ce manuel dfinit la politique qualit de lentreprise en termes de systme de management intgr,
dengagement de la direction, de management des ressources, de systmes de mesure et
damlioration.
Il sappuie sur diffrents documents normatifs :
La norme ISO 9001 qui traite des spcifications du management de la qualit
La norme OHSAS 18001 qui traite de la scurit dans les entreprises
La norme ISO 14001 qui traite du management de lenvironnement
Ci-aprs, nous dfinirons les objectifs dun systme de management intgr ainsi que ses objectifs.
2.2.1. Le systme de management intgr
Le Systme de Management Intgr (SMI) est le rsultat de lintgration des systmes Qualit,
Scurit et Environnement. Il permet de prendre en considration tous les domaines d'activit de
l'entreprise et dassurer la cohrence et la synergie entre eux. Plusieurs bnfices accompagnent
l'adoption de ce systme dont principalement les conomies de temps, d'efforts et d'argent, et une
amlioration continue de la satisfaction des besoins des clients.
La coordination du systme est facilite par le choix de la structure organisationnelle suivante selon
trois axes : SMQ, SMS, SME.
Pierre-Axel SPETTEL 19/52 Juin 2011
La figure suivante permet dillustrer et de synthtiser cette structure :
Systme de Management Intgr
(SMI)
Systme de Management Systme de Management Systme de Management
de la Qualit de la Scurit Environnemental
(SMQ) (SMS) (SME)
Fig 2.2.1. Systme de management intgr
Concrtement, le SMI dfinit des outils pour la conception et la mise en place dun systme de
management performant.
Ces outils sont des mthodes de travail qui permettent de structurer llaboration des systmes de
management Qualit, Scurit, et Environnement. Ce sont des outils de travail gnraux, qui ne sont
pas spcifiques Parisot. Les principaux sont :
Pierre-Axel SPETTEL 20/52 Juin 2011
La roue de Deming
Le premier outil, universellement reconnu dans les systmes de management est la dynamique
PDCA, pour Plan Do Act Check, aussi appele Roue de Deming.
Act mise en uvre dactions Plan Projection dans le futur, vision
correctives, stabilisation des rsultats court et moyen terme, planification
positifs et prvention de la dobjectifs prioritaires, laboration des
rcurrence des mauvais rsultats. plans et implication du personnel.
Bilan permettant la planification de
nouveaux objectifs.
Check Vrification que les actions Do Mise en uvre du systme et
planifies sont bien raliss et que les ralisation des objectifs
objectifs fixs sont atteints.
Fig. 2.2.2. : Dynamique PDCA
Cet outil permet de mettre en place une amlioration continue au sein des diffrents
systmes de management QSE.
Mthode 5S
Le nom 5S provient des mots japonais qui dfinissent les 5 oprations mener dans le cadre du
Systme de Management de la Qualit.
Oprations Mot japonais
Opration
Seiri = Dbarras
1
Opration
Seiton = Rangement
2
Opration
Seiso = Nettoyage
3
Opration
Seikeitsu = Ordre
4
Opration
Shitsuke = Rigueur
5
Pierre-Axel SPETTEL 21/52 Juin 2011
Donc, elle repose sur cinq principes simples :
DBARRASSER
RIGUEUR RANGER
ORDRE NETTOYER
Fig. 2.2.3. : Mthode des 5S
Cet outil permet simplement de crer un espace de travail propice lefficacit. Son application a
plusieurs buts, chaque S un objectif propre :
- Allger l'espace de travail de ce qui y est inutile
- Organiser l'espace de travail de faon efficace
- Amliorer l'tat de propret des lieux
- Prvenir l'apparition de la salet et du dsordre
- Encourager les efforts allant dans ce sens
L'ensemble du systme permet par ailleurs :
- D'amliorer les conditions de travail et le moral du personnel (il est plus agrable de travailler dans
un lieu propre et bien rang)
- De rduire les dpenses en temps et en nergie
- De rduire les risques d'accidents et/ou sanitaires
- D'amliorer la qualit de la production
Pierre-Axel SPETTEL 22/52 Juin 2011
Mthode Q.Q.O.C.Q.P.
La mthode Q.Q.O.C.P.Q. permet la collecte exhaustive et rigoureuse de donnes prcises en
adoptant une dmarche d'analyse critique constructive base sur le questionnement systmatique.
Elle permet galement de structurer un expos des faits ou d'un problme en posant (et en
rpondant ) un minimum de questions. Mthode simple de recherche dinformations et de mise en
place de solutions, elle sera plus souvent utilise pour la planification des processus.
Q De qui, Avec qui ? Responsable, acteur, sujet
Q Quoi, Avec quoi ? Outil, objet, rsultat
O O ? Lieu, service
C Comment, par quel Procdure, technique, action
procd ?
Q Quand ? Date, priodicit, dure
P Pourquoi ? Justification, raison d'tre
Fig 2.2.4. : Mthode QQOCQP
Le manuel QSE a galement pour objectif de dfinir les responsabilits, les comptences, ainsi que la
hirarchie de lentreprise. Dautre part, il dfinit les exigences relatives la documentation, la
maitrise des documents et des enregistrements.
2.2.2. Systme de management de la qualit
Le Systme de Management de la Qualit est la mise en uvre des actions planifies (documentes,
systmatises) et des techniques d'organisation qui permettent lentreprise de s'engager dans un
cycle d'amlioration continue.
Son but est de permettre lentreprise de satisfaire au mieux aux besoins et aux exigences de ses
clients. Cest ce domaine qui va principalement concerner mon projet de fin dtudes.
Pierre-Axel SPETTEL 23/52 Juin 2011
La premire tape dans la mise en place dun SMQ consiste tablir une cartographie des
processus en se basant sur lactivit de lentreprise et le droulement des oprations qui la
concerne :
Fig. 2.2.5. : Cartographie des processus
Ces processus sappuient sur des procdures, formulaires et indicateurs/bases de donnes. Ils sont
tous identifis et rpertoris dans le manuel QSE :
Processus
SMQ-PRO-01 : Droulement dune opration SMQ-PRO-08 : Maitrise des enregistrements
SMQ-PRO-02 : Appels dOffres SMQ-PRO-09 : Maitrises des actions correctives
SMQ-PRO-03 : Devis SMQ-PRO-10 : Maitrise du produit non conforme
SMQ-PRO-04 : Bon de Commande ST SMQ-PRO-11 : Audit interne
SMQ-PRO-05 : Facturation ST
SMQ-PRO-06 : Facturation Client
SMQ-PRO-07 : Maitrise des Documents
Pierre-Axel SPETTEL 24/52 Juin 2011
Procdures / Instructions
SMQ-INS-01 : Absences
SMQ-INS-02 : Gestion des Appels
SMQ-INS-03 : Fonctionnement Interne de lAgence Strasbourg
SMQ-INS-05 : Rangement du Bureau
Outils et formulaires
SMQ-FOR-01 Check-list pour 1re visite SMQ-FOR-10 Tableau des Marges
SMQ-FOR-02 Offre Chiffrage SMQ-FOR-11 Lettre Envoi Devis
SMQ-FOR-03 Lettre de motif de refus
SMQ-FOR-04 Bon de commande ST
SMQ-FOR-05 Facture ST
SMQ-FOR-06 Facture CLIENT
SMQ-FOR-07 PV de rception ST
SMQ-FOR-08 PV de rception Client
SMQ-FOR-09 Questionnaire de satisfaction client
Indicateurs / Bases de donnes
SMQ-BD-01 Indicateur Evaluation ST
SMQ-BD-02 Indicateur Satisfaction Client
SMQ-BD-03 Indicateur Rserves
SMQ-BD-04 Indicateur Efficacit
SMQ-BD-05 Indicateur scurit / environnement
SMQ-BD-06 Base de Donnes de Prix Unitaires
SMQ-BD-07 Contrle Appel dOffres et Devis
SMQ-BD-08 Contrle des Factures ST
SMQ-BD-09 Contrle des Facture Clients
Ces diffrents lments seront fournis en annexe. Sont recenss ici les documents cres par les deux
prcdents stagiaires (ceux-ci tant majoritairement corrigs durant mon PFE) et par moi-mme.
Laccent sera mis sur les indicateurs et bases de donnes, qui sont la base de lamlioration continue,
cur du systme de management qualit, et qui seront dcrits de faon exhaustive dans ce rapport.
Pierre-Axel SPETTEL 25/52 Juin 2011
2.2.3. Problmatique Objectifs
Nous avons jusqualors abord diffrents points :
Une prsentation de lentreprise, de son environnement de travail et de ses objectifs afin de
cerner lenvironnement dans lequel elle volue
Une introduction aux concepts et bnfices divers des systmes de management qualit
Le dveloppement rapide de Maison Parisot, pass dentreprise de peinture au statut dentreprise
gnrale en forte croissance, passe par une modernisation de sa gestion.
Lentreprise a donc dcid de mettre en place un systme de management Qualit, dont lobjectif
sera dans un premier temps de permettre lamlioration de la qualit des prestations fournies aux
clients, puis dans un second temps, dobtenir la certification ISO 9001 qui est un gage de confiance
considrable pour les partenaires de lentreprise, et notamment ses clients, qui sont de grosses
structures et donc sensibiliss ces thmatiques.
Dautres stagiaires ont pu se pencher sur cette problmatique ce jour. Les objectifs fixs en dbut
de PFE consisteront donc :
Effectuer un tat des lieux et une analyse de lexistant, et des pratiques de lentreprise
concernant le management de la qualit
Effectuer une analyse fine de la norme ISO 9001 afin de dtecter des ventuelles
erreurs/incomprhensions dans le travail de recensement/cartographie des processus
Palier aux manquement/diffrences nots entre lexistant et les exigences relatives la
norme ISO 9001
Reprendre entirement, de crer et de complter les documents prsents et dcrit dans le
manuel QSE
Mettre en place des outils de contrle de qualit des prestations fournies, et permettant de
mettre en place une amlioration continue
De faire connaitre et utiliser cette documentation par les diffrents intervenants de
lentreprise
Un bilan des objectifs raliss sera donn la fin de ce mmoire.
Pierre-Axel SPETTEL 26/52 Juin 2011
3. Analyse du Systme de Management Qualit existant
3.1. Analyse de lexistant
La premire tape de ce travail a consist faire une analyse fine et point par point des processus
dcrits dans le manuel QSE ainsi que des procdures/outils/indicateurs qui sy rattachent.
Le but de cette analyse tait de dterminer les divergences ventuelles entre ce qui est dcrit dans
les fiches de processus, se rattachant directement la cartographie prsente dans le manuel QSE, et
les pratiques de lentreprise.
Ci-dessous, un schma rappelant le droulement dune opration :
Pierre-Axel SPETTEL 27/52 Juin 2011
Consultation par le Contrat cadre avec
CLIENT le CLIENT Indicateur Efficacit
Besoins Recherche des
appels doffres DCE obtenu (Candidature possible)
formuls
SMQ-PRO-02
ST choisis Modifications si contrat cadre
Mise en rserves et
Choix ST Ordres de Ngociations en consultation
modifications pour
service signs
Veille Approbation leves de rserves
responsable
dagence
SMQ-BD-01 Visite avant
DPGF Donnes
Indicateur Efficacit
Indicateur satisfaction ST
Devis
Offre refuse
SMQ-FOR-01
DCE SMQ-PRO-03 Offre accepte : ordre de service sign
Indicateur Satisfaction Client
Bon de Indicateur Rserves
SMQ-FOR-11 commande ST BdC envoy Indicateur Scurit / Environ.
Indicateur Satisfaction ST
DPGF valid par CLIENT
SMQ-PRO-04
Rapports de runions
Facteur Facteur Suivi des travaux de chantiers
dclenchant dclenchant
externe SMQ-FOR-04
interne
SMQ-FOR-12 Ouvrage rceptionn
Rception
Entre Activit Sortie Paiement
Factures ST ou
paiement
SMQ-FOR-12 SMQ-PRO-05 direct par
CLIENT
SMQ-FOR-12
Fig. 3.1.1. Droulement dune opration Facture CLIENT
Ressource humaine, Paiement
matrielle ou financire SMQ-PRO-06
SMQ-FOR-05 SMQ-FOR-06
Pierre-Axel SPETTEL 28/52 Juin 2011
Le manuel QSE recense 11 processus qui dcrivent exhaustivement le mode de fonctionnement de
lentreprise et les outils mis en place pour les contrles qualit :
Droulement dune opration
Ce processus a pour but de dcrire exhaustivement le droulement dune opration, dune part, par
le schma prsent plus haut (Fig 4.1.1.), et dautre part, en terme de cartographie des processus.
Recherche des appels doffre
Ce processus a pour but de dcrire la faon dont sorganise la recherche des appels doffre. Il cite
notamment les principales sources de recherche, et savrera utile pour la formation du personnel
charg de ces tches.
Devis
Ce processus est mis en parenthse depuis lobtention par lentreprise dun logiciel de devis
permettant un suivi direct entre les deux agences.
Bon de commande sous-traitant
Ce processus a pour but de dcrire lorganisation des commandes passes aux sous-traitants. Il
contient un modle denvoi de bon de commande, ainsi quune base de donnes permettant le
contrle des factures.
Facturation sous-traitant
Ce processus a pour but de dcrire lenregistrement de factures sous-traitants. Il dfinit la base de
donnes cite plus haut, ainsi quun indicateur dvaluation des sous-traitants qui sera cr et
dfinit plus loin dans ce rapport (Chapitre 4. Elments mis en place).
Facturation client
Ce processus a pour but de structurer les rgles de facturation des clients, et notamment une base
de donnes denregistrement des factures. Dautre part, il dfinit un indicateur rserves qui sera
cr et dfinit plus loin dans ce rapport (Chapitre 4. Elments mis en place).
Maitrise des documents
Ce processus a pour but de dfinir la mise en place de tout nouveau document relatif au systme de
management (expression du besoin, validation du besoin, rdaction du document, approbation).
Pierre-Axel SPETTEL 29/52 Juin 2011
Maitrise des enregistrements
Ce processus a pour but de dfinir et de maitriser la gestion des enregistrements : classement,
archivage,
Actions correctives
Ce processus a pour but dassurer la gestion des actions correctives (suite un problme rel) et des
actions prventives (suite un problme potentiel). Il dfinit galement une base de donnes des
non-conformits.
Maitrise du produit non-conforme
Ce processus a pour but lenregistrement des non-conformits identifies dans le processus de
satisfaction du client afin de mettre en place les actions correctives adquates.
Audit interne
Ce processus a pour but dassurer lorganisation et le bon droulement daudits internes en vue de
rvision dobjectifs, suivi qualit, rsolution dvnements non conformes planification correctif et
prventif.
Analyse
Lanalyse de la description de ces processus amne les conclusions suivantes :
Les processus existent sur le papier, ainsi que la certains des documents qui y sont dcrits
(formulaires, base de donnes, indicateurs, ). En pratique, trs peu de ces documents sont utiliss
(soit ils ne le sont pas du tout, soit dautres documents sont utiliss la place). Ils seront modifier
ou crer au fur et mesure de lexprience de pilotage de projet acquise.
Les processus et tapes de la ralisation du produit sont tous biens dfinis (SMQ-PRO-xx).
Concernant les formulaires (SMQ-FOR-xx), il reste crer les n5 et 6 (facturation sous-
traitant et facturation client) ainsi que les n12, 13, 14 et 15. Aucun nest pour le moment
utilis sauf le n4 (bon de commande sous-traitant), mais il reste modifier.
Les bases de donnes et indicateurs (SMQ-BD-xx) ne sont utiliss que trs marginalement
(seules les SMQ-BD-08 et 09 contrle des factures ST et client - sont utilises). Laccent sera
mis sur ces outils qui sont au cur de lamlioration continue.
Les instructions SMQ-INS-xx (01, 02, 03, et 05) sont utilises.
Pierre-Axel SPETTEL 30/52 Juin 2011
Les objectifs seront donc :
Premirement, de reprendre entirement, de crer et de complter autant que possible les
documents prsents et dcrits dans le manuel QSE
De faire une mise jour de ce manuel
Crer et mettre en place les outils qui seront au cur de lamlioration continue (voir
Chapite 4.Elments mis en place)
Enfin, de faire connaitre et utiliser cette documentation par les diffrents intervenants de
lentreprise
N.B. : une analyse plus complte des processus et documents qui sy rattachent et disponible en
annexe pour information.
Pierre-Axel SPETTEL 31/52 Juin 2011
3.2. Analyse de la norme ISO 9001
3.2.1. Introduction
Aprs avoir repris point par point le manuel QSE et la description des processus encadrant le
droulement dune opration, je me suis directement intress la comprhension de la norme ISO
9001, encadrant de faon gnrale les systmes de management de la qualit.
Lobjectif tait de comparer lbauche de systme qualit existant avec les objectifs fix par la norme
ISO 9001, en en veillant ce que chaque consigne prsente dans la norme soit respecte .
3.2.2. Exigences de la norme
La norme ISO 9001 dfinit les exigences relatives la certification des systmes de management
Qualit, en termes :
De systme de management
De responsabilit de la direction
De management des ressources
De mesures, danalyses et damlioration
Lanalyse complte et point par point de cette norme ne sera pas traite directement dans le
mmoire, mais est fournie en annexe.
Aprs cette analyse, les conclusions sont les suivantes :
Beaucoup de choses restent traites de manire superflue
Lengagement de la direction na pas t trait, probablement parce que les
prcdents stagiaires ntaient pas en contact avec la direction
Les objectifs de la politique qualit dfinis dans la manuel QSE sont revoir, ainsi
que la communication (mise disposition des documents, information, )
Instaurer un systme permettant un contrle qualit et une amlioration continue,
point crucial de la norme ISO 9001
Mettre en place des revues de direction / audits internes bass sur les rsultats des
enqutes de satisfaction
Reste dfinir le processus encadrant les revues de direction
Enfin, beaucoup dincohrences figurent encore dans le manuel QSE : fiches de
processus qui nexistent pas, erreurs entre les processus/formulaires/outils/bases
de donnes, Celui-ci devra donc tre repris dans son ensemble
Pierre-Axel SPETTEL 32/52 Juin 2011
4. Elments mis en place
Suite ces deux analyses, il ma paru important de mettre en place les premiers lments
permettant un retour dexprience, une amlioration continue et une amlioration de la qualit
gnrale.
Avec les pilotes de projet de la filiale strasbourgeoise, jai donc mis en place des outils qui sont ds
prsent utiliss.
4.1. Indicateur dvaluation des sous-traitants
Cet outil sert lvaluation des sous-traitants : il permet, aprs une collaboration sur un projet, de
mettre en avant ou non le travail du sous-traitant afin denvisager de permettre aux pilotes de
projet de choisir ceux qui sont le plus performant.
Cet indicateur se compose dun outil de calcul pour lvaluation des sous-traitants, bas sur 2 critres
principaux :
La partie administrative, compose dune valuation sur les dlais de rponse, le cot, le
respect du cahier des charges, linnovation et les certifications
La partie excution, compose dune valuation sur le respect du planning, le passif des
accidents, la communication et la disponibilit, la qualit des prestations, les aspects
environnementaux et scuritaires, la ractivit, le SAV, le dossier des ouvrages excuts et la
propret/nettoyage du chantier
La partie administrative est pondre 40%, et la partie excution 60%. Ce choix a t fait de telle
sorte mettre plutt laccent sur la partie technique. Il est pour le moment arbitraire, mais des
modifications ou des ajustements pourront tre apports au fil des notations si lon se rend compte
que certains aspects prvalent sur dautres.
Loutil de calcul est simple utiliser : il suffit de cocher des caches pour chaque critre, le rendant
conforme, acceptable, amliorer, ou non conforme. Lutilisateur peut saider du guide dvaluation
prsent dans loutil sil a des doutes sur la faon dont les cases doivent tre coches.
Loutil renvoi ensuite un pourcentage de satisfaction, qui sera reporter dans la base de donnes des
sous-traitants. Cette base de donnes renseigne sur le nom, le lot, le dpartement dintervention, le
projet, les coordonnes du responsable ayant opr sur le projet, le pilote de projet charg de
laffaire, etc. Il renseigne galement sur lvaluation obtenue aprs chaque projet : A (90-100%), B
(80-89%), C (70-79%), et D (<70%).
Loutil permet enfin de classer les sous-traitants selon chaque critre voqu ci-dessus, le plus
intressant tant bien entendu de pouvoir mettre en avant les sous-traitants classs A afin de
pouvoir collaborer avec eux sur de futures oprations.
Pierre-Axel SPETTEL 33/52 Juin 2011
4.2. Questionnaire de satisfaction client
Cet outil est la cl de voute du principe damlioration continue, et servira de base aux futures
revues de direction et audit internes.
Le principe est, aprs chaque opration, denvoyer un questionnaire de satisfaction au client afin
davoir un retour sur le projet ralis. Son principe est dtre le plus concis et clair possible tout en
donnant une bonne ide globale de la satisfaction du client. La raison cela est quun questionnaire
long et lourd comprendre sera rebutant remplir, et quil est dj souvent difficile dobtenir des
clients quils prennent le temps de remplir un questionnaire de satisfaction mme rapidement
rempli.
Lentreprise est note sur les critres suivant :
Respect du planning
Respect du budget
Respect du cahier des charges
Communication/disponibilit
Qualit des prestations
Propret/scurit/environnement
Innovation
Satisfaction gnrale
La notation peut tre satisfaisante, plutt satisfaisante, peu satisfaisante ou insuffisante.
Une fois les retours de questionnaires rceptionns, ils sont consigns dans la base de donnes de
satisfaction dcrite ci-dessous.
4.3. Indicateur de satisfaction client
Une fois les questionnaires de satisfaction rceptionns, les rsultats sont retranscrits dans loutil de
calcul de satisfaction qui, comme pour les sous-traitants, retourne un pourcentage de satisfaction.
Cette note est ensuite retranscrite dans une base de donnes qui rpertorie la date, le client et le
projet, puis la note de satisfaction obtenue, et calcule ensuite un taux de satisfaction moyen, qui
permet de juger de la qualit de lentreprise sur le plus long terme.
Une prsentation powerpoint a t mise disposition des pilotes de projet pour lutilisation de ces
diffrents outils
Pierre-Axel SPETTEL 34/52 Juin 2011
4.4. Indicateur rserves
Cet indicateur ne permet pas de comptabiliser le nombre de rserves au sens strictement numrique
car ceci a t jug peu pertinent. Cependant, il permet de comparer la part de projet rceptionns
sans rserves, la part de projets dont les rserves sont leves dans les dlais, et la part de projets
dont les rserves sont leves hors dlai. Il permettra le suivi de la gestion des rserves et donc
lamlioration continue suite lanalyse des donnes obtenues dans le but dassurer une meilleure
satisfaction du client.
Le rsultat obtenu est un pourcentage. La difficult de cet indicateur rside dans le fait quil est
possible dattribuer un dlai de leve de rserves trop important et donc de satisfaire en thorie
un grand nombre de leve de rserves. Il est important de choisir judicieusement ce dlai sous peine
de rendre inutile cet indicateur. Cet indicateur sera donc un signal sur la capacit de Parisot Projet
rpondre dans cette situation. Le dpassement dun certain seuil fix par la Direction entrainera la
mise en place dun plan damlioration suite aux futurs audits et revues de direction. Il pourra
prendre deux formes distinctes avec la mise en place dactions correctives (Comment satisfaire ces
rserves ?) ou prventive (Comment viter ces rserves ?).
4.5. Indicateur efficacit
Cet indicateur renvoie le nombre de projets accepts issus de candidatures par rapport au nombre
de projet candidats. Cet indicateur permet lentreprise de vrifier son niveau face la
concurrence et de pouvoir le cas chant apporter des modifications sa structure si les rsultats ne
sont pas ceux escompts.
Lefficacit est mesure lors des deux phases o le client dispose du choix pour lEntreprise Gnrale.
La premire mesure (1er tour) sopre au niveau de la candidature. Il sagit dun premier choix
dentreprise pour le client justifi par des critres tel que lexprience, ses rfrences, le niveau de
logistique de lentreprise. Si lentreprise passe cette tape, elle a alors accs au DCE et peut ensuite
proposer une offre au client. Ce dernier opre un dernier choix (2nd tour) parmi les entreprises
restantes.
Ces deux outils de contrle sont encore en phase de conception et ne sont pas totalement finaliss.
Pierre-Axel SPETTEL 35/52 Juin 2011
4.6. Document unique Prsentation du logiciel MAEVA BTP
Fig 4.6.1. : Logiciel MAEVA BTP
4.6.1. Introduction
Le dcret du 5 novembre 2001 (et sa circulaire dapplication du 18 avril 2002) impose aux entreprises
une nouvelle obligation : celle de formaliser leurs risques propres dans un document unique.
Lobjectif principal du document unique rside dans la mise en uvre dun plan daction - prvention
visant maitriser les risques encourus par le personnel de lentreprise.
Le logiciel MAEVA BTP est une mthode danalyse et dvaluation des risques professionnels, et
permet de crer rapidement un Document Unique dvaluation des risques relatifs la sant et la
scurit.
Jai pu suivre une formation dispense par lOPPBTP pour lutilisation et la prise en main de ce
logiciel, que nous allons aborder ci-aprs.
Pierre-Axel SPETTEL 36/52 Juin 2011
4.6.2. Lexique prliminaire
Quelques dfinitions :
Danger
Il y a danger ou nuisance quand un matriel, un matriau, un produit, un mode opratoire,
une organisation, est capable de provoquer un dommage potentiel immdiat ou diffr.
Les dangers sont typs scurit (accident du travail) ou sant (maladie professionnelle).
Exemple : chute de hauteur (scurit), troubles musculo-squelettiques et maladies associes
(sant)
Situation de danger
Situation de travail ou matriel pouvant prsenter un danger ou une nuisance.
Exemple : soudage larc, pulvrisation de colles
Combinaison Situation de danger / Danger (SD / D)
Une situation de travail peut tre lorigine de plusieurs dangers diffrents, on considre
donc les combinaisons Situation de danger / Danger.
Exemple : Utilisation dappareil de levage => Basculement, renversement
Utilisation dappareil de levage => Retombe de la charge
Niveau de danger
Le niveau de danger est une valeur se rapportant limportance thorique du dommage
potentiel. A chaque combinaison SD / D est attribu un niveau de danger (valeur indique
entre parenthse). On distinguera ici 4 niveaux de danger selon une chelle de niveaux de 1
1000.
Echelle des niveaux de danger
1 : Blessure lgre atteinte lgre la sant pas darrt de travail
10 : Sans effet irrversible sur la sant pas darrt de travail
100 : Possibilit deffets irrversibles sur la sant et incapacit permanente
1000 : Danger mortel
Risque
Il y a risque lorsquune personne est expose un danger. Le risque est donc la combinaison
dun danger et de lexposition ce danger.
Mtier
Le mtier reprsente les activits exerces dans lentreprise. A chaque mtier est associ un
ensemble de combinaisons SD / D et leur niveau de danger correspondant.
Pierre-Axel SPETTEL 37/52 Juin 2011
4.6.3. Cration du Document Unique
La dmarche dvaluation des risques seffectue en 5 tapes :
Identification des dangers
Estimation du risque Document Unique
Evaluation du risque
Analyse
Plan daction
Plan daction
Nous allons aborder ces diffrentes tapes.
Identification des dangers
Dans cette partie, lutilisateur choisit les risques inhrents aux diverses professions exerces dans
lentreprise. Une liste de risques et propose lutilisateur.
Dautre part, MAEVA BTP sappuie sur une liste de 20 mtiers dont les situations de dangers sont
dj rpertories. Cest la faon la plus simple de procder, car elle vite davoir passer en revue
trop de situations risque qui ne concernent pas lentreprise.
Fig 4.6.2. : Identification des dangers
Pierre-Axel SPETTEL 38/52 Juin 2011
Slection des situations de danger Choix du mtier
Le logiciel indique le type de danger, sa
consquence, et son niveau de danger
Fig 4.6.3. : Identification des dangers
La fonction de ltape 1 et didentifier les combinaisons Situation de danger / Danger laide de la
base de donnes.
Pierre-Axel SPETTEL 39/52 Juin 2011
Estimation du risque
Dans cette partie, lutilisateur devra estimer la frquence dexposition de chaque situation de danger
quil a slectionn.
Slection de la frquence
dexposition au danger
Le logiciel indique lestimation du risque
pour chaque combinaison SD / D
Fig 4.6.4. : Estimation du risque
La fonction de ltape 2 et destimer le risquer en dterminant, pour chaque combinaison SD / D
identifie prcdemment, la frquence moyenne dexposition du personnel au danger.
Pierre-Axel SPETTEL 40/52 Juin 2011
Calcul de lestimation du risque
Le calcul de lestimation du risque sopre partir du niveau de danger et de la frquence moyenne
dexposition pour laquelle un coefficient est attribu :
4 si la frquence moyenne est quotidienne
3 si la frquence moyenne est hebdomadaire
2 si la frquence moyenne est mensuelle
1 si la frquence moyenne est annuelle
Evaluation du risque
Dans cette partie, lutilisateur devra raliser une valuation des risques. Cette valuation passe par la
prise en compte de la prvention mise en place dans lentreprise.
Pour chaque combinaison SD / D, lutilisateur
Le logiciel renvoie une priorit
devra renseigner les donnes de prvention
daction, modifiable
en place dans lentrepris
Fig 4.6.5. : Evaluation du risque
Lutilisateur devra renseigner le niveau (absent, moyen, bon) de prvention de 3 critres pour
chaque combinaison SD /D :
La formation
Le mode opratoire
Les quipements de protection
Pierre-Axel SPETTEL 41/52 Juin 2011
Le Logiciel indique ensuite une priorit daction sur chaque combinaison SD / D, modifiable par
lutilisateur : 1 = urgent, 2 = moyen terme, 3 = long terme.
A partir de ces informations, le logiciel applique un coefficient de prvention pour le calcul de
lvaluation du risque :
La fonction de cette tape est donc dvaluer le risque, en dterminant, pour chaque combinaison
SD / D, la prvention en place selon 3 axes.
A la suite de cette tape, il est possible dimprimer le document unique.
Analyse
Dans cette tape, lutilisateur doit choisir sur quelles combinaisons SD / D il dsire mettre laccent.
Evidemment, il conseill de rsoudre au plus vite les combinaisons qui prsentent les priorits
dactions les plus urgentes.
Cependant, lors de la formation, les conseils donns prodiguaient de choisir 4 ou 5 actions urgentes,
2 ou 3 actions moyen terme, et 1 ou 2 actions court terme, ce qui permet de ne pas rflchir
une amlioration de la prvention uniquement dans lurgence.
La fonction de cette tape et donc de prparer un plan daction par la slection de priorits et
laccs au catalogue de solutions pratiques, disponible sur internet.
Pierre-Axel SPETTEL 42/52 Juin 2011
Plan daction
Pour chaque combinaison SD / D, Fig 4.6.6. : Plan daction
lutilisateur rempli son plan daction
La phase finale consiste, pour chaque combinaison SD / D, remplir les objectifs atteindre, les
actions et moyens qui seront employs, le responsable de laction, lchance que lon souhaite se
donner, et enfin, la date laquelle laction a t mene.
La fonction de cette tape est donc dlaborer et de grer un plan daction.
Pierre-Axel SPETTEL 43/52 Juin 2011
Conclusion
Lutilisation de ce logiciel est trs simple, et la formation la cration du document unique dispense
par lOPPBTP est complte.
Elle permet de prendre conscience de limportance de ce document, tout dabord dun point de vue
juridique, puisque les entreprises nayant pas mis en place ce document encourent une amende de
1.500, mais aussi dun point de vue de la responsabilit du personnel dirigeant vis--vis du
personnel ouvrier.
En effet, un accident grave du travail, outre les consquences personnelles pour la vie dun ouvrier,
est synonyme de consquences financires importantes, et dans tous les cas bien suprieures au
cot de mise en place dun systme de protection et dinformation performant pour les ouvriers.
Dans le cas de notre plan daction, nous avons choisi daxer la prvention sur les points suivants :
Priorit daction urgente
Contacts avec des pices nues sous tension
Dplacement professionnels
Intervention sur matriaux contenant de lamiante, sur matriels contamins
Stockage en hauteur
Travail, circulation, ou accs en hauteur
Priorit daction moyen terme
Manutention matriels et matriaux
Travail en toutes positions
Priorit daction long terme
Claviers et souris dordinateur
Nous nous donnons jusqu la fin de lanne en cours pour mettre un place une prvention correcte
ou amliorer la prvention dj en place, suivant les sujets traits.
Le rsultat des diffrents lments prsents prcdemment est abord visuellement en annexe.
Pierre-Axel SPETTEL 44/52 Juin 2011
5. Amlioration continue
5.1. Introduction
Nous allons effectuer ci-dessous une analyse des premiers retours de questionnaires de satisfaction
client. Ce premier jet est constitu de 26 lments issus de nos 2 principaux clients en rnovation de
btiments commerciaux, LCL et La Poste.
5.2. Analyse point par point
Mode opratoire
Pour effectuer lanalyse des questionnaires de satisfaction, nous procderons comme suit :
Nous procderons ligne par ligne, cest--dire critre par critre
Pour chaque critre, un certain nombre de point sera attribu : 3 pour satisfaisant, 2 pour
plutt satisfaisant, 1 pour peu satisfaisant, et 0 pour insatisfaisant
Nous ferons une moyenne des notes pour chaque critre, avec comme objectif de se
rapprocher au plus de la note 3, et de sloigner au maximum de la note 0
Nous transformerons ensuite cette note en une note sur 20
Les rsultats seront rcapituls point par point ci-aprs
Respect du planning
La moyenne est points attribus est de 2.65, ce qui donne une note de 17.7/20.
Respect du budget
La moyenne des points attribus est de 2.35, ce qui donne une note de 15.6/20.
Respect du cahier des charges
La moyenne des points attribus est de 2.75, ce qui donne une note de 18.3/20.
Communication/Disponibilit
La moyenne des points attribus est de 2.50, ce qui donne une note de 16.7/20.
Pierre-Axel SPETTEL 45/52 Juin 2011
Qualit des prestations
La moyenne des points attribus est de 2.35, ce qui donne une note de 15.6/20.
Propret/Scurit/Environnement
La moyenne des points attribus 2.44, ce qui donne une note de 16.3/20.
Innovation
La moyenne des points attribus 2.14, ce qui donne une note de 14.3/20.
Satisfaction gnrale
La moyenne des points attribus est de 2.54, ce qui donne une note de 16.9/20.
5.3. Analyse globale des rsultats et conclusion
Les retours des questionnaires de satisfaction montrent dans leur globalit des rsultats trs bons.
Tous les rsultats prsentent une note suprieure 15/20, mis part le critre innovation .
Concernant ce point, nous pouvons mettre un bmol, en considrant le fait que beaucoup de nos
clients nont pas jug utile de noter ce critre.
Dautre part, il faut remarquer que deux projets ont t particulirement mal nots (par le mme
client qui na pas de bonnes relations avec le manager charg de ces deux projets). En ne tenant
pas compte de ces deux rsultats, toutes les notes obtenues sont suprieures 16.5/20.
Nous aurons lavenir une attention particulire sur tous les critres dont la note est au-dessous de
16/20, savoir :
Le respect du budget
La qualit des prestations
Linnovation
Enfin, il peut tre intressant de noter que beaucoup de questionnaires sont remplis avec peu
dattention, cest--dire en cochant systmatiquement la mme case (toutes les lignes coches en
satisfaisant ou plutt satisfaisant).
Cela peut tre interprt de deux manires :
Pierre-Axel SPETTEL 46/52 Juin 2011
Les clients soumis aux questionnaires ne sintressent pas la question et les remplissent
rapidement, sans se poser de relles interrogations sur notre dmarche ni sur la qualit du
travail.
Les clients soumis aux questionnaires sont globalement satisfaits, et nayant pas de point de
problme prcis relever, les questionnaires sont remplis rapidement sans porter
dattention particulire aux intituls des critres de notation.
Pierre-Axel SPETTEL 47/52 Juin 2011
5.4. Indicateur de satisfaction
Les diffrents rsultats des questionnaires ont galement t rentrs dans lindicateur de satisfaction
client.
Cet outil fournit un rsultat global pour chaque projet, et nanalyse pas les rsultats fournit point par
point. Le but est de faire ressortir une tendance globale de satisfaction, et il est donc surtout utile
lorsquun grand nombre de projet est pris en compte.
Une trentaine de projet est pour linstant pris en compte, ce qui permet davoir une tendance sur la
satisfaction gnrale.
Le rsultat obtenu est trs bon, et lobjectif futur sera de dpasser les 90% de satisfaction globale en
renforant les points faibles dcels grce aux questionnaires de satisfaction.
Le taux moyen de satisfaction sur 26
projets est de 86 %
Fig. 5.4.1. : Indicateur de satisfaction
Pierre-Axel SPETTEL 48/52 Juin 2011
6. Respect du planning et des objectifs
Nous allons ici rcapituler les objectifs fixs lors du dbut du projet, et vrifier sils ont t remplis ou
non tout au long de son avancement.
Rappel des objectifs :
Effectuer un tat des lieux et une analyse de lexistant, et des pratiques de lentreprise
concernant le management de la qualit
Ltat des lieux a t prsent dans ce rapport et est prsent de faon plus dtaille en
annexe
Effectuer une analyse fine de la norme ISO 9001 afin de dtecter des ventuelles
erreurs/incomprhensions dans le travail de recensement/cartographie des processus
Cette analyse a t prsente dans ce rapport et est prsente de faon plus dtaille en
annexe
Palier aux manquement/diffrences nots entre lexistant et les exigences relatives la
norme ISO 9001
Voir suite
Reprendre entirement, de crer et de complter les documents prsents et dcrit dans le
manuel QSE
Voir suite
Mettre en place des outils de contrle de qualit des prestations fournies, et permettant de
mettre en place une amlioration continue
Les outils qui ont t mis en place ont t prsents dans ce rapport, et sont galement
disponibles en annexe
De faire connaitre et utiliser cette documentation par les diffrents intervenants de
lentreprise
Une prsentation powerpoint a t mise disposition des managers projet concernant
les outils qui ont t mis en place
Concernant les objectifs de cration documentaire (nots Voir suite prcdemment) :
Reprise du manuel QSE : partir des divergences et des erreurs constates, apporter les
corrections ncessaires.
Le manuel QSE a t repris en partie (la majorit du travail est toutefois effectue). Cet
objectif est donc en partie ralis, et il restera achever.
Corriger et rendre utilisables un maximum de documents qui sont dcrits dans les processus.
Ce travail est fait par touches, lorsque lon doit se rfrer un
processus/formulaire/indicateur existant, et que des divergences thorie/pratique sont
constates, des modifications sont apportes.
Dvelopper une base de donnes des prix unitaires servant aux pilotes de projet.
Cet objectif a t laiss de ct pour le moment car son utilit nest pas urgente.
Pierre-Axel SPETTEL 49/52 Juin 2011
Concernant les objectifs organisationnels et complmentaires :
Organiser des audits internes pour contrler lutilisation des documents et leur bon
fonctionnement.
Un audit interne sera organiser ds que le systme sera bien en place et correctement
rod
Organiser une revue de direction partir des informations collectes travers les
questionnaires de satisfaction client
Une runion avec lensemble du personnel manager et administratif a t organise le
19/05/2011, o les points concernant lamlioration continue ont t abords (voir
Chapitre 5. Amlioration continue)
Se pencher sur les normes ISO 14001 et OHSAS 18001 (ce travail a t commenc au tout
dbut du PFE, mais jai prfr me concentrer dabord sur la qualit et lISO 9001 pour viter
de me disperser). Lavantage des systmes de management intgrs et quils permettent, A
TRAVERS la mise en place du systme qualit, de prendre en compte les aspects
environnementaux et scuritaires.
Concernant la partie environnementale, le travail na pas progress. En revanche, la
partie concernant la scurit a t aborde en profondeur, avec une formation sur
lutilisation du logiciel MAEVA BTP, et la rdaction dun document unique dvaluation
des risques professionnels concernant la scurit et la sant (voir partie 4.6. Document
Unique Prsentation du logiciel MAEVA BTP)
Pierre-Axel SPETTEL 50/52 Juin 2011
Conclusion
Conclusion gnrale
Maison Parisot a souhait se doter dune structure de management plaant le client au cur
des enjeux de lentreprise.
En ce sens, le management de la qualit et la norme ISO 9001 rpondent ces attentes en proposant
un systme qui permet une amlioration continue de la qualit du travail fourni par lentreprise, en
dfinissant 4 grands axes de travail :
La responsabilit de la direction dans la dmarche
La mise en place dun systme qualit proprement parler
La gestion des processus qui cadrent les activits de lentreprise
La mise en place doutils permettant une amlioration continue
De plus, lobtention de la certification ISO 9001 est aux yeux des diffrents partenaires, tant sous-
traitants que clients, un gage de qualit tel quil permet louverture de nouveaux marchs rservs
aux entreprises porteuses du label qualit.
Dans un premier temps, lapplication de la norme ISO 9001 lentreprise a permis de dcrire de
faon exhaustive les processus qui rgissent la conduite dopration et de les cartographier, puis
dimaginer diffrents outils de contrle de la qualit des prestations fournies par Maison Parisot.
Ces outils de contrle ont ensuite t mis en place dans lentreprise, permettant notamment de lui
donner une tendance quant la satisfaction gnrale de sa clientle, mais galement lui permettre
de mieux choisir ses partenaires sous-traitants, de relever les erreurs frquentes qui sont commises,
ses points forts et ses points faibles, toujours dans un but de mieux rpondre aux besoins et aux
exigences de sa clientle.
Exprience personnelle
Ce projet a t trs enrichissant, car il ma permis de minitier deux domaines qui sont trs
peu abords au cours notre formation :
Premirement, le domaine de la qualit, des systmes de management, et des
normes QSE. Le travail que jai effectu pendant ces quelques mois ma permis de
dcouvrir et de comprendre les enjeux dune organisation solide que peuvent
procurer les systmes de management dont les bases et exigences sont poses dans
la norme ISO 9001. Notamment, en apportant des gains de temps, une efficacit
accrue, et surtout une meilleure rponse face aux besoins des clients.
Pierre-Axel SPETTEL 51/52 Juin 2011
Deuximement, le domaine de la gestion et du pilotage de projets proprement
parler. En plus des tches relatives mon projet de fin dtudes, lentreprise
daccueil ma form au mtier de manager projet, en me confiant divers projets de
rnovation de btiments commerciaux avec ses principaux clients, La Poste et LCL.
Cette exprience a t particulirement enrichissante, et je souhaite ainsi continuer
dans cette voie.
Laprs PFE
Un certain nombre de choses seront approfondir a priori aprs le PFE, savoir :
Utiliser au maximum les documents et outils mis en place afin de roder le systme et de
juger de leur utilit.
Prendre contact plus srieusement avec des cabinets daudits & certification, afin dexpliquer
notre dmarche et dobtenir une certification via le systme qualit que nous avons mis en
place. En effet, la plupart des organismes daccrditation mettent directement en place un
systme QSE prt lemploi , ce que je trouve personnellement peu intressant voire
mme lencontre du mode de pense QSE, puisquil sagit de mettre en place un systme
tout fait sans vritable rflexion de la part de lentreprise.
La partie environnementale na pas t traite lors de mon projet. Cependant, la
configuration des normes ISO permet lintgration de la norme ISO 14001 travers le
systme qualit existant, en considrant les problmatiques environnementales dans chaque
processus. Ce travail pourra donc tre fait assez rapidement.
De mme, concernant la norme OHSAS 18001, la cration du Document Unique a recens
tous les risques professionnels et le travail est donc fait 90%. Il reste intgrer laspect
scuritaire dans la description des processus du systme de management.
Pierre-Axel SPETTEL 52/52 Juin 2011
Vous aimerez peut-être aussi
- Rapport-Gestion École PrivéDocument23 pagesRapport-Gestion École PrivéMed Mohamed100% (3)
- Modele Business Plan GratuitDocument3 pagesModele Business Plan GratuitJean AmaniPas encore d'évaluation
- Digitalisation Des AchatsDocument15 pagesDigitalisation Des AchatsFatimazahra MoutiPas encore d'évaluation
- Procedure - Localisée - de - Travail - en - Hauteur - Cote - D'ivoire - Final - 27022020Document32 pagesProcedure - Localisée - de - Travail - en - Hauteur - Cote - D'ivoire - Final - 27022020Dieu Donne Kpele100% (1)
- Gaudin Pfejuin2012 MémoireDocument49 pagesGaudin Pfejuin2012 MémoirerymouachPas encore d'évaluation
- Pfe Salah Eddine MosslihDocument85 pagesPfe Salah Eddine MosslihMed Mohamed100% (1)
- TP Atelier 01Document6 pagesTP Atelier 01Med MohamedPas encore d'évaluation
- Rapport Matthieu EHRHART PDFDocument37 pagesRapport Matthieu EHRHART PDFOthmane MabchourPas encore d'évaluation
- Planification et contrôle de la production et des stocks : techniques et pratiquesD'EverandPlanification et contrôle de la production et des stocks : techniques et pratiquesÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Analyse Des Problemes Critique - IDRISSI KAITOUNI Omar - 3965 PDFDocument59 pagesAnalyse Des Problemes Critique - IDRISSI KAITOUNI Omar - 3965 PDFChaimae FaikPas encore d'évaluation
- PFE Emna SGHAIER v2Document58 pagesPFE Emna SGHAIER v2aziz hajriPas encore d'évaluation
- 1 Rapport PFE 2013Document69 pages1 Rapport PFE 2013christianmakossoPas encore d'évaluation
- Rapport PFEDocument51 pagesRapport PFERachid Richard100% (1)
- Mémoire PFEç01 PDFDocument44 pagesMémoire PFEç01 PDFyoussefePas encore d'évaluation
- PFE BADDOU MeryemDocument74 pagesPFE BADDOU MeryemAHBIRPas encore d'évaluation
- PfeDocument109 pagesPfeSIVAR INGPas encore d'évaluation
- Amelioration Des Performances - Yassine FALEH - 4947 PDFDocument74 pagesAmelioration Des Performances - Yassine FALEH - 4947 PDFSoufiane Nasr EddinPas encore d'évaluation
- Rapport Pfe Clinique 2Document17 pagesRapport Pfe Clinique 2Nabila RIOUCHPas encore d'évaluation
- RUFF Mathieu Rapport de PFEDocument73 pagesRUFF Mathieu Rapport de PFEmissymen100% (1)
- Guide D'élaboration D'un Projet de Fin D'études: Dr. Moussa Olfa Classe: MI 31Document22 pagesGuide D'élaboration D'un Projet de Fin D'études: Dr. Moussa Olfa Classe: MI 31La- MinoPas encore d'évaluation
- Mémoire Pfe TrebotDocument71 pagesMémoire Pfe TrebotThomas BatascomePas encore d'évaluation
- Cadresonline - CV Ingenieur QualiteDocument1 pageCadresonline - CV Ingenieur QualiteSteven OsorioPas encore d'évaluation
- Audit Du Controle de GestionDocument3 pagesAudit Du Controle de Gestionang19elPas encore d'évaluation
- PFE Etude D'optimisation Des Logements Sociaux PDFDocument112 pagesPFE Etude D'optimisation Des Logements Sociaux PDFyassine EssoufiPas encore d'évaluation
- Pfe Master Hind Fin - MicrosoftDocument76 pagesPfe Master Hind Fin - Microsofttazi riffi harounePas encore d'évaluation
- Reduction Du Taux de Pannes de - Kannich Hamid - 2978 PDFDocument63 pagesReduction Du Taux de Pannes de - Kannich Hamid - 2978 PDFIslem BakkaiPas encore d'évaluation
- These QualitéDocument216 pagesThese QualitéSami TissPas encore d'évaluation
- Rapport AHBACH HAMZA Version 0Document42 pagesRapport AHBACH HAMZA Version 0hamza.ahbachPas encore d'évaluation
- PFE - Vincent VALERA - BAP Observations Et Synthèse Des Expériences de ChantierDocument56 pagesPFE - Vincent VALERA - BAP Observations Et Synthèse Des Expériences de ChantierkadaPas encore d'évaluation
- Appel M1 QHSE 2012-2013Document19 pagesAppel M1 QHSE 2012-2013Al Amine Baye FallPas encore d'évaluation
- BouzayDocument64 pagesBouzayFatima Zahra El OuardiPas encore d'évaluation
- 1Document7 pages1Roma ZahiPas encore d'évaluation
- Analyse Des Risques Selon Le R - Hamza BELMIR - 4337Document67 pagesAnalyse Des Risques Selon Le R - Hamza BELMIR - 4337ARKASPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument134 pagesRapport de StagebasssemPas encore d'évaluation
- Etude D'un HangarDocument47 pagesEtude D'un HangarFrancis SonkengPas encore d'évaluation
- Rapportmhmoudi 160610123306Document54 pagesRapportmhmoudi 160610123306SiMo DaminePas encore d'évaluation
- Rapport YEVOSSA Edwige - CompressedDocument74 pagesRapport YEVOSSA Edwige - CompressedBakayoko100% (1)
- Rapport de Stage - Centre Hospitalier AixDocument90 pagesRapport de Stage - Centre Hospitalier Aixbenoitdriencourt100% (1)
- Rapport de Stage en Bureau Detude en Construction MetalliqueDocument50 pagesRapport de Stage en Bureau Detude en Construction Metalliqueعبد الغنيPas encore d'évaluation
- Minimisation de Cout de Transp - LAMSSIAHv Ahlame - 2928 PDFDocument41 pagesMinimisation de Cout de Transp - LAMSSIAHv Ahlame - 2928 PDFSabra SmariPas encore d'évaluation
- Guide D'aide À L'élaboration D'un DCE de Changement D'appareils D'appuiDocument22 pagesGuide D'aide À L'élaboration D'un DCE de Changement D'appareils D'appuiIdriss ZakiPas encore d'évaluation
- PFE Régnier - Mémoire de PFEDocument55 pagesPFE Régnier - Mémoire de PFETháb NoironPas encore d'évaluation
- Organisation Des Chantiers de Travaux Publics - TIPesp-c112Document1 pageOrganisation Des Chantiers de Travaux Publics - TIPesp-c112Abdessalem MessaïPas encore d'évaluation
- Rapport PFE Master - ModifDocument127 pagesRapport PFE Master - ModifSabri JaziriPas encore d'évaluation
- PDF PDFDocument76 pagesPDF PDFSara AmsidderPas encore d'évaluation
- Tdi - Nouvelle Approche de La Durabilité Du Béton Indicateurs Et Methodes 1 - Baroghel-Bouny - FR PDFDocument14 pagesTdi - Nouvelle Approche de La Durabilité Du Béton Indicateurs Et Methodes 1 - Baroghel-Bouny - FR PDFFarida Diab SarmoukPas encore d'évaluation
- Accueil HSEDocument65 pagesAccueil HSEFatima Zahra OumoudidPas encore d'évaluation
- FinaleDocument55 pagesFinaledi mytryPas encore d'évaluation
- Livret D'accueil BTPDocument80 pagesLivret D'accueil BTPYannick SanouPas encore d'évaluation
- Projet de StageDocument4 pagesProjet de StageANAAAPas encore d'évaluation
- Gestion de La QualitéDocument108 pagesGestion de La Qualitébzouzouko@gmail.com100% (5)
- Rapport PDFDocument139 pagesRapport PDFJihane El AdnaniPas encore d'évaluation
- Pfe Presque FinaliseDocument110 pagesPfe Presque Finalisembodj93100% (1)
- Méthode APRDocument40 pagesMéthode APRstagfire17Pas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Menara HoldingDocument14 pagesRapport de Stage Menara HoldingNouhaila ErraysPas encore d'évaluation
- Techniques de Produc PDFDocument17 pagesTechniques de Produc PDFAb SarPas encore d'évaluation
- KABORE Master AIGEME Rapport de Stage 2008-2009Document29 pagesKABORE Master AIGEME Rapport de Stage 2008-2009KABORE ParfaitPas encore d'évaluation
- Mémoire de PFE - Claire CASENAVEDocument85 pagesMémoire de PFE - Claire CASENAVENaceri SaidPas encore d'évaluation
- Politique QHSEDocument1 pagePolitique QHSEaladesodiq415100% (1)
- Analyse d’impact réglementaire (AIR): Balises méthodologiques pour mieux évaluer les réglementationsD'EverandAnalyse d’impact réglementaire (AIR): Balises méthodologiques pour mieux évaluer les réglementationsPas encore d'évaluation
- Application de Workflow. Mise en Place Dans Une Entreprise IndustrielleDocument75 pagesApplication de Workflow. Mise en Place Dans Une Entreprise Industrieller_prePas encore d'évaluation
- DEUMAL Jordi Memoria Annex ProjecteDocument53 pagesDEUMAL Jordi Memoria Annex Projectedonatienk14Pas encore d'évaluation
- Rapport Pfe Final Laporte-FauretDocument76 pagesRapport Pfe Final Laporte-FauretyounessPas encore d'évaluation
- Raport FinalDocument120 pagesRaport FinalMongoué AstridPas encore d'évaluation
- Mémoire 5SDocument59 pagesMémoire 5SAzizPas encore d'évaluation
- Pfe Salah Eddine BaheddaDocument101 pagesPfe Salah Eddine BaheddaMed Mohamed100% (3)
- Examen Electr 2 Session Rattrapage 2013Document2 pagesExamen Electr 2 Session Rattrapage 2013Med MohamedPas encore d'évaluation
- Pfe Fatima Es SaadiDocument59 pagesPfe Fatima Es SaadiMed MohamedPas encore d'évaluation
- Pfe Mouna SitelDocument146 pagesPfe Mouna SitelMed MohamedPas encore d'évaluation
- Pfe Ihssan ErouayaneDocument101 pagesPfe Ihssan ErouayaneMed MohamedPas encore d'évaluation
- Pfe Mouhssine Lama OuiDocument95 pagesPfe Mouhssine Lama OuiMed Mohamed0% (1)
- Pfe Meryem SlimaniDocument78 pagesPfe Meryem SlimaniMed MohamedPas encore d'évaluation
- TechWeb 09-12-2014Document48 pagesTechWeb 09-12-2014Med MohamedPas encore d'évaluation
- Calendrier Examen SN P15Document2 pagesCalendrier Examen SN P15Med MohamedPas encore d'évaluation
- td3 PDFDocument5 pagestd3 PDFMed MohamedPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Etude de FaisabilitéDocument23 pagesChapitre 3 - Etude de FaisabilitéMed MohamedPas encore d'évaluation
- Exercices RecursiviteDocument3 pagesExercices RecursiviteMed MohamedPas encore d'évaluation
- TP01 PDFDocument11 pagesTP01 PDFMed Mohamed100% (1)
- Web Services Ijikki MohamedDocument53 pagesWeb Services Ijikki MohamedMed MohamedPas encore d'évaluation
- Definition Lean Management Micheal BalleDocument2 pagesDefinition Lean Management Micheal Ballefouad aminePas encore d'évaluation
- 209N72TKPE0719 Bloc2 Seq02 M02 S03Document9 pages209N72TKPE0719 Bloc2 Seq02 M02 S03josephinedossantospenidaPas encore d'évaluation
- Supermood LivreBlanc 50 Meilleures PratiquesDocument15 pagesSupermood LivreBlanc 50 Meilleures PratiquesNahilPas encore d'évaluation
- Exercice 02 Decembre CGDocument8 pagesExercice 02 Decembre CGdounyaPas encore d'évaluation
- 2016 CastaingsDocument213 pages2016 CastaingsAya MariaPas encore d'évaluation
- Questionnaire LeanDocument7 pagesQuestionnaire LeanAbdelatif HrPas encore d'évaluation
- Démarche QualitéDocument30 pagesDémarche QualitéjannanePas encore d'évaluation
- Tableau de BordDocument11 pagesTableau de Bordoumaima amarhouchPas encore d'évaluation
- Chapitre 20 Gestion Des DisponibilitesDocument25 pagesChapitre 20 Gestion Des DisponibilitesAdil ZidanePas encore d'évaluation
- andriamisamananaMioraH GES M1 14Document81 pagesandriamisamananaMioraH GES M1 14Marc othniel EnanPas encore d'évaluation
- Methodologie RapportDocument45 pagesMethodologie RapportNayizar Nizar100% (1)
- Introduction A La Logistique 1Document9 pagesIntroduction A La Logistique 1Ab Dou Bouslama100% (1)
- Support Cours Gouvernance SI Cobit Partie IDocument53 pagesSupport Cours Gouvernance SI Cobit Partie Iintratel100% (1)
- Chap 1 Et 2 - PFEDocument34 pagesChap 1 Et 2 - PFEjalila.alouliPas encore d'évaluation
- 2019 Business Development Course CatalogueDocument12 pages2019 Business Development Course CatalogueJM KoffiPas encore d'évaluation
- École de Management Et de Commerce International: La Salle EMCI - Saint-Etienne / LyonDocument15 pagesÉcole de Management Et de Commerce International: La Salle EMCI - Saint-Etienne / LyonPierre-Louis JANOTPas encore d'évaluation
- Audit Gestion Risques AMRAEDocument38 pagesAudit Gestion Risques AMRAEdonPas encore d'évaluation
- 9 Étapes GpecDocument11 pages9 Étapes GpecAnsoumana KamaraPas encore d'évaluation
- Getting Ready: Cours 1/4Document17 pagesGetting Ready: Cours 1/4DakelPas encore d'évaluation
- Mastere Specialise ERP RAPPORT DE THESEDocument71 pagesMastere Specialise ERP RAPPORT DE THESEMehdi ElPas encore d'évaluation
- Cas Pratique 1Document34 pagesCas Pratique 1Said BoukaabaPas encore d'évaluation
- Constant Kouame Yao - 024514Document6 pagesConstant Kouame Yao - 024514Nathanaël YaoPas encore d'évaluation
- Cours Comptabilité de Gestion S1 S2 - CopieDocument29 pagesCours Comptabilité de Gestion S1 S2 - CopieMr Moctar DEMIPas encore d'évaluation
- Management Des Organisations PubliquesDocument21 pagesManagement Des Organisations PubliquesHind BouzianePas encore d'évaluation
- Liste Diplomes CAMESgenererdiplomesDocument11 pagesListe Diplomes CAMESgenererdiplomesHopePas encore d'évaluation
- Assurance Qualite Tms1 2023mDocument142 pagesAssurance Qualite Tms1 2023mprudencekouara75Pas encore d'évaluation
- Manuel D'utilisation Livrable GTG-CATALYST-V1 PDFDocument33 pagesManuel D'utilisation Livrable GTG-CATALYST-V1 PDFRabahPas encore d'évaluation