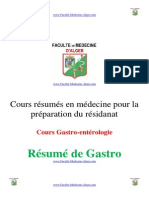Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Referentiel Chirurgie Viscerale Et Digestive
Referentiel Chirurgie Viscerale Et Digestive
Transféré par
Brenda MbogningCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Referentiel Chirurgie Viscerale Et Digestive
Referentiel Chirurgie Viscerale Et Digestive
Transféré par
Brenda MbogningDroits d'auteur :
Formats disponibles
Document de référence en
CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE
à l’usage des Commissions de qualification
Pr Jean Luc Bouillot
Dr Gérard Leynaud
Pr Georges Mantion
Pr Philippe Segol
Dr Jacques Soufron
Dr Nicolas Veyrie
Adopté par le Conseil National – Session du 6 février 2015
Les situations de soins types
Les situations de soins retenues : les critères de sélection
Les situations de soins retenues ne sont, bien entendu, pas exhaustives mais sont
considérées comme particulièrement représentatives de la spécialité. Elles devront
être complétées et ajustées régulièrement lors des moments prévus d'actualisation du
référentiel.
Sept situations de soins types (tableau) ont été retenues pour satisfaire aux critères
suivants :
faire partie du cœur de métier du chirurgien en chirurgie viscérale et digestive ;
représenter une variété suffisante de situations ;
représenter des situations qui, si elles sont gérées avec pertinence par un
chirurgien, peuvent permettre d'inférer que ce chirurgien est compétent.
Situations-types Caractéristiques
Vésicule,
1. Cholécystite aiguë
Risque vital
2. Hernie inguinale non
Paroi
étranglée chez l’adulte
3. Cancer de la jonction
Colon, rectum, Oncologie
colorectale (hors urgences)
Grêle,
4. Occlusion du grêle
Risque vital immédiat
5. Péritonite post opératoire Risque vital immédiat
6. Masse pelvienne (féminine, à Intéresse plusieurs organes,
froid) Multidisciplinaire
Cavité péritonéale,
7. Douleur abdominale aiguë
Urgence
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 2
Situation 1. Cholécystite aiguë
Réaliser un diagnostic
Au plus tôt et au plus près de l'arrivée du patient aux urgences.
en menant l'interrogatoire et l'anamnèse :
o antécédents ;
o crises antérieures, douleurs post prandiales, lithiase connue.
en procédant à l'examen clinique :
o avant —si possible— que le patient soit sous antalgiques ;
o en éliminant les autres urgences médicales (cœur, poumons, reins)
et abdominales ;
en distinguant la cholécystite d'une colique hépatique (présence éventuelle de
fièvre, durée de la douleur, défense).
en prescrivant des examens sanguins, sur indication, selon le protocole et en
fonction des signes cliniques (notamment température, frissons, âge) : protocole
d'hémoculture, bilan hépatobiliaire, pancréatique, CRP, hémostase.
en prescrivant des examens complémentaires :
o échographique : en se gardant de conclusions trop rapides en cas
d'absence d'épaississement de la paroi et/ou de lithiase, ou en cas
de fièvre durable, éventuellement en réalisant l'échographie soi -
même ;
o en réalisant une fibroscopie gastrique ou un autre examen
complémentaire, sur indication.
En envoyant le patient en consultation d'anesthésie.
Décider de l'indication et d'une stratégie thérapeutique
en synthétisant les informations et décidant en fonction de :
o âge, antécédents, traitements en cours, comorbidités du patient, état
général ;
o résultats des examens ;
o état de la voie biliaire principale et du foie.
en évaluant le degré d'urgence :
o en cas de suspicion de péritonite : intervention immédiate ;
o en cas d'intervention en urgence différée (jusqu'à 72 heures), préparer le
patient : en prescrivant pose d'une voie veineuse, antibiotiques,
antalgiques, jeûne et glace sur le ventre ;
o en cas de traitement seulement médical (cholécystite simple, patient vu
tardivement et comorbidité associée) : critères de surveillance.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 3
en anticipant la préparation du bloc :
o information de l'équipe au bloc ;
o attention au fonctionnement de chaque bloc (disponibilité du matériel) ;
o capacité de surseoir à l'opération en cas de risque opératoire majeur ou
de confier le patient à une autre équipe plus spécialisée.
en déterminant la voie opératoire : cœlioscopie ou laparotomie.
en informant le malade et la famille du diagnostic, des modalités d'intervention
et des probabilités de conversion.
Réaliser l'intervention chirurgicale
Préparer l'intervention :
en vérifiant la disponibilité et le fonctionnement du matériel et de la radio per-op.
en vérifiant la disponibilité et estimant la compétence de l'équipe.
en choisissant une installation à la française ou à l'américaine pour l'intervention
sous laparoscopie.
Organiser une intervention sous laparoscopie :
en connaissant les contre-indications ;
en s'assurant de l'équipement adéquat de la salle et de son bon fonctionnement
(logistique électricité et fluide, caméra insufflation, télévision) ;
en collaborant avec une équipe formée à cette technique : anesthésistes (gestion
de la capnie, gestion des curares), infirmiers... ;
en effectuant tous les gestes liés au maniement des techniques et à la
spécificité de l'intervention en qualité et en durée :
o en veillant au principe de triangulation,
o en veillant aux modalités de création du pneumo péritoine : open
cœlioscopie ou ponction directe à l'aiguille de Veres (avec tests de
sécurité),
o en surveillant les pressions d'insufflation et l'évolution de celles-ci pendant la
durée de l'intervention,
o en introduisant des pinces et des trocarts sous contrôle de la vue,
o en maîtrisant le maniement des pinces sous contrôle de la vue, et la
coordination du geste pour opérer sous écran,
o en faisant l'extraction des pièces anatomiques (sacs) ,
o en acceptant les critères de conversion à tous les stades de l'intervention
(laparotomie en cas de problème, risque hémorragique, pas d'avancée
dans la dissection au bout de 20 mn...),
o en enlevant les trocarts sous contrôle de la vue, en exsufflant le dernier
trocart en place et refermant les orifices.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 4
En faisant tous les gestes opératoires de la cholécystectomie sous cœlioscopie :
en réalisant les prélèvements bactériologiques ;
en vérifiant la cavité abdominale (saignements, écoulements,...) avant
d'enlever les trocarts ;
en ayant conscience de ses limites, être capable de demander l'avis d'un
collègue ;
en gérant les hémostases ;
en cas de calcul dans les voies biliaires, en décidant de laisser un calcul
cholédocien ou de l'extraire et argumenter ;
en gérant les comptes de compresses.
En réalisant la transmission écrite et orale :
utiliser un schéma ;
rédiger le CR opératoire.
Effectuer un suivi post-opératoire immédiat
en surveillant le patient et le suivant jusqu'à la sortie, en équipe avec
l'anesthésiste ;
en assurant la surveillance des risques d'hémorragie et de fuite biliaire ;
en prescrivant les conditions de réhabilitation du malade (déambulation, sonde,
drains, alimentation) et les médicaments nécessaires ;
le cas échéant, en proposant une stratégie et une chronologie de traitement s'il
existe un calcul résiduel ;
en gérant la sortie, en particulier en évaluant le contexte et les besoins du
malade pour la prise en charge ultérieure (arrêt de travail, maison de repos) ;
en rédigeant le CR d'hospitalisation pour le médecin tra itant.
Effectuer un suivi en temps différé
en prenant connaissance des résultats de l'analyse histologique ;
en assurant la traçabilité de la prise en charge, pour le patient et pour ses
médecins (compte-rendu opératoire, courrier, histologie...).
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 5
Situation 2. Hernie inguinale non étranglée chez
l'adulte
Réaliser un diagnostic
en menant l'interrogatoire :
o anamnèse, antécédents ;
o douleur : intensité, horaires, facteurs déclenchants ;
o pathologies associées ;
o facteurs favorisant la survenue des hernies (métiers de force, broncho-
pneumopathie...).
en faisant l'examen clinique :
o examen bilatéral, debout, couché, en toussant ;
o symptômes fonctionnels, recherche de gêne fonctionnelle ;
o examen des testicules et de l'ombilic ;
o toucher rectal sur indication chez l'homme dans la deuxième partie de la
vie.
en faisant le diagnostic différentiel des douleurs de l'aine sans rapport avec
une hernie
en prescrivant les examens para cliniques et biologiques uniquement en cas
de suspicion de pathologies associées
en informant le patient sur :
o les origines et les facteurs favorisant la hernie ;
o les risques et bénéfices d'une intervention et les douleurs post opératoires
potentielles.
Décider de l'indication et d'une stratégie thérapeutique
Cas 1 : décision d'intervention
en décidant des modalités
o chirurgie ambulatoire ou hospitalisation conventionnelle ;
o voie d'abord : chirurgie laparoscopique ou Kelotomie ;
o herniorraphie ou cure prothétique.
en argumentant sur les choix avec le patient.
en décidant de l'horaire de passage au bloc (salle aseptique).
en réalisant un bilan pré-opératoire (radio du thorax...).
en réalisant une consultation anesthésique.
en discutant avec l'anesthésiste et le patient de la technique d'anesthésie
(locale, générale, régionale).
Cas 2 : décision de ne pas intervenir
en donnant des conseils au patient pour détecter un étranglement et expliquer
la conduite à tenir en cas d'urgence.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 6
Réaliser l'intervention chirurgicale
en respectant les bonnes pratiques :
o veiller à la préservation des nerfs ;
o assurer une dissection minutieuse ;
o veiller à une asepsie rigoureuse en cas de réparation prothétique.
Effectuer un suivi post-opératoire immédiat
En assurant la surveillance classique :
o expliquant les précautions de reprise d'activité et une éventuelle
rééducation posturale ;
o prescrivant des antalgiques.
en prescrivant un arrêt de travail tenant compte de l'activité professionnelle
du patient (travailleur de force).
Effectuer un suivi en temps différé
en revoyant le patient à distance, pour contrôler la solidité de la réparation et
l'absence de douleur ;
en assurant la traçabilité de la prise en charge pour le patient et pour ses
médecins (compte-rendu opératoire, courrier...) ;
en enregistrant le patient au sein d'un éventuel registre.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 7
Situation 3. Cancer de la jonction colorectale (hors
urgence)
Réaliser un diagnostic
en menant l'interrogatoire :
o antécédents personnels (colites, coloscopies, chirurgie abdominale, ...) et
familiaux (cancers des ascendants, âges de survenue...) ;
o anamnèse ;
o pathologies associées.
en faisant l'examen clinique :
o palpation de l'abdomen et toucher rectal ;
o recherche de cicatrices abdominales.
en prescrivant des examens complémentaires :
o à visée diagnostique : coloscopie, biopsies, en cas de coloscopie
incomplète ou impossible, lavement au produit opaque ou scanner avec
opacification digestive ;
o à visée d'extension et d'opérabilité, si le diagnostic a été fait par le
médecin traitant ou le gastroentérologue : échographie hépatique ou
scanner (foie, reins, carcinose), radio du thorax ou scanner thoracique,
marqueurs tumoraux pré opératoires.
en informant le patient sur les conditions et les risques des examens.
en réalisant une synthèse et communiquant en RCP (Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire).
en communiquant au patient le diagnostic : expliquer l'éventuelle colostomie,
l'informer sur les risques associés (qualité de vie, sexualité, fertilité,
incontinence...) et s'adapter à la psychologie du patient, le préciser dans le
dossier ou dans la lettre au médecin traitant.
en prescrivant un bilan anesthésique et un bilan d'opérabilité (AG quasi
systématique).
Décider de l'indication et d'une stratégie thérapeutique
en préparant le malade, tenant compte des recommandations, et discutant de
l'intérêt d'une préparation colique ;
en déterminant la voie d'abord et l'option cœlioscopie, argumentant le choix
(abcès de paroi et éventrations...) ;
en prévenant le bloc et anticipant la disponibilité du personnel et du matériel.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 8
Réaliser l'intervention chirurgicale
en installant le malade selon option (double équipe...) ;
sous protocole préétabli d'antibioprophylaxie ;
en explorant la cavité abdominale (atteinte organes adjacents, carcinose
péritonéale, métastases hépatiques...) ;
en réalisant une ligature première des vaisseaux ;
en discutant l'exclusion de la tumeur ;
en mobilisant l'angle gauche ;
en veillant à ne pas passer au contact de l'aorte pour le curage ganglionnaire
{préservation des nerfs) ;
en effectuant un repérage des uretères ;
en libérant le moignon rectal, en amorçant le plan de l'ETM ;
en décidant le rétablissement de la continuité et son mode (mécanique ou
manuel) ;
en effectuant un lavage à la Bétadine du moignon rectal ;
en contrôlant l'étanchéité de l'anastomose (pour les interventions mécaniques) ;
en décidant ou non d'une stomie de protection (colostomie, iléostomie) ;
en réalisant un drainage sur indication ;
en contrôlant et envoyant la pièce à l'anapath ;
en réalisant la transmission écrite et orale, utilisant un schéma et rédigeant le
CR opératoire.
Effectuer un suivi post-opératoire immédiat
en suivant le patient jusqu'à la sortie, en équipe avec l'anesthésiste ;
en assurant la prévention des phlébites ;
en cas de colostomie, s'assurant qu'une prise en charge spécifique est
assurée par le stomathérapeute ;
en prescrivant les conditions de réhabilitation du malade (déambulation, sonde,
drains, alimentation) et les prescriptions médicamenteuses ;
en évaluant le contexte et les besoins du malade pour la prise en charge
ultérieure (arrêt de travail, maison de repos) ;
en donnant des conseils diététiques, voire orientant vers un diététicien ;
en rédigeant le compte rendu d'hospitalisation pour le médecin traitant et lui
demandant d'effectuer la demande de prise en charge à 100 %.
Effectuer un suivi en temps différé
à réception des résultats de l'anapath, en représentant le dossier en RCP pour
discuter de l'éventualité d'un traitement complémentaire en chimiothérapie ;
en revoyant le patient à un mois, pour assurer un éventuel traitement
complémentaire en oncologie ;
en organisant le suivi à distance : oncologue, chirurgien, médecin traitant.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 9
Situation 4. Occlusion du grêle
Réaliser un diagnostic
Au plus tôt et au plus près de l'arrivée du patient aux urgences.
en menant l'interrogatoire :
o antécédents (autres interventions abdominales, maladies inflammatoires...),
o anamnèse ;
en réalisant l'examen clinique —avant la prise d'antalgiques si possible
(cicatrices, orifices herniaires...) ;
en recherchant des signes de gravité : fièvre, altération de l'état général,
défense, intensité de la douleur... ;
en éliminant les diagnostics différentiels évidents (globe urinaire, grossesse,
torsion de l'ovaire, coliques néphrétiques, autres causes d'occlusion...) ;
en prescrivant des antalgiques, sous la responsabilité du chirurgien, avec une
surveillance rapprochée par le chirurgien ;
en posant une sonde gastrique et faisant vérifier la bonne pose de la sonde par
radio ;
en prescrivant des examens complémentaires :
o ASP ou scanner, selon les indications de bonne pratique et la disponibilité
des équipements (en recherche de signes de souffrance du grêle),
o examens biologiques, sanguins et urinaires, selon le protocole douleurs
abdominales ;
en mettant en condition le patient : voie veineuse (réhydratation), sonde
urinaire si indication ;
en demandant un bilan préopératoire avec visite anesthésique.
Décider de l'indication et d'une stratégie thérapeutique
Cas 1 : signes de gravité : opération d'emblée
tableau clinique (hyperalgie, fièvre, défense, contracture) ;
modifications biologiques (hyperleucocytose) ;
signes de souffrance intestinale au scanner.
Cas 2 : pas de signes de gravité : traitement médical et surveillance
en compensant les pertes hydriques et réaliser une aspiration gastrique ;
en veillant particulièrement aux patients âgés ;
en recherchant le mécanisme de l'occlusion : brides, adhérences, tumeur du
grêle, appendicite à forme occlusive, maladie de Crohn, iléus biliaire, bézoard..;
en demandant un scanner :
o nature de l'aspect occlusif,
o dilatation du grêle ;
si pas d'amélioration clinique rapide, décision d'intervention ;
en communiquant au patient et à la famille le diagnostic et la stratégie
recommandée;
en déterminant la voie d'abord : cœlioscopie dans les cas les plus favorables
(bride simple évoquée, malade jeune, chirurgien expérimenté) ou laparotomie ;
en prévenant le bloc et anticipant la disponibilité du personnel et du matériel.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 10
Réaliser l'intervention chirurgicale
en déroulant la totalité du grêle pour exploration ;
en adaptant le geste à la cause de l'occlusion ;
en appréciant la vitalité du grêle ;
en réalisant la transmission écrite et orale, en rédigeant le CR opératoire.
Effectuer un suivi post-opératoire immédiat
en suivant le patient jusqu'à la sortie, en équipe avec l'anesthésiste ;
en surveillant la sonde naso-gastrique et compensant les éventuelles pertes
hydriques;
en prescrivant les conditions de réhabilitation du malade (déambulation, sonde,
drains, alimentation) et les prescriptions médicamenteuses ;
en organisant la sortie :
o donnant des conseils pour les soins de la cicatrice et la reprise d'activité,
o informant sur les risques de récidives,
o rédigeant le courrier et le compte rendu d'hospitalisation pour le médecin
traitant.
Effectuer un suivi en temps différé
En revoyant le patient à 1 mois, pour contrôler la paroi (abcès, risques
d'éventration).
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 11
Situation 5. Péritonite post opératoire (chirurgie
digestive)
Réaliser un diagnostic
Au plus tôt et/ou au plus près de l'arrivée du patient aux urgences et compte
tenu de l'intervention initiale.
si le cas est évident, en décidant de l'opération d'emblée ;
sinon, en conduisant l'examen selon :
o la provenance du patient —opéré sur place ou suite à transfert—
(surveillance post-opératoire avec vigilance accrue à J+5 +/- 2 j),
o les signes de suspicion: signes généraux (faciès « gris », douleurs
abdominales, tachycardie / polypnée, température), signes digestifs
(diarrhées, abdomen distendu, défense, contracture), signes extra digestifs
(diurèse réduite, défaillance cardiaque, angoisse, désorientation) ;
en se méfiant des autres signes d'alerte trompeurs (symptomatologie pseudo -
embolique) justifiant une confrontation d'avis avec le réanimateur médical et un
échange de points de vue avec l'équipe soignante.
1er cas. Patient opéré sur place
en prescrivant des examens complémentaires :
o NFS / hyperleucocytose,
o gazométrie,
o créatinémie/fonctions rénales,
o scanner ;
en décidant d'intervenir au terme des examens, en cas de certitude ou de forte
suspicion ;
en mettant en condition le patient ;
en demandant un bilan préopératoire avec consultation d'anesthésiste ;
en s'assurant d'une possibilité de prise en charge en réanimation et du suivi
post-opératoire immédiat.
2e cas. Patient à transférer à défaut d'un plateau technique adapté et d'une possibilité
de prise en charge sur place
en organisant un transfert du patient selon le niveau de gravité et de stabilité
de son état.
3e cas. Patient provenant d'un transfert « 2e main » :
valider l'opportunité d'opérer :
o en retraçant l'anamnèse cernant toute la prise en charge ;
o en analysant le dossier « avec des yeux neufs » ;
o en se concertant avec les réanimateurs.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 12
Décider de l'indication et d'une stratégie thérapeutique
en synthétisant les informations et prenant une décision en évaluant le degré
d'urgence;
en validant la voie d'abord, à priori laparotomie sauf cas particulier
(cholépéritoine) ;
en anticipant la préparation du bloc :
o en informant l'équipe au bloc,
o en étant attentif à la préparation de la salle et au fonctionnement du bloc
(disponibilité du matériel, présence et expertise du personnel),
o en étant capable de surseoir à l'opération en cas de risque opératoire majeur
ou de confier le patient à une autre équipe plus spécialisée ou mieux
équipée ;
en informant le malade et la famille du diagnostic, des modalités d'intervention et
de ses conséquences ;
en veillant à la préparation du malade.
Réaliser l'intervention chirurgicale
en assurant les prélèvements nécessaires ;
en réalisant l'exploration ;
en procédant au lavage de la cavité abdominale ;
en décidant du choix des gestes et de leur exécution (stomies et démontage
d'anastomose) ;
en choisissant le drainage (selon type et implantation) ;
en prévenant toute éviscération.
Effectuer un suivi post-opératoire immédiat
en rédigeant un compte-rendu opératoire avec schéma complet détaillé ;
en effectuant un suivi chirurgical pluri quotidien ;
en contribuant au suivi médical en collaboration avec le réanimateur ;
en surveillant les drains et la coloration de la stomie ;
en assurant la relation avec le malade, le médecin traitant, la famille ;
en informant des conséquences de l'opération sur les conditions de vie.
Effectuer un suivi en temps différé
en prescrivant des conseils (stomathérapie) ;
en proposant une prise en charge nutritionnelle ;
en participant avec le staff à la revue de « morbimortalité » ;
en veillant aux démarches médico-légales.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 13
Situation 6. Masse pelvienne (chez la femme, à
froid)
Réaliser un diagnostic
en menant l'interrogatoire (anamnèse et antécédents) ;
en réalisant l'examen clinique :
o symptômes physiques, organiques, fonctionnels (ballonnement, gêne,
pesanteur),
o suivi gynécologique (date des dernières règles, frottis...),
o palpation du ventre en éliminant une grossesse insoupçonnée,
o touchers pelviens ;
en prescrivant les examens para cliniques :
o analyses biologiques (marqueurs tumoraux),
o échographie pelvienne,
o topographie de la masse.
Décider de l'indication et d'une stratégie thérapeutique
en prescrivant : bilan morphologique complémentaire ; scanner, IRM ; suivi
biologique.
en décidant l'intervention et la technique opératoire selon la/les indications : 3
cas.
Cas 1. Utérus : myome
en définissant les modalités de traitement en fonction de l'âge ;
en convenant avec le gynécologue de la thérapeutique médicale ;
en décidant en cas d'opération d'une hystérectomie totale, sub-totale ou d'une
myomectomie ;
en faisant un choix entre voie haute ou basse.
Cas 2. Ovaire : masse ovarienne
en effectuant une échographie endovaginale ;
en précisant s'il s'agit d'une masse liquidienne pure et de la possibilité de
ponction et/ou traitement hormonal ;
en prescrivant des examens complémentaires en cas de masse mixte ou
solide : IRM, scanner, dosage de marqueurs spécifiques :
o indication pour tumeur bénigne : cœlioscopie,
o indication pour suspicion de tumeur maligne : laparotomie (hystérectomie,
ovariectomie, chirurgie du cancer de l'ovaire ;
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 14
Cas 3. Pelvis
en réalisant des examens :
o digestif,
o génital,
o neurologique / pariétal ;
en précisant le diagnostic par scanner.
Réaliser l'intervention chirurgicale
en respectant, selon les différents cas, les règles de l'art et les techniques
opératoires propres à chacun.
Effectuer un suivi post-opératoire immédiat
en assurant la surveillance classique ;
en adressant le compte rendu d'hospitalisation au médecin gynécologue ;
en accompagnant la sortie :
o communiquant sur les précautions de reprise d'activité et une éventuelle
rééducation posturale,
o prescrivant des antalgiques si nécessaire.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 15
Situation 7. Syndrome de douleur abdominale
aiguë
Réaliser un diagnostic
en menant un interrogatoire approfondi :
o anamnèse détaillée,
o antécédents symptomatologiques ;
en prenant connaissance de l'avis du médecin traitant ;
en éliminant les pathologies à indications médicales (cardiologie,
pneumologie, urologie, gynécologie, pathologies digestives médicales...) ;
en réalisant l'examen clinique :
o symptômes physiques, organiques, fonctionnels (ballonnement, gêne,
pesanteur),
o cicatrices,
o percussion,
o auscultation,
o touchers pelviens,
o examen gynécologique ;
en prescrivant les examens paracliniques :
o analyses biologiques (NE, CRP, marqueurs tumoraux, analyse d'urine...),
o test de grossesse,
o écho abdominale et/ou TDM,
o radio pulmonaire.
Décider de l'indication et d'une stratégie thérapeutique
en évaluant l'urgence.
En cas de non urgence ou urgence différée
en organisant un suivi périodique en consultation et une surveillance sur mesure;
en informant le médecin traitant.
En cas d'urgence
en décidant de l'hospitalisation en chirurgie digestive ou orientant vers la
spécialité adaptée.
Réaliser l'intervention chirurgicale
en se reportant aux différentes situations d'intervention et à leurs indications
opératoires.
Effectuer un suivi post-opératoire immédiat
en se reportant aux différentes situations d'intervention et à leurs indications
opératoires.
Effectuer un suivi en temps différé
en se reportant aux différentes situations d'intervention et à leur surveillance
ultérieure.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 16
Les ressources en connaissances et
compétences
Les ressources indiquées ne constituent pas une liste exhaustive de connaissances et
compétences, mais identifient celles qui sont particulièrement requises pour exercer le
métier de chirurgien en chirurgie viscérale et digestive, et donc pour gérer les
situations de soins qui se présenteront.
Les ressources spécifiques à la spécialité en chirurgie
viscérale et digestive
Les prérequis de base
Être affilié au Collège de sa spécialité chirurgicale afin de garantir une mise à jour
régulière de sa compétence par la formation continue.
Les savoirs scientifiques et techniques validés
Avoir acquis les connaissances théoriques et techniques concernant :
les sciences fondamentales ;
la physiologie du tube digestif et des glandes annexes ;
la pathologie tumorale et des notions d'oncologie médicale ;
les techniques chirurgicales ;
les connaissances inhérentes à la chirurgie viscérale et aux spécialités suivantes :
endocrinienne, gynécologique, vasculaire
Chirurgie de l'œsophage et du diaphragme ;
Chirurgie de l'estomac, du duodénum et du jéjuno-iléon ;
Chirurgie colorectate et proctologique ;
Chirurgie du foie, de la rate et du système porte ;
Chirurgie des voies biliaires et du pancréas ;
Chirurgie pariétale ;
Chirurgie des cavités péritonéale et pelvienne ;
Chirurgie du sein et des glandes endocrines.
les urgences en chirurgie digestive ;
les modalités des endoscopies ;
des notions de réanimation ;
des notions de transplantation ;
des notions de prise en charge et gestion de la douleur ;
des notions des engagements juridiques.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 17
Principales modalités d'acquisition
les cours et enseignements qualifiants ;
le « compagnonnage » ;
les congrès et enseignements spécifiques ;
les stages de courte durée.
Expérience pratique validée et maîtrise des gestes chirurgicaux
Avoir acquis la maîtrise des interventions et des actes techniques dans les
domaines suivants :
Maîtrise des gestes essentiels en chirurgie vasculaire, urologique, gynécologique;
maîtrise des abords chirurgicaux (œsophage, thyroïde, estomac, rate, foie,
pancréas, glandes endocriniennes, intestins, anus) ;
chirurgie colorectale ;
chirurgie cœlioscopie ;
maîtrise de la chirurgie mini-invasive laparoscopique (éventuellement
robotique).
Modalité d'acquisition pratique
le service : participation aux activités de soins, présentation et discussion des
dossiers au staff, suivi des malades hospitalisés, supervision des observations,
gardes de spécialité... ;
le bloc opératoire ;
la consultation : réflexion diagnostique, information du patient... ;
les stages de mise en pratique validés par un carnet de stages :
en situation d'aide à un praticien expérimenté,
en situation d'acteur principal accompagné ;
les RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) ;
les réunions de morbi-mortalité ;
la diversité des lieux de stages pour permettre les acquisitions pratiques de
bases en chirurgie vasculaire, urologique, gynécologique.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 18
Les ressources communes à toutes les spécialités
Les prérequis de base
Reconnaissance par l'ordre des médecins du titre de Docteur en médecine et
de la qualification.
Déontologie professionnelle et éthique médicale.
Savoirs médicaux scientifiques et techniques validés
Avoir acquis les connaissances de base théoriques et techniques en chirurgie
concernant :
l'anatomie chirurgicale ;
l'acte opératoire (méthodologie chirurgicale) ;
la pathologie générale ;
les urgences chirurgicales.
Savoir actualiser et élargir ses connaissances théoriques et techniques (congrès,
cours, enseignements universitaires...).
Savoir-faire de raisonnement clinique et de décision
Être capable de :
effectuer une synthèse clinique et para clinique des démarches de diagnostic ;
prendre des décisions opératoires individuellement et collectivement ;
adopter en cours d'intervention des changements de stratégie apparaissant
nécessaires ;
mener des actions dans l'urgence.
Modalités de validation : présentation de cas cliniques :
en staff ;
en réunions scientifiques ou pédagogiques ;
en séminaires ou en congrès.
Savoir-faire d'information et de communication avec les patients
Être capable de :
établir une relation d'écoute empathique avec un pa tient ;
respecter l'intimité des patients ;
délivrer une information claire, loyale et appropriée au patient, à sa famille et à son
entourage et éventuellement reformuler pour s'assurer de sa compréhension ;
annoncer avec clarté, tact et humanité des pronostics ou des événements négatifs
(handicap, décès, tumeur cancéreuse...) ;
aider un patient à prendre sa décision en lui présentant la balance des bénéfices-
risques des diverses solutions thérapeutiques ;
favoriser le dialogue avec le patient, notamment en cas d'échec thérapeutique ou
de complications.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 19
Savoirs et savoir-faire de communication avec les collègues et les
divers acteurs intervenant dans les lieux de soins
Être capable de :
partager et diffuser dans les délais appropriés les informations utiles concernant le
patient ;
prendre des décisions en concertation avec les collègues et le personnel de soins;
assurer la traçabilité et la transmission des informations, en particulier la mise à
jour du dossier patient.
Savoirs et savoir-faire de coopération
Avoir acquis la connaissance :
de l'organisation et du fonctionnement de la consultation, des urgences, du bloc
opératoire et des unités de soins.
Être capable de :
s'intégrer dans une équipe en situant son rôle et celui des autres membres de
l'équipe ;
travailler en coopération avec les autres professionnels de la santé et en équipe
pluridisciplinaire ;
participer à des activités ou projets transversaux au sein de l'établissement et
dans le cadre de réseaux médicaux ;
connaître ses limites (compétences, moyens du plateau technique, relation
médecin-malade...) et savoir adresser le cas échéant un patient à un autre praticien
ou un autre établissement.
Savoirs et savoir-faire procéduraux
Avoir acquis la connaissance :
des protocoles d'organisation des soins ;
des recommandations concernant les pratiques cliniques ;
des obligations réglementaires ;
des règles de confidentialité et de secret professionnel.
Être capable de :
rédiger un compte-rendu opératoire structuré selon les règles et
recommandations;
mettre en œuvre avec discernement les protocoles d'organisation des soins ;
mettre en œuvre avec discernement les recommandations sur les pratiques
cliniques ;
vérifier que les protocoles sont réactualisés, diffusés et connus de l'ensemble des
acteurs intervenant sur le parcours de soins.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 20
Savoirs et savoir-faire en méthodologie de recherche clinique
Connaître :
les principes élémentaires de la recherche clinique et de la gestion des données ;
la notion de conflit d'intérêt,
Etre capable de :
développer une autoévaluation et une réflexion critique sur sa pratique en vue de
l'améliorer ;
faire une recherche bibliographique avec analyse critique des articles ;
présenter des dossiers cliniques en réunion ;
confronter les points de vue et opinions.
Savoirs de base concernant l'environnement professionnel et
institutionnel
Avoir acquis la connaissance :
du contexte institutionnel dans lequel se déroule la pratique ;
du rôle des diverses institutions et instances intervenant sur les parcours de soins ;
des bases de la gestion hospitalière, de la gestion des ressources humaines, de
la gestion des réclamations et des plaintes ;
du coût des examens et des appareillages préconisés.
CNOM/Document de référence en Chirurgie Viscérale et Digestive Page 21
Vous aimerez peut-être aussi
- Radiographie Thoracique: DR - Benmakhlouf DR - Ch.MokhnecheDocument47 pagesRadiographie Thoracique: DR - Benmakhlouf DR - Ch.Mokhnecheayoub GRBPas encore d'évaluation
- 01 ThyroïdectomieDocument16 pages01 ThyroïdectomieDand16Pas encore d'évaluation
- Nodule Froid Thyroidien (Conférence)Document35 pagesNodule Froid Thyroidien (Conférence)aitsurgery4730100% (1)
- CAT Devant Une Douleur AbdominaleDocument18 pagesCAT Devant Une Douleur AbdominaleMohamed Mimou0% (1)
- Anatomie Chirurgicale Et Voie D'abord de L'abdomenDocument16 pagesAnatomie Chirurgicale Et Voie D'abord de L'abdomenbaha2567% (6)
- Guide Pratique Pour La Présentation D'un Patient en Chirurgie DigestiveDocument3 pagesGuide Pratique Pour La Présentation D'un Patient en Chirurgie DigestiveDjallal Hassani100% (2)
- Hydrocèles de L'adulteDocument6 pagesHydrocèles de L'adulteMarcky EverHard PagniezPas encore d'évaluation
- Chir Digestive PR AHUKA 1Document341 pagesChir Digestive PR AHUKA 1lucienntakobajira1Pas encore d'évaluation
- CAT Devant Une Hemorragie Digestive HauteDocument61 pagesCAT Devant Une Hemorragie Digestive HauteSouleymanePas encore d'évaluation
- LES URGENCES CHIRURGICALES-convertiDocument153 pagesLES URGENCES CHIRURGICALES-convertialyounePas encore d'évaluation
- Plaies Pénétrantes de L'abdomenDocument44 pagesPlaies Pénétrantes de L'abdomencassiopeia xPas encore d'évaluation
- Sutures Chirurgicales: Un Manuel Pratique sur les Nœuds Chirurgicaux et les Techniques de Suture Utilisées dans les Premiers Secours, la Chirurgie et la Médecine GénéraleD'EverandSutures Chirurgicales: Un Manuel Pratique sur les Nœuds Chirurgicaux et les Techniques de Suture Utilisées dans les Premiers Secours, la Chirurgie et la Médecine GénéraleÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Précis d'anesthésie et de réanimation - Abrégé de la cinquième éditionD'EverandPrécis d'anesthésie et de réanimation - Abrégé de la cinquième éditionPas encore d'évaluation
- 33 - Bisegmentectomie IVb V Avec Curage Pour Cancer de La Vesicule Biliaire PDFDocument5 pages33 - Bisegmentectomie IVb V Avec Curage Pour Cancer de La Vesicule Biliaire PDFJohn SmithPas encore d'évaluation
- Occlusion Ale AigueDocument19 pagesOcclusion Ale Aigueaitsurgery4730Pas encore d'évaluation
- Traumatismes AbdominopelviensDocument50 pagesTraumatismes AbdominopelviensAli Slimani100% (1)
- Conduite À Tenir Devant Une Lésion Caustique Du Tractus Digestif SupérieurDocument26 pagesConduite À Tenir Devant Une Lésion Caustique Du Tractus Digestif Supérieuraitsurgery4730Pas encore d'évaluation
- Kyste Hydatique Du FoieDocument34 pagesKyste Hydatique Du FoieZak Oulmane33% (3)
- AngiocholiteDocument8 pagesAngiocholitebaha25Pas encore d'évaluation
- Infarctus Entero-MesenetriqueDocument11 pagesInfarctus Entero-Mesenetriqueminatayeb92Pas encore d'évaluation
- Cas Clini R4Document24 pagesCas Clini R4chirPas encore d'évaluation
- Occlusion Intestinale AigueDocument6 pagesOcclusion Intestinale AigueSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Traitement Chirurgical de La MUGDDocument13 pagesTraitement Chirurgical de La MUGDaitsurgery4730100% (6)
- Anastomose Colo-Anale Différée, Après Exérèse Totale Du MésorectumDocument4 pagesAnastomose Colo-Anale Différée, Après Exérèse Totale Du Mésorectummowoize83 mowoize83100% (1)
- Rupture de La RateDocument7 pagesRupture de La RateMACON824100% (1)
- Urgences ChirurgicalesDocument62 pagesUrgences ChirurgicalesalmnaouarPas encore d'évaluation
- Cours Coelioscopie IADE PDFDocument10 pagesCours Coelioscopie IADE PDFdfsdfsdftePas encore d'évaluation
- PolytraumatiséDocument13 pagesPolytraumatiséaitsurgery4730100% (2)
- Traumatisme Iatrogène de La VBPDocument8 pagesTraumatisme Iatrogène de La VBPOuedoasis TestPas encore d'évaluation
- 05-Occlusions Intestinales AiguësDocument3 pages05-Occlusions Intestinales AiguësDany AbdouPas encore d'évaluation
- Cours Voies Biliaires Extra 2020-ConvertiDocument4 pagesCours Voies Biliaires Extra 2020-ConvertiAghasy LittlePas encore d'évaluation
- Cas Clinique (Thyroide)Document25 pagesCas Clinique (Thyroide)aitsurgery4730100% (2)
- Traumatismes Abdominaux 2011Document32 pagesTraumatismes Abdominaux 2011achabsurgeryPas encore d'évaluation
- 22-Cancer Du CôlonDocument8 pages22-Cancer Du CôlonSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Lithiase Vesiculair4Document12 pagesLithiase Vesiculair4aitsurgery4730Pas encore d'évaluation
- UnknownDocument194 pagesUnknownSam Ath SanPas encore d'évaluation
- Résumé de GastroDocument11 pagesRésumé de Gastroimma_drPas encore d'évaluation
- Cas Clinique Chirurgie Viscerale 2Document3 pagesCas Clinique Chirurgie Viscerale 2Abdillahi MahadPas encore d'évaluation
- N°352 - Peritonite Aiguë Chez L'enfant - 06-03-2015Document8 pagesN°352 - Peritonite Aiguë Chez L'enfant - 06-03-2015Floroiu AncaPas encore d'évaluation
- 3 - Hernies Et Éventrations de La Paroi Abdominale - PR ToughraiDocument21 pages3 - Hernies Et Éventrations de La Paroi Abdominale - PR ToughraiDoha El Aidouni100% (1)
- L AppendiciteDocument3 pagesL AppendiciteKhaoulaFaithful100% (2)
- Cas Clinique Traumat Abd SpleniquepptDocument36 pagesCas Clinique Traumat Abd SpleniquepptIlyass ChekrouniPas encore d'évaluation
- Les Stomies DigestivesDocument6 pagesLes Stomies DigestivesBonjour666Pas encore d'évaluation
- Occlusions Intestinales - 061652Document61 pagesOcclusions Intestinales - 061652ndemba stevePas encore d'évaluation
- Appendicite AiguDocument20 pagesAppendicite Aiguقريوي مصطفى100% (2)
- Hernies Et Éventrations 2019 Cas CliniquesDocument20 pagesHernies Et Éventrations 2019 Cas Cliniqueszaafouri omarPas encore d'évaluation
- Cas Clinique - Urgences ChirurgicalesDocument40 pagesCas Clinique - Urgences ChirurgicalesWafa MinamPas encore d'évaluation
- Lithiase ResiduelleDocument12 pagesLithiase ResiduelleAlilou Le Duc100% (1)
- Kyste Hydatique Du FoieDocument49 pagesKyste Hydatique Du Foiedjamel100% (4)
- Douleur Abdominale Aigue TDDocument56 pagesDouleur Abdominale Aigue TDMohamed MimouPas encore d'évaluation
- La Chirurgie de L'hypertension PortaleDocument10 pagesLa Chirurgie de L'hypertension Portaleaitsurgery4730Pas encore d'évaluation
- Peritonites AiguesDocument19 pagesPeritonites Aiguesminatayeb92Pas encore d'évaluation
- Artere DigestiveDocument18 pagesArtere DigestiveIoana RastianPas encore d'évaluation
- CAT DEVANT UNE HEMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE D'o Ulcereuse PDFDocument5 pagesCAT DEVANT UNE HEMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE D'o Ulcereuse PDFYacine ZenadiPas encore d'évaluation
- Atrésie Oesophage 2019Document4 pagesAtrésie Oesophage 2019SouleymanePas encore d'évaluation
- Cas Cliniques de Chirurgie (Jury 2017) PDFDocument50 pagesCas Cliniques de Chirurgie (Jury 2017) PDFMichée IbulaPas encore d'évaluation
- Cancer de La VBP DEMSDocument20 pagesCancer de La VBP DEMSDjallal HassaniPas encore d'évaluation
- 28 Congrès National de Société Algerienne de Chirugie 2021Document62 pages28 Congrès National de Société Algerienne de Chirugie 2021neoPas encore d'évaluation
- Proctologie PratiqueDocument39 pagesProctologie PratiqueproctoaquitainePas encore d'évaluation
- Les Contusions de L'abdomenDocument62 pagesLes Contusions de L'abdomenFadi Fidou100% (2)
- 2021 AngiocholiteDocument35 pages2021 Angiocholiterahma bouadamPas encore d'évaluation
- Examen Clinique Chirurgie 2015Document2 pagesExamen Clinique Chirurgie 2015Mohamed TouatiPas encore d'évaluation
- 2022 DEPREZ-AudreyDocument38 pages2022 DEPREZ-Audreywb5510078Pas encore d'évaluation
- Le Guide Des Vergetures OorekaDocument40 pagesLe Guide Des Vergetures OorekaBauchard CorettePas encore d'évaluation
- Chirurgie de L'ethmoide Et Du SphenoideDocument14 pagesChirurgie de L'ethmoide Et Du SphenoideTayhoudit TaberkantPas encore d'évaluation
- Prise en Charge D Un Traumatisme HepatospleniqueDocument9 pagesPrise en Charge D Un Traumatisme HepatospleniqueHicham AjdarPas encore d'évaluation
- Abcès de Paroi Après Chirurgie AbdominaleDocument7 pagesAbcès de Paroi Après Chirurgie AbdominaleOussama TalahPas encore d'évaluation
- Le Laryngospame Perianesthesique Prevention Et TraitementDocument9 pagesLe Laryngospame Perianesthesique Prevention Et TraitementOussamaPas encore d'évaluation
- Rhinoplastie - Recherche GoogleDocument1 pageRhinoplastie - Recherche Googlelolo momoPas encore d'évaluation
- Chirurgie Esthetique Des PaupieresDocument4 pagesChirurgie Esthetique Des PaupieresMax StraviPas encore d'évaluation
- 3-Nevoux JDocument43 pages3-Nevoux Jdoud loPas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S0294126016300218 MainDocument14 pages1 s2.0 S0294126016300218 MainKevin DigbeuPas encore d'évaluation
- 1) Serine Bouzouaoui 2017.2018 PDFDocument10 pages1) Serine Bouzouaoui 2017.2018 PDFJhonny GreenPas encore d'évaluation
- Robert FrCD13Document61 pagesRobert FrCD13Anass VillaPas encore d'évaluation
- Anatomie Du NezDocument7 pagesAnatomie Du NezSara BerhPas encore d'évaluation
- Rattrapage Pseudarthrose Du Col FémoralDocument8 pagesRattrapage Pseudarthrose Du Col Fémoralfleur orchidée100% (1)
- ProthesesDocument27 pagesProthesessaadPas encore d'évaluation
- Décompression Portale Hypersélective Pour Rupture de Varices Œsophagiennes: Étude D'une Série de 122 Cas Avec Résultats LointainsDocument7 pagesDécompression Portale Hypersélective Pour Rupture de Varices Œsophagiennes: Étude D'une Série de 122 Cas Avec Résultats LointainsElbordjiPas encore d'évaluation
- Chirurgie Périmplantaire 2020Document27 pagesChirurgie Périmplantaire 2020hadil chebliPas encore d'évaluation
- Fracture Du Diaphyse Del'humerusDocument11 pagesFracture Du Diaphyse Del'humerusboutefal imenePas encore d'évaluation
- 23 - Occlusions Intestinales AiguesDocument17 pages23 - Occlusions Intestinales Aiguesamina mhnPas encore d'évaluation
- Cinématique Inverse D'un Robot Sériel Dédié Au Domaine MédicalDocument101 pagesCinématique Inverse D'un Robot Sériel Dédié Au Domaine MédicalChiheb MrabetPas encore d'évaluation
- Electro My Og Rap HeDocument3 pagesElectro My Og Rap HeKENANG KEMKA Léric FranckPas encore d'évaluation
- Don Et Greffe D'organeDocument14 pagesDon Et Greffe D'organeAya DjouambiPas encore d'évaluation
- Tfe Gradie Tablier Abdominal 10Document33 pagesTfe Gradie Tablier Abdominal 10franklin.nzemboPas encore d'évaluation
- Cancer Rectum 2018Document31 pagesCancer Rectum 2018ElbordjiPas encore d'évaluation
- Syllabus - Etude de CasDocument7 pagesSyllabus - Etude de CasImen ZammelPas encore d'évaluation
- Chirurgie Oculaire Sous Les Climats Chauds 10Document10 pagesChirurgie Oculaire Sous Les Climats Chauds 10Viergelene PercinePas encore d'évaluation
- Anesthesie Reanimation Occlusion Intestinale AigueDocument41 pagesAnesthesie Reanimation Occlusion Intestinale Aiguekheira SaketPas encore d'évaluation
- Catalogue Shop Biomedica Materiel Medical 19-08-2022Document9 pagesCatalogue Shop Biomedica Materiel Medical 19-08-2022Mr AbdellatifPas encore d'évaluation