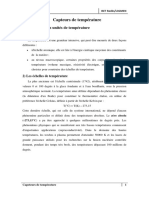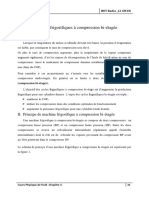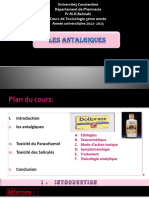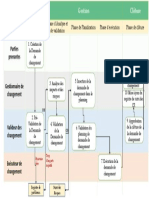Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Calcul Des Chambres Froides
Transféré par
Yosra JbeliTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Calcul Des Chambres Froides
Transféré par
Yosra JbeliDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dimensionnement des chambres froides
1 CLASSEMENT DES CHAMBRES FROIDES.
Il existe trois types de chambres froides :
• la chambre froide compacte
• la chambre froide modulable, démontable
• la chambre froide bâtie.
a- Définition :
Une chambre froide à usage commercial, est une enceinte frigorifique apte à
maintenir à la température requise les denrées périssables qui sont entreposées et
d’un volume tel que l’utilisateur doit y pénétrer pour introduire et prélever les produits.
Il existe deux types de chambre froide :
1- Chambre froide à température positive. L'évaporateur sera de type +A haute
température à convection naturelle. Exemple chambre froide de fleur (4) °C
+A haute température à convection forcée et dégivrage par air ambiant
Exemple chambre à produits embouteillés(4) °C.
2-Chambre froide à moyenne température
Exemple chambre à viande (1) °C.
3-Chambre froide à température négative
- Exemple chambre congélateur (-24°C) dégivrage électrique ou à gaz chauds.
2 PROCEDES DE REFROIDISSEMENT DANS
DES CHAMBRES FROIDES
2-1- modes de refroidissement
a- refroidissement directe
Celui-ci est également dénommé détente directe dans ce cas, le fluide frigorigène est
directement en contact thermique avec le liquide à refroidir, la chaleur qui lui est
retirée assurant l’évaporation du fluide frigorigène.
b- refroidissement indirecte
Il y a refroidissement indirect quand, pour le transfert de chaleur entre le liquide à
refroidir et le fluide frigorigène en évaporation, on a recours à un troisième liquide
intermédiaire que l’on dénomme généralement fluide frigo-porteur .
2-2- Systèmes de dégivrage
DEGIVRAGE DES EVAPORATEURS DES POSTES A TEMPERATEURS POSITIVES
Dégivrage à air
Avec des températures de conservation supérieures à 0°C, le dégivrage se conçoit
Calcul d’une chambre froide 1
Dimensionnement des chambres froides
généralement par arrêt de la production frigorifique et la mise en “ marche forcée ”du
ou des ventilateurs de l’évaporateur.
Le passage contenu de l’air à travers l’évaporateur (air à une température supérieur
à 0°C) va faire fondre le givre accumulé et assurer le dégivrage. La commande de
dégivrage pouvant se faire automatiquement par interrupteur horaire ou
manuellement.
DEGIVRAGE DES EVAPORATEURS DES POSTES A TEMPERATURE
NEGATIVES
Pour les postes à températures négatives il existe principalement trois procédés de
dégivrage.
1. Dégivrage par chauffage électrique
le dégivrage par résistances électriques est, de loin, le mode de dégivrage le plus
utilisé. Des épingles (ou cannes) chauffantes sont agrafées dans l’évaporateur
parallèlement aux tubes.
La commande du dégivrage se fait généralement par interrupteur horaire(“ pendule
de dégivrage ”), le retour à la “ marche réfrigération ” étant souvent assuré par un
thermostat de fin de dégivrage.
Avec ce procédé de dégivrage il est également prévu un thermostat de sécurité
chaud.
2. Dégivrage par gaz chauds
Avec ce procédé, le dégivrage de l’évaporateur est obtenu en envoyant dans
l’évaporateur les gaz chauds venant du refoulement du compresseur.
Une conduite “gaz chauds ” sur laquelle on trouve un robinet électromagnétique, relie
le refoulement du compresseur à l’entrée de l’évaporateur ‘en aval du détendeur).
La commande de dégivrage, par ouverture du robinet électromagnétique “ gaz
chauds ”, se fait généralement par interrupteur horaire.
3. Dégivrage par inversion de cycle
Une vanne 4 voies d’inversion de cycle permet d’inverser les rôles du condenseur et
de l’évaporateur. En phase dégivrage l’évaporateur à dégivrer fonctionne en
condenseur et le condenseur en évaporateur.
Comme pour les deux autre procédés, la commande du dégivrage (alimentation de
la vanne 4 voie d’inversion de cycle) se fait par interrupteur horaire.
3 Calcul de volume de la chambre
Vch = E/gv (m3)
Vch : volume de charge
E : Capacité de la chambre (T)
gv : coeff de charge T/m3.
Viande congelée gv = 0,35 T/ m3.
Viande suspendu gv = 0,25 T/ m3
Poisson en caisse gv = 0,45 T/ m3
Beurre gv = 0,70 T/ m3
.Oeuf gv = 0,26 T/ m3
Calcul d’une chambre froide 2
Dimensionnement des chambres froides
Pomme en caisse gv = 0,36 T/ m3
Orange gv = 0,45 T/ m3
Fch = Vch/Hch
Fch = surface de charge
Hch = hauteur de charge (0,5 à 0,6 m entre plafond et charge)
FCF = Fch/β
FCF = surface réelle de la C.F.
β = coeff d.utilisation
Pour : 100m² 0,70 à 0,75
100 - 400m² 0,75 à 0,80
400 m² 0,80 à 0,85
4 Introduction
Avant de commencer à procéder au dimensionnement des composants d’une
installation frigorifique, il est nécessaire de connaître :
la température souhaitée par le client ainsi que le type de marchandises qui
va se trouver dans la chambre froide
les modalités et contraintes de réalisation de l’installation
le type d’installation.
Ce n’est qu’après cela que l’on peut déterminer les charges thermiques de la
chambre froides. Ces charges correspondront à la production frigorifique nécessaire
pour en assurer la compensation.
Les charges thermiques se répartissent en deux grandes catégories : les charges
externes et les charges internes.
La catégorie des charges thermiques externes comprend :
les charges dues aux apports de chaleur par transmission à travers
l’enveloppe de la chambre froide : parois verticales, plancher bas et plancher
haut ;
les charges dues au renouvellement d’air ;
les charges dues à l’ouverture des portes.
La catégorie des charges thermiques internes se subdivise elle-même en deux
sous-catégories :
la sous-catégorie des charges dépendantes des produits entreposés et du ou
des évaporateurs, à savoir :
o les charges dues aux produits entrants ;
o les charges dues à la respiration des produits entreposés ( fruits et
légumes) ;
o les charges dues à la chaleur dégagée par le moteur de chaque
ventilateur d’évaporateur ;
o les charges dues au dégagement de chaleur des résistances
électriques des évaporateurs lorsque ces résistances sont mises sous
Calcul d’une chambre froide 3
Dimensionnement des chambres froides
tension en période de dégivrage ;
la sous-catégorie des charges indépendantes des produits entreposés et de
l’installation frigorifique et qui comprend :
o les charges dues à l’éclairage ;
o les charges dues au personnel ;
o les charges dues aux chariots élévateurs et transpalettes ;
o les charges dues à la présence d’éventuellement autres machines.
Calcul d’une chambre froide 4
Dimensionnement des chambres froides
5 Calcul des charges thermiques
externes
5.1 Charge thermique par transmission à travers
les parois ( Qtr)
On procède à ce calcul par paroi, c’est-à-dire d’abord les quatre parois verticale puis
le plancher haut (toiture) et enfin le plancher bas.
La charge thermique par transmission à travers les parois a pour valeur :
Q K St
tr
K étant le coefficient de transmission thermique de la paroi ( W/m²K), S la surface de
la paroi ( m²)et t l’écart de température entre l’intérieur de la chambre froide et
l’extérieur ( température du local qui contient la chambre froide ou la température de
l’extérieur).
Le coefficient K est calculé suivant sa formule classique :
K 1
1 e 1
n j
h hi
j 1
j e
On trouvera ci-dessous les tableaux donnant les coefficient de conductibilité
thermique des différents matériaux utilisés ainsi que le tableau donnant les
coefficients d’échange superficiel hi et he.
Calcul d’une chambre froide 5
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 6
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 7
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 8
Dimensionnement des chambres froides
Lorsqu’on veut effectuer un calcul précis dans le cas de chambres froides dont
certaines parois sont fortement ensoleillées, on majore l’écart de température t
donnant la charge thermique par transmission de la valeur de t’ donnée par le
tableau ci-dessous.
Q K S(t t')
tr
Calcul d’une chambre froide 9
Dimensionnement des chambres froides
5.2 Charge thermique par renouvellement d’air(Qre)
Dans de nombreuses chambres froides, il est prévu de renouveler plus ou moins l’air
ambiant, c’est-à-dire de remplacer une partie de l’air de la chambre froide par de l’air
extérieur dont la température est, une partie de l’année, supérieure à celle de la
chambre froide. La quantité d’air neuf admise doit être refroidie de la température
extérieure à la température de la chambre froide et constitue donc une charge
thermique.
La charge thermique par renouvellement d’air a pour valeur :
Qre ma,eh en kW
où ma,e est le débit massique d’air extérieur admis en kg/s et h est la différence
d’enthalpie entre l’air extérieur et l’air ambiant de la chambre froide (kJ/kg).
On a par ailleurs :
V
m
a,e a,a
86400
a,e
1,293
1 t
a,a
a
273,15
V V n
a,e cf
n 70
V cf
Va,e est le débit volumique d’air extérieur en m³/jour, a,a la masse volumique de l’air
dans la chambre froide, ta la température en °C de la chambre froide, V cf le volume
de la chambre froide en m³ et n le taux de renouvellement d’air journalier en jour -1
Calcul d’une chambre froide 10
Dimensionnement des chambres froides
5.3 Charge thermique par ouverture des portes( Qop)
Dans le cas de petites chambres froides commerciales ne comportant qu’une seule
porte, on se contente du calcul de la charge par renouvellement d’air tandis que dans
le cas d’une chambre froide d’assez grand volume comportant plusieurs portes. Il est
recommandé d’effectuer également le calcul de la charge par ouverture des portes.
Dans l’hypothèse où la chambre comporte plusieurs portes, on suppose presque
toujours qu’il n’y a très rarement ouverture simultanée de plusieurs portes et c’est
pourquoi le calcul n’est effectué que pour une seule porte.
La charge thermique par ouverture des portes est donnée par la formule :
Q 80,067t l h h 1 h h c
a,e
on trouve une grandeur
op p p a,a p p p a,e a,a ra
a,a
en watt
où tp est l’écart de température de l’air entre les deux côtés de la porte
p est le temps d’ouverture des portes exprimé en min/h
a,a est la masse volumique de l’air dans la chambre
a,e est la masse volumique de l’air à l’extérieur de la chambre
lp est la largeur de la porte
hp est la hauteur de la porte
ha,e et ha,a les enthalpies de l’air à l’extérieur et l’intérieur de la chambre froide
cra est un coefficient de minoration dû à la présence éventuelle d’un rideau d’air.
Dans le cas d’une porte sans rideau, on le prend égal à 1, tandis que dans la cs avec
rideau on le prend égal à 0,25.
On doit aussi calculer le temps d’ouverture des portes. Il consiste dans un premier
temps à déterminer le tonnage entreposable dans la chambre froide considérée, puis
partant de cette valeur, à estimer le flux horaire maximal de marchandises entrant ou
sortant (stockage/déstockage). Connaissant par expérience le temps moyen pendant
lequel la porte d’une chambre froide reste ouverte pour permettre le transit d’une
tonne d’un type de marchandise donné, il est alors possible de calculer pendant
combien de temps elle restera ouverte pour permettre le passage de la masse de
marchandises considérée. Le temps moyen pendant lequel la porte d’une chambre
froide reste ouverte pour permettre le transit d’une tonne d’un type de marchandise
donné comprend le temps nécessaire au passage au retour ( à vide ou à plein).
On a :
d f
i j
24
p
en min/h où dt est la durée moyenne d’ouvertures des portes en min/tonnes et f j le
flux journalier de marchandises en tonne/jour. Le tableau ci-dessous vous donne la
valeur de dt.
Calcul d’une chambre froide 11
Dimensionnement des chambres froides
Le flux journalier fj de marchandises pouvant transiter par la ou les portes d’une
chambre froide se détermine par l’expérience sur la base d’un certain pourcentage
de la contenance totale de la chambre froide en kg.
La contenance totale d’une chambre froide peut être calculée d’après la formule :
C Ahd
e o
où A est la surface de la chambre froide en m², h la hauteur maximale de gerbage
(entreposage) en m, de est la densité d’enterposage en kg/m³ donnée par les
tableaux ci-joints et o le coefficient d’occupation au sol des marchandises tenant
compte des passages, des espacements à respecter et donné en %( voir tableau ci-
dessous).
Calcul d’une chambre froide 12
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 13
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 14
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 15
Dimensionnement des chambres froides
6 Calcul des charges thermiques
internes
6.1 Charges thermiques internes indépendantes
des denrées entreposées
6.1.1 CHARGE THERMIQUE DUE À L’ÉCLAIRAGE (QEC)
Dans des chambres froides classiques, les luminaires prévus, doivent pouvoir
résister au froid et à l’humidité, être étanches à l’eau, être protégés des contacts
avec tous objets et être insensibles aux effets de la poussière. L’éclairement nominal
habituellement prévu oscille entre 60 et 100 lx ce qui fait que le projeteur peut partir
dans ses calculs sur la base d’une charge thermique d’environ 6W/m².
Plus généralement, la charge thermique due à l’éclairage se calcule d’après la
formule :
Q iP
24
ec
i étant le nombre de luminaires, P la puissance de chaque luminaire en W y compris
la puissance du starter dans le cas de lampes à cathode chaude, la durée de
fonctionnement des luminaires en h/j.
6.1.2 CHARGE THERMIQUE DUE AUX PERSONNES (QPE)
La charge thermique due aux personnes se calcule d’après la formule :
Q iq p
24
pe
où i est le nombre de personnes opérant dans la chambre froide, q p la quantité de
chaleur dégagée par unité de temps par une personne en activité moyenne dans une
chambre froide( voir tableau ci-dessous) et la durée de la présence de chaque
personne dans la chambre froide en h/j.
6.1.3 CHARGE THERMIQUE DUE AU MATÉRIEL ROULANT (QMR)
Ce matériel roulant est le plus souvent constitué de chariots élévateurs et
transpalettes. On a :
Calcul d’une chambre froide 16
Dimensionnement des chambres froides
Q iP
24
mr
avec i le nombre de matériels roulants, P la puissance totale de chaque type de
matériel roulant et le temps de fonctionnement de ce matériel par journée en h/j.
6.1.4 CHARGE THERMIQUE DUE AUX MACHINES DIVERSES (QMD)
Ces machines peuvent être très diversifiées : étuves, cutters, hachoirs, etc. On alune
formule identique au point précédent.
Q iP
24
md
Calcul d’une chambre froide 17
Dimensionnement des chambres froides
6.2 Charges thermiques internes dépendantes des
denrées entreposées
6.2.1 CHARGE THERMIQUE DUE AUX DENRÉES ENTRANTES (QDE)
Cette charge résulte de ce que les produits introduits dans la chambre froide se
trouvent presque toujours à une température supérieure à la température de la
chambre froide et qu’ils dégagent donc une certaine quantité de chaleur aussi
longtemps que leur température n’est pas tombée à la température d’entreposage.
La charge due aux produits entrants pour abaisser leur température jusqu’à celle
d’entreposage est donnée par la formule :
1
Q mc t t mLmc t t
1 2 2 2 3
86400
de
en kW où
m est la masse de denrées introduite chaque jour en kg/j
c1 est la capacité thermique moyenne entre t1 et t2 de chaque type de denrée
introduite, en kJ/kg.K
t1 est la température initiale de la denrée introduite en °C
t2 est la température de congélation de la denrée introduite en °C
L est la chaleur latente de congélation de la denrée introduite en kJ/kg
c2 est la capacité thermique moyenne entre t2 et t3 de chaque type de denrée
introduite, en kJ/kg.K
t3 est la température d’entreposage des denrées en °C.
Au lieu d’effectuer le calcul type de denrée par type de denrée lorsque les denrées
introduites sont différentes, on peut calculer, tant pour les denrées avant congélation
que pour les denrées après congélation, une capacité thermique massique moyenne
cm telle que :
c mc m c m c
1 1 2 2 n n
m m m
m
1 2 n
Calcul d’une chambre froide 18
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 19
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 20
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 21
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 22
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 23
Dimensionnement des chambres froides
6.2.2 CHARGE THERMIQUE DUE À LA RESPIRATION DES DENRÉES (QRESP)
Les produits végétaux entreposés dégagent de la chaleur du fait de leur respiration,
de même que les fromages du fait de leur fermentation. En présence de tels
produits, il faut tenir compte également de la charge correspondante qui a pour
valeur :
Q mq resp
86400
resp
en kW où qresp est la chaleur de respiration de la marchandise considérée en kJ/kg.j.
Le tableau donne les valeurs de qresp mais en kJ/t.h. Il y a donc à faire une petite
conversion à faire.
Calcul d’une chambre froide 24
Dimensionnement des chambres froides
Calcul d’une chambre froide 25
Dimensionnement des chambres froides
6.2.3 PUISSANCE FRIGORIFIQUE INTERMÉDIAIRE DE L’ÉVAPORATEUR(Q0,INT)
Arrivé à ce stade du calcul, il nécessaire de déterminer la puissance frigorifique
intermédiaire que le ou les évaporateurs devront assurer afin de couvrir la charge
thermique intermédiaire Qint, somme des différentes charges unitaires précédemment
calculées. Cette puissance frigorifique intermédiaire nous sera ensuite utile pour
déterminer, ainsi que nous le verrons au prochain paragraphe, la puissance
frigorifique prévisionnelle Q0,prév.
La charge thermique intermédiaire est :
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
int tr re op ec pe mr md de resp
Si l’on désigne par inst la durée de fonctionnement de l’installation frigorifique en
heures/jour ( 18h/j pou une chambre froide de produits congelés, 16h/j pour les
autres cas), la puissance frigorifique intermédiaire de l’évaporateur est alors :
Q Q 24 int
0,int
inst
6.2.4 CAHRGE THERMIQUE DUE AUX MOTEURS DES VENTILATEURS DES ÉVAPORATEURS
(QVENT)
Dans les chambres froides modernes, on utilise toujours des évaporateurs équipés
d’un ou plusieurs ventilateurs ce qui permet d’assurer un brassage et une circulation
efficaces de l’air. Chaque ventilateur est entraîné par un moteur électrique qui
dégage de la chaleur qui s’ajoute à la chaleur dégagée par les différentes autres
sources. La charge due aux moteurs des ventilateurs est alors donnée par la
formule :
Q nP évap
vent
inst
Ce calcul nécessite donc de connaître le nombre et le type d’évaporateurs prévus.
Or ces indications ne seront normalement connues qu’une fois le bilan frigorifique
établi. C’est pourquoi l’on procède dans un premier temps à la détermination
provisoire du nombre et du type d’évaporateurs à prévoir, cette détermination faisant
l’objet d’une vérification ultérieure, une fois la charge thermique totale effective
connue. Cette détermination provisoire tient également compte de la charge
thermique résultant du dégivrage, charge dont le calcul fait l’objet du prochain
paragraphe.
La détermination provisoire du nombre et du type d’évaporateurs se fait à partir du
calcul provisoire de la puissance frigorifique prévisionnelle Q 0,prév laquelle s’obtient en
ajoutant 20% à la puissance frigorifique intermédiaire Q 0,int calculée au paragraphe
précédent. On a donc :
Q 0,prév 1,2Q 0,int
Calcul d’une chambre froide 26
Dimensionnement des chambres froides
6.2.5 CHARGE THERMIQUE DUE AUX RÉSISTANCES DE DÉGIVRAGE (QDEG)
Il existe différents systèmes de dégivrage d’un évaporateur mais il s’agit souvent de
résistances électriques. La charge due aux résistances électriques est alors :
Q nP dég
dég
inst
dég qui est la durée journalière de dégivrage en h/j est donnée par le tableau ci-
dessous.
Calcul d’une chambre froide 27
Dimensionnement des chambres froides
7 Calcul et Sélection des composants
de l’installation frigorifique
Pour déterminer aisément les composants du circuit frigorifique il faut utiliser le
diagramme enthalpique.
Parmi les données de base
Température du local ou du procédé réfrigéré.
La puissance frigorifique Q à installer (déterminer grâce à un bilan thermique).
Les valeurs de référence.
Détermination de la température d’évaporation en estiment
ΔT = TSortie air/eau –Tévap → Tévap = TSortie air/eau - ΔT
Détermination de la température de condensation en estiment
ΔT = Tcond –T Sortie air/eau → Tcond = TSortie air/eau + ΔT
Tévap correspond BP
Tcond correspond HP ↔ choix du fluide frigorigène.
=ז HP/ BP < 7
Pour calculer et positionner les points sur le diagramme enthalpique, il faut
déterminer la surchauffe et le sous refroidissement.
En estiment ΔTsurch = Tsortie vap - Tévap
ΔTsous ref = Tcond – Tsortie liq
Positionner les point sur le diagramme enthalpique correspondant à la nature
du fluide frigorigène choisie.
Détermination du débit
qm = Q/(h1-h4)
Volume aspiré
Va = qm* vsp
Calcul d’une chambre froide 28
Dimensionnement des chambres froides
Taux de compression
т = HP/BP
Rendement volumétrique
ηv = 1-0.05т
Volume balayé du compresseur
Vb = Va/ ηv
Puissance théorique pour la compression
Pth = qm (h-h3)
Puissance réelle pour la compression
Pr = Pth/ ηi (ηi rendement indiqué qui est sensiblement égal à ηv)
Puissance utile sur l’arbre du compresseur
Pua = Pr/ ηm (ηm rendement mécanique presque 0.9)
Puissance utile du moteur électrique
Le moteur électrique doit avoir une puissance d’au moins 10 à 20%
supérieure à celle solliciter par le compresseur
Pum = Pua x 1.2
Puissance condenseur
Qcond = Qévap + Pum
Puissance du détendeur
Le détendeur doit assurer un débit qm avec un ΔP=HP-BP + ∑ ΔPéléments du circuit
Choix du compresseur
Puissance frigorifique
Tévap
Tcond → consultation guide détermination du compresseur
Vb
Choix du condenseur (guide)
Qcond = KSΔT ΔT= (Tcond – Te)
Calcul d’une chambre froide 29
Dimensionnement des chambres froides
Choix de l’évaporateur (guide)
Qévap = KSΔT ΔT= (Tévap – Te)
Sélection des tuyauteries
La sélection des diamètres doit se faire en cherchant à limiter autant que
possible les pertes de charge. La perte de charge est proportionnelle au carrée
de la vitesse.
En matière de vitesse, il faut adopter une valeur qui garantisse l’entrainement
de l’huile tout en limitant les pertes de charges. Ce compromis exige de
respecter les limites suivantes.
o Ligne liquide : vitesse maximale (1.5m/s) au-delà on s’expose à des
bruits, vibrations, coup de bélier usure prématrice des composants.
o Ligne aspirante : vitesse maxi 7m/s dans les parties montantes et 3m/s
dans les parties horizontales et descendantes.
o Ligne de refoulement : même observations que pour la ligne aspirante.
o Ligne liquide condenseur bouteille : vitesse maxi 1m/s.
Utilisation des abaques avec estimation des vitesses.
7.1 Evaporateur
Une première chose à déterminer est l’écartement des ailettes (ou pas) de
l’évaporateur.
Il sera de :
5 mm pour des installations dont la température d’évaporation est
supérieure ou égale à 0°C ou pour des locaux dont la différence de
température entre l’air entrant dans l’évaporateur et la température
d’évaporation est faible (5 à 6K) ou alors pour des chambres
d’entreposage de denrées congelées dont les apports d’humidité sont
faibles.
7 mm pour des resserres à viande ou des chambres d’entreposage de
produits congelés.
12 mm pour des locaux dont les apports en humidité sont élevés et lorsque
la température d’évaporation est inférieure ou égale à –3°C ce qui est le
cas par exemple des locaux de réfrigération rapide et de réfrigération-choc
ou alors des installations qui, pour diverses raisons, entre autre
d’approvisionnement, ne doivent être dégivrées que de nuit.
Ensuite, on utilise un catalogue d’une firme produisant des évaporateurs et de
sélectionner l’évaporateur en tenant compte des températures de la chambre froide
et d’évaporation.
Soit en employant un tableau, ou un nomogramme ou encore plus facile un logiciel
de sélection.
Calcul d’une chambre froide 30
Dimensionnement des chambres froides
7.2 Compresseur
On sélectionne le compresseur pour la même puissance frigorifique et la même
température d’évaporation de l’évaporateur. On tiendra aussi compte de la
température.
On utilise de nouveau les catalogues des constructeurs de compresseurs en
retrouvant la bonne puissance frigorifique. On notera aussi la puissance électrique
absorbée par le compresseur qui sera utile dans le choix du condenseur.
7.3 Condenseur
En effet, la puissance que le condenseur doit dissipé est égale à la puissance
frigorifique de l’installation augmentée de la puissance absorbée par le compresseur.
Il reste ensuite à sélectionner le condenseur dans les tables du constructeur en
tenant compte de certains coefficients tenant compte des conditions de
fonctionnement et du fluide frigorigène. Ces coefficients changent de forme avec le
constructeur.
7.4 Tuyauteries de fluide frigorigène
De nombreuses tuyauteries de fluide frigorigène étant réalisées en cuivre, c’est sur la
base de ce matériau que nous indiquerons comment les calculer.
Les trois principaux éléments à prendre en compte dans le calcul d’une tuyauterie de
fluide frigorigène sont :
la perte en charge
le retour d’huile
la vitesse d’écoulement
La perte de charge influence défavorablement la puissance frigorifique de
l’installation car celle-ci diminue lorsque la différence de pression augmente.
Le tableau ci-dessous donne les pertes de charge admissibles des différentes
tuyauteries d’une installation frigorifique.
Désignation de la tuyauterie perte de charge
recommandée en K
tuyauterie d’aspiration 1à2
tuyauterie de refoulement 1à2
tuyauterie de liquide (condenseur/ bouteille de 0,5
liquide)
tuyauterie de liquide (bouteille de liquide/évaporateur) 0,5
La sélection d’un compresseur se trouve amélioré lorsque l’on essaye d’estimer
préalablement au plus juste la perte de charge dans la tuyauterie d’aspiration.
En ce qui concerne la vitesse d’écoulement du fluide frigorigène, elle doit rester dans
les limites des valeurs du tableau ci-dessous.
désignation de la tuyauterie vitesse recommandée (m/s)
tuyauterie d’aspiration 6 à 12
tuyauterie de refoulement 6 à 15
tuyauterie de liquide 0,3 à 1,2
Calcul d’une chambre froide 31
Dimensionnement des chambres froides
La détermination du diamètre d’une tuyauterie de fluide frigorigène doit être faite
avec d’autant plus d’attention que la perte de charge augmente comme le carré de la
vitesse.
Pour calculer la vitesse du fluide, on utilise la formule suivante :
Q
w 4 O,n
h h d
1 2
2
On calcule ensuite les pertes de charge pour chacun des tronçons par la formule
suivante :
p p p p p
tot r s asc acc
L
p w w hg p
2 2
géo
tot
d2 2 acc
Le dernier terme représente les pertes de charge dues aux accessoires comme par
exemple une électrovanne. Ces pertes de charge sont souvent données d’après le k v
qui représente le débit d’eau en m³ /h passant à travers l’accessoire pour une
différence de pression de 1 bar.
2
q
p
v
k 1000
v
Ces pertes de charge totales sont exprimées en pascal et en utilisant le diagramme
de Mollier du fluide frigorigène on peut trouver la différence de température créée par
ces pertes de charge. Le du cuivre est égal à 0,03
Calcul d’une chambre froide 32
Vous aimerez peut-être aussi
- Chapitre II-1 Final Bilan FrigorifiqueDocument10 pagesChapitre II-1 Final Bilan Frigorifiqueriyad Zoubiri100% (5)
- Cours Sur Le Dimensionnement Des Systeme Frigorifiques Exercices CorrigesDocument18 pagesCours Sur Le Dimensionnement Des Systeme Frigorifiques Exercices Corrigessage blanqui nzaou100% (1)
- Conception Et Dimensionnement Des Differents Composants DDocument26 pagesConception Et Dimensionnement Des Differents Composants DCheikh tdiane Sakho100% (1)
- MEMOIRE Dimmensionnent D'une Chambre Froide Pour Conservation de LaitDocument114 pagesMEMOIRE Dimmensionnent D'une Chambre Froide Pour Conservation de Laitmoussoki roly amédée100% (10)
- Bilan Chambre Froide PositiveDocument6 pagesBilan Chambre Froide PositiveAmine AlouiPas encore d'évaluation
- Reparation Chambre FroidDocument112 pagesReparation Chambre Froidsahi youssef100% (1)
- Chambre Froide NégativeDocument10 pagesChambre Froide NégativeNassim Chraiti100% (2)
- Recherche Sur Les Techniques de Mise en Service DDocument11 pagesRecherche Sur Les Techniques de Mise en Service DAdam Ben Hamouda100% (1)
- Theorie Du Cycle FrigorifiqueDocument87 pagesTheorie Du Cycle Frigorifiquezizo46100% (3)
- Le Bilan ThermiqueDocument55 pagesLe Bilan ThermiqueSalissou Salha100% (5)
- Travaux Dirigés de TRAITEMENT DE L'AIR FICHE 1Document3 pagesTravaux Dirigés de TRAITEMENT DE L'AIR FICHE 1Vianney NOUKUIMEU80% (5)
- Chambre Froide PositiveDocument6 pagesChambre Froide PositiveNassim Chraiti100% (1)
- OFPTT Conception D Une Chambre FroideDocument69 pagesOFPTT Conception D Une Chambre FroideAziz Mokhles80% (15)
- Récupération D'un Fluide Frigorigène Dans Une Station de RécupérationDocument17 pagesRécupération D'un Fluide Frigorigène Dans Une Station de RécupérationRania Chaabi100% (2)
- Mini Projeet PPT Chambre FroideDocument13 pagesMini Projeet PPT Chambre FroideAmira Warhéni100% (1)
- Cours MFPCDocument18 pagesCours MFPCSyphax HDPas encore d'évaluation
- Devis Chambre FroideDocument2 pagesDevis Chambre FroideJoseph Rodrigue NDOMO80% (10)
- MemoireDocument78 pagesMemoireshapirPas encore d'évaluation
- Cahier de Charges Techniques Chambre FroideDocument3 pagesCahier de Charges Techniques Chambre FroideChaima CHERNI100% (2)
- Choix Du Groupe de CondensationDocument3 pagesChoix Du Groupe de CondensationBrahim Adou100% (3)
- Mémoire Ingénieur Andreas NGATSEDocument77 pagesMémoire Ingénieur Andreas NGATSEAndreas NGASTE100% (1)
- Bilan Thermique Des Chambres Froides CFP&CFNDocument10 pagesBilan Thermique Des Chambres Froides CFP&CFNSirineJamoussiPas encore d'évaluation
- TD 5 - FroidDocument3 pagesTD 5 - Froidi s67% (3)
- Correction TD2-Conditionnement D'airDocument9 pagesCorrection TD2-Conditionnement D'airTalel Missaoui100% (2)
- Choix D'évaporateurDocument3 pagesChoix D'évaporateurBrahim Adou100% (1)
- Bilan Thermique Pour Chambre FroideDocument7 pagesBilan Thermique Pour Chambre Froideridhajamel100% (2)
- VRV 2/ 3tubesDocument30 pagesVRV 2/ 3tubesAmeni Trigui100% (2)
- Mémoire Chambre Froide BouiraDocument107 pagesMémoire Chambre Froide BouiraLounis MohamedPas encore d'évaluation
- Bilan Frigorifique - Chambre FroideDocument10 pagesBilan Frigorifique - Chambre FroideNizar Ben EzzinePas encore d'évaluation
- Cours M-07 Bilan Thermique-1Document36 pagesCours M-07 Bilan Thermique-1Je Suis100% (2)
- Dimensionner Une Installation de Chauffage PDFDocument6 pagesDimensionner Une Installation de Chauffage PDFYoussef EL HamraouiPas encore d'évaluation
- Production de Froid - Exemples de Calcul de MachinesDocument12 pagesProduction de Froid - Exemples de Calcul de Machinesriadh100% (2)
- 09-Technologie Des Appareils FrigorifiquesDocument10 pages09-Technologie Des Appareils FrigorifiquesAmeni Ben Amor100% (1)
- TD 4 Et CorrectionDocument6 pagesTD 4 Et Correctionadel grr100% (1)
- Rapport de Stage Corrigé Oued Jacques PDFDocument52 pagesRapport de Stage Corrigé Oued Jacques PDFOusmane Dicko100% (1)
- Machines FrigorifiqueDocument17 pagesMachines FrigorifiqueAnonymous jmFTK5T0% (1)
- Cta PDFDocument27 pagesCta PDFMouad Elhitar88% (8)
- Choix Du DétendeurDocument3 pagesChoix Du DétendeurSAmia100% (2)
- Simulation 15 PannesDocument18 pagesSimulation 15 PannesDENOU100% (1)
- Module n03 Travail Du Tube Cuivre TSGC Ofppt 3 PDFDocument83 pagesModule n03 Travail Du Tube Cuivre TSGC Ofppt 3 PDFGastov Ghassen100% (2)
- Chap 4 Installations FrigorifiquesDocument17 pagesChap 4 Installations FrigorifiquesDiakhate El hadji omarPas encore d'évaluation
- Chap3-Traitement de L AirDocument17 pagesChap3-Traitement de L AirMohamed Amine Gharbi78% (9)
- Frigo PanneDocument2 pagesFrigo PanneMehdiPas encore d'évaluation
- RapportDocument29 pagesRapportmm1s2434340% (5)
- Energieplus-Lesite - Be-Bilan Frigorifique Dune Chambre Froide PDFDocument15 pagesEnergieplus-Lesite - Be-Bilan Frigorifique Dune Chambre Froide PDFBrahim Adou100% (1)
- Part 2 CH4Document19 pagesPart 2 CH4Ben Hur100% (2)
- Appareils Et Regulateurs Frigorifique PDFDocument59 pagesAppareils Et Regulateurs Frigorifique PDFKeshia Wise100% (1)
- TD 5 - CorrectionDocument5 pagesTD 5 - Correctioni s100% (6)
- Initiation Au Froid ComDocument89 pagesInitiation Au Froid ComNelson Lekane100% (2)
- TPTPTPDocument5 pagesTPTPTPBader Boukhlik50% (2)
- Cours Froid Industriel 4 GP 2013 Introduction (Partie1)Document44 pagesCours Froid Industriel 4 GP 2013 Introduction (Partie1)Marwane Belboualia100% (4)
- Mémoire de Master en Énergétiques Abassi MejdiDocument93 pagesMémoire de Master en Énergétiques Abassi MejdiMejdi Abassi100% (2)
- 3-Fonction Machine Frigorifique Partie 3Document123 pages3-Fonction Machine Frigorifique Partie 3Mourad El MendiliPas encore d'évaluation
- Chapitre KHDocument17 pagesChapitre KHSUB ZERO Elycheikh Bousseif EthmanePas encore d'évaluation
- Dimensionnement D Une Chambre FroideDocument42 pagesDimensionnement D Une Chambre FroideMouaâd ZahniPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Gind Emi 2023Document34 pagesChapitre 5 Gind Emi 2023TaybiPas encore d'évaluation
- Cycle Frigo LubanDocument37 pagesCycle Frigo Lubanjebokawhi308Pas encore d'évaluation
- Cours de Clim 2017Document24 pagesCours de Clim 2017abdoulaye.baldePas encore d'évaluation
- Cours THERMIQUE DU BÂTIMENTDocument17 pagesCours THERMIQUE DU BÂTIMENTHadrich Med Amin100% (1)
- Frigorifique ExamenDocument2 pagesFrigorifique ExamenAnonymous jmFTK5TPas encore d'évaluation
- Energies RenouvelablesDocument26 pagesEnergies RenouvelablesYosra JbeliPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Capteurs de DébitDocument7 pagesChapitre 3 - Capteurs de DébitYosra JbeliPas encore d'évaluation
- Audit EnergétiqueDocument54 pagesAudit EnergétiqueYosra Jbeli100% (1)
- Capteurs de TempératureDocument16 pagesCapteurs de TempératureYosra JbeliPas encore d'évaluation
- Capteurs de PressionDocument7 pagesCapteurs de PressionYosra JbeliPas encore d'évaluation
- Dimensionnement Hydraulique 3Document56 pagesDimensionnement Hydraulique 3Yosra JbeliPas encore d'évaluation
- Chauffage Individuel Centralisé 2Document9 pagesChauffage Individuel Centralisé 2Yosra Jbeli100% (1)
- Chap 2 La Conduction ThermiqueDocument7 pagesChap 2 La Conduction ThermiqueYosra Jbeli100% (3)
- Chapitre 3 Physique de FroidDocument15 pagesChapitre 3 Physique de FroidYosra Jbeli100% (4)
- Chapitre 2 Physique de FroidDocument16 pagesChapitre 2 Physique de FroidYosra Jbeli100% (2)
- Chap 3 Dynamiue Des Fluides VisDocument10 pagesChap 3 Dynamiue Des Fluides VisYosra JbeliPas encore d'évaluation
- Ecoconso - Que Signifient Les Nouveaux Pictogrammes de Danger - 2023-02-01Document4 pagesEcoconso - Que Signifient Les Nouveaux Pictogrammes de Danger - 2023-02-01Dieudonné NofodjiPas encore d'évaluation
- Coloration GramDocument6 pagesColoration GramFatmazohra RAHILPas encore d'évaluation
- Chapitre - 1 PH201Document15 pagesChapitre - 1 PH201FanxyvPas encore d'évaluation
- Comprendre La SchizophrénieDocument25 pagesComprendre La SchizophrénieMontada DjazaironaPas encore d'évaluation
- 14 Antalgiques PDFDocument50 pages14 Antalgiques PDFLonely SnailPas encore d'évaluation
- Grille-Observation EgronDocument10 pagesGrille-Observation EgronSofia KHOUBBANEPas encore d'évaluation
- Colchicine Dans La Goutte Usage Et MésusageDocument6 pagesColchicine Dans La Goutte Usage Et MésusageAmine DounanePas encore d'évaluation
- Cours Equipements StatiquesDocument107 pagesCours Equipements Statiquesرضا بن عمارPas encore d'évaluation
- Cours 21-26 (Unite 6 +7)Document54 pagesCours 21-26 (Unite 6 +7)Maria SimotaPas encore d'évaluation
- Mesures Anthropométriques Pour L'évaluation de L'état Nutritionnel D'un Individu & La Situation Dans Une CommunautéDocument67 pagesMesures Anthropométriques Pour L'évaluation de L'état Nutritionnel D'un Individu & La Situation Dans Une CommunautéIbrahim HamadouPas encore d'évaluation
- TD ExternesDocument24 pagesTD ExternesDoria OuahraniPas encore d'évaluation
- Programme AidesoignantfinalDocument63 pagesProgramme AidesoignantfinalAbdelghni LachhabPas encore d'évaluation
- FIT Manioc 2014Document2 pagesFIT Manioc 2014Williams Koffi100% (1)
- Graniscel S55Document2 pagesGraniscel S55Aîda hajriPas encore d'évaluation
- 25 - Workflow Demande de ModificationDocument1 page25 - Workflow Demande de ModificationSerge VolpiPas encore d'évaluation
- Get File PDFDocument28 pagesGet File PDFHichemPas encore d'évaluation
- RTEC Cassette - R410A - InverterDocument2 pagesRTEC Cassette - R410A - InverterMohamed KhaldiPas encore d'évaluation
- Les Biomarqueurs de L'infarctus Du Myocarde: ChapitreDocument8 pagesLes Biomarqueurs de L'infarctus Du Myocarde: ChapitreTarek SayhiPas encore d'évaluation
- 01-03 - Dec10 - Philippe Dozoul - AFNOR - FDX50-252 - Francais PDFDocument24 pages01-03 - Dec10 - Philippe Dozoul - AFNOR - FDX50-252 - Francais PDFNassima Bendjeddou100% (1)
- Tchekhov Les Trois SoeursDocument28 pagesTchekhov Les Trois SoeursCristina MiaPas encore d'évaluation
- Diabete Gestationnel SynthDocument12 pagesDiabete Gestationnel SynthDumas Tchibozo100% (1)
- 2015 04 17 - Business Plan 2015 2017 - FRDocument88 pages2015 04 17 - Business Plan 2015 2017 - FRfohi2009Pas encore d'évaluation
- Abord Premier de L'artère Mésentérique Supérieure Au Cours de La Duodénopancréatectomie CéphaliqueDocument3 pagesAbord Premier de L'artère Mésentérique Supérieure Au Cours de La Duodénopancréatectomie CéphaliquefdroooPas encore d'évaluation
- Brochure Charte Audit Interne 2015def22x23def16pages Corrig2e 1Document16 pagesBrochure Charte Audit Interne 2015def22x23def16pages Corrig2e 1ʚïɞ Fi Fi ʚïɞPas encore d'évaluation
- Calcul Des Roulements 2Document11 pagesCalcul Des Roulements 2Amine MechPas encore d'évaluation
- SN5 Corrige3 VFDocument23 pagesSN5 Corrige3 VFSimrat KaurPas encore d'évaluation
- TP Projet D'arch 2è CibDocument12 pagesTP Projet D'arch 2è CibAMALI BlaisePas encore d'évaluation
- Dosage de La Vitamine CDocument10 pagesDosage de La Vitamine CalexisbradPas encore d'évaluation
- AVENTURE DE L'ELECTRICITE - C'est Pas Sorcier Spécial Enseignant - Yoshi37Document2 pagesAVENTURE DE L'ELECTRICITE - C'est Pas Sorcier Spécial Enseignant - Yoshi37BarbaraPas encore d'évaluation
- Protocole Reherche 15 Sept 2023Document78 pagesProtocole Reherche 15 Sept 2023Ali AIT-MOHANDPas encore d'évaluation