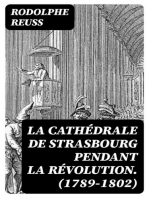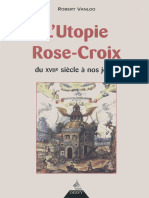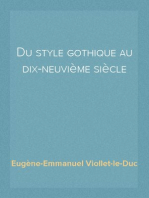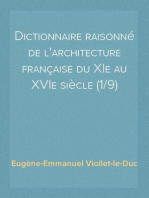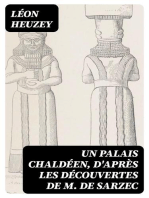Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Pierre Francastel - Versailles Et L'architecture Urbaine Au XVIIe Siècle
Transféré par
XUTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Pierre Francastel - Versailles Et L'architecture Urbaine Au XVIIe Siècle
Transféré par
XUDroits d'auteur :
Formats disponibles
Versailles et l'architecture urbaine au XVIIe siècle
Author(s): Pierre Francastel
Source: Annales. Histoire, Sciences Sociales , Oct. - Dec., 1955, 10e Année, No. 4 (Oct. -
Dec., 1955), pp. 465-479
Published by: Cambridge University Press
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/27579743
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Cambridge University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access
to Annales. Histoire, Sciences Sociales
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
ANNALES
?CONOMIES - SOCI?T?S - CIVILISATIONS
?TUDES
VERSAILLES ET L'ARCHITECTURE URBAINE
au xvne SI?CLE
Bien que le prestige de Versailles soit actuellement au plus haut point,
les ?tudes relatives ? son histoire n'ont pas fait de progr?s substantiel
depuis de longues ann?es. La publication de documents, tir?s principalement
des archives su?doises, nous a apport?, depuis trente ans, la solution de
quelques difficult?s et des pr?cisions d'ordre chronologique importantes,
mais on se meut toujours dans le cadre d?termin? par les admirables travaux
de Pierre de Nolhac au d?but de ce si?cle. Ce n'est certes pas manquer ?
sa m?moire que de le constater et de souhaiter en m?me temps que, suivant
son exemple, un nouveau pas soit fait pour interpr?ter plus compl?tement
une oeuvre dont il a ?t? le premier ? comprendre la signification v?ritable
ment exemplaire.
Cherchant, il y a vingt cinq ans, ? pr?ciser moi-m?me la signification de
la sculpture de Versailles, je m'?tais trouv? amen? ? entreprendre une ?tude
sur les sources du style fran?ais du xvne si?cle, acceptant ainsi au d?part
cette id?e que Versailles ?tait, suivant l'expression si frappante de Pierre
de Nolhac, le ? miroir du Grand Si?cle ?. Et la th?se finale suivant laquelle
le milieu versaillais, loin de se pr?senter comme une unit?, r?v?lait des
conflits de doctrine, une ?volution mettant en cause ? plusieurs reprises
les principes m?mes de Fart, n'avait pas ?t? sans soulever alors des r?serves
de divers c?t?s.
Le moment para?t venu de reprendre ces probl?mes, mais en choisissant
cette fois comme point d'application principal l'architecture, qui a fourni le
cadre de l'entreprise. Sans rejeter l'id?e que Versailles constitue le miroir
le plus fid?le de l'?poque, il est permis, en effet, de penser que l'on s'est
content? d'une vue rapide, la seule possible au d?part, et, surtout, qu'on
Annales (10e ann?e, octobre-d?cembre 1955), n? 4. 30
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
466 ANNALES
se faisait il y a cinquante ans une id?e encore 1res sommaire
qui unissent une uvre monumentale ? la soci?t? contempor
de Nolhac a ?t? des premiers ? concevoir ce lien de l'art et
11 serait s?rement d'accord pour souhaiter que se d?veloppen
destin?es ? mieux montrer la place que Versailles a tenue dans l
du Grand Si?cle.
On formulera, d'abord, deux observations. La premi?re e
Il y a cinquante ans, on partait de cette id?e que le si?cle d
constituait une ?poque domin?e d'une mani?re absolue par la
du roi. Les progr?s de notre connaissance des formes de la
contemporaine en Europe tendent peut-?tre aujourd'hui ?
l'exc?s la place tenue par le roi et par la France ? l'?poque
fait couramment de Versailles un chapitre de l'art baroque i
Une premi?re t?che consiste pour nous ? replacer l'entrepris
? sa place parmi les mouvements artistiques du temps qui so
de mouvements de civilisation. Il est pour cela n?cessaire que
tions l'id?e que la cr?ation de Versailles n'est pas l' uvre d'un
unanime, mais le produit d'un milieu fortement divis? et qu
cinquante ann?es de l'entreprise, a vu se modifier et les hommes
Le probl?me des g?n?rations de Versailles n'est pas seulemen
le posais il y a vingt-cinq ans, celui de l'?chelonnement entre d
rivaux d'une t?che qui traduit une ?volution des moyens d
mais celui d'une ?volution sociale et ?conomique qui met en caus
ments politiques et sociaux de l'?tat.
On voit ainsi se poser le second probl?me de base : dans qu
peut-on garder la notion du miroir? Plus que jamais, certes,
d'admettre que Versailles, l' uvre artistique majeure de ce temp
l'instrument d'observation le plus objectif et le plus complet
?t? l?gu? par les hommes du grand si?cle. En revanche, il faut
l'id?e que ce miroir nous renvoie n?cessairement une vue san
faut rejeter ?galement l'id?e que la part des diff?rents artisa
est conforme ? l'ordre des hi?rarchies administratives et sociale
Ce qui est inexact, c'est de croire que, parce que l' uvre artistiqu
une certaine harmonie ou plus exactement une certaine puiss
tement, elle t?moigne du r?le dominant de celui qui l'a voulue e
absolu de sa politique. Louis XIV a pu cr?er Versailles, il a p
s'imposer ? la nation, ?touffer toutes les dissidences, il ne les a p
et, dans Versailles m?me, on les d?couvre lorsqu'on s'approch
qu'on d?passe la vue rapide. Versailles n'est pas le produit d'u
m?thodiquement et progressivement ex?cut? par parties afin de
l'id?al unanime d'une soci?t? rigide. Le xvne si?cle fran?ais
caract?re glac? et froid que lui pr?tent ses d?tracteurs. Il vit, e
la violence de ses conflits, qui mettent en cause les fondements
de l'ordre humain ? tout autant que certaines uvres con
o? perce un moindre effort de perfection durable. Ce qui se ref
grand miroir de Versailles, ce n'est pas uniquement l'ordre o
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
VERSAILLES ET L'ARCHITECTURE URBAINE 467
les mille tendances qui ont fait de la France de la ?n du xvne si?cle le li
de la civilisation ? la fois la plus lucide et la plus r?volutionnaire de l'Europ
Miroir donc, plus que jamais, mais pas n?cessairement d'un ordre de mo
et d'une soci?t? totalitaire ? bien mieux repr?sent?e par des formes d'a
soi-disant libres mais caract?ristiques de soci?t?s intellectuellement confor
mistes.
*
Pour qui veut substituer ? l'?tude globale d'un V
qui n'a jamais exist? ? la vision d'un Versailles terra
intellectuels et sociaux du xvne si?cle, la premi?re d?m
les programmes. Doit-on consid?rer que, simplem
d?velopp?, suivant les lois d'une croissance naturelle,
simultan? des ressources et des ambitions de ses cr?at
du dessein fondamental? Ou bien faut-il admettre a
?chelonnement dans la d?termination des buts et d
ture?
Il se trouve que le d?bat se trouve centr?, d'une mani?re tr?s pr?cise,
autour de l'activit? des dix premi?res ann?es du r?gne de Louis XIV. Et,
m?me, que c'est entre les ann?es 1666 et 1674 que se sont concr?tis?s trois
programmes, correspondant ? trois solutions artistiques et humaines du
probl?me pos?. Il va de soi que cette position du probl?me est arbitraire
et qu'elle ?carte du d?bat de nombreux ?l?ments non seulement d'ex?cution
mais de conception, indispensables pour la connaissance aussi bien de Ver
sailles que de ?a soci?t? fran?aise du xvne si?cle. Elle permettra seulement
de pr?senter, dans les limites d'un article, quelques id?es et quelques faits
pouvant servir de point de d?part ? une enqu?te qui devra s'?tendre ? toutes
les formes d'art et ? toutes les phases de l' uvre consid?r?e.
Louis XIV vient, pour la premi?re fois, ? Versailles en 1651. Il a 13 ans.
11 y vient pour chasser, en passant. Il y trouve un petit ch?teau construit
par son p?re. C'est un pavillon de chasse tr?s modeste : brique et pierre,
foss?, cour centrale ; une seule ?paisseur de logis ; quelques pi?ces destin?es
au logement sommaire des chasseurs ; le capitaine des chasses apporte
?ventuellement la collation de Maisons ou de Saint-Germain ; les dames
ne peuvent y loger. C'est un programme adapt? aux go?ts personnels de
Louis XIII : solitude et bon plaisir. Le petit ch?teau de 1651 n'est pas
celui de la journ?e des Dupes (1630) ; il a ?t? reconstruit en 1632 et Louis XIII
par deux fois y a pri?, en vain, Mademoiselle de La Fayette (1637), puis
Mademoiselle d'Hautefort ?de vivre ? Versailles pour y ?tre ? lui?. Le
b?timent correspond alors aux futures folies du xvme si?cle plut?t qu'aux
successives constructions louis-quatorziennes.
Dix ans se passent. La seconde visite de Louis XIV, mis ? part sans doute
des passages de chasseur, se place en 1661. Mazarin mort, le roi ?mancip?
gouverne par lui-m?me. Un de ses premiers actes de souverain a ?t? la
disgr?ce de Fouquetau lendemain de la trop tapageuse f?te de Vaux (17 ao?t).
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
468 ANNALES
De 1661 au 28 septembre 1668, date de la nomination de
Surintendance des B?timents, se place la p?riode du premier V
Louis XIV. Elle est domin?e par la notion de la F?te, plus enco
l'a dit jusqu'? pr?sent.
Dans une ?tude d?velopp?e, il conviendra de faire appara?t
ment, toute une s?rie d'?l?ments complexes. De 1661 ? 1668, on n
pas la mise en uvre d'un unique programme de travaux une fois
formul? ; et la notion m?me de f?te est, ? cette ?poque, assez flot
qu'il soit utile de fournir ici quelques pr?cisions.
Il n'y a pas eu une seule f?te de Versailles comme une f?te
Une premi?re grande f?te fut donn?e en 1663 et elle marque l'in
d'?l?ments novateurs dans les plaisirs de la Cour. Par opposition
dente f?te de Cour, celle de 1662, le fameux Carrousel ? donn? a
et c?l?br? par l'estampe ? elle montre deux innovations : Moli?re
avec son th??tre et, du 15 au 22 septembre, la Cour toute enti?re,
les dames, est log?e au ch?teau. La gentilhommi?re des bois d
un palais gr?ce aux travaux ex?cut?s en deux ans avec une c?l?
quable. Simultan?ment le roi tient Conseil pour la premi?re fois ?
Dans son premier ?lan, le domaine appara?t ainsi comme li? ?
des activit?s personnelles du roi, dans la forme o? s'exerce, a
de son av?nement, le pouvoir, d'une part, et la vie de la jeunes
son temps. Association des femmes ? la vie de Cour, introduction
tacles de th??ore, ces deux traits originaux par rapport au pass? m
l'un comme l'autre le succ?s del? civilisation des ruelles, qui est pa
une civilisation parisienne. Une bande de jeunes nobles, gouver
des princes de la jeunesse dor?e du temps, s'empare du triste
la solitude et de l'ennui. Le roi est amoureux contre toutes les
dehors de la raison d'?tat.
En 1664, du 7 au 9 mai, les Plaisirs de Vile enchant?e marquent
de cette premi?re p?riode. On a souvent ?num?r? les divertisseme
pendant trois jours, ont maintenu la Cour dans un ?tat d'?mer
continuel. On notera ici que ces divertissements constituent une
somme de toutes les formes de plaisirs connus jusqu'? ce jour
Devises, Joutes, Tournois, Feu d'artifice, Festins, Com?die, Trag?d
La splendeur r?sulte, cette fois, davantage de l'accumulation qu
veaut?. Tout s'y trouve : le carrousel et le tournois qui rappellent
de la derni?re ?poque f?odale ; le cort?ge mythologique qui se rat
spectacles de la Renaissance florentine continu?e ? travers tout le
mais aussi, le spectacle au sens moderne du terme : com?die
entrem?l?e de trag?die corn?lienne. Pour mesurer l'originalit? de
qui va substituer ? la notion active du spectacle li? au sport,
ou au d?fil? de plein air, une notion du spectacle enferm? dan
et li? ? la nouvelle litt?rature, il n'est besoin que d'invoquer le t?m
mal connu de La Fontaine qui, d?crivant plus tard, en 1672, la f?te
marque, pour qui sait lire, un bl?me ? l'?gard de la com?die de
genre indigne de la haute soci?t?. Par cons?quent, certains asp
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
VERSAILLES ET L'ARCHITECTURE URBAINE 469
f?te de 1664 furent sentis par les contemporains comme des hardiesses
et il est incontestable que le jeune roi faisait preuve, dans ses divertissements
comme dans le reste, d'un esprit moderne. Toutefois, l'ensemble du pro
gramme des spectacles de 1664 ?tait assez touffu pour que le choix individuel
du monarque ne se marque pas enti?rement et ne soul?ve pas encore les
r?serves et le ralentissement qui, d?j? dans d'autres domaines, manifeste
la pression de certains milieux. D?s 1665 des ?l?ments conservateurs exercent
d?j? avec succ?s, dans des domaines capitaux, leur action1. Louis ne passera
des La Valli?re et des Montespan aux Maintenon que vingt ans plus tard,
mais, d?j?, il c?de sur quelques points qui indiquent qu'? la p?riode lib?rale de
son r?gne en succ?dera une autre o? il prendra de plus en plus conscience
de ses responsabilit?s en attendant de vieillir personnellement.
De 1661 ? 1664, ce premier Versailles, qui se d?veloppe avec une extr?me
rapidit?, est l' uvre d'une ?quipe de jeunes artistes brusquement charg?s
de la confiance du jeune roi. Louis a emprunt? ? Fouquet non seulement
son programme de demeure et de f?tes mais les inspirateurs du spectacle
insolent. Il a transport? de Vaux ? Versailles avec les orangers les artistes :
Le Vau, Le Brun, Le N?tre, les trois artisans de son premier palais d'homme
priv?. Bien que, pendant ce temps, la Cour manque de r?sidence ? Paris ?
o? les d?veloppements du Louvre ont ?t? g?n?s par les r?gences et le
troubles ? on se tromperait gravement en croyant que Louis XIV consid?re
d?j? Versailles comme sa r?sidence durable. Son caract?re de demeure
uniquement consacr?e aux plaisirs se trouve confirm? par l'ordre des travaux
durant les ann?es qui suivent la f?te de 1664. Quatre ans se passent, en effet,
entre les Plaisirs de Vile enchant?e et le Divertissement royal de Versailles
qui fut offert par le roi ? la Cour les 18 et 19 juillet 1668. Entre temps, on a
pouss? les travaux dans le sens des entreprises pr?c?dentes. Le ch?teau et
le jardin se sont agrandis. Mais le caract?re statique des desseins sur Versailles
est attest? par divers t?moignages. Il y a, d'une part, la chronologie des
travaux ?tablie par Pierre de Nolhac d'apr?s les Comptes des B?timents
et les papiers de Colbert ; il y a aussi une autre source moins exploit?e, mais
sur laquelle il faut insister. J'ai d?j? signal?, jadis, que La Fontaine, dans
sa description des merveilles du Versailles de 1668 ? dans le prologue de
Psych? ? pr?sentait des ouvrages de sculpture qui ne furent mis en place
que plus tard, vers 1672. C'est, en particulier, le cas du char d'Apollon,
beaucoup plus pr?s de Y Aurore de Ludovisi que du chef-d' uvre de Tubi.
Il est certain que le po?te a travaill? d'apr?s des textes, qui sont des devis
tr?s d?taill?s, fournis, au moment de la commande, sur le type de ceux que
nous avons conserv?s, par exemple, pour le tombeau de Richelieu par
Girardon2. Il en r?sulte que, de toute ?vidence, il a exist? pour Versailles,
1. Les ann?es o? se fixe le programme de Versailles, 1664-1669, sont celles o? se d?finit aussi
dans tous les domaines la politique du r?gne dans sa premi?re phase, sur le plan ?conomique
(colbertisme) comme sur le plan social et politique. Les premiers tarifs protecteurs sont de
1664-1667 ; les grands Jours d'Auvergne de 1665, ceux du Forez, 1666 ; le ?remue-m?nage? des
intendances, de 1665 ; la cr?ation de la Lieutenance de Police de, 1667 ; la crise du formulaire, de
1665 ; le contr?le strict de la librairie, de 1667.
2. J'ai publi? jadis ces march?s dans mon livre sur Girardon, Paris, 1929. Les faits relatifs ?
l'information de La Fontaine dans le prologue de Psych? sont rapport?s dans mon volume sur la
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
470 ANNALES
de 1664, date des Plaisirs de Vile enchant?e, ? 1672, date de la mise
d?finitive du premier d?cor sculpt? des jardins, un programme form
?tabli, programme qu'il a fallu pr?s de dix ans pour achever,
correspond ? l'id?al des ann?es 1661-1666 ? cette derni?re ?tant
passation des grandes commandes de sculpture. Le fait nouveau
recherches r?centes me permettent aujourd'hui d'ajouter, c'est qu'e
tout ce d?cor a ?t? con?u dans le dessein de conserver le souv
c?l?bre f?te qui a constitu? comme le programme de vie d'une g?n?
Le vrai titre du premier Versailles de Louis XIV, c'est le Vers
La Valli?re ? car il n'est point douteux que c'est ? elle que se r
le th?me central de la f?te. Je montrerai ailleurs, en effet, que c'est
de l'Amour vainqueur qui donne la clef de toute la symbolique,
des c?l?bres journ?es que du d?cor de Versailles, celui-ci ayant im
dans le plomb, le marbre et la charmille le spectacle des heures trop
d'enchantement. Le choix du po?me de l'Arioste ? qui offrait alors
les imaginations des syst?mes d'allusion transparents ? ne nou
aucune h?sitation possible. La mise en parall?le du livret de ces f
ceux du non moins c?l?bre Ballet comique de la reine en 1581 et avec
autres ballets de Cour du d?but du xvir9 si?cle, permet, au surplus,
cier la signification particuli?re de l'all?gorie et de montrer un glis
dans le syst?me symbolique dominant1. Le h?ros de ces f?tes n
cette d?esse imaginaire, Girc?, qui sert d'interm?diaire entre les de
la Cour, c'est }? Soleil, le roi lui-m?me, dispensateur de la Paix, de l
rit? et de l'Amour2.
La nouveaut? des f?tes, en 1664, c'est donc, ? la fois, un renouvel
sur le plan symbolique, des formes traditionnelles des plaisirs d
et, sur le plan formel, l'abandon du spectacle mobile, ?ph?m?re
participent de nombreux acteurs ; c'est en particulier, comme on l'a
place faite ? une sorte de festival Moli?re ? on joue, pendant les
les trois premiers actes de Tartuffe ? par quoi se trouve attest?
tence d'une autre source d'int?r?t que la tradition de la Cour. N
peut douter que le roi n'ait ?prouv? un go?t personnel pour M
qu'il prot?gera avec constance ? et qu'ainsi ne se manifeste, ? c
Sculpture de Versailles. Il va de soi que, lorsqu'on insiste sur les rapports ?troits q
entre les spectacles des Plaisirs, notamment les cort?ges de chars, et le d?cor sculpt?
Versailles, il ne faut pas entendre que les artistes ont ?t? amen?s ? reproduire les char
forme de 1664. Ils ont gard? les th?mes et apparemment travaill? sur des livrets
R?alisant un d?cor fixe, ils l'ont interpr?t? suivant d'autres r?gles techniques. C'est c
en parall?le d'une transposition ?ph?m?re suivant les r?gles traditionnelles des f?tes
interpr?tation durable qui doit faire l'objet de nouvelles analyses.
1. On trouve dans le recueil de Paul Lacroix, Ballets et mascarades de Cour sous
et Louis XIII de 1581 ? 1652, Gen?ve 1868, tout le mat?riel n?cessaire ? l'?tude des orig
premi?re iconographie versaillaise consid?r?e dans ses rapports avec les f?tes, Jusqu'
surtout rapproch?e des trait?s th?oriques et on lui a ainsi attribu? un caract?re d
livresque qui masque le r?le jou? par la tradition intellectuelle et technique des ?
royaux. Apr?s Louis XIV, cependant, il y aura une administration des ? Menus-Pla
jouera un r?le capital au xvine si?cle. Il faudra d?sormais insister sur ce caract?re li? a
de vie de la soci?t? des th?mes et des formes de l'art versaillais.
2. M. Louis Hautec ur, Louis XIV, roi Soleil, Paris, Pion, 1954, a bien mon
glissement survenu entre 1664 et 1680 dans la signification donn?e au symbole solair
n'a pas exploit? le t?moignage des Ballets et r?duit en g?n?ral au profit d'une inte
symboliste la part des r?alisations plastiques.
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
VERSAILLES ET L'ARCHITECTURE URBAINE 471
Faction de la jeune noblesse, celle des milieux parisiens, qui ont fourni ?
Moli?re, comme ? Le Vau et ? Le Brun, ses premi?res commandes. S?jour
de f?tes, le premier Versailles montre aussi le rapprochement de la
royaut? et de la capitale. Bien que le roi, dans l'avenir, se soit r?solu
ment ?cart? de Paris, il n'en a pas moins ?prouv? longtemps l'attraction.
Et m?me lorsqu'il aura fix? sa r?sidence d?finitive ? Versailles, apr?s 1682,
m?me lorsqu'il tiendra Paris en suspicion, il n'y aura jamais d'ateliers
artistiques en dehors de Paris ? le Louvre et les Gobelins. Ainsi, le
premier Versailles, celui des ann?es 1664-1668, marque-t-il, ? la fois,
le triomphe des formes traditionnelles de la f?te royale et la mont?e d'une
soci?t? urbaine destin?e, avec le temps, ? triompher de la royaut? ? apr?s
avoir cr?? pour elle le cadre admirable de son apog?e.
C'est par une contamination de la notion de spectacle que se manifeste
ainsi, d'abord, l'emprise urbaine sur le Versailles de Louis XIV. Mais la
p?n?tration des ateliers parisiens s'exerce, ?galement, par d'autres voies.
Non seulement le spectacle statique et imaginatif l'emporte sur les plaisirs
sportifs du pass?, mais l'architecture du domaine royal se transforme sous
l'action du milieu parisien.
Pour ?tre exact, il faut dire que cette action des milieux ?trangers ? la Cour
correspond ? une seconde phase de la cr?ation de Versailles, celle qui va de
la seconde grande f?te de 1668, le Divertissement royal, ? la troisi?me, celle
de 1674, qui ouvre une troisi?me phase de projets, aboutissant, en 1682,
? la transformation de Versailles en r?sidence officielle du souverain.
L'importance de l'ann?e 1668 dans le d?veloppement du programme
de Versailles a ?t? r?cemment mise en lumi?re par M. Fiske Kemball. ?tu
diant un plan d?couvert dans l'extraordinaire mine de documents que
constituent les archives su?doises, celui-ci a revis? l'opinion traditionnelle
concernant la responsabilit? de Colbert et du roi dans la conservation du
petit ch?teau de brique et de pierre envelopp? par les constructions modernes
de Le Vau1. M. Fiske Kemball a bien vu que Colbert, effray? par les d?ve
loppements de Versailles, a travaill?, contrairement ? l'opinion courante,
pour la conservation du plus d'?l?ments anciens possible et pour la r?duction
du programme, tandis que le roi ne cessait de pousser au d?veloppement
de son cher domaine. Il ne semble pas, toutefois, que l'?rudit am?ricain ait
tir? tout le parti souhaitable de la d?couverte du plan de Le Vau qui fixe les
?tapes successives de la transformation du palais entre le mois de juillet
1668 ? date de la grande F?te ? et le mois de juin 1669 ? date de l'adop
tion d?finitive du plan qui donne naissance au ch?teau de Le Vau construit
entre cette date et 1672.
1. Cf. Fiske Kemball, The Genesis of the Chateau Neuf at Versailles, 1668-1671, dans
Gazette des Beaux-Arts, 1953. Le plan de Le Vau qu'il interpr?te a ?t? retrouv? en Su?de (coll.
Cronstedt. Mus?e National de Stockholm) et signal? par M. A. Marie, Le Premier Ch?teau de
Versailles construit par Le Vau en 1664-1665 dans Bulletin de la Soci?t? de VHistoire de VArt
Fran?ais, 1952. La critique interne du plan et la mise en rapport avec les textes de Colbert sont
remarquables ; la vue stylistique plus limit?e.
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
472 ANNALES
Il n'est pas question de discuter ici, dans le d?tail, une chron
ni non plus d'entrer dans l'analyse des conflits personnels ou d'e
le r?le r?ciproque de tous les artisans rivaux de Versailles. Il y
de longs d?veloppements, appuy?s de nombreuses illustrations. Ce q
se propose, c'est de montrer que, si le premier Versailles de Louis X
domin? par la notion de F?te, le second est, lui, domin? par la n
S?jour et que c'est aux r?cents d?veloppements de l'habitation pa
tr?s exceptionnelle en Europe ? cette ?poque, que 'ce nouveau pro
a ?t? emprunt?. Cette notion de s?jour royal est bien distincte d'une t
notion, celle de R?sidence, qui a ?t? justement employ?e par P. d
pour indiquer le caract?re de Versailles apr?s 1682, date du transfer
le palais de la capitale du royaume. En r?alit?, apr?s cette derni?
Versailles cessera d'?tre la maison du roi consid?r? comme une p
pour devenir le lieu d'une sorte de culte politique et all?gorique
lequel s'effaceront les convenances du roi lui-m?me, r?fugi? dans se
appartements aux heures creuses de l'exercice de son v?ritable sacer
Quelle que soit la valeur du terme employ?, ce qui importe, c'est
marquer la transformation radicale qui se manifeste dans le pro
de Versailles entre les deux dates de 1668 et de 1678, correspondant
tivement au d?but de la construction des deux ch?teaux de Le V
Mansart.
La comparaison des plans r?cemment d?couverts permet de pr?ciser
la nature du choix exerc?, en 1668-1669, par le roi et par Colbert entre plu
sieurs solutions. Elle permet, surtout, d'affirmer que le programme du
second Versailles a ?t? enti?rement domin? par la d?termination du plan,
l'?l?vation n'ayant ?t? consid?r?e que comme un ?l?ment accessoire du
nouveau parti ? adopter. Point de d?part : le d?sir d'agrandir le b?timent.
Premi?re id?e, raser l'ancien ch?teau pour en ?difier un autre de plus grande
dimension. Apr?s quoi a surgi l'id?e de 1'? enveloppe ?, id?e inspir?e et
par des motifs d'?conomie et par le souci de conserver le plus de ma?onnerie
possible. Cependant, on s'aper?oit que la destruction pure et simple de
l'ancienne ma?onnerie et la reconstruction d'un ?difice en U aurait abouti
? cr?er un b?timent sans ?paisseur o? une seule enfilade de pi?ces aurait
trouv? sa place. Une telle id?e, notons-le, ne choquait aucunement. Depuis
le moyen ?ge on construisait g?n?ralement des ?difices qui ne comportaient
qu'une ?paisseur de pi?ces habitables ? qu'il s'agisse de la maison de Jacques
C ur ? Bourges ou d'un ch?teau moderne comme Ancy-le-Franc, prototype
au xvie si?cle de la nouvelle architecture. Les seuls exemples de plans group?s
sont fournis par certaines villas de Palladio ; encore faut-il observer qu'il
s'agit de programmes restreints, d'un plan central-forc?ment limit? ? cinq
pi?ces sans d?veloppement de fa?ade. Nous sommes si accoutum?s ? voir
1. On a tendance ? croire que les petits appartements ne sont apparus ? Versailles que sous
le r?gne de Louis XV. La question des petits appartements de Louis XIV est rendue difficile du
fait des innombrables remaniements des r?gnes suivants. Toutefois, il est certain que le probl?me
s'est pos? ? et a ?t? r?solu, en particulier par la cr?ation d'un appartement Maintenon, jusqu'ici
insuffisamment ?tudi?. Il faut aussi tenir compte du glissement de la notion commune du confort
priv?.
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
VERSAILLES ET L'ARCHITECTURE URBAINE 47a
les cr?ations classiques que nous avons du mal ? en comprendre la hardiesse.
En 1668 le probl?me de la cour et des acc?s, celui de la situation de l'escalier
dans un ?difice int?gr?, celui du d?doublement des appartements ?taient
loin de se pr?senter comme r?solus. La solution qui consista ? conserver
? Versailles l'ancien ch?teau de Louis XIII et ? l'envelopper d'un b?timent
en ?querre sur trois c?t?s eut le m?rite de l'?conomie et de la nouveaut?.
En inscrivant le nouveau ch?teau autour de l'ancien, on obtint un ?difice
complexe. L'id?e la plus neuve fut celle de cr?er des cours int?rieures, gr?ce
? quoi on eut un syst?me massif comportant non seulement une enfilade
de salles mais un r?seau de pi?ces communiquant par de multiples passages.
Or, aucun doute n'est possible sur l'origine de cette solution : elle ne pouvait
?tre alors sugg?r?e que par un artiste parisien comme Le Vau, constructeur
d'h?tels particuliers dans la capitale. Les travaux des historiens de l'archi
tecture ont soulign? les phases du d?veloppement de l'h?tel parisien avant
1660. On trouve d?j? des constructions qui sont de v?ritables organismes
agenc?s autour d'une ou de plusieurs cours. Comme ? Versailles, les prin
cipaux probl?mes sont ceux des axes de sym?trie, de l'implantation des
escaliers et des acc?s, de la diversit? des fa?ades adapt?es ? des proportions
diff?rentes suivant les c?t?s, du rejet des ?curies et des communs hors de la
proximit? des pi?ces r?sidentielles1. Quand on consid?re le d?veloppement
ult?rieur de Versailles, m?me apr?s 1678, on est frapp? de constater que
Mansart lui-m?me ne fera que d?velopper et, pour ainsi dire, extrapoler
le programme con?u par Le Vau en 1669 : rejet des ?curies au-del? de la
place d'Armes, rejet du Grand Commun, extension de la fa?ade sur les
jardins, assouplissement des liaisons fonctionnelles entre les deux faces du
corps central. Assur?ment, on verra appara?tre par la suite de nouveaux
?l?ments, surtout dans le domaine des liaisons entre le palais et le domaine
aux vastes horizons, qui sont rest?s ?trangers au programme de Le Vau.
Mais, en ce qui concerne la partie proprement r?sidentielle, les formules
finales sont d?j? esquiss?es, exception faite en ce qui concerne la cr?ation
tardive de la chambre du roi, v?ritable autel de la royaut? pr?sente dans
ces murs au dernier terme de l'?volution du domaine. En 1669 le roi ne vient
pas encore se faire adorer ? Versailles ; il y vient vivre en homme moderne,
soucieux de donner le ton ? son ?poque. Un peu lass? du programme des
f?tes dogmatiques et amoureuses, il y substitue un autre dessein, qui est
de donner son cadre naturel ? un mode de vie encore neuf.
Le second Versailles de Louis XIV est fait pour l'appartement. Mais
l'appartement n'est pas un palais inaccessible et redoutable d'o? partent la
justice et l'autorit?, c'est une demeure priv?e o? le prince re?oit ses sujets
1. Cf. Louis Hautec ur, Histoire de Varchitecture classique en France, t. II, Le R?gne de
Louis XIV, Paris, Picard, 1952. M. Hautec ur fait d?pendre tout le d?veloppement de l'archi
tecture classique des entreprises royales. Il n'a pas pos? la question, capitale, de la part prise
par les financiers dans le d?veloppement du Paris des ann?es 1640-1660 ; ni celle de l'extraordi
naire essor survenu dans la construction des couvents du fait de la rivalit? des ordres religieux.
L'histoire du xvn? si?cle est con?ue comme aboutissant d'une mani?re en quelque sorte n?ces
saire au r?gne de Louis XIV. Il y a l? un magnifique sujet d'?tude ? entreprendre. Il touche aussi
bien ? des probl?mes ?conomiques et sociaux qu'artistiques. Il faut renoncer ? la conception uni
fiante du classicisme et ce n'est pas chose facile.
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
474 ANNALES
et les initie aux formes nouvelles de la culture. Salle des ba
de jeux, mais aussi salle de musique. Autour du roi, ce son
et les com?diens, ce sont aussi l'entretien et la collation. Vie de
surtout de soci?t?. Avec le temps, les choses ?volueront ; le spe
versif, c?dera le pas, de plus en plus, au lansquenet, plus ?
seigneurs devenus seuls familiers d'une Cour qui se s?pare
par son ?loignement et par l'humeur durcie du souverain. Mais
et 1674, il y a eu une p?riode particuli?rement f?conde, o? Ver
cip? ? la formation de la vie sociale fran?aise du Grand Si?cle.
Cette participation ne s'est pas manifest?e uniquement dans
des programmes?quelle qu'ait pu ?tre, d'ailleurs, comme on l'a n
tance d?cisive du choix de principe qui, ? un moment donn?, e
limit? dans le temps, s'est une fois pour toute exerc? sur le plan. Le
fix?, il a fallu le r?aliser.
Il ne suffit pas de r?p?ter que c'est ? Paris que se trouvaient
de Versailles. Les relations du domaine et de la ville sont plus c
plus exactement, l'emprise de la ville sur le lieu du s?jour ro
dance absolue de Versailles se marque par le fait que le moin
venu de Paris, et aussi par le fait que la plupart des objets d
ont ?t? con?us pour un programme urbain. C'est pr?cis?men
o?, apr?s 1674, le roi commandera des ouvrages quine seront pl
utilit? pour d'autres que pour lui-m?me, que se situera l'ap
troisi?me Versailles, celui qui m?rite vraiment le titre de r?sid
En attendant, Versailles n'est pas encore le lieu du rite mo
du jeu ei?r?n?. On y voit moins d'objets que d'architecture
La visite aux Gobelins, comm?mor?e dans la suite de 1'Histoire
de 1667 ; c'est entre 1667 et 1683 que s'ex?cute cette grande s?r
series de haute lisse. Versailles n'est pas encore la vaste foir
qui ?merveillera l'Europe et consacrera le succ?s de la politiq
et artisanale de Colbert. Comme on le sait, la reconstitution des
ne se fait que progressivement. Entre 1669 et 1672, s'?coule
o? les desseins se fixent sans que se d?veloppent encore tou
quences.
On ne parvient pas du coup aux solutions. Les fa?ades du Versailles
de Le Vau ont des fen?tres carr?es et relativement basses qui ne seront
transform?es que plus tard ; les appartements ont un sol de marbre trop
luxueux et d'un entretien impossible qui sera remplac? par des parquets
de point de Hongrie. On traverse une p?riode d'adaptation o? le mod?le
ce n'est pas Versailles, c'est Paris, le Paris des financiers, des h?tels parti
culiers d'un luxe assur?ment ?norme mais priv?1. Le roi dirige alors, il ne
se flatte pas de cr?er les m urs.
1. M. Ren? Crozet, La Vie artistique en France au XVIIe si?cle (1598-1661) : les artistes et
la soci?t?, Paris, Presses Universitaires, 1954, a suivi la tradition en limitant a la notion du m?c?
nat les liaisons possibles entre l'artiste et la soci?t?. On fait ainsi d?pendre le Paris du d?but du
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
VERSAILLES ET L'ARCHITECTURE URBAINE 475
Il ne se flatte pas davantage de cr?er le style. Cette enveloppe d'archi
tecture qui se construit de 1668 ? 1672 autour du premier ch?teau, il faut
bien qu'elle en ait un. C'est le m?me qui, transform? comme on vient de
le dire, ou plut?t adapt? et am?lior?, a fourni sa forme au Versailles de
Mansart. Or, ce style n'est pas celui que Le Vau adoptait spontan?ment pour
les demeures priv?es de la capitale. Il est plus pr?s de certaines formules
italiennes ? d'o? est venue cette opinion si r?pandue que Versailles est
un des termes du palladianisme international. Pour bien situer cette fa?ade,
il faut se souvenir que, vers 1668, le dessein sur Versailles n'?tait pas le seul
qui retienne l'activit? des architectes royaux. On ?chouera ? situer d?finiti
vement Versailles si on oublie que le d?veloppement du programme de cette
demeure s'est poursuivi parall?lement avec le d?veloppement des desseins
sur le Louvre et dans les m?mes agences de travaux. La forme donn?e par
Le Vau ? sa fa?ade ne se comprend que si l'on songe que, simultan?ment,
se poursuivait le grand d?bat sur le palais de la capitale. Les ann?es 1664
1668 o? l'entreprise de Versailles marque un relatif arr?t, o? l'on se contente
d'immobiliser le d?cor fugitif des grands divertissements de la Cour, sont
celles o?, ? Paris, l'on fait appel au Bernin, o? se d?battent le plan et l'appa
rence de la demeure royale qui manque toujours ? la capitale. La m?me
Petite Commission nomm?e par le roi sur la suggestion de Colbert tranchera
finalement en ce qui concerne les plans de Versailles et ceux du Louvre.
Dans les deux cas on proc?de ? un double arbitrage entre les Fran?ais et les
Italiens, d'une part, et, parmi les Fran?ais, entre le groupe des architectes
et les Perrault ? c'est-?-dire les repr?sentants d'une forme plus intellectuelle
que technique de l'architecture1. Si l'exclusion de l'Italien est totale, on ne
peut nier, cependant, que la solution finale ne soit de compromis. A Paris,
au Louvre, ce sont les Perrault qui fourniront la solution du probl?me
de la Colonnade ; ? Versailles, les Perrault fourniront encore une contribution
importante ? la r?alisation du premier d?cor des jardins2. L'influence ita
lienne ne sera absente de l'une ni de l'autre entreprise. Versailles doit beau
coup ? la conception des jardins italiens ; la Colonnade des Perrault est
plus palladienne que la fa?ade de Versailles ; la fa?ade finale de Versailles
si?cle d'une certaine interpr?tation de Versailles, au lieu d'examiner l'emprise parisienne sur
Versailles. C'est cependant l? la clef du si?cle. Paris, qui jouera au xvine le r?le que l'on sait,
s'y pr?pare d?s 1640. Dans un sens, Versailles est une parenth?se. Il faudra ?tudier les modes
de financement aussi bien des ?difices religieux que des h?tels. Tout le probl?me social du
xvne si?cle est ? reprendre. Il modifiera nos vues sur l'art classique et r?ciproquement.
1. On trouvera dans Hautf.c ur, Histoire de Varchitecture classique..., les mat?riaux d'une
mise en relation des travaux des ? Commissions ? nomm?es par le roi ? l'instigation de Colbert
pour l'ach?vement simultan? da Louvre et de Versailles. Dans cet ouvrage M. Hautec ur a
sensiblement att?nu? ses th?ses anciennes relativement ? la paternit? de la Colonnade du Louvre.
Il a eu le m?rite, jadis, de reconna?tre le premier le caract?re coll?gial des d?cisions. Il reste
toutefois que si les responsabilit?s officielles sont partag?es, l'empreinte des participants se
marque dans les diff?rentes parties de l' uvre commune. On regrette que M. Hautec ur ait
supprim? toute r?f?rence aux travaux d'Andr? Hallays dont il s'est finalement tr?s sensiblement
rapproch?. Sa bibliographie, dans ce cas, est nettement orient?e.
2. La question de la part prise par les Perrault ? la conception du premier d?cor des jardins
a ?t? derni?rement tranch?e par la d?couverte dans les archives su?doises d'un texte in?dit que
M. Ragnar Josephson signale et analyse dans sa contribution aux Sculpteurs c?l?bres dont j'ai
dirig? la publication aux ?ditions Mazenod, 1955. Nouvelle preuve que la critique stylistique est
susceptible d'aboutir ? des solutions valables : Perrault est bien l'inspirateur, comme Pierre de
Nolhac et moi-m?me l'avions soutenu, de la Pyramide et de l'All?e d'Eau.
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
476 ANNALES
est en rapports certains avec les projets de Bernin pour le Lou
? Versailles que certains projets de monuments inspir?s des grandes
berninesques trouvent finalement leur place, sous une forme d?tou
reconnaissable1. Il serait absurde de nier les relations de Versai
l'italianisme. Toutefois, ces relations ne doivent pas non plus nous
d'une juste appr?ciation de l'originalit? des r?alisations versail
nous ne devons pas perdre de vue, au surplus, que le probl?me des
entre Versailles et l'Italie n'est pas un t?te ? t?te, mais se situe
contexte plus large o?, ? c?t? de celui de l'italianisme romain, le pr
de l'interpr?tation directe de l'antique, d'une part, celui de la d
du palladianisme en Europe, d'autre part, joue un r?le importan
d?termin?.
On ne trace ici que les cadres d'une enqu?te sur les probl?mes de Ver
sailles tels qu'ils se posent actuellement. P?riode des f?tes de Cour, p?riode
parisienne en attendant la p?riode versaillaise de l'entreprise, c'est d?j? une
distinction claire. Mais il est n?cessaire de fixer la mani?re dont se pose la
question de palladianisme de Versailles.
On part de deux s?ries d'observations. En premier lieu, l'?pisode palla
dien de Versailles s'ins?re dans un des grands courants de l'histoire de
l'architecture qui va du milieu du xvie ? la fin du xviir9 si?cle sans consti
tuer, sauf en Angleterre, la seule forme vivante de l'art. En second lieu, le
palladianisme s'oppose, finalement, dans son principe ? l'esprit de Versailles
qui est l'espr't classique et qui constitue, tout autant que le palladianisme,
une des forces vives de la civilisation artistique des temps modernes.
Des travaux r?cents ont mis en lumi?re les principes sur lesquels repose
le palladianisme, trop souvent consid?r? jusque-l? sous l'angle d'une inter
pr?tation qui ne remonte qu'? la fin du xvnr9 si?cle. M. R. Wittkower a tr?s
bien montr? que le palladianisme est un syst?me de l'architecture li? ?
une forme de la civilisation qui est essentiellement musicale : l'homme
mesure du monde suivant la croyance de l'humanisme ; une hi?rarchie de
valeurs num?riques rationnellement d?duites d'une connaissance de la g?o
m?trie mise en rapport avec le syst?me des proportions sonores qui se fonde
sur la loi harmonique des cordes vibrantes2. Jusqu'au milieu du xvne si?cle,
l'Angleterre de Pepys est attach?e ? cette culture de l'oreille qui commande
les r?alisations intellectuelles m?me dans le domaine plastique. L'architec
ture palladienne est l'interpr?tation spatiale d'un concept g?om?trique tir?
d'une conception philosophique de l'harmonie universelle.
Par ailleurs, en Angleterre, par suite de la R?forme et de la la?cisation
des terres d'?glise, le programme des grands travaux s'est vite r?duit ?
1. Cf. Ragnar Josephson, Le Projet de Le Brun pour le Louvre, dans Revue de VArt ancien
et moderne, 1928.
2. R. Wittkower, Architectural principles in the age of Humanism, Londres, Warburg,
1952. Sur le caract?re musical de la civilisation du xvie si?cle, on consultera aussi le livre de
Miss Frances Yates, French Academies of the Sixteenth Century, Londres, Warburg, 1947 et,
naturellement, les pages extraordinairement suggestives de Lucien Febvre dans son Rabelais.
Le Probl?me de Vincroyance au XVI6 si?cle, Paris, A. Michel, 1942, p. 468 et suiv. Le xvne si?cle
amorce ? peine encore la conqu?te de la vue, qui se poursuit rapidement aux xixe et xx6 si?cles
seulement.
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
VERSAILLES ET L'ARCHITECTURE URBAINE 477
l'extr?me. Le palladianisme ?lisab?thain est un style de Cour, la ? new
fashion ? de 1580 est l' uvre de quelques seigneurs bravant l'interdit g?n?
ral des contacts directs avec Rome. Ils construisent en termes palladiens
tir?s des trait?s autant que de l'imitation des uvres, un tr?s petit nombre
de ? ch?teaux imaginaires ?, suivant la jolie expression d'un des derniers
historiens de l'architecture anglaise1. Ils importent d'ailleurs eux-m?mes les
id?es et les formules qu'ex?cutent des artisans assez grossi?rement initi?s.
A la g?n?ration suivante seulement, le palladianisme d'Inigo Jones ? qui
est tr?s pr?s de certains aspects de Versailles2 ? est l' uvre d'un homme
directement li? ? l'Italie mais qui est l'agent des rois Stuarts et d'une
v?ritable r?action sans emprise profonde sur la soci?t? jusqu'au milieu du
xvme si?cle. En France non plus, la source directe de l'italianisme n'est pas
toujours Palladio. D?s la premi?re g?n?ration des architectes du xvie si?cle,
le contact r?gulier autant avec les uvres qu'avec les trait?s se fait par
l'implantation en France de quelques-uns des plus hardis th?oriciens comme
Serlio. Avec Lescot et Delorme, la France participe elle-m?me ? l'?labora
tion d'un syst?me international plus large que le palladianisme. Bernin, de
son c?t?, lui apporte un style romain plus proche des principes du Quat
trocento italien : palais carr? et application de la colonnade au cube de la
ma?onnerie. L'originalit? de Bernin, c'est d'avoir plaqu?, en effet, sur le
palais florentin du xve si?cle, un d?cor qui se d?roule comme un spectacle
toujours mouvant, qu'il s'agisse de la place Saint-Pierre, de la Scala Regia,
ou des projets pour le Louvre3.
Tout oppose, finalement, le d?veloppement de Versailles ? cet italia
nisme romain. Le palais ne sera pas un d?cor, il se lie ? un programme de
grands travaux qui, avant l'intervention du roi et de Colbert, s'est d?velopp?
? Paris du fait des financiers, dont l'action a ?t? d?cisive pendant que se
r?glaient les conflits entre la royaut? et la noblesse. Le fait saillant du d?but
du xviie si?cle parisien, c'est le lotissement des nouveaux quartiers d'o?
est n?e la conception de l'h?tel priv? dont le second Versailles n'a ?t?, comme
on vient de le dire, qu'une des ?tapes d'application. La bourgeoisie d'office
du xvie si?cle, devenue propri?taire de la terre et des rentes, consacre alors
1. John Summerson, Architecture in Britain, 1530-1830, Londres, Penguin, 1953. L'auteur
a eu le grand m?rite de rattacher l'?tude des formes au d?veloppement de la civilisation contem
poraine. Il rattache, toujours, les plans aux usages dominants dans la soci?t? et s'inspire d'une
conception vraiment fonctionnelle de l'architecture. En outre, au lieu de tracer un tableau ?
part d'une ?volution sociale fond?e sur d'autres sources que l'arch?ologie et d'y rapporter ensuite
les uvres, il unit dans une m?me analyse les faits arch?ologiques, intellectuels et sociaux. Son
essai prouve combien une reprise de l'histcirc architecturale du xvue si?cle fond?e sur les notions
de l'onction et de programme serait f?conde.
2. La comparaison entre la Salle des Banquets de Whitehall et la fa?ade sur les jardins de
Versailles n'a jamais ?t? esquiss?e. Il est clair, pourtant, que, quarante ans avant la visite de
Bernin en France, elle atteste l'existence d'un style romain international. Toute cette question
du romanisme, du palladianisme et du classicisme est enti?rement ? d?fricher.
3. En fait le style de Bernin, c'est d'abord le style romain-palladien de la fin du xvi? si?cle
pr?sent dans l'internationalisme d'Inigo Jones ; puis un ?l?ment personnel qui se lie ? la sc?no
graphie. Bernin, c'est avant tout du spectacle ; son art annonce autant Piran?se et Bibbiena que
Versailles. La Colonnade de Saint-Pierre de Rome est faite pour donner son effet au visiteur qui
marche vers la basilique. Le point de vue de Bernin est toujours mobile. Celui de Versailles est
fixe. En r?alit?, c'est vers 1665 le point de vue fixe qui est moderne (c'est-?-dire la r?gle des trois
unit?s). L'?volution de Versailles est, de toute mani?re, li?e ? une ?tude plus d?taill?e de la notion
de speclacle.
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
478 ANNALBS
sa fortune par son accession ? un nouveau mode de vie qui est essentielle
ment urbain. Les histoires de l'urbanisme ? si courtes en g?n?ral de v?ri
table ?rudition ? n'ont pas soulign? l'importance de ce mouvement qui
n'est pas uniquement parisien, mais qui int?resse ?galement des centres
comme Dijon ou comme Aix-en-Provence1. C'est le transfert des richesses
dans la concentration urbaine qui est le fait majeur de ce temps et qui
explique les formules recueillies par le second Versailles de Louis XIV,
celui que l'on peut justement appeler le Versailles parisien, le Versailles de
Colbert, malgr? la r?alit? de certaines influences secondaires comme celle
de l'Italie du Bernin.
* *
Il faut renoncer ? voir dans la cr?ation de Versaille
d'un programme progressivement d?duit d'une vision de
est le lieu des conflits qui opposent les clans et les classes
c'est le cadre de la vie du roi qui triomphe, l' uvre amo
prises de Le Vau se poursuit en dehors de Versailles, da
cesse de fournir au domaine monarchique les moyens de s
lorsqu'il existe entre les deux milieux des int?r?ts opp
consid?rer Versailles comme un reflet, mais comme une u
n'est pas la traduction plastique d'une sorte de vision abst
de la beaut? ; il est le t?moin d'abord plus large puis p
capacit?s cr?atrices de la capitale et d'une soci?t? en plein
vers les ann?es d?cisives o? se projette le premier gran
cr?ation de Versailles r?pond aux besoins et aux capacit
classes industrieuses de la nation avant de satisfaire les
d'un autocrate. Ce ne sont pas, comme en Angleterre, que
marge de la nation qui sont les initiateurs du go?t classiqu
pour laquelle, apparemment, il y a eu un grand art orig
? Londres. Le vrai inspirateur de l'art classique fran?
complexe de Paris ? o? voisinent les financiers et les a
pas la Cour, qui re?oit et utilise ensuite les mots d'ord
r?sulte la continuit? entre l'art parisien des ann?es 1640 e
de 1670. Versailles n'est pas le produit d'une sp?culati
d'une soci?t? unanime. Il exprime des aspirations et des co
des puissances. Dans ce qu'il a de cr?ateur, il n'est pas u
v?ritable apog?e se place dans la p?riode interm?diaire
? ses plaisirs pour attirer ? lui les activit?s de la ville la
de son royaume. Le Versailles de 1668 est un Versailles
Il va de soi que de patientes ?tudes seront n?cessaires po
1. Le terme d'urbanisme, pris au sens ?troit du terme, a justifi? tout
tions arbitraires et appauvrissantes. L'urbanisme, science des plans de vil
de l'?tude de l'architecture, science de l'habitat humain. Faute de quoi l'h
des schemes de plans qui n'ont jamais servi qu'? orienter l' uvre construc
? des ?l?ments arbitraires d'interpr?tation d?tach?s de toute r?alit? concr
toutes les sciences, l'urbanisme, science nouvelle, doit encore passer de l
t?tonnant ? celle de l'?rudition v?ritable o? les disciplines s'associent au l
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
VERSAILLES ET L'ARCHITECTURE URBAINE 479
la masse ?norme des travaux r?alis?s pour Versailles, les divers ?l?ments
r?v?lateurs des diff?rentes s?ries de valeurs qui se d?gagent ainsi. Programme
royal, programme d'habitation, chacune des phases plus d?licates de la vie
de la nation a laiss? quelque trace dans l' uvre, encore vivante dans son
ensemble, qui est sous nos yeux et qu'on ne peut envisager globalement.
Par certains c?t?s, Versailles pr?figure m?me certains mouvements de l'ave
nir, comme lorsqu'on y voit s'?baucher un cadre pour la vie de relation.
Versailles n'est ni un cadre formel, ni un code de signes d?duit d'une id?e
m?re. Il suit les variations d'un ordre social en d?s?quilibre. Il s'?puise le
jour o? l'emporte, dans ce cadre limit?, la volont? absolue et st?rilisatrice
du souverain. Il vit non pas de l'essor de cette volont?, mais de l'activit?
des classes qui fournissent au prince les moyens d'une politique finalement
dissoci?e des int?r?ts de la nation. On ne peut donc souscrire ? l'opinion
r?cemment exprim?e par M. John Nef suivant laquelle Versailles repr?sente,
au xviie si?cle, le produit d'une recherche id?ale du Beau absolu et d?sin
t?ress?1. Il n'est pas vrai que l'artiste travaille pour son plaisir et dans un
?tat de loisir qui le d?tache des grands int?r?ts de son ?poque. Le monde de
la qualit? est aussi un monde r?el. L'art de Versailles ne repr?sente pas,
dans un univers d?j? livr? ? la poursuite du quantitatif, une sorte de relique
ou de refuge ? l'usage des esprits distingu?s. Les cr?ateurs de Versailles
n'ont pas cherch?, seulement, le joli mais l'utile. Et, dans la mesure o? ils
se sont associ?s ? l' uvre de tous ceux ? litt?rateurs, savants ? qui ont
jet? les bases d'une forme de vie de relation originale en leur temps, ils ont
contribu? positivement au d?veloppement de cette soci?t? urbaine d'o? est
sorti le xviii0 si?cle et qui n'a pas peu contribu? au progr?s des lumi?res.
Pierre Francastel
1. J.-U. Nef, La Naissance de la civilisation industrielle et le monde contemporain, Paris,
Colin, 1954. C'est un tr?s beau livre et tr?s g?n?reux d'inspiration. Malheureusement, l'auteur,
qui n'est pas arch?ologue, est g?n? par l'adoption d'une id?ologie de l'art qui ne co?ncide pas avec
son ?rudition personnelle d'historien des faits ?conomiques. C'est la conception d'un art contem
porain oppos? au d?veloppement des valeurs spirituelles et ?ternelles de l'art qui p?se sur son
interpr?tation des faits. Il n'est pas vrai que l'art soit li? au domaine de la vie int?rieure ; il est
technique autant que sp?culation. J'ai essay? moi-m?me dans un petit livre, qui para?tra inces
samment, d'examiner ce probl?me-clef des relations de l'art et de la technique dans le monde
moderne. Le probl?me de Versailles est ? reconsid?rer autant en fonction d'une conception moderne
de l'art que d'une meilleure analyse des faits. Il n'est pas ?vident que l'art soit en conflit avec les
r?alit?s techniques et mat?rielles d'hier et d'aujourd'hui. Il ne s'agit, en tout ?tat de cause,
que d'une hypoth?se sans fondement objectif indiscutable.
This content downloaded from
222.93.149.226 on Wed, 24 Aug 2022 08:49:36 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Vous aimerez peut-être aussi
- 01-BABELON, J.P. CHASTEL, André. La Notion de Patrimoine - Compressed.pdf - PdfCompressor-1584923Document87 pages01-BABELON, J.P. CHASTEL, André. La Notion de Patrimoine - Compressed.pdf - PdfCompressor-1584923Renato Fonseca100% (1)
- Frey - Généalogie Du Mot UrbanismeDocument11 pagesFrey - Généalogie Du Mot UrbanismesamuelioPas encore d'évaluation
- Cicero Academicus. Recherches Sur Les Ac - Carlos LevyDocument703 pagesCicero Academicus. Recherches Sur Les Ac - Carlos LevyNLarbaud100% (1)
- Le Costume Historique - Tome 1Document368 pagesLe Costume Historique - Tome 1lepetitlulu100% (2)
- Christian Norberg-Schulz, Architecture Baroque Et Classique, ResenhaDocument2 pagesChristian Norberg-Schulz, Architecture Baroque Et Classique, ResenhaEdson AvlisPas encore d'évaluation
- Féodalités (888-1180) - Florian Mazel (Joël Cornette (Ed) (Cornette, Joël) )Document957 pagesFéodalités (888-1180) - Florian Mazel (Joël Cornette (Ed) (Cornette, Joël) )Kamille DevoyonPas encore d'évaluation
- FORME URBAINE DE L'ILOT A LA BARRE - Castex PaneraiDocument201 pagesFORME URBAINE DE L'ILOT A LA BARRE - Castex PaneraiChahrazed AsliPas encore d'évaluation
- Les moralistes français au dix-huitième siècle: Histoire des idées morales et politiques en France au dix-huitième siècleD'EverandLes moralistes français au dix-huitième siècle: Histoire des idées morales et politiques en France au dix-huitième sièclePas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de France Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To L'Année Sociologique (1940/1948-)Document2 pagesPresses Universitaires de France Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To L'Année Sociologique (1940/1948-)salah mechakraPas encore d'évaluation
- Baroque Et Classique, Une CivilisationDocument21 pagesBaroque Et Classique, Une CivilisationEdson AvlisPas encore d'évaluation
- Art Baroque Et Classic Is Me 2010 LouvainDocument8 pagesArt Baroque Et Classic Is Me 2010 Louvainao189Pas encore d'évaluation
- Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle TI: Tome 1D'EverandDictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle TI: Tome 1Pas encore d'évaluation
- Brown Scientific Organizations in Seventeenth Century France (1620-1680)Document326 pagesBrown Scientific Organizations in Seventeenth Century France (1620-1680)Alberto NavasPas encore d'évaluation
- Roger Dachez 2023 de Salomon À James AndersonDocument259 pagesRoger Dachez 2023 de Salomon À James AndersonxavierPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Art Et Histoire Dimension Et Mesure Des CivilisationsDocument21 pagesPierre Francastel - Art Et Histoire Dimension Et Mesure Des CivilisationsXUPas encore d'évaluation
- Renaissance: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandRenaissance: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Art contemporain: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandArt contemporain: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Art Et SociologieDocument38 pagesPierre Francastel - Art Et SociologieXUPas encore d'évaluation
- Pour Une Anthropologie de L EspaceDocument22 pagesPour Une Anthropologie de L EspacePaulo Ferreira0% (1)
- LA CULTURE Et Le PouvoirDocument10 pagesLA CULTURE Et Le PouvoirTorki lahcenePas encore d'évaluation
- Variations 480Document14 pagesVariations 480Daniel Rincon CairesPas encore d'évaluation
- La cathédrale de Strasbourg pendant la Révolution. (1789-1802)D'EverandLa cathédrale de Strasbourg pendant la Révolution. (1789-1802)Pas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Un Demi-Siècle de Peinture 1900-1950Document18 pagesPierre Francastel - Un Demi-Siècle de Peinture 1900-1950XUPas encore d'évaluation
- Perelman - Idéologie Ou Philosophie Des LumièresDocument223 pagesPerelman - Idéologie Ou Philosophie Des LumièresAndré MagnelliPas encore d'évaluation
- Garo, Isabelle - L'idéologie Ou La Pensée Embarquée-La Fabrique (2009)Document178 pagesGaro, Isabelle - L'idéologie Ou La Pensée Embarquée-La Fabrique (2009)Maxi OliveraPas encore d'évaluation
- Paris Capitale ÉconomiqueDocument9 pagesParis Capitale ÉconomiquechaklyPas encore d'évaluation
- L'Utopie Rose-Croix Du XVIIe Siècle À Nos JoursDocument434 pagesL'Utopie Rose-Croix Du XVIIe Siècle À Nos JoursAlois Haas100% (1)
- Van Eyck Strauven Nuevo RealismoDocument23 pagesVan Eyck Strauven Nuevo Realismojavier pabloPas encore d'évaluation
- Art Et Histoire, Dimension Et Mesure Des CivilisationsDocument21 pagesArt Et Histoire, Dimension Et Mesure Des CivilisationsJacques LouisPas encore d'évaluation
- Extramuros Une Histoire de Paris Et de Ses Banlieues À L'époque ContemporaineDocument36 pagesExtramuros Une Histoire de Paris Et de Ses Banlieues À L'époque ContemporaineHGlopezs0% (1)
- Du style gothique au dix-neuvième siècleD'EverandDu style gothique au dix-neuvième siècleÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- LE LATIN AU XVIIe SIÈCLEDocument13 pagesLE LATIN AU XVIIe SIÈCLEBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Raisonne de l'Architecture Francaise, Tome 1D'EverandDictionnaire Raisonne de l'Architecture Francaise, Tome 1Pas encore d'évaluation
- Histoire de La France Contemporaine - Histoire de La France Contemporaine - College de FranceDocument29 pagesHistoire de La France Contemporaine - Histoire de La France Contemporaine - College de FranceDimitri VeyssierePas encore d'évaluation
- Dosse, L'importance de L'oeuvre de Ricoeur Pour La Pratique HistorienneDocument20 pagesDosse, L'importance de L'oeuvre de Ricoeur Pour La Pratique HistorienneladalaikaPas encore d'évaluation
- Praxematique 4455Document14 pagesPraxematique 4455Daniel Rincon CairesPas encore d'évaluation
- Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle (1/9)D'EverandDictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle (1/9)Pas encore d'évaluation
- Espace en architecture et en esthétique: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandEspace en architecture et en esthétique: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les Musées Dart Moderne Ou Contemporain Une Exploration Conceptuelle Et Historique (Pedro Lorente) (Z-Library)Document377 pagesLes Musées Dart Moderne Ou Contemporain Une Exploration Conceptuelle Et Historique (Pedro Lorente) (Z-Library)Radu Toma0% (1)
- Lecture Cursive Litterature D Idees Corpus 1 Et 2Document9 pagesLecture Cursive Litterature D Idees Corpus 1 Et 2marwabelhassan162Pas encore d'évaluation
- Expérience du temps et historiographie au XXe siècle: Michel de Certeau, François Furet et Fernand DumontD'EverandExpérience du temps et historiographie au XXe siècle: Michel de Certeau, François Furet et Fernand DumontPas encore d'évaluation
- Paul Zanker - Nouvelles Orientations de La Recherche Revue ArchéologiqueDocument14 pagesPaul Zanker - Nouvelles Orientations de La Recherche Revue ArchéologiqueHeitor MachadoPas encore d'évaluation
- Culture Et Civilisation de La Langue Au 17 e Siècle LMD 1Document13 pagesCulture Et Civilisation de La Langue Au 17 e Siècle LMD 1اللهم غفرانكPas encore d'évaluation
- (1890) Le Costume en FranceDocument282 pages(1890) Le Costume en FranceHerbert Hillary Booker 2nd100% (2)
- L'art et les artistes modernes en France et en AngleterreD'EverandL'art et les artistes modernes en France et en AngleterrePas encore d'évaluation
- Le printemps de la Renaissance. La sculpture et les arts à Florence, 1400-1460 (Paris - 2013): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandLe printemps de la Renaissance. La sculpture et les arts à Florence, 1400-1460 (Paris - 2013): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Brune Oppetit, Portalis Philosophe PDFDocument8 pagesBrune Oppetit, Portalis Philosophe PDFJofre SinghPas encore d'évaluation
- Varsovie Budapest 1956Document54 pagesVarsovie Budapest 1956jean dosPas encore d'évaluation
- 1896 - Rusicade - Stora VarsDocument249 pages1896 - Rusicade - Stora VarsMarc MorellPas encore d'évaluation
- 200 CitationsDocument207 pages200 CitationsSamuel FoxPas encore d'évaluation
- La Ville Romaine Selon VitruveDocument21 pagesLa Ville Romaine Selon VitruveLassâad Ben FrajPas encore d'évaluation
- Roussel Tribu Et Cite PDFDocument323 pagesRoussel Tribu Et Cite PDFalverlinPas encore d'évaluation
- TAPIE - Le Baroque - Tapie Victor-LucienDocument99 pagesTAPIE - Le Baroque - Tapie Victor-LucienSamuel S. de OliveiraPas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de France: Info/about/policies/terms - JSPDocument47 pagesPresses Universitaires de France: Info/about/policies/terms - JSPIsmailPas encore d'évaluation
- Les Musées Dart Moderne Ou Contemporain Une Exploration Conceptuelle Et Historique (Pedro Lorente) (Z-Library)Document377 pagesLes Musées Dart Moderne Ou Contemporain Une Exploration Conceptuelle Et Historique (Pedro Lorente) (Z-Library)Radu TomaPas encore d'évaluation
- La Liberte Guidant Le Peuple de Delacroi PDFDocument4 pagesLa Liberte Guidant Le Peuple de Delacroi PDFArannoHossainPas encore d'évaluation
- Discours Actuels Sur L'histoire de L'art Du Xxe SiècleDocument15 pagesDiscours Actuels Sur L'histoire de L'art Du Xxe SiècleGuillaumePas encore d'évaluation
- Un palais chaldéen, d'après les découvertes de M. de SarzecD'EverandUn palais chaldéen, d'après les découvertes de M. de SarzecPas encore d'évaluation
- Olivier - Le Sobre Abime Au Temps Memoire Et ArcheologieDocument8 pagesOlivier - Le Sobre Abime Au Temps Memoire Et ArcheologieAntonioPas encore d'évaluation
- Jean-Pierre Richard - L'Univers Imaginaire de Mallarme - NodrmDocument666 pagesJean-Pierre Richard - L'Univers Imaginaire de Mallarme - NodrmXUPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Technique Et EsthétiqueDocument21 pagesPierre Francastel - Technique Et EsthétiqueXUPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - UN MYSTÈRE PARISIEN ILLUSTRÉ PAR UCCELLO LE MIRACLE DE L'HOSTIE D'URBINODocument13 pagesPierre Francastel - UN MYSTÈRE PARISIEN ILLUSTRÉ PAR UCCELLO LE MIRACLE DE L'HOSTIE D'URBINOXUPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Un Demi-Siècle de Peinture 1900-1950Document18 pagesPierre Francastel - Un Demi-Siècle de Peinture 1900-1950XUPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Art Et SociologieDocument38 pagesPierre Francastel - Art Et SociologieXUPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Art, Forme, StructureDocument27 pagesPierre Francastel - Art, Forme, StructureXUPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Art Et Histoire Dimension Et Mesure Des CivilisationsDocument21 pagesPierre Francastel - Art Et Histoire Dimension Et Mesure Des CivilisationsXUPas encore d'évaluation
- Hubert Damisch - Preface of Rosalind Krauss'Document9 pagesHubert Damisch - Preface of Rosalind Krauss'XUPas encore d'évaluation
- Joel Snyder - Visualisation Et Visibilité Marey Et La Méthode GraphiqueDocument16 pagesJoel Snyder - Visualisation Et Visibilité Marey Et La Méthode GraphiqueXUPas encore d'évaluation
- Louvre Images Du Louvre Histoire Du Louvre Dossier DocumentaireDocument9 pagesLouvre Images Du Louvre Histoire Du Louvre Dossier DocumentaireDevyani JaiswalPas encore d'évaluation
- PARISDocument2 pagesPARISclaudiu zbrancaPas encore d'évaluation
- Les Colonnades Du Louvre Narjiss OuinaksiDocument2 pagesLes Colonnades Du Louvre Narjiss OuinaksiAli BounherPas encore d'évaluation
- Livret Pedagogique AdultesDocument12 pagesLivret Pedagogique AdultesNajat chifaPas encore d'évaluation
- Hôtel de Longueville (Louvre)Document2 pagesHôtel de Longueville (Louvre)luciennePas encore d'évaluation
- Palais Des TuileriesDocument15 pagesPalais Des Tuileriesfrancois.richert34100% (1)
- Material Institutmanuelblancafort Cultural Frances 1213Document14 pagesMaterial Institutmanuelblancafort Cultural Frances 1213Nawar IbrahimPas encore d'évaluation
- Palais Du LouvreDocument27 pagesPalais Du Louvrefrancois.richert34Pas encore d'évaluation
- Cours 5 RenaissanceDocument5 pagesCours 5 RenaissanceMargaux DumontPas encore d'évaluation
- Les Monuments de FranceDocument2 pagesLes Monuments de FranceAdil Rashid50% (2)
- Synchronie 1 Study MaterialsDocument40 pagesSynchronie 1 Study MaterialsFrench frenzy100% (5)
- Chapitre 3 - La Renaissance FrancaiseDocument143 pagesChapitre 3 - La Renaissance FrancaiseKenzaPas encore d'évaluation
- 433 - CPS Paris S'eveille, Des Origigines A NapoleonDocument2 pages433 - CPS Paris S'eveille, Des Origigines A NapoleonkarinePas encore d'évaluation
- Documenter Les Collections Des MuséesDocument225 pagesDocumenter Les Collections Des MuséesDFPas encore d'évaluation
- Expozitii Din LuvruDocument5 pagesExpozitii Din LuvruBill RodriguezPas encore d'évaluation
- Pierre Francastel - Versailles Et L'architecture Urbaine Au XVIIe SiècleDocument16 pagesPierre Francastel - Versailles Et L'architecture Urbaine Au XVIIe SiècleXUPas encore d'évaluation
- Le Palais Des Tuileries Domaine (... ) Bpt6k6522727nDocument230 pagesLe Palais Des Tuileries Domaine (... ) Bpt6k6522727nAzul AzulzinhoPas encore d'évaluation
- L'Hôtel Des Monnaies: Les Batiments, Le Musée, Les Ateliers / Par Fernand MazerolleDocument182 pagesL'Hôtel Des Monnaies: Les Batiments, Le Musée, Les Ateliers / Par Fernand MazerolleDigital Library Numis (DLN)100% (2)
- L'Architecture NéoclassiqueDocument56 pagesL'Architecture NéoclassiqueChaimaa KabouriPas encore d'évaluation
- Louvre Rapport D Activite 2017 Musee Du Louvre PDFDocument219 pagesLouvre Rapport D Activite 2017 Musee Du Louvre PDFGabriela MihalcioiuPas encore d'évaluation
- Louvre Magazine Chiffres Royaux Emblemes PDFDocument12 pagesLouvre Magazine Chiffres Royaux Emblemes PDFJose CaetanoPas encore d'évaluation
- Atestat de Competenta Lingvistica La Limba FrancezaDocument9 pagesAtestat de Competenta Lingvistica La Limba Francezaeduard mariusPas encore d'évaluation
- Le Palais Du LouvreDocument15 pagesLe Palais Du LouvreAimad BouPas encore d'évaluation
- Bulletin de Liaison N°76 Mai 2019Document57 pagesBulletin de Liaison N°76 Mai 2019jean-louisPas encore d'évaluation
- Musee Du LouvruDocument3 pagesMusee Du LouvruOana Alexandra100% (1)
- C 13Document61 pagesC 13thot777Pas encore d'évaluation
- Le Louvre À Jouer - Jouer Pour S'approprier Le MuséeDocument10 pagesLe Louvre À Jouer - Jouer Pour S'approprier Le MuséelyndakermadPas encore d'évaluation
- AnisiaDocument5 pagesAnisiaAna Maria Laura StanPas encore d'évaluation
- LOUVRE PlanG-FR PDFDocument2 pagesLOUVRE PlanG-FR PDFDiana PricopPas encore d'évaluation