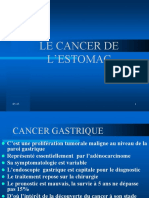Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
02 Peritonites Aigues
02 Peritonites Aigues
Transféré par
danger inflammableTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
02 Peritonites Aigues
02 Peritonites Aigues
Transféré par
danger inflammableDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
PERITONITES AIGUES
I- DEFINITION – Intérêt :
C’est l’inflammation aigue, diffuse ou localisée, de la séreuse péritonéale, secondaire à une
agression chimique ou septique. Elles sont primitives ou secondaires. C’est une urgence
médicochirurgicale extrêmement grave, mettant rapidement en jeu le pronostic vital en l’absence
d’une prise en charge précoce et adaptée.
Fréquence : c’est une urgence très fréquente.
Gravite : très grave surtout lorsqu’elle survient sur des terrains fragilisés. C’est donc une
urgence diagnostique et thérapeutique.
Causes : diverses mais dominées par les appendicites et les perforations d’ulcères.
Diagnostic : essentiellement clinique mais a largement bénéficie de l’apport des nouvelles
techniques d’imagerie.
Thérapeutique : c’est une urgence médico-chirurgicale. Là aussi, un énorme progrès a été fait
grâce à la radiologie interventionnelle et à la chirurgie laparoscopique.
Pronostic : dépend de sa cause et de la précocité du traitement.
II- CLASSIFICATION :
Parmi les différentes classifications des péritonites, celle dite de Hambourg qui sépare les péritonites
en trois classes selon l’origine de l’infection est la plus utilisée. Les péritonites secondaires
représentent 90 % des péritonites aiguës.
LES PERITONITES PRIMITIVES :
Ce sont toutes les infections de la cavité péritonéale qui se font en l’absence de foyers
infectieux intra abdominal ou de solution de continuité du tube digestif. Elles sont rares 1a
2% seulement. La contamination se fait par voie hématogène ou lymphatique. En générale
elles sont mono macrobienne. Leur traitement est médical.
Les causes les plus fréquentes sont l’infection d’ascite à E. coli chez le cirrhotique,
l’infection à staphylocoque par l’intermédiaire du cathéter chez les patients avec
dialyse péritonéale et la péritonite spontanée à pneumocoque de l’adulte.
LES PERITONITES SECONDAIRES :
Ce sont les plus couramment rencontrées. On distingue deux types :
péritonites par perforation d’un viscère creux (estomac,
duodénum, grêle et côlon).
péritonites par dissémination, le point de départ est un
foyer infectieux local (appendicite, salpingite, sigmoïdite,
cholécystite...).
LES PERITONITES TERTIAIRE :
Les péritonites tertiaires correspondent à des infections abdominales persistantes
malgré un traitement bien conduit (antibiothérapie adaptée et éradication du foyer
primitif abdominal par une ou plusieurs interventions). La cavité abdominale est
surinfectée par des micro-organismes peu virulents mais devenus résistants ou des
levures. Ces péritonites sont fréquemment associées à un syndrome de défaillance
multiviscérale.
III- PHYSIOPATHOLOGIE :
Péritonite localisée :
La réaction initiale à la dissémination microbienne provoque en quelques heures une dilatation
capillaire et une augmentation de la perméabilité péritonéale. Un épanchement liquidien septique se
Péritonites aigues conférence d’internat H-BOUCENNA CCA 2019
2
forme dans la zone inflammatoire. La richesse en fibrine de cet épanchement et les replis péritonéaux
physiologiques favorisent la localisation du processus. Les mécanismes cellulaires anti-infectieux se
déclenchent (accumulation intra péritonéale de granulocytes et de mastocytes), provoquent une
phagocytose bactérienne. Si le nombre de bactéries est faible (< 10 micro microorganismes/ml),
le processus demeure localisé et peut évoluer vers la guérison, la constitution d’un plastron ou le
développement d’un abcès. Sinon, le processus se généralise à l’ensemble de la cavité péritonéale
conduisant à la péritonite généralisée.
Péritonite généralisée :
Une concentration élevée de micro-organismes, un système immunitaire déficient ou une
contamination par des germes particulièrement virulents peut conduire à une diffusion du processus
infectieux à l’ensemble de la cavité péritonéale. Le péritoine est inflammatoire, épaissi et fragilisé.
Cette modification explique que la réalisation d’une suture digestive dans la péritonite aboutit
inéluctablement à un lâchage de celle-ci, sauf en cas de suture d’ulcère perforé. Elle explique
également la séquestration liquidienne intra péritonéale par défaut de réabsorption et l’augmentation
de la production de sécrétions inflammatoires, conduisant à la déshydratation et à l’insuffisance rénale
fonctionnelle. L’augmentation de la perméabilité péritonéale, notamment aux endotoxines
bactériennes explique les conséquences systémiques : choc septique, syndrome de détresse
respiratoire, nécrose tubulaire aiguë, coagulation intravasculaire disséminée, emboles septiques à
distance ou thrombose portale septique (pyléphlébite).
IV- DIAGNOSTIC POSITIF :
Le diagnostic de péritonite est clinique et en général assez facile. Des examens paracliniques sont
utiles pour préciser l’origine de la péritonite ou planifier la prise en charge mais ils ne doivent en
aucun cas retarder le traitement.
A- SIGNES CLINIQUES :
Syndrome péritonéal :
Quel que soit leur origine, les péritonites aigues généralisées ont en commun un certain nombre de
signes tels que les douleurs et les troubles du transit. Leur diagnostic est facile il est basé sur
l’examen clinique. Le signe capital reste certainement la contracture abdominale.
1- Signes fonctionnels :
Douleur : C’est le signe prédominant .Elle est constante, brutale, intense et maximale
d’emblée. Parfois elle évolue par paroxysmes. Elle est aggravée par la respiration et le
moindre mouvement. Son siège initial et son maximum d’intensité ont une valeur
localisatrice mais non spécifique. Elle diffuse rapidement pour se généralisée.
Nausées et vomissements : alimentaires ou bilieux. Inconstants.
Troubles du transit : à type d’arrêt des matières et des gaz, conséquence de l’iléus réactionnel.
Parfois précèdes par une diarrhée du fait de l’irritation péritonéale.
2- Signes généraux :
La température est variable et dépend de la virulence des germes.
Le faciès est pale couvert de sueurs et marque par la douleur.
La tachycardie est presque constamment présente.
Parois choc septique se traduisant par un faciès plombe, nez pince, chute tensionnelle,
frissons, marbrures
Péritonites aigues conférence d’internat H-BOUCENNA CCA 2019
3
3- Signes physiques :
Contracture abdominale : c’est le signe capital. Elle se traduit par une rigidité musculaire
permanente invincible et douloureuse. Bien que localisée au début elle se généralise
rapidement a toute la paroi abdominale. C’est le ventre de bois.
Défense abdominale : Elle peut remplacer la contracture et a la même signification.
Parfois elle est généralisée avec contracture limitée a une zone plus douloureuse.
La respiration est superficielle et très douloureuse.
TR : douloureux traduisant une inflammation du cul de sac de Douglas.
B- EXAMENS COMPLEMENTAIRES :
Radiographie d’abdomen sans préparation bien centrée sur les deux coupoles
diaphragmatiques : Elle peut montrer des signes de perforation sous forme de
pneumopéritoine localisé sous les coupoles (croissant gazeux sous phrénique). Elle
peut montrer des niveaux hydro-aériques témoin de l’iléus, ainsi qu’une grisaille
diffuse avec impression d’épaississement entre les niveaux qui témoigne de
l’épanchement intra péritonéal.
L’échographie : réaliser chez un patient instable. Elle permet le diagnostic d’un
épanchement péritonéal ou d’un abcès. L’examen est surtout rendu difficile par
l’iléus réflexe ou par l’obésité.
La TDM : utile lorsque l’interrogatoire ou l’examen clinique sont difficile
notamment en post opératoire. Il met en évidence et localise les abcès profonds et
est très utile pour le drainage non opératoire de certaines collections.
La biologie : guide la réanimation préopératoire et a un intérêt pronostique et
évolutif. La NFS met en évidence une hyperleucocytose souvent supérieure à
15000elts/mm3. La CRP est généralement augmentée.
V- FORMES CLINIQUES :
Le ventre des péritonites aigues n’appelle pas toujours au secours. Henri Mondor
A- FORMES ETIOLOGIQUES :
Péritonites secondaires :
+++++ (bulbaire ant +++)
1- Péritonites par perforation gastrique ou duodénale : d’origine ulcéreuse ou tumorale.
L’étiologie ulcéreuse est la plus fréquente et survient chez un homme âgé entre 20 et 60 ans.
C’est l’interrogatoire qui permet d’orienter le diagnostic vers l’origine ulcéreuse, ailleurs la
perforation est inaugurale. L’ASP peut montrer un pneumopéritoine. En l’absence de
pneumopéritoine alors qu’il existe une forte suspicion de la perforation, on peut pratiquer une
insufflation de l’air par une sonde gastrique et refaire la radiographie ou réaliser une TDM
abdominale qui est plus sensible pour mettre en évidence un pneumopéritoine minime.
2- Péritonite appendiculaire :
Péritonites aigues conférence d’internat H-BOUCENNA CCA 2019
4
La Péritonite peut survenir d’emblée (perforation d’une appendicite en péritoine libre) ou en
deux temps (diffusion progressive d’un pyo-appendice ou perforation secondaire d’un abcès
appendiculaire).
Clinique :
Le début est brutal dans la fosse iliaque droite ;
Les signes infectieux sont sévères (fièvre élevée, hyperleucocytose) ;
Prédominance des signes physiques (défense ou contracture) dans la FID
Les touchers pelviens retrouvent une douleur au niveau du cul-de-sac de Douglas.
Signes paracliniques
Radiographie D’ASP montre très souvent un iléus réflexe et /ou un stercolithe;
Echographie : épanchement avec signes d’appendicite;
TDM : confirme le diagnostic.
3- Péritonites biliaires :
Il s’agit d’une complication de la lithiase biliaire. Neuf fois sur dix la perforation siège sur la
vésicule. Elles sont souvent secondaires à une cholécystite aigue. Les mécanismes de la
perforation sont nombreux : ulcération pariétale par le calcul, ischémie pariétale vasculaire ou
infectieuse. Dans d’autres cas la diffusion se fait à partir d’un pyocholécyste.
Sur le plan clinique il s’agit le plus souvent d’une femme qui présente brutalement une
douleur de l’hypochondre droit avec irradiations vers l’épaule droite et la fosse iliaque droite.
Le début de symptomatologie au niveau de L’HCD et la notion d’antécédents de LV sont des
arguments en faveur de l’origine biliaire.
Les examens complémentaires tels que L’ASP mais surtout l’échographie abdominale
peuvent objectiver des images de calculs, un épanchement et des anomalies en faveur d’une
cholécystite.
Parfois il s’agit d’une péritonite biliaire compliquant une contusion hépatique.
4- Péritonites par perforation colique :
Les péritonites d'origine colique sont celles dont le pronostic est le plus grave en raison de la
septicité et du caractère fécaloïde de la contamination péritonéale. Cette péritonite stercorale
est responsable de signes infectieux généraux majeurs et précoces. Le pneumopéritoine est
abondant et souvent bilatéral. La TDM confirme le diagnostic.
Elle peut être secondaire à de nombreuses étiologies :
Péritonite compliquant une maladie diverticulaire sigmoïdienne : Par rupture d'un
diverticule (diverticulite) ou par diffusion d'un abcès péri sigmoïdien.
Péritonite sur cancer colorectal : Par perforation tumorale, d'un abcès péri néoplasique
ou le plus souvent, par perforation diastatique en amont d'un cancer occlusif et
siégeant le plus souvent au niveau du cæcum.
Perforation colique au cours d'un syndrome d'Ogilvie, d’un colon toxique compliquant
une RCH ou iatrogène lors d’une colonoscopie, une polypectomie ou une biopsie trop
large.
5- Péritonites par perforation du grêle :
Elles peuvent compliquer une fièvre typhoïde, une entérite segmentaire, un diverticule de
Meckel ou un traumatisme abdominal.
Parfois elles sont le terme évolutif d'une occlusion négligée par volvulus intestinal ou d’un
étranglement herniaire.
Péritonites aigues conférence d’internat H-BOUCENNA CCA 2019
5
6- Péritonites génitales :
elles sont secondaires soit à une salpingite soit à la rupture d’un pyosalpinx.
Elles sont souvent localisées au pelvis du fait de sa déclivité qui permet un cloisonnement
rapide. La diffusion à toute la cavité péritonéale est rare.
Il s’agit d’une jeune femme qui présente de douleurs basses hypogastriques diffusantes vers le
haut. La fièvre est élevée à 39-40 accompagnée de vomissements fréquents et d’un arrêt des
matières et des gaz. L’état général est conservé. La palpation révèle une douleur et une
contracture sus pubienne alors que le reste de l’abdomen reste moins douloureux. Au
spéculum le vagin et le col utérin sont très inflammatoires et à travers ce dernier s’écoule des
pertes purulentes. Les touchers pelviens retrouvent un utérus très fixé et très douloureux lors
des tentatives de mobilisation. Les culs-de-sac sont empâtés.
7- Péritonites urinaires :
elles sont secondaires à une rupture traumatique de la voie excrétrice haute ou de la vessie.
Exceptionnellement il s’agit de la rupture d’une pyonephrose.
Le tableau de péritonite est franc avec douleurs diffuses, fièvre, altération de l’état général et
contracture généralisée.
Il n’y pas de pneumopéritoine a l’ASP qui peut visualiser une lithiase radio opaque.
Le diagnostic étiologique est très difficile en préopératoire. Quelques fois c’est les antécédents
de lithiase rénale et l’échographie abdomino- pelvienne qui orientent le diagnostic.
Péritonites primitives :
Il s’agit de péritonites à pneumocoque ou à streptocoque, de péritonites tuberculeuses ou
d’infections d’ascites chez les cirrhotiques.
Elles revêtent le même tableau clinique que les péritonites secondaires. Faire la part des
choses est difficile, seul l’interrogatoire permet de retrouver un contexte particulier. La
ponction simple permet d’affirmer le diagnostic en révélant une flore polymorphe. Mais au
moindre doute la laparotomie s’impose.
Péritonites postopératoires :
Les péritonites postopératoires sont essentiellement dues à une désunion anastomotique.
Leur diagnostic est difficile car les signes abdominaux typiques de la péritonite sont absents
ou d'interprétation malaisée chez un opéré récent de l’abdomen.
Les symptômes sont dominés par les signes généraux qui sont au premier plan : AEG et choc
septique avec fièvre, frissons, sueurs, marbrures, hypotension artérielle, tachycardie et chute
de la pression veineuse centrale.
Signes pulmonaires avec polypnée, hypoxie voir œdème aigu du poumon.
Signes neurologiques avec troubles de conscience : agitation voir coma.
Signes hépatiques avec ictère chute des facteurs de la coagulation.
Insuffisance rénale avec oligoanurie et élévation des taux d’urée et de la créatinine.
hémorragies digestives par les ulcères de stress.
A l’examen de l’abdomen, les signes physiques sont dominés par l’iléus reflexe qui se traduit
par une hyper sécrétion gastrique (sonde gastrique qui ramène du liquide de stase) et un
ballonnement abdominal. La douleur abdominale et la contracture sont difficilement
interprétables du fait de l’incision chirurgicale. Des écoulements anormaux peuvent apparaître
(pus, bile, liquide digestif) par les drains ou à travers les plaies chirurgicales.
Parfois c’est la perturbation des examens biologiques qui alerte le médecin.
Les examens morphologiques (échographie et scanner) peuvent objectiver la présence d’un
épanchement péritonéale.
Péritonites aigues conférence d’internat H-BOUCENNA CCA 2019
6
Devant le doute vaut mieux réopérer le patient.
En réalité le diagnostic de péritonite postopératoire est très difficile. LE GALL a défini 6
facteurs ayant une valeur prédictive :
La négativité des hémocultures,
L’hyperleucocytose,
la douleur provoquée,
l’iléus,
les troubles psychiques,
la nature septique de la première intervention.
L’association hémocultures négative et douleur provoquée est la plus significative.
B- FORMES SYMPTOMATIQUES :
1- Péritonites toxiques :
Les péritonites toxiques sont marquées par la gravité des signes généraux et de défaillance
poly viscérale alors que les signes abdominaux sont modérés.
2- Péritonites asthéniques :
Elles sont l’apanage de sujets âgés, dénutris, sous corticothérapie, immunodépresseurs ou
antibiothérapie intempestive.
Elles se manifestent par un tableau clinique d'occlusion fébrile ou un tableau d’altération de
l’état général avec fièvre mais sans contracture abdominale.
NB : Des formes asthéniques occlusives, pseudo-tumorales surviennent volontiers chez les sujets âgés.
C- FORMES TOPOGRAPHIQUES :
1- Péritonites généralisées :
Elles correspondent aux formes les plus fréquentes. La cavité péritonéale contaminée dans son
ensemble.
2- Péritonites localisées :
Elles correspondent aux collections abcédés localisés, soit a l’étage sous mésocolique (cul de
sac de Douglas le plus souvent) ou à l’étage sus mésocolique (abcès sous-phrénique, sous
hépatiques ou de l’arrière cavité des épiploons).
Cliniquement, elles se caractérisent par un syndrome infectieux sévère et des signes physiques
étroitement liés au siège de la collection. Le diagnostic repose sur l’imagerie (Echographie
abdomino-pelvienne et surtout tomodensitométrie).
Le traitement peut être non opératoire faisant appel aux techniques de radiologie
interventionnelle.
VII- DINOSTIC DIFFERENTIEL :
Il se pose essentiellement avec les autres causes d’abdomen aigu qui ne nécessitent pas de
laparotomie en urgence.
Devant une douleur abdominale importante :
o Infarctus du myocarde.
o Pancréatite aigüe.
o Pneumopathie basale.
o Rétention aigue des urines.
Péritonites aigues conférence d’internat H-BOUCENNA CCA 2019
7
Devant une douleur abdominale avec contracture :
o Traumatisme du rachis.
o Contusion de la paroi antérieure de l’abdomen.
o Crise hyperalgique d’ulcère.
o Névrose hystérique.
IX- TRAITEMENT :
Le traitement de la péritonite aigue nécessite une collaboration médico-chirurgicale.
A- BUTS DU TRAITEMENT :
o Corriger les conséquences physiopathologiques de la péritonite.
o Assurer la disparition de la contamination bactérienne ou chimique.
o Traiter la cause de la péritonite afin d’éviter les récidives.
B- TRAITEMENT MEDICAL :
Le traitement médical vise à combattre l'infection et le retentissement général de la péritonite.
Il est instauré dès que le diagnostic est posé et maintenu durant et après l’intervention
chirurgicale.
Il associe :
La mise en condition du patient avec oxygénothérapie, pose de sonde
gastrique, de sonde urinaire et prise de voies veineuses pour remplissage
vasculaire et traitement des troubles hydro électrolytiques et nutritionnels;
Une antibiothérapie intraveineuse à large spectre probabiliste,
secondairement adaptée aux résultats bactériologiques des prélèvements
péritonéaux ou sanguins ;
Un contrôle des grandes fonctions vitales en cas de défaillance.
C- TRAITEMENT CHIRURGICAL :
Ce traitement dont l’indication est urgente a pour objectifs d’assurer la propreté de la cavité
péritonéale et l’éradication de la source de la contamination. Il comporte:
Une voie d'abord adaptée : large laparotomie médiane ou un abord
cœlioscopique,
Une exploration complète de la cavité péritonéale,
Une Toilette péritonéale abondante au sérum physiologique tiède après avoir
effectué des prélèvements bactériologiques intra péritonéaux,
Le traitement de la cause de la péritonite,
Un large drainage de la cavité péritonéale.
Traitement de la cause :
Perforation d’UGD :
La suture simple ave epiplooplastie est de plus en plus préconisée.
Plus rarement traitement de la perforation et de la maladie ulcéreuse, par
une vagotomie tronculaire bilatérale avec pyloroplastie ou une vagotomie
type Taylor chirurgical (séromytomie antérieure + vagotomie postérieure).
Quand il s’agit d’un ulcère gastrique le mieux est de réaliser une excision de
celui-ci pour analyse anatomopathologique éventuellement en extemporané,
ainsi qu’une surveillance endoscopique est systématique (un cancer n’est
jamais exclu).
Péritonites appendiculaires :
C’est l’appendicectomie par voie médiane ou par laparoscopie qui permet une toilette
Péritonites aigues conférence d’internat H-BOUCENNA CCA 2019
8
complète de la cavité péritonéale et un drainage adéquat.
Perforations coliques :
Extériorisation de la perforation et résection-rétablissement secondaire.
Parfois suture immédiate et colostomie d’amont.
Soit opération de Hartmann.
Exceptionnellement quand l’état local et générale le permettent, traitement
étiologique.
Péritonites biliaires :
Cholécystectomie avec exploration de la VBP et drainage biliaire externe
afin de vérifier la vacuité et l’intégrité en postopératoire.
Les patients extrêmement fragiles peuvent bénéficier d’une
cholécystectomie incomplète ou d’une cholécystotomie.
Une lithiase résiduelle sera traitée au mieux par une sphinctérotomie
endoscopique.
Péritonites génitales :
Une péritonite sur salpingite peut être diagnostiquée à la laparoscopie et
traitée médicalement. Si la péritonite est généralisée une toilette par
laparoscopie est réalisable. Sinon la laparotomie s’impose.
Chez la femme jeune le traitement doit être le plus conservateur possible
alors que chez la femme âgée, ménopausée un traitement plus mutilant est
possible.
Péritonites postopératoires :
Une désunion anastomotique doit être démontée puis extériorisée en stomie. Dans certains cas
particuliers, mettre à la peau les deux bout est impossible, on se rabat sur une fistulisation dirigée vers
l’extérieur.
La surveillance post opératoire :
La surveillance ainsi que les soins ont une importance capitale dans la réussite de l’intervention
chirurgicale. Cette surveillance a pour objectif de déceler et de traiter les complications telles que les
infections broncho-pulmonaires avec le redoutable SDRA, les complications urinaires, les
complications cardiaques et thromboemboliques. Une fièvre persistante, l’absence de reprise du
transit, une insuffisance rénale et hémodynamique feront craindre une péritonite récidivante du fait
d’un traitement initial incomplet.
CONCLUSION :
De diagnostic clinique relativement facile, la péritonite aigue reste une urgence medico-
chirurgicale quasi quotidienne grave dont le pronostic dépend essentiellement de la précocité
de la prise en charge et par conséquent de la rapidité du diagnostic.
Ce pronostic est largement corrélé à l’âge du patient, au délai de l’intervention et à l’étiologie
(la mortalité est < à 5 % pour les péritonites appendiculaires et dépasse 40% pour les
péritonites postopératoires).
Péritonites aigues conférence d’internat H-BOUCENNA CCA 2019
Vous aimerez peut-être aussi
- Sutures Chirurgicales: Un Manuel Pratique sur les Nœuds Chirurgicaux et les Techniques de Suture Utilisées dans les Premiers Secours, la Chirurgie et la Médecine GénéraleD'EverandSutures Chirurgicales: Un Manuel Pratique sur les Nœuds Chirurgicaux et les Techniques de Suture Utilisées dans les Premiers Secours, la Chirurgie et la Médecine GénéraleÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Traumatismes Abdominaux 2011Document32 pagesTraumatismes Abdominaux 2011achabsurgeryPas encore d'évaluation
- Conduite A Tenir Devant Brulure Caustique 2Document34 pagesConduite A Tenir Devant Brulure Caustique 2abdo217Pas encore d'évaluation
- 1-Appendicites Aigues, Par Dr. BentouhamiDocument27 pages1-Appendicites Aigues, Par Dr. BentouhamiAna ManaPas encore d'évaluation
- Semio3an-Appendicite Aigue PDFDocument3 pagesSemio3an-Appendicite Aigue PDFSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- Les Peritonites Aigues2Document50 pagesLes Peritonites Aigues2Chiriţoiu Anamaria33% (3)
- 2 - Abces Du PoumonDocument39 pages2 - Abces Du PoumonkoPas encore d'évaluation
- Pathologie de L'oesophageDocument51 pagesPathologie de L'oesophagecassiopeia xPas encore d'évaluation
- Contusion AbdoDocument27 pagesContusion Abdosouleymane barryPas encore d'évaluation
- Les Hernies de La Paroi AbdominaleDocument39 pagesLes Hernies de La Paroi Abdominalecassiopeia xPas encore d'évaluation
- Fichier Produit 3740Document59 pagesFichier Produit 3740Marie Marie100% (1)
- 50 - Diverticulite Et ComplicationsDocument2 pages50 - Diverticulite Et ComplicationsBenzaoui DjemanaPas encore d'évaluation
- 36 AnuriesDocument4 pages36 AnuriesSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- Plaies Pénétrantes de L'abdomenDocument44 pagesPlaies Pénétrantes de L'abdomencassiopeia xPas encore d'évaluation
- Relation Soignant - Soigné 2021Document3 pagesRelation Soignant - Soigné 2021Fadila100% (1)
- Topo HERNIESDocument28 pagesTopo HERNIESCéline KYPas encore d'évaluation
- Traitement Chirurgical de La MUGDDocument13 pagesTraitement Chirurgical de La MUGDaitsurgery4730100% (6)
- LVBP ExternatDocument9 pagesLVBP Externataitsurgery4730100% (1)
- Ampulome Vatérien PDFDocument9 pagesAmpulome Vatérien PDFYasmine DoumazPas encore d'évaluation
- 9-Lithiase VésiculaireDocument2 pages9-Lithiase VésiculaireidouPas encore d'évaluation
- Appendicite AiguëDocument22 pagesAppendicite AiguëBMA-medecine100% (6)
- 16a-CONTUSIONS DE L'ABDOMENDocument7 pages16a-CONTUSIONS DE L'ABDOMENSouley Salah Abdoul LatifPas encore d'évaluation
- Traumatisme Iatrogène de La VBPDocument8 pagesTraumatisme Iatrogène de La VBPOuedoasis TestPas encore d'évaluation
- Brulures CaustiquesDocument41 pagesBrulures CaustiquesAnna smithPas encore d'évaluation
- Bactéries Résistantes Aux AntibiotiquesDocument32 pagesBactéries Résistantes Aux AntibiotiquesMONNETPas encore d'évaluation
- Occlusion Intestinale AigueDocument6 pagesOcclusion Intestinale AigueSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- AngiocholiteDocument8 pagesAngiocholitebaha25Pas encore d'évaluation
- 3-Occlusion Intestinale Aigue, Par PR - SeddikDocument7 pages3-Occlusion Intestinale Aigue, Par PR - SeddikAna Mana100% (1)
- Conduite À Tenir Devant Un Abdomen AiguDocument80 pagesConduite À Tenir Devant Un Abdomen AiguMina Dahel100% (1)
- Appendicite 2020 PDFDocument9 pagesAppendicite 2020 PDFYasmine Doumaz100% (1)
- Cours Voies Biliaires Extra 2020-ConvertiDocument4 pagesCours Voies Biliaires Extra 2020-ConvertiAghasy LittlePas encore d'évaluation
- Perforation d'UGDDocument7 pagesPerforation d'UGDimene chadli0% (1)
- Appendicite Aigue Et Ses ComplicationsDocument3 pagesAppendicite Aigue Et Ses ComplicationsbrahimPas encore d'évaluation
- 5 Cancer Gastrique PDFDocument38 pages5 Cancer Gastrique PDFKhaoula HafoufPas encore d'évaluation
- CAS CLINIQUES de Chirurgie 3Document13 pagesCAS CLINIQUES de Chirurgie 3abdo217Pas encore d'évaluation
- Peritonites AiguesDocument26 pagesPeritonites Aigueselmokretar100% (1)
- PéritonitesDocument3 pagesPéritonitesNassima MalekPas encore d'évaluation
- Cholecystite Aigue LithiasiqueDocument8 pagesCholecystite Aigue LithiasiqueFlorina Popa100% (1)
- Abcès Du FoieDocument13 pagesAbcès Du FoieKida KeanPas encore d'évaluation
- 3 - Hernies Et Éventrations de La Paroi Abdominale - PR ToughraiDocument21 pages3 - Hernies Et Éventrations de La Paroi Abdominale - PR ToughraiDoha El Aidouni100% (1)
- 1-Appendicite AigueDocument18 pages1-Appendicite Aiguect6qdvbmdhPas encore d'évaluation
- 21-Appendicite AigueDocument7 pages21-Appendicite AigueSerigne Sohibou Gaye100% (3)
- Cancer de La VBP DEMSDocument20 pagesCancer de La VBP DEMSDjallal HassaniPas encore d'évaluation
- Lithiase ResiduelleDocument12 pagesLithiase ResiduelleAlilou Le Duc100% (1)
- Conduite À Tenir Devant Une Lésion Caustique Du Tractus Digestif SupérieurDocument26 pagesConduite À Tenir Devant Une Lésion Caustique Du Tractus Digestif Supérieuraitsurgery4730Pas encore d'évaluation
- L'invagination Intestinale Aigue Chez L'enfantDocument35 pagesL'invagination Intestinale Aigue Chez L'enfantCéline KYPas encore d'évaluation
- Traumatismes AbdominopelviensDocument50 pagesTraumatismes AbdominopelviensAli Slimani100% (1)
- Contusion Abdominale 2Document21 pagesContusion Abdominale 2Brahim BennouiPas encore d'évaluation
- Chir Digestive PR AHUKA 1Document341 pagesChir Digestive PR AHUKA 1lucienntakobajira1Pas encore d'évaluation
- MIB 195 Invagination Intestinale AigueDocument23 pagesMIB 195 Invagination Intestinale AiguemlinaballerinaPas encore d'évaluation
- Cas Clini R4Document24 pagesCas Clini R4chirPas encore d'évaluation
- Mégaœsophage IdiopathiqueDocument6 pagesMégaœsophage IdiopathiqueNouaïri AminePas encore d'évaluation
- 19-Pancreatite AigueDocument8 pages19-Pancreatite AigueSouley Salah Abdoul LatifPas encore d'évaluation
- 6 Hernie HiataleDocument4 pages6 Hernie HiataleAchraf MOUGINIPas encore d'évaluation
- Pancreatites AiguesDocument6 pagesPancreatites AiguesMouhamadou L. DIOPPas encore d'évaluation
- Rupture de La RateDocument7 pagesRupture de La RateMACON824100% (1)
- Semiologie Proctologique 2ème AnnéeDocument62 pagesSemiologie Proctologique 2ème AnnéeMohamed Ali Mtibaa100% (3)
- Cas Clinique Sténoses Des Voies Biliaires - Vienne-Ariane 2014Document51 pagesCas Clinique Sténoses Des Voies Biliaires - Vienne-Ariane 2014Abdelhak Zaher BenboualiPas encore d'évaluation
- Pancrétite Aiguemerzouk 3Document6 pagesPancrétite Aiguemerzouk 3Amir BoudiafPas encore d'évaluation
- 22-Cancer Du CôlonDocument8 pages22-Cancer Du CôlonSerigne Sohibou GayePas encore d'évaluation
- Pleurésie Séro FibrineuseDocument28 pagesPleurésie Séro FibrineuseSara AitouhanniPas encore d'évaluation
- Valve TricuspideDocument10 pagesValve TricuspideMina APas encore d'évaluation
- Referetiel AURA CPC 2020 VDEFDocument19 pagesReferetiel AURA CPC 2020 VDEFMina APas encore d'évaluation
- ReanimationDocument4 pagesReanimationMina APas encore d'évaluation
- Referetiel AURA CBNPC 2020 VDEFDocument73 pagesReferetiel AURA CBNPC 2020 VDEFMina APas encore d'évaluation
- Programme de Chirurgie Generale1 Ère AnnéeDocument2 pagesProgramme de Chirurgie Generale1 Ère AnnéeMina APas encore d'évaluation
- Anato de LaineDocument6 pagesAnato de LaineMina APas encore d'évaluation
- 41ème Concours de Résidanat de Médecine - Octobre 2017Document35 pages41ème Concours de Résidanat de Médecine - Octobre 2017Mina APas encore d'évaluation
- Péritonite Aiguë (DR BOUDIAF)Document36 pagesPéritonite Aiguë (DR BOUDIAF)Mina APas encore d'évaluation
- Industrie Pharmaceutique PDFDocument18 pagesIndustrie Pharmaceutique PDFkitab nadirPas encore d'évaluation
- Situation Vaccinale Du 03 Aout2022Document8 pagesSituation Vaccinale Du 03 Aout2022TRITAH FATIMAPas encore d'évaluation
- CMF Sante 2020Document4 pagesCMF Sante 2020jacques albertPas encore d'évaluation
- Document Unique RMPDocument18 pagesDocument Unique RMPSerges Nembot KamgaPas encore d'évaluation
- 5-La Chirurgie ParodontaleDocument11 pages5-La Chirurgie ParodontaleSiham MegPas encore d'évaluation
- D JEPU Pre Programme 2019 Médecins v4Document11 pagesD JEPU Pre Programme 2019 Médecins v4MohamedGhediraPas encore d'évaluation
- 63 Capture Des Animaux ErrantsDocument2 pages63 Capture Des Animaux ErrantsRutherford LeeuwenhoekPas encore d'évaluation
- Résultat Enquete Semaine Nationale SMMR 2015Document32 pagesRésultat Enquete Semaine Nationale SMMR 2015Hamza BounsifPas encore d'évaluation
- Tchad Loi 2000 24 PharmacieDocument23 pagesTchad Loi 2000 24 Pharmaciepabameizoune0Pas encore d'évaluation
- Hernie 3Document139 pagesHernie 3juniordringhiPas encore d'évaluation
- 26 MeningitesDocument7 pages26 MeningitesSerigne Sohibou Gaye100% (1)
- BonUsageAntibiotiques1 PDFDocument40 pagesBonUsageAntibiotiques1 PDFMamadou MbaoPas encore d'évaluation
- 2012 Classification Locaux CClinSEDocument1 page2012 Classification Locaux CClinSEJihad JihadPas encore d'évaluation
- MOUTOUSSAMY-CARPIN - Minchy - UE5.6S6 - JUIN2023 - MFEIDocument39 pagesMOUTOUSSAMY-CARPIN - Minchy - UE5.6S6 - JUIN2023 - MFEIMinchy carpinPas encore d'évaluation
- Re Daction The'se apCdeSGDocument49 pagesRe Daction The'se apCdeSGmtabPas encore d'évaluation
- Paces Demo 2019 - 3Document41 pagesPaces Demo 2019 - 3roger kinaPas encore d'évaluation
- Attestation Sur L HonneurDocument1 pageAttestation Sur L HonneurSabrina AvertyPas encore d'évaluation
- Semiologie Des Emotions PathologiquesDocument22 pagesSemiologie Des Emotions PathologiquesEbePas encore d'évaluation
- Les Pièges Dans Lévaluation Du Rétrécissement AortiqueDocument6 pagesLes Pièges Dans Lévaluation Du Rétrécissement AortiqueKIRADPas encore d'évaluation
- Tacrolimus Topique Et Atteintes Cutanées Résistantes de La Dermatomyosite Topical Tacrolimus and Resistant Skin Lesions of DermatomyositisDocument6 pagesTacrolimus Topique Et Atteintes Cutanées Résistantes de La Dermatomyosite Topical Tacrolimus and Resistant Skin Lesions of DermatomyositisSuesy HopePas encore d'évaluation
- Hépatopathies Non ViralesDocument69 pagesHépatopathies Non ViralesOthy MamoaPas encore d'évaluation
- Accidents Du TravailDocument4 pagesAccidents Du TravailJulie VIONPas encore d'évaluation
- Courbe de l'ARPEC-1Document75 pagesCourbe de l'ARPEC-1Hamza BIKIPas encore d'évaluation
- Medecine InterneDocument19 pagesMedecine InterneKarim KarimPas encore d'évaluation
- Lupus Érythémateux systémique-FIFI - ConvertiDocument12 pagesLupus Érythémateux systémique-FIFI - ConvertiCobra TxnPas encore d'évaluation
- Comment Augmente Notre Rytme Cardiaque Au Cours DDocument5 pagesComment Augmente Notre Rytme Cardiaque Au Cours DAdèle100% (1)
- Risques Présents: Baisse Audition Surdité Stress Maladie Neurologiques.Document5 pagesRisques Présents: Baisse Audition Surdité Stress Maladie Neurologiques.Faouzi JouiliPas encore d'évaluation
- 3ème DS SA3Document2 pages3ème DS SA3Tondji ZoundeglaPas encore d'évaluation