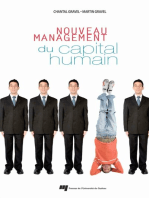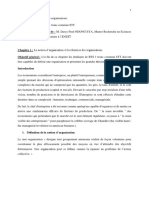Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Art - Lefevre - Théories Management
Art - Lefevre - Théories Management
Transféré par
Youssef El MeknessiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Art - Lefevre - Théories Management
Art - Lefevre - Théories Management
Transféré par
Youssef El MeknessiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Approches conceptuelles du management
Thories et stratgies du management
Le management est une responsabilit au sein de toute organisation et plus prcisment de la direction. Les structures sociales et mdico-sociales ne sont pas des entreprises comme les autres... Les environnements et la socit constituent plus quauparavant des rfrences et induisent des normes. Les frontires entre le dedans et le dehors sont davantage fluides, les institutions sont dsormais des organisations plus ouvertes, susceptibles de sadapter aux turbulences, en mesure de proposer des volutions. ce titre, le management doit permettre dlaborer des rponses appropries. Le secteur ne peut tre assimil aux entreprises ou aux administrations, car il trouve son essor dans les fondements de lconomie sociale ou solidaire, dans le militantisme social et la professionnalisation. Lthique sarticule la comptence et les associations ont faire valoir leur dimension politique et la force de leur projet. Au-del, les tablissements et services exercent une mission, ils rpondent des besoins, ils ont un rendez-vous avec lavenir. Les directions ont pour rle daccompagner le changement humain et technique, de promouvoir linnovation et la qualit des prestations. Le management rsulte dune vision et dune anticipation sur lavenir, mais il trace le chemin et il est alors pragmatique, mobilisateur et responsable. Discours et mthodes sont ncessaires. Le management ne forge pas des illusions, il sinscrit inlassablement dans lvnement et le quotidien des organisations.
Patrick Lefvre
Directeur du cabinet Techn-conseil
Patrick Lefvre est fondateur et directeur du cabinet Techn-conseil, spcialis dans laction sociale, le management des organisations et des ressources humaines. II enseigne galement dans plusieurs formations suprieures luniversit et dans des coles spcialises. ducateur spcialis, il a exerc pendant plusieurs annes la fonction de directeur dtablissement social, puis de directeur adjoint au sein dun CREAI.
Les Cahiers de lActif - N314-317
27
Manager les quipes
I - LE CONCEPT DE MANAGEMENT
Il sagit l dune notion qui sest peu peu dveloppe dans les entreprises industrielles et bureaucratiques, puis dans les entreprises de services, au cours du 20 sicle. Le concept apparat nettement la fin des annes 50 en Amrique, et se gnralise aujourdhui tous les univers de production, y compris dans lconomie sociale, et plus largement dans le champ de la sant et de laction sociale. Il constitue une rponse des volutions historiques et des mutations dans lconomie et le travail, il est associ la notion propose par F. Braudel davnement de la socit industrielle, de la socit bourgeoise et capitaliste . Le management renvoie aux thories relatives tantt aux organisations tantt aux stratgies qui impliquent lentreprise dans la gestion et lanimation de ses diffrentes ressources au regard de ses objectifs. Cest une rponse alternative au fonctionnement des entreprises charismatiques ou paternalistes, cest une dmarche de rationalisation de laction organise, dans les entreprises confrontes une complexification accrue des contraintes, tant au niveau humain que technique. Le management est une rponse alternative au fonctionnement des entreprises charismatiques ou paternalistes
Longtemps lie au secteur conomique et au march, cette dynamique correspond aussi bien lart de faire , aux processus qui permettent loptimisation de lentreprise sur le march, qu la valorisation des ressources humaines. Le terme management , dans son tymologie, renvoie lide de mange ou de mnage , et pourrait signifier rgler les affaires de la maison , ou amnager et bien videmment organiser. Il symbolise la main (cf. La main visible des managers, A. Chandler). La main est symboliquement associe au management et au manager. Les expressions prendre en main une organisation, tenir en main, mettre la main la pte illustrent bien des postures et des comportements de dirigeants, dans la conduite des affaires... Le management est dfini comme un art ou une action, qui permet de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son dveloppement, de la contrler, il sapplique tous les domaines dactivit de lentreprise . Il conduit obtenir des personnes que les tches soient accomplies dans les meilleures conditions. Il recouvre toutes les fonctions attaches lentreprise, lorganisation de la production, la gestion des ressources humaines, le dveloppement, la recherche ou linnovation...
II - REGARD SUR LES ORGANISATIONS
Management et organisation sont lis, parfois confondus. Lorganisation est aujourdhui dfinie comme un ensemble humain et technique structur autour de stratgies et mthodes lui permettant dassurer la fois sa prennit, sa comptence sur le march et la capacit atteindre ses objectifs. Lorganisation peut tre regarde comme un rassemblement de ressources humaines, matrielles, de travail et de capital, influences par une diversit de contraintes et dopportunits, internes et externes.
28
Les Cahiers de lActif - N314-317
Approche conceptuelles du management
H. Mintzberg la situe comme : un ensemble de personnes entreprenant une action collective la poursuite dune action commune . M. Crozier propose quant lui un ensemble constitu en vue datteindre un but clairement dfini, et ayant sa disposition toute une srie de procds et de contrles contraignants, permettant dassurer la subordination de tous ces moyens, y compris des ressources humaines, laccomplissement de ce but et impliquant la ncessit dunir les efforts dun individu celui des autres . Plus gnralement, lorganisation peut tre apprhende partir de plusieurs dimensions : A. lentit institutionnelle, de lidentit et de la culture, B. la dimension structurelle et fonctionnelle, C. la dimension de la comptence et de la performance. En fait, lorganisation a t pense comme un modle de socit induisant une certaine approche de laction collective, comme un processus de rationalisation du travail, dlaboration culturelle et symbolique, capable de dfinir des normes et des rgles explicites ou implicites, comme un lieu dchange et de communication, un lieu dexpression du pouvoir et du conflit. Il est galement important de regarder la question travers le prisme de lconomie dentreprise, et notamment les trois grandes priodes de dveloppement : n lconomie de production, n lconomie de march, n lconomie denvironnement.
Les modles reprables de laction organise
Charismatique Techniciste Lgaliste Entrepreneurial mythique ingnieur gestionnaire manager relationnel mcaniciste rationnel innovant et mobile communaut production/atelier procdures/bureau rseau
Guide de la fonction chef de service dans les organisations sociales et mdico-sociales, Patrick Lefvre, Dunod, 2001.
ce titre, le management a sans doute t dabord une rponse des contraintes de production, pour sintresser ensuite limpact du march et lessor des facteurs concurrentiels, jusqu la drgulation progressive des changes conomiques et au passage progressif du pilotage par loffre au pilotage par la demande. Le facteur humain est peu peu devenu un lment dterminant dans lhistoire des organisations, tout comme la t plus rcemment le dveloppement massif des technologies de linformation et de la communication, ou la recomposition massive des entreprises (dlocalisation, fusion/ absorption...). Le management a ainsi accompagn un mouvement qui trouve ses origines dans la rationalisation de la production, sadaptant par la suite aux volutions historiques, conomiques et culturelles. Il constitue une rponse qui prend ses repres dans la diversit des sciences humaines, juridiques, conomiques et de gestion. Ingnieurs, militaires, comptables, juristes, psychologues, autant de figures symboliques qui ont accompagn le dveloppement des ides et des conceptions du management.
Les Cahiers de lActif - N314-317
29
Manager les quipes
Les grands courants et les influences dans les organisations
1. La production La division du travail Mcaniser et motiver Machines spcialises, travail la chane Organisation scientifique du travail Le mtier se dtache de la qualification Analyse du travail/mthodes/rationalisation Staff and line Prvoir/organiser/commander/coordonner/contrler conomie de production
XIX sicle XIX sicle
Les chemins de fer Taylorisme
fin XIX
Fayol
Rupture dbut XX sicle -> Le travail en miettes, G. Friedmann 2. La motivation Production de masse Augmentation des salaires Les relations humaines et les thories de la motivation La dynamique de groupe dbut XX 1930 Fordisme E. Mayo-K. Lewin
Rupture due au fait que lentreprise est un lieu conflictuel 3. La participation Direction participative par objectifs (DPO) Innovation/cohrence/dlgation Dconcentration et responsabilit des cadres conomie de march P. Drucker O. Glinier 1950/1960
Sloan (Gnral Motors)
Rupture conomie dentreprise/rvolution des organisations 4. La polyvalence Pilotage par la demande et le juste temps. Flexibilit Organisation composite et polycellulaire Globalit tches et groupes autonomes Enrichissement des tches conomie de march
1970/1980 H. Seryiex
Entreprise 3 type
Polyvalence et dspcialisation 5. Acteurs et rseaux Entreprise systme et en rseau entreprise matricielle Organisation par projets Lentreprise lcoute Management systmique
1980/1995 M. Crozier H. Seryiex
Entreprise 4 type
Rupture : le mythe de lentreprise au profit de lthique 6. Lthique et la socit Lentreprise citoyenne Lentreprise une affaire de socit Citoyennet/dmocratie/environnement La lutte des places conomie de march A. Touraine R. Sainsaulieu 1995
V. De Gaulejac
Rarticulation de la productivit et de lemploi 7. Responsabilit et risque Le temps des responsables Le corrupteur et le corrompu Judiciarisation et accroissement des risques 2000 A. Etchegoyen A. Etchegoyen conomie assurancielle
Guide de la fonction chef de service dans les organisations sociales et mdico-sociales, Patrick Lefvre, Dunod, 2001.
30
Les Cahiers de lActif - N314-317
Approche conceptuelles du management
III - THORIES ET APPROCHES DU MANAGEMENT
Deux niveaux peuvent tre reprs comme constitutifs du management, qui permettent de se situer dans une multiplicit de thories et stratgies : n lanalyse des organisations, comme construit social et fonctionnement, n le comportement des individus et des groupes, et le facteur humain.
1. Lcole classique
Trois noms sont attachs la recherche et aux volutions : n Max Weber, penseur de la rationalisation et de la bureaucratie, propose de remettre en question le modle de lorganisation traditionnelle et charismatique, en sappuyant sur des procdures explicites de fonctionnement. On lui doit le concept dorganisation rationnelle lgale ; n Frdric W. Taylor, inventeur de lorganisation scientifique du travail, propose une diffrenciation formelle des tches confies aux dirigeants et aux excutants, mais il identifie et structure les diffrentes fonctions de lentreprise. Il introduit des mthodes psychotechniques de slection des individus (the right man in the right place) et explique la bonne faon daccomplir une tche (the one best way) ; n pour Henri Fayol, la division du travail, hirarchie et centralisation, lunit de commandement, constituent les bases du management scientifique et ont permis de dfinir le modle de lcole classique. Ces approches ont conduit de relles innovations au sein des organisations, mais elles correspondent un moment de lhistoire des entreprises industrielles. Elles restent des repres utiles dans le management, fonds sur la structuration formelle des niveaux organiss et des places. On peut leur reprocher dvoluer vers la bureaucratie et le cloisonnement, et davoir t plus adaptes des systmes ferms et des environnements stables, davoir nglig par ailleurs les facteurs de pouvoir et de conflits humains.
2. Lcole des relations humaines
Le concept de rationalit gnralise comporte des limites lis lincertitude des environnements et une certaine irrationalit du comportement humain. Elton Mayo sera le premier mettre en vidence le facteur humain et le champ de la motivation. Les courants relatifs la dynamique des groupes, sous limpulsion de Kurt Lewin, apportent des pistes nouvelles pour comprendre et intgrer laction collective, notamment les phnomnes de leadership et le fonctionnement des groupes restreints. Parfois en contradiction avec les thories rationnelles managriales dans les entreprises, cette approche a inaugur les analyses sur les phnomnes de pouvoir, les communications informelles.
3. Le management participatif
Li la direction des entreprises, le management participatif sintresse au mode de gouvernement et la construction des organigrammes, des relations humaines et sociales, et au processus de motivation et de participation des cadres et salaris. On peut la dcomposer en plusieurs niveaux :
Les Cahiers de lActif - N314-317
31
Manager les quipes
n n n
la direction participative par objectifs (DPPO), les cercles de pilotage et de qualit, lentreprise apprenante et formatrice.
Il sagit principalement de mettre en uvre des processus de dlgation et de consultation, comme des lments de la dcision, impliquant la responsabilit et lautonomie des acteurs, tous les niveaux de lorganisation. Les dmarches de projet se sont largement inspires de cette philosophie qui concilie la fois dlgation et dmocratisation de laction organise.
4. La sociologie des organisations
Courant plus rcent apparu dans les annes 70/80, il sest fortement dvelopp et allie deux approches, celle relative lorganisation elle-mme et celle relative aux individus qui la composent. La sociologie des organisations sintresse aux facteurs individuels et laction collective, traite de la socialisation et de la culture, de lanalyse et de la rgulation du pouvoir. On peut la dcomposer en plusieurs courants essentiels :
n
Lanalyse stratgique : Michel Crozier et Erhard Fried- Les dmarches de projet berg regardent lorganisation comme un systme politique, se sont largement inspires qui rsulte notamment du jeu des acteurs, de leur capacit de la philosophie du manadvelopper des stratgies et tirer profit des zones dincerti- gement participatif tude au sein de lorganisation. La rgulation sociale : Jean-Daniel Reynaud apporte un clairage important sur la place des rgles dans lorganisation montrant comment les rgles implicites ou explicites participent de la socialisation des individus et des groupes. Il distingue deux sortes de rgles, celles du contrle et celles lies lautonomie de lindividu. Lidentit et la culture : Renaud Sainsaulieu apporte de nombreux clairages sur les phnomnes identitaires et sur le dveloppement des cultures professionnelles ou organisationnelles. Il tente de comprendre les organisations partir des mondes sociaux qui la composent, de lautonomie de chacun, et identifie plusieurs modles dintgration sociale : lentreprise communaut qui fonctionne sur des normes explicites et intriorises, et sur le sentiment dappartenance de chacun lorganisation. lentreprise modernise qui concerne les entreprises fragilises par les contextes et menaces par les environnements, qui sadaptent et inventent une recomposition technologique et organisationnelle. Le changement global accompagne la dmarche. lentreprise bureaucratique caractrise plutt le secteur des administrations publiques et prives et sappuie sur la prgnance de normes, de rgles et de hirarchies qui structurent laction collective et limitent lautonomie des acteurs, mais qui tendent prenniser lorganisation. lentreprise duale qui rpond la contrainte de performance et de concurrence par une rationalisation accrue de la production, et par une flexibilit de lorganisation et des tches.
32
Les Cahiers de lActif - N314-317
Approche conceptuelles du management
lanalyse des organisations : ce courant articule sociologie et psychanalyse, individu et institution ; il observe lorganisation travers des principes lis la part de linconscient et de lirrationnel. Cest un regard particulirement utile pour les organisations qui traversent des crises et des conflits, permettant de relativiser la rationalit du vcu au sein des institutions et des groupes. Lanalyse institutionnelle offre un mode dintervention clinique adapt certaines situations. Lanthropologie et lethnologie apportent leur part la comprhension des organisations, travers ltude des mythes et des rites, et de la place accorde aux phnomnes de socialisation et de culture dentreprise.
IV - LVOLUTION DU MANAGEMENT
Il sagit de regarder les organisations comme des construits sociaux qui inventent des quilibres et cherchent les maintenir, quil sagisse dquilibres financiers, gestionnaires, productifs ou humains. Le management est plus que jamais dpendant des facteurs denvironnement conomiques et politiques. Les espaces interne et externe se sont progressivement recomposs, introduisant la notion de porosit des niveaux. Lentreprise comme micro-socit a laiss place lorganisation en rseau, une communication ouverte et fluide, et une moins grande matrise du management interne au profit de la gestion des incertitudes, tant au plan humain que technique. Cest ainsi que se sont dveloppes les notions de veille stratgique, technologique et concurrentielle . Organisation, acteurs et environnements dfinissent dsormais ensemble le jeu du compromis et de la ngociation, dans lequel les frontires de lorganisation sont de plus en plus virtuelles et les facteurs de rgulation externe de plus en plus prsents. Les exigences sont plus fortes, marques par des contraintes essentielles : le dveloppement de la concurrence, linnovation technologique, le risque et la prvention des risques, la motivation des individus. Le management systmique rendu ncessaire implique un travail renouvel sur les problmatiques du changement et la gestion des transitions. Lincertitude de nos socits et de lconomie ne doit cependant pas laisser place des approches managriales trop conjoncturelles et opportunistes. Les managers doivent aujourdhui acqurir des aptitudes analyser, comprendre des situations et des vnements dans un monde marqu par la turbulence et la fragilit des organisations. Le management constitue une rponse approprie la scurisation ncessaire des entreprises. Il est peut tre utile de sappuyer la fois sur une rflexion thique et sur la fonction citoyenne des organisations, au-del de leur position concurrentielle et de la recherche du march et du profit. Des quilibres sont ncessaires entre une vision de lentreprise adosse une conomie nolibrale, ou une conomie solidaire et sociale, responsable de lavenir des hommes et des socits.
Les Cahiers de lActif - N314-317
33
Manager les quipes
V - LE MANAGEMENT DANS LES ORGANISATIONS SOCIALES ET MDICO-SOCIALES
Le concept de management est rest longtemps la priphrie des organisations sociales et mdico-sociales. Le secteur est pourtant concern par toutes les volutions intervenues dans les entreprises prives ou publiques, mme si les associations, tablissements et services ont volu diffremment, compte tenu de facteurs historiques, culturels et de la nature des missions. En effet, lthique, le militantisme, la pression relative des environnements, ont longtemps protg des turbulences. Le secteur est aujourdhui identifi par les environnements juridiques, concurrentiels et conomiques. On assiste peu Le terme de management social a pris place prudemment dans des peu lmergence organisations qui sont de plus en plus confrontes aux mmes contrain- des entrepreneurs tes que les entreprises de services, si ce nest que le degr de pression sociaux externe est moindre. La protection que reprsentent les subventionnements accords aux tablissements et services, et le moindre risque entrepreneurial, contribuent pondrer les pressions. Pour autant, les exigences se sont accrues et les recompositions sont engages dans un secteur o lon parle ouvertement de reprise , de fusion , de qualit , de concurrence , dappels doffres... Les petites associations disparaissent au profit de groupes associatifs entreprenants. De nombreuses recompositions sorganisent aussi en rponse aux mutations contextuelles, la dsinstitutionalisation, la prise en compte des notions de territoire ou de travail en rseau, et surtout au dveloppement de la logique de prestation et de service au dtriment de la logique de structure. Les organisations sociales sont ds lors moins identifies partir de publics cibles, mais plutt partir de leur capacit rpondre, par la qualit et linnovation, des demandes naissantes sur le territoire, et partir de leur projet associatif ou dtablissement. ce titre, le management associatif prend une place aujourdhui plus importante, au-del de lautonomie des tablissements. On assiste peu peu des modifications sensibles, la disparition des directions charismatiques et larrive des entrepreneurs sociaux, quils soient bnvoles ou professionnels. Les btisseurs dhier ont laiss la place aux innovateurs et aux managers des ressources humaines. Les associations intgrent des organigrammes moins hirarchiques, davantage fonctionnels et transversaux, agissant en rseaux internes et externes, dconcentrs ou dcentraliss. La spcificit du management social accompagne plusieurs enjeux : n contribuer au maintien dune logique non commerciale qui privilgie lthique, n assurer les conditions de linnovation et du dveloppement des services, n contribuer la qualit des prestations en direction des usagers et de la socit, n optimiser les ressources humaines, tant au plan de la dynamisation que de la prospective.
34
Les Cahiers de lActif - N314-317
Approche conceptuelles du management
Le management du changement dans laction sociale
Recomposition Rgulation
Innovation Transformation
Contractualisation Partenariat
Citoyennet Responsabilit
Comptence Technicit
Politique
PROJET thique
Technique
UTOPIE
DIRECTION
COMPTENCE
- Management systmique Global/local/rseau - Organisation apprenante et formative - Lisibilit / communication RECONSTRUCTION / NGOCIATION / COMPROMIS AMBITION / RISQUE EXPRIMENTATION RSEAU / VALUATION
Guide de la fonction chef de service dans les organisations sociales et mdico-sociales, Patrick Lefvre, Dunod, 2001.
Les Cahiers de lActif - N314-317
35
Manager les quipes
Lorganisation par projets
Elle est aujourdhui lgitime et peut tre utilise au service de lefficacit, du dveloppement des ressources et de la dmocratie dans les associations, les tablissements privs et publics. Elle peut accompagner la dsinstitutionalisation sans que des ruptures trop brutales ninterviennent, dans le respect des personnes, quil sagisse des usagers ou des salaris. Le compromis et la ngociation simposent, ils appellent un management renouvel, moins centr sur la reproduction et le maintien des quilibres antrieurs, davantage cratif et prospectif, capable de se centrer la fois sur lvnement quotidien et sur la mise en perspective du futur. On peut alors assister la lgitimation du management transitionnel.
Lorganisation rationnelle lgale
La qualit du management reposera sur la capacit des organisations fonder des repres pour penser laction collective, la motivation et la comptence des acteurs. Elle ne peut plus tre lie au seul charisme des dirigeants, elle renvoie la force de lorganisation dfinie autour de sa culture, de ses normes fonctionnelles, la comptence de ses dirigeants et cadres capables de susciter et daccompagner le changement humain et technique. Plusieurs stratgies sont susceptibles dapporter des garanties aux tablissements et services : n la formalisation des projets, associant acteurs internes et partenaires, n les dmarches qualit, permettant la confiance et la scurisation des environnements, n la dfinition des responsabilits et des dlgations, n lanalyse des emplois et des comptences, n le management des trajectoires professionnelles et la mobilit des personnels.
Le management des ressources humaines*
Les ressources humaines sont nes avec la rflexion sur les organisations et le management. Regroupant la fois stratgies et mthodes, elles touchent aussi bien la gestion et ladministration, lorganisation du travail, limplication et la dynamisation des acteurs, la prospective, lanticipation et la gestion prvisionnelle, le dialogue social, les tudes quantitatives et qualitatives. La fonction ressources humaines est directement dpendante des directions au plan stratgique, on parle du directeur ou responsable des ressources humaines. Tantt confies des comptables, des gestionnaires des organisations, ces dlgations traduisaient des logiques institues, des manires de penser la place des salaris dans les organisations, autant que des philosophies de gestion. Des modles reprables travers plusieurs logiques : productiviste, celle de la rationalit du travail, gestionnaire, celle de lanalyse des cots, la logique de la prvision et de lanticipation, celle de la motivation et de limplication, la logique des comptences et de la formation, enfin celle du dialogue et des relations sociales.
* Extrait du Cahier Techn n3, Mai 2001.
36
Les Cahiers de lActif - N314-317
Approche conceptuelles du management
La gestion des ressources humaines
Emploi Gestion prvisionnelle Emplois et comptences Rfrentiels Travail Organisation Gestion du travail Hygine et scurit Ngociation Relations sociales Conflits du travail Participation
Communication Culture dentreprise Cohsion sociale Information
Administration Contrats - Conformit Dossiers du Personnel Rmunration Mdecine du travail
Individu Implication - Motivation valuation Trajectoire
Le management individualis
cadre contractuel SCURISATION
adhsion au projet ENGAGEMENT
valorisation personnelle IMAGE DE SOI
responsabilit professionnelle IMPLICATION
dveloppement des comptences PROFESSIONALISATION
mobilit professionnelle TRAJECTOIRE
Le management collectif
transversalit mutualisation enrichissement
emplois qualifications comptences
culture communication socialisation
projets innovation exprimentation
fonctions dlgations pouvoirs
Les Cahiers de lActif - N314-317
37
Manager les quipes
BIBLIOGRAPHIE
Sociologie des organisations M. Crozier, Lacteur et le systme P. Bernoux, La sociologie des organisations A. Bartoli, Communication et organisation J.-D. Reynaud, Les rgles du jeu et laction collective -> Complexit des organisations E. Morin, Introduction la pense complexe J.-L. Le Moigne, Le constructivisme, tome 1 et 2 M. Gnelot, Manager dans la complexit Management et ressources humaines M. Weber, conomie et socit H. Mintzberg, Voyage au centre des organisations ; Le manager au quotidien A. Chandler, Stratgies et structures de lentreprise M. Crozier, Lentreprise lcoute D. Weiss, Les ressources humaines J.-M. Peretti, Ressources humaines J.-P. Flipo, le marketing des services A. Meignant, Manager la formation Sociologie clinique M. Pags, Lemprise de lorganisation E. Enriquez, Lorganisation en analyse ; Les jeux du dsir et du pouvoir V. de Gaulejac, Sociologie clinique ; Le cot de lexcellence ; La lutte des places -> Identit et culture Mondes sociaux E. Jacques, La culture dentreprise R. Sainsaulieu, Les mondes sociaux ; Lidentit au travail ; Sociologie de lassociation L. Boltanski, Les conomies de la grandeur M. Callon, La science et les rseaux Direction et encadrement J.-M. Miramon, Le mtier de directeur ; Manager les changements dans laction sociale P. Lefvre, Guide de la fonction directeur dtablissement social et mdico-social P. Lefvre, Guide de la fonction chef de service dans les organisations sociales et mdico-sociales.
38
Les Cahiers de lActif - N314-317
Vous aimerez peut-être aussi
- Nouveau Releve CompteDocument6 pagesNouveau Releve CompteIbrahim El Amin80% (5)
- Interrogation MCO 1 - CorrectionDocument2 pagesInterrogation MCO 1 - CorrectionMarleen AttalPas encore d'évaluation
- Études de cas en GRH, en relations industrielles et en managementD'EverandÉtudes de cas en GRH, en relations industrielles et en managementÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Etat Avancement-ModifieDocument2 pagesEtat Avancement-ModifieMans Mic100% (2)
- Doc1 Final Management Operationnel PDFDocument57 pagesDoc1 Final Management Operationnel PDFhonoviw115Pas encore d'évaluation
- Fiscalité Des Entreprises.S5Document84 pagesFiscalité Des Entreprises.S5KHADIJA LMECHTAL100% (2)
- Rapport DolidolDocument4 pagesRapport DolidolKhalil IdrissiPas encore d'évaluation
- Management Des OrganisationsDocument68 pagesManagement Des OrganisationsNada DaPas encore d'évaluation
- L'entreprise full-RSE: De la prospective à la pratique, la vision des professionnelsD'EverandL'entreprise full-RSE: De la prospective à la pratique, la vision des professionnelsPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Analyse Des Organisation Et de L'entrepriseDocument17 pagesChapitre 1 Analyse Des Organisation Et de L'entrepriseel mountassir yahyaPas encore d'évaluation
- R DolidolDocument79 pagesR DolidolKhalil IdrissiPas encore d'évaluation
- Changement Organisationnel Et Évolution Des CompétencesDocument15 pagesChangement Organisationnel Et Évolution Des Compétencesfatoumata draméPas encore d'évaluation
- Partie PrenanteDocument20 pagesPartie PrenanteAbdou SalamatouPas encore d'évaluation
- RepercussionDocument41 pagesRepercussionhassanPas encore d'évaluation
- Management StrategiqueDocument64 pagesManagement StrategiqueZakaria ZikouPas encore d'évaluation
- RSE La Norme ISO 26000 Et Les Ressources Humaines Part 2Document5 pagesRSE La Norme ISO 26000 Et Les Ressources Humaines Part 2Rabah Nabil DekouchePas encore d'évaluation
- Présentation Sur Le ReengineeringDocument22 pagesPrésentation Sur Le ReengineeringDOUDOU-38Pas encore d'évaluation
- Les Défis de La RSE À L'ère Du Numérique - Quel Apport de L'audit Social (PDFDrive)Document220 pagesLes Défis de La RSE À L'ère Du Numérique - Quel Apport de L'audit Social (PDFDrive)carton SPSPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 La GPECDocument6 pagesChapitre 2 La GPECĖlena SåīPas encore d'évaluation
- Complement 2 Mecanisme de CoordinationDocument3 pagesComplement 2 Mecanisme de CoordinationFadimata Wallet DoudouPas encore d'évaluation
- Management de La Communication InterneDocument8 pagesManagement de La Communication InterneRachel BardetPas encore d'évaluation
- I-Les Origines Du Management ParticipatifDocument9 pagesI-Les Origines Du Management Participatifabdhafid meftahiPas encore d'évaluation
- Talbi JESADocument33 pagesTalbi JESAYoussef LeSafioPas encore d'évaluation
- Alfred Pritchard SloanDocument4 pagesAlfred Pritchard SloanMoad AbidPas encore d'évaluation
- La Construction Des Processus RHDocument3 pagesLa Construction Des Processus RHAdil LamPas encore d'évaluation
- INTRODUCTIONDocument7 pagesINTRODUCTIONPape Mamadou NdiayePas encore d'évaluation
- Typologie Des Cadres Et Des Systèmes de Mesure de PerformanceDocument11 pagesTypologie Des Cadres Et Des Systèmes de Mesure de PerformanceNajia El YanboiyPas encore d'évaluation
- Cours de Management Interculturel Master 1 AdekenDocument9 pagesCours de Management Interculturel Master 1 AdekenAmadou Nango100% (1)
- Thème 1 Les Enjeux Du Management Des OrganisationsDocument7 pagesThème 1 Les Enjeux Du Management Des OrganisationsMelvinPas encore d'évaluation
- Les Héritiers de Ces ÉcolesDocument10 pagesLes Héritiers de Ces ÉcolesZakaria Zerradi MansouriPas encore d'évaluation
- Le Dialogue Social Suffit-Il À La Cohésion de L'organisationDocument6 pagesLe Dialogue Social Suffit-Il À La Cohésion de L'organisationGhostoo GoPas encore d'évaluation
- Management Stratégique PDFDocument16 pagesManagement Stratégique PDFNabila Sabaoui Idrissi100% (1)
- Decentralisation RHDocument18 pagesDecentralisation RHMohamad SamyPas encore d'évaluation
- Articuler Les Politiques de GRH Et Les Stratégies DDocument4 pagesArticuler Les Politiques de GRH Et Les Stratégies DEl Mekki ZekraouiPas encore d'évaluation
- Concept Du Management StratégiqueDocument26 pagesConcept Du Management StratégiquederghalPas encore d'évaluation
- Politique Des Ressources Humaines SONASID VER1Document8 pagesPolitique Des Ressources Humaines SONASID VER1freedom_spirit_100% (1)
- La Gestion Des CompetencesDocument13 pagesLa Gestion Des Competencesfaroudja ait hamouPas encore d'évaluation
- La Fonction de DirectionDocument15 pagesLa Fonction de Directionaz.youssef017Pas encore d'évaluation
- Les Léviers Opérationnels de La GRHDocument37 pagesLes Léviers Opérationnels de La GRHAbdoulaye NdongPas encore d'évaluation
- Gouvernance Des Entreprises PDFDocument39 pagesGouvernance Des Entreprises PDFHiba Diwani100% (1)
- ExposéDocument22 pagesExposémary100% (1)
- Chap. 4: La Rémunération: Cours de MR - SadikiDocument10 pagesChap. 4: La Rémunération: Cours de MR - SadikisoukainaPas encore d'évaluation
- Support GRH FSTDocument40 pagesSupport GRH FSTAziz YahyaPas encore d'évaluation
- Responsabilité Sociale EntrepriseDocument4 pagesResponsabilité Sociale EntrepriseSara ElyahyaouiPas encore d'évaluation
- Etude Paribas Knowledge ManagementDocument82 pagesEtude Paribas Knowledge ManagementChaimae Sbai100% (4)
- Cours #01 Introduction Au Management StratégiqueDocument9 pagesCours #01 Introduction Au Management StratégiqueAya BelhadjPas encore d'évaluation
- Fiche Outil 2 - Concevoir Un Plan de FormationDocument2 pagesFiche Outil 2 - Concevoir Un Plan de FormationMoulay Said Erroudani100% (2)
- Les Aspects de La Gestion de La Force de VenteDocument37 pagesLes Aspects de La Gestion de La Force de VenteSoumia MezroubPas encore d'évaluation
- Initiation A La GRH IsgetDocument70 pagesInitiation A La GRH IsgetJean Jacques KayokaPas encore d'évaluation
- Masahiko AokiDocument12 pagesMasahiko AokiyassinePas encore d'évaluation
- Manag Sit de Crise FMKDocument14 pagesManag Sit de Crise FMKAzedine Oudrar100% (1)
- Ergonomie. P FalzonDocument21 pagesErgonomie. P FalzonFlora ArthPas encore d'évaluation
- Parties Prenantes Et RSEDocument13 pagesParties Prenantes Et RSEdinoPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Les Théories Du Management Des Organisations PDFDocument10 pagesChapitre 1 Les Théories Du Management Des Organisations PDFCarl Verlin MOUCKETOUPas encore d'évaluation
- GPEC-cas ALEGDocument27 pagesGPEC-cas ALEGdervillezPas encore d'évaluation
- Introduction À GRHDocument2 pagesIntroduction À GRHMed SOUFPas encore d'évaluation
- Aspects Intrinseques de La Motivation Et de La SatDocument19 pagesAspects Intrinseques de La Motivation Et de La SatAbd LwahdPas encore d'évaluation
- Management Strategi Que Et Management Operation NelDocument8 pagesManagement Strategi Que Et Management Operation NelZineb HmzPas encore d'évaluation
- Tkit3 FRDocument19 pagesTkit3 FRRim NbPas encore d'évaluation
- Le Réflexe Soft SkillsDocument282 pagesLe Réflexe Soft SkillsHalime HalimePas encore d'évaluation
- DCG / MANAGEMENT / Sujet Epreuve N° 1: Partie 1Document9 pagesDCG / MANAGEMENT / Sujet Epreuve N° 1: Partie 1abnadege45Pas encore d'évaluation
- Facture: Etat de CompteDocument2 pagesFacture: Etat de CompteDawson yasnaPas encore d'évaluation
- CAP 2021 Cpta UsuelleDocument11 pagesCAP 2021 Cpta UsuelleHamed BabaPas encore d'évaluation
- THEORIE DE DECISION ET DE JEUX 2023 Partie 05 1Document19 pagesTHEORIE DE DECISION ET DE JEUX 2023 Partie 05 1Ibtissam JDAIRIPas encore d'évaluation
- Expose Activités EconomiqueDocument2 pagesExpose Activités EconomiqueOmar BourzinePas encore d'évaluation
- CCTP Lot 1 Gros-Oeuvre MaconnerieDocument33 pagesCCTP Lot 1 Gros-Oeuvre MaconneriefourPas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document28 pagesChapitre 1Ãbdél Mãjìd ËlPas encore d'évaluation
- RAPPORT STAGE STAR (Enregistré Automatiquement)Document21 pagesRAPPORT STAGE STAR (Enregistré Automatiquement)merveilitongwa95Pas encore d'évaluation
- TP Gestion Des CarièrresDocument2 pagesTP Gestion Des CarièrresHiba RbPas encore d'évaluation
- Positionement de L'audit InterneDocument6 pagesPositionement de L'audit InterneSoufiane CHPas encore d'évaluation
- Avis D'Arrivee: Fildair SarlDocument2 pagesAvis D'Arrivee: Fildair SarlSamia SamiaPas encore d'évaluation
- Economie Industrielle Acte IDocument78 pagesEconomie Industrielle Acte Isamuel AssienanPas encore d'évaluation
- Expose D'audit OpérationnelDocument18 pagesExpose D'audit OpérationnelSORYPas encore d'évaluation
- Avis Au Public Lancement Appel D'offres Pour La Construction D'une École Secondaire Au Village KilongoDocument2 pagesAvis Au Public Lancement Appel D'offres Pour La Construction D'une École Secondaire Au Village KilongoInfos Actualite.cdPas encore d'évaluation
- Negociation InternationaleDocument19 pagesNegociation Internationalemaxuya2001Pas encore d'évaluation
- Principes de La TVADocument136 pagesPrincipes de La TVAMehdiPas encore d'évaluation
- Notions Droit Commercial - Pr. BenmoussaDocument19 pagesNotions Droit Commercial - Pr. BenmoussaMaatoubePas encore d'évaluation
- ManuelTheories Comptables 01dec10Document459 pagesManuelTheories Comptables 01dec10sainthilaireneilla18Pas encore d'évaluation
- Asaci Ai 2015Document78 pagesAsaci Ai 2015pascalPas encore d'évaluation
- DALLOZ Etudiant - Actualité: Dommage Causé Par Un Mineur: Les Responsabilités Se CumulentDocument1 pageDALLOZ Etudiant - Actualité: Dommage Causé Par Un Mineur: Les Responsabilités Se CumulentxavierPas encore d'évaluation
- Enonce Dernier TD 3 S1Document4 pagesEnonce Dernier TD 3 S1Ghadoui AminePas encore d'évaluation
- Maintenance PréventiveDocument12 pagesMaintenance PréventiveSoufianePas encore d'évaluation
- ZZ SAP Que Sont Les RICEFW Dans SAPDocument6 pagesZZ SAP Que Sont Les RICEFW Dans SAPJOHN BHARKLAY TIMAPas encore d'évaluation
- Lockheed MartinDocument19 pagesLockheed MartinYasmine LeePas encore d'évaluation