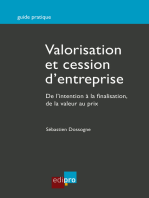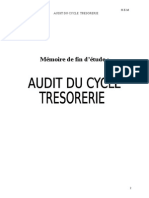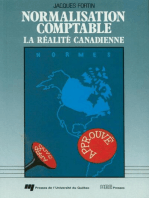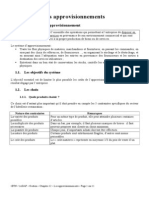Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Revue Analytique Et Controle Interne Outils de Detection Des Risques
Revue Analytique Et Controle Interne Outils de Detection Des Risques
Transféré par
Moh_ati0070 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
24 vues91 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
24 vues91 pagesRevue Analytique Et Controle Interne Outils de Detection Des Risques
Revue Analytique Et Controle Interne Outils de Detection Des Risques
Transféré par
Moh_ati007Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 91
Thme du mmoire :
Travail effectu par : BAKKALI HASSANI Ghita
Encadr par : M. EL KHALIFA
Anne universitaire : 2005 / 2006
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Certes, ce dossier est le fruit du travail de ltudiante que je suis, mais sa
finalisation a surtout t possible grce la collaboration de certaines personnes que je
tiens remercier.
Tout dabord, je tiens exprimer ma gratitude envers M. EL KHALIFA, mon
professeur encadrant, pour tout le savoir qu'il nous a inculqu ainsi que pour ses prcieux
conseils et sa grande indulgence.
Je suis aussi particulirement reconnaissante envers Messieurs ALMECHATT et
BIDAH, associs partner, pour mavoir accueillie au sein de leur cabinet Price
WaterHouse Coopers, et pour mavoir permis de raliser mon stage dans les meilleures
conditions grce leurs apports ininterrompus en conseils et judicieuses directives.
Jadresse galement mes remerciements au charmant personnel du cabinet pour
son aimable accueil.
En ctoyant des professionnels disponibles comme ceux de Price WaterHouse
Coopers, jai normment appris non seulement du point de vue thorique, mais aussi du
point de vue de lacquisition dune mthode de travail, du dveloppement de mes
capacits travailler en quipe et de la familiarisation avec les rouages dune entreprise.
Gnreux, ils nhsitaient pas partager leurs expriences avec leurs stagiaires.
Enfin, je me permets de ddier ce travail ma famille qui ma permis non
seulement d'tre de ce monde, mais aussi de poursuivre mes tudes suprieures par leur
soutien matriel et moral.
2
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
La pratique de l'audit, d'abord dans le domaine financier et comptable, puis, par
extension, dans les autres fonctions de l'entreprise (audit oprationnel), a connu ces
dernires annes un dveloppement considrable.
Il s'est construit autour de l'audit une image de modernit et d'efficacit qui provient de
trois principaux facteurs: la richesse du concept, l'exigence de comptences tendues des
auditeurs et la rigueur de la mthode.
L'audit est un mtier et une fonction dsormais part entire dans un grand
nombre d'entreprises et d'organismes de par le monde.
Au mme titre que d'autres professions ou fonctions voisines, souvent plus rpandues ou
mieux connues, tels le contrle de gestion, l'organisation, le conseil conomique; l'audit
prsente les caractristiques suivantes:
C'est une profession organise rpondant des normes comptables et juridiques
trs strictes.
C'est un outil structur, au service d'une Direction Gnrale ou d'un comit d'audit
reprsentant les intrts des actionnaires et des tiers.
C'est une fonction de contrle, au dpart, qui s'oriente de plus en plus vers un rle
de consulting dans la mesure o elle permet l'entreprise de suivre le chemin le
plus efficace et le plus efficient pour atteindre les objectifs fixs.
Historiquement parlant, la fonction de contrle s'est dveloppe avec la taille et la
complexit des organisations. Ne avec la rvolution industrielle, elle s'est impose dans
l'entreprise lors de l'application de la division scientifique du travail, vritable innovation
l'poque du Taylorisme. La mise en place d'un systme de contrle des activits de
chaque fonction s'est avre indispensable pour piloter l'entreprise et atteindre les
objectifs prvus.
3
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Contrler, c'est vrifier que les rgles dictes sont respectes et les ordres donns
appliqus. Cependant, le contrle du point de vue de l'approche d'audit moderne ne se
limite aucunement la simple vrification mais s'tend galement la notion de matrise
des procdures comptables, juridiques et financires.
Premire organisation mondiale de services intellectuels, Price WaterHouse
Coopers regroupe actuellement 155.000 collaborateurs implants dans 150 pays uvrant
chaque jour pour des entreprises de toutes tailles dans le monde, sur des marchs
mergents et en pleine croissance.
Si Price WaterHouse Coopers est leader aujourdhui dans son secteur dactivit,
cest bien grce son expertise internationale et son exprience tendue de longue date.
En effet, sa cration remontant au 19
me
sicle, la firme implante en 1903 en Afrique lun
des tous premiers bureaux du rseau de Price WaterHouse Coopers tel quil existe
aujourdhui, et en 1960, elle dbute ses activits au Maroc o elle est la premire firme
du genre stre implante.
Grce cette longue prsence, le personnel de la bote a acquis une exprience
considrable dans le domaine de laudit et du conseil.
Price WaterHouse Coopers propose une gamme complte de ses services ses
clients pour accrotre leurs valeurs ajoutes, matriser les risques et amliorer la
performance de leurs activits. Ces services sont organiss autour de quatre grands
mtiers : laudit financier, le conseil et le management, la corporate finance et le conseil
aux PME. De plus, les cabinets davocats correspondants conseillent les entreprises dans
le domaine juridique et fiscal. Les mtiers de Price WaterHouse Coopers sexercent en
toute indpendance auprs de grandes socits internationales, de bailleurs de fonds, de
gouvernements ainsi que de socits nationales et locales.
Laudit tant lexamen des systmes dune organisation en gnral et des
systmes de contrle en particulier par un personnel indpendant utilisant une
4
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
mthodologie spcifique base sur un rfrentiel et axe sur une information du pass, du
prsent et du futur dans le but de dgager les dficiences et damliorer les performances
desdits systmes , on conoit dans la ralit une trs grande varit possible daudits.
En effet, tout phnomne, ou toute information y tant relative, peut tre dfini comme
objet daudit. Il nest par ailleurs pas vident de dterminer une vritable typologie de ces
varits daudit, la plupart dentre eux pouvant ressortir de la dfinition gnrale prcite.
Ainsi, plusieurs audits peuvent tre effectus et nous pouvons distinguer laudit interne,
laudit social, laudit commercial, ou encore laudit financier.
5
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
La rgularit et la sincrit des comptes font partie des proccupations majeures
de tout dirigeant vu limpact de celles-ci sur limage de lentreprise lgard des bailleurs
de fonds, clients, actionnaires et autres tiers.
En effet, compte tenu des impratifs du march lis la transparence de linformation
financire, les responsables des entreprises cherchent ce que leurs comptes refltent
fidlement la situation financire, le rsultat et le patrimoine de leurs entreprises.
Les dirigeants, conscients de limportance de ces contraintes, se voient toujours
dans la ncessit de sassurer, vers la fin de lexercice comptable, de la cohrence de
lensemble des comptes ainsi que des tats financiers avant leur prsentation dfinitive.
A cet effet, lexamen analytique constitue un moyen efficace pour rpondre cet objectif.
Il sagit dune technique fonde sur lexistence dune relation logique entre les donnes
comptables, et par consquent, contribue fournir des lments de preuve que les
donnes provenant du systme comptable sont compltes et fiables.
Cette technique permet au dirigeant, soucieux de la fiabilit des tats financiers qui seront
produits la fin de lexercice, dacqurir la conviction quils sont rguliers, sincres et
donnent limage fidle du rsultat des oprations de lexercice, ainsi que de la situation
financire et du patrimoine de la socit.
Dailleurs, cette technique est largement utilise dans laudit. Nous, y avons
recours diffrents stades de nos missions. En effet, obligs deffectuer les travaux de
vrifications par sondage, nous nous y rfrons souvent pour mieux connatre
lentreprise, pour identifier les risques potentiels et pour collecter des lments probants
sur la vraisemblance ou sur le caractre raisonnable des comptes individuels ou des
groupes de comptes.
6
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Lors de la planification d'une mission d'audit, nous effectuons un examen
analytique pour obtenir une comprhension gnrale du contenu des comptes et des
changements significatifs survenus par rapport l'exercice prcdent, au niveau des
rgles et mthodes comptables de l'entreprise ou de ses oprations. Cet examen
analytique nous fournit un aperu de la liquidit et de la rentabilit de l'entreprise et nous
permet de dterminer le seuil de signification pralable. Nous recherchons des variations
inhabituelles dans les comptes ou au contraire l'absence de variations attendues, afin
d'identifier les risques accrus d'inexactitude significative.
La revue analytique nous permet en outre de mieux comprendre l'activit de l'entreprise
et d'identifier les lments qui conduisent s'interroger sur sa capacit poursuivre son
exploitation. Elle apparat donc comme un outil privilgi de dtection des risques
daudit.
Lvaluation du contrle interne peut savrer tre une technique incontournable
pour valuer et rduire les risques qui peuvent menacer les objectifs de la direction
gnrale. Suite cette valuation, un plan dactions est propos afin de permettre
lentreprise datteindre ses buts de manire rapide et efficace.
Le choix de ce sujet se justifie par l'intrt de ces outils pour l'auditeur. En effet,
un examen analytique et un contrle interne bien tablis permettent de dceler les risques
qui devront tre investigus et dtermineront ainsi le plan dactions mettre en uvre par
la Direction Gnrale pour une meilleure gestion des risques.
Notre travail sera prsent en trois parties :
Objectifs, mthodologie, techniques et limites de la revue analytique des comptes;
Cas pratique dune revue analytique : lentreprise Luxor;
Contrle interne et plan dactions mettre en uvre.
7
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Par souci de confidentialit, les chiffres apparaissant sur la revue analytique qui
vous seront communiqus nont aucun rapport avec les chiffres rels. Toutefois, jai
veill ce que la cohrence globale de ces chiffres soit respecte.
8
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
PARTIE I: OBJECTIFS, MTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LIMITES DE
LEXAMEN ANALYTIQUE DES COMPTES................................................................12
SECTION I : Intrts et objectifs de la revue analytique..................................................13
I - Intrts de la revue analytique.......................................................................................13
1 Gnralits.......................................................................................................13
2 - Rgles et mthodes comptables........................................................................13
3 - Continuit dexploitation..................................................................................14
II - Objectifs de la revue analytique...................................................................................14
1 - Procdures analytiques appliques lors de la planification de la mission........15
2 - Procdures analytiques utilises en tant que contrles substantifs...................15
3 - Procdures analytiques appliques comme moyen de revue de la cohrence
densemble des comptes lors de la phase finale de laudit....................................17
SECTION II : Mthodologie de mise en uvre de lexamen analytique..........................18
I - Collecte des informations financires et non financires..............................................18
II - Comparaison des informations....................................................................................19
III - Analyse des rsultats..................................................................................................22
1 - Rsultats des premires comparaisons..............................................................22
2 - Analyse plus approfondie.................................................................................23
3 - Variations impossibles expliquer...................................................................23
4 - Consquences des rsultats de la revue analytique sur le plan daudit.............24
SECTION III : Techniques de lexamen analytique..........................................................25
I - Classification des techniques de la revue analytique....................................................25
1 - La revue de vraisemblance...............................................................................25
2 - La comparaison des donnes absolues.............................................................26
3 - La comparaison des donnes relatives..............................................................26
4 - Les analyses de tendances................................................................................27
II - Principaux ratios utiliss..............................................................................................28
1 - Cot de production des ventes / stocks et en cours..........................................28
9
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2 - Produits dexploitation/Crances dexploitation..............................................29
3 - Achats/Fournisseurs dexploitation..................................................................29
4 - Frais financiers/Chiffre daffaires.....................................................................30
5 - Capitaux propres/Actif immobilis...................................................................30
6 - Capitaux propres/Dettes....................................................................................30
7 - Actif circulant court terme / dettes court terme...........................................31
SECTION IV : Limites de lexamen analytique................................................................32
PARTIE II: CAS PRATIQUE D'UNE REVUE ANALYTIQUE DES COMPTES:
L'ENTREPRISE "LUXOR"...............................................................................................34
SECTION I : Lentreprise Luxor dans son secteur............................................................35
I - Lhistoire du ciment......................................................................................................35
1 - Linvention du ciment.......................................................................................35
2 - Le ciment au XXe sicle...................................................................................36
II - Procd de fabrication du ciment.................................................................................37
1 - La carrire.........................................................................................................37
2 - Le broyage cru et la cuisson.............................................................................37
3 Le. broyage du ciment et lexpdition.............................................................37
III Lentreprise Luxor.....................................................................................................37
1 - Faits marquants de lanne 2005......................................................................38
2 - Une large gamme de produits...........................................................................38
SECTION II : Examen analytique de la socit Luxor......................................................40
I - tats de synthse de lentreprise...................................................................................40
1 - Bilan Actif........................................................................................................40
2 Bilan Passif......................................................................................................41
3 Comptes de rsultats........................................................................................42
II Examen analytique des comptes de bilan au 31/12/05, site de Tta...........................43
1 Passif................................................................................................................43
2 Actif.................................................................................................................45
3 - Comptes de rsultats.........................................................................................50
III - Conclusion de ltude.................................................................................................56
10
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
PARTIE III: CONTRLE INTERNE ET PLAN DACTIONS METTRE EN
UVRE.............................................................................................................................57
Section I : Diagnostic des systmes de contrle................................................................59
I - Identification des objectifs de la DG.............................................................................59
II - valuation des principaux risques (pouvant affecter les objectifs de la Direction
Gnrale)............................................................................................................................59
1 - Dfinition des risques.......................................................................................60
2 - numration des risques...................................................................................61
III - valuation du systme de contrle interne.................................................................63
1 - valuation de lenvironnement de contrle interne..........................................63
2 - valuation des systmes de contrles devant couvrir les risques menaant les
objectifs du client...............................................................................................................66
Section II : Plan dactions mettre en uvre par la socit Luxor..................................72
I - Plan dactions visant au renforcement gnral du contrle interne..............................72
II - Plans dactions visant couvrir les risques identifis qui menacent les objectifs de
lentreprise X.....................................................................................................................74
III - Plan dactions visant la mise en place de manuels de procdures utilisateurs...........76
IV - Mise en place dun systme de scoring......................................................................78
1 - Les principaux lments dun score.................................................................79
2 - Les avantages du scoring..................................................................................80
3 - Les objectifs stratgiques du scoring................................................................80
4 - La construction dun score et la stratgie de recouvrement..............................80
V - Matrise du systme dinformation..............................................................................81
1 - Plan destin assurer la matrise de ses oprations informatiques...................82
2 - Plan destin dfinir la stratgie informatique de lentreprise Luxor..............84
VI - La gestion des ressources humaines (la mise en place dun modle de carrire)......86
1 - Dfinition du modle........................................................................................86
2 - Comment mettre en uvre ce modle?.............................................................87
Recommandations............................................................................................................89
Conclusion........................................................................................................................91
11
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
12
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
SECTION I : INTRTS ET OBJECTIFS DE LA REVUE
ANALYTIQUE
I - Intrts de la revue analytique
1 - Gnralits
En rgle gnrale, l'examen analytique est ax sur les comptes regroups en
grandes masses et sur leurs corrlations.
Il est inutile de procder une analyse dtaille des facteurs qui sous-tendent les soldes
comptables, dans la mesure o l'examen analytique ne constitue pas une procdure de
validation destine nous procurer un niveau de confiance.
L'examen analytique consiste gnralement en une analyse des variations des soldes
laquelle s'ajoute celle des tendances et des ratios :
L'analyse des variations consiste comparer les variations du solde d'un compte
avec la variation attendue de ce solde et ventuellement comparer les variations
du solde d'un compte sur une priode donne (analyse des tendances);
L'analyse des ratios permet de comparer les corrlations entre des comptes avec les
corrlations attendues et peut se faire sur une priode donne au sein de l'entreprise
ou, plus rarement, elle peut porter sur le secteur d'activit.
2 - Rgles et mthodes comptables
Lorsque nous effectuons une revue analytique, nous devons tre attentifs toute
indication portant croire que l'entreprise a adopt ou devrait adopter de nouvelles rgles
et mthodes comptables. De tels changements ont gnralement t identifis lors de la
phase de comprhension de l'activit du client. Lorsque nous procdons l'analyse des
informations financires intrimaires, nous devons vrifier qu'elles sont bien tablies sur
les bases que l'on s'attend trouver.
Par exemple, si nous avons identifi un changement de rgles et mthodes comptables au
cours de notre phase de comprhension de l'activit du client, nous devons vrifier que
13
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
les comptes ont t tablis conformment notre comprhension des nouvelles rgles et
mthodes comptables.
3 - Continuit dexploitation
Lors de l'examen analytique, nous devons considrer le risque que l'hypothse de
continuit d'exploitation sous-jacente la prparation des comptes puisse ne plus tre
approprie. Les informations financires que nous utilisons pour effectuer notre revue
analytique indiquent parfois une tendance la dgradation de l'exploitation ou de la
situation financire et/ou l'incapacit du client honorer son passif exigible.
Si nous dtectons ce type de tendance, suffisamment marqu pour mettre srieusement en
doute la continuit de l'exploitation, nous pouvons avoir besoin d'obtenir des
informations supplmentaires pour dterminer nos actions futures et leur incidence sur
notre plan global, y compris sur la nature, le calendrier et l'tendue de nos travaux. Nous
devons galement, ds ce stade, discuter de nos proccupations avec la Direction
Gnrale.
II - Objectifs de la revue analytique
La revue analytique est utilise aux fins suivantes :
Pour aider lauditeur planifier la nature, le calendrier et ltendue des autres
procdures daudit;
En tant que contrle substantif lorsquil est plus efficace que dautres contrles
ponctuels pour rduire le risque de non dtection relatif des assertions spcifiques
sous-tendant ltablissement des comptes;
Comme moyen de revue de la cohrence densemble des comptes lors de la phase
finale de la mission.
14
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
1 - Procdures analytiques appliques lors de la planification de la
mission
Lauditeur met en uvre des procdures analytiques lors de la planification de sa
mission afin de mieux apprhender les activits de lentit et didentifier les domaines
prsentant un risque potentiel. Ces procdures peuvent rvler des aspects que le rviseur
navait pas identifi et laident dterminer la nature, le calendrier et ltendue des autres
procdures daudit.
Les procdures analytiques appliques lors de la planification de la mission se
fondent sur des donnes comptables, financires et non financires.
2 - Procdures analytiques utilises en tant que contrles substantifs
Le degr de confiance que lauditeur peut accorder aux contrles substantifs pour
rduire le risque de non dtection relatif certaines assertions spcifiques sous-tendant
ltablissement des comptes, peut sappuyer sur des contrles ponctuels, sur des
procdures analytiques ou sur une combinaison des deux. Pour dterminer les procdures
analytiques retenir pour un objectif daudit donn, le rviseur apprcie lefficience
prsume des procdures en vigueur pour rduire le risque de non dtection relatif des
assertions retenues sous-tendant ltablissement des comptes.
En rgle gnrale, lauditeur senquiert auprs de la direction de la disponibilit et
de la fiabilit des informations ncessaires lapplication des procdures analytiques et
des rsultats de toutes les procdures de mme nature mises en uvre lintrieur de
lentit. Il peut en effet savrer efficace dutiliser les donnes analytiques prpares par
lentit, condition de sassurer quelles ont t correctement labores.
Lorsque nous dsirons mettre en uvre des procdures analytiques en tant que
contrles substantifs, nous devons tenir compte dun certain nombre de facteurs tels que :
Les objectifs fixs pour lapplication des procdures analytiques et le degr de
fiabilit de leurs rsultats;
15
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
La nature de lactivit de lentit et la possibilit dutiliser des informations
parcellaires. Par exemple, les procdures analytiques peuvent savrer plus
efficaces lorsquelles sont appliques aux informations comptables et financires
de certaines divisions ou secteurs dactivit dune entit, ou aux comptes de sous-
groupes dune entit diversifie, que lorsquelles sont appliques aux comptes de
lentit dans leur ensemble;
La disponibilit des informations, tant comptables que financires (budgets ou
prvisions) que non financires (nombre dunits produites ou vendues);
La fiabilit des informations disponibles en dterminant par exemple si les budgets
sont prpars avec suffisamment de soin;
La pertinence des informations disponibles. titre dexemple, nous pouvons
dterminer si les budgets refltent des rsultats escompts plutt que des objectifs
atteindre;
Les sources des informations disponibles. Les sources indpendantes lentit sont
en gnral plus fiables que les sources internes. Cest la raison pour laquelle
lenvoi des lettres de circularisation aux partenaires de lentreprise est une
diligence laquelle nous devons nous soumettre en tant quauditeurs;
Le caractre comparable des informations disponibles : par exemple, des donnes
gnrales sur un secteur dactivit peuvent ncessiter dtre retraites pour pouvoir
tre compares avec celles dune entit qui produit et commercialise des biens
prsentant des particularits;
Les connaissances acquises au cours des missions prcdentes, ainsi que la
comprhension de lauditeur quant lefficacit des systmes comptables et de
contrle interne et les types de problmes ayant donn lieu des critures de
redressement au cours des exercices prcdents.
16
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
3 - Procdures analytiques appliques comme moyen de revue de la
cohrence densemble des comptes lors de la phase finale de laudit
Lauditeur applique des procdures analytiques lors de la phase finale de laudit
pour tirer une conclusion sur la cohrence densemble des comptes en sappuyant sur sa
connaissance gnrale de lentit et du secteur dactivit. Le rsultat de ces procdures
vise corroborer les conclusions auxquelles lauditeur est parvenu au cours de laudit des
comptes ou de postes des comptes et laident parvenir une conclusion gnrale quant
labsence danomalies significatives dans ces comptes. Toutefois, elles peuvent
galement servir identifier des domaines devant faire lobjet de procdures
complmentaires.
17
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
SECTION II : MTHODOLOGIE DE MISE EN UVRE DE
LEXAMEN ANALYTIQUE
Lexamen analytique prliminaire se ralise en trois tapes:
o Collecte des informations financires et non financires;
o Comparaison des informations;
o Analyse des rsultats.
I - Collecte des informations financires et non financires
Pour effectuer l'examen analytique, on doit obtenir les informations financires les
plus rcentes prpares par le client. On peut gnralement effectuer cette revue
analytique en adoptant pour ces informations un niveau de regroupement comparable
celui retenu pour la prsentation des comptes.
Dans les entreprises intervenant sur des secteurs d'activit trs diffrents ou
possdant des filiales importantes ou plusieurs tablissements, nous pouvons envisager
d'obtenir des informations financires pour chaque unit oprationnelle.
Dans certains cas, il peut savrer utile dobtenir des informations financires
trimestrielles, voire mensuelles, ou encore des prcisions supplmentaires sur certains
comptes (ex : par catgorie de stock).
Lorsque l'entreprise n'tablit pas de situation intermdiaire, nous pouvons tre amens
utiliser des informations financires intrimaires agrges au niveau de la balance
gnrale.
Bien que ces informations financires intrimaires risquent d'tre limites, nous pouvons
malgr tout effectuer un examen analytique sachant que les conclusions que nous en
tirerons seront tout aussi limites.
18
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
moins que l'entreprise ne soit dans sa premire anne d'activit, on dispose en
gnral des informations financires de l'exercice prcdent, prsentes de faon
comparable celles de l'exercice considr. On peut obtenir les donnes intrimaires de
l'exercice prcdent pour les comparer avec celles de l'exercice considr, ou on peut
encore annualiser les donnes intrimaires de l'exercice considr pour les comparer
celles ressortant la clture de l'exercice prcdent. Lorsque nous annualisons les
donnes intrimaires, on doit tenir compte des effets de saisonnalit sur le cycle
d'exploitation de l'entreprise.
On peut galement obtenir le budget, les prvisions du client pour lexercice
considr ou tout autre document, si on estime que ces tats ont t prpars sur la base
dhypothses raisonnables. Le cas chant, on utilise ces informations pour dterminer
les montants auxquels on peut sattendre pour lexercice considr.
En plus des informations financires, certaines informations non financires
peuvent tre utiles pour effectuer un examen analytique. Celles-ci permettent
habituellement de dterminer si les informations de l'exercice considr sont cohrentes
avec notre comprhension gnrale de l'activit du client.
Par exemple, les informations pouvant tre utilises par la direction comprennent la
capacit de production, les quantits achetes et vendues et les statistiques sur les
effectifs.
II - Comparaison des informations
Nous utilisons les informations obtenues pour les comparer celles de l'exercice
prcdent ou au budget de l'exercice considr. L'objectif essentiel de ces comparaisons
est d'identifier les situations susceptibles d'indiquer l'existence d'un risque d'inexactitude
significative.
19
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Pour ce faire on examine :
Les variations inhabituelles dans les comptes ou l'absence de variations prvues.
Par exemple, l'augmentation significative du compte de produits divers sans que nous
ayons identifi des sources de revenus nouvelles ou inhabituelles peut nous amener
nous interroger sur la validit des informations enregistres dans ce compte.
Les variations inhabituelles, ou l'absence de variations prvues, dans les principales
corrlations financires.
Par exemple, l'augmentation significative du compte clients, alors que les ventes n'ont pas
augment dans les mmes proportions, traduit un risque d'erreurs potentielles lies la
validit, la comptabilisation ou l'valuation des crances.
L'augmentation inattendue des marges brutes traduit un risque d'erreurs potentielles dans
les ventes, le cot des ventes et/ou les stocks.
Les principales corrlations financires/non financires.
Les principales corrlations financires/non financires suivantes peuvent tre identifies
partir des informations non financires obtenues lors des travaux de comprhension de
l'activit du client :
- Capacit de production par rapport aux ventes comptabilises et aux variations
de stocks;
- Limites de la capacit de stockage par rapport au montant des stocks.
Si on identifie des soldes ou des corrlations inhabituels ou inattendus sans justification
vidente, on les considre gnralement comme des risques accrus dinexactitude. Par
consquent, on doit identifier les comptes et les erreurs potentielles qui peuvent tre
affects.
Ainsi, cest en analysant les variations des soldes et en compltant cette analyse
par celle des tendances et des ratios quon identifie le plus facilement les fluctuations.
20
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
La dtermination des comparaisons et des mesures effectuer relve du jugement
professionnel et dpend des circonstances. En rgle gnrale, la premire tape consiste
examiner les variations qui sont intervenues entre deux exercices en comparant les
informations de lexercice considr avec celles de lexercice prcdent.
Les comparaisons dans le temps entre les informations financires de lexercice considr
et de lexercice prcdent ncessitent normalement de calculer :
- Les variations montaires des soldes;
- Les variations en pourcentages (entre lexercice considr et les exercices prcdents).
Dans certains cas, on compare les soldes de lexercice avec ceux de plusieurs
exercices prcdents. Cest un moyen souvent utile pour identifier des tendances qui se
dgagent sur un certain nombre dannes.
Par exemple, une lgre diminution de la marge brute peut sembler anodine en soi. On
peut toutefois considrer cette diminution dun autre il, si des diminutions similaires
sont constates au cours de chacun des trois exercices prcdents.
De simples comparaisons entre les soldes de comptes de l'exercice considr et
ceux de l'exercice prcdent peuvent faire ressortir des comptes qui n'taient pas utiliss
auparavant, qui ne le sont plus ou dont les soldes augmentent ou diminuent de manire
significative. Pour dterminer si ces modifications sont indicatrices d'un risque
d'inexactitude, nous les considrons la lumire de notre comprhension actuelle du
client.
Cette comprhension comprend notamment :
L'activit du client et l'environnement dans lequel il volue;
Les informations concernant les modifications intervenues ou prvues dans
l'activit ou les rgles et mthodes comptables, que nous avons pu obtenir lors de
contacts rguliers avec le client depuis la dernire mission d'audit, lors de runions
ou d'entretiens mens avec la direction gnrale pour mettre jour notre
comprhension de l'activit du client.
21
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Ces informations nous donnent en principe une bonne ide gnrale des variations
que nous nous attendons trouver dans la comparaison des informations de l'exercice
considr avec celles de l'exercice prcdent.
Par exemple, nous pouvons nous attendre une augmentation des ventes d'environ X %
par rapport la mme priode de l'exercice prcdent en raison d'une augmentation de la
force de vente.
III - Analyse des rsultats
1 - Rsultats des premires comparaisons
Nous devons examiner les rsultats de nos premires comparaisons pour voir s'ils
sont conformes nos prvisions. Lorsqu'il apparat des fluctuations qui diffrent
sensiblement de celles auxquelles nous nous attendions, nous discutons ces rsultats avec
la direction et dterminons si les explications qu'elle donne des fluctuations sont
plausibles. Ces explications doivent tre cohrentes avec notre comprhension de
l'activit. Nous pouvons tre amens examiner les lments probants si nous jugeons
que cela est ncessaire.
Les investigations que nous menons auprs de la direction sont par nature globales
et ont pour objectif d'une part d'identifier les raisons possibles de ces fluctuations, d'autre
part d'en dterminer l'ventuelle incidence sur la nature, le calendrier et l'tendue de nos
travaux d'audit. Ainsi, ces investigations nous permettent d'obtenir une meilleure
comprhension de l'activit du client et des oprations de l'exercice considr.
En complment de la discussion avec la direction des rsultats de nos premires
comparaisons, nous pouvons mettre en oeuvre d'autres procdures analytiques, soit pour
confirmer la cause des variations prvues, soit, dans le cas des variations imprvues, pour
identifier plus prcisment les lments des comptes ou les soldes de comptes sur
lesquels celles-ci ont une incidence.
22
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2 - Analyse plus approfondie
Nous pouvons, la suite de nos premires comparaisons, effectuer une analyse
plus approfondie des informations financires. En rgle gnrale, cette analyse est
effectue pour nous aider mieux dlimiter la cause d'une fluctuation d'un compte ou
d'un groupe de comptes particulier. Ceci nous permet, dans le cadre de notre valuation
des risques, d'une part de spcifier les risques accrus d'inexactitude par rapport des
comptes et des erreurs potentielles, et d'autre part d'laborer des plans d'audit appropris.
Cette analyse plus approfondie peut notamment comprendre :
Le calcul de mesures et de ratios comme les indicateurs de liquidit, d'activit, de
rentabilit, de levier financier, de productivit et d'valuation. Le choix des
mesures et des ratios appropris calculer relve du jugement professionnel et
dpend des circonstances. Les mesures utiliser sont celles qui sont les plus
adaptes pour identifier les situations indicatrices de risques accrus d'inexactitudes
significatives et celles qui sont les plus pertinentes par rapport la situation ou au
secteur d'activit du client.
Des comparaisons supplmentaires entre les montants comptabiliss au titre de
l'exercice considr et des informations ou des rfrences ("benchmarks")
indpendantes (ex. : montants budgts, branches dactivit similaires, concurrents
ou secteur d'activit).
3 - Variations impossibles expliquer
Lorsque notre examen analytique prliminaire rvle des rsultats imprvus qui ne
sont pas cohrents avec notre comprhension de l'activit et dont les causes ne peuvent
pas tre expliques de manire plausible par la direction ou tre justifies par des
lments probants, nous devons identifier les comptes et erreurs potentielles qui peuvent
tre affects afin de procder des tests de validation cibls.
23
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
4 - Consquences des rsultats de la revue analytique sur le plan daudit
Lexamen analytique peut permettre didentifier aussi bien des risques accrus que
des changements intervenus dans lactivit ou dans les systmes comptables qui peuvent
avoir une incidence sur le plan daudit (ex : nouveaux sites, produits et transactions). Les
informations obtenues peuvent galement indiquer que lhypothse de continuit de
lexploitation risque de ne plus tre approprie et attirer notre attention sur des points qui
peuvent donner lieu des commentaires sur la marche de lentreprise.
On utilise ces informations, en liaison avec notre connaissance de lactivit du
client et notre dtermination du seuil de signification pralable, pour identifier les risques
accrus au niveau des comptes et des erreurs potentielles.
24
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
SECTION III : TECHNIQUES DE LEXAMEN
ANALYTIQUE
Les techniques de lexamen analytique sont nombreuses et varies. Elles peuvent
tre utilises sparment ou dune faon combine. Toutefois, pour essayer de clarifier
ces diffrentes techniques, leurs utilits et leurs limites, nous avons jug utile, dans une
premire partie, de les classer de la manire suivante :
La revue de vraisemblance;
Les comparaisons de donnes absolues;
Les comparaisons de donnes relatives (ratios);
Les analyses de tendances.
Puis, dans une deuxime partie, il sera procd au traitement des principaux ratios que
peut utiliser lauditeur pour raliser un examen analytique.
I - Classification des techniques de la revue analytique
1 - La revue de vraisemblance
La revue de vraisemblance consiste procder un examen critique des
composantes dun solde pour identifier celles qui sont, priori, anormales. A titre
dexemple on peut citer :
Un compte client sans nom;
Une criture dbitrice dans un compte normalement crditeur;
Un libell incohrent;
.
Cet examen critique permet au dcideur de dtecter temps et dexpliciter les anomalies
flagrantes, mais il nest en aucun cas suffisant lui seul pour prouver quun compte ou un
document ne contient pas danomalies. En effet, ce nest pas parce quil ny a pas
danomalies apparentes quil nen existe pas de caches.
25
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2 - La comparaison des donnes absolues
Les donnes absolues sont des donnes considres pour elles-mmes et non par
rapport dautres lments de rfrence.
Ces donnes, prises en tant que telles, peuvent faire lobjet de diverses analyses :
Par rapport la (ou les) priode(s) antrieure(s), pour dterminer si lvolution est
cohrente;
Par rapport un budget, pour savoir si les objectifs fixs ont t atteints;
Par rapport aux mmes donnes dans des entreprises comparables, pour identifier
les particularits de lentreprise.
Ces comparaisons de donnes absolues doivent tre utilises avec prcaution car :
Elles supposent quil existe effectivement une logique dans lvolution dun
compte dune priode lautre;
La cohrence de la variation suppose quil ny a aucune modification dans les
composantes du montant considr;
Les chiffres des entreprises similaires ne sont pas ncessairement tablis sur la base
des mmes principes comptables.
Les conclusions tires de telles comparaisons ne sont fiables que si plusieurs dentre elles
confirment la mme prsomption.
3 - La comparaison des donnes relatives
Les donnes relatives supposent quil existe une relation directe entre une donne
et un lment de rfrence et que cette relation reste fixe. Cette relation est gnralement
calcule sous forme de pourcentage. Ces ratios peuvent tre analyss :
Seuls. Cest le cas par exemple des ratios de structure financire qui peuvent tre
significatifs en tant que tels;
Par rapport la (ou les) priode(s) prcdente(s);
Par rapport au budget;
26
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Par rapport aux statistiques du secteur;
Par rapport des donnes non financires.
La technique des ratios est relativement plus prcise que la technique prcdente dans la
mesure o elle fait rfrence plusieurs donnes de faon indpendante. Toutefois, elle a
ses propres limites qui tiennent :
La difficult de dfinir des relations relles qui existent entre deux donnes (plus
lentreprise est complexe, plus les facteurs susceptibles de modifier cette relation
sont nombreux);
Limpossibilit devant laquelle peut se trouver le dcideur pour expliquer les
causes dune variation anormale si les termes du ratio sont trop larges;
La comparabilit des chiffres de rfrence.
4 - Les analyses de tendances
Les analyses de tendances consistent procder aux diffrentes analyses dcrites
prcdemment, mais en gnral sur des priodes plus longues (plusieurs annes) pour
essayer den tirer des rgles plus prcises sur les relations qui existent entre les donnes
utilises et de prvoir les chiffres de la priode en cours tels quils rsulteraient de
lapplication des ces rgles. On peut, par exemple, analyser la progression des ventes sur
plusieurs exercices pour dterminer un taux de progression normal
Ces analyses de tendances peuvent tre faites de faon purement empirique, ou par
application de techniques statistiques comme les moyennes mobiles, les analyses de
rgression. Divers moyens matriels peuvent assister le dcideur pour lutilisation de
ces techniques : visualisation des tendances sur des graphiques, tableurs
Plus les moyens utiliss pour procder ces analyses de tendances sont bass sur des
rgles statistiques, plus la force probante des rsultats obtenus est grande.
Quelle que soit la technique utilise, cest en fait la cohrence entre les informations
obtenues qui lui donne sa force probante : un ratio ne signifie pas grand chose, mais
27
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
lanalyse de plusieurs ratios aboutissant au mme rsultat permet davoir une confiance
relativement importante dans les rsultats obtenus.
Ainsi, une prsentation et dfinition des principaux ratios qui peuvent tre utiliss
dans le cadre de lexamen analytique feront lobjet dune tude succincte ci-dessous.
II - Principaux ratios utiliss
1 - Cot de production des ventes / stocks et en cours
Ce ratio permet de mesurer le rythme auquel les stocks sont vendus. Un taux de
rotation des stocks exagrment lent peut signifier que les liquidits sont rduites mais
surtout quil y a des risques lis lobsolescence des stocks et leur dtrioration, do
vraisemblablement des problmes de dprciation. Un ralentissement important de ce
ratio peut galement saccompagner de problmes majeurs de stockage (cot, contrle de
quantits).
Un rythme lev de rotation des stocks est galement le signe dune bonne gestion de la
production, toutefois un rythme trop lev peut tre le signe de difficults tenir les
dlais de livraison (risque de litiges avec les clients ou de pertes de contrats), il peut tre
signe de sous valuation des stocks.
Prcautions prendre lors de lanalyse :
Ce ratio doit tre compar la dure moyenne de production qui varie sensiblement
selon le secteur dactivit;
Il est parfois difficile dobtenir des donnes rellement comparables au numrateur
et au dnominateur (absence de comptabilit analytique par exemple);
Il peut tre utile de calculer ce ratio par famille de produits lorsque celles-ci ne sont
pas homognes ou par catgories de stocks.
28
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2 - Produits dexploitation/Crances dexploitation
Ce ratio permet dvaluer le dlai moyen de recouvrement des crances. Il doit
tre compar au dlai moyen normal de crdit accord aux clients. Tout accroissement du
dlai de recouvrement pose le problme des risques de pertes sur crances douteuses ; il
est alors essentiel de vrifier la procdure de relance des clients, et danalyser
lanciennet des crances.
Prcautions prendre lors de lanalyse :
Il peut tre ncessaire de procder par catgories de clients si des conditions
diffrentes sont accordes (grossistes, administrations, particuliers);
Le montant des produits dexploitation doit tre toutes taxes comprises (TTC) pour
tre homogne avec les crances;
Le montant des crances doit incorporer tous les comptes rattachs et les carts de
conversion.
3 - Achats/Fournisseurs dexploitation
Ce ratio permet de mesurer le dlai moyen de rglement des fournisseurs,
compar avec le dlai normal accord par les fournisseurs, il peut tre rvlateur de
difficults financires. Si par ailleurs, ce ratio est nettement moins lev que le ratio
prcdent, il indique que lentreprise nest pas en mesure dobtenir de ses fournisseurs
les mmes dlais que ceux accords ses clients et quelle risque donc de se trouver
court de trsorerie.
Prcautions prendre lors de lanalyse :
Les achats doivent comprendre toutes les catgories de dpenses dont la
contrepartie est en compte fournisseurs dexploitation, ils doivent tre exprims en
TTC.
Le terme fournisseurs inclut tous les comptes rattachs et les carts de
conversion correspondants.
29
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Comme pour les clients, il peut tre souhaitable de raisonner par catgories de
fournisseurs, mais il nest pas toujours facile disoler les charges correspondant
chaque catgorie.
4 - Frais financiers/Chiffre daffaires
Ce ratio est un de ceux qui sont considrs comme rvlateur des difficults
financires des entreprises : il est toutefois intressant de constater que le seuil partir
duquel ce ratio est considr comme alarmant a considrablement volu au cours de la
dernire dcennie. Le dcideur doit donc sinformer rgulirement du niveau comme
normal compte tenu de lactivit de lentreprise.
NB : Les frais financiers doivent inclure ceux relatifs aux redevances de crdit bail.
5 - Capitaux propres/Actif immobilis
Ce ratio permet de mesurer le taux de couverture des emplois fixs par des
ressources permanentes et doit en principe tre suprieur 1.
Prcautions sont prendre lors de lanalyse :
liminer les actifs court terme;
liminer les actifs fictifs (frais dtablissement non amortis);
Comme pour tous les ratios qui font intervenir les immobilisations, le recours au
crdit-bail peut fausser les analyses.
6 - Capitaux propres/Dettes
Ce ratio permet de mesurer lautonomie financire de lentreprise : plus ce ratio
est lev, plus lentreprise est indpendante.
Toutefois, il faut observer, lors de lanalyse, certaines prcautions relatives :
- Certaines activits qui sont chroniquement sous capitalises sans que cela nuise leur
prennit;
30
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
- Des entreprises qui appartiennent des groupes, au secteur nationalis, et bnficiant
de soutiens financiers qui ne sont pas pris en compte par ce ratio.
7 - Actif circulant court terme / dettes court terme
Ce ratio permet de mesurer lendettement court terme et le fonds de roulement
(ratio de liquidit). Cest surtout la tendance de ce ratio qui est significative : une
tendance la baisse indique priori que la socit risque de manquer de fonds de
roulement et davoir des difficults faire face ses obligations, une tendance la hausse
peut tre lindice dun excdent de liquidit.
Pour tre probant, ce ratio doit saccompagner dune analyse du taux de rotation de
chaque composante (stocks, clients, fournisseurs).
31
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
SECTION IV : LIMITES DE LEXAMEN ANALYTIQUE
Lexamen analytique est, comme nous venons de le voir, un outil de dtection des
risques privilgi dans toute mission daudit.
Toutefois, la valeur probante de la revue analytique est limite par certains facteurs
affectant sa capacit dtecter les variations inhabituelles.
En effet, il nest possible didentifier de telles variations que si les donnes analyses
remplissent certains critres.
Le premier critre concerne la comparabilit des donnes : ainsi, si les donnes ne sont
pas constitues sur des bases comparables, il est difficile de dissocier la part de variation
du poste ou du ratio qui est due aux changements de celle qui est due dautres causes.
On peut citer titre dexemple :
- Si les rgles dimputation des oprations ont t modifies dun exercice lautre, les
variations des postes concerns ne pourront pas tre cohrentes avec lexercice
prcdent;
- Si lactivit dune entreprise est essentiellement saisonnire, les principales raisons de
variation du chiffre daffaires dun mois lautre ne permettront pas de dceler les
dcalages de facturations dus des erreurs de sparation des exercices.
Le deuxime critre qui influe sur la capacit de lexamen analytique dtecter des
variations anormales concerne lincapacit de cerner avec prcision les relations
mesurables existant entre les donnes analyses, notamment dans les entreprises qui ne
disposent pas dune comptabilit analytique, ni dun systme de contrle de gestion
suffisamment prcis.
32
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Par ailleurs, si les donnes analyses sont susceptibles dtre influences par un
trop grand nombre de facteurs, il peut se produire des compensations qui cachent des
variations significatives. Lvolution globale des cots de production peut, par exemple,
sembler cohrente alors que des variations sont incohrentes dans certaines de ses
composantes comme la main duvre, les consommations .
33
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
34
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
SECTION I : LENTREPRISE LUXOR DANS SON
SECTEUR
I - Lhistoire du ciment
1 - Linvention du ciment
1817- Une anne historique.
Cette date constitue le point de dpart de ce qui peut tre considr comme le
renouveau de lindustrie de la construction. En ce dbut de XIXe sicle, Louis Vicat
(1876 1861), jeune ingnieur des ponts et chausses de 22 ans mne des travaux autour
des phnomnes dhydraulicit du mlange chaux-cendres volcaniques . Ce liant, dj
connu des Romains, restait jusqualors le seul matriau connu capable de faire prise au
contact de leau.
Louis Vicat fut le premier dterminer de manire prcise les proportions de
calcaire et de silice ncessaires lobtention du mlange, qui aprs cuisson une
temprature donne et broyage, donne naissance un liant hydraulique industrialisable :
le ciment artificiel. Louis Vicat publia le rsultat de ses recherches sans prendre de
brevet.
Les dbuts dune industrie.
En affinant la composition du ciment mis au point par Louis Vicat, lcossais
Joseph Asdin (1778-1855) russit breveter en 1824 un ciment prise plus lente. Il lui
donna le nom de Portland, du fait de sa similitude daspect et de duret avec la roche du
jurassique suprieur que lon trouve dans la rgion de Portland dans le sud de
lAngleterre.
En France, la premire usine de ciment est cre en 1846 Boulogne-sur-Mer, bien
que les tous premiers ciments aient t fabriqus Pouilly en Bourgogne.
35
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Lafarge a fabriqu du ciment partir de 1868, sur son site du Teil dans lArdche, dont il
exploite depuis 1833 le gisement de pierre calcaire pour produire de la chaux.
Mais, le vritable essor de lindustrie du ciment concide avec le dveloppement
des nouveaux matriels de fabrication : four rotatif et broyeur boulets en tte. Ainsi en
1870, il fallait prs de 40 heures pour produire une tonne de clinker contre environ 3
minutes de nos jours.
2 - Le ciment au XXe sicle
Deux dcouvertes importantes marquent le dbut du XXe sicle. Toutes deux sont
signes Luxor.
Cest tout dabord la mise en vidence du principe de fabrication du ciment blanc,
caractris par lemploi du kaolin, exempt doxyde de fer, en lieu et place de largile.
Mais cette diffrence de composition nentrane aucune volution des caractristiques
intrinsques du matriau qui offre les mmes capacits de rsistance quun ciment gris
comparable.
Lanne 1908 voit la dcouverte du Ciment Fondu, le premier aluminate de
calcium industriel, fabriqu partir de calcaire et de bauxite. Cette dcouverte est le fait
de Jules Bied, directeur du Laboratoire de Recherche de Luxor, fond en 1887, qui est le
plus ancien centre de recherche au monde dans l'industrie cimentire. Rsistant aux
agents agressifs et aux hautes tempratures, le ciment alumineux savre bientt un
matriau aux multiples proprits, utilisable comme liant hautes performances ou
comme ractif chimique dans des applications trs varies. Aujourdhui, les aluminates
de calcium sont la pointe de dveloppements technologiques de la construction et sont
lorigine de nombreux produits techniques tels que mortiers spciaux, btons
rfractaires
36
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
II - Procd de fabrication du ciment
1 - La carrire
Les matires premires qui entrent dans la fabrication du ciment, essentiellement
le calcaire et largile, sont extraites de la carrire par abattage. Elles sont ensuite
concasses et transportes lusine o elles sont stockes et homognises.
2 - Le broyage cru et la cuisson
Un broyage trs fin permet dobtenir une farine crue, qui est ensuite prchauffe
et passe au four. Une flamme atteignant 2000C porte la matire 1500C, avant quelle
ne soit brutalement refroidie par soufflage dair. Aprs cuisson de la farine, on obtient le
clinker, matire de base ncessaire la fabrication de tout ciment.
3 - Le broyage du ciment et lexpdition
Le clinker et le gypse sont broys trs finement pour obtenir un "ciment pur". Des
constituants secondaires sont galement additionns pour obtenir des ciments composs.
Enfin, les ciments stocks dans des silos sont expdis en vrac ou en sacs vers leurs lieux
de consommation.
III Lentreprise Luxor
N1 mondial du ciment, Luxor a conu une offre de produits diversifie
lintention des professionnels de la construction. Cest ainsi que la branche Ciment
bnficie dune forte prsence internationale.
Les socits du Groupe sont implantes dans 43 pays. Le groupe compte 114 cimenteries,
20 stations de broyage de clinker et 6 stations de broyage de laitier dans le monde (140
sites industriels).
37
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Luxor propose des gammes de ciments, de liants hydrauliques et de chaux pour la
construction, la rnovation et les travaux publics plus de 50 000 clients dans le monde.
En 2005, le groupe compte 38200 collaborateurs.
1 - Faits marquants de lanne 2005
Lanne 2005 aura t une anne marque par la croissance. Dans un environnement
globalement favorable, ce sont les amliorations de performance qui ont port la hausse
des rsultats de la branche.
La fiabilit des usines sest amliore, engendrant une croissance des volumes vendus
et une meilleure utilisation des capacits.
La comptitivit des produits sur les diffrents marchs a permis de relever les prix,
afin de compenser les hausses de cots des facteurs.
La marge oprationnelle de la branche est reste stable, preuve de la capacit
industrielle de cette activit contenir la forte hausse en 2005 des cots de lnergie
grce la politique nergtique et aux progrs de performance.
2 - Une large gamme de produits
Pour rpondre aux besoins des clients, la gamme des ciments Luxor comprend :
Les ciments Portland :
Il sagit de matriaux de construction de base efficaces, conomes, de qualit et
polyvalents, utiliss notamment dans les produits prfabriqus et prts lemploi, dans le
bton hautes performances et dans les mortiers.
Les ciments composs :
Ils reprsentent une large gamme de produits, dont presque tous sont utiliss pour des
applications bton aux proprits particulires, telles qu'une permabilit rduite, une
plus grande force de rsistance, une meilleure exploitabilit, une bonne rsistance aux
sulfates et aux milieux naturels agressifs, un pouvoir de placement et une qualit de
finition suprieures (pour les fondations, ponts, routes, trottoirs).
38
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Les ciments au laitier :
Ils sont composs gnralement 100 % de poudre de sable de laitier, ces ciments
servent amliorer lexploitabilit et la "pompabilit" du bton plastique, donner au
bton endurci une activit de rsistance leve 28 jours, et rduire la permabilit et la
chaleur due lhydratation du ciment.
Les ciments spciaux :
Ce sont, par exemple, des ciments pour forages ptroliers, ayant une consistance unique
leur permettant dtre un excellent retardateur de prise et conservateur de fluidit ; ou des
liants hydrauliques conus pour la stabilisation des sols et la ralisation de couches de
forme.
Les ciments pour la maonnerie et les mortiers de ciment :
Ils sont fabriqus partir de procds scientifiques et grce des formulations qui
mlangent des ingrdients de grande qualit, ces produits offrent une gamme complte de
solutions pour des applications trs courantes telles que les briques en bton, les carreaux,
les couches denduit, le stuc, les tuiles joints, etc.
Les ciments blancs
Ils sont utiliss pour des ralisations architecturales en bton caractrises par des
finitions de surface uniformes, blanches ou aux couleurs chaudes ou claires.
39
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
SECTION II : EXAMEN ANALYTIQUE DE LA SOCIT
LUXOR
I - tats de synthse de lentreprise
1 - Bilan Actif
Variation
2004 2005
Valeur %
222 Brevets, marques, droits et valeurs similaires 4 380 4 380 0 0%
223 Fonds commercial 50 000 50 000 0 0%
282 Amortissement des immobilisations incorporelles -4 380 -4 380 0 0%
22 Immobilisations incorporelles nettes 50 000 50 000 0 0%
231 Terrains 13 800 13 800 0 0%
232 Constructions 153 912 156 294 2 382 2%
233 Installations techniques, matriels et outillages 963 897 973 086 9 189 1%
234 Matriels de transport 1 750 1 750 0 0%
235 Mobilier, matriels de bureau et amnagements divers 10 795 10 878 83 1%
238 Autres immobilisations corporelles 8 068 9 176 1 108 14%
239 Immobilisations en cours 55 044 114 758 59 714 108%
283 Amortissement des immobilisations corporelles -705 536 -779 886 -74 350 11%
23 Immobilisations corporelles nettes 501 730 499 856 -1 874 0%
241 Prts au personnel 4 824 5 456 632 13%
248 Crances / titres non consolids 7 136 7 152 16 0%
24 Crances long terme 11 960 12 608 648 5%
2 Comptes d'actif immobilis 563 690 562 464 -1 226 0%
3121 Matires premires 4 878 3 606 -1 272 -26%
3122 Matires et fournitures consommables 84 075 60 646 -23 429 -28%
3123 Emballages 2 083 2 333 250 12%
3128 Toiles filtrantes 749 1 661 912 122%
312 Matires et fournitures consommables 91 785 68 246 -23 539 -26%
3912 Provision pour dprciation des matires et fournitures -4 228 -4 228
313 Farines / Cru dos 1 058 673 -385 -36%
314 Clinker 9 853 1 534 -8 319 -84%
315 Produits finis 3 780 2 695 -1 085 -29%
31 Stocks 106 476 68 920 -37 556 -35%
0
341 Fournisseurs dbiteurs, avances et acomptes 624 2 528 1 904 305%
342 Clients 41 687 43 262 1 575 4%
3942 Provision sur clients domestiques -7 235 -6 839 396 -5%
343 Personnel dbiteur 516 296 -220 -43%
345 tat dbiteur 7 574 6 173 -1 401 -18%
348 Autres dbiteurs 1 886 1 064 -822 -44%
349 Comptes de rgularisation actif 1 790 1 940 150 8%
34 Crances de l'actif circulant 46 842 48 424 1 582 3%
3 Comptes d'actif circulant (Hors trsorerie) 153 318 117 344 -35 974 -23%
514 banques, TG et Chques postaux dbiteurs -3 391 9 993 13 384 -395%
516 Caisse 269 120 -149 -55%
51 Trsorerie Actif -3 122 10 113 13 235 -424%
Total actif 713 886 689 921
40
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2 Bilan Passif
Variation
2004 2005
Valeur %
Rsultat de l'exercice 336 764 386 115 49 351 15%
15 Provision charges rpartir 5 843 5 843 #DIV/0!
1601 Comptes de liaisons inter-tablissements Ttouan 280 867 197 260 -83 607 -30%
1602 Comptes de liaisons inter-tablissements Ttouan 7 042 -2 377 -9 419 -134%
1603 Comptes de liaisons inter-tablissements Sige 0
16 Comptes de liaisons 624 673 586 841 -37 832 -6%
1 Comptes de financement permanent 624 673 586 841 -37 832 -6%
4411 Fournisseurs 18 264 16 680 -1 584 -9%
4413 Frs. Retenue de garantie 9 9 0 0%
4415 EAP 27 251 3 857 -23 394 -86%
4417 FNP 11 762 26 253 14 491 123%
441 Fournisseurs et comptes rattachs 57 286 46 799 -10 487 -18%
443 Personnel crditeur 7 885 5 180 -2 705 -34%
444 Organismes sociaux 2 550 3 047 497 19%
445201 tat, IGR 667 721 54 8%
445202 tat, patente 77 77 0 0%
445205 Retenue la source 241 226 -15 -6%
445206 Extraction de carrire 2 109 2 109 0 0%
445230 tat, taxe sur ciment 3 861 4 521 660 17%
4453 tat, IS payer
4455 tat, TVA facture 4 4
4456 tat, TVA due 9 032 9 229 197 2%
4457 tat, impts et taxes payer 137 97 -40 -29%
4458 tat, autres comptes crditeurs 0
445 tat crditeur 16 124 16 984 860 5%
4481 Fournisseurs d'immobilisations 4 759 30 652 25 893 544%
4488 Crditeurs divers 609 404 -205 -34%
448 Autres cranciers 5 368 31 056 25 688 479%
449 Comptes de rgularisations 14 14
44 Dettes du passif circulant 89 213 103 080 13 867 16%
4 Comptes de passif circulant 89 213 103 080 13 867 16%
Total passif 713 886 689 921
41
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
3 Comptes de rsultats
Variation
2004 2005
Valeur %
6121 Achats inter tablissement blanc 2 188 6 928 4 740 217%
6122 Rechange mcanique 0 0 #DIV/0!
6123 cart rception facture 4 1 -3 -75%
6124 Consommation de Matires premires 138 472 153 248 14 776 11%
6125 Achats non stocks de matires et fournitures 64 347 66 560 2 213 3%
6126 Achats de prestations de services 20 219 22 945 2 726 13%
6129 RRR -24 -24 #DIV/0!
6128 Autres achats sur exercices antrieurs 15 -18 -33 -220%
612 Achats consomms de matires et fournitures 225 245 249 640 24 395 11%
6133 Entretiens et rparations 8 047 8 570 523 6%
6134 primes d'assurances 3 054 3 692 638 21%
6135 Personnel intrimaire externe 74 66 -8 -11%
6136 Autres honoraires 777 809 32 4%
613 Autres charges externes 11 952 13 137 1 185 10%
614 Autres charges externes 12 581 15 194 2 613 21%
616 Impts et taxes 18 159 14 628 -3 531 -19%
617 Charges de personnel 50 084 50 444 360 1%
618 J etons de prsence 17 0 -17 -100%
619 Dotations d'exploitation 84 562 91 066 6 504 8%
61 Charges d'exploitation 402 600 434 109 31 509 8%
7121 Vente de biens et services produits 750 467 833 109 82 642 11%
7124 Vente services Maroc 466 466 #DIV/0!
7125 Vente de services l'tranger 0 0 #DIV/0!
7127 Vente et produits accessoires 15 564 549 3660%
7129 RRR accordes sur vente -1 241 -196 1 045 -84%
712 Vente de biens et de services produits 749 241 833 943 84 702 11%
713 Variation de stock -4 322 -9 678 -5 356 124%
718 autres produits d'exploit exercice antrieur 7 7 #DIV/0!
719 Reprises d'exploitation. Transfert de charges. 499 689 190 38%
71 Produits d'exploitation 745 418 824 954 79 536 11%
Rsultat d'exploitation 342 818 390 845 48 027 14%
631 Charges d'intrts 0 #DIV/0!
633 Pertes de changes 364 571 207 57%
63 Charges financires 364 571 207 57%
733 Gains de change 99 67 -32 -32%
7381 Intrts des prts 325 41 -284 -87%
7384 Revenus sur Titres et valeurs de placements 2 -2 -100%
739 reprise de provisions pour R&C 0 #DIV/0!
73 Produits financiers 426 108 -318 -75%
Rsultat financier 62 -463 -525 -847%
Rsultat courant 342 880 390 382 47 502 14%
651 VNA sur immobilisations cdes 22 22 #DIV/0!
658 Autres charges non courantes 6 496 5 431 -1 065 -16%
659 Dotations non courantes 0 #DIV/0!
65 Charges non courantes 6 496 5 453 -1 043 -16%
751 Produits de cession des immobilisations 0 #DIV/0!
757 Reprises sur subventions d'investissement 0 #DIV/0!
758 Autres produits non courants 380 329 -51 -13%
759 Reprises des provisions rglementes 857 857 #DIV/0!
75 Produits non courants 380 1 186 806 212%
Rsultat non courant -6 116 -4 267 1 849 -30%
Rsultat 336 764 386 115 49 351 15%
42
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
II Examen analytique des comptes de bilan au 31/12/05, site
de Ttouan
1 Passif
Il nexiste pas de comptes de capitaux propres puisquil sagit des tats de
synthse relatifs un site li comptablement au sige avec un compte de liaison.
1.1 - Provision pour charges rpartir (5 843 KDH au 31/12/05; 0 KDH au 31/12/04;
Variation : + 5 843 KDH)
Elle correspond la provision pour rhabilitation de carrires passe au niveau du
sige en 2004 (et transfre par compte de liaison Ttouan en 2005) pour un montant de
6200 KDH. La dotation de 2005 est de 500 KDH. De cette provision ont t repris 856
KDH correspondant aux charges relles de lanne.
1.2 - Fournisseurs et effets payer (46 800 KDH au 31/12/05; 57 286 MDH au
31/12/04; Variation : - 10 487 KDH)
Le poste fournisseurs se compose essentiellement des comptes suivants :
31/12/04 31/12/05 Variation
Fournisseurs (Frs) 18 264 16 680 -1 584
Frs retenue de garantie 9 9 0
Frs - Effets Payer (EAP) 27 251 3 857 -23 394
Frs - Factures Non Parvenues (FNP) 11 762 26 253 14 491
L'analyse du dlai de rglement fournisseurs, se prsente comme suit:
31/12/2004 31/12/2005
Fournisseurs et comptes rattachs
dont on dduit les FNP 45 524 20 546
Consommations 225 245 249 639
Autres charges 24 596 28 331
Variation de stock 1 085 -33 328
Total charges (HT) - FNP 239 164 218 389
Total charges (TTC) 286 997 262 067
Dlai de rglement
57 28
43
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Cette baisse du dlai de rglement moyen sexplique par les importations du coke
(matire premire) qui ne sont plus payes par effet (de 90 150 jours) mais au comptant.
Ceci fait baisser de faon significative le dlai de rglement moyen des fournisseurs.
D'aprs le management, la rduction du dlai fournisseur permet au groupe de bnficier
de prestations de qualit et de pouvoir ngocier des escomptes avec ses fournisseurs.
Le compte FNP est analys en 2005. La socit est en train d'apurer les soldes
anciens ou en double emploi. Daprs nos tests sur les FNP au 31/12/2005 les montants
anciens rgulariser sont estims 690 KDH. Le risque sur les factures non parvenues
reste donc limit.
1.3 - Personnel crditeur et organismes sociaux (8 227 KDH au 31/12/05; 10 435
MDH au 31/12/04; Variation : - 2 208 KDH)
Le compte personnel et organismes sociaux est pass de 10 435 KDH 8 227
KDH, soit une baisse de 2 208 KDH correspondant essentiellement leffet conjugu de
la baisse des comptes dpts pargne et des caisses de secours de 0,8 MDH, de la baisse
des retenues de charge de personnel payer pour 1,6 MDH et de la hausse des autres
provisions pour assurance Accident de travail et responsabilit Civile (AT RC)
(augmentation lgale de cette assurance : multiplie par 2,5) pour un montant de 0,6
MDH comptabilis via le compte de liaison.
1.4 - tat crditeur (16 984 KDH au 31/12/05; 16 123 KDH au 31/12/04;
Variation : + 861 KDH)
Le solde est pass de 16 123 KDH 16 984 KDH entre le 31 dcembre 2004 et le
31 dcembre 2005, soit une diminution de 861 KDH, due aux effets conjoints de :
Laugmentation de la taxe sur le ciment payer instaure durant l'exercice 2004
pour 0,6 MDH suite un chiffre du mois de dcembre 2005 de 64,5 MDH (53,5
MDH en dcembre 2004);
44
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Laugmentation de la TVA due de 0,6 MDH. Ceci sexplique par laugmentation
du chiffre daffaires ralis au mois de dcembre 2005.
1.5 - Autres Cranciers ( 31 056 KDH au 31/12/05; 5 368 KDH au 31/12/04;
Variation : + 21 789 KDH)
Le compte autres cranciers se compose essentiellement des :
Factures d'immobilisations pour la ralisation des projets Silo stockage clinker, de
la bande du Curvoduc (carrire), de linstallation des combustibles de substitution
et de la salle centrale. Les montants budgtiss pour lensemble de ces projets
avoisinent les 75 MDH. En 2005, un total de 30,6 MDH correspond aux factures
non parvenues et fournisseurs dimmobilisations : il sagit des fournisseurs
suivants : ABB, ASA, Haver et Boeker.
Crditeurs divers pour 404 KDH.
1.6 - Comptes de rgularisation passif (14 KDH au 31/12/05; 0 KDH au 31/12/04;
Variation : + 14 KDH)
Ces montants ne sont pas significatifs.
2 Actif
2.1 - Immobilisations incorporelles nettes (50 000 KDH au 31/12/05; 50 000 KDH au
31/12/04 ; Variation : 0 KDH)
31/12/05 31/12/04 Variation
Immobilisations brutes 54 380 54 380 0
Amortissements -4 380 -4 380 0
Immobilisations nettes 50 000 50 000 0
Les immobilisations incorporelles nettes se composent essentiellement de fonds
de commerce pour 50 MDH.
45
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2.2 - Immobilisations corporelles nettes (499 856 KDH au 31/12/2005; 501 730 KDH
au 31/12/04; Variation : - 5 773 KDH)
31/12/04 31/12/05 Variation
Immobilisations brutes 1 207 266 1 279 742 72 476
Amortissements 705 536 779 886 74 350
Immobilisations nettes 501 730 499 856 -1 874
Les immobilisations corporelles nettes sont passes de 501 730 KDH 499 856
KDH, soit une baisse de 1 874 KDH due l'effet conjugu des :
Acquisitions au 31/12/05 pour 86 098 KDH composes essentiellement de :
- Silo ciment, clinker et ensacheuse : 29,1 MDH;
- Nouvelle trmie de correction : 9 MDH;
- Curvoduc : 2,8 MDH;
- Systme de contrle : 8 MDH;
- Installation des pneus dchiquets : 4,3 MDH;
- Nouvelle salle centrale : 4,3 MDH;
- Remplacement des moteurs et rsistances des ponts : 2,5 MDH;
- Systme de contrle commande : 2,3 MDH
Mises en service pour un montant global de 26 383 KDH. Il sagit principalement
de :
- Remplacement du harnais commande : 3,7 MDH;
- Analyseur four : 2 MDH;
- Broyeur BK 3 : 1,6 MDH;
- Mise niveau de la tour dchantillonnage : 1,3 MDH;
- Stockage clinker : 1,9 MDH;
- Remplacement du flasque concasseur : 3,4 MDH;
- Ventilateur de tirage four : 6 MDH.
Retrait des immobilisations rformes pour une valeur brute de 13,6 MDH.
46
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Pour les amortissements, il y a eu cette anne une dotation supplmentaire de 86,3
MDH et une diminution des amortissements suite au retrait des immobilisations
rformes amorties hauteur de 11,7 MDH.
2.3 - Immobilisations financires nettes (12 608 KDH au 31/12/05; 11 960 KDH au
31/12/04 ; Variation : + 648 KDH)
Ce poste correspond essentiellement aux prts accords au personnel pour 5,4
MDH et aux dpts et cautionnements pour 7,1 MDH.
2.4 - Stocks de matires et de produits (68 920 KDH au 31/12/05; 106 476 KDH au
31/12/04; Variation : - 37 556 KDH)
Le dtail des stocks se prsente comme suit :
31/12/04 31/12/05 Variation Var %
Matires premires 4 878 3 606 -1 272 -26%
Matires et fournitures consommables 84 075 60 646 -23 429 -28%
Emballages 2 083 2 333 250 12%
Toiles filtrantes 749 1 661 912 122%
Farines / Cru dos 1 058 673 -385 -36%
Clinker 9 853 1 534 -8 319 -84%
Produits finis 3 780 2 695 -1 085 -29%
Stock brut 106 476 73 148 -33 328 -31%
PROVISION DEP CONSOM -4 228 -4 228
Stock net de provision 106 476 68 920 -37 556 -35%
Un inventaire physique a t effectu l'usine au mois de novembre 2005.
Les principales variations concernent :
Les matires consommables avec une diminution de 23,4 MDH concernant
essentiellement le coke avec une diminution de 21,7 MDH;
Le clinker avec une diminution de 8,3 MDH;
Les produits finis avec une baisse de 1 MDH.
47
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Selon le management une politique de rduction des stocks est applique pour
optimiser le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Ainsi, la direction a dcid de
se dbarrasser des stocks de pices de rechange non utilisables ou rotation lente et
d'harmoniser les nomenclatures des articles en stock des usines afin de prparer le
lancement des commandes centralises pour l'ensemble des sites d'exploitation.
2.5 - Fournisseurs dbiteurs avances et acomptes (2 528 KDH au 31/12/05; 624 KDH
au 31/12/04; Variation : + 1 904 KDH)
Ce poste se compose principalement des droits de douanes avancs la direction
des douanes avant la livraison de la marchandise. Cest un compte ponctuel qui varie
selon les importations.
2.6 - Clients et effets recevoir nets (36 423 DH au 31/12/05; 34 452 KDH au
31/12/04; Variation : + 1 971 KDH)
31/12/04 31/12/05 Variation Var %
Clients 41 687 43 262 1 575 4%
Provision sur clients domestiques -7 235 -6 839 396 -5%
Clients nets de provision 28 710 30 353 1 643
CA net 749 241 833 936
Dlais de recouvrement (en jours) 14,0 13,3
Le dlai de rglement clients est rest stable hauteur de 14 jours entre le
31/12/04 et le 31/12/05. Le faible dlai de rglement des clients s'explique par le fait que
la plupart des clients rglent au comptant (paiement Cash).
Les principaux clients au 31/12/05 sont:
- ITALSTRAD : 2,3 MDH;
- SGTM : 11,5 MDH;
- MATCO ALAMI : 0,6 MDH;
- STAM : 0,7 MDH;
- SNTM : 0,6 MDH.
48
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
L'augmentation de l'encours client de 1,5 MDH est due essentiellement :
o Aux nouveaux clients ITALSTRAD dont l'encours au 31/12/05 s'lve
12,3 MDH contre 5 MDH au 31/12/04;
o Au dveloppement de nouveaux chantiers. Citons titre dexemple la double voie
ferroviaire soutraite par la SGTM.
2.7 - tat dbiteur (6 173 KDH au 31/12/05; 7 574 KDH au 31/12/04;
Variation : - 1 401 KDH)
Le compte tat dbiteur a connu une baisse de 1,4 MDH. Cette baisse est la
rsultante de la diminution de la TVA dductible sur achats en importation pour 3,8
MDH. Ce compte est essentiellement aliment au moment des livraisons de coke. Cette
anne la TVA sur limportation du coke a t comptabilise au niveau du sige; aussi en
dcembre 2004, une livraison de coke a gonfl le compte de TVA rcuprable.
2.8 - Dbiteurs divers (1 064 KDH au 31/12/05; 1 886 MDH au 31/12/04;
Variation : - 822 KDH)
Le solde du compte divers dbiteurs est pass de 1 886 KDH 1 064 KDH, soit
une diminution de 228 KDH due essentiellement au rglement dune facture de coke de
1 292 KDH, une nouvelle refacturation de 56 KDH pour Tanger (bauxite) et des
refacturations de personnel pour Ttouan pour 157 KDH.
2.9 - Comptes de rgularisation Actif (1 940 KDH au 31/12/05; 1 790 KDH au
31/12/04; Variation : + 150 KDH)
Le solde des comptes de rgularisation s'lve au 31 dcembre 2005 1 940 KDH
contre 1 790 KDH au 31 dcembre 2004, soit une augmentation de 150 KDH
correspondant au six mois dassurance (du 1
er
semestre 2006) paye en 2005.
49
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2.10 - Trsorerie Actif (10 113 KDH au 31/12/05; -3 122 KDH au 31/12/04;
Variation : + 13 235 KDH)
Laugmentation des comptes de trsorerie sexplique par les remises en banque
des chques clients. Luxor a remis la BMCE plus de 5 MDH et la BMCI 2 MDH de
chques clients au 31/12/05. Ils ont t transfrs en janvier au compte du sige via cash-
pooling. Tous les excdents de trsorerie sont transfrs aux comptes du sige pour tre
placs.
Les tats de rapprochement ont t prpars au 31/12/05, tous les suspens sont justifis.
3 - Comptes de rsultats
3.1 - Produits
Chiffre daffaires (833 936 KDH au 31/12/05; 749 241 KDH au 31/12/04; Variation :
+ 84 695 KDH)
Le chiffre d'affaires total a enregistr une augmentation de 11 %. Cette variation
s'analyse comme suit :
31/12/04 % 31/12/05 % Variation % Var
CPJ 45 SACS 154 747 21,0% 180 698 21,8% 25 951 16,8%
CPJ 45 VRAC 67 836 9,2% 96 127 11,6% 28 291 41,7%
CPJ 35 SACS 514 618 69,8% 550 269 66,5% 35 651 6,9%
VENTES BRUTES CIMENT GRIS 737 201 100,0% 827 094 100,0% 89 893 12,2%
Ristournes -11 644 -1,6% -10 426 -1,3% 1 218 -10,5%
VENTES NETTES CIMENT GRIS 725 557 98,4% 816 668 98,7% 91 111 12,6%
Ciment blanc CPJ 45 SACS 2 280 0,3% 1 689 0,2% -591 -25,9%
Clinker 13 492 1,8% 2 469 0,3% -11 023 -81,7%
Transport sur ventes 6 610 0,9% 11 734 1,4% 5 124 77,5%
Ventes diverses 1 304 0,2% 1 376 0,2% 72 5,5%
CA TOTAL 749 243 101,6% 833 936 100,8% 84 693 11,3%
50
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Ventes brutes de ciment gris (827 MDH au 31/12/05; 737 MDH au 31/12/04;
Variation : + 90 MDH)
Les ventes de ciment gris ont enregistr une augmentation de 90 MDH, soit
12,2 % de plus par rapport lanne 2004. Cette augmentation est le rsultat d'un effet
volume de 9 %.
Le volume des ventes est pass de 1 086 KT fin dcembre 2004 1 180 KT fin
dcembre 2005, soit un accroissement de 94 KT (9 %).
L'accroissement du volume des ventes s'explique principalement par la relance de
certains programmes d'habitat social dans le cadre du fonds Hassan II.
Par ailleurs, d'importantes livraisons ont t effectues plusieurs chantiers
importants tels que l'autoroute de Asilah / Sidi Yamani, le nouveau barrage pilot par le
groupe ITALSTRAD, et la double voie ferroviaire pilote par SGTM.
Le prix moyen de vente du ciment (PMVC) gris a augment par rapport l'anne
dernire de 3,6% passant de 668,2 Dhs /T 692,4 Dhs /T ; se situant 668,7 Dhs/T pour
le CPJ 45 vrac, 733,8 Dhs/T pour le CPJ 45 sac et 684 Dhs/T pour le CPJ 35 sac.
PMVC en 2004 PMVC en 2005 Variation Var %
CPJ 35 S 662,5 684 21,5 3,2%
CPJ 45 S 715,3 733,8 18,5 2,6%
CPJ 45 V 613,2 668,7 55,5 9,1%
Total ciment 668,2 692,4 24,2 3,6%
Les ventes de CPJ 35 sac, CPJ 45 sac et CPJ 45 vrac sont passes respectivement
de 71%, 20%, 10% au 31/12/04 67%, 21%, 12% au 31/12/05. Il est noter que le prix
moyen de vente du CPJ 45 est de 709,7 Dhs/T contre 684,0 Dhs/T pour le CPJ 35. Cette
variation des prix de vente des produits a contribu l'augmentation du chiffre d'affaires.
51
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Ventes 12/04 KT % Ventes 12/05 KT % Ecarts KT %
CPJ 35 S 768 71% 794 67% 26 28%
CPJ 45 S 214 20% 242 21% 28 30%
CPJ 45 V 104 10% 143 12% 39 42%
Total 1086 100% 1179 100% 93 100%
Ventes nettes de ciment gris (816 668 KDH au 31/12/05; 725 557 KDH au 31/12/04;
Variation : + 91 111 KDH)
Les ventes nettes de ciment gris ont enregistr une hausse (12,6 %) suprieure
celle des ventes brutes (12,2 %). Ceci s'explique par la baisse de la ristourne moyenne par
tonne qui est passe de 11 Dhs HT/T en 2004 9 Dhs HT/T en 2005.
Ventes Clinker (2 462 KDH au 31/12/05; 13 492 KDH au 31/12/04);
Variation : - 11 030 KDH)
Les ventes de Clinker au 31/12/04 concernaient un surplus d'approvisionnement des
usines de Tanger et Ttouan suite la fermeture prochaine de l'usine Ttouan 1. Les
quantits vendues au 31/12/04 s'levaient 36 KT pour un prix moyen de vente de
370 Dhs/T, contre 6,6 KT pour un prix moyen de 370 Dhs/T en 2005.
Transport sur ventes (11 735 KDH au 31/12/05; 6610 KDH au 31/12/04; Variation :
+ 5125 KDH)
31/12/04 31/12/05 Variation
Transport sur ventes 6 610 11 734 5 124
Chiffre d'affaires 740 413 821 066 80 653
Ratio Transport/CA 0,89% 1,43% 0,54%
L'augmentation des recettes de transport s'explique essentiellement par
l'augmentation des quantits vendues ainsi que le dveloppement du service (rendu) et la
fidlisation des clients optant pour le service rendu.
52
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
3.2 - Charges
3.2.1 - Achats consomms (249 640 KDH au 31/12/05; 225 245 KDH au 31/12/04;
Variation : + 24 395 KDH)
Le cot unitaire de production est pass de 151,3 Dhs/T en dcembre 2004
161,6 Dhs/T en dcembre 2005 soit une augmentation de 7%.
Cette variation sexplique principalement par laugmentation du prix du coke qui est
pass de 107,5 en dcembre 2004 112,5 en dcembre 2005 soit une hausse de 5% (en
unit de valeur).
Calcul du taux de marge :
31/12/04 31/12/05 Variation Var en %
Chiffre d'affaires 749 243 833 936 84 693 11%
Variation de stock -4 433 -9 678 -5 245 118%
Achats consomms 225 245 249 640 24 395 11%
Taux de marge 69,8% 69,7% 0 0%
Le taux de marge est rest stable entre dcembre 2004 (69,8%) et dcembre 2005
(69,7%). Cette situation est due une compensation entre laugmentation du cot unitaire
et celle du prix de vente.
3.2.2 - Autres charges externes (28 331 KDH au 31/12/05; 24 533 KDH au 31/12/04;
Variation : + 3 798 KDH)
L'augmentation des charges externes s'explique essentiellement par les effets
conjugus de:
Laugmentation des charges de transport sur ventes de 4,3 MDH passant de 6,5
MDH en dcembre 2004 10,8 MDH en dcembre 2005 suite l'augmentation du
volume des ventes et le dveloppement du service rendu ;
La baisse des frais de publicit denviron 2 MDH.
53
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
3.2.3 - Impts et taxes (14 628 KDH au 31/12/05 ; 18 159 KDH au 31/12/04; Variation :
- 3 531 KDH)
La diminution des impts et taxes sexplique par la baisse de la patente et de la
taxe urbaine et ddilit suite la diminution de la base de calcul des dites taxes. Cela est
d la baisse de lassiette taux fixe de 3 % (au lieu de 3% sur les terrains, 4% sur les
constructions, les matriels et outillages).
Charges de personnel (50 444 KDH au 31/12/05; 50 084 KDH au 31/12/04;
Variation : + 360 KDH)
Les charges de personnel sont restes stables hauteur de 50 MDH. Ceci
sexplique par leffet conjugu :
Dune diminution des salaires des cadres verss au sige, suite des dparts en
retraite ou des transferts la nouvelle entit de Ttouan (5 cadres) ;
Des recrutements de personnel en 2005, essentiellement des agents de matrise (au
nombre de 13).
Dotations aux amortissements et aux provisions (91 066 KDH au 31/12/05; 84 562 KDH
au 31/12/04; Variation : + 6 504 KDH)
L'augmentation des dotations aux amortissements et aux provisions s'explique
par :
Une dotation pour dprciation des pices de rechange anciennes ou rotation
lente pour un montant de 4,2 MDH. Le recensement des pices de rechange est
effectu sur la base du listing de l'inventaire permanent ;
L'augmentation des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
de 2,2 MDH suite aux nouveaux investissements raliss partir du deuxime
semestre de l'exercice 2004 ;
Une baisse des dotations pour dprciation des comptes clients de 0,3 KDH.
Aucune dotation aux provisions pour dprciation des comptes clients na t
comptabilise cette anne.
54
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Une nouvelle dotation pour dprciation du stock en 2005 dune valeur de
4,2 MDH ;
Une dotation pour rhabilitation de carrire Ttouan dune valeur de 0,5 MDH.
3.3 - Rsultat financier (-463 KDH au 31/12/05; 62 KDH au 31/12/04; Variation :
- 525 KDH
Le rsultat financier a diminu de 525 KDH, passant d'un gain financier de 62
KDH une perte financire de 463 KDH. La diminution du rsultat financier est due
particulirement la perte de change de 571 KDH enregistre au cours de l'exercice suite
la ngociation du taux terme du dollar suprieure au cours rel (ce dernier ayant
baiss).
3.4 - Rsultat non courant (- 4 267 KDH au 31/12/05; - 6 116 KDH au 31/12/04;
Variation : + 1 849 KDH)
Le rsultat non courant a connu une hausse de 1 849 KDH trouvant sa justification
dans les :
Charges exceptionnelles :
- Indemnits de dparts 3,6 MDH au 31/12/05;
- Provision pour frais de dmontage des stocks rforms pour 900 KDH;
- Frais de rhabilitation de carrires hauteur de 856 KDH.
Produits exceptionnels :
- Reprise de la provision pour rhabilitation de carrires : 856 KDH;
- Remboursements OFPPT et sinistres : 323 KDH.
55
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
III - Conclusion de ltude
Il ressort que l'examen analytique peut nous permettre d'identifier aussi bien des
risques accrus que des changements intervenus dans l'activit ou dans les systmes
comptables. Les informations obtenues peuvent galement nous indiquer que l'hypothse
de continuit de l'exploitation risque de ne plus tre approprie et attirer notre attention
sur des points qui peuvent donner lieu des commentaires sur la marche de l'entreprise.
Ces informations seront utilises, en liaison avec la connaissance de l'activit du
client et la dtermination du seuil de signification pralable, pour identifier les risques ou
les erreurs potentielles pouvant survenir lors de ltablissement des comptes de la socit.
Ainsi, la revue analytique permettra d'tablir des plans d'audit par compte qui seront
utiliss lors de la phase finale de validation des comptes.
56
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
57
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
La revue analytique est un outil indispensable pour la dtection des risques et
donc pour le contrle interne et le contrle de gestion : ainsi, la mission qui a t
entreprise au cours du mois de fvrier 2005 au sein de lentreprise Luxor consiste
entreprendre un diagnostic des systmes de contrle de ltablissement.
Cette mission avait pour objectif :
Didentifier et dvaluer les principaux risques qui pourraient menacer les objectifs de
la Direction Gnrale;
Dvaluer les systmes de contrle existants devant couvrir les principaux risques;
De dfinir un plan dactions indiquant les systmes de contrle mettre en uvre ou
amliorer.
La mise en uvre du plan dactions doit permettre une meilleure gestion des risques et
lamlioration de lenvironnement de contrle de lentreprise.
La prsente partie comprend dans un premier temps, le diagnostic et lvaluation des
risques encourus par le client.
Dans un deuxime temps nous nous intresserons aux plans dtaills proposs au client
par notre cabinet qui a pour but une meilleure ralisation de ses objectifs.
Nous rappelons que lobjectif de lintervention ntait pas dentreprendre une
valuation dtaille des systmes de contrles existants ni les tester pour sassurer
quils fonctionnent correctement mais daccompagner le client dans la dmarche
dvaluation de ses risques et des systmes de contrle.
Les travaux entrepris, depuis lidentification des objectifs jusqu llaboration
des plans dactions, ont t raliss principalement sur la base dentretiens avec les
responsables de lentreprise Luxor dans un esprit de transparence et de coopration.
58
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
SECTION I : DIAGNOSTIC DES SYSTMES DE
CONTRLE
I - Identification des objectifs de la DG
Ce travail a t entrepris sur la base dentretiens avec la Direction Gnrale.
Suite ces entretiens, 8 objectifs ont t identifis. Certains dentre eux ont une priorit
leve, nous leur accorderons de ce fait, la lettre E en guise dannotation, dautres sont de
priorit moyenne et seront dsigns par la lettre M.
Ainsi, les 8 objectifs fixs par le client sont numrs comme suit :
Financement (E) : Assurer le financement de lactivit;
Rentabilit(E) : Avoir une meilleure connaissance du niveau dendettement des
demandeurs de crdit et faire baisser les impays;
Recouvrement (E) : Amliorer les procdures en place;
Trsorerie (E) : Conserver une gestion prudente de la trsorerie;
Part de march (M) : Amliorer les parts de march;
Humain (M): Disposer de personnel plus ou moins qualifi selon les tches
voulues;
Stratgie (M): Tenir compte de la concurrence;
Rglementaire (E): Respecter la rglementation interne.
II - valuation des principaux risques (pouvant affecter les
objectifs de la Direction Gnrale)
Sur la base de ces objectifs, et suite aux conclusions tires de notre revue
analytique prcdemment cite nous avons entrepris une srie dentretiens avec la
Direction Gnrale ainsi que les principaux responsables de lentreprise Luxor afin
59
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
didentifier les plus importantes et les plus significatives zones de risques qui peuvent
affecter ces mmes objectifs.
Il est noter que 31 risques ont t identifis et peuvent tre classs selon leur degr
dimportance.
Avant de dresser un tableau rcapitulatif des rsultats de nos entretiens concernant
la dtection des principales zones de risques, il serait judicieux de donner une dfinition
brve, mais exhaustive de ces mmes risques.
1 - Dfinition des risques
1.1 - Risque de march
On entend par risque de march, les risques de pertes qui peuvent rsulter des
fluctuations des prix de matires, ou des propositions susceptibles dengendrer un risque
de change terme et au comptant.
1.2 - Risque global de taux dintrt
Le risque global de taux dintrt se dfinit comme limpact ngatif que pourrait
avoir une volution dfavorable des taux dintrt sur la situation financire de
ltablissement si un crdit est octroy par la socit.
1.3 - Risque de liquidit
Le risque de liquidit sentend comme le risque pour la socit de ne pas pouvoir
sacquitter, dans des conditions normales, de ses engagements leur chance.
1.4 - Risque de rglement
Le risque de rglement est risque de survenance, au cours du dlai ncessaire pour
le dnouement de lopration de rglement, dune dfaillance ou de difficults qui
empchent la socit dhonorer ses engagements lgard du contractant.
60
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
1.5 - Risque informatique
Le risque informatique peut correspondre au risque de survenance de
dysfonctionnements ou de rupture dans le fonctionnement du systme de traitement de
linformation, imputables des dfaillances dans le matriel ou des erreurs, des
manipulations ou autres motifs (virus) affectant les programmes dexcution.
1.6 - Risque juridique
Le risque juridique sentend comme le risque de survenance de litiges susceptibles
dengager la responsabilit de la socit du fait dimprcisions, de lacunes ou
dinsuffisances dans les contrats et autres actes de nature juridique la liant des tiers.
Aprs ce bref rappel, nous passons ltape suivante qui est lnumration des risques.
Nous avons prsent sur les tableaux suivants les risques identifis, catgorises selon le
degr dimportance et classs par ordre dcroissant dimportance.
2 - numration des risques
N risque
Nature
Risque
R5 Crdit Taux dincidents de paiements lev
R1
Crdit
- Dfaillance des clients
- Incapacit honorer le remboursement de
crdits
R11
Liquidit
Incapacit de trouver des sources de financement
ou rticence des banques refinancer lactivit
R 33
Stratgie
Incapacit de tisser des alliances avec un
partenaire tranger ou national, marginalisation
de lactivit dans un environnement trs
concurrentiel
R28 Humain Perte de personnel comptent
R27 Humain Qualifications insuffisantes du personnel (non
61
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
spcialisation)
R21 Informatique Procdures dexploitation insuffisamment
contrles
R18 Informatique Perte de continuit dexploitation
R23 Informatique Procdures de maintenance pas assez contrles
R7 Crdit Dprciation insuffisante des crances en
souffrance
R8 Crdit Recouvrement insuffisant des crances
R29 Humain Incapacit de trouver un personnel qualifi et
comptent
R19 Informatique Perte de la confidentialit des informations
R32 Stratgie Absence de stratgie de dveloppement
R9 Taux dintrt Changement des taux de refinancement
R16 Oprationnel Non respect des budgets et prvisions fixs par
la Direction
R20
Informatique
Incapacit de dvelopper un systme
dinformation conforme aux attentes des
utilisateurs.
R25
Juridique
Non respect de la rglementation en vigueur
(code de commerce, code de travail...)
Pnalit ou perte dagrment
R13
Liquidit
Incapacit de faire face ses exigibilits et
dhonorer les engagements de financement
envers la clientle
R2
Crdit
- Apprciation inadquate des dossiers de
crdit (systme de notation interne)
- Absence dinformations sur des clients
douteux (liste noire)
R22 Informatique Procdures de dveloppement inadaptes
R26 Humain Organisation non adapte lactivit
62
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
R30 Humain Grve du personnel
R34
Stratgie
Effondrement du cours de bourse du fait dune
mauvaise communication financire
R6
Crdit
Classification inadquate des crances en
souffrance
R12 Liquidit Mauvaise apprciation des entres et de sorties
de trsorerie
R17 Oprationnel Ne pas rpondre de manire rapide la clientle
R24
Juridique
Lacunes ou imprcisions dans la rdaction de
contrats entranant un litige
R4
Crdit
Dpassement des seuils tolrs des encours de
crdit, des impays et des crances en souffrance
R31 Humain Fraude
R10
Taux dintrt
Cot lev des oprations de financement auprs
des banques
III - valuation du systme de contrle interne
Nous prsentons ci-aprs une valuation gnrale de lenvironnement de contrle dans
une premire section, puis une valuation des systmes de contrle devant exister pour
couvrir les risques prcdemment identifis en deuxime lieu.
1 - valuation de lenvironnement de contrle interne
Cette valuation a t entreprise lors des sances de travail avec la Direction Gnrale et
les principaux responsables.
Elle sappuie sur les concepts du COSO report qui prsente les fondations du contrle
interne au sein dune organisation au travers de 5 lments :
63
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Domaine de
COSO
Ce qui existe au sein de
lentreprise
Ce qui peut tre amlior
1. Environnement
de contrle
(assez satisfaisant)
Sens de responsabilit,
de lthique
Respect de ses
partenaires
Volont de transparence
Souci damlioration
des performances
Direction assez
participative
Organisation structure
C1 : Formalisation des valeurs de
lentreprise Luxor (thique, engagement la
comptence)
C2 : Renforcement du personnel pour
certaines tches, pour amliorer la rapidit
des oprations et assurer la sparation des
tches sensibles
C3 : Meilleure formalisation des rles et
responsabilits
C4 : Formalisation de la politique de
ressources humaines
C5 : Dfinition et mise en place dun comit
daudit
2. valuation des
risques (faible)
La prsente mission
constitue la premire
action formelle
didentification et
dvaluation des risques
C6 : Formalisation des objectifs de la
Direction par exemple dans un plan
dentreprise, et partage des objectifs
principaux avec le personnel
C7 : Dfinition et mise en place de
mcanismes pour identifier et couvrir les
risques principaux
C8 : Dfinition des limites acceptables de
risque par activit
C9 : Dfinition et mise en place de
mcanismes pour grer les changements
dans lorganisation
64
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
3. Activits de
contrle
(insuffisant)
Existence doprations
de contrle des activits
C10 : Formalisation de lensemble des
systmes de contrle existants
C11 : tablissement de manuels de
procdures complets
4. Information et
communication
(insuffisant)
Systme dinformation
qui permet de collecter
les informations pour
grer lactivit
Efforts de
communication par la
Direction
C12 : Dfinition de la stratgie informatique
C13 : Dfinition et mise en place dune
politique de communication efficace
5. Monitoring des
systmes de
contrle
(insuffisant)
Runions de service
entre les membres de la
Direction
Rapprochement de
contrle par les
oprationnels de la
Direction
Prise en compte par la
Direction des
recommandations
externes
C14 : Ralisation et matrialisation des
oprations de contrle dans le flux continue
de lactivit
C15 : Nomination dun responsable du
respect du contrle interne
65
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2 - valuation des systmes de contrles devant couvrir les risques
menaant les objectifs du client
Par rapport aux risques numrs prcdemment accompagns de leurs
rfrences, notre travail consiste dans cette partie valuer les diffrents systmes de
contrle de lentreprise Luxor.
Tableau dvaluation des systmes de contrle
Rfrence
risque
Systmes de Contrle existants
Systmes de contrle complmentaires
mettre en place
R5 :
Crdit
Revue rgulire du niveau des
impays par client et relance des
impays selon une procdure dj
approuve
Liste des impays automatise
Circulariser les clients les plus importants
pour confirmer le solde des crances et diter
priodiquement la balance ge
R1 :
Crdit
Vrification de la capacit de
remboursement des clients
Gnralisation de la fixation dun plafond
acceptable dendettement
R11 :
Liquidit
Appel aux actionnaires : situation
financire saine permettant le recours
lendettement bancaire
Pas de contrle supplmentaire
R33 :
Stratgie
Bonne connaissance du march et
des acteurs
Surveillance de lvolution du march, des
nouveaux entrants et de la stratgie de
dveloppement des concurrents
R28 Absence de politique de gestion des
carrires des cadres
Mise en place dune politique de gestion des
carrires des cadres
R27 :
Humain
Encadrement du personnel par des
responsables comptents
Renforcement de lencadrement des
employs
tablissement de plans de formation du
personnel
valuation interne des comptences et
qualifications ncessaires pour les diffrentes
fonctions de ltablissement
66
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Plan de recrutement de personnel qualifi
aprs les dparts rguliers du personnel plus
g en retraite
R21 :
Informatique
Absence de procdures formalises
dexploitation
Mise en place dun rfrentiel de principes et
de procdures informatiques couvrant les
procdures dexploitation informatique
R18 :
Informatique
Plan de continuit dexploitation non
formalis
Mise en place dun plan de continuit
dexploitation, couvrant notamment le plan
de secours informatique
R23 :
Informatique
Absence de procdures de
maintenance formalises
Mise en place dun rfrentiel de principes et
de procdures informatiques couvrant les
procdures de maintenance informatique
R7 :
Crdit
Revue et approbation des provisions
constates par la Direction Gnrale
Documentation des exceptions aux rgles de
provisions tablies
R8 :
Crdit
Recouvrement entrepris par les
agents indpendants
Suivi de la ralisation des objectifs
assigns aux agents de recouvrement
par les responsables du recouvrement
Renforcement de la politique de
recouvrement et de contentieux
Renforcement des responsables chargs de
lencadrement et du contrle des agents de
recouvrement de manire couvrir la totalit
de la clientle
Fixation dun plan dintervention des
responsables du recouvrement y recourir
aprs un nombre dfini de relances du centre
dappels
R29 :
Humain
Dfinition du profil des postes
pourvoir et recours un cabinet de
recrutement pour la recherche de
candidats
Plans de ressources humaines couvrant tous
les aspects dune gestion de carrire : le
recrutement, lvaluation des performances,
la promotion, la formation et le suivi des
carrires...
R19 :
Informatique
Existence dun contrle de scurit
pour accder aux applications
Mise en place dune politique de scurit
informatique
R32 :
Stratgie
Stratgie de dveloppement dfinie
par le Conseil dAdministration
Formalisation dun plan dentreprise
comprenant des objectifs mesurables et
67
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
partags par le Conseil
R9 :
Taux dintrt
Suivi et ngociation des taux avec les
banques par la Direction Gnrale
Entreprendre des tudes de financement pour
valuer limpact des changements des taux
dintrt sur la situation financire
R20 :
Informatique
Systme actuel rpondant
globalement aux attentes de base des
utilisateurs
Mise en place dune stratgie informatique
dcoulant de la stratgie dentreprise et
permettant lutilisation du systme de
notation interne et dvaluation de la
performance
Mise en place dun rfrentiel de principes et
de procdures informatiques permettant de
matriser les oprations supportes par les
systmes informatiques
Mise en place dun rfrentiel de principes et
de procdures informatiques couvrant la
stratgie informatique, la slection de
progiciel et le dveloppement des systmes
R25 :
Juridique
Suivi des cumuls de fonction au
niveau de la Direction
Vrifier que les mandataires sociaux de la
socit respectent linterdiction du cumul de
ces fonctions avec les fonctions de direction
dans toute autre entreprise
R13 :
Liquidit
Suivi rgulier de la trsorerie par le
Directeur Gnral
Bonne capacit dendettement
Pas de contrle complmentaire propos
R2 :
Crdit
Vrification des informations
fournies par le client
Relance crite systmatique ds le
premier impay
Existence dun systme de notation
interne pour la catgorie seule des
salaris
Prise en compte de la situation
financire des clients potentiels et
Vrification systmatique des informations
fournies par le client auprs des tiers
(banques, employeurs, conservation foncire,
etc...)
Mise en place dun systme de notation
interne
Dfinition des rgles de gestion par rapport
aux impays par importance du client et tat
du march
68
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
des garanties prsentes pour loctroi
de crdit
Existence de systmes de dlgation
pour loctroi de crdit
Dcision de crdit prise en
conformit pour les crdits les plus
importants
Recherche dantcdents avant
loctroi dun nouveau crdit
Formalisation et archivage de lanalyse, des
critres pris en compte et de la mthode
dapprciation du dlai client
Exploitation systmatique des donnes du
recouvrement pour la fixation des lignes de
conduite en matire doctroi de crdit et
suivi des ralisations par rapport aux lignes
fixes
Formalisation des limites globales de crdit
tolres
R22 :
Informatique
Absence de procdures de
dveloppement formalises
Mise en place dun rfrentiel de principes et
de procdures informatiques couvrant les
procdures de dveloppement informatique
R26 :
Humain
Contrle des oprations quotidiennes
et contrle priodique par les
directeurs et chefs de service
Sparation des tches entre excution
et contrle
Mise en place de manuels de procdures
(complter les documents existants)
Disposer dune bonne sparation des tches
au niveau des activits sensibles ou critiques
R30 :
Humain
Amlioration du climat social en
prenant en compte les dolances du
personnel
Prise en compte de la satisfaction du
personnel lors dentretiens individuels
annuels
Renforcement de la communication interne :
adhsion du personnel aux objectifs de la
Direction par un systme de direction
participative par objectifs
R34 :
Stratgie
Pas de stratgie particulire Dfinir une politique de communication
financire
R6 :
Crdit
Classification des crances en
souffrance ( partir dtats
informatiques)
Contrle des exceptions de classification par
la Direction Financire
R12 :
Liquidit
Contrle de la trsorerie au jour le
jour
Mise en place du logiciel de trsorerie acquis
R17 : La structure de la socit permet de Pas de contrle supplmentaire propos
69
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Oprationnel rpondre de manire pro-active la
clientle
R24 :
Juridique
Pas de contrle spcifique Revue juridique des diffrentes conventions
liant la socit un tiers ou des socits du
groupe
R4 :
Crdit
Enclenchement systmatique de la
procdure de recouvrement ds le
premier impay
Enclenchement de la procdure de
recouvrement lissu de lexamen
des tats dimpays
Enclenchement de la procdure de
contentieux lissu du troisime
impay (non systmatique)
Procdure de contentieux formaliser
Renforcement des moyens humains et
matriels de la cellule contentieux (revue
globale de la politique de recouvrement)
R31 :
Humain
Existence dun code de conduite
implicite. Valeurs thiques imposes
par la Direction
Formaliser les principes thiques noncs
par la Direction Gnrale
R10 :
Trsorerie
Suivi rgulier de la trsorerie Instauration dun systme de suivi de la
trsorerie : suivi des dates de valeur,
vrification des chelles dintrt, des agios
bancaires et des budgets de trsorerie;
rapprochement quotidien entre la situation de
trsorerie dtermine par la socit et la
situation communique par les banques
Utilisation du progiciel de trsorerie acquis
R15 :
oprationnel
Systme dinformation permettant la
saisie et lenregistrement des
donnes comptables, et ne prsentant
pas de dysfonctionnement connu
ayant un impact sur linformation
financire
Pas de contrle complmentaire propos
R14 : Surveillance et respect des ratios Pas de contrle supplmentaire propos
70
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Liquidit rglementaires dendettement par la
Direction Gnrale
R3 :
crdit
Suivi du risque de crdit par la
Direction Commerciale et la
Direction Gnrale
valuation du risque en fonction de lhistoire
des incidents de paiement (comportement du
client tout au long de la dure de prt)
71
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
SECTION II : PLAN DACTIONS METTRE EN OEUVRE
PAR LA SOCIT LUXOR
Nous avons dtaill dans les paragraphes suivants les plans dactions pour la
gestion du crdit, des ressources humaines et de linformatique.
I - Plan dactions visant au renforcement gnral du contrle
interne
Actions mettre en uvre
Risques ou
points
couverts par
les actions
proposes
Dlai de
Mise en
uvre*
Responsabilit
Cration dun comit dAudit qui veillera la
cohrence des dispositifs de contrle et la mise
en place de mesures correctives pour combler les
lacunes dans le systme de contrle interne
C5 2 mois Conseil
dAdministration
Dfinir clairement les niveaux dautorit, de
responsabilit et les domaines dintervention
des units oprationnelles
C3 6 mois Direction
Gnrale
Nommer un responsable du contrle interne
qui sera charg de lvaluation des systmes de
contrle
C15 2 mois Direction
Gnrale
Formaliser les activits, les systmes de
contrle et les procdures de reporting sur
lefficacit des systmes de contrle
C10/C11/C14 5 6
mois
Direction
Gnrale
Dterminer les limites acceptables de risques C8 3 mois Direction
72
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Gnrale/Conseil
dadministration
tablir un plan dentreprise identifiant les
objectifs stratgiques moyen ou long terme et
prsentant les plans oprationnels mettre en
uvre court terme
Communication de ces objectifs au personnel
Le plan comprend galement une prsentation
du march avec ses opportunits et ses menaces
C1/C6/C13/R
33/R34
6 mois Direction
Gnrale/Conseil
dadministration
Mettre en place des procdures pour
lvaluation des risques et pour lvaluation des
systmes de contrle interne. La prsente tude
pourra servir de base au client dans la mise en
uvre de ses procdures
C7/C9 6 mois Direction
Gnrale
Sassurer de la stricte sparation des tches
(initiation, excution, contrle) pour les activits
les plus sensibles
C2 6 mois Direction
Gnrale/Conseil
dadministration
Manuel de contrle interne : complter les
manuels de procdures existants en prcisant le
rle, les responsabilits et les niveaux de
contrle (voir paragraphe ultrieur)
C10/C11 6 mois Direction
Gnrale
*le dlai de mise en uvre indiqu dpend de ltendue des travaux entrepris et des
ressources engages.
73
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
II - Plans dactions visant couvrir les risques identifis qui
menacent les objectifs de lentreprise X
Nous avons regroup sous la forme de plans dactions la majeure partie des
recommandations.
Les autres recommandations qui ne figurent pas dans ces plans doivent aussi tre traites
par le client : R9, R10, R15, R16, R17, R18, R19, R24, R25, R30, R33, R34.
Nous recommandons la Direction Gnrale de nommer une personne qui sera
charge de complter les plans dactions et du suivi de la mise en uvre des actions.
Actions en mettre en uvre
Risques
couverts par
les actions
proposes
Dlai de mise en
uvre
Responsabilit
Crdit :
Dfinition des critres dapprciation
du risque de crdit
Mise en place dun systme de notation
interne
Renforcement de lefficacit du
recouvrement
Dfinition de rgles de gestion bases
sur lhistorique des impays et des
crances irrcouvrables pour diminuer
le risque crdit
R1 R8
B10
De 6 mois 18 mois
NB : le dlai de
mise en uvre peut
dpendre des
dcisions prendre
concernant la
refonte ou non du
systme
dinformation
Direction du
dveloppement
Informatique :
Mise en place dun rfrentiel de
principes et de procdures
informatiques (exploitation,
C12/
R20 R23
3 mois
Service
informatique
74
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
dveloppement et maintenance)
Dfinition dune politique de scurit
et de continuit dexploitation
laboration dun schma directeur
informatique
Au del des risques identifis, le client doit
statuer sur la prennit du systme actuel
dvelopp en interne qui aurait peu de
chances dvoluer en cas de dpart des
principaux responsables informatiques
NB : la dfinition
dun schma
directeur
informatique peut
tre rapidement
entreprise, la refonte
ventuelle dun
systme
informatique peut
ncessiter un dlai
de 12 18 mois
Trsorerie :
Renforcement des moyens humains
Mise en place de loutil de gestion de
trsorerie
laboration et mise jour quotidienne
du planning prvisionnel des entres et
sorties de trsorerie
R11 R14
6 mois
Directeur
Gnral
Ressources humaines :
Dfinition dun plan de gestion de
ressources humaines couvrant tous les
aspects dune gestion de carrire
(procdure de recrutement,
dvaluation et de promotion; suivi des
carrires)
C4/
R26 R31
6 mois
Directeur
Gnral
75
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
III - Plan dactions visant la mise en place de manuels de
procdures utilisateurs
Nous citons ci-aprs les risques et les principes qui devraient tre mis en place :
Organisation des dpartements (dfinition du rle, responsabilits, tches)
1. dpartement comptable
2. direction recouvrement
3. service contentieux
4. service informatique.
Organisation des comits (membres, responsabilits, frquence de runion,
dcisions prises)
1. comit de direction
2. comit de crdit et de recouvrement
3. comit daudit
4. comit informatique
5. comit des ressources humaines
6. comit de trsorerie.
Procdures comptables
1. principes comptables retenus
2. mthodes dvaluation
3. plan de compte et annotation sur le fonctionnement des comptes
4. comptabilisation des oprations (achat, production, paie, immobilisations, oprations
diverses)
5. tablissement des obligations dclaratives : TVA, liasse fiscale, tat 9421 IGR,
CNSS, mutuelle et retraite
6. budget et reporting interne
7. reporting externe : tats financiers annuels.
76
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Procdures de gestion de la chane de crdits
1. ouverture de dossier
2. collecte et vrification des informations
3. valuation de dossier notation interne
4. acceptation
5. mise disposition du crdit
6. clture dun crdit
7. relance des clients en incident de paiement
8. gestion du recouvrement
9. gestion du contentieux
10. classification des crdits
11. laboration de reporting de gestion et des tableaux de bord, dont ceux de risque crdit.
Autres procdures
1. gestion des achats
2. gestion du personnel (recrutement, paie, valuation)
3. gestion des immobilisations
4. gestion de trsorerie
5. procdures informatiques.
77
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
IV - Mise en place dun systme de scoring
Nous prsentons dans cette partie les principaux lments dun systme de
scoring, lobjectif principal tant loptimisation de la gestion du risque de crdit afin
daugmenter la rentabilit de lactivit.
Le schma ci-dessous montre de manire trs synthtique les principaux lments dune
gestion de crdit :
Incidents Encours Encours
recouvrement contentieux
Client Octroi Encours sain Encours
Rgularisations surendettement
Fidlisation
Le systme de scoring consiste :
Mesurer de manire permanente et prcise le risque de crdit dans toutes les phases
de traitement;
Entreprendre des conomies dchelle par lautomatisation et la standardisation des
oprations;
Contrler la politique de risque.
Nous prsentons ci-aprs les principaux lments dun score, les avantages et les
objectifs stratgiques du scoring et les tapes suivre pour btir un systme de scoring
78
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
1 - Les principaux lments dun score
Un score est une fonction statistique permettant destimer la probabilit de dfaut
dun emprunteur sur la base :
o dun critre de risque expliquer (par exemple : 3 impays dans les 18 premiers
mois);
o de caractristiques socioprofessionnelles (ge, profession, anciennet
professionnelle, anciennet dans lhabitation, etc...);
o de lobservation de lhistorique du comportement de gnrations de crdits plus
anciennes.
Nous prsentons dans le schma ci-dessous lexemple dun score doctroi :
Donnes demandes Donnes calcules
aux clients par le secteur
- ge - Note de score
- Profession - Probabilit de
- Anciennet dans lemploi fonction dfaut Barre de score
- Matriel achet (VN, VO) de score en fonction du niveau
de risque souhait
Dcision
- Acceptation
- tude du dossier approfondie
- Refus
En fonction du rapport de la note du score et de la barre
79
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
2 - Les avantages du scoring
La mise en place dun systme de scoring offre lavantage de :
Formaliser et damliorer larchivage des informations sur les dossiers;
Permettre de mieux comprendre les risques;
tre en conformit avec les exigences rglementaires;
Mesurer en permanence les risques, ce qui permet dajuster la politique
commerciale en fonction du risque client;
Acqurir une exprience sur la clientle et pouvoir ensuite laborer une tarification
diffrencie en fonction du risque, ce qui permet damliorer la rentabilit.
3 - Les objectifs stratgiques du scoring
Le systme de scoring doit rpondre aux objectifs suivants :
La mesure permanente et prcise du risque, par une quantification et une
classification des populations par tranches de risques homognes;
La ralisation dconomies dchelles, par lutilisation dautomatismes dans les
prises de dcisions et luniformisation (et ventuellement centralisation) des
traitements;
Le contrle pouss du risque de crdit, par le reporting permanent des risques sur
lencours et la mesure rcurrente de la qualit de la demande et de la production.
4 - La construction dun score et la stratgie de recouvrement
Nous donnons ci-aprs trois lments cls pour la construction dun score et qui
sadaptent facilement au contexte dimplantations lgres :
tape n 1 : Dfinition dune grille pour la connaissance du comportement des
clients (en fonction de lhistorique).
Pour pouvoir btir le score, il est prfrable de disposer des caractristiques des
demandes sur les gnrations passes, de connatre le comportement de risque, et de
pouvoir rapprocher la demande au comportement. ventuellement, en labsence
dhistorique exploitable, un score gnrique (grille) peut tre utilis au dmarrage.
80
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
tape n2 : Suivi des performances et ajustement de la grille initiale.
Par la suite, le score va tre intgr dans les applications doctroi. Un suivi des
f ng.
tion de la
grille de scoring.
tre diffrencies selon les populations. Les stratgies de recouvrement doivent pouvoir
x pour la vente des
produit
avers de procdures de reporting, sur la
ase des scores et des stratgies de recouvrement. Ce suivi doit dtecter les drives
ventu
formation
per ormances doit alors tre entrepris pour pouvoir ajuster la grille de scori
tape n3 : Dfinition de stratgies pour le recouvrement et lamliora
Les procdures de recouvrement doivent alors tre structures en stratgies qui peuvent
tre mesures de manire pouvoir corriger les grilles de scoring.
Loptimisation de la grille de scoring doit permettre de dfinir les stratgies
performantes qui doivent tre communiques aux commerciau
s mais aussi aux agents de recouvrement.
Un suivi du risque doit tre labor au tr
b
elles dans la gestion du risque.
V - Matrise du systme din
mettre en place des systmes qui
pondent aux besoins des utilisateurs. Il doit aussi matriser les risques qui peuvent
impac
moyen terme, de matriser les risques informatiques les plus importants en mettant
;
Le client doit dfinir sa stratgie informatique et
r
ter le bon fonctionnement des activits supportes par linformatique.
Nous prsentons ci-aprs les plans qui devraient permettre au client :
en place un rfrentiel de principes et de procdures informatiques
plus long terme, de dfinir sa stratgie informatique au service de la stratgie de
lentreprise.
81
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
NB : la politique de scurit informatique et le plan de continuit dexploitation de la
socit peuvent tre couverts par le rfrentiel de principes et de procdures
informatiques
1 - Plan destin assurer la matrise de ses oprations informatiques
Nous prsentons ci-aprs un plan en quatre tapes pour la matrise des oprations
informatiques. Comme rfrentiel nous vous recommandons dutiliser les guides Cobit,
aujourdhui considr comme le meilleur rfrentiel international dans ce domaine.
Les guides Cobit (Control Objectives For Information and related Technology), sont
labors par lISCAF (Information System Audit and Control Foundation), organisation
dont PWC est membre. Leur mise en place requiert nanmoins des comptences fortes
dans le domaine des systmes dinformation de contrle interne.
Lobjectif dun rfrentiel de principes et de procdures informatiques est :
De permettre linformatique de dlivrer un bon niveau de service aux utilisateurs
et de pouvoir rpondre leurs attentes (qualit, dlais) en formalisant les relations
et les responsabilits dans le domaine informatique des diffrents intervenants
(personnel informatique, utilisateurs);
Dassurer un bon niveau de contrle des oprations du dpartement informatique,
en formalisant les contrles du personnel informatique et les informations de
gestion de la direction informatique;
Dassurer la prennit des oprations du dpartement informatique, en formalisant
les procdures informatiques;
De rationaliser lutilisation de loutil informatique, en optimisant les
investissements.
82
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
tape n1 : Dfinition du rle du dpartement informatique.
Cette tape doit permettre de dfinir de manire prcise le rle du service informatique,
son organisation, ses responsabilits (par exemple : la qualit du service souhaite) et ses
relations avec les principales directions.
tape n2 : Dfinition des fiches de fonction.
Lors de cette tape seront compltes les fiches de fonction pour les postes du
dpartement informatique. Il est important de sassurer que les tches incompatibles sont
bien spares et notamment les tches dexploitation informatique, de dveloppement
informatique et dadministration de la scurit. Cependant, dans la situation actuelle, (il y
a 2 personnes en charge du service informatique), il sera ncessaire deffectuer des
contrles indpendants (supervision par la direction, audits externes).
tape n3 : Dfinition du reporting de gestion et des tableaux de bord.
Les informations ncessaires la gestion efficace des activits du dpartement
informatique seront dtermines. Lors de cette tape, il convient didentifier les lments
cls remonter par tableau de bord vers la Direction Gnrale.
Les tableaux de bord doivent synthtiser lactivit informatique.
tape n4 : Rdaction des procdures.
Cette tape doit permettre didentifier les procdures qui doivent tre rdiges et
appliques par linformatique. Lensemble des procdures doit aboutir un rfrentiel
pour sassurer du contrle des oprations informatiques et de leur prennit.
Les procdures doivent prciser le champ dapplication, les acteurs, les tches, les
documents utiliss et les contrles entreprendre y compris certains modes opratoires.
Les procdures qui doivent tre envisages concernent : les oprations dexploitation
informatique (consignes dexploitation, suivi de la production, identification des
anomalies, mise en production de programmes, gestion des sauvegardes, etc...), les
procdures de dveloppement et de maintenance (processus de validation des dmarches
utilisateurs, dveloppement dapplications et de documentation des analyses et des
83
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
manuels, gestion des maintenances, etc...), les procdures dadministration de la scurit
(cration, modification, suppression de profils et de droits, identification et suivi des
incidents de scurit, revue des scurits systmes et applications, etc...).
2 - Plan destin dfinir la stratgie informatique de lentreprise Luxor
Nous prsentons ci-aprs les tapes suivre pour tablir un schma directeur
informatique :
tape n1 : Prise en compte de la stratgie du client.
Cette tape doit consister identifier les lments cls de la stratgie du client et de
connatre les grandes orientations oprationnelles par activit moyen (2ans) et long
terme (5 ans). Ces travaux pourraient par exemple sappuyer sur le plan dentreprise de la
socit que nous avons prcdemment recommand de formaliser (voir C6).
tape n2 : Analyse de lexistant.
Cette tape doit permettre dtablir un inventaire des systmes dinformation en place
ainsi que des projets en cours. Ce travail pourra seffectuer en tablissant une
cartographie mettant en vidence les systmes en support des activits de la socit.
Pour chaque systme rfrenc, il convient de dfinir les lments cls le caractrisant
(cots, matriels, systmes dexploitation en support, mode de fonctionnement, etc...).
tape n3 : Synthse des besoins dvolution.
Suite linventaire de lexistant, il convient dtablir les forces et les faiblesses de chaque
systme (couverture fonctionnelle, capacit dvolution et limites par rapport aux besoins
futurs).
tape n4 : Dfinition de larchitecture fonctionnelle cible.
Cette tape consiste dfinir les invariants fonctionnels souhaits pour chaque activit.
84
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Il convient de prendre en compte le caractre raliste de la mise en uvre de
larchitecture fonctionnelle cible eu gard lexistant, aux priorits damlioration et aux
possibilits des outils du march.
tape n5 : Scnario et bilan conomique.
Cette tape doit permettre dexaminer les gains escompts (exploitation, amlioration des
performances lies la mise en place de nouvelles fonctionnalits, service rendu aux
utilisateurs,...), les cots de mise en place ou dvolution de chaque application, les cots
administratifs et financiers existants et futurs ainsi que les cots dexploitation
informatique. Un bilan conomique doit tre tabli en prenant en compte les grandes
orientations de la Direction, les objectifs et les cots associs de la qualit de service des
activits informatiques de la socit. A ce stade, plusieurs scnarios peuvent tre
envisags.
tape n6 : valuation de limpact du systme cible pour lorganisation.
Cette tape consiste analyser les procdures en place par activit et par service pour
mesurer les changements potentiels sur lorganisation, les besoins en formation du
personnel et lidentification ventuelle de ressources complmentaires ainsi que les
risques associs la mise en oeuvre du (ou des) nouveau(x) systme(s).
tape n7 : choix dun scnario.
Cette tape doit permettre de slectionner les options par activits de la socit (par
exemple de choisir entre une combinaison de logiciels et de dveloppements spcifiques,
ou une solution de progiciel intgr). Lorsque le schma directeur informatique de la
socit aura t valid par la Direction Gnrale (ou un comit de pilotage), il conviendra
dtudier par la suite les plans de dploiement (dfinition des solutions techniques
retenir, dfinition des phases de migration, etc...) et les plans de slection des solutions
informatiques (rdaction des cahiers de charge pour la solution cible) afin de complter le
systme existant.
85
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
VI - La gestion des ressources humaines (la mise en place dun
modle de carrire)
Nous prsentons ci-aprs les lments cls de la mise en uvre dun modle de
carrire pour permettre le recrutement et lvaluation du personnel (il pourrait tre limit
dans un premier temps au personnel cadre).
Ce modle de carrire prsente les avantages suivants :
Le personnel connat parfaitement ce qui est attendu de lui (transparence du systme)
et est plus capable datteindre les objectifs dfinis dans son plan annuel dobjectifs;
La Direction Gnrale a une plus grande chance de voir ses objectifs connus et
partags par le personnel et dispose de meilleurs indicateurs pour sassurer quils
seront atteints par le personnel;
Ce modle permet la promotion et aussi la rtention du personnel le plus qualifi;
Il permet de dfinir les besoins en formation du personnel et les besoins en
recrutement.
Il est important de noter que la mise en uvre dun tel plan ncessite :
Une bonne prparation du modle de carrire (dfinitions de poste, processus
dvaluation);
Un gestionnaire des ressources humaines et du personnel pour le processus
dvaluation.
1 - Dfinition du modle
Ce modle doit :
Prendre en compte une dfinition prcise des comptences exiges pour les
principales activits et par poste, ceci pouvant tre ralis au travers des fiches de
fonctions dtailles ;
Revoir le modle annuellement pour prendre en compte les changements qui
peuvent intervenir dans lactivit du client ;
86
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Dfinir sur une base annuelle un plan dobjectifs (1) pour chaque personne ;
Permettre la promotion du personnel sur la base dune valuation objective des
comptences et des objectifs (2).
(1) les objectifs doivent tre spcifiques, ralistes, mesurables, dfinis dans le temps et
accepts par le personnel. Ils doivent aussi prendre en compte les attentes du
personnel (changer de poste intervalle rgulier, occuper un poste de responsabilit
5ans, dvelopper des comptences techniques dans un domaine particulier, ne pas se
dplacer gographiquement pour tre proche de sa famille, etc...)
(2) les objectifs de performance devraient inclure des mesures telles que : la satisfaction
des clients via les sondages, le taux dimpays, le lancement de nouveaux produits
russis, le taux de rtention du personnel au sein de la socit, etc...
2 - Comment mettre en uvre ce modle?
tape n1 : tablissement dune cartographie des comptences (souhaites) du
personnel.
La premire tape consiste tablir une cartographie des comptences du personnel selon
un certain nombre de critres, par exemple les comptences techniques, les comptences
commerciales, la capacit encadrer des personnes, etc.
tape n2 : Mise en place dun plan annuel individuel dobjectifs pour chaque
personne.
Il est important de dfinir et de valider des objectifs annuels individuels avec chaque
personne en indiquant comment il sera possible de les mesurer. Dans ce plan, on dfinira
ventuellement les comptences ncessaires acqurir pendant lexercice par la personne
et les moyens pour les acqurir.
tape n3 : laboration dun plan de formation.
Certaines comptences ne peuvent tre acquises que lors de formations (internes ou
externes). Grce au modle de carrire et au plan annuel dobjectifs, la socit connat
87
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
ainsi lensemble de ses besoins en formation qui, une fois regroups, vont lui permettre
de btir son plan de formation annuel.
tape n4 : valuation des performances en fin danne.
Lors dun entretien individuel de fin danne, aprs collecte des informations qui seront
des vidences pour lvaluation, il sera alors possible dvaluer les objectifs initialement
envisags et ceux atteints. Cest sur cette base que lvaluation pourra tre entreprise, en
tenant videmment compte de certains paramtres extrieurs qui ont pu avoir un impact
positif ou ngatif sur la performance de la personne.
tape n5 : Recrutement de personnel additif.
Le modle de carrire doit aussi servir la socit pour son recrutement car les
comptences requises sont dfinies pour chaque poste occup ou occuper.
88
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Dans le cadre de notre mission daudit des comptes (revue analytique), du
contrle interne et des diffrents systmes de contrles ; un ensemble de plans dactions
ont t cits tout au long de notre rapport.
Au final, nous rsumons les plus imminents dentre eux qui tendent couvrir les risques
menaant les objectifs de lentreprise Luxor.
Plans dactions mettre en uvre :
Renforcement du dispositif gnral de contrle interne travers :
La cration dun comit daudit, qui veillera la cohrence des dispositifs de
contrle et la mise en place des mesures correctives pour combler les lacunes
dans le systme de contrle interne. Il assurera un contrle oprationnel de la
Direction ainsi quun contrle sur la fiabilit de linformation communique;
La formaliser des activits de contrle et des procdures de reporting sur
lefficacit des systmes de contrle;
Ltablissement dun plan dentreprise identifiant les objectifs stratgiques moyen
ou long terme et dclin en plans oprationnels mettre en uvre; et
communication des objectifs principaux au personnel;
La mise en place de procdures dvaluation des risques et des systmes de contrle
interne;
Llaboration dun manuel de contrle interne : tablir les manuels de procdures
en prcisant le rle, les responsabilits et les niveaux de contrle.
Mise en uvre de plans oprationnels pour couvrir les risques majeurs dans les
domaines suivants :
89
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Crdit :
- Renforcement de lefficacit du recouvrement;
- Dfinition de rgles de gestion bases sur lhistorique des impays et des crances
irrcouvrables pour diminuer le risque crdit;
- Mise en place dun systme de notation interne (systme de scoring*).
Informatique :
- Mise en place dun rfrentiel de principes et de procdures informatiques;
- Dfinition dune politique de scurit et de continuit dexploitation;
- laboration dun schma directeur informatique.
Trsorerie
- Mise en place dun outil de gestion de la trsorerie;
- Mise en place de procdures formalises de gestion de trsorerie.
*La mise en place dun systme de scoring pourrait savrer intressante pour
lentreprise. Cependant, tant donn la taille rduite de lentreprise et le nombre de
dossiers grs, la mise en uvre dun tel systme bas sur des outils informatiques
pourrait savrer difficile. La dfinition et le respect dun systme de notation interne
(formalisation des rgles de gestion de slection des clients et doctroi de crdits) sont
toutefois indispensables.
Aussi, la revue analytique est le moyen efficace pour identifier, analyser et
matriser les risques. Elle constitue ainsi un outil indispensable pour mieux cerner
lactivit de la socit et ses liens et dpendances envers les tiers, ce qui permet de
vrifier la fidlit de son image quelle communique son environnement.
90
Revue analytique et contrle interne: outils de dtection des risques
Au cours de cette mission, les entretiens qui ont t raliss avec les responsables
de ltablissement ont permis de mettre en vidence des risques jugs importants par les
responsables de ltablissement tudi.
Les principaux risques identifis par les responsables de lentreprise Luxor sont les
suivants :
Taux dincidents de paiement lev;
Dfaillance des clients, incapacit honorer le remboursement des crdits;
Incapacit tisser des alliances avec un partenaire, ou marginalisation de lactivit
dans un environnement trs concurrentiel;
Perte de personnes cls;
Qualification insuffisante du personnel (non spcialisation).
Les entretiens ont mis en vidence un nombre importants de contrles (formaliss
ou pas) au sein de cet tablissement, aussi bien en ce qui concerne la politique globale de
contrle interne quen ce qui concerne la surveillance de risques spcifiques, mais ont
galement mis en vidence des faiblesses importantes de contrle interne.
Pour permettre lentreprise Luxor de matriser ses principaux risques, nous avons
recommand la mise en place de plans dactions.
Nous avons regroup les actions entreprendre en deux parties :
La premire prcise les actions qui auront un impact global sur lamlioration du
contrle interne au sein de lentreprise;
La seconde indique les actions qui permettront de matriser les risques spcifiques
auxquels lentreprise est confronte.
91
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Cycles de Controle InterneDocument22 pagesLes Cycles de Controle InterneJe Suis MagattePas encore d'évaluation
- Audit Du Cycle de TrésorerieDocument24 pagesAudit Du Cycle de TrésorerieSaifEddine Moussahhil93% (14)
- Audit Comptable Et Financier Par Cycle - S8 ACG ENCGADocument37 pagesAudit Comptable Et Financier Par Cycle - S8 ACG ENCGAanas hmidane100% (3)
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- Bouchra MemoireDocument41 pagesBouchra MemoireBouchra Rf100% (4)
- Guide de Revue AnalytiqueDocument28 pagesGuide de Revue Analytiquemootaz ben othmen100% (2)
- Audit Cas PratiqueDocument45 pagesAudit Cas PratiqueHanAz67% (6)
- Audit Des Comptes Et Révisions Annuels Avec ExcelDocument13 pagesAudit Des Comptes Et Révisions Annuels Avec ExcelSith Lord Gunnar100% (2)
- L'Entrepreneuriat Digital: Préparé Par: IBRAHIMI AchrafDocument11 pagesL'Entrepreneuriat Digital: Préparé Par: IBRAHIMI AchrafAchraf Ibrahimi100% (1)
- Valorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesD'EverandValorisation et cession d'entreprise: Opérations de fusions et acquisitions d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Audit (Controle Des Comptes de Capitaux) 01Document33 pagesAudit (Controle Des Comptes de Capitaux) 01Christian Joël100% (1)
- Methodologie DES Sondages EN Audit ET Demarche Pratique Dans LE Cadre DE L'Audit D'Un Etablissement DE CreditDocument174 pagesMethodologie DES Sondages EN Audit ET Demarche Pratique Dans LE Cadre DE L'Audit D'Un Etablissement DE CreditSoufiane100% (1)
- L'Appréciation Du Contrôle Interne Du Cycle Ventesclients Dans Le Cadre D'une Mission de CACDocument45 pagesL'Appréciation Du Contrôle Interne Du Cycle Ventesclients Dans Le Cadre D'une Mission de CAChajaritta9262% (13)
- Audit Des Immobilisations Dans Les Sociétés Industrielles PDFDocument52 pagesAudit Des Immobilisations Dans Les Sociétés Industrielles PDFjehan h100% (3)
- Audit Cycle (Stocks Et En-Cours)Document5 pagesAudit Cycle (Stocks Et En-Cours)MokrZah100% (1)
- Audit Cycle (Ventes-Clients)Document6 pagesAudit Cycle (Ventes-Clients)hocine_kashi100% (3)
- Méthodologie de recherche et théories en sciences comptablesD'EverandMéthodologie de recherche et théories en sciences comptablesPas encore d'évaluation
- Le Système d'information comptable au milieu automatiséD'EverandLe Système d'information comptable au milieu automatiséÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- De Walle Lhumour Dans La Littérature Et Dans L'art de L'ancienne ÉgypteDocument30 pagesDe Walle Lhumour Dans La Littérature Et Dans L'art de L'ancienne ÉgyptePaula Veiga100% (1)
- Audit de La TrésorerieDocument78 pagesAudit de La TrésorerieAyoubTazi80% (5)
- Audit de TrésierurerueDocument64 pagesAudit de TrésierurerueMyriam Essaidi100% (2)
- Audit Des Comptes de Stocks KPMG RABAT PDFDocument72 pagesAudit Des Comptes de Stocks KPMG RABAT PDFyasmine100% (6)
- Stage KPMGDocument4 pagesStage KPMGSofiane AlgerPas encore d'évaluation
- Audit Légal & ContractuelDocument89 pagesAudit Légal & ContractuelChaïmaâ AriouaPas encore d'évaluation
- Etude de Cas Cycle de TrésorerieDocument5 pagesEtude de Cas Cycle de TrésorerieAbou KhalilPas encore d'évaluation
- Audit de La Fonction Ventes ClientsDocument19 pagesAudit de La Fonction Ventes ClientsOussama Belhaj100% (2)
- Revue Analytique deDocument15 pagesRevue Analytique delakhniguePas encore d'évaluation
- Étude de Cas: Contrôle Des ComptesDocument12 pagesÉtude de Cas: Contrôle Des ComptesAziz aarouiPas encore d'évaluation
- Les Normes de L'audit FinancierDocument23 pagesLes Normes de L'audit FinancierHani Wassim83% (6)
- Audit Des CyclesDocument29 pagesAudit Des CyclesZahra Zizo100% (1)
- Audit Des Immobilisations MemoireDocument147 pagesAudit Des Immobilisations MemoireSoundous Bathami80% (10)
- RAPPORT PFE - Conduite Et Réalisation D'une Mission D'audit LégalDocument87 pagesRAPPORT PFE - Conduite Et Réalisation D'une Mission D'audit LégalLahoucineKicha100% (5)
- Audit Financier Et Contrôle InterneDocument107 pagesAudit Financier Et Contrôle InterneHamza HPas encore d'évaluation
- 8 (1) - Audit Des Immobilisations PDFDocument13 pages8 (1) - Audit Des Immobilisations PDFabdel2160% (1)
- Support Cours D'audit Et de Commissariat Aux ComptesDocument184 pagesSupport Cours D'audit Et de Commissariat Aux ComptesMohamed Dera100% (1)
- Seuil de Signification (Audit)Document29 pagesSeuil de Signification (Audit)simomks201475% (4)
- Audit Des Immobilisations Corporelles Dans Le Contexte Marocain Et Retraitements Selon Les Normes USDocument147 pagesAudit Des Immobilisations Corporelles Dans Le Contexte Marocain Et Retraitements Selon Les Normes USSoukaina Ouahid69% (13)
- Audit Par Cycle-IscaeDocument18 pagesAudit Par Cycle-IscaeEssoulahi EssoulahiPas encore d'évaluation
- Audit Des StocksDocument126 pagesAudit Des Stockskotta sergePas encore d'évaluation
- Mazar Cycle Immobilisations CorporellesDocument44 pagesMazar Cycle Immobilisations CorporellesRbaibi Simohamed33% (3)
- Chapitre 4: Les Assertions D'Audit Et Risques D'Audit Section 1: Les Assertions D'AuditDocument5 pagesChapitre 4: Les Assertions D'Audit Et Risques D'Audit Section 1: Les Assertions D'AuditOsmän Abdøu IbrPas encore d'évaluation
- Audit Financier Cycle Vente-ClientDocument6 pagesAudit Financier Cycle Vente-ClientAm InePas encore d'évaluation
- Apport de L'audit Externe Dans L'amélioration de La Gestion D'un ProjetDocument80 pagesApport de L'audit Externe Dans L'amélioration de La Gestion D'un Projetandymf1366100% (1)
- Audit Comptable Et FinancierDocument95 pagesAudit Comptable Et FinancierHicham Messid0% (1)
- Audit - Contrôle Des ComptesDocument19 pagesAudit - Contrôle Des ComptesHicham Dijam100% (1)
- Evaluation Controle Interne PDFDocument57 pagesEvaluation Controle Interne PDFFarrah Soumeur-ZieglerPas encore d'évaluation
- Seuil de SignificationDocument6 pagesSeuil de SignificationkhadijaPas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et FinancierDocument90 pagesAudit Comptable Et FinancierIsmailTouijiltPas encore d'évaluation
- (Audit Avancé) Cycle Achats-FournisseursDocument15 pages(Audit Avancé) Cycle Achats-FournisseursSith Lord Gunnar100% (2)
- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers - Guide d'accompagnement: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers - Guide d'accompagnement: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- Performance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsD'EverandPerformance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsPas encore d'évaluation
- La consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesD'EverandLa consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Rapport AuditDocument48 pagesRapport AuditKhadija Lmoussaoui100% (3)
- L'Audit FinancierDocument4 pagesL'Audit FinancierMELLOUKIPas encore d'évaluation
- 6 Dissertation de Laudit ComplementaireDocument8 pages6 Dissertation de Laudit Complementaireikram ezzariPas encore d'évaluation
- Remercie MentDocument75 pagesRemercie MentahmedPas encore d'évaluation
- Plannification Et Orientation D'une Mission D'auditDocument6 pagesPlannification Et Orientation D'une Mission D'auditMouad MouaniPas encore d'évaluation
- Organisation D'un Service D'audit InterneDocument49 pagesOrganisation D'un Service D'audit InterneSouha Layane100% (46)
- L'Efficacité Du Commissariat Aux Comptes ISADocument21 pagesL'Efficacité Du Commissariat Aux Comptes ISAZIEGLER KH100% (1)
- Harnais 005-2015Document4 pagesHarnais 005-2015SEGPA OUANGANIPas encore d'évaluation
- Burn Out Et Traumatismes Psychologiques PDFDocument161 pagesBurn Out Et Traumatismes Psychologiques PDFMoncef Pecha100% (1)
- Guide Des Librairies Indépendantes de Bretagne 2018Document169 pagesGuide Des Librairies Indépendantes de Bretagne 2018ActuaLittéPas encore d'évaluation
- P002-112-9782753104068.indd 1 30/04/12 14:00Document112 pagesP002-112-9782753104068.indd 1 30/04/12 14:00Kouao AdouPas encore d'évaluation
- A Mwotlap-French-English Dictionary (2012 Version)Document312 pagesA Mwotlap-French-English Dictionary (2012 Version)AlexFrancoisCnrsPas encore d'évaluation
- Tableau de Flux de La CDBDocument12 pagesTableau de Flux de La CDBonokokoskillPas encore d'évaluation
- Itinéraires de Roberto RosselliniDocument184 pagesItinéraires de Roberto Rossellinieduardofillat77Pas encore d'évaluation
- Interagir Avec Des Boutons - Apprenez À Programmer en JavaDocument21 pagesInteragir Avec Des Boutons - Apprenez À Programmer en JavaMohamed Rbihi0% (1)
- Le Relevé D'office Par La Cour de Justice Dans Le Cadre Du Renvoi Préjudiciel PDFDocument126 pagesLe Relevé D'office Par La Cour de Justice Dans Le Cadre Du Renvoi Préjudiciel PDFayoub2310Pas encore d'évaluation
- St02 2014 Aboudrar Poster v01Document1 pageSt02 2014 Aboudrar Poster v01JUNGPHPas encore d'évaluation
- Tableau SoulDocument3 pagesTableau SoulCoulibalyPas encore d'évaluation
- Les Vertiges de L'amour - TownleyDocument448 pagesLes Vertiges de L'amour - TownleyDanyPas encore d'évaluation
- Guide Technique - Valorisation Des Matériaux LocauxDocument42 pagesGuide Technique - Valorisation Des Matériaux LocauxOusseynou Ndiaye100% (2)
- La Terre VaDocument3 pagesLa Terre VaRassouma AdouPas encore d'évaluation
- Les GrainesDocument3 pagesLes Grainesninja750Pas encore d'évaluation
- 2014 Séminaire Arc 5403Document6 pages2014 Séminaire Arc 5403Greb LahPas encore d'évaluation
- La D Formation de Sperngel Propos de 3 CasDocument3 pagesLa D Formation de Sperngel Propos de 3 Caseella26870% (1)
- Description Et Etude Des Indicateurs de Maintenance de Top Drive tds-11Document66 pagesDescription Et Etude Des Indicateurs de Maintenance de Top Drive tds-11BRAHIM FEKAOUNIPas encore d'évaluation
- Chap 3 Physique AtomiqueDocument32 pagesChap 3 Physique AtomiqueJulien Hordélin OkouembéPas encore d'évaluation
- Proposition D'une Méthode de Justification Des Diaphragmes Horizontaux de Plancher BoisDocument41 pagesProposition D'une Méthode de Justification Des Diaphragmes Horizontaux de Plancher BoistotoPas encore d'évaluation
- Déclaration Rectificative ADC200F 16IDocument1 pageDéclaration Rectificative ADC200F 16IMohamed El HillalyPas encore d'évaluation
- Corrigé TD2Document4 pagesCorrigé TD2khelifasiwar90Pas encore d'évaluation
- 300 Questions Rencontrees Au BarreauDocument67 pages300 Questions Rencontrees Au Barreaustan big0% (1)
- Le Consommateur Et Son ComportementDocument10 pagesLe Consommateur Et Son Comportementabdelmajid en-namiPas encore d'évaluation
- 1BTN - Gestion - Chapitre 12 - Les Approvisionnements - CoursDocument11 pages1BTN - Gestion - Chapitre 12 - Les Approvisionnements - CoursSoulaiman HarrakPas encore d'évaluation
- Contrat Type CeDocument4 pagesContrat Type CeWladimir CRPas encore d'évaluation
- NOTE DE PRESENTATION DES OBJECTIFS DU CCD - BisDocument3 pagesNOTE DE PRESENTATION DES OBJECTIFS DU CCD - BisRomuald Arthur MbanaPas encore d'évaluation
- Dédicace À Ptolémée IX Sôter IIDocument10 pagesDédicace À Ptolémée IX Sôter IIMichel DisderoPas encore d'évaluation