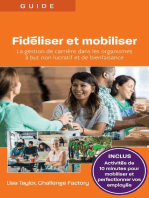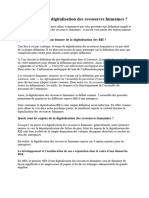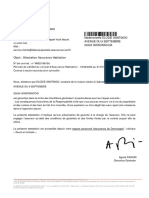Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
L Impact Des Solutions E RH Et SIRH Dans L Entreprise
L Impact Des Solutions E RH Et SIRH Dans L Entreprise
Transféré par
Miloudi SofianeTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
L Impact Des Solutions E RH Et SIRH Dans L Entreprise
L Impact Des Solutions E RH Et SIRH Dans L Entreprise
Transféré par
Miloudi SofianeDroits d'auteur :
Formats disponibles
Mmoire de fin dtude
El karkhi Zoubida
M2 Management des Ressources Humaines
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
El karkhi Zoubida
M2 Management des Ressources Humaines
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
REMERCIEMENT
Ce mmoire est semblable toute recherche qui a d tre encourage
pour aboutir.
Quil sagisse de conseils, de suivi, dimplication ou de soutien moral, je
reste redevable de nombreuses personnes, quelles trouvent ici
lexpression de ma profonde gratitude.
Je madresse tout dabord mes professeurs qui mont t dun apport
considrable, non seulement leurs orientations et leurs remarques
pertinentes mais surtout par leurs professionnalisme empreint
dexprience.
Mes remerciements vont aussi ma famille, mes collgues et mes amis
qui, avec cette question rcurrente, cest quand la soutenance ? , bien
quangoissante en priode frquente de doutes, mont permis de ne jamais
dvier de mon objectif final.
Je tmoigne de la gratitude pour toute personne qui ma aid finaliser
ce travail
Ces remerciements ne peuvent sachever, sans une pense particulire
pour mes parents. Leurs encouragements sont pour moi les piliers
fondateurs de ce que je suis et de ce que je fais.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Sommaire
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE :
Section 1 : (SIRH) Le systme dinformation Ressources humaines
Premire partie | Le concept des SIRH
1-Prsentation du concept du SIRH
1-1. Dfinition dun systme suivant Jean-Louis Le Moigne
o 1-2. Quest ce quun SIRH ?
o 1-3. Structure dun SIRH (schma)
o 1-3-1. Module oprationnel
o 1-3-2. Module pilotage
o 1-3-3. Systme dinformation
1-4. Les 4 ges de linformatisation des Ressources humaines
o 1-4-1. Lge de pierre : le progiciel de paie
o 1-4-2. Lge de bronze : le progiciel RH
o 1-4-3. Lge de fer : le SIRH
o 1-4-4. Le SOA (architecture oriente services) sera-t-il
lge dor ?
1-5. La Pratique de la modlisation
2- Rle du SIRH
3-Caractristiques du SIRH
4- Structure du SIRH
Deuxime partie | Les aspects oprationnels du SIRH
1- La gestion du personnel
1-1. La gestion administrative
1-2. La gestion des missions
1-3. La gestion de la formation
1-4. Les outils groupware et workflow du SIRH
2- La gestion des donnes relatives au salari
La gestion du dossier salari
La gestion des contrats de travail
3- La gestion des temps
4- La gestion de la paie
Troisime partie | Les aspects dcisionnels du SIRH
1- La prvision de la masse salariale
2- La GPEC
3- Le bilan et laudit social
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Quatrime partie | Limpact des solutions SIRH dans lentreprise
1- Impacts sur les effectifs et les cots
2- Impacts sur les salaris
3- Impacts sur les comptences
4- Impacts sur les managers
5- Impacts sur les quipes RH
Cinquime Partie | le Benchmark SIRH
o Exemple Benchmarking SIRH Cas Socit DANAE
Benchmark 2006
Benchmark 2007
Benchmark 2009
Benchmark 2010
Section 2 : Etude de Cas
Mise en place dun Progiciel de Gestion intgre au Campus universitaire Priv de
Marrakech
Phase Prparatoire
o Enqute de Satisfaction par questionnaire
Phase Analyse
o Analyse Questionnaire
Phase Implmentation
Phase Suivi
(Page 60 conduite de projet)
Exemples de Progiciel de gestion RH :
Sage Suite RH, 1er ERP de la gestion sociale pour les PME
Conclusion
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
La dfinition dun systme selon jean-Louis Le Moigne
Un systme peut tre dfinit comme :
1-Quelque chose (un objet)
Dans laction qui consistera modliser lobjet, il ne faudra pas perdre de vue que nous
cherchons reprsenter existe. On a souvent tendance en matire de systme dinformation et
doutils de gestion vouloir modliser ce que lon en tte, sans se remmorer que lobjet
modliser appartient au monde rel. Cette existence de lobjet entrane que la validation du
modle, qui en consiste une reprsentation, cest sa capacit en prdire les comportements,
dans le cadre de simulations.
2- Qui dans quelque chose (son environnement)
Linteraction entre le systme et son environnement constitue galement un facteur dont on
peut tirer de nombreuses consquences en matire de gestion des organisations. Lorganisation
est vue comme un systme en interaction avec un environnement, compos lui-mme de
nombreux autres systmes. Cette vision de lorganisation implique quelle ne peut se
concentrer uniquement sur son fonctionnement interne mais doit, au contraire, saxer sur les
interactions quelle entretient avec les autres systmes constituant son environnement
3-Pour quelque chose (sa finalit)
Lorganisation, entant que systme, poursuit un but. Elle recherche soit un profit rpartir ses
actionnaires, soit un service rendre la collectivit ou un groupe dayants droit. Cette
caractristique est trs importante, car il faut tre conscient de ce quest le but de lorganisation
et il faut un minimum de consensus sur celui-ci.
4- fait quelque chose (son activit)
Pour atteindre le but, il faut une activit, cratrice de valeur ajoute. Cette activit est mene
que par les diffrents acteurs de lorganisation. Cela redonne toute sa place lhumain, qui est
le seul facteur de cration de valeur.
Cela dmontre galement laspect dynamique inluctable. Lactivit cratrice transforme
lorganisation en linscrivant dans un mouvement perptuel, en interaction avec les acteurs de
son environnement.
5-Par quelque chose (sa structure)
Comment mener lactivit, qui permet dattendre le but ? Grce une structure, qui permet
dorganiser laction des diffrents acteurs et de faire circuler les flux ncessaires
6-Qui se transforme dans le temps (son volution)
Laction cration constitue un processus de transformation de ressources. Elle a un impact sur
lorganisation elle-mme.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Quest ce quun SIRH ?
Un SIRH est un systme intgr qui regroupe les applications informatiques sui grent
les ressources humaines, des plus classiques comme la paie ou la gestion du temps, aux
systmes dvaluation ou de formation. Le SIRH peut tre lui-mme un module dun ERP.
Ses principales fonctions vont de la gestion administrative du personnel (dossiers, suivi), la
paie, la gestion des rmunrations, la gestion des temps et des activits (GTA) , la gestion des
comptences et de la formation, la mobilit et gestion de carrires ou encore au recrutement.
Un SIRH est un rseau informatique priv, lintrieur dune organisation, qui utilise
les protocoles de communication et les techniques du rseau Internet.
Or, beaucoup dentreprises ont le sentiment de possder un SIRH lorsquelles mettent
disposition un certain nombre dinformations (note de nomination, actualit, protocoles
daccords divers) Notons toutefois quun internet interconnect avec, par le logiciel de paie
et qui gnre ainsi des flux dinformations (Workflow) entre les diffrentes bases de donnes,
fait bien partie intgrante dun SIRH.
Les interfaces intranet favorisent la dcentralisation de la collecte des informations
(absences, demandes de congs) et lautomatisation des circuits dapprobation. Enfin, la
prsence dun Workflow administratif est utile pour suivre les diffrentes dmarches (demande
de congs, gestion des horaires).
Figure 1 Ce que recouvre le terme SIRH
ERP : Entreprise ressources planning =PGI : progiciel de Gestion Intgr : ensemble de logiciels intgrant les principales
fonctions ncessaires la gestion des flux et des procdures de lentreprise (comptabilit, finances, logistique, paie et ressources
humaines, etc.) tous ces logiciels accdent des ressources communes, en particulier des bases de donnes.
GTA : Gestion des temps et des Activits, gestion du temps de prsence, heures supplmentaires, repos compensateurs, temps
partiel sont au menu de la GTA qui peut assurer aussi le contrle des badgeuses et autres pointeuses modernes.
Workflow : Gestion lectronique de processus : technologie logicielle ayant pour objectif lorganisation des processus de
fonctionnement dune entreprises leur mise en uvre. La gestion lectronique de processus implique la modlisation des
processus de travail et la prise en compte de tous les aspects relis au fonctionnement de lentreprise.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Structure dun SIRH :
Figure 2 - Un systme est compos de 3 types dlments
Des modules oprationnels
Ils mnent lactivit cratrice de valeur ajoute. Pour cela ils prsentent plusieurs
caractristiques essentielles :
-lorganisation doit trouver les ressources de toutes natures, qui feront lobjet des processus de
transformations par les modules oprationnels lextrieur, c'est--dire auprs dautres
systmes de son environnement.
- les modules oprationnels sont donc au contact permanent des acteurs de lenvironnement.
Paralllement leurs oprations de transformation des flux. Ils collectent les donnes sur les
conditions dobtention des flux entrants et sur la perception de flux sortants par
lenvironnement.
Les modules oprationnels ont donc deux fonctions fondamentales pour la vie de
lorganisation :
La cration de valeur dans le cadre de lactivit, qui va permettre datteindre le but
La connaissance des conditions dans lesquelles se droule lactivit, grace la
collecte des donnes au sein de lenvironnement.
Des modules pilotes
Ils permettent les dcisions stratgiques et tactiques et doivent faire en sorte de les faire
appliquer par les modules oprationnels. Pour prendre des dcisions, les modules pilotes ont
besoins dinformations sur les conditions de lactivit du systme quils pilotent. Ces
informations seront issues de la collecte des donnes, effectue par les modules oprationnels,
qui sont au contact de lenvironnement, tandis que les modules pilotes ne le sont pas.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Le systme dinformation
Il assure le couplage organisationnel entre les modules oprationnels et les modules pilotes. Un
de ses rles essentiels est de maitriser lentropie dans le droulement du processus de
croissance de lorganisation.
Lorganisation est vue comme un systme vivant et ouvert, intgr dans un environnement luimme compos dautres systmes avec lesquels il entre interaction.
On constate que le systme dinformation est donc un lment composant dun systme qui
assure le couplage organisationnel entre les modules oprationnels, qui assurent les processus
de transformation des flux entrants en flux sortants, crateurs de valeur ajoute. Et les modules
pilotes, qui prennent les dcisions et contrlent les rsultats obtenus
1-4. Les 4 ges de linformatisation des Ressources humaines
Lge de pierre : le progiciel de paie
A la fin des annes 60, linformatique vient de faire un pas de gant en passant de la
mcanographie lordinateur. Linformaticien, bien que cherchant raliser des
applications conformes ce qui lui est demand, se trouve dans une position dominante
du fait de ses connaissances techniques et de son langage.
Cela se rquilibre dans les annes 70 et au dbut des annes 80. La culture informatique
se rpand et lutilisateur comprend un peu mieux le langage de linformaticien. Commence
alors se poser la question de la relation entre informaticiens et utilisateurs. La raison est
que linformatique ralise de plus en plus dapplications pointues pour des utilisateurs
de plus en plus exigeants. Les utilisateurs osent enfin exprimer des demandes quils
commencent formaliser. Cest le dbut dune priode un peu surraliste, caractrise par
laccumulation de demandes des utilisateurs qui sentassent sur le bureau des analystes et
des programmeurs. Cest lpoque dore des informaticiens, qui sont dsirs, courtiss et
qui font tout leur possible pour rendre service.
Cela conduit des situations cocasses comme celle dun utilisateur qui, se faisant livrer la
nouvelle version tant attendue de son journal de paie, constate la premire dition, quil
a oubli par mgarde de prciser dans sa spcification dtaille quil voulait un total
gnral en bas du listing.
Il fait donc une demande complmentaire qui est place, rglement oblige, sous la pile des
demandes en attente.
Au final, pour un montant absent en bas dun tat, lutilisateur va devoir attendre des
mois, si ce nest pas des annes, pour obtenir satisfaction.
Face ce marasme quasi gnral, la communaut informatique propose une solution
originale: rendre les applications paramtrables.
Cela consiste donner la main lutilisateur sur une partie trs rduite de son application,
sans pour autant quil dispose de comptences informatiques et quil mette en pril le
traitement lui-mme. Il peut ainsi personnaliser quelques rgles de paie, modifier
quelques libells et mettre en forme quelques tats standard en choisissant ses en-ttes,
ses ruptures, ses arguments de tri.
Le premier package de paie (on nemploie pas encore le terme de progiciel) est n.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Pour les entreprises, cette nouvelle approche est une aubaine car, quoi quon en dise,
quest-ce qui diffrencie la paie dune entreprise de la paie dune autre entreprise ? Rien,
si ce nest la couleur du bulletin de paie. Le progiciel ralise dsormais en standard toutes
les fonctions de bases, savoir, calculer et diter des bulletins de paie, des journaux de
paie, des livres de paie, des tats comptables, des dclarations, etc.
Alors pourquoi se lancer dans le dveloppement interne lourd et coteux dun systme de
paie alors quil existe des solutions standardises ?
Autrement dit Pourquoi rinventer la roue ? .
Lge de bronze : le progiciel RH
Jusquau milieu des annes 90, les entreprises disposent ainsi dun systme de gestion de
personnel mono processus qui assure le traitement de paie avec brio. La culture
informatique des DRH est faible, et bien que les utilisateurs aient quand mme un rle
jouer,
elles
sen
remettent
en
grande
partie
la
DSI.
Cest dans cette mme priode que des problmatiques nouvelles apparaissent : avec la
monte du temps partiel, plusieurs mesures gouvernementales font entrer la paie dans
une autre dimension (mesures incitatives de rduction des charges patronales, nouvelles
contributions, nouveaux types de contrats, etc). Sous la pousse des nouvelles lois, la
paie se complexifie, de nouvelles rubriques apparaissent sur les bulletins de paie. On
commence demander de plus en plus danalyses soit au systme de paie, si celui-ci le
permet, soit des systmes spcifiques pour compter les heures de dbit-crdit, et ainsi
alimenter dautres systmes priphriques comme la gestion de production.
Trs rapidement le progiciel de paie sessouffle. Pour suivre une rglementation de plus en
plus complexe, les diteurs proposent de nouvelles versions de leurs produits. Leur offre
senrichit de nouveaux processus, comme la gestion du temps, la gestion de la formation,
btis sur le mme principe douverture que le processus de paie, mais surtout il existe
dsormais
un
outil
de
requtes
la
porte
des
utilisateurs.
Cette avance enthousiasme la fois DSI et utilisateurs de la DRH dautant plus que ces
derniers commencent acqurir une certaine culture informatique mais aussi une certaine
autonomie grce lvolution de la micro-informatique.
Lge de fer : le SIRH
A partir de lanne 2000, on constate deux types darchitecture dans les entreprises :
le progiciel unique de type couteau suisse qui prend en compte tous les processus
RH mais qui comporte souvent des lacunes ncessitant lapport de dveloppements
internes,
la cohabitation de plusieurs progiciels ddis, de type best of breed , interfacs entre
eux autour dun progiciel matre vritable rfrentiel des dossiers individuels.
Postes, emplois et comptences, entretiens et valuations, carrires, recrutement et
mobilit, units dorganisation, sont autant de processus nouveaux qui viennent complter
ceux existants. Traitements collaboratifs, workflow, gestion vnementielle entrent dans le
langage des gestionnaires RH.
Pour couronner le tout, la e-RH donne la main de nouveaux acteurs, les collaborateurs,
les managers au travers de portails RH, de self-services et autres solutions intranet.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Le SIRH vient dacqurir ses lettres de noblesse.
Aujourdhui, les avantages de solutions base de progiciels ne sont plus dmontrer :
un projet interne allg par une mise en uvre rapide de la solution,
une paie et une GRH prte lemploi,
une prise en compte par lditeur des volutions lgales,
un outil de requte la porte des utilisateurs,
une quipe informatique rduite et mme parfois inutile,
une matrise totale des processus par la DRH,
le partage dun savoir-faire par plusieurs entreprises,
une mutualisation des besoins par lditeur,
lajout de nouveaux processus rpondant lvolution de la fonction,
Le SOA sera-t-il lge dor ?
Tout semble avoir t explor dans le domaine des SIRH quand on regarde le chemin
parcouru
depuis
quelques
dcennies.
Cest sans compter sur la technologie qui poursuit inluctablement son avance fulgurante
et
qui
na
pas
fini
de
nous
surprendre.
Dsormais tout est possible, il suffit dun accs haut dbit, dun cran et dun clavier. La
technologie a boulevers la fonction ressources humaines et va continuer le faire. Mais
ce nest pas grce elle que la fonction RH sera plus performante, mais plutt
loriginalit des outils que lon va dvelopper et la qualit de la communication entre ces
outils.
Avec la multiplication des logiciels composant le SIRH sont apparus de nouveaux besoins :
faire communiquer ces systmes techniques entre eux, mais aussi de nouvelles difficults
: dvelopper et maintenir des interfaces que les diteurs se gardent bien de fournir.
Pour la DRH, force est de refaire appel une DSI quelque peu oublie pour mettre en
place
ces
interfaces
complexes
et
souvent
fragiles.
La rponse viendra peut-tre de l'architecture oriente services (de l'anglais Service
Oriented Architecture, ou SOA). Elle propose de dcouper les fonctionnalits dune
application ou dun systme en service mtier , rutilisables dans dautres
applications
ou
systme.
La voie du SOA sera-t-elle emprunte par nos chers diteurs ? Sans doute, car il y a l
matire proposer de nouvelles versions, de laccompagnement et du conseil. La plus
grosse
difficult
sera
pour
eux
de
saccorder
sur
un
socle
standard.
Pour les utilisateurs, les ractions sont mitiges, certes la solution est sduisante mais
devra-t-elle encore une fois passer par un projet SIRH big bang ?
La pratique de la modlisation :
Action dlaboration et de construction intentionnelle, par composition de symboles, de
modles susceptible de rendre intelligible un phnomne peru complexe et damplifier le
raisonnement de lacteur projetant une intervention dlibre au sein du phnomne :
Raisonnement visant notamment anticiper les consquences de ces projets dactions
possibles.
Le gestionnaire, quelle que soit s spcialit, doit devenir un spcialiste de la modlisation.
Cest la seule mthode quil peut mettre en uvre pour arriver comprendre :
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
la nature des problmatiques quil a rsoudre
le fonctionnement des sous-systmes qui lentourent ou dont il a la
responsabilit
les solutions alternatives qui soffrent lui
Il pourra alors choisir la solution lui paraissant la plus adquate linstant donn pour
solutionner le problme.
2-Le Rle du Systme dinformation :
1- Linstrument du couplage entre modules oprationnels et modules pilote au sein de
lorganisation
Lefficacit de la prise de dcision et la rapidit de la raction aux modifications des conduites
de lenvironnement, dans tous les domaines, dpendent de la qualit de ce couplage en terme :
de rapidit de transmission de linformation.
De fiabilit des informations transmises, non-dformation par des bruits parasites.
De compltude de linformation. Il ne doit pas y avoir domission dans la transmission
de donnes.
Dadquation de linformation transmise, par rapport aux besoins du destinataire.
Chaque destinataire de linformation aura des besoins caractriss par sa position
hirarchique et son rle fonctionnel dans lorganisation
2- Le mmoire de lorganisation
Une entreprise qui perd sa mmoire perd son histoire, son savoir et son savoir faire. Lamnsie
est aussi dsastreuse chez un tre social que chez un tre humain. La crativit, permettant de
rsoudre les problmes, autant fonde sur le raisonnement analogique, il est trs important de
capitaliser ses connaissances, pour accroitre son potentiel comme le fait le cerveau humain.
Malheureusement de nombreuses organisations ne sont pas structures pour prendre en main
correctement cette fonction de mmorisation, qui ncessite le stockage des informations, mais
galement leur mise disposition en cas de besoin.
3-linstrument de la mise en forme des donnes
Pour que chacun dans lentreprise possde linformation adquate au bon moment, le SI doit
non seulement faire circuler les donnes, mais les mettre en forme, conformment aux besoins
de chaque destinataire. Ladquation de linformation au destinataire doit prendre en compte sa
position et son rle dans lorganisation. Cela permettra chaque acteur de rpondre aux types
de questions quil rencontre dans lexercice de son poste travail au bon moment
La relation complexe entre information et organisation apparat donc fonde sur un rapport
dialectique. Linfirmation permet dinformer lorganisation. Lorganisation progresse et
apprend. Elle va formuler de nouvelles demandes, qui vont permettre dorganier linformation
et dapprofondir le SI. On entre ainsi dans une spirale de progrs mutuels, lorsque
lorganisation sapproprie le SI et lui renvoie de nouvelles demandes. Malheureusement, cette
spirale peut galement fonctionner de manire ngative, lorsque le SI est trop loign des
besoins de lorganisation ou lorsque lorganisation refuse de se lapproprier. Cette relation
dialectique complexe entre organisation et SI correspond au concept de
paradigme inforgtique de Jean Louis Le Moigne
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
3- Les caractristiques du systme dinformation
Figure 3. Structure Standard de tout Systme dinformation
Axe1 : informations reprsentations des flux manipuls par les modules oprationnels,
qui correspondent aux donnes relles
Laction sur les flux matriels, montaires ou humaines entrants ralise par les modules
oprationnels, pour les transformer en flux sortants, saccompagne de flux dinformation ou
donnes, que les modules oprationnels (MO), doivent collecter pour les entrer dans le systme
dinformation.
Ces informations reprsentent les divers flux, en nature et en dbit.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Les modules oprationnels auront donc pour tache de permettre au systme dinformation
lacquisition immdiate et complte de ces flux de donnes. Cette acquisition devra avoir
recours aux techniques adquates pour que lentreprise obtienne les informations dans les
dlais requis.
Axe2 : informations traitement des flux (applications oprationnelles)
Le systme dinformation va permettre de traiter les flux dinformations volumineux et
rptitifs, qui sont lis la transformation des flux entrants en flux sortants par les modules
oprationnels.
Cette partie des fonctions du systme dinformation constituera les applications
oprationnelles du systme informatique de gestion.
Ces applications permettent de :
-Dcharger les MO de traitement longs et fastidieux galement sources derreurs ;
-Implmenter dans les applications oprationnelles :
les rgles de gestion de lorganisation, notamment celles de type dcisions
rflexes
le contrle des droits et obligations des acteurs des groupes de travail
(groupware), pour aider la formalisation des processus,
les moyens de faire circuler linformation au sein des groupes de travail, qui
prennent en charge les processus afin dviter les erreurs et omissions.
-Alimenter en donnes les modules pilotes, afin de leur fournir les outils de contrle de
gestion, permettant de juger de latteinte des objectifs, et des outils daide la prise de
dcision.
Les donnes, qui sont lies aux manipulations de flux par les modules oprationnels, sont la
source de linformation des modules pilotes. Elles leur permettront de comparer les objectifs
assigns avec les ralisations et de prendre des dcisions pour les orientations venir de
lorganisation.
Axe 3 : Informations daide a la dcision respectant le niveau hirarchique et langle de
vue du destinataire
Le systeme dinformation va galement permettre de diffuser auprs des dcideurs des
informations pertinentes, avec un dlai suffisamment bref et sans dformation.
Cette partie du systme dinformation constituera les applications dcisionnelles du systme
informatique de gestion.
Dans le couplage entre modules oprationnels et pilotes, le systme dnformation na pas pour
unique fonction de faire circuler les informations, mais galement de les rendre plus ou moins
synthtiques et de les adapter au point de vue du destinataire.
En ce qui concerne les diffrences dangles de vue, elles sont lies au fait, qu un mme
niveau hirarchique, les diffrents acteurs nont pas les mmes rles. Leurs primtre de
dcision est diffrent. Les natures des dcisions prendre divergent de lun lautre. Ils ont
donc besoin dinformations diffrentes, mme si elles sont au mme niveau de synthse, et si
leurs donnes dorigines sont les mmes.
Axe 4 : informations concernant les objectifs assigns lors de la dmarche budgtaire
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Le module pilote pourra galement fixer les objectifs, qui seront mmoriss et contrls par le
systme dinformation. La dmarche budgtaire doit avoir pour mission de dfinir les objectifs
atteindre et de les dcomposer au niveau de responsabilit de chacun. Ce mcanisme sera la
base de la dlgation de responsabilit et du contrle de la ralisation par la hirarchie. Pour
pouvoir automatiser ce systme, il est ncessaire que les donnes prvisionnelles, que
constituent les objectifs, soient intgres dans le SI. On pourra automatiser la production du
contrle de gestion, suivant les rgles de gestion tablies, avec les donnes relles prsent dans
le SI, ds la gestion des flux de lactivit.
Axe5 : Informations concernant les dcisions prises par les modules pilotes
Les modules pilotes vont pouvoir prendre des dcisions, en sappuyant sur les informations qui
leur sont fournies par les outils daide la dcision.
Prendre une dcision ne suffit pas. Ce qui est plus difficile cest dobtenir sa transformation en
action.
Pour que cela soit possible, il faut que les acteurs oprationnels qui vont transformer la dcision
en action soient informs de la dcision. Il faut donc pouvoir intgrer la dcision dans le
systme dinformation. Cette dcision peut porter tant sur les mthodes de travail et rgles de
gestion que sur les rsultats obtenir.
Axe6 : informations expression des dcisions prises par les modules pilotes
Le SI doit permettre de transformer les dcisions globales en informations oprationnelles
adquates pour laction. Les dcisions globales prises par la hirarchie doivent tre dtailles et
traduites par rapport aux consquences quelles entranent pour chaque module oprationnel.
Le SI, sil est correctement structur, assurera effectivement le couplage entre modules
oprationnels et modules pilote. Il permettra donc le contrle et la rgulation du systme et
lorganisation.
Axe 7 : informations informelles non intgrables dans le systme dinformation
En dehors de lintervention du SI, les donnes acquises par les modules oprationnels circulent
de manire informelle. Cette circulation dinformations se fait sans aucune adaptation, mais
parfois avec des distorsions, sans aucune fiabilit et sans quaucun dlai de transmission ne
puisse tre dtermin. Il en est de mme pour mes dcisions prises par les modules pilotes, qui
doivent tre transmises aux modules oprationnels pour action.
Cependant, certaines informations ont, par nature, un caractre informel et sappuient sur des
relations interpersonnelles qui rendent impossible, et mme non souhaitable, lintervention du
SI dans leur circulation. Elles doivent conserver leur caractre de subjectivit.
Dans les annes soixante-dix et quatre-vingt, on avait tendance penser que des applications
intgres permettent de dbarrasser les dcideurs de prises de dcisions qui semblaient
lmentaires, comme le rapprovisionnement des matires er marchandises. On pensait alors
que les modles de gestion de stocks implments dans les applications permettraient de savoir
que, le stock dalerte tant atteint et le lot conomique de commande ayant t fini, le systme
pourrait passer les commandes aux fournisseurs pour maintenir les stocks leur niveau requis.
Ctait omettre la complexit de la ralit. Une dcision, si modeste puisse-t-elle paratre, ne
peut maner que dun tre humain. Le rle du SI est dalerter, dattirer lattention et de
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
proposer une action. Son rle sarrte la. La dcision appartient lacteur en charger de la
responsabilit.
Structure DU SIRH
Les deux remarques qui sont garder lesprit :
1- Le SIRH est une composante du SI de lorganisation. A ce titre, il est ncessaire de
modliser les points dinteraction entre le SIRH et les autres composants du SI.
Exemple : dans une industrie, il ya une interaction forte entre le SIRH et la GPAO (Gestion de
production assiste par ordinateur). Les heures effectues par le personnel ouvrier, les primes
qui leur sont attribues ou les absences, informations utilises par la paie, maneront de la
GPAO.
2-Le SIRH est constitu dune partie oprationnelles et une partie dcisionnelle.
Comme cest le cas pour la structure globale su SI de lorganisation, on rencontrera :
des aspects lis la gestion de lactivit courante, par les modules oprationnels,
des aspects dcisionnels, permettant aux modules pilotes dtayer leurs prises de
dcisions.
Les lments composant la partie oprationnelle et la partie dcisionnelle du SIRH sont
reprsents dans la figure ci- dessous.
Cette figure prsente les mmes structures et principes dans le domaine RH que dans
lensemble du SI.
Notamment, il existe :
une infrastructure entre les composants oprationnels ou dcisionnels
(Traits pointills ..) ;
Une incidence des donnes oprationnelles sur la prise de dcision, puis des dcisions
par laction oprationnelles (traits pleins ____) ;
Une alimentation du reporting que constituent le bilan et laudit social, par les autres
composants, tant oprationnels que dcisionnels (traits tirets -----)
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Figure 4. Structure Du SIRH au sein de lorganisation
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Un certain nombre doprations de traitement de donnes est ncessaire pour la gestion
quotidienne du personnel. Elles constitueront laspect oprationnel du SIRH.
Mais, cest galement un domaine ou de nombreuses dcisions stratgiques et tactiques sont
prendre, dans un environnement incertain et mouvant. Des outils daide la dcision sont donc
indispensables pour piloter les ressources humaines au sein de lorganisation.
Qui plus est, lorganisation est assaillie denqutes diverses et de contrles, manent de
diffrents organismes. La rponse ces diverses demandes exige de manipuler les informations
concernant le personnel, contenues dans le SIRH. Des outils de requtes et de reporting seront
donc indispensables.
Le SIRH devra avoir une unicit entre ces diffrents traitements. Les informations traites en
GRH, au sens strict du terme, qui sont plutt orients vers le dcisionnel et le pilotage, sont
extraites des donnes oprationnelles de la gestion quotidienne du personnel. Il ya donc tout
intrt assurer la cohrence et la continuit au sein de lensemble des composants de SIRH.
Or, on constate dans la ralit frquemment que les modules logiciels constituant le SIRH ne
sont pas capables de communiquer.
Exemple
Le logiciel de paie et celui de gestion des donnes relatives aux ressources humaines
(carrires, GPEC, etc.) sont distinct, voire incompatibles.
Cela entraine de nombreux dysfonctionnement et de nombreuses lacunes au niveau de SIRH.
La consquence est lapparition dun phnomne dentropie couteux plusieurs niveaux (couts
des heures de travail, couts de lindispensabilit de linformation, etc.)
Lentropie est mesurable au nombre de fois o lon recourt des feuilles de calcul de tableurs
pour traiter une information non disponible dans les autres outils ou inexploitable cause de
leur manque de compatibilit.
Certes, il existe sur le march des solutions globales, gnriques, qui sont censes permettre
toutes les organisations de couvrir tous leurs besoins en matire de GRH. Elles sont le plus
souvent lourdes et couteuses et ne correspondent pas ncessairement pour autant aux besoins
spcifiques din secteur dactivit, aux rgles particulires dne convention collective ou dun
rglement intrieur, ou aux rgles lgales et rglementaires en usage dans le pays.
Les couts induits de ces dysfonctionnements sont :
Limproductivit du travail engendrant de nombreuses heures de travail gches en
taches dexcution inutiles ou en doublons de taches ;
La non-qualit des rsultats, lie aux erreurs de reports ou dinterprtation des donnes
ou aux retards dans la disponibilit des rsultats cause de limproductivit du travail ;
La non-disponibilit des rsultats, dans les dlais requis ou dans labsolu, faute de
possder les donnes ncessaires ou dtre en mesure deffectuer les traitements requis
pour ces donnes.
Partie 2 :
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Les aspects Oprationnels du SIRH
Actuellement la gestion oprationnelle de RH comporte de nombreux aspects et beaucoup de
contrainte. Les origines de ces contraintes sont trs diverses. Elles peuvent tre :
Lgales
On constate que les lois sont trs nombreuses pour modeler le contexte des relations sociales.
Conventionnelles
Les conventions collectives fournissent un cadre obligatoire en de nombreuses matires,
notamment relatives la rmunration, lanciennet, etc.
Rglementaires
A caractre exogne par exemple un arrt prfectoral concernant louverture des
commerces certaines priodes. Mais il peut galement sagir de prescription du
rglement intrieur de lorganisation.
A caractre endogne lorganisation peut disposer dun rglement intrieur qui se
surajoute aux dispositions lgales et issues de la convention collective
Economiques
Lorganisation peut chercher optimiser laffectation du temps de travail, a bnficier de
contrats de travail aids, ou dallgement de charges sociales patronales, etc.
Les facteurs communs a toutes ces contraintes rsident dans la fait que, pour les grer sans
provoquer dentropie (dsordre du systme) et sans faire courir de risques lorganisation,
comme des actions prudhomales ou des redressements de cotisations par exemple, il faut
pouvoir :
Traites un volume dinformations trs important
Dans des dlais trs courts et impratifs
Avec une qualit voisine de la perfection, en termes de fiabilit et dexhaustivit
Constituer des moyens de preuves, tant au niveau des rsultats obtenus que des
mthodes appliques. Lobjectif est de permettre, en cas de contrle de la part de divers
organismes de dmontrer lexactitude des informations qui leur ont t fournis et le
respect des rgles en vigueur au moment ou le traitement est intervenu.
Compte tenu de la complexit croissante apporte par le mode de fonctionnement actuel autour
des donnes relatives au salari, il faut possder des outils qui permettent de juguler les
manifestations de lentropie dans ces domaines. Sinon, il va y avoir apparition de couts
parasites trs important :
Lis la ncessit dembaucher du personnel administratif pour grer les donnes
manuellement ( laide de tableurs)
Lis aux risques dus la non-qualit des traitements (omission, erreurs et dlais de
traitement)
prudhomme :Membre d'un tribunal lectif compos des reprsentants des salaris et des employeurs dans le
but de trancher sur les conflits d'ordre professionnels
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
La rapidit et la fiabilit du traitement des donnes relatives aux salaris exigent galement de
disposer doutils de communication, comme Intranet, entre le service ressources humaines et
les salaris.
Grace ce type dorganisation du SIRH, il sera possible :
De rduire les dlais de mise jour des donnes, en responsabilisant lacteur qui est la
source de celles-ci
De raccourcir le circuit de linformation, en utilisant la transmission numrique.
Damliorer le bilan du traitement des informations dans le SIRH en liminant le
volume trs important de documents papiers qui circulent
Dliminer des erreurs et omissions dans la collecte des donnes, celle-ci tant le fait du
principal intress, le salari
1- La gestion du personnel
1-1. La gestion administrative :
La gestion administrative du personnel a pour objectif de traiter de manire qualitative cset-dire sans erreur, sans dlai et sans omission les informations relatives de trs nombreux
domaines particuliers, qui ne cessent de se multiplier et daccroitre la complexit de leurs
rgles de gestion :
La plupart de ces informations sont mises jour dans le cadre du dossier du salari.
La liste des domaines grer dans ce cadre est prsente ci-dessous, elle montre la diversit des
taches incluses dans ce que lon peut appeler, de manire gnrique, la gestion administrative
du personnel.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Figure 5. Liste des taches appartenant la gestion administrative du personnel
La gestion de ces informations prsente deux types de problmes, dont la rsolution est
imprative.
1) A cause de leur diversit et du caractre non rgulier des vnements qui les
dclenchent, il est difficile dassurer lexhaustivit des traitements sans un
systme automatis, qui offre au gestionnaire des fonctions Workflow (gestion des
flux dactivits) de type alertes.
2) Le non-respect de rglementations, li aux omissions, aux erreurs ou aux
dlais, dans le traitement de ces donnes, peut faire courir lorganisation un
risque en matire de responsabilit, qui pourra se traduire tant sur le plan juridique
que sur le plan financier.
La gestion de ces informations ncessite une interaction forte avec les salaris concerns. Cest
pourquoi il sera intressant de possder dans le SI des fonctionnalits de collecte de donnes et
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
de circulation dinformation, entre la DRH et les personnels. Ces outils feront partie de lespace
numrique de travail du salari, qui pourra ainsi interagir plus efficacement avec la DRH, sans
avoir recours la transmission, longue et hasardeuse, de documents papier.
Figure 6. Processus de gestion administrative du personnel
La figure de processus ci-dessus montre les taches effectuer dans ce domaine et linteraction
souhaitable entre le salari et le service qui gre le personnel.
Le groupe de travail de ce processus est donc constitu de salari, source des donnes et
destinataires des rsultats du traitement de linformation et du gestionnaire qui applique les
rgles de gestion et contrle la validit et la mise a jour des donnes connues du SIRH
Le salari est responsable del mise jour de sa situation au regard dune ventuelle
reconnaissance dun handicap ou du renouvellement dun titre de sjour.
Cependant lorganisation doit sassurer que le salari a rempli ses obligations, car cela
conditionne la poursuite de son contrat de travail et des conditions de son excution.
En cas de non-respect des rglements, le salari pourra tre inquiet mais lorganisation sera
galement responsable. Elle pourra se trouver, par exemple, dans la situation demployer une
personne sans titre de sjour valide.
Le salari doit pouvoir informer le service gestionnaire de lvolution de sa situation. Pour
viter les dlais de transmission et de traitement de linformation, la communication avec le
salari a intrt tre automatise.
On aura tendance prconiser actuellement le recours des outils de communication
numrique, intgrs lIntranet, en remplacement de la transmission de documents papiers.
Cela permet damliorer la qualit du traitement des donnes administratives :
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
1- en rduisant les dlais de transmission
2- en minimisant des erreurs de recopie
3- en vitant les omissions dans le traitement des donnes, notamment grce aux alertes
de renouvellement.
1-2. La gestion des missions
De nombreux salaris sont amens effectuer des dplacements en missions professionnels.
Il ne sagit pas uniquement des cols blancs , qui sont par exemple consultants chez les
clients de leur entreprise. Il peut galement sagir douvriers sur les chantiers.
La gestion des dplacements et frais de missions reprsente donc une activit complexe et
lourde :
- il faut collecter de manire rapide et exhaustive lensemble des donnes :
motif du dplacement
personnes concernes
moyens de transport utiliss
frais engags
remboursement des frais de repas et dhbergement, avec prise en compte des barmes
de lUrssaf pour dterminer la part soumise et la part non soumise cotisation
incidence des repas pris en dplacement sur la distribution des tickets restaurants
- Il faut avoir un enchainement de contrles et dautorisation permettant de vrifier la ralit
du dplacement
- Il faut grer et contrles les conditions de remboursement des frais engags et la
rgularisation des ventuelles avances sur frais engags et la rgularisation des ventuelles
avances sur frais
Figure 7. Processus de suivi des missions
Urssaf : Union de recouvrement des cotisations de scurit sociale et d'allocations familiales. Des organismes
chargs de la collecte des cotisations sociales sur les salaires.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
La gestion des fiches de frais implique :
- un accs sur lintranet pour les salaris afin de saisir leurs ordres de mission et leurs
fiches de frais
- une application qui permette au service concern la DRH de contrles la validit des
informations et le respect des barmes
- une interface avec la paie pour le remboursement des frais de dplacement
- une interaction avec le plan de formation et avec le contrle de gestion pour
limputation analytique des frais de dplacement
1-3 La gestion de la formation
La gestion du plan de formation prsente une certaine complexit dans la mesure o
cohabitent :
- les actions de formations organises par lentreprise pour amliorer les comptences du
personnel dans les postes occups.
- les formations organises par lentreprise pour assurer lvolution des personnels en
cohrence avec lvolution de la technicit des postes de travail.
- les formations organises par lentreprise pour assurer la reconversion des personnels lie
lvolution quantitative prvisionnelle des emplois et comptences (GPEC)
- lexercice des diffrentes modalits du droit et du cong individuel de formation
Le budget formation soit pouvoir tre suivi en prenant en compte :
- les cots pdagogiques de la formation
- le cot des heures de travail payes passes en formation
- les frais de dplacement lis la formation.
Processus de gestion de la formation
En sappuyant sur lapplication GPEC, le service qui gre la formation va tablir le plan de
formation : rpartition entre la formation institutionnelle (adaptation au poste et volution
technique du poste) et le droit individuel la formation, actions et sessions du plan de
formation interne, organisation matrielle des services, etc.
Les salaris pourront formuler des demandes dinscription aux actions du plan de formation, le
service les inscrira en fonction de critre et de places disponibles.
Il devra suivre lexcution administrative de la formation : convention, annexe pdagogique,
feuille de prsence, frais de dplacement, etc.
Puis il devra faire un bilan de la formation ralise : nombre de personnes formes par type de
formation, par sexe, par tranche dges et par niveau de formation initiale, etc.
Il devra galement grer lvaluation :
- Evaluation chaud par les participants des actions de formation
- Evaluation froid par le salari et son responsable hirarchique, lors de lentretien annuel
dvaluation
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Figure 8. Processus de gestion de la formation
1-4. Les outils groupware et Workflow du SIRH
Le SIRH oprationnel gre des volumes importants de donnes dans des domaines trs varis.
Il ncessite une interaction entre de nombreux acteurs.
Les applications qui le composent doivent donc permettre :
- de dterminer les droits de chaque acteur sur la mise jour des donnes et laccs aux
informations. Il sagit des fonctionnalits groupware.
- doffrir des fonctionnalits daide la circulation des informations entre les acteurs
concerns. Il sagit des fonctions Workflow
En conclusion :
La cl de la russite de la gestion du domaine administratif repose la fois :
- Sur un systme dalertes concernant les vnements qui entrainent des besoins dintervention
au niveau du service du personnel
- Sur des outils intgrs de Workflow, qui facilitent la communication entre les salaris et le
service du personnel. Ces outils pourront utiliser lIntranet de lentreprise.
- Sur des procdures dfinissant les modalits de gestion de ces donnes
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
La gestion des donnes relatives aux salaris
1- la gestion du dossier salari
Pour grer les ressources humaines, il est fondamental de disposer dun dossier contenant
les informations relatives au salari, le plus complet possible et le plus jour possible.
Rappelons galement que le systme dinformation, vritables systmes nerveux des
organisations, doivent correspondre a ce quelles sont en termes de taille, dactivit,
dhistoire et de culture.
Le dossier salari comporte de nombreuses informations, qi peuvent faire lobjet de
modifications dans le temps, avec, le plus souvent, une priodicit de mise jour
totalement irrgulire.
Il sagit :
1- des informations signaltiques
Elles concernent les coordonnes personnelles et professionnelles, les diffrents noms et
prnoms de la personne, ses adresse et informations de contacts caractre personnel et
professionnel.
Dapparence anodine, ces informations sont sources de problmes. Quappelle-t-on le nom
dune personne ? Sagit-il de son nom patronymique (encore appel nom ou de naissance)
ou de nom marital ? De son nom dusage au lieu de son patronyme ?
Ladresse personnelle est elle le domicile lgal ou le lieu de rsidence ? (ltudiant
doctorant, qui occupe un poste de moniteur et qui a pour domicile celui des parents mais
qui rside prs de luniversit durant lanne)
2- des informations de relev didentit bancaire
Il convient de vrifier la cohrence des informations du RIB (relev didentit bancaire)
car elles vont servir au virement des salaires et, en cas derreur, cela entrainera de
nombreuses complications. Lors de la saisie des donnes du RIB, le logiciel devra proposer
un contrle de cl RIB afin de rejeter les informations errones.
3- des informations relatives au CV et la carrire
Lors du recrutement, puis lors des vnements de lvolution de carrire de la personne,
dans le cadre des promotions internes lorganisation, il sera indispensable de disposer des
donnes retraant ses formations, diplmes et comptences ainsi que ses expriences
antrieures. Dans le cadre de la gestion de la qualit, il faudrait organiser une mise jour
priodique(en principe annuelle) de ces donnes. Dans ce domaine, la meilleure solution
consiste en une mise jour par le salari via le portail Intranet. Le gestionnaire devra tre
inform automatiquement des mises jour effectues, afin de pouvoir les contrles
4- des informations administratives
Correspondant la gestion administrative.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Conclusion
Certaines informations seront rcurrentes, par exemple les lments de lentretien annuel
dvaluation, la gestion du droit aux congs. Dautres seront lies des vnements
alatoires, du point de vue du gestionnaire du personnel, comme par exemple un
changement dadresse.
Il est toujours complexe dorganiser la mise jour de ce type de donnes afin dassurer la
qualit maximum de donnes. Rappelons que la qualit de la collecte des donnes implique
dviter les erreurs, les dlais et les omissions.
Il est donc souhaitable de mettre en place une procdure de collecte :
- qui implique les salaris
- qui permette un contrle par recoupement pour le gestionnaire
- qui facilite la transmission dinformation entre le gestionnaire et le salari
Cela ressort la fois :
- dune dmarche de modlisation des processus de travail et de la rdaction dune
procdure
- dun effort de communication auprs des salaris et des gestionnaires pour
montrer les consquences ngatives possibles de la non mise jour des donnes
- de la disponibilit doutils de type WORKFLOW qui permettent dalerter sur
lanomalie des donnes et de communiquer facilement entre le service des
ressources
2- la gestion des contrats de travail
Le contrat de travail permet de consigner les informations de statut et de rmunration
applicable pour une priode.
Un salari peut faire lobjet de plusieurs contrats successifs ou parallles, qui permettent de
grer le statut ou les statuts du salari un moment donn et qui impactent les mentions et
les rgles de calcul du ou des bulletins de salaire, tablir chaque mois.
Lorsque les modifications a apporter au contrat sont de porte limite, par exemple la dure
ou la rmunration, elles peuvent faire lobjet dun avenant au contrat et non de la
ralisation dun nouveau contrat.
Par contre, lorsque le type de contrat de travail (CDI au lieu de CDD par exemple) ou le
statut (cadre au lieu demploy, par exemple) sont concerns par la modification, il sera
ncessaire de raliser un nouveau contrat pour que les rgles en matire sociale soient
correctement appliques la priode correspondante chaque statue. Si le salari a
plusieurs contrats simultans, impliquant des statuts diffrents, il aura plusieurs bulletins de
salaires pour une mme priode
Les gestionnaires devront disposer doutils dans le SIRH, qui leur permettront de grer les
contrats de travail de manire cohrente avec les rgles de gestion a appliquer.
Notamment le systme devra permettre de crer larborescence entre le dossier salari, les
contrats de travail qui lui sont associs et qui peuvent eux-mmes comporter un ou
plusieurs avenants.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
2- La gestion des temps
La gestion du temps de travail est un domaine de suivi dinformation qui pose problme
depuis trs longtemps. Lorganisation du travail est depuis plusieurs dizaines dannes
devenue plus flexible.
Les salaries, notamment dans les structures de grandes tailles, ont gnralement la
possibilit de commencer et de terminer leurs journes de travail des heures diffrents en
fonction de leur choix. La journe de travail est assez souvent compose dune plage fixe
encadre par deux plages variables.
En France, un alourdissement considrable de cette gestion a t introduit par lintroduction
de :
- lannualisation du temps de travail, avec plafonnement des heures
supplmentaires
- du suivi des congs lis la rduction du temps de travail
- des heures supplmentaires dfiscalises
Des outils permettent, depuis de nombreuses annes, de grer lenregistrement des temps de
travail en ayant recours des badges lectroniques, qui permettent de sassurer :
- de la prsence des personnes sur leur lieu de travail
- des temps de travail effectivement raliss
La gestion des temps concerne galement la gestion des congs qui constituent nanmoins un
domaine de gestion particulire.
Le processus de gestion des temps
Figure 9. Processus de gestion des temps
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
La gestion des temps peut tre alimente par diffrents modes dacquisition de donnes.
Deux types dobjectifs peuvent tre poursuivis :
-
soit il sagit de mesurer le temps de prsence du salari dans
lentreprise, avec la possibilit den dduire les absences et les
heures supplmentaires
soit il sagit de connatre les taches effectues par les salaris dns le
cadre dune production individuelle ou dans le cadre de traitement de
dossiers, dans une activit de service. Dans ce cas, il y aura deux
objectifs diffrents :
* Grer les temps des salaris
* Les imputer aux activits cratrices de valeur ajoute et en dterminer les couts et les marges
Pour satisfaire le premier cas de figure, mesurer le temps de prsence des salaris dans
lentreprise, on a recours des badgeuses et un logiciel associ dans les structures de taille
importantes.
Les avantages de ce systme sont multiples :
possibilit dintroduire le systme de lhoraire variable avec des plages variables en
dbut et fin de journe et une plage fixe
automatisation de la gestion de lannualisation du temps de travail
dtection automatique des absences, qui peuvent tre prvues l avance ou qui
sortiront en anomalies de badgeage , si elles ntaient pas prvues. Il sera alors facile
den renseigner le motif et la dure
basculement automatique des informations, contrles et compltes vers le logiciel de
paie, permettant un gain de productivit et une rduction des erreurs qui seraient lies
une ressaisie
Mais ce systme, compte tenu notamment de son cout, nest pas adapt aux petites et trs
petites entreprises. Elles ont tout de mme besoin de grer les temps de travail de leurs salaris.
Elles auront donc recours des systmes moins automatiss, mais qui rempliront les deux
objectifs la fois. Dans tous les cas, lorsque les entreprises de taille importante souhaitent avoir
une gestion par projets des dossiers, elles devront utiliser les deux types doutils.
Les badgeuses pour la gestion des temps des salaris, en interaction avec la paie et les relevs
dheurs pour laffectation aux projets.
Les outils de relevs dheures pourront se caractriser :
- pour les entreprises industrielles :
par des bons de travail qui permettront de connatre les temps de travail du personnel
ouvrier, leur affectation une quipe de production et un lot de produits fabriqus et
les machines utilises
le responsable de lordonnancement de la production saisira lui-mme les absences avec
leurs motifs
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
une interface entre lapplication e gestion de production et celle de la paie sera
ncessaire afin dviter les doubles saisies.
- Pour les entreprises de services
les salaris seront amens saisir des relevs dheures permettant dattacher leurs
taches des dossiers clients ou des affaires(ou contrats)
les relevs dheures feront lobjectif de contrles et de corrections par le service du
personnel
les absences seront saisies au niveau du service du personnel, ce qui permettra de
reconstituer lhoraire de travail du salari
une interface entre lapplication de gestion des relevs dheures et celle de paie sera
donc ncessaire afin dviter les doubles saisies
La gestion des absences devra permettre de distinguer :
- les absences autorises et non autorises.
Parmi les absences autorises, il faudra distinguer des types de motifs dabsence. En effet, un
certain nombre dentre elles sont soumises des conditions ou des vnements. Par exemple,
concernant les congs pour vnements familiaux, certains sont pays par lentreprise et
dautres sont pays au salari par les organismes sociaux, par exemple le cong paternit.
- les absences payes ou non payes
Cela dpendra de la rglementation nationale en vigueur, de la convention collective, du
rglement intrieur de lentreprise. Cest le cas, par exemple, de la subrogation en matire
dabsences pour causes de maladies, indemnises par la scurit sociale.
3 -La gestion de la paie
La gestion de la paie constitue un lment cl de la gestion oprationnelle du personnel.
Les oprations relatives la gestion administrative du personnel et la gestion des temps ont
un lieu direct avec la gnration des donnes traiter pour la paie.
Ainsi, une personne qui sabsente pour se rendre une visite mdicale obligatoire va disposer
dune autorisation dabsence paye. Il faudra donc enregistrer cet vnement dans la paie, afin
de ne pas lui retenir le temps dabsence sur son salaire.
La gestion des heures effectues et des heures supplmentaires va diffrer suivant que
lentreprise a un accord dannulation du temps de travail ou non.
Le statut de la personne aura des consquences sur le traitement de son bulletin de paie. Un
cadre aura des cotisations que lon ne trouvera pas sur le bulletin dun employ.
La convention collective laquelle est soumise lentreprise aura galement des consquences,
sur les minima catgoriels de salaires.
Les conditions de calcul dune commission danciennet ou des droits des congs
supplmentaires par exemple. Lorsquune entreprise a des activits diversifies, elle peut avoir
des salaris dpendants de plusieurs conventions collectives.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
En matire de bulletin de salaires, certaines mentions sont obligatoires, facultatives ou
interdites. Il faut donc tre attentif aux informations qui vont figurer sur le bulletin.
Le calcul et ldition des bulletins de salaire ne constituent pas les seules obligations de
lemployeur en la matire. Outre les fiches individuelles des salaris et les journaux et grandslivres de paie, il faudra :
-pouvoir justifier des calculs dallgements de charges
- pouvoir effectuer les dclarations de charges sociales priodiques (mensuelles ou
trimestrielles)
- pouvoir faire les dclarations annuelles des salaires
Processus de gestion de la paie
La figure 9 correspond la gestion du domaine oprationnel de la paie. Un processus connexe
la gestion de la paie, mais galement la GPEC, concernera la gestion prvisionnelle de la
masse salariale.
Figure10. Processus de gestion de la paie
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Les aspects dcisionnels du SIRH
Au niveau GRH comme dans tous les autres domaines du systme dinformation, les dcideurs
ont actuellement besoin de possder des tableaux de bords leurs fournissant les indicateurs
ncessaires pour tayer leurs prises de dcision.
En GH, les domaines concerns sont :
-La masse salariale, dont il faut pouvoir simuler lvolution en fonction de diffrents
paramtres exognes ou endognes :
lvolution des postes (GPEC)
lvolution de la population des salaris en termes dges et de statuts (GVT)
(glissement vieillesse technicit)
De surcroit, lentreprise a besoin de possder des statistiques sur de nombreux critres que
ce soit a usage interne, la demande de divers organismes extrieurs ou pour satisfaire ses
obligations lgales.
Cela constituera la dmarche dlaboration du bilan social et des tableaux de bord RH.
1 -La prvision de la masse salariale
La masse salariale volue en fonction de nombreux paramtres.
Le systme doit permettre de raliser des simulations en croisant diffrents paramtres relatifs :
- lvolution mcanique des salaires et des carrires en fonction du temps (facteur lis au
GVT, glissement vieillesse technicit)
- lvolution quantitative et qualitative des personnes, facteurs lis la GPEC (gestion
prvisionnelle des emplois et des comptences)
- lincidence des politiques salariales diffrents niveaux : nationale (incidents de lvolution
du SMIC) conventionnelle (incidence de la mise en uvre des grilles ngocies dans le cadre
de la convention collective) interne lorganisation.
Lanalyse du GVT (glissement vieillesse technicit)
Figure 11. Glissement Vieillesse technicit
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
La convention collective et le rglement intrieur organisent les conditions dapplication de la
notion de prime danciennet en fonction du statut du salari (cadre /non cadre notamment).
Le niveau de rmunration dun salari va donc voluer en fonction de son ge et de son temps
de prsence dans lentreprise.
Cest laspect du glissement de la mase salariale li la vieillesse.
De la mme faon, il faut tenir compte de la formation, des diplmes et de la nature de
lactivit du salari pour prvoir son volution statutaire et indiciaire, conforme la convention
collective, et le rgime de primes, qui lui sera accord. Cest laspect du glissement de la masse
salariale li la technicit
Cette analyse a un double impact :
- sur la gestion de la paie. Il sagit de mettre en application les rgles de la convention
collective, de manire automatique, en intgrant les paramtres danciennet et les grilles
indiciaires dans lapplication de paie ;
- sur la gestion de la prvision de la masse salariale. Il sagit de prvoir lincidence du
vieillissement et de lvolution technique des salaris sur la masse salariale.
Ces analyses permettront galement de tenir compte d la pyramide des ges dont limpact se
situera plusieurs niveau :
- sur lvolution de la masse salariale. Si la moyenne dge est leve on va remplacer des
personnes en fin de carrire avec un niveau de rmunration lev par des personnes plus
jeunes avec des rmunrations plus faibles. On sera donc en GVT ngatif. Au contraire, si la
moyenne dge est faible, le vieillissent de la population va entrainer un accroissement de la
masse salariale. On sera en GVT positif
- sur la capitalisation des connaissances et comptences au sein de lorganisation. Le turnover
entraine une perte de comptences, les nouveaux arrivants ne connaissant ni lhistoire, ni les
pratiques de lorganisation
2 -La GPEC (la gestion prvisionnelle des emplois et des comptences)
La gestion prvisionnelle des emplois et des comptences sappuiera sur un thsaurus et des
codifications de niveaux permettant de croiser :
1- les comptences possdes par les personnels
2- les activits menes par les personnels dans les postes quils occupent
3- les profils des postes
Un moteur de recherche sur la base ainsi constitue permettra :
1- de faciliter le travail de recherche dune personne, appartenant au personnel ou prsente
dans le fichier des candidatures, qui possderait le profil recherch pour pourvoir un
poste
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
2- de dfinir des caractristiques dune offre, externe ou interne, pour un appel
candidature sur un poste vacant
3- de mesurer les carts entre les comptences dune personne et les exigences du poste
quelle occupe afin dviter davoir des personnes sur-profiles ou sous-profiles par
rapport leur poste
4- de prparer les entretiens dvaluation en positionnant ces carts
5- de prparer le plan de formation par rapport aux carts combler.
Figure 12. Le processus de la GPEC
Le salari intervient dans la mise jour de donnes le concernant.
Il sagit :
- de son cv
- de sa fiche de comptences
- de la partie de la fiche dentretien-valuation le concernant
- de sa rponse une proposition de recrutement interne
- de sa demande de formation, etc.
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Mmoire de fin dtude
M2 Management des Ressources Humaines
Un SIRH pour quels bnfices ?
Simplicit :
Allgement des tches grce des outils innovants, simplifis, adapts et prenniss
Amlioration du suivi des activits grce des outils de pilotage industrialiss et partags
Efficacit :
Optimisation des processus
Economie des temps de traitement
Meilleure matrise des cots
Mutualisation des ressources, harmonisation des savoir-faire
Optimisation de la capacit dcisionnelle et du pilotage
Qualit :
Communication interne optimise avec une information plus riche, plus fiable et plus fluide
Amlioration de la qualit des changes et une aide la dcision pour tous les acteurs RH
Restitutions adaptes aux diffrents besoins de la DRH et de ses clients
Un SIRH pour quels processus ?
Gestion administrative des salaris
Gestion des emplois / comptences / talents
Gestion de la paie
Gestion de la mobilit
Recrutement
Gestion du budget et de la masse salariale
Formation
Elaboration des reportings RH
El karkhi Zoubida
Univ. Corse Pascal Paoli
Vous aimerez peut-être aussi
- La Mise en Place D'un Système D'information Ressources Humaines - Cas D'IB-MAROCDocument41 pagesLa Mise en Place D'un Système D'information Ressources Humaines - Cas D'IB-MAROCfouad100% (3)
- Cours 2 SIRH 1Document38 pagesCours 2 SIRH 1Karim AIT SMIRI75% (4)
- PFE-VERSION-FINALE SIRH EST BerrchidDocument51 pagesPFE-VERSION-FINALE SIRH EST BerrchidSoukaina Sebbata100% (9)
- Ebook Comment Mener A Bien Un Projet SIRH Dans Son Entreprise SQORUS - Compressed - SQORUSDocument27 pagesEbook Comment Mener A Bien Un Projet SIRH Dans Son Entreprise SQORUS - Compressed - SQORUSMami cisséPas encore d'évaluation
- Emploi et gestion des ressources humaines dans l'économie du savoirD'EverandEmploi et gestion des ressources humaines dans l'économie du savoirPas encore d'évaluation
- E RHDocument68 pagesE RHCharaf Eddine100% (1)
- E GRHDocument38 pagesE GRHYussuf El100% (5)
- Impact Transformationnel Des SIRH Sur Les OrganisationsDocument36 pagesImpact Transformationnel Des SIRH Sur Les OrganisationsfchougraniPas encore d'évaluation
- TIC Et RHDocument17 pagesTIC Et RHSalwa Talibi Sali0% (1)
- SIRHDocument15 pagesSIRHAbdelhakim Benselama100% (2)
- SIRH - Présentation 1Document18 pagesSIRH - Présentation 1MAIRAU Sylvie100% (1)
- Le MRH À L'ère de DigitalDocument30 pagesLe MRH À L'ère de DigitalZINEB YDIRPas encore d'évaluation
- Système D'information RHDocument48 pagesSystème D'information RHMrizig Aicha100% (3)
- Les Métiers Du SIRHDocument9 pagesLes Métiers Du SIRHAchraf AmilaPas encore d'évaluation
- Sirh Kawtar ChaaliDocument15 pagesSirh Kawtar ChaaliAbdel Sàitàl75% (4)
- Gérer les ressources humaines: Finalités, actions, outilsD'EverandGérer les ressources humaines: Finalités, actions, outilsPas encore d'évaluation
- Recruter aujourd'hui: Comment séduire les nouvelles générations ?D'EverandRecruter aujourd'hui: Comment séduire les nouvelles générations ?Pas encore d'évaluation
- Les pratiques de formation, d'intervention et d'accompagnement dans les métiers des ressources humainesD'EverandLes pratiques de formation, d'intervention et d'accompagnement dans les métiers des ressources humainesPas encore d'évaluation
- Culture agile: Manifeste pour une transformation porteuse de sens et cohérente de l'entrepriseD'EverandCulture agile: Manifeste pour une transformation porteuse de sens et cohérente de l'entreprisePas encore d'évaluation
- Fidéliser et mobiliser: La gestion de carrière dans les organismes à but non lucratif et de bienfaisanceD'EverandFidéliser et mobiliser: La gestion de carrière dans les organismes à but non lucratif et de bienfaisanceÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Feuilletage 721Document18 pagesFeuilletage 721Karim Haddadi100% (3)
- Introduction Au SIRHDocument37 pagesIntroduction Au SIRHCharly Fez100% (1)
- Les Metier SirhDocument10 pagesLes Metier Sirher-riyadPas encore d'évaluation
- Cours eGRH 11-12Document89 pagesCours eGRH 11-12Yann Mboungou100% (1)
- Concepts SIRHDocument2 pagesConcepts SIRHNesskensPas encore d'évaluation
- SIRHDocument4 pagesSIRHSalim NiliPas encore d'évaluation
- Système D'information Des Ressources HumainesDocument74 pagesSystème D'information Des Ressources Humainesmery457850% (2)
- SIRH Et GRH PDFDocument194 pagesSIRH Et GRH PDFAyoub Ou100% (2)
- SI Et Ressource HumaineDocument105 pagesSI Et Ressource HumaineSara Elmrabet100% (1)
- L'impact de L'intégration Des Nouvelles Technologies de L'information Et de La Communication Sur La Gestion Des Ressources Humaines PDFDocument128 pagesL'impact de L'intégration Des Nouvelles Technologies de L'information Et de La Communication Sur La Gestion Des Ressources Humaines PDFMohamed Chouchene100% (4)
- Digitalisation RHDocument22 pagesDigitalisation RHOMAR AKITARPas encore d'évaluation
- Introduction SIRHDocument2 pagesIntroduction SIRHtaouilPas encore d'évaluation
- La Fonction RHDocument52 pagesLa Fonction RHsoufiane100% (1)
- Chapitre 2 L'e-RecrutementDocument4 pagesChapitre 2 L'e-RecrutementOUMAYMA MOHDIQ100% (1)
- SirhDocument21 pagesSirhAyyoub DriouechPas encore d'évaluation
- e-GRH FinalDocument8 pagese-GRH FinalEsseddik Gheroui WahraniPas encore d'évaluation
- Digital RHDocument2 pagesDigital RHReda El Hamdouchi100% (1)
- IntroductionDocument19 pagesIntroductionKarim Haddadi100% (1)
- Le Rôle de Système D'information Dans L'optimisation de La GRH Au Sein de L'entrepriseDocument98 pagesLe Rôle de Système D'information Dans L'optimisation de La GRH Au Sein de L'entrepriseLaib RachidPas encore d'évaluation
- IA Et Management Des Ressources Humaines ArticleDocument12 pagesIA Et Management Des Ressources Humaines ArticleAbidPas encore d'évaluation
- 1Qu'Est-ce Que La Digitalisation Des Ressources HumainesDocument21 pages1Qu'Est-ce Que La Digitalisation Des Ressources Humainesibtissam elmaatiPas encore d'évaluation
- La Digitalisation de Fonctin RHDocument39 pagesLa Digitalisation de Fonctin RHKAOUTAR EL FADILY100% (2)
- L'apport Du Système D'information À La Fonction RH PDFDocument135 pagesL'apport Du Système D'information À La Fonction RH PDFHajar AllamPas encore d'évaluation
- E-Rh Et GRHDocument70 pagesE-Rh Et GRHtaouil100% (2)
- La GRH À Travers Les Compétences Pour Améliorer La Performance de L'entrepriseDocument219 pagesLa GRH À Travers Les Compétences Pour Améliorer La Performance de L'entrepriseNadjat Belghanami100% (1)
- E RecrutementDocument6 pagesE RecrutementsohaylabakPas encore d'évaluation
- Livre Blanc Sirh 10 Benefices CroissanceDocument22 pagesLivre Blanc Sirh 10 Benefices CroissanceNahilPas encore d'évaluation
- Formation SIRHDocument82 pagesFormation SIRHAnonymous R4x9VPkAxk100% (1)
- Atelier Digitalisation de La Fonction RHDocument46 pagesAtelier Digitalisation de La Fonction RHImane BaroudiPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'etudesDocument140 pagesMémoire de Fin D'etudesMarcus Black0% (1)
- 1 - Digitalisation Des RHDocument7 pages1 - Digitalisation Des RHEric CourtinPas encore d'évaluation
- Informatisation de La Gestion Des Ressources Humaines MemoireDocument66 pagesInformatisation de La Gestion Des Ressources Humaines MemoireBayiri DIAKITE50% (2)
- Les SIRH - JohnDocument13 pagesLes SIRH - JohnmugemaPas encore d'évaluation
- La Gestion Des Ressources HumainesDocument16 pagesLa Gestion Des Ressources Humainesabidoup100% (1)
- 9782311010176Document40 pages9782311010176Tchakounte Njoda50% (2)
- SIRH (Système D'information RH) - Définition Et Conseils - ConvictionsRHDocument1 pageSIRH (Système D'information RH) - Définition Et Conseils - ConvictionsRHMarwa EssedraouiPas encore d'évaluation
- Digit at Lisa TionDocument5 pagesDigit at Lisa TionjkPas encore d'évaluation
- Mémoire Déveleoppement Du Capital Humain t1Document108 pagesMémoire Déveleoppement Du Capital Humain t1mouna boumaizaPas encore d'évaluation
- Stratégie de RecrutementDocument7 pagesStratégie de RecrutementFatoumta Maïga100% (1)
- La Gpec - SofitelDocument46 pagesLa Gpec - Sofitelhabrewj80% (5)
- Examen de Fin de Semestre DaoDocument3 pagesExamen de Fin de Semestre DaoMathurin Zoyem GouafoPas encore d'évaluation
- Droit (2) Corrigé 4Document4 pagesDroit (2) Corrigé 4fatimazahrasaadouni696Pas encore d'évaluation
- Etude Metiers ActuariatDocument76 pagesEtude Metiers ActuariatAndy AkrePas encore d'évaluation
- Élaboration de La Stratégie Dun DASDocument33 pagesÉlaboration de La Stratégie Dun DASAbderrahim AskoukPas encore d'évaluation
- Comment Rédiger Une Note de Cadrage Pour Un ProjetDocument13 pagesComment Rédiger Une Note de Cadrage Pour Un ProjetMoustapha BakoPas encore d'évaluation
- M11 - Commercialisation D'une Opération de Transport TRA-TSETDocument178 pagesM11 - Commercialisation D'une Opération de Transport TRA-TSETSoumia Nohad100% (1)
- Ressource 1-1 ORGANISATION PROCESSUS PRODUCTION PDFDocument44 pagesRessource 1-1 ORGANISATION PROCESSUS PRODUCTION PDFAhmed TalebPas encore d'évaluation
- Etude de Cas - CAFEDocument1 pageEtude de Cas - CAFEliPas encore d'évaluation
- TD Amortissement LinéaireDocument10 pagesTD Amortissement LinéaireAdams KouribaPas encore d'évaluation
- TD Force de Vente 2011Document9 pagesTD Force de Vente 2011Zizou AbderamanPas encore d'évaluation
- Ingénierie Financière-Adel DerouicheDocument142 pagesIngénierie Financière-Adel DerouicheAicha Ben TaherPas encore d'évaluation
- Support de Cours Comptabilité Privée L2 - DR YAO AbelDocument104 pagesSupport de Cours Comptabilité Privée L2 - DR YAO AbelMeledje JeanPas encore d'évaluation
- Safety OHSAS 18001Document21 pagesSafety OHSAS 18001chouaïb JarPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument14 pagesRapport de Stageninou.first13Pas encore d'évaluation
- Les Indicateurs de Performances 12Document6 pagesLes Indicateurs de Performances 12Hassnae MessrarPas encore d'évaluation
- Travail PrésentationDocument35 pagesTravail Présentationaroua chouchenePas encore d'évaluation
- Chapitre Introductif Controle de GestionDocument17 pagesChapitre Introductif Controle de GestionHodo Saad Gouden100% (1)
- Rapport de Stage FiduciaireDocument24 pagesRapport de Stage Fiduciaireanasennouri50Pas encore d'évaluation
- CV 2Document17 pagesCV 2amauric52Pas encore d'évaluation
- Partiel 1 2020Document9 pagesPartiel 1 2020Iman DerkaouiPas encore d'évaluation
- Infotech-48 IFRS17 PDFDocument7 pagesInfotech-48 IFRS17 PDFkhedidja attiaPas encore d'évaluation
- Modèle de Rapport de FormationDocument10 pagesModèle de Rapport de FormationHarold MAHOUKPO0% (1)
- MerchandisingDocument21 pagesMerchandisingAttaiya AmalPas encore d'évaluation
- Attestation Assurance HabitationDocument1 pageAttestation Assurance Habitationelodiesantiago23Pas encore d'évaluation
- Cours D'économie Générale, Comptabilité Et Finances 2022-2023Document165 pagesCours D'économie Générale, Comptabilité Et Finances 2022-2023Elisée YumbaPas encore d'évaluation
- RAPPORT de Stage Emeraude FINALDocument25 pagesRAPPORT de Stage Emeraude FINALBakary FofanaPas encore d'évaluation
- MRPDocument5 pagesMRPrukjryukPas encore d'évaluation
- R+ - Sum+ - Du Rapport PDFDocument5 pagesR+ - Sum+ - Du Rapport PDFmouhssinePas encore d'évaluation
- Dossier de Candidature FC 2017 PDFDocument4 pagesDossier de Candidature FC 2017 PDFCheikhPas encore d'évaluation
- Management de La Qualité Module 1Document32 pagesManagement de La Qualité Module 1oussema waliPas encore d'évaluation