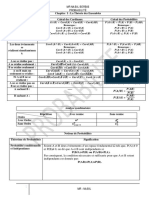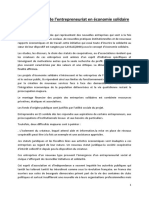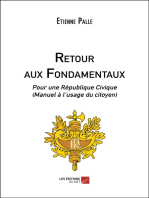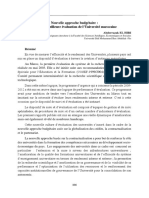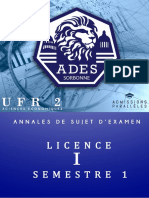Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ipemed Economie Sociale Et Solidaire Maroc Algerie Tunisie PDF
Ipemed Economie Sociale Et Solidaire Maroc Algerie Tunisie PDF
Transféré par
Reda KokaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ipemed Economie Sociale Et Solidaire Maroc Algerie Tunisie PDF
Ipemed Economie Sociale Et Solidaire Maroc Algerie Tunisie PDF
Transféré par
Reda KokaDroits d'auteur :
Formats disponibles
c o n s t r u i r e
l a
m d i t e r r a n e
Lconomie
sociale etsolidaire
auMaghreb
Quelles ralits pour quel avenir ?
algrie , maroc , tunisie
Monographies nationales
m a l i k a a h m e d - z a d , to u h a m i a b d e l k h a le k , z i e d o u e lh a z i
c o o r d o n n pa r
ale xis ghosn, chef de projet ipemed
Rapport pour Ipemed
Novembre 2013
LInstitut de Prospective conomique du monde Mditerranen ( Ipemed ) est un think-tank
mditerranen dont la mission est de rapprocher, par lconomie, les pays des deux rives
delaMditerrane. Depuis sa cration en fvrier 2006, il uvre la prise de conscience
dun avenir commun et dune convergence dintrts entre les pays du Nord et du Sud
delaMditerrane. Essentiellement financ par de grandes entreprises et des personnes physiques
qui partagent sonengagement, il a pour valeurs lindpendance politique et la parit Nord-Sud
danssa gouvernance comme dans lorganisation de ses travaux.
Il est prsid par Radhi Meddeb et dirig par Jean-Louis Guigou, qui en est le fondateur.
construire la mditerrane
La collection Construire la Mditerrane a t cre en 2009 par ipemed. Les experts dIpemed,
originaires des deux rives de la Mditerrane, y croisent leurs rflexions pour contribuer au dbat
surles grandes problmatiques mditerranennes, fconder une nouvelle approche des relations
Nord-Sud et formuler des propositions utiles aux populations des pays du Bassin mditerranen.
Les tudes publies dans la collection Construire la Mditerrane sont valides par le Comit
scientifique dipemed. Elles sont disponibles sur le site Internet dipemed. www.ipemed.coop
dj parus
Rgion mditerranenne et changement climatique,
Stphane Hallegatte, Samuel Somot et Hypahie
Nassopoulos, 2009
Eau et assainissement des villes et pays riverains
delaMditerrane,
sous la direction de Claude Martinand, 2009
Mditerrane 2030. Panorama et enjeux
gostratgiques, humains et conomiques,
Guillaume Almras et Ccile Jolly, 2010
Convergence en Mditerrane,
Maurizio Cascioli et Guillaume Mortelier, 2010
Mditerrane : passer des migrations aux mobilits,
Pierre Beckouche et Herv Le Bras, 2011
Rgulations rgionales de la mondialisation. Quelles
recommandations pour la Mditerrane ?,
coordonn par Pierre Beckouche
Demain, la Mditerrane. Scnarios et projections
2030,
Coordonn par Ccile Jolly et ralis avec le
Consortium Mditerrane 2030
Tomorrow, the Mediterranean. Scenarios
andprojections for 2030,
Coordinated by Ccile Jolly and produced with
theMediterranean 2030 Consortium
Partenariats public-priv enMditerrane. tat
deslieux et recommandations pour dvelopper
les ppp dans le financement de projets dans le Sud
etlEst de la Mditerrane,
Nicolas Beauss et Michel Gonnet, 2011
La confiance dans la socit numrique
mditerranenne : vers un espace.med,
coordonn par Laurent Gille, Wahiba Hammaoui
et Pierre Musso
Partenariats stratgiques pour la scurit alimentaire
en Mditerrane (Psam)
chapitre 1 tat des lieux,
Nahid Movahedi, Foued Cheriet, Jean-Louis
Rastoin, 2012
chapitre ii Besoins et opportunits des cooprations
inter-entreprises agroalimentaires en Mditerrane,
Foued Cheriet, Jean-Louis Rastoin, 2012
chapitre iii La situation cralire
enMditerrane. Enjeux stratgiques et lments
deprospective,
Nahid Movahedi, Foued Cheriet, Jean-Louis
Rastoin, 2012
Pour une politique agricole et agroalimentaire euromditerranenne,
Jean-Louis Rastoin, Lucien Bourgeois, Foued
Cheriet et Nahid Movahedi,
avec la collaboration de Fatima Boualem, 2012
Les dynamiques des ressources agricoles en
Mditerrane
Foued Cheriet, Nahid Movahedi, Jean-Louis
Rastoin, avec la collaboration de Fatima Boualem,
2011
Le rle des firmes touristiques dansledveloppement
dutourisme au Maroc
Maxime Weigert, 2012
Vers une Communaut euro-mditerranenne
delnergie. Passer de limport-export un nouveau
modle nergtique rgional
Moncef Ben Abdallah, Samir Allal, Jacques
Kappauf, Mourad Preure, mai 2013
Politiques dattraction des ressortissants rsidant
ltranger. Maroc, Algrie, Liban
Farida Souiah, aot 2013
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
ta b l e d e s m at i r e s g n r a l e
Executive summary . . . . . . . . . . . . . . 2
Synthse des monographies.
Diagnostics etcomplmentarits
au Sud et au Nord de la Mditerrane
en matire dESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ta ble des matires. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Monographies nationales
Algrie, Maroc, Tunisie. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ta ble des matires. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Algrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Maroc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Tunisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Bibliogra p hie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
executive summary
en mai 2013, pour la premire fois, sest tenu Tunis (Tunisie) la Confrence mditerranenne de lconomie sociale et solidaire (MedESS), qui a
regroup les principaux reprsentants du secteur dans la rgion et a pos
les bases dun cosystme mditerranen favorable aux entreprises sociales.
Le secteur de lESS permet la participation et lexpression de la socit
civile llaboration dun modle de dveloppement durable et solidaire dans
les pays du bassin mditerranen. Il prconise une autre faon de faire de
lconomie en remettant au centre des proccupations les personnes et la
satisfaction des besoins socio-conomiques. Cest une des exigences exprimes par les populations depuis les soulvements dans les pays arabes. Plutt quune alternative, lESS se positionne comme une troisime composante
de lconomie de march et du secteur public.
Dfinitions et mergence de lESS en Mditerrane occidentale
la crise conomique et louverture des marchs dans le cadre de la mondialisation contribuent limiter les moyens des tats pour faire face seuls
aux dfis lis la rsorption du chmage, aux nouvelles formes de pauvret
et la dgradation de lenvironnement. Cette situation a favoris lmergence dans les annes 1980 dun autre secteur qui essaye dapporter une
contribution la rsolution de problmes sociaux et conomiques. Il sagit
de lconomie dite sociale et solidaire associations, mutuelles, coopratives,
activits lies linsertion, services la personne, etc. qui se caractrise par
une gouvernance dmocratique, une gestion solidaire, un partage galitaire
des richesses cres et des finalits sociales et/ou environnementales.
Lconomie sociale et solidaire prend plusieurs appellations en fonction
du contexte et du rfrentiel culturel. Cest ainsi quon parle du non-profit
organisations aux tats-Unis, du volontary sector au Royaume-Uni, de lconomie sociale et solidaire dans les pays europens, de lconomie populaire, de
lconomie de dveloppement communautaire dans le monde francophone
et en Amrique du Sud. Pour dsigner le mme secteur on parle parfois dun
tiers secteur finalit sociale, dun tiers secteur dconomie de proximit, ou
encore dun secteur accompagnateur des deux secteurs priv et public. Le
dveloppement de lESS va de pair avec une contribution non ngligeable,
mais difficilement valuable, aux conomies nationales et une visibilit
accrue. Les pays du Sud et de lEst mditerranens (Psem) sinscrivent dans
cette dynamique malgr les contraintes qui psent sur le secteur.
Les cultures de solidarit, dentraide et de travail collectif ont toujours fait
partie des traditions et des pratiques des populations locales dans les pays du
Maghreb. Toutefois, lmergence de lconomie sociale et solidaire sous une
forme structure et organise, notamment pour sa composante associative,
est relativement rcente dans ces trois pays. Au Maroc et en Tunisie, lorga-
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
nisation du secteur date des annes 1980 et du dbut des annes 1990, suite
lapplication de plans dajustement structurel. En Algrie, lconomie sociale
sous sa forme modernise est apparue au milieu des annes 1990 afin dattnuer les effets de la transition vers lconomie de march qui sest accompagne dun accroissement des exclusions, de la pauvret et du chmage.
Les organisations de lconomie sociale et solidaire se sont dveloppes
dans le Maghreb et ont pris du terrain dans plusieurs domaines longtemps
rservs ltat : la fourniture des services et des quipements de base, notamment dans le monde rural, la lutte contre lanalphabtisme, la cration et
laccompagnement de projets de dveloppement local, la promotion et lintgration de la femme dans le circuit conomique, la promotion dactivits
gnratrices de revenus, etc. Dot dun fort potentiel, le secteur gagnerait
dsormais tre valoris et structur afin den faire un vecteur de dveloppement socio-conomique, crateur demplois et de revenus.
En effet, latout majeur de ces entreprises rside dans leur proximit
avec les populations locales, leur instance participative de prise de dcision
et leur connaissance des besoins au sein des territoires. Dans loptique de
favoriser des axes dvolution structurants et convergents en matire dESS
en Mditerrane, le rapport tablit au pralable un diagnostic de lESS dans
chaque pays du Maghreb.
tat des lieux de lconomie sociale et solidaire sur les rives nord
et sud de la Mditerrane
en tunisie, la rvolution de janvier 2011 a illustr de faon flagrante les
ingalits sociales et les disparits rgionales qui ont caractris le modle de
dveloppement de ce pays. Les manifestations dans les trois pays du Maghreb
ont t accompagnes de fortes attentes de la population qui demande une
amlioration rapide de son niveau de vie. Relever ces dfis ncessite lapport
de rponses innovantes qui peuvent maner des organisations de lconomie
sociale et solidaire.
Au Maghreb, le premier constat repose sur la diversit et lhtrognit
des composantes du secteur de lESS. Par rapport au rfrentiel europen,
si certaines organisations arrivent dvelopper de la valeur ajoute hybride
sociale et conomique, dautres accomplissent leur mission sociale avec
une faible orientation conomique. Cette situation ne contribue pas rendre
lESS audible dans les dbats nationaux et rgionaux, et ce dautant plus
quelles ne sont que trs peu intgres par les principales forces politiques,
conomiques et syndicales.
En Tunisie, le dveloppement de la part associative de lESS a t important entre 2010 et 2012, passant de 9 500 14 000 associations. Toutefois,
la rpartition spatiale des organisations de lESS demeurent ingalitaire sur
les territoires. Dans le contexte actuel, on constate un manque de soutien aux
initiatives dESS qui contribue accentuer davantage le dcalage entre les
formes traditionnelles de solidarit et dentraide et lmergence dun secteur
de lESS et de lentreprenariat social. En Algrie, o coexistent des formes
traditionnelles de solidarit et des formes plus institutionnalises, les annes
1990 et 2000 ont vu les dmarches dESS prolifrer. Nanmoins, la prsence
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
et le contrle des autorits publiques, en particulier depuis la cration dune
agence de dveloppement social (1996), tend paradoxalement impulser et
inhiber lmergence dun secteur part entire. Au Maroc, des dispositifs
publics ont t mis en place suite la cration, en 2005, de lInitiative nationale pour le dveloppement humain (INDH), et en vue de soutenir et de
mieux structurer le secteur de lESS.
Les pouvoirs publics de la rgion euro-mditerranenne et les bailleurs
de fonds rgionaux et internationaux gagneraient soutenir ces politiques
publiques dimpulsion du secteur en commenant par effectuer un travail
dactualisation, de collecte, de centralisation et de traitement des donnes
concernant lESS. Compte tenu des lacunes en la matire, il est difficile dvaluer la contribution socio-conomique de cette conomie et dlaborer un
compte satellite du secteur.
Les organisations de lconomie sociale et solidaire rencontrent des
contraintes qui continuent de limiter la porte de leurs interventions et de
rduire fortement lefficacit et lefficience de leurs actions. Il sagit principalement de :
linadquation du cadre juridique avec les ralits conomiques et sociales
du pays. Il est en effet contraignant ;
la multiplicit des intervenants et le manque de coordination aussi bien
entre les diffrents dpartements ministriels et organismes concerns de
ltat quentre les organisations de lconomie sociale et solidaire elles-mmes ;
la faiblesse quantitative et qualitative de leurs ressources humaines, ce
qui se rpercute sur leurs comptences en matire de gestion administrative
et financire, de planification, de conception et dvaluation de projets, de
comptabilit, bref sur leurs comptences managriales ;
les conditions de travail qui sont souvent prcaires. En effet, peu dassociations sont propritaires dun sige et dun local avec des quipements
ncessaires pour accomplir leurs missions dans de bonnes conditions ;
linsuffisance et lirrgularit de leurs ressources financires, ce qui rduit
sensiblement leurs projets et rend difficile la planification de leurs actionssur
le moyen et long termes et la prennisation des structures de lESS ;
Les problmes de valorisation et de commercialisation des produits du
secteur de lESS.
LESS na pas vocation remdier seule aux dysfonctionnements socioconomiques non rsolus par les sphres public et priv. Nanmoins, le
secteur est amen occuper un espace part entire, en complment des
autres, en sappuyant notamment sur la capacit de rsilience et dinnovation
de ces organisations. Le dfi actuel dans les pays du Maghreb consiste articuler les initiatives issues de lESS avec des politiques publiques appropries,
rpondant ainsi aux nouveaux enjeux de solidarit.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Les recommandations: des outils communs pour rpondre
auxdfis et aux enjeux partags
il convient tout dabord de rappeler la pertinence dapprhender lespace
sous-rgional regroupant les pays du Maghreb comme un ensemble cohrent
en vue de rflchir aux potentialits de ces territoires et aux dfis quil sagit de
relever. Il sagit ensuite de partager un diagnostic propos du secteur de lESS
au Maghreb en vue de dgager des propositions de travail qui puissent faire
lobjet de cooprations et dchanges avec les pays du bassin mditerranen.
Ltat des lieux du secteur de lESS, en particulier les contraintes qui
psent sur son dveloppement dans les trois pays du Maghreb, appelle des
recommandations sur la base desquelles pourrait tre bti un partenariat
euro-mditerranen dans ce secteur :
Identification de lESS comme un secteur stratgique pourvoyeur demplois
etcrateur de richesses
Valoriser les potentialits du secteur de lESS pour linsrer efficacement
dans les politiques publiques en dfinissant clairement les rapports entre
lESS, laction publique et les passerelles possibles avec le secteur priv.
Mettre en place des cadres spcifiques lESS et coordonns au niveau
ministriels et des collectivits territoriales: cration et/ou actualisation de
dispositifs juridique, institutionnel et de financement envers le secteur. De
plus, un rapprochement entre collectivits locales du Nord et du Sud pourrait faciliter lancrage dinitiatives qui rpondent aux besoins spcifiques de
chaque rgion sur la base des bonnes pratiques dveloppes au Nord (projets
innovants en France dans les rgions du Nord-Pas-de-Calais, de PACA et du
Languedoc-Roussillon, expriences des districts industriels en Italie, initiatives
en Espagne autour des communauts rgionales autonomes, etc.).
Structuration du secteur et prennisation de ses activits dans le cadre
dunpartenariat Euro-med renouvel
Procder dans le cadre du partenariat Euro-med la rforme du cadre
juridique rgissant les organisations de lconomie sociale et solidaire dans
les pays du Maghreb. Il sagit dassurer une reconnaissance lgale du secteur
en clarifiant, voire en simplifiant, les cadres juridiques, et en les adaptant aux
exigences de lESS et aux diffrentes formes dorganisations (coopratives,
associations, mutuelles, fondations, entreprises sociales, etc.). Ceci permettra
plus de souplesse et de flexibilit dans la cration de ces organisations.
Crer un statut de lentreprise sociale et solidaire et encourager la mise en
rseau de ces entreprises dans le but, dune part, de faciliter le contact avec les
pouvoirs publics, et dautre part, damliorer lefficacit des actions menes en
matire de dveloppement local par la coordination des actions, la mutualisation des ressources et le renforcement des capacits en matire de conception,
de mise en place et de gestion de projets de dveloppement intgrs.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Renforcer les ressources humaines tant sur le plan quantitatif que qualitatif par la mise en place de programmes de formations et dencadrements
en leur faveur. Il sagit de dvelopper les filires universitaires en matire
dentrepreneuriat social, de management des entreprises sociales et dconomie sociale et solidaire afin de mettre la disposition des organisations
des trois pays du Maghreb les comptences dans ces domaines. Il sagit galement de crer des instituts de formation aux mtiers de lESS qui peuvent
tre regroups dans le cadre du rseau MedESS.
Dotation du secteur en ressources propres afin dassurer lautonomie
desstructures de lESS
La prennit du secteur repose sur des sources de financements stables
et rcurrentes. Dans ce cadre, il est ncessaire de rpondre aux besoins financiers des oprateurs du secteur au Maghreb en envisageant la mutation du
microcrdit la micro-finance solidaire, de favoriser la cration de banques
coopratives et dinstitutions de micro-assurance et de mieux distinguer les
acteurs issus du secteur institutionnel de ceux de lESS sur le plan rglementaire et juridique. En un mot, lhybridation de ressources en provenance
des secteurs marchand, non marchand et non montaire est ncessaire la
structuration du secteur de lESS.
Pour rpondre aux problmatiques de valorisation et de commercialisation des produits du secteur, des dispositifs de types labels, chartes ou logos
ESS peuvent tre mis en place titre exprimental puis gnraliss.
alexis ghosn
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Lconome sociale et solidaire (ESS) au Maghreb :
quelles ralits pour quel avenir ?
Diagnostics
etcomplmentarits
au Sud et au Nord
de la Mditerrane
en matire dESS
Synthse des monographies
Najat El Mekkaoui
PSL Universit Paris-Dauphine, LEDA-UMR Dial, Ipemed
Amal Chevreau
Juriste de droit public, responsable ple tudes et projets, Ipemed
Alexis Ghosn
Chef de projet ESS, Ipemed
Novembre 2013
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
t a b l e d e s m at i r e s d e l a s y n t h s e
I nt ro duc tio n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Le dveloppement de lESS au Maghreb :
dispositifs, contraintes et leviers. . . . . . . . . . . . 25
Les caractristiques de lESS au Maghreb
et en Europe du Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cadres (juridique et institutionnel)
de lESS au Maghreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Contexte dmographique et socioconomique au Maghreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Contraintes dpasser pour une meilleure
structuration du secteur de lESS. . . . . . . . . . . . 26
Lindpendance par rapport au secteur
publicet la complmentarit avec le
secteurpriv but strictement lucratif
Le passage des logiques sectorielles
des logiques transversales : rseaux
etcooprations institutionnelles
Lessor de lESS en Mditerrane occidentale. . . 12
En Europe du Sud
Au Maghreb (Maroc, Algrie, Tunisie)
Les caractristiques de lESS au Maghreb
et en Europe du Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Economie sociale et conomie populaire
Institutionnalisation et rponse lurgence
LESS en Mditerrane :
dfinition et composantes. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Les problmatiques sous-jacentes aux
dfinitionsdu secteur de lESS . . . . . . . . . . . . . 18
Des formes de solidarit traditionnelle
(familiale, villageoise, de proximit,
religieuse ou communautaire)
Dfinitions et structuration de lESS
La composition et lanalyse chiffre
de lESS au Maghreb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
LESS au Maroc en chiffres
LESS en Algrie enchiffres
LESS en Tunisie enchiffres
Les leviers de dveloppement pour insrer
lESSdans le champ conomique. . . . . . . . . . . . 28
Favoriser lmergence dune
ESS territorialise
Les axes dvolution et les recommandations
en matire dESS en Mditerrane :
desoutilscommuns pour rpondre aux
dfisetaux enjeux partags. . . . . . . . . . . . . . . 29
Axes dvolution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mettre en place des financements
innovantsdestination de lESS
Renforcer les capacits des acteurs de lESS :
une offre de formation Nord-Sud
Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Identification de lESS comme un secteur
stratgique pourvoyeur demploiset
crateur de richesse
Structuration du secteur et prennisation
deses activits dans le cadre dun
partenariatEuromed renouvel
Dotation du secteur en ressources propres
afin dassurer lautonomie desstructures
delESS
A nnex e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
10
introduction
LESS au Maghreb, un secteur davenir
1. Dans les deux
prochaines dcennies
les Psem devront crer
entre 30 et 40 millions
de nouveaux emplois
pour maintenir le taux
demploi actuel. Vers
une croissance verte
en Mditerrane ,
Rapport Med 2012,
Banque mondiale,
p. 12.
2. Que ce soit dans
les secteurs agricole,
artisanal, industriel
ou de services
(notamment la
personne).
face aux transitions et aux mutations que connat la rgion mditerranenne, la crise conomique et laugmentation des dficits publics, le
rle de ltat et celui de lconomie de march se posent aux pays du Nord
comme aux pays du Sud et de lEst de la Mditerrane (Psem). Pour relever le
dfi, les initiatives issues du secteur de lconomie sociale et solidaire (ESS)
apportent des solutions en plaant les enjeux humains et environnementaux
au centre du dveloppement conomique et en tant vecteur de cohsion
sociale. Compte tenu des besoins en matire de cration demplois 1 et de voie
alternative destination, notamment, des jeunes et des femmes en Mditerrane, lESS se rvle tre un des axes daction et de collaboration pour
construire une rgion euro-mditerranenne conomiquement intgre et
durable.
Lconomie sociale et solidaire sest considrablement dveloppe au
cours de ces dernires annes au Maghreb, en partie pour faire face la
pauprisation et la marginalisation dune partie des populations. Dans le
prolongement de ses tudes sectorielles socio-conomiques, Ipemed a souhait produire un diagnostic de cette volution et proposer des axes dvolution pour une meilleure structuration et une visibilit accrue du secteur
de lconomie sociale et solidaire dans les pays du bassin mditerranen.
LESS regroupe des institutions sous statuts dassociation, de cooprative,
de mutuelle et de fondation, fdres autour des valeurs communes et de
lintrt collectif de leurs membres ou de lintrt gnral et socital quelles
servent. Elle regroupe galement des entreprises sociales et solidaires relevant dactivits telles que linsertion par lactivit conomique, les finances
solidaires ou le commerce quitable. Lorganisation de lconomie sociale et
solidaire revt ainsi diffrentes formes.
Les monographies au Maroc, en Algrie et en Tunisie fournissent un tat
des lieux du secteur de lESS dans ces pays. Elles exposent les enjeux dune
reconnaissance et dune structuration des secteurs qui composent cette conomie et proposent des axes dvolution et des recommandations visant
sappuyer sur les potentiels de lESS au Nord et au Sud de la Mditerrane,
notamment en termes de cration demplois. Dans chaque pays, le premier
constat est celui de la diversit des expriences qui agissent dans des champs
distincts et sous diffrents statuts juridiques. Ces initiatives convergent toutefois dans la faon quelles ont darticuler des objectifs sociaux ou politiques
( voire de gouvernance interne lorganisation sous la forme une personne =
une voix ) avec la mise en place dactivits conomiques gnratrices de valeur
ajoute et de revenu 2.
11
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Cette partie synthtique permet desquisser une analyse comparative
du secteur de lESS dans les socits du Maghreb, proches tant sur les plans
gographique que culturel. Avant de faire ressortir les aspects de complmentarit et de convergence Sud-Sud et Sud-Nord, le rapport sattache
poser la question de la dfinition conceptuelle du vocable conomie sociale et
solidaire et examiner les caractristiques qui diffrent dun pays et dune
rgion une autre. Enfin, lanalyse comparative entre les pays des deux rives
de la Mditerrane dans le domaine de lconomie sociale et solidaire permet
de poser la question des orientations stratgiques suivre pour les acteurs
et les structures du secteur.
Les enjeux du dveloppement de lESS au Maghreb sont particulirement pertinents aujourdhui, compte tenu du contexte socio-conomique et
des transitions en cours. De surcrot, lESS peut se rvler tre un secteur
davenir en tant que vecteur de relations rciproques entre le Nord et le
Sud de la Mditerrane. Le rle de lESS, en vue dapporter des rponses
des besoins fondamentaux non ou mal satisfaits dans des territoires et une
rgion en pleine mutation, est mettre en perspective avec les attentes dont
lessor du secteur fait lobjet.
En effet, les pays du Maghreb connaissent de profondes mutations :
Transition politique. Chmage, ingalits, disparits sociales et territoriales appellent une dmocratisation conomique et une orientation de
lappareil productif vers la satisfaction des besoins des populations.
Transition conomique. Ncessit de pallier un modle de croissance et
de dveloppement qui a montr ses limites, et de sengager vers un modle
durable et solidaire.
Transition sociale. Les acteurs de lESS contribuent aux mutations des
socits du Maghreb en dveloppant des modes de gouvernance et de rgulation et en exprimentant de nouvelles rponses aux tensions et aux dsquilibres dans ces pays.
Transition dmographique. Lmergence de nouveaux besoins dans les
populations reflte les mutations socio-dmographiques, notamment en ce
qui concerne les femmes, les jeunes et les personnes de plus de 60ans. La
protection sociale (vieillesse, maladie, incapacit, etc.) et la sant sont deux
priorits au Maghreb.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
12
Les caractristiques de lESS au Maghreb et en Europe du Sud
Contexte dmographique et socio-conomique au Maghreb
3. Banque mondiale
(2012).
4. OUADAH-BEDIDI
Z., VALLIN J.,
BOUCHOUCHA
I., La fcondit au
Maghreb : nouvelle
surprise , Population
et Socits N 486
bulletin mensuel
dinformation
de lInstitut
national dtudes
dmographiques,
fvrier 2012.
5. MARTIN I.,
Emploi et mobilit
des jeunes en
Mditerrane : une
question stratgique.
en qute de
stratgie , Confluences
Mditerrane, octobre
2012.
les transitions en cours dans les Psem sont le reflet de mutations profondes sur les plans politique, culturel et conomique. Aux aspirations dmocratiques se mlent des exigences socio-conomiques ainsi que la volont de
construire collectivement un modle de dveloppement plus inclusif, et qui
offre une meilleure rpartition des richesses, un quilibre territorial plus quitable et une place aux jeunes et aux femmes sur le march du travail.
Les indicateurs conomiques des pays du Maghreb soulignent des dcalages croissants entre les socits et la sphre de lconomie formelle. Sur le
plan dmographique, ces pays comprennent quelques 82 millions dhabitants
(32,5 millions au Maroc, 38,5 millions en Algrie et 10,8 millions en Tunisie 3). Si
depuis les annes 1980 la fcondit a baiss dans ces pays jusqu se rapprocher,
dans les annes 2000, du seuil de remplacement des gnrations (2,1 enfants
par femme), ce taux volue depuis de faon contraste : le taux de fcondit totale
semble se stabiliser en Tunisie (2,1), remonter en Algrie (2,8 en 2010) et continuer diminuer au Maroc (2,2)4. La croissance dmographique et la pression
urbaine vont saccrotre dans les dcennies qui viennent et intensifier encore la
pression sur le march de lemploi. En 2030, les tendances dmographiques
prvoient que les jeunes de ces pays seront 80 millions 5.
Les pays du sud et de lest de la Mditerrane ont cette particularit, par
rapport au reste du monde, dtre la rgion au sein de laquelle le taux de chmage des plus diplms est plus lev que celui des travailleurs ayant acquis
une formation de type secondaire ou primaire. Le tableau 1 montre comment
les jeunes et les femmes, les deux composantes majeures des socits du
Maghreb, sont les plus directement touchs par le chmage et la prcarit.
Dans ce contexte, les deux caractristiques principales de lESS, ses statuts but non-lucratif (ou lucrativit limite) et son objet social, ont orient
le secteur vers la satisfaction des besoins socio-conomiques plutt que vers
la maximisation du profit. LESS na pas (et ne devrait pas avoir) vocation
remdier seule aux dysfonctionnements non rsolus par les sphres publique
et prive. Nanmoins, le secteur est amen occuper un espace part entire,
en complment des autres, en sappuyant notamment sur la capacit de
rsilience et dinnovation des organisations.
Lessor de lESS en Mditerrane occidentale
En Europe du Sud
la crise financire de 2007-2008, puis son extension lconomie relle,
a mis sur le devant de la scne le rle que lESS est amene jouer lavenir.
En comparaison des autres secteurs, cette conomie a t plus rsistante et
plus rsiliente et a acquis une visibilit croissante. La reconnaissance juridique et politique dans lensemble des pays de lUnion europenne (UE)
est en passe de devenir une ralit court terme. Dans un rapport labor
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
13
tableau
1 Les indicateurs dmographique et socio-conomique au Maghreb
Dmographie
Evolution du Pib
Pib par habitant
Taux de chmage
Structure de
lconomie
et mergence
de lESS
Maroc
32,5 millions dhabitants
15-29 ans : 30 % de
la population totale
2,9 %
5 256,5 dollars
Population active : 9,4 %.
Femmes : 10,2 %.
Jeunes : 17,9 %.
(BM et HCP)
Economie librale ; dvelop-
pement du secteur de lESS
avec les plans dajustement
structurel (PAS) la fin
des annes 1980.
Algrie
38,5 millions dhabitants
15-29 ans : 30 % de
la population totale
2,5 %
5 404 dollars
Population active : 10 %
Femmes: 17 %
Jeunes: 21, 5 %
(BM et ONS)
Economie dorientation
socialiste jusque dans les
annes 1990 et transition
vers lconomie de march
par la suite.
Tunisie
10,8 millions dhabitants
15-29 ans : 27,9 % de
la population totale
2,7 %
9 698,1 dollars
Population active: 17,2 %
Femmes: 19 %
Diplms: 26,5 %
(BM et INS)
Economie librale oriente vers
le secteur tertiaire qui a vu
le secteur de lESS crotre dans
les annes 1980-1990 suite
lapplication des PAS.
Banque mondiale et instituts nationaux de statistiques, 2012
6. Lconomie
sociale dans lUnion
europenne. Rapport
de Jos Luis Monzn
et Rafael Chaves,
CIRIEC, 2012, p. 6.
pour le Comit conomique et social europen par le Centre international de
recherches et dinformation sur lconomie publique, sociale et cooprative
(CIRIEC) en 2012, lESS est prsente comme une solution aux crises conomiques et sociales actuelles 6. Le nombre croissant de mesures inities au
niveau des instances europennes (initiative pour lentrepreneuriat social,
fonds dentrepreneuriat social, statut de la fondation europenne, programmes Equal-FSE, etc.) et nationales (autour de llaboration dun cadre
lgal et institutionnel de lESS) est lillustration des attentes et des besoins
que suscite le dveloppement des structures de lESS.
Actuellement , les pays de lEurope du Sud voient le retrait de ltat providence se conjuguer au creusement des ingalits, la hausse du chmage,
notamment des jeunes et des femmes, et laugmentation des dficits publics.
Dans ce contexte daccroissement des incertitudes et de retrait des secteurs
public et priv dans la prise en compte des besoins, de nouveaux modes dorganisation mergent et permettent la prise en charge de ceux-ci par des structures
se distinguant des socits de capitaux et de la seule maximisation des profits.
Les initiatives sociales et solidaires sinsrent dans une dynamique plus large
dconomie inclusive au sein de laquelle sarticule linnovation sociale avec
des formes traditionnelles de solidarit. Ces expriences tentent de repenser
le modle socio-conomique damnagement des territoires au niveau local
tout en dynamisant les relations de proximit. Dfinie de faon globale, lESS
comprend les activits dont le but est de rpondre aux besoins de personnes,
et non de rmunrer des investisseurs ou des dtenteurs de capitaux, et insiste
sur la centralit des concepts de non-lucrativit et de lucrativit limite.
LItalie, lEspagne et le Portugal disposent chacun dun rseau de coop
ratives tendu et performant qui prdomine sur les autres composantes du
secteur de lESS. En France, la forme associative a historiquement t la plus
importante. Quant au concept dentreprenariat social, il a merg dans les pays
anglo-saxons puis sest diffus dans les pays industriels avancs dEurope du
Sud. Au niveau europen, des diffrences notoires existent entre les pays dans
les composantes du champ de lESS. LItalie est historiquement trs active
car elle sappuie sur des structures issues des mouvements catholiques (cf.
Confcooperative) et communistes (cf. Legacoop). Pourtant, jusqu prsent,
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
14
aucune reconnaissance de lconomie sociale en tant quentit proprement dite
nexiste de la part des pouvoirs publics. Cette situation explique que les formes
juridiques qui dfinissent le secteur ne soient pas lies fortement entre elles et
labsence dune vision communment partage par les acteurs.
LEspagne a une lgislation claire et bien dfinie depuis la loi (n5/2011)
du 29 mars 2011 qui rgit les infrastructures et les structures juridiques de
lconomie sociale. Daprs cette loi, le terme dconomie sociale dsigne les
activits conomiques et entrepreneuriales relevant de linitiative prive et ralises
par des organismes qui, conformment aux principes tablis par [cette loi], ont
pour finalit lintrt collectif de leurs membres ou lintrt gnral conomique ou
social (art. 2). Comme lItalie, lEspagne dispose de grandes organisations
reconnues internationalement, telles que Mondragn, premier groupe coop
ratif mondial. Les coopratives, le tiers secteur (associations et fondations
du secteur social) et les socits de travailleurs sont les trois piliers majeurs de
lESS dans le pays. En cherchant institutionnaliser le secteur de lconomie
sociale, ltat espagnol a voulu reconnatre des dynamiques qui continuent
tre structures autour des rgions autonomes espagnoles et des territoires
de plus petite chelle. Depuis 2011, bon nombre dacteurs saccordent dire
quune reconnaissance juridique doit saccompagner de mesures de soutien
conomique visant promouvoir et impulser le secteur.
En France, les politiques de soutien la structuration et au dveloppement
de lESS mergent dans les annes 2000. Initialement, ce sont les villes qui
commencent dsigner des lus rfrents en charge de la question, puis les
rgions ont progressivement intgr partir de 2004 des reprsentants de
lESS dans les dlgations des conseils rgionaux. La nomination dun ministre
dlgu lconomie sociale et solidaire en 2012 et le projet dune loi-cadre
prvue pour 2014 ont soulign la prise de conscience des pouvoirs publics quant
limportance de lESS. Il existe galement des chambres rgionales reprsentant lESS ainsi que des mouvements favorisant la synergie entre les acteurs a.
a. Tels que le
mouvement des
entrepreneurs sociaux
( Mouves ).
Au Maghreb ( Maroc, Algrie, Tunisie )
au maroc, le dveloppement de lconomie informelle va de pair avec lmergence de structures dESS la fin des annes 1980 et au dbut des annes
1990. En effet, lapplication du Programme dajustement structurel (PAS)
suite aux accords passs avec le Fonds montaire international et la Banque
mondiale sest traduite par un dsengagement progressif de ltat de plusieurs secteurs conomiques et sociaux, avec des consquences nfastes
sur lemploi, sur loffre de services publics et sur le pouvoir dachat de la
population. Depuis le lancement de lInitiative nationale de dveloppement
humain ( INDH ) par le roi Mohammed vi en mai 2005, les organisations
de lconomie sociale et solidaire interviennent de plus en plus afin, entre
autres, didentifier les besoins des populations, de porter des activits et des
projets gnrateurs de revenus, damliorer lefficacit de limpact des projets
sur les populations bnficiaires, de participer au financement et aux organes
de gouvernance de lINDH.
En Algrie, il faut relever la difficult dfinir le primtre et les frontires
du champ de lESS et valuer ce quelle reprsente en termes de volume
conomique et demploi. Si lmergence du secteur sexplique en partie par la
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
15
7. Voir Lamnage
ment du territoire
tunisien : 50 ans de
politiques lpreuve
de la mondialisation ,
Najem DHAHER,
EchoGo, 13, 2010.
8. Croissance et
emploi dans les pays
du Sud et de lEst de
la Mditerrane : les
gains de productivit
du travail jouentils un rle dans la
cration demplois ? ,
Macrodev n 8, (2013),
Agence franaise de
dveloppement.
transition entre une conomie dorientation socialiste jusque dans les annes
1990 et le basculement vers lconomie de march et les effets dvastateurs de
la guerre civile dans les annes 1990, son manque de visibilit est rechercher,
entre autres, dans les interactions avec les pouvoirs publics et dans lomniprsence de ltat. Lancrage de la gratuit du service public, les subventions la
consommation et lentretien de logiques rentire et redistributrice ne favorisent ni le dveloppement de lesprit entrepreneurial ni la prise dinitiative,
si bien que lmergence des pratiques de lESS se trouve contrarie par un
environnement rfractaire au changement.
En Tunisie, lconomie sest oriente depuis une vingtaine dannes vers
le dveloppement du secteur tertiaire et a vu, linstar du Maroc, lconomie
informelle et lESS se dvelopper au cours des dcennies 1980 et 1990. Le
contexte socio-conomique tunisien a favoris linsertion des organisations
de ce secteur dans une logique dentrepreneuriat social et collectif. Historiquement ancres dans le paysage, les organisations dESS existaient avant
lindpendance du pays. Sur le plan politique, elles ont t tantt reconnues
comme acteurs de dveloppement conomique et social juste aprs lindpendance, tantt cartes, contrles et considres comme un instrument
de valorisation de limage du pays lchelle internationale sous le rgime de
Zine el-Abidine Ben Ali. Aujourdhui, les structures et les dispositifs dESS
ont une offre diversifie mais ingalement rpartie sur le territoire7.
On la constat depuis son essor dans les annes 1980 au Maghreb, lESS
merge dans un contexte de pauprisation et de marginalisation croissantes
dune partie des populations. Le xixe sicle en Europe illustre galement la
multitude des initiatives (caisses de secours mutuel, coopratives de consommation, de travailleurs, etc.) visant rpondre collectivement des situations
de prcarit et dexclusion. Lune des raisons majeures des rvoltes observes
dans les Psem est relier au fait que les conomies de ces pays ne crent pas
suffisamment demplois. Lorientation rentire de ces conomies conjugue faiblesse de lentrepreneuriat et de linnovation, prdominance du secteur public
sur le secteur priv, poids du secteur informel (qui pse entre 20 et 30 % du
Pib non agricole en Algrie, au Maroc ou en gypte, selon lOCDE), et explique
en partie les faibles performances en matire de cration demplois 8.
Le constat au niveau des trois pays du Maghreb reste quune grande partie des initiatives issues du monde associatif sont des missions sociales avec
une faible orientation conomique, notamment dans les cas tunisien et algrien. A loppos, les coopratives et les mutuelles tendent promouvoir les
objectifs conomiques par rapport aux retombes sociales de leurs actions.
Les relations entre les pouvoirs publics et les acteurs de la socit civile
montrent quel point limbrication entre les deux peine faire merger un
secteur de lESS part entire. Dans les cas marocain (dans les annes 2000
et depuis 2005 en particulier) et algrien (depuis 1996), le rle croissant des
politiques publiques dans le soutien et le lancement dinitiatives sapparentant lESS est all de pair avec le dveloppement du secteur. La distribution
de subventions et de prts a toutefois favoris un modle de croissance dune
conomie sociale dpendante des mesures publiques, notamment dans le
cas algrien o se rajoutent les caractristiques propres une conomie
rentire. La volont pour les gouvernants de regagner la confiance des popu-
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
16
lations en impliquant des composantes de la socit civile conduit canaliser
et orienter les activits de lESS dans chaque pays. Linstrumentalisation
par les pouvoirs publics nuit la visibilit des activits de lESS et bride les
dynamiques dinnovation socio-conomique. Le cas de la micro-finance au
Maroc et en Algrie illustre cette complexit des liens puisquen plus de
rduire cette activit au seul micro-crdit, les pouvoirs publics concurrencent
directement les initiatives issues du champ de lESS.
Tandis que les pays de lUE convergent vers une harmonisation a minima
des dispositifs juridique et institutionnel de lESS, ceux du Maghreb ne disposent pas dun cadre lgislatif adapt et peinent reconnatre pleinement le
potentiel du secteur. En effet, la diversit des instances publiques et les liens
problmatiques avec les acteurs apparents au champ de lESS cantonnent
la majeure partie du secteur rpondre aux besoins durgence sans pouvoir
impulser une logique dinsertion dans lconomie formelle du pays.
A contrario de nombreux pays europens o lESS rpond aux exigences
dlaboration collective dun modle socio-conomique alternatif, lESS encore
en priode de gestation au Sud de la Mditerrane sinscrit dans une relation
complmentaire avec lconomie de march dans loptique de se dvelopper.
Le dplacement de lESS du rle dauxiliaire des pouvoirs publics son autonomisation devrait permettre sa meilleure insertion dans le systme productif
tant dans les secteurs agricole quindustriel-artisanal et tertiaire.
Les caractristiques de lESS au Maghreb et en Europe du Sud
Les causes qui ont prvalu lmergence du secteur de lESS en tant quenjeu
de dbat et de socit en Europe du Sud sont diffrentes de celles qui ont vu
lESS se dvelopper dans les annes quatre-vingt au Maghreb.
9. Voir Sarria Icaza
A. M. et Tiriba L.
(2006), conomie
populaire, in Laville
J.-L. et Cattani A. D.
(ds.), Dictionnaire de
lautre conomie, Paris,
Gallimard, 258-268
et Castel O. (2008)
De lconomie
informelle
lconomie populaire
solidaire : Concepts
et pratiques WP,
Universit de Rennes.
10. Oscillant entre un
et dix travailleurs.
Economie sociale et conomie populaire
En Europe les origines de lorganisation en un tiers-secteur remontent au
milieu du xixesicle, notamment en France et en Italie, avec les deux courants que sont lassociationnisme ouvrier et le catholicisme social. Lorganisation de structures sous des formes associative, cooprative ou mutualiste
a influ par la suite sur la mise en place des systmes de protection sociale
et dtat-providence dans la seconde moiti du xxesicle. Face aux questions
urbaines et la crise de ltat social, le secteur de lESS a merg afin de
rpondre aux besoins socio-conomiques non ou mal couverts par les secteurs public et priv. Toutefois, lESS en Europe sest dveloppe en rponse
lexclusion sociale dune frange de la population et aux dfaillances des
mcanismes de rgulation conomique et politique.
Dans les pays du Maghreb, les initiatives de lutte contre la pauvret
constituent le cur de lESS. Les sphres de ltat et du march ntant pas
en capacit de rpondre lensemble des besoins de la socit et de mettre
en place des mcanismes de rgulation juridique, institutionnelle et fiscale
sur lensemble des territoires, les expriences multiformes dESS ont tendance recouper, parfois, ce que les spcialiste dsignent comme relevant
de lconomie informelle, populaire ou souterraine 9. Par conomie populaire,
on entend lensemble des (petites 10) activits productives ou commerciales
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
17
qui sorganisent sous la forme de micro-entreprises familiales, dentreprises
associatives, de coopratives, de travailleurs indpendants. Lconomie informelle se dfinit quant elle par le fait que les activits gnrant des emplois
et des revenus ne sont pas dclares et intgres dans les circuits classiques
de lconomie ( secteur financier et bancaire) et politique (rattachement la
Caisse nationale du Scurit sociale et au systme de fiscalit, etc.). Enfin
lconomie dite souterraine ne rentre pas dans le cadre de lESS et renvoie des
pratiques occultes o le registre de la violence peut tre utilis par les acteurs.
LESS au Maghreb se rvle tre une raction moins une crise du lien
social et de lexclusion qu une situation de pauprisation et de marginalisation accrue de territoires selon les clivages rural/urbain, pauvre/riche et intrieur/ctier. Do lenjeu darriver dpasser la simple rponse lurgence
o saccumulent des conditions prcaires de travail dans le secteur de lESS
avec un faible niveau de structuration interne et darticulation avec lextrieur.
En se structurant et en affichant la volont de surmonter les dfis poss
lconomie dite populaire et informelle, lESS se pose comme une rponse plus
large aux besoins socitaux. Pour cela, il sagit de lui donner les moyens de
valoriser son potentiel et damliorer les conditions de vie des populations. Le
champ daction de ces activits gnratrices de revenus et demplois recoupe
une palette large, allant du traitement des dchets urbains, aux problmatiques
dducation, de travail artisanal, de sant publique. Sans se substituer au rle
dvolu aux services publics, lESS peut contribuer linsertion conomique
dune grande partie des populations du Maghreb. Sans perdre sa richesse lie
la diversit des initiatives issue de lESS, ce processus de dmocratisation
conomique permettra de r-encastrer une partie de la sphre conomique dans
un contexte social. Les formes que prennent ces actions restent diverses et
varies : le dveloppement conomique et local 11, lentrepreneuriat social, la
mise en place de systme dchange local, de mcanismes de finance solidaire
ou de budgets participatifs ou, de faon plus ancre historiquement sous des
formes mutualistes ou coopratives.
11. A titre dexemple,
voir le lancement
en 2013 de lInstitut
de la Citoyennet
(IdeC) et des
Agences dactions
communautaires en
Tunisie.
12. J.-L. GUIGOU,
Le retour des
territoires : les
atouts des circuits
courts , 14 octobre
2013, LeMonde.
Institutionnalisation et rponse lurgence
la description des initiatives dans le domaine de lESS au Maghreb soulve la faiblesse structurelle des activits qui ont du mal se prenniser dans la
dure et sinstitutionnaliser pour devenir des interlocuteurs au niveau local,
national, voire rgional. Il ressort de ce constat une image trs fragmente des
dynamiques dESS au Maghreb qui contraste avec limage que renvoient parfois les dynamiques en Europe du Sud, notamment en France, o les pouvoirs
publics et les institutions reprsentant des acteurs de lESS se retrouvent en
dissonance avec les besoins des acteurs locaux, sur le terrain. Do la ncessite
darticuler dun ct le soutien au renforcement des capacits se constituer
en sous-systmes institutionnels pour les acteurs de lESS avec de lautre ct
la prise de conscience des risques dinstrumentalisation et de chevauchement
des institutions en charge de reprsenter les structures de lESS.
Pour cette raison, la reconnaissance et le soutien lESS gagneraient
aller de pair avec une dynamique de dcentralisation politique o lchelon
rgional ( provinces et wilaya ) aurait un rle de pivot et de levier. En effet,
lESS sinscrit dans la logique annonce 12 de retour des territoires o les
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
18
circuits-courts et une conomie locale, productive et participative seront des
atouts majeurs. Sans des niveaux intermdiaires entre les acteurs locaux
et lchelon national, le renforcement de lorganisation des structures en
rseau, lappui des pouvoirs publics leur structuration et la mise en uvre
dun cadre lgal adapt ne sauraient suffire.
Les monographies ralises sur le Maghreb soulignent combien les dynamiques dESS se positionnent comme une rponse aux dsquilibres territoriaux dans ces pays. Les ingalits intra- et inter-territorales se retrouvent
en partie en ce qui concerne loffre propose par les structures dESS. Ceci
entrane une superposition de disparits tant en termes de territoire (clivages
entre les zones urbaines et rurales, riches et pauvres et celles ctires et de
lintrieur) que doffre propose (services ou productions agricole, industrielle
ou artisanale) par les structures dESS. Loffre des activits de lESS nest donc
pas labri du risque de reproduction des ingalits territoriales existantes.
La perte de matrise et de cohrence des espaces conomiques13 depuis une
trentaine dannes, notamment avec la mise en place des plans dajustement
structurel, a fragilis les structures traditionnelles dans les pays du Maghreb
sans qumergent des activits gnratrices de revenus et demplois. Ce dlitement des espaces conomiques et de cohsion spatiale et sociale laisse par
consquent une opportunit de cration despaces alternatifs dconomie
sociale et solidaire o la personne est place au centre des circuits dchanges
conomiques et o sarticulent les dimensions sociale, conomique et environnementale. Ce recentrage sur un espace territorial peut, comme lillustrent les
trois monographies, se structurer sous diverses formes telles que le commerce
quitable, les circuits-courts, les incubateurs, les systmes de finance solidaire.
LESS en Mditerrane : dfinition et composantes
Les problmatiques sous-jacentes aux dfinitions du secteur de lESS
la dfinition du secteur de lESS continue susciter des dbats dans les
pays du Sud comme du Nord depuis les annes 1980, do nos interrogations
quant ce concept dESS du point de vue des traditions des pays tudis, de
la recherche acadmique et des pratiques des acteurs et des structures.
Des formes de solidarit traditionnelle ( familiale, villageoise, de proximit,
religieuse ou communautaire ) : les biens habous, les wakf, la zakat, la touiza
13. G. CORM,
Lenouveau
gouvernement du
monde. La dcouverte,
Paris, 2011, p. 100.
au maghreb, la culture de solidarit, dentraide et de travail collectif constitue le principe de base de lESS. Sil est vrai que ces rapports de rciprocit
articuls autour des solidarits familiales (inter- et intra-gnrationnelles),
villageoise, de proximit, communautaire ou religieuse ont toujours fait partie
des traditions et des pratiques des socits maghrbines, lmergence dun
secteur sous une forme a minima structure et organise, notamment pour
sa composante associative, date de la fin des annes 1980 et des annes 1990.
19
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
figure
1 Le rle de lconomie sociale et solidaire
Prsentation dIpemed MedESS (Tunis, mai 2013)
Ces valeurs thiques qui permettent de replacer les questions conomiques au service des populations parties prenantes gagneraient servir de
catalyseur et tre capitalises travers la structuration du secteur de lESS. En
effet, la force des structures et des acteurs de lESS rside dans leur proximit
avec les populations, leur connaissance du terrain (identification des besoins,
laboration puis valuation des projets mis en uvre) et leur mode de fonctionnement souple qui leur permet dintervenir rapidement et efficacement. En
valorisant dune part les potentialits, les ressources et les atouts des territoires
et en sappuyant dautre part sur les solidarits de proximit et de rseaux, le
renforcement des capacits des acteurs de lESS au Maghreb donnerait au secteur la possibilit dassumer son positionnement en tant que voie alternative
et complmentaire par rapport aux conomies de march et publique.
Dfinitions et structuration de lESS
les diffrentes formes de lconomie sociale et solidaire et les valeurs
quelle sous-tend nous amnent retenir plusieurs approches. En effet, lconomie sociale et solidaire se structure autour de trois approches. Lconomie
sociale se dfinit par ses statuts (associations, mutuelles, coopratives et
fondations ) et correspond lapproche juridico-institutionnelle. Lconomie
solidaire se caractrise par lobjet social que lorganisation ou lentreprise se
fixe. Cette approche normative regroupe les principes communs aux entits
de lESS et se structure principalement autour de deux points : les finalits
de lactivit productive et les modes dorganisation interne. Enfin, les enjeux
et les modes de gouvernance soulignent limportance que revt le processus
de prise de dcision (en thorie une personne, une voix ) au sein du champ
de lESS qui englobe les secteurs marchand et non marchand, sans que la
frontire entre ces deux espaces soit tanche. figure 1
La question de la dfinition de lESS sous langle thorique. En rponse aux
besoins en termes de cration demploi et de dveloppement dun nouveau
modle conomique, lESS se dfinit comme une alternative prenant en
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
20
figure
CONOMIE
NON MONTAIRE
Les trois ples
de lconomie
plurielle
Dictionnaire de
lautre conomie,
Jean-Louis Laville
et Antonio David
Cattani (dir.)
Ed. Descle
de Brouwer, 2005.
14. K. POLANYI,
LaGrande
Transformation, aux
origines politiques
et conomiques de
notre temps (1944),
Gallimard (1983).
15. Voir, entre autres,
Socioconomie et
dmocratie. Lactualit
de Karl Polanyi, sous
la direction dIsabelle
Hillenkamp et de JeanLouis Laville, ditions
Ers, Paris, 2013.
16. Voir chez Polanyi
les principes de
ladministration
domestique, de
rciprocit, de
redistribution
qui existent en
complment du
principe de lconomie
de march.
17. Lconomie sociale
de A Z, Alternatives
Economiques, (2008).
Impulsion rciprocitaire fonde sur la recherche
de sens et les dynamiques de socialisation
au sein d'espaces publics de proximit
Vente de services et
contractualisation avec
partenaires privs
CONOMIE
MARCHANDE
CONOMIE
SOLIDAIRE
tablissement de conventions
dobjectifs avec les institutions
publiques et parapubliques
Hybridation entre
conomies
CONOMIE
NON MARCHANDE
compte la ncessaire recomposition des rapports entre conomie et socit.
Dj, au sortir de la seconde guerre mondiale lconomiste Karl Polanyi
montrait tout lenjeu de penser limbrication des sphres conomique et
politique 14. En actualisant cet hritage, des chercheurs15 en socio-conomie
montrent comment lconomie sociale et solidaire peut devenir un vecteur
majeur du r-encastrement des sphres conomique et politique avec des pratiques sociales ancres dans les territoires 16. Pour ce faire, la clarification de
la dfinition de ce quoi rfre lESS relve de deux objectifs : lune interne
et lautre externe. La premire est propre au secteur de lESS, qui englobe des
initiatives et des structures htrognes sur les plans des champs dactivit
et des statuts juridiques. En Europe, le consensus entre les acteurs de lESS
dfinit le secteur selon cinq caractristiques : la libre adhsion, la lucrativit
limite, la gestion dmocratique et participative, lutilit collective ou lutilit
sociale du projet, et la mixit des financements entre ressources prives et
publiques 17.
La dfinition de lESS vis--vis de lextrieur pose la question de sa constitution en tant que secteur part entire dans lconomie. Au pralable, il
est ncessaire de noter limportance de redcouvrir et de valoriser la nature
plurielle de lconomie, qui ne peut se rduire la seule conomie marchande de type capitalistique. La cration de biens et services, de revenus et
demplois est prsente dans les trois sphres que sont lconomie de march,
lconomie publique (tat et collectivits locales) et lconomie sociale et solidaire. La reconnaissance et la diffusion de cette conomie plurielle permet
de rendre compte de lhybridation ( figure 2) entre les conomies marchande,
non-marchande, montaire et non-montaire (activit domestique, bnvolat
ainsi que toutes les formes de travail non-rmunr). Ces dynamiques ont
amen articuler les enjeux autour de lESS avec limpratif de reconsidrer
les richesses en se dtachant des indicateurs macro-conomiques tels que le
Pib. Poser ces questions et y rpondre travers des forums et des plateformes
regroupant les acteurs de lESS en Mditerrane contribuera ce que les institutions publiques et les entreprises du secteur priv reconnaissent lessor de
lESS comme une voie complmentaire, durable et structure avec laquelle
nouer des partenariats innovants.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
21
La question de lESS sous langle des pratiques des acteurs. Sil est vrai que
lconomie sociale et solidaire reste, tant au Nord quau Sud de la Mditerrane, un concept plus ou moins accept, la raison principale tient sa
multi-dimensionnalit. Le secteur englobe la fois les initiatives et les outils
visant au rassemblement, laccompagnement et au renforcement des capacits des producteurs de petite et moyenne tailles, quel que soit le secteur
concern, que ceux assurant aux citoyens, principalement les plus dfavoriss, une protection sociale (sant, maternit, handicap, habitat, chmage,
vieillesse et dcs) et un complment de retraite.
Dans sa deuxime partie, la monographie sur lESS en Tunisie synthtise les diffrents concepts que lon regroupe parfois sous le terme conomie sociale et solidaire : les notions dentrepreneuriat social et dentreprise
sociale, de social business, de responsabilit sociale de lentreprise ou encore
dinnovation sociale renvoient chacune des pratiques distinctes en fonction de la position des acteurs dans le champ conomique. Ds lors, la difficult pour ce concept dESS consiste homogniser des pratiques parfois
divergentes, voire opposes les unes aux autres selon leur proximit avec les
champs de lconomie publique et de lconomie de march.
La composition et lanalyse chiffre de lESS au Maghreb
la prsentation descriptive des donnes disponibles ne peut tre complte
par une analyse plus pousse compte tenu du manque de donnes en la matire,
celles-ci tant limites et disparates. Esquisser une tude prcise du poids et
des impacts du secteur dans lconomie nationale exigerait au pralable un
important travail dactualisation, de collecte, de centralisation et de traitement
des donnes concernant les composantes de lESS et ce que constitueraient
les principaux inputs dun ventuel compte satellite du secteur. Sils dcidaient
dinvestir dans un tel effort, les bnfices seraient majeurs et durables pour les
pouvoirs publics et les bailleurs de fonds internationaux en vue de rendre plus
efficaces les politiques de soutien et de structuration de lESS.
18. Voir Annexe 1.
19. Les chiffres
prsents ici sont
tirs de lOffice du
dveloppement de la
coopration (ODCO,
Maroc).
20. Ce pourcentage
oscille entre 15 %
(selon lODCO) et
plus de 40 % selon T.
Abdelkhalek ( auteur
de la monographie
sur lconomie
sociale et solidaire au
Maroc pour Ipemed ).
Lconomie sociale et solidaire au Maroc en chiffres
selon le rseau esmed 18, en 2011 le Maroc comptabilisait 47 365 organisations dconomie sociale, ce qui reprsentait environ 3 % de la population
active. Dans loptique dune analyse chiffre, les autres composantes de lESS
que sont les associations et les mutuelles sont traites de faon limite, faute
de donnes. Une information plus ou moins fiable et structure est quant
elle disponible propos du tissu coopratif marocain19 : constitu de 7 800
coopratives (en 2010), le secteur souffre tout de mme dune valuation
imprcise quant au pourcentage de coopratives inactives 20. Il faut noter
limportante progression du secteur depuis la mise en place de lInitiative de
dveloppement humain (INDH) en 2005 puisque leur nombre a volu de
4 827 en 2004 7 800 en 2010. Lanalyse de celui-ci selon le secteur dactivit
rvle que la quasi-totalit (90 %) des coopratives est concentre dans trois
secteurs: lagriculture, lhabitat et lartisanat. Ces trois secteurs regroupent
74 % des adhrents.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
22
21. En 2010, le Maroc
comptait 52 mutuelles.
22. http://www.
remess.ma/
23. En plus du
dveloppement de
la finance solidaire
dans le secteur
bancaire, ilexiste
des institutions de
microcrdits autour
dela Fdration
Nationale des
Associations de
Microcrdit du Maroc :
Al Amana Microfinance, FONDEP
Micro-crdits,
Fondation ARDI,
Fondation Al Karama
MC, Fondation
Banque Populaire
pour le Micro Crdit,
etc.
Si lon carte les coopratives dhabitation, peu impliques dans une
activit conomique proprement dite, il ressort que les coopratives agricoles
reprsentent les trois quarts du tissu coopratif du Maroc. Caractrises par
une forte concentration, les coopratives agricoles actives sont plus des deux
tiers oprer dans quatre filires : la collecte et de la commercialisation du
lait (30,32 %), llevage (26,76 %), lapiculture (15,25 %) et lapprovisionnement (8,79 %).
Depuis le lancement de lINDH, le secteur associatif marocain a t
plac au centre du dispositif afin dasseoir son efficacit. A cet gard, beaucoup dassociations marocaines interviennent pour identifier les besoins des
populations, porter des activits gnratrices de revenus, participer au financement, organiser et accompagner les bnficiaires des projets ou participer
aux organes de gouvernance de lInitiative.
En labsence de statistiques fiables sur le secteur, il nest pas possible
dvaluer de faon prcise la dimension du tissu associatif, sa structure et la
valeur relle de sa contribution lconomie nationale. La Stratgie nationale
de lconomie sociale et solidaire 2010-2020 avance que le tissu associatif marocain est anim par environ 50 000 associations. La diversification du secteur est sa caractristique principale, et ce dautant plus quil faut souligner
quune partie des activits seulement peut tre comptabilise comme appartenant lconomie sociale et solidaire : les actions caractre conomique et
social comme celles traitant de dveloppement local (22 % des associations),
dactions sociales (21 %) ou culturelles (22 %). Cependant aucune rfrence
reconnue nest aujourdhui disponible pour rattacher la partie conomie
sociale et solidaire du tissu associatif lESS proprement parler.
Si le secteur mutualiste marocain est faible 21 et peu prsent dans les rgions
aux besoins levs, ladoption en 2007 dune nouvelle lgislation concernant
lassurance maladie obligatoire (AMO et son corollaire, le RAMED) devrait
terme modifier la place et le rle des mutuelles dans la socit marocaine.
Enfin, lessor des mutuelles communautaires, et leur encouragement
relatif par les pouvoirs publics, rpondent aux besoins de pallier lcart en
termes de couverture sanitaire et suscitent un intrt croissant de nombreux
acteurs dans la mesure o ce type de mutuelle sintgre dans les organisations dconomie sociale.
En matire de coordination au niveau national des organisations de lESS
marocaines, le pays est sur la bonne voie puisquil dispose dun Rseau Marocain de lEconomie Sociale et Solidaire (REMESS)22 qui uvre promouvoir
le secteur et dvelopper des synergies entre ses membres et dun Comit
concert Maroc de lconomie sociale et solidaire (CCMESS) depuis lt 2013.
Ces organismes ont pour tche complexe de jouer le rle dintermdiaire entre
les acteurs locaux de lESS et les institutions publiques telles que le ministre
de lArtisanat et de lconomie sociale et solidaire, lINDH ou lODCO.
En effet, le Maroc fait tat dune forte prsence des pouvoirs publics et
des initiatives de soutien lESS puisquen plus des institutions destines
structurer et soutenir le secteur, le pays connat un accroissement des
fondations, des banques 23 et des formations universitaires destines rendre
effectif le potentiel du secteur.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
23
Lconomie sociale et solidaire en Algrie
en algrie lmergence de lconomie sociale et solidaire prend place entre
des formes de solidarit traditionnelle et la fin de la solidarit institutionnalise (1962-1988) du pouvoir politique. Ainsi selon le ministre algrien de
lIntrieur et des collectivits locales, 1 027associations nationales, dont 326
peuvent potentiellement sinscrire dans le champ de lESS, et 92 627 associations locales, dont seulement 6 205 (6,7 %) peuvent sinscrire potentiellement
dans le champ de lESS. Les associations qui couvrent le territoire national
sinscrivent dans des types dactivit divers et varis tels que la solidarit, le
secours, la bienfaisance, la mutualit, la jeunesse, lenfance et adolescence, les
personnes en situation de handicap ou inadaptes, les femmes. Il faut noter
que ces structures disposent en grande partie de postes demplois permanents
et ont accs pour bon nombre aux financements publics.
Le dveloppement du secteur coopratif et mutualiste en Algrie sinscrit dans lhistoire coloniale du pays vis--vis de la France. Ainsi, des coopratives agricoles et industrielles ont t cres dans llan de lindpendance
algrienne afin de relancer lconomie du pays. Les premires entreprises
publiques sont nes du regroupement de ces coopratives 24, ont t prises
en charge par ltat25 lexemple des domaines autogrs puis, partir des
annes 1990, de nouvelles coopratives ont vu le jour suite au processus de
privatisation des entreprises publiques et locales.
Il nexiste pas dtude quantitative valuant limportance et les apports
du secteur coopratif sur les plans social et conomique et leur contribution
la rsolution des difficults socio-conomiques du pays, notamment en ce
qui concerne la crise du logement et la cration demplois. Le secteur mutualiste algrien, qui emploie environ 4000salaris, regroupe 32 mutuelles de
plus dun million dadhrents et couvre environ sept millions de bnficiaires.
Toutefois, on constate une diminution du nombre dadhrents aux mutuelles
depuis les annes 1990.
Enfin, le secteur des fondations, rattach juridiquement au statut associatif, est mergent en Algrie : le pays en compterait une douzaine, chacune
agissant dans des champs dintervention varis. Les pouvoirs publics algriens ont pris conscience du potentiel que reprsente le secteur de lESS pour
lconomie du pays et les bnfices que pourraient en tirer les populations. Si
des institutions tentent dimpulser et de soutenir les dynamiques luvre,
celles-ci gagneraient en efficacit si leur champ daction tait mieux dfini
juridiquement, en particulier leur rapport aux pouvoirs publics, au systme
de scurit sociale, au reste du secteur priv et aux partenaires internationaux
(bailleurs de fonds et autres structures dESS).
24 Tous les secteurs
taient concerns : les
btiments, les travaux
publics, lagriculture,
les services de
consommation, etc.
25. Et le syndicat de
lUnion gnrale des
travailleurs algriens
(UGTA) qui participait
la gestion de
lconomie avec lEtat.
Lconomie sociale et solidaire en Tunisie en chiffres
en tunisie, le secteur associatif reste peu actualis compte tenu du manque
de donnes sur les prsidents des associations, les coordonnes et ltat des
associations. De plus, le rpertoire nest pas actualis et comptabilise des associations inactives, voire disparues. La prise en compte de lvolution du secteur
se rvle dautant plus ncessaire depuis les vnements sociaux de janvier
2011 qui a vu le nombre des associations croitre sans commune mesure avec
les dcennies passes : de 9 561 en 2010, il est pass 14 729 en 2012, du fait
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
24
26. Le Bureau
international du travail
a dfini en 1993 le
secteur informel
comme lensemble des
activits de production et
dchange non-agricoles
qui nappartiennent pas
au secteur formel, ds
lors quelles chappent
lenregistrement
statistique et comptable
et ne sont pas assujetties
aux rglementations
sociales et fiscales, et
qui relvent du secteur
institutionnel des
mnages au sens du
Systme de Comptabilit
Nationale des NationsUnies .
27. Source : Lemploi
informel dans les pays
en dveloppement ,
Organisation de
coopration et de
dveloppement
conomiques (OCDE),
2009.
28. Voir ADAIR
P., Lconomie
informelle au
Maghreb : une
perspective
comparatiste AlgrieMaroc , contribution
la Premire universit
de printemps
des conomies
mditerranennes
et du monde arabe
Tanger, 25-27 avril
2002.
de lacquisition des liberts de groupement et dassociation, dune part, et de
la simplification des procdures de cration des associations dautre part.
Les origines du secteur mutualiste en Tunisie remontent la priode
coloniale. Ce secteur a pour objectif linstauration dun systme mutualiste
et solidaire entre les adhrents travers la couverture des risques inhrents
la personne humaine comme les maladies, la maternit, la vieillesse, les
accidents et linvalidit et ce, en faveur des adhrents et de leurs familles en
contre partie de cotisations. Cette couverture est complmentaire celles
fournies par les caisses nationales de scurit sociale et de retraite. En 2012,
la Tunisie comptabilise 48 mutuelles rparties entre les secteurs public (15),
semi-tatique ( 20 ) et priv (13).
Suite linstauration du systme coopratif dans les annes 1960, la
Tunisie a enregistr la cration de coopratives de services et de coopratives
commerciales. Toutefois, les informations sur ces coopratives, celles du
secteur textile, du secteur du logement ou encore de lartisanat sont trs rares
et disperses voire inexistantes, raison pour laquelle il nest pas possible de
dlimiter la taille ou dtudier les caractristiques de ce secteur.
Quant aux fondations, le centre Ifeda en comptabilise trois, savoir :
la fondation Atlas pour lauto-dveloppement et de la solidarit, la fondation
El Kef pour le dveloppement rgional et la Fondation tunisienne pour le
dveloppement communautaire.
En plus des trois statuts juridiques (voire quatre, avec celui des fondations) que sont les associations, les mutuelles et les coopratives qui dlimitent
en partie le champ de lconomie sociale et solidaire, on peut y intgrer certaines organisations informelles (cf. quatrime partie de la monographie sur
lESS au Maroc). Le secteur et lemploi informels au Maghreb ont progress
simultanment lessor de lESS depuis la fin des annes 1980 la suite de la
mise en place des programmes dajustement structurel du Fonds montaire
international qui ont modifi les structures des conomies de ces pays en
profondeur. Lconomie informelle regroupe dun ct le secteur informel 26 et
de lautre lemploi informel, cest--dire les emplois non protgs qui existent
dans le secteur informel et lensemble des emplois non dclars des entreprises du secteur formel. Lessor de linformalit dans le march du travail
des pays du Maghreb a atteint des niveaux importants comme latteste sur la
priode 2000-2007 la part de lemploi informel dans le total de lemploi non
agricole : 47,3 % pour la rgion, 41,3 % en Algrie, 67,1 % au Maroc et 35 % en
Tunisie 27. Dune manire gnrale, linformel est prsent dans tous les pays en
voie de dveloppement et il se caractrise par des emplois au sein de la sphre
familiale ou de proximit dans lartisanat, le travail indpendant ou domicile,
avec peu ou pas de qualification, des salaires irrguliers et une absence de
protection sociale et de lgislation du travail 28.
Lexpertise et lexprience des organisations de lESS et des pouvoirs
publics ( tat, institutions publiques et collectivits locales) en Europe aussi
bien dans les modalits de collecte et traitement des donnes que dans les
projets et les politiques publiques visant lutter contre les formes de pauvret
et dexclusion nous portent croire quune coopration et des changes de
bonnes pratiques dans ce domaine impliqueraient des partenariats fructueux
entre les acteurs.
25
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Le dveloppement de lESS au Maghreb :
dispositifs, contraintes et leviers
Cadres juridique et institutionnel de lESS au Maghreb
en matire de reconnaissance de lESS, des dcisions politiques peuvent
tre prises travers des dispositifs juridiques ou institutionnels promouvant
lESS en tant quactrice des diffrentes politiques publiques. La reconnaissance juridique tablit une reconnaissance explicite par les pouvoirs publics
de lidentit spcifique des organisations concernes qui appellent un traitement particulier. A partir de l, le systme juridique entend les institutionnaliser avec un statut dacteur priv. La reconnaissance institutionnelle a lieu
travers lexistence dorganes institutionnaliss de participation et de dialogue
social o les organisations de lconomie sociale sont reprsentes. tableau 2
En France et en Espagne, un conseil national des reprsentants de lESS
a t promu, regroupant, entre autres, les diffrentes plateformes de lconomie sociale et solidaire. Ces institutions ou rseaux sont en gestation dans les
pays du Maghreb. Au Maroc, ce type de conseil existe dj pour les socits
mutualistes. De plus, la participation et limplication des associations dans
les diffrentes commissions nationales, rgionales et provinciales sont devenues une ralit dans la pratique effective des pouvoirs publics marocains.
LAlgrie et la Tunisie, o il ny a pas dorganes reprsentatifs du secteur
au niveau national, gagneraient impulser une meilleure visibilit et limage
sociopolitique de lESS et institutionnaliser davantage les politiques trans-sectorielles qui lui sont propres. En effet, dans ces pays limplication de la socit
civile au sein des processus dlaboration de politiques publiques concernant
ce secteur reste faible, si ce nest inexistante.
Sur le plan institutionnel, la multiplicit des intervenants conjugue
au manque de coordination entre les diffrents dpartements en charge de
prs ou de loin des organisations de lESS, risque de constituer une entrave
au dveloppement et lexpansion du secteur.
Sur le plan juridique, lexistence et la multiplicit des textes risquent de
constituer une entrave au dveloppement de nouvelles formes dorganisations dESS ou dinhiber les organisations dj existantes dans leurs rponses
aux besoins sociaux et aux nouvelles exigences socitales. Dans le cadre du
rseau MedESS, et en partenariat avec le bureau international du travail et le
rseau ESMed, un cycle de sminaires sera organis en 2014 afin de travailler
la convergence des rglementations.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
26
tableau
2 Les cadres lgislatif et institutionnel en charge de lESS au Maghreb
Ipemed
Contraintes dpasser pour une meilleure structuration
du secteur de lESS
Lindpendance par rapport au secteur public et la complmentarit
aveclesecteur priv but strictement lucratif
29. Les initiatives
dESS, et en grande
partie le tissu asso
ciatif, ont souvent eu
tendance assumer
contre leur gr ou
leur insu, et selon la
conjoncture politique,
soit un rle visant
masquer lincapacit
des pouvoirs publics
satisfaire les attentes
des populations,
soit celui de relais
redistributeur des
ressources publiques.
30. Voir LAVILLE J.L., Lconomie solidaire.
Une perspective
internationale.
Librairie Arthme
Fayard/Pluriel, Paris,
2013, pp. 298-300.
le double risque pour les acteurs et les structures de lESS est dune part
linstrumentalisation (des organisations ou des finalits recherches par
celles-ci) par les pouvoirs publics et dautre part la concurrence des acteurs
privs lucratifs. Leur position dintermdiaire et la prise en compte de ces
deux risques illustrent demble lintrt pour les organismes de lESS de
bnficier de cadres lgislatif et institutionnel favorables. En effet, de telles
rformes dfiniraient de faon approprie le rle et les fonctions de ces organisations 29. Evoluer de ltat tutlaire ltat facilitateur 30 consacrerait la
vision plurielle de lconomie et inscrirait les organisations dESS comme
des institutions intermdiaires lintersection de la relation entre ltat, le
secteur priv hors ESS et la socit civile.
Une fois les rapports dfinis entre le secteur public et celui de lESS, ce
dernier gagnerait formaliser de faon innovante les liens et les possibilits
de partenariat avec le secteur priv hors ESS, en particulier dans loptique de
rpondre aux besoins de financement et de formation (notamment de comptences techniques, administratives et managriales). Les enjeux autour de
lducation et de la formation professionnelle sont lis celui du chmage
des jeunes et des femmes. Amliorer lemployabilit de ces populations dans
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
27
les structures de lESS peut se faire, par exemple, travers la mise en place
de filire ou de spcialit de co-formation Sud-Sud et Sud-Nord31 ou lambitieux projet campus MedESS de cration de la premire cole internationale
de management spcifique lESS avec ses diffrents sites mditerranens.
Le passage des logiques sectorielles des logiques transversales :
rseaux et cooprations institutionnelles
31. Comme le
prconise le rapport
de Michel Vauzelle
au Prsident et au
Premier ministre de la
Rpublique franaise,
Avec la jeunesse
mditerranenne,
matriser et construire
notre communaut de
destin (octobre 2013).
32. La cration en
octobre 2013 dun
ministre marocain
de lArtisanat et de
lconomie sociale
et solidaire (ESS) est
souligner. Celui-ci
a, entre autres, pour
objectif annonc de
soutenir la mise en
synergie des acteurs et
de structurer lESS au
Maroc.
33. VAUZELLE M.,
Avec la jeunesse
mditerranenne,
matriser et construire
notre communaut de
destin , op. cit., p. 21.
34. A ce titre, voir
le rseau REALISLR (Rseau Actif
pour LInnovation
Sociale en Languedoc
Roussillon, cr en
dcembre 2008).
Il regroupe les
diffrents acteurs de
lESS dans la rgion
(incubateur, ppinire
dentreprises
coopratives, cole
de lentrepreneuriat
dES, etc.) et bnficie
du soutien de lUE,
de la Rgion ainsi que
de la coordination
de la Chambre
rgionale dconomie
sociale et solidaire
du LanguedocRoussillon, ainsi
que le Laboratoire
mixte international
Mediter (Terroirs
Mditerranens :
Environnement,
Patrimoine et
Dveloppement )
pilot conjointement
par lUniversit
Mohammed V Agdal
(Rabat, Maroc)
et lInstitut de
recherche pour le
dveloppement (IRD,
France).
les monographies sur lESS au Maghreb relvent que dans chaque pays,
et de faon plus ou moins avance, des stratgies et des programmes sectoriels avec une dimension conomie sociale et solidaire ont t alors mis en
place. Nanmoins, chaque expert souligne le manque de stratgie cohrente,
globale et inclusive du secteur de lESS en tant que tel.
La structuration et lessor du secteur de lESS au Maghreb sont tributaires
dune coordination inter-ministrielle efficace32 et dune harmonisation de
laction publique destination du secteur. Les politiques publiques en matire
dESS sont attendues en matire de financement du secteur, de promotion,
de formation, de recherches acadmique et exprimentale, de projets-pilotes
innovants, daide par des services concrets, de politiques de demandes et de
moyens allous visant mettre les acteurs en liaison les uns avec les autres.
De plus, sur le plan des rapports entre les pays de la rgion euro-mditerranenne, ces derniers gagneraient sinscrire dans la dynamique propose
dernirement dans le rapport Vauzelle, concernant la cration dun espace
franco-maghrbin [euro-mditerranen] de lconomie sociale et solidaire33 et de
soutenir les initiatives rgionales qui proposent des axes de convergence en la
matire (cf. la cration dun fonds dinvestissement, CoopMed, port par le Crdit Coopratif, pour renforcer les capacits financires locales des structures).
La mise en rseau des acteurs et des structures peut se faire sous diffrentes formes dans loptique de dvelopper des synergies et des ples territorialiss dconomie sociale et solidaire. Le modle des ples de comptitivit
et dexcellence, organiss par filires et autour de plates-formes multi-acteurs,
peut servir dexemple 34 et sarticuler par la suite avec les reprsentations institutionnelles aux niveaux local, national et rgional (Maghreb et Mditerrane).
La mise en place de plateforme commune dingnierie de projets incluant des
collectivits territoriales du Sud de la France, dItalie et dEspagne peut galement se dcliner dans les pays du Maghreb travers des axes de coopration
multiples (inter-tatique, de coopration dcentralise, dorganisations de la
socit civile, etc.).
Lobjectif de convergence des politiques en matire dESS aura un
impact dautant plus grand sil est impuls par les chelons nationaux et
locaux. La cration de chambres rgionales de lESS au niveau des conseils
dconcentrs-dcentraliss dans les pays du Maghreb donnerait la possibilit aux acteurs de lESS de se regrouper en un ensemble de rseaux coopratifs, mutualistes, associatifs, de fondations et dentreprises sociales qui
se reconnaissent dans le concept dconomie sociale et solidaire. Des politiques publiques coordonnes qui utilisent pleinement les potentialits de
lESS peuvent galement prendre la forme de procdure de labellisation et
de certification ESS, de regroupement en ples dESS territorialises ou de
simplification des procdures de formalisation pour les organisations dESS
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
28
et les entreprises sociales (en particulier les entreprises dites dinsertion et
celles de services aux personnes).
Ladoption dune stratgie intgre de dveloppement de lESS dans les
territoires aura pour avantage de temprer les carts inter- et intra-rgionaux
dans les pays du Maghreb, dans les provinces o des tensions apparaissent du
fait des processus de comptitivit rgionale ( villes intermdiaires) et mondiale ( grandes mtropoles). Que certains territoires urbains et marginaliss,
ou de lintrieur et enclavs, soient inclus dans cette stratgie sera un facteur
dattractivit permettant aux initiatives dESS de bnficier dune meilleure
visibilit vis--vis des pouvoirs publics (tat ou collectivits locales), du secteur priv ( grande entreprise et PME-PMI-ETI) et des bailleurs de fonds
rgionaux et internationaux actifs dans la rgion.
Les leviers de dveloppement pour insrer lESS dans
le champ conomique
a. Voir ce propos le
rseau territorial Cit
ESS (Cits de lESS).
35. Voir les travaux de
ZAOUAL H. (dir.)
propos des innovations
territorialises
ou situes dans
Dveloppement durable
des territoires. Economie
sociale, environnement
et innovations,
LHarmattan, Paris,
2008.
36. BLAVOT C.,
Pour une cologie
industrielle , Institut
Veblen, Paris, 2011.
Favoriser lmergence dune conomie sociale et solidaire territorialise a
la coopration entre les acteurs sur un territoire favorise le croisement
des activits dont la mise en synergie permet une approche plus globale que
sectorielle. Cette dynamique, en plus daccroitre lattractivit du territoire par
la mobilisation de ressources nouvelles, donne une visibilit accrue et promeut un mode de dveloppement durable et solidaire attach aux pratiques
de proximit o les relations inter-personnelles sont centrales.
La runion dacteurs jusqu prsent en partie isols de lESS sur une base
territoriale a pour objectif de dvelopper des synergies et de mutualiser les ressources, les moyens et les risques des acteurs, de participer la convergence
des diagnostics et llaboration de rponses collectives apporter. Pour que
lESS soit reconnue en tant que secteur davenir, porteur dinnovation socioconomique 35, le secteur doit parvenir changer dchelle afin de peser rellement en faisant valoir son vritable poids conomique et social dans lespace
rgional et en vue de contribuer de faon effective une mondialisation plus
quitable et responsable et une transformation sociale et environnementale
du modle de lconomie de march.
Les secteurs de lconomie de march peuvent tre dclins dans le
domaine de lESS en tant quenjeux dcisifs pour un dveloppement durable
dans le bassin mditerranen. A ce titre, lorganisation en filire intgre (de
lapprovisionnement en engrais et autres intrants la commercialisation ou
la transformation des produits dexploitations) gagnerait se structurer et
sorganiser de faon mutualiser les moyens et les risques. Pour lagriculture,
larticulation dun dveloppement dune agriculture vivrire, oriente vers le
march local et les commerces de proximit, et lessor dune agriculture plus
exportatrice (produits labelliss bio, forte valeur ajoute) permettraient aux
producteurs de petite taille de passer de la rponse lurgence une insertion
progressive dans une logique conomique sur le long terme.
Lide dune cologie industrielle 36 qui, en associant les acteurs publics
et privs dun territoire et dans le prolongement des districts industriels
italiens, dveloppe des cooprations, des matriaux et des procds plus per-
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
29
formants sur les plans conomique, cologique et social ne peut tre envisageable qu condition que les acteurs dcident de converger et de sorganiser
pour mieux articuler, par exemple, les filires de production, de transformation, de commercialisation et de distribution.
La mise en place dune conomie circulaire base sur des rapports de
proximit et de rciprocit demande, pour devenir ralisable, des exprimentations de filires-pilotes, linstar des domaines de la collecte des dchets
solides urbains (matire et nergie) et du recyclage (utiliser les dchets des uns
comme matires premires des autres et construire des formes de bouclage
des flux de matires).
La constitution de lentrepreneuriat social et de lESS en tant que leviers
en faveur dun modle de dveloppement quilibr lchelle des territoires
ncessite des conditions dmergence et dvolution de systmes productifs
localiss, entendus comme une organisation productive particulire localise
sur un territoire correspondant gnralement un bassin demploi. Cette organisation fonctionne comme un rseau dinterdpendances constitues dunits
productives ayant des activits similaires ou complmentaires qui se divisent le
travail (entreprises de production ou de services, centres de recherche, organismes
de formation, centres de transfert et de veille technologique, etc.) 37.
Les axes dvolution et les recommandations en matire
dESS en Mditerrane : des outils communs pour rpondre
auxdfis et aux enjeux partags
il faut dabord rappeler la pertinence dapprhender lespace sous-rgional regroupant les pays du Maghreb comme un ensemble cohrent en vue de
rflchir aux potentialits de ces territoires et aux dfis quil sagit de relever.
Il sagit ensuite de partager un diagnostic propos du secteur de lESS en
Mditerrane en vue de dgager des propositions de travail qui puissent faire
lobjet de cooprations et dchanges.
Axes dvolution
37. DATAR, Les
systmes productifs
locaux, La
Documentation
franaise, Paris,
2002. Pour en
savoir plus, voir les
travaux de Raveyre
et Saglio (1984),
Courlet et Pecqueur
(1991) et de Beccatini
(notamment Le
district marshallien,
une notion socioconomique , in
Benko G., Lipietz A.,
Les rgions qui gagnent,
PUF, Paris, 1992).
des axes dvolution sont des lignes directrices qui soulignent lintrt
dune coopration entre les pays du Maghreb et lEurope afin de permettre
une meilleure structuration du secteur de lESS travers des changes de
savoirs, de savoir-faire et dexpriences russies. Plutt que daboutir des
programmes bilatraux, ces recommandations privilgient les cooprations
et les rseaux entre plusieurs pays.
Mettre en place des financements innovants destination de lESS
Avec le secteur public. La (re)dfiniton claire et partage (cadres juridique et
institutionnel) des statuts, des rles et des fonctions entre les organisations de
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
30
38. Ces initiatives ont
abouti, entre autres,
ladoption du statut de
la socit cooprative
europenne.
39. Lconomie
sociale dans lUnion
europenne, CIRIEC
(2007).
40. Le taux de
bancarisation varie
selon les pays du
Maghreb : plutt
lev en comparaison
des autres pays de la
rgion en Tunisie, en
progression constante
depuis une dizaine
dannes au Maroc, il
reste faible en Algrie.
Voir le rapport de
lUnion des banques
maghrbines (2009).
lESS et les pouvoirs publics offre la possibilit de revoir les principaux modes
de contractualisation entre ces derniers. Pour mettre en place une lgislation
favorisant par exemple les commandes publiques (contrat de partenariat, dlgation de service public ou march public) avec des organisations de lESS,
il serait intressant de voir dans quelle mesure le cadre en vigueur au Nord
pourrait tre mobilis au profit des pays du Sud de la Mditerrane.
Le rle des pouvoirs publics en vue de structurer le secteur est dterminant, do lintrt de dfinir des cadres adapts aux mutations contemporaines
et au rle de lESS comme secteur porteur. Lefficacit des politiques sociales
(notamment celles de lINDH au Maroc ou de lADS en Algrie) dpend en
partie de la volont des acteurs et des instituions publiques dinclure les organismes de lESS dans leur laboration et leur valuation. Les interdpendances
entre le secteur public et celui de lESS est dautant plus ncessaire que la promotion et la mise en synergie des structures de ce secteur se rvlent impensables sans lappui des autorits comptentes au niveau politique.
La loi visant promouvoir et structurer lESS en France, en discussion au
Parlement en 2013-2014, a pris des dcisions marquantes en vue de rserver
des financements destination du secteur : le groupe Caisse des Dpts va
tre amen grer une dotation de 100 millions deuros en faveur de lESS
afin de renforcer les fonds propres dentreprises du secteur et de consolider
les emplois. La Banque publique dinvestissement va galement disposer de
nouveaux outils de financement de lESS tels quun fonds de financement,
un fonds dinnovation sociale, des prts participatifs social et solidaire ou des
financements participatifs (crowfunding). On peut imaginer dans le cas du
Maghreb voir les Caisses des dpts et consignations tunisienne et marocaine
jouer un rle dans le soutien la structuration du secteur de lESS.
Depuis les annes 2000, les dispositifs et les outils de soutien lESS
au niveau europen se multiplient, en particulier sous limpulsion du Parlement europen, du Comit conomique et social europen (CESE) et de la
Confrence permanente europenne des coopratives, mutuelles, associations et fondations (CEP-CMAF) 38. Les effets structurants des programmes
europens tels que le Fonds social europen (FSE), les initiatives communautaires Adapt et Equal, ou encore laction pilote Troisime systme et emploi
ont renforc la visibilit de ce secteur en tant que ple dutilit sociale 39 en
mettant disposition de ces structures des moyens adapts.
Sil existe divers moyens de drainer lpargne vers les structures de lESS
et de rattacher ces dernires au circuit classique de lconomie 40, il semble
ncessaire dy parvenir avec le concours du secteur priv, notamment bancaire. Des passerelles avec les secteurs priv et public sont donc laborer
comme levier de dveloppement de lESS.
Financements innovants dans lESS et partenariat avec le secteur priv. Dans la
continuit de ces dmarches, la recherche de financements innovants recouvre
un large champ dinitiatives telles que la finance islamique, la finance solidaire, la micro-finance ou les expriences de monnaies solidaires et de banques
coopratives, qui gagneraient tre investies par les acteurs du secteur, de la
recherche acadmique (universits et thinks tanks) et les pouvoirs publics.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
31
41. Voir le Projet RSMENA qui encourage
depuis sa cration
en 2011 ladoption
et lutilisation de la
norme ISO 26000
sur la responsabilit
socitale dans la
rgion Moyen-OrientAfrique du Nord
(MENA).
42. Voir le label RSE
de la Confdration
Gnrale des
Entreprises
Marocaines (CGEM).
43. Petia Koleva et
Jouhaina Gherib
Laresponsabilit
sociale des
entreprises en
Tunisie : une lecture
institutionnaliste ,
Revue Tiers Monde
4/2012 (n212), p.
83-99.
44. Ibid., pp. 96-97.
45. A titre dexemple,
voir lEcole
COEPTIS ddie
la qualification
des dirigeants et
cadres dirigeants de
lconomie Sociale,
base Montpellier
(France).
46. Portails
numriques de
lESS au niveau
local recensant
et prsentant les
acteurs de lESS et
lquivalent lchelle
nationale ainsi que
celles du Maghreb
et du pourtour
mditerranen ;
diffusion dinfor
mations travers
des confrences
et des recherches
acadmiques et
exprimentales,
dpartements, voire
ministres publics
de lESS, ainsi que
des relais au sein des
collectivits locales,
etc.
En plus du rle central des banques et du secteur financier dans loffre
de services innovants visant intgrer une frange de la population reste
jusqu prsent lcart de laccs aux crdits, lESS recouvre le champ des
entreprises dites responsables qui intgrent des principes du dveloppement durable dans leurs actions. Les dynamiques autour de la responsabilit
sociale des entreprises (RSE) et de linvestissement socialement responsable
(ISR) ouvrent des questions concernant le rapport des entreprises avec leur
environnement et la relation que les banques entretiennent avec leurs clients
sur la destination et la gestion de lpargne. Si le concept et sa mise en pratique se diffusent tant en Algrie 41, quau Maroc 42 et en Tunisie 43, des spcialistes relvent le manque dinstitutionnalisation de la RSE comme un ensemble
cohrent de rgles de comportement en matire sociale et environnementale et de
vision globale intgrative 44. Pour y remdier, les tats de la rgion devraient
commencer par mettre en place un cadre lgislatif et rglementaire adapt
pour dfinir le socle partir duquel toutes les initiatives socialement responsables
volontaires vont pouvoir se dvelopper dans le respect des institutions.
Renforcer les capacits des acteurs de lESS : une offre de formation Nord-Sud
en matire dESS
conjugus aux besoins de financement et aux contraintes juridiques, les
principaux obstacles la prennisation des structures de lESS et la structuration du secteur se situent dans les besoins en comptences des acteurs.
La rponse aux carences dans la formation aux mtiers de lESS45 demande la
cration de contenu destination des cycles secondaires, de masters spcialiss, de chaires dans les instituts de formation et les universits en sciences
humaines et sociales. Lorganisation de rencontres pluriannuelles dchanges
dexpriences afin de rpondre aux faiblesses du secteur (dans la commercialisation des produits, lorganisation en filire intgr, la recherche de fonds,
etc.) est une autre cl pour accrotre la visibilit de lESS et son ancrage en tant
que secteur part entire qui fonctionne selon des principes propres et des
valeurs de coopration, de solidarit et dinnovation sociale tout en proposant
des offres comptitives. Ces dynamiques peuvent sappuyer sur des rflexions
stratgiques (campus MedESS, etc.) et des changes dexprience autour de
ples de formation professionnelle adapts aux besoins (structurels et conjoncturels) des organisations de lESS au Sud et au Nord de la Mditerrane.
La mise en place doffres de formation adaptes exige un travail danticipation des besoins en comptences des structures de lESS et, en aval, un
travail de communication et dinformation visant promouvoir et valoriser
le secteur sur diffrents supports 46. Afin dimpulser la mise en uvre de ces
objectifs, la cration dun Observatoire mditerranen de lESS sur les bases
de linitiative MedESS 2013 permettrait dans un premier temps de centraliser
les donnes collectes et actualises et de produire un rapport annuel sur la
ralit de lESS en Mditerrane, autant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Une institution comme celle-ci serait mme dvaluer lvolution du secteur et de formuler des recommandations ainsi quune vision prospective de
dveloppement du secteur long terme.
32
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Recommandations
lanalyse du secteur de lESS dans les trois pays du Maghreb appelle trois
recommandations sur la base desquelles, pourrait tre bti un partenariat
euro-mditerranen dans ce secteur :
Identification de lESS comme un secteur stratgique pourvoyeur demplois
etcrateur de richesses
il sagit de valoriser les potentialits de lESS pour linsrer efficacement
dans les politiques publiques en dfinissant clairement les rapports entre
lESS et laction publique.
Structuration du secteur et prennisation de ses activits dans le cadre
dunpartenariat Euromed renouvel
Procder dans le cadre du partenariat Euromed la rforme du cadre
juridique rgissant les organisations de lconomie sociale dans les pays du
Maghreb. Il sagit dassurer une reconnaissance lgale du secteur de lconomie sociale en clarifiant les cadres juridiques, en les adaptant aux exigences
de lESS et aux diffrentes formes dorganisations (coopratives, associations,
mutuelles, etc.) ce qui permettra plus de souplesse et de flexibilit dans la
cration de ces organisations.
Crer un statut de lESS et encourager la mise en rseau de ces entreprises
dans le but de faciliter le contact avec les pouvoirs publics et damliorer lefficacit des actions de dveloppement local par la coordination des actions, la
mutualisation des ressources et le renforcement des capacits en matire de
conception, de mise en place et de gestion de projets de dveloppement intgrs.
Mettre en place des cadres spcifiques lESS au niveau des collectivits
territoriales. Un rapprochement entre collectivits locales du Nord et du Sud
faciliterait lancrage dinitiatives qui rpondent aux besoins de chaque rgion
sur la base des bonnes pratiques dveloppes au Nord.
Renforcer les ressources humaines tant sur le plan quantitatif que qualitatif par la mise en place de programmes de formations et dencadrements
en leur faveur. Il sagit de dvelopper les filires universitaires en matire
dentrepreneuriat social, de management des entreprises sociales et dconomie sociale et solidaire afin de mettre la disposition des organisations
des trois pays du Maghreb les comptences dans ces domaines. Il sagit galement de crer des instituts de formation aux mtiers de lESS qui peuvent
tre regroups dans le cadre du rseau MedESS.
Dotation du secteur en ressources propres afin dassurer lautonomie
desstructures de lESS
la prennit du secteur repose sur des sources de financements stables et
rcurrentes. Dans ce cadre, il est ncessaire de rpondre aux besoins financiers
des oprateurs du secteur au Maghreb en envisageant la mutation du microcrdit la micro-finance solidaire, de favoriser la cration de banques coopratives
et dinstitutions de micro-assurance et de mieux distinguer les acteurs issus du
secteur institutionnel de ceux de lESS sur le plan rglementaire et juridique.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
33
annexe
Donnes conomiques par pays membres
du Rseau Euro-mditerranen de lconomie sociale ( ESMED )
Plaquette de prsentation du Rseau ESMED
(http://www.socialeconomy.eu.org/IMG/pdf/triptico_ESMED_frances.pdf)
34
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
bibliographie
Regards dconomistes sur lconomie sociale
etsolidaire, (2013) Alternatives conomique N63
bis, Paris.
DHAHER N., (2010), Lamnagement du
territoire tunisien : 50 ans de politiques lpreuve
de la mondialisation , EchoGo N13.
HILLENKAMP I. et LAVILLE J.-L., (2013),
Socioconomie et dmocratie : lactualit de Karl
Polanyi, Ers, Paris.
KOLEVA P. et Jouhaina GHERIB J.,
Laresponsabilit sociale des entreprises
en Tunisie: une lecture institutionnaliste,
RevueTiers Monde 4/2012 (n212), p.83-99.
LAVILLE J.-L., (2013), Lconomie solidaire.
Uneperspective internationale. Collection Hachette
Pluriel Sociologie, Paris.
Lconomie sociale dans lUnion europenne.
Rapportde Jos Luis Monzn et Rafael
Chaves, Centre international de recherches
etdinformation sur lconomie publique, sociale
et cooprative (CIRIEC) et Comit conomique
etsocial europen (CESE), 2012.
Lconomie sociale de A Z ,
Alternatives conomiques, 2008.
MADARIAGA N., (2013), Croissance
etemploi dans les pays du Sud et de lEst
delaMditerrane : les gains de productivit
du travail jouent-ils un rle dans la cration
demplois ?, Macrodev n8, Agence franaise
dedveloppement, Paris.
MARTIN I., (2012), Emploi et mobilit
des jeunes en Mditerrane : une question
stratgique. en qute de stratgie, Confluences
Mditerrane.
OUADAH-BEDIDI Z., VALLIN J.,
BOUCHOUCHA I., (2012), La fcondit
auMaghreb: nouvelle surprise, Population
etSocits N 486 Bulletin mensuel dinformation
delInstitut national dtudes dmographiques.
POLANYI K., La Grande Transformation, aux
origines politiques et conomiques de notre temps
(1944), Gallimard (1983).
ZAOUAL H. (dir.), (2008), Dveloppement durable
des territoires. Economie sociale, environnement
etinnovations, LHarmattan, 2008.
35
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Lconomie sociale
etsolidaire auMaghreb
Quelles ralits
pour quel avenir ?
Monographies nationales
algrie, maroc, tunisie
Malika Ahmed-Zad
Touhami Abdelkhalek
Zied Ouelhazi
Coordonn par
Alexis Ghosn
Chef de projet ESS, Ipemed
Novembre 2013
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
36
table des matires
des monographies
La ncessit dvoluer vers un rseau
de lESS en Algrie, au Maghreb et
dans la rgion euro-mditerranenne . . . . . . . 71
Des leviers de financements multiformes. . . . . 71
Les tablissements bancaires intervenants
dans les dispositifs de micro-crdits. . . . . . . . . . 71
Rsum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Les tablissements publics intervenants
dans les dispositifs de micro-crdits. . . . . . . . . . 71
Lentrepreneuriat social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Algrie
valuation du poids de lESS dans lconomie
algrienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Contexte conomique, dmographique
et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Perspectives davenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Principales causes de la crise
socio-conomique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Principales rponses institutionnelles la crise. 44
Moyens mis en uvre pour assurer
la cohsion sociale
Les quatre orientations principales des
mesures sociales partir de 1990
Laction pour linsertion et la cration
demplois
Dfinition et activits de lconomie sociale . . 47
Les pratiques de solidarits traditionnelles . . . 48
Acteurs, structures etemplois gnrs. . . . . . . 50
Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Mutuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Fondations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Secteur coopratif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Gense du mouvement coopratif
Coopratives dpargne
Le secteur assurantiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Contexte historique, juridique et
institutionnel
Caractristiques
Un fort potentiel dedveloppement
Un secteur domin par lescompagnies
publiques
Prvalence des assurances obligatoires
(dommages : automobile)
Les assurances de personnes : activit
naissante et crneau davenir
maroc
Contexte conomique, dmographique
et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Dmographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
conomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Enseignement et alphabtisation . . . . . . . . . . . 89
Pauvret et prcarit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Emploi et chmage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Dfinition et composantes de lESS. . . . . . . . . . 90
propos de la forme historique de lESS. . . . . . 90
Dfinition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Composantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Les coopratives
Les associations
Les mutuelles
Enjeux et cadre institutionnel. . . . . . . . . . . . . . 96
Lconomie sociale en chiffres. . . . . . . . . . . . . . 98
Le secteur coopratif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Rpartition des coopratives actives
selon le secteur dactivit,
selon la rgion conomique
Les femmes dans les coopratives
Performances des coopratives
Lemploi dans le secteur coopratif
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
37
Le secteur associatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Expriences rgionales
Difficults rencontres par les associations
Le secteur des mutuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Mutuelles de couverture sanitaire et sociale
Mutuelles dassurance
Socits de cautionnement mutuel
A propos du systme de protection sociale
Autres expriences : les mutuelles
communautaires
Organisations informelles
Politiques publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Valoriser et promouvoir le produit de lESS. . . . 117
Renforcer et organiser les acteurs . . . . . . . . . . . 118
Crer un environnement favorable
au dveloppement de lESS . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Favoriser lmergence dinitiatives sur
lesterritoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Faciliter laccs des acteurs de lESS
la scurit sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Dvelopper les outils de suivi et dvaluation,
de veille stratgique, de communication
etdepartenariat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Perspectives davenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Conclusion et recommandations. . . . . . . . . . . . 122
tunisie
Cadre conceptuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Emergence du concept de lentrepreneuriat
social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Dfinition de lentrepreneuriat social et
delentreprise sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Distinction par rapport des notions proches. .
132Social business
Responsabilit sociale de lentreprise
Innovation sociale
Entrepreneuriat social
Ampleur de lentrepreneuriat social. . . . . . . . . . 134
Contexte conomique, dmographique
et social et conomie sociale. . . . . . . . . . . . . . . 135
Contexte socio-conomique. . . . . . . . . . . . . . . . 135
Contexte dmographique
Contexte conomique
Le dispositif de lESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Les associations
Les mutuelles
Les organismes professionnels agricoles
Autres organisations
Les politiques publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Dispositif institutionnel
Dispositif de financement des
organisations delESS
Politiques publiques en matire dESS:
analyse comparative
Contribution socio-conomique
des organisations de lESS . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Organisations de lESS : rponse lurgence
ouentrepreneuriat social ?. . . . . . . . . . . . . . . . 162
Evaluation du positionnement. . . . . . . . . . . . . . 162
Indicateurs de la dimension conomique
Indicateurs de la dimension sociale
Indicateurs de la structure de gouvernance
Etudes de cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Association ferme thrapeutique pour
handicaps Sidi Thabet
Association de soutien lautodveloppement
Conclusion et recommandations. . . . . . . . . . . . 170
Annex e 1
Cadre juridique des organisations de lESS
enTunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
38
rsum
la crise conomique et louverture des marchs dans le cadre de la mondialisation contribuent limiter les moyens des tats pour faire face seuls
aux dfis lis la rsorption du chmage, aux nouvelles formes de pauvret
et la dgradation de lenvironnement. Cette situation a favoris lmergence
dun secteur, autre que ltat et le secteur priv, qui essaye dapporter une
contribution la rsolution de problmes sociaux et conomiques. Il sagit
de lconomie dite sociale et solidaire associations, mutuelles, coopratives,
activits lies linsertion, services la personne, etc. qui se caractrise par
une gouvernance dmocratique, une gestion solidaire, un partage galitaire
des salaires et/ou des profits et des finalits sociales.
Lconomie sociale prend plusieurs appellations en fonction du contexte
et du rfrentiel culturel. Ainsi on parle du non-profit organisations aux tatsUnis, du volontary sector au Royaume-Uni, de lconomie sociale et solidaire, de
lconomie populaire, de lconomie de dveloppement communautaire dans
le monde francophone et en Amrique latine. Pour dsigner le mme secteur
on parle parfois dun tiers secteur finalit sociale, dun tiers secteur dconomie de proximit, ou encore dun secteur accompagnateur des deux secteurs
priv et public. Toutes ces dfinitions dsignent un ensemble dactivits conomiques et sociales exerces par des organisations relevant de la socit civile
et parfois de type coopratif. Ce type dorganisations sest dvelopp partout
dans le monde, dans des pays aussi bien dvelopps quen dveloppement, et
apporte une contribution non ngligeable aux conomies nationales.
Lislam sert aussi de rfrence majeure pour de nombreuses initiatives
du secteur. Ainsi, des banques dites islamiques cherchent dvelopper des
pratiques non capitalistes et refusent le principe de lintrt sur le capital.
Cela se traduit par des ralisations proches de ce que lon dfinit habituellement en Occident comme lconomie sociale. La Grameen Bank, au Bangladesh, est un bel exemple de projet marqu par la culture musulmane. La
philosophie de la Grameen Bank offre une lecture mancipatrice de lislam
et souligne le rle central que les femmes ont jouer dans le dveloppement,
particulirement celles qui sont les plus faibles sur le plan conomique.
Dans les pays du Maghreb, la culture de solidarit, dentraide et de travail
collectif a toujours fait partie des pratiques des populations locales. Toutefois,
lmergence de lconomie sociale et solidaire sous une forme structure et
organise, notamment pour sa composante associative, est rcente dans les
trois pays du Maghreb. Au Maroc et en Tunisie, lorganisation du secteur
date des annes 1980 et du dbut des annes 1990 suite lapplication de
programmes dajustement structurel. En Algrie, lconomie sociale sous sa
forme modernise est apparue au milieu des annes 1990 afin dattnuer les
effets de la transition vers lconomie de march qui sest accompagne dun
accroissement des exclusions, de la pauvret et du chmage.
39
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Les organisations de lconomie sociale, particulirement les associations, se sont dveloppes dans le Maghreb et ont pris du terrain dans plusieurs domaines longtemps rservs ltat : la fourniture des services et
des quipements de base, notamment dans le monde rural, la lutte contre
lanalphabtisme, la cration et laccompagnement de projets de dveloppement, la promotion et lintgration de la femme dans le circuit conomique,
la promotion dactivits gnratrices de revenus, etc. Dot dun fort potentiel,
le secteur de lESS gagnerait tre valoris et structur afin den faire un vecteur de dveloppement socio-conomique, crateur demplois et de revenus.
En effet, latout majeur de ces entreprises rside dans leur proximit avec les
populations locales et leur connaissance des besoins au sein des territoires.
40
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
conomie sociale et solidaire (ESS)
en Algrie
Malika Ahmed Zaid
Professeur, directrice du Laboratoire REDYL
( Rformes conomiques et dynamiques locales,
Universit Mouloud-Mammeri, Tizi-Ouzou, Algrie)
41
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
selon m. autes (2006), lconomie sociale et solidaire recouvre un vaste
champ dinitiatives et dactivits loin davoir une visibilit sociale la hauteur
de ce quelles reprsentent en termes de volume conomique et demplois.
Entre, dun ct, les acteurs historiques de lconomie sociale dont la gnalogie remonte au xixe sicle et qui sont solidement installs dans le paysage
conomique et social, et la multiplicit des initiatives qui ont merg essentiellement dans le dernier quart du xxe sicle en cho aux transformations
profondes du capitalisme, il existe tout un ensemble de continuits et de
discontinuits que de nombreux travaux et tudes tentent dclairer.
Dans ce rapport, lobjectif est de prsenter un tat des lieux de lconomie sociale et solidaire (ESS) et dapporter un clairage sur les enjeux
actuels de ce secteur en Algrie. Le rapport met en avant les potentialits
mais aussi les limites de lESS qui se prsente aujourdhui dans de nombreux pays comme un atout complmentaire, porteur de dveloppement
social et conomique quilibr et rparti de faon quitable. Il identifie les
obstacles quelle rencontre et les opportunits quelle reprsente en termes
dactivit conomique, de cration demplois, de rponse des besoins que le
march et lconomie administre laissent en friche ou inaccomplis. Ltude
analyse galement les rfrents qui peuvent aider matrialiser les actions
entreprises dans le cadre de lESS, quils soient intrinsques la socit ou
extrinsques vhiculs par lconomie administre, le march et tant dautres
facteurs influents.
Par ailleurs, il est ncessaire de souligner la difficult dapproche de
lESS. Celle-ci peut partir de micro-initiatives associatives ou sinscrire dans
des logiques de dveloppement social au niveau local ou danimation sociale
linitiative de collectivits locales, le plus souvent, ou des mouvements
dducation populaire en milieu rural. Elle peut aussi prendre la forme de la
mutualisation de risques ou de moyens comme dans le domaine de la sant
ou de lagriculture (cf. la Caisse nationale de mutualit agricole algrienne).
LESS a galement des liens avec les logiques dinsertion des publics en difficult: entreprises dinsertion, rgies de quartier, comits de villages, actions
danimation ou de formation.
La question est donc de savoir ce que ces expriences ont en commun.
Quest-ce qui les identifie ou spcifie comme tant des activits dconomie
sociale et solidaire ? Tout dabord, on constate des racines historiques communes : les solidarits (dites traditionnelles), le souci de lautre, limportance
de la personne face des rapports conomiques qui dshumanisent les relations, des logiques dauto-organisation dans des situations conomiques et
sociales difficiles.
42
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
Contexte conomique, dmographique et social en Algrie
lalgrie est un pays producteur et exportateur de ptrole gnrant de forts
revenus, disposant de potentialits agricoles certaines et investissant dans le
capital humain. Macro-conomiquement, elle affiche des indicateurs encourageants ( Pib ). LAlgrie, linstar de bon nombre de pays en dveloppement
a vcu et vit lexprience dadhsion lconomie de march.
Cependant, malgr toutes ses potentialits, lconomie de lAlgrie na
pas emprunt la trajectoire de la diversification au regard de ses performances lexportation. Bien quayant procd une rforme de sa politique
commerciale, lAlgrie na pas russi matrialiser les mutations attendues
de son systme productif, hypothquant ainsi le processus dmergence conomique. La tentative de conversion de son conomie au modle exportateur
reste un processus inachev, et encore moins concluant. Son insertion lconomie internationale continue dafficher un caractre statique, en raison de
la permanence de spcialisations industrielles domines par les ressources
naturelles et les biens intensifs en facteur travail peu qualifi (tableau 1).
Les IDE nont pas donn les rsultats escompts et la cration demplois ne connat pas les succs esprs. Le secteur informel est puissant
et le chmage affectant la population jeune (notamment diplme) est en
apparence de 9 %, mais il est voil par les dispositifs demplois prcaires et
gnralement temporaires. Le modle de dveloppement actuel, assis sur un
systme rentier induit, entre autres, de nouvelles fractures sociales, et une
propagation de nouvelles ingalits au niveau de la population.
Lconomie sociale et solidaire (ESS) se prsente comme une voie possible la lumire des expriences vcues par certains pays latino-amricains
et africains. La situation algrienne, tout autant que la sous-rgion maghrbine, illustrent combien il est ncessaire dinvestir le champ de lESS en
sappuyant sur lide dexploiter le capital social qui est une donne fondamentale des socits algrienne et maghrbine, traditionnellement solidaires et entreprenantes.
Face la situation financire et conomique de lAlgrie au dbut des
annes 1990, les mesures sociales ont tard venir. Les premires nont t
mises en uvre quen 1992. Elles ont t entreprises sous lgide de la Banque
mondiale (BM) en tant que programmes daccompagnement lapplication
du plan dajustement structurel (PAS). Faute de moyens, leurs impacts furent
limits. En 1996, ces mesures ont t renforces grce lamlioration de
lconomie algrienne.
Avant de prsenter les moyens et instruments mis en uvre pour
rpondre aux dfis poss par le contexte conomique et sociale algrien,
nous allons prsenter les causes ayant induit cette situation de crise multidimensionnelle. La crise sociale a pris une dimension importante depuis
1990, avec diverses caractristiques principales.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
43
tableau
Algrie
1 Indicateurs macro-conomiques de lAlgrie
Population ( au 1er janvier 2013 )
37,8 millions
PIB/habitant ( 2012 )
5 659 USD
PIB/habitant en PPA ( 2012 )
7 262 USD
IDH ( 2012 )
0,713
(93e sur 187 pays)
Classement Doing Business ( 2013 )
Taux de chmage ( 2012 )
152/185
10,2 %
Taux dinflation (dcembre 2012,
en glissement annuel)
8,89 %
Taux de change /DZD
(moyenne 4e trimestre 2012)
102,95
Prix du baril de ptrole brut
(OPEC basket price, moyenne annuelle 2012) 109,45 USD
Rserves de change
(au 31 dcembre 2012)
193,9 Mds USD
FMI
Principales causes de la crise socio-conomique
1. Pour lOrganisation
de coopration et
de dveloppement
conomiques (OCDE),
une rcession est une
priode dau moins
deux ans pendant
laquelle lcart de
production cumul
atteint au moins 2 %
de Pib et la production
devient infrieure
dau moins 1 % la
production potentielle
durant une anne au
moins. (Perspectives
conomiques de lOCDE,
vol. 2008, n 2, p. 31).
2. Le taux de
pauvret en Algrie
avoisinerait 22,6 % de
la population, selon
lenqute de lONS
datant de 1995.
Laugmentation importante du taux de pauvret.
Laugmentation du taux de chmage et limportance du niveau
du licenciement dans les entreprises publiques.
La baisse du pouvoir dachat.
la crise ptrolire de 1986 a mis en relief la forte dpendance de lconomie algrienne des facteurs exognes, son manque defficacit et ses dysfonctionnements. Elle a rvl galement les consquences dune confusion
entre lconomique et le social. Les facteurs de cette crise, essentiellement
lie lconomie, se rsument comme suit : importance du poids de la dette
extrieure, baisse du taux de croissance du Produit intrieur brut (Pib), suppression de la subvention des prix la consommation, volution de linflation.
Nous prsentons ci-dessous ces facteurs, dans une perspective volutive,
afin de mieux comprendre leur contribution laccentuation de la crise et
llargissement de la pauvret. Une baisse du Pib a t enregistre, dune
moyenne annuelle de -0,6 % entre 1986 et 1994, qui sest traduite par une
phase de rcession 1.
Lvolution des prix la consommation a enregistr une baisse du pouvoir dachat qui est visible lorsque lon analyse lvolution de lindice gnral
des prix la consommation qui a enregistr des variations moyennes de
21,1 % entre 1990 et 1996.
La baisse du pouvoir dachat est galement lie la suppression du systme de subvention des prix. La loi de 1989 sur les prix a consacr labandon
de la rgulation et de ladministration systmatique des prix. partir de l, un
grand nombre de produits na plus bnfici de la subvention tatique. Cette
perte de pouvoir dachat, face la libralisation du march, sest rpercute
sur linflation qui a pris des proportions exceptionnelles entre 1990 et 1996.
Lensemble de ces facteurs a induit une forte augmentation du taux de pauvret
qui a atteint des niveaux record, dpassant 20 % selon certaines estimations 2.
Lextension du chmage demeure lune des consquences les plus nfastes
de lapplication du programme dajustement structurel (PAS) du Fonds montaire international (FMI). Face cette situation et la contraction des dpenses
budgtaires, ltat a initi des programmes pour attnuer les effets sur les
populations dfavorises. Nous retraons ci-dessous les principales mesures,
qui vont de pair avec les rformes conomiques partir de 1990.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
44
Algrie
Principales rponses institutionnelles la crise socio-conomique
3. Par exemple, les
vnements qui ont
marqu Alger en
octobre 1988, appels
meutes de la semoule.
4. Dcret excutif
n 96-232 du 29 juin
1996 portant cration
et fixant lesstatuts
de lAgence de
dveloppement social
(ADS).
5. CNES, volution
des systmes de
protection sociale ,
2001.
6. Dcret excutif
n 97-327 du
09/09/1997, portant
attribution du ministre
de la Solidarit
nationale et de la
famille, JORA n 60,
du 10/09/1997,
pp. 4-6.
7. ADS, Recueil de
textes rgissant les
programmes grs par
la ADS , d. 2001.
8. Dcret prsidentiel
n 08-09 du
27/01/2008, confrant
au ministre de la
Solidarit nationale
le pouvoir de tutelle
sur lAgence de
dveloppement
social, JORA n 05
du30/01/2008, p. 4.
Les moyens mis en uvre par les pouvoirs publics pour assurer la cohsion sociale
afin de rpondre la situation de crise conomique et sociale, ltat a mis
en uvre un ensemble dinstruments, des institutions et des financements
pour assurer la cohsion sociale 3. On peut synthtiser comme suit ensemble
de mesures prise :
Cration dinstitutions charges de la prise en charge du chmage et de
la pauvret ou de la mise niveau des institutions existantes, telles que la
Caisse nationale dassurance chmage (CNAM) et lAgence nationale pour
lemploi (ANE). La cration, en 19964, de lAgence de dveloppement social
(ADS) est lune des actions majeures dans ce processus.
Cration dun dispositif daction sociale, notamment le filet social qui
est le premier dispositif daide sociale initi en 1992. Dautres dispositifs ont
t mis en place et se sont accentus partir de 1998 avec lamlioration de
la situation conomique du pays.
Financement, par le budget public en direction des secteurs sociaux, dun
ensemble vari daides et de soutiens aux catgories dmunies et dfavorises.
Rhabilitation de la solidarit publique, par la cration du ministre de
la Solidarit nationale afin dassurer la mise en uvre de ces filets sociaux.
ceci sajoute une forme dappel combiner leffort de solidarit publique
avec les autres formes de solidarits prives afin dassurer une forme de
complmentarit et defficacit dans laction.
Prise en charge de la dimension sociale dans lensemble des programmes
de dveloppement initis par ltat : un Plan de soutien la relance conomique
(PSRE), un Programme de proximit de dveloppement rural (PPDR), un Plan
de proximit de dveloppement rural intgr (PPDRI), etc.
Il est possible de dtailler de faon plus prcise ces actions et danalyser
leur logique dintervention travers la prsentation du Budget social de la
nation (BSN), considr comme linstrument privilgi de laction sociale de
ltat. Le BSN se compose de deux grandes parties : la premire concerne les
transferts montaires et la deuxime les transferts non montaires.
Les dpenses sociales de ltat algrien ont connu une nette progression
de 1990 1992, une diminution de 1992 1996 puis, de 1997 nos jours,
une volution positive. En 2000, elles reprsentaient 12,6% du Pib 5.
La cration en 1997 6, dun dpartement ministriel visant rtablir
un systme de solidarit publique fut la principale rponse institutionnelle
aux phnomnes de pauvret et dexclusion sociale. Ce ministre est charg
de la gestion des dispositifs de solidarit et daction sociale mais aussi de
ltude, de la programmation et de linitiation de tout type daction visant
lutter contre la pauvret et lexclusion. Les attributions de ce ministre sont
principalement orientes vers la ralisation et le suivi des programmes et
dactions pour la cohsion sociale.
Une Agence de dveloppement social (ADS) a t cre en 1996 7 sous
la tutelle du Premier ministre, puis est passe en 2008 sous la tutelle du
ministre de la Solidarit nationale8. Elle a pour mission gnrale, le dveloppement conomique et social des catgories dmunies, savoir :
le dveloppement communautaire ;
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
45
Algrie
les filets sociaux ;
les cellules de proximit ;
les travaux dutilit publique haute intensit de main-duvre (Tuphimo, ex-ABC ) et les primes dinsertion des diplms (PID, ex-CPE) ;
les micro-crdits.
la multiplicit de moyens et dinstitutions cres sajoutent des dispositifs de protection sociale et daide pour lamlioration des conditions de vie des
populations dmunies. Ces dispositifs ont t impulss, partir des annes
1998-1999, grce lamlioration progressive de la situation conomique du
pays due laugmentation des prix du ptrole. Le Pib est en nette augmentation
(81,85 %) entre 2000 et 2005. La priode 2003-2005 enregistre des augmentations record avec un taux moyen de variation annuelle de 18,22 %. Les prix
la consommation ont connu une certaine stabilit par rapport laugmentation
quils ont enregistre entre 1989 et 2000. La stabilit des prix la consommation a conduit une baisse significative du taux dinflation.
La variation de lindice des prix la consommation a connu une forte
baisse, passant de 20,2 % en 1990 3,9 % en 2007. Cette amlioration des
conditions conomiques du pays a rduit le taux de pauvret, qui est pass de
22,6 % en 1995 6 % en 2005, selon lenqute ralise par le Centre national dtudes et danalyses pour la population et le dveloppement (CENEAP).
Lengagement public dans le domaine de lemploi a permis une baisse du
taux de chmage depuis 2000. Cette baisse sexplique par le dveloppement
conomique du secteur priv, devenu un employeur part entire ct de
ltat, et par limportance de lemploi public cr dans le cadre des dispositifs de
promotion et dinsertion. Le rythme de cration demplois sest amlior, passant de 2,2 %, en moyenne annuelle entre 1997 et 2001, 6,6%, en moyenne
annuelle pour la priode 2001-2005, correspondant la cration de 1,8 millions
demplois 9.
9. CNES, PNUD,
Rapport sur le
dveloppement en
Algrie , 2006, p.56.
10. ADS, Recueil
detextes rgissant les
programmes sociaux
grs par lADS, d.
2001.
Les quatre orientations principales des mesures sociales partir de 1990
concernant laide sociale pour les catgories dfavorises, les principaux programmes visant cet objectif sont :
Lallocation forfaitaire de solidarit (AFS), destine aux chefs de famille
gs de plus de 60 ans sans revenus, aux personnes ges vivant seules et aux
personnes dans lincapacit physique de travailler. Le montant de lallocation
est de 1000 dinars algrien (DA) par mois10, avec une prise en charge de la
couverture sociale et un complment de 120 DA par personne charge, pour
un maximum de trois personnes.
Lindemnit pour activit dintrt gnral (IAIG), octroye aux personnes membres de familles sans revenu, dge actif et apte au travail, en
contre partie de leur participation des activits dintrt gnral organises
par les collectivits territoriales. Le montant de lindemnit tait de 2200 DA
en 1995. Elle est passe 2800 DA en 2001 puis 3000 DA depuis, avec une
indemnit de 4250 DA pour les chefs de chantier. Ils bnficient galement
de la couverture sociale.
LAFS et lIAIG sont deux dispositifs constitutifs de ce quon appelle
le filet social, initi depuis 1992. Ils sont grs par lADS en collaboration
avec les Directions des actions sociales (DAS) et les bureaux communaux de
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
46
Algrie
laction sociale. Le quota des bnficiaires est arrt au niveau national pour
chaque wilaya.
En plus de ces deux dispositifs, laide sociale comprend des actions daides
matrielles et financires, de couverture sociale et de prise en charge dans des
tablissements spcialiss pour les personnes en situation de handicap. Une
aide est galement accorde aux familles accueillant un enfant priv de famille.
Les programmes de dveloppement communautaire initis en 1998
soutiennent des initiatives en faveur des populations dmunies en collaborant au financement et la ralisation de projets dutilit conomique et
sociale avec la mobilisation des populations concernes, dans le secteur de
ladduction deau potable (AEP), de lassainissement et dans la distribution
publique dlectricit. La particularit de ces projets demeure dans la dimension participative quils comportent. Les habitants des localits bnficiaires
participent la concrtisation de ces projets par le biais dune contribution
financire de 25% ou dun apport en main duvre et en matriaux. Les 75 %
restants sont financs par lADS.
11. Appele
dispositif demplois
dattente .
12. Dcret
Excutif n 08.10
du 27/01/2008
modifiant le dcret
excutif n 04.14 du
22/01/2004, portant
cration et fixant les
statuts de lAgence
de Gestion du
Microcrdit, JORA
n 05 du 30/01/2008,
p.4.
13. ADS, Agence
de dveloppement
social, Recueil
de textes des
programmes sociaux
grs pat lADS ,
2001.
Laction pour linsertion et la cration demplois
en raison de limportance du taux de chmage en Algrie, un dispositif
dinsertion et de lutte contre de chmage, a t mis en place ds 1992. La
premire mesure visait linsertion et la cration demplois temporaires11 dans
le cadre des travaux dutilit publique haute intensit de main-duvre
(TUP-HIMO), des emplois salaris initiative locale (ESIL) ou des contrats
pr-emploi (CPE). Ces trois programmes ont t transforms, au dbut danne 2008, en utilisant respectivement les acronymes PAIS, ABC et PID. Toutefois ils demeurent inchangs du point de vue du contenu, des conditions
daccs et des montants des indemnits.
Un autre ensemble de mesures visant la cration demplois durables a
t mis en place. Il sagit principalement du :
Micro crdit. Dispositif cr en 1999 gr par lAgence de gestion du microcrdit, mise elle aussi sous la tutelle du ministre de la Solidarit nationale12,
il consiste octroyer des crdits pour des projets dune valeur comprise entre
50000 DA et 400000 DA avec bonification du taux dintrt jusqu 90 %
de linvestissement.
La micro-entreprise. Dispositif gr par lANSEJ, cest un ensemble daides et
dincitations investir dans les projets de moins de 10 millions de DA avec
un apport personnel de 10 %.
Ces mesures visant crer de lemploi durable ont t renforces en
2005 dans le cadre du PSRE par le programme de construction de locaux
pour activit conomique. Ces locaux sont destins aux jeunes chmeurs
pour la ralisation dactivits conomiques de commerce et de production.
la fin des annes 1990, un nouveau type daction sociale tait en promotion en Algrie. Le dispositif cellule de proximit 13 fut le programme phare
de lpoque. Il visait une meilleure prise en charge de la question sociale en
adaptant la rponse chaque besoin par un traitement direct. Il prvoyait un
recensement local de la demande sociale en matire dducation, de prvention
sanitaire, dinsertion socioprofessionnelle, danimation culturelle sportive,
psychosociale, ainsi que toute aide et information. Ces cellules de proximit
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
47
Algrie
ont t installes dabord dans des zones dites trs sensibles puis elles taient
appeles tre gnralises dans toutes les communes. Loprationnalit de
ce dispositif reste trs limite et mme installes, les cellules de proximit,
nexercent pas pleinement leurs missions.
Dans le contexte algrien, la construction du rfrentiel de lESS se fait
en relation avec lconomie classique. Les trois volets reconnus lESS sont
ici dclins diffremment. Le premier, ayant trait au type de rapports aux usagers, prend galement en considration les aspirations des acteurs dans le
fonctionnement interne de leur organisation. Le second concerne le rapport
au march et linscription en tant quconomie dite du tiers secteur, notamment
dans des changes avec lconomie dite classique. Elle cherche se positionner comme une conomie diffrente de cette dernire. Le champ acadmique
et un nombre important dacteurs de lESS parlent aujourdhui du concept
dconomie plurielle 14 pour dsigner le secteur de lESS et la distinguer de lconomie de march et de lconomie publique (tat et collectivits territoriales).
Le troisime volet a trait au rapport au politique relativement aux politiques
publiques inities qui prtendent des formes dinnovations sociales, mais qui
produisent des rponses peu efficaces au chmage, lexode rural et la prise
en charge des services publics locaux tant ce rapport reste inachev en raison
de labsence de prise en compte du processus de dfinition et de construction
de politiques publiques locales.
Dfinition et activits qui embrassent le champ de lconomie
sociale en Algrie
14. A propos du
concept dconomie
plurielle , voir les
travaux de LAVILLE
(J.-L.), notamment
Socioconomie et
dmocratie : lactualit
de Karl Polanyi. I.
HILLENKAMP (dir.)
& J.-L. LAVILLE
(dir.), Ed. ERES, 2013.
en tant que fait nouveau et tardant se formaliser et tre accept en tant
que tel et surtout en tant qualternative viable par rapport aux autres formes
dconomies, il faut relever la difficult dfinir le primtre et les frontires
du champ de lESS en Algrie, et encore moins, peser ce quelle reprsente
en termes de volume conomique et demplois. dfaut de mesurer ltendue et limpact des actions conduites dans le cadre de lESS, on peut rendre
compte, de manire qualitative, des types dactivits embrasses par lESS.
Le manque de visibilit des activits de lESS est chercher entre autres
dans les rapports et les interactions avec les politiques publiques, en raison
notamment de limportance de lintervention de ltat, particulirement ces
deux dernires dcennies, qui ont vu une croissance substantielle des revenus
externes du pays. Lancrage de la gratuit du service public dans les mentalits
ne favorise pas le dveloppement de lesprit entrepreneurial et la prise dinitiative si bien que lmergence des pratiques de lESS se trouve contrari par
un environnement social rfractaire au changement.
En dehors des formes traditionnelles et religieuses, lconomie sociale et
solidaire tend se confondre ou se substituer avec les mesures publiques
dinsertion professionnelle. Souvent elle est directement ou indirectement alimente par des fonds publics dans lobjectif de rechercher la paix sociale. Ds
48
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
lors, la forte intervention de ltat a imprim une forme de canalisation des
activits de lESS dans des crneaux prfrentiels aux politiques publiques. On
observe des actions lies aux politiques publiques telles que les politiques dinsertion et les actions de dveloppement local. Dautres activits se substituent
la politique publique dans une forme de subsidiarit, tels que les projets ou
actions entreprises dans le cadre de la solidarit religieuse (Fonds de la zakat).
On peut rappeler quun ministre de la Solidarit et du Travail et une Agence
de dveloppement social (ADS) ont t crs au milieu de la dcennie 1990
au moment o la socit algrienne subissait les affres de la violence.
Loin dtablir une typologie exhaustive des activits embrasses dans le
cadre de lESS en Algrie, une analyse des champs dintervention des diffrentes structures de lESS (associations, mutuelles, coopratives et quelques
banques qui simpliquent dans cet lan social et solidaire), permet didentifier les principaux crneaux dactivits : formation, lutte contre la pauvret
et les flaux sociaux, animation de quartiers et de villages, alphabtisation et
ducation, mutualisation de risques et de moyens, insertion de publics en
difficult (personnes ges, malades chroniques, handicaps, etc.), promotion
de la femme rurale, actions familiales (artisanat, TPE), assurances, agroalimentaire, prvoyance et protection sociale, assistance aux malades et mdicosociale, dveloppement social local, initiative de cration de micro-entreprises
et de trs petites entreprises partir de ressources territoriales et de microfinancement, mise en uvre de ppinires dentreprises autour de ressources
locales (artisanat, plan deau, patrimoine, tourisme solidaire, etc.), accs au
logement (coopratives), accs la culture et aux arts (associations), etc.
Les pratiques de solidarits traditionnelles : des ferments
favorables au dveloppement de lconomie sociale
la socit algrienne traditionnelle est traverse par des formes de solidarit que lon retrouve pratiquement dans tous les groupes et communauts.
Incarnant la puissance du lien social, les pratiques solidaires jouent en faveur
dun quilibre socital et visent garantir lquit entre les membres de la
communaut ou du groupe. Cest aussi un instrument de rgulation dans
les processus de gestion des biens communs et des ressources, lexemple
de leau. Ces pratiques solidaires et formes de solidarit traditionnelle se
manifestent dabord dans le cadre de lorganisation familiale et tribale ou
encore dans le cadre religieux. Cette organisation, qualifie de segmentaire,
garantie cohsion et cohrence la socit traditionnelle. Elle se fonde sur
un mode de reprsentation qui dicte lensemble des quilibres socitaux
auxquels personne ne peut se soustraire et auxquels chacun doit contribuer.
Le maintien des quilibres gnraux appelle des principes de rciprocit, de
partage et de mutualit des ressources disponibles et ce quelques soient leur
nature et leurs formes.
49
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
Dans le cadre familial, villageois ou tribal, la touiza ou tiwizi, constitue
la forme de coopration et de mutualisation la plus prsente sur la base
du principe de rciprocit, du jeu du don et du contre-don et de lchange.
Cette pratique solidaire permet la mobilisation des ressources humaines
disponibles et la mutualisation des moyens matriels pour la ralisation dun
travail au profit dune famille, comme la rcolte dolives ou le labour. Elle a
son corollaire en Kabylie par exemple que lon dsigne par le terme tachemlit,
travaux collectifs, qui sexerce dans le cadre villageois notamment sous la
responsabilit de lassemble villageoise et qui implique toutes les forces
vives du village pour lexcution de travaux dintrt gnral (entretien des
voies de circulation, entretien des sources et fontaines, des lieux publics, etc.)
ou pour ldification des structures ou ouvrages communautaires telles que
les mosques, les coles, les maisons, la voirie et lassainissement, ainsi qu
tous les travaux dutilit communautaire : labours, semailles, moissons, etc.
La touiza est encore pratique dans plusieurs rgions de lAlgrie.
Ces formes de solidarit, religieuse ou communautaire, concourent au
renforcement des liens sociaux et la lutte contre toutes formes dexclusion,
de prcarit et de pauvret. Cette solidarit, organique, est assise sur le caractre communautaire de la construction socitale de lAlgrie depuis fort longtemps. Comme exemple de produit de ces formes et pratiques de solidarit
encore oprationnelles de nos jours, on peut citer les systmes dirrigation
dans les diffrentes rgions du nord du pays ou encore les systmes de la
foggara dans les rgions du sud du pays.
Dans le premier cas, citons les biens habous (terme dsignant le droit
relatif la proprit foncire au Maghreb ; les habous publics sont des biens
considrs dintrt gnral affects accueillir des hpitaux, des coles religieuses, etc.), les wakf, ou biens de mainmorte (il sagit dun bien inalinable
conserv au sein dune famille ; lorsque la ligne steint, le bien est affect
des uvres charitables et devient un habous public) et la zakat, ou aumne,
troisime pilier de lislam, le achour, sorte de dme sur la rcolte et les avoirs,
la zakat el fitr et la sadaqa contribuent considrablement au mcanismes de
consolidation de la solidarit et de la cohsion sociale.
Ces mcanismes sappuient sur les initiatives citoyennes et les rseaux
dentraide et contribuent au dveloppement local. Ils sont coordonns par
un organe central, la djemaa ou tajmaat, conseil de sages au niveau dun
village, dun groupe ou dune communaut, qui constitue non seulement
une instance de concertation, darbitrage, de mdiation dans les litiges ou de
prise de dcision mais aussi une instance de dmocratie participative. Cette
forme de solidarit est ancre dans lethos du peuple algrien. Elle persiste
jusqu nos jours, mme si elle a t partiellement reprise ou remodele par
ltat ds 1962, sous la bannire dun dveloppement socialiste et participatif
et par endroits instrumentalise et banalise.
50
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
Acteurs, structures de lconomie sociale et emplois gnrs
par le secteur
les structures de less revtent aussi bien des formes modernes (associations, mutuelles, coopratives, fondations et autres) que des formes dinspiration traditionnelle, reflet et rsurgence de lancrage de linstinct solidaire
et des liens sociaux tisss et toujours prsents dans la socit algrienne.
Ces formes traditionnelles qui persistent ont t institutionnalises par le
ministre des Affaires religieuses et des wakfs, notamment travers deux
fonds de solidarit (Fonds de la zakat el fitr et Fonds de la zakat).
Lconomie sociale dans sa forme actuelle, contemporaine, structure,
organise et institutionnalise est rcente en Algrie, linstar de lensemble
de la sous-rgion maghrbine (Maroc et Tunisie). Sur le plan organisationnel,
lconomie sociale en Algrie est constitue de quatre composantes principales : les associations, les mutuelles, les fondations et les coopratives. Les
structures traditionnelles de lconomie sociale ne sont pas formellement
incluses dans ces organisations. Par ailleurs, cette dfinition ne couvre pas
non plus les producteurs individuels, mme sils sont en situation conomique prcaire.
Les associations
les associations sont des personnes morales de droit priv. Elles ont des
droits et des obligations qui leur permettent de fonctionner, cest--dire de
se mouvoir dans les rouages juridiques et administratifs complexes dune
socit moderne. Avant de traiter de la consistance et de limplication des
associations dans la promotion de lconomie sociale et solidaire en Algrie,
il parat utile de faire un rappel de la gense et du dveloppement du tissu
associatif dans ce pays. Ds lindpendance, en 1962, les pouvoirs publics
ont reconduit la loi franaise en date de 1901 sur les associations, en vigueur
durant la priode coloniale, et ce afin dviter une situation de vide juridique. Toutefois, mesure que le rgime consolidait son assise, il imposait
de nombreuses restrictions la libert dassociation. En instituant le double
agrment, la promulgation de lordonnance de 1971 a permis aux autorits
dexercer un pouvoir discrtionnaire, notamment en matire dautorisation
de cration dassociation. Les associations constitues dans ce contexte relevaient des domaines sportif, professionnel ou religieux et taient contrles
par les organisations de masse et les unions professionnelles, elles-mmes
encadres par le pouvoir politique.
Il faut attendre ladoption de la loi n 87-15 en 1987 pour que certaines
restrictions soient leves. En autorisant la constitution dans son sillage de
la Ligue algrienne des droits de lhomme (LADH), elle illustre une forme
dessoufflement de la domination de ltat centralis. Au dbut de la dcennie 1990, les rformateurs ont pris conscience du fait que les associations
pouvaient servir de vecteur porteur leurs projets en les soutenant ou en
assumant des politiques dont le cot conomique ou social tait trop lev
pour les gouvernants. Cest dans ce sens dailleurs que certaines associations,
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
51
15. THIEUX (L.), Le
secteur associatif
en Algrie : la
difficile mergence
dun espace de
contestation
politique , LAnne
du Maghreb, V |
2009, pp. 129-144.
Algrie
qui demeuraient des satellites du pouvoir, ont t appeles suppler ltat
sur certains crneaux, comme la planification familiale, tout en canalisant
les financements des bailleurs de fonds internationaux.
Les vnements doctobre 1988 ont certainement acclr le rythme
des rformes induites par le consensus de Washington. Aprs ladoption de
la constitution de 1989, qui a ouvert la voie la libert dassociation avec la
promulgation de la loi 90-31 de dcembre 1990, le mouvement associatif a
connu un essor sans prcdent. Ce nouveau cadre lgislatif restait cependant
flou sur plusieurs aspects, tandis que certaines dispositions de la loi ont permis au pouvoir de conserver des mcanismes de contrle et de limitation
lexercice de la libert dassociation.
Par ailleurs, la loi tablit des contraintes relatives au rgime de financement : les dons et legs dassociations trangres requirent une autorisation
pralable des pouvoirs publics et sont interdits lorsquils ne sont pas en rapport direct avec leur objet social.
Malgr toutes ces contraintes et restrictions, le cadre juridique de la loi
de 1990 fut considr comme libral, notamment au vu de la situation dans
les annes 1970 et 1980. Ce cadre juridique na pas t un frein lexpansion du rseau associatif, notamment aux rseaux dassociations islamistes
puisque selon les statistiques du ministre de lIntrieur il y avait dj
lpoque 11 000 associations caractre religieux et/ou de type islamiste.
Le rythme de croissance du tissu associatif na pas diminu15. Selon les
donnes officielles, entre 1990 et 1997, 57 000 associations ont t cres
dont 1 000 denvergure nationale et 56000 au niveau local. Ce phnomne
est la fois spectaculaire et surprenant pour la priode puisque cette expansion sest produite dans une dynamique sociale profondment marque par
la violence.
En 2012, 5 134 associations locales ont vu le jour travers lensemble du
pays, soit en moyenne quatorze par jour (contre 190 associations par jour
pour la France, titre dexemple); celles-ci sont actives dans les domaines
social, de lducation, sanitaire, humanitaire, culturel, scientifique, sportif et
de lmancipation de la femme, selon les donnes du ministre de lIntrieur.
Le nombre dassociations enregistres au 31 dcembre 2012 lchelle nationale a atteint prs de 96 150, dont prs de 15 800 sont caractre religieux et
inscrites au titre de la loi 90/31 relative aux associations.
Bien quil soit rcent, ce chiffre ne donne pas de prcision sur la structure dtaille du tissu associatif algrien. Par ailleurs, les pouvoirs publics
comptent accorder un traitement particulier aux associations caractre religieux. En effet, eu gard limportance en nombre et leur rle au sein de
la socit, un projet de loi organique et de statuts y affrant sont en cours
dlaboration par le ministre de lIntrieur en vue de les soumettre lapprciation du gouvernement. Le lgislateur a opt pour lorganisation de la
constitution des associations sur la base dun texte prcis en adquation avec
le caractre spcifique conformment larticle 47 de la nouvelle loi sur les
associations.
En fait, cest sur demande du ministre des Affaires religieuses et des
wakfs qua t entreprise llaboration de ce projet de texte sur la constitution,
le fonctionnement et lorganisation des associations caractre religieux. Ce
52
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
projet de texte permettra de combler certains vides juridiques en la matire
et de mieux dfinir la typologie des associations caractre religieux selon la
nature de leurs activits. Celles-ci seront rparties en quatre principales catgories : association de la mosque, association de lcole coranique, association des rites de la religion musulmane et association religieuse pour les non
musulmans. Selon les informations fournies par le ministre de lIntrieur, le
texte portera galement sur la cration dtablissements caractre religieux
et dutilit publique comme les tablissements de la mosque, de la Zakat et
du Waqf. Entre autres particularits du projet de loi, il y a lieu de mentionner
lapprobation pralable de ladministration charge des affaires juridiques pour
la constitution dassociations caractre religieux . Celle-ci met son avis dans
un dlai dun mois au plus tard et sur la base de critres objectifs bien dfinis
dans le projet de loi prcise le ministre.
Pour avoir une ide de la structure du tissu associatif et de la reprsentativit des associations selon leur champ dactivit et leur nature, il est
important de rappeler, qu la fin de lanne 2011, le champ associatif algrien
sarticulait autour de 93654 associations tous secteurs confondus. Celles-ci
se dclinent en 1 027 associations caractre national et 92627 associations
caractre local, selon les donnes du ministre de lIntrieur.
Il est noter que de nombreuses associations ne sont pas actives de
faon effective, si bien que les pouvoirs publics affirment leur volont dassainir le champ associatif par la promulgation dun nouveau cadre juridique
travers la loi n 12-06 relative aux associations en date du 12 janvier 2012
qui a pour objet de dterminer les conditions et modalits de constitution,
dorganisation et de fonctionnement des associations et de fixer son champ
dapplication.
Parmi le millier dassociations caractre national, 213 activent dans le
domaine professionnel, 151 dans la sant, 143 dans les arts et la culture, 142
dans la jeunesse et les sports, 49 dans les sciences et technologies et 23 dans
le domaine de la promotion de la femme, etc. Tandis quon identifie 326associations rattachables dune manire ou dune autre au champ de lESS. Ce
rapport lESS nest pas forcment effectif, mais la dfinition des crneaux
investis par les diverses catgories dassociations (solidarit, secours, bienfaisance, mutualit, jeunesse, handicaps et inadapts, femmes, enfance
et adolescence, etc.) et le fait quun bon nombre dentre elles disposent de
postes demplois permanents, nous incitent les intgrer comme vecteurs
potentiellement favorables lESS.
La structure du champ associatif est domine par cinq catgories dassociations qui sont par ordre dimportance les suivantes : Comits de quartiers,
associations religieuses, sports et ducation physique, parents dlves et arts
et culture qui psent pratiquement pour 81,3%, soit 75 365 sur un total de
92 627 associations.
Les associations qui peuvent revtir un caractre social et solidaire proprement dit sont au nombre de 6 205, soit 6,7 % du nombre global. Ces
associations agissent dans le domaine de la sant et la mdecine, du secours,
de la solidarit et bienfaisance, des femmes, des retraits et personnes ges
et des personnes en situation de handicap. Si lon considre les associations,
les comits de villages et les comits de quartier comme une manation des
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
53
tableau
Algrie
2 Typologie et consistance du tissu associatif en Algrie (dcembre 2012)
Type dactivit Nombre dassociations
Professionnelle
Religieuse
Sports & ducation
Arts et culture
Parents dlves
Sciences et technologie
Comits de quartiers
Environnement
Handicaps et inadapts
4 171
15 304
15 019
10 014
14 891
949
20 137
1 938
1 234
Consistance
4,5 %
16,5 %
16,2 %
10,8 %
16,1 %
1,1 %
21,7 %
2,1 %
1,3 %
Type dactivit Nombre dassociations
Consommateurs
Jeunesse et enfance
Tourisme & loisirs
Retraits & personnes ges
Femmes
Solidarit et bienfaisance
Secours
Sant & mdecine
Anciens lves & tudiants
Total
111
2 677
894
152
919
2 978
167
644
134
92 627
Consistance
0,1 %
2,9 %
1,0 %
0,2 %
1,0 %
3,2 %
0,2 %
0,7 %
0,5 %
100 %
FMI
assembles traditionnelles des villages ou leur nouvelle forme, ce chiffre
peut alors tre pouss 26 342 associations incarnant ou pouvant incarner
lesprit social et solidaire, soit donc 28,4% du nombre total dassociations.
Sagissant des associations locales, au nombre de 92627, leur typologie
et leur consistance sont reprsentes dans le tableau 2.
Cette multitude dassociations nest pas un indicateur fiable du dynamisme de la socit civile parce que dans les faits, il existe un cart considrable entre le nombre dassociations officiellement recenses et le nombre
dassociations rellement actives. De mme, le mouvement associatif na
pas une implantation homogne sur lensemble du territoire national. Ce
sont les rgions Centre et Ouest du pays qui montrent un dynamisme plus
important qu lEst. Les associations sont beaucoup plus nombreuses dans
les zones urbaines et dans les rgions o prdominent les modes dorganisation communautaire ou villageoise comme en Kabylie et dans le Mzab.
Par ailleurs, la plupart des associations concentrent leurs activits dans les
domaines social, culturel et dans lenvironnement, cest--dire dans des secteurs dinterventions que ltat a intrt promouvoir et qui prolongent ou
soutiennent les actions publiques.
Sagissant du mode dorganisation et de fonctionnement, la majeure
partie des associations accusent un dficit dmocratique notable. Dans la
majorit des cas, la figure du prsident est prdominante et il ny a pas de
rgularit dans la tenue des assembles ordinaires. Si le niveau de participation de la population reste relativement faible, celui de formation des cadres
associatifs, qui proviennent principalement du secteur public, est en gnral
apprciable, puisque la plupart dclinent une formation universitaire. Enfin,
ces associations sont dpendantes financirement des subventions de ltat
et rares sont celles qui ont accs aux financements internationaux, les procdures daccs aux subventions trangres tant complexes et fortement
contrles par ltat.
En Algrie, comparativement la Loi n 90-31 du 4 dcembre 1990, la loi
n 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, apporte de nombreuses
modifications et donne la dfinition suivante dans larticle 2 : lassociation est
le regroupement de personnes physiques et/ou de personnes morales sur une base
contractuelle dure dtermine ou dure indtermine. Ces personnes mettent
54
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
en commun, bnvolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs
moyens pour promouvoir et encourager les activits dans les domaines, notamment,
professionnel, social, scientifique, religieux, ducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire . Il prcise en outre, lobjet de lassociation doit
tre dfini avec prcision et sa dnomination doit exprimer le lien avec cet objet.
Toutefois, lobjet et les buts de ses activits doivent sinscrire dans lintrt gnral et
ne pas tre contraires aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu lordre
public, aux bonnes murs et aux dispositions des lois et rglements en vigueur .
Le mode de financement des associations
les sources de financement des associations sont essentiellement les
subventions de ltat. Toutefois, certaines associations bnficient dautres
financements: dons, cotisations ou participations trangres des projets.
Le contrle institu par ltat dans ce domaine est justifi comme suit: la
comptabilit est vrifie par un commissaire aux comptes, supervise par
le Trsor algrien et par le Tribunal territorialement comptent et le bilan
financier annuel est communiqu au ministre de lIntrieur (Direction des
associations).
Nanmoins, pour assurer une prennit de laction associative, les pouvoirs publics doivent revoir le mode dattribution des subventions, qui se
fonde sur une dmarche de type clientliste. La notion de subvention lie
un programme daction ne doit pas masquer la ralit et la subvention devrait
tre lie un partenariat association-ministre ou association-collectivit territoriale bas sur une convention qui identifie les objectifs, dfinit les actions et
explicite les modalits dvaluation. En outre, les pouvoirs publics gagneraient
assurer le budget de fonctionnement des associations qui remplissent une
mission dutilit publique. leur tour, les associations gagneraient faire
en sorte dassurer le maximum de traabilit des crdits, de ventilation de
leur budget et des dons quelles reoivent. Dans un tel cadre, elles seraient
amenes rendre compte chaque donateur et chaque bailleur de fonds tout
en orientant ces ressources vers des actions et des activits utiles la socit
selon les objectifs et la mission quelles se fixent.
Par ailleurs, par le biais du travail en rseau au niveau national ou grce
lappui dorganisations internationales, certaines associations de services ont
russi accrotre leurs capacits dintervention de faon autonome surtout
dans le secteur social, sanitaire et celui de la jeunesse. Ainsi, des plateformes
de coordination ont t cres qui ont comme objectif la promotion dinitiatives de coordination des ONG algriennes partir de portails Internet.
Disposant de plus dautonomie financire grce au soutien de bailleurs
de fonds internationaux, dautres associations comme le Centre dinformation et de documentation sur les droits de lenfant et de la femme (CIDDEF)
ont russi susciter un dbat public et des projets de rforme lgislative sur
la question des femmes et le travail, ou sur celle de lenfance abandonne.
Nanmoins, linternationalisation du champ associatif algrien nest pas
bien perue par le pouvoir qui y voit une remise en cause de son contrle effectif sur le mouvement associatif. Cest pourquoi le rgime juridique limite les
possibilits pour les associations locales dtablir des liens avec des organisations internationales : elles ne peuvent pas adhrer des associations interna-
55
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
tionales poursuivant le mme but. Seules les associations nationales peuvent
le faire, aprs accord pralable du ministre de lIntrieur.Ces contraintes et
mcanismes de contrle mettent en vidence la mfiance des autorits vis-vis de tout ce qui peut ressembler une ingrence trangre. Ltat algrien est cependant conditionn par des intrts contradictoires: le besoin de
reconnaissance extrieure dun ct et le risque que reprsente louverture
de lAlgrie la prsence dorganisations internationales, de lautre.
LUE a mis en place en 2001 dans le cadre du programme Meda un projet
de soutien aux associations de dveloppement destin amliorer la formation des cadres associatifs et lappui la mise en rseau des associations.
Cependant le constat gnral met en vidence la faiblesse des changes des
associations algriennes avec des ONG internationales. Toutefois le financement accord dans le cadre du programme Meda ii a eu pour objectif de
renforcer le rle de la socit civile dans les processus de dveloppement.
Les mutuelles
en algrie, dans un contexte conomique difficile, les propositions de
cration des mutuelles sont restreintes mme si elles constituent des instruments permettant dviter que les conditions des travailleurs algriens ne se
dgradent davantage au regard de lrosion du pouvoir dachat et de linflation. Le mouvement mutualiste simpose comme un moyen adquat pour
minimiser lexclusion et renforcer une conomie sociale tenant compte de
ltre humain et uvrant son bien-tre et celui des collectifs de travailleurs.
Ce mouvement accusait un grand retard malgr le choix dune gestion conomique socialiste qui tait cense le soutenir ; il nen demeure pas moins que
ce systme de protection a fini par trouver largement sa place. Cependant,
trs peu dexperts se sont penchs sur la question de la mutualit, ce qui
revient dire que cet aspect de la solidarit sociale est quasiment mconnu.
Rares, en effet, sont les tudes qui traitent de ce sujet et il va sans dire que
les statistiques sur lvolution de ce mouvement sont quasi inexistantes.
Le rapport tudie les diffrents textes juridiques qui rgissent les
mutuelles en Algrie et qui rpondent la problmatique de savoir quels
sont les apports et les lacunes de ces textes ? Sont-ils suffisants pour dvelopper le mouvement mutualiste algrien dans un contexte marqu par un
regain dintrt pour lESS ?
La dfinition des mutuelles
le code franais de la Mutualit dans son article L111-1, alina 1, stipule
que les mutuelles sont des personnes morales de droit priv but non lucratif.
Elles mnent notamment au moyen de cotisations verses par leurs membres, et
dans lintrt de ces derniers et de leurs ayant droit, une action de prvoyance, de
solidarit et dentraide, dans les conditions prvues par leurs statuts afin de contribuer au dveloppement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres
et lamlioration de leurs conditions de vie .
Selon la dfinition de Friendly societes, la mutualisation est une forme
ouvrire qui a t fonde sur la mise en commun de ressources et la prise en charge
solidaire des risques, et a conduit la cration de socits mutuelles .
56
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
Cadre juridique des mutuelles
les mutuelles sociales taient rgies par la loi 90-31 relative aux associations et, depuis janvier 2012, par la loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative
aux associations, notamment pour ce qui est de lagrment de la mutuelle
sociale. La loi 90-33 du 25 dcembre 1990, modifie et complte, relative aux
mutuelles sociales, dtermine les modalits de constitution, dorganisation
et de fonctionnement des mutuelles sociales. Le dcret excutif n97-428 du
10 novembre 1997 fixe les modalits du contrle par le ministre du travail,
de lemploi et de la scurit sociale. Le dcret excutif n91-159 du 18 mai
1991 fixe le nombre minimum dadhrents requis par la constitution dune
mutuelle sociale. Larrt du 7 dcembre 1997 fixe les taux daffectation des
ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations.
Lgalement, cest au ministre du Travail, de lEmploi et de la Scurit
sociale quincombe le rle de contrler la bonne application de la lgislation sur les mutuelles sociales. En cas de dysfonctionnement ou de prjudice
grave (dsquilibres financiers, baisse importante des effectifs des adhrents,
absence de fonctionnement dmocratique, etc.), un administrateur provisoire
est nomm par ce ministre pour un mandat de trois mois en vue dorganiser
une nouvelle assemble gnrale lective de la mutuelle concerne.
Selon un bilan du ministre du Travail, de lEmploi et de la Scurit
sociale, les mutuelles sociales recenses sont au nombre de 32. Ce chiffre
comprend toutes les mutuelles mme celles qui ne sont pas actives. Elles se
rpartissent comme suit : 23 mutuelles sociales actives qui ont une situation
considre comme lgale et rglementaire bien que certaines connaissent
des problmes ; neuf ne remplissent pas ou nont pas encore rempli lune
des conditions requises leur reconnaissance lgale en tant que mutuelle
sociale. Parmi ces dernires, certaines sont actives normalement depuis des
annes. Les effectifs des adhrents des 23 mutuelles en situation rgulire
slvent plus dun million de mutualistes, le reste des mutuelles totalise
prs de 10000 adhrents. Organises en fdration, les 23 mutuelles disposent, en sus des locaux destins aux centres payeurs, directions rgionales
et directions gnrales, de 90 CMS (centres mdico-sociaux) et 31 centres
de vacances et de repos. Elles emploient prs de 4000travailleurs salaris.
Selon ce bilan tabli par le ministre de tutelle, le niveau du nombre
dadhrents aux mutuelles enregistre une rgression par rapport aux annes
1990 o il avoisinait 1,6 million de mutualistes. Cette rgression des effectifs
des adhrents nest pas ncessairement la consquence de la rcession de
lemploi au niveau du secteur conomique public comme le textile, lindustrie et les matriaux de construction, mais il est plus significatif dans les
mutuelles ancres dans le secteur de la Fonction publique qui ont connu
des crises lors des renouvellements des organes statutaires ou la suite de
dysfonctionnements graves ou dinterfrences externes syndicales ou administratives. Sagissant de lapplication des taux daffectation des ressources de
la mutuelle sociale provenant des cotisations, aucune mutuelle ne respecte les
taux rglementaires fixs par les dispositions de larrt du 7 dcembre 1997.
Pour certaines mutuelles, limportance du dpassement des taux lgaux par
les taux daffectation rels en matire de frais de fonctionnement sexplique
en partie par les frais des personnels affects aux centres mdicaux sociaux
57
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
(CMS) et des autres structures de sant dont les dpenses sont comptabilises dans les frais de gestion et de fonctionnement de la mutuelle. Il apparat
galement que la publication des rapports dactivit et des comptes par les
mutuelles ne se fait pas toujours. Dans le cadre des tripartites qui regroupent
le gouvernement, le patronat et lUnion gnrale des travailleurs algriens
(UGTA), louverture du dossier des mutuelles a t envisage avec comme
objectif la promulgation dune nouvelle loi relative aux mutuelles qui pourrait
donner un nouveau souffle au crneau mutualiste. Mais le projet de texte ne
semble pas faire le consensus souhait et reste en dbat jusqu maintenant.
Les fonctions des mutuelles sont beaucoup plus lies lassurance sociale
et des activits annexes qui ne concernent que les adhrents. Ces mutuelles
appliquent une solidarit basique et sont structures en fonction de leur secteur ( entreprises, administration, ducation, services). Il sagit dorganismes
libres auxquels ladhsion nest pas obligatoire. Elles mnent une action de prvoyance et dentraide, dans les conditions prvues par la loi et les statuts, afin de
contribuer au dveloppement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs
membres et lamlioration de leurs conditions de vie. Elles interviennent en
complment la scurit sociale. Au-del de laction mene en faveur de leurs
socitaires, elles exercent un effet rgulateur qui leur vaut dtre reconnues
dutilit sociale. Elles sont fdres au niveau national par un comit de coordination. Ltat cherche actuellement les dvelopper et mieux les encadrer.
Rglementairement, les mutuelles sociales peuvent assurer leurs
membres et leurs ayants droit des prestations de type individuel ou de type
collectif. Les prestations individuelles servies par la mutuelle sociale peuvent
se dcliner pour une ou plusieurs prestations suivantes: prestations en nature
de lassurance maladie, les indemnits journalires de lassurances maladie,
les majorations des pensions dinvalidit des assurances sociales, lorsque
le titulaire nexerce aucune activit professionnelle, majorations de rentes
daccidents de travail ou de maladie professionnelle, majorations de pensions de rversion en faveur des ayants droit, prestations sous forme daides,
de secours ou de prts. Les prestations collectives servies par la mutuelle
sociale sont relatives aux prestations complmentaires en matire de sant,
aux actions sociales en faveur des membres ou ayants droit, aux activits
culturelles, sportives ou rcratives, aux actions en matire de logement.
Dans le respect des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur
et aprs autorisation de lautorit publique comptente, la mutuelle sociale
vocation nationale peut cooprer avec toutes associations trangres poursuivant des buts statutaires similaires ou adhrer celles-ci pour autant que
ces relations nemportent pas de sujtions particulires pour la mutuelle
sociale. ce titre, les dons et legs des associations trangres ne sont accepts
quaprs autorisation pralable de lautorit publique concerne.
Plus la taille de la mutuelle est importante plus ses capacits financires
sont leves : les mutuelles qui ont moins de 10 000 travailleurs sont celles qui
connaissent le plus de difficults fonctionner de faon sereine et durable. La
typologie des mutuelles selon leur taille stablit comme suit :
trois ont plus de 100 000 adhrents ;
trois ont entre 100 000 et 50 000 adhrents ;
huit ont entre 50 000 et 20 000 mutualistes ;
58
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
cinq ont entre 20 000 et 10 000 adhrents ;
sept ont entre 10 000 et 3 000 adhrents ;
quatre mutuelles ont moins de 3 000 adhrents.
Les mutuelles les plus actives sont les suivantes :
la MUNATEC (Mutuelle nationale des travailleurs de lducation
et de la culture),
MGTSS (Mutuelle gnrale des travailleurs de la scurit sociale) ;
MGIP (Mutuelle gnrale de lindustrie du ptrole) ;
MGPTT (Mutuelle gnrale des postes et tlcommunications) ;
MGEG (Mutuelle gnrale de llectricit et du gaz) ;
MGHFE (Mutuelle gnrale de lhydraulique, des forts et
de lquipement) ;
MGC (Mutuelle gnrale des communaux) ;
MGD (Mutuelle gnrale des douanes) ;
MGPC (Mutuelle gnrale de la Protection civile) ;
MGS (Mutuelle gnrale de la sant) ;
MGT (Mutuelle gnrale des transports) ;
MGH (Mutuelle gnrale de lhabitat) ;
MGIFA (Mutuelle gnrale indpendante des fonctionnaires dAlgrie).
LAlgrie enregistre un grand retard dans le secteur mutualiste. Des dfaillances et des lacunes dans la gestion et des retards sont constats dans le remboursement des prestations mdicales. Certains centres de soins ne disposent
pas dquipements adquats pour une prise en charge mdicale et mutualiste.
Compte tenu de la fragilit de lconomie algrienne, des carences du
tissu entrepreneurial, des dysfonctionnements du systme productif et des
mauvaises conditions sociales qui accentuent les disparits sociales, lAlgrie
na dautre choix que duvrer pour une plus grande solidarit.
Les fondations
on relve entre quinze vingt fondations activent en Algrie, dans des
domaines diversifis et revtant un caractre social, politique, caritatif, de
promotion de la citoyennet, droits de lhomme, solidarit ou projets dans
des zones dshrites en vue de lutter contre la pauvret. Certaines sont des
reprsentations ou des succursales de fondations actives dans des pays trangers ( Europe ). Le champ dintervention de la plupart des fondations et leur
envergure sont limits, quand bien mme il en est qui dispose dun effectif
apprciable de salaris. Relativement aux associations, on peut affirmer que
la contribution des fondations lancrage de lESS dans la socit algrienne
demeure trs modeste.
Le cadre juridique des fondations algriennes
les fondations sont considres comme des associations caractre spcifique et sont rgies par la loi 12-06 du 12/01/2012, particulirement par ses
articles 49 55 du chapitre II. Cette loi dfinit une fondation comme une institution caractre priv cre linitiative dune ou de plusieurs personnes
59
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
physiques ou morales par la dvolution dun fonds ou de biens ou de droits
destins promouvoir une uvre ou des activits spcifiquement dfinies.
Elle peut galement recevoir des dons et legs dans les conditions prvues par
la lgislation en vigueur.
Le secteur coopratif
des coopratives agricoles et industrielles ont t cres dans llan de
lindpendance algrienne afin de relancer lconomie du pays la suite du
dpart de la puissance coloniale franaise.
Gense du mouvement coopratif algrien
les premires entreprises publiques sont nes du regroupement de
ces coopratives, qui existaient dans tous les secteurs (btiments, travaux
publics, agriculture et services de consommation). Par la suite, ces coopratives ont t encadres par ltat lexemple des domaines autogrs. partir
des annes 90, de nouvelles coopratives ont vu le jour suite au processus
de privatisation des entreprises publiques et locales. Leur fonctionnement
restait largement arrim lidologie socialiste encore vivace au sein du seul
syndicat : lUnion gnrale des travailleurs algriens (UGTA), qui participait
la gestion de lconomie avec ltat.
Par la suite, de nouvelles formes de coopratives fleurissent, notamment
dans le domaine du logement (coopratives immobilires). Ce type de coop
rative est pratiquement la seule forme qui a survcu et qui a vite dgnr en
espace de spculation. Encourag dabord par les pouvoirs publics, ceux-ci
iront jusqu allouer les assiettes de terrain ncessaires la ralisation de coopratives immobilires et soutenir les projets par le biais des banques publiques.
Les pouvoirs publics ont promulgu une nouvelle loi (loi 11-04 du 17fvrier
2011 fixant les rgles rgissant lactivit de promotion immobilire) pour
rorganiser lactivit immobilire qui abroge le dcret lgislatif n 93-03 du
1er mars 1993. Par la mme occasion, cette loi abroge lordonnance n76-92
du 23 octobre 1992 portant sur les coopratives immobilires sans expliquer
les conditions de dissolution de celles qui existent, dune part, et sans expliciter la dmarche que doivent suivre les auto-constructeurs groups. Pour
autant, il nest pas possible daffirmer que la cooprative immobilire est
interdite ou nexiste plus.
Aujourdhui, on ne dispose daucune tude quantitative sur limportance
et les apports de telles coopratives au plan social et conomique et leur contribution la rsolution de la crise du logement en Algrie et, a fortiori, sur la
cration demploi. De ce fait, il parat hasardeux de les associer, dans ltat
actuel des choses, au champ de lESS dautant plus que ne figurant pas dans la
nouvelle loi sur la promotion immobilire, on voit mal quelle assise juridique
leur donner et comment valuer leur part dans lESS en absence de donnes
sur la question.
La gense du systme coopratif et mutuel agricole remonte aux premires annes de la colonisation (1850) avec la cration du Comptoir national
de lescompte (CNE), accompagn par la suite par la cration de compagnies spcialises dans le crdit mutuel au profit des paysans franais et de
60
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
la Socit indigne de prvoyance (SIP) au profit des fellahs algriens. Le
nombre des SIP saccrot rapidement pour atteindre 503 en 1947 et 53651
socitaires. Aprs ces deux premires formes de coopratives, le Secteur
damlioration rurale (SAR) a vu le jour en 1945 et furent ainsi cres des
coopratives mixtes colons-fellahs plus ou moins russies. Ainsi, les missions conomiques et techniques des SAR sont clairement dfinies ds leur
cration, puisque le paysannat tel quil est conu travers la nouvelle rforme
tend sur le plan technique instruire le fellah et lquiper pour la mise en
uvre de mthodes de production modernes en prsence dans le secteur
du colon et, sur le plan conomique, orienter les fellahs et pasteurs vers
lconomie dchange, les investissements rentables et la pratique du crdit.
lindpendance, ce fut la cration dexploitations collectives, grandes
entreprises agricoles salaris et coopratives agricoles de production sur
prs de 40 % de la SAU (surface agricole utile) totale du pays jusquen 1980
o on a assist une refonte radicale des options tatiques en faveur dun processus de privatisation des terres publiques et dindividualisation de lexploitation des terres (1987). Dans le prolongement de ces nouvelles orientations,
ltat annule la loi de rforme agraire (1990) et procde la restitution aux
anciens propritaires des terres expropries en 1971. Ces mesures mettent
fin lexistence dun secteur tatique de proprit et de production et rhabilite le rle de la proprit et de lexploitation individuelles. Ltat a consacr
lessentiel des terres nationalises la constitution dexploitations collectives.
Deux systmes dexploitation ont t mis en place : lautogestion ouvrire
sur les grandes exploitations coloniales et les coopratives agricoles de production sur les terres du Fonds national de la Rvolution agraire (FNRA) de
tailles individuelles plutt rduites. La rforme de 1987 a supprim la tutelle du
ministre de lAgriculture et a autoris la libre cration des coopratives ainsi
que le contrle sur leur gestion. Les anciennes sont rorganises en conservant gnralement leur personnel mais en lisant des nouveaux dirigeants
par les dsormais socitaires rels. Cette libralisation sest accompagne dune
explosion dans la cration de coopratives. On est pass de 283 coopratives
de services en 1988 1 298 en 1994 et 1 676 en 1999 mais le dveloppement
des coopratives enregistr au cours de ces dernires annes sest toutefois
ralenti et leur nombre reste relativement modeste. Le nombre des coopratives
de services agricoles (CSA) a presque tripl depuis la mise en place du plan
dajustement du secteur agricole en 1986 passant ainsi de 71 CSA en 1987
205 en 2000. Selon les donnes rcentes du ministre de lAgriculture, 1091
coopratives agricoles sont agres, regroupant un effectif de 84000 adhrents relativement 900000 exploitants agricoles en activit.
Malgr ce frein relatif au dveloppement du systme coopratif agricole,
les coopratives peuvent encore jouer un rle dterminant dans le dveloppement agricole et rural durables. Leurs capacits et leur adaptation aux
exigences de lheure doivent tre renforces par le biais de partenariats. En
effet, des agriculteurs regroups au sein de coopratives possdent un capital
la fois social et organisationnel et ont acquis un certain pouvoir de ngociation sur le niveau des prix agricoles. A titre dexemple, ce double capital
permettra de limiter le phnomne de la fixation des prix par le mcanisme
de loffre et de la demande.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
61
Algrie
Coopratives dpargne : des crneaux mutualistes pour les salaris,
unetentative dimpulsion du systme mutualiste
16. Ghana Oukazi,
Finance : Des
coopratives dpargne
et de crdit pour les
salaris , Le Quotidien
dOran (2009).
suite lapplication de la loi 07-01 en date du 27 fvrier 2007 du ministre des Finances, la Banque dAlgrie a publi un rglement qui autorise
les salaris crer des coopratives dpargne et de crdit caractre mutualiste et utilitaire mme de leur assurer diverses oprations bancaires16.
Cette dmarche apparat comme similaire celle des Credit-Unions qui a
fonctionn dans les pays anglo-saxons. Il sagit de mutuelles qui peuvent
tre constitues par une catgorie de travailleurs issus dune mme entit et
dont lattribution dagrment relve de la Banque dAlgrie. Les coopratives
dpargne et de crdit sont des coopratives dont la cration vise les groupements de salaris issus dune mme entit juridique, dun mme groupe,
dune mme institution ou toute collectivit dont les membres ont un mme
intrt avec laquelle un contrat de rfrence est conclu. Linstitution bancaire
prcise dans larticle 3 de son rglement que la demande dautorisation dtablissement dune cooprative dpargne et de crdit est, conformment aux
dispositions lgales, adresse au prsident du Conseil de la monnaie et du
crdit. Elle est appuye par un dossier dont les lments constitutifs sont fixs
par une instruction de la Banque dAlgrie. Aprs acceptation du dossier,
lagrment est accord par son gouverneur sur instruction du Conseil de la
monnaie et du crdit.
Une fois cres, les coopratives sont alimentes financirement par
des apports personnels des salaris eux-mmes, cest--dire des souscripteurs physiques qui deviennent les socitaires. Toutefois, il est envisageable
que les pouvoirs publics y contribuent par une aide au titre de souscripteur
moral. Larticle 4 du rglement exige dailleurs deux dinclure dans le dossier
dautorisation dtablissement de la cooprative les lments dinformation
relatifs au programme dactivit (laboration dun plan daffaires sur cinq
ans qui prcise les conditions financires et de fonctionnement, description
de la stratgie de dveloppement du rseau, des moyens prvus cet effet, des
moyens financiers et des moyens techniques mettre en uvre et prcision
de lidentit des membres fondateurs de la cooprative). Le plan daffaires
indiquera en particulier la provenance et le cot des ressources, les conditions de distribution de crdit et les dispositions visant garantir lquilibre
financier de la cooprative, sa liquidit et sa solvabilit.
Ce type de coopratives ne se substitue ni aux uvres sociales ni aux
caisses mutuelles. Elles sont cres en vue de proposer aux socitaires des
offres de services pour des dpts, des produits dpargne, des possibilits de
financement de type crdit la consommation ou au logement, etc. Dans le
texte, on relve quil est demand aux souscripteurs physiques dinclure dans
le dossier des lments relatifs la surface financire de lentit ou des entits
juridiques partenaires de la cooprative dpargne et de crdit et ltendue
de son ou de ses engagements techniques et financiers, matrialis par un
contrat qui dfinit notamment le niveau et les modalits de lappui financier.
Cet appui peut prendre la forme dun prt subordonn, sans intrts ou dun
apport en capital qui ne saurait dpasser 70% du capital de la cooprative.
Lorganisation et le fonctionnement de ces entits sont fixs dans le
cadre de la loi. Les coopratives ne sont pas caractre commercial mais
62
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
mutualiste et utilitaire. Les salaris auront ainsi droit des avantages en
nature : des mises disposition gratuites de ressources, notamment sous
forme de dotation en capital, de prt taux infrieur aux conditions normales
du march ; des accords commerciaux et de paiement par lentreprise pour
fourniture de services financiers. Les excdents financiers de la cooprative
sont soit distribus entre les socitaires ou alors laisss dans la caisse pour
financer des crdits ou autres oprations quils estiment ncessaires.
Ces coopratives ne remplacent en aucun cas les caisses mutuelles
qui traditionnellement sont qualifies pour les produits dassurance. Elles
ne peuvent non plus se substituer aux uvres sociales parce que celles-ci
neffectuent pas doprations de banque comme cest le cas pour les coopratives. Elles sont soumises des rgles dagrment, celles dorganisation,
de gestion et de contrle.
Le secteur assurantiel
Contexte historique, juridique et institutionnel du secteur des assurances
hrit de lre coloniale, le systme algrien des assurances comptait
lindpendance 160 compagnies trangres oprant sur le territoire national.
La loi 62-157 du 21 dcembre 1962 reconduisait tous les textes en attendant
la mise en place dune rglementation au bnfice des intrts de la nation.
Contraintes par la nationalisation de lactivit et la spcialisation des compagnies, la plupart des socits trangres ont quitt le pays, laissant des engagements envers leurs clients que devait honorer ltat algrien travers ses
socits. Ce contentieux, notamment dans sa composante immobilire, na
t rgl en totalit quen 2008, autorisant ainsi les socits franaises rinvestir le champ algrien des assurances. La main-mise de ltat sur le march
des assurances dure jusquau dbut des annes 1990, poque o le processus
sinverse avec notamment la dspcialisation et louverture au priv du march
des assurances, la parution des textes relatifs lautonomie des entreprises
publiques en 1989 ouvrant dj au processus de dspcialisation.
En 1964, le secteur tait structur autour de la Compagnie algrienne
dassurance et de rassurance (CAAR), la Socit algrienne des assurances
(SAA) qui tait auparavant algro-gyptienne, la compagnie tunisienne STAR
et deux mutuelles (risques agricoles et enseignement). Ltat avait ainsi le
monopole total sur les activits dassurance institu par lordonnance 66-127
du 27 mai 1966. Ce monopole sexerait alors par deux entreprises publiques :
la CAAR pour les risques transports et industriels, la SAA pour les risques
automobiles, assurances de personnes et risques simples. Cre en 1975, la
Compagnie centrale de rassurance (CCR) consolide le monopole de ltat
tandis que sa spcialisation est accentue davantage par la cration de la Compagnie algrienne des assurances du transport (CAAT) en 1982 qui prend
une part de march de la CAAR qui dtenait alors le monopole sur les risques
industriels.
Ce cadre monopolistique est boulevers par un changement majeur avec
la promulgation de lordonnance n95-07 du 25 janvier 1995 qui permet la
cration de socits prives algriennes et constitue le texte de rfrence en
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
63
Algrie
matire de droit algrien des assurances. On assiste alors la rapparition des
intermdiaires dassurances, disparus avec linstitution du monopole de ltat
sur les activits dassurance. Les compagnies trangres dsirant simplanter
en Algrie peuvent se constituer en socits dassurance de droit local, en
succursales ou en mutuelles dassurance, comme elles peuvent opter pour la
cration de bureaux de reprsentation partir de janvier 2007. chacune de
ces structures correspond videmment un rgime juridique spcifique.
Aprs plus dune dcennie, la loi n 06-04 du 20 fvrier 2006 modifie
foncirement lordonnance 95-07 par lintroduction de la gnralisation de
lassurance de groupe, lautorisation de la bancassurance et linstitution du
principe de sparation des activits des compagnies ( Vie et Non Vie) tout en
crant une autorit de rgulation et de contrle du secteur des assurances en
la Commission de Supervision des Assurances.
Enfin, le dcret 375-09 du 16 novembre 2009 exige laugmentation du
seuil minimum du capital des socits dassurances de personnes un milliard de DA et celui des autres socits dommages deux milliards DA.
17. Le secteur
des assurances en
Algrie (2012),
Septembre 2013,
Direction gnrale
du Trsor franais,
Publications des
services conomiques
(http://www.tresor.
economie.gouv.fr/
File/389867).
18. BENLAHRECH
R., Pourquoi
les Algriens ne
sassurent pas ?
Edition du 27 fvrier
2013, (www.economie.
jeuneafrique.com).
Caractristiques du secteur des assurances
ltude annuelle sur les marchs mondiaux de lassurance, ralise en
2012 par la compagnie mondiale de rassurance Swiss Re, classe lAlgrie au
soixante-septime rang sur 147 pays ( 64e rang en 2011, 61e rang en 2010) sur
la base du montant des primes encaisses avec une part de march lchelle
mondiale de 0,03 %17. LAlgrie se classe la sixime place lchelle africaine
derrire lAfrique du Sud (17e lchelle mondiale), le Maroc (53e), le Nigria
(58e), lEgypte (59e) et le Kenya (66e).
Selon cette tude, lAlgrie avec lquivalent de 1,25 milliards de dollars
de primes encaisses en 2012 (contre 1,2 milliards de dollars en 2011) participe hauteur de 1,74% (contre 1,5 % en 2011) au march de lassurance
du continent africain (71,9 milliards de dollars) qui ne pse que 1,56% du
march mondial (4 612 milliards de dollars). titre de comparaison, le chiffre
daffaires du Maroc est de 3,5 milliards de dollars en 201218. Hors Afrique du
Sud qui reprsente elle seule 80 % du march africain, lAlgrie pse pour
7 % environ dans le march africain. Malgr une lgre rgression dans le
classement mondial, le march algrien de lassurance connat une relative
progression en termes de chiffre daffaires comme en tmoigne la figure 1 qui
reprsente lvolution de cette donne pour la priode 2006-2012 :
Par ailleurs, selon les donnes du Conseil national des assurances (CNA),
ce chiffre daffaires enregistre une progression de 23% pour le premier trimestre de lanne 2013 par rapport la mme priode en 2012 passant ainsi
de 24 milliards DA 30,7 milliards DA. Remarquons aussi que le taux de
croissance annuel du chiffre daffaires du secteur des assurances dpasse les
10 %, except pour lanne 2010 o lon enregistre une baisse sensible de
la croissance qui nest plus que de 4 %, celle-ci tant en fait fortement tributaire des investissements de ltat. Cette baisse sexpliquerait donc par le
ralentissement, voire larrt, des chantiers conomiques entrant dans le plan
quinquennal 2005-2010 et les difficults rencontres faire dmarrer ceux
du quinquennat suivant. Ce qui voudrait dire que si lon dfalquait la contribution des entreprises publiques et des grands projets conomiques rele-
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
64
figure
Algrie
volution du chiffre
daffaires du secteur
desassurances
entre2006 et2012
(milliards
dedollars)
Recoupements par lexpert des
chiffres fournis dans diverses sources
bibliographiques.
vant du programme des investissements publics, le march des assurances
en serait srieusement affect. Dun autre ct, il semble que les assureurs
prouvent dnormes difficults fidliser et stabiliser leurs clientles, ou
les convaincre souscrire des contrats dassurances, except celles qui revtent
un caractre obligatoire. Cela tant, pour comprendre cette volution, saisir
limportance du march des assurances en Algrie, les contours de sa production et de ses performances, nous analyserons ci-aprs les principales
tendances rcurrentes dans les tudes relatives ce secteur.
19. TAIBI, L.,
Lesecteur algrien
des assurances boud
par les compagnies
trangres, Journal
enligne, Les Afriques.
Un secteur fort potentiel en voie de dveloppement
le degr de dveloppement du secteur des assurances et ses performances sont mesurables par des indicateurs tels que le taux de pntration,
le ratio montant des primes rapport la population et le taux de couverture.
Le taux de pntration dfini comme le rapport du montant global des
primes dassurances au Pib est encore faible : le chiffre daffaires retenu pour
lanne 2012 est de 1,25 milliards de dollars (0,7 % du Pib). En moyenne, ce
ratio est de lordre 0,6 % sur la dernire dcennie. On est loin des performances
des pays mergents dont le taux est de lordre de 3 %, et trs loin de celles
des pays industrialiss dont le taux atteint 9 %. Il est intressant de signaler
que le taux de pntration est de 2 % pour la Tunisie et 3 % pour le Maroc au
cours de ces dernires annes19. Le ratio montant des primes dassurance par
habitant slve 34 dollars contre une moyenne mondiale de 656 dollars.
titre de comparaison, ce ratio est de lordre de 45dollars au Maroc, 55 dollars en
Tunisie et 700 dollars en Afrique du Sud. Le taux de couverture est de lordre
dun point de vente pour 28000habitants, la moyenne mondiale est de un
point de vente pour 5000habitants. Ces indicateurs sont modestes devant
les moyennes mondiales, mais cela naltre en rien le potentiel du secteur
des assurances en Algrie et les opportunits de dveloppement. En principe,
louverture du march au secteur priv, les efforts consentis par les entreprises
publiques, mme sils sont encore insuffisants, pour offrir un service de qualit la clientle et la tendance la modernisation de leurs outils de gestion
contribueront progressivement une meilleure valorisation de ce potentiel.
Toutefois, la sensibilisation de la clientle sur limportance de lassurance sous
toutes ses formes demeure un point cl de lamlioration des performances
du secteur des assurances et de son dveloppement. Do limportance du
65
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
dveloppement des outils de communication, tant au niveau des organes institutionnels chargs de contrler, de rglementer et dencadrer le secteur que
des acteurs eux-mmes. Il est important de souligner que ltat a encore un
rle dterminant jouer dans le soutien au secteur, notamment par la mise
en uvre de facilitation, dautant plus quil est encore largement domin par
les compagnies publiques.
Un secteur largement domin par les compagnies publiques
comme il est signal plus haut, la fin du monopole de ltat et louverture
du march la concurrence sont rcents ( ordonnance n95-07 du 25 janvier
1995 ). Ce qui explique le poids prpondrant du secteur public qui intervient
pour plus de 75 % dans le chiffre daffaires de lassurance en Algrie. Pour
le premier trimestre 2013, la note de conjoncture du CNA fait ressortir une
hausse de 12 % du chiffre daffaires des socits capitaux privs comparativement la mme priode de 2012, atteignant ainsi 27 % du march. Pour
cette priode, la part des entreprises publiques dans le march des assurances
pse pour 22,3 milliards DA (CAAR non incluse) contre 8,2 milliards DA
pour les entreprises prives et 0,26 milliards DA pour les entreprises mixtes.
Le secteur des assurances est actuellement fort de vingt-et-une compagnies dont dix socits publiques, neuf socits prives et deux mutuelles. Avec
la mise en uvre des dispositions de lordonnance n95-07 et de la loi n06-04
et lassainissement du contentieux algro-franais en 2008, le secteur sest non
seulement enrichi de nouveaux acteurs mais aussi par la cration de filiales vie
par certaines compagnies publiques ou prives, ceci dans le but de respecter la
rglementation qui prvoit la sparation des activits dommages et vie en deux
entits distinctes. Cette dynamique de distinction des champs dactivits a
conduit la configuration suivante : seize compagnies proposent des produits
relevant du champ des activits dommages et huit compagnies exercent dans
le champ des activits dassurance-vie. Il est vident que certaines compagnies
activent dans les deux champs du secteur. Le tableau 3 donne les listes des
acteurs de chacun des champs de spcialisation.
Cela tant, la typologie des socits dassurances selon le secteur dappartenance (public/priv) et leur spcialisation stablit comme suit.
Dix socits relevant du secteur public. Quatre compagnies sont gnralistes
et oprent dans toutes les branches dassurances. Ce sont la CAAR, la SAA,
la CAAT et la CASH (une filiale de la Sonatrach). Les trois premires compagnies publiques ont cr trois filiales dassurances de personnes pour tre en
conformit avec la rglementation qui impose la sparation des assurances
de dommages de celles des personnes. Les trois filiales sont alors : Taamine
Life Algerie, une SPA filiale de la CAAT, Caarama assurance, SPA filiale de la
CAAR, et la Socit dassurance de prvoyance et de sant SAPS, SPA issue
du partenariat entre la SAA et la Macif.
Deux compagnies sont spcialises dans lassurance du risque crdit.
Ce sont la Cagex pour le crdit lexportation et la SGCI pour le crdit
limmobilier. Et une socit publique de rassurance, la CCR, ou Compagnie
centrale de rassurance, qui bnficie des cessions prfrentielles du march
de la garantie de ltat.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
66
tableau
Composition
du secteur
assurantiel
enAlgrie
Recoupements par
lexpert des chiffres
fournis dans
diverses sources
bibliographiques.
Champ des assurances dommages
Algrie
Champ des assurances-vie
SAA
SAPS (SAA + MACIF)
CAAT Taamine Life (100% CAAT)
CAAR
Caarama (100% CAAR)
CIAR
Macir-Vie (100% CIAR)
CCR
Cardif-El Djazair
axa Assurance-dommages
Axa Assurance-vie
CNMA
Mutualiste (100% CNMA)
Salama Assurance
Salama-Assurance-Vie
GAM
Trust
CASH
MAATEC
2A
Alliance
Cagex
SGCI
Neuf socits relevant du secteur priv. Ce sont : lAlgrienne des assurances
( 2A ), Alliance Assurances cote sur la Bourse dAlger, Axa Algrie dispose
de deux filiales ( dommages et vie) en partenariat avec le FNI (36%) et la
BEA ( 15 % ), Cardif El Djazair, premire socit agre spcialise en assurances de personnes en Algrie, la Compagnie internationale dassurance
et de rassurance ( CIAR) et sa filiale dassurance de personnes Macir-Vie,
Gnrale dassurance mditerranenne (GAM), Salama Assurances (ex-El
Baraka Oua Al Amane) et TRUST Algeria.
Deux socits mutuelles qui pratiquent lassurance directe. Ce sont la CNMA,
mutuelle agricole, hritire de la mutualit agricole franaise qui reprsente
une part de march de 6 % et la MAATEC, mutuelle des travailleurs de lducation nationale et de la culture.
Mme si en nombre dintervenants le secteur priv rivalise avec le secteur public, sa part de march demeure relativement modeste. Toutefois, elle
est en continuelle progression: de 5 % en 1999 elle passe 20% en 2000
pour atteindre un taux de 24,8 % en 2012 et 27% au premier trimestre 2013,
selon les chiffres du CNA donns dans la note de conjoncture du march des
assurances du premier trimestre 2013.
20. Propos repris
deTAIBI, L., op. cit.
Prvalence des assurances obligatoires (dommages : automobile)
outre cette timide perce des compagnies prives, le march algrien
est caractris par la prvalence des assurances obligatoires. Au premier trimestre 2013, lassurance de dommages couvre 96 % du march hors acceptations internationales, progressant de 23% relativement la mme priode
de 2012. Selon les termes dun expert europen intervenant dans le cadre
dun projet de coopration : En Algrie, les particuliers continuent de considrer lassurance comme une dmarche force et un impt subi, ou plus prcisment
comme une redevance parafiscale 20. Ainsi, plus de 80 % des contrats dassurance souscrits dans le pays rsultent dune obligation lgale. figure 2
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
67
figure
Algrie
Structure de
laproduction des
assurances de
dommages aupremier
trimestre 2013
labor par lexpert sur la base
de la note de conjoncture du CNA
Lassurance automobile obligatoire se taille la part du lion, avec prs de
60 % de part de march et reprsente 70 % pour les compagnies prives,
suivie de lassurance sur les risques industriels et des assurances souscrites
par les transporteurs de voyageurs et de marchandises. Au cours du premier
trimestre 2013, lassurance automobile enregistre une hausse de 26 % par
rapport au premier trimestre 2012. Elle reprsente 61 % de la production des
assurances de dommages contre 60% en 2012. Quoique dficitaire, lassurance obligatoire RC (responsabilit civile) de lautomobile enregistre une
progression de 11 % au premier trimestre 2013 avec une part dans le portefeuille automobile estime 15 %. Ce dficit latent sexplique en majeure partie par laugmentation des sinistres dclars et du cot des indemnisations
aggrav par les accidents de la route mortels, le nombre moyen de tus et de
blesss avoisinant 4 500 personnes par an, ainsi que par le montant modeste
de la prime impos par ltat. La prime moyenne RC est actuellement de
lordre de 1 500 DA (15 euros ) alors quelle est de 300 euros chez les voisins
maghrbins.
Lassurance incendie et risques divers (IRD) a connu une volution de
16 % au premier trimestre 2013 par rapport la mme priode en 2012. Les
assurances incendie et risques de construction interviennent pour prs de
59% dans le portefeuille de la branche. Par contre lassurance contre les catastrophes naturelles enregistre une baisse de 11% entre le premier semestre
2013 et la mme priode en 2012. Elle ne contribue qu hauteur de moins de
2% dans le portefeuille de la branche. En effet, consquence dune absence
dobligation lgale dans ce domaine, le patrimoine immobilier reste le parent
pauvre de lassurance algrienne ; moins dun logement sur dix est couvert
par un contrat. La cration, la suite des inondations de Bab-El-Oued (Alger)
et du sisme de Boumerds en mai 2003, dune assurance contre les catastrophes naturelles (CAT-NAT) na pas encore permis ce type dassurance de
dcoller. Les assureurs narrivent pas convaincre leurs clients souscrire
cette assurance tandis que ceux-ci nont pas compris limportance dune telle
couverture qui, dans les faits, est devenue une obligation qui ne se manifeste
quau cours dune transaction immobilire.
La branche transport enregistre une baisse de prs de 7% entre 2011 et
2012, principalement imputable lactivit de transport maritime qui intervient pour prs de 64% de la branche, notamment suite la baisse enregistre
par la garantie des facults maritimes qui participe pour plus de 68% des
primes de lassurance maritime. Au premier trimestre 2013, la branche trans-
68
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
port connat une hausse de 30% comparativement la mme priode en 2012.
Tire 69% par les activits du transport maritime, 27% par le transport
terrestre et seulement 4% par le transport arien, cette branche connat des
croissances apprciables dans toutes ses sous-branches : transport maritime
(+41 %), transport arien (+34 %), transport terrestre (+19 %). En 2012, elle
a accus une baisse de prs de 7 % relativement 2011 consquemment un
recul enregistr par la garantie des facults maritimes (prs de -8%).
Le chiffre daffaires du march des assurances agricoles a connu une
hausse sensible de 30% au cours du premier trimestre 2013 comparativement
au premier trimestre 2012. Le CNA explique cette progression par une pousse
sensible du volume des primes des diffrentes sous-branches : production
vgtale (+40%), production animale (+33%), engins et matriels agricoles
(+33 %). Par ailleurs, les autres risques agricoles enregistrent une augmentation de 10% pour la mme priode. Les primes des assurances agricoles ont
enregistr une hausse de 38 % entre 2011 et 2012 mme si elles ne participent
qu concurrence de 2,4% dans la structure du chiffre daffaires global des
assurances de dommages. Cette monte significative et constante du chiffre
daffaires du march des assurances agricoles est chercher dans limportance
des programmes dinvestissement engags par ltat dans le secteur.
Lassurance crdit-caution a connu une hausse exceptionnelle de 80 % au
premier trimestre 2013 comparativement la mme priode de 2012. Cette
volution est due principalement aux rsultats de lassurance insolvabilit
gnrale qui marque une trs forte hausse de 1117 %, du crdit immobilier qui
affiche une croissance de 164% avec une contribution de 47% au portefeuille
de la branche et du crdit lexportation dont le chiffre daffaires a augment
de 42%. Cependant, ce boom doit tre relativis, la branche ne contribuant
qu concurrence de 0,7 % dans le chiffre daffaires global des assurances de
dommages. Ces rsultats exceptionnels sont mettre en relation avec les facilitations octroys aux citoyens dsirant accder lacquisition de logements par
le biais de diffrents dispositifs.
Les assurances de personnes : une activit naissante et un crneau davenir
ce type dactivits tarde dmarrer et prendre son envol pour des raisons
socitales et un dficit dinformation et de communication de la part des assureurs. Les habitudes culturelles (forte solidarit familiale) et la rorganisation
du secteur psent encore sur lactivit. La branche reprsente aujourdhui une
part trs modeste de lactivit des compagnies algriennes. Pour lanne 2012,
elle ne participe que pour 4% au premier trimestre 2013, moins de 7% dans le
march total des assurances alors quelle atteignait 8% en 2011. Cette rgression sexplique principalement par la rduction des ventes de contrats individuels, annexs aux contrats dommages lors du premier semestre 2012. figure 3
Selon la note de conjoncture du CNA, la production des assurances de
personnes est estime 1,2 milliards DA (environ 15,3 millions de dollars) au
premier trimestre 2013 contre 966 millions DA (12,4 millions de dollars) la
mme priode pour 2012, soit une progression de 21 % et une part de march de 4 % relativement la production globale du march du secteur. Les
garanties Groupe, Vie-Dcs-Retraite, Assistance en cours des dplacements
et Accident-Maladie qui dtiennent respectivement 24 %, 33 %, 23 % et 20 %
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
69
figure
Algrie
Structure de
laproduction des
assurances de
personnes aupremier
trimestre 2013
Elabor par lexpert sur la base
de la note deconjoncture du CNA
du portefeuille de la branche, comme le montre la structure de la production
reprsente ci-dessus, enregistrent des taux dvolution respectifs de 3 %, 6 %,
27 % et 108 % comparativement au premier trimestre 2012.
Le taux de pntration de lassurance des personnes nest que de 0,1 % contre
0,9 % au Maroc par exemple. Pourtant cest un crneau o des potentialits sont
des plus prometteuses, en raison des assurances de groupe, de lassurance exige
pour lobtention de crdits bancaires et bien dautres. Par ailleurs, longtemps
considr comme gnreux, le systme de couverture sociale algrien montre
ses limites avec lmergence de couches sociales exigeantes en matire de qualit
de soins mdicaux ou de retraites ainsi que lvolution des cots des prestations
mdicales avec la monte en puissance du secteur priv dans le domaine mdical. Lintroduction dun systme de retraite par capitalisation, la couverture des
soins mdicaux, proposs par des structures prives plus performantes, sont les
pistes les plus prometteuses. On a l galement un faisceau dopportunits o
lexpertise des oprateurs internationaux pourraient faire la diffrence.
Pour promouvoir lassurance de personnes, les pouvoirs publics ont
accord une convention de distribution de contrats dassurance de personnes
aux socits consacres aux dommages tandis que les oprateurs essaient de
sadapter cette nouvelle donne en renforant leurs rseaux de distribution
et en commercialisant de nouveaux produits.
Selon le prsident de lUnion algrienne des assureurs et rassureurs
(UAR), le march de lassurance-vie pourrait atteindre 50 milliards DA (environ 0,64 milliards de dollars) dici une dcennie, lquivalent de la moiti du
march global des assurances qui devrait atteindre au minimum 100 milliards DA (environ 1,3 milliards de dollars). Seulement, le dcret 375-09 du
16 novembre 2009, en exigeant laugmentation du capital des socits dassurances de personnes un milliard DA (contre 200 millions DA auparavant),
a contraint le dveloppement de lactivit Vie sachant que le march global
est estim moins de 7 milliards DA en 2012. Le dveloppement de lactivit
Vie se heurte galement linsuffisance des produits dpargne, au contrle
des changes qui interdit les placements lextrieur et limposition par ltat
dun rendement minimum sur les produits dpargne difficile atteindre avec
les instruments disponibles (Bons de Trsor).
Rglement des sinistres. En matire de prise en charge des sinistres, le CNA
relve dans sa note de conjoncture du premier trimestre 2013 que le montant
des sinistres rgl a atteint 6,9 milliards DA (environ 88 millions de dollars)
en progression de 115% par rapport au premier trimestre 2012. Le montant
70
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
total des sinistres rgls est domin 65% par lassurance automobile. Ce
taux est toutefois en rgression par rapport lexercice prcdent (84%),
contrairement la branche IRD qui marque une hausse remarquable du
montant des sinistres rgls (+566 %) et un degr moindre la branche
Transport (183 % ). Quant aux autres branches, la structure des sinistres na
pas subi de modifications significatives.
Un secteur rglement et encadr par le ministre des Finances. Le secteur
des assurances est sous lautorit et le contrle du ministre des Finances.
Deux organes supervisent rgulirement les activits dassurances. Prsid par
le ministre des Finances et gr par un secrtaire gnral permanent, le Conseil
national des assurances est structur en quatre commissions (agrments,
tarifs, juridique et march). Il vise dynamiser la profession. Il rend compte
des activits du secteur travers une note de conjoncture publie trimestriellement sur son site www.cna.dz . De son ct, la Commission de supervision des
assurances, prside par le directeur gnral du Trsor, accorde les agrments
aux nouvelles compagnies sur le march algrien. Elle est charge de veiller
au respect des dispositions lgislatives et rglementaires par les assureurs, de
sassurer quils sy tiennent et quils sont en mesure de tenir leurs engagements
vis--vis des clients et de vrifier les informations relatives lorigine des fonds
utiliss par les assureurs dans la constitution ou laugmentation de leur capital.
Quant la Direction des assurances qui dpend de la Direction gnrale du
Trsor, elle suit lactivit des compagnies et labore la rglementation.
Comme on le constate travers les principaux indicateurs caractristiques
des activits dassurances en Algrie, le march est en progression constante et
renferme un fort potentiel qui ne demande qu tre exploit. Malgr les insuffisances et les retards enregistrs, notamment dans louverture du march au
secteur priv, la domination du march par le secteur public, les opportunits
sont nombreuses et des crneaux entiers demeurent encore vierges, linstar
des branches de lassurance des personnes. Par ailleurs, la culture de lutilit de
lassurance doit tre dveloppe davantage par la mise en uvre de meilleurs
instruments de communication et dinformation afin dextraire lassurance du
champ de lobligation et la verser dans sa dimension sociale. Les limites de la
scurit sociale, qui saffichent de plus en plus, doivent inciter investir davantage dans le champ des assurances, par lextension notamment du champ des
mutuelles et la diversification des sous-branches des assurances.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
71
Algrie
La ncessit dvoluer vers un rseau de lESS en Algrie,
auMaghreb et dans la rgion euro-mditerranenne
21. A titre dexemples :
AHMED ZAID M.,
Prdispositions sociales
traditionnelles et
limites des dispositifs
institutionnels de
laction sociale territo
riale en Algrie,
Contribution au 27e
congrs du CIRIEC,
Innovation and
Management. The
responses of public,
social and co-operative
economy enterprises
to major challenges,
Sville, 09/2008.
Idem, Lincubateur
dentreprises du tierssecteur : un instrument
dancrage territorial
de lentrepreneuriat
social, 28e congrs du
CIRIEC, Lconomie
publique et sociale : une
issue la crise et un
support au dvelop
pement durable, Berlin
16-19/05/10.
Idem & BENAMARA
K., Economie
sociale et action
sociale territoriale :
les innovations des
associations caractre
social en Kabylie
(Algrie), RIUESS,
Nancy, 2012.
Idem, Contribution
ltude de lefficacit et
de lquit de laction
sociale des collectivits
territoriales algriennes :
Application aux
collectivits territoriales
de la Wilaya de TiziOuzou, Mmoire de
magister, UMMTO
dirig par AHMED
ZAID M., 2010.
Idem, Territorialisation
de laction sociale
et dveloppement
territorial durable en
Algrie : Les rponses
de lconomie sociale
au regard de lefficacit
conomique et de
lquit sociale, Thse
dfaut dun soutien direct de ltat, lvolution de lconomie sociale
et solidaire en Algrie et au Maghreb reste limite. Le premier rside dans
les difficults conceptuelles et mthodologiques de la dfinition des composantes de lESS. Les pouvoirs publics ne reconnaissant pas lintrt gnral
de lconomie sociale et solidaire, il narrive pas classer ses acteurs dans une
catgorie dtermine. Cette situation entrane des difficults pour lorganisation et la structuration de lESS, notamment en Algrie. Contrairement au
Maroc et la Tunisie, o lESS est aide par lEurope et soutenue par ltat,
lAlgrie ne dispose pas dun cadre institutionnel et lgislatif favorisant les
activits conomiques de personnes pour le caractre social.
Enfin, des travaux universitaires prennent forme en Algrie autour
des thmatiques de lESS, notamment au Laboratoire de recherche sur les
rformes conomiques et dynamiques locales de luniversit Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou et luniversit Abou-Bekr-Belkad de Tlemcen. Ces travaux se matrialisent par des publications sur les formes actuelles de lESS
ou sur les potentialits que recle la socit algrienne travers les formes de
solidarit traditionnelles et le capital social21. Les chercheurs tentent dintgrer
les rseaux de lESS existant lchelle internationale et joignent leurs voix par
des communications scientifiques afin dassoir un discours sur limportance
de lESS dans le contexte socioconomique actuel.
Des leviers de financements multiformes pour lESS
lajustement structurel et la transition dune conomie socialiste vers
une conomie de march ouverte a entran des consquences sociales difficiles pour les populations algriennes (suppression des subventions, dtrioration du niveau de vie, croissance importante du chmage et accroissement
de la pauvret ). Le taux de chmage est important et frlait la barre de 30 %
( moyenne nationale) en 2003 pour avoisiner 10 % en 2012, avec de fortes
variations rgionales. Malgr les efforts et les leviers multiformes mis en
uvre, les jeunes demeurent aujourdhui encore la frange de la population
la plus touche par le chmage et la prcarit.
La lutte contre la pauvret et le chmage est le point focal des diverses formes de laction sociale en Algrie et une proccupation majeure des pouvoirs
publics. Linstitutionnalisation de la solidarit sest traduite par des dispositifs
et des filets sociaux pour aider les populations dmunies. En consquence, des
actions de traitement social de la pauvret ont t dveloppes dans le cadre
dun programme dnomm filet social (allocation forfaitaire de solidarit,
indemnit pour activit dintrt gnral, emploi salari dinitiative locale,
cellules de proximit, Tup-himo, diverses autres indemnits). Sans remettre
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
72
en cours dirige par
AHMED ZAID M.
Mmoires de
master dir. AHMED
ZAID M., 2013,
REDYL, UMMTO :
1. AMROUN C., Les
coopratives agricoles
de la wilaya de TiziOuzou. tat de lieux et
dynamiques actuelles,
2. SFIHI F., Fonds
Zakat : oprateur de la
micro finance au service
du dveloppement
durable des territoires,
3.MOHAMED
SEGHIR O.,
Lincubateur
dentreprises sociales, un
outil de potentialisation
des dispositifs daction
sociale en Algrie,
4.BOUTRAHI S., Les
caisses villageoises en
Kabylie. De la solidarit
mcaniste la solidarit
organique.
Algrie
en cause lintrt de ces actions, il faut cependant constater quelles maintiennent les bnficiaires dans une situation de dpendance et de pauvret.
La micro-finance, ou plus exactement le microcrdit, est n en Algrie
en 1999 et a t confi pour sa mise en uvre lAgence de Dveloppement
Social (ADS). Il tait caractris par des prts dont les montants se situaient
entre 50 000 et 350 000 DA, soit lquivalent de 600 4000 dollars au taux
de la priode. Le microcrdit tait destin lachat dun petit quipement et
autres moyens de cration dune micro activit pour son propre compte et
remboursable sur une priode de 12 60 mois.
Le financement des microcrdits tait assur par des banques publiques
et prives mais aussi sur concours budgtaires de ltat, tant entendu quil
faisait partie de la panoplie des dispositifs publics de lutte contre la pauvret
et la prcarit et en particulier contre le chmage des jeunes. Il bnficiait de
conditions daccs simplifies et dun soutien de ltat (notamment dune
bonification du taux dintrt de 8 % dont seulement 2 % taient la charge
des bnficiaires) ainsi que dun Fonds de garantie contre les risques de non
remboursement. Par la suite, les dispositifs doctroi de microcrdits ont t
multiplis. Les conditions et les modalits daccs ont t assouplies tandis
que les montants des prts ont t substantiellement rviss la hausse,
notamment avec lembellie financire due la hausse des prix des hydrocarbures. Malgr ces facilitations, les performances de ces dispositifs restent
limites tandis que les objectifs ne sont que partiellement atteints, en particulier au plan qualitatif et de la participation des micro-entreprises cres
la diversification de lconomie nationale hors hydrocarbures.
Les principaux textes de base qui rgissent le microcrdit sont :
Le dcret prsidentiel n04-13 du 22 janvier 2004 relatif au dispositif
du microcrdit.
Le dcret excutif n04-15 du 22 janvier 2004 fixant les conditions et le
niveau daide accorde aux bnficiaires du microcrdit.
Le dcret excutif n05-414 du 25 octobre 2005 fixant les modalits de
fonctionnement du compte daffectation spciale n302117 intitul Fonds
national de soutien au microcrdits.
Le microcrdit a t revu par rapport au relvement des niveaux de prts
accords, par les textes suivants :
Le dcret prsidentiel n11-133 du 22 mars 2011 relatif au dispositif du
microcrdit.
Le dcret excutif n 11-134 du 22 mars 2011 modifiant et compltant le
dcret excutif n 04-15 du 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau
daide accorde aux bnficiaires du microcrdit.
Le Fonds de garantie du microcrdit est rgi par le dcret excutif n0502 du 3 janvier 2005 modifiant et compltant le dcret n04-16 du 22 janvier
2004 fixant le statut du fonds de garantie de mutuelle des microcrdits.
ce jour, aucune stratgie nationale de dveloppement du microcrdit
et encore moins de dveloppement de la micro-finance na t adopte par les
pouvoirs publics ou par lAgence nationale en charge du dispositif de microcrdit. En matire de structuration, il nexiste pas encore en Algrie dassociation professionnelle ddie la micro-finance ou au microcrdit.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
73
Algrie
Les tablissements bancaires intervenants dans les dispositifs
demicro-crdits
cinq banques publiques participent aux dispositifs publics de financement
des microcrdits ANGEM et des autres dispositifs de micro entreprises (ANSEJ,
CNAC) 22 et du Banque nationale dAlgrie (BNA), Banque extrieure dAlgrie
(BEA), Banque de dveloppement local (BDL), Banque de lagriculture et du
dveloppement rural (BADR), Crdit populaire dAlgrie (CPA), et une banque
prive Banque El Baraka partenaire du ministre des Affaires religieuses pour
le microcrdit de la zakat, signataire dune convention avec le Programme
de dveloppement conomique durable (DEVED), un programme pilote de
la GIZ23, de mme que la Banque CNEP24 pour la mise en place dun service
ddi au financement des TPE (trs petites entreprises).
Les tablissements publics intervenants dans les dispositifs
demicro-crdits
22. Agence pour le
soutien lEmploi
des Jeunes et Caisse
nationale dassurance
chmage.
23. Agence allemande
de coopration
internationale.
24. Banque-Caisse
nationale dpargne
etde prvoyance.
ANGEM: Agence nationale de gestion du microcrdit. LANGEM est essentiellement ddie au microcrdit institutionnel destin aux populations pauvres
et gnralement non bancables, auxquelles elle octroie des PNR ( prts non
rmunrs). Lagence dispose galement dun Fonds de garanti des microcrdits. LANGEM sarticule autour de onze antennes rgionales et de 48 coordinations de wilayas. tablie en 2002, lagence vise favoriser lauto-emploi, le
travail domicile et les activits artisanales dans les zones urbaines et rurales,
encourager lmergence dactivits conomiques et culturelles de production de biens et services gnratrice de revenus dans les zones rurales, et
dvelopper lesprit dentreprenariat dans un souci dintgration conomique
et sociale. Ses principales missions sont de grer le dispositif du microcrdit
conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. LANGEM a
rellement dbut ses activits au cours du mois doctobre 2004.
Ses domaines dactivits sont la micro-finance, la coordination, la mise en
place de partenariats institutionnels et bancaires, linformation, le conseil et
laccompagnement et le suivi des activits ralises. Le dispositif de lagence a
gnr prs de 660 000 postes demploi la faveur du lancement de 439 923
micro-activits dans le cadre du dispositif ANGEM. 267 000 de ces microactivits ont t cres par des femmes, soit 60 % du nombre total, gnrant
400 532 emplois directs.
La rpartition par secteur dactivit stablit comme suit : 20,99 % des
micro-activits sont cres dans le secteur des services, 19,30 % dans lartisanat, 17 % dans lagriculture et 8,76 dans le BTP, selon les responsables de
cet organisme. la suite de mouvements de protestation, une mesure spcifique a t consentie par les pouvoirs publics au profit des jeunes promoteurs
potentiels des wilayas du sud du pays. Le microcrdit octroy par lANGEM
pour lacquisition de matires premires va passer ds 2013 de 100000
250 000 DA. Le tableau 4 donne une ide du nombre de bnficiaires de crdits
ANGEM et du volume des crdits engags entre 2009 et 2012.
Jusqu 2011, les prts accords par lANGEM consistent en des prts non
rmunrs (PNR) dun montant 30000 DA destins lachat de matires premires. Ceux-ci sont particulirement priss par les femmes entrepreneures.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
74
tableau
Algrie
4 Bnficiaires et volume de crdits ANGEM engags entre 2009 et 2012
Nombre dtablissements financiers impliqus
Nombre de bnficiaires ANGEM
Dont financement bancaire
Volume des crdits distribus (DA)
2009
5 + 1
60 734
2 627
1 888 751 562
2010
Id.
51 446
3 130
1 664 088 141
2011
2012
Id.
Id.
107 611
108 390
1 595 Non dclar
4 208 639 622
5 603 590 828
Un autre type de prt dont le montant varie entre 400000 500000 DA
fait appel un montage financier avec les banques. Compte tenu du succs
de ce type de produit financier, notamment auprs des femmes, les montants ont t ports, par le dcret n 11-134 du 22 mars 2011, respectivement
400000 DA pour les PNR et 1000000 de DA pour ceux impliquant les
banques. Ce dernier produit est une formule triangulaire qui fait appel un
prt bancaire (70 %), un PNR ANGEM (29%) et un apport personnel du
promoteur (1 %).
25. Voir Algrie-Portail
PME et la rubrique
Programmes
demploi et dinsertion
de lADS .
Agence du dveloppement social25. Dote dun statut spcifique qui lui confre
une grande souplesse, lADS gre des programmes dvelopps en direction
des populations dfavorises. Place sous la tutelle du ministre de lEmploi
et de la Solidarit, elle a pour principal objectif la lutte contre la pauvret, le
chmage et lexclusion sociale. LADS est une institution gestion spcifique
cre en 1996 par dcret excutif n96-232, dans le cadre dune refonte de la
politique sociale. Elle vise promouvoir, slectionner et financer totalement
ou en partie, par voie de subvention ou tout autre moyen adquat :
les actions et interventions en faveur des populations dmunies et du
dveloppement communautaire;
tous projets de travaux ou de services dintrt conomique et social et
comportant une grande intensit de main duvre;
gestion et mise en uvre des programmes demploi ( CPE-TUP-HIMOESIL-IAIG );
qurir et recueillir toutes les aides financires, dons, legs ou libralits,
quils soient de caractre national ou international, ncessaires laccomplissement de son objet social;
instaurer un partenariat fcond avec la socit civile tout en impliquant
le mouvement associatif;
engager des relations de coopration avec les institutions trangres qui
reprsentent des bailleurs de fonds potentiel.
Selon la notice dinformation labore par lADS lendroit des candidats
au dispositif, ses programmes demploi et dinsertion visent mettre disposition des PME et des micro-entreprises (tcherons) des jeunes diplms
de lenseignement suprieur et techniciens suprieurs primo-demandeurs
demplois au chmage ainsi que des jeunes chmeurs de moins de 30 ans,
pour leur faire acqurir une exprience leur permettant daccder un emploi
permanent. Le programme CPE permet a lentreprise de disposer de cadres
moindres charges et de soutenir son efficacit. Pour les contrats de pr-emploi
concernant les jeunes diplms, la PME ou la micro entreprise devra sengager
auprs de la direction de lemploi de la wilaya recruter pendant une premire
75
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
priode dun an renouvelable une fois et pour six mois, un jeune diplm
de lenseignement suprieur ou un technicien suprieur primo-demandeur
demploi.
lissue de la phase prise en charge par ltat, lentreprise bnficiaire
peut recruter dfinitivement lintress ou lui accorder un certificat de travail affrant la priode dactivit. Les rmunrations mensuelles brutes
ainsi que les charges sociales sont prises en charge par ltat. Lentreprise
bnficiera davantages fiscaux et parafiscaux consistant en un abattement
progressif sur le VF fix comme suit : 100 % pour la premire anne, 50 %
pour la deuxime anne et 30 % pour la troisime anne. Le bnficiaire
du CPE peroit une rmunration mensuelle brute de 8 000 DA pour le
diplm de luniversit et de 6000 DA pour le technicien suprieur. Ltat
travers lADS prend en charge les cots salariaux des employs pendant la
priode de douze mois et des avantages fiscaux et parafiscaux en perspective
du recrutement durable des jeunes diplms. La PME est libre de donner un
complment de salaire au diplm recrute.
ANSEJ : Agence nationale de soutien lemploi des jeunes. Cre en 1996,
lANSEJ a pour mission de favoriser la cration et lextension dactivits de
production de biens et de services par des jeunes promoteurs dots dune
qualification professionnelle ou dun savoir-faire reconnu. LANSEJ soutient
des investissements de moins de 5 millions de DA jusqu 10 millions de
DA. De son ct, le postulant doit adhrer au Fonds de Caution Mutuelle
de Garantie risques-crdits pour jeunes promoteurs. Charge de mettre en
uvre des actions pour lutter contre le chmage et de favoriser linsertion
conomique dans le cadre de la dynamisation du secteur priv, lANSEJ est
une agence gouvernementale daide la cration dentreprises prsente sur
lensemble du territoire algrien travers un rseau de 53 antennes. Les
actions de lagence sarticulent autour des deux principaux objectifs :
favoriser la cration dactivits de biens et services par de jeunes promoteurs ;
encourager toutes formes dactions et mesures tendant promouvoir
lemploi des jeunes.
Oprationnelle depuis le deuxime semestre 1997, lAgence pour le soutien lemploi des jeunes est un acteur incontournable du dveloppement
conomique local en Algrie. Elle a pour missions : linformation, la sensibilisation et laccompagnement ainsi que la cration demplois. Selon le ministre
du Travail, de lEmploi et de la Scurit sociale, depuis le lancement de la
stratgie de lemploi de jeunes en 1998, plus de 300 000 micro-entreprises
ont t cres dans le cadre du dispositif ANSEJ, dont 32 000 dans lartisanat.
La cration de ces micro-entreprises a gnr prs de 600 000 emplois, dont
18 % sont des femmes.
CNAC : Caisse nationale dassurance chmage. Outre sa mission principale,
la Caisse nationale dassurance chmage, cre en 1994, sest donne aussi
pour mission, depuis 2003, le financement de la cration dactivits de biens
et services par les chmeurs promoteurs gs de 30 50 ans, licencis pour
raisons conomiques. Entre 2005 et 2009, la CNAC a financ 18207pro-
76
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
jets de micro-entreprises dont 7946 projets en 2009, crant ainsi 44 247
emplois dans diffrents secteurs dactivits. Le montant de la participation
de la CNAC au financement de ces projets slve 2 milliards de DA contre
une contribution des banques de lordre de 6 milliards de DA alors que les
apports personnels des bnficiaires ne reprsentent que 0,7 milliards de
DA. La rpartition des projets par secteur dactivits seffectue comme suit :
agriculture et levage (23,7 %) ; transport (22,6 %), services (2891%), BTPH
( 10,06 % ), industrie (14,35 %), autres (0,38 %). Les projets ports par des
femmes ne reprsentent que 10 % du total.
Sur la priode 2010 2012, ce sont 61 000 projets qui ont t financs
dans le cadre du dispositif CNAC et qui ont cr 113 000 emplois. Ce qui
donne au total pour la priode 2005 2012, 79 207 projets financs qui ont
gnr 157 247 emplois, soit une moyenne de 11315 projets par an et prs de
22 500 emplois crs par an.
PNDA : Programme national de dveloppement agricole, un instrument de
solidarit pour les communauts rurales. Depuis 2000, un plan national
de dveloppement agricole financ par le Fonds national de rgulation et de
dveloppement agricole (FNDRA) vise crer une dynamique de dveloppement de lagriculture en milieu rural occup par 13 millions dhabitants.
Le ministre de lAgriculture a initi en 2002 un programme spcifique aux
zones rurales dfavorises. Les dispositifs de dveloppement proposs dans
le cadre de ce programme visent renforcer le tissu social et conomique
des populations de ces zones pour ne pas les exclure de la dynamique de
dveloppement global. Cependant, cette initiative ne semble pas atteindre ses
objectifs dans le sens o une bonne partie des mnages ruraux narrivent pas
intgrer les programmes mis en uvre dans le cadre du PNDRA en raison
de contraintes dligibilit et dintgration du circuit de commercialisation.
PDRI : Projets de proximit de dveloppement rural intgr, un instrument
potentiel favorable la promotion de lESS dans lespace rural algrien. Lobjectif des PPDRI est de dvelopper la capacit de prise en charge du dveloppement par les organisations de base et la croissance conomique travers
le dveloppement dactivits conomiques de proximit. Les activits sorganisent autour de thmes fdrateurs qui peuvent runir les populations dans
un mme projet comme, par exemple, la modernisation des villages et des
ksours, la diversification des activits conomiques, la protection des ressources naturelles ou la rhabilitation du patrimoine matriel et immatriel.
Une premire valuation de ces projets porte sur le nombre dentits
administratives, dorganisations de base, de populations concernes, de
mnages bnficiaires et demplois crs. Selon les donnes de la Direction
gnrale des forts, durant le premier semestre 2012 plus de 5 300 projets de
proximit de dveloppement rural intgr (PPDRI) ont t lancs. Ce chiffre
est en hausse de 62 % relativement la priode 2009-2011 qui a vu lapprobation de 6059 PPDRI et le lancement effectif de 4165 projets. Ces projets
couvrent plus de 5 600 localits rurales situes dans 1 384 communes au
bnfice de plus de 790 336 mnages ruraux, pour quatre millions dhabitants. Pour la priode 2009-2011, ces projets auraient gnr 133 880 emplois
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
77
26. Voir Le
renouveau agricole
et rural en marche :
revue et perspectives
Ministre de
lAgriculture et du
Dveloppement rural,
Algrie, (2012).
Algrie
assimilables des quivalents-emplois permanents, selon la terminologie des
concepteurs de ces projets.
La mme source indique que sur les 7 812 PPDRI proposs durant le
premier semestre 2012, 6874 ont t approuvs, soit un taux de 88 % du
total. Outre leurs impacts sur lamlioration des moyens de subsistance des
mnages cibls, ces projets incluent des actions collectives ayant un effet
significatif sur les conditions de vie des localits rurales concernes, notamment travers les oprations de dsenclavement et de construction dhabitat
rural. Durant cette priode, 51931 hectares de plantations ont t ralises
portant ainsi la superficie couverte pour la priode 2009-2012 209000hectares, soit un quivalent de 171 millions de plants mis en terre travers diffrentes wilayas du pays. Les plantations forestires reprsentent 72 % des
ralisations globales pour cette mme priode avec 149824 hectares, contre
43437 hectares pour les plantations fruitires (21 %), alors que les plantations
pastorales couvrent 14481 hectares, soit 7 % du total. Ces projets ont gnr
prs de 40000 quivalent-emplois permanents.
Sur un plan global et en termes de perspectives immdiates, 10 200 projets de proximit de dveloppement rural intgr (PPDRI) sont programms
travers 2200 localits rurales dans le cadre du programme quinquennal
2010-2014. Ces projets visent lamlioration des conditions de vie de 730000
mnages ruraux, soit 4500000 habitants. Ils contribueront la prservation
et la valorisation de 8,2 millions dhectares sur les 50 millions dhectares
de lespace rural algrien. Situs dans les zones montagneuses, steppiques
et sahariennes, ces projets renforceront les capacits agricoles du pays et
entendent crer 750000 quivalents-emplois permanents.
Sinscrivant dans le cadre de la loi 08-16 dorientation agricole du 3aot
2008 et de la loi relative aux conditions dexploitation des terres agricoles relevant du domaine priv de ltat, les PPDRI visent apporter des lments de
rponse aux difficults du foncier auxquelles sont confronts les travailleurs de
la terre. cet effet, plusieurs mesures de soutien sont inities par le ministre
de tutelle au profit des paysans. Parmi celles-ci, il faut relever les encouragements rservs aux filires cralire, olicole et viticole par lesquelles se singularisent certaines wilayas. Il convient galement de souligner limportance
des instruments de modernisation de lappareil productif, les modalits daccs
aux mesures daccompagnement et de soutien des diffrents programmes et
les mesures visant la valorisation des produits du terroir.
Selon les dernires informations fournies par le site du ministre de
lAgriculture dans le rapport sur le dveloppement de lagriculture, le taux
de ralisation des engagements des PPDRI avoisine 30 % 26. Ce taux parat
modeste pour des petits projets de proximit mais il semble que les procdures de mise en uvre construites au fur et mesure sont lorigine de ce
dcalage entre les dveloppements thoriques du projet et leur traduction
sur le terrain, qui fait appel une procdure dapprobation multi-niveaux
complexe au nom des principes de comptitivit et de transparence. Avec
lexprience, la mise en uvre des PPDRI connatra une nette amlioration,
notamment avec une plus grande implication des parties prenantes et une
apprciation des impacts positifs des projets sur le bien-tre des populations
et sur les changements dans leur environnement.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
78
Algrie
Concernant lancrage de ce type de projet dans lESS, cest travers lintroduction de nouvelles formes de gouvernance que cet aspect peut tre apprhend. En effet, mme sil sagit dun instrument institutionnel, le processus
de mise en uvre des PPDRI privilgie dans sa conception lesprit de participation, dorganisation, de partenariat et de structuration des acteurs avec
comme principe fdrateur, la mutualisation. Cette approche participe donc
dun effort convergent des acteurs fond sur lesprit de solidarit et dentraide
qui sexprime travers lexemple dun service dassurance et de compensation
assur par la Caisse nationale de la mutualit agricole (CNMA). Jusqu 2012,
cette mutuelle fdrait 150 000 socitaires et 300 000 usagers.
27. Collecte de
laumne que les
musulmans sont
tenus de calculer
chaque anne lunaire
sur leur fortune et
de donner aux plus
pauvres dans leur pays
de rsidence ; la zakat
constitue le troisime
pilier de lislam.
Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs : la rsurgence dune forme
de solidarit traditionnelle dans des projets dESS. Ce ministre a mis en
place en 2003, dans le cadre du fonds de la zakat 27 un microcrdit dit de la
zakat destin aux ncessiteux. Le prt avec intrt tant prohib en islam,
les prts sans intrt ne dpassent pas les 500000 DA par bnficiaire. De
2003 2011, le fonds de la zakat aurait octroy quelques 8580 microcrdits
pour un montant global de 1078628558 DA (env. 10 millions deuros). De
la mme manire et selon le ministre des Affaires religieuses, des aides
financires ont t consenties 345660 familles ncessiteuses dans le cadre
du fonds de la zakat el fitr entre 2003 et 2009. Pour la priode 2004-2009,
4 495 projets dinvestissement ont t financs dans le cadre du fonds de la
zakat. Pour la priode 2003-2009, le fonds de la zakat sur le capital a collect
2 258 561 274,24DA (environ 22 500 000 deuros) tandis que le fonds de
la zakat el fitr a collect 1 524 666 156,96 DA (environ 15 250 000 deuros).
Cest la banque Al Baraka qui octroie et gre les crdits pour le compte du
ministre des Affaires religieuses et des wakfs, en application de la loi sur la
monnaie et le crdit. Peu dinformations existent sur les conditions doctroi
et le fonctionnement de ce nouveau produit dans la micro-finance en Algrie.
Le fonds de la zakat est dfini comme une institution religieuse et sociale
qui uvre sous la tutelle du ministre des Affaires religieuses et des wakfs
qui lui garantit la couverture juridique dans le cadre de la loi sur la mosque.
Il est organis selon trois niveaux correspondant la commission de base au
niveau de la dara, la commission de wilaya et la commission nationale qui
renferme le haut conseil du fonds de la zakat. Il est stipul que les fonds collects dans le cadre de la zakat sont dpenss au profit des familles dmunies
travers une allocation trimestrielle, semestrielle ou annuelle, pour financer
les projets dinvestissement au profit des pauvres et pour lacquisition dquipements au profit des petites et des toutes petites entreprises.
De nombreux projets sont entrepris dans le cadre des wakfs : ralisation
dun centre commercial et culturel Oran, de 42 locaux commerciaux Tiaret,
investissement consistant en la ralisation de centres commerciaux et administratifs Sidi-Yahia (Alger) financs par des investisseurs privs sur des
terres wakfs sur la base dun principe de concession, investissement au quartier
El-Karam Alger comprenant des services sociaux et de prestation ; il consiste
en la ralisation de 150logements, 170locaux commerciaux, une polyclinique,
une banque, un htel, une maison pour orphelins ; projet de cration dune
socit de taxis dote de 30 vhicules gnrant une quarantaine demplois.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
79
Algrie
Une initiative prive pour le microcrdit : cration dune Institution de microfinance (IMF). Ces derniers temps, il est fait tat dune initiative prive de
cration dune institution de micro-finance28. En effet, aprs les solutions
publiques de microcrdit, notamment lANSEJ, LANGEM, lADS et la CNAC
et le ministre des Affaires religieuses, cest au tour de linitiative prive
dinvestir le crneau du financement des microcrdits travers un premier
tablissement de financement pour le dveloppement conomique et social
(FIDES). Avec des crdits pratiquement symboliques dun montant de lordre
de 3 500DA (50dollars), les emprunteurs peuvent augmenter quelque peu
la rentabilit de leurs activits (petit commerce, agriculture ou artisanat) et
accrotre ainsi leurs revenus. En effet, laccs aux prestations financires leur
permet dtre moins dpendants des intermdiaires, de dvelopper leurs processus de travail et dobtenir de meilleurs prix sur des marchs plus loigns.
Pour cet tablissement, FIDES-Algrie, une filiale de lassociation FIDES
( Finances pour le dveloppement conomique et social), le microcrdit est
une rponse partielle au dveloppement des entreprises en Algrie.
Il est vrai que les banques agres en Algrie noffrent pas ce type de
solutions et que lAlgrie est lun des derniers pays au monde o il n y a
pas de micro-finance commerciale de ce genre. FIDES-Algrie entend faire
bnficier le pays de cette nouvelle forme de financement du dveloppement,
visant soutenir sur place, de manire cible, des personnes en situation
prcaire mais actives conomiquement.
Il est noter que cet tablissement lance sa premire exprience Ghardaa travers limplantation de son premier guichet en Algrie. Cette option
porte en elle-mme toute la philosophie du FIDES qui repose sur un systme
dentraide familiale, amicale, tribale ou de quartiers, mme de garantir le
remboursement des prts par cette chane solidaire. Cette logique est applique
par FIDES-Algrie. Constatant une forte demande en produits islamiques, elle
a accd aux souhaits des clients de la rgion.
Lentrepreneuriat social
28. Voir SABOUNJI
R. Le microcrdit
commercial dbarque
en Algrie , Les
Afriques, Alger.
limportance du dveloppement de lentrepreneuriat social en Algrie
nest plus souligner du fait quil permet entre autres la rsorption du taux de
chmage et la prise en charge de divers problmes sociaux. En effet, lentrepreneuriat social, qui conjugue la logique conomique et sociale, connat ses
dbuts en Algrie. Cette nouvelle forme de lconomie des entreprises, qui
prend en charge les besoins sociaux fondamentaux pour faire du profit, a t
initie dans le sud algrien autour de la production et du conditionnement
de la datte.
Lentreprise Bionoor, spcialise dans la production et le conditionnement de la datte dOuargla sous le label Bio, a t lance afin de crer de
lemploi pour les jeunes chmeurs de la rgion, mais aussi pour la rhabilitation de la datte par son conditionnement et son exportation vers les marchs
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
80
Algrie
extrieurs. Cette initiative vise relever le dfi et son produit a gagn une certaine notorit spcialement en Europe. Cette initiative unique en son genre
a t suivie par dautres entrepreneurs sociaux qui agissent actuellement en
Algrie pour apporter avant tout des solutions aux problmes de socit. ce
titre, les pouvoirs publics et les entreprises prives tentent des collaborations
avec comme objectif la protection et la promotion de lintrt gnral.
On peut tendre la cration dentreprises sociales aux activits qui
relvent de la gestion des dchets, pour rpondre rapidement la dgradation
fort avance de lenvironnement et aux dficits latents dans les champs de la
collecte et du traitement des dchets. Il est possible de crer des entreprises
sociales qui, en rinvestissant une grande part de leur capital dans des enjeux
de socit, raliseront des gains substantiels et creront de lemploi.
valuation du poids de lESS danslconomie algrienne
29. Voir
DEMOUSTIER D.,
conomie sociale
et action publique :
largissement,
substitution, ou
aiguillon? , BANCE
P., LAction publique
dans la crise. Vers un
renouveau en France et
en Europe ?, PURH,
2012.
des recherches rcentes ont tent de quantifier la plus-value de solidarit
de lESS travers lvaluation du poids conomique du secteur de lESS, en
particulier dans la rgion du Languedoc-Roussillon en calculant une richesse
montaire nette, la cration demplois nets et limportance des cots vits29.
La constitution dune base de donnes et llaboration dun cadre mthodologique dvaluation des productions marchandes et non marchandes des
organisations ont t ncessaire pour aboutir des rsultats fiables. Le traitement de ces derniers a conduit proposer la mesure des valeurs ajoutes
marchandes directes et indirectes, de lemploi, du surplus de solidarit et des
valeurs sociales hors march. De surcrot, il a t soulign limportance destimer le nombre des prestations du secteur et le nombre des bnvoles dans
les territoires concernes. Un travail de ce type est envisageable en Algrie si
les pouvoirs publics et les acteurs du secteur de lESS saccordent dgager
des moyens pour y parvenir.
Le Centre des jeunes dirigeants de lconomie sociale (CIDES) propose
un bilan socital plus ambitieux que le bilan social, comme outil de management et de performance des organisations et des territoires socialement responsables. De son ct, lAgence de valorisation des initiatives socio-conomiques
(AVISE) a rdig un guide de lutilit sociale comme convention sociopolitique
afin daccompagner les acteurs associatifs, notamment dans lautodiagnostic
de leurs processus, rsultats et impacts ( voir Demoustier). Enfin, le Conseil
rgional Rhnes-Alpes promeut loutil EvaluRa, conu de faon partenariale,
pour donner une vision claire du gain socital apport par une activit dESS.
Ces volutions de lintervention publique territoriale tmoignent dune
meilleure reconnaissance de lESS, rductible ni une normalisation administrative (intgration dans les dispositifs publics), ni aux normes marchandes
(soumission aux normes de la concurrence). Elles montrent la complmentarit et les interactions entre les dynamiques de lESS et les dynamiques
publiques, qui loin dtre excluantes se renforcent rciproquement.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
81
30. Atlas de lconomie
sociale et solidaire,
Franois Rousseau
(Dir.), JurisAssociations, 2012.
Algrie
Sagissant du cas algrien, il nous semble que nous ne pourrions aller
vers des approches telles que dcrites ci-dessus, nayant pas de tradition
dESS rellement tablie. Pour diverses raisons, il est extrmement difficile
de quantifier le poids de lESS dans le champ de lconomie algrienne et
encore moins dans le Pib tant il sagit dun concept totalement nouveau
dans le paysage de la recherche universitaire mais aussi de la tradition de
lanalyse conomique et de lapprhension de cette donne dans le champ
sociopolitique.
Par ailleurs, il est difficile de dissocier ce qui relve rellement des
actions de lESS proprement dite des actions qui peuvent sapparenter lconomie solidaire tant au plan des acteurs impliqus que des publics ou des
populations concerns ou encore des sources de financement. Ds lors, les
dveloppements de lESS ne sont pas intgrs dans la statistique publique.
Cest l une difficult majeure que lon nomettra pas de relever ici et qui
soulve, son tour, une question de reconnaissance de lESS et partant, de
politique au profit de lESS.
Cependant ce manque de reconnaissance de lESS nest pas total du
moment que lconomie sociale sous sa forme moderne a fait irruption en
Algrie en 1996 du moins dans le discours officiel. Avec la mise en uvre
du programme dajustement structurel (1994-1997) sur recommandation du
FMI, ce nouveau lexique sest adjoint la notion dESS comme une alternative
englobant les mesures durgence inities par les pouvoirs publics en rponse
aux maux sociaux.
Nanmoins, la connaissance et la reconnaissance de lESS nont pas
connu de progrs significatif. Par consquent, on ne dispose pas dinformation et de statistiques fiables, ne fussent-elles que partielles, qui puissent
nous livrer une vision utile du secteur de lESS en Algrie. Ni lOffice national
de statistiques (ONS), ni le ministre de la Solidarit et de la Famille, ni le
Conseil national conomique et social (CNES) ne font mention de ce secteur.
Les informations sont encore trop faibles et disparates pour envisager constituer un Atlas de lESS en Algrie similaire celui publi en France30. Logiquement, cest lchelle des collectivits territoriales ( wilaya et commune)
que doivent se tisser les premiers partenariats de lESS et prendre forme les
premiers embryons de statistiques.
Plus gnralement, si lvaluation du poids global de lESS reste faire,
la question de la reconnaissance mrite encore davantage de dmarches
damlioration. Il semble pertinent daccorder la priorit la constitution
de statistiques sur les acteurs pouvant offrir une valuation opratoire des
qualits propres de lESS et de ses performances en Algrie, lattention devant
tre focalise davantage sur les chelons rgionaux et locaux dans un premier
temps travers la comptabilit rgionale.
La mthodologie prconise et utilise est celle dveloppe sous lgide
des Nations unies travers le systme du compte satellite entendu comme un
ensemble de tableaux statistiques cohrents avec le cadre central des comptes
nationaux, mais dans lequel on peut adopter une approche spcifique et
ajouter des lments qui ne figurent pas dans les comptes nationaux afin de
dcrire la ralit conomique dun autre point de vue. La mthodologie de ce
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
82
tableau
Algrie
5 Part de lESS dans lconomie algrienne travers les emplois gnrs
Emplois ou quivalent-emplois
temps plein
Taux
Associations
79 000
et fondations
Mutuelles
4 000
Coopratives
84 000
PPDRI
44 600
MARW-Zakat
1 600
Microcrdit institutionnel 145 000 [- ADS]
Microcrdit ONG
500
Filets sociaux divers
Equivalent-emplois
(IAGI, TUPHIMO, etc.) TUPHIMO : 15 000 /5 (ETP)
ESIL : 143 400 /5 (ETP)
Autres formes
500
TOTAL
390 880
5 000 000 salaris
7,80 %
Associations + Mutuelles + coop- 3,35 %
ratives + autres formes (168 000)
9 000 000 salaris permanents
4,30 %
et non permanents
1,86 %
Observations
Estimation et moyenne sur la population des
associations partir de la ralit de certaines
associations et de lintgration du bnvolat
Solidarit institutionnelle
Etude sur les activits de Touiza
Source : ONS/ADS (anne 2009)
Solidarit institutionnelle
Estimation sur la base dobservations de terrain
3 % de la masse salariale raison dun
salaire moyen de 35 000 DA/mois
CNES-PNUD, RNDH , 2006
31. Voir Le
compte satellite
desinstitutions
sans but lucratif
Institut des comptes
nationaux et
Banque nationale
deBelgique,
Bruxelles, 2004.
compte satellite a fait lobjet dune phase de testing dans certains pays, mais
il reste ltat embryonnaire en Algrie 31.
Le systme de comptabilit nationale en Algrie (Systme de comptes
conomiques algriens, SCEA) ne dispose pratiquement daucun indicateur
homogne qui permette de mesurer le poids conomique de lensemble des
composantes assimilables au champ de lESS (coopratives, mutuelles, associations, fondations). Pour une premire approche, il nest possible de travailler que sur des formes demploi salari et des salaires qui peuvent croiser les
nomenclatures dactivits et les types juridiques ou dorganisations. Ce qui
rend lvaluation difficile et la marge derreur importante. tableau 5
Comme on le constate, lESS sous toutes ses formes reprsente au mieux
8 % des emplois salaris si lon tient compte de toutes les activits sapparentant de prs ou de loin lESS, soit quelques 390 880emplois (ETP, quivalent temps plein) dont 43 % dans les formes dorganisations associatives,
coopratives, mutuelles, fondations et autres. Cette borne suprieure est videmment trs large. Mais si lon ne tient compte que de la contribution des
organisations de lESS stricto sensu rapporte la population totale des salaris
permanents et non permanents, le ratio se rduit moins de 2 %, ce qui traduit beaucoup mieux la ralit dune ESS en gestation et est en conformit
avec les donnes utilises pour lestimation du taux de chmage en Algrie.
Au vu de cette premire estimation ce sont les secteurs associatif et
coopratif qui contribuent le plus dans le champ de lESS. Selon nos estimations sur la base de la ralit du terrain, le secteur associatif compterait
79 000emplois ( ETP) auquel il conviendrait dajouter le volume du travail
bnvole qui est difficilement valuable tant les disparits entre associations
sont importantes et les contributions relles des adhrents aux activits asso-
83
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
ciatives sont diffrentes, si lon veut avoir une estimation du poids conomique rel ( en termes de force de travail et de capacit de production de services ). De mme, dans ce travail prliminaire, le budget cumul du secteur
associatif ou lquivalent de son chiffre dactivit est difficilement cernable.
Le secteur coopratif initialement bien dvelopp et diversifi en Algrie occupe actuellement une place relativement modeste dans quelques secteurs comme lagriculture ou lagroalimentaire. La partie visible du secteur
regroupe 1 091 coopratives agricoles agres regroupant 84000 adhrents
relativement 900 000 exploitants agricoles en activit, soit 84000 emplois
( non convertis en ETP). De nouvelles entreprises sont en dveloppement
( commerants, artisans, taxieurs, etc.), mais leur contribution est difficilement valuable aujourdhui, les donnes ntant pas disponibles.
Malgr son poids conomique relativement modeste, on doit souligner
tout de mme le rle socital de la mutualit pour certaines franges de la
population, par la mutualisation des risques et lapplication du principe de
non slectivit, par ses effets rgulateurs sur le march de lassurance et, bien
davantage, celui de la sant, mais surtout par la solidarit intergnrationnelle quelle gnre du fait du respect de ses rgles. Enfin, on ne peut omettre
de citer le rle des coopratives agricoles dont les actions de production et
de promotion sont profitables non seulement aux cooprateurs et aux agriculteurs eux-mmes, mais se propagent par ondes successives dans le tissu
territorial et les communauts locales.
Les perspectives davenir de lESS enAlgrie
les perspectives envisageables devraient conjuguer les actions de lESS
et les dynamiques territoriales. Dsormais, il sagit de rflchir la part de
lconomie sociale et solidaire dans la construction politique du dveloppement local pour arriver progressivement sa traduction dans de nouveaux
rseaux de gouvernance lchelle des collectivits territoriales ( wilaya,
commune, voire lchelle de rgions gographiquement identifies) aprs
avoir tabli le reprage de dynamiques territoriales suffisamment homognes pour donner au processus de matrialisation et dvolution de lESS une
dimension la fois socitale et historique.
En somme cela revient dfinir des rgimes territoriaux dESS spcifiques diffrentes rgions. Dans son article, Les rgimes territoriaux de
lESS : le cas du pays basque franais, Itaina montre que cette approche
revient interroger les facteurs de constitution dun capital social territorial qui constitue en tant que bien collectif un facteur de production part
entire. On voit alors se constituer les modalits de rgulation politique systmique cest--dire des formes de gouvernance dun territoire, et enfin, la
construction de problmes publics sur le territoire, autrement dit, la transformation denjeux sociaux en problmes publics et problmes politiques
(Itaina, 2010).
84
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Algrie
Lopportunit offerte par la promotion de lESS en Algrie doit tre saisie
pour llaboration et la mise en uvre dune politique transversale dinitiatives
et dentreprises fortement structures par des logiques la fois statutaire et
sectorielle. Lmergence de politiques territoriales dESS doit aller dans le sens
dune consolidation et dun renouvellement institutionnels qui accordent une
place lESS en tant que composante lgitime de lconomie plurielle mme
de peser sur les logiques de dveloppement local. La reconnaissance du caractre transversal de lESS est fondamentale face aux logiques dintgrations sectorielle ou statutaire, qui remettent priodiquement en cause ses spcificits
socio-conomique et sociopolitique (Fraisse, 2005).
Le champ de lESS est encore en phase de gestation en Algrie. Il se manifeste beaucoup plus par des actions miettes que par une logique dacteurs
et dorganisations ancres dans des ralits socitales et encore moins dans
des dynamiques territoriales et conomiques convergentes. Cette tendance
est dailleurs corrobore par labsence dun cadre juridique propre lESS en
Algrie ainsi que dans les autres pays du Maghreb, malgr lexistence de textes
de loi rgissant les diffrentes formes dentreprises sociales, et dun cadre institutionnel de soutien de lconomie sociale tant au niveau de ladministration
de ltat que des collectivits territoriales.
Il est clairement tabli que le champ de lESS est pour le moment largement domin par les formes et dispositifs institutionnels qui assurent
lessentiel de son financement par des voies directes ou indirectes. Les fondations sont trs peu dveloppes et constituent pour la plupart des prolongements dONG. Ayant une tradition ancre dans lhistoire du pays, les
coopratives pousent diverses activits, mais elles ne demeurent effectives
et oprationnelles que dans le domaine de lagriculture et de limmobilier.
Lvaluation de la part de lESS dans lconomie algrienne relve dun
exercice extrmement difficile dans un contexte marqu par labsence de
donnes et statistiques spcifiques au domaine, des difficults lies limbrication des leviers institutionnels avec les leviers traditionnels ainsi que par
la dilution des actions imputables lESS par rapport aux dispositifs publics.
Toutefois, lespoir de voir lESS connatre un dcollage et une volution
constructive comme dans dautres pays demeure possible, au vu de lmergence progressive de rseaux favorables tant lchelle nationale qu celle du
Maghreb. Cet lan de lESS peut tre encourag par lexistence de ferments
au sein de la socit algrienne qui offrent de vritables prdispositions ou
des capabilits certaines travers sa forte rsilience, sa capacit dadaptation
et dintgration des lments exognes, et surtout sa capacit dintgrer des
processus volutifs. Dans le mme sillage, la socit porte en elle des principes forts dorganisation et de fdration, de mutualisation des moyens et de
la force de travail, mais aussi de valorisation de ses propres ressources aussi
modestes soient elles ( ressources territoriales, humaines ) notamment dans
la gestion des biens communs. Ce capital social apprciable peut tre exploit
et servir dassise la consolidation et la promotion de lESS en Algrie.
85
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
conomie sociale et solidaire (ESS)
au Maroc
86
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
la crise conomique et laugmentation des dficits publics, louverture
des marchs et lincidence de la mondialisation, lavnement de lconomie
de savoir, etc., ont favoris un profond rexamen du rle de ltat dans la
plupart des pays du monde. En effet, ltat semble aujourdhui de plus en
plus incapable de faire face seul aux dfis troitement lis de la persistance
du chmage, des nouvelles formes de pauvret, de la dgradation de lenvironnement, etc. Cette situation a favoris, un peu partout travers le monde,
lmergence dun autre secteur, autre que ltat et le secteur priv, qui apporte
une contribution importante la solution des problmes humains en plaant
lHomme au centre du dveloppement conomique et social.
Il sagit dun secteur qui prend plusieurs appellations en fonction du
contexte. Ainsi, on parle de Non-profit organisations aux tats-Unis, du volontary sector en Angleterre, du troisime systme dans lUnion Europenne, de
lconomie sociale, de lconomie solidaire, de lconomie populaire, de lconomie de dveloppement communautaire dans le monde francophone et en
Amrique latine, mais parfois galement dun Tiers secteur finalit sociale,
dun tiers secteur dconomie de proximit, amortisseur social en remplacement
dun tat providence moins prsent ou encore dun secteur accompagnateur des deux secteurs priv et public. Toutes ces appellations dsignent un
ensemble dactivits conomiques et sociales exerces par des organisations
relevant de la socit civile et parfois de type coopratif ou associatif.
Lapparition de ces organisations reflte bien dune part la qute de nouvelles relations avec ltat et le march et dautre part une tendance vers
une approche ascendante et autonome de dveloppement socio-conomique
(une approche participative et de partenariat) du bas vers le haut.
Ce type dorganisation sest dvelopp partout dans le monde, tant dans
des pays dvelopps quen dveloppement, et apporte une contribution non
ngligeable aux conomies nationales. En France, lconomie sociale contribue hauteur de 10% environ au produit intrieur brut (Pib) et emploie
quelques 7% 8% de la population active (plus de 2 millions de salaris).
En Belgique, il participerait environ 10% au Pib et 10% environ lemploi
(dont 80% pour le secteur associatif, 15% pour le secteur coopratif et 5%
pour les mutualits). Aux Pays-Bas, il serait lorigine de quelques 10,2 % du
Pib et environ 13 % de lemploi non agricole rmunr.
Au Maroc, bien que la culture de solidarit, dentraide et de travail collectif, qui constituent les principes de base de lconomie sociale, fasse partie
des traditions, lmergence du secteur sous une forme structure et organise, notamment pour sa composante associative, date des annes 1980 et du
dbut des annes 1990. En effet, lapplication du Programme dajustement
structurel (PAS) pendant cette priode sest traduite par un dsengagement
progressif de ltat de plusieurs secteurs conomiques et sociaux, ce qui a eu
des effets plutt nfastes sur lemploi, sur loffre de services publics et sur le
pouvoir dachat de la population.
Les organisations de lconomie sociale, particulirement les associations, se sont rapidement dveloppes et ont pris du terrain dans plusieurs
domaines, longtemps rservs ltat : la fourniture de services de proximit
et des quipements de base, notamment dans le monde rural, la lutte contre
lanalphabtisme, la cration et laccompagnement de projets de dveloppe-
87
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
ment, la promotion et lintgration de la femme dans le circuit conomique,
le financement de petits projets, etc. Dans tous ces domaines, les organisations de lconomie sociale accomplissent un travail reconnu aussi bien par
les pouvoirs publics, que les populations ou les organisations internationales.
La force des entreprises de lconomie sociale rside dans leur proximit avec
les populations, leur connaissance du terrain, leur mode de fonctionnement
souple qui leur permet dintervenir rapidement et efficacement.
Aujourdhui encore, depuis le lancement de lInitiative nationale de
dveloppement humain (INDH), par le roi Mohamed vi, le 18 mai 2005, les
entreprises de lconomie sociale, notamment les associations, se sont fortement mobilises pour russir ce grand chantier. Elles interviennent pour
identifier les besoins des populations, porter des activits gnratrices de
revenus, participer au financement, organiser les bnficiaires des projets,
participer aux organes de gouvernance de lINDH, etc.
Dans ce travail, nous revenons dabord sur une caractrisation plus ou
moins jour du contexte conomique, dmographique et social du pays
(deuxime section ). Dans la troisime section, nous prcisons ce qui semble
tre une dfinition de lconomie sociale au Maroc avec ses frontires plus au
moins tanches et les conditions ayant favoris son mergence au Maroc.
Sur la lance, nous prsenterons la quatrime section les enjeux (assigns)
lconomie sociale au Maroc au niveau de son rle et son cadre institutionnel. La cinquime section prsente les chiffres officiels disponibles relatifs
lconomie sociale au Maroc. Depuis quelques annes maintenant, les autorits tentent de mettre en place une politique publique en matire dconomie sociale. Nous rservons la sixime section pour prsenter les contours
de cette politique alors que la septime section revient sur les perspectives
davenir de lconomie sociale au Maroc. La dernire section est rserve
quelques recommandations et une conclusion.
Contexte conomique, dmographique et social
dans cette section, et avant de traiter les aspects spcifiques relatifs lconomie sociale, objet de cette tude, nous revenons brivement sur quelques
lments des contextes dmographique, conomique et social du Maroc, qui
ont favoris le dveloppement des initiatives dconomie sociale.
Dmographie
selon le dernier recensement de la population et de lhabitat, ralis en
2004, la population du Maroc slevait 29,9 millions dhabitants (16,4millions en milieu urbain et 13,5 millions en milieu rural). Selon les projections
du Haut-commissariat au plan (HCP), en 2013, cette population serait denviron 32,8 millions (19,4 millions en milieu urbain et 13,4 en milieu rural). Le
88
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
Maroc est en fait parmi les pays les plus peupls de la rgion Moyen-Orient
et Afrique du Nord.
Cette population est principalement jeune puisque, en 2013, la proportion de celle-ci ge de moins de 15 ans, reprsenterait plus 26 %. Celle ge
de 15 59 ans ( population en ge dactivit) reprsenterait 64 %. Celle des
personnes ges de plus de 60 ans, et qui seraient au nombre de 4,6 millions,
ne reprsenterait que 14 % de la population totale.
Le taux daccroissement de la population ne dpasserait pas 1,4 % par
an alors que lindice synthtique de fcondit est de lordre de 2,05 enfants
par femme ( 1,93 en milieu urbain). Le taux de mortalit infantile est de
26,49. Le taux de mortalit maternelle est de 112 dcs pour 100000naissances en 2011. Lesprance de vie la naissance atteint 73,7 ans.
La lecture de ces indicateurs, par rapport aux besoins auxquels les pouvoirs publics devraient faire face, montre que le pays a progress mais reste
confront des dfis multiples et de natures diffrentes : en matire de scolarisation et de formation, de sant et de protection sociale, de logement, de
lutte contre la pauvret et la prcarit, de lutte contre le chmage notamment
chez les jeunes et les jeunes diplms, etc.
conomie
la fin des annes 1970 et le dbut des annes 1980 ont t marqus par
une dgradation des quilibres fondamentaux de lconomie nationale et
par la fragilit de ses structures face aux effets des facteurs conjoncturels.
A titre dexemple, le dficit budgtaire avait atteint prs de 9 % du produit
intrieur brut. Ainsi, la dcennie 1980 a t marque par une politique de
rigueur visant la fois la rforme des finances publiques, celle du commerce
extrieur et celle du systme montaire et financier. Par ailleurs, partir de
la fin des annes 1990 et surtout pendant les dix dernires annes, le Maroc
a mis en place plusieurs rformes visant mieux grer lconomie du pays.
Ces politiques, mises en uvre dans un contexte national pas toujours
favorable, marques par des annes de scheresses et par une conjoncture
internationale non moins dfavorable, caractrises par une hausse soutenue du prix du ptrole et des prix des produits alimentaires, ont permis de
contenir le dficit budgtaire et de le placer un niveau soutenable (autour
de 3 % du Pib) et aussi de ramener linflation au-dessous du seuil de 3 %.
Les politiques macroconomiques mises en place ont donc permis de
contrer, autant que possible, et au moins pour quelques annes, la crise internationale de 2008 et ses rpercussions. Cette rsilience a malheureusement
fini par saffaiblir en 2012 et 2013 pour se transformer en un dbut de crise
des finances publiques. Le dficit budgtaire a ainsi atteint prs de 6 % en
2011 et 7 % environ en 2012. Le ratio de la dette publique au Pib a aussi atteint
plus de 54 % en 2011 et sest mis sur une tendance haussire.
Par ailleurs, lamlioration des quilibres macroconomiques des
annes 1990 et davant lvnement de la crise de 2008, ne sest pas toujours
accompagne dune croissance conomique au rythme escompt. En effet,
malgr les mesures incitatives prises pour encourager les investissements,
les deux dernires dcennies ont mme t marques par des tendances non
89
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
monotones de lactivit conomique. Le taux de croissance annuel moyen du
Pib a t de quelques 3,8 % au cours de la dcennie 1980, de 2,6 % seulement
pour la priode 1991-1999, de 3,6 % entre 2000 et 2004. En 2010, le taux
de croissance na t que de 3,6 % pour passer 5 % en 2011. En 2012 le taux
de croissance a t en net ralentissement.
Ce rythme de croissance, globalement modeste, sest donc avr insuffisant pour rpondre aux besoins sociaux en accroissement continu et laugmentation de la population active gnratrice dune offre demploi sur le
march du travail. Les dficits sociaux nont t que partiellement absorbs
mais restent des niveaux levs. Depuis le milieu des annes 1980, il sest
avr que ltat est pratiquement incapable de faire face seul la demande
sociale. Cette situation a videmment cr un champ fertile pour le dveloppement de lconomie sociale sur tous les plans.
Enseignement et alphabtisation
bien que des amliorations notables aient t enregistres ces trente
dernires annes en matire de scolarisation et de lutte contre lanalphabtisme, des dficits persistent dans ces domaines. La scolarisation, la formation, lalphabtisation et laccs au savoir sous toutes ses formes et de faon
gnrale, sont loin dtre la porte de toutes les tranches de la population.
En effet, si le taux de scolarisation des garons et des filles gs de 6 11ans
dpasse aujourdhui les 93%, force est de constater que des disparits persistent entre les deux sexes, entre les rgions et entre les localits. Lanalphabtisme touche encore plus de 35% de la population ge de 10 ans et
plus. Selon le recensement gnral de la population et de lhabitat ralis en
2004, ce taux tait de 29 % en milieu urbain et de 60 % en milieu rural. Les
femmes sont plus touches par ce phnomne que les hommes.
Pauvret et prcarit
bien que lincidence de la pauvret ait enregistr un recul considrable
ces deux dernires dcennies, une frange non ngligeable de la population
reste dans une situation de grande prcarit. Les dernires informations disponibles font tat denviron 4 millions de personnes qui vivent en dessous du
seuil de la pauvret. Ce phnomne touche ingalement les diffrentes rgions
du pays. En 2007, le taux de pauvret varie de 2,8 % dans la rgion dOued
Eddahab Lagouira 20,5 % dans la rgion du Gharb Chrarda Beni Hssen. Le
phnomne est nettement plus inquitant en milieu rural o prs de quinze
personnes sur cent sont pauvres. Pour le milieu urbain, les chiffres officiels
montrent que cinq personnes sur cent sont pauvres en termes montaires.
Emploi et chmage
lanalyse du march de lemploi permet de constater que celui-ci souffre
de distorsions entre loffre et la demande de la main-duvre. Le chmage,
particulirement prononc chez les jeunes diplms, se maintient un
niveau lev. Les statistiques en la matire font tat dun taux de lordre de
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
90
maroc
9 % en 2012. Il est de 13,4 % en milieu urbain, de 33,5 % chez les jeunes actifs
gs de 15 24 ans et de plus de 25 % chez les diplms ayant un niveau
denseignement suprieur. Le taux de chmage de la population urbaine
fminine a t de plus de 20 %.
Ce taux de chmage lev, surtout en milieu urbain, serait la consquence
de plusieurs facteurs. Il sagit dabord des changements dmographiques
intervenus depuis les annes 1970. Ceux-ci ont entran une forte hausse de
leffectif de la classe dges 15-59 ans qui reprsente aujourdhui prs des deux
tiers de la population totale. Cette pousse dmographique sest mcaniquement traduite par une forte pression sur le march de lemploi. Lexode rural,
d entre autres la succession des annes de scheresse et lattrait de la ville,
vu le dveloppement limit du milieu rural, nest pas tranger ces taux de
chmage levs en milieu urbain. Le systme ducatif et ses problmes ainsi
que la pression des effectifs des sortants sur le march de lemploi en plus des
distorsions dues linadquation de certaines filires de formation avec les
besoins de lconomie nationale, accentuent ce phnomne.
Par ailleurs, le cadre institutionnel et rglementaire qui rgit le march
du travail au Maroc, ainsi que les cadres macroconomique et incitatif qui
animent la politique conomique gnrale du pays contribuent maintenir
ce taux de chmage des niveaux relativement levs.
Dfinition et composantes de lconomie sociale au Maroc
32. La touiza est une
organisation coutu
mire que simposent
les membres dune
communaut pour
sentraider pour la
moisson, la cueillette
des olives, des dattes,
etc. Elle se cre par
ncessit et sestompe
une fois le problme
rsolu, pour reprendre
si ncessaire. On en
distingue deux sortes:
la touiza dintrt
collectif, dcide par
la jma en fonction
des travaux dintrt
commun toute
la collectivit (ex.:
construction et entre
tien des mosques),
et la touiza dintrt
individuel, quand
une personne ou une
famille demande laide
de la communaut
pour un travail (ex.:
la couverture dune
maison) la simple
condition de les
nourrir.
dans cette section, nous passons en revue de faon brve les dfinitions
usuelles du concept de lconomie sociale. Nous mettons laccent par la suite
sur la dfinition retenue pour celui-ci dans le cas du Maroc. Nous y identifions
aussi les principales composantes du secteur ainsi que les conditions ayant
favoris son mergence pendant les dernires annes.
propos de la forme historique de lconomie sociale au Maroc
il peut tre utile de rappeler quhistoriquement, lconomie sociale a toujours exist, sous une forme ou une autre, au Maroc. En effet, les initiatives
qui respectent les principes gnraux de lconomie sociale ne datent pas
daujourdhui. Les cultures de solidarit, dentraide et de travail collectif ont
toujours fait partie des traditions et des pratiques de la socit. Les formes de
solidarit et de travail collectif constituent les piliers des relations entre les
individus de la mme famille et de la mme tribu, entre jeunes et vieux, entre
riches et pauvres, etc. Elles se manifestaient sous forme dentraide entre
voisins, voire dans des groupes plus larges. Des oprations dites la touiza 32
taient courantes en milieu rural. Elles ont t mobilisatrices defforts et de
synergies pour servir les intrts dune personne dans le besoin ou encore
ceux de tout un groupe.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
91
maroc
Une autre manifestation traditionnelle de lconomie sociale se trouvait
dans la gestion des actifs ou biens habous et doprations lies leurs revenus.
La jma33 tait linstitution qui incarnait la volont collective de coopration
et qui assurait la prennit des liens de solidarit dans la communaut. Ses
taches allaient de la gestion, la rpartition, la rgulation des droits aux eaux
dirrigation, aux pturages, aux richesses forestires, etc. Elle intervenait aussi
dans la gestion de lespace et de certains quipements collectifs : mosque,
cimetire, matmora, souk, etc. Elle tait autant une instance darbitrage interne
quune force contre les menaces ou agressions externes. Son fonctionnement
faisait donc rfrence de faon trs avance aux principes de lconomie sociale
dans sa dfinition moderne.
Cette forme de lconomie sociale tout comme le rle de la jma ont
perdu du terrain et se sont dsintgrs, sous leffet de divers facteurs dmographiques, conomiques, sociaux et politiques. Les acquis historiques de
cette forme de gestion ne sont plus valoriss, aux bnfices dautres formes
dinstitutions et dorganisations sociales. Dans ce mouvement, des groupes
de la population qui taient auparavant protgs se retrouvent vulnrables,
pauvres ou exclus puisque les nouveaux mcanismes et les nouvelles institutions ne se sont pas substitus temps aux anciennes structures.
De la dfinition de lconomie sociale
33. La jma est une
forme dorganisation
coutumire qui
a pourobjectif la
gestion des intrts
communs de la
communaut
(constructions de
routes, entretiens
des coles ou des
mosques, etc.)
travers la mobilisation
des gens sous forme
de touiza.
34. Defourny, Jacques
et Develtere, Patrick
(1997), Jalons pour
une clarification
desdbats sur
lconomie sociale .
il convient de reconnatre que malgr tous les crits, ce concept reste
ambigu. Il combine deux termes larges : conomie et sociale. La conceptualisation et la dfinition peuvent donc diffrer selon que lon insiste sur le volet
conomique ou sur le volet social. Cette ambigut suscite depuis toujours
des dbats et des recherches lchelle internationale. Elle a aussi conduit
plusieurs dnominations et dfinitions qui varient dun pays lautre et dun
courant de pense lautre. Ces dfinitions ont au moins un point commun :
lexistence dun troisime secteur aux cts des secteurs public et priv. Cest
ce troisime secteur qui intresse tous les courants en la matire.
Ainsi, et titre dexemple, la deuxime rencontre internationale sur
la globalisation de la solidarit (Qubec, octobre 2001) dfinit lconomie
sociale comme tant un ensemble dinitiatives conomiques finalit sociale qui
participent la construction dune nouvelle faon de vivre et de penser lconomie
travers des dizaines de milliers de projets dans les pays du Nord comme du Sud.
Elle place la personne humaine au centre du dveloppement conomique et social.
La solidarit en conomie repose sur un projet tout la fois conomique, politique
et social, qui entrane une nouvelle manire de faire de la politique et dtablir les
relations humaines sur la base du consensus et de lagir citoyen .
En Belgique, lconomie sociale regroupe les activits conomiques exerces
par des socits, principalement des coopratives, des mutualits et des associations,
dont lthique se caractrise par la finalit de services aux membres ou la collectivit plutt que de profit, lautonomie de gestion, le processus de dcision dmocratique et la primaut des personnes et du travail sur le capital dans la rpartition
des revenus (Conseil wallon de leconomie sociale)34.
En gnral, on entend par conomie sociale (et/ou solidaire), les activits conomiques de production de biens et/ou de services, exerces par des
92
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
groupements de personnes dans le cadre dentits ddies (coopratives,
associations, mutuelles, etc.). Ces dernires se distinguent nettement par
leur finalit sociale. Elle se concentre sur lamlioration des services fournis
leurs membres et aux conditions de vie de toute la communaut.
Au Maroc, le concept moderne de lconomie sociale date de la fin des
annes 1980. Il a t voqu pour la premire fois lors dun colloque organis
par le Dpartement charg du Plan en 1987. Il dsignait des activits conomiques dont le but est de rpondre aux besoins sociaux de la collectivit. Ces
activits sexercent dans trois types dorganisations qui sont les coopratives,
les associations et les mutuelles. La stratgie nationale de lconomie sociale
et solidaire (2010-2020) prcise en page 28 que lconomie sociale et solidaire
est lensemble des initiatives conomiques cherchant produire des biens ou des
services, consommer et pargner autrement, de manire plus respectueuse de
lHomme, de lenvironnement et des territoires .
La stratgie caractrise donc lconomie sociale par la finalit des services rendus aux membres et la collectivit. Elle se base sur des principes
de solidarit et de responsabilit et par un contrle dmocratique par les
membres selon le principe une personne gale une voix, et non pas une action
gale une voix de lconomie prive. Au niveau des activits, lconomie sociale
se caractrise par son dynamisme territorial et la mobilisation des citoyens
au niveau local. Elle participe ainsi la production de biens et services ce
mme niveau en contribuant la cration demplois et de la valeur ajoute.
De ce fait elle amliore le niveau de vie des mnages et attnue la pauvret.
Au niveau organisationnel, lconomie sociale sexerce au Maroc dans le
cadre de coopratives, dassociations, de mutuelles et de fondations. Toutes ces
organisations respecteraient les valeurs de base de lconomie sociale en mettant laccent sur linsertion des individus dans lactivit conomique. Plusieurs
secteurs sont couverts par ces organisations : lagriculture, lartisanat, le logement, le tourisme, lexploitation forestire, les services financiers, la sant et les
services sociaux, lintgration lemploi, lducation, les activits culturelles
Si lexercice des activits conomiques, dans le cadre de ces organisations, a pour objectif laide la satisfaction des besoins sociaux urgents et la
raction aux situations sociales critiques non combles ni par ltat ni par le
secteur priv, il reflte galement, dune part, la qute et la mise en place de
nouvelles relations avec ces deux secteurs et, dautre part, la tendance vers
lancrage dune approche participative et de proximit en matire de dveloppement socio-conomique du bas vers le haut.
Par ailleurs, lconomie sociale au Maroc, particulirement dans sa composante cooprative, sintresse aux petits producteurs et aux petits mtiers
qui sappuient nettement sur lauto emploi et qui constituent la plus grande
partie du tissu conomique national. En se situant ce niveau de la pyramide
conomique et sociale, lconomie sociale pourrait tre un champ privilgi
pour lapplication effective dun dveloppement conomique et social intgr.
Il convient de noter toutefois que la notion de lconomie sociale est, malgr tout, mal dfinie, donc mal connue au Maroc. Si lon exclut les acteurs directs
du secteur, celui-ci demeure manifestement mconnu chez une grande partie
de la population, voire chez plusieurs dcideurs et responsables de ladministration. Un effort soutenu doit tre men en matire de communication.
93
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
Composantes de lconomie sociale
lconomie sociale dans sa forme actuelle, contemporaine, structure,
organise et institutionnalise est donc rcente au Maroc. Elle a merg,
dabord spontanment puis avec lincitation de ltat, pour contribuer faire
face certaines consquences ngatives, prcisment sur le volet social, de
politiques menes pendant les annes 1980 et 1990. Ces difficults sont lies
laccs des populations aux services sociaux de base, la recrudescence de
la pauvret et de la vulnrabilit, aux problmes du chmage, notamment
des jeunes diplms.
Sur le plan organisationnel, et linstar de plusieurs pays travers le
monde, lconomie sociale au Maroc est constitue de trois composantes
principales: les coopratives, les associations et les mutuelles. Les structures
traditionnelles de lconomie sociale ne sont pas formellement incluses dans
ces organisations. Cette dfinition ne couvre pas non plus les producteurs
individuels mme sils sont en situation conomique prcaire.
Les coopratives
la loi 24/83 fixant le statut gnral des coopratives au Maroc, dfinit la
cooprative comme tant un groupement de personnes physiques, qui conviennent de se runir pour crer une entreprise charge de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin. Des personnes morales
remplissant certaines conditions peuvent devenir membres dune cooprative .
Une cooprative est gre par les cooprants en appliquant les principes
fondamentaux de la coopration suivants :
toute personne, sans distinction, peut adhrer une cooprative sous
la seule rserve de remplir, personnellement, les conditions de fond arrtes
par les constituants de cette dernire en raison de son activit ;
tout cooprateur peut se retirer de la cooprative sous la seule obligation
de ne pas porter prjudice son fonctionnement par un retrait intempestif;
tout cooprateur, quel que soit le nombre de parts quil possde, dispose
de droits gaux et a, en consquence, une voix dans les assembles gnrales
de la cooprative ;
les excdents de recettes de la cooprative sur ses dpenses dexploitation doivent tre rpartis entre les cooprateurs au prorata des oprations
quils ont traites avec elle ou du travail quils lui ont fourni ;
les excdents mis en rserve ne peuvent plus tre distribus aux membres de la cooprative ;
le capital nest pas rmunr en principe. Dans le cas o il le serait,
lintrt sera dun taux limit ;
le membre dune cooprative nest pas seulement un associ apporteur
de capitaux, mais un cooprateur en ce sens que sa participation aux activits
de sa cooprative se manifeste sous forme dapports, de cessions de biens
ou de service ou de travail ;
lentreprise fonde sur une action collective tend la promotion et lducation de ses membres qui se sont unis en raison non pas par leurs apports
respectifs mais par leurs connaissances personnelles et de leur volont de
solidarit ;
94
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
les coopratives ayant le mme objet tablissent, dans la mesure o cela
satisfait leurs intrts, des relations entre elles et avec celles ayant dautres
objets, sur les plans conomique, social et ducatif, tant lchelon national
quinternational et ce, dans le cadre de linter-coopration.
Les coopratives marocaines exercent leurs actions dans toutes les branches de lactivit humaine en cherchant essentiellement :
amliorer la situation socio-conomique de leurs membres ;
promouvoir lesprit coopratif parmi les membres ;
rduire, au bnfice de leurs membres et par leffort commun de ceux-ci,
le prix de revient et, le cas chant, le prix de vente de certains produits ou
de certains services ;
amliorer la qualit marchande des produits fournis leurs membres
ou de ceux produits par ces derniers et livrs aux consommateurs ;
dvelopper et valoriser, au maximum, la production de leurs membres.
Les associations
intervenant en tant quinstitutions de relais ou dintermdiaires entre
ltat et le citoyen, les associations se sont dveloppes au Maroc dans le cadre
du code des liberts publiques. Elles sont rgies par le dahir du 15 novembre
1958 modifi et complt en juillet 2002. Ce texte dfinit lassociation dans son
article premier comme suit: lassociation est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes physiques mettent en commun dune faon permanente leurs
connaissances ou leur activit dans un but autre que de partager des bnfices .
Dans le dveloppement du secteur associatif au Maroc, on distingue
deux priodes durant les cinquante dernires annes. La premire stale de
lindpendance du pays jusquau dbut des annes 1980. Une premire gnration dassociations est alors apparue dans les domaines de la culture, de la
jeunesse, de lanimation, du sport et de la bienfaisance. La deuxime priode
court du dbut des annes 1980 jusqu nos jours. Elle est caractrise par
un dveloppement remarquable du nombre dassociations qui sintressent
au dveloppement, particulirement au niveau local. Plusieurs explications
politiques et conomiques sont avances pour expliquer cette croissance en
nombre et en domaines couverts par les associations. Certaines se basent sur
les consquences plutt mitiges sur le plan social de lapplication du PAS
entre 1983 et le dbut des annes 1990. On avance aussi laugmentation de
la pauvret, de lexclusion sociale, laggravation du chmage, laccentuation
des disparits rgionales, etc.
La logique de ces explications se fonde principalement sur laffirmation que face tous ces dficits, les populations se trouvent plus que jamais
contraintes dvelopper de nouvelles formes de solidarit et dentraide, conomiques et sociales pour tenter dallger ou de rsoudre certains des problmes les plus cruciaux et les plus urgents auxquels elles sont confrontes.
Cest ainsi que les associations, composante importante de lconomie sociale,
ont commenc tre perues comme un acteur incontournable dans le processus du dveloppement conomique, politique et social du pays.
Ainsi, par leurs actions et leurs initiatives, les associations ont pu rpondre plusieurs besoins des populations au niveau le plus fin du territoire.
95
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
Elles ont fait valoir de faon habile et efficace leur capacit jouer convenablement leur rle de partenaire dans le dveloppement participatif. Leurs
activits stendent aujourdhui sur un champ vaste touchant toutes les couches de la population et englobant des domaines trs varis.
En effet, un survol de ces domaines montre que les points dentres dans
le processus dmergence des activits des associations sont axs sur la satisfaction des besoins de base des citoyens. Elles sont ainsi prsentes dans tous
les domaines longtemps rservs ltat, tels que la lutte contre la pauvret,
lalphabtisation, la sant, lhabitat, linfrastructure locale et les quipements
de base, la cration et laccompagnement de projets locaux de dveloppement,
la micro finance, etc.
En menant leur actions aux niveaux, national, rgional et aussi et surtout local ( lchelle du village et du douar), leurs populations cibles sont la
femme en particulier en milieu rural, les jeunes, les enfants, les personnes
ges, les personnes handicapes et toutes les catgories de la population
juges les plus vulnrables ou dans des situations prcaires.
Dans tous ces domaines et pour toutes les catgories cibles, et selon
un avis presque gnral, les associations accomplissent un travail essentiel, reconnu aussi bien par les pouvoirs publics et par les populations ellesmmes que par les organisations internationales actives dans le domaine.
La force des associations rside, nous lavons signal plus haut, dans leur
proximit avec les populations, dans leur parfaite connaissance du terrain,
dans leur mode de fonctionnement souple qui leur permet dintervenir rapidement et de faon efficace et beaucoup moins bureaucratique.
Aujourdhui encore, depuis le lancement de lInitiative de dveloppement humain ( INDH) en mai 2005, les associations se sont fortement
mobilises pour contribuer la russite de celle-ci. Elles ont t places au
centre du processus. En effet, elles interviennent pour identifier les besoins
des populations, porter des activits gnratrices de revenus, participer au
financement, organiser les bnficiaires des projets, participer aux organes
de gouvernance de lInitiative, etc.
Les mutuelles
le dahir n 1-57-187, portant statut de la mutualit au Maroc, dfinit les
mutuelles comme tant des groupements but non lucratif, qui au moyen des
cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans lintrt de ceux-ci ou
de leur famille, une action de prvoyance, de solidarit et dentraide tendant la
couverture des risques pouvant atteindre la personne humaine . Les mutuelles
poursuivent le but dassurer sur une base solidaire laccs aux services et la
protection. Deux principes gnraux sont la base des mutuelles :
La solidarit entre les membres. Ce principe exprime la volont de rgler les
situations individuelles par laction collective. Labsence de discrimination
entre les membres, aussi bien dans les conditions dadhsion que dans la
prise en charge, est la rgle de rfrence. Ainsi, dans le domaine de la sant
par exemple, la solidarit sexprime dans lapplication du principe essentiel de
la mutualisation du risque, qui se rfre toute situation o chaque membre
paye une cotisation indpendamment du risque personnel de tomber malade
96
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
et bnficie des mmes services en cas de maladie. Lobjectif mutualiste tant
damliorer les conditions sociales de ses affilis dans un esprit de prvoyance,
de solidarit et dentraide, les mutuelles refusent par principe toute forme
dexclusion ou de slection de risques, que ce soit selon des critres dge,
dtat de sant, de niveau de revenus ou encore socioprofessionnels.
Le caractre non lucratif. Contrairement aux assureurs commerciaux, les
mutuelles sont des organismes but non lucratif. Elles ne rmunrent pas le
capital en actions et ne paient pas de dividendes au titre des apports faits aux
adhrents sous forme dactions. Tout surplus des recettes sur les dpenses
doit uniquement contribuer la ralisation du but commun. Ce sont les adhrents eux-mmes qui dcident librement de son affectation : augmentation
des rserves pour parer dventuelles hausses du cot du risque, amlioration des services existant ou rponse dautres besoins des membres, voire la
rduction de la cotisation. Labsence de but lucratif, avec les principes de nonexclusion, garantit lengagement durable de la mutualit envers ses membres.
Il garantit aussi une relation stable de long terme avec les membres.
Enjeux et cadre institutionnel de lconomie sociale au Maroc
lconomie sociale, selon ses diffrentes composantes, connat une forte
croissance ces dernires annes au Maroc. Ses structures sont de plus en
plus actives et contribuent au dveloppement conomique et social de notre
pays malgr les difficults tant exognes (problmes dapprovisionnement,
de commercialisation et de financement, cadre juridique) quendognes
( sous-quipement, faiblesses des capacits managriales et techniques,
fragilit financire ) auxquelles elles sont confrontes et qui entravent leur
dveloppement. Ce fait rsulte de plusieurs facteurs dont la volont politique,
assez prononce ces dernires annes, pour le dveloppement de lconomie
sociale et solidaire dans le pays. Cette volont sest renforce, et en partie
concrtise, avec lavnement de lInitiative nationale pour le dveloppement
humain (INDH) qui a comme objectif ultime la lutte contre la pauvret, la
vulnrabilit et la prcarit.
Dans ce sens, plusieurs projets ont t mis en place, particulirement
au niveau local, pour favoriser le renforcement ou lmergence de nouvelles
activits relatives ce secteur en dveloppement. Il a t remarqu quil a un
potentiel de dveloppement qui nest que peu ou pas du tout exploit en termes
de ressources et dans plusieurs secteurs dactivit (agriculture, artisanat, tourisme, pche, services, produits du terroir, infrastructures locales, services de
proximit la population, etc.). Des stratgies et des programmes sectoriels,
avec une dimension nette conomie sociale ont t alors mis en place.
Depuis dix ans, le Maroc a mis en place un ensemble de stratgies
sectorielles. Elles ont t dveloppes puis oprationnalises par diffrents
dpartements ministriels. Il sagit en particulier du Plan Maroc Vert pour
97
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
lagriculture, de la Vision 2015 pour lartisanat, de la Vision 2010 puis de la
Vision 2020 pour le tourisme, du Plan Halieutis 2020 pour le secteur de
la pche, etc. Dans presque toutes ces stratgies sectorielles on retrouve au
moins un axe ddi de faon plus ou moins explicite aux activits de lconomie sociale ( agriculture solidaire, tourisme de niche et tourisme rural, mono
artisans, pche artisanale).
Le cadre institutionnel officiel, mis en place pour grer lconomie sociale
au Maroc, est complexe et surtout peu favorable au dveloppement du secteur. Les intervenants agissent de faon presque indpendantes et sans aucune
coordination. Il sagit du ministre des Affaires (conomiques) gnrales qui
exerce en fait une tutelle sur le secteur. Le dpartement de lconomie sociale a
t plac sous ce ministre pour la premire fois en 2002. Il a t charg de :
raliser des tudes stratgiques sur lconomie sociale au Maroc, en
concertation avec les administrations et les acteurs concerns ;
promouvoir le secteur dans ses diffrentes composantes (associations,
coopratives, mutuelles, etc.) ;
coordonner, suivre et valuer les actions menes par les organes de ltat
en matire dconomie sociale ;
adapter le cadre juridique du secteur aux ralits conomiques et social
du pays ;
collecter et diffuser linformation statistique sur le secteur.
A ct de ce ministre qui devrait jouer un rle de premier plan, dautres
dpartements interviennent chacun selon un axe spcifique. De faon plus
prcise, il sagit du ministre de lconomie et des finances, du ministre de
lIntrieur, du ministre du Dveloppement social, de la solidarit et de la
famille, du ministre de la Justice, du secrtariat gnral du gouvernement.
Par ailleurs, chaque dpartement sectoriel peut intervenir de faon directe
ou indirecte, sur des aspects techniques le concernant et en fonction de sa
mission principale, dans le domaine de lconomie sociale. Il sagit de faon
spcifique des dpartements de lagriculture, de la pche, du tourisme, de lartisanat, de lhabitat, de la sant, de lducation, de la culture, de la jeunesse et
sport, de lenvironnement, de lalphabtisation, du commerce et de lindustrie,
de la famille, de lenfance et des handicaps, de lnergie et des mines, etc.
A ct des ministres, on retrouve des organismes publics dont les prrogatives sont plus ou moins ddies lconomie sociale. Il sagit dabord de
lOffice de dveloppement de la coopration (ODCO) qui a t cr en 1962.
Il est lorgane spcialis qui incombe la gestion des coopratives au Maroc.
Selon la loi, ses missions consistent :
centraliser et instruire les demandes de constitution des coopratives et
de leurs unions ;
inciter la cration des coopratives (campagnes de vulgarisation et de
formation) ;
prter assistance juridique aux coopratives et leurs unions ;
centraliser et diffuser la documentation de linformation relative la
coopration ;
rgler lamiable les diffrends opposant des adhrents des coopratives
(conciliation et gestion des confits).
98
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
Le deuxime organisme est lAgence de dveloppement social (ADS).
Elle a t cre en 1999. Son intervention porte sur la consolidation du capital
humain et social par des actions concernant :
le renforcement des capacits des acteurs locaux ;
la promotion et le dveloppement des activits gnratrices de revenus
et demploi ;
lamlioration des conditions de vie des populations cibles en milieux
urbain et rural.
Il y a enfin des interventions plutt ponctuelles des institutions non
gouvernementales suivantes :
la Fdration nationale des coopratives du Maroc ;
les Unions sectorielles des coopratives ;
la Fdration nationale des associations de micro crdit ;
des Espaces et Fdrations des associations sous formes de rseaux aux
niveaux national et rgional.
Lconomie sociale au Maroc en chiffres
cette partie de ltude est consacre une tentative danalyse en chiffres
du secteur de lconomie sociale au Maroc. Nous nous y limitons une prsentation descriptive des donnes disponibles. En effet ces dernires sont
globalement limites et disparates. Des analyses plus pousses, comme celles qui approcheraient le poids et les impacts du secteur dans lconomie
nationale, et qui constitueraient les principaux inputs dun ventuel compte
satellite du secteur ne sont pas disponibles. Ces mesures sont, selon les responsables du secteur, gourmandes en informations et ncessiteraient des
exploitations appropries denqutes lourdes et coteuses dont certaines ont
t conduites dernirement au Maroc.
Dans cette prsentation, chacune des trois catgories dentreprises de
lconomie sociale est traite part, selon diffrentes dimensions, en tenant
compte de ses spcificits. Laccent est mis sur le tissu coopratif pour lequel
une information plus ou moins fiable et structure est disponible. Les autres
composantes de lconomie sociale, en loccurrence les associations et les
mutuelles sont traites dune manire plus sommaire, faute de donnes.
Le secteur coopratif
le secteur coopratif fait partie du paysage socio-conomique du Maroc
depuis plus 50 ans et reste en progression. Selon lOffice du dveloppement
de la coopration (ODCO), le tissu coopratif marocain compte plus de
7 800coopratives (2010), tous secteurs confondus. Daprs la mme source,
plus de 15 % de ces coopratives sont inactives dans le sens quelles nont exerc
aucune activit au profit de leurs membres pendant au moins deux exercices
successifs (41 % des coopratives hors secteur de lhabitat sont inactives).
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
99
graphique
600
volution rcente
du nombre
de crations
de coopratives
tableau
400
200
0
ODCO 2010
487
303
2005
tableau
547
maroc
610
364
2006
2007
2008
2009
Rpartition des adhrents des
coopratives selon le secteur dactivit
Rpartition du capital des
coopratives selon le secteur dactivit
Agriculture
Habitat
Artisanat
Fort
Autres
Total
Agriculture
Habitat
Artisanat
Autres
Total
Effectifs
280 165
47 258
22 321
7 190
23 210
380 144
Part en %
73,7 %
12,43 %
5,87 %
1,89 %
6,11 %
100 %
Montant en Dhs
4 570 633 381
1 496 396 336
115 239 958
44 445 745
6 226 715 420
Part en %
73,40 %
24,03 %
1,85 %
0,72 %
100 %
ODCO 2010
ODCO 2010
Le secteur coopratif a enregistr une nette progression depuis le lancement de lINDH. En effet leffectif des coopratives, de 4 827 en 2004, 5 276
en 2006, 6 386 en 2008, a atteint 7804 en 2010. Le nombre de crations
a en effet plus que doubl entre 2004 et 2010. Le nombre de cration des
coopratives est pass de 328 en 2004 909 en 2010. Aujourdhui le secteur
encadrerait environ 3% de la population active ou encore quelque 1,2 % de la
population totale. Il contribuerait ainsi 1 % de lemploi salari en gnrant
un chiffre daffaire de quelques 12 milliards de dirhams. graphique 1, tableau 2,
tableau 3
Dans cette section, nous prsentons en premier lieu un panorama global
du tissu coopratif marocain (sa rpartition spatiale, par secteur dactivit et
par filire et selon la catgorie dadhrents). En second lieu, nous analysons
les indicateurs conomiques disponibles sur le secteur en mettant laccent
sur la situation patrimoniale des coopratives et leurs performances dexploitation. Nous commenons ce survol du secteur coopratif marocain en
dcrivant la rpartition des coopratives actives selon le secteur dactivit.
35. Toutes les
statistiques relatives
aux coopratives
sont issues du site de
lODCO : http://www.
odco.gov.ma/rubrique.
php?rub=3 et de
lAnnuaire Statistique
des Coopratives au
Maroc 2010.
Rpartition des coopratives actives selon le secteur dactivit
le tissu coopratif marocain est constitu de plusieurs familles de structures coopratives35. Lanalyse de ce secteur rvle que la quasi-totalit (90 %)
des coopratives est concentre dans trois secteurs dactivit : lagriculture,
lhabitat et lartisanat. Ces trois secteurs regroupent 74 % des adhrents. Ce
sont les secteurs traditionnels de la coopration dans son sens de base.
Lorsque les coopratives dhabitation, qui nexercent presque aucune
activit conomique proprement dite, sont mises de ct, il ressort que les
coopratives agricoles reprsentent les trois quarts du tissu coopratif national. Elles sont suivies, mais de loin, des coopratives artisanales avec 12 %.
Le reste se trouve rparti entre les activits lies la fort (4 %), la pche
artisanale (2 %), le transport (2 %) et autres. tableau 4
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
100
tableau
tableau
maroc
Rpartition du capital des coopratives
selon le secteur dactivit
Rpartition des coopratives agricoles
selon les filires
Agriculture
Habitat
Artisanat
Autres
Total
Collecte et Com. du lait
Elevage
Apiculture
Approvisionnement
Autres
Total
ODCO 2010
Effectif
4 964
1 023
964
801
7 752
Part en %
64,04 %
13,20 %
12,44 %
10,33 %
100 %
Effectif
1 517
1 339
763
440
944
5 003
Part en %
30 %
27 %
15 %
9%
19 %
100 %
ODCO 2010
Les coopratives agricoles. Selon les dernires statistiques publies, on
recense plus 5 000 coopratives agricoles qui se rpartissent en 37branches
dactivit. Le secteur agricole saccapare donc lui seul presque deux tiers
de leffectif total des coopratives. Les coopratives agricoles fonctionnent
sur le mode dassociation dagriculteurs indpendants. Ces derniers livrent
leur production de biens la cooprative. Celle-ci est en principe charge den
optimiser sa commercialisation en ltat ou encore sa transformation et son
conditionnement. Les rsultats et les recettes sont rpartis entre les adhrents
selon des rgles prcises. Le mouvement compte galement des unions de
coopratives, des coopratives dapprovisionnement, de pompage deau, de
transport de produits agroalimentaires et des coopratives dutilisation de
matriel agricole.
Les coopratives regrouperaient plus de 280 000 agriculteurs. Elles totalisent un capital de 1,5 milliard de dirhams et emploient plus de 7 000 personnes
dont la moiti environ comme des emplois permanents. Parmi les coopratives
enregistres et recenses, les deux tiers environ sont actives et ont un fonctionnement statutaire plus ou moins rgulier.
Les coopratives agricoles se caractrisent par une forte concentration.
En effet, parmi les coopratives actives, plus des deux tiers oprent dans
quatre principales filires. Il sagit, selon la nomenclature de lODCO, de
la collecte et de la commercialisation du lait, avec 30,32 %, de llevage avec
26,76 %, de lapiculture avec 15,25 % et de lapprovisionnement avec 8,79 %.
Le reste est rparti entre les 33 autres filires. tableau 5
Les coopratives artisanales. Elles reprsenteraient un peu plus de 12 % de
leffectif total des coopratives (968) et 6 % du nombre dadhrents. Elles
regrouperaient ainsi un peu plus de 22 300 artisans pour 35 mtiers. Le capital global de ces coopratives en 2010 a t de plus de 115 millions de dirhams.
Elles fonctionnent pratiquement sur le mme principe que les coopratives
agricoles. Les membres adhrents sont des producteurs indpendants. Ils
sassocient principalement pour commercialiser leur production.
Les coopratives artisanales sont relativement plus diversifies que
celles du secteur agricole. En effet, la premire filire artisanale, en termes
de nombre de coopratives, savoir la filire textile et tapis, reprsente
moins de 14 % de lensemble des coopratives artisanales. Elle est suivie des
filires couture et broderie (9 %), du btiment (8 %), bois et menuiserie
( 8 % ) et des tailleurs et confection ( 7 %). tableaux 6 et 7
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
101
tableau
maroc
6 Rpartition des coopratives artisanales selon les filires
Textiles, tapis
14 %
Poterie et cramique
Couture, broderie
9 %
Forgerons et ferroniers
Batiment, gros uvre
8 %
Mozaque, zelligeurs
Bois, menuiserie
8 % Btiments, peinture et vitre
Tailleurs, confection
7 %
Marqueterie, sculpture sur pltre
Batiments, installation-lectrique
6 % Textiles, tisserands
Commercialisation produits artisanaux
5 %
Autres
Total
5%
4%
3%
3%
3%
3%
22 %
100 %
ODCO 2010
tableau
7 Rpartition des adhrents des coopratives artisanales selon les filires
Textile et tapis
Couture et Broderie
Btiments
Tailleurs-Confection
Menuiserie
Commercialisation des produits artisanaux
Autres
Total
Effectif
4 523
2 526
2 094
2 022
1 493
1 358
8 305
22 321
Part en %
20,26 %
11,32
9,38
9,06
6,69
6,08
37,21
100 %
ODCO 2010
Les coopratives dhabitat. Elles reprsentent environ 13 % de leffectif total
des coopratives et regroupent 13 % des adhrents. Elles se constituent de
manire plutt temporaire pour la construction de logements, en tant que
rsidence principale, pour le compte de leurs membres. Elles se chargent
des oprations administratives et financires, de lachat et de lamnagement
du terrain puis de la construction. Aprs la ralisation du projet elle peut
se transformer en coproprit. Cependant, en termes de capital mobilis,
les coopratives de lhabitat sont les plus capitalistiques. En effet, mme en
ntant que 13%, elles saccaparent 73,4 % du capital global des coopratives
dnombres. Les statistiques actuelles comptent un peu moins de 900 coopratives dhabitat regroupant plus de 41 000 propritaires.
Les autres coopratives. Mis part les trois secteurs traditionnels de la coop
ration, les autres domaines dactivits sont trs peu reprsents. Des coopratives organises sous le mode dindpendants associs se retrouvent en
petit nombre dans les secteurs tels que la fort, la pche, la transformation,
le transport, le commerce Elles reprsenteraient moins de 10 %. Il ressort
en particulier une trs faible prsence des coopratives dans le secteur des
services. Ainsi, et malgr le potentiel du pays en la matire, on dnombre
moins de 90 coopratives dans le secteur de la pche artisanale. Dans le secteur du transport, on en dnombre 54. Les diffrents types de services que les
coopratives peuvent investir et couvrir (artisanat de service, services la personne, services aux entreprises ) sont trop peu inexploits. Elles ne sont exerces que de manire informelle alors quelles constitueraient sans nul doute
un vivier important pour le dveloppement de lconomie sociale et solidaire
dans le futur au Maroc.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
102
tableau
maroc
8 Rpartition des coopratives selon la rgion conomique
Effectif
Part en %
Effectif
Souss-Massa-Dara
877
11,31 %
Gharb-Chrarda-Beni Hssen
440
Tanger-Ttouan
776
10,01 %
Guelmim-Es-Smara
439
Doukkala-Abda
722
9,31 %
Taza-Al Hoceima-Taounate
403
La rgion de loriental
690
8,90 %
Tadla-Azilal
362
Mkns-Tafilalet
589
7,60 %
Fs-Boulmane
334
Marrakech-Tansift-Al Haouz
573
7,39 %
Le Grand Casablanca
219
Rabat-Sal-Zemmour-Zar
564
7,28 %
Layaune Boujdour-Sakia Al Hamra 180
Chaouia-Ouardigha
497
6,41 %
Oued Eddahab-Lagouira
87
Total
7 752
Part en %
5,68 %
5,66 %
5,20 %
4,67 %
4,31 %
2,83 %
2,32 %
1,20 %
100 %
ODCO 2010
tableau
9 Rpartition des adhrents des coopratives selon la rgion conomique
Effectif
Part en %
Effectif
Marrakech-Tansift-Al Haouz
54 186
14,25 %
Gharb-Chrarda-Beni Hssen
19 475
Souss-Massa-Dara
43 316
11,39 %
Rabat-Sal-Zemmour-Zar
18 608
La rgion de lOriental
41 340
10,87 %
Le Grand Casablanca
12 365
Doukkala-Abda
40 767
10,72 %
Taza-Al Hoceima-Taounate
10 585
Tadla-Azilal
36 164
9,51 %
Fs-Boulmane
9 729
Chaouia-Ouardigha
30 851
8,12 %
Guelmim-Es-Smara
5 906
Tanger-Ttouan
28 034
7,37 %
Layaune Boujdour-Sakia AlHamra 2 719
Mkns-Tafilalet
25 092
6,60 %
Oued Eddahab-Lagouira
1 007
Total
380 144
Part en %
5,12 %
4,89 %
3,25 %
2,78 %
2,56 %
1,55 %
0,72 %
0,26 %
100 %
ODCO 2010
Rpartition des coopratives actives selon la rgion conomique
le tissu coopratif marocain tant domin par les coopratives agricoles,
sa rpartition sur le territoire national se trouve tre en faveur des rgions
vocation plutt agricole. De ce fait il est relativement dispers sur le territoire national. En effet, 40 % environ des coopratives actives se trouvent
dans quatre rgions : Souss-Massa-Dra (11,31 %), Tanger-Ttouan (10,01 %),
Doukkala-Abda (9,31 %) et lOriental (8,90 %). Elles sont suivies des trois
autres rgions qui ont chacune plus de 7 % de coopratives (Mekns-Tafilalet, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Rabat-Sal-Zemmour-Zar). Les autres
rgions ont chacune moins de 7 % des coopratives.
En termes dadhrents, la rgion de Marrakech-Tensift-Al Haouz est en
premire position avec plus de 14,25 % de lensemble des membres. tableaux 8
et 9
Les femmes dans les coopratives marocaines
les femmes marocaines participent significativement au mouvement
coopratif. Ainsi, les coopratives composes exclusivement de femmes
reprsentent 12,6 % du total des coopratives en 2010. Elles regroupent plus
de 22 400 adhrentes et sont particulirement centres sur les secteurs de
lagriculture ( 37,29 %) et de lartisanat (35,36 %). tableaux 10 et 11
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
103
tableau
10
tableau
maroc
11 Rpartition des adhrents
Rpartition des coopratives de
femmes selon le secteur dactivit
des coopratives de femmes selon
lesecteur dactivit
Agriculture
Artisanat
Argane
Autres
Total
Agriculture
Artisanat
Argane
Autres
Total
Part en %
40 %
35 %
18 %
6%
100 %
ODCO 2010
Effectif
8 363
7 930
4 952
1 184
22 429
Part en %
37,29 %
35,36 %
22,08 %
5,27 %
100 %
ODCO 2010
tableau
12 Chiffre daffaires total des coopratives
selon le secteur dactivit
Montant en Dhs
Agriculture
7 510 708 640
Artisanat
155 701 156
Commerce de dtail
110 001 401
Fort
26 514 192
Transport
18 658 863
Argane
10 821 376
Autres
9 786 412
Total
22 429
Part en %
95,77 %
1,99 %
1,40 %
0,34 %
0,24 %
0,14 %
0,12 %
100 %
ODCO 2010
Performances dexploitation des coopratives
lun des indicateurs conomiques qui permettent de dcrire le niveau
de performance du secteur coopratif national est le chiffre daffaires des
coopratives actives. Dans cette sous-section, nous prsentons les donnes
disponibles sur cet indicateur.
Chiffre daffaires. Sur les 7 800 coopratives actives (de 2010), seules 1 163
ont dclar leur chiffre daffaires pour lexercice 2008, les coopratives dhabitat ne sont pas concernes. Prises ensembles, ces coopratives cumulent
un chiffre daffaires annuel global de lordre de 7,8 milliards dirhams, soit
une moyenne de 6,7 millions de dirhams par cooprative.
Selon le secteur dactivit, les coopratives agricoles, qui reprsentent
un peu plus de 64 % des coopratives dclarantes, contribuent hauteur
de 95,77 %. Les coopratives artisanales dclarantes ralisent peine 2 %
du chiffre daffaires total. Ces rsultats sexpliquent en partie par le fait que
la cooprative artisanale est en gnral de petite taille comparativement la
cooprative agricole.
Sur les 1 163 coopratives qui ont rpondu, celles qui exercent dans le
secteur du commerce de dtail gnrent gnralement le chiffre daffaires
moyen le plus lev. Celles du secteur agricole se placent en deuxime position ce titre. tableau 12
Rsultat dexploitation. En se basant sur les dclarations de 824 coopratives
qui ont rpondu en 2002 (nous navons pas pu avoir linformation pour 2008
dans lannuaire de 2010), quatre coopratives sur cinq sont excdentaires en
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
104
tableau
13
tableau
maroc
14
Rpartition des coopratives selon
lesecteur dactivit et la nature
dursultat dexploitation en 2002
Excdent annuel
des coopratives selon
le secteur dactivit
Nombre de coopratives dclarantes
Excdentaires Dficitaires Total
Agriculture
486
120
606
Alphabtisation
2
2
4
Artisanat
122
44
166
Commerants-dtaillants
7
2
9
Consommation
2
2
4
Exploitation des carrires
0
1
1
Fort
21
3
24
Pche
4
1
5
Transport
2
3
5
Total
646
178
824
Montant en Dhs
Agriculture
87 299 951
Artisanat
6 876 438
Transport
4 383 804
Argane
2 136 221
Fort
2 113 396
Autres secteurs
1 405 594
Total
104 215 405
Part en %
83,77 %
6,60 %
4,21 %
2,05 %
2,03 %
1,35 %
100 %
ODCO 2010
ODCO 2002
2002. Exception faite des secteurs de lalphabtisation, de la consommation
et des transports, pour lesquelles ce taux ne dpasse pas 50 %, tous les secteurs enregistrent des taux de rentabilit satisfaisants (en termes de nombre)
allant de 73 % pour lartisanat 88 % pour la fort. tableau 13
Dans le mme ordre dides, il convient de signaler que les 646 coop
ratives excdentaires en 2002 ont gnr un excdent global de lordre de
130,6millions dirhams, soit un excdent moyen denviron 202 000 dirhams
par cooprative.
En 2008, les 1 163 coopratives qui ont rpondu totaliseraient un excdent global de plus de 104 millions de dirhams. Ce chiffre global dissimule
videmment des disparits sectorielles importantes. Les coopratives agricoles viennent largement en tte avec un excdent global de plus de 87 millions
de dirhams, soit 83,77 % de lexcdent total enregistr sans que lon puisse
dduire lexcdent moyen par cooprative ce niveau partir des donnes
dj traites.
Les coopratives dartisans se placent en seconde position avec 6,6 %
de lexcdent global (6,87 millions dirhams). Les coopratives du secteur du
transport dgagent un excdent global de 4,38 millions de dirhams, ce qui
reprsente 4,21 % du total dclar. tableau 14
En 2002, anne pour laquelle on a ce type dinformation, les 178 coopratives dficitaires ont gnr un dficit global de lordre de 23,9 millions
dirhams, soit un dficit moyen denviron 134000 dirhams par cooprative
dficitaire. Les coopratives artisanales ont affich le dficit moyen le plus
lev atteignant 242 600 dirhams. Les coopratives du secteur agricole enregistrent un dficit moins significatif de lordre de 102300 dirhams. tableau 15
Lemploi dans le secteur coopratif
une dimension importante de lconomie sociale en gnral et du secteur
coopratif en particulier est sa contribution dans la cration des emplois.
Dans cette sous-section nous nous arrtons sur cet aspect dans la limite des
donnes disponibles.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
105
tableau
15 Dficit des coopratives
tableau
selonlesecteur dactivit en 2002
Coopratives
dclarantes
Agriculture
4120
Alphabtisation
2
Artisanat
44
Commerants-dtaillants
2
Consommation
2
Exploitation des carrires
1
Fort
3
Pche
1
Transport
3
Total
178
Dficit
Global Moyen
12 280 002 102 333
98 821 49 411
10 675 434 242 624
183 634 91 817
133 425 66 713
58 899 58 899
179 968 59 989
153 196 153 196
93 787 31 262
23 857 166 134 029
maroc
17
Excdent annuel
des coopratives selon
le secteur dactivit
Agriculture
Artisanat
Fort
Autres secteurs
Total
Effectif
464 223 736
18 150 248
8 002 514
5 340 614
495 717 113
Part en %
93,65 %
3,66 %
1,61 %
1,08 %
100 %
ODCO 2010
ODCO 2002
tableau
16 Rpartition de lemploi dans les coopratives selon le secteur dactivit
Salaris permanents
Effectif Part en %
Agriculture
9 038
52,78
Artisanat
5 219
30,48
Fort
1 091
6,37
Argane
618
3,61
Pche
310
1,81
Commerce de dtail
234
1,37
Transport
151
0,88
Plante mdicinales et aromat.
119
0,69
Consommation
115
0,67
Denres alimentaire
92
0,54
Alphabtisation
77
0,45
Autres secteurs
61
0,36
Total
17 125
100,00
Salaris occasionnels
Effectif Part en %
5 982
78,77
864
11,38
418
5,50
197
2,59
69
0,91
64
0,84
7 594
100,00
Total
Effectif Part en %
15 020
60,76
6 083
30,22
1 509
6,10
618
2,50
507
2,05
303
1,23
151
0,61
183
0,74
115
0,47
92
0,37
77
0,31
61
0,25
24 719
100,00
ODCO 2010
36. Voir le document
de la Stratgie natio
nale de lconomie
sociale et solidaire
2010-2020, page 45.
Lemploi total par secteur dactivit. Au titre de lexercice 2008, les 1 163
coopratives ayant dclar leurs statistiques en matire demploi ont assur
dans lensemble, environ 24 719 postes demplois, toutes catgories confondues ( permanents, temporaires, occasionnels, adhrents travailleurs et salaris ). On dduit donc une moyenne de 21 salaris par cooprative. De cet
effectif, 17 125, soit plus des deux tiers, avaient un statut de permanent.
Trois secteurs se trouvent lorigine de la quasi-totalit (97 %) de ces
emplois. Il sagit principalement de lagriculture (60,76 %), de lartisanat
( 30,48 % ) et de la fort avec (6,10 %). Il convient de noter toutefois que les
emplois gnrs par les coopratives agricoles sont en grande partie (40 %)
temporaires, tandis que ceux crs par les organismes coopratifs oprant
dans les secteurs de lartisanat et de la fort sont en majorit (85,79 % et
72,30 % respectivement) permanents. tableaux 16 et 17
En liaison avec lemploi dans ce secteur, au titre de lanne 2009, prs
de 15 % des coopratives actives hors habitat sont affilies la CNSS. Il y a
donc clairement un accs limit la couverture sociale36. Globalement prs
106
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
tableau
maroc
18 Rpartition des associations
selon le domaine dactivit
Action conomique, emploi et logement
Culture, sports et loisirs
Action soaciale et activits rattaches
Education et recherche
Unions patronales et professionnelles
Environnement
Autres
Total
Part en %
22 %
22 %
21 %
12 %
4%
2%
18 %
100 %
Ministre des Affaires conomiques et gnrales (MAEG)
et ministre de lIntrieur (MI).
de 50 % des salaris employs par le secteur coopratif sont assurs. Ce sont
les coopratives agricoles qui couvrent le plus dassurs avec plus de 46%
de ces derniers. Par ailleurs il ny aucun systme de couverture sociale pour
les adhrents des coopratives.
Le secteur associatif
comme nous lavons prcis ci-dessus, au fil des annes, les associations
deviennent de plus en plus un acteur incontournable dans le dveloppement conomique et social du Maroc. Leur rle sest encore renforc avec le
lancement de lINDH qui sollicite explicitement leur intervention tous les
niveaux : de la proposition des projets la participation dans les organes de
gouvernance, en passant par lorganisation des bnficiaires, la contribution
au financement, la concrtisation et laccompagnement des projets, etc.
Nanmoins, en labsence de statistiques fiables sur le secteur, la dimension du tissu associatif, sa structure et encore moins la valeur relle de sa
contribution lconomie nationale, restent inconnues. notre connaissance, il nexiste nos jours au Maroc aucune tude srieuse traitant le secteur associatif dans son ensemble. Il nexiste donc pas de statistiques officielles exhaustives sur le secteur associatif qui permettraient de le dcrire
puis de lanalyser de faon convenable. Les initiatives en la matire, menes
par certains organismes nationaux et internationaux ou encore par des chercheurs, se sont focalises sur des domaines dactivits particuliers ou encore
sur des rgions ou sur des localits bien dtermines.
Les statistiques les plus rcentes, reprises dans Stratgie nationale de
lconomie sociale et solidaire 2010-2020, montrent que le tissu associatif
marocain est anim par pas moins de 50 000 associations. Ces dernires
couvrent des branches trs diversifies. Une partie des activits pourrait certainement tre comptabilise comme appartenant lconomie sociale. Il
sagit particulirement des actions caractre conomique et social comme
ce qui est dveloppement local (22 % des associations), le social pur (21 %)
ou encore le culturel rcratif (22 %). tableau 18
Si lon se base sur dautres estimations fragmentaires, il ressort que le
nombre total dassociations serait denviron 40 000 en lan 2000 (au lieu
de 50 000 avanc ci-dessus en lan 2010 environ). Elles couvriraient, daprs
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
107
tableau
maroc
19 Rpartition des associations de
lchantillon selon le type dactivit (1998-1999)
Associations ducatives
Associations de bienfaisance
Associations culturelles
Associations artistiques
Associations de thtre
Associations politiques
Associations scientifiques
Associations sportives
37. Annuaires
des associations
marocaines de
dveloppement,
AMAPPE, Editions
OKAD, octobre 2000.
38. Salama Sadi,
Stefan Toepler et
Lester Salamon,
Le secteur but non
lucratif au Maroc,
Universit John
Hopkins, Edition
Imprial, Rabat,
Dcembre 2003.
39. Etude sur le
bnvolat et le
volontariat au Maroc,
PNUD 2005.
40 Le travail
associatif au
Maroc : lments de
stratgies , les actes
des tables rondes
organises par
lEspace Associatif,
Rabat - Casablanca
1998-1999.
Nombre
18
12
12
5
4
1
1
10
une tude ralise par lAssociation marocaine pour lappui et la promotion
de la petite entreprise (AMAPPE) 37, lensemble du territoire national. Elles
mneraient leurs actions dans tous les domaines du dveloppement : infrastructure de base, lectrification, alimentation en eau potable, protection de
lenvironnement, alphabtisation, ducation, sant, promotion de la petite
entreprise, micro crdit, lutte contre la corruption, etc.
Par ailleurs, dans le cadre dun projet de comparaisons internationales sur
le secteur but non lucratif 38, lUniversit amricaine Johns-Hopkins a men
une premire tentative en vue destimer lapport du secteur des Institutions
sans but lucratif (ISBL), compos en grande partie des associations qui constituent lune des composantes principales du secteur de lconomie sociale. Selon
cette tude, au Maroc, le secteur sans but lucratif emploie un peu moins de
160 000 personnes quivalentes temps plein, ce qui reprsente prs de 1,5 %
de la population active en 2002-2003.
Ltude a rvl galement que la socit civile marocaine doit sa contribution au dveloppement du travail bnvole. La part de lquivalent travail
plein temps des travailleurs volontaires dans lemploi gnr par les organisations but non lucratif est ainsi estime 53 % au Maroc, ce qui est largement
suprieur la moyenne internationale qui nest que de 38 %. Toutefois, cette
manire danalyser la contribution du secteur la cration demplois par le
seul emploi direct cr est rductrice de son apport au dveloppement conomique et social du pays. La contribution relle du secteur associatif rside
aussi et surtout dans ses effets induits, en termes de richesses et demplois
indirects crs, travers les projets quil mne, encadre ou appuie dans tous les
domaines du dveloppement. A titre dexemple, les 12 associations de microcrdits agres au Maroc ont octroy, jusqu 2005, plus de 2 millions de
prts, totalisant ainsi 5,5milliards de dirhams plus de 450000 clients actifs.
Ces chiffres, certainement plus levs aujourdhui, ont gnr un nombre
considrable demplois directs et indirects, beaucoup plus que les quelques
2 000emplois directs permanents engendrs par ces associations 39, emplois
qui auraient leur tour gnr des revenus
Une autre enqute, assez ancienne, sur le secteur associatif a t ralise
pour le compte du ministre de lIntrieur 40. Elle a concern 17 600 associations. Cette enqute permet de dresser une rpartition de celles-ci selon
le type dactivit. tableau 19
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
108
graphique
maroc
Rpartition
desassociations de
largion de SoussMassa-Dra selon
laprovince
graphique
Rpartition
desassociations
delargion de SoussMassa-Dra selon
lesecteur dactivit
Les financements internationaux des ONG puis ceux lis de faon
directe ou indirecte lINDH ont certainement encourag la redynamisation et la cration des associations. Cependant aucune rfrence reconnue
nest aujourdhui disponible pour approcher la partie conomie sociale de
ce secteur comme il se doit. De ce fait, et dfaut de statistiques fiables au
niveau national, nous revenons ci-dessous, dune manire plutt concrte,
sur quelques lments relatifs aux activits des associations, sur les emplois
crs et sur quelques difficults auxquelles elles sont confrontes, tout ceci
sur la base de diverses tudes ralises aux niveaux de quelques rgions.
Quelques expriences rgionales
titre dillustration, trois expriences sont ici traites. Il sagit des rgions
de Souss Massa Daraa, de lOriental et de Marrakech Tensift Al Haouz.
41. Les statistiques
prsentes et
analyses dans cette
section proviennent de
ltude sur lconomie
sociale dans les
rgions du SoussMassa-Dara et de
lOriental, ralise
en 2004-2005 par la
Direction des Etudes,
de la Coopration
et de la Lgislation,
Dpartement de
lArtisanat et de
lEconomie Sociale.
Le tissu associatif de la rgion du Souss Massa Dara 41. Le nombre total dasso
ciations caractre conomique recenses dans la rgion de Souss-Massa-Dra
en 2004 slve 1 727 associations totalisant prs de 200000adhrents. Le
nombre de bnficiaires de leurs activits est estim 940000personnes.
Les trois quarts de ces associations mnent leurs activits particulirement
dans la province de Taroudant (36,8 %) et la prfecture de Chtouka At Baha
( 35,5 % ). Ces associations uvrent dans plusieurs champs dactivit avec
une prpondrance des domaines du dveloppement et de linfrastructure
de base. graphiques 2 et 3
Le nombre total des salaris employs par ces associations est estim
1 100 personnes, soit 0,6 salari en moyenne par association. Quatre associations sur cinq dclarent navoir aucun salari, et seules 7,7 % dclarent
avoir leur charge trois salaris et plus.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
109
tableau
20
graphique
Rpartition des associations
caractre conomique
delargion deSoussMassa-Dra selonlenombre
desalaris
Aucun salari
Un salari
Deux salaris
Trois salaris et plus
Total
tableau
Rpartition desassociations de largion
deSouss-Massa-Dra selon laprovince
80,5 %
8,1 %
3,7 %
7,7 %
100 %
21
graphique
Rpartition des associations
caractre conomique
delargion de lOriental
selon lenombre de salaris
Aucun salari
Un salari
Deux salaris
Trois salaris et plus
Total
maroc
15
Rpartition des associations de la rgion
delOriental selon le secteur dactivit
62 %
10 %
6%
22 %
100 %
Direction des Etudes de la Coopration
et de la Lgislation, 2005
Les activits des associations de cette rgion reposent donc sur le travail
bnvole en particulier. Leffectif global des bnvoles dans les associations
de la rgion slve 28 000 personnes, soit en moyenne six bnvoles par
association. tableau 20
42. Les statistiques
analyses dans cette
section proviennent de
ltude sur lconomie
sociale dans les
rgions du SoussMassa-Dara et de
lOriental, ralise
en 2004-2005 par la
Direction des Etudes,
de la Coopration
et de la Lgislation,
Dpartement de
lartisanat et de
lEconomie Sociale.
Le tissu associatif de la rgion de lOriental42. En 2004, la rgion de lOriental
comptait quelques 521 associations totalisant prs de 211 000 adhrents. Le
nombre de bnficiaires de leurs activits aurait t de lordre de 933 000per
sonnes. Cest un tissu qui couvre lensemble des provinces et prfectures de
la rgion avec une forte concentration dans la province de Taourirte. Celleci dtient elle seule 37 % des associations de la rgion. Viennent ensuite
la prfecture dOujda (20 %) et les provinces de Figuig (20 %) et de Nador
(14 %). Berkane et Jerada arrivent en dernier avec des parts relativement
faibles. graphique 14
Les associations de la rgion uvrent dans plusieurs domaines avec une
dominance des activits relatives au dveloppement qui attirent la moiti des
associations de la rgion. Les associations des artisans viennent en deuxime
position avec 15 %, suivies des associations vocation socio-conomique avec
13 %. Les sports et loisirs, lducation et la formation et lart et culture cumulent
17 % des associations de la rgion. graphique 15
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
110
graphique
16
graphique
Rpartition des associations de largion
de Marrakech-Tansift-El Haouz
selonladimension
maroc
17
Structure des associations selon
le nombre de salaris
Le nombre total des salaris employs par les associations de la rgion
est estim 900 personnes, soit 1,7 salari en moyenne par association. Les
associations de la rgion font galement appel au travail bnvole, mais dans
une moindre mesure en comparaison avec la rgion de Souss Massa Daraa.
En 2004, leffectif global des bnvoles dans les associations de la rgion a
t estim 6 000 (en moyenne 11,5 bnvoles par association contre 16
dans la rgion de Souss Massa Daraa). tableau 21
43. Les statistiques
analyses dans cette
section proviennent
de ltude sur Les
ONGs de la rgion de
Marrakech-Tansift-El
Haouz actives dans le
domaine de la femme ,
ralise en 2002-2003
par le Dpartement
de Prvision
Economique et du
Plan (Direction
Rgionale de
Marrakech-TansiftEl Haouz) avec
lappui du Fonds des
Nations Unies pour la
Population (FNUAP).
Le tissu associatif de la rgion de Marrakech-Tansift-El Haouz43. Il se dgage
dune tude ralise dans la rgion que les associations uvrent elles aussi
dans divers domaines tels que lducation, lalphabtisation, la formation et
lapprentissage, la promotion conomique de la femme travers des microprojets agricoles et de tapis, lentraide sociale au profit de la femme travers, par exemple, laccueil des filles scolarises du milieu rural et laide aux
femmes dmunies, la ralisation de petits projets dinfrastructure, etc. 11 %
de ces associations tendent leurs activits toute la rgion tandis que 84 %
dentre elles se limitent au niveau la province, voire de la commune.
La majorit des associations de la rgion sont de petite taille. Leffectif
moyen des adhrents par association est de 184 personnes. Le nombre moyen
de bnvoles par association serait de lordre de 52 personnes. graphique 16
En matire demploi, 35 % des associations enqutes emploient un
personnel salari permanent. Le nombre moyen demplois assurs par ces
associations est de 3,3 emplois par association, composes pour lessentiel
demploys exerant des professions subalternes. graphique 17
Difficults rencontres par les associations
les tudes ralises dans les trois rgions font ressortir que le tissu associatif est confront plusieurs contraintes. Ce constat peut se gnraliser au
niveau national pour le secteur. Ce dernier prsente en effet des faiblesses qui
limitent son efficacit en tant quagent du dveloppement local. Sur le terrain,
il ressort que ces contraintes limitent largement la porte des actions des
associations, malgr leur dynamisme. Les associations structures, capables
de mener bien des actions viables en stimulant une dynamique locale et
en suscitant un esprit associatif sont peu nombreuses. Il ressort ainsi de
111
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
ces tudes que laccent doit tre mis sur quatre principales difficults dont
souffre de faon nette le tissu associatif marocain :
difficults financires. Face aux besoins sans cesse croissants, les financements des associations sont limits. Ils proviennent de dons et de subventions dorganismes nationaux et internationaux. Certaines associations sont
cres sans objectifs de dveloppement prcis. Elles restent la recherche de
projets en fonction des financements disponibles ou accessibles. Comme ces
derniers sont en gnral faibles et irrguliers, les associations se trouvent
handicapes, ce qui rend leur action difficile voire impossible ;
difficults lies aux ressources humaines, au mode de gestion et au
management. Rares sont les associations qui appliquent des techniques
de planification stratgique ou qui font appel aux services de spcialiste en
matire de gestion ou de comptabilit. Leurs comptences managriales sont
faibles. Elles manquent de professionnalisme par rapport aux taches quelles
affrontent cause dun manque de profils ddis au travail associatif ;
difficults lies aux infrastructures et aux quipements. Les conditions
de travail des associations sont dfavorables, car peu dassociations sont propritaires dun sige et dun local quip pour accomplir leurs missions ;
difficults lies au cadre juridique, qui nest plus adapt la situation
conomique et sociale du pays et lvolution du secteur associatif ;
difficults relatives au manque de mobilisation pour le travail bnvole ;
difficults lies labsence de synergies avec le secteur coopratif : exercice
des activits lucratives directement avec des individus souvent dans linformel.
Le secteur des mutuelles
les socits dites dentraide ou mutuelles sont le troisime pilier de lconomie sociale au Maroc. Cres sous le colonialisme, les premires sont des
mutuelles dassurance agricole. Elles garantissent en particulier la mortalit
du btail et la grle. Aprs lindpendance, les agriculteurs marocains constituent des caisses rgionales qui se fdrent au sein de la Mutuelle agricole
marocaine dassurance (MAMDA). En 1919, naissent les mutuelles de sant
pour les fonctionnaires (ex. : Mutuelle de la police ). Aprs lindpendance,
les mutuelles se dveloppent largement, puis se regroupent au sein de la
Caisse nationale des organismes de prvoyance sociale (CNOPS).
Aujourdhui, le secteur est domin par les mutuelles du secteur public,
anim par plus de cinquante institutions (52 en 2010). La moiti de celles-ci
sont des mutuelles de couverture sanitaire. Huit parmi elles sont publiques,
regroupes au sein de la CNOPS. 43 % des socits de cautionnement mutuel
oprent dans les secteurs de lartisanat. Onze de ces mutuelles regroupent
quelques 8 840 artisans. On retrouve aussi 6 mutuelles dans le secteur du
transport qui regroupent 8 979 exploitants de voitures de transport. Trois
mutuelles sont actives dans le secteur de la pche et couvrent un peu moins
de 700 pcheurs. Il y a aussi 2 mutuelles pour les petites et moyennes entreprises avec 517 commerants et jeunes promoteurs. On dnombre enfin 3
mutuelles dassurance, la Mutuelle agricole dassurance (MAMDA), la
Mutuelle dassurance des transporteurs unis (MATU) et la Mutuelle dassurance sur les accidents de route et de travail.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
112
maroc
Les mutuelles de couverture sanitaire et sociale
depuis la cration rcente de la Mutuelle nationale des artistes44, cette
catgorie comprend 26 mutuelles dont 9 publiques, en plus de la CNOPS
charge de lorganisation des mutuelles du secteur public45. Elles regroupent
plus de 1,5 millions dadhrents, (principalement des salaris du secteur
public ) et concernent plus de 4 millions de bnficiaires. Elles jouent actuellement le rle dvolu dans dautres pays lassurance maladie obligatoire.
On dnombre aussi trois unions de socits mutualistes dont fait partie
la Caisse nationale des organismes de prvoyance sociale (CNOPS).
Les mutuelles dassurance
elles sont au nombre de trois et fournissent les diffrentes catgories
de services dassurance et de rassurance :
la Mutuelle agricole marocaine dassurances (MAMDA), destine couvrir uniquement les risques lis des activits agricoles ;
la Mutuelle centrale marocaine dassurances (MCMA), gnraliste en ce
sens quelle couvre lensemble des risques classiques (biens et personnes),
lis tous les secteurs ;
la Mutuelle dassurances des transports unis (MATU), spcialise exclusivement dans le domaine de lassurance des transports publics de voyageurs.
Le principal acteur est constitu du groupe MAMDA-MCMA qui comporte donc deux branches :
une branche assurance agricole ancienne : MAMDA dont le CA 2006
est de 273 millions de Dh ;
une branche dassurances autres risques : MCMA dont le CA 2006 est
de 412 millions de Dh.
La MAMDA et la MCMA, qui forment le groupe, drainent ensemble
plus de 70 000 adhrents travers le pays. Dans un souci de proximit, elles
utilisent un rseau national de distribution compos de plus de 28 bureaux
rgionaux et emploient pas moins de 300 personnes.
Le groupe est aussi devenu un important investisseur institutionnel. Il
compte de nombreuses participations financires dans des socits marocaines : Attijariwafa bank (8 % du capital), BMCE Bank (8 %) et Maghrbail
( 8 % ), SNI ( 6 % ), ONA (6 %), Sonasid (12 %), Fertima (30 % ). De plus, le
groupe pratique galement le capital-risque.
Quant la MATU, elle emploie prs de 234 personnes et dispose de
plusieurs agences rparties sur lensemble du territoire national.
44. Au terme de
lassemble gnrale
qui sest tenue
dimanche 24 juin
2007 Mohammedia.
45. Le statut des
mutuelles au Maroc
est rgi par les
dispositions du dahir
n 1.57.187 du 12
novembre 1963.
Les Socits de cautionnement mutuel
cette catgorie de mutuelles est compose de 22 institutions rparties
comme suit :
11 socits dans le secteur de lartisanat, regroupant 8 840 artisans ;
6 socits dans le secteur du transport, avec 8979 exploitants des voitures de transport ;
3 socits dans le secteur de la pche avec 675 pcheurs ;
2 socits dans le secteur des petites et moyennes entreprises, qui
regroupent 517 commerants et jeunes promoteurs.
113
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
propos du systme de protection sociale au Maroc
au maroc, la prvoyance sociale est assure par plusieurs institutions.
Dans le secteur priv, ce rle est jou par la Caisse nationale de scurit sociale
(CNSS) et la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR). Dans
le secteur public, ce rle est assur par la Caisse marocaine de retraite (CMR),
le Rgime collectif dallocation de retraite (RCAR) et la CNOPS.
Le secteur semi-public qui couvre des offices, des tablissements industriels, commerciaux et bancaires (lONE, la Rgie des tabacs, la Banque du
Maroc, lOCP et lODEP) est couvert par des rgimes autonomes et des caisses internes. Certains de ces organismes sont en train de passer dautres
rgimes.
Sur cette base, et partir des chiffres de ces organismes, la couverture
sociale au Maroc toucherait moins de 20 % de la population.
Le cas de la Caisse Nationale de la Scurit Sociale (CNSS). Le rgime marocain de scurit sociale a t cr en 1959, et est entr en vigueur en 1961. La
gestion de ce rgime a t confie la Caisse Nationale de Scurit Sociale.
La CNSS a t charge de grer le seul rgime obligatoire de scurit sociale
qui existait alors au Maroc. Ce rgime est financ par les cotisations des
employeurs et des salaris dans des proportions fixes. Il repose sur lensemble des rmunrations perues par les salaris, y compris les indemnits,
primes, gratifications et tous les autres avantages en argent et en nature.
Ce rgime, qui a deux composantes (obligatoire et volontaire) est en fait
une chane de solidarit organise. Il vise protger les salaris des divers
secteurs privs de lconomie nationale, savoir lindustrie, le commerce,
les professions librales, lagriculture, lartisanat, et la pche maritime des
risques de perte de revenus en cas de maladie, de maternit, dinvalidit ou de
vieillesse. Les prestations de la CNSS prennent trois formes principales: les
allocations familiales, les prestations court terme (les allocations de maternit, les indemnits journalires de maladie, le cong de naissance, et lallocation de dcs), les prestations long terme (la pension de retraite, la pension dinvalidit, la pension de survivants, et lallocation dcs). Le nombre
daffiliations demeure globalement faible tout comme les effectifs des immatriculs, malgr les efforts dlargissement et de couverture.
La Caisse Nationale des Organismes de Prvoyance Sociale (CNOPS). La
CNOPS est une fdration de 9 socits mutualistes du secteur public. Ses
ressources financires proviennent de cotisations salariales et patronales.
Elle assure actuellement la couverture mutualiste plus de 1 million de personnes. Ces dernires se concentrent naturellement dans les grandes villes
du pays. Ce rgime ne couvre en effet que les fonctionnaires et les employs
des quelques grandes entreprises.
Il ressort que les catgories pauvres et vulnrables de la population ne
bnficient daucune couverture sociale en labsence de mcanismes institutionnels de prise en charge. Le gouvernement a initi un projet de gnralisation de la couverture quelques 300 000 nouveaux adhrents, dont 170000
retraits et veuves travers lAssurance maladie obligatoire. Ce projet est difficile raliser pour diffrentes raison organisationnelles et de financement.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
114
maroc
En effet, la couverture de ces 300 000 adhrents impliquerait le double de cet
effectif tant donn le nombre de personnes charge. De plus, laffiliation des
170 000 retraits et veuves couvrirait une population qui naurait jamais cotis
auparavant, et qui la CNOPS devrait consacrer une proportion importante
de ses ressources.
Par ailleurs, lvolution de ce rgime moyen terme laisse prsager une
diminution du nombre dactifs par rapport au nombre de retraits. En effet,
si depuis une dizaine dannes, dix actifs cotisent pour un retrait, ils sont
seulement six aujourdhui.
46. Loi 65/00 portant
cration du systme
dassurance maladie
obligatoire.
47. Toutes les
statistiques sur
les mutuelles
communautaires
traites dans ce
document sont
tires de ltude
sur ralise
par lOrganisation
mondiale de la sant
(2006).
Autres expriences mutualistes : les mutuelles communautaires
ladoption en 2007 dune nouvelle loi46 sur lassurance maladie obligatoire
(AMO et son corollaire destination des populations dmunies, le RAMED)
devrait modifier profondment le positionnement et le rle des mutuelles dans
la socit marocaine. Ce nouveau dispositif de couverture sanitaire ne couvrirait que la moiti de la population qui vit dune activit dans le secteur informel.
Pour pallier cet cart en termes de couverture sanitaire, et en plus des
mutuelles classiques de sant, on assiste au Maroc lmergence dune autre
catgorie de mutuelles, les mutuelles communautaires 47. La cration de ce
type de mutuelle dorganisation dconomie sociale est encourage. Elles
seraient des organismes but non lucratif dont lobjectif est de constituer un
mcanisme dassurance maladie, conu et gr au niveau local, par lequel les
populations sorganisent elles-mmes pour rcolter des cotisations, fixer les
prestations rembourses en change des cotisations et payer les prestataires
pour les soins fournis couverts par la garantie.
Il sagit donc de groupes de personnes qui sorganisent localement pour
faire face, au moyen de leurs cotisations, leurs besoins en matire de financement de la sant. Les mutuelles de ce type, cres dans diffrents cadres,
nont fait lobjet daucune stratgie. Elles ont cependant un point commun,
celui davoir t inities par ltat.
La premire mutuelle de ce genre a vu le jour en 2002 dans la commune
de Zoumi, suite une demande de la Dlgation de la sant de la province
de Chefchaouen, soutenue par lUnicef. Le but tait de favoriser la prise en
charge prcoce des maladies et de lutter contre la mauvaise disponibilit de
mdicaments. Dans le mme cadre, et aprs avoir observ les bons rsultats
de la mutuelle de Zoumi, une deuxime mutuelle communautaire est cre
sous forme dune fdration de trois mutuelles couvrant les trois communes
de Bb Taza, Bni Darkoul et Bni Salah dans la mme province. La mutuelle de
Tabant dans la province dAzilal a en revanche t cre en avril 2005 dans le
cadre du programme des Besoins essentiels de dveloppement (BED) men
par le ministre de la Sant pour amliorer ltat de sant des populations.
La cotisation annuelle par mnage est de 150 DH pour la mutuelle de
Zoumi et de 200 DH pour les deux autres. La garantie couvre les mdicaments non fournis par le centre de sant et les transferts en ambulance
lhpital de rfrence. Elle comprend en plus, dans le cas de la mutuelle de
Bab Taza, les mdicaments pour le traitement de deux maladies chroniques,
le diabte et lhypertension artrielle.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
115
tableau
22
tableau
maroc
23
Nombre dadhrents
desmutuelles communautaires
pour lexercice 2005
Bilan financier des mutuelles
communautaires
pour lexercice 2005
Mutuelle
communautaire
Zoumi
Tabant
Bab Taza
Recettes Dpenses
Solde
Zoumi
140 756
83 700
57 056
Tabant
95 600
29 000
66 600
Bab Taza
169 817
41 833
127 984
Nombre
Taux de
dadhrents couverture 48
335
478
25 %
886
11 %
Rapport
rec./dp.
1,7
3,3
4,1
Le nombre dadhrents pour lexercice 2005 a atteint 335 pour la mutuelle
de Zoumi, 478 pour la mutuelle de Tabant et 886 pour la mutuelle de Bab
Taza. tableau 22
Toutes ces mutuelles prsentent des bilans financiers largement excdentaires. Celle de Bab Taza, qui couvre trois communes et compte le plus dadhrents, affiche lexcdent le plus lev avec prs de 128 000 DH, soit environ
les trois quarts des recettes. Vient ensuite celle de Tabant avec un excdent de
lordre des deux tiers des recettes. Ce taux est relativement moins important
dans le cas de la mutuelle de Zoumi (40 %) cause des dpenses exceptionnelles relatives la rparation de lambulance du centre de sant.
De ces chiffres, on peut conclure que ces mutuelles pourraient sduire
davantage de clients en baissant la cotisation des adhrents ou en largissant
le champ de la garantie propose ( tableau 23 ). Sur la base dun sondage ralis
auprs de 141 adhrents de la mutuelle de Zoumi, 79% des interviews se
sont dclars trs satisfaits, 19 % se sont dclars peu satisfaits et 2 % uniquement se sont dclars pas satisfaits.
Jusqu fin 2005, le Maroc comptait trois mutuelles communautaires
oprationnelles. Cinq autres expriences taient en cours dtude ou de mise
en place. Encourag par ces rsultats, lUnicef envisageait la cration de
18autres mutuelles communautaires dans le pays. En 2006, des mutuelles
taient dj en projets sur plusieurs sites, tels que ceux dAt Mhammed et
At Abbas dans la province dAzilal, dOurika dans la province dEl Haouz,
et de Sabt Jahjouh dans la province dEl Hajeb.
Ceci tant, ce nouveau mcanisme de mutuelles communautaires pourrait contribuer, aux cts de lassurance maladie obligatoire (AMO) et du
rgime dassistance mdicale (RAMED) rcemment mis en place, lamlioration du taux de couverture sanitaire au Maroc.
48. Nombre
dadhrents rapport
au nombre total
de mnages de la
(les) commune (s)
couverte (s).
Organisations informelles
par dfinition, ces organisations sont exclues du champ que couvrirait
une dfinition de base de lconomie sociale au Maroc. Cependant, ces mmes
entits peuvent tre considres comme de vritables units de base de cette
conomie. Plusieurs enqutes et tudes montrent limportance conomique
du secteur informel au Maroc. Ce dernier permet une large part de la population de survivre et de faire face des situations difficiles. Si la dfinition
conceptuelle de lconomie sociale peut couvrir les activits de ces organisations, il reste quil est toujours difficile de quantifier leur apport exact sur le plan
conomique : emploi, production, valeur ajoute, etc. En effet ce ne sont pas
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
116
maroc
toutes les activits informelles qui pourraient faire partie de lconomie
sociale. Des raffinements et des critres simposeraient. Ces derniers se baseraient sur le nombre de personnes impliques, le type dactivit exact et son
caractre, la destination de la production, etc.
Politiques publiques en matire dconomie sociale au Maroc49
49. Cette section
sinspire trs
largement de
deux rfrences :
(Abdelkhalek 2007)
et de la Stratgie
nationale de
lconomie sociale
et solidaire 20102020 du ministre
dlgu auprs du
chef du gouvernement
charg des Affaires
conomiques et
gnrales.
au lendemain de lachvement de la mise en place du programme dajustement structurel et pour rattraper en partie les dficits sociaux enregistrs,
les pouvoirs publics ont mis en avant lamlioration des conditions de vie de
la population. Plusieurs programmes ont t lancs dans le but damliorer
laccs des populations aux services sociaux de base : le Programme dlectrification rurale global, le Programme dapprovisionnement group en eau
potable des populations rurales (PAGER), le Programme national de lutte
contre la rage (PNCR), Barnamaj Aoulaouiyat Jtimaiya (BAJ), etc.
Par ailleurs, avec lavnement en 2005 de lInitiative nationale de dveloppement humain, les organisations de lconomie sociale, particulirement
les coopratives et les associations, ont t appeles jouer un rle de premier
plan. Cest elles que revenaient la mobilisation et lorganisation des populations potentiellement cibles, lidentification des projets, la contribution au
financement, la concrtisation ou laccompagnement des projets, etc.
Conscients des enjeux de ce secteur qui simpose de plus en plus, les
gouvernements qui se sont succds depuis 1998 se sont engags, dune
manire ou dune autre, promouvoir et le dveloppement de lconomie
sociale et solidaire travers diffrentes interventions dont le dveloppement
dactivits gnratrices de revenus. Par exemple, la dclaration du gouvernement qui a t investi en octobre 2007 prcisait que Le gouvernement
considre lconomie sociale comme tant un domaine pouvant servir de base la
cration de nouveaux postes demploi. [ ], nous allons uvrer pour le dveloppement de ce secteur par la promotion des activits gnratrices de revenus sur les
plans rgional et local, et travers lexploitation des potentialits et des ressources
humaines et naturelles propres chaque rgion .
Un ministre (Affaires conomiques et gnrales) sest charg de piloter
ces actions. Il a ainsi labor, mis jour puis actualis, en concertation avec
lensemble des dpartements et acteurs potentiellement concerns, une stratgie nationale pour le dveloppement des initiatives de lconomie sociale et
solidaire. Elle a t et est encore une feuille de route pour dvelopper lconomie sociale jusqu lhorizon de 2020. Les principaux axes de cette stratgie,
au nombre de sept, sont :
renforcer et harmoniser laction publique en matire dconomie sociale
et solidaire, aux niveaux national et rgional ;
favoriser lmergence dune conomie sociale et solidaire performante
et structure capable de jouer pleinement son rle en matire de lutte contre
la pauvret, la prcarit et lexclusion sociale ;
117
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
contribuer un dveloppement territorial intgr fond sur lexploitation rationnelle et la valorisation des richesses et des potentialits locales ;
amliorer la visibilit et la connaissance du secteur de lconomie sociale
et solidaire.
De faon plus prcise et chiffre, la stratgie a retenu les objectifs suivants :
renforcer ladhsion de la population active aux coopratives, en augmentant le taux de pntration de la cooprative parmi cette population de
3,1 % actuellement 7,5 % lhorizon 2020 ;
renforcer la contribution de lconomie sociale et solidaire la cration
de lemploi, en augmentant le nombre de salaris des coopratives de 50 000
actuellement 175 000 lhorizon 2020 ;
amliorer la contribution du secteur la cration de la richesse, en augmentant sa part dans le Pib de 1,6 % actuellement 3,9 % lhorizon 2020.
Pour atteindre ces objectifs, la stratgie a prcis sept axes dintervention.
Valoriser et promouvoir le produit de lconomie sociale et solidaire
cet axe cherche rsoudre lun des principaux problmes que rencontrent
les coopratives, principal acteur de lconomie sociale. Il sagit de la valorisation du produit de lconomie sociale et solidaire et lamlioration de son
attractivit afin dlargir ses opportunits au niveau de la commercialisation.
En effet, il est connu que malgr loriginalit et la qualit des produits de
lconomie sociale, ces derniers sont gnralement mal ou insuffisamment
valoriss sur le march, donc mal commercialiss. Ils ne trouvent ni leur crneau dans les canaux de distribution ni leur place sur les rayons de la grande
distribution. Lorsque ces produits russissent tre exposs, ils perdent face
la concurrence des produits industriels qui leurs sont substituables.
De faon prcise cet axe sarticule autour de :
lamlioration de la prsentation des produits de lconomie sociale
diffrents niveaux : emballage, tiquetage, conditionnement, etc. Des prototypes demballage appropris seraient mis la disposition des oprateurs
pour les aider sajuster aux exigences des marchs ;
la cration dun label distinctif pour les produits de lESS ;
lidentification et lencouragement des oprateurs dans la recherche et
ladoption de nouveaux crneaux forte valeur ajoute.
Favoriser laccs des produits de lconomie sociale et solidaire au march
cause des tailles des organisations de lconomie sociale au Maroc,
gnralement petites, et aussi de la faiblesse ou du non encadrement total
de ces dernires, ces units ne matrisent pas les techniques de marketing.
Elles ne disposent pas non plus des moyens financiers ou logistiques ncessaires pour accder aux marchs intrieurs et encore moins lexportation.
De ce fait, ces units et leurs membres, sont exploits par des intermdiaires
qui saccaparent parfois des marges considrables. Dans le cas inverse les
produits de ces instituions narrivent pas sur les marchs, ce qui annule tout
revenu attendu et place ces units dans des situations difficiles en terme de
118
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
gestion. Cet axe de la stratgie, que les responsables essayent de mettre en
place, devrait allger ce phnomne en veillant :
lorganisation rgulire de salons ddis aux produits de lconomie
sociale aux niveaux national et rgional ;
le dveloppement conceptuel puis la mise en place dune plateforme
pour le commerce quitable ;
lorganisation de marchs itinrants rgionaux pour les produits de
lconomie sociale ;
la promotion des boutiques du commerce solidaire ;
la promotion des produits de lconomie sociale et solidaire auprs des
entreprises ( chanes de grande distribution, entreprises touristiques, sites
touristiques, export).
Renforcer et organiser les acteurs de lconomie sociale et solidaire
les institutions de lconomie sociale ne disposent pas des ressources
humaines qualifies et jour en matire de marketing et de commercialisation. Dans ce sens la stratgie propose :
la mise en place dun dispositif daccompagnement et dencadrement
pr et post cration au profit des acteurs de lconomie sociale et solidaire.
Le but est daccompagner les porteurs de projets lors de la cration et du
dveloppement (dmarches administratives, business plans, financement,
formation, assistance technique) ;
lencouragement et laccompagnement de lmergence dacteurs de
rfrence en conomie sociale capables de jouer le rle de locomotive pour
le secteur ;
lencouragement et laccompagnement de la mise en rseau des acteurs
de lconomie sociale et solidaire (regroupement de coopratives en unions,
rseaux et espaces associatifs, rseaux rgionaux dconomie sociale, etc.).
Crer un environnement favorable au dveloppement delESS
plusieurs actions sont envisages dans ce cadre par cette nouvelle stratgie. Elles sont disparates et diversifies et cherchent promouvoir lmergence de lconomie sociale diffrents niveaux. Il sagit principalement :
asseoir un cadre juridique simple et attractif pour les coopratives
travers la rvision du cadre juridique actuel en vue dallger les formalits
administratives de cration et pour instaurer de nouvelles rgles de gouvernance permettant une meilleure rentabilit ;
chercher diversifier les statuts juridiques des entreprises de lESS
(entreprise sociale, auto entreprise, socit responsabilit simplifie...) ;
asseoir un cadre institutionnel efficace, en particulier la radaptation des
missions de lODCO la ralit socioconomique des coopratives et le renforcement de ses ressources, la mise en place dune Commission nationale de
coordination de lconomie sociale et llaboration dune charte thique pour
le secteur ;
dvelopper des outils de financement mieux adapts aux caractristiques des entreprises de lconomie sociale et solidaire.
119
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
Favoriser lmergence dinitiatives dESS surlesterritoires
il est connu que lconomie sociale et solidaire est une conomie de proximit. Elle ne peut tre dveloppe que dans le cadre dune approche territoriale, partenariale et participative. Sinscrivant dans cette logique, la stratgie
prvoit de : mener des diagnostics territoriaux participatifs et de mettre en
place des cartes des potentialits locales ; mettre en place des programmes territoriaux intgrs pour le dveloppement de lconomie sociale et solidaire.
Faciliter laccs des acteurs de lESS lascurit sociale
en plus de lencouragement des activits conomiques cratrices de
richesses et de lemploi, lamlioration des conditions de vie des acteurs de
lconomie sociale passe par laccs de cette catgorie la couverture mdicale et sociale. Dans ce sens, la stratgie compte uvrer pour faciliter laccs
des oprateurs de lconomie sociale et solidaire la couverture mdicale. A
cet effet, la stratgie compte mettre laccent sur :
lamlioration du taux daffiliation la CNSS des salaris du secteur
(information, sensibilisation, accompagnement) ;
lintgration des adhrents des coopratives dans les rgimes de couverture mdicale existants ;
la promotion et laccompagnement de la cration de mutuelles de sant
adaptes cette catgorie de la population.
Dvelopper les outils de suivi et dvaluation, de veille
stratgique, de communication et de partenariat
la mise en uvre de la stratgie et latteinte de ses objectifs ncessite un
effort en matire de communication et de sensibilisation sur limportance
conomique et sociale du secteur, sur les enjeux dont il est porteur et sur son
rle dans la diffusion des valeurs de solidarit, dentraide et de mutualit.
Dans ce cadre, laccent serait mis sur la production des connaissances, sur
la mobilisation de lexpertise, sur la promotion de bonnes pratiques et sur la
veille stratgique et le suivi-valuation. La stratgie prvoit de mettre en place
un observatoire national pour lconomie sociale et solidaire, de dvelopper la
communication institutionnelle et le partenariat avec les acteurs nationaux
et internationaux.
Ces activits sont inities et pilotes par deux directions centrales, la
Direction des tudes, de la coopration et de la lgislation (DECL) et la Direction de lconomie sociale (DES), en plus de lOffice de dveloppement de la
coopration (ODCO), qui est un tablissement public sous tutelle du ministre des Affaires conomiques et gnrales.
En plus de la stratgie ici dtaille et de ses axes, le ministre responsable
de ce secteur a mis en place des programmes pour la traduire sur le terrain.
Dans ce sens une tude pilote a t ralise dans la rgion de Rabat-SalZemmour-Zaer. Elle a vis lidentification des produits de lconomie sociale
et solidaire fort potentiel commercial. Lobjectif est damliorer leur forme
finale la commercialisation. Ltude a permis de slectionner dix familles
de produits pour lesquels des prototypes demballage ont t conus. Elle a
120
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
aussi permis de dceler plusieurs dysfonctionnements dans les circuits de
commercialisation des produits de lconomie sociale en gnral et de proposer des solutions adquates pour en amliorer la distribution.
Par ailleurs, pour amliorer laccs au march des produits de lconomie
sociale et solidaire, la DECL a mis en place un concept dit marchs itinrants.
Elle a ainsi organis ces marchs dans plusieurs rgions conomiques du pays.
Ces marchs ont permis des coopratives et associations (plus de 1 000 et
plus de 12 000 membres dont plus de 9 000 femmes) de promouvoir et de
vendre directement leurs produits.
Dans le cadre de laxe relatif au renforcement et lorganisation des acteurs
de lconomie sociale et pour remdier aux cessations des activits de plusieurs jeunes coopratives, les responsables du dpartement, en collaboration
avec le ministre des Finances et lODECO, ont mis en place un programme
daccompagnement des jeunes coopratives. Ce programme dit mourafaka et
qui signifie accompagnement, sest fix comme objectif la prennisation de
lactivit du plus grand nombre de coopratives. Un budget significatif de 85
millions de dirhams sur 5 ans a t allou au programme.
Au niveau de laxe relatif lencouragement de lmergence des initiatives dconomie sociale au niveau des territoires, llaboration de plans
rgionaux relatifs ces secteurs a t lance. Ces plans devraient dfinir
des cadres qui favoriseraient les complmentarits et les convergences entre
lensemble des acteurs locaux de lconomie sociale et solidaire. 3 plans rgionaux de ce type dits Plans rgionaux pour le dveloppement de lconomie
sociale et solidaire (PDRES) ont t termins. Il sagit de ceux des rgions
de Rabat Sal Zemmour Zaer, de Laayoune Boujdour Essakia El Hamra, de
Doukkala Abda, Oued Eddahab Lagouira et Guelmim Essmara. Des budgets
de mise en uvre ont t aussi allous. Ceux des autres 13 autres rgions
sont en principe en cours dlaboration.
Pour le sixime axe de la stratgie, en particulier ce qui est relatif la
mise en place dune couverture mdicale pour les membres des coopratives,
une consultation dans ce sens a t lance. Elle a comme objectif dtudier le
cadre institutionnel et les possibilits de financement dune telle initiative.
Les premiers rsultats de la consultation ont conclu linadaptation des systmes qui existent actuellement. Il est recommand aux acteurs cooprateurs
la cration de leur propre mutuelle de sant. Des enqutes complmentaires
sont aussi programmes dans ce sens.
En matire de dveloppement des outils de suivi et dvaluation, de la
veille stratgique, de la communication et du partenariat, qui est un axe de
la stratgie, plusieurs actions ont t entreprises.
Dans un premier temps, la direction responsable a entrepris la mise en
place dun Observatoire national de leconomie sociale et solidaire en mme
temps que la promotion des systmes dinformation gographique de lconomie sociale et solidaire. Lobjectif tant de remdier autant que possible
au manque de donnes et dinformations statistiques sur le secteur. Cest
une premire tape pour une meilleure connaissance du secteur. Ltude a
dress un tat des lieux en matire dinformation sur lconomie sociale et
solidaire et des expriences internationale. La conception du systme dans
son ensemble est en cours.
121
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
La DECL a enfin entrepris un partenariat avec plusieurs universits
marocaines pour former des agents de lconomie sociale et dvelopper la
recherche scientifique sur le secteur.
Concernant la coopration internationale, le ministre de tutelle recherche toujours des partenariats avec des organisations internationales actives dans le secteur de lconomie sociale et solidaire. Lobjectif avou est
de souvrir sur lexprience internationale et didentifier des opportunits
pour les oprateurs marocains du secteur. Quelques conventions ont t dj
signes dans ce sens.
Perspectives davenir de lconomie sociale au Maroc
comme il se doit, avant la mise en place de la nouvelle stratgie de lconomie sociale et solidaire au Maroc, un diagnostic assez large du secteur a t
fait. Il a permis didentifier les atouts et surtout les contraintes, faiblesses et
lacunes de ses principaux acteurs. Ces dernires ont t soulignes tout au
long du cycle des projets des institutions de lconomie sociale.
Au niveau de lidentification et de la formulation du projet, il a t
constat un faible potentiel entrepreneurial et une faible capacit managriale chez les membres des institutions et leurs gestionnaires. Ces derniers
sont souvent soit analphabtes, soit avec un trs faible niveau scolaire. Il en
dcoule une absence de crativit, dinnovation et la dominance dun esprit
conservateur qui limite le dveloppement de la productivit aux niveaux des
activits entreprendre.
La faiblesse dans les comptences se prolonge au niveau du montage
et de la planification des activits entreprendre. En effet, la majorit des
membres et des gestionnaires nont aucune connaissance des procdures
administratives qui simposent. Des erreurs sont alors gnralement commises, allongent les dlais, augmentent les cots, rduisent les bnfices et
peuvent mme compromettre la concrtisation ou la russite du projet.
Pendant lexcution et au cours du dveloppement du projet, il ressort
globalement une gouvernance qui laisse dsirer parfois mme en violation
des principes de base fondateurs des institutions de lconomie sociale. Les
comptences comptables, et en termes de savoir-faire des gestionnaires sont
limites. Il en dcoule des produits peu comptitifs, sous valoriss en termes
de conception technique, de conditionnement et demballage sans aucune
stratgie de commercialisation approprie. Cest ainsi que la plupart des produits du secteur nont pas de circuits prcis dcoulement pour une grande
consommation, ce qui rduit les chiffres daffaires des institutions. Dans
le mme ordre dides, la gestion financire de ces dernires est loin dtre
parfaite. Pour diffrentes raisons elles nont quun accs limit aux diffrents
systmes et mcanismes de financement et restent largement dpendantes
du soutien de ltat et de ses services.
122
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
En principe, telle que dcrite ci-dessus, la stratgie apporterait des
rponses, au moins thoriques et parfois pratiques et oprationnelles plusieurs sinon tous ces problmes identifis. Il est donc attendu que cette
stratgie contribue redynamiser le secteur. A moyen terme, elle devrait
crer un environnement plus favorable, propice lmergence dune nouvelle gnration dentreprises dans le secteur. Ces dernires devraient tenir
compte de faon nette de lapproche filire, axe sur le march, avec un
ancrage territorial. Il semble que cest dans ce sens que les retombes conomiques et sociales sur les conditions de vie de la population sont les plus leves puisque elles exploitent les potentialits et des spcificits territoriales.
Cette stratgie, base aussi sur laccompagnement, devrait amliorer lattractivit des produits commercialisables par les entreprises de lconomie
sociale. En effet, il est attendu que llaboration de stratgies intgres claires,
qui tiennent compte des tendances des marchs, amliore la productivit des
entreprises. Il en va de mme de la mise en place dun environnement global
propice lmergence et au dveloppement des initiatives locales de ces units
sur tous les plans, particulirement institutionnel, juridique et financier.
Sur cette base, et de faon raliste, il ressort que le secteur de lconomie
sociale au Maroc est sur une bonne voie pour se positionner en tant que secteur davenir. Cependant il a certainement des contraintes surmonter et des
ajustements mettre en place pour simposer en tant que secteur part entire.
Conclusion et recommandations
au maroc, les initiatives respectant les principes de lconomie sociale ne
datent pas daujourdhui. Les cultures de solidarit, dentraide et de travail
collectif sont ancres dans les traditions et les pratiques de la socit marocaine. Depuis toujours, les Marocains, particulirement en milieu rural, sorganisent selon plusieurs formes coutumires pour rpondre leurs besoins
conomiques et sociaux. Cependant, lconomie sociale sous sa forme
actuelle, structure, organise et institutionnalise na pris forme qu partir
des annes 1990 et au dbut des annes 2000. Elle a merg, dabord spontanment puis sous limpulsion de ltat, pour contribuer allger les dficits
sociaux engendrs par les diffrentes politiques conomiques (ou absence
de celles-ci ) dont, semble-t-il, le programme dajustement structurel (19831991). Ces dficits ont trait particulirement laccs des populations aux
services sociaux de base, la recrudescence de la pauvret et de la vulnrabilit, aux problmes du chmage, notamment celui des jeunes diplms, etc.
Ds lors, lconomie sociale, notamment sa composante associative, a
connu un essor et un dynamisme sans prcdent en attirant de plus en
plus dindividus, de communauts et dorganismes. Cette forte progression
quantitative des organisations de lconomie sociale a t accompagne dun
largissement et dune diversification de leurs domaines dintervention. Aux
associations sportives, culturelles et de bienfaisance qui rgnaient aupara-
123
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
vant, sest ajoute, aujourdhui, une nouvelle catgorie dassociations, en
loccurrence les associations de dveloppement.
De leur ct, les coopratives, bien quelles restent concentres dans
les trois secteurs traditionnels, savoir lhabitat, lagriculture et lartisanat,
embrassent de nouveaux secteurs dactivit. Quant aux mutuelles, elles
dpassent leur caractre national ou sectoriel, puisque on assiste lmergence des mutuelles communautaires.
Les organisations de lconomie sociale sont ainsi prsentes dans tous
les domaines longtemps rservs ltat, tels que la cration et laccompagnement de projets locaux de dveloppement, la micro-finance, lalphabtisation, la sant, lhabitat, linfrastructure locale et les quipements de base,
etc. Leurs populations cibles sont les femmes en particulier en milieu rural,
les jeunes, les enfants, les personnes ges, les personnes handicapes et
toutes les catgories de la population juges dans des situations prcaires.
Dans leur action, les organisations de lconomie sociale adoptent une
vritable politique de proximit et une dmarche participative impliquant
directement les populations bnficiaires en investissant leur force qui rside
dans leur proximit de la population, leur parfaite connaissance du terrain
et leur mode de fonctionnement souple leur permettant dintervenir rapidement et de faon efficace. Cest ainsi quelles ont pu rpondre plusieurs
besoins des populations au niveau le plus fin du territoire difficilement
atteint par les actions de ltat.
Par ailleurs, les pouvoirs publics ont adopt progressivement, une politique de partenariat avec ces organisations dans le but de rendre plus efficace
laction publique en matire du dveloppement social, notamment au niveau
local. Dans ce sens, des appuis techniques et financiers leurs ont t accords, bien quils demeurent insuffisants, aussi bien dans le cadre du budget
de ltat que dans le cadre de programmes de coopration internationale.
Cette tendance au partenariat avec les organisations de lconomie sociale
et leur implication dans le dveloppement conomique et social est renforce
avec lavnement de lInitiative nationale de dveloppement humain (INDH).
Celle-ci est fonde sur une approche participative qui met les entreprises de
lconomie sociale au centre du processus de dveloppement humain. Elles
sont sollicites pour lidentification des besoins des populations, lexercice
et lencadrement de projets, lorganisation des bnficiaires des projets, la
participation aux organes de gouvernance, etc.
Sur le plan institutionnel, ltat a mis en place des entits ministrielles
pour promouvoir lconomie sociale travers les coopratives, les associations et les mutuelles. Il sagit particulirement du Dpartement de lconomie sociale. Mais malgr ces efforts, les organisations de lconomie sociale
subissent une multitude de contraintes qui limitent la porte de leurs interventions et rduisent fortement leur efficacit. Il sagit en particulier de :
linsuffisance et de lirrgularit de leurs ressources financires, ce qui
rduit sensiblement leurs projets et rend difficile la planification des actions ;
la faiblesse quantitative et qualitative de leurs ressources humaines.
Cela se rpercute sur les comptences en matire de gestion administrative
et financire, de planification, de conception et dvaluation de projets, de
comptabilit, bref sur leurs comptences managriales ;
124
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
maroc
les conditions de travail laissent dsirer. Peu dassociations sont propritaires dun sige et dun local avec des quipements ncessaires pour
accomplir leurs missions dans de bonnes conditions ;
linadquation du cadre juridique avec les ralits conomiques et sociales
du pays. Il est en effet contraignant, en particulier pour le secteur coopratif ;
le manque de coordination aussi bien entre les diffrents dpartements
ministriels et organismes concerns de ltat quentre les organisations de
lconomie sociale.
Dans la perspective de dynamiser les organisations de lconomie sociale
pour quelles puissent jouer, avec efficacit et efficience, le rle qui leur appartient en matire de dveloppement conomique et social, certaines recommandations peuvent tre formules. Celles-ci sont des corollaires des contraintes
susmentionnes. Il sagit notamment de :
rsoudre ou du moins attnuer sensiblement la contrainte financire
des organisations de lconomie sociale en cherchant les voies et les moyens
de la prennisation de leurs ressources ;
renforcer leurs ressources humaines tant sur le plan quantitatif que qualitatif par la mise en place de programmes de formations et dencadrements
en leur faveur;
amliorer les conditions de travail des entreprises de lconomie sociale
en les aidant acqurir des quipements ncessaires laccomplissement de
leurs missions dans de bonnes conditions ;
mettre en place une plateforme interministrielle pour coordonner les
actions des diffrents intervenants dans le domaine de lconomie sociale ;
encourager la mise en rseau des entreprise de lconomie sociale dans
le but, dune part, de faciliter le contact avec les pouvoirs publics, et dautre
part, damliorer lefficacit des actions menes en matire de dveloppement local par la coordination des actions, la mutualisation des ressources
et le renforcement des capacits en matire de conception, de mise en place
et de gestion de projets de dveloppement intgrs ;
procder la rforme du cadre juridique rgissant les organisations de
lconomie sociale ;
initier et promouvoir la culture de lconomie sociale par le biais de
compagnes de sensibilisation de proximit sur les vertus de lesprit coopratif
et associatif, sur la culture du partage, de lentraide et de la solidarit.
125
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
conomie sociale et solidaire (ESS)
en Tunisie
Zied Ouelhazi
Consultant
126
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
la crise conomique et louverture des marchs dans le cadre de la mondialisation contribuent limiter les moyens des tats pour faire face seuls aux
dfis lis la rsorption du chmage, aux nouvelles formes de pauvret et la
dgradation de lenvironnement. Cette situation a favoris lmergence dun
secteur, autre que ltat et le secteur priv, qui essaye dapporter une contribution la rsolution de problmes sociaux et conomiques. Il sagit de lconomie dite sociale et solidaire SCOP, Mutuelles, activits lies linsertion,
services la personne etc. qui se caractrise par une gouvernance dmocratique, une gestion thique et un partage galitaire des salaires ou des profits.
Lconomie sociale prend plusieurs appellations en fonction du contexte
et du rfrentiel culturel. Ainsi, on parle du non-profit organisations aux tatsUnis, du volontary sector au Royaume-Uni, de lconomie sociale et solidaire,
de lconomie populaire, de lconomie de dveloppement communautaire
dans le monde francophone et en Amrique latine. Pour dsigner le mme
secteur on parle galement dun tiers secteur finalit sociale, dun tiers secteur dconomie de proximit ou encore dun secteur accompagnateur des
deux secteurs priv et public. Toutes ces dfinitions dsignent un ensemble
dactivits conomiques et sociales exerces par des organisations relevant
de la socit civile et parfois de type coopratif. Ce type dorganisation sest
dvelopp partout dans le monde, dans des pays aussi bien dvelopps quen
dveloppement, et apporte une contribution non ngligeable aux conomies
nationales.
Les organisations de lconomie sociale, particulirement les associations, se sont dveloppes en Tunisie et ont gagn du terrain dans plusieurs
domaines longtemps rservs ltat : la fourniture des services et des quipements de base, notamment dans le monde rural, la lutte contre lanalphabtisme, la cration et laccompagnement de projets de dveloppement, la promotion et lintgration de la femme dans le circuit conomique, la promotion
dactivits gnratrices de revenus etc. En novembre 2007, la charte de Tunis
de lconomie sociale est signe entre diffrentes organisations appartenant
ce tiers secteur. Cette charte porte sur la cration du Rseau tunisien de
lconomie sociale (RTES) qui a pour objectif dassister techniquement les
structures et les organisations dans le domaine des tudes, du diagnostic, de
la formation et de laccompagnement professionnel.
LInstitut de prospective economique du monde mditerranen (Ipemed)
se propose de faire une tude sur ce secteur en Tunisie. Cette tude vise identifier les perspectives davenir et de dveloppement du secteur de lconomie
sociale et son insertion dans le champ conomique travers lentrepreneuriat
social ou collectif.
Afin dy rpondre, la mthodologie a repos sur trois approches :
La collecte de donnes statistiques relatives aux contextes dmographique et socio-conomique de la Tunisie (donnes dmographiques, donnes conomiques et indicateurs sociaux) ainsi quaux organisations de lconomie sociale ( nombre, catgorisation, rpartition gographique, etc.);
La recherche documentaire qui touche la littrature relative lconomie
sociale, les textes juridiques et les tudes qui ont t menes sur les organisations de lconomie sociale en Tunisie (associations, coopratives, etc.);
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
127
Tunisie
Il a t prvu de mener une enqute auprs des organisations de lconomie sociale et solidaire (ESS) en Tunisie. Un questionnaire a t labor.
Il a pour but de dresser un profil des organisations de lESS en Tunisie et
didentifier leurs besoins en matire de financement et de dveloppement de
comptences en se rfrant leurs faiblesses. La mthode de collecte de donnes tait base sur lenvoi de ce questionnaire par courrier lectronique aux
diffrentes organisations. Sur 130 questionnaires envoys, sept seulement
ont t retourns ; soit un taux de rponse de 5,3% 50. Ils ne peuvent donc
en aucun cas tre utiliss. Dans ce contexte, le diagnostic des organisations
sest limit aux rsultats des tudes les plus rcentes qui ont t menes sur
les organisations de lESS savoir :
a. ltude mene par le bureau dtudes belge COWI pour le compte de
la Commission europenne intitule Rapport de diagnostic sur la socit civile
tunisienne, ralise en 2012 ;
b. ltude mene par Malena et al. pour le compte de la Banque Africaine
de Dveloppement, intitule La gouvernance participative en Tunisie : Amliorer
les prestations des services publics travers des partenariats tat-citoyen, ralise
en 2012 ;
c. ltude mene par Belad pour le compte de la Confdration espagnole
dentreprises de lconomie sociale (Cepes) intitule Lconomie sociale en
Tunisie, ralise en 2007.
Le rapport est articul autour de cinq sections. La premire dresse le
cadre conceptuel de lentrepreneuriat social. La seconde traite du contexte
socio-conomique en Tunisie. Dans la troisime, il est question de prsenter
le dispositif de lconomie sociale et solidaire en Tunisie tout en analysant le
dispositif juridique, institutionnel et de financement et en passant en revue,
dans le cadre dune analyse comparative avec des pays du Nord et du Sud, les
politiques publiques. Dans le cadre de la quatrime section, il est question
de positionner les organisations de lconomie sociale et solidaire par rapport
au rfrentiel retenu dans le cadre de la revue de la littrature. Enfin, dans la
dernire section, des recommandations-actions sont proposes pour ancrer
les organisations tudies dans le champ conomique.
Cadre conceptuel
50. Le faible taux de
retour est dj un
rsultat rvlateur
quant lutilisation
des technologies de
linformation et de la
communication au
sein des organisations
de lconomie sociale
et solidaire.
la revue de la littrature relative lconomie sociale et solidaire et
lentrepreneuriat social porte sur deux aspects. Le premier est mthodologique puisque le cadre conceptuel dlimite le champ dinvestigation de la
prsente tude. Le deuxime est dclairer et de sensibiliser les lecteurs sur
le contexte dmergence de lconomie sociale et solidaire et de lentrepreneuriat social, de le dfinir et de montrer la diffrence entre ces concepts
et dautres notions trs proches souvent utilises dune manire interchangeable.
128
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
mergence du concept de lentrepreneuriat social
la pratique de lentrepreneuriat social est assez rcente. Aux tatsUnis et en Europe, le processus de reconnaissance est entam au dbut des
annes 1980. Lmergence de ce type dentrepreneuriat est troitement lie
lmergence, de prime abord, dun tiers secteur quest lconomie sociale
et solidaire, ct du secteur public et du secteur priv capitaliste.
Enjolras (2008) explique lmergence de lconomie sociale et solidaire
suivant quatre paradigmes. La dfaillance du gouvernement dans loffre de
biens collectifs incite les consommateurs sous-satisfaits sorienter vers la
cration dorganisations but non-lucratif pour la fourniture de ces biens.
Lasymtrie dinformation relative la qualit des biens et des services offerts
sur le march, justifie la cration dorganisations but non-lucratif peu incites tirer profit de lasymtrie du fait de la contrainte de non-distribution.
Le paradigme de lconomie sociale considre les organisations dconomie
sociale comme une alternative au capitalisme (Gueslin, 1998). Il justifie les
organisations de lconomie sociale par la rpartition des richesses sociales
suivant lapproche initie par Lon Walras (Docks, 1996). Le paradigme
de lconomie solidaire justifie les organisations but non-lucratif par leur
utilit sociale, leur contribution rsoudre les problmes macro-sociaux et
leur contribution la rgnration des liens sociaux et de la cohsion sociale
et par leur rle dintermdiation entre le secteur public et le march. Le paradigme de la socit civile met laccent sur le rle politique des organisations
de lconomie sociale et solidaire comme institutions dmocratiques dans la
mesure o elles constituent des espaces publics dagrgation des prfrences
et/ou dlaboration et dexpression de conceptions du bien commun.
Defourny et al. (2000, p.4) avancent que lorganisation dconomie
sociale et solidaire a comme caractristique doffrir des services ses membres
ou la communaut plutt que dtre un outil de rmunration du capital [].
La ralisation dun bnfice est ds lors un moyen pour offrir un service, et non
le principal moteur sous-tendant lactivit conomique. Les organisations de
lconomie sociale et solidaire regroupent les associations, les coopratives,
les mutuelles, les fdrations et les fondations.
En se rfrant Huybrechts et al. (2012), la prolifration dassociations et dautres organisations de lconomie sociale et solidaire a stimul la
concurrence entre elles pour obtenir du financement public. Combin la
rcession conomique, ceci a engendr une disparit croissante entre loffre
et la demande de ressources, avec notamment la rduction du financement
public, pour soutenir les organisations sociales (Fontan, 2011; Huybrechts,
et al., 2012 ). Selon Kanter & Summers (2006), ce contexte a pouss les organisations de lconomie sociale et solidaire devenir plus entreprenantes et
diversifier leur sources de financement, contribuant ainsi lmergence
de nouveaux concepts tels que lentrepreneuriat social, lentrepreneur social
et lentreprise sociale.
Au dbut des annes 90, en Italie, le statut spcifique de cooprative
sociale est adopt. Cette cooprative dveloppe des activits conomiques
au service dobjectifs sociaux. Dans dautres pays, de nouvelles lgislations
reconnaissent la possibilit de dployer une activit conomique tout en
poursuivant une finalit sociale (Roelants, 2009). Certains statuts se sont
129
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
mouls dans le modle coopratif comme en France (socit cooprative
dintrt collectif en 2001) ou en Pologne (cooprative sociale en 2006).
Dautres se sont inspirs du modle coopratif tout en offrant un cadre nouveau : la socit finalit sociale en Belgique en 1995, ou encore la community
interest company au Royaume-Uni en 2006.
Plusieurs travaux de recherche ont tent de dresser les contours des
notions de lentrepreneuriat social, de lentrepreneur social et de lentreprise
sociale. Ces travaux ont essay de les dfinir, den prsenter les caractristiques, de les distinguer par rapport des notions proches et den mesurer
lampleur.
Dfinition de lentrepreneuriat social et de lentreprise sociale
la revue de la littrature montre quune multitude de dfinitions des
notions de lentrepreneuriat social, de lentrepreneur social et de lentreprise
sociale ont t avances. Ces dfinitions soulvent des divergences aussi bien
conceptuelles que rgionales eu gard lentrepreneuriat social. Sur le plan
conceptuel, la divergence consiste considrer lentrepreneuriat social au
sens le plus large se limiter donc la notion dentrepreneuriat ou, dune
manire restreinte. Sur le plan rgional, les divergences sont observes entre
lapproche europenne et celle, nord amricaine, de lentrepreneuriat social.
Ce dbat sexplique par le rcent intrt accord lentrepreneuriat social o
le champ dinvestigation est encore au stade du dveloppement (Huybrechts,
et al., 2012).
Les notions de lentrepreneuriat social, de lentrepreneur social et de lentreprise sociale ont t utilises dune manire interchangeable (Defourny &
Nyssens, 2010 ). En Amrique du Nord, si lcole des ressources marchandes
a avanc des dfinitions de lentreprise sociale, les tenants de lcole de linnovation sociale ont mis laccent sur le rle central de lentrepreneur social.
En Europe et aux niveaux acadmique et institutionnel, les dfinitions ont
principalement port sur lentreprise sociale.
Lcole des ressources marchandes a tent de dfinir lentreprise sociale.
La premire gnration de ces travaux (Skloot, 1987 ; Young & Salamon,
2002 ) soutient que lentreprise sociale couvre les activits conomiques marchandes dployes par les organisations prives (indpendamment de leur
statut juridique mais simposant la contrainte de non-distribution) au service
de leur mission sociale. La deuxime gnration de travaux de ladite cole
voit lentreprise sociale comme une notion qui stend toutes les formes
dorganisations ( lucratives ou non) pourvu quelles dploient une activit
marchande en vue dune finalit sociale (Austin, et al., 2006). Cette deuxime gnration de travaux met laccent sur deux aspects savoir lactivit
marchande et la mthode de gestion issue du secteur priv capitaliste.
De son ct, lcole de linnovation sociale met laccent sur le rle central
de lentrepreneur social. Selon Dees (1998), lentrepreneur social joue un
rle dagent de changement dans le secteur social en poursuivant une mission de
cration de valeur sociale en exploitant de nouvelles opportunits pour soutenir
cette mission. Il sinscrit dans un processus continu dinnovation, dadaptation et
dapprentissage, agissant avec audace sans tre limit, a priori, par les ressources
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
130
51. A social enterprise
is a business with
primarily social
objectives whose
surpluses are
principally reinvested
for that purpose in
the business or in the
community rather
than being driven by
the need to maximize
profit for shareholders
and owners. Cabinet
Office (2006)
Tunisie
disponibles et en faisant preuve dun sens aigu de lengagement vis--vis de sa mission
et de ses impacts sociaux (p. 4). Alors que lcole des ressources marchandes
met laccent sur le type de ressources mobilises, celle de linnovation sociale
insiste sur la nature systmique de linnovation et sur lampleur de limpact
social. Brouard et al. (2008) suggrent que les entreprises sociales sont dfinies
comme des organisations cres afin de poursuivre des missions sociales ou des
objectifs visant gnrer des bnfices sociaux indpendamment de leur proprit
ou de leur structure juridique avec des degrs varis dautofinancement, dinnovation et de transformation sociale.
En Europe et dans le cadre du Programme Leonardo da Vinci, la Commission europenne dfinit lentrepreneur social comme une personne qui
exerce une fonction de direction dans une entreprise dont la finalit conomique
est conjointe ou subordonne une finalit rpondant des valeurs de solidarit entre personnes, groupes sociaux, territoires [...]. Son action est de concevoir,
promouvoir, dvelopper lactivit de cette entreprise dans sa finalit solidaire et
sociale . Au Royaume-Uni, le Cabinet Office propose une dfinition qui
inclut les entreprises sociales tout en accordant une place certaines coopratives : Une entreprise sociale est une activit avec des objectifs principalement
sociaux dont les surplus sont en grande partie rinvestis pour ce but ou dans la
communaut, plutt qutre conduit par le besoin de maximiser les bnfices pour
des actionnaires et des propritaires. 51
A partir des diffrentes dfinitions avances de lentrepreneuriat social,
Huybrechts et al. (2012) dgagent trois dimensions caractrisant cette notion :
la finalit socitale, linnovation et lorientation march.
La finalit sociale rside dans le fait que la priorit est accorde aux
aspects sociaux et environnementaux. La finalit sociale devrait se retrouver
dans la production de biens et de services et dexternalits positives ainsi
que dans les processus organisationnels. La finalit sociale devrait tre identifiable par les rsultats de lentreprise sociale travers ses impacts sociaux
et environnementaux.
Linnovation porte sur le dveloppement de nouveaux processus ou
modles organisationnels ou biens et services ou encore de nouvelles ides
face aux dfis sociaux. Selon Huybrechets et al. (2012), linnovation suit un
processus schumptrien et vise le recentrage des marchs autour de nouveaux quilibres ou la modification de systmes. De ce fait, linnovation peut
avoir soit une porte mineure ( au niveau micro) soit une porte radicale (au
niveau des systmes). De son ct, Fontan (2011) souligne que linnovation
peut porter sur des actions rformistes porte mineure (nouveau service),
ou porte majeure (nouveau march, nouvelle organisation). Linnovation
peut, par ailleurs, porter sur des actions de rupture porte stratgique (nouvelle organisation du travail, nouveau mode de gouvernance) ou porte
radicale ( nouveau systme conomique ou politique).
Lorientation march se manifeste par la mobilisation de ressources marchandes travers la production de biens ou de services, par la prise de risque
conomique, par la combinaison de travail rmunr et du bnvolat et par
lamlioration des performances de lorganisation par la volont de rendre
des comptes (Nicholls, et al., 2006).
131
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Selon lapproche du rseau Emergence de lentreprise sociale en Europe
(Emes), la production de biens et de services reprsente la raison dtre de
lorganisation. Elle devrait tre implique dune manire continue dans la
production de biens ou loffre de services aux personnes, ce qui exclut les organisations de dfense dintrts et de redistribution de fonds des entreprises
sociales (Defourny & Nyssens, 2010). Dans ce cadre, les auteurs soulvent
des divergences rgionales. En Europe, la production de biens et de services
incarne en elle-mme la poursuite de la mission sociale. Une vision partage
par lcole de linnovation sociale. Contrairement cette vision, lcole des
ressources marchandes considre lactivit commerciale comme une simple
source de revenus en soutien la mission sociale. La vente de biens et services
est secondaire.
En matire de mobilisation de ressources, des divergences apparaissent
entre diffrentes coles de pense. Alors que lcole nord amricaine de linnovation sociale et lapproche europenne saccordent sur le caractre hybride
des ressources (revenus gnrs de lactivit conomique, dons, fonds publics,
bnvolat), lcole nord amricaine des ressources marchandes se limite la
mobilisation essentiellement des revenus gnrs de lactivit conomique
( Defourny & Nyssens, 2010).
En distinguant lentrepreneuriat, au sens large, de lentrepreneuriat
social et collectif, Lvesque (2002) note que la prise de risque est une caractristique commune ces trois types dentrepreneuriat mais celle-ci nest pas
du mme ordre. Dans le cas de lentrepreneuriat social, ou collectif, le risque
est assum des fins sociales ou collectives. Le risque conomique est totalement ou partiellement assum par les crateurs de lentreprise sociale. Selon
Defourny & Nyssens (2010), la viabilit financire dpend des efforts consentis par les membres (bnvoles ou travailleurs) pour assurer lentreprise des
ressources suffisantes la poursuite de sa mission sociale. Cette vision nest
pas partage par les tenants de lcole des ressources marchandes qui insistent
sur le fait que la viabilit conomique est fondamentalement tributaire des
ressources commerciales gnres.
Lactivit de lentreprise sociale requiert un niveau minimum demploi
rmunr (Defourny & Nyssens, 2010). Comme les organisations de lconomie sociale et solidaire, les entreprises sociales font appel des ressources
montaires et non-montaires, des travailleurs rmunrs comme des
volontaires.
Un des aspects cruciaux de lentreprise sociale est la structure de gouvernance. Lvesque (2002) et Fontan (2011) soulignent que le modle de
gouvernance au sein des entreprises sociales est la fois vertical et horizontal. Dans leur analyse comparative entre les deux approches nord amricaine et europenne de lentrepreneuriat social, Defourny & Nyssens (2010)
rapportent que lEmes insiste sur trois caractristiques essentielles de la
gouvernance des entreprises sociales. Celles-ci doivent avoir un degr lev
dautonomie par rapport aux entreprises prives lucratives et par rapport aux
pouvoirs publics. Identiquement aux organisations de lconomie sociale et
solidaire, lEmes souligne que la prise de dcision est base sur le principe
un membre, une voix et ce, indpendamment de la dtention du capital.
Cet aspect est ignor par les coles des ressources marchandes et de linno-
132
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
vation sociale. Par opposition lcole de linnovation sociale o le centrage
est fait sur lentrepreneur, le rseau accorde une importance la dynamique
participative o les diffrentes parties prenantes, concernes de prs ou de
loin par les activits de lentreprise sociale, peuvent tre impliques dans la
prise de dcision. Selon ces auteurs, la structure de gouvernance telle que
prconise par lEmes constitue un ensemble de caractristiques organisationnelles qui garantissent la poursuite de la mission sociale.
Bien quil y ait des divergences entre lapproche europenne et celle nord
amricaine, Huybrechts et al. (2012) soulignent que celles-ci sont en train de
sestomper. Emerson (2006) souligne la ncessit de converger lapproche de
lcole des ressources marchandes et celle de linnovation sociale dans une
caractrisation de lentrepreneuriat social et ce, quelque soit la forme juridique de lorganisation, en retenant comme caractristiques : i) la poursuite
dimpacts sociaux ; ii) linnovation sociale ; iii) la mobilisation de ressources
marchandes ; iv) lutilisation des mthodes managriales ; v) la considration
de la double-triple ligne de rsultat ; et vi) la cration dune valeur ajoute
hybride (dimensions conomique et sociale).
Distinction par rapport des notions proches
outre lutilisation interchangeable des notions dentrepreneuriat social,
dentrepreneur social et dentreprise sociale, celles-ci ont aussi souvent t
confondues avec dautres notions trs proches telles que celles du social business, de la responsabilit sociale des entreprises, de linnovation sociale et du
secteur de lconomie sociale et solidaire. De ce fait, il est jug pertinent de
distinguer notre champ dinvestigation par rapport ces notions proches. Cet
exercice est essentiellement bas sur celui men par Huybechts et al. (2012).
Social business
le social business est une notion diffuse rcemment par le prix Nobel de
la paix et fondateur de la Grameen Bank. Cest une organisation qui poursuit
une mission plutt que le profit et qui peut agir en tant quagent de changement
pour le monde (Yunus, 2007, p. 22).
Huybrechts et al. considrent que le concept de social business est plus
restrictif que celui de lentreprise sociale ou de lentrepreneuriat social. Dune
manire quivalente aux organisations de lconomie sociale et solidaire, le
social business simpose la contrainte de non-distribution. Toutefois, celui-ci
diffre des organisations de lconomie sociale et solidaire et de lentreprise
sociale sur certains aspects. Les social businesses doivent imprativement se
financer et couvrir leur cot par le march et non pas par la philanthropie ou
par le financement public, comme les organisations de lconomie sociale et
solidaire. Dans le mme contexte, les tudes empiriques de lentrepreneuriat
social montrent une mixit des sources de financement (Bacq & Janssen,
2011). En outre, la notion de social business ignore la possibilit dhybridation
des logiques sociales et commerciales (Billis, 2010; Di Domenico, et al., 2010;
Huybrechts, 2012). Dans ce sens, Defourny & Nyssens (2010) considrent le
social business comme proche de lentreprise sociale telle que dfinie dans
les travaux de deuxime gnration de lcole des ressources marchandes.
133
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Responsabilit sociale de lentreprise
suivant le trait de Lisbonne la responsabilit socitale de lentreprise est
un concept qui dsigne lintgration volontaire par les entreprises, des proccupations sociales et environnementales leurs activits commerciales et leurs relations
avec les parties prenantes.
Selon les auteurs de lcole des ressources marchandes (Baron, 2007;
Austin, et al., 2006), la responsabilit sociale de lentreprise pourrait tre
considre comme proche ou synonyme de lentrepreneuriat social. Toutefois, Huybrechts et al. (2012) dgagent deux lments qui diffrencient
lentrepreneuriat social de la responsabilit sociale de lentreprise. En premier lieu, la responsabilit sociale de lentreprise nest pas essentiellement
entrepreneuriale ou innovante. En second lieu, les deux formes ont des finalits divergentes. En entrepreneuriat social, la mission sociale est prioritaire
et les bnfices sont un moyen datteindre cette mission (les bnfices sont
rinvestis au moins partiellement).
Innovation sociale
linnovation sociale est dfinie comme de nouvelles solutions apportes aux besoins socitaux. Elle peut apparatre dans nimporte quel secteur
(public, priv capitaliste, priv non lucratif). De ce fait, bien que lentrepreneuriat social et linnovation sociale se recoupent, cette dernire nest
pas forcment oriente march. Mulgan et al. (2007) et Phills et al. (2008)
considrent linnovation sociale comme un terme gnrique auquel lentrepreneuriat social et dautres initiatives novatrices peuvent se rattacher.
Entrepreneuriat social et conomie sociale et solidaire
huybrechts et al. (2012) considrent que le concept de lconomie sociale
et solidaire est la fois plus large et plus restreint que lentrepreneuriat social.
Il est plus large dans la mesure o toutes les dynamiques ne sont ni entrepreneuriales ni marchandes. Il est plus troit dans le sens o lentrepreneuriat
social ne se limite pas aux organisations ayant un statut juridique spcifique
lconomie sociale et solidaire (association, cooprative, mutuelles et fondations). Defourny & Nyssens (2010) avancent que les entreprises sociales
peuvent galement se dvelopper dans le cadre dautres statuts juridiques
que ceux des organisations de lconomie sociale et solidaire (un cadre juridique spcifique).
Lconomie sociale fait rfrence un secteur de manire statique et
mesurable (Huybrechts, 2012). Par contre, lentrepreneuriat social dsigne
des processus entrepreneuriaux finalit sociale qui sont bien souvent ancrs
dans lconomie sociale et solidaire mais qui peuvent se situer au carrefour
de plusieurs secteurs existants. A cet gard, Fontan (2011) suggre que ltat
pourrait initier des projets dentrepreneuriat social vocation publique.
Defourny & Nyssens (2010) considrent que le concept dentreprise
sociale peut tre un vecteur dintgration de toute lconomie sociale et solidaire. Selon les auteurs, lapprhension de lconomie sociale et solidaire
souffre de deux tensions. La premire trouve son origine dans lcart existant
entre les entreprises offrant toute leur production sur le march ( telles que les
coopratives ) et les associations dont les activits seraient peu conomiques
134
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
et dont les ressources sont assez souvent non-marchandes. Cet cart est en
train de se rduire dans la mesure o les organisations de la socit civile
adoptent de plus en plus une orientation marchande. La deuxime tension
est identifie entre les organisations intrt mutuel servant essentiellement
leurs membres ( exemple des coopratives et des mutuelles) et celles intrt
gnral au service dune communaut plus large ( limage des associations
environnementales ). Cette tension est en train de sestomper dans le sens o
les coopratives sont de plus en plus au service dusagers non-membres. A
cet gard, les auteurs soulignent que le rle intgrateur de lentreprise sociale
rside dans le fait quelle met en lumire la proximit entre les associations
et les coopratives dintrt gnral.
Ampleur de lentrepreneuriat social
soulevant le caractre flou de la dfinition de lentrepreneuriat social, le
fait quil ne se rsume pas un statut juridique unique et quil soit focalis sur
les processus et non sur un secteur ou sur un type bien dtermin dorganisation, Huybrechts et al. (2012) reconnaissent que mesurer ltendue ou lampleur de lentrepreneuriat social savre un exercice difficile, voire impossible.
Toutefois, certaines tentatives ont cherch avancer des donnes chiffres de lentrepreneuriat social. Linitiative du Global Entrepreneurship
Monitor (Gem) a mis en place une enqute permettant de saisir limportance
de lentrepreneuriat social en Europe. Cette initiative a t largie lchelle
internationale en 2010. Une autre alternative permettant de collecter des donnes sur lentrepreneuriat social est de faire le suivi les activits des rseaux et
des structures dappui aux entrepreneurs et/ou entreprises sociaux.
Le rseau Emes a dvelopp un ensemble dindicateurs, souvent rencontrs dans la littrature, qui permettent de caractriser les entreprises sociales
(Defourny & Nyssens, 2010). Toutefois, ces indicateurs ne prtendent pas
mesurer quantitativement lampleur de lentrepreneuriat social. Ils permettent didentifier et de suivre lmergence des entreprises sociales dans le
secteur de lconomie sociale et solidaire.
Dans le cadre de ce rapport, lidal-type de lEmes constitue un rfrentiel pertinent pour identifier les organisations tunisiennes de lconomie
sociale et solidaire qui sinscrivent dans une logique dentrepreneuriat social,
de dgager leurs faiblesses afin de proposer des recommandations permettant de les insrer encore plus dans le champ conomique.
135
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Contexte conomique, dmographique et social en Tunisie
etconomie sociale
lmergence de lconomie sociale et solidaire en Tunisie ne date pas
daujourdhui. Des facteurs dordre socio-conomique, mais aussi politique,
y ont contribu.
Contexte socio-conomique
dans le cadre de lanalyse du contexte socio-conomique, il sagit de traiter les caractristiques dmographiques et ducationnelles de la population,
dune part, et celles socio-conomiques, dautre part.
Contexte dmographique
la population tunisienne est caractrise par une lgre supriorit
fminine par rapport la population masculine. La part de la population
fminine a volu de 50 % en 2007 50,2 % en 2011. Lanalyse de la population par structure dge montre deux faits marquants. Le premier concerne
limportance des jeunes entre 15 et 29 ans avec une part de 28,5 % de la
population totale en 2011. Le deuxime concerne la croissance de la part de
population ge de 60 ans et plus. figure 1
La projection de la population lhorizon de 2039 montre une tendance
la hausse de la part des seniors dans la population. La part de la population
ge de 60 ans et plus passerait de 9,8 % en 2009 13 % en 2019 et 20,1 %
en 2039. Dun autre ct, la part des moins jeunes entre 5 et 14 ans rgresserait de 15,8 % en 2009 12,9 % en 2039. La part de la population entre
15 et 59 ans connatrait aussi une baisse en passant de 66,3 % en 2009
60,2 % en 2039. figure 2
Ces volutions suggrent la ncessit daccorder une attention particulire trois types de populations savoir les femmes, les jeunes et les personnes ges de 60 ans et plus. Sur les court et moyen termes, les schmas
de dveloppement socio-conomiques doivent, non seulement, prendre en
considration les aspirations des femmes et des jeunes, mais aussi les faire
participer dans la conception desdits schmas. Le vieillissement de la population entraine lmergence de nouveaux besoins sociaux spcifiques auxquels
des rponses doivent tre apportes.
Limportance de la population fminine et des jeunes saccentue encore
dans la mesure o lon tient compte des caractristiques ducationnelles
de ces deux populations. Si lon considre les jeunes ayant un ge compris
entre 15 et 24 ans, la proportion de la population ayant un niveau secondaire
et suprieur est de lordre de 82,7 %. Lanalyse par genre montre une lgre
supriorit masculine au niveau secondaire mais une supriorit fminine
au niveau suprieur. figure 3
En considrant la tranche dge 25 ans et plus, la proportion de la population nayant pas de niveau ou au moins un niveau primaire reprsente 59,5 %
du total de la population appartenant cette tranche. Lun des faits marquants
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
136
figure
Tunisie
1 Structure de la population par genre ( gauche )
et par catgories dge ( droite )
Institut national de la statistique Tunisie.
figure
2 Projection de la population lhorizon 2039 par catgories dge
Institut national
de la statistique
Tunisie.
figure 3 Structure des populations ges de 15-24 ans ( gauche)
et de 25 ans et plus ( droite) par niveau dinstruction et par genre
Enqute nationale sur la population et lemploi 2011 - INS.
est que la proportion des femmes ges de 25 ans et plus, ayant un niveau
primaire ou infrieur, reprsente 65,8 %. Cette population reprsente 59,4 %
de la population fminine au cours de 2011.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
137
figure
4 volution de la structure
figure
Tunisie
5 Croissance
conomique de la Tunisie
conomique en Tunisie
World Development Indicators Database - World Bank
World Development Indicators Database - World Bank
Le contexte conomique
lconomie tunisienne est principalement tertiaire. La part moyenne
des services reprsente 59,1 % sur la priode 2007-2011. Ces valeurs sont
nuancer puisque les services intgrent aussi les services de ladministration
publique. Ceux-ci reprsentent en moyenne 16,4 % sur la priode 2006-2010.
La part moyenne de lagriculture est en rgression sur les trois priodes danalyse. Elle passe de 11,7 % sur la priode 1997-2001 8,6 % sur la priode
2007-2011. figure 4
Lconomie tunisienne a enregistr une croissance soutenue avec un taux
de 5 % sur les priodes 1997-2001 et 2002-2006. Sur la priode 2007-2011,
la Tunisie na enregistr quun taux de 2,2 %. Cette contre-performance est
explique par la crise conomique mondiale de 2008, la crise de lendettement
en Union europenne en 2010 et par le blocage de lconomie tunisienne au
cours de lanne 2011 suite la rvolution du 14 janvier. figure 5
Sur le plan sectoriel, la croissance conomique est principalement tire
par les services sur les priodes 1997-2001 et 2002-2006 avec, respectivement, une contribution de 3,4 % et 2,9 %. Au cours de la priode 20072011, la contribution sest limite 1,4 point de croissance. La contribution
de lindustrie la croissance sest amliore en passant de 1,6 point sur la
priode 1997-2001 1,7 point sur la priode 2007-2011. Lagriculture sest
caractrise par une contribution ngative sur la priode 2007-2011. En affinant lanalyse un niveau sectoriel plus dtaill, la contribution des services
fournis par les organisations associatives dans la croissance conomique,
est presque nulle (0,005 % sur la priode 2002-2006 et 0,004 % sur les
priodes 2007-2011).
Dans une autre perspective, comme le montre la figure 6, la croissance
conomique est tire par la consommation prive, les exportations et la
consommation publique. Le fait marquant est la contribution de plus en
plus faible de la formation brute du capital fixe. Elle est passe de 1,6 % sur
la priode 1997-2001 0,4 % sur la priode 2002-2006 pour croitre lgrement 0,7 % sur la priode 2007-2011. figure 7
La faible contribution de linvestissement notamment priv peut tre
explique par deux raisons lies la gouvernance et au climat des affaires.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
138
figure
6 Contribution sectorielle
la croissance conomique
figure
Tunisie
7 Contribution des emplois
la croissance conomique
World Development Indicators Database - World Bank
World Development Indicators Database - World Bank
Par rfrence aux indicateurs de gouvernance dvelopps par le groupe
de recherche la Banque mondiale (Kaufmann, et al., 2013), les scores de la
Tunisie sur les dimensions voix citoyenne et responsabilit, efficacit du gouvernement et lutte contre la corruption se sont dgrads sur la priode 19962010. Le rapport sur la comptitivit globale publi par le Forum conomique
mondial (2011) vient confirmer ces scores. Selon lenqute mene dans le cadre
de ce rapport, linefficience bureaucratique du gouvernement est le principal
facteur problmatique dans le climat des affaires. Linstabilit des politiques
conomiques figure la quatrime place. De son ct, la corruption figure
la septime place des facteurs problmatiques.
Suivant le rapport relatif au climat des affaires (Banque Mondiale et
Socit financire internationale, 2013), bien que la Tunisie soit classe cinquantime sur 185 conomies, elle a perdu cinq places par rapport 2012. La
dgradation du climat des affaires en Tunisie est explique par le retard en
matire de rformes ciblant la cration dentreprise et lobtention de prts par
rapport aux autres conomies tudies. En matire de financement, le Forum
conomique mondial souligne que la Tunisie a un dsavantage comptitif
en matire daccs aux services financiers et de facilit dobtention de prts
qui est considre comme le deuxime facteur problmatique pour faire des
affaires.
La faible part de linvestissement priv et sa faible contribution la croissance constitue un frein la cration demplois. A cet gard, le taux de chmage national a atteint 17,2 % en 2012, alors quil tait autour dune moyenne
de 12,7 % sur la priode de 2006-2010. Cette accentuation du chmage est
fondamentalement explique par le blocage de lconomie au cours de 2011
et la reprise lente au cours de 2012.
Au-del du taux de chmage absolu, la structure du chmage en fonction
du niveau dinstruction et par genre montre limportance du chmage chez
les diplms de lenseignement suprieur, dune part, et chez les femmes,
dautre part. En considrant le taux de chmage par genre, il est plus lev
chez la population fminine que celui de la population masculine ou encore
la moyenne nationale. En outre, le chmage enregistr chez la population
fminine diplme de lenseignement suprieur est largement suprieur
celui observ chez la population masculine. figure 8
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
139
figure
Tunisie
8 : Taux de chmage national ( gauche) et des diplms
de lenseignement suprieur ( droite) par genre
Enqute sur la population et lemploi 2012 - Institut National de la Statistique
52. Lindice de Gini
indique dans quelle
mesure la rpartition
des revenus entre
les individus ou les
mnages au sein
dune conomie
scarte de lgalit
parfaite. Le coefficient
de Gini est compris
entre 0 (galit
parfaite) et 100
(ingalit absolue).
Source : Banque
mondiale.
Dans le cadre du rapport sur lquit des genres publi par la Banque
mondiale (2013, a) , la Tunisie connait un paradoxe de parit de genre : malgr
les progrs raliss en matire de rduction de lcart existant entre les deux
genres dans les domaines de la sant et de lducation, ceux-ci ne se sont pas
traduits par une meilleure participation de la population fminine la vie
conomique. Selon cette tude, les barrires une telle participation sont lies
au dcalage entre la formation et les comptences exiges par le secteur priv,
la lgislation du travail et aux normes sociales et culturelles.
Outre la problmatique du chmage, le soulvement populaire du 14 janvier 2011 a point du doigt les disparits rgionales et les ingalits sociales
qui caractrisent le dveloppement socio-conomique en Tunisie. En matire
dingalits sociales, lindice de Gini52 montre une lgre rgression des ingalits en passant dune valeur de 37,5 en 2000 35,8 en 2010. La dcomposition de lindice, de manire mieux caractriser les ingalits, montre un
accroissement des ingalits entre les rgions et donc une aggravation des disparits entre elles. Le niveau de vie dans les rgions les plus pauvres a cru sur
la priode danalyse un rythme plus faible que les rgions les plus nanties.
Dun autre ct, la figure 7 montre une rduction des ingalits intra-rgionales
o la valeur de lindice passe de 21,1 en 2000 17,6 en 2010. La rduction des
ingalits intra-rgionales est synonyme de plus de convergence du niveau de
vie des personnes habitant la mme rgion. figure 9
En matire de pauvret, le taux est de lordre de 15,5 % en 2010, en baisse
par rapport 2005 et 2000. Cette baisse sexplique par la croissance plus
rapide de la consommation que des prix sur la priode 2000-2010. Nanmoins, il faut souligner que le taux de pauvret dans le milieu non communal
(rural) varie presque du simple au double par rapport la moyenne nationale.
figure 10
Lanalyse de la pauvret par rgion montre des disparits entre les rgions
littorales et celles de lintrieur et du sud de la Tunisie. Alors les rgions
du Grand Tunis, du Nord-Est et du Centre-Est affichent des taux largement
infrieurs la moyenne nationale, des rgions comme le Centre-Ouest et le
Sud-Ouest affichent des taux largement suprieurs la rfrence nationale.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
140
figure
9 Evolution
delindice de Gini
enTunisie
figure
Tunisie
10 Taux de pauvret en Tunisie
et par rgion (en %)
La ligne rouge horizontale reprsente le taux de pauvret lchelle nationale
Institut National de la Statistique
Institut National de la Statistique
La revue du contexte socio-conomique appelle les observations suivantes :
sur le plan dmographique, les jeunes et les femmes constituent une
part importante de la population. Nanmoins selon les projections faites
lhorizon 2039, la Tunisie observerait un vieillissement de la population et
donc, lmergence de nouveaux besoins socitaux ;
lanalyse du contexte conomique fait ressortir un cart persistant en
matire de parit du genre malgr les progrs enregistrs au niveau de la
sant et de lducation. Laccs des femmes, notamment les diplmes de
lenseignement suprieur, aux opportunits demplois reste faible ;
malgr une croissance conomique soutenue sur la priode 1997-2010,
les fruits de celle-ci nont pas t rpartis quitablement entre les rgions et
les groupes sociaux. Bien quil y ait une certaine convergence en matire de
niveau de vie au sein dune mme rgion, les ingalits et les disparits interrgionales saccentuent. Les ingalits dans les rgions les plus dmunies ont
cru un rythme relativement plus faible que dans les rgions les plus nanties.
Le contexte socio-conomique de la Tunisie a favoris lmergence du
secteur de lconomie sociale et solidaire et notamment linsertion des organisations de ce secteur dans une logique dentrepreneuriat social et collectif.
Nanmoins, la particularit de la Tunisie est que sur le plan historique, ces
organisations ont toujours exist, mme avant lindpendance. Sur le plan
politique, ces organisations ont t tantt reconnues comme acteurs de dveloppement conomique et social, juste aprs lindpendance, et tantt cartes, contrles et considres comme un instrument damlioration dimage
linternational, essentiellement sous lre Ben Ali.
Le dispositif de lconomie sociale et solidaire en Tunisie est diversifi et
en mutation constante suivant les priorits sociales et conomiques du pays.
Il compte une varit dorganismes de types associatif, coopratif, mutualiste, professionnel.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
141
figure
Tunisie
11 volution du nombre dassociations en Tunisie
www.ifeda.org
Consult
le 2 mars 2013
figure
12 Rpartition des associations par champ dintervention (2012)
www.ifeda.org
Consult
le 2 mars 2013
Le dispositif de lconomie sociale et solidaire en Tunisie
le dispositif de lconomie sociale et solidaire en Tunisie est compos
des organisations classiques du secteur : les associations, les mutuelles et les
fondations, les coopratives, les groupements professionnels et les structures
agricoles.
53. Le centre
Ifeda collecte les
informations relatives
aux associations
en se basant sur
les demandes de
cration adresses
la Direction des
associations au niveau
du Premier ministre
(et au Ministre de
lintrieur avant
la rvolution du
14 janvier 2011).
Lactualisation
durpertoire nest
pasfaite.
Les associations
lanalyse mene dans le rapport est base sur des donnes compiles du
rpertoire des associations conu et gr par le centre dinformation, de formation, dtudes et de dveloppement des associations (Ifeda)53. Toutefois, il
convient de soulever des remarques quant la pertinence de ces donnes :
le rpertoire des associations reste peu actualis : manque de donnes
sur les prsidents des associations, les coordonnes et ltat des associations ;
le rpertoire tient compte aussi bien des associations actives que de
celles qui ne le sont pas ou qui ont disparu. Le nombre des associations en
Tunisie est surestim et le rpertoire mrite dtre purifi.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
142
figure
Tunisie
13 Rpartition des associations par rgion (2012)
www.ifeda.org
Consult
le 2 mars 2013
Depuis la rvolution du 14 janvier 2011, la Tunisie a vu le nombre des
associations prolifrer. Alors que le nombre des associations tait de 9 561
en 2010, il est pass 14 729 en 2012. Cet accroissement sexplique par les
acquis de la rvolution en termes de libert de groupement et dassociation,
dune part, et par la simplification des procdures de cration dassociation,
dautre part. figure 11
La rpartition des associations par champ dintervention, montre une
grande diversit couvrant diffrents domaines conomiques, sociaux et environnementaux. Les associations daction de dveloppement des coles reprsentent presque le tiers du nombre des associations, suivies par les associations culturelles et artistiques (16 %) et des associations de dveloppement,
de micro-crdits et de charit sociale (12 % respectivement). figure 12
La rpartition gographique par rgion des associations montre une
concentration des associations sur le Grand Tunis, les rgions du Centre-Est
et du Nord-Est. Ceci sexplique par la nature du systme politique et conomique de la Tunisie:
Durant les deux dernires dcennies, lorientation du dveloppement
sest toujours concentre sur les rgions littorales. La proximit des associations des ples conomiques favoriserait laccessibilit de celles-ci au financement provenant du secteur priv.
Bien quil y ait des offices de dveloppement au niveau de ces rgions,
et linstitution de conseils rgionaux au niveau des gouvernorats, le centre
de prise de dcisions et de dfinition des politiques conomiques et sociales
est rest concentr au niveau de la capitale. Combin au manque de transparence et douverture quant la diffusion de linformation, lloignement
de ce centre constitue une contrainte pour les associations.
Dans le mme sens que le point prcdent, bien que ladministration
publique soit reprsente par des directions et des reprsentations rgionales, ces dernires restent sous-quipes et dpourvues dun interlocuteur
avec les associations. figure 13
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
143
figure
Tunisie
14 Rpartition des associations et taux dincidence de pauvret par rgion
www.ifeda.org
Consult le 2 mars 2013,
INS
Cette rpartition savre paradoxale si lon tient compte des taux de lincidence de pauvret dans les diffrentes rgions. En effet les rgions o les
besoins socio-conomiques savrent importants sont celles o le nombre dassociations est le plus faible. Alors que la rgion du Centre-Ouest connat un
taux dincidence de pauvret de 32,3 %, la part des associations dans la rgion
est de 11,6 %. De mme pour la rgion du Sud-Ouest et Nord-Ouest. figure 14
Ce rsultat, doit tre interprt avec prcaution. En effet, daprs les rsultats de lenqute mene auprs de 259 associations dans le cadre de ltude
ralise par la Banque Africaine de Dveloppement (2012), 37,6 % des rpondants interviennent un niveau national, 41,4 % un niveau rgional, 42,1 %
au niveau du gouvernorat, 45,1 % au niveau municipal et 20,3 % seulement
au niveau du quartier ou du voisinage.
A partir de ce rsultat, une association base Tunis, par exemple,
pourrait intervenir Kasserine ou Kairouan. Toutefois, les rsultats de cette
enqute nous interpellent aussi sur la proximit des associations du terrain.
Les mutuelles
dun point de vue historique, le secteur des mutuelles a merg, en
Tunisie, lors de la priode coloniale limage de la mutuelle de lAgence
nationale du tabac, Ettaouen, et la mutuelle Ettadhamen pour les orphelins
du personnel de lenseignement de la Rpublique tunisienne.
Les mutuelles visent linstauration dun systme mutualiste et solidaire
entre les adhrents travers la couverture des risques inhrents la personne
humaine comme les maladies, la maternit, la vieillesse, les accidents et
linvalidit et ce, en faveur des adhrents et de leurs familles en contre partie
de cotisations. Cette couverture est complmentaire celles fournies par les
caisses nationales de scurit sociale et de retraite.
La Tunisie compte 48 mutuelles en 2012. Elles sont rparties comme
suit : quinze mutuelles dans le secteur public, vingt mutuelles dans le secteur
semi-tatique et treize dans le secteur priv.
La revue de ce sous-secteur est base sur un rapport annuel publi par le
ministre des Finances. Les donnes relatives aux ralisations des mutuelles
restent non actualises. Le dernier rapport disponible remonte 2008 et
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
144
figure
Tunisie
15 Rpartition des sources de revenus des mutuelles
par type de source et par secteur
Les subventions de lEtat ne sont accordes
quaux mutuelles du secteur public.
Lacontribution patronale ne concerne que
lesecteur des entreprises tatiques et prives.
Rapport sur le secteur des mutuelles, 2007
figure
16 Ventilation des dpenses des mutuelles par type de prestation et par secteur
Rapport sur le secteur
des mutuelles, 2007
porte sur les ralisations de 2007. Par ailleurs, le rapport ne tient compte que
de 38 mutuelles qui ont communiqu leurs documents financiers.
Le nombre dadhrents slve 291915, et le nombre des bnficiaires
non-adhrents 513 704, soit un total de bnficiaires de 805 619 en 2007.
La rpartition des bnficiaires entre les trois secteurs montre une part trs
importante dans le secteur public avec 59, 2 %, suivi du secteur semi-tatique avec 39,4 % alors que le secteur priv ne reprsente que 1,4 %.
Du point de vue des ressources, la part des cotisations et des revenus
de participation constituent les premires sources de revenus. Lanalyse par
type de secteur montre que, pour le semi tatique et le priv, la contribution
patronale et la cotisation des adhrents sont les sources de revenus les plus
importantes. figure 15
Les prestations offertes par les mutuelles portent sur le remboursement
de frais mdicaux, des prestations sociales (prime de mariage, de rentre scolaire, primes accordes pour les ftes religieuses, etc.), les indemnits de mise
la retraite, les indemnits dcs, les crdits ainsi que dautres activits.
La ventilation des dpenses par type de prestation, montre limportance
des remboursement de frais mdicaux et des crdits accords qui accaparent,
respectivement, 46,1 % et 25,4 % des dpenses globales des mutuelles tudies. Les prestations sociales reprsentent 12,8 %. figure 16
145
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
La structure des dpenses par secteur montre limportance des crdits
suivi des remboursement de frais mdicaux et des prestations sociales au
niveau des dpenses des mutuelles du secteur public. Par contre, dans les
secteurs semi-tatique et priv, le remboursement des frais mdicaux accapare la plus grande part des dpenses globales des mutuelles. Un des faits
marquants est limportance des frais de gestion des mutuelles appartenant
au secteur priv, avec une part de 16% alors quelle ne reprsente que 5 %
dans le secteur public et 6 % dans le secteur semi-tatique.
Les organismes professionnels agricoles
la tunisie comptait une diversit dorganismes professionnels agricoles
savoir : les coopratives de services agricoles, les groupements dintrt collectif, les groupements forestiers dintrt collectif, les groupements professionnels, les groupements interprofessionnels et plus rcemment les groupements
de dveloppement agricole et les socits mutuelles de services agricoles.
A partir de 1999 et plus rcemment, depuis 2005, les organismes professionnels agricoles ont connu une restructuration sur le plan de la forme
juridique. Dsormais les groupements dintrt collectif caractre gnral
et ceux caractre spcifique (forestier, oliculture, conservation de leau et
du sol ) oprent sous la dnomination des groupements de dveloppement
agricole et les coopratives centrales et de services agricoles ont migr vers
le statut de socit mutuelle de services agricoles.
Dans le cadre de cette tude, lintrt portera sur les socits mutuelles
de services agricoles et les groupements de dveloppement agricole.
Les socits mutuelles de services agricoles (SMSA). Les SMSA sont des
socits capital et actionnaires variables et exercent dans le domaine de
lagriculture et de la pche. Elles visent fournir des services leurs adhrents en vue de mettre niveau les exploitations agricoles et damliorer la
gestion de la production.
Les SMSA sont charges notamment de fournir les intrants et les services ncessaires pour lexercice de lactivit agricole ou de pche, dorienter et encadrer leurs adhrents afin dassurer la viabilit conomique des
exploitations et damliorer la qualit des produits, et de commercialiser les
produits agricoles.
Les SMSA se rpartissent en deux types : les socits mutuelles centrales et celles de base. La SMSA de base offre une ou plusieurs activits qui
ne dpassent pas son primtre dintervention. Elle regroupe les adhrents
dont les exploitations ne dpassent pas les frontires administratives du gouvernorat avec la possibilit de stendre sur un gouvernorat juxtapos sans
couvrir tout le territoire tunisien. Dun autre ct, la SMSA centrale, appele
auparavant cooprative centrale agricole, assure une seule prestation sur tout
le territoire tunisien. Elle est charge de fournir une prestation caractre
communautaire. Elle est constitue de SMSA de base. De ce fait, les adhrents
ce type de socit ont des exploitations rparties sur deux gouvernorats ou
plus pouvant tre non adjacents.
Le nombre total de SMSA en Tunisie a atteint 177 socits en 2012. Elles
se rpartissent en douze SMSA centrales et 165 SMSA de base.
146
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Parmi les douze SMSA centrales, trois ont t cres avant lindpendance, six au cours des annes 1970, une en 1997 et deux en 2012. Elles
comptent 2 412 adhrents et sont au service de 20756 usagers en 2012. En
moyenne, une SMSA centrale compte 201 adhrents et 1730 usagers. Elles
dtiennent un capital de lordre de 3925,4 milliers de TND et ont ralis un
chiffre daffaire de lordre de 561,4 millions de TND en 2012.
Sagissant des SMSA de base, elles comptaient 24381 adhrents et sont
au service de 34 669 usagers soit, en moyenne, 148 adhrents et 210 usagers
par SMSA en 2012. En termes de rpartition gographique selon les grandes
rgions de la Tunisie, les SMSA de base sont fortement prsentes au Centre
Est avec une part de 30 % du total, suivi par le Nord-Est avec 18 % des SMSA
et le Centre-Ouest avec 17 %. Le Nord-Est qui est une rgion vocation essentiellement agricole ne compte que 12% des SMSA de base.
Les groupements de dveloppement agricole et de la pche (GDAP). Les
groupements de dveloppement agricole et de la pche sont des associations
but non lucratif. Leur rle est trs important sur les plans conomique,
social et environnemental. En effet, leur objectif est de grer collectivement
les ressources naturelles dune zone clairement identifie et de contribuer
son dveloppement.
Les GDAP assurent des missions qui rpondent aux attentes de leurs
adhrents et aux exigences du dveloppement du secteur de lagriculture et de
la pche et des services qui lui sont lis. En effet, ces missions consistent en :
la protection des ressources naturelles et la rationalisation de leur utilisation ;
lexcution des travaux agricoles et des services de la pche ;
lquipement de leur primtre dintervention en quipements ruraux
ncessaires ;
laide des instances concernes lapurement des situations agraires ;
laugmentation de la productivit des exploitations agricoles ;
le dveloppement des systmes de parcours et des techniques dlevage ;
lencadrement de leurs adhrents en les orientant vers les meilleures
techniques de production ;
laccompagnement des adhrents dans la valorisation des produits sur
les marchs locaux et internationaux ;
ltablissement de relations dchange dexpertises et de coopration
avec dautres organismes agricoles locaux et internationaux.
On recense plusieurs types de GDAP suivant leur domaine dactivit :
les GDA et les GDP, et les GDA lis la gestion des ressources hydrauliques
tels que les GDA daccs leau potable et les GDA dirrigation.
La Tunisie compte 2742 GDA en 2011, en augmentation de 5,5 % par
rapport 2009. Les GDA couvrent une superficie totale de 9,6 millions
dhectares et dtiennent un capital de 9 408 millions de TND.
Du point de vue rpartition gographique, tous domaines confondus, la
rgion du Centre-Ouest accapare 25,4 % des GDA suivie par celles du NordOuest, du Centre-Est et du Sud-Ouest avec des parts respectives de 17,7 %,
14,9 % et 13,5 % en 2011.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
147
figure
Tunisie
17 Rpartition des GDA suivant la nature de leur activit (2011)
Direction gnrale de financement,
dinvestissement et des organismes
professionnels (DG Fiop), ministre
delAgriculture
Comme lillustre la figure 17, les GDA lis la gestion des ressources
hydrauliques sont les plus nombreuses. En effet, la Tunisie compte 1267 GDA
deau potable et 1 243 GDA dirrigation en 2011. Le nombre des GDA et des
GDP est de 232. Ces GDA comptent 2 % de GDA dintrt communautaire
et 7 % de GDA dintrt collectif. La premire catgorie regroupe : les GDA
forestiers, les GDA de conservation du sol, les GDA de lutte contre la dsertification, les GDA de gestion des ressources naturelles, les GDA de protection
des nappes phratiques.
La deuxime catgorie compte les GDA de craliculture, les GDA dagriculture biologique, les GDA de propritaires doliviers, les GDA dlevage, les
GDA de pche, les GDA multi-activits et les GDA ayant dautres activits.
Les GDA comptent 526830 adhrents en 2011 soit, en moyenne 216 adhrents par GDA. Bien que le nombre de GDA ait augment, le nombre dadhrents a enregistr une baisse par rapport 2009 avec un taux annuel moyen
de - 7,3 %. Suivant le domaine dactivit, les GDA deau potable comptent
en moyenne 318 adhrents, ceux dirrigation 101 adhrents. Concernant les
GDA dintrt collectif, ils comptent en moyenne 177adhrents alors que
ceux dintrt communautaire nen comptent que 108. Suivant la localisation
gographique, la rgion du Centre-Ouest affiche le nombre moyen dadhrents par GDA le plus lev avec 333 adhrents, suivie par le Nord-Ouest et le
Sud-Est avec respectivement 211 adhrents et le Nord-Est avec 181 adhrents
en moyenne.
A lchelle nationale, la part de GDA ayant un directeur ne dpasse pas
32,8 %. Cette part varie selon le domaine dactivit et la localisation gographique. En effet, si lon considre le domaine dactivit, la part des GDA deau
potable et celle des GDA deau dirrigation ayant un directeur sont autour
de 27 % et 36 %. Bien que les parts avances soient proches de la moyenne
nationale, celles des GDA dintrt communautaire et collectif sont autour de
10 % et 12 % respectivement. Par rgion de localisation, celle du Sud-Ouest
compte la part la plus importante de GDA ayant un directeur avec 46 % des
GDA de la rgion, suivie par celle du Nord-Ouest et du Centre-Ouest avec
44,7 % et 40,3 % respectivement.
148
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Autres organisations dconomie sociale et solidaire
parmi les autres organisations de lconomie sociale et solidaire qui
existent en Tunisie, on cite les coopratives non-agricoles et les fondations.
Les coopratives non-agricoles. Suite linstauration du systme coopratif
( annes 1960 ), la Tunisie a enregistr la cration de coopratives de services
au Sahel et de coopratives commerciales Sfax. Actuellement, les informations sur ces coopratives, celles du secteur textile, du logement ou de
lartisanat, sont rares et disperses voire inexistantes. De ce fait, il nous est
impossible de dlimiter la taille ou den tudier les caractristiques.
Les fondations. Les fondations sont dfinies comme des organismes de droit
priv auxquels, par dons, donations ou legs, une ou plusieurs personnes
physiques ou morales consacrent des biens ou des droits mobiliers ou immobiliers en vue de les affecter une action sans but lucratif de type culturel,
pdagogique, scientifique ou de bienfaisance.
Les fondations interviennent pour amliorer les conditions de vie, les
sources de revenus et lhygine et la sant de lenfant, de la femme et de la
famille. Selon le rpertoire du centre Ifeda, la Tunisie compte trois fondations
savoir: la fondation Atlas pour lauto-dveloppement et de la solidarit, la
fondation El Kef pour le dveloppement rgional et la Fondation tunisienne
pour le dveloppement communautaire. Bien que ce secteur connaisse un
intrt important au niveau mondial, il reste peu dvelopp en Tunisie.
Les politiques publiques en matire dconomie sociale et solidaire
dans le cadre des politiques publiques en matire dconomie sociale
et solidaire, lattention portera sur les dispositifs institutionnel et de financement. Lobjectif est dapprcier si les pouvoirs publics en Tunisie ont mis
en place un cadre favorisant lmergence dentreprises sociales, leur dveloppement et leur expansion. Lanalyse du dispositif institutionnel rvle si
celui-ci facilite laccomplissement des missions sociales des organisations de
lconomie sociale et solidaire. Le dispositif de financement permet dapprcier les ressources mises la disposition des organisations de lconomie
sociale et solidaire afin quelles puissent mener terme leur mission sociale.
Dans un deuxime temps, une analyse comparative des politiques
publiques par rapport des pays europens et du Maghreb sera mene. Elle
rvlera les similarits et les complmentarits entre les dispositifs.
Le dispositif institutionnel
la diversit des organisations tunisiennes de lconomie sociale et solidaire ainsi que de leur domaine dintervention sest accompagne par la
multiplicit des structures tatiques administratives et techniques qui sont
en charge de ces organisations ou en interaction avec elles.
Les organisations du type associatif relevaient, avant la rvolution, du
ministre de lIntrieur et du dveloppement local. Lobjectif tait de contrler laction de la socit civile tunisienne. Aprs la rvolution du 14 janvier
2011 et afin de repositionner la socit civile et lui permettre daccomplir sa
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
149
54. Cette tude,
publie en mars
2012 par lUnion
Europenne (UE),
est un rapport
de diagnostic sur
la Socit Civile
Tunisienne (SCT).
55. Le cadre juridique
des organisations de
lconomie sociale
et solidaire en
Tunisie ( association,
mutuelles, coopra
tives et organismes
professionnels
agricoles ) est trait
dune manire
dtaille en annexe
durapport.
Tunisie
mission, les organisations relvent, dsormais, du Premier ministre qui
sest dot dune direction des associations. Cette direction assure le suivi de
la cration des organisations du type associatif, de leurs activits et veille au
respect de la rglementation en vigueur.
Outre cet organe, le premier ministre est aussi dot dun centre dinformation, dtudes et de documentation sur les associations le centre Ifeda.
Ce centre est cr en vertu du dcret n2000-688 du 5 avril 2000. Parmi ses
attributions, on cite :
assumer le rle dobservatoire de lactivit associative, travers la collecte de donnes, dinformations, des publications la concernant tout en les
rpertoriant dans une banque de donnes cre cet effet ;
mener des tudes dvaluation et de prospection et des recherches relatives aux associations ;
organiser des sminaires dapprentissage et de formation, des journes
dtudes et des rencontres aidant les associations accomplir leur mission;
faciliter la coopration et la collaboration entre les diffrents intervenants dans le domaine associatif ;
aider llaboration et la mise en place de programmes permettant de
promouvoir le travail associatif.
Le centre Ifeda reste concentr sur les associations bien que dautres organisations de lconomie sociale et solidaire soient rgies par le cadre juridique
relatif lassociation telles que les fondations, les mutuelles et les amicales.
Daprs ltude mene dans le cadre du Programme dappui la socit civile
en Tunisie (Pasc)54, le centre Ifeda sest focalis essentiellement sur la formation. Sur le plan organisationnel, ltude souligne aussi labsence dimplication
des associations dans le conseil dadministration du centre (COWI, 2012).
tant donne la diversit des domaines dintervention des organisations
tunisiennes de lconomie sociale et solidaire, dautres ministres sont aussi
dots de directions ou de services ddis aux relations avec elles. A titre
dexemple ( Belaid, 2007), au niveau du ministre des Affaires sociales, la
Direction gnrale de la promotion sociale (DGPS) joue un rle de soutien
aux organisations de lconomie sociale et solidaire et plus particulirement
les associations caractre social. Cette direction est dote dune sous-direction des associations qui est charge de participer llaboration de la lgislation relative la promotion du secteur associatif, dexaminer les demandes
de subvention manant des associations et dassurer la coordination entre
les associations uvrant dans le domaine du social.
Il faut aussi rappeler que ces directions ou services, au sein des ministres, nont pas leurs homologues lchelle des reprsentations rgionales.
COWI (2012) souligne que, bien quil y ait une collaboration oprationnelle entre les structures tatiques et les organisations de lconomie sociale et
solidaire, il nexiste gure de procdures ou de mcanismes formels dimplication effective de ces dernires dans la formulation ou la mise en uvre de
leurs politiques, stratgies, programmes, projets ou actions courantes.
Dans le cas des mutuelles, comme le souligne le cadre juridique qui les
rgit 55, elles sont essentiellement sous tutelle du ministre des Finances et du
ministre des Affaires sociales, lexception de certaines qui sont cres par
des lois spciales et relvent donc dautres institutions. Leur cration et lexer-
150
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
cice de leurs activits est conditionn au double accord des deux ministres.
Le contrle de leurs activits incombe au ministre des Affaires sociales. Toutefois le ministre des Finances peut aussi effectuer des oprations de contrle
en avisant le ministre des Affaires sociales. Les deux ministres peuvent dun
commun accord dsigner un ou des intrimaires pour organiser des lections
dans un dlai de trois mois.
Les organismes de tutelles, dans le cas des socits mutuelles de services
agricoles, dpendent du type de la socit, quelle soit centrale ou de base.
Dans les deux cas, les socits mutuelles sont sous tutelle du ministre de
lAgriculture qui approuve les statuts. Toutefois, au niveau de lexploitation et
pour les socits mutuelles centrales, elles sont sous la tutelle et le contrle du
ministre des Finances. Alors que pour les socits mutuelles de base, elles
sont sous la tutelle du ministre de lAgriculture et du gouverneur territorialement comptent.
Comme les socits mutuelles de base de services agricoles, les groupements de dveloppement de lagriculture et de la pche sont sous la tutelle
du ministre de lAgriculture et du gouverneur territorialement comptent.
Le contrle et le suivi de lexploitation sont assurs par le gouverneur.
Au niveau des instances publiques, on constate dj la multiplicit des
intervenants tant au niveau de la cration des organisations de lconomie
sociale et solidaire en Tunisie quau niveau du suivi et du contrle.
Outre les instances publiques, les organisations de lconomie sociale et
solidaire peuvent se structurer sous forme dunion ou de fdration, comme
les mutuelles et les coopratives. LUnion nationale des mutuelles (Unam), qui
regroupe plusieurs mutuelles, a pour objectif de lancer des projets sociaux, de
crer des espaces culturels et sociaux, doffrir des prestations de rassurance pour
les mutuelles membres de lunion, de raliser des tudes ou des programmes
de formation visant le dveloppement efficient des mutuelles membres, et de
faciliter lchange dexpriences et dinformations entre mutuelles.
La Fdration nationale des coopratives regroupe les coopratives.
Parmi ses activits on cite la formation, lorganisation des ateliers de rflexions
sur la gestion et le fonctionnement des coopratives, etc. (Belaid, 2007).
Le dispositif de financement des organisations de lconomie sociale et solidaire
lanalyse du dispositif de financement portera essentiellement sur les
fonds publics et les microcrdits. Il faut noter que le dispositif de financement
nest pas limit ces deux dispositifs. Le secteur priv, les organisations non
gouvernementales et les organisations dconomie sociale et solidaire trangres et internationales contribuent aussi travers des programmes de partenariats ou travers des appels proposition de projets au financement de
lconomie sociale et solidaire en Tunisie. Nanmoins il nexiste pas notre
connaissance de donnes centralises et publies quant leur contribution.
Les fonds publics. Selon Belaid (2007), dans le cadre des diffrents plans
de dveloppement socio-conomiques qua connu la Tunisie, la place des
organisations de lconomie sociale et solidaire a vari dun plan un autre.
Cette variation sexplique par le contexte socio-conomique, dune part, et
par les stratgies de dveloppement adoptes, dautre part.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
151
Tunisie
Ltat tunisien a mis en place un systme de subvention et daides en
faveur des organisations de lconomie sociale et solidaire. A titre dexemple,
lexamen des diffrents budgets ministriels, des prsidences de la rpublique
et du gouvernement ainsi que celui de lAssemble constituante nationale 56
pour lanne 2012 et 2013 montrent que le budget allou aux organisations
est pass de 111,7 millions de TND 127,8, soit une volution de lordre de
14,4 % entre 2013 et 2012. Cette enveloppe reprsente une part trs faible
dans le budget total de ltat. En effet, pour les deux annes tudies, la part
est autour de 0,4 %. Ces enveloppes reprsentent aussi 0,6 % des ressources
propres de ltat et 0,8 % des dpenses de gestion.
Lanalyse de la structure du budget allou aux organisations sociales et
solidaires suivant leur domaine dactivit montre que la part des amicales,
des socits mutuelles et des associations sportives des agents des diffrents
ministres reprsente 4,6 % sur les deux annes danalyse voluant avec un
taux de croissance de 13,9 %. La part des organisations non gouvernementales internationales reprsente en moyenne 17,6 % en 2012 et 2013, enregistrant une hausse de 10,2 %. La part alloue aux autres organisations (autres
amicales, associations caractre social, culturelles, environnementales,
enfance et jeunesse, sportives, scientifiques) reprsente en moyenne 77,8 %
du total du budget, soit une augmentation de 15,4 % entre 2012 et 2013.
Si lon considre le fait que le budget de 2012 est forte orientation
sociale, les parts tudies sur les deux dernires annes montrent que le rle
et limplication des organisations de lconomie sociale et solidaire restent
marginaux. Par ailleurs, en supposant que laccroissement du nombre dassociations entre 2012 et 2013 suive celui enregistr entre 2010 et 2012 (soit
22 % ), on constate que le nombre des associations augmente plus rapidement que le budget qui leur est allou. Cela impliquerait que le budget par
association serait en baisse. Une telle situation raviverait la concurrence
entre les associations et les inciterait trouver dautres financements.
56. Les budgets
analyss le sont au
niveau des ministres.
Les budgets des
diffrentes agences
techniques ne sont
pas pris en compte.
Bien que les budgets
de certaines de ces
agences prvoient
une enveloppe pour
les organisations
delconomie sociale
et solidaire, celle-ci
est principalement
oriente vers leurs
propres amicales
etassociations
sportives.
57. Lanalyse est base
sur le rapport publi
par le Ministre des
finances analysant la
situation du secteur
de la micro-finance en
Tunisie (2011).
Les microcrdits 57. La reconnaissance du secteur des microcrdits est rcente
en Tunisie. A part des initiatives manant des associations de dveloppement
tunisiennes au cours des annes 1990 et de lassociation de micro-finance
Enda-Interarabe, les pouvoirs publics reconnaissent le secteur en 1999
travers la mise en place dun cadre rglementaire, la loi organique n 99-67
du 15 juillet 1999 et ses arrts ministriels, et linstauration dune banque
publique ddie, en loccurrence la Banque tunisienne de solidarit (BTS).
Cette institutionnalisation du microcrdit a dbouch sur deux dispositifs qui voluent en parallle. Le premier est centr autour de la BTS. La
banque accorde des microcrdits hautement subventionns dune manire
directe ou travers les associations de microcrdits (AMC). Le second est
celui dEnda qui opre aux conditions du march, selon les normes internationales, sur drogation spciale.
En septembre 2010, des modifications sont apportes larrt du 27aot
1999. Elles portent sur deux aspects majeurs. Le premier concerne les conditions du crdit. Le second est louverture du secteur du microcrdit aux organisations non-gouvernementales internationales reconnues en Tunisie sur
agrment du ministre des Finances.
152
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Les AMC ont pour activit la gestion du microcrdit mais plusieurs
exercent dautres activits, telles que la formation professionnelle et laccompagnement des promoteurs. Leur cration a t souvent linitiative de ltat.
Aujourdhui plus de 288 AMC avec une taille moyenne de 800 emprunteurs
actifs sont comptabilises. La BTS assure leur refinancement ( taux zro) et
la couverture de certains cots oprationnels via lallocation de subventions
de dmarrage et par crdit octroy.
En dcembre 2010, environ 210000 clients taient actifs pour un montant dencours brut de 140 millions TND. Au 31 octobre 2010 et sur les dix
dernires annes, le montant des microcrdits dbourss slve 430 millions TND, soit 480 000 crdits. Ceci reprsente une moyenne de 895 TND
par crdit sur ces dix dernires annes, soit 16 % du Pib par habitant. Depuis
2004, la croissance des allocations BTS ou du nombre des crdits a t moins
rapide avec peu de nouveaux clients.
En 2011, suite la rvolution tunisienne, lactivit de ces AMC sest fortement dgrade refltant les difficults conomiques des clients, des problmes
oprationnels lis la faiblesse structurelle de ces toutes petites associations, et
des problmes de gouvernance lis leur proximit avec lancien rgime.
Enda a t fonde en Tunisie en 1990, pour mener des activits de
dveloppement urbain et de protection de lenvironnement. Elle a introduit
le microcrdit parmi ses activits en 1995 pour sy spcialiser en 2000. Enda
obtient lautorisation du ministre des Finances doctroyer des microcrdits
en 2005 avec une autorisation spciale pour facturer des taux dintrt lui
permettant de couvrir ses charges et donc suprieurs au plafond fix par la
loi. Au 31 mars 2012, son portefeuille regroupe 204 805 clients actifs pour un
encours de crdits de 113 millions TND. Elle offre ses services via un rseau
de 65 agences oprant dans 206 dlgations.
Une tude de march (IBM Belgium, 2010) auprs dun chantillon de
515 mnages ( 914 actifs) dans 23 dlgations reprsentatives montre que la
demande potentielle de microcrdits slverait un million de personnes :
le montant souhait du crdit est de 1 300 TND en moyenne, avec des
montants suprieurs pour les chefs de mnages et les hommes, sur une dure
moyenne de 19 mois et une capacit de remboursement de 70-80 TND par
mois ;
en milieu rural, ces crdits seraient allous lacquisition de cheptel et
aux aliments de btail (65 % des rponses toutes catgories confondues) et
aux intrants agricoles pour les chefs dexploitations (20 % des rponses). En
milieu urbain, les crdits seraient allou lacquisition dquipements et outillages (45 % des rponses), de cheptel (30 %) et au fond de roulement (16 %).
La demande lie au logement reste ngligeable avec 3 % de la demande.
Une nouvelle stratgie de dveloppement de la micro-finance a t mise
en place en Tunisie. tablie lhorizon 2014, elle distingue quatre priorits :
mettre en place un cadre rglementaire et une supervision encourageant
lvolution du secteur ;
contribuer via la micro-finance au dveloppement des rgions et segments prioritaires ;
structurer le secteur pour inscrire son impact dans la dure ;
promouvoir et accompagner une croissance responsable du secteur .
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
153
58. Selon Global
Findex, 67,8 % des
tunisiens gs de
15 ans et plus, sont
exclus de toute
activit financire
( World Bank, 2013,
b ). Lexclusion touche
essentiellement les
femmes, les moins
instruits et les agents
faible revenu.
Selon Maxula Bourse
( Maxula Bourse,
2012 ), le taux de
bancarisation en
Tunisie est de 55 %
en2011.
Tunisie
Dans le cadre du premier axe, une rforme juridique a tabli un nouveau
cadre rglementaire du microcrdit avec le dcret-loi 2011-117 approuv en
octobre 2011. Ce nouveau cadre:
autorise deux types de formes lgales savoir la socit anonyme et
lassociation ;
dfinit des standards de gouvernance, contrle interne, protection des
consommateurs, reporting, etc. ;
cre une autorit de contrle ddie, sous la supervision du ministre
des Finances ;
augmente le champ du microcrdit 20 000 TND ;
autorise les institutions de micro-finance oprer en tant quagents pour
les compagnies dassurance.
Deux critiques ont t avances par les AMC lgard de ce nouveau
cadre rglementaire. Dune part, les AMC, en tant quacteur majeur du microcrdit, ont t exclues du dbat qui a prcd la publication de ce nouveau
dcret-loi. Dautre part, la nouvelle loi exige un capital minimum de 200 000
TND des AMC afin quelles puissent continuer exercer dans le secteur. Une
exigence qui risque de mettre au chmage 1 200 personnes. A ce niveau, il
convient de sinterroger sur lutilit de cette exigence : sagit-il dune mesure
visant lassainissement des AMC ? Sagit-il dune mesure visant garantir
la viabilit conomique future des AMC ? Constitue-t-elle une barrire la
cration de nouvelles AMC ? Si la rponse ces trois question est affirmative,
quel est son impact sur linclusion financire des populations cibles par les
AMC ?
En janvier 2013, le ministre des Finances a publi un arrt relatif
aux procdures doctroi dagrments aux institutions de micro-finance et
leur volution institutionnelle. Depuis, le paysage des institutions de microfinance a connu lentre sur le march de deux nouveaux acteurs MicroCred
Tunisie et Tayssir.
MicroCred Tunisie est une institution cofinance par lUnion europ
enne, des institutions financires internationales et des partenaires tunisiens
(banques, groupes industriels privs). Cest un projet dun montant total de
3,6 millions TND avec une subvention de lUnion europenne slevant
1,8 million TND. Lobjectif de celui-ci est de favoriser linclusion financire
des populations dfavorises en Tunisie et de contribuer au dveloppement
dune conomie sociale, inclusive et solidaire. Cette institution offrira des services financiers aux personnes exclues du systme bancaire formel 58, accompagnera et coachera les jeunes diplms et personnes au chmage souhaitant
crer leurs entreprises et contribuera lamlioration des conditions de vie des
micro-entrepreneurs et de leur entourage familial par loffre de produits financiers adapts leurs besoins. Ce projet associera des acteurs locaux tunisiens
chargs didentifier et de reprer les vrais bnficiaires potentiels des microcrdits. Cest une opportunit pour les AMC qui ne pourraient pas remplir la
condition de 200 000 TND en revoyant leur activit en tant que prestataires
de services auprs de cette institution faisant valoir leur exprience et leur
avantage comptitif en termes de proximit.
Par ailleurs et selon des responsables du projet, le nombre de bnficiaires slvera plus de 250 000 durant les cinq prochaines annes dont
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
154
Tunisie
150 000 dans les rgions dfavorises et dont 40 000 clients qui ont bnfici dun crdit trs petite entreprise.
Tayssir est dote dun capital de 3 millions de dinars qui pourrait passer
5 millions dici la fin de 2013. Elle regroupe des industriels (Alliance Immobilire et Scet Tunisie), quatre banques de la place [ Union bancaire pour le
commerce et lindustrie (UBCI), Amen Bank (et sa compagnie dassurance),
COMAR, Banque de Tunisie et Banque tuniso-kowetienne], lAssociation
pour le droit linitiative conomique Internationale (Adie) et ventuellement la Banque europenne dinvestissement (BEI). Lobjectif de Tayssir est
de financer des microprojets dans le centre et le nord-ouest de la Tunisie.
Outre ces deux nouveaux acteurs, le ministre des Finances envisageait
ds 2011 la ralisation dune tude qui analyserait le rle que pourrait jouer
la poste tunisienne dans le futur dans linclusion financire. La poste compte,
en 2011, 1 103 bureaux dont 53 % sont situs dans les 14 gouvernorats identifis comme prioritaires par le ministre du Dveloppement rgional et de
la planification. En 2010, la poste comptait 4,5 millions de clients qui elle
fournit diffrents services financiers savoir : comptes courants, comptes
dpargne, paiement de factures, transferts dargent et mandats, cartes de
paiement ( pr et postpayes), assurances et un produit dinvestissement.
Les politiques publiques en matire dESS en Tunisie :
une analyse comparative
dans les paragraphes prcdents, il a t question de prsenter lenvironnement institutionnel et de financement de lconomie sociale et solidaire en
Tunisie. Dans ce qui suit, une analyse comparative de politiques publiques de
la Tunisie avec des pays du Nord et du Sud, notamment la France, lEspagne,
lItalie, le Maroc et ventuellement lAlgrie59. Cette analyse comparative nous
permettra par la suite didentifier les convergences entre les pays ainsi que
les pistes dharmonisation possibles.
Lanalyse comparative est mene suivant cinq dimensions (Chaves,
2002 ). Ces dimensions concernent les politiques institutionnelles, les politiques de promotion, de formation et de recherche, les politiques financires,
les politiques daide par des services concrets et les politiques de la demande.
59. Les recherches
menes nont pas
permis de collecter
des informations
pertinentes quant
lconomie sociale et
solidaire en Algrie.
Les politiques institutionnelles. Les politiques institutionnelles concernent la
reconnaissance de lconomie sociale en tant quactrice du processus dlaboration et de mise en uvre des diffrentes politiques publiques. Cette reconnaissance peut tre dordre juridique ou institutionnel. La reconnaissance
juridique consiste en la reconnaissance explicite par les pouvoirs publics de
lidentit spcifique des organisations concernes qui appellent un traitement particulier. A partir de l, le systme juridique entend les institutionnaliser avec un statut dacteur priv (Monzon & Chavez, 2012). La reconnaissance institutionnelle peut tre apprcie travers lexistence dorganes
institutionnaliss de participation et de dialogue social o les organisations
de lconomie sociale sont reprsentes.
Sur le plan juridique, la France, lItalie, lEspagne, le Maroc et lAlgrie
reconnaissent les diffrentes formes dorganisations dconomie sociale et
solidaire. Ces pays disposent des lois rglementant le fonctionnement et
155
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
garantissant les droits des membres et des tiers de ces organisations. Dans
certains cas, certaines organisations jouissent dune large reconnaissance au
point dtre mentionnes au niveau de la constitution nationale telle que les
coopratives pour lItalie et la socit civile et le mouvement associatif pour
lAlgrie. En Espagne, une loi nationale sur lconomie sociale a t adopte
en mars 2011; cette loi a permis lEspagne dtre identifie comme un
exemple en matire de reconnaissance nationale du secteur et de politique
officielle en faveur de ce secteur. Bien que la Tunisie soit en cours de rdaction
de sa nouvelle constitution, celle-ci noctroie explicitement aucune place aux
organisations de lconomie sociale et solidaire comme acteur et partenaire
de dveloppement socio-conomique.
Sur le plan institutionnel, la plus grande reconnaissance publique accorde lconomie sociale et solidaire en Europe est la nomination par le gouvernement franais, en 2012, dun ministre dlgu lconomie sociale et
solidaire au sein du ministre de lconomie en plus du ministre des Sports,
de la jeunesse, de lducation populaire et de la vie associative. Bien que la
relation entre les pouvoirs publics et les organisations de lconomie sociale
et solidaire se fasse selon des dimensions sectorielles, le Maroc a institu
depuis 2002 un dpartement de lconomie sociale rattach au ministre
du Tourisme, de lartisanat et de lconomie sociale (Abdelkhalek, 2007).
En France, comme en Espagne, un Conseil national de lconomie sociale
a t mis en place regroupant, entre autre, les diffrentes plateformes de
lconomie sociale et solidaire. Ce genre de conseil est en cours de gestation
en Algrie. Au Maroc, le dveloppement de ce type de conseil est limit
un seul type dorganisation qui sont les socits mutualistes. Nanmoins, la
participation et limplication des associations dans les diffrentes commissions nationales, rgionales et provinciales sont devenues pratiquement une
culture chez les pouvoirs publics marocains (Abdelkhalek, 2007). En Tunisie,
on note labsence de tels organes de haut rang qui, selon Monzon et Chavez
(2012), permettent dimpulser la visibilit et limage sociopolitique de lconomie sociale et dinstitutionnaliser les politiques trans-sectorielles qui lui
sont propres. Comme soulign au niveau de diffrentes tudes consultes,
limplication de la socit civile dans les processus dlaboration de politiques
du secteur reste faible voire quasi-absente.
La multiplicit des intervenants au niveau institutionnel conjugue au
manque de coordination entre les diffrents dpartements risque de constituer une entrave au dveloppement et lexpansion du secteur de lconomie
sociale et solidaire. Ceci est notamment le cas au Maroc et en Tunisie (Belaid,
2007 ; Abdelkhalek, 2007 ; COWI, 2012).
Lexistence et la multiplicit des textes juridiques risquent de constituer
une entrave au dveloppement de nouvelles formes dorganisations dconomie sociale (Monzon & Chavez, 2012) ou de permettre aux organisations dj
existantes de rpondre aux nouvelles exigences socitales ( cas des mutuelles
en Tunisie ministre des Finances, 2007). Dans le premier cas, de nouvelles dispositions lgislatives rgissant les nouvelles formes ont vu le jour
(loi n 460/1997 relative aux organisations but non lucratif dutilit sociale
et loi n 118/2005 relative aux entreprises sociales en Italie) ou des modifications ont t apportes aux dispositions existantes (les socits coopratives
156
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
dintrt collectif instaures en 2001 en France et les coopratives dinitiative
sociale en Espagne ). Dans le deuxime cas, une rvision de loi relative aux
mutuelles tarde se faire.
Politiques de promotion, de formation et de recherche. Selon Monzon et
Chavez (2012, p. 89), lobjectif de ces politiques est, dune part, de donner de
la visibilit lconomie sociale et de lui assurer ladhsion de la socit et, dautre
part, de dvelopper les comptences en matire de formation et de recherche au
profit de lensemble du secteur.
LItalie, lEspagne et la France disposent de centres spcialiss de
recherche et de formation articuls en rseau : le rseau interuniversitaire
franais de lconomie sociale et solidaire et le rseau espagnol CIRIEC des
chercheurs en conomie sociale. En lien avec ces rseaux, du ct de lenseignement, des diplmes de troisime cycle en matire dconomie sociale
ont t instaurs.
La formation et la recherche en matire dconomie sociale et solidaire
dans les pays du Maghreb, sont dans un tat embryonnaire voire absente. Le
premier programme en Tunisie a t instaur en 2012 avec une formation
acadmique en matire dentrepreneuriat social au sein dune universit
prive. Avec laccueil du Forum social mondial et du MedESS en Tunisie
en 2013 lintrt port lconomie sociale devrait devenir plus important.
Nanmoins, en raison du systme de gestion de lenseignement suprieur
en Tunisie, la rvision ou linstauration de programmes ducatifs en matire
dconomie sociale devrait se faire au cours de lanne 2014-2015. Au Maroc,
la stratgie de dveloppement du secteur ne prvoit pas le dveloppement des
comptences en matire dconomie sociale dans les centres universitaires
(Abdelkhalek, 2007). En Algrie, linformation reste peu disponible pour
pouvoir apprcier les politiques publiques en la matire.
Politiques financires. Les politiques publiques financires, telles que les
politiques budgtaires, allouent directement ou indirectement des fonds pour
assurer la promotion et le dveloppement de lconomie sociale. Dans le cas
de la Tunisie, du Maroc, de lEspagne et de lItalie, certaines formes dorganisations dconomie sociale et solidaire disposent de fonds publics. Par exemple,
les associations (au Maroc et en Tunisie) et les mutuelles (en Tunisie) sont
concernes par ces fonds alors quen Italie et en Espagne, ce sont les coopratives qui sont les plus dotes par ces fonds. Dans le cas de la France, les fonds,
de caractre mixte ou paritaire, sont cogrs par ladministration et par des
organisations de lconomie sociale. A cet gard, Monzon et Chavez (2012)
citent le fonds national pour le dveloppement de la vie associative (FNDVA)
et le fonds national pour le dveloppement du sport (FNDS).
Le financement des organisations de lconomie sociale et solidaire se
fait aussi sur des ressources non budgtaires qui peuvent provenir du produit de lexploitation de jeux de hasard (loteries par exemple). En Espagne,
lOrganisation nationale des aveugles espagnoles (ONCE) a mobilis, en 2009,
230 millions deuros pour financer des services sociaux spcialiss ses adhrents (ducation, emplois, rhabilitation, aides techniques adaptes, communication et accs linformation, sports et loisirs). Lintervention de lONCE ne
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
157
Tunisie
sest pas limite ses adhrents. La Fondation ONCE, cre en 1988, assure
linclusion dautres personnes besoins spcifiques (souffrant dautres handicaps que la ccit ou la surdit) en matire demploi et damlioration de leur
accessibilit lducation et aux activits de loisirs. En Tunisie, une partie du
produit (60 %) du Promosport revient dvelopper linfrastructure sportive
ncessaire aux associations sportives. Les SMSA bnficient des incitations
financires prvues dans le cadre du code dincitations aux investissements
prvu pour les entreprises du secteur priv. Les associations tunisiennes, dans
le cadre de dveloppement de leurs projets productifs ou sociaux, peuvent aussi
se porter candidates ces incitations, condition quelles disposent dun code
fiscal60.
Outre les incitations financires, la Tunisie et le Maroc accordent aussi des
incitations fiscales aux SMSA et associations (celles remplissant la condition
mentionne ci-dessus pour la Tunisie). Dans le cas de la Tunisie, ces incitations concernent lexonration de la TVA sur les biens acquis sur le march
local, lexonration de limpt sur les socits, lexonration de la charge patronale la scurit sociale pour les projets dvelopps dans les zones dcrtes
comme zones de dveloppement rgional. Le Maroc accorde des exonrations
similaires (Abdelkhalek, 2007). Les associations sont exonres de la TVA
lexception des tablissements de vente ou de services appartenant celles-ci.
Les associations de soutien aux petites et moyennes entreprises et reconnues
dutilit publique sont aussi exonres de la TVA. Les socits mutualistes,
reconnue dutilit publique, sont exonres de la TVA, des droits de timbre,
denregistrement et de la taxe urbaine.
En plus des politiques financires, au sens strict du terme, les politiques
publiques peuvent porter sur laide lemploi. De telles politiques sont en
vigueur en France, en Espagne ou en Tunisie. LEspagne permet aux personnes
au chmage de percevoir la totalit de leurs indemnits si elles dcident de
lancer une cooprative ou une socit anonyme participation ouvrire (Monzon et Chavez, 2012). La France a mis en place des politiques daide lemploi
dans les associations et le systme de chques-emploi. Comme la France, la
Tunisie a encourag le recrutement des diplms de lenseignement suprieur
au sein des organisations de lconomie sociale et solidaire (associations, GDA,
SMSA) travers le fonds national de lemploi 21-21 61 via le programme intitul
contrat dinsertion des diplms de lenseignement suprieur (Cides).
60. Cette condition
contraint les
associations dclarer
un bnfice gal
zro la fin de
lexercice comptable.
61. Cr en dcembre
1999, ce programme
vise soutenir et
faciliter linsertion sur
le march du travail
des jeunes (diplms)
tunisiens.
Les politiques daide par des services concrets. Ce sont des politiques qui
visent soutenir le dveloppement des organisations de lconomie sociale et
solidaire travers la fourniture de prestations pratiques dinformation technique, de consultance, de mise en rseau, de restructuration, de cration de
structures de deuxime niveau, etc. Le rapport de Monzon et Chavez (2012)
montre que dans les pays europens ces services sont plutt fournis par les
fdrations sectorielles avec un soutien financier public.
Dans le cas des associations tunisiennes, certaines de ces prestations
sont offertes par le centre Ifeda (informations, tudes, formations). Au niveau
des organismes professionnels agricoles, ces prestations sont offertes par
lAgence de vulgarisation et de la formation agricole (AVFA) et lObservatoire
national de lagriculture (Onagri).
158
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Dans le cas des coopratives du Maroc, lOffice de dveloppement de la
coopration (Odco) fournit ces prestations. En outre, des programmes ont t
mis en place au profit des associations. Ils prvoient une assistance technique
travers la formation en matire de gestion administrative et financire et de
techniques de conception, de formulation dvaluation et dexcution des projets. Cette assistance est fournie par lAgence de dveloppement social (ADS),
une unit intgre lorganigramme du ministre de Dveloppement social, de
la famille et de la solidarit (Abdelkhalek, 2007). Pour lAlgrie, aucune information, notre connaissance, nest disponible en matire de politiques daide.
Les politiques de demande. Les pouvoirs publics peuvent stimuler les entreprises dconomie sociale en facilitant leur accs au statut de fournisseurs du
secteur public, quils soient consommateurs en bout de chane ou consommateurs intermdiaires (dans le cas de services sociaux, de sant ou dducation dont les bnficiaires finaux sont les citoyens). Ces prestations peuvent
faire lobjet de contrat entre ladministration et les organisations dconomie
sociale et solidaire.
En Tunisie de tels dispositifs existent au niveau des associations caractre social qui grent des centres sociaux publics. Nanmoins, la politique
de demande reste exclusive si lon considre les marchs publics qui restent
orients essentiellement vers le secteur priv. Ceci peut tre expliqu par la
taille moyenne voire petite des organisations de lconomie sociale.
Au Maroc, la politique de demande est concrtise par la signature de
convention de partenariat entre des dpartements ministriels et des organisations nationales dans divers secteurs. Par exemple, Abdelkhalek (2007) cite
la convention conclue entre le dpartement charg de lducation et des ONG
nationales dans le but dradiquer lanalphabtisme chez les enfants de 8
16 ans et de promouvoir la scolarisation des filles en milieu rural. Un autre
exemple porte sur la convention entre le dpartement de la sant et certaines
ONG nationales en vue damliorer la condition de la femme dans le domaine
de la sant et laccs de la population aux prestations et services de sant de la
reproduction. En Espagne, les coopratives ont pu, rcemment, agir en tant
que distributeur dlectricit ou revendeurs de carburant dans des stationsservices coopratives alors quelles taient bannies de ces fonctions.
Contribution socio-conomique des organisations de lconomie
sociale et solidaire
les donnes relatives lemploi dans les organisations de lconomie
sociale et solidaire en Tunisie sont rares. Lintrt pour le secteur est rcent.
Afin de dterminer la contribution conomique, on peut se baser sur deux
indicateurs, savoir la part de la valeur ajoute dans le Pib et les emplois. La
contribution sociale et environnementale peut tre apprcie travers plusieurs indicateurs tenant compte de la spcificit du domaine dintervention
des organisations de lconomie sociale et solidaire en Tunisie.
Selon le dernier rapport sur la comptabilit nationale (2011), la valeur
ajoute du poste services fournis par des organisations associatives est estime
64,3 millions de dinars aux prix constants de lanne prcdente en 2010
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
159
62. Mis part
quelques travaux
acadmiques ou
ceux raliss par des
acadmiciens, lon
confond toujours
lconomie sociale
et solidaire au
secteur associatif
et des coopratives,
ngligeant dautres
composantes telles
que les fondations,
lesmutuelles, etc.
63. Le rapport ne
mentionne pas
lcart type de
manire apprcier
la dispersion de
lemploi rmunr au
sein des associations
interroges.
Tunisie
alors quelle ntait que de 53,9 millions de dinars en 2006. La part de la
valeur ajoute des services fournis par les organisations associatives est estime 0,1 % sur la priode de lanalyse (2006-2010).
Il faut noter quau niveau du poste services fournis par les organisations
associatives, sont prises en considration les associations et les organisations
de type associatif telles que les fondations et ventuellement les GDA. La
valeur ajoute des organismes professionnels agricoles (SMSA) ou encore
les mutuelles sont considres respectivement dans les postes agriculture et
pche et services financiers. De ce fait, la part de la valeur ajoute estime des
organisations de lconomie sociale et solidaire sont sous-estimes.
Au niveau des associations, une tude est en cours dlaboration, coinjointement par le centre Ifeda et lINS, afin dobtenir un rpertoire actualis des
associations 62 tout en essayant destimer sa contribution conomique. Ltude
ralise par Malena et al. (2012) montre que le nombre demplois rmunrs
moyen au sein des associations est de 2,5 emplois 63. Par rapport au secteur
priv, la performance enregistre par les associations reste suprieure la
moyenne nationale qui est de lordre de 1,6 emploi salari par entreprise. Au
niveau sectoriel, les associations font mieux que les entreprises de services qui
comptent en moyenne 0,8 emploi salari par entreprise. Toutefois elles sont
nettement dpasses par les entreprises industrielles et agricoles et de pche
qui comptent en moyenne 5,7 et 9,5 salaris respectivement.
Considrant les organismes professionnels agricoles, notamment les
SMSA centrales, celles-ci comptent 1 479 emplois en 2011, soit 123 emplois par
SMSA centrale, 0,61 emploi par adhrent et 0,07 emploi par usager. En matire
de statut dans le travail, les cadres dans les SMSA reprsentent 19,5 % et donc
un taux dencadrement de 0,19, soit un cadre pour cinq employs et ouvriers.
Selon le suivi assur par la DG Fiop, dix SMSA centrales sont en activit ( cinq rencontrent des difficults financires et deux sont en phase de
lancement ). Cette situation sexplique par le faible taux de couverture des
adhrents et des usagers ou par la nature de lactivit agricole et ses performances conomiques dune manire gnrale. Cette question mrite aussi
une tude approfondie.
Les SMSA de base comptent 1 498 emplois, soit 9,1 emplois par SMSA,
0,06 emploi par adhrent et 0,04 emploi par usager en 2012. Les emplois
des cadres, issus de lenseignement suprieur, reprsentent 27,6 %, donc
un taux dencadrement autour de 0,38, soit le double de celui enregistr au
niveau des SMSA centrales.
Lanalyse des emplois par rgion montre des disparits (tableau 1). A
lexception de la rgion du Grand Tunis, faiblement agricole, les rgions
affichent des emplois par adhrents et par usager trs faibles. Ceci pourrait
renseigner sur la qualit des prestations offertes par le SMSA en matire de
formation et daccompagnement.
La part des cadres est importante dans la rgion du Sud-Ouest avec 65,6 %
de lemploi total dans les SMSA de la rgion. En seconde et troisime positions
viennent les rgions du Centre-Ouest et du Nord-Est avec, respectivement,
43,3 % et 30,8 %. La rgion du Grand Tunis enregistre la part la plus faible
demplois de cadres dans lemploi total des SMSA de la rgion. Enregistrant
des parts importantes de cadres dans lemploi total, les trois rgions du Sud-
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
160
tableau
Tunisie
1 Indicateurs cl de lemploi dans les SMSA de base par rgion (2012)
Grand Tunis
Nord-Est
Nord-Ouest
Centre-Est
Centre-Ouest
Sud-Est
Sud-Ouest
National
Emploi
par adhrent
0,48
0,03
0,12
0,08
0,04
0,06
0,02
0,06
Emploi
par usager
0,181
0,026
0,043
0,081
0,030
0,061
0,003
0,043
Cadres
par SMSA
2
2
1
5
2
1
3
3
Employs et
ouvriers par SMSA
15
3
3
13
2
4
1
7
Part
des cadres
13,4 %
30,8 %
27,4 %
27,1 %
43,3 %
20,3 %
65,6 %
27,6 %
Taux
dencadrement
0,16
0,45
0,38
0,37
0,76
0,26
1,91
0,38
DG Fiop, ministre de lAgriculture
tableau
2 Indicateurs relatifs lemploi dans les GDA par domaine dactivit
Type de GDA
Emplois par GDA
Eau potable
1,2
Eau dirrigation
2,3
Autres
0,5
Intrt communautaire
0,3
Intrt collectif
0,5
Emplois par adhrent
1,2
1,8
0,5
0,3
0,5
Part des cadres
48,3 %
39,1 %
56,8 %
66,7 %
55,2 %
Taux dencadrement
0,9
0,6
1,3
2,0
1,2
DG Fiop, ministre de lAgriculture
Ouest, du Centre-Ouest et du Nord-Est affichent les taux dencadrement les
plus levs avec, respectivement 1,91, 0,76 et 0,48 cadre par employ.
Les GDA comptent 3 880 emploi en 2012, soit 0,007 emploi par adhrent, ce qui est trs faible. La part de lemploi des cadres issus de lenseignement suprieur reprsente 40,8 %, donc un taux dencadrement autour
de 0,7 cadre par employ et ouvrier.
Etant donn la disponibilit des donnes par rgion et par domaine
dactivit, il a t possible danalyser lemploi suivant ces deux critres.
Lanalyse par domaine dactivit, montre que le nombre demplois dans
les GDA lis leau sont plus important que dans les autres GDA. Le nombre
demplois par adhrent suit la mme tendance avec 1,2 et 1,8 emploi par adhrent au sein des GDA deau potable et deau dirrigation respectivement. En
matire demploi des cadres, cest au niveau des GDA dintrt communautaire que lon retrouve la part la plus importante de cadres (66,7 %) suivis par
les GDA dintrt collectif. En consquence, les taux dencadrement les plus
levs sont observs au niveau de ces deux types de GDA o le taux dencadrement moyen dans les GDA dintrt communautaire est de deux cadres par
employs. Les GDA deau potable enregistrent aussi un taux dencadrement
proche de un cadre pour un employ. Ceci nous amne se poser des questions quant au niveau de productivit dans ces types de GDA et la qualit de
lencadrement aux GDA du Grand Tunis. tableau 2
Lanalyse rgionale de lemploi dans les GDA montre que ceux du Sud
sont les plus crateurs demplois avec respectivement 2 et 3,1 emplois en
moyenne par GDA dans les rgions du Sud-Est et du Sud-Ouest. Il faut noter
que les GDA crent moins demplois que le secteur priv o il y a 9,5salaris
par entreprise agricole. En termes de nombre de cadres par GDA, cest ceux
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
161
tableau
Tunisie
3 Indicateurs relatifs lemploi dans les GDA par rgion
Grand Tunis
Nord-Est
Nord-Ouest
Centre-Est
Centre-Ouest
Sud-Est
Sud-Ouest
National
Emploi
par GDA
0,4
1,3
1,5
1,0
1,4
2,0
3,1
1,6
Cadre
par GDA
0,08
0,13
0,86
0,18
0,66
0,44
1,71
0,65
Employ et
ouvrier par GDA
0,35
1,19
0,64
0,85
0,70
1,55
1,42
0,94
Emploi par
adhrent
0,010
0,007
0,007
0,006
0,004
0,009
0,021
0,007
Cadres
en %
19,0 %
9,7 %
57,4 %
17,8 %
48,6 %
22,2 %
54,6 %
40,8 %
Taux
dencadrement
0,2
0,1
1,3
0,2
0,9
0,3
1,2
0,7
DG Fiop, ministre de lAgriculture
figure
18
Situation de GDA
par domaine
dactivit
DG Fiop,
ministre de lAgriculture
du Sud-Ouest qui enregistrent la meilleure performance, en moyenne, avec
1,7cadre par GDA suivis par ceux du Nord-Ouest avec 0,86. En matire demploys et douvriers, bien que les GDA du Nord-Est enregistrent un nombre
moyen de cadre par GDA de 0,13, ils emploient autour de 1,2 employ et
ouvrier. Dans cette catgorie demplois, les GDA du Sud continuent tre
les plus crateurs demplois.
Ces performances se sont rpercutes sur le nombre demploi par adhrent, sur la part des cadres dans lemploi et sur le taux dencadrement. A lexcep
tion du Centre-Est et du Centre-Ouest, les rgions enregistrent un nombre
demplois par adhrent suprieur ou gal la moyenne nationale. Nanmoins
les taux restent faibles. En considrant la part des cadres, les GDA du Nord-Est,
du Centre-Est et du Grand Tunis sont les moins recruteurs de cadres. Quant aux
taux dencadrement, les plus levs sont enregistrs aux GDA du Nord-Ouest,
du Sud-Ouest et du Centre-Ouest, proches ou suprieurs lunit. tableau 3:
A ce niveau il est important de souligner quen matire de performance,
66 % des GDA sont en activit alors que 28 % rencontrent des difficults ou
sont en arrt dactivit en 2011. Lanalyse par domaine dactivit montre que
cette tendance est observe au niveau de tous les domaines et plus particulirement au niveau des GDA dintrt communautaire. La figure 18 montre que
la part des GDA dintrt communautaire qui sont en difficult est autour de
37 % alors que ceux qui sont en arrt dactivit est de 21,7 % en 2011.
Ces performances sexpliquent par la spcificit du domaine dactivit
des GDA qui sintressent la gestion de biens environnementaux publics
et lune des raisons serait alors le manque de comptences en la matire.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
162
Tunisie
Une autre explication est lie aux donnes relatives lemploi dans ce type de
GDA avec un GDA sur neuf ayant un directeur, en moyenne 0,3 emploi par
GDA, 0,3 emploi par adhrent et un taux dencadrement de deux. Comme le
suggre Belaid (2007), la situation conomique de ces GDA mrite une attention particulire compte tenu des enjeux stratgiques de leurs interventions.
Quant aux indicateurs de performances sociales, un systme de valorisation et dvaluation spcifique fait dfaut, mme auprs des instances
publiques. Il est difficile dvaluer le nombre de projets conomiques dvelopps et le nombre demplois crs par les associations de dveloppement. De
mme, il est difficile de disposer de la part des personnes dpendantes prises
en charge par les associations par rapport au total des personnes dpendantes.
De telles donnes sont disponibles dans les rapports des projets financs
par les organisations et institutions financires internationales. Par exemple,
le rapport dvaluation du renforcement des GDA deau potable (Banque africaine de dveloppement, 2009) mentionne que lensemble des 1 260GDA
daccs leau potable dessert 232 000 familles rurales, soit environ 1 275 million dhabitants ruraux. Ils assurent une production moyenne de 65litres par
habitant et par jour et une consommation spcifique moyenne de 48litres
par habitant et par jour, comprenant les besoins domestiques, ceux du cheptel
voire larrosage dappoint en cas de scheresse. Le rapport avance aussi quavec
la SONEDE et, part gale, les 1 260 GDA contribuent assurer un taux global
de desserte en eau potable en milieu rural suprieur 90 %.
Organisations de lconomie sociale et solidaire :
rponse lurgence ou entrepreneuriat social ?
le positionnement des organisations de lconomie sociale et solidaire en
Tunisie peut tre dfini travers le croisement des rsultats de diagnostic
effectus dans le cadre des trois tudes cites au niveau de la mthodologie, le
dispositif juridique et institutionnel, dune part, et des indicateurs de lidaltype dvelopps par lEmes 64 tels que catgoriss par Defourny & Nyssens
(2010), dautre part.
valuation du positionnement
64. Le rseau
europen Emes
runit des centres
de recherche
universitaires et
des chercheurs
indpendants en vue
de produire un corpus
de connaissances
thoriques et
empiriques sur
lconomie sociale et
lentrepreunariat .
( socioco.org )
lvaluation est faite suivant des indicateurs relatifs la dimension conomique, la dimension sociale et la structure de gouvernance.
Les indicateurs de la dimension conomique
lapproche Emes retient trois indicateurs : la production continue de biens
ou de services, un niveau significatif de prise de risque conomique et un
niveau minimum demploi rmunr.
Par rapport au premier indicateur, la problmatique ne se pose pas au
niveau des organismes professionnels agricoles puisquils coulent la tota-
163
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
lit de leur production sur le march (socit mutuelle de services agricoles,
groupement de dveloppement de lagriculture et de la pche). Nanmoins, au
niveau des organisations de lconomie sociale et solidaires de type associatif,
la production de biens ou de services fait dfaut dans la majorit des cas.
Bien que la loi autorise exercer des activits commerciales afin de remplir la mission sociale qui est lobjet de lassociation, les rsultats au niveau de
leur contribution et la trs faible part de la valeur ajoute dans le Pib (0,1%
sur la priode 2000-2012) montrent que les organisations de lconomie
sociale et solidaire de type associatif gnrent de la valeur ajoute sociale,
mais restent peu orientes vers la cration de la valeur ajoute conomique.
A cet gard, Cowi (2012) souligne que les actions associatives sont frquemment du type assistanat.
La faible orientation conomique est inhrente aux faiblesses qui caractrisent les organisations de type associatif. Belaid (2007), Cowi (2012) et
Malena et al. (2012) rvlent que les organisations dconomie sociale et
solidaire de type associatif souffrent des faiblesses suivantes:
faibles aptitudes organisationnelles, managriales en matire de travail
associatif lies au bas niveau de formation et de comptence ;
capacit insuffisante en matire dlaboration de visions et de stratgies
dactions, de planification et de programmation didentification, de formulation et de montage de projet ;
matrise des mtiers et connaissances insuffisantes dans les domaines
dintervention des associations ou encore des GDA daccs leau potable
(Banque africaine de dveloppement, 2009) ;
difficult prparer les dossiers de soumission aux appels proposition
lancs par des partenaires techniques ou financiers combine une faible
matrise de leurs exigences techniques et mthodologiques ;
insuffisance des capacits financires pour quiper les organisations
(notamment les associations), pour couvrir les frais de fonctionnement et
pour lancer les projets.
Toutefois, les associations sadonnent ponctuellement des activits
commerciales qui leur permettent de collecter des fonds : vente darticles,
organisation de manifestations culturelles Dans la majorit des cas, la
nature du bien ou du service nest pas intimement lie la mission sociale
de lassociation.
Sagissant du niveau de prise de risque conomique, les organismes
professionnels agricoles prennent un risque conomique significatif. La
viabilit financire de ces organismes dpend la fois de la rentabilit de
leurs activits commerciales et de lengagement des adhrents mobiliser
des ressources suffisantes pour la survie de lorganisation. Au niveau des
organisations de type associatif, tant donn que leurs activits sont peu
conomiques, le risque y affrent est faible.
Concernant le niveau demploi rmunr, lanalyse de la contribution
socio-conomique a montr le faible nombre de travailleurs rmunrs au
sein des associations, lexception des organismes professionnels agricoles
qui font appels des ouvriers permanents et des ouvriers saisonniers. Les
SMSA comptaient, en 2012, 2 977 cadres et ouvriers permanents en plus des
saisonniers. Les GDA comptaient 3 880 cadres et employs, et 800 directeurs.
164
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Par rapport la dimension conomique, le positionnement des organisations
tunisiennes de lconomie sociale et solidaire montre que les SMSA sont les
organisations quirpondent le mieux lidal-type dvelopp par lEmes.
La production ponctuelle de biens et de services au niveau des organisations de
type associatif (association, GDA) et des socits mutuelles a fait en sorte que le
niveau derisque conomique au sein de ces organisations soit faible.
La faible orientation conomique des associations est due aux faibles capacits
managriales et financires, et la faible matrise des mtiers lis aux domaines
dintervention, donc la faible capacit identifier les opportunits conomiques.
Lemploi rmunr reste faible au niveau des associations qui fonctionnent
beaucoup plusavec du volontariat, des GDA et des socits mutuelles, alors quil
est moyen auniveaudes SMSA.
Associations
Socits mutuelles
SMSA
GDA
Production de
Risque conomique
biens et de services
Ponctuelle
Faible
Ponctuelle
Faible
Continue
Significatif
Suivant domaine
Faible modr
dactivit
(suivant domaine dactivit)
Emploi
rmunr
Faible
Faible
Moyen
Faible
Les indicateurs de la dimension sociale
suivant lidal-type de lEmes, les indicateurs de la dimension sociale
concernent un objectif explicite de service la communaut, une initiative
manant dun groupe de citoyens ou une limitation de la distribution des
bnfices. Le premier indicateur peut tre vrifi dans le cas des organisations
de lconomie sociale et solidaire de type associatif et mutualiste limage des
associations, des mutuelles, des fondations et des groupements de dveloppement de lagriculture. Nanmoins, quand il sagit des socits mutuelles de
services agricoles, les objectifs conomiques priment sur les objectifs sociaux.
Il faut rappeler que, bien que ces organisations amliorent les revenus des
exploitants agricoles, donc leur niveau de vie, de telles structures se sont dveloppes dans le cadre dune politique agricole en Tunisie.
Le deuxime indicateur est vrifi en rfrence aux textes juridiques qui
rgissent les organisations de lconomie sociale et solidaire. Lorganisation est
cre autour du projet dun groupe de personnes partageant le mme besoin
ou un objectif dfini. Dans certains cas, les associations de dveloppement
ont man de linitiative de ltat (les AMC). Le diagnostic men a montr
que parfois cette dimension nest pas maintenue dans le temps, notamment
au sein des organisations dun certain ge. Ceci sexplique par ladaptation
de lorganisation au contexte socio-conomique dans lequel elle volue. Il y
a un autre risque quant prennit de la mission, eu gard une remarque
souleve dans le cadre du diagnostic men par Cowi auprs des organisations
de la socit civile en Tunisie : il y a parfois tendance la personnification de
lassociation autour de ses leaders plutt que des valeurs de lorganisation.
Pour le troisime indicateur, les textes juridiques ont limit la distribution des bnfices en mentionnant explicitement quelle ne se fait pas
au prorata des parts en capital social. Les excdents peuvent tre rinvestis
ou rpartis suivant lactivit de ladhrent au sein de lorganisation (cas des
coopratives et des socits mutuelles), et doivent tre rinvestis dans le cas
des organisations de type associatif.
165
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Le positionnement effectu fait ressortir les associations, les GDA et les socits
mutuelles comme les organisations dconomie sociale et solidaire rpondant le
mieux aux critres de la dimension sociale tels que dfinis par lidal-type de lEmes.
Dans le cas des SMSA, lobjectif de service la communaut est plutt implicite.
Les SMSA ont t dveloppes dans le cadre dune politique conomique de
dveloppement agricole.
Les associations, les socits mutuelles, les organismes professionnels agricoles sont,
dans leur majorit, des initiatives manant de groupes de personnes partageant les
mmes objectifs. Si ces objectifs sont maintenus dans le temps pour les organisations
de jeune ge, ils sont adapts aux mutations socio-conomiques dans le cas des
organisations les plus ges.
La redistribution des bnfices au sein des organisations tunisiennes de lconomie
sociale est dfinie par les textes juridiques rgissant leurs activits. Dans le cas des
organisations du type associatif et des socits mutuelles, lexcdent est totalement
rinvesti. Dans le cas des SMSA et certains GDA, lexcdent peut tre partiellement
rparti suivant la participation des adhrents aux activits de lorganisation.
Associations
Socits mutuelles
SMSA
GDA
Objectif explicite
de service
la communaut
Oui
Oui
Non
Oui
Initiative manant
dun groupe de citoyens
Gnralement (initiatives
de ltat pour les AMC )
Oui
Oui
Oui [excepts les GDA
dintrt communautaire
(ltat)]
Rpartition
de lexcdent
Totalement rinvesti
Totalement rinvesti
Partielle. Suivant la contribution
de ladhrent dans lactivit
Partielle. Suivant la contribu-
tion de ladhrent dans lactivit
(suivant domaine dactivit)
Les indicateurs de la structure de gouvernance
suivant defourny & nyssens (2010), ces indicateurs constituent des traits
majeurs dun modle de gouvernance spcifique : un degr lev dautonomie, un pouvoir de dcision non bas sur la dtention du capital et une
dynamique participative impliquant diffrentes parties prenantes.
Par rapport au premier indicateur et daprs les textes juridiques, si les
associations, les fondations et les amicales jouissent dun grand degr dautonomie, ce nest pas le cas des mutuelles et des organismes professionnels
agricoles.
Comme dmontr au niveau de la revue du dispositif institutionnel,
le ministre des Finances peut dun commun accord avec le ministre des
Affaires sociales dsigner un ou des intrimaires pour organiser les lections. Au niveau des socits mutuelles de services agricoles et des groupements de dveloppement de lagriculture et de la pche, le contrle des
instances tatiques est plus imposant :
la socit mutuelle centrale est tenue dinviter, titre dobservateur, un
reprsentant du ministre de lAgriculture et du ministre des Finances (le
gouverneur ou son reprsentant pour les socits mutuelles de base) aux
runions du conseil dadministration des assembles gnrales ;
la socit mutuelle centrale doit leurs prsenter obligatoirement les
documents relatifs la loi de leur organigramme, la nomination des agents
et leur rmunration, et le statut du directeur gnral ;
la socit mutuelle doit aussi leur adresser les tats financiers, les procs
verbaux du conseil dadministration et de lassemble gnrale, les rapports
de contrle et tout ce qui prouve le fonctionnement de la mutuelle selon la
166
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
lgislation en vigueur ainsi que les rapports si la mutuelle gre un service
ou bien public. Les ministres (le gouverneur pour les socits mutuelles de
base) peuvent prsenter des rserves ou des observations ;
en cas de constatation de violation des dispositions lgales et rglementaires, ou des statuts de la socit ou de non respect de ses intrts, lautorit
de tutelle peut convoquer une assemble gnrale extraordinaire pour examiner la situation de la socit mutuelle, et mme surseoir lexcution de
toute dcision quelle considre susceptible de porter atteinte aux intrts de
la socit mutuelle en attendant que lassemble gnrale extraordinaire se
prononce sur les questions en instance.
Dans le cas des groupements de dveloppement de lagriculture et de
la pche :
ils sont sous la tutelle et le contrle du gouverneur ;
ils sont tenus dinviter, titre dobservateur un reprsentant du gouverneur aux runions du conseil dadministration et des assembles gnrales ;
ils doivent aussi lui adresser les tats financiers, les procs verbaux du
conseil dadministration et de lassemble gnrale ;
en cas de gestion douvrages publics ou de participation lexcution de
travaux publics, le groupement doit aussi inviter un reprsentant du commissaire rgional au dveloppement agricole territorialement comptent
titre dobservateur.
Le second indicateur est aussi garanti par les textes juridiques o quelque
soit lapport ou le degr dengagement, le pouvoir de dcision est bas sur le
principe un membre, une voix dans les diffrents types dorganisation dconomie sociale et solidaire considrs dans lanalyse.
Le positionnement des diffrentes organisations sur lindicateur relatif
la dynamique participative intgrant les diffrentes parties prenantes montre
que, dans la majorit des cas cet aspect fait dfaut. La relation entre les
organisations de lconomie sociale et solidaire, notamment les associations,
est plutt caractrise par des tensions. Les tudes consultes soulvent les
reproches faites par les associations aux pouvoirs publics :
la faible reconnaissance de limportance du rle des organisations de
lconomie sociale et solidaire dans le dveloppement socio-conomique,
notamment dans le contexte actuel ;
la faible intgration dans les processus dlaboration des stratgies et
des programmes sociaux et de dveloppement ;
la lourdeur administrative dans le traitement des demandes et des dossiers ;
laccs restreint une information fiable et pertinente ;
le manque de promotion des initiatives russies au sein des organisations.
Ces tudes soulvent aussi des faiblesses au niveau de la gouvernance
des organisations de lconomie sociale et solidaire, dont on cite :
faibles aptitudes sur la gouvernance participative et insuffisance en
matire de communication interne ;
faibles aptitudes interagir avec les acteurs gouvernementaux ;
absence de dialogue et de collaboration avec les dcideurs publiques et
les acteurs de ladministration.
167
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Par rapport la dimension de la gouvernance, les organisations de type associatif
(associations, fondations, amicales) rpondent au moins deux critres sur trois.
Les socits mutuelles et les organismes professionnels ne bnficient pas dun
degr lev dautonomie et ne sinscrivent pas dans une dynamique participative.
Les autorits de tutelles ont le droit, lgal, dintervenir en tant quobservateur
etde contrleur des activits de ces organisations.
Dans les diffrentes organisations dconomie sociale et solidaire, le pouvoir de
dcision est dfini suivant le principe un membre, une voix. Ce principe est impos
par les diffrents cadres rglementaires rgissant les activits des diffrentes
organisations tudies.
La relation tat-organisation de lconomie sociale et solidaire, notamment dans le
cas des associations, est principalement caractrise par les tensions. Ces tensions
sont nourries par le manque de reconnaissance du rle de ces organisations, de
lafourniture dune information fiable et pertinente et de la bureaucratie.
Degr dautonomie
Associations
Elev
Socits mutuelles Modr
SMSA
Faible
GDA
Faible
Pouvoir de dcision
un membre, une voix
un membre, une voix
un membre, une voix
un membre, une voix
Dynamique participative
Assez prsente
Assez prsente
Impose par la loi (pouvoirs publics)
Impose par la loi (pouvoirs publics)
A partir de cette valuation, il apparat que certains types dorganisations
de lconomie sociale et solidaire en Tunisie sont trs proches de lidal-type
de lEmes limage des organismes professionnels agricoles. Nanmoins,
le diagnostic fait apparatre lloignement des associations de ce rfrentiel,
mme si ce constat relatif aux associations ne devrait pas tre gnralis. Il
existe des exemples o des associations ont pu mener des initiatives permettant de les considrer comme des entreprises sociales en Tunisie.
tudes de cas
dans ce rapport, deux tudes de cas sont prsentes. Elles sont puises
dans le tissu associatif. La premire porte sur lassociation ferme thrapeutique pour les handicaps. La seconde porte sur lassociation de soutien
lauto-dveloppement (Asad).
Lassociation ferme thrapeutique pour handicaps Sidi Thabet
lassociation ferme thrapeutique pour handicaps a t cre avant la rvolution de 2011 et compte 103 adhrents bnvoles. La majorit des membres
du comit directeur et du staff excutif a un niveau dtudes suprieures. Les
domaines dintervention de lassociation sont la formation, linsertion et le
dveloppement agricole ou rural tout en accordant une importance la protection de lenvironnement. Sa population-cible est les personnes besoins spcifiques (personnes en situation de handicap PSH) appartenant des familles
ncessiteuses. Son intervention se limite au niveau de sa rgion dimplantation : Sidi Thabet, au nord-ouest de Tunis, dans le gouvernorat de lAriana.
Lassociation gre une ferme thrapeutique pour handicaps. Sa mission est la prise en charge ducative et thrapeutique ainsi que la formation
professionnelle de 74 jeunes PSH grce une quipe pluridisciplinaire de
43salaris encadrs par les membres de lassociation, tous volontaires et
dont cinq temps plein. Les objectifs spcifiques sont :
168
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
une prise en charge spcialise des personnes en situation dhandicap
(PSH) grce des activits thrapeutiques adaptes pour assurer le dveloppement des capacits physiques et mentales des jeunes travers un programme individuel personnalis ;
le bien-tre des jeunes par la promotion des loisirs, des activits culturelles et sportives ;
lintgration sociale des jeunes travers linsertion professionnelle.
Le budget est compos de :
la mise en place de projets par des appels projets, des dons dinstitutions publiques ou prives, locales ou trangres et aussi par des privs ;
les frais de fonctionnement du projet et son dveloppement (salaires,
frais lis la structure et aux animaux) sont assurs par les apports de lassociation (manifestation, dons, cotisations, etc.).
Les ressources de la ferme, en 2012, sont ventiles comme suit : 70 %
aux manifestations organises par lAFTH ; 15 % la vente produits agricoles ;
7 % de dons et cotisations ; 8 % de caisses nationales.
Daprs les donnes sur les ressources, il convient de souligner que
lassociation dgage des ressources marchandes de deux sources : loffre de
prestations culturelles, et la vente des produits agricoles de la ferme. Dans ce
sens, la ferme rpond plus au modle dentreprise sociale de lcole des ressources marchandes qui considre la nature des biens ou des services gnrant des revenus marchands comme secondaire pourvu quils sont investis
dans latteinte de la mission sociale.
Au niveau de la gouvernance, lassociation est gre par un organe excutif lu qui veille la transparence financire en communiquant tous les
dtails financiers y compris la taille du budget. Mme en dehors de lassemble gnrale, les membres ont la possibilit de suivre et de contrler les
oprations financires. En outre, lassociation sinscrit dans une dynamique
participative o elle est souvent consulte par les pouvoirs publics, opre en
collaboration avec eux et les invitent participer ses assembles gnrales.
Ceci tant lassociation a un grand degr dautonomie par rapport aux instances publiques.
Par ailleurs, lassociation sest fix comme objectifs de dvelopper les
projets au niveau de la ferme pour quils sautofinancent; le surplus de bnfice financera les microprojets de jeunes qualifis. En effet, ltat actuel,
la ferme dispose dun poulailler de 323 m2 (84 m2 couvert en dur et 173 m2
parcours dont 66 m2 ombrires). Les dimensions du poulailler permettent
dlever 300 poules pondeuses et de 1 200 poulets de chaires par an.
Le projet consiste donc en lamnagement dun poulailler selon les
normes de conduite en mode bio avec un btiment central (existant) et un
parcours grillag autour de 150 m2 pour les pondeuses ; lamnagement
dune poussinire (existante) et dun parcours grillag de 500 m2 dont le
tiers sera ombrag ; lacquisition du matriel dlevage ; lachat danimaux ;
les frais de certification.
Ce projet est innovant dans la mesure o :
cest un projet solidaire (formation professionnelle de jeunes handicaps
ncessiteux, financement de microprojets et cration demploi pour eux) ;
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
169
Tunisie
il fait appel des technologies favorisant la production bio (EM technologie65, ensemble de micro-organismes, autoris par les organismes certificateurs biologiques dont Ecocert) ;
la commercialisation diversifiera les canaux de distribution (vente par
Internet, sur les lieux de travail et dans les boutiques spcialises), sous le
label commerce quitable (pratiqu dj la ferme pour les produits du terroir).
En termes de retombes socio-conomique, le projet crera deux postes
permanents la premire anne, deux temps partiel et linsertion de dix
jeunes handicaps par an les annes suivantes.
Par rapport au rfrentiel Emes, le projet renforce lorientation march
de lassociation en dveloppant ses ressources marchandes par des activits
commerciales intimement lies sa mission sociale.
65. EM technologie
est utilise dans la
litire des animaux
pour activer la
dcomposition des
dchets, dans leur
alimentation pour
lutter contre les
diarrhes et dans
le nettoyage des
btiments.
Lassociation de soutien lauto-dveloppement
asad est une association de dveloppement cre en 1988 et compte
140 adhrents dont 24 sont des travailleurs rmunrs. La majorit des
membres du comit directeur et de lorgane excutif ont un niveau dtudes
suprieures. Asad dispose dun sige Tunis. Les domaines dintervention
sont multiples et touchent aux aspects conomiques, sociaux et environnementaux. Les principaux sont la lutte contre la pauvret travers le dveloppement rural et agricole et le dveloppement communautaire, la sant,
lducation et la formation la protection de lenvironnement et la gestion des
ressources naturelles.
La multitude de domaines dintervention dAsad montrent que les objectifs ont volu au cours des annes suivant les volutions socio-conomiques
en Tunisie. Malgr cela, la mission sociale reste dfinie et explicite. Asad
vise la lutte contre la pauvret et la prcarit et lamlioration des revenus et
des conditions de vie des populations vivant dans des zones marginalises.
Le primtre dintervention dAsad est national avec une focalisation
sur trois gouvernorats : Bizerte, Zaghouan et Kairouan. Les groupes cibles
dAsad sont les populations pauvres des milieux urbain et rural et toutes les
tranches dge (enfants, jeunes, personnes ges) avec une attention particulire accorde aux femmes.
Lassociation produit dune manire continue des biens et des services
qui servent directement sa mission sociale qui lui permettent de gnrer des
revenus. Nanmoins, les revenus marchands ne constituent pas une part
importante de ses ressources. Les ressources financires proviennent des
partenariats avec la Banque tunisienne de solidarit (BTS), les fonds publics
et les dons des organisations trangres (ambassades, ONG). Par exemple,
en 2009, les allocations obtenues de la BTS se sont leves 1,5 million de
TND. En septembre 2011, Asad a obtenu une subvention de lambassade de
France en Tunisie dans le cadre du Fond de dveloppement social (FDS) de
15 000 euros pour financer un projet sur la promotion de lartisanat fminin
Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte).
Asad a recours aux travailleurs rmunrs. La part de ceux-ci reprsente
17 % des adhrents dAsad. Bien quelle soit infrieure au seuil rencontr
dans la littrature ( minimum 50 %), cette part reste importante par rapport
170
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
la moyenne identifie dans les tudes faites sur les chantillons dassociations ( 2,5 emplois par association en moyenne).
Dans le cadre de ses projets, Asad a cr en 1994 un centre de milieu
naturel Chlaghmia Menzel Bourguiba qui assure aux jeunes filles lcart
du systme scolaire une formation professionnelle accompagne dun cycle
dalphabtisation. lissue de cette formation (deux trois ans), les bnficiaires sont places dans des usines de confection ou sinstallent leur
compte laide dun micro-crdit octroy par lAsad. Plus de mille femmes
ont bnfici des activits du centre. Une centaine dentre elles ont constitu
en 2003 lAssociation de femmes artisanes de Menzel Bourguiba.
Afin de renforcer son orientation march, Asad doit augmenter ses capacits dans les aspects suivants : la prparation des dossiers de soumissions aux
appels proposition lancs par les partenaires techniques et financiers ainsi
que par les institutions publiques ; lidentification des opportunits de march ; les techniques de commercialisation et de communication promotionnelles (marketing) ; les technologies de linformation et de la communication,
ainsi que la communication interne et externe
En matire de gouvernance, Asad jouit dun degr lev dautonomie
par rapport aux partenaires (pouvoirs publics, entreprises prives lucratives).
Elle est gre par un organe excutif lu pour un mandat de deux ans. Le
pouvoir de dcision suit le principe un membre, une voix. La gestion financire
de lassociation est transparente. Les informations financires sont communiques tous les adhrents qui ont aussi la possibilit den assurer le suivi
mme en dehors des assembles gnrales.
Dans sa relation avec les diffrents partenaires, contrairement aux rsultats des enqutes menes dans le cadre des tudes de COWI et de Malena et
al., Asad entretient une relation de partenariat avec les institutions publiques
et autres partenaires techniques et financiers. Dun ct, elle est consulte
par les pouvoirs publics dans des questions qui soulvent de ses domaines
dintervention. Dun autre ct, Asad invite les partenaires et les usagers
participer ses assembles gnrales. Nanmoins, Asad reproche aux pouvoirs publics la faible implication effective des associations dans les processus dlaboration des politiques publiques, la lourdeur des procdures administratives et la quasi absence de promotion des initiatives russies manant
des organisations par domaine dintervention.
Daprs lanalyse mene jusquici, Asad rpond plusieurs critres de
lidal-type de lEmes et contribue la production de valeur ajoute hybride
( sociale et conomique). Elle fournit des services sociaux communautaires
( externalits positives lies la formation et lalphabtisation des femmes
artisanes, par exemple) et contribue linsertion professionnelle et au dveloppement de projets via loctroi de micro-crdits.
171
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Conclusion et recommandations
lanalyse du contexte socio-conomique a montr que la Tunisie fait face
des dfis socitaux majeurs caractriss par les disparits rgionales et les
ingalits sociales, do lutilit des organisations de lconomie sociale et
solidaire comme vecteurs de dveloppement et porteuses de solutions innovantes ces dfis.
Le diagnostic du secteur de lconomie sociale et solidaire en Tunisie a
port sur les dispositifs institutionnel, juridique et de financement ainsi que
sur une comparaison euro-mditerranenne des politiques publiques. Il a
tent de positionner les organisations de lconomie sociale et solidaire tunisiennes par rapport lidal-type dvelopp par le rseau Emes. Ce diagnostic
a montr lexistence dentraves au dveloppement de lconomie sociale et
solidaire en Tunisie :
la reconnaissance institutionnelle de lconomie sociale et solidaire en
Tunisie reste faible. La relation pouvoirs publics-organisations de lconomie sociale et solidaire se fait selon des dimensions sectorielles induisant
une multiplicit des vis--vis institutionnels avec un manque de coordination entre eux. La gestion de la relation par ces instances sest caractrise
par le manque de communication dinformations fiables et pertinentes, par
une lourdeur bureaucratique et par lingrence dans la gestion de certaines
formes dorganisations (SMSA, GDA et mutuelles) ;
bien que les organisations soient reconnues sur le plan juridique
comme des acteurs privs, lencadrement juridique sest caractris par son
inadaptation aux nouvelles exigences socio-conomiques dans certains cas
( les mutuelles ). Labsence dun cadre juridique gnral entrave lapparition
de nouvelles formes dorganisations et donc linnovation sociale ;
labsence dune politique de formation et de recherche en matire dconomie sociale a eu pour consquence la faiblesse quantitative et qualitative
des comptences des organisations ce qui sest rpercut sur leurs capacits organisationnelles et managriales. Mme les politiques daides par des
services concrets, notamment en matire de formation, nont pas permis de
mettre niveau les comptences au niveau des organisations ;
la politique de demande reste la plupart du temps exclusive avec une
faible participation des organisations aux marchs publics rduisant ainsi
leur marge de croissance ;
labsence et les faibles opportunits de croissance se sont rpercutes
sur la taille des organisations, notamment les associations et les organismes
professionnels agricoles, ce qui sest traduit par le manque de ressources
matrielles ( sige ou local ainsi que les quipements ncessaires) et linsuffisance et lirrgularit des ressources financires ;
bien que les groupes dont manent les initiatives sociales soient de
bonne volont et fortement engags, ils reconnaissent leur faible matrise des
mtiers lis aux divers domaines dintervention, linsuffisance de leur capacit en matire de prparation des dossiers de soumission, de planification,
de conception, de montage et de gestion des projets, de marketing associatif
et dutilisation des technologies de linformation et de la communication.
172
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
A partir de ce diagnostic et afin de mieux insrer les organisations de
lconomie sociale et solidaire dans le champ conomique, des recommandations peuvent tre avances. Elles impliquent aussi bien les acteurs nationaux
que des acteurs du Nord ou du Sud de la Mditerrane :
mise en place dun cadre juridique harmonis entre les pays du Maghreb
favorisant lmergence de nouvelles formes dentreprises sociales et le dveloppement de celles existantes ;
instauration, au Premier ministre, dun secrtariat dtat lconomie
sociale et solidaire relay, au niveau rgional, par des dlgations rgionales
qui sont membres permanents des conseils rgionaux. Doter le secrtariat
dtat dun observatoire national de lconomie sociale et solidaire ;
cration dun fonds spcial pour la promotion de lconomie sociale et
solidaire financ par les fonds publics (diffrents budgets), personnes physiques et morales et gr par le secrtariat dtat ;
mise en place dune plateforme mutuelle regroupant les intervenants de
lconomie sociale et solidaire (entreprises sociales, partenaires financiers et
autorits rgionales ) ;
contribution au dveloppement des institutions de micro-finance travers des partenariats Nord-Sud entre institutions europennes et institutions
financires tunisiennes et socits prives ;
laboration et mise en place conjointe dune politique de formation et
de recherche, au niveau des universits entre pays maghrbins et europens ;
dveloppement de partenariats de types Sud-Sud et Nord-Sud en matire
dappui technique aux organisations de lconomie sociale et solidaire travers des formations et des changes dexpertise dans des domaines lis au
dveloppement de lorientation march des organisations et la gouvernance
participative ;
diversification des leviers de croissance des organisations de lconomie
sociale et solidaire en mettant en place une politique de demande inclusive
notamment en matire de marchs publics.
173
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
anne x e 1
Cadre juridique des organisations de lconomie
sociale et solidaire en Tunisie
plusieurs organisations interviennent dans la vie sociale sans pour
autant susciter le mme intrt. Le lgislateur na choisi de rgir soigneusement que certaines dentre elles. Dautres nont aucun statut particulier et
sont organises par des textes assez anciens et peu cohrents (mutuelles).
Des troisimes nont mme pas t encadres par le lgislateur malgr leur
importance historique en Tunisie et actuelle dans le monde (fondations). Il
nen demeure pas moins que le trait commun de ces entits reste le but non
lucratif, ou du moins labsence de cette intention dans lesprit des fondateurs.
Cette prcision est suscite par le fait que selon quelques textes, comme celui
qui rgit les mutuelles, il est possible en fin danne comptable de partager
une partie des excdents (appels dividendes par le dcret de 2007 relatif aux
socits mutuelles de services agricoles cites ultrieurement).
Ces organismes ont plusieurs points communs. Notamment les principes qui les rgissent : le principe de ladhsion libre et de la porte ouverte,
celui de la gestion dmocratique, celui de la promotion sociale et de lducation. En revanche, dautres principes distinguent lassociation des autres
organismes. Pour les associations, le lgislateur ne peut pas obliger ladhrant participer par une cotisation quelconque sauf si les statuts le stipulent
expressment ; contrairement aux autres organisations o la cotisation est
obligatoire. Alors que les organismes de type associatif sont soumis la
contrainte de non-distribution, dautres organisations peuvent procder
la rpartition des excdents au prorata des oprations effectues ainsi qu la
rmunration limite du capital (article 2 de la loi de 1967 relatif la cooprative par exemple).
Le cadre juridique des organisations de lESS en Tunisie est caractris
par une multiplicit de textes et de formes juridiques. Le lgislateur a cherch
le rgime adquat qui permet de concilier entre deux impratifs : une libert
daction requise pour permettre ces organismes daccomplir leur mission
sociale ; et une obligation de contrle effectu par ltat tantt antrieurement
la cration de lorganisation par le biais de la multiplication des formalits
de constitution, tantt postrieurement en les soumettant une multitude de
conditions de transparence essentiellement financire. Or cette diversification
rend lopration plus complique pour tous les acteurs.
Dans le mme contexte, le lgislateur a essay de suivre lvolution
du secteur. Toutefois ces essais ponctuels ne procdent pas une rvision
densemble pour trouver une solution globale, adquate et harmonieuse. On
constate lchec des coopratives, on les remplace par des socits mutualistes. Le contexte actuel exige un encouragement de la libert daction et
dexpression ( ex. : le remplacement de lobligation dagrment dans la cration des associations par la procdure de dclaration).
174
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Lassociation. Daprs larticle 2 du dcret-loi n2011-88 de 24 septembre
2011 abrogeant la loi n59-154 du 7 novembre 1959 lassociation est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun dune
faon permanente leurs connaissances ou leur activit dans un but autre que de
partager des bnfices. noter : la loi relative lassociation rgit plusieurs
autres formes dorganisations de lESS en Tunisie telles que les fondations
et les amicales.
Le principe dict par larticle 4 (une lecture a contrario ) est la gnralit
du champ dintervention des associations ; larticle souligne dailleurs seulement les restrictions : lobjet de lassociation ne peut tre une quelconque
invitation la violence, discrimination de quelque nature que ce soit : religion,
sexe, etc. De mme, lassociation ne peut exercer des activits commerciales
si lobjectif est de distribuer des bnfices entre ses membres des fins personnels. Les associations couvrent plusieurs domaines : diverses catgories
telles que les associations fminines, juridiques, sportives ou scientifiques.
Le dcret-loi susvis na pas prcis la forme dadministration ou de
prise de dcision au sein de lassociation, ce qui laisse une marge de libert
aux fondateurs.
Lassociation est constitue selon le principe de la dclaration auprs du
secrtariat gnral du gouvernement ; le Premier ministre se rserve le dlai
dun mois pour se prononcer. Son silence vaut acceptation.
Le dcret-loi de 2011 a exig par contre un ge minimum de 16 ans pour
fonder une association, et de 13 ans pour y adhrer ; or comment concilier
entre lobligation de reprsenter lassociation vis--vis des tiers et des administrations par une personne qui devrait tre capable dobliger et de sobliger,
et le fait que cette personne pourrait ne pas avoir la capacit lgale tant quelle
a moins de 18 ans accomplis.
La cooprative et les socits mutuelles de services agricoles. Larticle 2 de la
loi n 67-4 du 19 janvier 1967 relative au statut de la coopration la dfinit
comme tant : des socits capital et personnel variable constitues entre des
personnes ayant des intrts communs qui sunissent en vue de satisfaire leurs
besoins et amliorer leurs conditions matrielles et morales. Contrairement aux
associations, le champ dintervention des coopratives est limit par le lgislateur qui, dans lalina 2 du mme article, dispose : Elles exercent leurs activits dans les secteurs dfinis par le Plan national de dveloppement . Dailleurs
le lgislateur prvoit dans larticle 5 de la mme loi lobligation de se conformer des statuts types, fixs par un dcret. En dautre termes, il prvoit des
mentions obligatoires auxquelles on ne peut droger.
Le dcret n 70-516 du 21 septembre 1970 fixe le statut-type des coopratives de service, type polyculture. Contrairement lassociation, la cooprative est soumise au rgime de lagrment.
La coopration dans le secteur agricole est rgie par une loi spciale n6349 du 27 mai 1963. Une loi ultrieure, du 18 octobre 2005, cre une nouvelle
forme : les socits mutuelles de services agricoles. Cette loi nabroge pas
expressment la loi de 1963 ; nanmoins, ces socits ont le mme objet que
les coopratives rgies par la loi de 1963.
175
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
La loi n 94 en date du 18 octobre 2005 rgissant les socits mutuelles
de services agricoles est complte par le dcret n1390 en date de 11 juin
2007 relatif lapprobation des statuts-types des socits mutuelles centrales
de services agricoles (lapprobation est dailleurs faite conjointement par le
ministre de lAgriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des
Finances ) ; et un dcret n1391 la mme date et relatif lapprobation des
statuts-types des socits mutuelles de base de services agricoles (approuvs
quant ceux-ci par le ministre de lAgriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de lIntrieur et de dveloppement local et le ministre des
Finances ).
Ces socits ont, en ce qui concerne leur administration, le mme rgime
juridique que les socits commerciales anonymes rgime moniste : un
conseil dadministration prsid par une personne lue. Le prsident du
conseil, son reprsentant lgal, peut tre aid par des directeurs gnraux.
Ce choix pris par le pouvoir de tutelle ne laisse aucun choix dun autre mode
de gouvernance. Par ailleurs, chaque adhrent aura droit une seule voix au
sein des assembles gnrales, quelque soit sa participation dans les parts
du capital.
Les groupements de dveloppement dans le secteur de lagriculture et de la
pche. La loi n2 004-24 en date de 15 mars 2004 modifiant la loi n99-43 du
10 mai 1999 prvoit que tous les propritaires et exploitants dans le secteur
de lagriculture et de la pche doivent adopter la dnomination de groupement
de dveloppement dans le secteur de lagriculture et de la pche. Les groupements
dintrt collectif deviennent aussi rgis par cette loi et doivent dans le dlai
de 3 ans de la promulgation de ladite loi se conformer ses dispositions.
Lobjectif de ces groupements est de rpondre aux besoins de ses adhrents
tout en dveloppant le secteur dagriculture et de la pche et protger les
ressources naturelles.
Le lgislateur de 1999 a modifi leur dnomination en les appelant
groupements pour souligner leur diffrence par rapport au rgime des associations. Un dcret n99-1819 du 23 aot 1999, modifi par un dcret n20013006, lui-mme modifi par un dcret n2005 du 24 mars 2005 prcise les
statuts-type de ces groupements. Ces groupements ont le mme modle de
gouvernance que les socits mutuelles : ils sont administrs par un conseil
dadministration lu par une assemble gnrale, organe suprme qui prend
toutes les dcisions.
Les mutuelles. Aucune loi porte gnrale ne rgit les mutuelles. Un dcret
dat du 18 fvrier 1954 dfinit par contre les socits mutualistes comme des
socits capital et personnel variables, dont lobjectif est prcis par les statuts,
rpondant aux exigences des statuts-types tablis par le lgislateur dans le
cadre dun dcret ancien qui date de 1954. Un arrt de 17 septembre 1984,
manant du ministre des Finances et du ministre des Affaires sociales
conjointement, complta les dits statuts. Une disposition est rendue obligatoire dans les statuts des mutuelles : la socit sinterdit toute discussion
politique, religieuse ou trangre aux buts de la mutualit.
176
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Tunisie
Selon ce dcret de 1954, les mutuelles sont des groupements qui, au
moyen des cotisations de leurs membres se proposent de mener dans lintrt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prvoyance, de solidarit
et dentraide tendant la couverture des risques inhrents la personne
humaine : maladie, maternit, vieillesse, accident, invalidit, dcs, etc.
exception faite des organismes privs dassurances rgulirement agres
en Tunisie et inscrits sur une liste arrte par le Directeur des Finances et
publies au journal officiel Tunisien qui sont soumis un rgime spcial.
Les statuts adopts par lassemble constitutive doivent tre dposs
contre rcpiss, la Direction des finances pour approbation. Lapprobation
fait objet dun arrt conjoint du ministre des affaires sociales et du directeur
des finances. Cet arrt doit intervenir dans le dlai de trois mois compter
de la date du dpt des statuts.
On souligne que dans certaines mutuelles, essentiellement celles qui
reprsentent des groupements professionnels, telle que la mutuelle des personnels des douanes, ladhsion est obligatoire la loi n 89-53 du 14 mars
1989 portant constitution dune mutuelle des personnels des douanes et
ce, moyennant une cotisation dont le montant est retenue la source sur
leurs traitement et moluments.
Une loi n 82-69 du 6 aot 1982, portant constitution dune mutuelle
des personnels de la Garde nationale et de la protection civile prcise par
exemple que cette socit mutuelle est sous la tutelle du ministre de lIntrieur ; celle relative aux personnels des douanes susvise est par contre sous
la tutelle du ministre des Finances.
Le cadre juridique rgissant les mutuelles, datant de 1954, ne rpond
plus aux mutations socio-conomiques qua connu la Tunisie. Par ailleurs,
ce texte ne prend pas considration certaines activits et prestations assures
par les mutuelles.
Lanalyse du cadre juridique a montr jusquici la diversit des textes
juridiques rgissant les activits des organisations de lconomie sociale et
solidaire en Tunisie. Il a aussi soulign la varit dinstances de tutelles des
diffrentes organisations.
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
177
bibliographie
ess en algrie
AUTES, M., 2006, Les acteurs et les
rfrentiels , in J. N. CHOPART et al.,
Lesdynamiques de lconomie sociale et solidaire,
LaDcouverte, Recherches, pp. 81-113.
BENLAHRECH R., Pourquoi les Algriens ne
sassurent pas ? Edition du 27 fvrier 2013, site
www.economie.jeuneafrique.com.
BATIFOULIER P. (1995) : Lconomie sociale, Paris
Puf.
BADDACHE F. (2004) : Entreprises et ONG, Paris
LHarmattan.
BEN NEFISSA, ET AII (2004) : ONG et
gouvernance dans le monde arabe, Paris KarthalaCedej (425p).
BESSAOUD O (2005) : Les organisations
rurales au Maghreb : un essai dvaluation de leur
rle dans le dveloppement agricole et rural .
Communication sminaire SFER.
CLERC D. (1996) : De lconomie des
conventions lconomie de la rgle, de lchange
et de la production in Economies et Socits, srie
Economie du travail, n 11-12.
CLERC D. (1999) : Ethique : Lconomie et la
vertu Alternatives conomiques N171.
CHOPART J. N., NEYRET G., RAULT D. (2006) :
Les dynamiques de lconomie sociale et solidaire.
Paris, ed. La dcouverte.
Conseil national des assurances (CNA), Note
de conjoncture du march des assurances,
1ertrimestre 2013, sur le site www.cna.dz.
COLLOMBON J. M. ET PARODI M. (1997) :
Lconomie solidaire a-t-elle besoin de lconomie
sociale ? : Recma n 264.
DELORME A. (1983) : LEtat et lEconomie. Paris
Seuil.
DEMOUSTIER D. (1995) : Lconomie sociale
toujours rinventer (entretien) Alternatives
conomiques N126.
DEMOUSTIER D. (2003) : Lconomie sociale et
solidaire : sassocier pour entreprendre autrement.
Paris Syros.
DRAPERI J. F. (2005) : Les entreprises sociales,
Paris, Fondation du crdit coopratif.
ENJOLRAS B. (1993) : Vers une thorie socioconomique de lassociation : lapport de la thorie
des conventions , Recma n 250.
ENJOLRAS B. (2002) : Lconomie solidaire et le
march ; Modernit socit civile et dmocratie, Paris,
LHarmattan.
ENJOLRAS B. (2005) : Economie sociale et
solidaire et rgimes de gouvernance , Recma
n 296. (pp 56-69).
FLAHAUT E, NOGUES H., SCHIEB-BENFAIT,
(2011), Lconomie sociale et solidaire. Nouvelles
pratiques et dynamiques territoriales, PUR, Rennes.
FAVREAU L (2002) : Mondialisation, conomie
sociale, dveloppement local et solidarit
internationale. Presses de lUniversit du Qubec.
FERREIRA N., LIPIETZ A. (2005) : Economie
solidaire et autogestion, Paris LHarmattan.
GARRAB M. (2003) : Utilit sociale et capital
social interne. CEP N12.
GARRAB M (2007) : La valeur dactivit totale
(VAT) et analyse diagnostic du tourisme social en
Languedoc-Roussillon, Revue de lUNAT.
HIRSCHMAN A (1984) : Moralit et sciences
sociales in Lconomie comme science morale et
politique, Paris, ed. Le Seuil/Gallimard.
KMPG, Guide des assurances en Algrie, 2009.
LA DOCUMENTATION FRANAISE (1998) :
Lconomie sociale : un secteur davenir, Paris.
LAVILLE J. L. (1995) : Lconomie solidaire :
une nouvelle forme dconomie sociale ? Recma
n 255.
LAVILLE J. L. (2001) : Vers une conomie
sociale et solidaire , Recma N281.
178
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
LIPIETZ, ALAIN (2001) : Pour le tiers secteur :
lconomie sociale et solidaire : pourquoi et comment,
Paris. La Documentation franaise/LaDcouverte.
CHARIF, M., BENMANSOUR, A., 2011, Le rle
de lEtat dans lconomie sociale en Algrie, Revue
internationale de lconomie sociale, Recma n 321.
OULD AOUDIA J. (2006) : Croissance et rforme
dans les pays arabes mditerranens, Paris, AFD /
Karthala.
DEMOUSTIER, D., 2012, Economie sociale
et action publique : largissement, substitution
ou aiguillon ? in Laction publique dans la crise.
Vers un renouveau en France et en Europe ? Sous
ladirection de Philippe BANCE, Publications
desuniversits de Rouen et du Havre.
PECQUEUR B. (2009) : Gestion durable des
territoires, dveloppement local et solidaire :
regards croiss , Natures Sciences Socits 3/2009
(Vol. 17), p. 299-301.
PROUTEAU L. (2006) : La mesure de la
valorisation du bnvolat. Colloque de lAddes Mars.
RIZZO P. (2003) : Lconomie sociale et solidaire
face aux exprimentations montaires : monnaies
sociales et monnaies multilatrales, Paris,
LHarmattan.
SEN A. K. (1998) : Lconomie est une science morale
Paris, La dcouverte (p. 69).
SEN A. K. (2000) : Un nouveau modle
conomique: dveloppement, justice, libert. Paris
Odile Jacob.
SEN A. (2005) : La dmocratie des autres Pourquoi
la libert nest pas une invention de lOccident Paris,
Payot.
Service Economique Rgional dAlger, Le secteur
des assurances en Algrie (2012), Publications
des Services conomiques, Direction Gnral du
Trsor, septembre 2013.
STIGLITZ J. E. (2004) : La grande dsillusion ;
Paris Fayard.
STIGLITZ J. E. (2006) : Un autre monde, Paris
Fayard.
STIGLITZ J.E. (2008) : Allocution au 27e congrs
du CIRIEC, Sville 23-25/09/08
TAIBI, L., Le secteur algrien des assurances
boud par les compagnies trangres , Les
Afriques (journal en ligne).
TCHERNOGOG V. (2001) : Ressources
financement public et logiques dactions
dassociations Recma n282.
VIENNEY, C. (1985) : Lorganisation cooprative
comme instrument de politique conomique.
Revue des Etudes Coopratives n 16.
VIENNEY C. (1994) : Lconomie sociale, Paris,
Ed.La dcouverte.
VIENNEY C (2002) : Coopration et conomie
sociale au second XXe sicle, Institut de
lconomie sociale, Paris lHarmattan.
FRAISSE L., 2005, Les enjeux dune action
publique en faveur de lconomie sociale et
solidaire, ERESS, Sociologie conomique, in
Genauto Carvalho da Frana et al., Action publique
et conomie solidaire, (pp. 335-345).
ess au maroc
Abdelkhalek, Touhami, (2007), Lconomie
sociale au Maroc : tat des lieux et perspectives
davenir , dans La economa social en el Magreb :
La situacon de Marruecos y Tnez, (Lconomie
sociale au Maghreb : la situation au Maroc et
en Tunisie), Agencia espaola de cooperatcion
internacional.
AMAPPE, ODCO, Banque Mondiale, (2000),
Annuaire des associations de dveloppement au
Maroc , Editions OKAD, Rabat.
Bennani A., Houzir M., Filali Meknassi R., (1999),
Diagnostic des ONGs oeuvrant dans le domaine
de lenvironnement et du dveloppement au Maroc ,
PNUD, Rabat.
Chaize, Christian, (2003), Lconomie sociale et
solidaire au Maroc : les conditions de son dveloppe
ment , Mmoire pour lobtention de la licence
professionnelle Accompagnement et coordination
des projets de solidarit internationale et de
dveloppement durable , Universit Michel de
Montaigne, Bordeaux 3.
Defourny, Jacques et Develtere, Patrick, Jalons
pour une clarification des dbats sur lconomie
sociale , www.hiva.be/docs/artikel/ ART12_PD_
ADADialogue_1997.htm.
Dpartement de la Prvision conomique et du
Plan (Direction rgionale de Marrakech-Tansift-El
Haouz), (2003), ONGs de la Rgion de MarrakechTansift-El Haouz actives dans le domaine de la
femme , 2002-2003.
Dpartement de lartisanat et de leconomie
sociale, Direction des etudes de la coopration et
de la lgislation, (2005), Etude sur le secteur de
lEconomie Sociale : Rgions du Souss-Massa-Dra et
de lOriental, Rabat.
179
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Dpartement de lArtisanat et de lEconomie
Sociale, Direction des Etudes de la Coopration
et de la Lgislation, (2007), Note sur lconomie
sociale au Maroc : lments dapproche stratgique ,
Rabat.
Espace Associatif, (1999), Laction associative
au Maroc : lments de diagnostic , actes des
tables rondes organises par lEspace Associatif,
Fondation Friedrich Ebert Stiftung, Rabat.
Ibrouk, Aomar et Sahli, Fatiha La promotion
des actions du mouvement associatif au Maroc : des
ralisations apprciables valuer , Euro-Med
Integration - NCRE - University of Canterbury New Zealand, http://www.europe.canterbury.ac.nz/
publications/euromed/.
Mertens, Sybille, (2001), Lconomie sociale, un
troisime secteur apprhender , in Economie Autrement, Dossier Economie sociale, Hautes
tudes commerciales - HEC, Lige.
Ministre des Affaires Etrangres et de la
Coopration, (Direction de la Coopration
Multilatrale), Fonds des Nations Unies pour la
Population, (2005) Rpertoire des ONGs de la
rgion de Mekns-Tafilalet oprant dans le domaine de
lhabilitation des femmes , Axions communication.
Ministre dlgu auprs du chef du
gouvernement charg des affaires economiques et
gnrales, (2011), Stratgie nationale de lconomie
sociale et solidaire 2010-2020 , Rabat
Ministre du Dveloppement social, de la Famille
et de la Solidarit, (2007), Bilan de laction
gouvernementale et perspective moyen terme ,
Bilan du ministre du Dveloppement social, de la
Famille et de la Solidarit pour la priode octobre
2002-juin 2007.
Prier, Florence, (2005), Etude sur le bnvolat et
le volontariat au Maroc , PNUD Maroc, Rabat.
Sadi S., Toepler S., et Salamon L., (2003),
Lesecteur but non lucratif au Maroc , Edition
Imprial, Rabat.
Sidi Hida, Bouchra, Les ONG de dveloppement,
logiques dacteurs et stratgies de dveloppement, le cas
du Maroc , www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/dvlp/
documents/DT_25_Bouchra.pdf.
ODCO, (2010), Annuaire statistique des
coopratives et unions des coopratives , Rabat,
Maroc.
Da h irs e t Dcrets de rfre n ce
Dcret n2-02-638 du 9 rejeb 1423 (17 septembre
2002) fixant les attributions et lorganisation
du ministre de lconomie sociale, des petites
et moyennes entreprises et de lartisanat
(dpartement de lconomie sociale et des petites
et moyennes entreprises et dpartement de
lartisanat), (Bulletin Officiel n5044 du jeudi
3octobre 2002)
Dahir n 1-99-207 du 13 joumada II 1420 (25 aot
1999) portant promulgation de la loi n 12-99
portant cration de lAgence de dveloppement
social (Bulletin Officiel n4732 du jeudi 7 octobre
1999)
Dahir n 2-99-69 du 25 joumada II 1420
(6 octobre 1999) pris pour lapplication de la
loi n 12-99 portant cration de lAgence de
dveloppement social (Bulletin Officiel n4732 du
jeudi 7 octobre 1999)
Dahir portant loi n 1-73-654 du 11 Rabia II 1395
(23 avril 1975) relatif lOffice du dveloppement
de la coopration (ODCO.). (Bulletin Officiel
n 3264 du mercredi 21 mai 1975).
Dahir n1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5octobre
1984) portant promulgation de la loi n24-83
fixant le statut gnral des coopratives et les
missions de lOffice du dveloppement de la
coopration. (Bulletin Officiel n 4240 du mercredi
2 fvrier 1994).
Dcret n 2-97-352 du 24 Safar 1418 (30 juin 1997)
instituant, au profit de lOffice du dveloppement
de la coopration, une taxe parafiscale dite Taxe
de dveloppement coopratif (Bulletin Officiel
n4495 Bis du lundi 30 juin 1997).
Dahir n1-58-376 du 3 Joumada I 1378
(15novembre 1958) rglementant le droit
dassociation (Bulletin Officiel n2404 bis du jeudi
27novembre 1958)
Dahir n1-94-260 du 4 Moharrem 1415 (14 juin
1994) portant promulgation de la loi n 34-93
portant ratification du dcret loi n 2-92-719 du
30 Rabia I 1413 (28 septembre 1992) modifiant et
compltant les articles 18 et 32 du dahir n1-58376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958)
rglementant le droit dassociation (Bulletin Officiel
n 4259 du mercredi 15 juin 1994)
Dahir n1-02-206 du 12 Joumada I 1423 (23
juillet 2002) portant promulgation de la loi n
75-00 modifiant et compltant le dahir n1-58376 du 3Joumada I 1378 (15 novembre 1958)
rglementant le droit dassociation (Bulletin Officiel
n5048 du Jeudi 17 Octobre 2002)
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
180
Dahir n 1-57-187 du 24 Joumada II 1383
(12 novembre 1963) portant statut de la
mutualit (Bulletin Officiel n 2666 du vendredi
29novembre 1963)
Banque Africaine de Dveloppement, 2009. Appui
au programme de renforcement des groupements
de dveloppement agricole deau potable. Rapport
dvaluation, Tunis: s.n.
Dcret Royal n 249-66 du 29 Safar 1386 (18 juin
1966) fixant la composition et les attributions du
Conseil Suprieur de la mutualit (Bulletin Officiel
n2800 du mercredi 29 juin 1966)
Banque Mondiale et Socit Financire Interna
tionale, 2013. Doing business. Des rglementations
intelligentes pour les petites et moyennes entreprises,
Washington D.C.: Banque Mondiale.
Dcret Royal portant loi n 130-68 du 10 Joumada
I 1388 (5 aot 1968) modifiant le dahir n1-57-187
du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant
statut de la mutualit (Bulletin Officiel n2911 du
mercredi 14 aot 1968)
Baron, D., 2007. Corporate Social responsability
and Social Entrepreurship. Journal of Economics &
Management Strategy, 53(6), pp. 1419-1440.
Dahir portant loi n1-76-388 du 25 Safar 1397
(15fvrier 1977) modifiant et compltant le dahir
n1-57-187 du 24 Joumada II 1383 (12 novembre
1963) portant statut de la mutualit (Bulletin
Officiel n3359 du mercredi 16 mars 1977)
Dahir n1-79-33 du 22 Joumada I 1399 (20 avril
1979) portant promulgation de la loi n4-79
abrogeant et remplaant larticle 46 du dahir
n1-57-187 du 24 Joumada II 1383 (12 novembre
1963) portant statut de la mutualit (Bulletin
Officiel n3474 du mercredi 30 mai 1979)
Belaid, O., 2007. Rapport sur lconomie sociale
en Tunisie. In: CEPES, UNCAM, UNAM &
ODCO, eds. Lconomie sociale au Maghreb.
Lasituation au Maroc et en Tunisie. s.l.:s.n., pp. 171218.
Billis, D., 2010. Hybrid organizations and third
sector: Challenges for practice, theory and policy. New
York: Palgrave-MacMillan.
Brouard, F., Hebb, T. & Madill, J., 2008. A typology
of social enterprises, Ottawa: s.n.
Cabinet Office, 2006. Social enterprise Action Plan.
Scaling new heights, London: s.n.
Dcret n2-01-299 du 19 Rabia Il 1422 (11juillet
2001) modifiant le dahir n 1-57-187 du
24Joumada Il 1383 (12 novembre 1963) portant
statut de la mutualit (Bulletin Officiel n 4918 du
jeudi 19 juillet 2001).
Chaves, R., 2002. Politiques publiques et conomie
sociale en Europe: le cas de lEspagne. Annals of
Public and Cooperative Economics, 73(3), pp.453480.
E S S en T unisie
Dees, J., 1998. The meaning of social entrepreurship,
s.l.: mimo.
Abdelkhalek, T., 2007. Economie sociale au
Maroc: Etat des lieux et perspectives davenir.
In: CEPES, UNCAM, UNAM & ODCO, eds.
Lconomie sociale au Maghreb. La situation au
Maroc et en Tunisie. s.l.:s.n., pp. 115-169.
Austin, J., Leonard, H., Reficco, E. & WeiSkillen, J., 2006. Social Entrepreurship: It is
for corporations, too. In: A. Nicholls, ed. Social
Entrepreneurship. New models of sustainable social
change. Oxford: Oxford University Press, pp. 169204.
Bacq, S. & Janssen, F., 2011. The multiple
faces of social entrepreneurship: A review of
definitional issues based on geographical and
thematic criteria. Entrepreneurship and Regional
Development: An International Journal, 23(5),
pp. 373-403.
COWI, 2012. Rapport de diagnostic sur la socit
civile tunisienne, Bruxelles, Belgique: s.n.
Defourny, J., Develtere, P. & Fonteneau, B., 2000.
Social economy north and south, Leuven: s.n.
Defourny, J. & Nyssens, M., 2010. Approches
europennes et amricanes de lentreprise sociale:
Une perspective comparative. Paris, 23e colloque
delADDES.
Di Domenico, M., Haugh, H. & Tracey, P., 2010.
social Bricolage: Theorizing social value creation
in social enterprises. Entrepreneurship: Theory and
Practice, 34(4), pp. 681-703.
Docks, P., 1996. La socit nest pas un piquenique. Lon Walras et lconomie sociale. Paris:
Economica.
181
lconomie sociale etsolidaire aumaghreb
Emerson, J., 2006. Moving ahead together:
Implications of a blended value framework for the
future of social entrepreneurship. In: A. Nicholls,
ed. social entrepreneurship. New models of sustainable
social change. New York: Oxford University Press,
pp. 391-406.
Enjolras, B., 2008. Fondements normatifs des
organisations dconomie sociale et solidaire
et valuation du point de vue des politiques
publiques. Economie et Solidarit, 39(1), pp. 14-34.
Fontan, J., 2011. Entrepreneuriat social et
entrepreneuriat collectif: Synthse et constats.
Revue Canadienne des Recherches sur les OBSL et
lconomie sociale, Issue 2, pp. 37-56.
Gueslin, A., 1998. Linvention de lconomie sociale.
Paris: Economica.
Huybrechts, B., 2012. Fair trade organizations and
social enterprises. Social innovation through hybrid
organization models. New York: Routledge.
Huybrechts, B., Nicholls, A. & Mouchamps, H.,
2012. Entrepreneuriat social: dfinitions, ressorts
et dfis. In: E. Bayle & J. Dupuis, eds. Management
des entreprises de lconomie sociale et solidaire.
Bruxelles: De Boeck University, pp. 89-106.
IBM Belgium, 2010. Etude sur le march de la
microfinance en Tunisie, Brussel: IBM Belgium.
Institut National de la Statistique, 2011.
Lescomptes de la nation, Tunis: s.n.
Kanter, R. & Summers, D., 2006. Doing well
while doing good. In: W. Powell, ed. The nonprofit
sector: A research handbook. New Haven: Yale
University Press.
Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M.,
2013. Worldwilde Governance Indicators. [Online]
Available at: http://info.worldbank.org/
governance/wgi/index.asp
[Accessed 27 Fvrier 2013].
Lvesque, B., 2002. Entrepreneurship collectif et
conomie sociale: Entreprendre autrement, Montral:
s.n.
Malena, et al., 2012. La gouvernance participative en
Tunisie: Amliorer la prestation des services publics
travers des partenariats tat-citoyen, Tunis: s.n.
Maxula Bourse, 2012. Revue Bancaire, Tunis:
Maxula Bourse.
Ministre des Finances, 2007. Rapport sur les
socits mutuelles, Tunis: s.n.
Ministre des Finances, 2011. Vision concerte
pour le dveloppement de la microfinance 2011-2014,
Tunis: s.n.
Monzon, J. & Chavez, R., 2012. Lconomie sociale
dans lUnion europenne, s.l.: s.n.
Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R. & Sanders, B.,
2007. Social innovation: What it is, why it matters
and how it can be accelerated, Oxford: s.n.
Nicholls, A., 2010. Fair trade: Towards an
economic vertue. Journal of Business Ethics, 92(0),
pp. 241-245.
Nicholls, A., Cho & A.H., 2006. Social
Entrepreneurship: the structuration of a field. In:
A. Nicholls, ed. Social Entrepreneurship. New models
of sustainable change. Oxford: Oxford University
Press, pp. 99-118.
Phills, J., Deiglmeier, K. & Miller, D., 2008.
Rediscovering social innovation. Stanford Social
Innovation Review, Volume Fall 2008, pp. 34-43.
Roelants, B., 2009. Cooperatives and social
entreprises. Governance and normative frameworks.
Brussels: CECOP Publications.
Skloot, E., 1987. Enterprise and commerce in
nonprofit organizations. In: W. Powell, ed. The
nonprofit sector: A research handbook. New Haven:
Yale University Press.
World Bank, 2013, a. Opening doors: Gender
equality and development in the MENA region,
Washington D.C.: s.n.
World Bank, 2013, b. Global Financial Inclusion
Database. [Online]
Available at: http://datatopics.worldbank.org/
financialinclusion/ [Accessed 23 october 2013].
World Economic Forum, 2011. Global
competitiveness report, Davos: s.n.
Young, D. & Salamon, L., 2002.
Commercialization, social ventures and for-profit
competition. In: L. Salamon, ed. The state of
nonprofit America. Washington, D.C.: Brookings
Institution, pp. 423-446.
Yunus, M., 2007. Creating a world without poverty:
Social business and the future of capitalism. New
York: Public Affair.
c o n s t r u i r e
l a
m d i t e r r a n e
Vous aimerez peut-être aussi
- Contrat Location SalleDocument5 pagesContrat Location Sallepeulu0% (1)
- Jean-Louis Doney-L'économie Aux Concours-La Documentation Française (2016) PDFDocument231 pagesJean-Louis Doney-L'économie Aux Concours-La Documentation Française (2016) PDFنبيل بربيب100% (2)
- Probabilite ResumeDocument9 pagesProbabilite Resumeنبيل بربيب100% (3)
- DCG 2016 Compta Approfondie PDFDocument160 pagesDCG 2016 Compta Approfondie PDFنبيل بربيب100% (3)
- Economie Sociale Et Solidaire Au MarocDocument6 pagesEconomie Sociale Et Solidaire Au MarocYoussef Hjira100% (3)
- Corrections Exo Sdu No DV 4Document59 pagesCorrections Exo Sdu No DV 4نبيل بربيب100% (2)
- Climat Des Affaires Au Maroc CNEADocument4 pagesClimat Des Affaires Au Maroc CNEAKaramPas encore d'évaluation
- ESS Et DDDocument51 pagesESS Et DDRachida Idtaleb100% (1)
- Économie SocialeDocument28 pagesÉconomie SocialeSalma Choukri100% (3)
- Projet Fin Detude 2017.2018Document85 pagesProjet Fin Detude 2017.2018salhi4227Pas encore d'évaluation
- Le Role Des Coopératives Dans Le Développement de l'ESS Cas de La Région Fes MeknesDocument63 pagesLe Role Des Coopératives Dans Le Développement de l'ESS Cas de La Région Fes MeknesWarda Warda100% (1)
- L'Économie Sociale Et Solidaire À L'Assaut Des Inégalités Sociales Pour Une Approche Territoriale Du Développement DurableDocument104 pagesL'Économie Sociale Et Solidaire À L'Assaut Des Inégalités Sociales Pour Une Approche Territoriale Du Développement DurableHamza MellianiPas encore d'évaluation
- ESS Rapport Au MarocDocument133 pagesESS Rapport Au MarocHicham ElmaghribiPas encore d'évaluation
- Economie Sociale Et Solidaire Nouvelles Trajectoires Dinnovations by Sophie Boutillier, Sylvain Allemand, CollectifDocument241 pagesEconomie Sociale Et Solidaire Nouvelles Trajectoires Dinnovations by Sophie Boutillier, Sylvain Allemand, CollectifSarah BPas encore d'évaluation
- L'Économie Sociale Au MarocDocument50 pagesL'Économie Sociale Au MarocBadr FernandezPas encore d'évaluation
- Exposé MR Ouhajou Def 2Document45 pagesExposé MR Ouhajou Def 2rachidaPas encore d'évaluation
- Relation Entre l'ESS Et Le TerritoireDocument70 pagesRelation Entre l'ESS Et Le Territoirefranque lebon100% (2)
- Cooperatifs o MarocDocument46 pagesCooperatifs o MarocSafri Yassine100% (1)
- Sujet 5 Politiques Publiques TerritorialesDocument41 pagesSujet 5 Politiques Publiques TerritorialesSoulaiman AmraniPas encore d'évaluation
- Projet FinaliséDocument55 pagesProjet FinaliséKHAOULA RADOUI50% (2)
- Dynamique Coopérative Au Maroc Et Nouveau Modèle de DevlptDocument20 pagesDynamique Coopérative Au Maroc Et Nouveau Modèle de DevlptotmaniPas encore d'évaluation
- L Entrepreneuriat Social Au MarocDocument22 pagesL Entrepreneuriat Social Au Marocehjkojwe0fijioqwd100% (1)
- Politique de L'économie Sociale Et Défi Du Développement Humain Au MarocDocument282 pagesPolitique de L'économie Sociale Et Défi Du Développement Humain Au MarocDrissPas encore d'évaluation
- Le Role Des Coopératives Dans L'économieDocument19 pagesLe Role Des Coopératives Dans L'économieRachida Idtaleb100% (1)
- Entrepreneuriat Social Au Maroc: Memoire Pour L'Obtention de La Licence Fondamentale en Siences Economiques Et GestionDocument12 pagesEntrepreneuriat Social Au Maroc: Memoire Pour L'Obtention de La Licence Fondamentale en Siences Economiques Et GestionHichaam Alaoui100% (1)
- Developpement DurableDocument4 pagesDeveloppement DurableJoséBovéPas encore d'évaluation
- Entrepreneuriat SocialDocument4 pagesEntrepreneuriat SocialFouad SaddPas encore d'évaluation
- PFEDocument31 pagesPFERIHABPas encore d'évaluation
- Cours D'economie Social Et SolidaireDocument15 pagesCours D'economie Social Et Solidaireklashkevin9072Pas encore d'évaluation
- 1 SMDocument12 pages1 SMreda bazziPas encore d'évaluation
- Le Financement Des CoopérativesDocument2 pagesLe Financement Des Coopérativesrachid belhaj100% (1)
- 1 SMDocument21 pages1 SMhamza dahbi67% (3)
- Naou Falk Ada RapportDocument35 pagesNaou Falk Ada RapportNaoufal Kada100% (1)
- Les Politiques Sociales en Contexte Du COVID-19 INDH Le Programme D'amélioration Du Revenu Et Inclusion Économique Des JeunesDocument23 pagesLes Politiques Sociales en Contexte Du COVID-19 INDH Le Programme D'amélioration Du Revenu Et Inclusion Économique Des JeunesYouness El OuardiPas encore d'évaluation
- Attractivité Territoriale Et Développement Des Partenariats en Faveur Des Investisseurs MRE Dans La Région Béni Mellal KhénifraDocument221 pagesAttractivité Territoriale Et Développement Des Partenariats en Faveur Des Investisseurs MRE Dans La Région Béni Mellal KhénifraZineb BelPas encore d'évaluation
- Abouali Benddou Le Modèle Coopératif Marocain: Un Outil Propice Au Service Du Développement DurableDocument11 pagesAbouali Benddou Le Modèle Coopératif Marocain: Un Outil Propice Au Service Du Développement DurableSaidYoussPas encore d'évaluation
- La Communication Des Collectivités À L'ère NumériqueDocument12 pagesLa Communication Des Collectivités À L'ère Numériqueothmane oumanPas encore d'évaluation
- Dev TerritorialDocument24 pagesDev TerritorialelharrouniPas encore d'évaluation
- La Régionalisation Avancée Et INDHDocument3 pagesLa Régionalisation Avancée Et INDHAissam AlamiPas encore d'évaluation
- Microfinance Impact Sur Pauvrete PED-2012Document78 pagesMicrofinance Impact Sur Pauvrete PED-2012FriedrichPas encore d'évaluation
- Cours EessDocument25 pagesCours Eessbouslimane idirPas encore d'évaluation
- Impact Coop Féminines MarocDocument22 pagesImpact Coop Féminines Marochamid AatifPas encore d'évaluation
- L'Économie Sociale Et Solidaire 2018 PDFDocument27 pagesL'Économie Sociale Et Solidaire 2018 PDFRachida IdtalebPas encore d'évaluation
- Initiative Nationale Pour Le Développement Humain INDHDocument2 pagesInitiative Nationale Pour Le Développement Humain INDHElbankiPas encore d'évaluation
- PARTIE 1 Cadre Théorique Aves L'introductionDocument38 pagesPARTIE 1 Cadre Théorique Aves L'introductionMohamed OmriPas encore d'évaluation
- Capital Social, Innovation, Développement TerritorialDocument64 pagesCapital Social, Innovation, Développement TerritorialHajar ElrhaffouliPas encore d'évaluation
- Livret Indh VFDocument68 pagesLivret Indh VFsaid kabbachPas encore d'évaluation
- Caractéristiques de L l'ESSDocument21 pagesCaractéristiques de L l'ESSAbdlghni Rahmouni100% (1)
- Gouvernance Territoriale Et Développement LocalDocument113 pagesGouvernance Territoriale Et Développement LocalBen Chacha SamiraPas encore d'évaluation
- Généralités Sur La Notion de CoopérativeDocument4 pagesGénéralités Sur La Notion de CoopérativeSoufiane CH100% (1)
- Roles Collectivités Et Developpement PDFDocument21 pagesRoles Collectivités Et Developpement PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- L'approche Néo-InstitutionnelleDocument18 pagesL'approche Néo-InstitutionnelleMeryem Bennani100% (1)
- Recueil de Pratiques Participatives Au MarocDocument84 pagesRecueil de Pratiques Participatives Au MarocZakaria El HoubiPas encore d'évaluation
- L'innovation Sociale Et Le Paradigme NaissantDocument24 pagesL'innovation Sociale Et Le Paradigme Naissantfranque lebonPas encore d'évaluation
- Marché de L'emploi.2008Document27 pagesMarché de L'emploi.2008api-19610556Pas encore d'évaluation
- Cours l'ESSDocument77 pagesCours l'ESShjhPas encore d'évaluation
- Economie Sociale Et Solidaire - Gouvernance Et PDFDocument162 pagesEconomie Sociale Et Solidaire - Gouvernance Et PDFseydina100% (1)
- Memoire FinalDocument118 pagesMemoire FinalWarda WardaPas encore d'évaluation
- Entrepreneuriat Social Et CapitalismeDocument14 pagesEntrepreneuriat Social Et CapitalismeKaoutarBouibkerPas encore d'évaluation
- Les Concepts Clé de L'economie Solidaire Et SocialeDocument11 pagesLes Concepts Clé de L'economie Solidaire Et SocialeNoureddine DjerroudPas encore d'évaluation
- Entrepreneuriat Licence SEG Sem 5. SEGDocument190 pagesEntrepreneuriat Licence SEG Sem 5. SEGIkram OuardiPas encore d'évaluation
- Zammar & AbdelbakiDocument15 pagesZammar & AbdelbakiAnaibar TarikPas encore d'évaluation
- Collectivités LocalesDocument4 pagesCollectivités LocalesdiourouPas encore d'évaluation
- Quel demain pour quel Maroc ?: Réflexions sur le développementD'EverandQuel demain pour quel Maroc ?: Réflexions sur le développementPas encore d'évaluation
- L' innovation et l’économie sociale au cœur du modèle québécois: Entretiens avec Benoît LévesqueD'EverandL' innovation et l’économie sociale au cœur du modèle québécois: Entretiens avec Benoît LévesqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Retour aux Fondamentaux: Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)D'EverandRetour aux Fondamentaux: Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)Pas encore d'évaluation
- Dialnet LImportanceEconomiqueESocialesDuTourismeMondialEtD 4830593 PDFDocument19 pagesDialnet LImportanceEconomiqueESocialesDuTourismeMondialEtD 4830593 PDFنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- L - Audit Des Regions MarocainesDocument43 pagesL - Audit Des Regions Marocainesنبيل بربيب100% (1)
- Approche Intégrée de Développement Territorial 2014-2020 PDFDocument20 pagesApproche Intégrée de Développement Territorial 2014-2020 PDFنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Plaquette 2020 FR Bat PDFDocument116 pagesPlaquette 2020 FR Bat PDFنبيل بربيب100% (1)
- El Habti MarocDocument19 pagesEl Habti Marocنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Commercialisation Des Produits Islamiques Au MarocDocument16 pagesCommercialisation Des Produits Islamiques Au Marocنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Finacement Participatif - Final PDFDocument32 pagesFinacement Participatif - Final PDFنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Ech Estimation PDFDocument125 pagesEch Estimation PDFنبيل بربيب100% (1)
- Le Plan Vert PDFDocument17 pagesLe Plan Vert PDFنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Al Maliya n60 PDFDocument49 pagesAl Maliya n60 PDFنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Examens Echantillonnage EstimationDocument41 pagesExamens Echantillonnage Estimationنبيل بربيب25% (4)
- Introduction À La Méthode Statistique (WWW - Coursdefsjes.com) PDFDocument384 pagesIntroduction À La Méthode Statistique (WWW - Coursdefsjes.com) PDFنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Cours Echantillonnage Et Estimation (S3)Document152 pagesCours Echantillonnage Et Estimation (S3)نبيل بربيب33% (3)
- Abderrazak EL HIRIDocument15 pagesAbderrazak EL HIRIنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Polycopie EFC 06Document232 pagesPolycopie EFC 06نبيل بربيبPas encore d'évaluation
- PDFDocument6 pagesPDFنبيل بربيبPas encore d'évaluation
- Arnaud Poissonnier, Beryl Bès-Le Financement Participatif - Un Nouvel Outil Pour Les Entreprises-Eyrolles (2016)Document177 pagesArnaud Poissonnier, Beryl Bès-Le Financement Participatif - Un Nouvel Outil Pour Les Entreprises-Eyrolles (2016)نبيل بربيب100% (1)
- Al Maliya n60Document49 pagesAl Maliya n60نبيل بربيبPas encore d'évaluation
- ProposalDocument13 pagesProposalji19766Pas encore d'évaluation
- Cours de CA Chapitre N 2Document37 pagesCours de CA Chapitre N 2lea lam100% (1)
- Ae Teste1 Geo10Document12 pagesAe Teste1 Geo10Vanda SirgadoPas encore d'évaluation
- DD Merkblatt Sperrkonto FR DataDocument2 pagesDD Merkblatt Sperrkonto FR DataYoucef NassimoPas encore d'évaluation
- Jeu SeigneurieDocument7 pagesJeu SeigneurieFedner SaturnePas encore d'évaluation
- AgroAlimentaire KenitraDocument9 pagesAgroAlimentaire KenitraAmina CHAHBOUNIPas encore d'évaluation
- INTERREG IIIB - Potentiels Des RégionsDocument586 pagesINTERREG IIIB - Potentiels Des RégionsCognosferaPas encore d'évaluation
- Processus D Integration Des Odd Dans Les PolitiquesDocument16 pagesProcessus D Integration Des Odd Dans Les PolitiquesAbdoul SOROPas encore d'évaluation
- Plan Comptable General Des EntreprisesDocument203 pagesPlan Comptable General Des EntreprisesBikahc LiuotPas encore d'évaluation
- Pages 1 - 87Document87 pagesPages 1 - 87Elena Silvia SoldeanuPas encore d'évaluation
- Passion - Novembre 2015Document48 pagesPassion - Novembre 2015Ville de MarchiennesPas encore d'évaluation
- Afrique: 50 Ans Après Les Indépendances - May 10Document5 pagesAfrique: 50 Ans Après Les Indépendances - May 10Olivier LumenganesoPas encore d'évaluation
- RMI EBOOK Les Figures ChartistesDocument17 pagesRMI EBOOK Les Figures ChartistesHarry Akakpo100% (1)
- Revision L Energie EolienneDocument2 pagesRevision L Energie EolienneNinaPas encore d'évaluation
- Big DataDocument8 pagesBig DataAnonymous T7ZApHuTHhPas encore d'évaluation
- Droit Com s2 2015Document71 pagesDroit Com s2 2015yassinePas encore d'évaluation
- baleIII WEBcompletDocument101 pagesbaleIII WEBcompletAnas BendourouPas encore d'évaluation
- Maghreb Oxygene BrseDocument19 pagesMaghreb Oxygene BrsesihambekriPas encore d'évaluation
- Chapitre I Généralités Sur La Microéconomie - Format WordDocument7 pagesChapitre I Généralités Sur La Microéconomie - Format WordmadeiboyPas encore d'évaluation
- Exercice Sur Chap 1 Seconde L Bien Et Besoin 2324-2Document2 pagesExercice Sur Chap 1 Seconde L Bien Et Besoin 2324-2secoucamara261092100% (2)
- Banque CentraleDocument15 pagesBanque CentraleLilia LinaPas encore d'évaluation
- 11-Reglement Marches Groupe Al Omrane-1277460056fichier0Document131 pages11-Reglement Marches Groupe Al Omrane-1277460056fichier0Abir AjroudiPas encore d'évaluation
- 1251 PDFDocument24 pages1251 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage BMCIDocument41 pagesRapport de Stage BMCIAmine El Abbassi50% (4)
- Mini Projet FondationDocument22 pagesMini Projet Fondationzahir benlarbiPas encore d'évaluation
- Annales L1 S1Document119 pagesAnnales L1 S1YsfPas encore d'évaluation
- Corrigé TD2 Eco Du TravailDocument2 pagesCorrigé TD2 Eco Du TravailyyznmqqffbPas encore d'évaluation