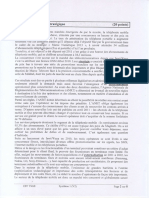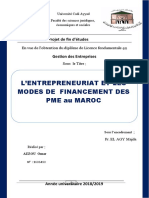Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Afrique: 50 Ans Après Les Indépendances - May 10
Afrique: 50 Ans Après Les Indépendances - May 10
Transféré par
Olivier LumenganesoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Afrique: 50 Ans Après Les Indépendances - May 10
Afrique: 50 Ans Après Les Indépendances - May 10
Transféré par
Olivier LumenganesoDroits d'auteur :
Formats disponibles
50 ans après les indépendances
Vers un renouveau économique de l’Afrique ?
Terre de conquêtes des plus grandes puissances d’hier, l’Afrique1 a longtemps été présentée à travers
le seul prisme de la misère, des maladies, des guerres ethniques, des coups d’Etat, de la mauvaise
gouvernance et de la corruption. 50 ans après les indépendances et malgré la persistance des
problèmes structurels et des défis majeurs, le temps de l’Afrique semble avoir sonné. Une chose reste
certaine: le 21ème siècle devra compter avec cette région du monde. En effet, cet immense continent,
aux ressources naturelles abondantes et à la population importante (quelques 987 millions en 2009) et
jeune (1 africain sur 2 a moins de 15 ans aujourd’hui) a toujours eu le potentiel pour devenir une
puissance économique de premier ordre 2 . La croissance économique enregistrée ces 10 dernières
années, largement au dessus de la moyenne mondiale, est la plus importante jamais connue dans le
continent. Si elle ne donne pas droit à utiliser tous les superlatifs, elle vient en tout cas rappeler que
l’Afrique n’est plus un bloc monolithique comme jadis présenté. A nos yeux, en pleine période de
commémoration du cinquantenaire des indépendances, il existe bel et bien deux Afriques: celle qui
avance au rythme de l’économie de marché et celle qui stagne à la lenteur des réformes.
Des décennies perdues, en fait
Entre le 1er janvier et le 28 novembre 1960, 17 pays africains déclaraient officiellement leur
indépendance politique3. Dès lors, l’avenir du continent semble brillant et prometteur. Les économies y
sont solides et le taux de croissance largement supérieur à celui d’autres régions comparables que sont
l’Asie du Sud Est et l’Amérique latine, par exemple. Le continent africain et ses dirigeants de l’époque
ont principalement misé sur les ressources naturelles et les matières premières, avec le pari que leurs
prix devaient continuer à s’apprécier compte tenu de la forte demande mondiale.
Cependant, c’est au détour des années 1970s que l’équilibre va changer tant à l’échelle mondiale que
continentale. Au premier plan, la pression sur l’économie mondiale, née des 2 chocs pétroliers, qui va
entraîner une détérioration généralisée de la situation économique du continent africain. En second plan,
mais pas le moindre, l’élite politique dans nombreux des Etats du continent qui va, elle, se durcir dans
l'autocratie et la dictature. Ces changements vont négativement impacter les économies de la région.
Non seulement ces économies vont se détériorer, mais le continent africain va devenir une des régions
les plus pauvres du monde. En moyenne, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel africain par
tête d’habitant va rester faible (moins de 1% par an) au cours des années 1965-1990, tandis qu’en
Amérique latine et en Asie du Sud Est, elle va dépasser les 2% et 5% par année, respectivement.
Le caractère autocratique de la plupart des régimes politiques africains d’alors va conduire à
l’expansion de la corruption et de la gabegie. Aussi, fortement dépendants des revenus des
exportations, les Etats africains vont vite basculer dans l’endettement (domestique et international) avec
la baisse rapide, à l’international, des prix des matières premières. Ce mélange de mauvaise
gouvernance et de perte de revenus conduira ces Etats au bord de la faillite économique et de la
rupture sociale au début des années 1990s. Surendettés, les bailleurs de fonds internationaux vont
alors les contraindre à des cures d’amaigrissement, encore décriées aujourd’hui par certains, imposant
des mesures d’assainissement drastiques dans la gestion publique. Ce sera le début des épisodes
douloureux des programmes d’ajustements structurels avec l’aide du Fonds Monétaire International
(FMI) et de la Banque Mondiale (BM). Le respect rigoureux de ces programmes d’ajustement par
1 Nous ferons ici principalement référence à l’Afrique Subsaharienne.
2
A prix courants ou constants, la production intérieure brute du continent ne dépasse pas les 4% de celle du monde.
3 La plupart étaient des colonies françaises, la liste comprenant aussi la plus grande colonie britannique (le Nigeria) et belge
(Le Congo).
50 ans après les indépendances: vers un renouveau économique de l’Afrique ? 1
certains Etats a conduit certes à des sacrifices douloureux, notamment dans le paiement exorbitant du
service de la dette, mais aura en conséquence eu le mérite de contenir leur dette souveraine à des
niveaux plus admissibles 4 . Ce sont donc, paradoxalement, ces programmes d’assainissement tant
décriés, couplés de l’accélération de la mondialisation du commerce international et de la grande
libéralisation des flux de capitaux à la fin des années 1990, qui conduiront au retour des capitaux et des
investisseurs étrangers dans le continent.
Dès lors, et cela en quelques années, les fondamentaux des économies africaines vont s’améliorer: les
budgets des gouvernements se rééquilibrent, la dette extérieure fond, et l’inflation s’établit à des
niveaux plus raisonnables. Surtout, l’Afrique connaît, depuis une décennie, une accélération
économique importante, avec un taux moyen de croissance de son PIB réel autour des 5% en rythme
annuel (moins de 2% dans les années 1990s), largement au-dessus de celui des économies
développées. Plus intéressant encore, la décomposition de cette croissance économique montre que la
part de la demande domestique5 n’a cessé de prendre de l’ampleur, passant à près de 150% du taux de
croissance enregistré en 2007, alors même qu’elle ne pesait même pas plus de 20% (principalement les
dépenses gouvernementales) en 2000. La consommation privée compte désormais pour près de 60%
de la croissance économique contre une contribution négative à la fin des années 1990s. La formation
brute de capital fixe n’a contribué, elle, que pour moins de 25% à la croissance économique, une taille
bien faible par rapport à l’Asie du Sud Est, par exemple6.
Le PIB africain par tête d’habitant s’accroît lui aussi à un rythme soutenu de près de 3% en moyenne
entre 1995 et 2008 (un taux identique à celui de l’Amérique latine contre 8% en Asie du Sud Est, sur la
même période). Inévitablement, la récente crise financière mondiale n’a pas épargné les économies
africaines, mais celles-ci semblent avoir mieux résisté que prévu. Affectée ainsi par la baisse du
commerce mondial, des investissement directs étrangers (IDE), des transferts de fonds des travailleurs
à partir de l’étranger, et de l’aide internationale, l’année 2009 a enregistré une croissance annuelle du
PIB réel estimée à 2.1% (3.9% pour les pays exportateurs de pétrole, 4.3% pour les pays à faibles
revenus, et -1.8% pour les pays à revenus moyens) par le FMI. Légèrement plus faible, ce taux reste
tout de même supérieur à celui des pays de la zone euro (-4.9% de croissance l’année dernière). Pour
2010 (2011), les prévisions indiquent une amélioration de la croissance avec des taux attendus à 4.7%
(5.9 %, respectivement).
Des réformes à l’intégration totale dans l’économie mondiale
L’embellie de l’économie mondiale et le boom des matières premières ont joué un rôle primordial dans
cette nouvelle dynamique économique. Mais pas seulement. Comme souligné précédemment, de vrais
changements structurels ont été consentis avec l’aide des organisations internationales. Certains pays
ont su, par exemple, réinvestir la manne financière des matières premières pour diversifier davantage
leurs économies, évitant ainsi de dépendre uniquement des exportations. La coopération régionale et le
commerce entre pays du Sud ont également stimulé le continent, notamment grâce à leur
regroupement dans des espaces de marchés communs7. L’émergence d’une meilleure gouvernance,
malgré une corruption encore endémique, a permis des progrès considérables pour soutenir la stabilité
économique. Il reste que les déficits publics sont passés de près de 3% du PIB en moyenne, à la fin des
années 1990s, à un surplus de 1.9% en 2008. L’inflation semble également sous contrôle avec une
4
De nombreux pays africains, sous l’égide du FMI et de la BM notamment, vont aussi bénéficier des programmes
internationaux de réduction de la dette extérieure réduisant ainsi le poids de la dette à des niveaux plus supportables.
5
Demande domestique = consommation privée + dépenses gouvernementales + investissements domestiques bruts.
6 Les investissements bruts représentent 24.5% du PIB en Afrique contre près de 40% en Asie émergente.
7 UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), SADC (Southeren Africa Development Community), COMESA
(Common Market for Estern and Southern Africa).
50 ans après les indépendances: vers un renouveau économique de l’Afrique ? 2
moyenne à 6.2% en 2008, contre près de 30% dans les années 1980s. Par ailleurs, après des années
de stagnation, le continent a enregistré une forte croissance de ses exportations, surtout ces dix
dernières années, alimentée par la forte demande (pour des biens primaires tels que le bois, le pétrole,
les métaux, …) des économies asiatiques comme la Chine 8 . Les termes de l’échange des pays
africains, autre indicateur important de compétitivité internationale, ont progressé, en moyenne et de
façon continue, de près de 6.5% (8% pour les pays intensifs en ressources, et 5% pour les autres),
entre 2002 et 2007. Avec une meilleure gestion de la manne financière des exportations des matières
premières, les réserves de change dans le continent ont augmenté, passant de moins de 50 milliards de
dollar, à la fin des années 1990s, à près de 300 milliards de dollar en 2007, ce qui représente près de
140% du PIB total de la région9. Les flux bruts de capitaux privés sont passés de seulement 9 milliards
de dollars, en 2000, à près de 45 milliards en 200610. Quant aux flux d’IDE (près de 30% du total des
investissements bruts dans tout le continent), ils sont passés de moins de 10 milliards de dollars
américains en 1995 à 88 milliards en 200811, amenant ainsi le stock des IDE dans le continent à près
de 511 milliards de dollar12. Le volume total médian de la dette extérieure des Etats africains a lui,
parallèlement, fortement chuté, passant de près de 70% du PIB au début des années 2000 à 23% du
PIB en 200713. Par conséquent, la balance du compte courant, en déficit permanent (-3% du PIB durant
les années 1990s, en moyenne), s’est améliorée depuis pour un surplus de près de 1% du PIB en 2008
(-6.5% en 2009, au plus haut de la dernière crise). Et, enfin, les bourses financières africaines, bien
qu’encore immatures dans certains pays 14 , ont enregistré des performances particulièrement
saisissantes, avec une rentabilité moyenne continue de près de 6%, durant les dernières années15.
Pourtant, malgré ce constat plutôt flatteur, les défis auxquels fait face le continent africain restent de
taille. En effet, le taux de pauvreté de la région demeure encore le plus élevé du monde (avec près de
45% de la population du continent vivant avec moins de 1 dollar par jour). Les projections
démographiques prédisent un accroissement de la population africaine qui devrait passer de 797.5
millions de personnes en 2000 à 1.7 milliards en 2050 (soit près de 22% de la population mondiale). Et,
contrairement au pays développés aux populations vieillissantes, la population en Afrique est très jeune,
avec un âge médian de 17 ans (23 ans dans le monde). Pour le continent, cette dynamique
démographique est incontestablement source de défis gigantesques. Mais elle offre aussi de vrais
challenges et un fort potentiel de croissance économique, car elle s’accompagne d’une demande
accrue d’urbanisation et des besoins énormes de développer les infrastructures physiques (les
communications, les logements, les transports, les écoles, les hôpitaux). Selon les estimations de la BM,
les besoins en infrastructures du continent nécessitent des investissements de près de 22 milliards de
8
L’Europe reste le principal partenaire commercial du continent. On observe cependant qu’aujourd’hui, près de 15% des
exportations de l’Afrique vont en Asie. En 2006, le commerce entre le continent et la Chine a atteint les 50 milliards de dollar.
9
Cette manne a, notamment, permis au continent de mieux tenir pendant la récente crise économique mondiale, qui a
fortement frappé les exportations africaines.
10
Les transferts de fonds des travailleurs de l’étranger représentent aujourd’hui près de 30% des flux nets de capitaux dans
la région, juste derrière les IDE (plus de 50%), mais loin devant l’aide internationale (moins de 10%).
11
L’Afrique Subsaharienne attire près des deux tiers des flux d’IDE dans le continent. Les pays exportateurs de pétrole
comme l’Angola, le Congo, le Gabon, la Guinée Bissau, le Nigéria en sont les premiers bénéficiaires (75% des dits flux).
12 L’Asie est devenue depuis un important investisseur dans la région avec des stocks d’IDE dépassant les 10 milliards de
dollars en 2004 (moins d’un milliard de dollars en 1990), selon les estimations de CNUCED.
13
La dette souveraine africaine est aujourd’hui plutôt bien quottée par les agences traditionnelles que sont Fitch et S&P,
avec une note moyenne de B et des perspectives jugées stables à positives. Ceci a permis une accélération du négoce des
obligations souveraines africaines sur les marchés internationaux (près de 12 milliards de dollars en 2007).
14
En capitalisation et en volume. Le nombre moyen des sociétés quottées dans tout le continent, Afrique du Nord comprise)
est de 114 (39, Afrique du Sud exclue), avec une capitalisation boursière qui représente 37% (22% Afrique du Sud exclue),
et un turnover de 8% (4% Afrique du Sud exclue). L’Afrique du Sud possède 90% des sociétés quottées dans le continent.
15
Il s’agit de la rentabilité moyenne continue de l’indice S&P Africa 40, en dollar, sur la période décembre 2000 à décembre
2007. Sur la même période, les marchés émergents, dans l’ensemble, ont surperformé avec près de 16% de rentabilité
constante et continue pour l’indice MSCI Emerging Markets. La faible corrélation des bourses africaines avec celles des
économies développées offre, par ailleurs, des vraies opportunités de diversification dans un portefeuille d’actions globales.
50 ans après les indépendances: vers un renouveau économique de l’Afrique ? 3
dollar par an, plus 17 autres milliards rien que pour la maintenance et l’entretien. Cela représente donc
de belles opportunités de croissance par l’investissement brut domestique en perspective. La
croissance économique devrait aussi être portée par des investissements étrangers, en réponse aux
multiples initiatives entreprises par les gouvernements (garanties ou subventions, réductions des taxes
aux exportations et importations, élimination des procédures administratives redondantes et inefficaces¸
développement de nouvelles infrastructures financières) pour rendre la région attractive aux IDE.
De la tragédie économique au renouveau: et si l’histoire était comparable
Le débat sur la désillusion des économies africaines a toujours fait couler beaucoup d’encre. En général,
la réflexion s’est portée sur la mauvaise gouvernance, les déséquilibres budgétaires et commerciaux, la
mauvaise qualité des infrastructures, la non-diversification de ces économies extrêmement vulnérables
aux chocs extérieurs. Quelque soit la piste retenue, il n’y a aucun doute: les performances économiques
de l’Afrique postcoloniale ont été catastrophiques et qualifiées de tragédie par nombreux économistes.
L’histoire, cependant, nous montre des similitudes étonnantes de trajectoires avec d’autres régions en
développement qui conduisent à des comparaisons certaines et permettent d’extrapoler sur les
performances économiques à venir du continent noir.
Bien que toute trajectoire historique ait sa spécificité, nous pouvons trouver des similitudes
intéressantes de trajectoires entre les pays africains et d’autres régions émergentes comme l’Amérique
latine après les indépendances. En effet, en dépit du fait que l'Afrique et l'Amérique latine ont conquis
leurs indépendances de la domination coloniale européenne à différentes périodes du temps (la plupart
des pays latino-américains après 1820 et ceux de l'Afrique après 1960), les deux continents partagent
des similitudes stupéfiantes dans leurs trajectoires. Dans chaque cas, les indépendances ont été
suivies par de l'instabilité politique, des conflits violents, et une stagnation économique qui a duré près
d'un demi-siècle. Des estimations empiriques montrent, par exemple, que, durant les cinquante
première années des indépendances, la croissance du PIB par tête d’habitant du continent latino-
américain n’a jamais dépassé 1% par année. La même analyse s’applique à l’Afrique, puisqu’en cette
année du cinquantenaire, on observe que le PIB par tête d’habitant du continent n’a cru en moyenne
que de 0.89% par année, jusqu’encore à 2002. Par comparaison historique, on observe donc que la
performance économique dans le demi-siècle qui suit les indépendances a été relativement faible pour
les deux continents.
Comme pour l’Amérique latine, l’instabilité politique et les conflits civils violents en Afrique ont
énormément pesé dans la performance économique d’après-colonisation. Mais les choix politiques ont
aussi joué un rôle non négligeable. En Amérique latine, presque tout va changer après le
cinquantenaire des indépendances. A commencer par la politique où le changement est venu des
victoires (parfois par les armes) des mouvements libéraux. Ceux-ci vont imposer des reformes
importantes (comme l’égalité civique, la fin de l’esclavage, la séparation de l’église et de l’Etat, la
suppression des monopoles, l’adoption de nouveaux codes civil et commercial, la réforme du système
judiciaire, et la réorganisation du système bancaire) ainsi que la mise en place des politiques
économiques basées sur l’investissement (dans les infrastructures physiques, notamment), sur
l’ouverture commerciale, et la renégociation de la dette domestique et extérieure, etc. Tous ces
changements vont apporter de la stabilité qui va favoriser la croissance économique dans de la région.
La similitude des faits reste encore ici troublante. En effet, la plupart des gouvernements africains de
postindépendance ont choisi des systèmes politiques de partis uniques, nationalistes, souvent militaires,
accompagnés d’un modèle économique de gestion centralisée, et souvent peu ouvert voire peu
diversifié au commerce extérieur. Ces choix politiques unilatéralistes et interventionnistes ont créé des
Etats à taille gigantesque, évinçant l’initiative et l’investissement privés, favorisant la gabegie, la baisse
50 ans après les indépendances: vers un renouveau économique de l’Afrique ? 4
des revenus publics, et une recrudescence des déficits et de la dette souveraine. Cependant, à côté
des assainissements économiques mentionnés précédemment, le continent africain semble connaître
depuis peu une diminution des conflits politiques et armés16.
Certes, comparaison n’est pas raison. Mais, si l’histoire devait être comparable, des signaux analogues
semblent indiquer que l’Afrique devrait imiter l’expérience latino-américaine et entrer dans une période
de stabilité politique et de croissance économique soutenue. Oui, certaines zones demeurent encore
instables, mais la paix, bien que parfois fragile, est bien là. La démocratie, naissante aussi mais active,
a conduit à l’élection d’une nouvelle élite qui met, tant bien que mal, en place des réformes
institutionnelles importantes et adopte des politiques économiques plutôt libérales, permettant
notamment d’attirer davantage de capitaux internationaux et les investisseurs étrangers. L’histoire ne se
répète pas. Au mieux, elle rime17. En cette année où la coupe du monde de football aura lieu pour la
première fois dans le continent, et en pleine période de commémoration des 50 ans d’indépendance,
l’avenir de l’Afrique semble à nouveau radieux, toute chose étant égale par ailleurs. Est-ce alors la
renaissance tant attendue de l’Afrique ? Il semble en tout cas que le continent en emprunte le chemin.
L’avenir, seul, nous répondra.
Andy Kalusivikako, politologue
Olivier Lumenganeso, économiste
Genève, Mai 2010
Politologue, Andy Kalusivikako est diplômé en sciences politiques et en relations internationales des universités de
Lausanne et de Louvain en Belgique. Il travaille dans le secteur bancaire. Comme consultant indépendant, il développe
régulièrement des mandats de conseil stratégique sur les enjeux publics et privés.
Diplômé en économie et finance de l’université de Genève, Olivier Lumenganeso est analyste financier et stratégiste global,
spécialiste des marchés émergents dans la banque privée. Il a aussi une expérience dans l’enseignement universitaire et
dans la recherche appliquée au sein, notamment, des organisations internationales comme le fonds monétaire international
et la banque mondiale.
Références:
Bates R., Coatsworth J., et Williamson J. (2007): Lost decades, postindependence performance in Latin America
and Africa, The Journal of Economic History , Volume 67 , Issue 04, pp 917-43 ;
David Rockfeller Center for Latin American Studies (1999): Latin America and the World Economy Since 1800,
édité par Coatsworth J. et Taylor A.;
Ndulu B., O’Connell S., Bates R. (2007): The political economy of economic growth in Africa, 1960-2000, volumes
1 et 2, Cambridge University Press ;
Pierre de Senarclens (2001), La mondialisation: Théories, enjeux et débats, Armand Colin, Paris, 2001.
16
Avec, néanmoins, des exceptions notables comme le génocide rwandais, les conflits en République Centrafricaine, en
Côte d’Ivoire, en Erythrée, au Niger, en République Démocratique du Congo (que l’on a qualifié de première guerre mondiale
africaine), au Soudan, au Tchad, en Somalie où l’Etat n’existe carrément plus, etc.
17
Mark Twain :écrivain et humoriste américain (1835-1910).
50 ans après les indépendances: vers un renouveau économique de l’Afrique ? 5
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Créances Douteuses Et Leur Impact Sur Le Résultat Et La Situation Financière de L'entrepriseDocument110 pagesLes Créances Douteuses Et Leur Impact Sur Le Résultat Et La Situation Financière de L'entrepriseŠïď Ãļỉ100% (1)
- Vue D'ensemble - La Croissance Au Service Du Développement HumainDocument12 pagesVue D'ensemble - La Croissance Au Service Du Développement HumainAlaealeaPas encore d'évaluation
- Ohada Actes Uniformes Sur Les Comptes ConsolidesDocument10 pagesOhada Actes Uniformes Sur Les Comptes ConsolideskhadimniangPas encore d'évaluation
- Formules de CalculDocument7 pagesFormules de CalculNourman GentlmanPas encore d'évaluation
- Nepad ExpliquéDocument12 pagesNepad ExpliquéMbaye Babacarish BanePas encore d'évaluation
- 1 Mondialisation EconomiqueDocument17 pages1 Mondialisation Economiquemasse.diop1Pas encore d'évaluation
- Macroéconomie - Investir - MexiqueDocument24 pagesMacroéconomie - Investir - MexiqueGino TanguayPas encore d'évaluation
- CDS Symposium - Intervention - MLWDocument20 pagesCDS Symposium - Intervention - MLWAYOUB WALAYACHIPas encore d'évaluation
- Impact Crise Financière AfriqueDocument20 pagesImpact Crise Financière AfriqueËstėllę Christiānę Bissā ZambøPas encore d'évaluation
- Afrique SubsaharienneDocument10 pagesAfrique SubsaharienneKhady Gning100% (1)
- Les Probleme Lie Au Okxcapbxl Developpement ÉconomiquementDocument3 pagesLes Probleme Lie Au Okxcapbxl Developpement ÉconomiquementGaniyou NanaPas encore d'évaluation
- CH4 L'Afrique Dans Les Échanges InternationauxDocument8 pagesCH4 L'Afrique Dans Les Échanges InternationauxHamda AliPas encore d'évaluation
- Thiam12 16Document5 pagesThiam12 16Kouassi Yannick N'GORANPas encore d'évaluation
- CfaDocument86 pagesCfabamogojeanbaptiste57Pas encore d'évaluation
- Sujet Montrez Que La Croissance Est Un Phénomène Irrégulier Et InégalitaireDocument5 pagesSujet Montrez Que La Croissance Est Un Phénomène Irrégulier Et InégalitaireMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- L'Afrique - Une Chance À Saisir - Allocution de M. Alassane D. Ouattara, Directeur Général Adjoint Du Fonds Monétaire InternationalDocument5 pagesL'Afrique - Une Chance À Saisir - Allocution de M. Alassane D. Ouattara, Directeur Général Adjoint Du Fonds Monétaire InternationalAlexandrovic Dimitrius Dibikov ZidanovPas encore d'évaluation
- InflationDocument12 pagesInflationAlliance's NgokanyukudiPas encore d'évaluation
- La Rupture Des Années 80: I/L'émergence D'une Économie D'endettement International IntermédiaireDocument4 pagesLa Rupture Des Années 80: I/L'émergence D'une Économie D'endettement International IntermédiaireNejma AdjalPas encore d'évaluation
- Le Modèle de Développement Camerounais 1965-1990 de La Croissance Équilibrée À La Crise StructurelleDocument21 pagesLe Modèle de Développement Camerounais 1965-1990 de La Croissance Équilibrée À La Crise StructurelleSORRHE KARENSENPas encore d'évaluation
- MGI Lions On The Move French Translation Executive SummaryDocument12 pagesMGI Lions On The Move French Translation Executive SummaryRobin PerraultPas encore d'évaluation
- L'Afrique Dans Le Nouvel Ordre MondialDocument2 pagesL'Afrique Dans Le Nouvel Ordre MondialAdinaPacurarPas encore d'évaluation
- Memoire CESAGDocument73 pagesMemoire CESAGmamadoubaylosowPas encore d'évaluation
- Les Problemes Et Les Perspectives de Developpement de LDocument7 pagesLes Problemes Et Les Perspectives de Developpement de LMouhamadou MballoPas encore d'évaluation
- Document Diagne NarDocument7 pagesDocument Diagne Nartyrbbn82qtPas encore d'évaluation
- P.5.L' AfriqueDocument10 pagesP.5.L' AfriqueDiopPas encore d'évaluation
- Le Maghreb Dans Les Relations Internationales - Le Maghreb Et Son Sud - L'enjeu Économique Africain - CNRS ÉditionsDocument17 pagesLe Maghreb Dans Les Relations Internationales - Le Maghreb Et Son Sud - L'enjeu Économique Africain - CNRS ÉditionsMohammed BenaliPas encore d'évaluation
- La Crise FinanciereDocument12 pagesLa Crise FinancieremasterccaPas encore d'évaluation
- INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AGRICOLE EN AFRIQUE CENTRALE CAS Du TCHADDocument26 pagesINVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AGRICOLE EN AFRIQUE CENTRALE CAS Du TCHADKendra MasseyPas encore d'évaluation
- Prof Mabi Vingt Cinq Ans Devolution de Leconomie Congolaise ActualiséDocument11 pagesProf Mabi Vingt Cinq Ans Devolution de Leconomie Congolaise Actualisémalobarey66Pas encore d'évaluation
- Economie Congolaise-Covid-19 PDFDocument10 pagesEconomie Congolaise-Covid-19 PDFLevy NdiayPas encore d'évaluation
- 3.2.3. III - 4 Et 5Document6 pages3.2.3. III - 4 Et 5Mounia HantatPas encore d'évaluation
- Crise AsiatiqueDocument8 pagesCrise AsiatiqueKaneki GoulPas encore d'évaluation
- L'économie AméricaineDocument16 pagesL'économie AméricaineFOFANA ALIMAMYPas encore d'évaluation
- L'economie de La Cote D'ivoirDocument6 pagesL'economie de La Cote D'ivoirballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation
- BenchaabounDocument29 pagesBenchaabounZinad TadlaouiPas encore d'évaluation
- Un Ralentissement Structurel de L'activité Dans Les Grands Pays ÉmergentsDocument12 pagesUn Ralentissement Structurel de L'activité Dans Les Grands Pays ÉmergentsNKINSIPas encore d'évaluation
- PEC Chap1 1èrepartieDocument24 pagesPEC Chap1 1èrepartiebiz nryooPas encore d'évaluation
- La Montée en Puissance Des Pays ÉmergentsDocument4 pagesLa Montée en Puissance Des Pays Émergentshello mustPas encore d'évaluation
- GEP 422 La MondialisationDocument13 pagesGEP 422 La Mondialisationangenina739Pas encore d'évaluation
- Chapitre V La CroissanceDocument12 pagesChapitre V La CroissanceAdrien NacerPas encore d'évaluation
- 5045 4054415097641730191 PDFDocument24 pages5045 4054415097641730191 PDFMouhamed NdaoPas encore d'évaluation
- LA MONDIALISATION DE LA PAUVRETÉ-auteur: Michel Chossudovsky Aux Ed. EcosociétéDocument11 pagesLA MONDIALISATION DE LA PAUVRETÉ-auteur: Michel Chossudovsky Aux Ed. EcosociétéeddybullzPas encore d'évaluation
- Éco ProjetDocument7 pagesÉco ProjetvictorPas encore d'évaluation
- Les Conséquences de La Crise de 29 en Amérique LatineDocument3 pagesLes Conséquences de La Crise de 29 en Amérique LatineMathilde GPas encore d'évaluation
- Le Journal de L'afrique N°28: Les Derniers Jours Du Franc CFADocument45 pagesLe Journal de L'afrique N°28: Les Derniers Jours Du Franc CFAAlexAnfruns100% (2)
- Afrique Un Continent en MargeDocument5 pagesAfrique Un Continent en MargeAyoub MouhsinePas encore d'évaluation
- 1 Politiques Économiques PR K SABRIDocument104 pages1 Politiques Économiques PR K SABRInabilosPas encore d'évaluation
- Finances Publiques en Tunisie: Comment Financer Le Fardeau Croissant Des Dépenses Publiques en Période de Faible Croissance Économique ?Document21 pagesFinances Publiques en Tunisie: Comment Financer Le Fardeau Croissant Des Dépenses Publiques en Période de Faible Croissance Économique ?Yosr TliliPas encore d'évaluation
- Synthèse La République Populaire de ChineDocument3 pagesSynthèse La République Populaire de ChineJeanne ArakelianPas encore d'évaluation
- MALIDocument19 pagesMALIvalentina.peykovaPas encore d'évaluation
- Commerce International - WikipédiaDocument13 pagesCommerce International - Wikipédiarakotogre925Pas encore d'évaluation
- GoldbergDocument6 pagesGoldbergLivia JoycePas encore d'évaluation
- Economie Du MarocDocument27 pagesEconomie Du MarocOtmane SatPas encore d'évaluation
- La Réponse À La Crise Dans Les Pays ÉmergentsDocument28 pagesLa Réponse À La Crise Dans Les Pays ÉmergentsEco Tv Abdel100% (1)
- Bamba Contamin Diomande Kunvaly, K0Ulibal.Y: Crise Economique Et Programmes D'Ajustement Structurel en Cote-D'IvoireDocument15 pagesBamba Contamin Diomande Kunvaly, K0Ulibal.Y: Crise Economique Et Programmes D'Ajustement Structurel en Cote-D'IvoireDenver DenverPas encore d'évaluation
- Séance 6Document6 pagesSéance 6NOHAILA DAALIPas encore d'évaluation
- Partie III Globalisation FinancièreDocument47 pagesPartie III Globalisation FinancièreBâdr OUPas encore d'évaluation
- Fiche 5 Economie MondialeDocument14 pagesFiche 5 Economie MondialeLì SěļPas encore d'évaluation
- Expose de Macroeconomie 1Document16 pagesExpose de Macroeconomie 1alazizjagerjackmongo18Pas encore d'évaluation
- Hfe 4Document8 pagesHfe 4ABRAHAM NENEPas encore d'évaluation
- G3 L'Amérique Puissance Du Nord Affirmation Du SudDocument15 pagesG3 L'Amérique Puissance Du Nord Affirmation Du SudmercierPas encore d'évaluation
- Cours Gestion BudgétaireDocument23 pagesCours Gestion BudgétaireAymen Hssaini100% (1)
- Cours de Gestion Des RisquesDocument25 pagesCours de Gestion Des RisquesRémi Bachelet100% (7)
- Analyser La RentabilitéDocument5 pagesAnalyser La RentabilitéWafa Harumi FoufaPas encore d'évaluation
- examenTSGE 2014variantte 2Document7 pagesexamenTSGE 2014variantte 2Med MedPas encore d'évaluation
- Projet de Fin Detude MiseDocument82 pagesProjet de Fin Detude MiseLoubna Ben100% (3)
- Rapport Stage AwbDocument30 pagesRapport Stage AwbMehdi TabitPas encore d'évaluation
- IBSDocument13 pagesIBShalim262008Pas encore d'évaluation
- Atouts Et Faiblesses de Lafrique Du SudDocument3 pagesAtouts Et Faiblesses de Lafrique Du SudkhPas encore d'évaluation
- Parc ÉolienDocument24 pagesParc ÉolienYacoub Cheikh100% (2)
- Consulter Lecon 2Document16 pagesConsulter Lecon 2rabii maalejPas encore d'évaluation
- Rapport ESG Et Tableau de FinancementDocument39 pagesRapport ESG Et Tableau de FinancementKhadija BouzidPas encore d'évaluation
- BerkDeMarzo - Chap20Document32 pagesBerkDeMarzo - Chap20malvert91Pas encore d'évaluation
- Secteur Des AssurancesDocument35 pagesSecteur Des Assurancesولد دارهوم83% (6)
- Cout de Revient TransportDocument88 pagesCout de Revient TransportSaid Negredo MejhoudiPas encore d'évaluation
- Ecartde ConversionDocument17 pagesEcartde ConversionFatima OmariPas encore d'évaluation
- Communiqué de Presse ECT-19 12 20616Document2 pagesCommuniqué de Presse ECT-19 12 20616Eric VeillonPas encore d'évaluation
- 777lachuteduVaticanetdeWallStreet PDFDocument41 pages777lachuteduVaticanetdeWallStreet PDFDAZGOOPas encore d'évaluation
- Ciment de Bizerte DefinitifDocument9 pagesCiment de Bizerte DefinitifhatemPas encore d'évaluation
- Effet de LevierDocument3 pagesEffet de LevierPlouf PloufPas encore d'évaluation
- Exos IAS-IFRS PDFDocument38 pagesExos IAS-IFRS PDFYasser Lotfy75% (4)
- Brochure Gestion de Portefeuille 0512Document20 pagesBrochure Gestion de Portefeuille 0512Anonymous fDi4ZlLPas encore d'évaluation
- 2297note D Information SIFCA 2013-2021-VFDocument97 pages2297note D Information SIFCA 2013-2021-VFarmanijamesPas encore d'évaluation
- Financement Des Investissements Par Emprunt Obligataire - Cas Du Port Autonome de Dakar (PAD)Document98 pagesFinancement Des Investissements Par Emprunt Obligataire - Cas Du Port Autonome de Dakar (PAD)Gracy Fall Dzon100% (3)
- Évaluation Des Obligations Et Structure Par Termes Des Taux D'intérêtsDocument38 pagesÉvaluation Des Obligations Et Structure Par Termes Des Taux D'intérêtsSonia Ben Jemaa100% (1)
- Vocabulaire Argent Banque AnglaisDocument1 pageVocabulaire Argent Banque AnglaisquereurPas encore d'évaluation
- Communication - Bale II Et Le Traiment Du Risque de Credit Pme PDFDocument32 pagesCommunication - Bale II Et Le Traiment Du Risque de Credit Pme PDFMustapha AmmariPas encore d'évaluation
- MKG Des AssurancesDocument31 pagesMKG Des AssurancesZeineb TouliPas encore d'évaluation