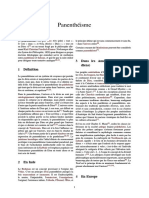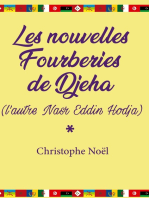Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dialnet LeProblemeDeLaPhilosophieIslamique 3082581 PDF
Dialnet LeProblemeDeLaPhilosophieIslamique 3082581 PDF
Transféré par
AhmedSoussiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dialnet LeProblemeDeLaPhilosophieIslamique 3082581 PDF
Dialnet LeProblemeDeLaPhilosophieIslamique 3082581 PDF
Transféré par
AhmedSoussiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cauriensia, Vol.
IV (2009) 215-224, ISSN: 1886-4945
Le problème de la philosophie islamique
Omar Merzoug
Docteur en philosophie (Sorbonne, Paris IV)
Resumen
En este artículo se muestran ciertos ejemplos extraídos de la producción filosófica
musulmana con el fin de intentar dilucidar hasta qué punto podemos hablar de filosofía
musulmana, cuestión que presupone una cierta posición ante la filosofía. El ejercicio de
la razón filosófica por parte de los autores musulmanes muestra un quehacer propio que
sabe responder a la dialéctica fe-razón y que como cristianos y judíos supone un gran
ejercicio y un reto intelectual.
Palabras clave: Averroes, Filosofía islámica, Zakariyya Rhazî.
Abstract
This paper contains some examples taken from the Muslim philosophical output
which aim to explain the extent to which we can talk about Muslim philosophy. This
question assumes a particular position before philosophy. The exercise of philosophical
reason practised by Muslim authors shows a task that is able to answer to the faith-
reason dialectics and that, as Christians and Jews, entails a big effort and an intellectual
challenge
Key words: Averroes, Islamic philosophy, Zakariyya Rhazî.
L’expression de “philosophie islamique” est couramment employée par les
historiens de la philosophie médiévale pour désigner cette période entre le VIIIe
et le XIIIe siècle qui a vu fleurir sous la plume de “philosophes musulmans” un
216 Omar Merzoug
certain nombre d’œuvres de qualité inégale et qui ont joué un certain rôle dans
la pensée et les écrits d’auteurs médiévaux chrétiens dont le plus célèbre est
sans doute saint Thomas d’Aquin. Henri Corbin n’hésite pas à l’utiliser et à en
justifier l’usage, Badawi l’emploie également, Walzer évoque une “islamic phi-
losophy”, Majid Fakhry parle de philosophie islamique et Gilson fait usage du
terme de “philosophie árabe “. Le philosophe marocain Al-Jabirî aussi emploie
cette expression qui ne renvoie pas seulement à la période ou à l’origine orien-
tale ou confessionnelle des auteurs, elle est usitée pour signifier que ces œuvres
que l’on qualifie de philosophiques se situent dans la postérité de la philosophie
grecque et surtout d’Aristote et de Plotin, c’est-à-dire d’auteurs païens qui, quel
que soit l’effort de la philosophie grecque, sont restés dans les limites du paga-
nisme.
Pourtant au philosophe traditionnel, pareille formule paraît pour le moins
paradoxale, à moins qu’elle n’enferme une contradiction. La philosophie, au
sens obvie du terme, et pour largement simplifier, se réclame d’un exercice de
la raison, un exercice profane de la “lumière naturelle”. Le philosophe examine,
recherche, interroge tout et tout devra être passé au crible de l’esprit, un esprit
cela va sans dire, critique pour atteindre la vérité et asseoir sur cette vérité les
principes d’une sagesse.
Le meilleur exemple de philosophe est sans doute Socrate dont l’activité se
résumait à la critique des notions communément admises,. Il tentait de montrer
que ces notions n’allaient pas du tout de soi, que cette analyse critique des con-
cepts est l’œuvre de la raison devant qui tout devient objet de recherche, même
le fait religieux ou la croyance religieuse.
Or, dans la formule dont nous nous occupons, il y a le qualificatif islami-
que. Lequel renvoie à une religion apparue, au VIIe siècle de l’ère chrétienne,
en Arabie. C’est un fait très connu que Islam signifie “soumission à Dieu”,
une attitude en apparence contraire à celle qui anime l’esprit du philosophe se
caractérisant, nous venons de le préciser, par sa capacité à interroger de manière
critique les objets qui s’offrent à sa pensée. Comme d’autres religions, l’Islam
est une religion, un corps de dogmes et de croyances, révélée. Le Livre sacré
des Musulmans, le Coran, contient la parole de Dieu dictée par l’Ange Gabriel,
et recueillie par Le Prophète Muhammad dans sa retraite des environs de La
Mecque. Dieu y nomme un certain nombre de choses, prescrit, admoneste, ser-
monne, menace et raconte à des fins d’édification, les faits des peuples passés
punis pour leur impiété. Il y est question de Dieu, de sa nature, de la création du
monde, de l’immortalité de l’âme, du Jugement dernier, du châtiment ou de la
rétribution. Dieu révèle à l’homme son existence, son unicité, sa nature, qu’il a
créé le monde et comment etc.
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
Le problème de la philosophie islamique 217
Par voie de conséquence, nous avons d’une part liés dans une même for-
mule le terme de philosophie qui renvoie à un exercice profane et critique de
la raison et un qualificatif qui réfère au fait de la Révélation, laquelle relève du
surnaturel et fait sens pour le croyant. Cette formule pose en fait un problème
philosophique sérieux, celui de savoir si nous n’avons pas affaire avec cette
expression de philosophie islamique à un concept contradictoire qui se détruit
lui-même, et de surcroît, si le référent d’une telle formule renvoie à une réalité
historique objective.
On répondra que l’Histoire atteste qu’un certain nombre de doctrines été
rangées dans la rubrique “philosophies islamiques”, œuvre de ceux que Badawi
appelle les “philosophes purs”et Corbin “les philosophes hellénisants”. Mais
toute la question est de savoir si cette philosophie hellénisante qui, emprun-
tant ses termes, ses concepts, ses problématiques, ses thèmes et sa logique à
la philosophie des Platon, Aristote et Plotin, cherche à l’harmoniser avec les
dogmes de l’Islam n’est pas un habit d’Arlequin où des fragments de théologie
sont plaqués sur des développements philosophiques. En d’autres termes, ces
scolastiques spéculatives, dont le but avoué est de défendre par des arguments
rationnels et si nécessaire philosophiques, le corps doctrinal de l’Islam, peuvent
recevoir le nom de philosophie. Ne s’agirait-il pas en l’occurrence d’une
“escroquerie d’étiquette”?
Dès lors, Le philosophe se voit acculé à un dilemme : soit soumettre sa rai-
son à des dogmes qui sont l’objet d’une Révélation et y adhérer, soit assumer sa
fonction critique et notamment soumettre les dogmes, fussent-ils révélés et dût-
on les admettre comme tels, à l’examen de la raison. Ainsi posé, l’expression de
“philosophie islamique” paraît des plus problématiques. Si d’excellents esprits
l‘ont utilisée, c’est sans doute qu’ils entendaient signifier par là qu‘il existait
des musulmans philosophes, et partant ils ont appelé l‘œuvre de ces musulmans
qui philosophait des philosophies islamiques. Qu’il y eut des Musulmans qui
philosophèrent, nul ne le conteste, mais toute la question est de savoir s’il y eut,
s’il peut y avoir une philosophie islamique.
Le rationalisme de Zakariyya Rhazî (IXe) est le prototype de la philoso-
phie qui prétend se passer de révélation religieuse ou d’intuition mystique1. Par
sa raison, l’homme est à même de distinguer le bien du mal et donc de fonder
une morale, par sa raison, l’homme se rend compte que les religions sont un
tissu de contradictions, que les paroles des prophètes s’opposent les unes aux
autres alors qu’ils se disent les ministres d’un seul et même Dieu. Condamnant
toute démarche ésotérique, et partant toute philosophie qui se donnerait pour
prophétique et suprarationnelle, Rhazi répudie tout surnaturel et jette au rebut
1 Kitâb al-ilm al-ilâhî
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
218 Omar Merzoug
l’irrationnalisme au nom de la raison, critère de vérité et guide pour l’action.
Son Dieu est le Dieu des philosophes et des savants, non le Dieu des Ecritures,
du Coran et des prophètes. On ne trahirait certes pas la pensée de Rhazi en
disant qu’il parie intégralement sur la raison, que sur ce point il est antipasca-
lien, et qu’entre la foi révélée et la raison, il n’est pas de commune mesure, pas
de terrain d’entente, comme il ne saurait être question d’accord entre la vérité et
l’erreur, entre la certitude et le surnaturel. Il ne saurait y avoir deux domaines,
mais un seul, celui de la raison, outil qui nous permet de pénétrer l’essence des
choses et d’arpenter tout le champ du connaissable.
La société secrète de philosophes qui a connu la renommée sous le nom
des “Ikhwân As-Safâ” (traduit plus ou moins heureusement par les Frères de la
Pureté) se situe de ce point de vue sur la même ligne que Rhazi. Les philoso-
phes, qui la composent, considèrent que la philosophie est supérieure à la révé-
lation, que la révélation s’adresse au commun des mortels, auquel on envoie
les prophètes comme on envoie le médecin aux gens malades. Le philosophe,
entendu au sens néoplatonicien, n’a que faire de cette médecine, l’exercice
de sa raison naturelle suffit pour comprendre les réalités, guider son action et
trouver l’ataraxie.
Pour des raisons inverses, des raisons religieuses et théologiques, Ibn
Taymiyya s’élève contre la prétention de la philosophie à atteindre la certitude.
Partant, il rejette la philosophie grecque dans son ensemble et y est très hos-
tile. La philosophie platonico-aristotélicienne n’atteint pas le fond de l’être,
Ibn Taymiyya très subtilement l’attaque en son maillon le plus intéressant, la
logique, pour Aristote, la science c’est la démonstration par syllogismes. Or,
Ibn Taymiyya note que la logique formelle, et pour cause, ne s’intéresse qu’à la
forme du syllogisme et non à sa matière. Sans matière, le raisonnement tourne à
vide. Or, prétend Ibn Taymiyya, la matière est plus intéressante que la forme qui
est indifférente à l’expérience. Adoptant un point de vue que n’eurent pas renié
Locke ou Hume, Ibn Taymiyya affirme que l’expérience fonde toute science
véritable, la science part de l’expérience. Il donne l’exemple du feu qui brûle
qui n’est pas un concept ou une idée, mais dont l’idée est tirée d’une expérience
concrète. Dans la connaissance on procède du particulier au général et non
inversement contrairement à ce que prétend Aristote pour qui il n’y a de science
que du général. Nous savons que les hommes sont mortels, avons-nous besoin
de former un syllogisme pour le savoir ?. Cette critique est a priori étonnante
puisque Aristote a critiqué Platon en disant que Platon a construit sa science en
partant des conditions logiques auquel répondait l’idée de science, en allant du
concept de science à son objet, mais Aristote objecte que “la science ne doit pas
se construire elle-même son objet propre sans se demander si cet objet coincide
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
Le problème de la philosophie islamique 219
ou non avec le monde donné. Car le monde réel reste toujours le seul objet
d’une science qui se veut réelle, comme le voulait le Stagirite
Aux yeux d’Ibn Taymiyya, la syllogistique d’Aristote est scientifiquement
stérile. L’accusation qui pèse sur Aristote d’avoir bloqué le progrès du savoir
pendant des siècles eût trouvé en Ibn Taymiyya un partisan sans doute zélé.
Pour des raisons différentes, Ibn Khaldûn affirme que la philosophie est une
discipline vaine : elle est le lieu géométrique des questions métaphysiques,
c’est-à-dire le lieu du verbiage et de la phraséologie. Il n’est pas plus indulgent
avec les musulmans comme Ibn Sîna, Farâbi ou Ibn Rochd qui croient pouvoir
prouver les dogmes religieux par la raison. En quoi ils se trompent lourdement.
La raison humaine a des limites et ne peut s’élever au rang des vérités révélées,
si la raison pouvait prouver le dogme, la révélation serait sans objet. La Loi
révélée est supérieure à la raison et la comprend et la renferme, lui enseignant
des vérités auxquelles la raison ne peut parvenir par ses propres moyens, lui
évitant ainsi d’errer.
Esprit longtemps tourmenté, en proie à un doute qui l’a profondément
affecté, doute existentiel et non pas doute purement intellectuel comme celui de
Descartes. (A ce titre, Ghazâli est plus proche du tourment et de l’interrogation
pascalienne que de Descartes), Ghazâli à la recherche de la certitude, explore
les philosophies et les théologies constituées à son époque, les Mu’tazila, les
philosophes dont il expose les thèses dans son essai Les Intentions des Philo-
sophes. Il a lui-même raconté dans Le Préservateur de l’Erreur son parcours
à la recherche de la certitude. Touchant la philosophie qui est essentiellement
dans la postérité arabe d’Aristote à la fois une logique et une métaphysique.
Dans Le Préservateur de l’Erreur, il classe les philosophes du point de vue de
l’incroyance, et il les divise en trois, les matérialistes (Dahriyyûn), les natura-
listes (tabi’iyyun) et les déistes (Ilahiyyûn). Dans le premier cas, il songe sans
doute aux atomistes, aux Démocrite et Epicure, qui se passent de l’hypothèse
d’un Dieu unique, du Dieu des religions monothéistes, créateur, Gazali conclut
à l’incroyance (zandaqa), les seconds, sont aussi des incroyants (zanâdiqa) et
quant aux derniers, les Socrate, Platon, Aristote, il précise qu’ils ont réfuté les
matérialistes et les naturalistes. En gros, conclut Ghazâli, ce que les déistes
grecs ont transmis et ce qui a été repris par les musulmans Farâbi et Ibn Sîna,
doit être pour une part être excommunié, une autre part doit être l’objet d’une
“innovation blâmable” et une dernière part ne doit pas être totalement rejetée.
Il s’est donc trouvé des philosophes pour nier l’existence d’une philo-
sophie islamique. Car soit la philosophie se trouvera instrumentalisée pour
“prouver” les dogmes et l’on confondra la philosophie et la religion, soit on
parlera d’une philosophie islamique pour dire qu’elle est la philosophie vraie,
et on ne voit pas pourquoi cette philosophie serait l’apanage des Musulmans.
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
220 Omar Merzoug
Enfin, on prétendra qu’il faut et qu’il suffit que cette philosophie ne s’inscrive
pas en faux contre les enseignements de l’islam, et voila la philosophie cap-
tive, et comme mise en demeure de se conformer au credo, et de nouveau nous
retombons dans la théologie. La philosophie ne saurait être islamique pas plus
qu’elle n’est juive ou chrétienne, la raison, outil du philosophe, est universelle
et c’est cette “lumière naturelle”qu’il utilise de manière critique pour se déba-
rrasser des préjugés, des notions confuses et fausses, pour acquérir la vraie
science qui n’est pas celle des théologiens. Nous sommes au rouet : le concept
contradictoire d’une philosophie qui serait religieuse, c’est-à-dire d’un exercice
de la raison “lumière naturelle” qui se soumettrait aux données surnaturelle de
la révélation.
Plus sensible que Rhazî au fait que la raison divise plus qu’elle n’unit les
positions, ou bien divise autant qu’elle unit, Ghazâli remarque que les philo-
sophes anciens, bataillant tous sous la bannière de la raison, ont professé des
doctrines qui se contredisaient les unes les autres. Il note les divergences pro-
fondes et les positions irréconciliables entre les matérialistes de l’Antiquité, les
Démocrite et Epicure, avec les platoniciens. Il souligne le fait que Platon a cri-
tiqué ses prédécesseurs et qu’ils (Socrate et Platon) ont été réfutés par Aristote.
Les postcartésiens que furent Spinoza, Malebranche et Leibniz invoquaient
la même raison, et au nom de cette rationalité, ils ont construit des systèmes
métaphysiques antinomiques. Il suffit de se reporter à la Critique de la Raison
Pure pour voir Kant administrer la preuve qu’au nom de la même raison on
peut rigoureusement prouver des thèses adverses. Il n’y a donc pas que la reli-
gion qui divise, la raison aussi provoque des schismes, et croire qu’il suffit de
démonstrations pour amener l’humanité à un “accord des entendements”, selon
la formule de Spinoza, est une belle et dangereuse chimère.
Pourquoi conserver une formule, un concept, une expression que tous
semblent rejeter, pour des raisons différentes, voire opposées ? Car Ghazâli
ne propose en somme de conserver de la philosophie que la logique qui lui
paraît indolore pour la foi, toute la métaphysique des philosophes ne pouvant
conduire qu’à l’athéisme. Ibn Taymiyya va plus loin et porte l’estocade, nous
venons de le voir, même la logique lui paraît sans intérêt puisqu’elle ne fait
rien connaître. Elle ne saurait donc être cet organon que célèbrent les aristo-
téliciens. Ibn Khaldûn veut bien de la logique, mais à condition qu’elle soit
accessible à ceux qu’une foi solide, doublée d’une forte formation théologique,
a prémuni contre les possibles errements. L’unanimité semble se faire contre la
philosophie, sentie comme discipline allogène qui ne trouve pas prise, de sol où
s’enraciner dans l’humus de l’islam.
Or il est un fait indéniable : les philosophies issues de la Grèce, mais
aussi les sagesses de l’Iran ancien et de l’Inde se sont trouvées en contact avec
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
Le problème de la philosophie islamique 221
l’Islam, religion nouvellement révélée. Ces contacts ont tantôt pris la forme
d’une confrontation, de rejet et tantôt de tentatives d’harmonisation devant ce
fait étonnant, ressenti comme tel par les philosophes hellénisants. La raison ne
peut être qu’une, et la raison est un don du Seigneur, comme la foi, de sorte
qu’il leur est apparu pour le moins anormal que la vérité de la foi et la vérité de
la philosophie pussent se contredire, et qu’on aille jusqu’à utiliser l’une contre
l’autre, ou exclure l’une du champ de l’autre. C’est un autre fait que Kindi,
Farabi, Ibn Sîna, Ibn Roschd, des philosophes et des savants éminents, ont
tenté de concilier philosophie et religion. De sorte qu’on peut légitimement se
demander comment ces musulmans qui ne se montrèrent pas rétifs à la philoso-
phie, issue des Grecs, ont pensé les rapports de la philosophie et de la religion.
De ce point de vue, l’averroïsme s’offre comme un terrain de choix pour
l’étude de ces rapports. D’une part, parce qu’il leur a consacré un essai exclusif,
et qu’il reprend la question dans son grand livre La Destruction de la Destruc-
tion et dans d’autres textes plus courts.
Dans le Fasl al-Maqal, Ibn Roschd prend bien soin de préciser qu’à ses
yeux “philosopher n’est rien autre chose que de la considération, la méditation
sur les êtres par où ces êtres sont signes de l’existence de l’Artisan, je veux dire
par où elles sont créées...”. Il ajoute que ce genre de spéculation est autorisée
par la Loi religieuse et qu’il y a dans le Coran des versets innombrables qui
l’accréditent.
Ceux qui s’opposent à la philosophie au motif que des pareilles recherches
sont une innovation blâmable, que la première génération de Musulmans a fort
bien ignoré la logique d’Aristote et s’en est parfaitement porté, Ibn Roschd
réplique en disant qu’il y a d’autres innovations inconnues des premiers musul-
mans et qui ont été retenues, comme par ex le raisonnement juridique.
Par conséquent, il ne faut pas hésiter à se lancer dans la recherche philo-
sophique, en utilisant les instruments de la vraie science, celle de la logique
et de la démonstration syllogistique. Ibn Roschd affirme dans ce traité qu’il
ne saurait y avoir de contradiction entre la foi et la raison, car les aboutissants
de la démonstration syllogistique dans la mesure où ils sont la vérité même
ne sauraient contredire cette autre vérité révélée par Dieu à ses prophètes. La
vraie philosophie concorde avec la vraie foi : C’est la position de principe
qu’adoptera plus tard Malebranche. Ce n’est pas en cautionnant une foi pares-
seuse, en faisant intervenir les dogmes comme un deus ex machina que Ibn
Roschd entent faire coïncider foi et raison, mais, au contraire, en suivant un
chemin plus escarpé, plus périlleux, celui de la démonstration, qu’il entend
prouver de la manière la plus claire l’accord essentiel de la foi et de la raison.
Et la forme la plus élevée, la plus rigoureuse du savoir démonstratif, ce sont les
syllogismes hérités d’Aristote. C’est donc par la conception purement aristoté-
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
222 Omar Merzoug
licienne de la science qu’il entend parvenir à l’accord de la foi et de la raison. Si
l’on y réussit, la foi y gagne, car elle se verra confortée par les résultats d’une
démarche purement rationnelle que ses vérités viendraient couronner.
L’argumentation d’Ibn Roschd est facilitée par deux faisceaux de faits:
d’abord les injonctions du Coran aux êtres humains à se servir de leur raison
pour connaître entre autres le Seigneur des Cieux et de la terre, et secondement
la théorie aristotélicienne de la science. (Aristote ne va comme Platon de l’idée
de la science à l’objet, mais tente de déterminer à quelles conditions le monde
réel est susceptible de science rationnelle). Par conséquent, quand le Coran
demande aux hommes, aux croyants de considérer, de méditer les signes natu-
rels, les objets naturels, le monde et ses merveilles, ses beautés, ses commodités
etc…, cet Aristoteles redivivus qu’est Averroès ne se sent pas en exil, il est
chez lui. Et pour que la conciliation de la foi et de la raison soit possible, Ibn
Roschd se voit contraint de proposer une classification aristocratique de ceux
à qui s’adresse le Livre. Il y a d’abord le peuple à qui il faut proposer la foi du
charbonnier et qui ne comprend rien aux spéculations philosophiques. De ce
point de vue, rien n’est plus étranger à Ibn Roschd que le “rendre la philosophie
populaire” de Diderot. Rendre la philosophie populaire, c’est pour le vulgaire
faciliter les divisions et favoriser les schismes, provoquer des guerres reli-
gieuses et des conflits politiques. Les hommes sont en effet différents, le peuple
n’est sensible qu’aux arguments oratoires ; les théologiens, eux, sont sensibles
aux arguments dialectiques, au sens aristotélicien du terme. Enfin la classe des
philosophes qui eux sont gens d’herméneutique, de démonstration.
Il n’y a donc pas comme beaucoup l’ont pensé une double vérité, mais une
expression multiple et différente d’une seule et même vérité selon la capacité
des gens à l’appréhender. Un peu à la manière de la substance spinoziste qui est
unique mais que chacun de ses modes reflète fidèlement. Le plus intéressant est
que cette façon de voir peut se renforcer par des versets coraniques : “Appelle
à la voie de ton Seigneur par la sagesse et les exhortations courtoises, Dispute
avec eux de la manière la plus convenable” (Coran, XVI, 126). La disparité des
esprits et des facultés font que les vérités philosophiques ne doivent pas lan-
cées sur la place publique et c’est à cette condition que philosophie et religion
peuvent se concilier.
Le second faisceau est le caractère rationnel du Coran. Plus que toute autre
livre révélé, le Coran enjoint aux croyants d’étudier, de faire preuve de raison,
d’utiliser ce don que Dieu leur a fait et qui les élève au rang d’hommes en leur
donnant sur les autres êtres animés une évidente supériorité. Il y a donc un
appel dans le texte coranique à pratiquer la spéculation, à étudier les phénomè-
nes de la nature, animaux, astres, etc. Et d’autre part, les premières sourates
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
Le problème de la philosophie islamique 223
révélées sont empreintes d’un caractère métaphysique qui a frappé nombre de
spécialistes et d’orientalistes.
Il serait par ailleurs tout à fait exagéré, voire fallacieux de prétendre que
les penseurs de l’Islam n’aient pas trouvé dans le Coran de quoi susciter,
nourrir et accompagner leurs métaphysiques. L’idée de l’Etre unique ne leur
vient certainement pas des Grecs qui, c’est une vérité fort connue, ne se sont
jamais élevés à cette idée. “On ne voit aucun système philosophique grec qui
ait réservé le nom de Dieu à un être unique et ait suspendu à l’idée de ce Dieu
le système entier de l’Univers “2. Tout au long de sa prédication, Muhammad,
le prophète de l’Islam, a prêché l’Unicité de Dieu (Tawhîd) et il n’a jamais tran-
sigé sur ce point. Toute la métaphysique de l’Islam procède de cette unicité de
l’Etre premier. Chez Al-Ash’arî (874/935), il y a la formulation de la preuve de
Dieu par l’idée de la Perfection. En s’appuyant sur des versets coraniques (LVI,
59/60) et surtout celui-ci : “Nous avons créé l’Homme d’un morceau d’argile.
Puis nous l’avons fait éjaculation dans un réceptacle solide, puis Nous avons
fait l’éjaculation adhérence. Nous avons fait l’adhérence matière flasque. Nous
avons fait la masse flasque ossature et Nous avons revêtu de chair l’ossature.
Ensuite nous instituâmes une seconde créature. Béni soit Allah, le meilleur des
Créateurs 2 (Coran, XXIII, 12-14), Al Ash’arî entend démontrer l’existence du
Créateur par l’imperfection foncière de la créature. La faiblesse ontologique
de l’homme renvoie à l’idée d’une perfection supérieure. Ainsi que le dira plus
tard Descartes : “Lorsque je fais réflexion sur moi, non seulement je connais
que je suis une chose imparfaite et dépendante d’autrui…mais je connais aussi
en même temps que celui duquel je dépends possède en soi toutes ces grandes
choses auxquelles j’aspire et dont je trouve en moi les idées, non pas indéfi-
niment et seulement en puissance, mais qu’il en jouit en effet actuellement et
infiniment, et ainsi qu’il est Dieu “. La réflexion sur la contingence des êtres
créées, qui n’ont pas leur cause en eux-mêmes, qui ne se sont pas donné l’être,
conduira à conceptualiser la distinction de l’Etre nécessaire et de l’Etre contin-
gent qu’on trouve au fondement de la philosophe d’un al-Farâbî3 ou d’un Ibn
Sîna. On y reconnaît l’une des preuves de l’existence de Dieu, la preuve par la
contingence de l’homme (contingentia hominis). Plus tard, Descartes partira
bien de la contingence, non du monde, mais de l’homme pour rencontrer Dieu :
“Si j’étais indépendant de tout autre et que je fusse moi-même l’auteur de mon
être, certes je ne douterais d’aucune chose, je ne concevrais plus de désirs et
enfin il ne me manquerait aucune perfection, car je me serais donné moi-même
2 Etienne Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, p.40, Vrin, Paris, 1944
3 Notamment dans “ Les opinions des habitants de la Cité vertueuse ”.
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
224 Omar Merzoug
toutes celles dont j’ai en moi quelque idée, et ainsi je serais Dieu”. D’où il
appert que Dieu est bien le dispensateur d’existence.
Ces quelques exemples qu’on peut à l’envi multiplier montrent que les
Musulmans ne pouvaient, quelque héritiers des Grecs que le furent les averroïs-
tes par exemple, philosopher à la manière des Grecs qui, eux, n’étaient pas cap-
tifs du dilemme Raison/Révélation. C’est à l’aune de cette difficulté qu’il faut
juger les penseurs chrétiens, juifs ou musulmans qui eurent, sur ce point précis,
plus de mérite que les Grecs.
cauriensia, Vol. IV, 2009 – 215-224, ISSN: 1886-4945
Vous aimerez peut-être aussi
- Qu'est-Ce Que La Philosophie Islamique - PDFDocument5 pagesQu'est-Ce Que La Philosophie Islamique - PDFمحمد الحاج سالم100% (1)
- Souad Ayada - These - Islam Des TheophaniesDocument615 pagesSouad Ayada - These - Islam Des TheophaniesursidalPas encore d'évaluation
- Sciences religieuses traditionnelles en Islam: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandSciences religieuses traditionnelles en Islam: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Philosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moraleD'EverandPhilosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moralePas encore d'évaluation
- Le livre descendu: Essai d'exégèse coranique, Volume 2D'EverandLe livre descendu: Essai d'exégèse coranique, Volume 2Pas encore d'évaluation
- Sur La Postérité Spirituelle de L Ésotériste René GuénonDocument178 pagesSur La Postérité Spirituelle de L Ésotériste René Guénonludovic1970Pas encore d'évaluation
- Al Farabi - L'Obtention Du BonheurDocument7 pagesAl Farabi - L'Obtention Du BonheurFalcofelix87Pas encore d'évaluation
- Michel Valsan L Investiture Du Cheikh Al Akbar Au Centre SupremeDocument15 pagesMichel Valsan L Investiture Du Cheikh Al Akbar Au Centre SupremeMostafa MenierPas encore d'évaluation
- Éric GEOFFROY, L'Islam Sera Spirituel Ou Ne Sera Pluassr-22587Document4 pagesÉric GEOFFROY, L'Islam Sera Spirituel Ou Ne Sera Pluassr-22587Mohammed GhazalPas encore d'évaluation
- Charles Andre Gilis Tawhid Et JihadDocument5 pagesCharles Andre Gilis Tawhid Et JihadMostafa MenierPas encore d'évaluation
- Mort Et Résurrection en IslamDocument15 pagesMort Et Résurrection en IslamJarls CissePas encore d'évaluation
- Titus Burckhardt Et Lecole TraditionalisteDocument7 pagesTitus Burckhardt Et Lecole TraditionalistePedro GuedesPas encore d'évaluation
- Le Livre de L'ordre Et de La DéfenseDocument53 pagesLe Livre de L'ordre Et de La DéfensekaliyugaaPas encore d'évaluation
- PanenthéismeDocument5 pagesPanenthéismeYacine JFPas encore d'évaluation
- Yawaqit 1 Préface PréambuleDocument13 pagesYawaqit 1 Préface PréambuleWillamy Fernandes100% (1)
- Sur Les Traces de La Religion Pérenne - Frithjof SchuonDocument57 pagesSur Les Traces de La Religion Pérenne - Frithjof SchuonJulien111Pas encore d'évaluation
- Denis GRIL, Esotérisme Contre Hérésie Abd Al-Rahmân Al-Bistâmî Un Représentant de La Science Des Lettres À Bursa.Document14 pagesDenis GRIL, Esotérisme Contre Hérésie Abd Al-Rahmân Al-Bistâmî Un Représentant de La Science Des Lettres À Bursa.Hassan Turini100% (1)
- Au Nom DDocument63 pagesAu Nom DDIABAGATE APas encore d'évaluation
- Cheikh Martin Lings Abu Bakr Siraj Al-DinDocument4 pagesCheikh Martin Lings Abu Bakr Siraj Al-Dinlordbou66Pas encore d'évaluation
- Scuola Normale Superiore: Au-Delà de L'antinomie Modernité Et TraditionDocument544 pagesScuola Normale Superiore: Au-Delà de L'antinomie Modernité Et TraditionAbdelli SamirPas encore d'évaluation
- De La Sécularisation Laïque Par Le Salafisme SéculierDocument28 pagesDe La Sécularisation Laïque Par Le Salafisme Séculierlarochealain100% (1)
- Goldziher Culte Des SaintsDocument50 pagesGoldziher Culte Des SaintsJeroen Vanwymeersch100% (1)
- Aurora Part 1Document12 pagesAurora Part 1kaliyugaaPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument20 pagesExtraitmounir57Pas encore d'évaluation
- Le Degre Ultime de L Heresie Textes SpiDocument11 pagesLe Degre Ultime de L Heresie Textes SpiRadwan KammounPas encore d'évaluation
- Tayeb Chouiref Mufti Et SoufiDocument4 pagesTayeb Chouiref Mufti Et SoufiAshrafHassanmPas encore d'évaluation
- Divin Féminin Et Spiritualité ChiiteDocument7 pagesDivin Féminin Et Spiritualité ChiiteIbrahima SakhoPas encore d'évaluation
- La Dialectique Aristotélicienne Et L'impact de Son Infiltration Dans Les Sciences IslamiquesDocument11 pagesLa Dialectique Aristotélicienne Et L'impact de Son Infiltration Dans Les Sciences IslamiquesryadstreamingPas encore d'évaluation
- Michel Lagarde - Abd Al-Qâdir Al-Jazâ'irîDocument20 pagesMichel Lagarde - Abd Al-Qâdir Al-Jazâ'irîjafarroger100% (2)
- 1822-La Descente Du Christ Aux EnfersDocument21 pages1822-La Descente Du Christ Aux Enferspradier kip100% (1)
- (Etudes Traditionnelles - Islam FR) - Michel Chodkiewicz - Tawajjuh, Rabita Et Nisba Dans La Tariqa NaqshbandiyyaDocument10 pages(Etudes Traditionnelles - Islam FR) - Michel Chodkiewicz - Tawajjuh, Rabita Et Nisba Dans La Tariqa NaqshbandiyyaRoger Mayen100% (1)
- Anqa Phenix KzakhariaDocument16 pagesAnqa Phenix KzakhariaDon MassimoPas encore d'évaluation
- La Fin Des Temps Modernes - La Tariqah ShâdhiliyyahDocument1 pageLa Fin Des Temps Modernes - La Tariqah ShâdhiliyyahzamudioPas encore d'évaluation
- L'adhésion Aveugle Aux Écoles de PenséeDocument15 pagesL'adhésion Aveugle Aux Écoles de PenséenuckcheddyPas encore d'évaluation
- La Comprehension de L'unicité À La Lumiere...Document6 pagesLa Comprehension de L'unicité À La Lumiere...testoPas encore d'évaluation
- Valsan - Remarques Occasionnelles Sur Jeanne D'arcDocument16 pagesValsan - Remarques Occasionnelles Sur Jeanne D'arcMahakala95Pas encore d'évaluation
- Charles Andre Gilis Tawhid Et Ikhlas Chap 9Document5 pagesCharles Andre Gilis Tawhid Et Ikhlas Chap 9Mostafa MenierPas encore d'évaluation
- Station de L'équivalence Entre La Femme Et L'homme Dans Certaines Demeures Divines - Ibn ArabiDocument21 pagesStation de L'équivalence Entre La Femme Et L'homme Dans Certaines Demeures Divines - Ibn Arabibarouk444Pas encore d'évaluation
- Julius Evola Esoterisme Tradition Et PolDocument27 pagesJulius Evola Esoterisme Tradition Et PolJörgPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu Paru Dans La Revue La Tourbe Des Philosophes, N° 24-25 (1983) - Jean Tourniac - Melkitsedeq Ou La Tradition PrimordialeDocument2 pagesCompte-Rendu Paru Dans La Revue La Tourbe Des Philosophes, N° 24-25 (1983) - Jean Tourniac - Melkitsedeq Ou La Tradition PrimordialeRoberto TurciPas encore d'évaluation
- Wahdat Al WujûdDocument21 pagesWahdat Al WujûdRoberto TurciPas encore d'évaluation
- Omar Benissa - A Propos de La FutuwwaDocument9 pagesOmar Benissa - A Propos de La FutuwwaTur111Pas encore d'évaluation
- Le Coran Et L'orientalismeDocument19 pagesLe Coran Et L'orientalismemimoun543100% (1)
- Plotin AugustinDocument5 pagesPlotin AugustinFarahBejiPas encore d'évaluation
- These Rene GuenonDocument14 pagesThese Rene GuenonccshamiPas encore d'évaluation
- Charles-André Gilis - Le Statut Islamique de La FemmeDocument3 pagesCharles-André Gilis - Le Statut Islamique de La Femmebarouk444Pas encore d'évaluation
- Carra de Vaux GhazzaliDocument344 pagesCarra de Vaux GhazzaliAhmed Berrouho100% (2)
- Jean Moncelon - Les Cahiers D'orient Et D'occident No.28Document24 pagesJean Moncelon - Les Cahiers D'orient Et D'occident No.28danielproulx2Pas encore d'évaluation
- La Chute de L'homme À La Lumière Des Textes Fondateurs de L'islam PDFDocument52 pagesLa Chute de L'homme À La Lumière Des Textes Fondateurs de L'islam PDFSalomon AlexandrePas encore d'évaluation
- Rene Guenon - L Ésotérisme Islamique - Cahiers Du SudDocument3 pagesRene Guenon - L Ésotérisme Islamique - Cahiers Du SudAndreea Ciocioman100% (1)
- Mysteres ChristiquesDocument9 pagesMysteres ChristiqueschristellechillyPas encore d'évaluation
- Charles-André Gilis - L'Esprit Universel de L'islamDocument8 pagesCharles-André Gilis - L'Esprit Universel de L'islambarouk444Pas encore d'évaluation
- Interpretations Spirituelles de LalchimiDocument10 pagesInterpretations Spirituelles de LalchimiVince 04100% (1)
- Nasr Eddin Hodja rencontre Diogène: Très-Mirifiques et Très-Edifiantes Aventures du Hodja Nasr EddinD'EverandNasr Eddin Hodja rencontre Diogène: Très-Mirifiques et Très-Edifiantes Aventures du Hodja Nasr EddinPas encore d'évaluation
- Les nouvelles Fourberies de Djeha: (l'autre Nasr Eddin Hodja)D'EverandLes nouvelles Fourberies de Djeha: (l'autre Nasr Eddin Hodja)Pas encore d'évaluation
- L'inimitabilité Du Coran Et de La Sunna Dans La Médecine Préventive Et Les Micro-OrganismesDocument83 pagesL'inimitabilité Du Coran Et de La Sunna Dans La Médecine Préventive Et Les Micro-OrganismesAnthony GhelfoPas encore d'évaluation
- Les Musulmans en Amérique D'avant Christophe ColombDocument8 pagesLes Musulmans en Amérique D'avant Christophe ColombAnthony GhelfoPas encore d'évaluation
- Initiation Aux Sciences Du Hadith PDFDocument70 pagesInitiation Aux Sciences Du Hadith PDFRobert HollowayPas encore d'évaluation
- Averroes - Science Et Foi - Le Problème de La RaisonDocument9 pagesAverroes - Science Et Foi - Le Problème de La RaisonAnthony GhelfoPas encore d'évaluation
- Interpretation Esoterique CoranDocument11 pagesInterpretation Esoterique CoranDIABAGATE A100% (1)
- Théorie Du Développement Moral Chez Lawrence Kohlberg Et Ses Critiques (Gilligan Et Habermas)Document14 pagesThéorie Du Développement Moral Chez Lawrence Kohlberg Et Ses Critiques (Gilligan Et Habermas)Anthony GhelfoPas encore d'évaluation
- Les 3 Portes de La Sagesse, de Charles BrulhartDocument3 pagesLes 3 Portes de La Sagesse, de Charles BrulhartAnthony GhelfoPas encore d'évaluation
- TV LobotomieDocument318 pagesTV LobotomieStéphanie100% (3)
- Husserl I Levy BruhlDocument15 pagesHusserl I Levy BruhltwerkterPas encore d'évaluation
- Cours Autrui PDFDocument18 pagesCours Autrui PDFSouley AliPas encore d'évaluation
- Le Rapport Entre Existence Et EssenceDocument2 pagesLe Rapport Entre Existence Et EssencePierre Frantz PetitPas encore d'évaluation
- Pour Réussir Ses ProjetsDocument2 pagesPour Réussir Ses ProjetsM Yusuf Ali R100% (1)
- Épimé H: Collection Fondée Jean 1-Fyppolite Et Dirigée Par Jean-Luc LvfarionDocument222 pagesÉpimé H: Collection Fondée Jean 1-Fyppolite Et Dirigée Par Jean-Luc LvfarionAndrewReyes100% (1)
- À Propos de Hans BlumenbergDocument12 pagesÀ Propos de Hans BlumenbergAnonymous va7umdWyhPas encore d'évaluation
- Les 3 Questions Selon KantDocument3 pagesLes 3 Questions Selon Kantcamarguari_moiPas encore d'évaluation
- Badiou-Orienter Dans La PenseeDocument255 pagesBadiou-Orienter Dans La Penseeparvizm100% (4)
- Philo AntiqueDocument4 pagesPhilo AntiqueAlain TerrieurePas encore d'évaluation
- Respeth 52 DiaDocument26 pagesRespeth 52 DiaAntonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- La Tragédie Grecque HegelDocument8 pagesLa Tragédie Grecque HegelVladimir ChakibPas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie Sur La NatureDocument7 pagesCours de Philosophie Sur La Naturemgh salahPas encore d'évaluation
- Le Rationalisme Appliqué (Gaston Bachelard)Document219 pagesLe Rationalisme Appliqué (Gaston Bachelard)VGPas encore d'évaluation
- Phénoménologie Et Réalisme 1Document3 pagesPhénoménologie Et Réalisme 1bressolettePas encore d'évaluation
- TL Philosophie Peut On Renoncer A La Verite L Juin 2018Document5 pagesTL Philosophie Peut On Renoncer A La Verite L Juin 2018LinxegubPas encore d'évaluation
- Module 6 - Épistémologie Et Enseignement Des SciencesDocument6 pagesModule 6 - Épistémologie Et Enseignement Des SciencesDavid KientegaPas encore d'évaluation
- مباحث المنهج التداولي ودورها في تحليل الخطاب PDFDocument16 pagesمباحث المنهج التداولي ودورها في تحليل الخطاب PDFHager Kasem100% (1)
- William JamesDocument1 pageWilliam JamesamninemoranPas encore d'évaluation
- Elie During, L'Âme (Résumé)Document4 pagesElie During, L'Âme (Résumé)aminickPas encore d'évaluation
- Pour Une Metaphysique de La Presence - Derrida Leph - 084 - 0451Document12 pagesPour Une Metaphysique de La Presence - Derrida Leph - 084 - 0451Claude SpPas encore d'évaluation
- Mawâni' at Takfir PDF FinalDocument11 pagesMawâni' at Takfir PDF FinalsalifPas encore d'évaluation
- °sommer, Christian - BibliographieDocument64 pages°sommer, Christian - BibliographieAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation
- L'Actualité de L'épistémologie HistoriqueDocument12 pagesL'Actualité de L'épistémologie HistoriquemarcelloluchiniPas encore d'évaluation
- Idéalisme Allemand - WikipédiaDocument8 pagesIdéalisme Allemand - WikipédiaLeynel6 LowePas encore d'évaluation
- Theologie Philosophique Et IntelligenceDocument10 pagesTheologie Philosophique Et IntelligenceAbdl Al-HzrdPas encore d'évaluation
- F. Van Steenberghen - Les Lettres D'étienne Gilson Au P. de Lubac PDFDocument9 pagesF. Van Steenberghen - Les Lettres D'étienne Gilson Au P. de Lubac PDFMarisa La Barbera100% (1)
- Carbone - Le Sensible & L'excédent. Merleau-Ponty & KantDocument29 pagesCarbone - Le Sensible & L'excédent. Merleau-Ponty & Kant2krazedPas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de FranceDocument17 pagesPresses Universitaires de FranceJavier BenetPas encore d'évaluation
- Sermon Sur L Unite Chretienne 2Document7 pagesSermon Sur L Unite Chretienne 2YvesPas encore d'évaluation
- Cours LOG MOD 1Document47 pagesCours LOG MOD 1Amine ElmortadaPas encore d'évaluation